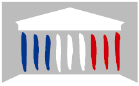N° 2556
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 2010
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le fonctionnement de l’hôpital
ET PRÉSENTÉ PAR
M. Jean Mallot,
Député.
——
INTRODUCTION 9
I.- LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS SUPPOSE D’EN AMÉLIORER L’EFFICIENCE MÉDICO-ÉCONOMIQUE 11
A. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EST MARQUÉE PAR LA RÉDUCTION DE LA DURÉE DES SÉJOURS ET L’AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ AMBULATOIRE 11
1. Le développement de l’hospitalisation ambulatoire s’inscrit dans la tendance générale à la réduction de la durée des séjours hospitaliers 12
a) Le nombre de lits d’hospitalisation complète diminue 12
b) L’hospitalisation partielle continue de se développer 12
2. Chaque année, une personne sur six est hospitalisée dans un service de médecine, chirurgie ou obstétrique 13
a) Les établissements publics de santé représentent deux tiers de l’activité mais la place du secteur privé est importante 13
b) Plus de la moitié des séjours sont des séjours classés en médecine 14
c) Les cliniques représentent près de la moitié des séjours en chirurgie 14
d) L’hospitalisation partielle continue de se développer et le rééquilibrage entre les secteurs est amorcé 15
B. LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ONT ÉTÉ PLACÉS SOUS LA CONTRAINTE DU RETOUR À L’ÉQUILIBRE FINANCIER EN 2012 15
1. La dégradation de la situation financière des hôpitaux publics a été ralentie en 2008 15
a) De 2004 à 2007, la situation financière des hôpitaux publics s’est dégradée 16
b) En 2007, les produits des hôpitaux publics ont augmenté plus fortement que l’année précédente, mais encore moins vite que les charges 17
c) Sous l’impulsion du plan Hôpital 2007, les hôpitaux publics ont réalisé des investissements importants, mais qui ont été surtout financés par l’endettement 18
d) 2008 marque une inversion de la tendance à la dégradation de la situation financière des hôpitaux publics : le déficit global qui représente 1 % des produits a été réduit d’un cinquième, mais près de 40 % des établissements demeurent en déficit 19
e) Les centres hospitaliers régionaux représentent 70 % du déficit 20
f) Par comparaison, le résultat économique et financier des cliniques privées est resté globalement favorable, mais une clinique sur quatre déclare des pertes 23
2. Les établissements, compte tenu de l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) hospitalier, sont contraints de s’adapter pour améliorer leur efficience 25
a) La dépense hospitalière représente 53 % de l’ONDAM et 3,6 % du PIB 25
b) L’objectif de retour à l’équilibre financier de tous les établissements hospitaliers en 2012 était déjà important 25
c) Cet objectif sera plus difficile à atteindre si le rythme de progression de l’ONDAM hospitalier est plus faible 26
d) Le vieillissement de la population pourrait entraîner une augmentation du recours aux soins hospitaliers 27
C. DIVERS TRAVAUX MONTRENT DES ÉCARTS IMPORTANTS DANS LA MOBILISATION DES MOYENS ET LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DES ÉTABLISSEMENTS 28
1. Les disparités dans l’allocation des moyens pour une même activité de soins semblent considérables 28
a) Les moyens mobilisés peuvent aller du simple au triple, voire davantage 28
b) Certaines activités sont très déficitaires 29
c) Tous les établissements étudiés présentent des activités déficitaires 29
2. Les écarts de productivité entre services peuvent être très importants 29
a) Les écarts de coûts de production des soins sont très importants 29
b) Tous les établissements peuvent améliorer leur performance 30
c) Les établissements et services sont confrontés à la difficulté d’adapter les moyens à l’activité 30
II.- AMÉLIORER LE PILOTAGE MÉDICO-ÉCONOMIQUE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS 33
A. LE PILOTAGE STRATÉGIQUE NATIONAL DE LA PERFORMANCE HOSPITALIÈRE DEVRAIT ÊTRE PLUS AFFIRMÉ 33
1. Mettre en place une stratégie nationale de la performance médico-économique dans les établissements hospitaliers 34
a) La réorganisation de l’administration centrale vise à dépasser l’hospitalo-centrisme, favoriser les coopérations et inciter à la performance 34
b) L’administration centrale doit se mobiliser sur le thème de l’efficience médico-économique et définir des priorités nationales 36
c) Mieux préparer et accompagner la mise en œuvre des réformes 37
d) Anticiper les évolutions de l’hôpital 38
2. Renforcer et clarifier l’audit hospitalier 38
a) Clarifier l’organisation de l’audit hospitalier 38
b) Diffuser les référentiels de bonne pratique organisationnelle 42
c) Instituer une obligation d’audit périodique des établissements hospitaliers 43
B. METTRE EN PLACE LES NOUVEAUX INSTRUMENTS DU PILOTAGE RÉGIONAL DE L’EFFICIENCE MÉDICO-ÉCONOMIQUE 43
1. Les agences régionales de santé doivent être fortement mobilisées sur le thème de l’efficience 44
a) L’organisation des agences régionales de santé doit clairement traduire la priorité donnée à l’amélioration de l’efficience médico-économique 44
b) Les agences régionales de santé doivent s’affirmer dans leur rôle d’appui-conseil des établissements hospitaliers 45
2. Les agences régionales de santé doivent assurer un suivi précis des établissements 46
a) Les agences régionales de santé doivent alimenter le dialogue de gestion avec les établissements 46
b) Les agences régionales de santé doivent donner la priorité au redressement des établissements en déficit 46
III.- GÉNÉRALISER LES BONNES PRATIQUES D’ORGANISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 49
A. VEILLER À LA QUALITÉ DE L’ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS ET À L’EFFICIENCE MÉDICO-ÉCONOMIQUE DES PÔLES D’ACTIVITÉ 49
1. Accorder un intérêt accru à la qualité de l’administration des établissements 49
a) Les directeurs d’établissements publics de santé disposent de pouvoirs très larges d’organisation et de gestion 49
b) Mieux former et sélectionner les équipes de direction des établissements hospitaliers 51
c) Veiller aux conditions d’ouverture effective du corps des directeurs d’hôpital 52
d) Renforcer la formation d’adaptation au poste 53
e) Veiller au bon usage de l’intéressement aux résultats 54
2. Mieux associer la communauté médicale au pilotage médico-économique et appuyer la mise en place des pôles d’activité 55
a) Mieux impliquer la communauté médicale dans la définition du projet médical et la gestion des établissements 55
b) Poursuivre la mise en place des pôles en veillant à la mise en place de la délégation de gestion 57
3. Généraliser la mise en place des instruments de pilotage et de gestion 61
a) Généraliser une comptabilité analytique performante permettant de mesurer les coûts de production 61
b) Généraliser la mesure de la performance et mettre en place des tableaux de bord 64
c) Mettre à niveau et rendre interopérables les systèmes d’information hospitaliers 65
d) Inciter les établissements et les pôles à réaliser des audits de performance financiers et de processus 67
e) Préparer la certification des comptes des établissements de santé 68
B. INCITER AUX RÉORGANISATIONS FAVORABLES À LA QUALITÉ DES SOINS ET À L’AMÉLIORATION DE L’EFFICIENCE 68
1. Tirer réellement les conséquences des audits de performance 69
a) Veiller à l’application des conclusions des audits 69
b) Assurer le suivi des préconisations 69
2. Optimiser la permanence des soins et des urgences 70
a) Soulager les urgences hospitalières grâce à la réorganisation territoriale de la permanence des soins en médecine ambulatoire 70
b) Veiller à l’utilisation du levier financier redonné aux agences régionales de santé pour organiser la permanence des soins hospitalière 71
c) Améliorer la prise en charge des usagers aux urgences 71
3. Améliorer la gestion des capacités 72
a) L’application des bonnes pratiques organisationnelles pourrait permettre de gagner, au minimum, 10 % des journées de séjour 72
b) L’application des bonnes pratiques organisationnelles permet d’améliorer la prise en charge des usagers 74
4. Accélérer le développement de la chirurgie ambulatoire et améliorer la gestion des blocs opératoires 75
a) Rattraper le retard en chirurgie ambulatoire 75
b) Améliorer la gestion des blocs opératoires 78
5. Maîtriser les dépenses de médicaments, d’imagerie et d’examens biologiques 79
a) Éviter la surprescription en mettant en place des référentiels 79
b) Regrouper les équipements de biologie et d’imagerie 80
6. Veiller à la pertinence des séjours et des actes et renforcer le contrôle de la qualité et de la sécurité des soins 81
a) Veiller à la pertinence des séjours et des actes 81
b) Assurer la qualité des soins 82
7. Améliorer les politiques d’achats et garantir la sécurité juridique des marchés publics passés par les établissements publics de santé 85
a) Recourir davantage aux groupements d’achats 85
b) Fiabiliser les achats 86
c) Mutualiser les fonctions supports 87
C. SIMPLIFIER LE PARCOURS DU PATIENT ET ASSURER LE RECOUVREMENT DES RECETTES 87
1. Faciliter le parcours de l’usager 87
a) Simplifier le parcours de l’usager dans l’établissement hospitalier 87
b) Mieux s’impliquer dans la prise en charge en amont et en aval de l’hôpital 88
c) Développer la télémédecine 89
2. Favoriser le développement de l’hospitalisation à domicile 90
a) L’hospitalisation à domicile constitue une alternative à l’hospitalisation complète 90
b) Le nombre de places en hospitalisation à domicile est en augmentation sensible 91
c) L’offre de soins d’hospitalisation à domicile reste inégalement répartie sur le territoire 92
d) L’hospitalisation à domicile doit encore être développée 92
3. Fiabiliser la chaîne de facturation-recouvrement 92
a) Favoriser le recouvrement direct des consultations externes 93
b) Expérimenter la facturation directe avant de décider sa mise en oeuvre 94
IV.- CLARIFIER LE FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 97
A. ADAPTER LE MODE DE FINANCEMENT ET MODERNISER LE PATRIMOINE HOSPITALIER 97
1. La tarification à l’activité ne garantit pas l’efficience 97
a) Depuis l’année d’application des tarifs de séjours au taux de 100 %, le déficit des établissements hospitaliers à, de fait, tendance à diminuer 97
b) Le système de financement n’est pas encore stabilisé 97
c) Le nouveau mécanisme de financement ne garantit pas l’efficience 99
d) Le nouveau dispositif ne garantit pas l’accessibilité géographique des soins 100
2. Renforcer l’équité du système de financement pour en faire un levier d’efficience médico-économique 101
a) Veiller à l’équité des financements 101
b) Veiller à la juste couverture des coûts par les tarifs 102
c) Mieux valoriser la qualité des soins pour éviter les dérives dans l’utilisation de la tarification à l’activité 103
d) La question de l’éventuelle convergence des tarifs des secteurs privé et public reste posée 104
e) Le travail de clarification des dotations au titre des missions d’intérêt général doit être poursuivi 107
f) Veiller à la bonne utilisation des aides à la contractualisation 108
g) Mieux valoriser la prise en charge sociale, éducative voire psychologique des patients à l’hôpital et dans leur parcours de soins 109
h) Améliorer la visibilité budgétaire des établissements 109
i) Préparer les prochaines étapes 110
3. Moderniser le patrimoine hospitalier et améliorer sa gestion 111
a) Moderniser le patrimoine hospitalier 111
b) Améliorer la gestion du patrimoine hospitalier 113
B. AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET ANTICIPER LE RENOUVELLEMENT DU PERSONNEL HOSPITALIER 114
1. Améliorer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 115
a) Depuis 1980 les personnels hospitaliers ont augmenté d’un peu plus d’un tiers 115
b) Les praticiens hospitaliers occupent une place importante dans les établissements de santé publics 116
c) Renforcer la gestion prévisionnelle des emplois hospitaliers et des compétences 118
2. Renforcer l’attractivité des carrières à l’hôpital 120
a) Renforcer l’attractivité des carrières médicales 120
b) Améliorer les carrières des personnels non médicaux 121
c) Prendre en compte l’évolution des métiers, favoriser la délégation de tâches et la reconnaissance des nouvelles pratiques 123
3. Améliorer les conditions de travail des personnels hospitaliers et mieux les associer au fonctionnement des établissements 123
a) Mieux prendre en compte les difficultés des métiers pour lutter contre la souffrance au travail 123
b) Mieux associer les personnels hospitaliers aux réformes 124
PRINCIPALES PROPOSITIONS 125
CONTRIBUTION DE MME JACQUELINE FRAYSSE POUR LES MEMBRES DU GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (GDR) 129
TRAVAUX DE LA COMMISSION 131
ANNEXES 143
ANNEXE 1 : UN CAS GRAVE DE DÉRIVE : LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 143
ANNEXE 2 : COMPOSITION DE LA MISSION 179
ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 181
ANNEXE 4 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 185
INTRODUCTION
À la demande de la commission des affaires sociales, la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) s’est penchée sur le fonctionnement de l’hôpital public. Cette réflexion intervient à un moment particulier puisque la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui concerne notamment les établissements hospitaliers, n’est pas encore totalement appliquée, tous les textes devant en préciser les conditions d’application n’ayant pas encore été publiés.
La MECSS qui a concentré son analyse sur les établissements hospitaliers publics a étudié les voies et moyens de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement interne des établissements afin d’améliorer la qualité du service médical rendu aux usagers et leur efficience médico-économique. Elle n’a pas souhaité refaire les débats qui ont eu lieu au moment de l’examen de la loi du 21 juillet 2009 au Parlement ni anticiper sur les conséquences de cette loi, notamment sur l’organisation territoriale des soins.
Le partage et l’application des bonnes pratiques d’organisation lui ont semblé être un levier important pour améliorer le fonctionnement interne des établissements et l’efficience médico-économique.
La Mission a cherché à formuler des propositions en conciliant l’égalité d’accès aux soins, la qualité et la sécurité des soins, dans le respect de l’éthique médicale et de la bientraitance des usagers, dans le cadre de leur parcours global de soins et d’une organisation des prises en charge mieux coordonnée.
Les constats effectués et les propositions avancées pour contribuer à un meilleur fonctionnement de l’hôpital public ont naturellement vocation à s’intégrer dans une démarche plus vaste : à partir de l’énoncé d’une politique de santé publique, de la définition des missions attribuées à chaque acteur du système de santé et de l’organisation territoriale de la prise en charge des patients à chaque étape – de la prévention aux soins – les établissements se voient fixer des objectifs sanitaires et attribuer des moyens financiers.
La MECSS a décidé de commencer ses travaux par l’étude approfondie du cas concret d’un hôpital. Le choix s’est porté sur le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Cet établissement qui est le résultat d’une fusion de deux établissements a pendant plusieurs années réalisé des déficits croissants, au point d’être placé dans une situation financière périlleuse, en raison, notamment, de réorganisations insuffisantes et d’une accumulation de sérieuses défaillances de gestion (graves insuffisances des outils de pilotage, défaut de récupération de recettes, anomalies dans les procédures de marchés publics). Depuis deux ans, la nouvelle équipe dirigeante a inversé la tendance et réduit sensiblement le déficit. La MECSS a entendu les principaux acteurs du centre hospitalier ainsi que les autorités de pilotage et de contrôle pour mieux comprendre les logiques et les causes ayant conduit à cette situation, tout en ayant conscience qu’elle n’est pas représentative de la gestion de tous les établissements hospitaliers.
La Mission a ensuite procédé pendant plusieurs mois à l’audition de la Cour des comptes et des principaux acteurs du monde hospitalier : ministre de la santé et des sports, services ministériels, agences et missions techniques, fédérations d’établissements, directeurs d’établissements publics et d’établissements privés, syndicats des personnels de direction, des praticiens hospitaliers et des personnels non médicaux, associations représentants les usagers, Haute Autorité de santé, Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, École des hautes études en santé publique, Inspection générale des affaires sociales et conseillers généraux des établissements de santé. Elle a également reçu des contributions qui ont alimenté sa réflexion.
Les comptes rendus de l’ensemble des auditions sont présentés en annexe du présent rapport.
Celui-ci tente de prendre la mesure des marges d’amélioration possibles de l’efficience médico-économique (I) et propose de renforcer le pilotage de l’efficience (II), de généraliser les bonnes pratiques d’organisation (III), de clarifier le financement des établissements et enfin d’améliorer la gestion des ressources humaines (IV).
I.- LA RECHERCHE DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS SUPPOSE D’EN AMÉLIORER L’EFFICIENCE MÉDICO-ÉCONOMIQUE
Les établissements de santé jouent un rôle majeur dans la réponse aux problèmes de santé des Français. Fin 2008, on dénombrait 3 040 établissements publics et privés de santé (988 entités juridiques publiques et 2 052 entités géographiques privées). Les effectifs employés sont évalués à 1,2 million de personnes soit plus d’un million en équivalents temps plein. En 2010, l’objectif national des dépenses hospitalières s’élève à 71,2 milliards d’euros.
L’importance de la mission de l’hôpital, qui est de produire un service médical afin d’améliorer la santé des usagers, et le poids des moyens mobilisés justifient l’intérêt porté à l’amélioration du fonctionnement des établissements et à leur efficience médico-économique. L’objectif est d’associer la recherche de la pertinence, de la qualité et de la sécurité maximum des soins à la recherche de la meilleure efficacité économique de leur production. L’amélioration de l’organisation et du fonctionnement interne des établissements doit leur permettre d’améliorer l’efficience médicale et la qualité du service rendu aux usagers. Cette recherche s’inscrit donc dans l’objectif premier d’améliorer la santé des personnes.
Mais la réalisation de cet objectif ne s’oppose pas à l’intérêt des personnels médicaux et non médicaux. Elle nécessite, bien au contraire, d’associer étroitement l’ensemble des personnels dans un dialogue social permanent pour conduire les évolutions nécessaires des établissements en prenant en compte les préoccupations, les difficultés et les attentes des personnels. De ce point de vue, il faudra veiller à ce que les nouvelles dispositions issues de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui renforcent la centralisation du pouvoir dans les établissements publics de santé et dont les conséquences sur la participation de la communauté médicale aux processus de décision devront être évaluées, permettent également au dialogue social de se développer. Car l’amélioration de l’efficience médico-économique des établissements de santé publics et dont les conséquences sur la participation de la communauté médicale aux processus de décision devront être évaluées, dépend, en grande partie, de la qualité de ce dialogue social, de l’attention portée aux personnels ainsi que de leur implication dans une démarche collective et partagée.
A. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EST MARQUÉE PAR LA RÉDUCTION DE LA DURÉE DES SÉJOURS ET L’AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ AMBULATOIRE
L’activité des établissements évolue en fonction des modifications des techniques médicales et des modes de prise en charge des patients. Globalement, il est estimé que le volume d’activité des établissements progresse de 1 % à 1,5 % par an. Par ailleurs, on observe que l’évolution des prises en charge se traduit, à la fois, par une diminution de la durée de séjour, ce qui réduit le besoin en lits ou en journées, et par une augmentation du coût unitaire des prises en charge.
1. Le développement de l’hospitalisation ambulatoire s’inscrit dans la tendance générale à la réduction de la durée des séjours hospitaliers
En 2008, les établissements de santé publics et privés ont enregistré un peu plus de 25 millions d’entrées et venues en hospitalisation complète, c’est-à-dire en principe supérieure à un jour, ou en hospitalisation partielle, de moins de un jour.
a) Le nombre de lits d’hospitalisation complète diminue
En 2008, l’hospitalisation complète représente une capacité totale de 440 000 lits pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation (SSR) ainsi que de soins de longue durée. L’hospitalisation complète représente, pour l’ensemble des disciplines, 12 millions d’entrées et 130 millions de journées.
Capacités et activité des établissements de santé en hospitalisation complète, en 2008
Hospitalisation complète | ||
Nombre de lits |
Nombre d’entrées (en milliers) | |
Médecine, chirurgie, obstétrique |
223 343 |
10 352 |
Psychiatrie |
57 141 |
623 |
Soins de suite et de réadaptation |
97 940 |
931 |
Soins de longue durée |
61 819 |
34 |
Total |
440 243 |
11 941 |
Source : ministère de la santé et des sports.
En 2008, les capacités en hospitalisation complète ont diminué de 8 000 lits par rapport à 2007, soit 1,7 %, mais le nombre d’entrées a augmenté de 0,5 %. La baisse du nombre de lits s’observe dans toutes les disciplines, à l’exception des services de soins de suite et de réadaptation qui bénéficient du transfert de places de soins de longue durée.
b) L’hospitalisation partielle continue de se développer
En 2008, les établissements de santé qui regroupaient 58 500 places d’hospitalisation partielle ont réalisé 13,2 millions de venues. Les capacités d’accueil en hospitalisation partielle sont en augmentation sensible, depuis plusieurs années. Elles ont encore augmenté de 5 % en 2008.
Capacités et activité des établissements de santé en hospitalisation partielle, en 2008
Hospitalisation partielle | ||
Nombre de places |
Nombre de venues (en milliers) | |
Médecine, chirurgie, obstétrique |
23 280 |
5 994 |
Psychiatrie |
27 715 |
5 155 |
Soins de suite et de réadaptation |
7 500 |
2 094 |
Soins de longue durée |
- |
- |
Total |
58 495 |
13 243 |
Source : ministère de la santé et des sports.
Le développement de l’hospitalisation partielle est particulièrement important pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique et pour les services de soins de suite et de réadaptation.
2. Chaque année, une personne sur six est hospitalisée dans un service de médecine, chirurgie ou obstétrique
Chaque année, une personne sur six est hospitalisée dans un service de médecine, de chirurgie ou d’obstétrique. On enregistre ainsi 16 millions d’entrées dans les établissements de santé pour le traitement d’affections relevant de ces disciplines. Cependant, l’activité globale de médecine, chirurgie et obstétrique semble s’être stabilisée en 2008, par rapport à 2007.
a) Les établissements publics de santé représentent deux tiers de l’activité mais la place du secteur privé est importante
S’inscrivant dans le mouvement général, la tendance à la réduction du nombre de lits d’hospitalisation complète en médecine, chirurgie et obstétrique se poursuit.
En 2008, l’hospitalisation complète a représenté un peu plus de dix millions d’entrées. Le nombre de séjours a légèrement augmenté (+ 0,4 %) mais le nombre de journées a un peu diminué (- 0,2 %). La durée moyenne de séjour a été de 5,8 jours. En revanche, la tendance à la diminution du nombre de lits d’hospitalisation complète s’est poursuivie (- 1,4 %).
Évolution du nombre de lits en médecine, chirurgie et obstétrique
Années |
nombre de lits MCO |
1974 |
323 500 |
1978 |
340 000 |
1984 |
319 000 |
1994 |
271 000 |
2006 |
222 000 |
Source : Éco-santé 2010
Le nombre de lits d’hospitalisation complète de médecine, chirurgie et obstétrique a augmenté jusqu’à 1978. L’évolution s’est inversée à partir de 1979. Depuis trente ans, le nombre de lits d’hospitalisation complète en MCO diminue régulièrement, en moyenne de 4 000 lits par an. Il est passé de 340 000 en 1978 à 222 000 en 2006, soit une diminution de 35 %. Cependant, depuis 2003, on note un ralentissement du rythme de la diminution.
Au sein de l’ensemble de l’activité de médecine, chirurgie et obstétrique, le nombre de séjours en hospitalisation complète tend à augmenter en médecine, diminuer en chirurgie et être relativement stable en obstétrique, l’activité de cette dernière discipline étant naturellement lié au nombre de naissances. Dans le secteur public, le nombre de séjours chirurgicaux en hospitalisation complète augmente faiblement depuis 2004 (+ 0,4 % en moyenne annuelle).
Par ailleurs, les établissements publics de santé représentent près des deux tiers des lits et des entrées en médecine, chirurgie et obstétrique, les établissements privés lucratifs près d’un quart et les établissements privés non lucratifs un peu plus de 8 %. Le poids du secteur public en médecine, chirurgie et obstétrique est donc deux fois plus important que celui du secteur privé. Mais, et c’est une des spécificités marquantes du système hospitalier français, le poids du secteur privé est plus important que dans les autres pays développés. Dans certains pays, à la différence de la situation française, l’offre est en quasi-totalité publique (Danemark, Finlande, Norvège, Suède).
Répartition des lits et des séjours en hospitalisation complète en médecine,
chirurgie et obstétrique, en 2008
Nombre de lits |
% |
Nombre d’entrées (en milliers) |
% | |
Établissements Publics |
149 063 |
66,7 % |
6 549 |
63,3 % |
Établissements privés à but non lucratif |
18 495 |
8,3 % |
847 |
8,2 % |
Établissements privés à but lucratif |
55 785 |
25 % |
2 957 |
28,5 % |
Total |
223 343 |
100 % |
10 352 |
100 % |
Source : ministère de la santé et des sports
b) Plus de la moitié des séjours sont des séjours classés en médecine
Près de 55 % des séjours sont classés en médecine, un peu plus d’un tiers sont classés en chirurgie et un sur dix en obstétrique.
Répartition des séjours en médecine, chirurgie et obstétrique, en 2008
Nombre de lits |
% |
Nombre d’entrées (en milliers) |
% |
Nombre de journées (en milliers) |
% | |
Médecine |
115 068 |
51,5 % |
5 650 |
54,6 % |
34 223 |
57,3 % |
Chirurgie |
86 057 |
38,5 % |
3 690 |
35,6 % |
20 683 |
34,6 % |
Obstétrique |
22 218 |
9,9 % |
1 013 |
9,8 % |
4 847 |
8,1 % |
Total |
223 343 |
100 % |
10 352 |
100 % |
59 753 |
100 % |
Source : ministère de la santé et des sports
c) Les cliniques représentent près de la moitié des séjours en chirurgie
La spécificité française relative au poids du secteur privé dans l’offre de soins hospitaliers est accentuée pour les activités de chirurgie. La répartition entre les secteurs est en effet marquée par le poids très important que représentent les cliniques dans l’activité de chirurgie. Ces dernières réalisent un nombre d’entrées plus important (1,76 million d’entrées, soit 47,7 % du total des séjours en chirurgie) que les établissements relevant du secteur public (1,62 million d’entrées, soit 43,9 % des séjours). Au total, les cliniques et les établissements privés à but non lucratif totalisent 56,1 % des séjours de chirurgie. Toutefois, en termes de nombre de journées d’hospitalisation, le secteur public détient une part de l’activité plus importante (53,2 %) que celle des cliniques (38,4 %). Cette différence s’explique – en partie – par le fait que les établissements publics traitent plus de cas lourds qui nécessitent des interventions et des soins post-opératoires plus importants. La durée moyenne de séjour en chirurgie est souvent plus longue dans le secteur public que dans les cliniques.
d) L’hospitalisation partielle continue de se développer et le rééquilibrage entre les secteurs est amorcé
Depuis 2002, l’activité d’hospitalisation partielle s’est fortement développée (+ 8 % par an, en moyenne, de 2002 à 2006). Elle a encore progressé de 2 % en 2008. Cette hausse est entièrement due au développement de la chirurgie ambulatoire. Celle-ci est en plein essor dans le secteur public (+ 13,6 % en 2008) et dans le secteur privé à but non lucratif (+ 11,4 %). Les établissements de santé relevant de ces secteurs ont ainsi augmenté leur poids par rapport aux établissements privés à but lucratif (+ 2,7 %). Mais le secteur privé à but lucratif reste toujours très largement majoritaire dans l’hospitalisation partielle en chirurgie, puisqu’il représente deux tiers des séjours (67 %), les secteurs public et privé non lucratif n’en totalisant encore qu’un tiers.
Ces évolutions d’activité sont notamment liées à la forte augmentation du nombre de places en hospitalisation partielle (+ 7,7 % en 2008), la hausse la plus importante concernant la chirurgie ambulatoire dans le secteur public, où le nombre de places a augmenté de 18,5 % lors de la seule année 2008.
B. LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PUBLICS ONT ÉTÉ PLACÉS SOUS LA CONTRAINTE DU RETOUR À L’ÉQUILIBRE FINANCIER EN 2012
Le président de la République a fixé l’objectif d’équilibre financier pour tous les établissements publics de santé en 2012. La réalisation de cet objectif place nombre d’établissements sous une forte contrainte qui les conduit à améliorer leur efficience, revoir leur organisation et, le cas échéant, à mieux maîtriser, voire à réduire, leurs effectifs, puisque les charges de personnel constituent le principal poste de dépenses. Le rappel de l’évolution de la situation financière des établissements de santé publics permet de prendre la mesure des efforts à produire d’ici 2012.
1. La dégradation de la situation financière des hôpitaux publics a été ralentie en 2008
En 2008, on note, en effet, un début d’inversion de la tendance à la dégradation des comptes des hôpitaux publics observée durant les quatre premières années de mise en œuvre de la tarification à l’activité.
a) De 2004 à 2007, la situation financière des hôpitaux publics s’est dégradée
Selon les données de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), les années 2004 à 2007 ont, en effet, été marquées par la tendance à l’augmentation globale du déficit dans les près de mille (997 en 2007) établissements publics de santé.
En 2007, le déficit des hôpitaux publics s’est élevé à 486 millions d’euros contre 193 millions d’euros, en 2006.
Le déficit constaté en 2007 représente 0,9 % des produits perçus par les établissements publics de santé qui se sont élevés à 59,8 milliards d’euros. Le résultat des établissements publics de santé est passé de + 1 %, en 2004, à – 0,9 %, en 2007.
De 2004 à 2007, la tendance à la dégradation du résultat a été en grande partie imputable à la situation du budget principal des hôpitaux publics. Le déficit de ce budget est passé de 421 millions d’euros, en 2006, à 689 millions d’euros, en 2007. Cependant, cette augmentation a été partiellement compensée par l’excédent du budget annexe de près de 200 millions d’euros, en 2007.
Budget principal et budget annexe
Le budget global hospitalier se compose d’un budget principal et d’un budget annexe. Le budget principal présente les opérations financières relatives aux activités de court et de moyen séjour ainsi que de psychiatrie. Le budget annexe retrace les données financières relatives aux autres activités qui font l’objet d’un financement spécifique, notamment les unités de soins de longue durée (USLD) et les établissements hébergeant des personnes âgées.
De 2004 à 2007, le nombre d’hôpitaux publics en déficit a augmenté chaque année. En 2007, 391 hôpitaux publics étaient déficitaires, soit 39 % des établissements, et totalisaient un déficit de 761 millions d’euros. Les 606 établissements qui étaient à l’équilibre ou excédentaires, soit 61 % des établissements, totalisaient un excédent de 275 millions d’euros.
Les situations étaient très contrastées selon les catégories d’établissements.
Les hôpitaux publics sont répartis en sept catégories
– l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
– les trente autres centres hospitaliers régionaux (CHR) ;
Les centres hospitaliers (CH) qui sont eux-mêmes classés en trois catégories, selon leur taille mesurée à partir de leurs produits :
– les grands centres hospitaliers qui bénéficient d’un financement par l’Assurance maladie de plus de 70 millions d’euros ;
– les moyens centres hospitaliers qui bénéficient d’un financement par l’Assurance maladie compris entre 20 et 70 millions d’euros ;
– les petits centres hospitaliers qui bénéficient d’un financement par l’Assurance maladie de moins de 20 millions d’euros ;
– les hôpitaux locaux (HL) ;
– les centres hospitaliers spécialisés dans la lutte contre les maladies mentales (CHS).
En 2007, vingt-six des trente centres hospitaliers régionaux étaient en déficit. Au total, le déficit des centres hospitaliers régionaux représentait 2,1 % de leurs produits, soit un taux de déficit deux fois plus important que pour l’ensemble des établissements publics de santé. Les grands centres hospitaliers étaient aussi globalement déficitaires de 1,4 %, de même que les centres hospitaliers de taille moyenne de 0,7 %. Seules étaient dans une situation excédentaire les petits centres hospitaliers (+ 0,9 %), les hôpitaux locaux (+ 2,3 %) et les centres hospitaliers spécialisés dans la lutte contre les maladies mentales (+ 0,7 %).
b) En 2007, les produits des hôpitaux publics ont augmenté plus fortement que l’année précédente, mais encore moins vite que les charges
En 2007, les produits globaux des établissements de santé publics ont augmenté de 3,2 %, au lieu de 2,2 %, en 2006.
En 2007, le budget global des établissements de santé publics s’est élevé à 59,8 milliards d’euros. Le budget principal a représenté près de 88 % du budget total du secteur public hospitalier (52,4 milliards d’euros) et le budget annexe 12 % (7,3 milliards d’euros).
La composition du budget principal
Le budget principal des établissements publics de santé est composé de trois groupes de produits et de quatre groupes de charges.
Les groupes de produits sont :
– groupe 1 : les produits versés par l’Assurance maladie ;
– groupe 2 : les autres produits de l’activité hospitalière ;
– groupe 3 : les autres produits ;
Les groupes de charges sont :
– groupe 1 : les charges de personnel ;
– groupe 2 : les charges à caractère médical ;
– groupe 3 : les charges à caractère hôtelier et général ;
– groupe 4 : les charges d’amortissement, de provisions, financières et exceptionnelles
En 2007, les produits versés par l’Assurance maladie ont représenté 43,6 milliards d’euros, soit 82 % du budget principal des établissements publics. Ces produits constituent donc l’essentiel des produits du budget principal, hormis pour les hôpitaux locaux.
Les financements des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), qui ont été attribués par les agences régionales de l’hospitalisation, se sont élevés à 5,7 milliards d’euros, soit 11 % du budget principal des établissements publics. Cependant, près des deux tiers des financements au titre des MIGAC ont été affectés aux centres hospitaliers régionaux. Ils représentaient plus de 20 % des financements versés par l’Assurance maladie à ces établissements contre 10 % pour les centres hospitaliers de grande et moyenne tailles et 7,2 % pour les petits centres hospitaliers. Ces financements ont à nouveau fortement augmenté de 14 %, comme en 2006.
Les autres produits de l’activité hospitalière qui sont à la charge des patients et surtout des organismes complémentaires se sont élevés à 4,1 milliards d’euros, soit 7,7 % des produits du budget principal.
Les autres produits qui comprennent notamment les recettes tirées de la vente de produits fabriqués, les produits financiers et les produits exceptionnels ont représenté 5 milliards d’euros en 2007, soit 10,6 % du budget principal.
En 2007, les charges du secteur public hospitalier se sont élevées à 60,3 milliards d’euros, dont 88 % ont été comptabilisées en budget principal. Comme en 2006, les charges ont progressé plus rapidement (+ 3,7 %) que les produits (+ 3,2 %).
Les charges de personnel qui se sont élevées à 41,7 milliards d’euros, dont 37 milliards d’euros pour le budget principal, ont augmenté de 3,7 %. Elles représentent 69 % du total des charges et sont prépondérantes pour toutes les catégories d’établissements.
Les charges à caractère médical se sont élevées à 7,2 milliards d’euros et ont représenté 13,3 % du budget principal. Elles ont continué d’augmenter fortement, mais sur un rythme encore plus élevé que l’année précédente : + 6,9 % en 2007 contre + 3,2 % en 2006.
Enfin, les charges à caractère hôtelier et général ainsi que les charges d’amortissements et de frais financiers ont augmenté plus modérément, de respectivement + 0,8 % et + 2,1 %.
c) Sous l’impulsion du plan Hôpital 2007, les hôpitaux publics ont réalisé des investissements importants, mais qui ont été surtout financés par l’endettement
Au cours de la période 2002-2007, sous l’impulsion du plan Hôpital 2007, l’effort d’investissement des hôpitaux publics a considérablement augmenté. La part des dépenses d’investissement au sein des recettes générées par l’activité hospitalière est passée de 7,2 %, en 2002 à 10,1 % en 2007 et le rythme de renouvellement des immobilisations s’est accéléré.
Cependant, la capacité d’autofinancement des établissements s’est réduite (de 7,2 % en 2004 à 5,1 % en 2007), une part plus importante des produits étant consacrée aux dépenses courantes. En conséquence, l’endettement des hôpitaux publics a continué d’augmenter. Le taux d’endettement qui mesure la part des dettes au sein des ressources stables est ainsi passé de 33 % en 2002 à 40 % en 2007. L’augmentation de l’endettement a été particulièrement marquée dans les centres hospitaliers régionaux, dont certains se sont lancés dans des programmes d’investissement très importants.
Par ailleurs, la capacité de remboursement des établissements publics de santé s’est aussi fortement dégradée. Ainsi, le ratio d’endettement qui mesure le nombre d’années d’autofinancement nécessaire au remboursement total de la dette est passé de 3,5 années en 2002 à 5,6 années en 2007 (+ 60 %).
d) 2008 marque une inversion de la tendance à la dégradation de la situation financière des hôpitaux publics : le déficit global qui représente 1 % des produits a été réduit d’un cinquième, mais près de 40 % des établissements demeurent en déficit
Selon les données de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation concernant l’ensemble des 1 504 établissements publics de santé et des établissements privés à but non lucratif, en 2008, le déficit total de ces établissements a diminué sensiblement.
Le déficit sur le budget principal est passé de 716 millions d’euros, en 2007, à 592 millions d’euros, en 2008, soit une diminution de 17 %. Il représentait 0,9 % des produits, en 2008, contre 1,14 %, en 2007. Le déficit global a connu une évolution parallèle puisqu’il est passé de 525 millions d’euros à 398 millions d’euros en 2008, soit une diminution de 24 %. Il représente 0,55 % des produits du budget global au lieu de 0,75 % l’année précédente.
Ainsi, le déficit des établissements de santé publics et privés à but non lucratif a été réduit d’environ un cinquième, en 2008. Le maintien de ce rythme de réduction du déficit durant les quatre années suivantes pourrait, en principe, permettre d’atteindre l’objectif de retour à l’équilibre fixé pour 2012. De fait, au regard des marges d’amélioration de l’efficience médico-économique qui existent dans les établissements, l’effort qui leur est demandé pourrait paraître relativement modeste, puisqu’il consiste à réduire le déficit d’environ 100 millions d’euros par an, ce qui représente 0,2 % des produits et de l’ordre de 0,3 % des charges de personnel.
Il faudra néanmoins évaluer aussi l’impact de ces efforts sur les conditions de travail des personnels.
Par ailleurs, à la fin de l’année 2008, sur les 1 504 établissements de santé publics et privés à but non lucratif concernés, 576 étaient en déficit, soit 38 % des établissements, et 928 étaient à l’équilibre ou en situation excédentaire, soit 62 % des établissements. Les établissements déficitaires présentaient un déficit moyen relativement limité puisqu’il s’élevait à 1,5 million d’euros.
Le déficit global des 555 établissements privés à but non lucratif était aussi assez limité puisqu’il s’élevait à 13,5 millions d’euros.
Par ailleurs, la capacité d’autofinancement des établissements s’est sensiblement améliorée en 2008. Les établissements ont aussi moins recouru à l’emprunt pour financer leurs investissements et ont amélioré leur capacité de remboursement.
L’année 2008 a été également marquée par une augmentation plus forte des dépenses d’assurance maladie concernant l’activité en médecine, chirurgie et obstétrique. Cette évolution est liée, pour partie, à la fin de la période de transition dans le financement de ces activités, lesquelles sont, en 2008, pour la première fois, financées par les tarifs à l’activité au taux de 100 %. Auparavant, quand l’activité évoluait, les recettes ne suivaient pas totalement cette évolution puisqu’une partie d’entre elles était encore financée par une dotation complémentaire.
Au total, en 2008, sous l’effet des financements au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation qui ont augmenté de 5,3 %, les recettes versées par l’Assurance maladie aux établissements de santé publics et aux établissements de santé privés à but non lucratif pour financer leurs activités de médecine, chirurgie et obstétrique ont augmenté de 4,4 %. Les dépenses les plus dynamiques ont été les achats de produits pharmaceutiques et de produits à usage médical (ce qui, au passage, soulève la question du coût du médicament à l’hôpital), ainsi que les charges de personnel qui ont augmenté de 3,7 %, comme en 2007.
En 2008, nombre d’établissements ont amélioré leur résultat global, à l’exception des centres hospitaliers régionaux (hors Assistance publique-Hôpitaux de Paris), des hôpitaux locaux et des établissements privés à but non lucratif.
e) Les centres hospitaliers régionaux représentent 70 % du déficit
Globalement, en 2008, la situation des centres hospitaliers régionaux a continué de se dégrader puisque le déficit du budget principal de ces établissements est passé de 392 millions d’euros, en 2007, à 420 millions d’euros, en 2008, soit une augmentation de près de 5 %. Le déficit du budget global, pour ce qui les concerne, est passé de 311 millions d’euros, en 2007, à 357 millions d’euros, en 2008.
Le déficit des centres hospitaliers régionaux représente une part croissante du déficit de l’ensemble des établissements publics et privés à but non lucratif. Cette part est passée de 55 %, en 2007, à 69 %, en 2008.
Encore peut-on rappeler que les CHU remplissent des missions d’intérêt général en matière d’enseignement et de recherche, lesquelles sont financées par des dotations spécifiques (les dotations MIGAC), et qu’ils totalisent le quart des capacités d’hospitalisation et réalisent un séjour d’hospitalisation sur six. En outre, avec la mise en place de la tarification à l’activité, plus la part de l’activité de médecine, chirurgie et obstétrique est importante, plus les établissements sont exposés à la nécessité de s’adapter au changement de mode de financement. Or cette part est relativement plus forte pour les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers universitaires que pour les centres hospitaliers et établissements privés à but non lucratif. Cela explique, au moins partiellement, le poids du déficit et met en évidence les difficultés des CHU à adapter leur organisation en fonction de la nouvelle donne. Au demeurant, il faut reconnaître que la spécialisation dans les activités où les établissements sont les plus efficients, à laquelle incite le nouveau mode de financement, est aussi plus difficile à mettre en œuvre dans les CHU, puisqu’ils ont une vocation généraliste et doivent maintenir une offre de soins polyvalente.
Il reste que près de 70 % du déficit est le fait de vingt-six centres hospitaliers universitaires ou régionaux et 30 % résultent des 1 480 autres établissements.
Or, depuis le début des années 2000, la situation financière des centres hospitalo-universitaires s’est rapidement dégradée. En 2002, huit CHU étaient en déficit, quatorze, en 2005. En 2008, L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et vingt-six centres hospitaliers régionaux sur trente étaient en déficit.
Cependant, les évolutions de la situation financière des établissements restent très contrastées. Plusieurs centres hospitaliers régionaux ont amélioré leur situation, comme ceux de Dijon, Nîmes, Metz-Thionville, Toulouse, Lille, Caen et Nantes. A contrario, la situation financière de certains centres hospitaliers régionaux s’est sensiblement dégradée, notamment ceux implantés à Marseille, à Nancy, à Lyon et à Saint-Étienne. La dégradation dans ces établissements s’explique, pour partie, par les surcoûts d’exploitation d’investissements mal maîtrisés.
En 2009, selon les données arrêtées à la fin du mois de mars 2010, le déficit de l’ensemble des centres hospitaliers universitaires et des centres hospitaliers régionaux s’est stabilisé par rapport à 2008, à 422 millions d’euros. Le déficit de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris s’est sensiblement aggravé, puisqu’il est passé de 21 millions d’euros, en 2008, à 96 millions d’euros, en 2009. Hors Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le déficit des centres hospitaliers universitaires et des centres hospitaliers régionaux est passé de 398 millions d’euros, en 2008, à 326 millions d’euros, en 2009, soit une diminution de 18 %.
Résultats du compte principal des centres hospitaliers régionaux, en 2007, 2008 et 2009
Nom du centre hospitalier régional |
Résultat du budget principal |
Part du résultat dans les produits du budget principal | |||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 | |
AP-Hôpitaux de Paris |
- 40,8 |
- 20,8 |
- 96,2 |
- 0,7 % |
- 0,3 % |
CHU de Strasbourg |
- 15,0 |
- 17,2 |
- 8,1 |
- 2,3 % |
- 2,5 % |
CHU de Bordeaux |
- 1,7 |
- 2,2 |
- 10,6 |
- 0,2 % |
- 0,2 % |
CHU de Clermont-Ferrand |
- 5,9 |
- 5,6 |
- 3,5 |
- 1,4 % |
- 1,2 % |
CHU de Dijon |
- 7,9 |
- 6,9 |
- 1,3 |
- 2,1 % |
- 1,7 % |
CHRU de Brest |
- 5,7 |
- 9,2 |
- 5,3 |
- 1,6 % |
- 2,5 % |
CHU de Rennes |
- 6,5 |
- 7,1 |
- 3,5 |
- 1,3 % |
- 1,4 % |
CHRU de Tours |
- 4,8 |
- 9,6 |
1,4 |
- 1,0 % |
- 1,9 % |
CHR d’Orléans |
- 0,4 |
0,0 |
0,0 |
- 0,2 % |
0,0 % |
CHR de Reims |
- 4,3 |
- 7,5 |
- 6,8 |
- 1,1 % |
- 1,8 % |
CHU de Besançon |
- 2,8 |
- 5,5 |
- 3,8 |
- 0,8 % |
- 1,4 % |
CHU de Nîmes |
- 4,5 |
0,3 |
- 0,5 |
- 1,6 % |
0,1 % |
CHU de Montpellier |
- 1,6 |
- 0,1 |
0,0 |
- 0,2 % |
0,0 % |
CHU de Limoges |
1,1 |
- 3,2 |
- 2,9 |
0,3 % |
- 0,8 % |
CHU de Nancy |
- 18,9 |
- 32,8 |
- 29,9 |
- 3,3 % |
- 5,6 % |
CHU de Metz-Thionville |
- 12,5 |
- 6,1 |
- 6,1 |
- 3,5 % |
- 1,6 % |
CHU de Toulouse |
- 12,2 |
- 3,8 |
0,0 |
- 1,5 % |
- 0,4 % |
CHR de Lille |
- 15,2 |
- 7,5 |
- 3,1 |
- 1,9 % |
- 0,9 % |
CHU Côte de Nacre-Caen |
- 24,8 |
- 13,4 |
- 37,2 |
- 5,9 % |
- 3,0 % |
CHU de Rouen |
- 6,5 |
- 4,7 |
- 0,8 |
- 1,3 % |
- 0,9 % |
CHU de Nantes |
- 31,6 |
- 18,0 |
- 12 |
- 5,4 % |
- 2,7 % |
CHU d’Angers |
- 3,8 |
0,2 |
0,3 |
- 1,1 % |
0,1 % |
CHU d’Amiens |
- 9,8 |
- 6,1 |
- 4,0 |
- 2,4 % |
- 1,4 % |
CHU de Poitiers |
4,0 |
3,5 |
4,7 |
1,1 % |
1,0 % |
CHU de Nice |
- 36,5 |
- 30,7 |
- 20,9 |
- 7,5 % |
- 5,9 % |
AP-Hôpitaux de Marseille |
- 49,8 |
- 58,4 |
- 34,9 |
- 4,9 % |
- 5,5 % |
CHU de Grenoble |
- 6,7 |
- 5,6 |
- 7 |
- 1,3 % |
- 1,0 % |
CHU de Saint-Étienne |
- 8,4 |
- 17,3 |
- 8,6 |
- 2,2 % |
- 4,0 % |
Hospices civils de Lyon |
- 36,6 |
- 94,3 |
- 7,7 |
- 2,6 % |
- 6,7 % |
CHU de Pointe-à-Pitre-Abymes |
- 16,3 |
- 7,1 |
- 16 |
- 6,9 % |
- 2,8 % |
CHU de Fort de France |
- 6,2 |
- 13,2 |
- 30 |
- 2,2 % |
- 4,5 % |
CHU de La Réunion |
- 11,2 |
- 5,6 |
|||
Total |
- 392,5 |
- 420,9 |
- 422,4 |
2,1 % |
- |
Source : plateforme Cabestan de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et Conférence des directeurs généraux de CHU.
En 2009, six centres hospitaliers universitaires ou centres hospitaliers régionaux sur trente-deux sont dans une situation équilibrée ou excédentaire et vingt-six sont en déficit. La plupart des établissements ont amélioré leur résultat. À l’inverse de la tendance générale, quatre établissements ont vu leur situation se dégrader : l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le Centre hospitalier régional de Caen et les centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort de France.
f) Par comparaison, le résultat économique et financier des cliniques privées est resté globalement favorable, mais une clinique sur quatre déclare des pertes
Dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2008, la Cour des comptes rappelle que les cliniques privées ont connu un mouvement de restructuration important depuis un peu plus de dix ans. Ce mouvement a beaucoup moins concerné le secteur public, notamment les CHU qui représentent plus du tiers des dépenses des établissements publics.
Ainsi, entre 1997 et 2006, sur les 276 services de chirurgie qui ont été fermés, 200 ont été fermés dans les cliniques à but lucratif, soit 72 %, et 76 dans les établissements publics. Le nombre de cliniques privées ayant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique est passé de 1 070, en 1998, à 660 en 2005, soit une diminution de près de 40 %. Le plus souvent, les restructurations se sont traduites par la construction d’établissements mono-site plus modernes ayant une capacité supérieure. La taille moyenne des cliniques est ainsi passée de 70 lits, en 1995, à 110 lits, en 2005. Parallèlement, ont été constitués et développés des groupes privés régionaux ou nationaux de cliniques.
La Cour ajoute que les restructurations des cliniques se poursuivent à un rythme soutenu, notamment dans les villes importantes. Les cliniques assurent, en outre, une prise charge croissante des pathologies lourdes (chirurgie cardiaque, orthopédique, digestive…) et exercent une activité de plus en plus concurrentielle vis-à-vis des hôpitaux publics et notamment des CHU.
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques a, de son côté, à partir des déclarations fiscales d’un échantillon de près de 850 sociétés d’exploitation de cliniques privées (sur un total de plus de 1 100), réalisé une étude sur la situation économique et financière de ces cliniques.
En 2007, malgré un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires et une légère baisse des profits, la situation économique et financière des cliniques est restée globalement favorable.
Le chiffre d’affaires des cliniques privées s’est élevé à 11,7 milliards d’euros. Un peu plus de 80 % du chiffre d’affaires des cliniques était réalisé au titre des activités de médecine, chirurgie et obstétrique, pour l’essentiel dans des polycliniques, et un peu moins de 20 % pour les activités de psychiatrie et les soins de suite et de réadaptation.
En 2007, le chiffre d’affaires des cliniques privées a augmenté de 4,4 %, au lieu de 6,7 %, en 2006. La croissance du chiffre d’affaires des grandes cliniques, qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 12 millions d’euros, a été moins dynamique (4,8 % en 2007 au lieu de 9,2 % en 2006) alors que celle concernant les cliniques de taille moyenne (6 à 12 millions d’euros de chiffre d’affaires) et les petites cliniques (moins de 6 millions d’euros) l’a été davantage. Près des deux tiers du chiffre d’affaires sont réalisés par les grandes cliniques.
Par ailleurs, la tendance à l’amélioration de la rentabilité économique des cliniques, mesurée par le rapport du résultat sur le chiffre d’affaires, s’est infléchie depuis 2006. Alors qu’elle avait régulièrement augmenté de 2003 à 2005 (1,3 % en 2003, 2,1 % en 2004 et 3,3 % en 2005), elle est passée de 3,2 %, en 2006, à 3,1 %, en 2007. Elle est ainsi quasiment stabilisée au-dessus de 3 %, depuis trois ans.
En 2007, la moitié des cliniques ont une rentabilité supérieure à ce taux et 10 % ont une rentabilité supérieure à 11 %. Le taux de rentabilité économique est plus élevé dans les petites cliniques (4,7 %) que dans les cliniques de taille moyenne (2,8 %) et les grandes (3 %). Le taux de rentabilité économique des cliniques est aussi plus élevé dans le secteur de la psychiatrie et dans les établissements de soins de suite et de réadaptation que dans le secteur de la médecine, chirurgie et obstétrique.
Cependant, une clinique sur quatre déclare des pertes et la part des cliniques qui déclarent des pertes augmente, puisqu’elle est passée de 23 % en 2006 à 25 % en 2007. En outre, 10 % des cliniques affichent des pertes supérieures à 5 % du chiffre d’affaires.
En 2007, les charges de personnel ont représenté 44 % du chiffre d’affaires des cliniques privées et ont augmenté plus rapidement que le chiffre d’affaires (5 % contre 4,4 %). Encore faut-il rappeler que les rémunérations versées aux médecins sous forme d’honoraires ne sont pas prises en compte dans les charges de personnel des cliniques privées et que sont donc seulement comptabilisées les charges salariales correspondant aux emplois de médecins salariés, lesquels sont très peu nombreux dans les cliniques privées. Par ailleurs, la participation des salariés aux résultats a représenté un demi point du chiffre d’affaires.
La rentabilité financière, calculée par le ratio résultat sur capitaux propres, mesure le revenu que tirent les actionnaires de l’entreprise et permet d’apprécier l’attractivité du secteur en termes d’actionnariat. En 2007, la rentabilité financière des sociétés d’exploitation des cliniques privées s’est élevée à 13,1 %, soit une diminution de un point par rapport à 2006. La rentabilité financière est plus élevée dans les établissements spécialisés dans les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation (17,1 %) que dans les cliniques de médecine, chirurgie et obstétrique (12,2 %).
En 2007, l’effort d’investissement des cliniques privées a représenté 10,7 % du chiffre d’affaires, la capacité d’autofinancement 5,6 % et l’endettement total a représenté 41 % des capitaux permanents.
2. Les établissements, compte tenu de l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) hospitalier, sont contraints de s’adapter pour améliorer leur efficience
a) La dépense hospitalière représente 53 % de l’ONDAM et 3,6 % du PIB
En 2008, la dépense de soins hospitaliers représentait 41 % de la consommation de soins et 3,6 % du produit intérieur brut.
En 2010, l’objectif national des dépenses hospitalières s’élève à 71,2 milliards d’euros et représente 44 % de l’ONDAM.
Mais, si l’on tient compte de la décomposition de l’ONDAM par prescripteurs et donc des dépenses de ville d’origine hospitalière (consommations de soins, médicaments et produits médicaux résultant de prescriptions hospitalières) qui se sont élevées à 14,8 milliards d’euros en 2008, le poids de l’hôpital dans l’ONDAM est près de dix points supérieur, puisqu’il s’élève à 53 %. L’hôpital est donc prescripteur de plus de la moitié des dépenses d’assurance maladie alors que les soins prescrits en ville représentent 38 % de l’ONDAM.
b) L’objectif de retour à l’équilibre financier de tous les établissements hospitaliers en 2012 était déjà important
Le Président de la République a fixé l’objectif de retour à l’équilibre en 2012 de tous les établissements hospitaliers.
C’est un objectif qui ne sera pas facile à atteindre. Sa réalisation en cinq années, sur la période 2008-2012, s’inscrit en effet dans un contexte financier de plus en plus contraint, notamment en raison de la crise économique et financière récente.
En 2010, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) qui s’élève à 162,4 milliards d’euros est en augmentation de 3 % par rapport à 2009. Mais, l’augmentation de l’objectif national des dépenses hospitalières a été fixée à 2,8 %, soit le taux de progression le plus faible depuis dix ans. Il est vrai, si l’on ajoute la ressource supplémentaire liée à l’augmentation de deux euros du forfait hospitalier qui doit être acquitté par les patients et peut être remboursé par les organismes de couverture complémentaire santé, que la progression des ressources des établissements de santé devrait atteindre 3 %.
En 2008, le déficit des établissements de santé publics a été réduit d’environ un cinquième. Le maintien de ce rythme de réduction du déficit durant les quatre années suivantes pourrait permettre d’atteindre l’objectif de retour à l’équilibre fixé pour 2012. Toute la question est de savoir si ce rythme pourra être maintenu.
c) Cet objectif sera plus difficile à atteindre si le rythme de progression de l’ONDAM hospitalier est plus faible
Les perspectives de réduction des déficits publics vont peser sur l’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie et, notamment, sur les financements affectés aux établissements hospitaliers. Il a été envisagé, à l’occasion de la première conférence sur le déficit, organisée le 28 janvier 2010, de ramener le rythme de progression de l’ONDAM hospitalier à environ 2 %, en 2011, au lieu de 2,8 %, cette année.
Si cette hypothèse se confirmait, les établissements seraient contraints d’accentuer et d’accélérer les efforts d’adaptation, de réorganisation et d’amélioration de l’efficience.
À la suite de la première conférence sur le déficit, un groupe de travail a été constitué, sous la présidence de M. Raoul Briet, membre du collège de la Haute Autorité de santé, pour fixer de nouvelles règles permettant d’améliorer le pilotage des dépenses d’assurance maladie et d’assurer le respect de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie. La mission était composée de quinze membres, dont quatre parlementaires. Actuellement, le comité d’alerte se prononce une seule fois, au mois de juin de chaque année, pour assurer la réalisation de l’ONDAM. L’objectif de la mission était de proposer la création de nouveaux outils de maîtrise de la dépense pouvant être mis en œuvre en cours d’année.
M. Raoul Briet a remis son rapport avant la seconde conférence sur le déficit qui a eu lieu le 20 mai 2010.
En 2009, selon les données provisoires publiées par le ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État au début du mois d’avril 2010, les dépenses relevant du champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie ont augmenté de 3,7 % au lieu des 3,3 % prévus par la loi de financement de la sécurité sociale. Pour l’ensemble de l’année 2009, 40 % du dépassement de l’objectif serait lié aux soins de ville et 60 % aux établissements de santé. Les dépenses hospitalières auraient ainsi augmenté de plus de 600 millions d’euros par rapport à l’objectif initial. Selon le ministère cette évolution s’expliquerait notamment par le dynamisme de l’activité hospitalière, dont une part serait liée à l’épidémie de grippe A(H1N1), ainsi qu’à la mise en place de la nouvelle classification des séjours hospitaliers qui rend compte de manière plus exhaustive de l’activité hospitalière.
Cependant, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, a indiqué lors de son audition par la MECSS, que, selon elle, la tendance à la diminution du déficit des établissements hospitaliers, constatée en 2008, devrait se poursuivre en 2009.
Le Président de la République a indiqué à l’issue de la seconde session de la conférence sur le déficit, le 20 mai 2010, que l’objectif de progression de l’ONDAM qui a été fixé à 3,3 % en 2009 et 3 % en 2010 serait fixé à 2,9 % en 2011 et 2,8 % en 2012. Cela confirme l’inflexion de la période récente. Les prochaines lois de financement de la sécurité sociale fixeront la répartition de l’ONDAM entre les sous-objectifs de dépenses, en particulier l’objectif de dépenses hospitalières. À cet égard, le Président de la République a annoncé qu’une fraction des dotations sera mise en réserve en début d’année et sera déléguée au fur et à mesure de la bonne exécution de l’objectif de dépenses d’assurance maladie. Il est aussi prévu de renforcer le pilotage de la dépense d’assurance maladie en donnant au comité d’alerte le droit de se prononcer ex ante sur la construction de l’ONDAM et de formuler dès le 15 avril un premier avis sur l’exécution de l’objectif de l’année précédente. En outre, le seuil de l’alerte, fixé aujourd’hui à 0,75 % sera progressivement abaissé à 0,5 % d’ici 2012-2013.
d) Le vieillissement de la population pourrait entraîner une augmentation du recours aux soins hospitaliers
La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère de la santé et des sports a réalisé, en 2007, une étude pour évaluer les conséquences du vieillissement de la population sur l’évolution de la demande de soins hospitaliers. À partir d’une analyse rétrospective sur la période 1998-2004, trois scénarios d’évolution possibles à l’horizon 2030 ont été étudiés : le statu quo, le maintien des paramètres à leur niveau de 2007 et la poursuite à l’identique des tendances récentes concernant les taux d’hospitalisation, les durées de séjour et les parts d’ambulatoire. Des prévisions d’évolution des pathologies et des traitements ainsi que des modalités d’organisation plus ou moins performante de la prise en charge ont également été prises en compte.
L’analyse rétrospective a montré que le système hospitalier avait fait preuve d’une grande adaptabilité. En effet, en 2004, le volume des soins dispensés était inférieur de 14 % pour l’ensemble de la population et de 10 % pour les personnes âgées à ce qu’on pouvait attendre. Le nombre d’équivalents-journées est passé de 66,7 millions, en 1998 à 58,4 millions, en 2004. Le nombre de journées d’hospitalisation a également diminué, au lieu d’augmenter, comme on aurait pu s’y attendre sous l’effet de l’accroissement et du vieillissement de la population. Cela montre bien que l’évolution de l’hospitalisation ne dépend pas que des modifications structurelles de la population. Les modalités d’organisation et le progrès technique jouent aussi un rôle important.
Les enseignements des projections aboutissent à la même conclusion : les choix organisationnels ont plus d’impact que les facteurs démographiques. Dans le premier scénario, l’effet pur et mécanique de l’accroissement et du vieillissement de la population, à organisation et comportements inchangés, provoquerait un choc sur le système hospitalier. En 2030, le nombre d’équivalents-journées augmenterait de 21 millions, soit une augmentation de 36 %. A contrario, le troisième scénario, fondé sur des hypothèses de diffusion du progrès médical et l’utilisation des modes d’organisation les plus performants, montre que l’organisation des soins et les pratiques qui en découlent pourraient plus que compenser l’effet mécanique de l’accroissement et de vieillissement de la population. Dans ce scénario, le nombre de lits d’hospitalisation complète en 2030 pourrait être de près de 20 % inférieur à celui de 2004, la baisse étant continue sur la période, et le nombre de places en ambulatoire doublerait.
En outre, l’évolution des pathologies liées à l’âge pourrait être très différente de l’évolution constatée actuellement, grâce aux améliorations thérapeutiques, à l’amélioration de la prévention et aux modifications de la prise en charge.
Des stratégies volontaristes et bien articulées de recherche, de prévention et de traitement, adaptées à chaque pathologie et associées à une organisation de l’offre de soins décloisonnée pour fluidifier les parcours de soins, peuvent permettre de contrebalancer les évolutions démographiques.
C. DIVERS TRAVAUX MONTRENT DES ÉCARTS IMPORTANTS DANS LA MOBILISATION DES MOYENS ET LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DES ÉTABLISSEMENTS
1. Les disparités dans l’allocation des moyens pour une même activité de soins semblent considérables
Le rapport annuel sur la sécurité sociale publié par la Cour des comptes, au mois de septembre 2009, met en évidence des disparités importantes dans l’allocation des moyens dans des services hospitaliers exerçant la même spécialité au sein d’une quarantaine d’établissements de tailles différentes. L’étude qui a été menée avec les chambres régionales des comptes et qui concerne la période 2005-2007 porte sur trois spécialités : la pneumologie, la chirurgie orthopédique et la maternité. Elles représentent, en moyenne, un quart des recettes des établissements de l’échantillon.
a) Les moyens mobilisés peuvent aller du simple au triple, voire davantage
Il est tout d’abord souligné la très grande diversité de l’organisation de la production de soins. Il semble même que ni les dispositions réglementaires ni les différents mécanismes de financement qui se sont succédé n’ont eu pour effet de réduire cette diversité d’organisation.
Les écarts dans l’allocation des moyens sont considérables. Selon les services de soins, les effectifs médicaux par lit peuvent varier de 1 à 5 en maternité, de 1 à 8 en chirurgie orthopédique et de 1 à 10 en pneumologie. L’ampleur des écarts concernant les personnels non médicaux est moins importante puisqu’elle est de 1 à 3 ou 4. Les écarts sont du même ordre, c’est-à-dire d’environ 1 à 3, en ce qui concerne le taux d’occupation des lits, la durée moyenne des séjours, le nombre annuel de séjours par lit, la recette par cas traité et la recette moyenne par lit. Il est précisé que ni la taille des établissements ni la qualité de CHU n’expliquent ces écarts. Dans les maternités, ceux-ci ne s’expliquent que partiellement par le niveau de technicité qui s’y attache.
Ces différences montrent que l’allocation des moyens n’est pas toujours optimale. Il semble qu’il y ait, en bien des endroits, des marges de progression. La question de savoir si ces disparités ont des conséquences sur la qualité du service médical rendu méritera néanmoins d’être approfondie.
b) Certaines activités sont très déficitaires
Les écarts des résultats économiques dans les trois activités sont aussi considérables. Certains services génèrent un résultat fortement excédentaire pouvant représenter jusqu’à 40 % des recettes. D’autres services présentent des déficits de la même ampleur. Mais le déficit peut être encore plus important. Il peut représenter jusqu’à 75 % des recettes dans certains services de pneumologie et jusqu’à 100 % dans certains services de maternité.
c) Tous les établissements étudiés présentent des activités déficitaires
En outre les situations sont très contrastées. Alors que l’activité de médecine, chirurgie et obstétrique peut être excédentaire dans un établissement, certaines activités relevant de ce secteur peuvent être déficitaires. Mais, si les trois services peuvent être déficitaires dans un même établissement, dans aucun établissement de l’échantillon en situation d’excédent pour l’ensemble des activités de médecine, chirurgie et obstétrique, les trois activités n’étaient en excédent. Tous les établissements présentent au moins un des trois services en situation de déficit et auraient donc, a priori, des marges de progression.
Les déficits peuvent s’expliquer par une série de facteurs concernant les dépenses et les recettes. Pour rétablir une situation dégradée, il faut agir sur un ensemble de facteurs. Il ne suffit pas, comme cherchent à le faire certains établissements, pôles ou services, d’augmenter le volume d’activité pour faire disparaître le déficit. Il est en général prioritaire de chercher à mieux maîtriser les coûts.
2. Les écarts de productivité entre services peuvent être très importants
a) Les écarts de coûts de production des soins sont très importants
Dans l’échantillon des établissements étudiés, il ressort que pour générer la même recette issue de la tarification à l’activité (T2A), avec le même nombre de journées ou de lits dans la même spécialité, il faut à certains hôpitaux quatre fois plus de médecins qu’à d’autres et jusqu’à quinze fois dans les maternités. Dans les services d’urgences, les écarts concernant les personnels non médicaux vont de 1 à 5 et le coût d’une ligne de garde pour 5 000 passages peut varier de 1 à 12 (de 16 000 euros à 200 000 euros, la moyenne étant de 86 000 euros). Les écarts de coûts de la permanence des soins peuvent être encore plus élevés.
L’exemple du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye montre que les doublons de services, qui peuvent être très coûteux, ne constituent pas en eux-mêmes, des facteurs de qualité des soins.
b) Tous les établissements peuvent améliorer leur performance
Les disparités dans les ratios d’effectifs soignants et non soignants qui expriment la productivité médicale et non médicale sont très importantes entre établissements et entre services d’un même établissement. Le constat général est donc moins celui de l’existence de quelques établissements à gros problèmes que celui de la généralité des marges d’amélioration, certes plus ou moins importantes.
La comparaison avec les moyennes des différentes catégories d’établissements permet de mettre en évidence des situations d’effectifs élevés voire surdimensionnés dans certaines activités des établissements, notamment en raison de défauts d’organisation. Dans les services de chirurgie de l’échantillon, en moyenne, le nombre d’opérations par chirurgien dépasse à peine celui des jours ouvrables. Cela met en évidence le faible niveau d’activité de certains praticiens. En outre, les taux d’occupation des lits sont souvent voisins de 50 % et peuvent même atteindre 25 %. Dans certains services, le nombre de lits est trop important et les effectifs mal adaptés aux besoins.
c) Les établissements et services sont confrontés à la difficulté d’adapter les moyens à l’activité
Les déficits résultent souvent d’une absence d’adaptation ou d’une mauvaise adaptation des moyens à l’évolution des besoins de soins. Des retards dans la réalisation des adaptations ou des prévisions d’activité erronées ou trop optimistes peuvent entraîner des surcoûts importants et durables, notamment liés à des investissements surdimensionnés et qu’il est ensuite difficile de maîtriser. Les cas d’absence d’adéquation à l’évolution de l’activité se retrouvent tout autant dans les établissements ou services implantés en zones rurales où, pour respecter l’égalité d’accès aux soins, il faut maintenir une offre de soins que dans de grands établissements situés dans de grandes agglomérations où l’offre de soins est importante.
Les établissements étudiés montrent des profils d’évolution des personnels assez différents. Après la mise en place de la réduction du temps de travail, certains établissements ont, indépendamment de l’évolution de l’activité, continué d’augmenter les effectifs, tandis que d’autres les ont stabilisés. En outre, l’enquête de la Cour des comptes montre une augmentation importante des dépenses de remplacement, en raison de difficultés de recrutement mais aussi de l’augmentation de l’absentéisme, lequel peut être source de désorganisations et de surcoûts. Or, le coût d’un intérimaire peut être jusqu’à trois fois plus élevé que celui d’un emploi permanent. En outre, les difficultés dans la gestion des présences et des plannings d’activité sont génératrices de stress et sont mal vécues par les personnels.
Cela renvoie notamment à la nécessité d’améliorer la gestion du temps médical afin de pallier certaines insuffisances dans l’organisation du temps de travail des médecins, leur pratique des gardes et astreintes et l’activité libérale de certains d’entre eux. Encore peut-on ajouter que, dans certains cas, la permanence des soins est utilisée comme un moyen d’apporter un complément de rémunération.
La Cour des comptes soulignait, dans son rapport sur les personnels des établissements publics de santé, publié en 2006, que le contrôle des règles relatives à l’exercice d’une activité libérale à l’hôpital, était « difficile », notamment en ce qui concerne la règle prévoyant que la durée de l’activité libérale n’excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. L’ordonnance du 23 février 2010 de coordination avec la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu que le contrat d’activité libérale qui est approuvé par l’agence régionale de santé doit désormais faire l’objet d’un avis du chef de pôle. Cependant, le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de ladite loi a prévu que la commission de l’activité libérale, qui doit être créée dans chaque établissement où s’exerce une activité libérale, doit désormais comprendre un représentant des usagers du système de santé, mais il a supprimé une disposition de l’article R. 6154-11 du code de la santé publique qui donnait à la commission un droit d’accès à toutes les informations utiles à l’exécution de ses missions, notamment aux jours et heures de consultation figurant au tableau général de service prévisionnel établi mensuellement par le directeur de l’établissement public de santé.
Pour sa part, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie estime que, sur la base des travaux réalisés par la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers, l’écart moyen de coût global lié à une inefficience de l’organisation est au moins de 25 %, entre un établissement très performant et les autres.
II.- AMÉLIORER LE PILOTAGE MÉDICO-ÉCONOMIQUE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Dans son rapport annuel sur la sécurité sociale, publié au mois de septembre 2009, la Cour des comptes fait le constat que « le plus souvent, le problème des hôpitaux est moins la quantité de leurs moyens que leur utilisation au bon endroit et au bon moment » et rappelle que la bonne adéquation des moyens aux activités dépend de l’organisation interne des services et des établissements.
La nécessité accrue de maîtriser la progression de la dépense hospitalière et la mise en place de la tarification à l’activité ont, logiquement, conduit les établissements et l’ensemble des décideurs hospitaliers à accorder un intérêt croissant à la recherche de l’efficience médico-économique dans les établissements hospitaliers. Mais l’appropriation du nouveau modèle de financement hospitalier et la prise de conscience de ses impacts sur les établissements n’ont été que très progressives chez les personnels, en particulier chez certains personnels médicaux et de direction. De ce fait, certains établissements ont tardé à procéder aux ajustements et réorganisations qui auraient été nécessaires. La T2A a ainsi permis de révéler des situations déficitaires que l’ancien mode de financement par dotation globale n’avait pas permis de mesurer.
Mais toute recherche d’efficience dans les établissements hospitaliers doit obligatoirement associer la recherche de la pertinence, de la qualité et de la sécurité maximum des soins, ainsi que la recherche de la meilleure efficacité économique de la production des soins. La dimension médicale doit toujours être prioritaire. La mission des établissements hospitaliers reste d’abord et toujours de répondre aux besoins de prise en charge des patients. Les travaux de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale ont été conduits dans cet esprit. L’objectif est bien de rechercher les voies d’amélioration de l’organisation et du fonctionnement des établissements hospitaliers pour leur permettre d’améliorer la qualité des soins.
La réorganisation de l’administration centrale et la mise en place des agences régionales de santé devraient être l’occasion d’améliorer le pilotage de la performance médico-économique des établissements hospitaliers, au niveau national et régional.
A. LE PILOTAGE STRATÉGIQUE NATIONAL DE LA PERFORMANCE HOSPITALIÈRE DEVRAIT ÊTRE PLUS AFFIRMÉ
Au fil du temps, les instruments de pilotage de la politique hospitalière ont évolué. Ils ont été longtemps concentrés au sein des services de l’administration centrale, puis, pour différentes raisons, liées à la technicité croissante des sujets ou à l’évolution des modes de gestion publique, ils ont été partiellement répartis dans des organismes satellites à statuts variables. Ce faisant, l’administration centrale des hôpitaux a connu la même évolution que d’autres administrations, à savoir un certain éclatement des compétences techniques. Plus récemment, les nouvelles orientations décidées à la suite de la révision générale des politiques publiques ont conduit à recentrer les services centraux sur le pilotage de l’ensemble du système de soins, dans une approche décloisonnée réunissant la ville, l’hôpital, le social et le médico-social.
1. Mettre en place une stratégie nationale de la performance médico-économique dans les établissements hospitaliers
La mise en place d’un véritable cadrage national de la stratégie de la performance dans les établissements hospitaliers passe par l’amélioration du pilotage national en la matière, la clarification de l’appui et de l’accompagnement des établissements, ainsi que l’amélioration de la connaissance sur l’activité hospitalière et l’organisation des établissements.
Il est arrivé à la MECSS, au cours des auditions auxquelles elle a procédé, de constater un décalage entre les déclarations des responsables de certains organismes chargés du pilotage et les descriptions fournies par les acteurs de terrain.
a) La réorganisation de l’administration centrale vise à dépasser l’hospitalo-centrisme, favoriser les coopérations et inciter à la performance
Le mouvement de réorganisation de l’administration de l’ensemble du secteur de la santé, initié par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, se concrétise notamment dans l’évolution des services centraux du ministère en charge de la santé. Un décret et un arrêté du 15 mars 2010 prévoient ainsi la transformation de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins en direction générale de l’offre de soins (DGOS). La suppression de la mention de l’hospitalisation dans l’intitulé de la direction marque la volonté de dépasser l’approche hospitalo-centrée des politiques de santé et de promouvoir une stratégie plus globale, incluant la médecine de ville et les professionnels médico-sociaux. La nouvelle direction générale de l’offre de soins est notamment chargée de veiller à la cohérence des politiques d’offre de soins développées dans les champs sanitaire et médico-social, en lien avec la nouvelle direction générale de la cohésion sociale qui a été créée au mois de janvier 2010. L’objectif est de promouvoir le développement des coopérations et des mutualisations entre les acteurs de l’offre de soins.
L’accent est aussi mis sur la promotion de la performance. La sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins a notamment pour mission d’accroître la performance de l’ensemble des acteurs de l’offre de soins, de garantir l’emploi optimal des ressources et l’efficience médico-économique. Elle doit également veiller à l’amélioration de l’efficience des établissements de santé, avec le concours de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, dont elle assure la tutelle.
Par ailleurs, est créé un comité stratégique qui assiste le directeur général dans la définition des orientations stratégiques de l’offre de soins et le suivi de leur mise en œuvre. Il réunit notamment les directeurs de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, du Centre national de gestion, un directeur général d’agence régionale de santé ainsi que, en tant que de besoin, le représentant de tout autre organisme concerné par l’offre de soins. Il serait souhaitable que la compétence du comité stratégique comprenne la performance médico-économique, en particulier hospitalière.
Organisation de la gouvernance hospitalière
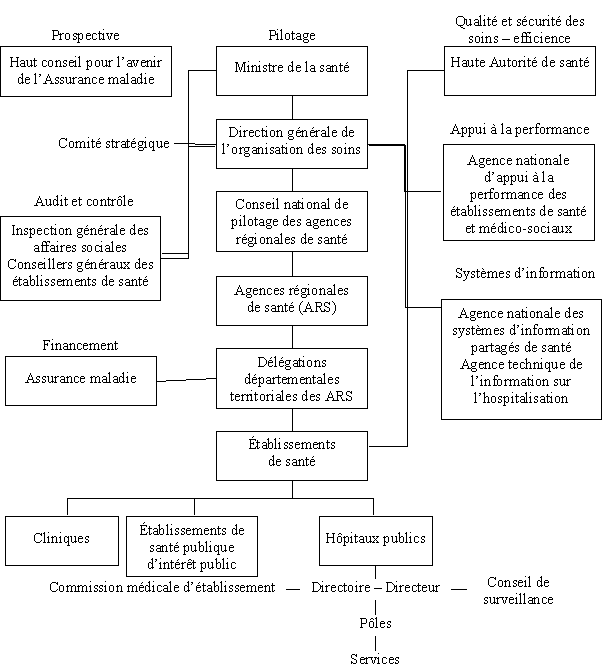
En outre, le pilotage au niveau central est renforcé grâce à la participation de la direction générale de l’offre de soins au conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
b) L’administration centrale doit se mobiliser sur le thème de l’efficience médico-économique et définir des priorités nationales
La nouvelle direction doit s’impliquer clairement et de manière volontariste sur la question des réorganisations internes et l’amélioration du fonctionnement des établissements hospitaliers.
La nouvelle direction générale devrait fixer des objectifs clairs aux agences régionales de santé dans ce domaine, développer les outils permettant une mise en œuvre efficace ainsi que le suivi régulier et l’évaluation des actions conduites par les établissements et les agences régionales de santé, en particulier pour pallier les problèmes structurels liés à l’organisation des services ainsi que favoriser les coopérations et les mutualisations. Il serait également souhaitable que le Gouvernement définisse un plan national d’amélioration de la performance hospitalière qui fixe les grandes orientations et les actions prioritaires à mener. Celui-ci pourrait servir de guide à l’action des agences régionales de santé et des établissements et « nourrir » les contrats d’objectifs et de moyens conclus avec les agences régionales de santé. Un rapport annuel présentant le bilan des réalisations dans les établissements serait annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce document, qui devrait être mis en ligne sous une forme lisible et accessible à tous, compléterait ainsi utilement les quelques indicateurs figurant dans le programme de qualité et d’efficience « maladie », annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Un des chantiers prioritaires devrait être l’adaptation des systèmes d’information hospitaliers et la mise en place généralisée de comptabilités analytiques performantes qui permettent de connaître les coûts de production. Il s’agira aussi de faire preuve de pédagogie pour montrer que les améliorations dans l’organisation peuvent et doivent être sources d’améliorations de la qualité et de la sécurité des soins, et pour faire en sorte que les équipes soignantes s’approprient les réorganisations.
Dans cette logique, l’amélioration de la connaissance sur l’organisation et l’activité des établissements devrait être un chantier prioritaire. Des progrès ont été accomplis ces dernières années concernant certaines données de base sur l’activité des établissements, mais les outils d’information, de suivi et d’analyse de la performance hospitalière méritent d’être encore développés et perfectionnés.
L’Agence technique de l’information hospitalière (ATIH) devrait être mobilisée sur ce sujet. Il faudra toutefois s’assurer que l’infocentre qui doit regrouper des informations sur l’offre de soins ne fasse pas double emploi avec les bases gérées par l’agence.
La nouvelle direction générale de l’offre de soins devrait aussi se mobilier davantage pour améliorer l’information des usagers sur l’hôpital. Une meilleure transparence sur l’activité des établissements et leurs performances permettrait de faciliter l’orientation des patients dans le système hospitalier et d’inciter les établissements à améliorer leur organisation et leur efficience médico-économique. Compte tenu de la tendance à la multiplication des bases de données sur l’hôpital, il faudra procéder à une rationalisation du dispositif afin de fournir aux patients des informations utiles et facilement accessibles. En particulier, devront être publiés un certain nombre d’indicateurs de qualité.
L’animation d’une stratégie de moyen terme de la performance médico-économique hospitalière suppose aussi une bonne articulation entre le programme d’orientations pluriannuel de l’Assurance maladie et son programme de gestion du risque que la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a institué. Ce dernier a notamment pour vocation de promouvoir des actions favorisant l’évolution des pratiques et de l’organisation des établissements de santé, afin de favoriser la qualité et l’efficience des soins.
L’affirmation du rôle stratégique de la nouvelle direction générale de l’offre de soins constitue une évolution qui peut être soutenue. Il conviendra cependant de vérifier que la nouvelle organisation de l’administration centrale a bien pour effet d’améliorer, effectivement, le pilotage d’ensemble et l’efficience médico-économique des établissements.
c) Mieux préparer et accompagner la mise en œuvre des réformes
À ce stade, il faut souligner les difficultés éprouvées par les établissements hospitaliers et les personnels qui les animent pour mettre en œuvre les réformes hospitalières qui se sont succédé depuis une quinzaine d’années. Les modifications prévues par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires vont encore changer la donne. Les établissements vont devoir s’y adapter. 222 décrets d’application doivent être publiés. C’est un ensemble de textes importants que les acteurs hospitaliers doivent lire, comprendre, « digérer » et, ensuite, appliquer avec diligence et le plus intelligemment possible. De nombreux dispositifs et équilibres seront modifiés. Cela peut générer chez les patients et les personnels hospitaliers des incertitudes, des réticences et des peurs, elles-mêmes sources de difficultés, de désorganisations, de perte d’efficacité voire de dégradation de la qualité des soins.
Afin de pallier ces difficultés, outre la demande exprimée par de nombreux représentants d’établissements hospitaliers auditionnés par la Mission d’une pause dans les réformes et d’une stabilisation des règles, l’administration centrale, recentrée sur sa mission de pilotage, devra mettre en place une véritable pédagogie du changement. Celle-ci devrait avoir pour objectif de mettre les réformes en perspectives et de permettre à chacun des acteurs hospitaliers et des patients de les comprendre et de se les approprier. Des progrès sont certainement possibles dans ce domaine et la nouvelle direction générale devrait prendre en compte cette nouvelle orientation. On ne réforme pas l’hôpital sans les soignants et sans les usagers et si, dans le processus de mise en œuvre, des adaptations paraissent nécessaires pour aller à l’objectif partagé, il n’y a pas lieu de les exclure a priori.
d) Anticiper les évolutions de l’hôpital
La direction générale de l’offre de soins pourrait aussi se mobiliser pour organiser la réflexion prospective sur les évolutions à venir de l’hôpital et la question de l’efficience hospitalière. Quelles sont les perspectives d’évolution de l’hôpital d’ici 2020 ou 2030 ? Quel rôle doit jouer l’hôpital dans la prise en charge globale des patients ? Comment améliorer la prise en charge des patients et la performance médico-économique des établissements ? Ces questions devraient faire l’objet d’un débat initié par l’État. Cela serait un moyen de renouveler la démarche des États généraux de l’organisation de la santé. La réflexion pourrait être menée dans le cadre de la Haute Autorité de santé ou du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. Il y a nécessité de débattre, de manière détachée des contingences quotidiennes, pour envisager de nouvelles options, essayer de dégager des consensus et trouver des solutions permettant d’améliorer la qualité du service rendu aux patients, grâce notamment à des progrès dans le fonctionnement des établissements.
2. Renforcer et clarifier l’audit hospitalier
La mission d’évaluation et de contrôle a auditionné un grand nombre d’acteurs du monde hospitalier. Elle a notamment entendu des représentants d’organismes publics chargés du contrôle et de l’amélioration de l’efficience des établissements hospitaliers ou de cabinets privés spécialisés dans l’audit et le conseil en organisation. Cela lui a permis de prendre la mesure de l’importance de l’audit externe pour améliorer les performances médico-économiques des établissements hospitaliers, en particulier de ceux qui sont en situation de déficit.
En cette matière il est possible de progresser. Il faut, d’une part clarifier le panorama des organismes qui participent à l’appui et l’accompagnement des établissements hospitaliers pour améliorer leur fonctionnement, et d’autre part favoriser la diffusion et l’application des référentiels de bonne gestion et de bonne pratique organisationnelle.
a) Clarifier l’organisation de l’audit hospitalier
Même si la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a cherché à simplifier le panorama des organismes qui gravitent autour de la nouvelle direction générale de l’offre de soins, il faudra poursuivre dans ce sens.
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), instituée par l’article 18 de ladite loi, a été officiellement créée le 23 octobre 2009. Son président et son directeur général ont été auditionnés par la MECSS.
L’agence regroupe trois organismes : le Groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier (GMSIH), la Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH) et la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier (MEAH). L’agence a été constituée sous la forme juridique d’un groupement d’intérêt public.
Elle a pour mission :
– l’appui et l’accompagnement des établissements, notamment dans le cadre de missions de réorganisation interne, de redressement, de gestion immobilière ou de projets de recompositions hospitalières ou médico-sociales ;
– l’évaluation, l’audit et l’expertise des projets hospitaliers ou médico-sociaux, notamment dans le domaine immobilier et des systèmes d’information ;
– le pilotage et la conduite d’audits sur la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;
– l’appui aux agences régionales de santé dans leur mission de pilotage opérationnel et d’amélioration de la performance des établissements ;
– l’appui de l’administration centrale dans sa mission de pilotage stratégique de l’offre de soins et médico-social ;
– la conception et la diffusion d’outils et de services permettant aux établissements de santé et médico-sociaux d’améliorer leur performance, en particulier la qualité de leur service aux patients et aux personnes.
L’objectif fixé à l’agence est d’améliorer la performance globale des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Le programme de travail de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux pour 2010
L’agence a fixé dix axes d’action :
– mettre en œuvre des « projets performance » dans cinquante établissements de santé ;
– déployer des organisations performantes en chirurgie ;
– développer une gamme d’outils de performance capitalisant les meilleures pratiques du terrain ;
– accompagner un territoire de santé pour créer un « modèle » de parcours des personnes et de recomposition de l’offre de soins ;
– appuyer la mobilité des professionnels et développer la gestion des ressources humaines ;
– aider les établissements à définir un plan de gestion patrimoniale pluriannuel ;
– accompagner les directions des établissements dans la réussite de leurs projets de système d’information ;
– améliorer la performance de 100 pôles en accompagnant leurs managers ;
– constituer, en liaison avec les agences régionales de santé, un observatoire national de la performance rassemblant l’ensemble des données des établissements ;
– développer le pilotage de la performance dans le secteur médico-social.
Actuellement, l’agence comporte une soixantaine de personnes et l’effectif devrait atteindre quatre-vingts à la fin de l’année 2010. Elle recourt à l’assistance de cabinets de conseil, notamment pour réaliser les actions d’audit et d’accompagnement dans les établissements.
La Haute Autorité de santé est, pour sa part, chargée d’améliorer la qualité des soins dans les établissements de santé, d’élaborer des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique, d’évaluer les pratiques professionnelles et d’assurer la définition et la mise œuvre de la procédure de certification des établissements de santé. La Haute Autorité de santé s’est en outre vu attribuer, depuis 2008, le pouvoir d’émettre, dans le cadre de ses missions, des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescriptions ou de prise en charge les plus efficientes.
L’Agence nationale des systèmes d’information partagés dans les domaines de la santé et du secteur médico-social (ASIP Santé) a été créée, en même temps qu’était annoncée par le Gouvernement la relance du dossier médical personnel, par la transformation du groupement d’intérêt public Dossier médical personnel (GIP-DMP). La nouvelle agence est dotée de compétences élargies. Elle a pour objectif de favoriser le développement de l’ensemble des systèmes d’information de santé et de la télémédecine. Elle doit veiller à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’échanges et de partage des données de santé. Elle peut accompagner les initiatives publiques et privées et attribuer des financements pour les soutenir. L’agence est notamment chargée de la réalisation et du déploiement du dossier médical personnel, de la définition et de l’homologation de référentiels ainsi que de la certification, la production, la gestion et le déploiement de la carte de professionnel de santé. L’agence doit aussi contribuer à améliorer la coordination et la continuité des soins.
Malgré la simplification qu’a apportée la création de l’Agence nationale d’appui à la performance hospitalière, le panorama reste touffu et des chevauchements de compétences et dans les actions opérationnelles menées par les différents organismes ne sont pas exclus.
Afin d’y pallier, l’Agence nationale d’appui à la performance hospitalière a d’ailleurs conclu des conventions de partenariat avec la Haute Autorité de santé, l’Agence nationale des systèmes d’information partagés dans les domaines de la santé et du secteur médico-social et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
L’Inspection générale des affaires sociales et le corps des conseillers généraux des établissements de santé sont deux autres instances publiques qui peuvent effectuer des audits et des contrôles dans les établissements.
L’inspection générale est actuellement placée sous la tutelle de quatre ministres. Certains membres de l’Inspection générale des affaires sociales sont d’anciens directeurs d’hôpitaux. L’activité de l’inspection générale n’est certes pas entièrement consacrée aux établissements hospitaliers. Cependant, près de la moitié des missions réalisées par les membres de l’inspection concernent la santé ainsi que l’administration et la modernisation des services. En outre, la moitié de l’activité de l’Inspection générale des affaires sociales consiste en missions d’audit, de contrôle, d’appui et de conseil. L’inspection effectue régulièrement des missions dans les établissements hospitaliers en difficulté financière ou à l’occasion d’accidents médicaux.
Le corps des conseillers généraux des établissements de santé est essentiellement composé d’anciens directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation et d’anciens praticiens ou directeurs d’hôpitaux. Il a pour mission d’améliorer le fonctionnement et la gestion administrative et financière des établissements hospitaliers et d’assurer des missions d’assistance technique, d’audit et de contrôle de gestion dans les établissements. Son activité est exclusivement consacrée aux établissements hospitaliers.
Les membres de l’Inspection générale des affaires sociales et les conseillers généraux des établissements de santé peuvent assurer l’administration provisoire des établissements publics de santé en difficulté.
Afin de rationaliser les interventions, il a été décidé de rapprocher les conseillers généraux des établissements de santé de l’Inspection générale des affaires sociales, au premier trimestre 2010. L’objectif est de créer un pôle d’inspection, de contrôle, d’évaluation et d’appui en matière de santé et d’organisation des soins. L’inspection générale et les conseillers généraux des établissements de santé pourront ainsi mieux coordonner leurs interventions et harmoniser leurs méthodes et leurs programmes de travail.
Il faudra s’assurer que les accords conclus et les rapprochements en cours permettent effectivement d’éviter le morcellement et l’enchevêtrement des actions menées par les différents acteurs.
Les compétences et les moyens d’expertise, d’audit, d’appui, de conseil et d’accompagnement des établissements hospitaliers pour améliorer leur performance sont d’ores et déjà importants. Ils doivent être mieux structurés, mieux organisés et mieux pilotés. L’objectif doit être d’optimiser l’utilisation de ces compétences et de ces moyens et d’assurer impérativement une coopération efficace entre les différents organismes.
Cependant, compte tenu des enjeux que représentent l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement des établissements hospitaliers, il faudra clarifier les missions des organismes et envisager une nouvelle simplification du dispositif. Il s’agira de faciliter le pilotage d’ensemble de la performance hospitalière, améliorer la lisibilité du dispositif pour les acteurs hospitaliers, développer la réflexion, la recherche et l’intérêt pour les questions d’organisation des établissements, renforcer l’efficacité de l’appui technique et de l’accompagnement pour la mise en œuvre des réorganisations internes et le développement des coopérations avec l’amont et l’aval de l’hôpital.
Par ailleurs, il est souhaitable d’associer les médecins-conseils de l’Assurance maladie à l’appui et au conseil aux établissements en matière d’amélioration de la performance médico-économique. Cela permettra de renforcer les moyens de l’appui et du conseil aux établissements et d’assurer la cohérence des actions conduites par les médecins-conseil dans l’ensemble, décloisonné, de l’offre de soins.
b) Diffuser les référentiels de bonne pratique organisationnelle
Les travaux réalisés par la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers, depuis sa création en mai 2003, dans le cadre du plan Hôpital 2007, sont d’une qualité reconnue. L’organisme qui avait pour mission d’aider les établissements de santé publics et privés à améliorer leur organisation a ouvert des chantiers importants et permis de proposer des solutions pragmatiques pour régler des problèmes concrets auxquels sont souvent confrontés les établissements hospitaliers. La Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers a, en quelques années, mené 1 400 opérations dans plus de six cents établissements. Elle a permis de faire progresser la réflexion sur nombre de sujets comme l’organisation des services d’urgences et la réduction des temps d’attente, l’organisation et la gestion des blocs opératoires, le temps de travail des médecins et d’autres sujets peu explorés comme l’imagerie ou le circuit du médicament.
La mission a publié des guides méthodologiques pour améliorer les organisations : les guides de bonne pratique organisationnelle. Mais ceux-ci ne sont pas toujours connus des dirigeants dans les établissements.
Il convient de donner aux guides de bonne pratique organisationnelle établis par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux le caractère de référentiel opposable et de confier aux agences régionales de santé la mission d’assurer leur diffusion et de veiller à leur application par les établissements, les pôles et les services. Dans cet esprit, la direction générale de l’offre de soins est en train d’élaborer un référentiel opposable sur la gestion du médicament.
Non seulement, comme on l’a dit plus haut, une bonne coordination entre les organismes chargés du pilotage du système hospitalier est nécessaire, mais la diffusion et la mise en œuvre effective des bonnes pratiques organisationnelles devront mobiliser des moyens en personnels spécifiques.
Les savoirs accumulés, tirés des interventions d’appui-conseil et de contrôle menées par les différents acteurs, devront être présentés de manière claire, mis en commun, partagés et accessibles. Cette capitalisation des connaissances et d’apprentissage par l’exemple doit être encouragée et les actions de formation des décideurs et des autres personnels de l’hôpital doivent être développées. En 2008, 4 300 professionnels ont participé aux formations dispensées par la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers sur les thèmes de la gestion de projet et de management du changement. Il faudra naturellement évaluer l’efficacité de ces formations.
c) Instituer une obligation d’audit périodique des établissements hospitaliers
Tout au long des auditions, la Mission d’évaluation et de contrôle a acquis la conviction qu’il y a une nécessité d’apporter un appui extérieur aux établissements pour les aider à mener la réflexion sur leur efficience pour ensuite définir et mettre en œuvre les solutions et les réorganisations les plus adaptées.
Actuellement, les démarches d’amélioration organisationnelle sont décidées par les établissements, le cas échéant avec l’incitation des agences régionales de l’hospitalisation. L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux intervient dans les établissements publics et privés qui le demandent. L’Inspection générale des affaires sociales peut avoir à se pencher sur les questions d’organisation à l’occasion d’action de contrôle ou dans le cadre d’une procédure de redressement, en cas de difficultés financières caractérisées. Des textes réglementaires fixent des seuils de déficit, différents selon les types d’établissement, pour l’élaboration d’un plan de retour à l’équilibre financier.
Il faut être plus volontariste dans la démarche afin de concrétiser, sans tarder, les changements organisationnels susceptibles d’améliorer la qualité du service rendu aux patients ainsi que l’efficience et les conditions de travail du personnel.
À l’avenir, chaque établissement devra pouvoir bénéficier d’un appui personnalisé, périodiquement, par exemple avant le renouvellement du contrat d’objectifs et de moyens conclu avec l’agence régionale de santé, tous les cinq ans, ou en préalable à une révision ciblée concernant l’amélioration de la performance. Cette action pourrait consister en un audit de l’organisation, la définition de préconisations et l’accompagnement de leur mise en œuvre. Dans la mesure où les établissements disposent d’outils de connaissance efficaces sur leur performance médico-économique, les actions d’appui pourraient être ciblées sur les activités le nécessitant. Les établissements connaissant les déséquilibres financiers les plus importants devraient être prioritaires.
Des moyens d’audit et d’appui importants sont disponibles. Il est indispensable de mieux les utiliser dans le cadre d’une démarche plus structurée.
B. METTRE EN PLACE LES NOUVEAUX INSTRUMENTS DU PILOTAGE RÉGIONAL DE L’EFFICIENCE MÉDICO-ÉCONOMIQUE
Les enquêtes de la Cour des comptes et des rapports de missions d’inspection ont notamment établi que les agences régionales de l’hospitalisation n’ont eu qu’une action limitée en matière de performance et d’efficience des établissements de santé. Il faudra que les agences régionales de santé qui vont s’y substituer permettent d’effectuer de réelles avancées dans ce domaine.
La création des agences régionales de santé offre en effet la possibilité d’une rationalisation du système de santé. Les agences ont une compétence très large. Elles doivent piloter la politique de santé partenariale de territoire. Elles sont dotées de pouvoirs importants, notamment en matière de nomination et de révocation des directeurs d’établissement.
1. Les agences régionales de santé doivent être fortement mobilisées sur le thème de l’efficience
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu la mise en place des agences régionales de santé avant le 1er juillet 2010. Le Gouvernement a souhaité anticiper sur cette date butoir et a décidé d’installer les nouvelles agences au début du deuxième trimestre de 2010. Les préfigurateurs des agences ont été nommés au début du mois d’octobre 2009. Ils auront donc disposé de six mois pour définir des axes d’action prioritaires, organiser les services et constituer les équipes. Les agences régionales de santé ont commencé à fonctionner et les directeurs ont été nommés le 1er avril 2010. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des agences régionales de santé seront prochainement conclus et les nouvelles instances d’administration territoriale seront mises en place avant la fin du mois de juin 2010.
a) L’organisation des agences régionales de santé doit clairement traduire la priorité donnée à l’amélioration de l’efficience médico-économique
Les nouvelles agences seront, au moins dans un premier temps, particulièrement mobilisées sur la question de l’amélioration de l’organisation de l’offre de soins. Cette orientation correspond au texte de la loi du 21 juillet 2009. S’agissant des missions, la loi fixe aux agences la mission de contribuer au respect de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie.
Mais la loi ne prévoit l’obligation générale de « garantir l’efficacité du système de santé » que lorsqu’elle traite de l’organisation de l’offre territoriale de soins. Le thème de l’efficience et de la performance des établissements de santé n’est pas mentionné dans le texte.
Or, comme M. Philippe Ritter, président du conseil d’administration de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, l’a indiqué lors de son audition par la MECSS : « Lorsque j’étais à l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France, je me suis rendu compte des lacunes qui existaient : outre que le niveau central n’exerçait aucune pression pour nous pousser à nous intéresser à la performance des établissements, nous n’avions pas les compétences internes suffisantes. »
Désormais, selon M. Philippe Ritter : « Il faudra que les agences régionales de santé acquièrent une culture axée sur la performance. »
Il est proposé de fixer, de manière expresse, dans la loi cet objectif aux agences. L’amélioration de l’efficience des établissements de santé sera ainsi un axe clairement identifié de leur action. Elles devront notamment promouvoir la culture de l’évaluation dans les établissements.
Dans cette logique, l’organisation des agences régionales de santé ainsi que des délégations territoriales qu’elles mettront en place dans les départements devra traduire concrètement la prise en compte de cet objectif.
Les premiers contrats d’objectifs et de moyens des agences régionales de santé, les projets régionaux de santé, qui devront être élaborés à la fin de l’été 2011, et les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens qui seront conclus entre les agences régionales de santé et les établissements de santé publics devront être particulièrement précis sur ce sujet et fixer des objectifs d’amélioration de l’efficience clairs, réalistes et vérifiables, à l’aide d’indicateurs.
Par ailleurs, l’évaluation des directeurs des agences régionales de santé prendra en compte la performance des établissements hospitaliers dont ils assurent le pilotage.
b) Les agences régionales de santé doivent s’affirmer dans leur rôle d’appui-conseil des établissements hospitaliers
Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, créé par la loi du 21 juillet 2009, devra être le lieu de la coordination des agences en matière d’amélioration de l’organisation interne des établissements hospitaliers. Le conseil national devra être le vecteur de diffusion des orientations nationales fixées par le plan national d’amélioration de la performance hospitalière. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens fixeront à chacune des agences des objectifs précis et des actions prioritaires à conduire en matière d’amélioration de l’organisation interne des établissements hospitaliers relevant de leur compétence. Ces objectifs serviront ensuite de base à la conclusion des contrats avec les établissements, laquelle devrait être systématiquement précédée d’un diagnostic préalable précis. Les agences régionales de santé inciteront les établissements à réaliser des analyses de la performance.
Des objectifs devront notamment être fixés aux agences régionales de santé concernant l’organisation de leurs relations avec les intervenants de l’appui-conseil dans les établissements. L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux devra impérativement, comme elle s’y est d’ores et déjà engagée, collaborer de façon très étroite avec les agences régionales de santé. Elle servira de « boîte à outils » pour les agences régionales et leur fournira des référentiels et des méthodes afin qu’elles puissent remplir leurs missions dans les meilleures conditions.
L’organisation d’une bonne collaboration entre l’Agence nationale d’appui à la performance hospitalière et les autres acteurs de l’appui-conseil, mieux pilotés et mieux coordonnés, d’une part, et les agences régionales de santé, d’autre part, constitue un enjeu important pour l’amélioration de l’efficience dans les établissements hospitaliers.
2. Les agences régionales de santé doivent assurer un suivi précis des établissements
Si les agences régionales de santé sont dotées de compétences nettement plus larges que les agences régionales de l’hospitalisation c’est notamment pour assurer un meilleur pilotage régional de l’ensemble de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale régionale. Les agences régionales de santé devront en particulier effectuer un suivi précis de l’exécution des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus avec les établissements.
a) Les agences régionales de santé doivent alimenter le dialogue de gestion avec les établissements
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu que les agences régionales de santé autorisent la création et les activités des établissements de santé. Elles ont également pour mission de contrôler le fonctionnement des activités et d’allouer aux établissements les ressources qui relèvent de leur compétence. Elles peuvent, à ce titre, s’intéresser à la gestion des ressources humaines. Mais cela suppose de mettre en place les outils leur permettant de disposer d’informations fiables et rapides dans ce domaine.
Dans ce cadre ainsi que dans le respect de l’autonomie de gestion des établissements et des pouvoirs propres des directeurs d’établissements pour les organiser, les agences devront entretenir un dialogue de gestion régulier, plus soutenu et plus développé avec les directeurs d’établissements. Elles pourront assurer un suivi trimestriel et précis de la mise en œuvre des engagements prévus dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des établissements en matière d’adaptation de leur organisation et de leur gestion.
Pour alimenter le dialogue de gestion, les agences régionales de santé devront disposer d’outils de suivi et mettre en place un tableau de bord concernant notamment l’efficience médico-économique des établissements de la région et dont les données pourraient être mises en ligne.
b) Les agences régionales de santé doivent donner la priorité au redressement des établissements en déficit
Les agences régionales de santé orienteront prioritairement leur action en direction des établissements qui connaissent une situation financière déséquilibrée.
Les réorganisations et améliorations du fonctionnement interne des établissements doivent contribuer à améliorer la qualité des soins et du service rendu aux patients, mais elles peuvent aussi favoriser le retour à l’équilibre des établissements en déficit. Les agences régionales de santé, doivent, mieux que ne l’ont fait certaines agences régionales de l’hospitalisation, accompagner les établissements dans leurs actions de redressement, en leur offrant notamment l’appui permettant la réalisation des évolutions attendues. L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux concourra à cette action, puisqu’à la demande du gouvernement elle doit réaliser des audits sur les cinquante plus gros établissements déficitaires.
Les agences régionales de santé accorderont une plus grande attention aux établissements en restructuration, notamment en cas de fusion d’établissements. Au risque de paraître énoncer des évidences, la MECSS, à la suite de ses observations et auditions, rappelle que les projets de restructuration ou de fusion doivent faire l’objet d’une étude préalable exigeante. Tout processus de restructuration ou de fusion devrait être précédé d’un audit externe et d’un diagnostic précis. Le projet médical qui doit être la base de toute opération de restructuration ou de fusion devrait toujours être élaboré après une concertation approfondie avec les différents acteurs hospitaliers concernés. Les agences régionales devront assurer un contrôle de la qualité du projet médical et de sa faisabilité. La phase de préparation du projet est en effet essentielle. Elle doit permettre de dégager un consensus sur les orientations et l’organisation future ainsi que sur les conséquences en termes de redistribution des activités et de redéploiement des pouvoirs de direction entre les pôles et les services, voire des établissements, et des personnels.
La question de la faisabilité des réorganisations est un point crucial. La MECSS a pu notamment le constater lorsqu’elle a étudié le cas du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, issu de la fusion de deux centres hospitaliers situés à proximité l’un de l’autre. Le manque de clarté de la démarche de fusion et des objectifs fixés, ainsi que l’absence de consensus réel de la part des personnels ont conduit à des blocages. Chacun défendant son pré carré, les réorganisations prévues n’ont pas été effectuées ou seulement partiellement et avec des retards importants. En l’absence d’actions correctrices efficaces et en raison d’insuffisances multiples de la part des tutelles, cela a contribué à générer des déficits croissants remettant en cause la viabilité même de l’établissement. En outre, l’accumulation de dysfonctionnements peut créer des conditions favorables à l’apparition de dérives importantes de gestion.
Lorsque cela est nécessaire, les agences régionales de santé doivent exiger des établissements en difficulté la mise en place d’actions correctrices rapides, éventuellement avec l’aide de missions d’appui-conseil d’urgence, et ne pas laisser perdurer les déséquilibres.
Il faut également que les agences soient particulièrement vigilantes dans l’attribution des aides financières aux établissements en situation de redressement. Il conviendra de renforcer les conditions d’attribution des aides financières aux établissements en difficulté et de mieux s’assurer que les résultats correspondent aux objectifs fixés. La MECSS a pu constater que ce n’était pas toujours le cas dans le passé. Alors que la marge de manœuvre dont peuvent disposer les agences pour soutenir les établissements dans leurs efforts d’adaptation aux réformes et de retour à l’équilibre financier a été fortement augmentée ces dernières années, il convient d’être particulièrement vigilant sur l’utilisation des aides au redressement attribuées aux établissements.
III.- GÉNÉRALISER LES BONNES PRATIQUES D’ORGANISATION DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
L’amélioration du fonctionnement interne des établissements et de leur efficience médico-économique suppose la mise en place d’organisations plus performantes. Grâce à une meilleure administration des établissements et à une meilleure implication des personnels, les bonnes pratiques d’organisation devraient pouvoir se diffuser dans tous les établissements. Cette démarche devrait s’inscrire dans le cadre de l’organisation territoriale de la santé et de la prise en charge globale et coordonnée de l’usager dans son parcours de soins.
A. VEILLER À LA QUALITÉ DE L’ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS ET À L’EFFICIENCE MÉDICO-ÉCONOMIQUE DES PÔLES D’ACTIVITÉ
1. Accorder un intérêt accru à la qualité de l’administration des établissements
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a renforcé les pouvoirs des directeurs d’établissements publics de santé. Ce changement, pour espérer produire les résultats escomptés, suppose, notamment, de veiller à la qualité du recrutement et des nominations de directeurs.
a) Les directeurs d’établissements publics de santé disposent de pouvoirs très larges d’organisation et de gestion
Le mode d’administration des établissements publics de santé a été modifié à plusieurs reprises depuis une vingtaine d’années. La dernière modification importante a été celle prévue par l’ordonnance du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a modifié, à nouveau, l’organisation institutionnelle interne des établissements. Elle a pour intention de mettre en place un meilleur équilibre entre les pouvoirs administratifs et médicaux et de clarifier les rôles des organes décisionnels.
De fait, la loi du 21 juillet 2009 traduit les préconisations formulées par la commission de concertation sur les missions de l’hôpital, présidée par M. Gérard Larcher. La commission suggérait une organisation centrée sur trois piliers complémentaires : un directeur conforté et responsabilisé, un organe délibérant recentré sur la définition d’orientations stratégiques et un conseil exécutif resserré impliquant fortement les médecins. En d’autres termes, l’objectif était de réaliser une révolution managériale qui permette la création d’un véritable « patron » dans les établissements hospitaliers publics.
Cependant, il convient de rappeler que les établissements publics de santé demeurent des personnes morales de droit public, qu’ils restent dotés de l’autonomie administrative et financière et que leur objet n’est ni industriel ni commercial. L’hôpital public n’est pas une entreprise.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit que les établissements publics de santé sont désormais administrés par un directeur, un conseil de surveillance (qui se substitue au conseil d’administration) et un directoire (qui remplace le conseil exécutif).
Le directeur ne sera plus forcément un fonctionnaire relevant du statut des directeurs d’établissement hospitaliers. Les pouvoirs du directeur sont renforcés, notamment en matière d’organisation interne et de gestion des personnels. En outre, une partie des compétences du conseil d’administration sont transférées au directeur.
Cette évolution s’inscrit dans une tendance amorcée depuis la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. La loi du 21 juillet 2009 prolonge cette tendance et renforce encore les pouvoirs de direction des directeurs d’établissements, au moment où la création du financement à l’activité réduit leur pouvoir d’allocation des moyens budgétaires.
Le renforcement du pouvoir de direction du directeur vient ainsi compenser la modification de son pouvoir financier. Les directeurs sont censés être ainsi davantage des managers dont l’objectif principal est d’optimiser les organisations et de mieux responsabiliser les personnels hospitaliers afin de leur permettre de mieux gérer les activités dont ils ont la charge et de mieux répondre à la demande de soins des usagers.
Le directeur conduit la politique générale de l’établissement. Il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel et dispose d’un pouvoir de nomination, après concertation avec le directoire et dans le respect de l’indépendance et des règles déontologiques des médecins. Pour les personnels de direction et les praticiens hospitaliers, c’est le centre national de gestion qui procède, sauf exceptions, aux nominations. Le directeur conclut le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé. Il décide, conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
En outre, le directeur arrête le projet médical, après avis de la commission médicale d’établissement et « arrête l’organisation interne et signe les contrats de pôles d’activité ». La loi ajoute que les établissements « définissent librement leur organisation interne ». Ainsi, les directeurs disposent d’un large pouvoir en matière d’organisation interne.
Par ailleurs, à défaut d’accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales, il décide de l’organisation du travail et des temps de repos.
Le directoire est présidé par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement en assure la vice-présidence. Le directoire élabore avec le directeur le projet médical d’établissement et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. En outre, il convient de rappeler qu’en cas de déséquilibre financier de l’établissement, le directeur a une pleine responsabilité, en tant que président du directoire, pour établir le plan de redressement et signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Le conseil de surveillance, qui est présidé par un membre représentant les collectivités locales ou les personnalités qualifiées, est centré sur ses compétences en matière de stratégie d’établissement et exerce un contrôle permanent de la gestion. Il délibère sur le projet d’établissement et émet des avis, en particulier sur la politique de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que sur les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. Il conviendra de veiller à ce que les conseils de surveillance, recentrés sur la stratégie d’établissement, jouent pleinement leur rôle et disposent des informations et outils adaptés à leur mission.
Les dispositions réglementaires précisant l’application du nouveau mode d’administration des établissements hospitaliers publics n’ont pas encore été toutes publiées. L’expérience montrera si tous les effets bénéfiques annoncés seront alors bien au rendez-vous et pourront se concrétiser par des améliorations du fonctionnement interne des établissements et l’amélioration de leur efficience médico-économique. Il faudra en particulier s’intéresser aux conséquences qu’aura cette concentration des pouvoirs entre les mains du directeur et aux risques que comporte, pour le bon équilibre de la gestion médico-économique des établissements, la place désormais accordée à la communauté médicale.
b) Mieux former et sélectionner les équipes de direction des établissements hospitaliers
Ainsi, le directeur dispose de pouvoirs propres élargis pour conduire et accompagner la politique de l’établissement dans le cadre du territoire dont il relève. Cette évolution de la gestion hospitalière doit, pour espérer produire les effets positifs attendus, être accompagnée d’un renforcement des capacités managériales des équipes de direction. Le management doit être de plus en plus qualifié et expérimenté pour réaliser les adaptations nécessaires des structures, des organisations, des techniques et des modes de prise en charge ainsi que pour développer des coopérations dans le cadre des territoires de santé.
Afin de répondre aux nouveaux enjeux de la direction des établissements, le Gouvernement a prévu de rénover le statut de ces personnels et de revaloriser la carrière de directeur d’hôpital en mettant en place un nouveau référentiel métier, en améliorant le déroulement de la carrière et en adaptant le régime indemnitaire.
c) Veiller aux conditions d’ouverture effective du corps des directeurs d’hôpital
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a notamment prévu l’ouverture de l’accès aux fonctions de directeur d’établissement hospitalier à des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.
Deux décrets du 11 mars 2010 fixent les nouvelles modalités de sélection et de nomination aux emplois de directeur d’hôpital quand ce n’est pas un directeur de CHU ou de centre hospitalier régional, ces derniers étant nommés directement par le Gouvernement.
Le premier décret prévoit qu’en cas de vacance de poste, un comité de sélection (qui se substitue à la commission des carrières), placé auprès du Centre national de gestion des personnels de direction, effectue d’abord une présélection de six candidats. Le comité de sélection effectue son choix parmi les personnels de direction régis par le statut, les fonctionnaires des autres fonctions publiques inscrits sur une liste d’aptitude établie par le centre ou encore des personnes non fonctionnaires. Le comité propose une liste au directeur du Centre national de gestion et ce dernier arrête la liste définitive. L’agence régionale de santé concernée sélectionne ensuite au moins trois personnes figurant sur cette liste, après avoir auditionné les différents candidats et après avoir recueilli l’avis du président du conseil d’administration ou de surveillance de l’établissement de santé. Puis, le Centre national de gestion nomme un des candidats retenus par l’agence régionale de santé, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Lorsque, par exception, le directeur de l’agence régionale de santé souhaite recruter une personne non fonctionnaire figurant sur la liste de présélection, il procède directement au recrutement par contrat.
Le dispositif retenu donne donc un pouvoir de proposition important au Centre national de gestion et au comité de sélection. Le choix du directeur de l’agence régionale de santé sera limité à la liste des personnes présélectionnées, laquelle ne comportera pas forcément de candidats non fonctionnaires, soit parce qu’il n’y a pas de candidat soit, s’il y en a, parce que le comité n’en aura présélectionné aucun. En outre, le Centre national de gestion conserve le pouvoir de nomination et décide du choix final de la personne à nommer, s’il s’agit d’un fonctionnaire, à partir de la deuxième sélection effectuée par le directeur de l’agence régionale de santé.
Le second décret prévoit que les personnes non fonctionnaires peuvent être nommées pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans et que le montant de la rémunération ainsi que de l’éventuelle attribution d’une partie variable en fonction des résultats d’une évaluation annuelle est fixé par référence aux rémunérations des personnels de direction de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions similaires. Le nombre de recrutements de personnes non fonctionnaires pour occuper un emploi de directeur d’établissement est limité à 10 % des emplois de directeur.
Les deux décrets cherchent à concilier le respect du statut national des personnels de direction d’établissements hospitaliers et la volonté d’ouvrir ces fonctions à des non-fonctionnaires. Il conviendra de vérifier si l’application de ces textes correspond aux objectifs fixés et si ceux-ci permettent effectivement de diversifier les profils de recrutement et à des personnes non fonctionnaires qui ont une bonne connaissance du secteur de la santé, tels que des médecins, de prétendre et d’accéder à des postes de direction d’établissements hospitaliers. Le législateur a considéré que ce pourrait être un moyen efficace de dynamiser et de renouveler certaines équipes de direction. Il a également estimé que ce pourrait être une opportunité pour faire circuler et partager les compétences de bonne gestion d’établissements de santé et pour favoriser les coopérations entre les secteurs, dans une approche territoriale de santé que l’on souhaite promouvoir.
Par ailleurs, un autre décret du 11 mars 2010 prévoit aussi l’application du principe du comité de sélection des candidatures pour pourvoir les autres postes de direction dans les établissements (directeurs-adjoints…).
d) Renforcer la formation d’adaptation au poste
La procédure de sélection des directeurs doit, en principe, permettre de nommer les personnes les mieux à même de réaliser les missions qui leur sont confiées dans un établissement.
Toutefois, la loi du 21 juillet 2009 a prévu que, dans le cadre de sa prise de fonction, le directeur nommé doit suivre une formation adaptée à sa fonction. Cette formation d’adaptation au poste vient compléter la formation dispensée à l’École nationale des hautes études en santé publique, de vingt-sept mois pour les directeurs d’hôpital, et les actions de formation continue.
Le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 précise que la formation doit être adaptée à la mission confiée selon l’emploi détenu et qu’elle doit permettre l’acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions dans l’établissement d’affectation. Le contenu de la formation, qui est axée sur le management, est précisé. Elle concerne notamment la stratégie et la conduite de projets, la gestion des ressources humaines, la gestion financière et budgétaire, la qualité et la gestion des risques, et les systèmes d’information en santé. La formation spécifique destinée aux personnels de direction doit être effectuée pendant la première année d’exercice des fonctions.
Il conviendra d’évaluer, dans les prochaines années, l’efficacité de cette formation d’adaptation au poste. Cette question revêt une importance particulière dans les cas de nominations de directeurs pour effectuer le redressement d’établissements en difficulté. Il est par ailleurs souhaitable que, dans une période exigeante en termes d’adaptation pour tous les établissements de santé, la formation des directeurs d’établissement en matière de management, de conduite du changement et de gestion des ressources humaines soit renforcée. Il faudra aussi favoriser le développement des capacités à mettre en place et faire vivre des coopérations avec d’autres établissements hospitaliers et divers organismes situés en amont et en aval dans le parcours de soins des usagers.
e) Veiller au bon usage de l’intéressement aux résultats
Chaque année, les directeurs d’établissement sont soumis à une évaluation par le directeur de l’agence régionale de santé. Les autres membres du corps des personnels de direction qui sont directeurs adjoints ou directeurs des soins sont évalués par les directeurs d’établissement.
La prime de fonction des directeurs d’hôpital
L’article 2 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements publics de santé prévoit l’attribution d’une prime de fonction. Elle se compose d’une part fixe et d’une part variable.
La part fixe qui variait, en 2007, de 9 500 euros par an pour les directeurs adjoints à 15 000 euros pour les plus hauts emplois de directeurs de CHU est attribuée de manière automatique à tous les personnels de direction. La part variable qui est attribuée par l’autorité d’évaluation peut s’échelonner de 8 500 euros à 20 500 euros. En outre, la part variable peut être modulée de + 20 % à - 20 %, en fonction de la manière de servir et des résultats obtenus.
Selon le rapport annuel d’activité 2008 du Centre national de gestion, en 2007, sur les 2 654 directeurs d’hôpital, 80 % ont bénéficié d’une majoration de la part variable de 11 % à 20 %, 15 % ont bénéficié d’une majoration de 1 % à 10 %, 7 % n’ont pas bénéficié de majoration et 0,6 % a bénéficié d’une part variable minorée de 1 % à 20 %.
L’entretien d’évaluation a pour but de permettre de faire le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et de fixer des objectifs prioritaires pour l’année à venir. L’évaluation est prise en compte pour l’avancement et l’attribution de la part variable de la rémunération. C’est un rendez-vous important qui doit être valorisé et utilisé comme un levier pour mobiliser les équipes de direction des établissements, en particulier sur les objectifs d’amélioration de la performance médico-économique et la conduite des réorganisations internes qui y sont liés. L’évaluation devrait notamment prendre davantage en compte la qualité de la gestion, les résultats économiques et la capacité des directeurs d’établissements à mener à bien les réorganisations internes nécessaires. À cet effet, il serait utile de préciser les critères d’évaluation.
2. Mieux associer la communauté médicale au pilotage médico-économique et appuyer la mise en place des pôles d’activité
L’amélioration de la performance médico-économique des établissements hospitaliers passe par la bonne implication de la communauté médicale dans la gestion des établissements et des pôles.
a) Mieux impliquer la communauté médicale dans la définition du projet médical et la gestion des établissements
La concentration du pouvoir de direction doit être conciliée avec la nécessaire implication d’équipes médicales pleinement responsables.
La loi du 21 juillet 2009 prévoit de recentrer la commission médicale d’établissement sur sa contribution à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que sur les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
La loi prévoit que le président de la commission médicale d’établissement est désormais vice-président du directoire. Il pourra donc, à ce titre, exprimer les souhaits de la communauté médicale. Il coordonne la politique médicale de l’établissement et élabore, avec le directeur d’établissement et dans le respect du contrat d’objectifs et de moyens, le projet médical. En outre, le président de la commission médicale d’établissement partage le pouvoir décisionnel avec le directeur puisqu’il décide, conjointement avec lui, de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. Le président de la commission médicale d’établissement pourra aussi conseiller le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement. Afin de garantir l’exécution du projet médical, il est appelé à donner son avis sur les contrats de pôles médicaux et médico-techniques pour vérifier la cohérence des contrats avec le projet médical. Le président de la commission médicale d’établissement est ainsi appelé à jouer un rôle déterminant dans la conduite de la politique médicale de l’établissement et à assumer des responsabilités renforcées dans la gestion des pôles médicaux et médico-techniques.
Le décret n° 2010-439 du 30 avril 2010 relatif à la commission médicale d’établissement dans les établissements publics de santé s’inscrit dans cette logique de redistribution des rôles entre le président de la commission médicale d’établissement et la commission médicale elle-même. Il étend le champ des sujets sur lesquels la commission médicale d’établissement est consultée. La commission sera désormais consultée sur le projet médical d’établissement mais aussi sur le projet d’établissement, les modifications des missions de service public attribuées à l’établissement, le règlement intérieur de l’établissement, les programmes d’investissement concernant les équipements médicaux, les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social. La commission médicale d’établissement sera en outre tenue informée sur les éléments budgétaires et financiers, le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, le rapport annuel d’activité, les contrats de pôles, le bilan annuel des tableaux de service, le recrutement des emplois médicaux, l’organisation interne de l’établissement et les travaux et aménagements susceptibles d’avoir un impact sur la qualité et la sécurité des soins.
La commission médicale d’établissement contribuera aussi à l’élaboration de la politique et de projets d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, à l’évaluation et à l’amélioration de la prise en charge des usagers, au fonctionnement des urgences et de la permanence des soins ainsi qu’à l’organisation des parcours de soins.
L’association de la communauté médicale aux décisions et à la gestion est indispensable à la bonne marche des établissements. Si la mission des personnels médicaux et paramédicaux est bien la production de soins et la prise en charge des malades, ces personnels ne peuvent se désintéresser des questions d’organisation et d’efficacité médico-économique qui sont désormais inséparables de la prise en charge médicale et de la dispensation des soins.
Le corollaire de l’instauration de la tarification à l’activité est bien la responsabilisation des équipes médicales. Celles-ci ne peuvent pas se reposer ou se défausser des questions d’organisation sur les personnels administratifs et de direction. Elles doivent s’impliquer directement dans la gestion pour améliorer les organisations et la performance des services qu’elles animent. L’évolution des comportements des médecins est essentielle, car elle peut permettre d’adapter les pratiques afin d’en améliorer l’efficience médico-économique.
Cette éthique de la responsabilité de gestion doit être partagée par toutes les parties prenantes de la communauté médicale. Chacun de ses membres doit avoir conscience de la nécessité du bon usage des moyens. D’autant que la tarification à l’activité rend nécessaire de collecter rapidement des données d’activité fiables, ce qui incite les établissements à coder leur activité au plus près des lieux où elle est réalisée.
Comme l’a souligné M. Jacques Métais, qui était directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France au moment de son audition par la MECSS : « Un des avantages de la tarification à l’activité est que, pour la première fois, le système de financement dépend de l’activité médicale de l’établissement – ce qui est la moindre des choses. Or, l’hôpital étant financé selon les pathologies qu’il traite, il importe de connaître précisément ce qu’ont fait les médecins. Le clinicien doit donc fournir un certain nombre d’informations sur le patient qu’il vient de traiter, de la même façon qu’il remplirait une feuille de maladie, par exemple. Le rapprochement peut paraître audacieux, mais il signifie seulement que l’on ne lui demande rien de surhumain : il s’agit de noter le diagnostic d’entrée, le diagnostic de sortie, les actes principaux effectués sur le patient… »
En conséquence, le codage de l’activité hospitalière est de plus en plus géré à la source et les praticiens ont désormais un rôle déterminant à exercer en matière de codage. Cette prise de conscience des personnels doit être favorisée par le développement d’actions d’information et de formation pour expliquer les enjeux des modifications intervenues. Il s’agit de rapprocher les métiers sur un objectif de prise en charge du patient et de faire en sorte que les personnels soignants trouvent eux aussi un intérêt dans la recherche de l’efficience médico-économique. Il est souhaitable de généraliser le codage à la source, « au lit du malade », des séjours et des actes par les professionnels de santé dans les établissements hospitaliers.
Cette responsabilisation des équipes médicales leur permettra d’assurer pleinement et plus facilement l’exercice de leur art en garantissant leur indépendance dans l’exercice de leur activité professionnelle et le respect des règles déontologiques.
Les responsables des établissements hospitaliers et des équipes médicales doivent faire œuvre de pédagogie en ce qui concerne le nouveau cadre de gestion et les enjeux qu’il recouvre auprès des personnels qui participent au fonctionnement des activités. Il s’agit d’un changement culturel profond, même si les préoccupations d’efficacité étaient, bien sûr, déjà présentes, antérieurement aux réformes institutionnelles et financières récentes.
L’adhésion des personnels concernés constitue une condition déterminante pour la mise en place et la réussite de la politique de chaque établissement pour l’amélioration de l’efficience médico-économique et les réorganisations qui peuvent y être liées.
Le cadre des pôles vise à favoriser la réalisation de ce changement culturel et la concrétisation des adaptations à effectuer.
b) Poursuivre la mise en place des pôles en veillant à la mise en place de la délégation de gestion
L’ordonnance du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé a prévu de structurer les hôpitaux en pôles d’activité. L’organisation en pôles correspond à une volonté de déconcentration et de décloisonnement de l’hôpital en vue de favoriser le travail interdisciplinaire et d’améliorer la prise en charge des usagers. L’organisation en pôles vise ainsi à donner plus de souplesse dans les organisations.
L’ordonnance prévoit que les pôles sont constitués par le regroupement d’unités et de services afin d’organiser la mise en cohérence d’activités médicales, médico-techniques, techniques ou administratives. Les pôles sont dirigés par des chefs de pôles qui sont responsables de leur gestion. L’ordonnance prévoyait que les contrats de pôles étaient négociés et signés par le « responsable de pôle » avec le directeur d’établissement. Les pôles devaient être mis en place avant le 31 décembre 2006. Le constat qui peut être dressé est celui de retards dans la mise en œuvre et d’un certain manque d’ambition dans les organisations des pôles qui ont été arrêtées. Cependant, dans les établissements où ils ont été mis en place, les pôles ont produit des effets positifs. Leur mise en place a favorisé l’amélioration de la concertation et des pratiques mais, jusqu’à présent, relativement peu de l’organisation des soins. Les pôles sont en moyenne trois fois moins nombreux que les services qui les ont constitués. Cependant faute d’un cadrage juridique suffisant, notamment en ce qui concerne le pilotage des pôles, le mouvement de création des pôles est resté incomplet et l’efficacité d’ensemble demeure difficile à mesurer.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a maintenu l’organisation en pôles qui est même devenue l’organisation de droit commun. Cependant, cette loi a modifié les dispositions relatives aux « chefs de pôle » et au pilotage des pôles avec l’intention de promouvoir la logique de résultat et de gestion de projet.
C’est désormais le directeur qui définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité, conformément au projet médical d’établissement et après avis de la commission médicale d’établissement. Une dérogation à la création des pôles est toutefois prévue pour les établissements de petite taille.
En outre, la loi renforce le pouvoir du directeur pour la nomination des chefs de pôles. Auparavant, la nomination des chefs de pôles résultait d’une décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement ou, en cas de désaccord, d’une délibération du conseil d’administration. Désormais, les chefs de pôles d’activité clinique ou médico-technique, qui sont dénommés pôles hospitalo-universitaires dans les CHU, sont nommés par le directeur, sur une liste établie par le président de la commission médicale d’établissement. En cas de désaccord, le directeur peut demander une nouvelle liste. En cas de désaccord persistant, le directeur peut nommer la personne de son choix. En outre, les possibilités de recrutement sont élargies, puisque les chefs de pôles d’activité clinique ou médico-technique peuvent être des praticiens contractuels.
Par ailleurs, la loi du 21 juillet 2009 prévoit que le directeur et le chef de pôle signent un contrat de pôle qui, désormais, précise les objectifs ainsi que les ressources humaines et les moyens matériels qui lui sont délégués. Le chef de pôle doit mettre en œuvre la politique de l’établissement pour atteindre les objectifs qui ont été fixés au pôle. Il encadre le pôle et organise son fonctionnement technique et il organise l’affectation des ressources humaines, en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle. Le chef de pôle ne se limite plus à organiser le fonctionnement technique du pôle mais supervise l’ensemble de son fonctionnement.
Ainsi, le rôle du chef de pôle et son autonomie sont renforcés. Le chef de pôle a désormais une autorité fonctionnelle sur les équipes médicales. Les chefs de pôles sont dotés d’une responsabilité très large de gestion. Désormais, ils disposent d’une délégation de gestion pleine et entière.
Il faudra faire en sorte que les modifications récentes du cadre juridique permettent de sécuriser le dispositif et de dépasser le constat actuel du retard dans la mise en place des pôles, même si les situations sont différentes selon les établissements.
L’organisation en pôles visant, notamment, à favoriser la mutualisation des ressources humaines et des moyens techniques, on peut penser que les disparités observées dans la mise en œuvre des pôles expliquent, au moins en partie, les différences de performances médico-économiques des établissements. En effet, la mise en place des pôles conduit, le plus souvent, les équipes qui les animent à s’interroger, de manière collective, sur la rationalisation de l’organisation de leurs activités. Elle devrait donc favoriser le recours à des actions d’appui et de conseil. La mise en place des pôles constitue l’occasion de développer les audits de processus, de qualité et d’efficience. Elle devrait aussi constituer un levier pour inciter aux réorganisations et à la recherche de l’amélioration de la qualité du service et de l’efficience.
Le potentiel d’amélioration que représente la création des pôles n’est pas encore pleinement réalisé. Les directeurs d’établissement et les commissions médicales d’établissements doivent poursuivre, avec volontarisme, leur mise en place. Cependant, les directeurs devront veiller à ce que ne se reconstituent pas de nouvelles féodalités à l’intérieur des établissements de nature à bloquer les évolutions nécessaires pour faciliter et simplifier l’exercice médical ou supprimer certains doublons et modifier des organisations peu efficientes.
Les directeurs d’établissement ont un rôle essentiel à jouer dans le découpage des pôles ainsi que dans la définition des objectifs, notamment médico-économiques, ainsi que des programmes d’action et des indicateurs de suivi. Le découpage des pôles, lesquels peuvent comporter « des structures internes de prise en charge du malade », est une question cruciale pour l’amélioration de l’efficience. Ils ne doivent pas être trop grands pour rester à taille humaine et permettre un réel pilotage par les chefs de pôles. Ils ne doivent pas être trop petits pour permettre des mutualisations de moyens. Cela renvoie à la notion de masse ou de taille critique. Compte tenu de la diversité des établissements, des activités et des organisations préexistantes, il est difficile de donner une seule réponse. Les pôles doivent organiser des regroupements d’activités cohérents et permettre une bonne articulation entre les différents services et entités qui les constituent.
Dans les pôles cliniques, les regroupements de services et entités peuvent correspondre à des logiques de structuration par filière (pouvant, par exemple, consister à regrouper les soins aigus avec les soins de suite spécialisés correspondants) ou par thème médical. Le plus souvent, les périmètres et le contenu des pôles résulteront des logiques médico-économiques propres aux établissements et à leurs spécificités, la bonne « logique » paraissant être celle du parcours du patient. Il est souhaitable que les regroupements résultent d’une réflexion approfondie sur l’articulation la plus efficace, d’une part, entre les activités cliniques, d’autre part, entre les activités cliniques et les activités médico-techniques. Les directeurs d’établissement devraient pouvoir se référer aux bonnes pratiques de gestion opérationnelle de la production des soins qui ont été identifiées par la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers. L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux qui lui succède pourrait pour se pencher à nouveau sur ce sujet important afin de proposer des solutions simples et opérationnelles permettant d’éclairer les établissements dans la démarche de création des pôles et d’amélioration de leur fonctionnement.
Compte tenu des pouvoirs accrus des chefs de pôles d’activité, la sélection des chefs de pôle doit faire l’objet d’une grande attention. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit que les chefs de pôles sont choisis et nommés par le directeur, sur une liste proposée par le président de la commission médicale d’établissement.
En tout état de cause, la poursuite de la mise en place des pôles et les modifications de l’organisation des pôles existants constituent un enjeu important. Il appartient aux acteurs d’appliquer les nouvelles dispositions afin d’améliorer l’efficience médico-économique des pôles. Il faudra notamment veiller au respect de la délégation de gestion, à son contenu et à la qualité de sa mise en œuvre. Les dispositions réglementaires relatives à l’application des nouvelles dispositions n’ont pas encore été publiées.
Dans cette logique, les chefs de pôle ont aussi un rôle important à jouer. Le chef de pôle est chargé d’organiser, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle « le fonctionnement » du pôle et plus seulement « le fonctionnement technique », comme cela était prévu antérieurement, et il a autorité fonctionnelle sur les personnels qu’il peut affecter en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle.
La mise en place des pôles et leur bon fonctionnement supposent de mener des efforts importants de communication et de concertation interne ainsi que de formation et d’accompagnement des équipes de direction. Les chefs de pôle doivent, notamment, pouvoir bénéficier d’actions de formation à la gestion et au management. Le contrat de pôle doit fixer les axes stratégiques précis de la délégation de gestion et des objectifs chiffrés et contrôlables. Le chef de pôle doit aussi élaborer le projet de pôle qui va décliner les objectifs fixés par le contrat de pôle.
Pour assurer leur mission, les chefs de pôle pourront, si nécessaire et si les capacités de l’établissement le permettent, selon la structuration qui sera retenue en fonction des besoins médicaux ainsi que des objectifs d’efficacité et de la taille des pôles, demander à bénéficier de moyens d’appui, comme un cadre de gestion et un gestionnaire administratif voire un contrôleur de gestion. La loi du 21 juillet 2009 a supprimé l’obligation d’affecter au chef de pôle un cadre médical et un cadre administratif, quelle que soit la taille du pôle.
Par ailleurs, les pôles devraient pouvoir disposer d’instruments de pilotage de l’activité ainsi que d’outils de comptabilité analytique et de gestion des ressources humaines. Ils doivent disposer d’outils d’analyse suffisamment élaborés et performants pour analyser, avec précision, les résultats obtenus puis identifier les dysfonctionnements pour ensuite les corriger et améliorer les organisations. Les pôles pourraient aussi mettre en place un dispositif d’intéressement collectif afin de favoriser la mobilisation des services et des équipes qui les animent. Les expériences en la matière mériteraient d’être diffusées.
L’enjeu de la création des pôles est au total de responsabiliser les équipes et de mettre en place une véritable délégation de gestion sur des projets médicaux afin de favoriser l’autonomie des médecins et leur capacité d’initiative, comme celle des autres personnels.
3. Généraliser la mise en place des instruments de pilotage et de gestion
La qualité du pilotage des établissements hospitaliers dépend, en grande partie, de la mise en place d’instruments de pilotage de qualité. On peut même affirmer que le pilotage ne peut être réellement efficace que s’il est adossé à des instruments de pilotage performants.
En effet, comme l’a souligné M. Christian Anastasy, directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, lors de son audition par la MECSS : « La fonction de l’hôpital étant de produire du service médical, il faut connaître la nature de ce service médical, son volume et son coût. »
C’est donc grâce à des outils de connaissance adaptés aux conditions d’activité et de production des soins que l’on peut assurer, dans la transparence, une analyse objective du fonctionnement des activités à l’hôpital et prendre la mesure de l’efficience médico-économique. L’évaluation partagée des résultats permet ensuite d’améliorer le pilotage de l’organisation des soins et de définir des actions d’amélioration de l’efficience.
a) Généraliser une comptabilité analytique performante permettant de mesurer les coûts de production
L’atteinte des objectifs d’efficience médico-économiques fixés par les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens suppose de développer les outils de la comptabilité analytique hospitalière et du contrôle de gestion. Cette nécessité de bonne gestion s’impose d’autant plus avec le financement à l’activité des établissements.
Tous les établissements devraient donc disposer d’outils de comptabilité analytique performants pour évaluer leur activité et leur gestion, analyser les coûts et les écarts, puis définir et mettre en œuvre les améliorations en termes de qualité, de sécurité et de performances des prestations assurées.
Force est de constater que ce n’est pas encore le cas. On comprend, dès lors, que certains établissements, qui fonctionnent sans avoir une connaissance claire et objectivée de leurs forces et de leurs faiblesses aient du mal à mettre en place les actions correctrices nécessaires pour redresser des situations déficitaires. Six ans après la mise en place de la tarification à l’activité et quelles que soient les interrogations ou contestations que l’on peut avoir sur le modèle de T2A appliqué, cette situation est regrettable et ne peut perdurer.
En 2008, selon l’enquête réalisée par le ministère de la santé et des sports, deux tiers (65 %) des établissements publics de santé (hors hôpitaux locaux) déclaraient avoir mis en place des outils de comptabilité analytique, dont tous les CHU. Ainsi, 63 % des établissements indiquaient avoir mis en place des tableaux de suivi d’indicateurs d’activité et de dépenses, mais seulement 19 % un tableau coûts case mix par pôle et 34 % des comptes de résultats par pôle (CREA).
Le tableau coût case mix (TCCM) permet de comparer les données de coûts et d’activité d’un établissement avec les données de la base de l’étude nationale de coûts (ENC). Cet outil a été conçu pour identifier les spécificités, en terme de structure de coûts ou d’activité, d’un établissement par rapport à l’échantillon des établissements de l’étude nationale de coûts faisant office de référentiel. Le principe du tableau coût case mix consiste donc à comparer – pour les séjours d’un établissement donné (case mix) – les coûts et l’activité observés dans l’établissement avec ceux calculés dans le référentiel.
L’enquête a montré que plus la situation concurrentielle était forte, plus la comptabilité analytique était utilisée.
Trois niveaux de comptabilité analytique ont été récemment définis :
– le niveau 1 correspond à la mise en place d’un retraitement comptable ; celui-ci est obligatoire, en application de l’article R. 6145-7 du code de la santé publique, et tous les établissements le produisent chaque année ;
– le niveau 2 consiste à alimenter la base de comparaison des coûts indirects de logistique, administratifs et médico-technique ; seulement un quart (27 %) des établissements soumis à la tarification à l’activité produisent des fiches de coûts indirects et participent à la base dite d’Angers ;
– le niveau 3, le plus technique, permet aux établissements de participer à la définition de l’échelle nationale des coûts ; seulement un établissement sur dix répond à ce niveau d’exigence, validé par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
Afin d’accélérer la généralisation de la comptabilité analytique dans les établissements de santé publics et dans chaque pôle, dans le cadre de la délégation de gestion, un plan d’action est actuellement mis en œuvre par la direction générale de l’offre de soins. L’objectif est d’harmoniser les outils et les méthodes de calcul des coûts afin de mettre en place dans les établissements des logiciels adaptés et interopérables. La nouvelle version du guide de la comptabilité analytique hospitalière, prévue pour 2010 ou 2011, prendra en compte les évolutions liées à la mise place de la tarification à l’activité, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Cette publication qui est très attendue par les établissements permettra aux éditeurs de logiciels d’adapter les logiciels de gestion et les systèmes d’information. Parallèlement, une mission de conseillers généraux des établissements de santé a été chargée d’identifier les bonnes pratiques en matière d’utilisation des outils de gestion interne et de comptabilité analytique. Les agences régionales de santé doivent effectuer, pour leur part, un état des lieux précis dans les établissements de santé pour s’assurer de la faisabilité technique des évolutions à réaliser.
Par ailleurs, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux devrait conduire ensuite une mission d’appui et d’accompagnement au changement pour promouvoir le développement des compétences en matière d’analyse de gestion au sein de chaque établissement hospitalier. À ce jour, 170 établissements ont été accompagnés dans la mise en place de la comptabilité analytique et l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux a prévu d’accompagner cinquante nouveaux établissements de santé par an.
Les agences régionales de santé ont été chargées de relayer cette action afin d’adapter l’appui en fonction des besoins des établissements.
La MECSS considère qu’il est absolument nécessaire de progresser très rapidement dans la mise en place d’une comptabilité analytique performante. Il faut mettre un terme aux atermoiements et retards en cette matière. Dans le cadre du financement à l’activité, ceux-ci ne sont plus acceptables. Tous les établissements doivent être doté d’une comptabilité analytique performante dans un délai de deux ans. Il s’agit d’une obligation de résultat. Pour la réaliser, le ministère devra mobiliser tous les moyens supplémentaires nécessaires. Il s’agit d’avoir une connaissance précise et exhaustive des coûts de production dans tous les établissements hospitaliers et les pôles. Cela doit impérativement amener les établissements à intégrer davantage des éléments de coûts et d’efficience dans le pilotage permanent des organisations. Le renforcement de l’approche médicalisée suppose aussi d’améliorer la connaissance de la formation des coûts et l’analyse des écarts de coûts par rapport à des référentiels, comme l’échelle nationale des coûts à méthodologie commune. L’objectif est de développer la gestion médico-économique des établissements afin d’améliorer la qualité des prises en charge et du service médical rendu aux usagers. La comptabilité analytique est devenue, avec la mise en place de la tarification à l’activité un outil indispensable d’aide à la décision et à la gestion des établissements. Il faut donc impérativement généraliser la mise en place et l’utilisation d’une comptabilité analytique performante dans tous les établissements dans les deux prochaines années.
Le décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 prévoit que le directeur de l’établissement hospitalier communique au conseil de surveillance les résultats de la comptabilité analytique. Cela devrait permettre au conseil de mieux assumer sa mission en matière de stratégie et de contrôle de la gestion de l’établissement.
b) Généraliser la mesure de la performance et mettre en place des tableaux de bord
La comptabilité analytique est un des outils de gestion et de pilotage indispensables. Mais d’autres outils devraient être systématiquement mis en place dans les établissements et les pôles afin de permettre l’analyse des performances et les comparaisons entre activités, pôles et établissements. Des tableaux de bord précis et lisibles sont de nature à favoriser le suivi des activités, de la qualité, de la sécurité et de la performance médico-économique afin d’améliorer les organisations de production des soins et des prestations aux usagers. Naturellement, au niveau des pôles, les tableaux de bord doivent être simplifiés. Pourtant, la mise en place de ces outils d’analyse de l’activité, comme les tableaux synthétiques d’activité (TSA), et des coûts ne suffit pas. Pour que ceux-ci soient effectivement utilisés, dans une logique de changement et d’adaptation continue, ils doivent faire l’objet d’une bonne appropriation par les personnels. Cela suppose de développer des efforts d’information et de formation en gestion et contrôle de gestion afin de développer une culture de gestion par l’analyse des coûts, dans une organisation désormais polaire. Dans cet esprit, il convient de développer des compétences en analyse de gestion interne dans chaque hôpital, ainsi que dans chaque pôle.
Les établissements peuvent utiliser le tableau de bord de pilotage de la performance hospitalière qui a été mis en place par le ministère de la santé en 2007. Le tableau de bord est composé d’une vingtaine d’indicateurs permettant de situer les établissements entre eux sur différents champs de la performance : activité, insertion de l’établissement dans son environnement, attractivité, équilibre financier d’exploitation, investissement, performance et productivité de l’organisation, ressources humaines, bon usage des médicaments, niveau de certification, qualité et sécurité. Les établissements peuvent comparer les valeurs des indicateurs à celles de la moyenne nationale, de la moyenne régionale et de la moyenne de la catégorie de l’établissement. Ce tableau de bord permet ainsi à chaque établissement de santé de disposer d’une vision globale et synthétique de sa performance et de se comparer aux établissements de sa région et de sa catégorie. Cela doit le conduire à rechercher les causes de son positionnement dans le tableau.
L’utilisation d’outils permettant d’objectiver les situations doit favoriser l’information et l’analyse partagée, afin de pouvoir procéder, ensuite, de manière concertée, aux adaptations éventuellement nécessaires pour améliorer la qualité des soins et la prise en charge des usagers ainsi que l’efficience.
c) Mettre à niveau et rendre interopérables les systèmes d’information hospitaliers
Malgré de réels efforts de modernisation accomplis ces dernières années, notamment grâce aux plans Hôpital 2007, qui prévoyait que 10 % de l’enveloppe d’aide seraient consacrés à ce sujet, et Hôpital 2012, qui poursuit le mouvement engagé, force est de constater que des marges de progression existent encore en matière de systèmes d’information hospitaliers.
Ainsi, M. Jacques Métais, qui était directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France lors de son audition par la MECSS, a rappelé : « Sur le plan régional, des initiatives ont été prises par certaines agences pour développer une sorte de schéma régional des systèmes d’information hospitaliers ; c’est le cas en Île-de-France. Mais le rôle de l’agence régionale de l’hospitalisation est purement incitatif. Elle peut apporter des financements, mais ne peut pas contraindre un hôpital à s’informatiser si son directeur s’y refuse. S’agissant d’un problème d’organisation interne, et en vertu du principe – légitime – de l’autonomie de gestion des hôpitaux, il appartient à la direction de l’établissement d’en décider. »
Par ailleurs, M. Christian Anastasy, directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux a indiqué, lors de son audition par la MECSS : « Nous nous sommes rendu compte, en faisant le bilan du plan hôpital 2007 que 75 % des projets qui ont été aidés pour leur système d’information se sont ″cassés la figure″. Nous avons cherché à comprendre pourquoi.
« Nous nous sommes aperçu, avec consternation, qu’il y a une déconnexion totale entre le management de tête et les systèmes d’information. Pour les directeurs d’hôpitaux et les médecins, les systèmes d’information sont de la basse intendance qu’ils sous-traitent à des ingénieurs informaticiens qui sont parfois tout frais sortis de l’école de Rennes et n’ont aucune expérience. »
Or, l’amélioration des systèmes d’information hospitaliers constitue un enjeu majeur pour la modernisation des établissements hospitaliers. Cela devrait être un objectif prioritaire des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Dans cet esprit, il faut s’assurer que chaque établissement hospitalier dispose d’un système d’information efficace et interopérable avec ceux des autres acteurs du système de santé, y compris ceux chargés de leur financement.
De la qualité du système d’information dépend la qualité du pilotage. C’est aussi grâce à des systèmes d’information performants et interconnectés que la gestion décloisonnée de l’offre de soins pourra être pleinement efficace et la prise en charge des usagers améliorée. À cet égard, il est indispensable que les logiciels d’aide à la prescription hospitaliers soient mis en place. La Haute Autorité de santé devra se mobiliser sur ce thème afin d’arrêter le référentiel ainsi que la procédure de certification nécessaire et veiller à ce que les logiciels hospitaliers soient effectivement compatibles avec les logiciels d’aide à la prescription en médecine ambulatoire.
Le rôle de l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP Santé) sera déterminant pour accompagner les établissements de santé mais aussi, depuis décembre 2009, les établissements médico-sociaux dans la démarche de modernisation de leur système d’information. Parallèlement à la préparation du déploiement du dossier médical personnel, l’agence doit se concentrer sur la définition et la publication de référentiels de systèmes d’information, d’échanges et de partages de données de santé interopérables, destinés aux établissements de santé. En effet, l’étude réalisée à la demande du ministère en charge de la santé concernant l’organisation à mettre en place au niveau national et dans les régions pour faciliter le développement des systèmes d’information en santé partagés sur tout le territoire a montré la nécessité d’un cadrage national et la définition d’un système d’interopérabilité pérenne. Dans cette logique, l’ensemble des référentiels doit être mis à la disposition des éditeurs de logiciels le plus rapidement possible afin de favoriser la mise en place des espaces numériques régionaux de santé (ENRS) dans les délais les plus brefs.
Pour mener ce projet, l’Agence des systèmes d’information partagés de santé devrait coordonner son action avec celles de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. L’Agence des systèmes d’information partagés de santé devra avancer, sans nouveau retard, dans la mise en place du dossier médical personnel engagée depuis 2004, sachant que naturellement le dossier médical personnel est nécessaire pour assurer un meilleur parcours du patient dans l’ensemble du système de santé, médecine de ville comprise. Lors de ses travaux, la MECSS a été frappée de constater la multiplication des dossiers médicaux informatisés mis en place par les établissements de santé ou des groupements d’établissements de santé organisés au plan local. L’Agence des systèmes d’information partagés de santé devra veiller à ce que le contenu de ces dossiers médicaux puisse être intégré dans le futur dossier médical personnel ou au moins que les données qu’ils contiennent soient directement accessibles.
L’amélioration des systèmes d’information hospitaliers doit contribuer à mieux organiser et fluidifier le parcours de soins des usagers du système de santé et médico-social. Cela devra également permettre de développer la télémédecine et la télésanté. Mais pour parvenir à améliorer réellement les systèmes d’information, il est indispensable que les directeurs d’établissement se mobilisent davantage sur ce sujet et s’impliquent concrètement dans la mise en œuvre du projet de modernisation, en associant à la démarche l’ensemble des personnels dont, en premier lieu, les chefs de pôles et les praticiens. La modernisation des systèmes d’information constitue un levier important pour favoriser la mobilisation des équipes sur un projet de performance global.
d) Inciter les établissements et les pôles à réaliser des audits de performance financiers et de processus
Des outils existent permettant de réaliser des analyses de la performance d’un établissement.
Il est notamment possible de formuler des diagnostics à l’aide du Diagnostic flash qui a été créé en 2006 et actualisé en 2007. Le Diagnostic flash permet de comparer, à l’aide de 43 indicateurs partagés par tous les établissements, les résultats d’un établissement. L’analyse des indicateurs financiers, d’activité et patient, de processus et d’organisation, et de ressources humaines permet d’avoir une représentation claire et synthétique de la situation de l’établissement et de détecter les principales difficultés.
Les 43 indicateurs du Diagnostic flash | |
Indicateurs activité et patient – taux d’occupation net en médecine – taux d’occupation net en chirurgie – taux d’occupation net en obstétrique – poids moyen en euros des cas traités (PMCT) relatif de l’établissement – PMCT relatif de l’établissement en chirurgie – part de marché en chirurgie – taux d’hospitalisation des passages aux urgences – productivité horaire IRM – productivité horaire scanner – nombre de prothèses de hanche |
Indicateurs de ressources humaines – budget Intérim – budget CDD du personnel non médical – budget CDD du personnel médical – structure d’âge du corps médical – structure d’âge des personnels non médicaux – densité encadrement des personnels non médicaux – poids des gardes et astreintes – taux de départ des infirmiers diplômes d’État (IDE) – taux d’absentéisme du personnel non médical |
Indicateurs financiers – taux de marge brute – reports de charges d’exercices antérieurs – indicateur de durée apparente de la dette – taux de renouvellement des immobilisations – capacité de remboursement des emprunts – fonds de roulement d’exploitation en jours – besoin en fonds de roulement en jours de charges d’exploitation – ratio de créances vers les particuliers émises dans l’année et non recouvrées – respect / amélioration du taux d’évolution des recettes et des dépenses par rapport à l’état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) |
Indicateurs de processus et d’organisation – indicateur de performance en médecine, chirurgie et obstétrique – indicateur de performance durée moyenne de séjour (DMS) globale – indicateur de performance DMS médecine – indicateur de performance DMS chirurgie – indicateur de performance DMS obstétrique – ratio agents des services cliniques – ratio agents des services médico-techniques – poids des dépenses administratives et logistiques – recettes rapportées aux effectifs médicaux – prix de revient des laboratoires de biologie – pourcentage de transferts depuis les urgences – temps annuel moyen de mise à disposition d’une salle d’opération hors garde et urgences – taux d’utilisation moyen des salles d’opérations – temps annuel de mise à disposition de l’IRM – temps annuel de mise à disposition du scanner |
Il peut être nécessaire de compléter ce diagnostic rapide par des audits financiers plus précis et des audits de processus, avant de définir éventuellement des actions de réorganisation et, le cas échéant, les actions du plan de retour à l’équilibre.
Les agences régionales de santé devront inciter les établissements à utiliser ces outils, à réaliser des audits de performance et à s’approprier les guides de bonnes pratiques et les référentiels établis par la Haute Autorité de santé, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et l’Agence des systèmes d’information partagés de santé.
e) Préparer la certification des comptes des établissements de santé
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires prévoit que les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés. Des travaux ont été engagés afin de préparer la mise en œuvre de la certification comptable, en 2014, comme le prévoit la loi. Il conviendra de définir le champ des établissements concernés et les modalités de la certification.
Cette question revêt une importance réelle. Il ne s’agit pas d’une formalité supplémentaire et superfétatoire mais d’une nécessité pour assurer la sincérité et la fiabilité des comptes des établissements publics de santé. Il faut donc que, tout en prenant en compte le coût de la certification, le champ des établissements concernés soit aussi large que possible.
B. INCITER AUX RÉORGANISATIONS FAVORABLES À LA QUALITÉ DES SOINS ET À L’AMÉLIORATION DE L’EFFICIENCE
De la qualité de l’organisation des établissements et, en particulier, de l’organisation des soins, résulte, en grande partie, la performance, tant en termes de qualité que de sécurité des soins. Dans cet esprit, la recherche de l’efficience médico-économique doit être une priorité pour l’ensemble des personnels hospitaliers.
L’objectif est d’adapter, en permanence, l’offre de prise en charge à la demande croissante de soins, en particulier des personnes âgées ou très âgées, et en fonction de l’évolution des techniques médicales. Il s’agit d’ajuster les capacités d’accueil, d’éviter l’engorgement des urgences et de parvenir, au quotidien, à mettre en adéquation les ressources et les besoins. Pour y parvenir, il faut définir et diffuser les meilleures pratiques, puis faire en sorte que les établissements s’en inspirent.
Car, comme M. Philippe Ritter, président du conseil d’administration de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, l’a indiqué, lors de son audition par la MECSS : « la non-qualité et la mauvaise organisation entraînent une mauvaise prise en charge, sans parler des surcoûts induits…C’est par le biais de comparaisons avec d’autres établissements et par la diffusion de bonnes pratiques qu’on arrivera à faire évoluer les choses. »
1. Tirer réellement les conséquences des audits de performance
La réalisation d’audits de performance n’est pas une fin en soi. Il convient de mettre en œuvre leurs conclusions et d’assurer le suivi de leur application.
a) Veiller à l’application des conclusions des audits
Un audit de performance bien mené, de manière concertée, doit permettre d’établir un diagnostic partagé par les acteurs concernés. L’élaboration des actions correctrices, à partir du diagnostic, doit aussi être concertée et partagée par les acteurs. Cela facilitera ensuite la mise en œuvre des éventuelles mesures de réorganisation. Mais la qualité de la méthodologie suivie pour la réalisation d’un audit constitue une condition de la bonne concrétisation de ses conclusions.
Il appartient aux directeurs d’établissement, aux chefs de pôles et aux chefs de services de conduire le changement et de procéder avec les personnels concernés à la mise en œuvre des réorganisations qui permettront d’améliorer la prise en charge médicale des usagers ainsi que l’efficience. Afin de favoriser la culture de l’adaptation permanente, il est important d’appliquer aussi précisément que possible les mesures décidées. Car le renoncement à appliquer certaines mesures peut affaiblir la dynamique d’efficience médico-économique que l’on veut promouvoir.
Encore faut-il préciser que l’objectif n’est pas de substituer systématiquement et de manière autoritaire une organisation identifiée comme performante à une autre organisation considérée comme étant moins performante, mais de s’inspirer des bonnes pratiques pour s’en rapprocher et converger vers les organisations permettant d’améliorer la prise en charge des usagers et qui sont les plus efficientes.
b) Assurer le suivi des préconisations
L’application des mesures décidées à l’issue des audits de performance médico-économique doit faire l’objet d’un suivi précis et également partagé par les équipes médicales, paramédicales et médico-techniques concernées. Ce suivi doit faire l’objet de rendez-vous programmés et permettre d’analyser aussi précisément que possible les résultats obtenus, de mesurer les progrès accomplis, les insuffisances et les écarts par rapport à d’autres organisations comparables. Cela suppose – il faut y insister – que les structures d’activité disposent d’outils de gestion et de pilotage performants.
2. Optimiser la permanence des soins et des urgences
Le nombre de passages dans les services d’urgences est en forte augmentation. Il est passé de 7 millions de passages, en 1986, à près de 18 millions de passages, en 2008. Or, plusieurs études menées ces dernières années sur la permanence des soins en médecine ambulatoire ont montré que les urgences hospitalières accueillaient un afflux important de patients n’ayant pas eu recours en première intention à la médecine générale de ville. L’attractivité des services d’urgences tient non seulement à certaines insuffisances de la médecine de ville mais aussi au fait que les soins dispensés à l’hôpital sont moins coûteux pour les usagers et que le cadre hospitalier offre, en un même lieu, un ensemble de compétences médicales et de services de grande qualité.
Afin d’éviter l’engorgement des urgences et de réduire le rythme de progression des passages aux urgences hospitalières ainsi que certaines hospitalisations non pertinentes ou inadéquates, plusieurs mesures ont été prises pour améliorer l’organisation de la permanence des soins ambulatoire et de la permanence des soins hospitalière.
a) Soulager les urgences hospitalières grâce à la réorganisation territoriale de la permanence des soins en médecine ambulatoire
La loi du 21 juillet 2009 a modifié les dispositions relatives à la permanence des soins. Elle a confié au directeur général de l’agence régionale de santé la responsabilité de l’organisation de la permanence des soins ambulatoires. Celle-ci fera l’objet d’un suivi particulier et un des indicateurs de performance retenu pourrait être l’évolution du taux de passage aux urgences en première partie de nuit. La permanence des soins fait désormais l’objet d’une organisation territoriale entre les établissements de santé et la médecine de ville. Les directeurs d’agences régionales de santé sont responsables du pilotage de la permanence des soins sur la base du schéma régional d’organisation des soins.
La loi réaffirme le rôle essentiel de la régulation médicale préalable dans le système de prise en charge des demandes de soins de premier recours, en faisant du 15 le numéro d’appel national. Le médecin libéral peut désormais assumer la régulation des appels au sein d’un centre 15 hébergé par un établissement de santé. La régulation préalable devrait ainsi être plus efficace et permettre d’assurer un premier filtre d’entrée en réorientant vers la médecine de ville les demandes de soins non programmés ne relevant pas de l’urgence vitale.
Par ailleurs, la loi du 21 juillet 2009 a créé une obligation pour les médecins libéraux d’assurer la mission de service public de la permanence des soins dans le cadre de leur activité. Le directeur de l’agence régionale de santé doit organiser la permanence et transmettre les informations nécessaires au préfet, lorsque la permanence n’est pas assurée, afin que celui-ci décide, le cas échéant de mesures de réquisitions.
Le développement des maisons médicales de garde peut aussi constituer un élément de réponse organisé en proximité pouvant proposer une alternative au recours aux urgences hospitalières pour les demandes de soins ne relevant pas de l’urgence vitale. L’adossement des maisons médicales de garde aux structures hospitalières, qui est d’ailleurs recommandée par la circulaire relative aux maisons médicales de garde du 23 mars 2007, devrait aussi permettre d’alléger le flux des patients qui s’adressent aux services d’urgences.
b) Veiller à l’utilisation du levier financier redonné aux agences régionales de santé pour organiser la permanence des soins hospitalière
La réorganisation de la permanence des soins hospitalière constitue le second versant de la réorganisation d’ensemble de la permanence des soins. Les objectifs de cette réorganisation consistent à assurer aux patients, dans les territoires, un accès en permanence aux soins urgents, en éliminant les doublons dans certains endroits et les carences dans d’autres, à optimiser l’utilisation de la ressource médicale et paramédicale et à favoriser l’efficience du dispositif en évitant les dépenses inutiles et en ne rémunérant que les établissements qui réalisent effectivement la permanence des soins.
À cet effet, depuis 2009, le coût des gardes et des astreintes médicales a été retiré des tarifs, afin de constituer une enveloppe de mission d’intérêt général, d’un montant de 760 millions d’euros, permettant aux agences régionales de santé de rémunérer directement les établissements en fonction de leur prise en charge effective de la permanence des soins hospitalière. Cela doit permettre de mieux articuler la réforme du financement et la réorganisation territoriale de la permanence des soins.
Il faudra s’assurer que la réforme de la permanence des soins aboutira effectivement à réaliser la recomposition attendue, à pallier les insuffisances actuelles de la médecine de ville dans ce domaine, à désengorger les services d’urgences hospitaliers et à assurer une prise en charge des usagers dans des conditions de qualité et de sécurité optimales.
c) Améliorer la prise en charge des usagers aux urgences
Les services d’urgences constituent souvent la porte d’entrée des usagers de l’hôpital. C’est le premier contact avec l’établissement. De ce premier contact, de la qualité de l’accueil et de la prise en charge médicale de l’usager va résulter, pour une grande part, l’impression que celui-ci conservera de son passage ou de son séjour dans l’établissement hospitalier. C’est donc un moment important du séjour à l’hôpital que l’établissement se doit d’organiser le mieux possible.
Les services d’urgences sont une porte d’entrée mais ils constituent aussi une vitrine, laquelle peut être plus ou moins attractive, ce qui peut avoir des conséquences sur l’activité générale de l’établissement.
Tant pour des raisons de qualité de la prise en charge médicale que de confort du patient et d’efficience, les établissements de santé publics ont intérêt à être particulièrement attentif à l’organisation des urgences.
Des améliorations peuvent dans certains cas être apportées au fonctionnement des services d’urgences. Au moment de l’accueil, les usagers peuvent être mieux orientés et répartis dans des circuits organisés, plus ou moins rapides selon le degré d’urgence, la nature des affections et les conditions de traitement (soins immédiats, soins rapides non immédiats, patients debout, patients couchés, traumatologie, filières spécifiques…). Cela permet de réduire le temps d’attente aux urgences qui est mal vécu par les usagers et de réduire les transferts en hospitalisation. Le taux de transfert en hospitalisation est d’ailleurs un indicateur d’efficience. Une meilleure organisation doit permettre de réduire de façon très significative le temps d’attente aux urgences. Cela doit augmenter la satisfaction des usagers et éviter des hospitalisations non pertinentes. La réorientation vers la maison médicale de garde, en particulier si elle est adossée à l’établissement, voire vers la médecine de ville, peut aussi alléger les urgences et habituer les usagers à recourir au service de santé le mieux à même de répondre à leur besoin.
Cette évolution doit s’effectuer avec mesure et il convient naturellement de toujours s’assurer que la permanence des soins hospitalière permet de prendre en charge les véritables urgences vitales et d’assurer les soins les plus urgents.
L’amélioration de l’organisation des urgences permet d’obtenir des résultats très significatifs et, notamment, de beaucoup réduire les délais d’attente. Mais pour réussir et produire ses pleins effets, cette démarche doit être articulée avec d’autres actions coordonnées, notamment l’amélioration de la gestion des lits et de l’aval des urgences. Elle doit s’inscrire dans un projet de performance global.
3. Améliorer la gestion des capacités
Le lit demeure une référence et un actif fondamental de l’hôpital. Aussi, l’optimisation de la gestion des lits est une source importante d’amélioration de la prise en charge médicale des usagers et de l’efficience.
a) L’application des bonnes pratiques organisationnelles pourrait permettre de gagner, au minimum, 10 % des journées de séjour
L’amélioration de la gestion de la capacité d’accueil a pour objectif d’éviter qu’un lit soit vide au-delà du temps nécessaire pour remettre en état la chambre dans le respect des prescriptions d’hygiène, ou qu’un lit soit occupé par un usager sans que la journée soit nécessaire à sa prise en charge, par exemple en raison d’une attente pour réaliser un examen ou l’attente d’un lit d’aval.
Deux indicateurs permettent d’avoir une première idée des marges de manœuvre à l’intérieur de l’établissement : le taux d’occupation des lits et le taux de pertinence ou de non-pertinence des journées d’hospitalisation, voire des admissions. Certains jours de la semaine, certains services sont occupés de manière intensive (parfois à plus de 100 %) et d’autres jours imparfaitement. La Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers a fréquemment relevé, lors de ses études sur un échantillon d’établissements, des taux de non-pertinence des journées d’hospitalisation d’environ 30 % dans les hôpitaux généraux, des pourcentages inférieurs à 15 % pour les services les plus techniques, comme la réanimation, et supérieurs à 50 % dans des services de gériatrie aiguë. En outre, les séjours anormalement longs, qui sont peu fréquents puisqu’ils représentent entre 1 % et 8 % des séjours dans l’échantillon étudié, peuvent être à l’origine de 30 % des journées-lit. De même, les horaires tardifs d’admission des usagers peuvent générer une utilisation sous optimale de la première journée d’hospitalisation.
Le diagnostic général est que l’optimisation de la gestion des lits peut permettre aux établissements étudiés de réaliser des gains substantiels, pouvant représenter au minimum 10 % d’activité et de financement supplémentaire voire bien plus dans le cas d’une optimisation plus poussée.
Les travaux de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers ont permis de déterminer vingt-neuf bonnes pratiques organisationnelles pour la gestion des lits.
Les bonnes pratiques organisationnelles pour la gestion des lits
I – Management et pilotage
1. Mettre en place une cellule d’ordonnancement
2. Identifier les principaux processus de gestion des lits à mettre sous contrôle
3. Développer la gestion prévisionnelle des lits
4. Mettre en place un tableau de bord de la gestion des lits
5. Fiabiliser l’enregistrement et le partage des informations en temps réel
6. Disposer d’une liste à jour des établissements d’aval
7. Suivre l’activité du service social et la qualité des relations avec les établissements d’aval
8. Suivre les séjours longs et mettre en place une revue de ces dossiers
II - Planification
9. Allouer les lits aux différentes spécialités en fonction de l’activité constatée
10. Répartir les ressources humaines au regard des besoins au cours de l’année
11. Au sein d’un pôle, dédier des périmètres pour l’urgence et le programmé
12. Développer la polycompétence et la polyvalence des équipes soignantes
13. Organiser le passage des assistantes sociales
14. Homogénéiser les bons de demande d’aval
15. Mettre en place une « enveloppe de sortie »
16. Mettre en place un salon de sortie
17. Programmer conjointement admission dans un lit et passage au bloc
III - Programmation
18. Préparer la sortie vers l’aval avant l’admission
19. Programmer les séjours en cherchant à lisser l’activité sur la semaine
20. Développer les préadmissions
21. Reprogrammer des prises en charge non urgentes
22. Admettre des patients le vendredi en hôpital de semaine
IV - Régulation
23. Réduire les temps d’accès à l’imagerie pour réduire la durée de séjour
24. Organiser le travail pour faire plus de mouvements le matin
25. Réaliser systématiquement la remise en état des lits dans la foulée de la sortie du patient
26. Prévenir la famille et le patient de la date et de l’heure de sortie au plus tôt
27. Renseigner et faire vivre la date prévisionnelle de sortie
28. Évaluer le besoin et déclencher au plus tôt le recours au service social
29. En cas d’affluence aux urgences, faire monter les patients dans les services
b) L’application des bonnes pratiques organisationnelles permet d’améliorer la prise en charge des usagers
Le gain financier est donc potentiellement très significatif, mais n’est pas le seul. À condition de ne pas tomber dans l’excès, l’optimisation des lits a en effet également des impacts positifs sur la qualité des soins (diminution du taux de journées non pertinentes, meilleur accès aux lits, notamment pour les patients hospitalisés depuis les urgences…) et sur la satisfaction des professionnels (diminution des incidents, des « frictions », lissage de la charge de travail sur la semaine…).
À la Polyclinique de Rillieux, Lyon Nord, l’optimisation de la gestion des lits a permis d’augmenter l’activité en médecine de 13 % et de 5 % en chirurgie, d’augmenter de 20 % le taux d’occupation des lits du fait d’une meilleure gestion prévisionnelle, de diminuer de 50 % les journées non pertinentes, de diminuer le délai d’obtention d’une place en aval de l’hospitalisation (de 23 jours à 9 jours), de réduire la durée moyenne de séjour d’un quart en la ramenant de 8 jours à 6 jours. Dans d’autres établissements, l’application des bonnes pratiques organisationnelles a permis d’augmenter les sorties de services réalisées avant 13 heures et de libérer des lits, notamment pour l’accueil des patients des urgences, d’effectuer des admissions plus précoces et d’améliorer l’utilisation de la première journée d’hospitalisation, de lisser l’activité sur la semaine ou encore de diminuer l’occupation des lits par des séjours de plus de trente jours.
Cela montre que, souvent, comme l’a indiqué M. Philippe Ritter, président de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, lors de son audition par la MECSS : « une bonne organisation contribue aussi à améliorer les soins. »
Ces constats étant faits, on peut malgré tout se demander pourquoi les pratiques correspondantes ne sont pas plus répandues.
Dans cet esprit, il faudra donc faire œuvre pédagogique, mieux diffuser et faire appliquer dans les établissements les bonnes pratiques organisationnelles qui sont source d’amélioration de l’efficience médico-économique.
Au-delà, la MECSS estime nécessaire de concrétiser le décloisonnement des secteurs grâce à la mise en place obligatoire d’une gestion mutualisée des lits et des capacités dans les établissements de santé ainsi qu’entre les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux dans le cadre régional. Cela doit permettre d’éviter certaines pertes de temps pour les personnels de santé et les personnels administratifs chargés des prises en charge et des soins lorsqu’ils recherchent une place, en particulier en urgence, dans une structure de soins ou d’accueil, et d’éviter certains errements constatés qui peuvent entraîner des risques pour les patients en attente de soins.
4. Accélérer le développement de la chirurgie ambulatoire et améliorer la gestion des blocs opératoires
Une tendance forte de l’évolution des établissements hospitaliers est de recentrer les lits hospitaliers sur les soins aigus. L’hospitalisation dans un service de soins aigus est justifiée par la nature des actes effectués et par l’état du patient. Dans les autres cas des solutions alternatives existent, comme l’hospitalisation à domicile, la prise en charge dans un service de soins de suite et de réadaptation ou encore dans un service de médecine ou de chirurgie ambulatoires. L’organisation d’une offre de soins hospitalière graduée doit permettre de mieux répondre à l’ensemble des besoins de soins des usagers et d’améliorer l’efficience des soins hospitaliers.
a) Rattraper le retard en chirurgie ambulatoire
Les établissements de santé publics et privés ont une activité importante en médecine ambulatoire, puisque 13 millions de consultations ambulatoires sont réalisées chaque année, dont 40 % dans les CHU. Les établissements répondent ainsi à une mission de proximité en permettant l’accès de toute la population à des soins spécialisés. Mais il existe aussi en France un potentiel important de développement de la chirurgie ambulatoire qui permet au patient de regagner son domicile le jour même de l’intervention.
Depuis la fin des années 90, la part de la chirurgie ambulatoire dans l’activité de chirurgie des établissements de santé a augmenté mais elle demeure inférieure à celle d’autres pays de l’Union européenne. En 2008, le taux de chirurgie ambulatoire était de 32 % en France, alors qu’il était de 78 % au Danemark et de 79 % en Grande-Bretagne. Cependant, on observe dans notre pays une grande hétérogénéité des pratiques en chirurgie ambulatoire, selon les régions, les établissements et les types d’actes.
La France devrait, en conséquence, rattraper son retard dans ce domaine. L’évolution des techniques chirurgicales autorise cette évolution. En outre, la chirurgie ambulatoire permet, en général, d’assurer une meilleure prise en charge des usagers pour lesquelles elle est source de satisfaction. Des études réalisées, notamment, par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés montrent que 90 % des usagers se déclarent satisfaits de ce mode de prise en charge et que 88 % se disent prêts à renouveler l’expérience. Le développement de la chirurgie ambulatoire peut aussi être un facteur de modernisation et d’amélioration de la qualité globale de la prise en charge médicale dans la mesure où il impose aux professionnels un niveau d’exigence élevé, lié à la brièveté du séjour hospitalier et à l’enjeu permanent de qualité et de sécurité des soins. À condition d’être bien organisée et en liaison avec l’aval de l’hôpital, la chirurgie ambulatoire peut assurer la qualité de la prise en charge, sans risque de complications supplémentaires, et avec une meilleure efficience.
Diverses mesures ont été prises, depuis plusieurs années, pour favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire. Des objectifs ont été fixés dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire. Certaines régions ont mis en place des plans régionaux spécifiques. Le régime des autorisations de création de cette activité a été simplifié. La politique tarifaire a été adaptée afin de la rendre plus incitative. Les tarifs T2A de prise en charge de certains actes de chirurgie ambulatoire ont été revalorisés et rapprochés des tarifs d’hospitalisation complète et la montée en charge de la part tarifée a été plus rapide pour ces actes. Des aides à l’investissement peuvent être attribuées dans le cadre des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 pour financer les restructurations nécessaires des plateaux techniques de chirurgie. Les établissements peuvent aussi se référer aux guides de bonnes pratiques organisationnelles qui sont diffusés par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Par ailleurs, un dispositif d’entente préalable a été institué qui peut être utilisé lorsque l’hospitalisation avec hébergement représente une proportion élevée.
De nouvelles mesures sont prévues pour 2010. Afin de généraliser l’activité de chirurgie ambulatoire, le décret sur les conditions d’autorisation de l’activité de soins de chirurgie des établissements de santé devrait prévoir que la pratique de la chirurgie ambulatoire sera une condition de cette autorisation. Autrement dit, la chirurgie ambulatoire devrait être l’une des modalités de fonctionnement pour tous les établissements autorisés à pratiquer l’activité de chirurgie. Afin de développer l’offre régionale de chirurgie ambulatoire, il est aussi envisagé de créer des centres de chirurgie ambulatoire exclusive et de développer des structures répondant à des besoins locaux. Pour renforcer l’incitation tarifaire à pratiquer la chirurgie ambulatoire, la valorisation des séjours en chirurgie ambulatoire doit être améliorée et le rapprochement des tarifs de chirurgie ambulatoire avec ceux de chirurgie en hospitalisation complète doit se poursuivre. Enfin, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux doit mener une réflexion sur l’organisation performante de la chirurgie et l’efficience des pratiques en chirurgie ambulatoire.
En dépit des efforts réalisés, force est de souligner, comme l’a fait M. Laurent Degos, président de la Haute Autorité de santé, lors de son audition par la MECSS, que : « La France se distingue par un faible taux de prise en charge en chirurgie ambulatoire. »
De fait, la chirurgie ambulatoire peine à se développer. Elle a relativement peu progressé ces dernières années puisque le taux de chirurgie ambulatoire est passé de 30 % en 2003 à 32 % en 2008 et que la chirurgie en hospitalisation complète représente encore deux tiers des séjours.
Or, selon M. Jean-Michel Dubernard, membre du collège de la Haute Autorité de santé et ancien président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale : « si, dans dix ans, nous parvenons au niveau actuel des Américains en matière de chirurgie ambulatoire, 90 % de nos lits de chirurgie ne serviront plus à rien. D’où l’importance cruciale pour l’hôpital de pouvoir anticiper. »
La question du développement de la chirurgie ambulatoire constitue un enjeu majeur pour l’avenir des établissements de santé et l’organisation de l’offre de soins.
Mais, comme l’a rappelé M. Jean-Michel Dubernard : « En matière de chirurgie ambulatoire, il y a un énorme effort de pédagogie à fournir, à tous les niveaux, et d’abord auprès des patients, dont il faut apaiser les craintes légitimes. Il faut simplement leur expliquer que ce dispositif suppose la mise en place d’un réseau de surveillance, comme cela se fait ailleurs, et que les risques de développer une infection nosocomiale sont cinq fois moindres qu’au cours d’une hospitalisation classique. Convaincre les médecins n’est pas non plus une mince affaire, d’autant qu’un bon chirurgien est une personne anxieuse, qui ne se résout pas facilement à laisser sortir le patient dans la journée. L’administration est tout aussi difficile à convaincre. »
Pour sa part, M. Benjamin Maurice, qui était, lors de son audition par la MECSS, directeur de la Mission sur la tarification à l’activité et chef du bureau du financement de l’hospitalisation privée à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des sports, a indiqué : « Le développement de la chirurgie ambulatoire n’est pas facile car celle-ci remet en cause certains gestes traditionnels. Elle suppose une organisation adaptée et exige que des explications détaillées soient fournies aux patients, qui ne sont pas habitués à quitter aussi rapidement l’établissement de santé. Néanmoins, tout le monde s’accorde à considérer la chirurgie ambulatoire comme un facteur de qualité et d’efficience. »
Des études devront être menées pour évaluer les freins au développement de la chirurgie ambulatoire, trouver les solutions réellement efficaces pour les lever et permettre de réaliser le potentiel annoncé, dans des conditions permettant d’assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicale ainsi que le confort et la satisfaction des usagers. Cela suppose d’affirmer une volonté politique claire et de renforcer les incitations permettant de réaliser cette orientation stratégique majeure pour le système hospitalier.
Dans cette logique, il est souhaitable que le décret qui doit fixer les nouvelles conditions d’autorisation de l’activité de chirurgie dans les établissements de santé soit publié rapidement et que celui-ci prévoit, comme cela est envisagé, que l’exercice de la chirurgie ambulatoire est une condition de l’autorisation.
Le traitement de la maladie ne s’arrêtant pas à la sortie de l’hôpital, cela nécessite aussi d’améliorer l’aval de la prise en charge à l’hôpital, c’est-à-dire de développer et de mieux organiser l’hospitalisation à domicile ainsi que le suivi et la prise en charge post-opératoire, notamment par la médecine de ville, les services de soins infirmiers à domicile et les services de soins de suite et de réadaptation. Le développement de la chirurgie ambulatoire doit avoir un effet structurant sur l’ensemble de l’offre de soins. C’est un levier que les agences régionales de santé doivent utiliser pour réaliser les réorganisations jugées nécessaires.
À partir d’un cadrage national et des projets régionaux de santé, les agences régionales de santé devraient fixer, dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus avec les établissements, des objectifs concernant la montée en charge de la chirurgie ambulatoire. Mais les établissements et les agences régionales de santé doivent également veiller à ne pas accroître les inégalités de santé liées à des différences dans les capacités à assurer une bonne prise en charge de l’usager après une intervention de chirurgie ambulatoire.
Par ailleurs, le développement de la chirurgie ambulatoire entraîne des conséquences importantes pour les personnels. Il convient donc de les anticiper afin de définir une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences adaptée et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment en matière de formation, de requalification et de mobilité des personnels.
b) Améliorer la gestion des blocs opératoires
L’activité chirurgicale structure en grande partie l’organisation des hôpitaux, en particulier les plus grands, comme les CHU. À l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par exemple, l’activité chirurgicale représente près de 30 % des lits installés et des entrées. Or, des études montrent des différences très importantes entre les établissements, en ce qui concerne le nombre annuel d’interventions par anesthésiste et le nombre annuel d’interventions rapportés au personnel non médical affectés aux blocs opératoires.
Des réorganisations, souvent techniquement simples mais humainement parfois plus difficiles à réaliser, peuvent permettre d’améliorer l’utilisation des salles. L’informatisation des blocs et une meilleure programmation des interventions peuvent permettre d’augmenter le taux d’occupation des salles opératoires (les taux constatés sont souvent inférieurs au taux cible de 85 %) et d’éviter ou réduire sensiblement les taux de débordement qui correspondent à l’utilisation des salles au-delà des horaires d’ouverture réglementés (le taux cible est de 5 %). La mise en place de blocs opératoires communs et la mutualisation des salles, voire des équipes, peuvent aussi permettre d’élargir les périodes d’ouverture des blocs. Afin de favoriser les réorganisations, certains établissements ont mis en place des conseils de bloc qui ont défini des chartes de bloc mentionnant explicitement les horaires d’ouverture. Des progrès peuvent aussi être accomplis pour développer la polyvalence des personnels, améliorer l’organisation des temps de travail. Une meilleure adéquation des horaires des différentes catégories de personnel avec les activités de soins et une meilleure affectation du personnel non médical peuvent notamment permettre d’optimiser le temps médical et l’utilisation des salles. Une meilleure planification de la présence des anesthésistes peut aussi permettre de continuer l’activité pour les urgences et en cas de débordement.
À la suite des travaux réalisés par la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers, des progrès ont été réalisés dans certains établissements, mais des marges substantielles d’amélioration existent encore.
Afin d’améliorer le pilotage des blocs opératoires, il faudra généraliser l’informatisation des blocs et faire en sorte que ceux-ci soient dotés de logiciels de gestion des blocs permettant le partage de l’information entre eux. Cela permettrait d’améliorer la planification de l’activité prévisionnelle des blocs et des personnels ainsi que de mesurer l’activité réalisée et d’en assurer le suivi à l’aide d’indicateurs. Ces derniers, notamment concernant l’utilisation des blocs, devraient être débattus en conseil de bloc et prévus par les contrats de pôles. L’analyse du temps opératoire permettrait d’identifier les points de blocage, de redondance et de délais pour ensuite y remédier. Les établissements doivent s’investir davantage sur le thème de la gestion des blocs et du temps médical dans les blocs opératoires ainsi que dans la mise en place de systèmes d’information adaptés à la culture de l’évaluation qu’il faut promouvoir. L’amélioration de la gestion et de la connaissance des coûts de fonctionnement des salles permettra notamment de mieux ajuster l’offre aux besoins des usagers et de renforcer l’efficience médico-économique.
5. Maîtriser les dépenses de médicaments, d’imagerie et d’examens biologiques
La limitation de la dispersion des activités d’examens de biologie et de radiologie ainsi que la réduction de la surprescription constituent aussi des moyens d’éviter des surcoûts et d’améliorer l’efficience médico-économique.
a) Éviter la surprescription en mettant en place des référentiels
Il existe fréquemment dans les établissements des marges de progrès possibles consistant en la réduction de certaines prescriptions non pertinentes de médicaments, d’examens de biologie ou d’examens radiologiques.
Car la surprescription de médicaments ne concerne pas seulement la médecine de ville. Elle concerne aussi les établissements hospitaliers. De même, souvent en raison d’insuffisances des systèmes d’information, des examens de biologie et d’imagerie sont effectués en double, voire davantage si l’on prend en compte les examens effectués en secteur de ville.
Parvenir à la juste prescription suppose notamment de mettre en place des référentiels. Des accords de bon usage sont prévus en matière de prescription des médicaments et les établissements doivent conclure des contrats de bon usage des médicaments. Des logiciels d’aide à la prescription visent à faciliter l’application des référentiels par les praticiens hospitaliers. Ils pourraient être davantage utilisés. Des référentiels devraient aussi être établis pour les examens de biologie ou de radiologie. Les efforts d’information sur ces sujets en faveur des praticiens et des internes à leur arrivée dans un service devraient d’ailleurs être renforcés et améliorés.
La réalisation de l’objectif visant à éviter les doublons de prescription renvoie à la nécessité d’améliorer les systèmes information pour les rendre interopérables et permettre le partage des informations entre les différents acteurs du système de santé. Sans attendre l’achèvement du grand chantier de l’informatisation de la prescription des médicaments qui est un des objectifs du plan Hôpital 2012, il pourrait être inclus dans les systèmes informatiques internes aux établissements un dispositif d’alerte permettant de signaler les doublons de prescriptions et d’examens. Cela n’est pas toujours le cas, notamment dans de grands établissements. L’informatisation de la prescription médicamenteuse peut aussi contribuer à la lutte contre la iatrogénie, à laquelle les personnes âgées sont plus exposées du fait de la polypathologie et de la polymédication. On peut, sur ce point, renvoyer au récent rapport de la MECSS sur la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments, présenté par Mme Catherine Lemorton (rapport n° 848 de l’Assemblée nationale, déposé le 30 avril 2008).
b) Regrouper les équipements de biologie et d’imagerie
Le regroupement de services d’examens de biologie ou de radiologie peut aussi permettre de dégager des marges de manœuvre consacrées à des activités de soins pertinentes ou à augmenter la qualité et la sécurité des soins. Dans les établissements d’une certaine taille, il peut exister plusieurs laboratoires de biologie et un parc d’équipements en imagerie dispersé. Il est alors intéressant de limiter la dispersion et d’organiser le regroupement d’activités et des matériels correspondants pour les réaliser. Les regroupements peuvent concerner, par exemple, des activités d’examens spécialisés qui sont rassemblées sur des sites référents ou des équipements lourds d’imagerie, tels que les appareils d’imagerie par résonance magnétique, les scanners, les tomographes par émission de positons et les gammas caméras. Cela permet de rationaliser les processus, mais aussi d’améliorer la gestion des ressources humaines et de mutualiser les gardes.
Comme M. François Devif, directeur chez Capgemini Consulting et responsable de la mission d’audit du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, l’a indiqué lors de son audition par la MECSS : « Le gros enseignement que l’on peut tirer du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye comme d’autres établissements est la nécessité de lutter progressivement contre la démultiplication de moyens qui amène chacun de ces moyens à n’être que partiellement exploité et à l’être dans des logiques qui ne sont pas forcément alignées sur la logique même de l’institution. »
Il a aussi ajouté que : « La réforme importante à conduire dans les hôpitaux publics est de distinguer entre ce qui relève du spécifique et ce qui relève d’une valeur ajoutée mutualisable et transverse afin de mieux amortir les coûts fixes des grosses structures – imagerie, laboratoires, blocs opératoires – qui pèsent lourdement dans les comptes de résultat. »
6. Veiller à la pertinence des séjours et des actes et renforcer le contrôle de la qualité et de la sécurité des soins
La question de la pertinence des séjours hospitaliers et des actes et interventions qui y sont accomplis est encore relativement peu étudiée. En regard, la question de la qualité des prises en charge et des actes fait l’objet d’un intérêt accru mais des progrès peuvent encore être accomplis.
a) Veiller à la pertinence des séjours et des actes
Le recentrage de l’hôpital sur les soins aigus suppose de réduire les hospitalisations non pertinentes ou inadéquates, c’est-à-dire :
– les hospitalisations qui ne sont pas nécessaires parce que le malade aurait pu être traité autrement, en médecine préventive, par la médecine de ville, par des soins externes ou dans le cadre d’un réseau de soins ;
– les hospitalisations qui résultent d’un mauvais aiguillage de l’usager, notamment en raison d’un engorgement de certains services ou d’une mauvaise gestion des lits ;
– les hospitalisations complètes alors qu’une hospitalisation de jour ou partielle serait plus indiquée ;
– les hospitalisations complètes qui se prolongent, sans autre justification que l’engorgement des structures d’aval d’hospitalisation ou de soins infirmiers à domicile, de services de soins de suite et de réadaptation, d’établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes ou d’autres établissements médico-sociaux.
Les diverses études ponctuelles qui ont été menées sur des échantillons limités d’établissements montrent que la proportion des journées d’hospitalisation non pertinentes est importante. Les taux d’inadéquation relevés sont en général de 15 % à 30 %, mais peuvent aller jusqu’à 70 %. Le ministère de la santé et des sports a lancé une étude pour mieux appréhender les taux d’inadéquation et quantifier les impacts économiques. Elle devrait être achevée prochainement.
La réduction des inadéquations hospitalières devra être un objectif prioritaire des agences régionales de santé et des établissements. Les axes d’amélioration sont connus. Il s’agit d’améliorer l’organisation et le fonctionnement interne des établissements de santé, de développer les alternatives à l’hospitalisation complète, de créer des structures d’aval adaptées et d’améliorer l’organisation des filières de prise en charge des usagers.
Cependant, le développement d’une approche plus qualitative du fonctionnement d’un établissement de santé doit aussi conduire à s’interroger sur la pertinence des soins et des interventions.
Les enquêtes qui ont été menées sur la pertinence des interventions et les analyses des pratiques locales mettent en évidence des disparités importantes de fréquence dans les interventions et dans les types de prise en charge. La Fédération hospitalière de France a notamment réalisé des études sur la pratique de la césarienne et de l’appendicectomie. L’augmentation continue de la pratique de la césarienne semble s’expliquer par divers facteurs : la volonté d’améliorer l’organisation des naissances afin de pallier des sous-effectifs dans le cadre de la permanence des soins, notamment dans les petites maternités, ou pour éviter les embouteillages dans les grandes maternités. Mais une autre hypothèse est aussi avancée : la volonté d’optimiser les coûts de production, grâce à la programmation des soins. Par ailleurs, l’analyse de la pratique de l’appendicectomie fait apparaître des disparités locales. Celle-ci est davantage pratiquée dans les zones rurales, probablement en raison des difficultés d’assurer une permanence des soins efficace, en radiologie notamment.
Cela pose la question de l’égalité d’accès de tous les usagers à des soins de qualité. D’autant que les différences de pratiques ne sont souvent que partiellement explicables. L’analyse des différences de pratiques et de la pertinence des interventions et des soins devrait faire l’objet de travaux de recherche et d’études complémentaires. La mise en place d’indicateurs comparatifs d’hospitalisation pour les diverses affections permettrait d’améliorer la connaissance dans ce domaine.
b) Assurer la qualité des soins
La fonction de l’hôpital est de produire du service médical. De ce fait, la performance des établissements de santé dépend en grande partie du niveau de qualité de la prise en charge des usagers.
Depuis sa mise en place en 1996, la procédure d’accréditation des établissements de santé publics et privés, qui consiste en une évaluation externe et indépendante de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé, a évolué. La seconde version (V2), qui est utilisée à partir de 2010, couvre un champ plus large et est plus exigeante que la première version, mais elle comporte moins d’indicateurs. Elle vise toujours à faire un état des lieux de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement, mais ajoute l’obligation pour l’établissement d’apporter des réponses sur le niveau de qualité atteint et d’apprécier les démarches d’évaluation des pratiques professionnelles.
La certification est établie sous le contrôle de la Haute Autorité de santé à partir d’une auto-évaluation réalisée par l’établissement de 28 références (au lieu de 44 dans la V1) déclinées en 82 critères (au lieu de 138 dans la V1) concernant la politique et la qualité du management (la stratégie de l’établissement, le pilotage interne, la gestion des ressources humaines et financières, le système d’information, les fonctions logistiques, la gestion des ressources physiques et la qualité de l’environnement, la qualité et la sécurité des soins) et la prise en charge du patient (le respect des droits du patient, la bientraitance et la prise en charge de la douleur, le parcours du patient et la prise en charge médicale ainsi que l’évaluation des pratiques professionnelles).
Le bilan de la certification auquel a procédé la Haute Autorité de santé, sur la base d’une enquête effectuée dans une cinquantaine d’établissements en 2007, montre que les établissements se sont pour la plupart mobilisés pour répondre aux recommandations et réserves formulées lors de l’attribution de la certification, et que des améliorations significatives ont été apportées qui ont pu nécessiter des adaptations importantes de l’organisation des établissements. La Haute Autorité estime que la certification a ainsi permis d’agir positivement sur des points essentiels pour l’amélioration de la qualité de la prise en charge des usagers, tels que les conditions de dispensation des médicaments, le signalement des infections nosocomiales, l’évaluation de la pertinence des pratiques professionnelles, la justification de la prescription d’examens, l’hygiène des locaux et l’élimination des déchets.
Il faudra vérifier que la nouvelle version de la certification permettra d’en renforcer l’impact sur la qualité et la sécurité des soins. Chaque établissement devrait s’inscrire dans une démarche d’amélioration globale de la qualité et de la sécurité des soins et devrait définir une stratégie de développement de la qualité de nature à générer des changements partagés par les équipes et les personnels concernés. À cet égard, il faut rappeler que la certification par la Haute Autorité de santé porte sur le fonctionnement global de l’établissement de santé et non sur des secteurs d’activité. Les établissements devraient donc être incités à rechercher des certifications, complémentaires à celle délivrées par la Haute Autorité de santé, concernant des services spécialisés dans un domaine (ISO 9001) ou un secteur d’activité (par exemple, délivrée par l’agence de la biomédecine pour l’activité de prélèvements).
Au-delà, la Haute Autorité de santé devrait mettre en œuvre une véritable régulation par la qualité de l’activité des établissements de santé. Pour ce faire, elle devrait mesurer de manière précise l’impact de la certification et entretenir la dynamique d’amélioration de la qualité dans les établissements en assurant le suivi continu d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
En dehors de la certification de nombreuses actions contribuent à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins : la fixation de seuils d’activité, notamment pour les maternités, la chirurgie, la cancérologie ou d’autres activités hautement spécialisées (cardiologie adulte et pédiatrique, neurochirurgie, neuroradiologie…).
En outre, l’introduction de procédures de routine dans l’exercice de certaines activités peut permettre de réduire les risques de non-qualité ou d’accidents médicaux.
La check list « sécurité du patient au bloc opératoire »
Afin d’améliorer la sécurité du patient lors des interventions chirurgicales, la Haute Autorité de santé a décidé de faire de l’utilisation d’une check-list dans l’organisation des blocs opératoires un critère exigible pour la certification des établissements de santé. Ainsi, depuis le début de 2010, les équipes médicales ont l’obligation d’effectuer la vérification systématique d’une liste de dix points critiques, aux trois moments charnières d’une opération : avant l’anesthésie (vérification de l’identité du patient et d’éventuelles allergies), avant l’intervention elle-même (vérification de l’intervention prévue et de sa localisation, nécessité d’antibiotiques…) et après l’intervention (décompte des matériels, prescriptions postopératoires). Cette obligation de contrôle interne s’inspire du dispositif de la check list utilisée dans l’aéronautique qui a fait la preuve de son efficacité.
Par ailleurs, la lutte contre les infections nosocomiales qui a fait l’objet d’actions précises, engagées depuis une quinzaine d’années, visant à structurer la lutte, améliorer l’organisation des soins et l’hygiène, assurer le recensement et le signalement, donne des résultats intéressants bien qu’encore insuffisants. Selon la dernière enquête réalisée par le ministère de la santé, en 2006, sur les 271 100 patients présents dans les établissements de santé (avec un taux de couverture des établissements proche de l’exhaustivité), 11 500 souffraient d’une infection nosocomiale, soit 4,25 % des patients. Par rapport à l’enquête précédente, effectuée en 2001, le taux de prévalence a diminué de 7,7 % (4,61 en 2001).
La mise en place d’indicateurs de suivi (indicateur composite de lutte contre les infections nosocomiales ICALIN, indicateur de surveillance des infections en site opératoire, indice de bon usage des antibiotiques, indicateur de consommation des solutions hydro-alcooliques, taux d’incidence de staphylocoques dorés résistant à la méticilline) permet d’améliorer la connaissance et de renforcer l’efficacité des actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Cependant, il faudra que la politique de prévention des infections nosocomiales soit encore améliorée et fasse l’objet d’une constante attention de la part des personnels. Cela est d’autant plus important que le risque potentiel d’être exposés à une infection nosocomiale pourrait augmenter dans les années à venir en raison du développement de nouvelles techniques invasives qui permettent de maintenir en vie des personnes très fragiles et du vieillissement de la population qui entraîne une augmentation de l’âge moyen des personnes admises à l’hôpital.
Dans ce domaine également, il convient de développer la culture de la comparaison afin d’améliorer les performances des hôpitaux, en particulier en ce qui concerne la qualité et la sécurité des soins qui constituent la raison d’être des établissements.
Le développement de démarches d’évaluation des pratiques professionnelles participe également à la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Les équipes médicales devraient procéder systématiquement à des revues de morbidité et de mortalité, dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaire, non seulement pour ce qui concerne les activités de chirurgie, d’anesthésie-réanimation et de cancérologie mais aussi dans certains secteurs d’activité clinique ou médico-technique (psychiatrie, coloscopie…).
Au-delà, et partant de l’idée que les soins dispensés visent à améliorer l’état de santé de l’usager, il serait souhaitable que la Haute Autorité de santé étudie la possibilité de mesurer l’efficacité des soins et de mettre en place des indicateurs susceptibles de renseigner sur les résultats des prises en charge.
En outre, la Haute Autorité de santé devra se mobiliser davantage pour améliorer la gestion par l’efficience médico-économique des établissements de santé. Elle devra utiliser davantage le pouvoir qui lui a été donné d’émettre des recommandations et avis médico-économiques sur les prises en charge les plus efficientes. À partir de ses travaux de certification des établissements et des évaluations de la pertinence, de la qualité et de la sécurité des soins qu’elle réalise, la Haute Autorité de santé devrait pouvoir mettre en évidence les organisations des prises en charges et des soins les plus efficientes afin d’en assurer la promotion par le biais de recommandations adressées aux établissements de santé. La Haute Autorité de santé doit effectuer le rapprochement entre le constat, rappelé plus haut, de différences considérables dans les moyens mobilisés pour assurer les prises en charge et produire les soins, d’une part, et les conséquences de ces différences sur la qualité du service médical rendu aux usagers, d’autre part. La Haute Autorité de santé doit réaliser ce travail de synthèse. Ses recommandations, spécialisées selon les activités et les structures, doivent avoir pour objectif d’améliorer l’efficience médico-économique dans les établissements et de réduire les écarts entre les établissements, pôles, services et autres organisations internes. Les établissements devront appliquer ces recommandations. Il pourrait être prévu de les rendre opposables. Bien évidemment, la Haute Autorité de santé devrait s’assurer de leur application, en particulier lors de ses visites effectuées dans les établissements dans le cadre de la procédure de certification.
7. Améliorer les politiques d’achats et garantir la sécurité juridique des marchés publics passés par les établissements publics de santé
a) Recourir davantage aux groupements d’achats
Les achats, notamment de médicaments, de dispositifs médicaux, de transports sanitaires, de fournitures hôtelières, d’énergie et de maintenance, représentent un poste important de dépenses des établissements de santé. Or, d’après les études comparatives qui ont été réalisées par la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers sur un échantillon d’établissements, les écarts de prix d’achat des produits et services sont importants, puisqu’ils peuvent varier de 5 % à 90 %, selon les produits. Le gain théorique moyen sur la gamme de produits étudiés s’élève à 14 %. Ce constat d’une forte variation des prix entre les établissements a conduit à rechercher des modalités d’achat moins coûteuses et à recourir à la solution du groupement d’achats. Selon la Fédération hospitalière de France, il existerait 341 groupements d’achats qui ont été constitués par regroupements de types d’établissements, par types de produits ou sur une base territoriale, le plus souvent régionale. La taille critique serait de 200 millions d’euros. Selon des données émanant de deux groupements d’achats importants, dont le groupement qui réunit 31 CHU et une vingtaine de grands centres hospitaliers et représente près de la moitié du marché des achats hospitaliers, la solution du groupement d’achat peut permettre d’économiser environ 10 % du montant des achats.
Il est probable qu’il existe encore des marges de gains dans ce domaine. Il faut donc que les établissements recourent obligatoirement à la solution de groupements d’achats lorsqu’ils existent et que les groupements d’achats soient eux-mêmes incités à se regrouper pour dépasser la taille critique et optimiser les gains.
Il faut cependant rappeler que l’appréciation de la qualité de la politique d’achats ne se résume pas au prix obtenu du fournisseur, mais qu’elle doit prendre aussi en compte la juste évaluation du besoin, la précision et la qualité des spécifications techniques ainsi que la maîtrise des consommations. Sur ces différents thèmes des progrès pourraient être, sans doute, aussi accomplis. L’amélioration de l’organisation du processus d’achat et d’approvisionnement et la professionnalisation de cette fonction peuvent non seulement permettre de gagner sur les prix, mais aussi sur les coûts internes de fonctionnement de l’établissement et sur la qualité du service rendu aux usagers.
Par ailleurs, il n’est malheureusement pas inutile de rappeler que chacun des établissements publics de santé doit être vigilant en ce qui concerne le respect des procédures de passation et d’exécution des marchés publics. Les règles du code des marchés publics relatives à la transparence, à la publicité, à la mise en concurrence, à la conclusion et au paiement des marchés publics, de même que les règles de conservation des archives de marchés publics peuvent, certes, apparaître compliquées et contraignantes, mais elles visent à garantir la sécurité juridique des achats et le bon usage de l’argent public. Elles doivent donc être scrupuleusement respectées par tous les établissements.
Les services d’achats et de contrôle interne des établissements publics de santé devraient être particulièrement mobilisés sur ce thème. Les services achats des établissements peuvent notamment se référer à la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics. Par ailleurs, il serait souhaitable que le contrôle de légalité joue pleinement son rôle dans ce domaine et que les chambres régionales des comptes exercent un contrôle attentif afin de vérifier plus souvent la régularité des marchés publics passés par les établissements hospitaliers (1).
c) Mutualiser les fonctions supports
Dans la logique de recherche d’efficience, de partenariat et de complémentarité, il serait nécessaire que les agences régionales de santé fixent, dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, des objectifs concernant la mutualisation entre établissements hospitaliers de certaines fonctions supports, comme la stérilisation, la restauration ou la blanchisserie qui représentent 10 % du budget de fonctionnement des établissements. Les gains réalisés par les établissements pourraient être redéployés dans l’amélioration de la prise en charge médicale. Dans certains cas et sous certaines conditions, il peut être intéressant de recourir à des prestataires extérieurs à l’établissement pour certaines activités médico-techniques (radiologie, laboratoire, blocs), des prestations techniques (maintenance, réparation ou sécurité des bâtiments) ou des fonctions support de restauration, linge et déchets.
C. SIMPLIFIER LE PARCOURS DU PATIENT ET ASSURER LE RECOUVREMENT DES RECETTES
L’hôpital doit permettre à chacun d’accéder à des soins de qualité sur tout le territoire et contribuer à mieux répondre aux différents besoins de chaque personne soignée. Car traiter la maladie, ce n’est pas seulement prodiguer des soins. C’est aussi assurer une prise en charge globale de la personne, durant tout son parcours de soins.
1. Faciliter le parcours de l’usager
Outre le droit de l’usager à des soins de qualité, celui-ci, généralement placé en situation de faiblesse en raison de la maladie ou de l’affection à traiter, doit être accueilli dans l’établissement de santé dans de bonnes conditions.
a) Simplifier le parcours de l’usager dans l’établissement hospitalier
L’entrée et l’accueil à l’hôpital constituent le premier contact de l’usager avec l’établissement. L’entrée est donc un moment très important qui devrait être mieux utilisé pour organiser la prise en charge de l’usager et l’informer sur les différentes étapes du parcours de soins. L’organisation de l’accueil donne souvent une bonne idée de la qualité de l’organisation générale d’un établissement. L’efficacité et la continuité de la prise en charge et des soins supposent la mise en place d’une organisation efficiente tout au long du parcours de l’usager. C’est notamment le moyen de réduire les temps d’attente aux urgences, lors des consultations spécialisées ou lors des autres étapes du parcours (examens radiologiques et biologiques…).
Afin de faciliter le parcours de soins de l’usager et d’appréhender ce parcours comme un tout et pas seulement comme une succession d’étapes, il serait souhaitable que chaque patient puisse recourir, en tant que de besoin, à une personne unique pour l’accompagner pendant son séjour dans l’établissement. Il pourrait s’agir d’un référent ou d’un « coordinateur des soins », qui serait chargé d’orienter le patient, d’organiser l’ensemble de son séjour et d’être le point de contact pour les intervenants extérieurs, la famille et les aidants.
Par ailleurs, dans un but pédagogique et de transparence, il faudrait de mieux informer les patients sur le coût des traitements et séjours hospitaliers. Il faudrait notamment que les tarifs des actes réalisés dans les établissements de santé publics soient mis en ligne sur le site Ameli de l’Assurance maladie.
b) Mieux s’impliquer dans la prise en charge en amont et en aval de l’hôpital
Afin d’améliorer l’efficience de la prise en charge des usagers, la continuité et la coordination de la prise en charge tout au long de la chaîne du soin, il est aussi essentiel d’améliorer le partage des informations à l’intérieur des établissements, mais aussi avec l’amont et l’aval de l’hôpital. Or, les dossiers patients dans les établissements sont encore parfois incomplets et des améliorations devraient être apportées afin de renforcer l’exhaustivité du recensement des actes, examens et prescriptions. L’amélioration de la gestion administrative de l’usager suppose notamment de supprimer les cloisonnements internes et de mieux articuler les données médicales et les données administratives.
La bonne tenue du dossier patient concourt à la qualité de la prise en charge pluri professionnelle et pluridisciplinaire qui est souvent nécessaire. Compte tenu de la tendance au recentrage de l’hôpital sur les activités aiguës, à la réduction des durées de séjours dans les établissements de santé, que favorise d’ailleurs la tarification à l’activité, ainsi qu’au développement des maladies chroniques, la question du partage de l’information revêt une importance croissante.
Pour fonctionner selon cette logique, les établissements hospitaliers doivent travailler de plus en plus en liaison avec les professionnels et structures d’accueil et de soins situés en amont et en aval de l’hôpital. Afin d’éviter des prolongations de séjours hospitaliers, en raison de difficultés de retour de l’usager à son domicile ou de prise en charge dans un établissement des soins de suite et de réadaptation ou un établissement d’hébergement de personnes âgées, les établissements devraient notamment disposer d’informations, en temps réel, sur les capacités d’hébergement et de prise en charge à la sortie de l’hôpital. Le raccourcissement des séjours doit conduire les établissements à organiser la sortie de l’hôpital, avec les usagers, les proches et les aidants, ainsi que l’ensemble des intervenants, dès l’entrée dans l’établissement, voire avant l’entrée.
Par ailleurs, il faudra permettre à chaque usager, à la sortie de l’établissement, voire au cours du parcours de soins au sein de l’établissement, de faire part à une personne référente de son niveau de satisfaction et de ses observations sur la qualité de la prise en charge médico-administrative.
Tant l’évolution des techniques médicales et de communication que la demande des usagers et l’objectif d’efficience poussent au développement de la télémédecine et de la télésanté. La télémédecine constitue, notamment, un moyen de pallier partiellement les déficiences de l’offre de soins, en particulier en zones rurales. La télésanté peut ainsi contribuer à garantir l’accès de tous à un système de santé de qualité sur tout le territoire.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu les cas dans lesquels la médecine à distance pourra être utilisé : « Elle permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients. » Le champ de la télémédecine est donc très large.
Le développement de la télémédecine et de la télésanté représente un enjeu important pour l’avenir du système de santé. Il devrait entraîner des effets systémiques et contribuer à l’évolution de la structuration de l’offre de soins et de l’organisation des soins. Il suppose aussi que certaines difficultés soient levées, notamment la question de la tarification ou les problèmes de compétence partagée. Le déploiement de la télésanté va probablement modifier les relations entre professionnels de santé, notamment les relations entre les médecins et les infirmiers, mais aussi le parcours de santé de l’usager, ce qui pourra nécessiter une plus grande implication dans sa prise en charge.
De fait, la télésanté va accélérer une série d’évolutions constatées depuis plusieurs années : l’ouverture de l’hôpital sur l’extérieur, l’hôpital devenant un lieu de soins aigus et de recours concentrant des plateaux techniques importants ; le développement des alternatives à l’hospitalisation en établissement, des prises en charge en ambulatoire, de l’hospitalisation à domicile, du maintien à domicile notamment grâce à la télésurveillance dans le cadre de l’accompagnement de la sortie de l’hôpital ; le décloisonnement entre la prise en charge médicale et la prise en charge médico-sociale ; enfin l’amélioration de l’organisation de la permanence des soins et de la continuité des soins.
Tous ces sujets concernent directement les établissements hospitaliers et auront des conséquences multiples sur leur organisation interne et leur fonctionnement. Il est donc nécessaire que les établissements hospitaliers participent au déploiement de la télésanté et qu’ils anticipent et préparent les adaptations nécessaires à réaliser dans les dix ou vingt prochaines années. Ils devraient être un des principaux acteurs de cette évolution structurante pour améliorer le service rendu aux usagers.
2. Favoriser le développement de l’hospitalisation à domicile
L’hospitalisation à domicile (HAD) constitue une alternative à l’hospitalisation complète qui doit être développée afin de favoriser le redéploiement des prises en charge et de mieux répondre aux besoins et aux aspirations des patients.
a) L’hospitalisation à domicile constitue une alternative à l’hospitalisation complète
L’hospitalisation à domicile constitue une modalité d’hospitalisation récente qui est désormais pleinement reconnue.
La première structure officielle d’hospitalisation à domicile a été mise en place, en 1957, par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Par ailleurs, en 1958, l’association d’hospitalisation à domicile « Santé Service » a été créée, avec l’aide de la Ligue contre le cancer, afin de prendre en charge les patients atteints de cancer.
Depuis, le début des années 2000, deux circulaires ont précisé le champ d’application de l’hospitalisation à domicile et son fonctionnement. La circulaire du 30 mai 2000 stipule que « l’hospitalisation à domicile concerne les malades atteints de pathologies graves, aiguës ou chroniques, évolutives ou instables qui, en l’absence de tel service, seraient hospitalisées en établissement de santé ». La circulaire du 1er décembre 2006 rappelle le caractère polyvalent et généraliste de l’hospitalisation à domicile, son régime d’autorisation, ses obligations, le rôle des différents acteurs et son positionnement dans l’offre de soins locale. De fait, l’hospitalisation à domicile concerne les soins de médecine, l’obstétrique comme les soins de suite et de réadaptation.
L’hospitalisation à domicile a vocation à prendre en charge des patients de la naissance à la fin de vie. Elle peut concerner des nouveau-nés dont les parents reçoivent une éducation aux soins, un patient sorti de chirurgie ayant besoin de pansements complexes, ou encore des patients atteints de cancer ou des personnes en fin de vie nécessitant des soins palliatifs. La prise en charge du patient en hospitalisation à domicile est globale. Le médecin de la structure d’hospitalisation à domicile coordonne la prise en charge en liaison avec l’hôpital et le médecin traitant. Les progrès techniques permettent de dispenser des soins médicaux et paramédicaux complexes, continus et fréquents, comparables à ceux dispensés en établissement hospitalier. L’hospitalisation à domicile doit notamment pouvoir faire face à une urgence vitale. Mais, l’activité d’hospitalisation à domicile, en raison de la lourdeur et de la technicité des soins délivrés dans ce cadre, est bien distincte de celle des soins de dialyse à domicile et des soins infirmiers à domicile.
Depuis 2006, les séjours en hospitalisation à domicile sont rémunérés par le biais de la tarification à l’activité, selon des modalités spécifiques. La rémunération correspond à un forfait journalier dont le montant est fonction des soins dispensés au malade et applicable à toutes les structures, publiques ou privées, d’hospitalisation à domicile.
b) Le nombre de places en hospitalisation à domicile est en augmentation sensible
L’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation a prévu l’obligation d’insérer dans les schémas régionaux d’organisation sanitaire un volet concernant l’hospitalisation à domicile. En conséquence, les acteurs régionaux ont intégré le développement de l’hospitalisation à domicile dans l’offre territoriale de soins.
Ainsi, depuis 2000, la capacité offerte en places d’hospitalisation à domicile a été multipliée par 1,7. Toutefois, en 2006, il existait seulement 164 structures d’hospitalisation à domicile en métropole offrant une capacité de 6 700 places. En 2006, l’hospitalisation à domicile a réalisé 85 000 séjours correspondant à 2,1 millions de journées.
Ces résultats peuvent notamment être comparés aux 222 000 lits de médecine, chirurgie et obstétrique et aux 10 millions de séjours en hospitalisation complète.
Le secteur privé non lucratif joue un rôle important dans l’hospitalisation à domicile. Il totalise près de la moitié des structures (78) mais représente les deux tiers des places, 60 % des séjours et 68 % des journées. Le secteur public occupe une place moins importante sur ce créneau d’activité. Il regroupe près de la moitié des structures (74) mais il ne représente que 38 % des séjours et 28 % des journées. Enfin, le secteur privé à but lucratif est très peu présent dans l’hospitalisation à domicile, puisque les douze structures qu’il regroupe ne réalisent que 2 % des journées.
Les soins liés à la périnatalité, comme la surveillance de grossesse à risque et les soins post-partum pathologiques, représentent près d’un quart des séjours en hospitalisation à domicile, les soins en cancérologie 19 % et les soins palliatifs 15 %. La moitié des séjours en hospitalisation à domicile ont une durée inférieure à six jours et les trois quarts des séjours ont des durées inférieures à dix-neuf jours. Seulement 1 % des séjours ont une durée supérieure à huit mois.
c) L’offre de soins d’hospitalisation à domicile reste inégalement répartie sur le territoire
Par nature, l’hospitalisation à domicile reste un mode d’hospitalisation de proximité. L’offre de soins détermine la zone d’intervention de la demande. En effet, pour la plupart, les patients pris en charge en hospitalisation à domicile résident dans des zones proches des structures.
En l’état actuel du maillage territorial, cette alternative à l’hospitalisation conventionnelle ne peut pas être proposée à tous les patients qui pourraient et voudraient en bénéficier. L’Île-de-France concentre à elle seule un tiers des places et la moitié de l’activité y est réalisée. Mais dans nombre de régions, l’hospitalisation à domicile est encore peu répandue. En 2006, un département sur cinq ne disposait d’aucune structure d’accueil en hospitalisation à domicile.
d) L’hospitalisation à domicile doit encore être développée
Afin de développer l’hospitalisation à domicile qui constitue une alternative efficace à l’hospitalisation complète et qui est souhaitée par de nombreux patients, ainsi que pallier les inégalités d’accès, il faudra augmenter le nombre de places d’hospitalisation à domicile.
Les efforts de développement de l’hospitalisation à domicile doivent donc être poursuivis pour adapter le système de soins aux besoins de la population, notamment aux personnes âgées qui sont souvent concernées par des maladies chroniques pouvant justifier des soins en hospitalisation à domicile. À condition de faire l’objet d’un accompagnement de qualité, cette solution est souvent mieux adaptée et moins traumatisante pour ces personnes qu’une hospitalisation complète qui suppose de quitter son logement et son cadre de vie habituel.
Il faudra en conséquence veiller à la réalisation de l’objectif fixé par le Gouvernement de 15 000 places d’hospitalisation à domicile en 2010. Il s’agit d’amplifier le développement de cette modalité de prise en charge qui répond à la demande des patients.
3. Fiabiliser la chaîne de facturation-recouvrement
En régime de tarification à l’activité, il est essentiel de facturer les actes. Mais la bonne gestion impose aussi de recouvrer les factures. Or, ce n’est pas toujours le cas.
M. Christian Anastasy, directeur général de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, a notamment indiqué, lors de son audition par la MECSS : « Un sondage montre que 22 CHU sur 27 ne facturent pas les 18 euros qui sont dus par l’assurance maladie à tout établissement qui fait des actes supérieurs à KC 50. »
De fait, comme l’a souligné M. Jacques Métais, qui était directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France au moment de son audition par la MECSS : « certains établissements éprouvent des difficultés à encaisser une partie de leurs recettes, notamment dans le cadre des consultations externes et des urgences. C’est un vrai problème pour certains établissements, mais on constate que d’autres ont su s’organiser, y compris dans des zones de précarité où la clientèle est non seulement défavorisée mais aussi difficile à localiser ».
En outre, selon M. Luc Paraire, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines qui a été auditionné par la MECSS, les recettes non perçues par certains établissements pourraient représenter 5 % des recettes d’exploitation. Dans le cas du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, certaines années l’ensemble des actes non facturés pourrait avoir représenté de l’ordre de 15 % de ses recettes potentielles.
Et selon plusieurs directeurs auditionnés par la MECSS, la décentralisation du codage des actes dans leur établissement a fait apparaître, a posteriori, 5 % de sous-facturation.
a) Favoriser le recouvrement direct des consultations externes
L’exemple de la facturation des consultations externes dans les hôpitaux permet d’illustrer la difficulté des établissements à s’adapter à la nouvelle donne financière que constitue la tarification à l’activité.
Nombre d’établissements hospitaliers ont longtemps considéré que l’activité de consultations externes était une activité secondaire par rapport aux activités d’hospitalisation. L’enjeu financier qu’elles représentaient était perçu comme mineur par les décideurs hospitaliers et les consultations externes se sont développées, parfois de manière empirique, sans que leur soit accordée toute l’attention souhaitable, en particulier en matière de recouvrement des facturations.
Avec le financement par budget global, les établissements hospitaliers n’avaient pas d’incitation à agir pour assurer un recouvrement efficace et aussi exhaustif que possible. Que l’établissement fasse ou non payer les patients n’avait pas d’impact sur le budget de l’établissement. L’objectif était de maîtriser l’activité et d’éviter les comportements inflationnistes. Mais l’inconvénient était que les établissements n’étaient pas incités à recouvrer la part des frais de soins due par les patients.
Avec la tarification à l’activité, l’amélioration du recouvrement est devenue une nécessité. Aucun dispositif n’est prévu pour compenser le manque à gagner résultant d’un défaut de recouvrement. Or, les travaux de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers, réalisés en 2008 sur un échantillon d’établissements, ont montré que beaucoup d’établissements hospitaliers laissaient partir les patients sans rien leur avoir demandé de payer, ni au moment de leur venue en consultation, ni au moment de leur sortie. Dans ce cas, la facture est, en principe, envoyée a posteriori au patient. Mais les trésoreries des établissements renoncent à facturer les montants inférieurs à un seuil de recouvrement, généralement de 5 euros. En dessous de ce montant, il est en effet considéré que la procédure de recouvrement est trop coûteuse, au regard de la somme à récupérer. Or, avec le mécanisme du ticket modérateur, il est fréquent que les patients aient à payer moins de 5 euros et, en conséquence, ne reçoivent jamais de facture. C’est notamment le cas de ceux ayant bénéficié d’une simple consultation.
Dans d’autres cas, la consultation est accompagnée d’actes complémentaires de radiologie, de biologie ou d’examens divers qui sont bien facturés mais, en raison de défaillances dans les systèmes d’information, il n’est pas possible de faire la liaison entre la consultation du patient et les actes complémentaires. Il n’est donc pas possible d’attribuer l’ensemble des facturations au patient. C’est ainsi que certains actes ne sont jamais facturés, faute d’un enregistrement efficace.
Au total, si l’on ajoute les non-facturations, les recouvrements tardifs, occasionnant des contentieux coûteux, et les créances irrécouvrables, notamment auprès de personnes en difficulté, l’enjeu financier que représente la facturation-recouvrement est important et peut peser lourd dans les déficits des établissements.
Au-delà de l’aspect financier, les dysfonctionnements dans la chaîne de facturation-recouvrement peuvent donner une mauvaise image de l’établissement et favoriser des comportements peu respectueux de la part de certains patients (non-venues, non-respect des horaires) de nature à engendrer des désorganisations de services de soins et des pertes d’efficacité, également coûteuses et pouvant affecter la qualité de la prise en charge.
La mise en place de circuits de facturation-recouvrement efficaces constitue encore un enjeu important pour nombre d’établissements. Certains établissements développent le prépaiement pour certaines consultations. Il faut encourager le paiement des consultations ainsi que des actes et examens programmés, au moment de l’entrée de l’usager dans l’établissement. Dès lors, les établissements hospitaliers seront amenés à améliorer le circuit administratif des patients et, pour cela, à rationaliser l’implantation des guichets et revoir les horaires d’ouverture afin de les faire correspondre avec ceux des consultations, notamment en fin d’après-midi.
M. Philippe Ritter, président du conseil d’administration de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, rappelait ainsi, lors de son audition par la MECSS : « lorsque j’étais directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de l’Île-de-France, j’ai été frappé de constater que, dans nombre d’établissements, notamment dans les banlieues de l’Ouest et du Nord de l’Île-de-France, la caisse fermait à trois heures de l’après-midi alors que les sorties se faisaient vers dix-sept heures. On s’étonnait ensuite qu’il soit difficile de faire payer les factures à la clientèle, une fois rentrée chez elle. »
b) Expérimenter la facturation directe avant de décider sa mise en oeuvre
La mise en œuvre de la facturation directe dans les établissements anciennement financés par dotation globale a déjà été retardée à plusieurs reprises.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 qui a mis en place la T2A a prévu certaines dispositions transitoires. Le I de l’article 33 de cette loi a notamment fixé le principe de la facturation directe à la sécurité sociale des prestations d’hospitalisation et l’application de cette disposition au 1er janvier 2006. Il a été aussi prévu que, durant une période transitoire de deux ans, la facturation s’effectuerait de façon agrégée par le biais de la communication des données d’activité à l’agence régionale de l’hospitalisation, laquelle procéderait ensuite à la valorisation des prestations en fonction des tarifs applicables.
Devant les difficultés de mise en œuvre de la facturation directe, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a reporté, de trois ans, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2009.
À la suite du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, de décembre 2008, consacré à ce sujet, qui soulignait l’impossibilité de mettre en œuvre la facturation directe en raison d’un défaut de pilotage et de difficultés techniques, la loi de financement pour 2009 a prévu un nouveau report, de deux ans et demi, au 1er juillet 2011. Cependant, la possibilité d’effectuer des expérimentations dans l’intervalle a été ouverte. Mais le décret en fixant les conditions de mise en œuvre et l’arrêté devant fixer la liste des établissements volontaires n’ont pas encore été publiés.
Au total, l’application du principe de la facturation directe, initialement fixée au 1er janvier 2006 et désormais fixée au 1er juillet 2011, a, pour le moment, été reportée de cinq ans et demi.
Selon M. Frédéric van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie : « La facturation individuelle introduira davantage de transparence dans les activités des établissements ; elle permettra de vérifier que les paiements se font à bon droit et favorisera la mise en place de programmes d’accompagnement des patients ainsi que le déclenchement d’actions de prévention secondaire ou tertiaire…La facturation individuelle n’est pas qu’un projet informatique ; elle vise également à améliorer l’organisation des établissements de santé et à mieux anticiper la sortie des patients, afin d’améliorer la fluidité des parcours. »
Il faudra cependant évaluer soigneusement les expérimentations qu’il est prévu de lancer prochainement, de manière à mesurer ce que la facturation directe apporterait véritablement par rapport à la situation actuelle compte tenu, notamment, du coût de gestion et de la charge de travail qui en résulterait.
En tout état de cause, le rôle des départements d’information médicale est désormais essentiel pour améliorer le recouvrement des recettes correspondant précisément à l’activité des établissements et s’assurer, à cet effet, de l’exhaustivité et de la qualité du codage des séjours et des actes effectués par des personnels spécialisés ou, de préférence, par les praticiens eux-mêmes à la source du soin.
IV.- CLARIFIER LE FINANCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
A. ADAPTER LE MODE DE FINANCEMENT ET MODERNISER LE PATRIMOINE HOSPITALIER
La tarification à l’activité a été conçue par ses auteurs comme un levier d’amélioration de l’efficience. À ce stade, les résultats obtenus ne paraissent pas à la hauteur des espérances initiales. Il conviendrait d’en clarifier les objectifs mais aussi de concilier la réponse à la demande de stabilisation exprimée par les établissements hospitaliers avec la nécessité d’adapter encore le modèle de financement.
1. La tarification à l’activité ne garantit pas l’efficience
a) Depuis l’année d’application des tarifs de séjours au taux de 100 %, le déficit des établissements hospitaliers à, de fait, tendance à diminuer
L’Inspection générale des affaires sociales a estimé, dans son rapport sur le contrôle des mesures prises dans le cadre des contrats de retour à l’équilibre, publié au mois de janvier 2008, que la mise en œuvre de la tarification à l’activité a eu un effet de révélateur de « la sous-performance » de certains établissements et a ainsi contribué à faire apparaître des déficits jusqu’alors masqués.
Cependant, on peut constater que l’application des tarifs de séjours au taux de 100 % a accompagné à la fois la décélération de la progression de l’ONDAM hospitalier et la diminution du déficit des établissements hospitaliers. En effet, pendant les deux premières années d’application des tarifs de séjours au taux de 100 %, en 2008 et 2009, le déficit des établissements de santé publics a diminué, puisqu’il a été ramené d’environ 700 millions d’euros à 500 millions d’euros. Il s’agit d’une simple constatation. Compte tenu de la complexité du modèle de financement, de la multiplicité des paramètres qui y concourent ainsi que de la multiplicité des établissements et des disparités de situations, il n’est pas possible d’établir un lien de cause à effet précis et direct ou exclusif. D’autant que, parallèlement à la montée en charge de la tarification à l’activité et à la décélération de l’ONDAM hospitalier, la relance de l’investissement hospitalier initiée dans le cadre du plan Hôpital 2007 a contribué à accroître les charges des établissements.
b) Le système de financement n’est pas encore stabilisé
Le nouveau mécanisme d’allocation des ressources aux établissements de santé doit concilier les objectifs de justice et d’efficacité. C’est dans cette logique de recherche d’équité et d’efficience que la tarification à l’activité a été mise en place, afin de dynamiser la gestion des établissements de santé et d’éliminer les disparités historiques de financement entre établissements.
De fait, on observe qu’une multiplicité d’objectifs, auxquels correspondent des enveloppes financières distinctes, a été assignée au nouveau modèle d’allocations de ressources. Ils ne sont pas forcément aisément conciliables.
En conséquence, le nouveau dispositif, comme dans les autres pays qui appliquent le financement à l’activité, est composite. Il comprend trois types de ressources : des tarifs, des dotations et des financements complémentaires. Plus précisément, il allie un financement par des tarifs de séjours hospitaliers ou de prix de journée pour certaines activités (comme l’hospitalisation à domicile ou la dialyse), la prise en charge de certaines prestations en plus des tarifs (comme les médicaments coûteux et certains dispositifs médicaux), l’octroi de dotations pour financer des missions spécifiques, d’intérêt général, d’enseignement et de recherche (les MIG et les MERRI), l’attribution de forfaits annuels pour l’exercice d’activités particulières (comme les urgences ou les greffes) et, enfin, une enveloppe financière mise, chaque année, à la disposition des agences régionales de santé (la partie aide à la contractualisation – AC – des MIGAC).
Dans la perspective de faire converger les tarifs applicables au secteur public et ceux concernant le secteur privé, le principe général du nouveau mode de financement est de financer par des tarifs ce qui peut et doit l’être et de financer par des dotations ou d’autres modalités ce qui ne peut pas être intégré dans les tarifs.
Répartition des financements en objectif 2009
Secteur public |
Secteur privé | |
Tarifs de séjours |
72,63 % |
80,15 % |
Remboursements listes en sus médicaments et dispositifs médicaux implantables |
6,75 % |
16,15 % |
Forfaits annuels |
2,23 % |
2,28 % |
Dotations au titre des missions d’intérêt général et des aides à la contractualisation (MIGAC) |
18,38 % |
1,31 % |
Total |
100 % |
100 % |
Source : Cour des comptes
Les établissements publics de santé soumis à la tarification à l’activité sont donc globalement financés presque à hauteur des trois quarts par les tarifs de séjours et de près d’un cinquième par les dotations MIGAC. Mais alors que l’objectif de dépenses de médecine, chirurgie et obstétrique a augmenté de 2,4 %, en moyenne annuelle, de 2005 à 2009, les dotations MIGAC ont augmenté de 12,1 %, en moyenne annuelle sur cette même période. L’évolution des dotations d’aide à la contractualisation a notamment contribué à cette augmentation, puisqu’elles sont passées de 762 millions d’euros, en 2005 à 2,127 milliards d’euros en 2007, soit un quasi-triplement en trois ans. Cette tendance à la hausse de l’enveloppe d’aide à la contractualisation s’est poursuivie. Parallèlement, les remboursements en sus des tarifs des produits inscrits sur les listes ont augmenté très fortement ces dernières années, à un rythme moyen annuel supérieur à 10 % (+ 11,6 %, en 2008 et + 16 % pour les médicaments). Ainsi, alors que la part que représentent dans l’enveloppe hospitalière les dotations MIGAC et les remboursements en sus augmente fortement, a contrario, la part tarifaire diminue légèrement mais demeure prépondérante.
Évolution des composantes du financement des établissements de santé
Montants |
Part des différentes composantes | ||
2009 |
2005 |
2009 | |
Objectifs de dépenses (1) |
68 520 |
- |
- |
I. Établissements tarifés à l’activité |
50 828 |
73,2 % |
74,2 % |
1. Objectif de dépenses de médecine, chirurgie et obstétrique (ODMCO) |
43 134 |
89,1 % |
84,9 % |
Part activité |
37 645 |
90,4 % |
87,3 % |
Médicaments et dispositifs médicaux implantables |
4 340 |
7,4 % |
10,1 % |
Forfaits annuels |
1 150 |
2,1 % |
2,7 % |
2. Dotations au titre des missions d’intérêt général et des aides à la contractualisation (MIGAC) |
7 694 |
10,9 % |
15,1 % |
II. Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
17 691 |
26,8 % |
25,8 % |
1. Objectif de dépenses d’assurance maladie (ODAM) |
15 515 |
89,3 % |
87,7 % |
2. Objectif quantifié national (OQN) de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation |
2 176 |
10,7 % |
12,3 % |
(1) Hors champ non régulé et hors fonds pour la modernisation des établissements publics et privés de santé.
Source : Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
La définition et la mise en œuvre du nouveau dispositif ont été accomplies rapidement sans que toutes les études nécessaires à son paramétrage et à l’évaluation de ses conséquences n’aient été réalisées. Il en est résulté des difficultés de calage du nouveau modèle de financement. De plus, les adaptations successives auxquels il a fallu procéder ont été effectuées dans des conditions de transparence pas toujours bien assurées et souvent tardivement, ce qui a rendu plus difficile la compréhension du dispositif par les personnels et son application par les établissements.
c) Le nouveau mécanisme de financement ne garantit pas l’efficience
En principe, la tarification à l’activité devrait constituer un levier fort pour inciter les établissements à faire évoluer leur activité et leur organisation afin d’améliorer leur efficience. Comme l’a indiqué M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des sports, lors de son audition par la MECSS : « C’est depuis l’instauration d’un levier tarifaire que se posent les questions de facturation exhaustive, d’analyse de coûts et d’organisation. La T2A exige des changements profonds. » Mais il a aussi ajouté : « Le système d’allocation budgétaire mis en place est vertueux mais il a ses limites : il permet d’impulser des changements mais ne donne pas le chemin pour y parvenir. »
De fait, l’observation de la réaction des établissements confrontés à l’application du nouveau mécanisme de financement incline à penser que les effets de la tarification à l’activité n’ont pas été à la hauteur des espérances initiales. C’est en tout cas le constat qui a été dressé par la Cour des comptes concernant les cinq premières années d’application de la tarification à l’activité, dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2009. Cet avis semble partagé par le comité d’évaluation de la tarification à l’activité qui, dans son second rapport d’activité, publié au mois de septembre 2009, estime que : « la T2A a conduit les établissements à reconsidérer en profondeur leur stratégie et à envisager quelques premiers changements organisationnels, même s’ils demeurent encore le plus souvent assez modestes. » Le comité ajoute que : « La T2A suscite à l’évidence une dynamique de changement qui se traduit par une évolution des comportements d’une partie des acteurs mais qui n’embraye que difficilement sur les problématiques organisationnelles. L’intégration des logiques médico-économiques apparaît réelle chez certains médecins (notamment les chefs de pôle, les DIM…) mais elle reste souvent centrée sur la notion d’activité et se porte plus difficilement sur la recherche d’efficience des processus de prise en charge. »
Compte tenu de la montée en charge très progressive du nouveau dispositif, initialement prévue (part tarifaire limitée à 10 %, en 2004, 25 % en 2005, 35 % en 2006, 50 %, en 2007, puis portée par étapes à 100 %, en 2012), les établissements publics de santé n’ont pas tous bien compris le sens réel du changement de mécanisme d’allocations de ressources ni pris l’exacte mesure des conséquences de ce changement, au terme du processus qui avait été fixé, au départ, à une date assez éloignée, en 2012, justement pour que les établissements puissent s’habituer aux nouvelles règles. Certains établissements, notamment ceux dont l’activité se développe, ont réagi plus promptement que d’autres qui bénéficiaient de l’ancien système de financement par dotation globale.
Cependant, globalement, les établissements publics de santé auxquels est appliquée la tarification à l’activité depuis 2004, pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique, semblent s’approprier, progressivement, les nouvelles conditions de financement et amorcer le changement culturel qu’elles impliquent dans la gestion des établissements. Il aura fallu du temps aux établissements pour qu’ils commencent à procéder aux adaptations nécessaires et certains établissements publics ont encore du mal à s’adapter au nouveau mode de financement. Mais il faut observer que le processus d’adaptation du fonctionnement des établissements en fonction du changement de modèle d’allocations de ressources n’est pas facile à mener car celui-ci demeure complexe et n’est pas encore stabilisé.
d) Le nouveau dispositif ne garantit pas l’accessibilité géographique des soins
La tarification à l’activité correspond à une logique dans laquelle l’activité est déterminée par les offreurs de soins dans un processus de soins décentralisé. Cette logique peut apparaître en contradiction avec la logique de planification sanitaire et d’organisation de l’offre de soins qui se traduit par la fixation d’objectifs quantifiés de l’offre des soins. Ces derniers visent à fixer des volumes d’activité par établissement à l’intérieur de fourchettes dont le non-respect peut, en principe, faire l’objet de sanctions dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Jusqu’à maintenant, ce dispositif s’est avéré peu contraignant mais, selon le comité d’évaluation de la T2A, la logique de proximité de l’accès aux soins semble continuer de primer sur la logique économique. Cette appréciation est néanmoins fragile puisqu’elle est fondée sur une analyse concernant seulement deux régions, la Franche-Comté et le Languedoc-Roussillon.
Le comité d’évaluation devrait élargir son étude et évaluer plus précisément les relations entre accessibilité géographique aux soins et tarification à l’activité. Au-delà, il est nécessaire que les agences régionales de santé jouent leur rôle de régulateur et veillent à la bonne articulation de ces deux logiques afin d’assurer le maintien de l’accessibilité de l’offre de soins. Les outils de la planification régionale, le plan régional de santé et le schéma régional d’organisation des soins ainsi que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens devront être utilisés à cet effet. Un financement au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation correspondant aux contraintes d’aménagement du territoire serait cohérent avec cette démarche.
2. Renforcer l’équité du système de financement pour en faire un levier d’efficience médico-économique
L’application de la tarification à l’activité aux établissements de santé publics devrait leur permettre d’assurer leurs missions de service public et de produire des soins de la meilleure qualité possible tout en assurant la meilleure utilisation des crédits alloués. Mais cet objectif ne peut avoir une chance d’être atteint que si chaque établissement est doté d’une comptabilité analytique efficace lui permettant de porter le bon diagnostic et de prendre les mesures nécessaires en connaissance de cause. En outre, comme l’expérience récente semble le montrer, il ne faut pas assigner à l’outil de répartition des financements que constitue la tarification à l’activité un rôle plus important que celui qu’il peut jouer. Il serait excessif de considérer la tarification à l’activité comme un outil miracle permettant de régler les principaux problèmes que pose la modernisation des établissements de santé publics. On peut d’ailleurs se demander si l’institution de la tarification à l’activité, qui réduit le pouvoir d’orientation des agences régionales de santé, ne va constituer un frein à la mise en œuvre d’une réorganisation et d’une régulation régionale efficace de l’offre de soins.
a) Veiller à l’équité des financements
La question de la répartition des différents financements inclus dans l’ONDAM hospitalier est essentielle. Depuis la mise en place de la T2A, les sous-enveloppes ont eu des évolutions différentes. La forte progression des dotations au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation correspond à la volonté de rémunérer plus justement les missions d’intérêt général, d’enseignement et de recherche. Mais, en contrepartie, la part de l’objectif de dépenses correspondant aux tarifs des séjours de médecine, chirurgie et d’obstétrique a été réduite. D’autant que les dépenses au titre des médicaments coûteux et des dispositifs médicaux sont en forte croissance. Dès lors, deux questions légitimes se confrontent : celle de savoir si la réduction du poids de la part tarifaire ne conduit pas à amoindrir l’amélioration de l’efficience mais aussi celle de déterminer la juste rémunération des missions ne pouvant être incluses dans les tarifs. C’est d’ailleurs là qu’apparaît un des paradoxes de la tarification à l’activité : puisqu’elle se fait au sein d’une enveloppe nationale fermée, toute augmentation des dotations MIGAC produit une réduction des tarifs, lesquels sont pourtant censés refléter de « justes coûts ».
Des progrès peuvent certainement être encore accomplis pour améliorer l’équité des financements et favoriser l’efficience. Chacun des compartiments du financement obéit à sa logique propre et il s’agit au bout du compte d’assurer la cohérence d’ensemble correspondant aux objectifs que l’on s’est fixés. Cela n’est pas simple et si les principes initiaux du nouveau système d’allocation de ressources n’ont pas changé, en revanche les modalités de financement fixées au départ ont évolué, notamment pour prendre en compte les évolutions des modes de prise en charge des usagers (par exemple, création de forfaits greffes et prélèvements, revalorisation des tarifs de soins palliatifs).
b) Veiller à la juste couverture des coûts par les tarifs
La question de la fixation des tarifs est cruciale pour les établissements. Les résultats de l’activité médicale dépendent en grande partie du niveau des tarifs. Or, les auditions de la MECSS ont permis de souligner une difficulté. Les tarifs doivent-ils refléter la réalité des coûts afin de les couvrir exactement ou peuvent-ils être utilisés pour envoyer un « signal prix » et orienter l’activité en fonction de choix stratégiques ? Ces deux objectifs paraissent difficilement conciliables, car si l’on se place dans la seconde hypothèse, cela suppose une décision volontariste des pouvoirs publics consistant à fixer les tarifs d’une activité, dont on souhaite encourager le développement, à un niveau nettement supérieur au coût de production du soin (comme pour la chirurgie ambulatoire ou les soins palliatifs) ou, à l’inverse, à un niveau sensiblement inférieur, si l’on souhaite en réduire la pratique. Cette question n’est pas clairement tranchée, ce qui nuit à la clarté du dispositif. D’autant que la vérité des coûts ne semble pas toujours assurée. Des incertitudes subsistent en effet sur le périmètre des coûts pris en compte dans l’échelle nationale de coûts qui sert de référence pour établir les tarifs. Il sera donc souhaitable de clarifier ce point et de préciser la relation entre tarifs et coûts.
L’augmentation du nombre de tarifs des groupes homogènes de séjours, de 950 à 2 300, prévue par la nouvelle version de la classification (V11), entrée en vigueur en 2009, doit permettre d’améliorer la précision des tarifs, puisqu’ils prennent désormais en compte la lourdeur de la prise en charge en intégrant les comorbidités. Chacune des 611 racines est segmentée jusqu’à quatre niveaux de sévérité. Les établissements qui prennent en charge les cas les plus lourds (souvent les CHU) seront mieux rémunérés qu’auparavant et ceux qui prennent en charge des cas moins lourds seront privés d’un effet d’aubaine. La nouvelle classification vise ainsi à améliorer l’équité du financement des séjours par les tarifs.
Pour autant, à défaut d’un choix entre des tarifs stricts reflets des coûts et des tarifs « d’orientation », on risque de n’avoir ni l’un ni l’autre. C’est à partir d’une connaissance précise de la réalité des coûts que la fixation de tarifs d’orientation permet le pilotage du système.
c) Mieux valoriser la qualité des soins pour éviter les dérives dans l’utilisation de la tarification à l’activité
La recherche de l’efficience médico-économique est un des objectifs qui a motivé l’instauration de la tarification à l’activité. Mais il faut veiller à ce que le nouveau dispositif de financement et ses différentes composantes permettent d’assurer, effectivement, l’efficience économique ainsi que la pertinence, la qualité et la sécurité des soins.
Car, comme M. Benjamin Maurice, qui était, lors de son audition par la MECSS, directeur de la Mission sur la tarification à l’activité et chef du bureau du financement de l’hospitalisation privée à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des sports, l’a indiqué : « La T2A fait partie d’un tout, et le comportement des acteurs ne doit pas être guidé par des considérations uniquement économiques. L’intérêt du malade doit passer avant tout. Ce principe doit être sans cesse réaffirmé.»
Il est vrai également que le modèle actuel de tarification à l’activité ne traite que des séjours et ne prend pas en considération le continuum de prise en charge des patients alors que les maladies chroniques progressent. Une prise en charge continue peut-elle se réduire à une succession de « séjours » ?
Ces sujets sont, curieusement, encore peu étudiés. Le comité d’évaluation de la tarification à l’activité a estimé, dans son premier rapport, qu’il était prématuré d’imputer à la tarification à l’activité d’éventuelles évolutions observées. Dans son second rapport, le comité d’évaluation indique que dans les pays qui ont mis en œuvre un système de tarification à l’activité, il n’a pas pour l’instant été observé d’effet de diminution de la qualité des soins. Avec six ans de recul dont deux avec des tarifs appliqués à 100 %, on doit pouvoir réaliser quelques analyses susceptibles de déboucher sur des résultats intéressants, puis d’en tirer des enseignements. Il faudrait que la direction générale de l’offre de soins ainsi que le comité d’évaluation accélèrent leurs travaux pour mesurer l’impact éventuel de la tarification à l’activité sur la qualité et la pertinence des soins, afin d’éclairer la réflexion sur l’orientation à donner au nouveau mécanisme d’allocation de ressources aux établissements de santé.
D’ores et déjà, d’aucuns considèrent qu’il est nécessaire de renforcer la rémunération de la qualité des soins afin de mieux équilibrer le financement. C’est en particulier le sentiment de M. Laurent Degos, président de la Haute Autorité de santé qui a indiqué, lors de son audition par la MECSS : « il s’agirait de faire contrepoids à la productivité au moyen d’une autre source de financement, telle que l’enveloppe affectée aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), susceptible de prendre en compte la qualité. Il s’agirait de prévoir, dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens, deux enveloppes, l’une destinée à des objectifs quantitatifs, l’autre conditionnée à des critères qualitatifs. »
Cette proposition visant à renforcer la régulation par la qualité est intéressante et mérite d’être étudiée. Il serait d’ailleurs nécessaire que la réflexion prenne en compte dans l’appréciation de la qualité, l’analyse de la pertinence des prises en charge, des actes, des prescriptions, notamment des prescriptions médicamenteuses facturées en sus, et des séjours hospitaliers.
Une meilleure rémunération de la qualité aurait en outre pour effet d’éviter ou de limiter certaines dérives possibles dans l’utilisation du nouveau mécanisme de financement et certains effets pervers, comme l’orientation des établissements vers les activités les plus rentables, l’incitation au développement de l’activité (notamment pour rétablir un équilibre financier), la sélection des patients, le tronçonnage des prises en charge et le développement du nomadisme des patients, les actes non pertinents ou de moindre qualité, l’externalisation des prestations (examens réalisés « en ville »), l’optimisation du codage et le surcodage.
Le comité d’évaluation devra accélérer ses travaux sur ces éventuels effets indésirables. Sous réserve que le comité ait mis en place, comme cela était initialement prévu, les instruments d’analyse nécessaires, celui-ci devrait aujourd’hui être en mesure de livrer des informations de portée générale, précises et utiles sur la mise en œuvre du dispositif par les établissements et ses effets sur la performance économique des établissements, la qualité des soins et l’accès aux soins.
d) La question de l’éventuelle convergence des tarifs des secteurs privé et public reste posée
La convergence intra sectorielle est en voie d’être atteinte, comme cela est prévu, en 2012. En 2009, cette convergence était réalisée à 80 % dans le secteur public et à 71 % dans le secteur privé.
En revanche, la question, importante et sensible, de la convergence des montants des tarifs applicables dans le secteur privé et dans le secteur public, dite convergence intersectorielle, reste posée. Le principe de la convergence intersectorielle a été pendant plusieurs années fortement contesté par les établissements publics de santé, notamment par les plus importants qui bénéficiaient de l’ancien système de financement, ce qui a beaucoup compliqué la mise en œuvre du nouveau mécanisme d’allocation des ressources. De fait, le secteur public et le secteur privé ont des logiques de fonctionnement et des contraintes qui sont de nature différente et justifient des modes de financement distincts.
Chronologie de la convergence intersectorielle
PLFSS 2004 : l’exposé des motifs énonce le principe de la convergence.
LFSS 2005 : la convergence doit s’effectuer « dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs, au plus tard en 2012. » En outre, la loi fixe un objectif intermédiaire de réduction de l’écart entre les tarifs de 50 % en 2008.
LFSS 2008 : le processus de convergence doit être orienté vers les tarifs des cliniques privées, l’échéance intermédiaire de 2008 est supprimée et le principe de tarifs identiques pour les prestations nouvellement créées est posé.
LFSS 2009 : chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les travaux préparatoires à la convergence.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires reporte l’échéance de 2012 à 2018.
Depuis le lancement de la tarification à l’activité, plusieurs évolutions ont permis de réduire les écarts de tarifs entre les secteurs. Des progrès ont notamment été accomplis afin de clarifier les périmètres des charges couvertes par les tarifs. La comparaison des périmètres des charges couvertes montre en effet des différences importantes qui faussent l’appréciation des écarts de coûts entre les deux secteurs. Les rémunérations des médecins qui constituent une part importante des dépenses sont prises en compte dans les tarifs du secteur public, alors qu’elles sont hors tarifs pour le secteur privé. Les actes de biologie d’imagerie et d’exploration fonctionnelle sont aussi inclus dans les tarifs du secteur public contrairement à ceux du secteur privé, où leur rémunération s’effectue par le biais d’honoraires.
Les missions d’intérêt général assumées, pour l’essentiel, par le secteur public doivent être prises en compte à leur juste valeur. Des améliorations ont été apportées pour affiner la liste et mieux évaluer les missions rémunérées par des dotations. D’autres évolutions récentes ont permis d’améliorer l’équité du financement en retirant certaines charges du périmètre des tarifs pour les faire couvrir par les dotations MIGAC. Ainsi, en 2009, d’une part, le coût des gardes et astreintes médicales liées à la permanence des soins hospitalière a été retiré des tarifs, afin de constituer une enveloppe MIGAC, d’un montant de 760 millions d’euros en année pleine, d’autre part, une enveloppe précarité d’un montant de 100 millions d’euros, financée par un retrait de la base des tarifs, a été constituée, au sein des MIGAC. Il serait d’ailleurs souhaitable d’affiner le chiffrage du coût de ces missions.
Parallèlement à ces opérations de transferts entre enveloppes, les travaux menés sur les différences de charges entre les secteurs ont permis de mieux appréhender les écarts de coûts.
Selon les différentes évaluations réalisées, l’écart facial tarifaire intersectoriel qui était de 40 %, en 2006, se situait dans une fourchette de 18 % à 24 %, en 2009.
Le report de l’objectif de convergence de 2012 à 2018 devrait permettre de poursuivre les travaux d’évaluation des différences de charges et de coûts (charge en soins, coût du travail, activité non programmée, effets de gamme et de taille, activités péri-hospitalières, fiscalité) en distinguant ceux, justifiés par des différences dans la nature des charges, de ceux, non justifiés, traduisant des différences d’efficience, avec l’objectif de mener à terme la convergence intrasectorielle qui est considérée comme une étape vers la convergence intersectorielle. Il serait parallèlement souhaitable de poursuivre le mouvement de clarification et de réduction des écarts de tarifs correspondants à des écarts de coûts non justifiés, ainsi que les opérations de transferts d’enveloppes, de la base tarifs aux dotations MIGAC, correspondant à des différences de coûts justifiées devant être financées par des dotations MIGAC. En 2010 une expérimentation doit être menée prévoyant des rapprochements tarifaires concernant une liste de séjours.
Cependant, afin d’assurer l’équité entre les secteurs, il ne faudra envisager la convergence que dans la limite des écarts de coûts objectivés et justifiés. Autrement dit, à terme, il sera nécessaire de maintenir des écarts tarifaires, dès lors que ceux-ci sont légitimes, c’est-à-dire justifiés par des différences dans la nature des charges s’imposant aux établissements.
On peut d’ailleurs rappeler que l’harmonisation des modalités de financement n’est pas synonyme de convergence des tarifs. Les deux objectifs initiaux assignés à la T2A sont distincts. L’harmonisation des modalités de financement correspond seulement à la volonté de financer les mêmes missions selon des modalités identiques. À ce stade, on ne peut donc écarter l’hypothèse que, au terme du processus de clarification qui a été engagé, des écarts subsistent qui justifient l’application de tarifs différenciés. La mise en cohérence des tarifs entre le public et le privé ne débouche pas nécessairement sur l’identité de ces tarifs.
Le débat sur la convergence doit désormais être aussi appréhendé sous un jour nouveau, dans la mesure où la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires fait évoluer le champ de compétence et les responsabilités des établissements de santé, en établissant la liste de quatorze missions de service public, recoupant en partie les missions d’intérêt général financées par les MIGAC, pouvant être prises en charge par les établissements de santé, quel qu’en soit le statut. Lorsqu’une mission de service public n’est pas assurée sur un territoire de santé, l’agence régionale de santé désigne la ou les personnes qui en sont chargées. Cette évolution qui a fait l’objet de vifs débats au Parlement est censée correspondre à une volonté de développer une dynamique territoriale de l’offre de soins pouvant se traduire par la mise en place de recompositions, de partenariats et de coopérations entre établissements, par exemple au sein de communautés hospitalières de territoire. Certains parlementaires, dont votre rapporteur, y ont vu un risque de démantèlement progressif du service public hospitalier.
e) Le travail de clarification des dotations au titre des missions d’intérêt général doit être poursuivi
Les dotations prévues au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation correspondent à la volonté de maintenir des sources de financement en dehors du principe général de la tarification à l’activité, pour financer des missions qui ne se limitent pas à des activités productrices de soins et qui ne peuvent être quantifiées et donc rémunérées comme elles, ou pour mieux identifier certaines missions et leur associer un financement spécifique.
Les dotations MIGAC, auxquelles tous les établissements publics et privés soumis à la T2A peuvent prétendre, sont parties intégrantes du système de tarification à l’activité. Les dotations MIGAC sont un des leviers de régulation de la tarification à l’activité. À condition qu’elles soient bien ciblées, qu’elles soient attribuées selon des critères précis et objectivés et que leur utilisation soit évaluée, les dotations MIGAC doivent permettre d’accompagner le processus de convergence et contribuer à l’amélioration de l’efficience médico-économique et à la performance globale.
Les modifications qui sont apportées, année après année, à la liste des missions et aux conditions de leur évaluation concourent au processus d’évolution raisonné et pragmatique du modèle de financement à l’activité.
Dans cette optique et afin d’assurer l’équité du financement, il est souhaitable de poursuivre les travaux visant à définir plus précisément le champ des activités retenues comme missions d’intérêt général (MIG) et financées par dotations MIGAC ainsi qu’à améliorer la valorisation de ces missions et des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Il est important de progresser, de concert, sur ces deux points. Le principe, retenu depuis 2007, d’une mise à jour annuelle de la liste des missions d’intérêt général contribue d’ailleurs à améliorer la lisibilité du dispositif pour les établissements.
En outre, l’attribution des dotations pourrait être améliorée. À cet effet, il serait souhaitable de renforcer la contractualisation et de recourir davantage, pour les missions d’intérêt général qui s’y prête et les MERRI, à la procédure d’appel à projet auprès des établissements de la région. Par ailleurs, l’évaluation de l’accomplissement des missions devrait être plus précise afin de vérifier que les objectifs fixés dans l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ont bien été atteints.
Enfin, il faudra préciser les conséquences à tirer en ce qui concerne l’évolution des dotations MIGAC, à la suite du vote de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et en conséquence de la volonté de décloisonner l’offre de soins. Deux questions principales sont aujourd’hui posées.
La première concerne le financement des missions de service public prévues par la loi et qui pourraient être assumées par les établissements publics et les établissements privés. La liste des missions de service public et des missions d’intérêt général ne se recoupent que partiellement et la question du vecteur de financement des missions de service public n’est pas fixée par la loi. Il faudra éclairer ce sujet et préciser la part du financement des missions de service public qui sera assurée par les dotations MIGAC et par les tarifs.
La seconde question concerne l’éventualité d’ouvrir le bénéficie des MIGAC aux médecins libéraux qui participeraient à la permanence des soins, comme cela est suggéré dans le rapport de la mission de réflexion concernant la définition d’un nouveau modèle de la médecine libérale, présidée par M. Michel Legmann, président du Conseil national de l’ordre des médecins.
f) Veiller à la bonne utilisation des aides à la contractualisation
Des aides à la contractualisation (AC) peuvent être attribuées par les agences régionales de santé, principalement pour financer les charges d’amortissement résultant des investissements de modernisation ou restructuration des établissements, accompagner le développement ou le maintien d’activités dans le cadre du schéma régional d’organisation des soins ainsi que pour soutenir les établissements dans leurs efforts d’adaptation aux réformes et de retour à l’équilibre.
Afin de renforcer les marges de manœuvre des agences régionales de l’hospitalisation, l’attribution des aides a été régionalisée depuis 2006 et le montant de l’enveloppe des aides à la contractualisation a fortement augmenté jusqu’à 2008 (+ 27 % en 2007 et + 23 % en 2008). L’enveloppe des aides s’est élevée à 2,3 milliards d’euros en 2008. 42 % de l’enveloppe ont été consacrés à l’investissement, 23 % à l’accompagnement des établissements déficitaires, 7 % au renforcement de l’offre, 5 % au développement de l’activité, 1,6 % au maintien d’une activité déficitaire et 21 % à d’autres actions.
Les 545 millions d’euros prévus en 2008 pour l’accompagnement des établissements déficitaires ont été attribués, pour plus de la moitié, à des établissements ayant conclu un plan de retour à l’équilibre et, à hauteur de 40 %, à des établissements n’ayant pas conclu de plan de retour à l’équilibre. À la suite du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur ce sujet, publié en 2008, des améliorations ont été apportées afin de mieux encadrer les plans de retour à l’équilibre. Il a en outre été demandé aux agences régionales de l’hospitalisation de n’attribuer que des crédits non reconductibles et sous conditions.
Il peut être légitime d’aider certains établissements qui éprouvent des difficultés transitoires à s’adapter au nouveau modèle de financement à l’activité. Mais les aides à l’accompagnement attribuées par les agences régionales ne peuvent être des aides pérennes permettant de compenser durablement des insuffisances et des dysfonctionnements structurels. L’aide peut accompagner, pendant une courte période, les établissements dans le processus de réorganisation et de mise en place de mesures correctrices structurelles permettant d’améliorer l’efficience. Elle n’a pas pour vocation de compenser, durablement, des déficits croissants dus à des défauts de management et d’adaptation.
En conséquence, il faudra vérifier que les nouvelles orientations fixées pour l’attribution des aides à l’accompagnement des établissements déficitaires sont respectées. Il s’agit d’éviter que des aides soient accordées aux établissements et reconduites, voire augmentées, d’année en année, sans que les objectifs prévus d’amélioration de l’efficience ne soient tenus, comme la MECSS a pu en faire l’observation dans certains cas.
g) Mieux valoriser la prise en charge sociale, éducative voire psychologique des patients à l’hôpital et dans leur parcours de soins
La prise en charge à l’hôpital ne se réduit pas à la dispensation d’actes médicaux cliniques ou techniques. Dans certains cas, la prise en charge humaine de la personne dans son parcours de soins peut nécessiter la mise en œuvre d’un accompagnement social, éducatif, voire psychologique. Les auditions réalisées par la MECSS ont permis de mettre en lumière l’importance d’une meilleure valorisation de cet accompagnement et d’une valorisation de la coordination des soins, afin d’améliorer le parcours de soins des usagers ainsi que d’assurer une prise en charge globale et coordonnée.
h) Améliorer la visibilité budgétaire des établissements
Le pilotage d’un établissement de santé suppose un minimum de visibilité sur les règles de financement de l’activité qui sont fixées par la puissance publique. Depuis la mise en place de la tarification à l’activité, nombre de dirigeants d’établissements et de représentants des établissements se plaignent d’un manque de transparence et de lisibilité du nouveau dispositif de financement. Ils regrettent aussi que les nombreuses modifications qui sont apportées au dispositif, au fur et à mesure de sa montée en charge, ne soient connues que tardivement chaque année, ce qui complique la réflexion stratégique sur le positionnement des établissements et ne permet pas de mettre en place une véritable gestion prospective. Outre l’incertitude sur l’évolution de l’ONDAM hospitalier, ce manque de visibilité sur les évolutions du modèle de financement peut avoir pour conséquence de freiner ou de rendre plus difficiles les adaptations et les réorganisations internes des établissements lorsqu’elles sont nécessaires.
Il est à cet égard paradoxal de constater que la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ait conduit à retarder encore, en 2010, la publication des paramètres de financement nécessaires à la construction des états prévisionnels de recettes et de dépenses des établissements. Mi-mai, la circulaire budgétaire pour la campagne 2010 n’était pas encore publiée. Même si ce retard est imputable à la nécessité de publication, après les concertations nécessaires, de textes d’application de la loi concernant la gouvernance des établissements et, plus précisément, du décret relatif au conseil de surveillance, il est indispensable qu’à l’avenir cette dérive soit corrigée et que les établissements disposent des informations budgétaires plus tôt. Cela permettra aux agences régionales de santé et aux dirigeants des établissements de mieux organiser l’exercice budgétaire et de faciliter la mise en œuvre de la politique régionale de santé.
i) Préparer les prochaines étapes
Les modifications qui ont été apportées au modèle de la tarification à l’activité ont eu pour objectif de le rendre plus précis et plus pertinent, dans l’intention de rendre le financement plus juste. Les évolutions prévues, dans les années à venir, du financement des établissements de santé, qui s’inscrivent aussi dans cette logique, devraient avoir pour objet d’étendre la tarification à l’activité à de nouvelles structures de soins et à de nouvelles activités.
Dans le champ des activités de médecine, chirurgie et obstétrique, la tarification à l’activité devrait être appliquée à la radiothérapie libérale en 2011. Cela suppose que les structures correspondantes soient reconnues comme établissements de santé et que soient achevés les travaux concernant le calcul des tarifs et le transfert d’enveloppe entre médecine de ville et hôpital.
En 2012, l’élargissement de la tarification à l’activité devrait concerner les hôpitaux locaux. Dès 2009, les agences régionales de l’hospitalisation ont été invitées à moduler la dotation annuelle de financement correspondant à l’activité de médecine. Cette modulation vise à donner un premier signe de reconnaissance et d’engagement dans le dispositif. Afin de préparer cette extension qui ne peut s’envisager qu’en tenant compte des spécificités de ces établissements, il est souhaitable d’inciter les hôpitaux locaux à améliorer la qualité du programme de médicalisation des systèmes d’information et des outils de gestion. Il faudra que les agences régionales de santé mobilisent des financements spécifiques pour accompagner les hôpitaux locaux dans cet effort important de modernisation des systèmes d’information.
Il est par ailleurs prévu d’étendre la tarification à l’activité aux activités de soins de suite et réadaptation ainsi qu’en psychiatrie. En ce qui concerne les soins de suite et de réadaptation, un modèle intermédiaire de modulation des ressources a été mis en place en 2009 et reconduit en 2010. Il est fondé sur un indicateur composite lié à la lourdeur des prises en charge : l’indice de valorisation de l’activité. Les travaux actuellement menés visent à fixer le modèle cible et le calendrier de mise en œuvre. Outre la volonté de répartir plus équitablement les ressources entre les établissements, cette extension de la tarification à l’activité, qui pourrait prendre effet en 2012, vise à accompagner la restructuration de l’offre de soins de suite et de réadaptation qui a été initiée par deux décrets du 17 avril 2008. Elle vise aussi à fluidifier la filière de soins entre les activités de médecine, chirurgie et obstétrique et celles des soins de suite et de réadaptation, dans un contexte de vieillissement de la population et de développement des maladies chroniques et du handicap. Cela doit permettre d’assurer la prise en charge la plus adaptée, sans rupture.
Sur le champ de la psychiatrie, les travaux sont moins avancés. Il s’agit d’abord de tester le système de recueil d’information sur l’activité qui a été élaboré en 2008 et de définir une classification médico-économique des prestations de soins, à partir de ce recueil et d’une étude nationale de coûts à méthodologie commune. Une concertation avec les professionnels de la psychiatrie doit permettre d’avancer sur ces sujets. Il est envisagé d’expérimenter les différents modèles en 2011 et 2012 pour mieux prendre en considération les spécificités de ce secteur, sur la base d’une claire définition des missions en santé mentale et en répondant à la nécessité de conserver des psychiatres à l’hôpital. Les travaux préparatoires sont complexes et prendront du temps. Cependant, il faut observer que la France n’est pas dans une situation particulière à cet égard, puisqu’aucun autre pays européen n’a encore mis en place de système satisfaisant.
Au-delà des extensions de la tarification à l’activité, déjà réalisées ou en préparation, compte tenu de l’objectif de décloisonnement des acteurs de la santé et du soin et d’une meilleure organisation de la prise en charge durant le parcours de soins, il y a lieu de s’interroger sur la convergence des systèmes de financement ou, en tout cas, sur la structure des financements, des différents acteurs de la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale. La réponse qui sera apportée à cette question devra chercher à faciliter l’organisation d’une offre de soins mieux cordonnée et, en conséquence, à fluidifier les parcours de soins et améliorer le service rendu aux personnes prises en charge.
3. Moderniser le patrimoine hospitalier et améliorer sa gestion
Le plan Hôpital 2007 et le plan Hôpital 2012 visent à développer l’investissement hospitalier afin de moderniser les établissements de santé. Au-delà, se pose la question de l’amélioration de la gestion du patrimoine hospitalier.
a) Moderniser le patrimoine hospitalier
Le plan Hôpital 2007 a été lancé en 2004, en même temps que la tarification à l’activité. L’objectif était d’accélérer l’amélioration de la qualité des infrastructures hospitalières, notamment en les mettant en conformité avec les normes de sécurité, et de les adapter à l’évolution des techniques médicales. Selon le chiffrage initial, il s’agissait de réduire le délai de mise à niveau du patrimoine hospitalier de treize ans à cinq ans. L’objectif a été ainsi fixé de réaliser un volume d’investissement supplémentaire de 30 % par rapport au rythme d’investissement antérieur, en immobilier, équipements et systèmes d’information.
Fin 2007 le plan avait permis de financer 937 opérations pour un total de dépenses d’investissements s’élevant à plus de 16 milliards d’euros, grâce à une aide de l’État représentant 6 milliards d’euros, soit un taux effectif de subvention de 37,5 %, très inférieur au taux de 100 % initialement envisagé en 2003.
La Cour des comptes qui a mené une enquête sur l’application du plan dans quatre régions souligne, dans son rapport sur la sécurité sociale pour 2009, que les défaillances de pilotage national n’ont pas permis de maîtriser la dépense et considère que, en raison de modalités de sélection insuffisantes, de l’absence de prise en compte du retour sur investissement et d’incertitudes sur la situation financière des établissements, un trop grand nombre de projets ont été retenus dont la viabilité économique n’était pas toujours assurée. Ainsi, faute d’outil, la rentabilité économique et l’efficacité sanitaire des projets n’ont pas été précisées dans les contrats signés, contrairement à l’objectif du plan d’amélioration de la productivité des établissements.
La Cour estime que le plan Hôpital 2007 a permis une forte relance de l’investissement mais que certains projets étaient mal dimensionnés. En conséquence, cela a pu contribuer au développement de l’endettement et à la dégradation de la situation financière de certains établissements publics de santé, notamment des CHU qui ont eu une politique intensive d’investissements sur la période 2003-2007.
Le plan Hôpital 2012 vise à réaliser un effort d’investissement de 10 milliards d’euros avec une subvention de financement de 5 milliards d’euros et reposant de nouveau largement sur l’emprunt aidé. L’objectif du nouveau plan est d’accompagner la recomposition hospitalière et de soutenir l’effort d’amélioration de la performance. Le plan vise à maintenir l’investissement hospitalier au même niveau que pendant le plan Hôpital 2007, à consacrer 85 % de l’effort aux investissements immobiliers et 15 % aux investissements dans les systèmes d’information hospitaliers.
Au mois de février 2010, une première série de 640 projets a été retenue représentant 4,6 milliards d’euros d’investissements et 2,2 milliards d’aides. 84 % des aides concernent les établissements publics hospitaliers. Cette priorité accordée à l’hôpital public devrait d’ailleurs être renforcée.
La plupart des opérations sélectionnées concernent des investissements consacrés à la production des soins (72 %). Les projets immobiliers peuvent consister en des regroupements d’établissements, notamment des établissements publics et des établissements privés, des restructurations internes (notamment de blocs opératoires), des reconstructions complètes ou des opérations de développement ou de modernisation de structures de soins de suite et de réadaptation.
Par ailleurs, près de cinq cents projets concernent l’amélioration des systèmes d’information, comme le dossier médical ou le circuit du médicament. Dans ce domaine, la logique de regroupement des projets et de mutualisation est encouragée. Cela peut prendre la forme de projets de territoires avec une gestion commune organisée dans le cadre de groupement de coopération sanitaire ou de rapprochements entre établissements. Plus de la moitié des projets sont mutualisés, par exemple dans des projets de groupe, des projets de systèmes d’information de territoire ou des plateformes d’interopérabilité.
Les circulaires relatives à la mise en œuvre du plan hôpital 2012 prévoient notamment le renforcement de la sélectivité des projets. Pour être retenues, les opérations immobilières doivent notamment satisfaire à des critères d’efficience de l’organisation des soins. En outre, il est prévu de majorer la part des aides en capital pour atténuer les recours à l’emprunt.
Il serait opportun que, dans l’application du plan Hôpital 2012, il soit tenu compte des enseignements tirés du plan Hôpital 2007. Il faudra donc améliorer le pilotage de la mise en œuvre du plan, assurer une meilleure sélection des projets et un suivi plus précis des engagements. Au-delà, il est suggéré que, compte tenu de l’importance du montant des aides prévues par les deux plans ainsi que des observations formulées par la Cour des comptes sur le plan Hôpital 2007, la commission des affaires sociales puisse effectuer un travail de contrôle et d’évaluation complémentaire sur l’application des deux plans.
b) Améliorer la gestion du patrimoine hospitalier
La gestion du patrimoine hospitalier peut et doit être améliorée. Le patrimoine immobilier des hôpitaux publics n’est pas précisément connu, mais il serait d’une surface supérieure à celui de l’État et pourrait représenter plusieurs dizaines de milliards d’euros.
Or, l’État a modernisé sa politique immobilière. Il a mis en place une véritable stratégie de modernisation de sa gestion patrimoniale. L’objectif est d’assurer aux agents un cadre de travail de qualité et fonctionnel, de faire bénéficier les usagers de bonnes conditions d’accueil et d’utiliser le patrimoine dans des conditions qui garantissent la performance immobilière et la préservation de sa valeur. À titre d’exemple, une norme de 12 mètres carrés de surface utile nette par poste administratif a été fixée. Le service France Domaine qui relève de la direction générale des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État a été chargé de la mise en œuvre de la gestion patrimoniale de l’immobilier de l’État. Sur la base de schémas pluriannuels de stratégie immobilière, qui fixent des objectifs de réduction du volume et de coût des surfaces occupées, France Domaine signe, avec les administrations centrales, des conventions d’utilisation, le régime de l’affectation des biens domaniaux ayant été abrogé. Les conventions fixent le montant des loyers qui sont dus à France Domaine. Pour ce qui concerne les services déconcentrés de l’État, ce sont les préfets qui signent les conventions d’utilisation.
Il serait intéressant de s’inspirer de cet exemple pour améliorer la gestion du patrimoine hospitalier.
Cela suppose en premier lieu d’établir un recensement exhaustif du patrimoine et d’en estimer la valeur. L’exercice peut ne pas être si simple, en particulier pour certains grands établissements qui ne disposent pas de bilan patrimonial précis.
Dans un objectif de gestion médico-économique plus active du patrimoine hospitalier, il faut instaurer l’obligation pour les établissements de santé d’établir un bilan patrimonial annuel précis et réévalué chaque année.
Il faut parallèlement étudier les voies d’améliorations possibles de la gestion du patrimoine immobilier des hôpitaux. Des plans de gestion devraient être mis en place par les établissements. Une autre solution consistant à confier la gestion à un office public de gestion du patrimoine hospitalier pourrait aussi être étudiée, afin de décharger les établissements.
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux a prévu de réaliser une étude sur la gestion patrimoniale des établissements de santé.
Par ailleurs, il sera utile d’engager une réflexion sur la conception architecturale des établissements hospitaliers avec pour objectif d’améliorer la qualité des soins et du service rendu aux usagers ainsi que l’efficience. Les frais d’entretien et de maintenance ne sont pas indifférents au dimensionnement et à la configuration des espaces et des locaux.
Par ailleurs, le produit des éventuelles cessions d’immeubles pourrait être notamment utilisé pour développer les aides au logement des personnels hospitaliers.
B. AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET ANTICIPER LE RENOUVELLEMENT DU PERSONNEL HOSPITALIER
Dans son rapport sur les personnels des établissements publics de santé, publié en 2006, la Cour des comptes souligne de nombreuses insuffisances dans la gestion des ressources humaines hospitalières. Les personnels médicaux et non-médicaux constituent pourtant le cœur des établissements. La complexité et la technicité croissante des processus de soins nécessitent de réunir un ensemble de compétences spécialisées et de mobiliser les personnels afin d’assurer la qualité et l’efficience des prises en charge des usagers. Toute démarche de modernisation d’un établissement suppose, pour être correctement réalisée et pour procurer les améliorations attendues, une adhésion forte des personnels hospitaliers au projet médical et au projet d’établissement.
1. Améliorer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
a) Depuis 1980 les personnels hospitaliers ont augmenté d’un peu plus d’un tiers
Selon le rapport de la Cour des comptes sur les effectifs de l’État, publié au mois de décembre 2009, le nombre de personnes employées dans la fonction publique hospitalière est passé de 671 000, en 1980, à 1 035 000, en 2007, soit une augmentation de 54 %.
En équivalents temps plein, les effectifs sont passés de 702 000, en 1986, à 956 000, en 2007, soit une hausse de 36,2 %. Sur la même période, la population française a augmenté de 14,7 %, les effectifs en équivalents temps plein de la fonction publique de l’État de 7,4 % et ceux de la fonction publique territoriale de 54,7 %, mais les collectivités territoriales ont, il est vrai, bénéficié de transferts de compétences importants.
Le nombre des agents de la fonction publique hospitalière a donc augmenté plus vite que la population. L’augmentation des effectifs de la fonction publique hospitalière a été régulière durant la période, même si elle a été plus importante après 2000, notamment pour faire face à la nouvelle organisation du travail issue des mesures de réduction de la durée du travail. Le rythme de la progression annuelle moyenne a été de 2 % sur la période 1980-1986, puis de 0,9 % sur la période 1986-1996 et de 2,6 % pour la période 1996-2007. En 2007, la fonction publique hospitalière représentait 73 % des effectifs employés dans les établissements publics ou privés de santé, 6,8 % de l’emploi total et un tiers de l’emploi public. En 2007, les charges de personnel de la fonction publique hospitalière ont représenté 41,7 milliards d’euros.
Selon le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, en 2006, les personnels hospitaliers étaient répartis entre environ 90 000 emplois médicaux et 755 000 emplois non médicaux, dont 87 000 personnels administratifs, 531 000 soignants (dont 215 000 infirmiers et 185 000 aides-soignants), 10 000 personnels éducatifs et sociaux, 37 000 personnels médico-techniques et 90 000 personnels techniques. Globalement, un emploi de praticien hospitalier correspond environ à un emploi administratif, cinq emplois non médicaux de personnels soignants (dont deux d’infirmiers et deux d’aides-soignants), un emploi de personnels techniques, et un emploi de personnels éducatifs et sociaux ainsi que de personnels médico-techniques.
Selon les résultats de l’enquête annuelle réalisée sur un échantillon d’établissements publics de santé de plus de 300 agents, les femmes représentent environ les trois quarts du personnel des hôpitaux. Les personnels handicapés déclarés représentent 3,9 % du personnel des hôpitaux et les emplois aidés 2,9 %. Pour assurer la permanence et la qualité des soins, l’organisation du travail à l’hôpital est complexe et les statuts variés. Moins de la moitié du personnel travaille avec des horaires fixes de jour. 57 % du personnel soignant travaillent selon des horaires alternants. En outre, 21 % du personnel non médical (28 % des infirmiers) travaillent à temps partiel, mais les agents choisissent généralement des horaires proches d’un temps plein, puisque plus des trois-quarts travaillent avec des taux de temps partiel supérieurs à 70 %.
La durée moyenne d’absence pour motifs médicaux est de 19 jours par an, dont 9 jours pour maladies de courte durée. Depuis dix ans, malgré des fluctuations, le taux d’accident du travail a tendance à légèrement diminuer.
Par ailleurs, les dépenses de formation professionnelle du personnel non médical ont tendance à diminuer. Elles sont passées de 3,4 %, en 2004, à 2,8 %, en 2007, mais le nombre de jours de formation se situe entre trois et quatre par agent, depuis dix ans.
b) Les praticiens hospitaliers occupent une place importante dans les établissements de santé publics
En ce qui concerne les personnels médicaux, les praticiens hospitaliers constituent la catégorie la plus importante, devant le personnel temporaire de plein exercice, les hospitalo-universitaires qui sont les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers, les praticiens associés et les praticiens en formation, internes ou faisant fonction d’interne. La composition du personnel médical varie selon qu’il s’agit d’un grand établissement hospitalo-universitaire ou d’un centre hospitalier. En équivalents temps plein, le personnel médical se compose de 75 % de praticiens en exercice et de 25 % de praticiens en formation.
Au 1er janvier 2010, selon les données du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé employaient près de 40 000 praticiens hospitaliers, dont 24 400 praticiens titulaires (61 %) et 12 400 praticiens contractuels (31 %).
34 400 (86 %) sont des praticiens hospitaliers à temps plein et 5 500 (14 %) sont des praticiens hospitaliers à temps partiel.
Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, au 1er janvier 2010 (1)
Spécialités |
Praticiens hospitaliers à temps plein |
Praticiens hospitaliers à temps partiel |
Biologie |
1 778 |
180 |
Chirurgie |
4 465 |
1 044 |
Médecine |
20 572 |
2 854 |
Odontologie |
61 |
94 |
Pharmacie |
1 769 |
242 |
Psychiatrie |
4 460 |
801 |
Radiologie et imagerie médicale |
1 333 |
278 |
Total |
34 438 |
5 493 |
(1) en nombre de postes occupés
Source : Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Au 1er janvier 2010, le taux de vacance statutaire, c’est-à-dire la différence entre le nombre de postes prévus au budget et le nombre de postes occupés, est de 22,3 % pour les praticiens hospitaliers à temps plein et de 37,3 % pour les praticiens hospitaliers à temps partiel. Le taux de vacance est supérieur à la moyenne dans les régions Basse-Normandie, Picardie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et dans les départements d’outre-mer, à l’exception de La Réunion. Le taux de vacance est particulièrement élevé en radiologie (35 %). Encore faut-il rappeler que les postes vacants peuvent être occupés par des médecins intérimaires. Il reste que ce fort taux de vacance constitue un problème important dont le traitement doit être prioritaire.
L’âge moyen des praticiens est proche de cinquante ans. Les hommes représentent 57 % des praticiens, mais les femmes étant majoritaires dans les jeunes générations, la profession se féminise.
En 2009, le nombre de praticiens hospitaliers à temps plein a augmenté de 1,7 %, tandis que celui des praticiens à temps partiel a diminué de 2,8 %, après avoir augmenté de 6,5 %, en 2008. En 2009, 1 995 praticiens hospitaliers ont été recrutés et 1 176 ont cessé leur activité de praticiens hospitaliers, principalement en raison d’un départ à la retraite (57 %) ou d’une démission (280 démissions, soit 24 % des cessations d’activité et 0,7 % des praticiens hospitaliers). Le taux de démission est particulièrement élevé chez les radiologues (35 %) et chez les chirurgiens (34 %).
De 2002 à 2010, le nombre de praticiens hospitaliers est passé de 29 600 à 40 200, soit une augmentation de 10 600 ou 35,8 % en huit ans.
Évolution des effectifs rémunérés de praticiens hospitaliers, de 2002 à 2010
Total praticiens hospitaliers |
Praticiens hospitaliers à temps plein |
Praticiens hospitaliers à temps partiel | ||
Effectif |
Taux d’évolution |
Effectif | ||
2002 |
29 578 |
23738 |
- |
5 840 |
2003 |
31 343 |
25 494 |
+ 7,4 % |
5 849 |
2004 |
32 852 |
26 985 |
+ 5,8 % |
5 867 |
2005 |
34 597 |
28 935 |
+ 7,2 % |
5 662 |
2006 |
36 249 |
30 620 |
+ 5,8 % |
5 629 |
2007 |
37 853 |
32 217 |
+ 5,2 % |
5 616 |
2008 |
38 454 |
33 122 |
+ 2,8 % |
5 332 |
2009 |
39 744 |
34 168 |
+ 2,9 % |
5 676 |
2010 |
40 164 |
34 648 |
+ 1,7 % |
5 516 |
Évolution de 2002 à 2010 |
+ 10 586 |
+ 10 910 |
+ 46 % |
- 324 |
Source : Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
Cette évolution a notamment visé à compenser, d’une part, la diminution du temps de travail des médecins en raison de l’attribution de jours de congés supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail et, d’autre part, l’application d’une directive européenne. La Cour de justice européenne a en effet reconnu, le 3 octobre 2000, l’applicabilité aux médecins hospitaliers de la directive du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Depuis cette décision, le temps de garde ou de permanence des soins des médecins est donc considéré comme temps de travail. Cela a entraîné une réduction massive des obligations de service, puisqu’une garde hebdomadaire est désormais comptabilisée pour deux demi-journées de travail, ce qui réduit de 20 % les obligations de service, lesquelles sont fixées à dix demi-journées par semaine.
c) Renforcer la gestion prévisionnelle des emplois hospitaliers et des compétences
Dans les cinq prochaines années, plus de 300 000 départs à la retraite pourraient avoir lieu chez les personnels hospitaliers. Les nécessités de recrutement qui vont en découler supposent d’anticiper ces évolutions et d’améliorer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Pendant longtemps, le pilotage des personnels hospitaliers a été très difficile, en raison de l’insuffisance des informations sur les personnels hospitaliers médicaux et non médicaux. Ce déficit de connaissance sur les effectifs employés dans les établissements rendait pratiquement impossible la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois efficace et l’adaptation des ressources humaines en fonction des besoins de soins.
Afin de pallier ces insuffisances, deux observatoires des personnels médicaux et non médicaux ont été créés : l’Observatoire national des métiers et des emplois de la fonction publique hospitalière qui a été créé en 2001 et l’Observatoire national de la démographie des professions de santé qui a été créé en 2003. Ces organismes ont pour mission d’améliorer la connaissance sur les personnels hospitaliers, de mener des études prospectives et d’anticiper les besoins ainsi que de favoriser la gestion prévisionnelle des emplois. L’observatoire national des métiers a aussi été chargé d’établir un répertoire des métiers qui doit permettre d’identifier les nouveaux métiers et de faciliter la gestion prévisionnelle des métiers. Le premier répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière a été publié en 2004. Un nouveau répertoire a été publié en 2009.
Ces organismes ont permis d’améliorer les connaissances sur les personnels hospitaliers, mais celles-ci demeurent encore insuffisantes. Les données sur les effectifs sont encore relativement peu fiables et, selon les sources, les données sont différentes. Cela n’est d’ailleurs pas étonnant, puisque, souvent, les établissements eux-mêmes ne connaissent pas précisément les effectifs qu’ils emploient. La complexité des organisations et la multiplicité des statuts ne peuvent justifier de telles insuffisances. En conséquence, il faut faire en sorte que les établissements disposent d’informations fiables sur les effectifs qu’ils emploient et que ces informations soient transmises aux agences régionales de santé.
Néanmoins, les travaux de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé ont permis d’éclairer les perspectives concernant les personnels médicaux et, notamment, de corriger la trajectoire d’évolution de leurs effectifs en augmentant le numerus clausus. L’Observatoire a réalisé des prévisions concernant des catégories de personnel qui connaissent des difficultés de recrutement, comme les manipulateurs en radiologie ou les masseurs-kinésithérapeutes, ou des métiers concernant le traitement d’une maladie comme le cancer.
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui a été créé en 2007 et a pour mission d’assurer la gestion statutaire et le développement des ressources humaines, doit contribuer à améliorer la gestion des praticiens et des personnels de direction. Le centre national de gestion est d’ailleurs chargé de gérer l’ensemble des personnels de direction des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux. Il organise les concours, la mobilité, la nomination, la gestion de carrière et accompagne le développement professionnel ou le changement de métiers des praticiens ou des personnels de direction placés en recherche d’affectation. Le contrat d’objectifs et de moyens 2010-2013 du centre national de gestion prévoit l’élaboration d’une cartographie des emplois et des compétences des praticiens hospitaliers et des directeurs, la mise en place d’une bourse des emplois et le développement de la gestion individualisée des carrières. Le centre de gestion doit aussi soutenir, dans le domaine des ressources humaines, la réorganisation de l’offre de soins, favoriser les échanges d’information avec les professions concernées et mettre en place la gestion nationale des directeurs de soins.
Le pilotage de la réorganisation de l’offre de soins suppose que les agences régionales de santé disposent de toutes les informations nécessaires sur les personnels employés par les établissements. Les agences régionales devraient définir, après avis de la conférence régionale de santé, une stratégie régionale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour l’ensemble de l’offre de soins. Les projets régionaux de santé et les schémas régionaux de prévention, d’organisation des soins et d’organisation médico-sociale devraient préciser les orientations de cette gestion prévisionnelle.
Au-delà, il faudrait confier aux agences régionales de santé une compétence plus large sur la gestion de l’emploi hospitalier et développer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences par territoire.
Par ailleurs, les établissements de santé publics devraient aussi se mobiliser pour améliorer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de leurs personnels. Il est notamment nécessaire qu’ils facilitent la mobilité des personnels, conformément à la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
2. Renforcer l’attractivité des carrières à l’hôpital
L’évolution des établissements hospitaliers impose aussi de renforcer l’attractivité des carrières des personnels hospitaliers, car les deux évolutions sont indissociables.
a) Renforcer l’attractivité des carrières médicales
Depuis dix ans, les effectifs des praticiens hospitaliers ont sensiblement augmenté mais, dans certaines spécialités, les taux de vacance sont importants, en raison d’une d’attractivité insuffisante. Or, les départs nombreux de praticiens en retraite vont, même si l’augmentation du numerus clausus est maintenue, entraîner un infléchissement des effectifs de médecins jusque dans les années 2025. En conséquence, cela nécessite d’anticiper ces évolutions et de soutenir l’attractivité des carrières de praticiens hospitaliers. D’autant que certains praticiens issus des générations plus jeunes et plus féminisées peuvent avoir une approche différente du travail à l’hôpital de celle de leurs prédécesseurs.
L’activité libérale des praticiens hospitaliers publics, faible en volume,
se développe en secteur 2
En 2004, 4 212 praticiens hospitaliers (deux tiers exerçant en secteur 1 et un tiers en secteur 2), soit 11 % de l’effectif total, exerçaient une activité libérale dans un établissement de santé public. Le montant des honoraires déclarés à ce titre s’élevait à 257 millions d’euros, ce qui correspondait à une rémunération moyenne brute de 60 980 euros par médecin (55 000 euros pour le secteur 1 et 70 000 euros pour le secteur 2). Le praticien hospitalier doit verser une redevance à l’établissement qui varie selon les actes, la spécialité et le secteur hospitalo-universitaire de 20 % à 60 %.
Les dépassements d’honoraires représentaient 57 millions d’euros, soit 29 % de la masse des honoraires (34 000 euros par praticien de secteur 2). Le montant des dépassements se répartissait en 2 millions pour les praticiens de secteur 1, ce qui représentait un taux de dépassement (ratio des dépassements sur les honoraires bruts) de 1,3 %, et 55 millions d’euros pour les praticiens de secteur 2, ce qui représentait un taux de dépassement de 98,5 %. En moyenne, les praticiens hospitaliers de secteur 2 compensaient un volume d’activité libérale plus faible d’un tiers par rapport à celui des praticiens de secteur 1 par des dépassements d’honoraires plus importants. Ces dépassements permettaient ainsi aux praticiens de secteur 2 de doubler le montant de leurs honoraires.
Le nombre de praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale, après avoir augmenté de 19 %, entre 1995 et 2000 (+ 45 % en secteur 1 et – 8,3 % en secteur 2), a, de 2000 à 2004, diminué de 4 % (- 7 % en secteur 1 et + 1,7 % en secteur 2), mais le montant des dépassements s’est accru en moyenne de 7 % par an entre 2000 et 2005.
Le rapport de la mission concernant la promotion et la modernisation des recrutements médicaux à l’hôpital public qui a été remis à la ministre de la santé et des sports, au mois de juillet 2009, évoque la crise identitaire qui touche les praticiens hospitaliers et qui se traduit par un pourcentage de vacance de postes croissant. Afin d’y remédier, il formule une dizaine de propositions visant à renforcer l’attractivité des carrières de praticiens hospitaliers. Il est notamment proposé de :
– promouvoir les carrières hospitalières dès le deuxième cycle des études médicales et de valoriser ces carrières auprès de chefs de clinique assistants ;
– constituer des équipes hospitalières regroupant au moins dix praticiens, labellisées par la Haute Autorité de santé, et organisées grâce à un contrat d’équipe inclus dans le contrat de pôle permettant de planifier et mesurer les temps individuels d’activités qui seraient choisis librement dans la limite d’une fourchette ;
– d’instaurer une rémunération variable liée au niveau et à la qualité de l’activité et une rémunération à la performance.
Le rapport souhaite aussi la mise en place d’une gestion personnalisée des carrières et formule des préconisations concernant les conditions d’application du contrat de clinicien prévu par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Il sera intéressant de savoir quelles suites le Gouvernement entend donner à ces propositions et, le cas échéant, quelles mesures il envisage pour réduire les vacances de postes. Ces questions revêtent une acuité nouvelle, depuis que certaines cliniques commencent à développer le salariat des médecins qu’elles emploient et proposent des primes pour embaucher de nouveaux médecins.
Par ailleurs, afin de favoriser les réorganisations internes, il paraît aujourd’hui nécessaire de développer la formation professionnelle et continue des praticiens en management, à la gestion de projets et à la conduite du changement. Souvent, les praticiens jouent le rôle d’animateur d’équipes et doivent promouvoir la qualité hospitalière et la culture de l’efficience médico-économique.
Il conviendrait aussi d’assurer une gestion plus active de la carrière des praticiens, afin de permette une diversification des parcours et un enrichissement des carrières et de mieux organiser la pluriactivité et la mobilité externe.
Compte tenu du vieillissement de la population, il faudrait également mieux organiser la filière gériatrique.
b) Améliorer les carrières des personnels non médicaux
L’évolution des statuts et l’amélioration des carrières des personnels non médicaux peuvent constituer un levier important pour accompagner et favoriser les réorganisations dans les établissements. Un mouvement d’évolutions statutaires a été engagé dans ce sens depuis plusieurs années.
De nouvelles modifications sont intervenues récemment. Le protocole d’accord du 2 février 2010 comporte six volets prévoyant des revalorisations indiciaires pour les personnels hospitaliers infirmiers et les autres professions paramédicales, les cadres hospitaliers et les personnels administratifs, techniques, ouvriers et socio-éducatifs. Le protocole prévoit, notamment, d’étendre la reconnaissance de la formation au niveau de la licence à l’ensemble des infirmiers, ce qui permet de leur ouvrir l’accès à la catégorie A des fonctionnaires, mais en contrepartie il est prévu de supprimer la majoration de durée d’assurance liée à l’appartenance à la catégorie active et de reporter l’âge d’ouverture du droit à la retraite à soixante ans. Les infirmiers en poste disposeraient d’un droit d’option leur permettant de décider s’ils souhaitent ou non que les nouvelles dispositions leur soient appliquées. Un article visant à permettre l’application de ces dispositions a été inséré dans le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique qui est actuellement examiné par le Parlement.
Dans les prochaines années, les établissements hospitaliers devraient poursuivre leur évolution, ce qui va nécessiter des adaptations de la part des personnels non médicaux. Ainsi, le développement de la chirurgie ambulatoire devrait entraîner des conséquences importantes pour les personnels. Il est donc indispensable de les anticiper afin de définir une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences adaptée et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires, notamment en matière de formation, de requalification et de mobilité des personnels.
Dans cette logique, il est opportun de favoriser les évolutions de carrières des personnels non médicaux et d’amplifier les efforts de formation professionnelle à cet effet. Le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière rénove le dispositif antérieur. Il prévoit notamment l’élaboration d’un document pluriannuel d’orientation de la formation, d’un plan annuel de formation et d’un rapport annuel sur son exécution, l’obligation de consacrer 2,1 % des rémunérations à la formation, un entretien annuel de formation ainsi que la remise d’un passeport de formation à chaque agent et un droit individuel à la formation professionnelle transférable de vingt heures par an, comme dans le secteur privé.
Afin d’anticiper le renouvellement des départs importants en retraite ainsi que d’accompagner les évolutions et la modernisation des établissements hospitaliers publics, il est nécessaire d’accentuer les efforts de formation professionnelle en faveur des personnels non médicaux. Il faudra, en conséquence, s’assurer que les nouvelles dispositions prévues par le décret sont bien appliquées. Au demeurant, on peut se demander si l’obligation de financement de 2,1 % aura un réel impact, puisque le taux actuellement constaté est supérieur, même s’il a tendance à diminuer, probablement en raison de la tarification à l’activité qui, au moins dans un premier temps, a conduit les établissements à faire des économies sur les dépenses de formation professionnelle. La suggestion d’un grand plan national de formation visant à anticiper les départs massifs en retraite devra être étudiée.
c) Prendre en compte l’évolution des métiers, favoriser la délégation de tâches et la reconnaissance des nouvelles pratiques
L’évolution des modes de prise en charge et les nécessités d’organisation d’un hôpital moderne peuvent notamment conduire à organiser des transferts de tâches et à développer les coopérations entre le personnel médical et les personnels non médicaux. À cet égard, une meilleure progressivité pourrait être organisée entre les personnels médicaux, dont la formation peut durer plus de dix ans, et les infirmières qui bénéficient d’une formation de trois ans. Il y a entre ces deux catégories de personnels un écart de durée de formation important et des paliers de formation intermédiaires pourraient être créés pour répondre à la demande croissante et plus diversifiée de soins. Les infirmiers devraient ainsi pouvoir plus facilement poursuivre ou reprendre leur formation pour accéder au niveau master.
De même, des formations aux nouveaux métiers de la santé, correspondant au niveau master, pourraient être créées et les possibilités d’accès aux carrières hospitalières et d’évolution de carrière par la voie de la valorisation des acquis de l’expérience devraient être développées. On peut rappeler que la commission des affaires sociales a créé, au mois de janvier 2010, une mission d’information sur la formation des professions paramédicales qui devrait rendre prochainement son rapport.
La réorganisation de l’offre de soins autour du parcours du patient devrait en outre conduire à développer la mobilité des personnels non médicaux et à ménager des passerelles pour permettre aux professionnels d’évoluer dans les filières de soins. Parallèlement à la meilleure prise en compte du parcours de soins de l’usager, il conviendra de fluidifier les carrières des personnels hospitaliers et, à cet effet, de personnaliser la gestion des compétences et des carrières.
3. Améliorer les conditions de travail des personnels hospitaliers et mieux les associer au fonctionnement des établissements
a) Mieux prendre en compte les difficultés des métiers pour lutter contre la souffrance au travail
Les personnels hospitaliers médicaux et non médicaux, qui sont confrontés quotidiennement à la maladie et, selon les spécialités, à la mort, font preuve d’un dévouement remarquable au service des usagers. De ce point de vue, force est de reconnaître que les changements fréquents de règles et d’organisation sont souvent mal vécus par les personnels hospitaliers qui sont exposés à la douleur humaine. Ainsi, la charge émotionnelle et la nécessité d’assurer la qualité des soins dans un environnement techniquement complexe et changeant, en particulier en raison de la réduction de la durée des séjours, est parfois difficile à supporter par les personnels au contact des malades. Le malaise ressenti par les personnels hospitaliers provient souvent de changements imposés et réalisés trop rapidement, sans une concertation et une association suffisantes des personnels. Aussi, le déficit de dialogue social et la tendance à l’intensification du travail peuvent générer du stress et de la souffrance au travail, voire des situations de burn out.
Ces problèmes ne doivent pas être méconnus. Le déni ne serait pas une réponse acceptable. Les gestionnaires des ressources humaines peuvent au moins limiter ces désagréments et traumatismes, en mettant en place des actions de prévention et des lieux d’échange afin de libérer la parole et de favoriser la verbalisation des difficultés. Cela permet souvent de réduire les problèmes de mal-être que peuvent éprouver les personnels. La qualité des soins et la bientraitance dépendent, en grande partie, du bien-être des personnels chargés de dispenser les soins et d’assurer les prises en charge. Lutter contre la souffrance au travail et améliorer les conditions de travail des personnels doit donc, toujours, être une priorité.
b) Mieux associer les personnels hospitaliers aux réformes
Les évolutions de l’organisation interne des pôles et des services, qui sont souvent nécessaires pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers, peuvent compliquer le fonctionnement des équipes soignantes et affecter les conditions de travail. Il est, dès lors, essentiel d’associer, au maximum, tous les personnels à la démarche de modernisation et aux changements qu’elle suppose. Car, comme l’a indiqué M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des sports, lors de son audition par la MECSS : « On a constaté qu’une bonne organisation était due à une bonne association des soignants et des non-soignants. Aucun progrès ne peut se faire sans les personnels soignants, et encore moins contre eux. Les projets doivent être portés par des équipes médicales et bénéficier d’un accompagnement administratif adéquat. »
Le rôle des chefs d’établissement, des chefs de pôles et des chefs de service ou d’équipe est de donner du sens aux évolutions et aux réorganisations, afin de maintenir la motivation des personnels. Il est également, lorsque des réorganisations, voire des fusions, sont mises en œuvre, d’assurer une politique d’accompagnement social de la mobilité, par exemple.
L’action des dirigeants devrait aussi veiller à mieux associer les différentes catégories de personnels, médicaux et non médicaux, soignants et non soignants, que l’on oppose parfois et dont les intérêts ne sont pas toujours spontanément convergents. La même attention doit être accordée aux différentes catégories de personnels composant la communauté de travail qui anime les établissements, tant en ce qui concerne l’information sur la gestion de l’établissement que le dialogue social ou la formation professionnelle.
Il est en effet indispensable d’organiser la concertation et le dialogue social sur les évolutions organisationnelles des établissements hospitaliers publics, le partage d’informations et l’échange aux différents niveaux. Cela peut et doit être un levier d’amélioration et d’efficience accrue.
I. Sur le pilotage de l’efficience médico-économique
1. Demander au Gouvernement de fixer des objectifs aux agences régionales de santé en matière d’amélioration de l’efficience médico-économique des hôpitaux, de réorganisations internes et d’amélioration du fonctionnement des établissements ;
2. Demander au Gouvernement de fournir au Parlement un rapport annuel, annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale, présentant les orientations, le bilan et les perspectives en matière de réorganisations internes et d’améliorations apportées au fonctionnement des établissements hospitaliers et d’en publier les résultats sous une forme accessible à tous sur internet ;
3. Améliorer l’information des usagers en enrichissant et rationalisant les bases d’informations en ligne sur l’hôpital ;
II. Sur l’appui technique aux réorganisations hospitalières et la prise en compte de l’efficience
4. Organiser le dialogue social sur les évolutions organisationnelles des établissements publics de santé ;
5. Clarifier les missions des organismes qui sont chargés de l’appui et du conseil aux établissements en matière d’amélioration de la performance médico-économique, assurer impérativement une coordination efficace de leur action et y associer les médecins-conseils de l’Assurance maladie ;
6. Donner un caractère opposable aux guides de bonnes pratiques organisationnelles établis par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, confier aux agences régionales de santé la mission d’assurer leur diffusion et veiller à leur application par les établissements, les pôles et les services ;
7. Développer la formation des dirigeants des établissements et des personnels hospitaliers à l’efficience médico-économique hospitalière ;
8. Établir un diagnostic sur la performance médico-économique de l’établissement avant de conclure le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
9. Établir la collaboration entre les agences régionales de santé et l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et assurer la remontée d’informations des établissements ;
10. Améliorer la connaissance statistique des effectifs employés dans les établissements hospitaliers ;
11. Réaliser avant toute opération de restructuration ou de fusion un audit et un diagnostic préalables et définir un projet médical et un projet d’établissement partagés ;
12. Conditionner l’attribution des aides financières des agences régionales de santé aux établissements devant revenir à l’équilibre financier à la conclusion d’engagements précis et quantifiables et en assurer le suivi effectif ;
13. Renforcer la formation en management et conduite du changement des directeurs d’établissement ;
14. Évaluer l’efficacité de la formation d’adaptation au poste de directeur d’établissement et des formations concernant la gestion de projet et le management du changement ;
III. Sur les pôles
15. Poursuivre la mise en place des pôles et inciter à la réalisation d’audits d’efficience médico-économique dans les pôles et les services ;
16. Demander à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux de formuler des préconisations en ce qui concerne l’organisation des pôles ;
IV. Sur les outils de pilotage et de gestion dans les établissements
17. Rendre effective la mise en place une comptabilité analytique performante dans tous les établissements dans un délai de deux ans, développer l’analyse et le contrôle de gestion et y consacrer les moyens nécessaires dans un calendrier fixé à l’avance ;
18. Demander à l’Agence des systèmes d’information partagé (ASIP-Santé) d’établir rapidement des référentiels de systèmes d’information partagés et interopérables et mettre en place ces systèmes d’information ;
19. Demander à l’ASIP-Santé d’accélérer la mise en place du dossier médical personnel (DMP) et veiller à la compatibilité des dossiers médicaux existants avec le DMP ;
20. Veiller à la réorganisation de la permanence des soins pour désengorger les urgences hospitalières ;
V. Sur les évolutions de l’activité hospitalière
21. Lever les freins au développement de la chirurgie et de la médecine ambulatoires, prévoir un cadrage national pour ce développement et fixer des objectifs dans les contrats d’objectifs et de moyens ;
22. Poursuivre le développement de l’hospitalisation à domicile et en simplifier et rendre lisible l’accès ;
VI. Sur la régulation par la qualité
23. Développer l’informatisation des blocs opératoires, utiliser des logiciels de gestion des blocs, améliorer la planification de l’activité et assurer le suivi à l’aide d’indicateurs concernant notamment le temps opératoire et les coûts de fonctionnement des salles ;
24. Appliquer les référentiels de prescription des médicaments, utiliser les logiciels d’aide à la prescription hospitalière, veiller à leur compatibilité avec les logiciels d’aide à la prescription de ville, et informatiser la prescription médicamenteuse ;
25. Établir des référentiels pour les examens biologique et de radiologie et développer l’information des nouveaux médecins et des internes sur ces référentiels ;
26. Mobiliser la Haute Autorité de santé pour élaborer et diffuser des recommandations sur les prises en charge et les soins offrant la meilleure efficience médico-économique, et envisager de donner aux recommandations un caractère opposable ;
27. Développer un système interne d’alerte pour éviter les doublons de prescription de médicaments ou d’examens biologiques ou de radiologie ;
28. Développer avec la Haute Autorité de santé les travaux d’études et de recherche sur la pertinence des interventions et des soins ;
29. Mettre en place une gestion mutualisée des lits et des capacités dans les établissements de santé ainsi qu’entre les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, dans le cadre régional ;
VII. Sur l’efficience des achats et la sécurité juridique des marchés publics
30. Professionnaliser la fonction achats et rendre obligatoire le recours aux groupements d’achats hospitaliers ;
31. Veiller au respect des règles relatives aux marchés publics et contrôler leur application ;
32. Fixer dans les contrats d’objectifs et de moyens des objectifs en matière de mutualisation de fonctions support ;
VIII. Sur les rapports avec les usagers
33. Améliorer l’information des usagers sur le parcours de soins, définir un référent, coordinateur de séjour ou de parcours de soins pour chaque patient et mettre les usagers en situation d’être informés sur le coût des traitements ;
34. Améliorer l’organisation de la prise en charge à la sortie de l’hôpital ;
IX. Sur le financement des établissements
35. Veiller à ce que la tarification à l’activité n’ait pas pour conséquence de réduire l’accessibilité aux soins ;
36. Clarifier l’objectif du financement par les tarifs ;
37. Accélérer les études sur les effets directs et indirects de la tarification à l’activité sur l’activité des établissements et la qualité des soins ;
38. Renforcer la rémunération de la qualité des soins par des dotations au titre des missions d’intérêt général et les aides à la contractualisation ;
39. Généraliser le codage à la source, « au lit du malade », des séjours et des actes par les professionnels de santé ;
40. Généraliser le paiement de la consultation, ainsi que des actes et examens programmés, au moment de l’entrée de l’usager dans l’établissement ;
41. Mener rapidement les travaux préalables avant de généraliser l’application du nouveau mode de financement aux hôpitaux locaux, aux services de soins de suite et de réadaptation et à la psychiatrie ;
42. Instaurer l’obligation pour les établissements de santé d’établir un bilan patrimonial annuel précis et réévalué chaque année, améliorer la gestion du patrimoine immobilier hospitalier et étudier la possibilité de mettre en place un office public de gestion ;
X. Sur la gestion du personnel
43. Mettre en place une stratégie régionale de gestion prévisionnelle des personnels hospitaliers ;
44. Permettre aux infirmiers de poursuivre leur formation jusqu’au niveau master et développer les possibilités d’évolution de carrière par la voie de la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle ;
45. Faciliter et accompagner la mobilité des personnels et personnaliser la gestion des carrières ;
46. Lutter contre la souffrance au travail.
*
La mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale a adopté le présent rapport lors de sa réunion du mercredi 26 mai 2010.
Comme le prévoit l’article LO 111-9-3 du code de la sécurité sociale, elle notifiera les préconisations du présent rapport au Gouvernement et aux organismes de sécurité sociale concernés, lesquels seront tenus d’y répondre dans un délai de deux mois, et assurera le suivi de ses conclusions.
CONTRIBUTION DE MME JACQUELINE FRAYSSE POUR LES MEMBRES DU GROUPE DE LA GAUCHE DÉMOCRATE ET RÉPUBLICAINE (GDR)
Jacqueline Fraysse, députée des Hauts-de-Seine, membre de la commission des affaires sociales, et les membres du groupe GDR, tiennent à saluer l'importance et la qualité de ce rapport qui s'est attaché à ne négliger aucun aspect du fonctionnement des hôpitaux publics.
Madame Fraysse note par ailleurs que les constats énoncés recoupent pour partie les mises en garde qu'elle a pu formuler lors de l'examen des nombreuses réformes subies depuis quelques années par les hôpitaux publics (hôpital 2007, fermetures massives des lits, passage à la T2A, regroupement d'hôpitaux, loi HPST…). Concernant plus particulièrement la généralisation de la tarification à l'activité, elle tient à rappeler qu'elle n'a eu de cesse, avec les députés de son groupe en s'appuyant sur les recommandations du comité d'éthique et les travaux de la Cour des comptes, d'en dénoncer les limites, et notamment l'insuffisance des enveloppes MIGAC, la mauvaise prise en compte des soins de long séjour et des maladies chroniques, les risques de sélection des patients en fonction de leur pathologie, les risques sur la qualité des soins, etc.
Si certaines des préconisations formulées dans ce rapport semblent évidentes, sans doute n'est-il pas inopportun de les rappeler. Il en est ainsi de l'organisation du dialogue social sur les évolutions organisationnelles des établissements publics de santé (proposition n° 4), de l'amélioration de la connaissance statistique des effectifs employés dans les établissements hospitaliers (proposition n° 10), de la définition préalable d'un projet médical et d'un projet d'établissement avant toute opération de restructuration (proposition n° 11), du renforcement de la formation des directeurs d'établissement (propositions n° 7, 13 et 14), de la mise en place d'une comptabilité analytique performante dans les établissements de santé (proposition n° 17), du respect des règles relatives aux marchés publics (proposition n° 31) ou de la lutte contre la souffrance au travail (proposition n° 46), cette dernière question ne pouvant faire l'économie d'une réflexion sur les conséquences de la réduction massive des effectifs.
D'autres propositions apparaissent davantage comme des points d'appui. Il en est ainsi des cadrages ministériels (proposition n° 1), des guides de bonnes pratiques (propositions n° 6) et des référentiels (propositions n° 24 à 26). Madame Fraysse tient cependant à souligner la limite des cadrages et des référentiels qui, en généralisant les « bonnes pratiques », ne peuvent prendre en compte les spécificités géographiques des établissements de santé, ou celles liées à leurs missions et aux patients qu'ils accueillent. Si les référentiels permettent de disposer d'un cadre général bénéfique pour certains établissements, ils peuvent également accentuer les difficultés d'hôpitaux qui, du fait de ces particularités concrètes, ne peuvent entrer dans des critères prédéfinis et atteindre des objectifs préalablement fixés.
D'autres propositions, enfin, apparaissent comme essentielles. Il en est ainsi de celles concernant le financement des établissements, comme les conséquences de la tarification à l'activité sur l'accès aux soins (proposition n° 35), la clarification des objectifs du financement par la T2A (proposition n° 36) ou la demande d'une meilleure évaluation et prise en compte de certaines missions d'intérêt général et de la qualité des soins (proposition n° 38),
Madame Fraysse et les membres du groupe GDR déplorent néanmoins que toutes ces propositions restent ancrées dans les limites de la politique actuelle définie par le Gouvernement. Or, cette politique, inscrite dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et mise en œuvre par la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », est caractérisée par la primauté accordée à la réduction des dépenses, au détriment de la prise en compte des besoins.
Si les députés du groupe GDR partagent la volonté affichée d'une meilleure efficience médico-économique, permettant une utilisation optimale de l'argent public, ils ne partagent pas les choix politiques actuels qui ont tous en commun la réduction des dépenses publiques pour la santé.
Ces choix politiques et la prédominance accordée à l'objectif d'équilibre budgétaire sont en contradiction avec les missions remplies par les hôpitaux publics, qui se doivent au contraire de donner la priorité à l'accès aux soins et à la réponse aux besoins de santé de l'ensemble de la population. Ils favorisent, à terme, les établissements de santé privés et une réponse individuelle aux besoins de santé, là où nous privilégions, au contraire, une réponse collective et solidaire dans un cadre public.
Sous réserve de ces observations, Jacqueline Fraysse et les membres du groupe GDR considèrent que ce rapport constitue une base de travail et de réflexion utile.
Paris, le 26 mai 2010
TRAVAUX DE LA COMMISSION
La Commission des affaires sociales examine le rapport d’information de M. Jean Mallot en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur le fonctionnement de l’hôpital, au cours de sa séance du mercredi 26 mai 2010.
M. Jean-Luc Préel, président. Nous examinons aujourd’hui le rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, qui est un organisme très important dont j’ai pu apprécier les travaux, sur le fond et sur la forme, qui ont permis de dresser un bilan exhaustif du fonctionnement de l’hôpital et de ses difficultés.
M. Jean Mallot, rapporteur. À travers ce rapport, qui a été intitulé « Mieux gérer pour mieux soigner », la MECSS s’est intéressée au fonctionnement de l’hôpital, ce qui n’est pas étonnant lorsque l’on sait que ce secteur représente environ la moitié des dépenses d’assurance maladie. Ces travaux interviennent dans le contexte de l’application progressive de la tarification à l’activité depuis 2004 et de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, deuxième élément structurant, qui n’est toujours pas complètement en application puisque tous les textes réglementaires n’ont pas été publiés, même si les agences régionales de santé ont été mises en place, le 1er avril 2010. À cet égard, la mission d’évaluation et de contrôle a considéré qu’il s’agit d’une loi de la République et qu’il ne convenait donc pas de refaire le débat sur ses dispositions ; il sera temps, dans deux ou trois ans, d’en faire l’évaluation et de voir notamment si certaines craintes étaient justifiées. Les travaux de la mission d’évaluation s’inscrivent donc dans ce cadre législatif.
La MECSS a, par ailleurs, suivi une méthode un peu nouvelle, en s’intéressant à un cas particulier, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui a été choisi pour plusieurs raisons, et notamment parce qu’après l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, il s’agit du plus gros centre hospitalier d’Île-de-France, résultant d’une fusion de deux établissements, intervenue en 1997, qui n’a jamais vraiment été appliquée, et qu’il concentre plusieurs dysfonctionnements liés notamment à des manquements humains, à des insuffisances des outils de pilotage et du système de facturation et même à des irrégularités aux règles régissant les marchés publics. Son déficit représentait, en 2007, environ 17 % du budget annuel, ce qui constitue une forme de record.
Cet établissement fait l’objet de quatre démarches : une procédure interne de redressement de ses comptes, une démarche judiciaire – le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ayant, après avoir constaté que sur un échantillon de dix-neuf marchés publics étudiés de manière approfondie par une mission d’inspection qu’il avait diligenté, quinze marchés étaient entachés d’irrégularités, saisi le Procureur de la République en novembre dernier – , une mission en cours de l’Inspection générale des affaires sociales et les travaux de la MECSS.
Nous avons essayé d’identifier des caractéristiques de gestion communes à d’autres établissements et les spécificités du Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. En vue de formuler des préconisations visant à améliorer le fonctionnement des établissements publics hospitaliers, nous avons entendu en particulier des représentants de la Cour des comptes, d’autres établissements de santé, d’agences – en particulier, la Haute Autorité de santé et l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux – des représentants du personnel ainsi que de l’Inspection générale des affaires sociales.
Il convient tout d’abord de rappeler que le service public hospitalier représente les deux tiers de l’activité hospitalière et que le secteur privé représente environ la moitié de l’activité de chirurgie et que l’activité hospitalière est marquée par la diminution de la durée moyenne des séjours. Enfin, les établissements publics de santé s’inscrivent dans un cadrage financier visant un retour à l’équilibre en 2012. Le déficit des établissements publics de santé représente environ 500 millions d’euros et environ 1 % des produits, ce qui n’est pas gigantesque au regard de l’inversion de tendance constatée en 2008. A priori, cet objectif ne paraît pas hors de portée. Mais, aujourd’hui, cet objectif de retour à l’équilibre s’inscrit dans un contexte budgétaire peu porteur de déficit de l’Assurance maladie, qui devrait être supérieur à dix milliards d’euros cette année, et des perspectives pessimistes d’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). On peut donc légitimement s’interroger sur la réalisation de l’objectif fixé de retour à l’équilibre de tous les établissements en 2012. Si l’évolution de l’ONDAM est insuffisante, les hôpitaux seront placés dans une situation intenable.
Par ailleurs, si l’objectif ultime est d’assurer des soins de qualité, on ne peut se désintéresser de leur coût et il convient, en conséquence, de chercher à améliorer l’efficience médico-économique des établissements. À cet égard, on peut rappeler que si, en 2008, 40 % des établissements demeuraient en déficit, les centres hospitaliers régionaux et universitaires concentraient 70 % du déficit global. Par ailleurs, l’augmentation de l’endettement des établissements fragilise leur situation financière.
Dans son rapport sur la sécurité sociale de 2009, la Cour des comptes a fait apparaître des disparités dans la répartition des moyens pour produire les soins, qui varie par exemple de 1 à 5 en maternité, de 1 à 8 pour la chirurgie orthopédique et jusqu’à 1 à 10 en pneumologie dans l’échantillon des établissements ayant fait l’objet de son étude. Deux questions se posent alors. Ces différences sont-elles justifiées ? Quel est leur impact sur la qualité du service médical rendu ?
S’agissant des préconisations, qui concernent un secteur d’activité essentiel et vaste, il convient tout d’abord d’améliorer le pilotage médico-économique des établissements. Au niveau national, des réformes ont été engagées. Ainsi, la création de la direction générale de l’offre de soins (DGOS) marque une volonté de sortir de « l’hospitalo-centrisme », mais il est encore nécessaire de clarifier les compétences de la nébuleuse d’organismes qui gravitent autour d’elles, tels que l’Agence des systèmes d’information partagés (ASIP Santé), l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, le conseil général des établissements de santé et l’Inspection générale des affaires sociales qui font tous de l’audit mais qui sont amenés, tellement l’organisation est complexe, à devoir passer entre eux des conventions de partenariat pour coordonner leurs actions. Leurs travaux doivent notamment consister à élaborer des référentiels de bonne pratique, rendus obligatoires et opposables.
Par ailleurs, la loi du 21 juillet 2009 a institué, à l’échelon régional les agences régionales de santé qui ont un rôle important à jouer pour diffuser les bonnes pratiques organisationnelles, qui peuvent être mises en place dans certains établissements, mais que le système semble avoir du mal à transposer dans d’autres établissements. Par ailleurs, la MECSS souhaite que les renouvellements des personnels de direction des établissements soient l’occasion de recourir à de nouveaux profils de directeurs et que la formation des directeurs soit améliorée, afin de développer la culture de l’efficience médico-économique. Il semble, en outre, que la communauté médicale n’est pas suffisamment associée au pilotage médico-économique des établissements. Là aussi, il y a une culture d’efficience médico-économique à diffuser et un effort de formation à faire.
La mise en place de pôles doit, par ailleurs, être accompagnée d’une véritable délégation de gestion et les pôles doivent disposer d’outils de pilotage performants. De manière plus générale, il est étonnant de voir que, même avec la nouvelle donne que constitue la tarification à l’activité, beaucoup d’établissements n’ont toujours pas de système de comptabilité analytique efficace et ne disposent pas des outils leur permettant de se comparer. D’une certaine manière, c’est un peu comme un automobiliste qui devrait respecter une limitation de vitesse mais qui n’aurait pas de compteur dans sa voiture !
Une autre voie d’amélioration concerne les systèmes d’information, qui ne sont en général pas interopérables, ce qui complique le pilotage des établissements. Par ailleurs, il faut absolument soulager les urgences hospitalières, en réorganisant la permanence des soins et en développant la médecine ambulatoire.
Il y a également des progrès importants à réaliser en matière de gestion des capacités, c’est-à-dire des lits. En outre, le développement de la chirurgie ambulatoire, qu’il faut encourager, va pousser à la restructuration de l’offre hospitalière. Elle correspond au souhait des patients et constitue un progrès en terme de qualité des soins, mais elle ne représente en France que 32 % de l’activité de chirurgie, contre 78 % au Danemark et 79 % en Grande-Bretagne. Il convient d’accompagner ce mouvement concernant les personnels mais aussi les patients afin d’éviter d’accroître les inégalités d’accès aux soins en raison des inégalités sociales, la compréhension du système de soins étant plus difficile pour les personnes défavorisées.
Il apparaît aussi nécessaire de mettre en place des référentiels de prescription des médicaments ainsi que des examens de biologie et de radiologie, afin d’améliorer la qualité et la pertinence des soins. Car, avec la tarification à l’activité, les établissements sont, par nature, incités à accroître leur activité et l’on peut craindre que des établissements en arrivent à faire des actes dont l’utilité serait contestable. Afin d’éviter un tel effet pervers, la Haute Autorité de santé a préconisé de mieux financer la qualité des soins. Cette position est soutenue par la MECSS.
Il convient, par ailleurs, d’améliorer la lisibilité du parcours de soins et de mettre en place à cet effet un référent qui accompagne chaque patient dans son parcours, de promouvoir le développement de la télémédecine et de l’hospitalisation à domicile ainsi que l’amélioration de la chaîne de facturation et de recouvrement. Il suffit de comparer le déficit des établissements publics hospitaliers, qui représente 1 % des produits, au taux de 5 % de sous-facturation que l’on observe dans certains établissements, sans parler du cas particulier du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, pour comprendre la nécessité d’améliorer le recouvrement des recettes résultant des tarifs par les établissements.
Je poursuivrai mes propos par quelques remarques sur la tarification à l’activité (T2A). Elle a des effets structurants et permet, certes, de sortir de l’ancien système de financement par dotation globale en basant désormais le financement sur des tarifs correspondant à la réalité des actes effectués, mais cette tarification possède un caractère inflationniste, puisqu’elle pousse à l’activité. En outre, elle ne garantit pas l’efficience médico-économique et n’est toujours pas stabilisée, puisque nous en sommes à la onzième version des tarifs et que chaque changement de version nécessite une adaptation des agents chargés de l’appliquer. Se pose, en outre, le problème de la part du tarif par rapport à la part du financement par les dotations au titre des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC). En effet, ces dotations, dédiées au financement des missions d’intérêt général de l’hôpital public, tels que la permanence des soins, les services d’urgences, la recherche, l’enseignement, la prise en charge des populations en état de précarité, selon leur évolution, déforment en effet le système de financement des établissements, puisque, à enveloppe constante, plus les MIGAC augmentent, plus la part tarifaire diminue, et plus la part, soi-disant exacte, des tarifs perd de l’importance. Ce paradoxe est inhérent au nouveau système de financement. La T2A ne garantit pas non plus l’accessibilité géographique des soins. Le risque existe même qu’elle accentue les déséquilibres territoriaux. Enfin, se pose la question de savoir si elle doit s’appuyer sur des tarifs reflétant strictement et au centime d’euro près les coûts des prestations fournies ou si elle doit constituer un outil de pilotage du système, par exemple pour développer la chirurgie ambulatoire. À titre personnel, je pense que la fixation des tarifs doit, certes, partir des coûts réels constatés, mais que la T2A doit également être un outil d’orientation de l’activité hospitalière.
En outre, la tarification à l’activité ne doit pas être un frein à l’amélioration de la qualité des soins. La Haute Autorité de santé a, certes, proposé l’institution d’une dotation MIGAC dédiée à l’amélioration de la qualité des soins, mais il convient de veiller à ce que l’application de la T2A ne conduise pas à des dérives. Il faut notamment assurer la pertinence de chacun des actes et éviter que la T2A n’incite à les multiplier inutilement. Il faut aussi éviter que la T2A ne conduise à privilégier les activités les plus rentables et à sélectionner les patients ou à optimiser le codage, c’est-à-dire à favoriser le choix par le médecin qui réalise l’acte du code qui rapportera le plus lorsqu’il existera une ambiguïté entre deux codes. Il faut donc développer les travaux d’analyse sur les éventuels effets pervers de la T2A, afin de pouvoir, le cas échéant, les corriger. Des progrès peuvent certainement être accomplis dans ce domaine.
En ce qui concerne la question de la convergence des tarifs des établissements, il faut rappeler que l’application de la tarification à l’activité aux établissements publics s’est accompagnée de la mise en place de deux processus de convergence : d’une part la convergence intrasectorielle, qui consiste à faire converger les tarifs des établissements de chacun des secteurs, publics d’un côté et privé de l’autre, d’autre part la convergence intersectorielle, qui vise à faire converger les tarifs du secteur public vers ceux du secteur privé. La convergence intrasectorielle ne suscite pas de débat. Elle est logique et cohérente, puisque les établissements obéissent, au sein de leur secteur, aux mêmes règles. En revanche, la convergence intersectorielle suscite des débats et des oppositions, dans la mesure où les établissements n’ont pas les mêmes modes de fonctionnement, ne répondent pas à la même logique, ne se sont pas vus assignés par le législateur les mêmes objectifs, ni les mêmes missions, même si la loi du 21 juillet 2009 a porté « un coup de canif » à la compétence quasi exclusive des établissements hospitaliers publics pour accomplir les missions de service public de santé en ouvrant le droit d’en exercer aux établissements privés qui le souhaitent. Ce fut d’ailleurs, au moment de la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale, un sujet de vifs débats entre la majorité et l’opposition, auxquels votre rapporteur a notamment participé activement pour s’opposer à cette évolution. Il reste que, à la différence des établissements publics, les établissements privés ne sont pas tenus d’accomplir les missions de service public. Les établissements du secteur privé ont donc des coûts de production des soins moins importants. C’est une autre source de difficulté pour réaliser la convergence tarifaire entre les secteurs. En outre, le secteur privé répond à des objectifs de rentabilité du capital et la comptabilisation des charges et des rémunérations des médecins s’effectue dans des conditions différentes dans le secteur public et dans le secteur privé. Partant de ce constat, dont il faut, comme je viens de le faire, expliquer les causes, le principe de la convergence apparaît discutable et il serait préférable, plutôt que de rechercher une convergence des tarifs, de s’orienter vers une mise en cohérence des règles de financement des deux secteurs. Il convient d’ailleurs de noter que ladite convergence a déjà été reportée à 2018, ce qui est une bonne chose, et pour ma part je pense que c’est un objectif qui ne pourra pas être réalisé.
Je terminerai ma présentation des préconisations, par trois points d’inégale importance. Afin d’améliorer la gestion du patrimoine immobilier hospitalier, il faut d’abord procéder à un inventaire de ce patrimoine que, aujourd’hui, l’on connaît très mal. Il serait d’ailleurs intéressant de réfléchir à la création d’un office public national de gestion du patrimoine immobilier hospitalier. Il faut voir si cela pourrait permettre d’aider les établissements à réaliser des progrès dans ce domaine.
Le coût des ressources humaines dans les hôpitaux publics est considérable, puisqu’il représente près de 70 % des charges d’exploitation. Pour autant, il ne faut pas en déduire qu’il suffit de réduire les frais de personnel pour réduire les déficits. Une telle attitude constituerait une erreur, surtout si cela conduisait à offrir un service médical rendu de moindre qualité. La collectivité n’y aurait rien gagné. Il faut, au contraire, développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, rendre les carrières médicales et non médicales plus attractives, améliorer les conditions de travail en associant davantage le personnel aux évolutions et réorganisations des établissements. L’application des référentiels de bonne pratique et l’amélioration du dialogue social doivent faciliter les évolutions. La prise en compte de l’intérêt des personnels et l’amélioration de leurs conditions de travail ne s’opposent pas à l’amélioration de l’efficience médico-économique ; au contraire, les deux objectifs sont complémentaires. Il y a d’ailleurs beaucoup de progrès à accomplir pour améliorer le dialogue social dans les établissements.
En conclusion, je souhaite que la MECSS assure le suivi de l’application des 46 propositions assez précises présentées dans le rapport et qu’il soit proposé à la ministre en charge de la santé de venir s’exprimer devant nous sur ce sujet, dans quelques mois. En conclusion de cette présentation générale, je veux rappeler que la MECSS, tout au long de ses travaux, a eu pour seul objectif de déterminer les solutions pouvant permettre d’améliorer la santé de nos concitoyens et l’efficience médico-économique des établissements publics hospitaliers.
M. Jean-Luc Préel, président. Je remercie le rapporteur de sa présentation synthétique d’un rapport extrêmement riche, qui concerne un sujet essentiel. La lecture de ce rapport permet, en effet, à partir de l’exemple d’un établissement cumulant de nombreuses difficultés, d’appréhender la situation de l’ensemble des établissements hospitaliers privés et publics. Le rapport présente, en effet, de nombreuses données statistiques intéressantes concernant par exemple l’évolution du nombre d’entrées dans les établissements et les durées moyennes de séjours, ainsi que des éléments d’information tout aussi intéressants sur certains dysfonctionnements ou insuffisances, notamment en ce qui concerne les outils de pilotage et de gestion, que l’on peut retrouver dans certains établissements hospitaliers. Le rapport insiste en particulier sur la nécessité d’assurer un recrutement plus ouvert de dirigeants d’établissements plus polyvalents et mieux formés pour exercer leurs missions. Le rapport présente 46 propositions et on pourrait même encore en ajouter d’autres.
M. Pierre Morange. Je salue la qualité exceptionnelle de ce rapport qui répond au souhait exprimé par la MECSS de produire un document de synthèse, établi à partir de l’examen « de terrain » d’un établissement hospitalier placé dans une situation financière particulièrement dégradée, et présentant des conclusions pouvant concerner tous les établissements. Le rapport effectue une analyse du fonctionnement des établissements hospitaliers et formule des préconisations de portée générale. Après un rappel des fondamentaux – un hôpital est fait pour produire de la santé –, le rapport fait apparaître que toutes les problématiques constatées dans divers exemples précis se retrouvent dans les autres établissements de soins et que les logiques de contractualisation, de mutualisation et de recherche de la meilleure efficience médico-économique des hôpitaux au service de la santé de nos concitoyens permettent, à l’intérieur du cadre défini par la loi du 21 juillet 2009, d’améliorer les résultats en matière de gestion des ressources humaines, techniques et financières. Nous avons constaté, à de nombreuses reprises, que l’analyse du fonctionnement interne de l’hôpital est marquée par une mosaïque d’expériences réussies, mais qu’il faut, grâce à un effort renforcé de pédagogie, mieux les diffuser et les faire partager par l’ensemble des établissements. Il est, en effet, nécessaire de développer la culture de l’amélioration de l’efficience médico-économique. Je rappelle que le rapport, enrichi de la contribution de certains membres de la MECSS appartenant au groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du parti de gauche, a été voté à l’unanimité des membres de la mission d’évaluation et de contrôle. Celle-ci assurera le suivi de ses préconisations et souhaite traduire celles-ci en initiatives législatives, par exemple sous la forme d’amendements qui pourraient être soutenus par l’ensemble des membres de la MECSS, voire de l’ensemble des membres de la commission des affaires sociales. Il faut rappeler que l’objectif de la MECSS est d’améliorer la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens.
M. Bernard Perrut. Je salue la qualité du travail réalisé par la MECSS, dont témoigne notamment le nombre important d’heures d’auditions effectuées. Il faut en particulier féliciter ses coprésidents, Jean Mallot et Pierre Morange. Le rapport montre que, quelles que soient les convictions de chacun, tous peuvent se retrouver sur une analyse commune et c’est en cela qu’il est intéressant. À partir d’une analyse très précise du système hospitalier, ce rapport établit un certain nombre de constats sur les établissements tant publics que privés, qui sont au demeurant complémentaires. En qualité d’élus locaux, nous faisons, tous les jours, ces mêmes constats sur le terrain. Il est vrai que les différences qui peuvent exister entre les différentes catégories d’établissements peuvent permettre d’assurer un meilleur accueil des patients et un exercice différencié et spécialisé dans les différentes disciplines médicales. Mais, ce rapport va encore beaucoup plus loin grâce aux propositions qu’il comporte et qui reposent sur l’analyse de fortes évolutions, comme la réduction de la durée moyenne des séjours et l’augmentation de l’activité ambulatoire. Il développe également une véritable dimension économique, que j’apprécie beaucoup, et qui se traduit par la question suivante : comment mieux gérer pour bien soigner ? C’est là une évolution significative vers une stratégie de la performance médico-économique hospitalière. Dans cette logique, le rapport préconise de mettre en place de nouveaux instruments de pilotage et de mobiliser sur ce thème les agences régionales de santé, dont il est sans doute trop tôt pour mesurer l’efficacité dans ce domaine. Le rapport demande que des objectifs leur soient fixés en matière d’appui et de conseil aux établissements, de renforcement du dialogue de gestion et de redressement des établissements déficitaires. Celan étant, je souhaiterais présenter quelques autres observations et poser plusieurs questions :
– Quelle sera l’incidence du vieillissement de la population et de l’augmentation du nombre de personnes dépendantes sur les structures hospitalières ? Avez-vous pu mesurer si elles conduiront à une hausse du recours aux soins hospitaliers ? Comment les établissements publics et privés pourront-ils y faire face ?
– La répartition territoriale des établissements est-elle équilibrée ? C’est un problème que nous rencontrons et sur lequel nous travaillons en liaison avec la constitution des communautés hospitalières de territoires ?
– Quel constat peut-on faire s’agissant de la généralisation des bonnes pratiques dans les établissements ? Ces dernières peuvent se traduire directement dans des améliorations de leur gestion ; par exemple, l’ouverture des fonctions de direction à d’autres corps de fonctionnaires et à des non-fonctionnaires, l’intéressement aux résultats, qui est déjà mis en place pour les directeurs et qui devrait être étendu à tous les personnels, comme je l’ai moi-même fait dans mon département, au Centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. De même, devraient être plus souvent mises en place des politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi qu’un projet social. Cela peut permettre d’organiser les vacances d’été du personnel, de mieux prendre en compte les contraintes de conciliation de la vie privée et de la vie familiale des salariés qui ont des enfants à charge, de mettre en place des procédures d’écoute des personnes subissant une souffrance au travail. Tous les établissements hospitaliers ont-ils mis en place un tel projet social ?
– L’encombrement des urgences nous interroge. Que faudrait-il faire pour les soulager ? Le développement des maisons médicales de garde, l’amélioration de la répartition des médecins sur le territoire et le renforcement du rôle de la médecine libérale, suffiront-ils ? Avez-vous envisagé d’autres réponses à ce problème ?
– Où en est le développement des groupements d’achats hospitaliers ? Sachant qu’ils permettent de sérieuses économies sur les achats hospitaliers, on peut s’interroger sur les différences de prix pratiquées pour l’achat de produits identiques par des établissements différents, selon leur situation géographique.
– L’hospitalisation à domicile, encore insuffisante et inégalement répartie, doit être développée en liaison avec les associations d’aide et de soins à domicile, ainsi qu’avec les infirmières et les médecins libéraux, et toutes les structures qui doivent être mieux coordonnées. Il faut aussi répondre aux difficultés que rencontrent les associations d’aide à domicile.
– Les relations avec les usagers doivent également être améliorées, notamment l’information sur leur parcours de soins, mais aussi sur les coûts des hospitalisations. Il n’est pas normal qu’une personne arrivant à l’hôpital n’en ait pas connaissance. Toute personne doit pouvoir savoir à quoi s’attendre, savoir que la santé a un coût et un prix et je me félicite de ce que, dans ma circonscription, l’hôpital de Villefranche-sur-Saône fournisse de telles informations à ses patients en les affichant sur un tableau, à l’entrée de l’établissement. En outre, il conviendrait d’améliorer la prise en charge des patients à la sortie de l’établissement hospitalier et, plus précisément, des personnes âgées isolées qui doivent être accueillies à leur sortie de l’hôpital dans un établissement de soins de suite et de réadaptation.
Saluant de nouveau la qualité du rapport présenté par Jean Mallot, je souhaite vivement que soit assuré le suivi de ses préconisations et que le plus grand nombre d’entre elles soient appliquées.
M. Jean-Luc Préel, président. Nous apprécions les remarques pertinentes de Bernard Perrut qui démontrent sa compétence en la matière et ses capacités d’analyse et de synthèse. Les établissements hospitaliers ont pour mission de procurer des soins aux patients dans les meilleures conditions de pilotage médico-économique possibles. Leur déficit budgétaire, qui s’accroissait régulièrement jusqu’en 2007, du fait principalement des centres hospitaliers universitaires, a diminué de près de 20 % en 2008. Or, si le taux d’augmentation de l’ONDAM diminue, l’équilibre financier des établissements ne sera pas atteint en 2012. Il faudra donc être particulièrement attentif à l’évolution de l’ONDAM hospitalier dans les prochaines années.
M. Dominique Tian. Je participais tout à l’heure à un débat avec M. Raoul Briet qui est un spécialiste de la sécurité sociale. Ce dernier rappelait que la France est le pays où les dépenses de santé sont les plus élevées, mais qu’elles ne produisent pas nécessairement un meilleur résultat en termes de santé publique que dans les autres pays. Cela doit nous faire réfléchir. Je tiens à féliciter Jean Mallot pour cet excellent rapport, qui souligne notamment la complémentarité entre les établissements de santé publics et privés. Les établissements publics représentent 149 000 lits, les établissements privés à but non lucratif 18 000 lits et les établissements privés à but lucratif 56 000 lits. Comme l’explique le rapport, si la dégradation de la situation financière des hôpitaux s’est ralentie en 2008, une clinique privée sur quatre déclare des pertes. Aussi, entre 1997 et 2006, sur les 276 services de chirurgie qui ont été fermés, 200 ont été fermés dans les cliniques à but lucratif.
M. Jean-Luc Préel, président. La rentabilité financière des établissements privés n’est quand même pas nulle !
M. Dominique Tian. Le nombre de cliniques privées ayant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique a diminué de 40 % entre 1998 et 2005. Ce secteur a donc connu de nombreuses restructurations.
Le rapport adopte la logique de l’efficience médico-économique, ce que j’approuve en raison des écarts importants persistants entre les coûts de production des soins, selon les établissements. En revanche, et c’est la seule divergence que j’ai avec l’ensemble des propositions du rapport, proposer le report de la convergence intersectorielle à 2018 ne me paraît pas une bonne orientation. Cela est de nature à retarder l’analyse des causes objectives des écarts de coûts de production des soins entre les établissements du secteur public et ceux du secteur privé. Cependant, je veux enfin remercier à nouveau Jean Mallot pour son remarquable rapport.
M. Jean Mallot, rapporteur. Je souhaite donner quelques éléments complémentaires. Une contribution de Jacqueline Fraysse, membre de la MECSS et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et du Parti de gauche qui apporte des nuances à notre propos, sera annexée au rapport.
M. Pierre Morange. J’ajoute que conformément à la tradition de la MECSS consistant à mener ses travaux en toute transparence, le compte rendu de l’audition de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), qui s’est tenue à huis clos, à sa demande, jeudi dernier, sera publié après la fin de la procédure contradictoire en cours entre la mission d’inspection et le Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui fait l’objet du contrôle, et donc après l’établissement du rapport définitif de l’inspection.
M. le rapporteur. L’espérance de vie augmente, ce qui constitue une réalité heureuse, car l’on vit plus âgé et en relative meilleure santé. Notamment en raison de l’amélioration des techniques médicales, l’augmentation de la demande de soins ne devrait pas être proportionnelle au vieillissement de la population. Cependant, afin de limiter l’impact du vieillissement de la population, il faudra diversifier les modalités de prises en charge des patients. Il s’agira en particulier de développer l’hospitalisation à domicile et d’améliorer la coordination des soins et des prises en charge. L’évolution future de la demande de soins peut donc être maîtrisée.
Le système hospitalier ne peut garantir sans pilote un égal accès aux soins sur l’ensemble du territoire. La tarification à l’activité ne permettant pas, à elle seule, d’assurer cette égalité, les agences régionales de santé doivent utiliser les leviers dont elles disposent pour y parvenir, en tous points du territoire. En outre, l’organisation territoriale de l’offre de soins, comme d’ailleurs l’organisation interne des établissements, doit être établie en réponse à un projet médical, élaboré en fonction des besoins de santé des populations, pour éviter aux établissements de se retrouver dans une situation dégradée, comme celle qui est, encore aujourd’hui, constatée au Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Le rapport aborde la question de la souffrance au travail dans les hôpitaux, notamment dans sa proposition n° 46. Les conditions de travail des personnels sont effectivement très difficiles, en particulier à cause de la confrontation permanente avec la maladie. Afin de limiter ce risque, les personnels doivent être mieux associés aux évolutions des établissements et mieux accompagnés, notamment grâce à un effort accru de formation professionnelle, dans leurs possibilités de mobilité et d’évolutions de carrière.
Les urgences hospitalières connaissent des difficultés évidentes. La réforme du système de financement peut, à cet égard, résoudre une partie du problème. On peut citer par exemple l’ancienne tarification à l’activité qui incitait à accueillir les patients. Le basculement actuel vers un système de dotations constitue une évolution positive. Les agences régionales de santé doivent néanmoins travailler à la réorganisation de la permanence des soins. Je pense également que des économies peuvent être réalisées grâce aux groupements d’achats.
Si l’on veut développer l’hospitalisation à domicile, il faut tout d’abord accroître la lisibilité du système et la coordination des acteurs. Il est surprenant que, parfois, ce soit le patient qui doive organiser lui-même son hospitalisation à domicile. De plus, nombre de nos concitoyens, isolés ou en situation de précarité, n’ont pas les moyens d’être hospitalisés chez eux dans de bonnes conditions.
Les relations avec les usagers peuvent être améliorées, grâce à la diffusion d’informations en ligne, sur le coût des prestations par exemple, et par un meilleur accompagnement des patients dans leur parcours de soins y compris après leur sortie de l’établissement. Il est proposé la création d’un référent coordinateur de soins pour accompagner chaque patient dans son parcours.
Je tiens à rappeler à notre collègue Dominique Tian que si les cliniques privées ont connu des pertes et des restructurations, leurs activités demeurent rentables.
Le retour à l’équilibre financier des établissements hospitaliers serait théoriquement possible en cinq ans, si les déficits continuaient de diminuer de 20 % chaque année. Mais cela suppose le maintien de l’évolution de l’ONDAM à un niveau suffisant pour financer les activités des établissements. À défaut, cet objectif sera difficile à atteindre. Si l’État accorde toujours les mêmes moyens aux hôpitaux, il est vrai que ces efforts de résorption du déficit de l’Assurance maladie devront être recherchés dans les autres types de dépenses .
Pour améliorer les pratiques professionnelles, la communauté médicale doit être davantage et mieux associée à la vie de l’établissement. Or, la loi du 21 juillet 2009, qui a centralisé le pouvoir de décision dans les mains du directeur, n’a pas promu cette orientation. Nos propositions visent à corriger ce travers de la loi. Le renforcement de l’implication de la communauté médicale suppose notamment que les médecins utilisent davantage les référentiels définis par les organismes spécialisés et assurent le codage des actes « au lit du malade », à la source du soin.
M. Jean-Luc Préel, président. Il faut méditer ce rapport, notamment son chapitre sur les déficits et l’endettement des établissements qui est particulièrement intéressant. En raison des investissements importants qu’ils ont engagés, certains établissements peuvent aujourd’hui se trouver en difficulté pour assumer la charge financière du remboursement des emprunts et les coûts de fonctionnement. Il faut d’ailleurs regretter la présence insuffisante de gestionnaires dans les conseils de surveillance pour permettre à ceux-ci de pouvoir exercer correctement leur mission. On peut d’ailleurs se demander comment faire pour améliorer les compétences en gestion des médecins qui font déjà en général quatorze années d’études. Les 46 propositions de cet excellent rapport donneront certainement lieu à de nombreux amendements qui les concrétiseront.
La commission autorise, en application de l’article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d’information en vue de sa publication.
ANNEXE 1 : UN CAS GRAVE DE DÉRIVE : LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
La MECSS a commencé ses travaux sur le fonctionnement de l’hôpital par l’analyse du cas concret d’un établissement hospitalier public. Le choix s’est porté sur le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) qui est dans une situation financière fortement déficitaire.
L’annexe présente une synthèse des documents transmis par le ministre du budget, le président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France et le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France ainsi que des éléments retenus des auditions effectuées.
I.- UN CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE BICÉPHALE ET D’IMPORTANCE RÉGIONALE
A. UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ POLYVALENT MULTISITES DE PREMIER RECOURS
Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) est l’établissement hospitalier le plus important d’Île-de-France, après l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Il est implanté dans le département des Yvelines, dans l’Ouest de la région parisienne qui dispose d’une offre sanitaire publique et privée importante et où la concurrence entre établissements est forte.
Le CHIPS est un établissement public de santé polyvalent multisites de proximité issu de la fusion, intervenue en mai 1997, de deux hôpitaux généraux, distants de sept kilomètres :
– d’une part, l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye, ouvert en 1881 et progressivement restructuré depuis les années soixante,
– d’autre part, l’hôpital de Poissy, ouvert en 1967 et installé sur la colline de Beauregard, qui bénéficie de financements des dix-sept communes du canton, regroupées en syndicat intercommunal.
Le CHIPS est un hôpital de premier recours où toutes les activités de médecine, de chirurgie, d’obstétrique, de soins de suite et de réadaptation (SSR), de psychiatrie, de soins de longue durée et de maison de retraite sont exercées.
Les pôles d’activité dominants sont le pôle mère-enfant, la chirurgie orthopédique et digestive et la cardiologie. L’activité chirurgicale en hospitalisation complète est de bon niveau, mais l’activité ambulatoire n’est pas très développée et la prise en charge des cas lourds est limitée.
B. LE PLUS GROS ÉTABLISSEMENT D’ÎLE-DE-FRANCE, APRÈS L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS
L’établissement dispose d’une capacité globale de 1 494 lits autorisés et 1 308 installés.
Le budget principal regroupe un ensemble de services qui totalisent 935 lits effectifs. Près de la moitié sont affectés au court séjour en médecine, chirurgie et obstétrique, dont 62 % pour la médecine, 23 % pour la chirurgie et 15 % pour l’obstétrique. Le centre hospitalier dispose aussi de 90 lits de soins de suite et de réadaptation, dont 15 de rééducation fonctionnelle, et de 217 lits de soins de longue durée.
Les neuf budgets annexes correspondent aux trois établissements de long séjour, aux deux maisons de retraite, à la structure d’accueil de jour pour personnes âgées, au service de soins infirmiers à domicile et aux écoles paramédicales, gérés par le CHIPS, qui préparent à la carrière d’infirmière, d’aide-soignante, de manipulateur de radiologie, d’infirmière-anesthésiste et de sage-femme.
Le centre hospitalier dispose d’un effectif de 3 264 personnes dont 289 personnels médicaux et 2 975 personnels non médicaux pour répondre aux besoins d’une population d’un bassin de vie d’environ 500 000 habitants. 91 % des consultants et personnes hospitalisées dans l’établissement habitent dans les Yvelines et 97 % résident en Île-de-France.
L’acte de création du CHIPS a fixé le principe de la présidence alternée du conseil d’administration, par périodes de trois ans, entre le maire de Poissy et le maire de Saint-Germain-en-Laye, le maire qui n’est pas président étant président suppléant.
En 2007, le directeur général en poste depuis la fusion a été remplacé par un nouveau directeur général. Ce dernier est notamment assisté par deux directeurs délégués présents sur les deux sites principaux de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye.
Le budget principal, qui correspond à l’activité hospitalière de court séjour, représente près de 93 % du budget total du CHIPS et les budgets annexes qui correspondent aux trois établissements de long séjour, aux deux maisons de retraite et aux services de soins à domicile gérés par le CHIPS représentent environ 7 % du budget total.
L’hospitalisation complète représente 81 % de la production de points ISA de l’établissement et l’ambulatoire près de 8 %.
C. L’APPARITION PROGRESSIVE DES DYSFONCTIONNEMENTS
1994 : le schéma régional d’organisation sanitaire fixe un objectif de travail en complémentarité aux deux établissements hospitaliers de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye
Juillet 1997 : fusion juridique des deux établissements
Avril 1998 : adoption d’une version provisoire du projet médical
Janvier 1999 : adoption de la version définitive du projet médical
2001 : présentation du projet de contrat d’objectifs et de moyens
Mai 2002 : le conseil d’administration accepte l’installation des deux établissements fusionnés sur un site unique différent des localisations existantes
Juillet 2002 : adoption du projet de service de soins infirmiers
Mars 2003 : conclusion du contrat d’objectifs et de moyens pour la période 2002-2005 ; il fixe les grandes lignes du projet social qui doit être développé en 2004 de même que celles du plan directeur architectural et du schéma du système d’information
Septembre 2003 : lettre du ministre de la santé demandant la mise au point d’un projet médical commun et la spécialisation des deux sites ; la lettre demande aussi au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’apprécier l’opportunité et la faisabilité d’une éventuelle construction nouvelle sur un site unique et tiers
Juillet 2004 : premier rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion du CHIPS pour les années 1998 à 2001
Décembre 2004 : signature du contrat de retour à l’équilibre financier à fin 2008 ; il est fondé sur la perspective d’une restructuration du site de Saint-Germain-en-Laye et la reconstruction du site de Poissy « dans les meilleurs délais », de manière à permettre « à l’outil de production de connaître une rationalisation effective »
2006 : adoption du projet d’établissement qui prévoit le maintien de l’activité sur deux sites, avec reconstruction du site de Poissy et restructuration de celui de Saint-Germain-en-Laye
Mars 2007 : signature du nouveau contrat d’objectifs et de moyens
Mai 2007 : le directeur général quitte l’établissement, début de l’intérim
2007 : remise du rapport de la mission d’audit demandé par la ministre de la santé
Octobre 2007 : arrivée du nouveau directeur général
Novembre 2007 : lettre de la ministre de la santé prévoyant de réunir l’ensemble des activités aiguës du CHIPS sur un nouveau site unique ; il s’agira du projet le plus important qui sera financé dans le cadre de la deuxième tranche du plan Hôpital 2012
Octobre 2008 : nouveau plan de retour à l’équilibre financier à l’horizon 2012 prévoyant des efforts accrus de réduction des charges et d’augmentation des recettes (abandon du Petscan)
Fin 2008 : rapport d’analyse financière de la direction générale des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État
Mars 2009 : d’une part, second rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion du CHIPS pour les années 2002 et suivantes, d’autre part, rapport d’inspection de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur les marchés publics du CHIPS
Mi-2009 : signature d’une promesse de vente pour l’acquisition d’un terrain dans la commune de Chambourcy pour l’implantation d’un nouvel établissement (regroupant les activités de court séjour)
Juillet 2009 : transmission du rapport d’inspection de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur les marchés publics du CHIPS au procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale
Novembre 2009 : ouverture par le procureur de la République d’une enquête préliminaire sur les marchés publics du CHIPS et demande d’inspection du CHIPS confiée à l’Inspection générale des affaires sociales.
II.- DES DOCUMENTS TRANSMIS CONVERGENTS ET ACCABLANTS
1. L’établissement est dans une situation financière périlleuse
a) Depuis la fusion intervenue en 1997, le centre hospitalier n’est pas parvenu à améliorer suffisamment sa productivité et a été placé dans une situation de déficit chronique et croissant dont il n’est pas parvenu à sortir
Depuis la fusion, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n’est pas parvenu à procéder aux réorganisations nécessaires et à améliorer suffisamment sa productivité, ce qui l’a placé dans une situation de déficit chronique et croissant dont il n’est pas parvenu à sortir.
Le tableau ci-dessous, établi à partir des données figurant dans les différents documents transmis à la MECSS, présente les principaux résultats financiers.
Résultats financiers du centre hospitalier et prévisions à l’horizon 2011
(En millions d’euros)
Soldes |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2007 modifiée |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Résultat d’exploitation |
- 0,8 |
- 2,1 |
1,8 |
7,7 |
4,9 |
- 3 |
- 22 |
- 30,5 |
||||||
Résultat courant (après produits financiers et charges financières) |
0,3 |
6,4 |
3,8 |
- 4,1 |
- 24,1 |
- 32,3 |
||||||||
Résultat exceptionnel (produits et charges exceptionnels) |
- 0,5 |
- 7,9 |
- 3,7 |
- 22,5 |
- 1,3 |
- 1,3 |
||||||||
Résultat net |
- 0,2 |
- 1,5 |
0,1 |
- 26,6 |
- 25,4 |
- 33,6 |
- 35 |
- 38,1 |
- 43 |
- 48 | ||||
Déficits cumulés |
- 57 |
- 91 |
-129,1 |
- 172,1 |
- 220 |
Depuis dix ans, en dépit de la mise en œuvre de plusieurs plans de redressement et de l’octroi d’aides financières renouvelées et croissantes qui absorbent d’ailleurs une part de plus en plus importante des dotations régionales, la situation financière de l’établissement a continué de se dégrader rapidement.
En 2008, le déficit s’est élevé à 35 millions d’euros, ce qui représente 17,5 % des recettes d’exploitation, et le déficit cumulé s’élève à 91 millions d’euros. Les prévisions pour les années suivantes ne sont pas plus optimistes, puisqu’elles prévoient une nouvelle aggravation de la situation. En l’absence de mesures correctrices réellement efficaces, le déficit pour 2011 pourrait s’élever à près de 50 millions d’euros et le déficit cumulé à 220 millions d’euros en 2011.
b) L’établissement doit faire face à un véritable défi : rétablir son équilibre financier, avant l’ouverture d’un nouvel hôpital
Le nouveau plan de redressement, adopté fin 2008, fixe un objectif de retour à l’équilibre en 2012, avant l’ouverture, prévue en 2014, d’un nouvel hôpital qui doit regrouper les activités de court séjour, implanté sur un nouveau site sur la commune de Chambourcy.
La lettre de la ministre de la santé du 17 novembre 2007 qui énonce cette décision lève au moins une incertitude et offre une meilleure visibilité aux principaux acteurs de l’hôpital – élus, personnels et patients, quant à l’avenir à moyen terme de l’établissement.
La chambre régionale des comptes d’Île-de-France considère que, dans l’attente de la mise en place du nouvel hôpital, la direction de l’hôpital actuel devrait être missionnée pour organiser l’activité de manière rationnelle, dans le cadre de l’organisation des soins définie par les autorités de tutelle.
c) La nouvelle direction a engagé l’effort de redressement
Dans sa réponse au projet de rapport de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, M. Gilbert Chodorge, directeur général de l’hôpital souligne les efforts engagés depuis 2008.
Le directeur général du centre hospitalier, nommé en juillet 2007, indique que l’établissement a présenté à l’agence régionale de l’hospitalisation, au mois d’octobre 2008, un nouveau plan de retour à l’équilibre financier à l’horizon 2012 qui prévoit des efforts accrus de réduction des charges, notamment l’abandon du Petscan qui s’annonçait déficitaire même avec un cofinancement par le partenaire privé, et d’augmentation des recettes.
Il précise notamment que des actions ont été engagées en 2008 concernant :
– la mise en place des outils d’un pilotage médico-économique qui passe par l’amélioration de la comptabilité analytique, grâce à l’instauration d’une démarche de comptabilité analytique systématisée, de résultats analytiques par pôles et de tableaux de bord mensuels ;
– la diminution des effectifs de 131 équivalents temps plein en une année, « le point d’inflexion des dépenses de personnel non médical ayant été atteint en mars 2008 » ;
– la gestion du temps de travail et la comptabilisation des temps de travail (prise des jours de RTT au fur et à mesure, réflexion en cours pour exclure le temps de repas du temps de travail, fin du deuxième « compte épargne temps maison », diminution du recours à l’intérim – plus cher que les heures supplémentaires, limitation du recours aux heures supplémentaires, amélioration du contrôle du temps de travail).
L’audition du nouveau directeur général
par la MECSS, le 5 novembre 2009
1. En 2007, à son arrivée dans l’établissement, M. Gilbert Chodorge dresse le constat sévère d’une situation financière périlleuse résultant d’une accumulation de graves dysfonctionnements
– Les comptes sont insincères
« En arrivant le 15 octobre 2007, je m’aperçois assez rapidement que les comptes ne sont pas sincères… Les comptes étaient faux… Il y avait un arriéré d’une dizaine d’années de taxe sur les salaires et nous avons dû emprunter pour rembourser… À mon avis, le déficit caché était de l’ordre de 44 millions d’euros. »
– Le déficit est abyssal
« La situation…était complètement anormale. D’habitude, le déficit d’exploitation est de l’ordre de 3 % ou 4 %. Au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, il était de 14 %. »
– À la fusion non aboutie et coûteuse s’ajoute de graves insuffisances de gestion
« Au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, deux phénomènes se conjuguent. Tout d’abord, un manque total de préparation au passage à la T2A… Ensuite, la persistance des difficultés, douze ans après la fusion…. la fusion est restée virtuelle : administrative, mais pas médicale…. L’important, ce sont les synergies médicales. Résultat : on a toutes les charges en double : gardes de nuit, réduction du temps de travail des médecins et des personnels, etc… »
– Le pilotage de la fusion est non équilibré, installé dans la routine et défaillant
« La fusion n’aurait pas dû se faire avec les gens en place… Confier la responsabilité de la fusion à un des acteurs en place revient quasiment à la condamner…. Que le directeur de Poissy soit devenu le directeur de l’ensemble a eu pour conséquence de le laisser en place pendant dix-neuf ans. C’est beaucoup. »
« Avec un budget de 260 millions, si vous n’avez pas de directeur financier, pas de responsable du personnel, pas de responsable de la logistique, vous ne pouvez pas faire grand-chose… Le directeur des ressources humaines de l’époque… m’a expliqué qu’il ne suivait pas ses dépenses de personnel. »
– La mise en évidence de graves irrégularités sur les marchés publics constitue un symptôme des dysfonctionnements
« On m’a envoyé au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour rétablir l’équilibre financier sans que personne ne m’ait dit qu’il y avait un problème relatif aux marchés…. On en revient au même malaise. Comment a-t-on pu laisser les choses se dégrader ainsi ? C’était Le Bateau Ivre. »
2. Fin 2009 : l’action déterminée mise en œuvre par la nouvelle équipe de direction a permis de réduire de presque la moitié le déficit en deux ans
– L’action résolue du nouveau directeur général a permis de commencer à redresser la situation
« Pourtant, le retour à l’équilibre est possible… Une fois découvert le vrai déficit, je suis obligé de faire un vrai plan de retour à l’équilibre. Nous sommes passés ainsi de moins 39 millions à moins 23,6 millions cette année (2009)».
– La tutelle doit appuyer les efforts engagés
« S’il n’y a pas de volonté de l’administration et de l’ARH-ARS (agence régionale de santé) de mettre un terme aux déficits, il y en aura toujours. »
– Des outils de pilotage ont été mis en place
« Depuis mon arrivée, nous avons tenté d’instaurer un dialogue médico-économique, en mettant au point un compte de résultat par activité. Les tableaux de bord sont diffusés par notre intranet. »
– Le recouvrement des recettes a été remis à niveau
« Je le répète à mes adjoints, avec la T2A nous sommes tous directeurs des finances… J’essaie avec la nouvelle équipe de direction et d’un consultant de former toutes les secrétaires médicales aux nouvelles règles de facturation pour faire payer les patients à la source… Un logiciel, utilisé au sein de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), nous a ainsi permis de récupérer 7 ou 8 millions d’euros sur 2007 et 2008. »
2. Les principaux éléments d’information résultant de l’analyse des documents transmis
Les principaux éléments d’information résultant de l’analyse des différents documents transmis par le ministère du budget, l’agence régionale d’hospitalisation d’Île-de-France et la chambre régionale des comptes d’Île-de-France sont convergents. Ils soulignent tous la situation financière désormais sérieusement dégradée de l’établissement en raison de son incapacité à procéder aux réorganisations nécessaires pour améliorer suffisamment la productivité et réduire le déficit.
a) Le rapport d’analyse financière établi par le ministère du budget
Le ministre du budget a fait parvenir un rapport d’analyse financière portant sur les comptes des années 2003 à 2007 du centre hospitalier, réalisé par les services locaux de la direction générale des finances publiques.
Ce rapport donne le ton puisqu’il conclut que l’établissement connaît « un déséquilibre structurel qui le place dans une situation critique proche de la faillite si des mesures urgentes ne sont pas prises pour résorber rapidement le déficit. »
b) Les documents transmis par l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France a fait parvenir à la MECSS de très nombreux documents administratifs concernant les dix dernières années d’activité : les comptes rendus des réunions du conseil d’administration, les contrats d’objectifs et de moyens, les rapports budgétaires, les comptes de la gestion, les rapports d’orientation, les comptes administratifs, les bilans sociaux, les rapports annuels, les comptes de gestion, le contrat de retour à l’équilibre financier conclu en 2004 et le bilan de son application réalisé en 2006, ainsi que la synthèse de l’expertise de la mission d’appui et de conseil menée en 2007. Ces documents permettent de suivre assez précisément l’évolution de la situation de l’hôpital.
Ils font essentiellement apparaître que le centre hospitalier n’a pas su procéder à toutes les réorganisations qui auraient été nécessaires pour optimiser sa gestion tout en améliorant la qualité de l’offre de soins.
La fusion fait suite à l’affirmation, en juillet 1994, par le schéma régional d’organisation sanitaire d’Île-de-France d’un objectif de complémentarité assigné aux deux établissements.
La fusion juridique est intervenue en juillet 1997, alors qu’une première version du projet médical n’a été adoptée qu’au mois d’avril 1998 et la version définitive au mois de janvier 1999, c’est-à-dire dix-huit mois après la fusion juridique. Ce retard a été probablement préjudiciable à la définition et à la mise en place des réorganisations qui auraient dû être conduites au moment de la fusion ou très rapidement après.
Les efforts de rationalisation du fonctionnement de l’établissement et de maîtrise des coûts, notamment de personnel, sont insuffisants. En raison de certaines réticences de représentants des populations des communes concernées mais aussi des personnels médicaux et non médicaux, les regroupements d’activité sont difficiles à mener à terme et lorsqu’ils aboutissent, c’est souvent avec retard. Cela conduit à maintenir certains doublons et génère des surcoûts, par rapport à des structures comparables, qu’il est difficile de réduire et qui même se cumulent. Au total la productivité de l’établissement, mesurée par le point d’indice synthétique d’activité – le point ISA – est insuffisante. Elle est, depuis le début des années 2000, inférieure à la moyenne régionale.
c) Les deux rapports d’observations de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France sur la gestion de l’hôpital
Le président de la chambre régionale des comptes a fait parvenir deux rapports présentant les conclusions définitives sur la gestion des exercices 1998 à 2001, d’une part, et 2002 à 2006, d’autre part.
Le premier rapport montre que la situation financière de l’établissement est, au début des années 2000, déjà nettement défavorable. Les frais de personnels, sont déjà trop élevés comparativement à des établissements de même importance et les reports de charges d’un exercice sur le suivant augmentent, ce qui conduit à réduire artificiellement le montant du déficit affiché.
La chambre note une accumulation de retards dans la définition des outils de pilotage et la réalisation des réorganisations nécessaires qui auraient dû être effectuées au moment de la fusion ou dans les premiers mois suivants.
Le second rapport de la chambre régionale des comptes rappelle que le centre hospitalier intercommunal « est dans une situation financière compromise » et que celle-ci continue de se dégrader.
3. Le redressement de la situation financière a été engagé par la nouvelle équipe de direction mais des évolutions importantes restent à accomplir
La présentation d’extraits de l’audition du nouveau directeur général de l’établissement permet de mettre en perspective l’évolution de l’établissement.
Malgré les difficultés financières et de gestion qu’il rencontre, le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye remplit sa mission de service public de santé. L’établissement qui développe des activités de pointe continue d’occuper une place importante dans l’offre de soins régionale. Il participe à la prise en charge et à la couverture des besoins de soins d’une population de 500 000 habitants qui représente la moitié de la population du département des Yvelines. Cela doit être souligné, d’autant que l’établissement exerce son activité dans un contexte de concurrence forte lié à la densité de l’offre de soins dans l’ouest parisien et à la proximité de Paris.
Cependant, depuis la fusion juridique, l’établissement a connu une longue période de dégradation progressive de sa situation financière. Celle-ci s’est d’ailleurs accélérée dans les dernières années de la précédente direction. Cette détérioration de la situation financière résulte d’une accumulation d’insuffisances dans le pilotage et la gestion de l’établissement. Les graves irrégularités mises en évidence par des missions de contrôle, notamment concernant certains marchés publics, constituent d’ailleurs des symptômes d’une gestion défaillante.
Depuis deux ans, la nouvelle équipe dirigeante a obtenu des résultats tangibles qui se traduisent notamment par une inflexion sensible de la courbe d’évolution du résultat financier. La gestion administrative et la situation financière se sont améliorées. Mais les progrès incontestables qui ont été accomplis sont liés à la maîtrise de certaines dépenses de personnels, essentiellement non médicaux, ainsi qu’à une amélioration de la facturation et du recouvrement. Dans ce domaine, les améliorations qui ont été obtenues en peu de temps ont permis à l’établissement de revenir dans une situation normale.
Cependant, si l’établissement est sur la bonne voie, le rétablissement de l’équilibre financier n’a pas encore été atteint et les premiers résultats positifs obtenus doivent être confirmés et amplifiés. Cela suppose de mettre en œuvre d’autres améliorations structurelles concernant notamment l’organisation interne de la production de soins et le développement de l’activité. Ces évolutions seront peut-être plus difficiles à réaliser. Pour y parvenir, cela nécessitera l’affirmation d’une volonté forte et coordonnée de l’équipe dirigeante et des instances de gouvernance de l’établissement afin de fédérer l’ensemble des personnels sur un projet médical rénové et de bénéficier de l’appui de la tutelle.
À ce stade, afin de poursuivre l’effort de redressement qui a été engagé, de préparer au mieux la mise en place du nouvel établissement qui doit regrouper les activités de courts séjours sur un site unique dans la commune de Chambourcy et d’utiliser au mieux la période transitoire, il paraît indispensable de constituer rapidement une mission d’appui-conseil de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux dotée de tous les moyens nécessaires et du temps suffisant pour accompagner l’établissement dans la poursuite de ses efforts pour revenir à l’équilibre financier, continuer de répondre aux besoins des patients et maintenir la qualité des soins. L’appui-conseil externe doit permettre à l’établissement de définir et mettre en œuvre de manière concertée les réorganisations et améliorations de la gestion interne nécessaires. Pour obtenir les améliorations attendues, il convient en effet d’associer dans cette démarche l’ensemble des personnels médicaux, soignants et non soignants.
III.- SYNTHÈSE DES DOCUMENTS TRANSMIS PAR L’AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION
Cette annexe est une synthèse des documents transmis par l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France. Elle présente les principales informations sur le fonctionnement de l’hôpital et permet de prendre la mesure de la gravité des problèmes qu’il rencontre.
Les sources d’information sur l’hôpital et la mesure de la productivité en point ISA
Outre les données concernant le CHIPS figurant dans les documents administratifs et financiers, des bases de données nationales permettent d’effectuer des comparaisons entre établissements hospitaliers et de mesurer leur productivité.
La Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) recense l’activité et les personnels des établissements de santé publics et privés ainsi que les moyens de production humains et matériels utilisés. Cette statistique a été refondue à partir de 1999 pour tenir compte de la généralisation du Programme de médicalisation du système d’information (PMSI).
Le PMSI, qui a été autorisé par une circulaire du 5 août 1986, consiste en un recueil d’informations administratives et médicales sur chaque séjour de patient effectué dans un établissement de santé. La totalité des séjours est classée en un nombre limité de groupes de séjours présentant une similitude médicale et un coût voisin : les groupes homogènes de malades (GHM).
Par ailleurs, grâce à la comptabilité analytique détaillée d’une quarantaine d’établissements, un coût moyen, exprimé en indice synthétique d’activité (ISA), est calculé pour chaque GHM. La valeur du point ISA résulte du rapport entre les dépenses hospitalières et la production d’actes, chaque acte correspondant à un certain nombre de points. Pour chaque région et pour chaque établissement, sont calculés le nombre de points ISA produits et la valeur moyenne du point ISA. Les dotations budgétaires sont notamment modulées en fonction de la valeur du point ISA. En outre, des péréquations interrégionale et intrarégionale sont effectuées afin de réduire les inégalités de dotations budgétaires entre les régions et entre les établissements.
La valeur du point ISA constitue un indicateur global de la productivité des établissements de santé.
1997 : l’année de la fusion, la productivité du CHIPS est encore supérieure à celle de la moyenne régionale
L’année de la fusion juridique, comptable et médicale, le coût du point ISA du CHIPS est en effet de 3 % inférieur à celui de la moyenne régionale : 13,63 francs contre 14,03 francs.
1998 : une première aide financière ponctuelle est accordée pour équilibrer le budget
Devant les difficultés apparues lors de la mise en œuvre du projet médical arrêté à la suite de la fusion, une mission de médiation a été mise en place, à la demande du président du conseil d’administration.
Les conclusions de la mission diligentée par le ministère de la santé, rendues au mois de novembre, dans le but d’élaborer le schéma d’organisation des activités médicales développées sur deux sites indiquent que « pour réussir cette fusion complexe et délicate » il convient de :
– « réaliser un équilibre entre les deux hôpitaux, chacun devant être leader sur quelques disciplines,
– ne pas créer de doublons au niveau des plateaux techniques spécialisés ou des services à haute contrainte de personnels,
– à l’inverse, offrir à la population des services de proximité dans les disciplines généralistes,
– enfin, entreprendre la mise en place du nouveau schéma d’organisation des activités médicales de façon progressive, par étapes, en tenant compte à la fois des travaux à réaliser et des opportunités créées par le départ des personnes, c’est-à-dire des situations qui permettent de restructurer sans brutalité. »
Le point ISA du CHIPS est passé juste au-dessus de la moyenne régionale (14,51 francs contre 14,48).
Le 17 décembre 1998, le secrétaire d’État à la santé a, « devant les difficultés rencontrées par le CHIPS, octroyé une enveloppe de 5 millions de francs, non pérenne », ce qui représente 0,4 % du budget de 1,308 milliard de francs de dépenses d’exploitation pour 1,303 milliard de francs de recettes.
En outre, le bilan social note une augmentation très forte de l’absentéisme.
1999 : la productivité commence à se dégrader
L’établissement a poursuivi la mise en œuvre de son projet médical en réalisant plusieurs évolutions importantes : le regroupement en un seul service de l’activité d’orthopédie et de traumatologie, la création d’une fédération de chirurgie viscérale et générale, le regroupement sur le site de Saint-Germain-en-Laye de l’activité opératoire d’ORL, la création d’un service unique d’obstétrique avec la gynécologie regroupé sur le site de Saint-Germain, la répartition entre une maternité de niveau II à Saint-Germain et une de niveau III à Poissy, la mise en place d’un projet commun pour la pédiatrie, la création d’un service unique d’anatomopathologie et de pharmacie, enfin la création d’un département d’information médicale et d’un département de cancérologie.
En outre, le CHIPS est un des premiers établissements à s’engager dans la démarche de certification par l’Agence nationale d’accréditation des établissements de santé, devenue la Haute Autorité de santé.
Cependant, contrairement aux années précédentes, en partie à la suite de la mise en place d’une nouvelle échelle des groupes homogènes de malades, la productivité des activités de médecine, chirurgie, obstétrique, mesurée par le point d’indice synthétique d’activité (ISA) est devenue défavorable. En effet, alors qu’en 1998, le CHIPS était, par rapport à la région, plus gros producteur de points ISA (4,96 %) que consommateur de crédits (4,88 %), en 1999, les résultats se sont inversés, le CHIPS produisant 4,79 % des points ISA et coûtant 4,83 % des dépenses régionale de médecine, chirurgie et obstétrique.
En 1999, la valeur du point ISA du CHIPS (14,69 francs) est devenue supérieure de 0,8 % à la moyenne régionale (14,57 francs). En conséquence, alors que la production régionale a, malgré le changement d’échelle, augmenté de 1,36 %, la production du CHIPS a diminué de 2,08 %. Au total, par rapport à la moyenne de l’Île-de-France, la production de points ISA du CHIPS a diminué de 3,5 %, la dégradation étant principalement due au secteur de l’hospitalisation (- 3,15 %).
Par ailleurs, les renégociations d’emprunts menées en 1999 et 2000 ont permis de réduire les taux d’intérêt et de réaliser des économies mais l’étude d’endettement réalisée pour la préparation du budget 2000 faisait état d’une inquiétude concernant la production d’autofinancement.
On note enfin une augmentation du nombre de créances irrécouvrables et du montant total qu’elles représentent.
Le compte administratif fait apparaître un résultat excédentaire de 1,1 million de francs correspondant à 0,1 % des dépenses. La diminution du résultat, par rapport à celui de 4,1 millions de francs constaté en 1998, résulte principalement d’une augmentation des dépenses de fonctionnement plus forte que celles des recettes générées par la progression de l’activité. Par ailleurs, l’investissement est en diminution sensible et les recettes d’emprunt n’ont pas été totalement utilisées.
Au mois de septembre, un protocole d’accord est conclu entre l’agence régionale de l’hospitalisation et l’établissement, dans la perspective de la signature d’un contrat d’objectifs et de moyens.
Le rapport d’orientation pour 2000 précise que la mutualisation des moyens des deux établissements doit permettre de « créer une véritable ″Cité hospitalière″ qui servira d’exemple à de futurs regroupements d’établissements ».
2000 : le point ISA du centre hospitalier est légèrement au-dessus de la moyenne régionale et un déficit de 1 % des recettes apparaît
La question de la rationalisation des activités et de la répartition des services, notamment celui des urgences chirurgicales de garde, entre les deux sites suscite de fortes tensions et des inquiétudes chez les personnels et dans la population régionale.
Cependant plusieurs opérations de rationalisation sont menées, en application du projet médical : la cardiologie est regroupée sur le site de Saint-Germain, la pédiatrie générale est aussi regroupée sur un seul site et la prise en charge des urgences chirurgicales en garde la nuit et le week-end est réorganisée.
Plusieurs mouvements de grève concernant différentes catégories de personnels médicaux et non médicaux se succèdent. Les revendications concernent la diminution de la précarité et l’augmentation des postes médicaux.
Principalement en raison de la baisse d’activité du CHIPS, en particulier en chirurgie, le point ISA du CHIPS s’élève à 14,27 francs contre 14,02 pour la moyenne régionale, soit + 1,8 %. L’activité d’hospitalisation complète en MCO a baissé de 1,72 % et n’a pas été compensée par la progression de 6,2 % de l’hospitalisation incomplète.
Du fait de recettes inférieures à ce qui était prévu (- 1,5 %), le déficit budgétaire s’élève à 13,6 millions de francs (environ 2,1 millions d’euros), ce qui représente 1,1 % des recettes. C’est le premier déficit sur le budget général constaté depuis la fusion.
Les recettes proviennent de la dotation globale à hauteur de 87,2 %, des produits des tarifications pour 6,5 % et des autres produits pour 6,2 %.
2001 : l’agence régionale de l’hospitalisation demande au centre hospitalier de mettre en place un premier plan d’économie
Le diagnostic défavorable établi par l’agence régionale de l’hospitalisation sur l’établissement conduit l’agence à demander à celui-ci de faire des économies. L’agence régionale considère que le redressement du CHIPS est prioritaire. Au mois de juillet, en vertu du principe de l’alternance, c’est le maire de Saint-Germain-en-Laye qui devient président du conseil d’administration.
a) La demande d’un premier plan d’économie
Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation notifie son budget au CHIPS, en augmentation de 1,03 % alors que l’enveloppe régionale hors Assistance publique-Hôpitaux de Paris augmente de 2,11 %, et, en conséquence, demande à l’établissement de mettre en place « un plan d’économie ».
Dans la perspective de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de l’hospitalisation, un protocole d’accord est conclu avec l’agence qui prévoit le non-prélèvement de crédits qui aurait dû normalement être la conséquence de la valeur du point ISA de l’établissement supérieure à la moyenne régionale.
Lors de la réunion du conseil d’administration du 20 janvier 2001, le directeur du CHIPS résume la situation en indiquant que le diagnostic préalable à l’élaboration du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens met en évidence « une baisse d’activité depuis trois ans, notamment pour la chirurgie… alors que l’établissement a maintenu son potentiel de production » et que « la situation est sévère au travers de certains indicateurs ».
Lors de cette réunion, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, représentant l’agence régionale de l’hospitalisation, reconnaît les difficultés d’adaptation liées à la fusion, notamment pour les personnels. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales évoque une augmentation du taux d’absentéisme par fatigue et par stress. Cependant, il souligne que le point ISA de l’Île-de-France se situe au-dessus de celui de la France entière et que le point ISA du CHIPS est encore plus élevé que celui de la moyenne régionale, ce qui constitue « une difficulté supplémentaire. »
Compte tenu du contexte et du fait que le CHIPS est l’établissement le plus important de la région, hors Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l’agence régionale de l’hospitalisation a décidé de donner la priorité au redressement du CHIPS.
Le directeur du CHIPS indique que les réorganisations à engager doivent permettre à l’établissement de « rebondir assez rapidement au niveau de l’activité. » Le projet de contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoit de ne pas faire porter « le redressement uniquement sur les crédits, mais de faire le pari d’une reprise d’activité »…« modérée et progressive (52 millions de francs sur cinq ans) », qui consiste en une augmentation d’environ 600 000 points ISA chaque année.
En ce qui concerne l’action sur les crédits, l’objectif est de répartir l’effort (7,2 millions de francs) sur les trois dernières années du contrat et de résorber sur les deux premières années le déficit de 9,2 millions de francs qui va ressortir de l’exercice 2000.
Par ailleurs, il est prévu de réduire les financements dédiés à la formation continue et à la promotion professionnelle des agents de 2,78 % de la masse salariale au pourcentage légal minimum de 2,10 %, en 2002.
Le CHIPS est accrédité par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé avec une réserve. Dans le cadre de la démarche de certification de l’établissement une direction de la qualité, rattachée à la direction générale, est alors créée.
b) Par rapport à la moyenne régionale, les coûts de personnel et les coûts médicaux du centre hospitalier paraissent particulièrement élevés
Le diagnostic préalable à l’élaboration du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens indique que la production de l’établissement diminue alors que celle de la région progresse et souligne que le niveau de productivité du CHIPS n’est pas satisfaisant. Cela se traduit par une dégradation de la valeur du point ISA de l’établissement. Cette évolution est le résultat de la progression très forte des dépenses de fonctionnement, notamment des dépenses de personnels, en particulier médicaux et de cadres infirmiers, et des dépenses médicales, en raison d’une surconsommation médicale alors même que l’activité diminue fortement.
Classement des dépenses hospitalières
– Groupe 1 : dépenses de personnels.
– Groupe 2 : dépenses médicales.
– Groupe 3 : dépenses hôtelières et générales.
– Groupe 4 : dépenses d’amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles et reprises de résultats.
Les données les plus préoccupantes tirées du bilan social 1998 concernent la part des dépenses de groupe 1 qui mobilisent 70,13 % du total des moyens contre 62,95 % en moyenne sur la région. Le poids des gardes est notamment supérieur de 71 % au poids moyen régional. Depuis la fusion, l’absentéisme pour maladie de longue durée a quasiment doublé (+ 85 %) et le nombre d’heures supplémentaires qui a fortement augmenté en 2001 représente 46 équivalents temps plein.
Au total, il est souligné que la situation budgétaire de l’établissement s’est aggravée et que la fusion des deux hôpitaux et la mise en place d’une nouvelle organisation n’ont pas permis de dégager des gains de productivité depuis trois ans ni de réaliser des économies de gestion, en dehors des dépenses hôtelières et des frais financiers. Il est clairement demandé à l’établissement de s’engager dans le sens d’une meilleure efficience et de diminuer les dépenses de fonctionnement en maîtrisant notamment l’évolution des dépenses de personnels. Le CHIPS doit optimiser l’organisation de chacune des activités médicales sur les deux sites afin d’améliorer la productivité et adapter les moyens humains, notamment médicaux, aux activités de l’établissement.
c) L’hypothèse d’un regroupement de l’hôpital sur un seul site est, pour la première fois, évoquée
Par ailleurs, lors de la réunion du conseil d’administration du 25 octobre 2001, sont évoqués l’avenir du CHIPS et le regroupement de l’hôpital sur un seul site. Sur ce point, le rapport médical d’établissement, publié fin 2002, indique que la commission médicale d’établissement et la grande majorité du corps médical souhaitent donner une nouvelle orientation au projet médical en prévoyant le regroupement des hôpitaux de Poissy et de Saint-Germain sur un site unique, en tout cas du plateau technique et de la médecine, de la chirurgie et de l’obstétrique.
Sont également abordées, lors de cette réunion du conseil d’administration, les difficultés liées à la mise en œuvre des 35 heures, notamment en raison des difficultés de recrutement de personnels qualifiés et à la limitation par la réglementation relative aux fonctionnaires hospitaliers du nombre d’heures supplémentaires à 20 heures par mois. Pour la mise en place des 35 heures, dont il est considéré qu’elle « représente une perte en force de travail de 10 % », l’établissement a obtenu l’attribution de 131 postes dont le recrutement devait s’étaler sur trois ans.
Le directeur de l’établissement insiste sur la situation financière « particulièrement préoccupante, malgré les crédits supplémentaires » et annonce un dépassement de l’ordre de 30 millions de francs sur un budget d’environ 1,3 milliard de francs, soit 2,3 %. L’établissement doit percevoir un crédit supplémentaire de 7 millions de francs, ce qui permettra de réduire le report de charges annoncé.
Le regroupement des deux services d’urgence sur un seul site la nuit est difficile à réaliser, notamment en raison de l’engagement qui avait été pris lors de la fusion de maintenir des urgences 24h/24 sur les deux sites et de la relation conflictuelle qui existe entre les deux chefs de service concernés.
L’établissement est touché par plusieurs mouvements sociaux. Après les assistantes sociales, ce sont les techniciens de laboratoires et les internes qui se sont mis en grève. Le mouvement de grève des internes dure plusieurs semaines, ce qui perturbe la qualité du service. La cause principale du mécontentement concerne l’organisation et la rémunération des gardes dans le cadre des obligations de service ainsi que la mise en place du repos de sécurité de cinquante-cinq jours en plus des congés payés.
L’exercice 2001 est le premier à se terminer avec un déficit consolidé uniquement généré par le budget général. Le déficit réel 2001 s’élève finalement à 21 millions de francs : 9 millions de déficit sur le budget général et 12 millions de report de charges, c’est-à-dire de dépenses non émises. Le déficit représente 1,5 % des recettes. Le directeur évoque « une situation financière difficile » mais précise que la plupart des établissements hospitaliers sont touchés et qu’un rebasage budgétaire est demandé.
Il est en outre mentionné dans le compte administratif que « les années à venir s’annoncent préoccupantes ».
2002 : le déficit annuel représente 0,5 % des charges et 3,3 % avec les reports de charges
Pour 2002, l’agence limite l’évolution du budget primitif du CHIPS à + 1,95 % en raison de la valeur élevée du point ISA du centre hospitalier (2,175 euros contre 2,14 euros pour la moyenne régionale, soit + 1,6 %, et la valeur cible de 2,08 euros pour la valeur cible fixée par l’agence, soit + 4,6 %). L’agence ajoute « en conséquence, cette faible progression va devoir être accompagnée d’un plan d’économie et de mesures vous permettant d’améliorer la productivité de l’établissement. »
L’idée d’un regroupement sur un site unique progresse mais elle n’est envisagée par le président du conseil d’administration que comme « une perspective à long terme sur dix, douze, voire quinze ans ». La tutelle envisage de constituer une mission d’appui sur ce sujet.
Même si l’établissement a obtenu l’attribution de 131 postes en compensation, la mise en œuvre de l’aménagement et réduction du temps de travail pourrait se traduire par une réduction de l’offre de soins, préjudiciable à l’amélioration de la valeur du point ISA de l’établissement, alors qu’il conviendrait d’augmenter l’activité. L’établissement devrait appliquer l’accord conclu à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et validé par le ministère qui prévoit une base de 32h30. Le directeur rappelle que l’établissement est déjà confronté à des difficultés de fonctionnement et se dit très inquiet sur l’avenir du centre hospitalier.
L’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est signé le 20 février 2002. Il prévoit une organisation du travail en 37h30 avec quinze jours de vacances supplémentaires au titre de la réduction du temps de travail. En contrepartie, la création de cinquante emplois est obtenue.
En raison de l’effectif insuffisant des urgentistes temps plein et de la difficulté croissante de trouver des médecins intérimaires, lesquels assurent 30 % à 40 % de la liste de garde, l’établissement décide « en cas de besoin » de réduire le nombre de listes de garde des urgences de quatre à trois, dont une liste polyvalente à Saint-Germain-en-Laye.
Le regroupement de l’activité de la maternité (4 200 accouchements), une des plus grandes de France, sur un site unique est aussi envisagé.
Le compte rendu de la réunion du conseil d’administration, du 16 mai 2002, indique que le regroupement de l’hôpital sur un site tiers et commun, à l’horizon de douze à quinze ans, est privilégié « comme cela avait déjà été prévu au milieu des années 1970 par Madame Simone Veil, alors ministre de la santé. »
Cependant, 80 % des membres de la commission médicale d’établissement (52 sur 65 votants) souhaitent le regroupement rapide des activités des sites de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye sur un site unique. Cette position est notamment motivée par le fait que « les difficultés liées à la pénurie des personnels médical et paramédical sont telles que l’établissement n’a plus les moyens de poursuivre la permanence des soins. »
Lors de sa réunion du 9 juillet 2002, le conseil d’administration « réaffirme que l’hôpital a vocation à se développer dans les prochaines années de façon équilibrée sur les deux sites de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye. Il accueille positivement la réflexion des médecins sur le regroupement à terme sur un site unique et tiers de l’hôpital afin d’en faciliter le fonctionnement ; et demande aux pouvoirs publics de prendre rapidement position sur son avenir par l’intermédiaire d’une mission d’appui. »
Le directeur souhaite limiter la durée de la période d’incertitude qui est la pire des situations et a maintenant atteint ses limites.
Le bilan social souligne la poursuite de l’accroissement de l’effectif permanent et la forte augmentation de l’absentéisme.
Malgré 10 % de crédits supplémentaires entre le budget primitif et le budget exécutoire, le solde déficitaire 2002 s’élève à 950 000 euros, soit 0,44 % des dépenses. Mais il faut prendre en compte les reports de charges qui s’élèvent à 7,1 millions d’euros (1,9 million d’euros pour deux mois de taxes sur les salaires et des factures de chauffage au titre de 2001, et 5,2 millions d’euros pour neuf mois de taxes sur les salaires au titre de 2002), soit 3,27 % des charges.
Le montant des titres irrécouvrables (en moyenne 53 euros) s’élève à 927 000 euros, en 2002. La plupart des titres sont d’un montant inférieur au seuil des poursuites (30 euros pour les commandements et 61 euros pour les saisies).
Le rapport de présentation du compte administratif indique : « La situation est préoccupante…mais elle s’explique en totalité, à fin 2002. » Puis, il conclut : « Le regroupement et le redimensionnement des services sur un seul site, est l’une des voies pour obtenir un redressement de la situation financière. »
Par ailleurs, le CHIPS a été accrédité par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, après la levée de la réserve concernant les prescriptions médicales.
2003 : le contrat d’objectifs et de moyens 2002-2005 fixe à l’établissement l’objectif d’améliorer sa productivité, l’activité baisse de 3,2 %, le report de charges augmente fortement à 17 millions d’euros et représente 8 % des charges
a) Le contrat d’objectif et de moyens 2002-2005
Le contrat d’objectifs et de moyens 2002-2005, signé le 21 mars 2003, fixe notamment à l’établissement l’objectif d’améliorer sa productivité pour l’amener au niveau des trois plus gros producteurs de points ISA de la région, hors Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
b) Le ministre reporte l’éventualité du regroupement sur un site tiers
La réunion du conseil d’administration du 15 avril 2003 est consacrée à la présentation et la discussion du rapport de la mission d’appui du ministère sur l’avenir du CHIPS. Le représentant du ministère souligne que l’établissement « est issu d’une longue histoire un peu chaotique, avec au départ un mariage de raison ». À moyen terme (cinq à sept ans), l’objectif est de « redonner un sens à l’aventure de la fusion ». Afin de pouvoir inscrire le projet de futur hôpital dans le plan Hôpital 2007, il faut trouver, dans les deux mois, un terrain pour accueillir le nouvel hôpital. Une liste de cinq sites d’implantation envisageables est établie.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales souligne les difficultés de mise en œuvre des décisions visant à inscrire la fusion dans les faits.
Le conseil d’administration décide, lors de sa réunion du 3 juillet 2003, tenue en l’absence du président, de mettre en œuvre les préconisations du rapport définitif de la mission d’appui et de conseil (qui fait le « constat d’une productivité médiocre ») et de retenir, pour la construction d’un hôpital neuf regroupant les lits de court séjour, un site unique et tiers. Deux sites sont présélectionnés.
Dans une lettre du 2 septembre 2003, le ministre de la santé indique que le projet de nouvel hôpital n’est pas retenu dans le cadre du plan Hôpital 2007. Une nouvelle étude doit être entreprise. Il appartiendra ensuite au directeur de l’agence régionale d’apprécier au vu du projet médical commun qui aura été élaboré dans un délai de six mois et devra comprendre une collaboration public-privé, l’opportunité et la faisabilité d’une éventuelle construction nouvelle sur un site unique tiers.
Le projet de nouvel hôpital étant remis en cause, le choix d’un terrain n’est plus d’actualité.
Il est décidé de regrouper les activités d’obstétrique à Poissy, de créer un site internet et de lancer un audit des blocs opératoires.
c) La situation financière continue de se dégrader
Le compte administratif pour 2003 mentionne une diminution de l’activité exprimée en points ISA de 3,15 %, notamment en raison d’une baisse d’activité de 2,8 % de l’activité d’hospitalisation. Un « petit déficit » de 0,2 million d’euros est constaté mais le report de charges augmente de 10,2 millions d’euros et s’élève à 17,3 millions d’euros, à fin 2003, soit 8 % des charges (221 millions d’euros).
Il est indiqué : « La réforme de la Tarification dite T2A va révolutionner la culture des hôpitaux publics sur leur mode de fonctionnement... Le moteur des établissements publics de santé va être les recettes ; le carburant sera l’activité. Il va falloir tout compter : l’argent, l’activité, toute l’activité… »
Le bilan social fait état de la situation très tendue en matière de ressources humaines ainsi que des limites liées à l’accumulation des heures supplémentaires, puis il conclut : « il devient impératif de restructurer l’appareil de production de soins et de prestations logistiques. »
2004 : le nouveau projet médical prévoit le maintien des deux sites et un contrat de retour à l’équilibre financier en 2008 est conclu
Le conseil d’administration décide, le 18 mars 2004, de « s’abstenir de voter sur les crédits accordés au titre du budget 2004 qui ne correspondent pas aux propositions budgétaires de l’établissement et ne lui permettent pas de fonctionner sur la base de ses objectifs.»
Le nouveau projet médical 2004-2008 est cependant adopté par le conseil d’administration, le 7 juin 2004, après avoir recueilli l’avis favorable de 77 % des médecins, de la commission médicale d’établissement et du comité technique d’établissement. Il reconnaît, pour la première fois l’existence de deux bassins de vie et prévoit la reconstruction du site de Poissy et la restructuration du site de Saint-Germain-en-Laye, à condition d’obtenir un financement dans le cadre du plan Hôpital 2007.
L’activité d’obstétrique et la chirurgie gynécologique sont regroupées à Poissy. Cependant, certains regroupements d’activité sur le site de Poissy semblent provoquer une fuite de patients et une perte de clientèle pour le CHIPS dans son ensemble.
L’admission en non-valeur de 21 000 créances irrécouvrables pour un montant de un million d’euros suscite un échange permettant d’envisager diverses solutions pour améliorer le recouvrement (améliorer les vérifications d’identité, développer le pré-paiement sur la base de forfaits ou le paiement en régie à la sortie, rendre la carte vitale au moment du retour à la caisse), lors de la réunion du conseil d’administration du 5 juillet 2004, mais ne débouche sur aucune décision.
Le directeur du CHIPS est reconduit dans ses fonctions pour quatre ans.
Le contrat de retour à l’équilibre financier, signé le 3 décembre 2004, fait état d’une simulation de déficits annuels croissants, de 12 millions d’euros en 2004 à 17 millions d’euros en 2008, ainsi que de déficits cumulés aussi croissants : 19 millions d’euros en 2003, 31,2 millions en 2004, 43,9 en 2005, 58 millions en 2006, 73,6 millions en 2007 et 90,5 millions d’euros en 2008. Il fixe un objectif de retour à l’équilibre en 2008. L’agence apportera une aide de 19 millions sur trois ans : 8 millions d’euros en 2004, 6 millions en 2005 et 5 millions d’euros en 2006. La réussite du plan repose sur la mise en œuvre de la reconstruction-restructuration prévue par le projet médical qui doit permettre de rationaliser effectivement l’outil de production et une série de mesures concernant la reprise d’activité (augmentation de 15 % du nombre d’entrées et d’actes médico-techniques, sur quatre ans), l’organisation de la permanence des soins, l’ajustement des effectifs en fonction de l’activité, la rationalisation des achats et de certaines dépenses. L’ensemble des mesures devrait permettre de ramener le déficit cumulé à 32 millions d’euros en 2008, lequel devrait être apuré au cours des exercices suivants.
L’activité, mesurée par le nombre de journées, a diminué de 2 %, en 2004.
2005 : le ministre attribue un financement de 332 millions d’euros pour la restructuration-reconstruction du CHIPS et le déficit continue d’augmenter
En raison de difficultés dans le codage, il est décidé d’effectuer un audit du codage et de toute la chaîne du recueil de l’activité. L’audit permet d’identifier les problèmes et de « récupérer un million sur les 2,7 millions d’euros ponctionnés au titre de la T2A en 2004. »
L’activité progresse en raison de l’augmentation de la fréquentation et d’un meilleur recueil de cette activité, mais le nombre de journées diminue en raison de la réduction de la durée moyenne de séjour.
Compte tenu du report de charges de 19 millions d’euros qui pèse sur le budget et du contrat de retour à l’équilibre financier, les heures supplémentaires des aides-soignantes qui travaillent la nuit et sont passées à un horaire hebdomadaire de 32h30 ne seront plus payées, mais récupérées ou versées sur un compte épargne temps.
Le conseil d’administration adopte le plan pluriannuel d’investissement 2005-2013 pour un montant de 332,4 millions d’euros. Une lettre du ministre, en date du 25 septembre 2005, prévoit l’attribution d’un financement de 332 millions d’euros pour la restructuration du site de Saint-Germain-en-Laye et la reconstruction du site de Poissy, dont 166,5 millions d’euros pour la reconstruction du site de Poissy.
Deux cliniques locales vont s’implanter, dans le cadre d’un partenariat public-privé, sur le site de Saint-Germain-en-Laye. Des terrains seront vendus au groupe de cliniques. Le terrain prévu pour la reconstruction de Poissy est situé dans « une coulée verte » et doit faire l’objet d’un déclassement par le préfet pour pouvoir être utilisé dans le cadre d’un projet d’intérêt général, ce qui supposerait aussi de modifier le schéma directeur de la région.
Le rapport budgétaire préliminaire pour 2006 indique : « à ce jour, le conseil d’administration a admis 12 millions d’euros de créances en irrecouvrabilité. »
L’activité, mesurée par le nombre de journées, a augmenté de 5,1 %, en 2005. Cependant, fin 2005, le report de charges s’élève à 23,5 millions d’euros et le déficit cumulé à 36,7 millions d’euros (9 % de plus que ce qui est prévu par le contrat de retour à l’équilibre financier) ce qui représente 15,9 % des charges. Les créances admises en non-valeur et restant à apurer représentent 12,8 millions d’euros, soit 4,74 % des charges. L’agence régionale considère que : « la situation financière est particulièrement dégradée » et évoque la possibilité du report de certains investissements. 16 500 titres ont été admis en non-valeur (dont les trois quarts sont d’un montant inférieur à 15 euros et 96 % inférieurs à 150 euros), pour un montant de 773 000 euros, en 2005.
2006 : grâce à l’aide de l’agence régionale de l’hospitalisation, le déficit cumulé apparent est contenu
Le ministère autorise l’installation d’un petscan (tomographe à émission de positons) sur le site de Saint-Germain-en-Laye, dans le cadre du groupement d’intérêt économique constitué avec la clinique. Le prépaiement du ticket modérateur est mis en place.
Afin de gagner du temps pour la reconstruction du site de Poissy, une solution alternative au projet d’intérêt général est envisagée sur un autre terrain de 10 hectares. La construction des bâtiments est prévue sur la période 2010-2012 et la mise en œuvre en 2013.
Cependant, la mise en place des pôles réactive la controverse sur la répartition des activités entre les deux sites.
L’activité, mesurée par le nombre de journées, diminue de 2,5 %. Le déficit de l’année s’élève à 6,6 millions d’euros et 26,2 millions d’euros avec le report de charges de 19,6 millions d’euros. Cependant, compte tenu de l’attribution d’une « aide non pérenne » de 3,6 millions d’euros en fin d’année, d’une reprise sur provision de un million et d’une « aide ponctuelle » de un million, le déficit réel s’élève à 12,2 millions d’euros.
Fin 2006, le déficit cumulé atteint 29,7 millions d’euros et le montant des créances admises en non-valeur restant à apurer s’élève à 11,1 millions d’euros. L’agence régionale considère que le fonds de roulement net global ne permet pas de couvrir le financement des reports de charges et met en péril le financement du plan pluriannuel d’investissement. Cependant, le déficit des hôpitaux publics d’Île-de-France devait passer de 80 millions d’euros, en 2005, à 300 millions d’euros, en 2006.
Le bilan social fait état d’une diminution du nombre d’emplois et d’une forte augmentation de l’absentéisme.
Cette même année, le CHIPS est certifié par la Haute Autorité de santé. Par ailleurs, la Fédération hospitalière de France lui attribue le prix du meilleur site internet d’un établissement hospitalier.
2007 : le déficit cumulé réel représente un tiers des produits d’exploitation
L’agence régionale refuse d’approuver la tranche d’investissements prévue en 2007 au titre du nouveau site de Poissy et demande de modifier le plan d’investissement afin d’améliorer l’équilibre financier.
Le rapport, de septembre 2007, de la mission d’appui et de conseil suscitée par le ministère conclut à la nécessité de mettre en place un plan de redressement fondé sur le développement de l’activité et une réduction significative des dépenses d’exploitation, avant que l’établissement se restructure sur un site unique. Pendant la période transitoire, il préconise de rationaliser l’organisation et de supprimer certains doublons concernant les urgences et la chirurgie, d’optimiser l’utilisation des lits de médecine, chirurgie et obstétrique et d’anticiper sur la réalisation du nouvel hôpital en construisant, sans attendre, le pôle logistique devant regrouper les laboratoires et les activités de restauration.
L’acte de vente aux cliniques d’un terrain du site de Saint-Germain-en-Laye ayant été signé, les travaux de construction peuvent commencer. Le conseil d’administration adopte le préprogramme de nouveau site hospitalier de Poissy.
Une mission d’évaluation de la mise en œuvre du projet médical est demandée par l’agence régionale. Par ailleurs, le nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2007-2011 est conclu avec l’agence régionale.
Le déficit s’élève à 27,7 millions d’euros, en 2007, soit 13 % des produits.
Fin 2007, le déficit cumulé s’élève à 57,4 millions d’euros.
Cependant, dans un objectif de sincérité des comptes, il convient de prendre en compte le stock de créances irrécouvrables de 8,2 millions d’euros, les comptes épargne-temps du personnel médical pour 6,4 millions d’euros et du personnel non médical pour 0,2 million d’euros, ainsi que les heures supplémentaires du personnel non médical pour 1,6 million d’euros. Cela porte le déficit cumulé à 73,7 millions d’euros, fin 2007, soit 34,6 % des produits, hors aides non pérennes qui se sont élevés à 212,7 millions d’euros.
2008 : le projet de nouvel hôpital à Chambourcy et le nouveau plan de retour à l’équilibre financier
Dans la perspective de la construction d’un nouvel hôpital sur la commune de Chambourcy, il est décidé d’y acquérir un terrain de 17 hectares pour un prix de 21 millions d’euros. L’objectif est de bénéficier d’un financement dans le cadre du plan Hôpital 2012 et de démarrer les travaux début 2011 pour permettre d’ouvrir le nouvel établissement en 2014. Le coût du projet est estimé à 300 millions d’euros. Il est décidé de recourir à la procédure de conception-réalisation prévue par l’article L. 6148-7 du code de la santé publique pour réaliser le projet.
Le rapport d’audit réalisé par un cabinet conseil prévoit un déficit prévisionnel de 36,9 millions d’euros en 2008 et de 47,7 millions d’euros en 2011 ; le déficit cumulé 2007-2011 pouvant s’élever à 193,3 millions d’euros.
En conséquence, un nouveau plan de retour à l’équilibre financier est adopté prévoyant, d’une part, 95 pistes d’action pour réaliser un gain net de 46 millions d’euros et, d’autre part, une aide sur quatre ans de l’agence régionale de 62,5 millions d’euros.
2009 : la mise en évidence d’insuffisances de gestion par les organes de contrôle
Un rapport d’inspection de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales établit un constat sévère sur les marchés publics passés par l’établissement. Sur l’échantillon de marchés étudiés, de nombreuses irrégularités sont constatées en matière de passation des marchés (transparence, publicité, modifications) et de conservation des archives.
Par ailleurs, un nouveau rapport de la chambre régionale des comptes analyse la gestion de l’établissement, depuis 2002 (cf. V).
IV.- SYNTHÈSE DU RAPPORT D’ANALYSE FINANCIÈRE SUR LE CENTRE HOSPITALIER ÉTABLI PAR LES SERVICES LOCAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MINISTÈRE DU BUDGET
Le rapport montre que les principaux indicateurs financiers « sont au rouge » et souligne que la situation de l’établissement est alarmante. Pour tenter d’y remédier, un nouveau plan de redressement a été voté par le conseil d’administration, au mois d’octobre 2008.
A. UNE SITUATION FINANCIÈRE TRÈS DÉGRADÉE
L’analyse financière qui a porté sur les exercices 2003 à 2007 met en effet en évidence :
– un déficit d’autofinancement, depuis 2006, les charges courantes ainsi que les charges financières augmentant plus vite que les produits de l’activité hospitalière ;
– une faiblesse structurelle de l’exploitation (résultat net négatif), celle-ci ne permettant plus de couvrir intégralement les charges de personnel en 2007 ; en outre, le rattrapage du mandatement de la taxe sur les salaires en 2006 et 2007 a encore aggravé la situation financière du CHIPS ;
– en raison de la capacité d’autofinancement négative, depuis 2006, la politique d’investissement est financée exclusivement par l’emprunt ; les dotations au titre des missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation versées par l’agence régionale de l’hospitalisation n’ont pas permis de retarder le recours à l’emprunt mais ont servi à compenser l’insuffisance de l’exploitation ; les nouveaux emprunts ont servi à rembourser les anciens et à couvrir des charges d’exploitation ; l’établissement ne dispose d’aucune marge de manœuvre pour autofinancer des investissements nouveaux ;
– une dégradation de la situation de trésorerie en 2007 palliée par des tirages successifs sur la ligne de trésorerie et des délais de paiement des fournisseurs qui s’allongent fortement.
Entre 2003 et 2007, alors que les produits d’exploitation ont augmenté de 7,3 %, les consommations intermédiaires ont progressé de 17,3 % et les dépenses de personnel de 16,2 %.
Les résultats financiers du centre hospitalier, de 2003 à 2007
(En millions d’euros)
Soldes |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2007 |
Résultat d’exploitation |
1,8 |
7,7 |
4,9 |
- 3 |
- 22 |
- 30,5 |
Résultat courant |
0,3 |
6,4 |
3,8 |
- 4,1 |
- 24,1 |
- 32,3 |
Résultat exceptionnel (produits et charges exceptionnels) |
- 0,5 |
- 7,9 |
- 3,7 |
- 22,5 |
- 1,3 |
- 1,3 |
Résultat net |
- 0,2 |
- 1,5 |
0,1 |
- 26,6 |
- 25,4 |
- 33,6 |
La régularisation des reports de charges qui a été effectuée en 2006 a eu pour conséquence d’augmenter les charges exceptionnelles de 24 millions d’euros et d’augmenter d’autant le déficit constaté cette année-là. L’essentiel de ce montant (environ 20 millions d’euros) correspond à la taxe sur les salaires non mandatée au titre des exercices 2002 à 2005.
L’apurement des reports de charges a entraîné une forte augmentation des charges exceptionnelles en 2006.
La pratique des reports de charges
La réforme de la tarification à l’activité (T2A) des établissements hospitaliers, décidée en 2003, s’est accompagnée d’une réforme comptable des établissements hospitaliers qui a notamment consisté à mettre en place l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD).
Avant cet état, certains établissements publics de santé avaient recours à la pratique des « reports de charges », c’est-à-dire au non-mandatement de certaines charges et à leur non-rattachement budgétaires et comptables à l’exercice.
Avec la mise en place de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, en 2006, les établissements ont été incités à abandonner cette pratique et à faire apparaître sur cet exercice et le suivant la totalité des charges reportées des exercices antérieurs.
En 2007, les produits des activités hospitalières de médecine, chirurgie et obstétrique et d’hospitalisation à domicile, qui représentent le premier poste de recettes (60 % des produits bruts d’exploitation), ont diminué de 4,5 %.
Le rapport indique que « cette baisse montre la grande fragilité de l’activité du CHIPS ».
Il précise toutefois que la baisse serait due à une baisse d’activité de l’hôpital mais aussi, « selon la direction », à une mauvaise codification des actes par certains services.
Cette même année, les dépenses de personnel non médical ont augmenté légèrement mais les dépenses de personnel médical ont baissé de 5 %.
Toujours en 2007, les créances admises en non-valeur mandatées ont quadruplé et l’hôpital a bénéficié d’une dotation spéciale de l’agence régionale de l’hospitalisation de 5 millions d’euros pour les compenser.
Le résultat net de l’hôpital est de 25,4 millions d’euros en 2007. En prenant en compte l’intégralité des sommes admises en non-valeur, le déficit de l’hôpital s’élèverait à 33,6 millions d’euros.
Le rapport ajoute qu’au rythme actuel (de 2008) et si rien n’est tenté, le déficit estimé à 36,9 millions d’euros en 2008, devrait atteindre 47,7 millions d’euros en 2011.
B. LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU PLAN DE REDRESSEMENT À LA FIN DE L’ANNÉE 2008
L’agence régionale de l’hospitalisation a notifié une mise en demeure au président du conseil d’administration et au directeur général afin que le centre hospitalier s’engage au retour à l’équilibre financier avant 2012 et propose un plan de redressement sur la période 2009-2012. En l’absence de toute proposition, l’établissement serait mis sous administration provisoire.
Le conseil d’administration a donc voté au mois d’octobre 2008 un nouveau plan de retour à l’équilibre prévoyant :
– une régularisation de la valorisation de l’activité existante ;
– un développement d’activités bénéficiaires ;
– une baisse sensible des dépenses, en particulier par l’optimisation des ressources humaines, la restructuration des unités de production par une synergie entre les deux sites de Poissy et de Saint-Germain.
V.- SYNTHÈSE DES RAPPORTS DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D’ÎLE-DE-FRANCE
Le président de la chambre régionale des comptes a fait parvenir à la MECSS deux rapports présentant les conclusions définitives sur la gestion des exercices 1998 à 2001, d’une part, et 2002 à 2006, d’autre part.
A. LE PREMIER RAPPORT SUR LA GESTION DES ANNÉES 1998 À 2001
La situation financière analysée par la chambre régionale est déjà nettement défavorable. La chronologie de la mise en place de la fusion que rappelle la chambre éclaire ce constat.
Elle montre une accumulation de retards dans la définition des outils de la nouvelle gouvernance et la réalisation des réorganisations nécessaires et qui auraient dû être effectuées au moment de la fusion ou dans les premiers mois suivants.
Au total, ces éléments conduisent à penser que la fusion a été effectuée trop rapidement et n’a pas été suffisamment préparée.
1. L’analyse financière réalisée par la chambre régionale est déjà défavorable
Le premier rapport souligne que le résultat d’exploitation, résultant de l’activité de l’hôpital, qui était largement excédentaire en 1998 et 1999 « s’effondre » en 2000. Le résultat global consolidé est déficitaire en 2000 et 2001. Le déficit 2001 représente environ 1 % des dépenses de fonctionnement.
Il souligne déjà que la situation budgétaire et de trésorerie de l’établissement est critique et note la tendance à l’augmentation de ses dépenses de personnel. Ces dernières qui représentaient 70,8 % des charges d’exploitation en 1998 en représentaient 71,4 %, en 2001, ce qui est nettement supérieur à la norme de 66 % généralement admise pour un établissement de cette importance situé en Île-de-France. En 2001, la différence s’élève à 5,4 points et représente 8 % de la norme de référence. La hausse des effectifs depuis la fusion explique très largement l’augmentation des frais de personnel. Entre 1997 et 2001, l’effectif du personnel médical est passé de 270 à 304 et celui du personnel non médical de 2 383 à 3 179 alors que « l’activité de l’établissement est plutôt orientée à la baisse. »
Il est en outre relevé une pratique de transfert de charges de plus en plus marquée d’un exercice à l’autre et qui excède les ajustements habituels. La chambre considère que l’importance des déficiences dans l’identification des charges et des produits à transférer « porte atteinte au principe de sincérité des comptes. »
Déjà, la chambre invite l’établissement à prendre les décisions de gestion, seules de nature à garantir l’équilibre budgétaire, à savoir contingenter la dépense médicale ou plafonner les dépenses de personnel par redéploiement des effectifs.
2. Cette situation peut s’expliquer par les retards observés dans la mise en place des nouveaux outils de pilotage et la réorganisation de la fonction soins
Le rapport de la chambre régionale présente une chronologie assez précise de la mise en place des nouveaux outils de pilotage.
Il indique tout d’abord que le centre hospitalier est le résultat de la fusion qui a fait suite à l’affirmation, en juillet 1994, par le schéma régional d’organisation sanitaire d’Île-de-France d’un objectif de complémentarité assigné aux deux établissements de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye.
La fusion juridique est intervenue en juillet 1997 alors que la première version du projet médical a été adoptée au mois d’avril 1998 et la version définitive au mois de janvier 1999.
Le projet médical défini cinq principes d’organisation et fixe cinq axes principaux d’actions portant sur la maternité, la néonatologie et la pédiatrie, les urgences, la chirurgie, la médecine, la psychiatrie et le secteur médical technique.
Le rapport de la chambre, finalisé en juillet 2004, indique cependant que le projet d’établissement, dont le projet médical est une des composantes, n’a pu être achevé en raison des incertitudes qui demeurent encore sur la répartition et la réorganisation des services entre les deux sites. En outre, un nouveau projet médical serait en cours d’élaboration. Le projet de service de soins infirmiers a été adopté le 9 juillet 2002.
Le contrat d’objectifs et de moyens a été adopté par le conseil d’administration, le 28 novembre 2002. Il fixe les grandes lignes du projet social qui doit être développé en 2004 de même que celles relatives du plan directeur architectural et du schéma du système d’information.
Le contrat d’objectifs et de moyens portant sur la période 2002-2005 a été signé par l’agence régionale de l’hospitalisation, le 21 mars 2003. Le contrat prévoit une augmentation « réfléchie et mesurée » de l’activité chirurgicale et une amélioration de la productivité devant conduire à un maintien du point ISA de l’établissement à une valeur semblable à celle des trois plus gros producteurs de points ISA de l’Île-de-France. Il est également prévu le lancement d’une réflexion sur le regroupement souhaitable de certaines activités médicales sur un site unique.
Le projet de rapport a été communiqué au directeur de l’établissement mais il n’a pas fait l’objet de réponse de sa part.
B. LE SECOND RAPPORT SUR LA GESTION DES ANNÉES 2002 ET SUIVANTES
Le projet de second rapport de la chambre régionale des comptes a fait l’objet de remarques du directeur général du centre hospitalier.
1. Le rapport de la chambre régionale des comptes met en évidence les insuffisances des mesures de redressement
Les conclusions du second rapport de la chambre régionale des comptes qui porte sur les exercices 2002 et suivants sont sévères. Contrairement aux engagements formalisés dans le premier projet médical adopté après la fusion, il subsiste de nombreux doublons dans les services et les coûts de production de l’établissement sont plus élevés que ceux de structures comparables.
Le rapport rappelle tout d’abord que le centre hospitalier intercommunal « est dans une situation financière compromise. » En effet, de 2002 à 2008, les résultats financiers ont toujours été déficitaires, sauf en 2005 où les comptes sont justes à l’équilibre.
Il précise, en outre, que les déficits de 26,2 millions d’euros et de 27,7 millions d’euros en 2006 et 2007 résultent, certes, de l’apurement des reports de charges des exercices antérieurs (près de 20 millions d’euros de taxe sur les salaires en 2006) et des créances irrécouvrables (apurement en 2007 de 5 millions d’euros de créances irrécouvrables admises en non-valeur), mais qu’ils sont intervenus alors même que l’établissement a bénéficié de plusieurs aides exceptionnelles : 18,5 millions d’euros obtenus au titre du contrat de retour à l’équilibre financier de 2004 à 2006, 3,7 millions d’euros d’ « ajustement de fin de campagne » accordés en 2006, 10,6 millions d’euros d’aides à la contractualisation en 2007.
La chambre régionale note que la tutelle est parfaitement informée de la situation financière de l’établissement mais ajoute que les deux mesures les plus déterminantes pour le retour à l’équilibre à fin 2008, prévues par le contrat de retour à l’équilibre, conclu en décembre 2004, à savoir la diminution des personnels médicaux et non médicaux, n’ont toujours pas été réellement entamées fin 2006.
Hors mouvements exceptionnels concernant les charges et produits (aides exceptionnelles…), le déficit structurel 2007 s’élève à 35 millions d’euros.
Pour 2008, le déficit prévisionnel s’élève à 34 millions d’euros.
2. La chambre régionale des comptes insiste sur la nécessité de rationaliser l’organisation de l’activité et de réaliser les adaptations nécessaires avant l’ouverture du nouvel établissement sur un site tiers
La chambre régionale note que, à défaut de mesures énergiques de redressement, la situation financière s’est encore détériorée au cours des exercices 2007 et 2008, et estime que la survie financière de l’hôpital dépend de sa capacité à se réorganiser en profondeur.
Fin 2007, le report à nouveau déficitaire atteint 57 millions d’euros. Fin 2008, le cumul des déficits devrait s’élever à 91 millions d’euros.
Le rapport ajoute que cette situation s’explique par le fait que le centre hospitalier a, au cours de la période analysée, connu un développement satisfaisant de son activité mais à un coût supérieur à celui de structures comparables. Parallèlement, les mesures de redressement prévues par le contrat de retour à l’équilibre financier n’ont pas été réalisées à hauteur des attentes.
En mars 2007, un nouveau contrat d’objectifs et de moyens a été signé.
Les termes du nouveau contrat sont relativement vagues. Cela s’explique notamment par les incertitudes concernant le devenir de l’hôpital. Néanmoins, afin d’atteindre le retour à l’équilibre financier prévu par le contrat de retour à l’équilibre financier, des mesures ont été présentées à l’agence régionale de l’hospitalisation au mois de mars 2008.
Elles explorent deux axes principaux :
– d’une part, la réalisation d’économies, principalement grâce à une « gestion active du personnel » (gels de postes, remplacement sélectif des départs en retraite, développement du recrutement d’agents contractuels, diminution des gardes et astreintes, respect de la réglementation) et à l’optimisation des fonctions logistiques ;
– d’autre part, l’augmentation, des recettes, grâce au développement d’activités nouvelles (implantation d’un Petscan, médecine de l’adolescent, chirurgie bariatrique, rythmologie interventionnelle, radiothérapie) et de la valorisation des activités réalisées.
Les principales mesures qui ont été détaillées dans le contrat ont été analysées par la chambre régionale des comptes. Celle-ci les estime, en l’état, insuffisantes pour redresser la situation, faute d’une révision de l’organisation des soins. Compte tenu de l’importance du déficit, les actions prévues ne paraissent pas à la hauteur de l’enjeu.
Au surplus, selon la chambre régionale, certaines décisions prises par la nouvelle direction, comme la création de deux postes de directeurs, semblent aller à l’encontre de l’objectif de plus grande productivité, donné à l’ensemble de l’établissement et aux équipes soignantes, en particulier.
La chambre identifie également de graves insuffisances dans les outils de pilotage de la gestion. En raison des incompatibilités existantes entre les différents systèmes d’information, la comptabilité analytique est défaillante et le contrôle de gestion n’est pas du tout développé au sein de l’établissement.
Ainsi, selon la chambre régionale, plus de dix ans après la fusion qui a rapproché des structures comparables, présentes sur les mêmes secteurs d’activité, il subsiste encore un grand nombre de doublons dans les services. Cette dualité immobilise un volant important de ressources humaines, notamment sur des segments d’activité dans lesquels la main-d’œuvre se fait rare, et rend la permanence des soins extrêmement onéreuse.
Le rapport conclut qu’après de nombreux revirements, la décision de réunir l’ensemble des activités aiguës sur un nouveau site unique a été actée en novembre 2007, par courrier de la ministre de la santé. La décision ministérielle rend caduque le contrat de retour à l’équilibre qui était fondé sur la perspective d’une restructuration du site de Saint-Germain-en-Laye et la reconstruction du site de Poissy de manière à permettre à l’outil de production de connaître une rationalisation effective. De fait, le centre hospitalier qui est contraint de s’endetter pour couvrir ses dépenses courantes n’est pas en mesure de financer d’éventuels investissements.
La chambre régionale estime néanmoins que le nouveau cap fixé semble devoir être tenu et considère que la période intermédiaire – la mise en service de la nouvelle structure n’étant pas envisageable avant 2013 – doit être mise à profit, d’une part, pour rétablir l’équilibre, voire dégager une capacité d’autofinancement, inexistante actuellement et, d’autre part, pour structurer les activités et les équipes de sorte que la mise en œuvre du nouvel équipement soit immédiatement opérationnelle.
Le rapport indique enfin que la nouvelle direction doit être missionnée pour organiser l’activité de manière rationnelle, dans le cadre de l’organisation territoriale des soins, définie par les autorités de tutelle.
Dans une lettre en date du 9 avril 2009, le directeur général du centre hospitalier a présenté des remarques sur le projet de rapport de la chambre régionale des comptes.
VI.- UN DÉFI : LE NOUVEAU PLAN DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE FINANCIER ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, FIN 2008
Le nouveau plan de retour à l’équilibre financier a été adopté lors de la réunion du conseil d’administration du centre hospitalier qui s’est tenu, le 23 octobre 2008, en présence du directeur de l’agence régionale d’hospitalisation.
A. LE CONSTAT D’UNE SITUATION FINANCIÈRE ENCORE PLUS ALARMANTE
1. Le déficit prévisionnel pour 2008 s’élève à 37 millions d’euros et représente 17,5 % des produits
Le centre hospitalier est effectivement dans une situation financière très grave.
Selon le document annexé au compte rendu de la réunion du conseil d’administration, le déficit 2007 s’est élevé à 28 millions d’euros. Le déficit prévisionnel pour 2008 s’élève à 36,9 millions d’euros. Le déficit désormais attendu serait ainsi supérieur de 9,2 millions d’euros au déficit prévu, soit un tiers de plus que la prévision initiale.
Le déficit prévisionnel pour 2008 représente 17,5 % des produits (210 millions d’euros) et 14,5 % des charges (247 millions d’euros). Le code de la santé publique fixe à 2 % de déficit le seuil de déclenchement de la procédure de redressement des comptes pour la catégorie d’établissement dont relève le CHIPS.
2. En l’absence de mesures correctrices réellement efficaces, le déficit pourrait s’élever à près de 50 millions d’euros en 2011 et le déficit cumulé à près de 220 millions d’euros
Les déficits prévisionnels pour les années suivantes s’élèvent à 38,1 millions d’euros en 2009, 43 millions en 2010 et 47,7 millions en 2011.
En cinq ans, de 2007 à 2011, le déficit pourrait augmenter de 70 % : de 28 millions en 2007 à 48 millions en 2011. Le montant des déficits cumulés sur cette période s’élèverait à 193,4 millions d’euros et le déficit cumulé total à près de 220 millions d’euros.
B. LE NOUVEAU PLAN DE RETOUR À L’ÉQUILIBRE FINANCIER À L’HORIZON 2012 FIXE DES OBJECTIFS TRÈS AMBITIEUX DE GAINS NETS ET PRÉVOIT UNE AIDE MASSIVE DE L’AGENCE RÉGIONALE D’HOSPITALISATION
Le plan de retour à l’équilibre financier a été approuvé, le 20 octobre 2008, par la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et par la commission médicale d’établissement. Le conseil d’administration du CHIPS l’a adopté le 23 octobre 2008.
1. Le nouveau plan décidé après la réalisation d’un audit prévoit un retour à l’équilibre financier en 2012
Le plan de retour à l’équilibre financier, d’une durée de quatre ans correspondant à la période 2008-2011, vise à permettre de revenir à l’équilibre financier en 2012. Selon le directeur du CHIPS, « le résultat espéré fin 2008 est un retour à l’équilibre parfait en 2012. »
Selon la proposition de plan de retour à l’équilibre financier, établie avec l’aide de consultants de Capgemini Consulting et annexé au compte rendu du conseil d’administration, le plan de retour à l’équilibre prévoit de dégager, par « des améliorations économiques pérennes », « un gain net de 46 millions d’euros » en 2011.
2. L’objectif est de réaliser une cinquantaine de millions d’euros de « gains nets »
a) 95 pistes de « gains nets » ont été retenues
Les 95 pistes de « gains nets » qui ont été retenues concernent cinq champs d’actions.
Les 95 pistes de gains nets prévus par le plan de retour à l’équilibre financier
Champ d’actions |
Nombre de pistes |
Gains nets |
Développement d’activités nouvelles |
36 |
16,2 |
Régularisation de la valorisation de l’activité existante |
23 |
12,8 |
Optimisation de la gestion des ressources humaines et de la masse salariale |
6,9 | |
Restructuration et redimensionnement d’unités de production |
18 |
5,1 |
Réorganisation et redimensionnement des fonctions support |
8 |
5 |
Total |
95 |
46 |
On peut noter que le surcoût lié au caractère bisite de l’établissement est estimé dans le document de Capgemini à seulement 3 à 4 millions d’euros.
b) Les améliorations recherchées concernent les dépenses, les recettes et la valorisation de l’activité
Les gains espérés se répartissent approximativement en trois tiers :
– baisse de dépenses : 37 % ;
– augmentation de l’activité : 35 % ;
– amélioration de la valorisation : 28 %.
3. L’agence régionale d’hospitalisation accompagne l’établissement en lui apportant une aide financière très importante
a) Une aide prévue de 68 millions d’euros
Pour financer son plan de redressement, le CHIPS a demandé à l’agence régionale de l’hospitalisation une aide de 67,5 millions sur quatre ans.
Le directeur de l’agence régionale a indiqué que l’agence s’engageait pour la durée du plan de redressement sur un financement de 62,5 millions d’euros pour couvrir le déficit prévisionnel résiduel, après réalisation des gains nets par l’établissement.
Le document de Capgemini annexé au compte rendu de la réunion du conseil d’administration indique un montant global d’aide de l’agence régionale de l’hospitalisation de 62 millions et fournit la répartition du financement sur la durée du plan : 36,9 millions d’euros en 2008, 19,6 millions en 2009, 9,3 millions en 2010 et 1,7 million en 2011, soit un total de 67,5 millions.
b) Une aide attribuée sous condition qui mobilise un quart des ressources de l’agence régionale
Le directeur de l’agence régionale a aussi précisé « qu’il s’agit d’un effort énorme pour l’agence régionale de l’hospitalisation » qui « va mobiliser un quart de ses ressources en 2008 pour le CHIPS ». Selon lui, la moitié de l’aide de l’agence régionale de l’hospitalisation de 62,5 millions d’euros sera considérée comme acquise après la validation du plan de retour à l’équilibre financier et l’autre moitié sera conditionnée aux résultats de mise en œuvre effective du plan. « Cela signifie qu’elle attend qu’en 2009 l’établissement réduise effectivement le déficit prévisionnel et annoncé à hauteur de 19 millions, pour qu’en 2010 l’aide de l’agence régionale de l’hospitalisation soit versée. »
L’agence régionale de l’hospitalisation a en outre demandé que l’établissement fasse un effort particulier sur le dernier trimestre 2008 chiffré à 5 millions d’euros. Le directeur de l’établissement s’est engagé à mener à cet effet une action sur la facturation pour récupérer le maximum de recettes. Ce montant de 5 millions d’euros explique la différence entre les 67,5 millions d’euros demandés par l’établissement et le financement de 62,5 millions fixé par l’agence régionale de l’hospitalisation.
ANNEXE 2 : COMPOSITION DE LA MISSION
Présidents
M. Jean Mallot (SRC)
M. Pierre Morange (UMP)
Membres
Groupe UMP
M. Georges Colombier
M. Rémi Delatte
M. Jean-Pierre Door
Mme Bérengère Poletti
M. Dominique Tian
Groupe SRC
Mme Martine Carrillon-Couvreur
Mme Marie-Françoise Clergeau
Mme Catherine Génisson
Mme Catherine Lemorton
Mme Marisol Touraine
Groupe GDR
Mme Martine Billard
Mme Jacqueline Fraysse
M. Maxime Gremetz
Groupe NC
M. Claude Leteurtre
M. Jean-Luc Préel
ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Pages
Auditions, à huis clos, du 29 septembre 2009 :
16 h 30 Mme Rolande Ruellan, présidente de la sixième chambre de la Cour des comptes, M. Noël Diricq, conseiller maître, Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseillère maître, et Mme Carole Pelletier, rapporteure 185
18 h 00 M. Jean-Yves Bertucci, président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, et Mme Sylvie Boutereau-Tichet, conseillère référendaire à la Cour des comptes 194
Auditions, à huis clos, du 8 octobre 2009 :
9 h 00 M. Marc Buisson, ancien directeur général du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye 203
10 h 00 M. Luc Paraire, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines 213
Auditions, à huis clos, du 22 octobre 2009 :
9 h 30 M. Emmanuel Lamy, président du conseil d’administration du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, maire de Saint-Germain-en-Laye 220
10 h 15 Table ronde avec des responsables de pôles médicaux et le président de la commission médicale d’établissement du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye : M. Jean-Pierre Gayno, chef du pôle « médecine interne et cardiovasculaire », M. Hervé Outin, chef du service de réanimation, président de la commission médicale d’établissement, M. Nicolas Simon, chef du pôle « urgences-réanimation-pédiatrie », et M. Nicolas Tabary, chef du pôle « chirurgie-anesthésie-bloc opératoire » 226
11 h 45 M. Jacques Masdeu-Arus, ancien président du conseil d’administration du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye 236
Auditions, à huis clos, du 5 novembre 2009 :
8 h 00 M. Gilbert Chodorge, directeur général du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye 351
9 h 00 Table ronde avec des responsables de pôles et de services administratifs du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye : Mme Gaëlle Fonlupt, responsable du pôle « activité », et Mme Joséphine Romano, directrice de la clientèle, M. Nicolas-Raphaël Fouque, responsable du pôle « ressources », et Mme Florence Ardilly, directrice des achats 249
10 h 00 Table ronde avec des directeurs ou anciens directeurs de services administratifs du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint- Germain-en-Laye : Mme Patricia Colonnello, directrice des affaires hôtelières, logistiques et biomédicales, M. Michel Louis-Joseph Dogué, ancien directeur des ressources humaines, directeur du Centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, et Mme Viviane Humbert, directrice du projet « nouvel hôpital » 259
Auditions, à huis clos, du 19 novembre 2009 :
9 h 30 M. Jacques Métais, directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France 270
10 h 30 M. François Devif, directeur chez Capgemini Consulting, responsable de la mission d’audit du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye 281
11 h 30 M. Philippe Ritter, président du conseil d’administration de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, et M. Christian Anastasy, directeur général 290
Auditions du 26 novembre 2009 :
9 h 30 M. Pierre Vollot, directeur du Centre hospitalier intercommunal Loire-Vendée-Océan 303
10 h 30 Mme Véronique Anatole-Touzet, directrice générale du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville 312
11 h 30 M. Philippe Roussel, directeur général du Centre hospitalier du Mans, M. Lucien Vicenzutti, directeur du Centre hospitalier de Lens, et Mme Véronique Vosgien, vice-présidente de la commission médicale d’établissement, et M. Philippe Vrouvakis, directeur général de la Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle 320
Auditions du 3 décembre 2009 :
9 h 00 M. Gérard Vincent, délégué général de la Fédération hospitalière de France, et M. Yves Gaubert, responsable du pôle finances 329
9 h 40 M. Jean-Loup Durousset, président de la Fédération de l’hospitalisation privée, et M. Laurent Castra, directeur des affaires économiques 336
10 h 20 M. Antoine Dubout, président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, et M. Yves-Jean Dupuis, directeur général 344
Auditions du 10 décembre 2009 :
9 h 30 Mme Maryse Chodorge, directrice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation 351
10 h 30 M. Antoine Flahault, directeur de l’École des hautes études en santé publique, et M. Christian Queyroux, secrétaire général 357
11 h 30 Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière 364
Auditions du 17 décembre 2009 :
9 h 30 Mme Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des sports 373
10 h 30 M. Christophe Alfandari, président du directoire de la Clinique Saint-Gatien, M. Philippe Choupin, directeur général délégué des Nouvelles cliniques nantaises, et M. Gérard Reysseguier, directeur de la Clinique Sarrus-Teinturiers 383
11 h 30 M. Gérard Baron, directeur général de la Clinique Belledonne, M. Philippe Plagès, directeur par intérim de la Polyclinique Majorelle, M. Frédéric Dubois, président-directeur général du groupe Médi-Partenaires, et M. Sami Franck Rifaï, directeur général de la Clinique Tivoli 388
Auditions du 14 janvier 2010 :
9 h 30 Mme Nathalie Canieux, secrétaire générale de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, M. Thierry Petyst de Morcourt, chargé de la fonction publique hospitalière à la Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC, M. Philippe Crépel, responsable de la politique revendicatrice de la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, M. Denis Basset, secrétaire fédéral de la branche santé de la Fédération des personnels des services publics et de santé Force Ouvrière, et M. Jean-Yves Daviaud, assistant fédéral de la branche santé, M. Jean-Marie Sala, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale SUD santé sociaux, et M. Dominique Russo, secrétaire général de l’UNSA-Directeur, représentant l’Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux 398
11 h 00 M. Pierre Faraggi, président de la Confédération des praticiens des hôpitaux et M. Jean-Claude Penochet, vice-président et président du Syndicat des psychiatres des hôpitaux, Mme Rachel Bocher, présidente de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers, et M. Alain Jacob, secrétaire général, M. François Aubart, président de la Coordination médicale hospitalière, M. Roland Rymer, président du Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux publics, M. Jean-Pierre Esterni, secrétaire général, et M. André Elhadad, vice-président 411
Auditions du 28 janvier 2010 :
9 h 00 M. Laurent Degos, président de la Haute Autorité de santé, MM. Jean-Michel Dubernard et Jean-Paul Guérin, membres du collège, et M. François Romaneix, directeur 423
10 h 00 Mme Claude Rambaud, présidente de l’Association de lutte, d’information et d’étude des infections nosocomiales – Le Lien, membre du Collectif interassociatif sur la santé, et M. Nicolas Brun, chargé de la santé à l’Union nationale des associations familiales et président d’honneur du Collectif interassociatif sur la santé 431
Auditions du 11 février 2010 :
9 h 30 M. Benoît Leclercq, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, M. Paul Castel, directeur général des Hospices civils de Lyon et président de la Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires, M. Jean-Pierre Dewitte, directeur général du Centre hospitalier universitaire de Poitiers, et M. Denis Fréchou, président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers 441
10 h 30 M. Pierre Boissier, chef de l’Inspection générale des affaires sociales, Mme Françoise Lalande et M. Christophe Lannelongue, inspecteurs généraux des affaires sociales, et M. Denis Debrosse, conseiller général des établissements de santé 451
11 h 30 M. Alain Destée, président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires, M. Francis Fellinger, président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers, M. Didier Gaillard, président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des établissements de santé privés à but non lucratif, M. Jean-Pierre Genet, président d’honneur, M. Marc Hayat, vice-président, et M. Jean Halligon, ancien président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement de l’hospitalisation privée 457
Auditions du 18 février 2010 :
9 h 30 M. Frédéric van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, et M. Jean-Marc Aubert, directeur délégué à l’organisation des soins 466
10 h 30 M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des sports 476
11 h 30 M. Benjamin Maurice, directeur de la Mission sur la tarification à l’activité et chef du bureau du financement de l’hospitalisation privée à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des sports 482
Audition du 30 mars 2010 :
9 h 30 Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports 490
Audition, à huis clos, du 20 mai 2010 :
9 h 30 M. Pierre Boissier, chef de l’Inspection générale des affaires sociales, et M. Pascal Penaud, inspecteur général des affaires sociales
ANNEXE 4 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
AUDITIONS DU 29 SEPTEMBRE 2009
Audition, à huis clos, de Mme Rolande Ruellan, présidente de la sixième chambre de la Cour des comptes, de M. Noël Diricq, conseiller maître, de Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseillère maître, et de Mme Carole Pelletier, rapporteure.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous entamons le cycle des auditions sur le fonctionnement de l’hôpital en accueillant Mme Rolande Ruellan, présidente de la sixième chambre de la Cour des comptes. Elle va nous exposer le détail des remarques formulées par la Cour dans son rapport annuel sur la sécurité sociale à propos de la réforme de l’hôpital et des insuffisances de nos structures hospitalières.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous avons parfaitement conscience que la promulgation toute récente de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires va faire bouger les choses. Mais celles-ci changent tout le temps, et notre méthode aussi puisque nous avons décidé de nous intéresser à des cas particuliers avant de généraliser les conclusions que nous aurons pu tirer. Nous nous attacherons en particulier aux disparités entre établissements, sur lesquelles vous aviez déjà attiré notre attention.
Pourriez-vous tout d’abord, madame la présidente, nous présenter les principales conclusions de votre rapport sur l’organisation de l’hôpital ?
M. Rolande Ruellan, présidente de la sixième chambre de la Cour des comptes. Dans le cadre du premier bilan du plan Hôpital 2007 dressé par la Cour, le volet consacré à l’organisation et à la gouvernance a mobilisé dix-huit chambres régionales des comptes autour d’un panel de trente-neuf établissements. Statistiquement, l’échantillon n’est pas représentatif, mais il est très diversifié.
Mme Marianne Lévy-Rosenwald, conseillère maître à la Cour des comptes. Nous avons procédé en deux étapes. Avant une seconde phase plus qualitative et centrée sur des entretiens approfondis, la première, quantitative, comportait un questionnaire assez fermé, réclamant beaucoup de données chiffrées sur trois services qui pouvaient se prêter à des comparaisons en médecine, en chirurgie et en obstétrique, à savoir la pneumologie, la chirurgie orthopédique et la maternité. Tous les établissements ne disposant pas d’une comptabilité analytique en coût complet par spécialité, une vingtaine d’entre eux a pu nous transmettre le détail des coûts. En revanche, nous disposons de données descriptives pour les trente-neuf établissements.
Mme Rolande Ruellan. Nous vous en fournirons la liste.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est le pourcentage d’établissements qui ont une comptabilité analytique ?
M. Noël Diricq, conseiller maître à la Cour des comptes. Nous sommes bien en peine de vous répondre. Tous n’en ont pas, sans compter ceux, et ils sont nombreux, qui croient en avoir une. Pour faire de la comptabilité analytique en coût complet un instrument opérationnel, il faut de vraies exigences méthodologiques et des choix d’organisation qui n’ont pas été faits partout. Le matériel existe, les référentiels existent, mais la tutelle elle-même est bien obligée d’admettre un état très sous-optimal sur le terrain. Il y a néanmoins des discussions, y compris au sein de l’univers hospitalier, sur des conventions d’instruments de répartition des coûts. Cela dit, rien n’est réglé pour l’instant.
Mme Rolande Ruellan. Le ministère a mis des outils à la disposition des établissements, mais ceux-ci répugnent à s’en emparer. Ils n’ont pas toujours envie de connaître la réalité des coûts.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Et le ministère ne leur demande rien ?
Mme Rolande Ruellan. Il faut lui poser la question car nous n’avons obtenu que des réponses convenues.
M. Noël Diricq. À défaut d’être plus précis, nous sommes en mesure d’affirmer que beaucoup ne sont pas capables de dire ce que sont les coûts complets, ni de les comparer. Ce qui est vrai au niveau de l’établissement l’est a fortiori au niveau des responsables de pôle, dont on attend désormais qu’ils orientent leur activité de façon à optimiser la gestion.
Mme Rolande Ruellan. Il arrive aussi que les éléments, quand ils existent, ne leur soient pas donnés. C’est un autre problème. Les pôles, de création récente, se sont mis en place tellement lentement que nous n’avons pas pu mesurer leur efficacité. Nous avons seulement constaté qu’ils n’ont pas les outils, notamment les données sur leurs propres coûts, qui leur permettraient de jouer vraiment leur rôle.
Mme Carole Pelletier, conseillère à la Cour des comptes. Beaucoup d’établissements sont en train d’y travailler, mais ils ne sont pas encore dans une phase de production régulière. Les chiffres arrivent avec du retard, un an souvent, et le dispositif n’est pas opérationnel. C’est la raison pour laquelle nous avons traité surtout l’année 2006. Les chiffres de 2007 n’étaient pas encore connus, du moins en comptabilité analytique.
M. le coprésident Pierre Morange. La comptabilité analytique a-t-elle un caractère obligatoire dans les hôpitaux ?
M. Noël Diricq. Il y a des circulaires en ce sens.
M. le coprésident Pierre Morange. Elles ne sont donc pas appliquées ?
Mme Carole Pelletier. Faute de moyens mis en œuvre.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans vos comparaisons des maternités, les avez-vous distinguées en fonction de leur type – 1, 2 ou 3 –, qui dépend de la complexité croissante des actes qu’elles pratiquent ?
Mme Marianne Lévy-Rosenwald. Oui, mais vous seriez surpris du résultat ! Le niveau le plus élevé n’est pas forcément le plus onéreux. L’obstétrique suppose une permanence des soins, c’est-à-dire des coûts fixes, qui, à moins de 300 ou 400 accouchements par an, ne peuvent pas être amortis, indépendamment de la complexité des cas traités. En outre, les établissements les mieux équipés attirent les femmes qui y préfèrent accoucher et les ratios économiques sont finalement plus favorables aux maternités de type 3.
Mme Rolande Ruellan. Nous avions déjà appelé l’attention sur le fait que la population ne respecte pas le classement, si bien que les maternités de niveau 3 accueillent beaucoup d’accouchements sans problème.
Mme Catherine Génisson. Ces maternités jouent parfois le rôle de maternité de proximité.
Mme Rolande Ruellan. C’est tout le problème des CHU qui sont aussi, et on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas le cas, des hôpitaux de proximité. D’ailleurs, 80 % des activités des CHU sont des interventions de base qui pourraient être faites ailleurs et il arrive que certains centres hospitaliers soient au moins aussi pointus que des CHU.
M. Maxime Gremetz. Je ne comprends pas. Chez moi, à Doullens, les gens se battent pour garder leur maternité qui n’a que trois accouchements de moins que le seuil fixé. Ils n’ont aucune envie de faire quarante-cinq kilomètres pour se rendre à Amiens, mais ils y sont obligés.
Des économies sont nécessaires. Mais, si les CHU sont aussi des hôpitaux de proximité, ce dont je me réjouis, comment expliquer que 92 % d’entre eux soient en déficit ? Et que le CHU d’Amiens, l’hôpital Nord, situé dans la zone populaire, la plus peuplée, qui abrite la zone industrielle, soit déménagé en totalité loin au sud, laissant un quartier déshérité sans aucun service. On va certes construire un plateau technique remarquable mais très cher, et les hôpitaux n’ont plus le droit – je le sais car j’ai lu la note – d’exécuter des actes mineurs, comme de soigner un panaris. On envoie les gens dans le privé ! Nous sommes pourtant les derniers en matière de soins, avec le Pas-de-Calais.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est pourquoi la mission a décidé d’adopter une démarche de terrain, en partant d’exemples concrets comme celui qui vient d’être décrit, pour évaluer l’efficacité des mesures que nous avons votées, et qui ne sont pas toujours appliquées, sur la qualité des soins prodigués à nos concitoyens. Nous examinons un cas particulier, le Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui est l’hôpital le plus déficitaire de France avec 150 millions d’euros de déficit cumulé, pour comprendre les raisons – d’ordre sanitaire, financier ou législatif – pour lesquelles il en est arrivé là. Il devrait y avoir dans les hôpitaux, en vertu de l’article R. 6145-7 du code de la santé publique, une comptabilité analytique permettant de savoir si l’argent des Français est bien utilisé et si l’égal accès aux soins est une réalité dans nos territoires.
Le premier président de la Cour des comptes a confié à la Commission des affaires sociales avoir constaté que, sur la trentaine d’établissements étudiés, le coût des mêmes actes se situait dans un rapport allant de 1 à 10. Nous sommes ici pour comprendre les raisons d’un tel écart.
M. Maxime Gremetz. Je voudrais que la mission prenne connaissance du rapport de la chambre régionale des comptes de Picardie sur le CHU d’Amiens, que j’ai remis à la ministre et qui conclut que le projet le concernant est idiot.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La Cour met en doute la pertinence de la comptabilité analytique dans les établissements contrôlés. Ne craignez-vous pas que ses arguments ne servent à mettre en cause, d’une part, la tarification à l’activité que l’on cherche à mettre en place et qui repose largement sur ce concept ; d’autre part, les résultats de votre étude dont vous dites vous-même que l’échantillon n’est pas représentatif – et ce malgré l’amplitude manifestement significative des résultats ? Dans quels domaines vos conclusions sont-elles incontestables et peuvent-elles servir à étayer des propositions ou des travaux ultérieurs ?
Mme Rolande Ruellan. Nous nous heurtons typiquement à un problème d’application des textes. Ce n’est pas la peine de multiplier les lois sur l’organisation de l’hôpital. Il faut absolument, sur le plan local, une autorité, peut-être l’agence régionale de santé, qui ait suffisamment de pouvoir pour obliger les établissements à mettre en place le fonctionnement le plus efficient possible, ce qui suppose d’avoir des éléments de comparaison. Autrefois, les établissements vivaient en bunker, en invoquant leurs différences. Maintenant, on dispose d’outils. La Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH) a beaucoup travaillé, et nous regrettons que les établissements ne s’appuient pas sur les bonnes pratiques qu’elle a définies pour permettre des évolutions. Certaines recettes sont simples, reposant sur le savoir-faire des équipes administratives et médicales sur le terrain. Nous n’avons pas pour autant la prétention de procéder à des audits d’organisation. Cela étant, vous avez raison, l’amplitude des écarts révèle des problèmes, d’autant que nous avons précisément choisi des disciplines relativement homogènes.
Le message essentiel de notre étude est qu’il y a des efforts à faire partout, y compris à l’intérieur d’un même établissement. Les hôpitaux fonctionnent toujours par service. Le chef de service fait la pluie et le beau temps et, s’il est « propriétaire » de ses infirmières, il n’ira pas les donner au service d’à côté même si ce dernier en manque. Les ratios de personnel – médical ou non médical – d’un service à l’autre révèlent des écarts considérables. Même si les personnels ne sont pas interchangeables, il y a un problème de gouvernance et de management : la coopération entre médecins et la direction doit être améliorée pour favoriser une approche médico-économique. Nous nous sommes efforcés d’être concrets et de donner des chiffres. Et nos résultats ont confirmé ce que tout le monde sait intuitivement. Cela étant, certains établissements n’ont pas apprécié d’être pointés du doigt, en particulier les CHU de Lille et de Lyon.
M. Noël Diricq. Les chiffres qui figurent dans le rapport ne sont pas contestés, soit que la comptabilité analytique soit fiable, soit que les données soient disponibles par ailleurs. Rien de ce qui figure n’a échappé à la contradiction des établissements. Mais certains acteurs du milieu hospitalier tirent prétexte de l’insuffisance actuelle des statistiques pour ne pas se préoccuper des coûts. Un tel comportement n’est pas responsable car, aussi imparfaits que soient les indicateurs, les écarts qu’ils révèlent sont suffisants pour entamer des actions. Il y a désormais moyen de repérer son positionnement relatif, même si nous n’avons pas la précision de l’horlogerie suisse. L’inertie ne saurait se justifier.
Mme Catherine Génisson. Une des conséquences de la T2A ne serait-elle pas, paradoxalement, le transfert d’activités dites moins rentables des hôpitaux de niveau inférieur aux hôpitaux de niveau plus élevé ? Cela pourrait expliquer partiellement que 80 % de l’activité des CHU soit celle d’un hôpital général. Il y a vingt ans, dans le Pas-de-Calais, les polytraumatisés étaient opérés dans les hôpitaux périphériques ; ils sont désormais systématiquement envoyés au CHU de Lille, bien qu’il y ait un chirurgien viscéral et un chirurgien orthopédique dans chaque hôpital périphérique. La T2A n’incite-t-elle pas les établissements à se défausser des activités très lourdes ou peu rentables ? Par ailleurs, les hôpitaux publics situés près de cliniques privées ont-ils une structure de coûts comparable à un hôpital isolé ?
Mme Rolande Ruellan. Les établissements privés se spécialisent dans certaines interventions, en particulier la chirurgie programmée, moins exigeantes en organisation et en personnel, tandis que l’hôpital public a une responsabilité de service public et doit offrir une gamme de services plus vaste. Il est très difficile de raisonner globalement mais, au sein d’un même bassin, la concurrence est de mise dans un premier temps. Il est arrivé à des ARH de favoriser des cliniques privées quand elles étaient meilleures que l’hôpital public car il n’y a pas de raison de faire coexister et se concurrencer des structures distantes de quelques kilomètres : c’est la complémentarité qui doit prévaloir ! Certaines cliniques privées ne se limitent pas à la cataracte et à la pose de pacemakers, et elles peuvent tuer l’hôpital public quand il n’est pas performant. Dans le Sud, là où la densité médicale est forte, à Nice ou même à Marseille, il se fait tailler des croupières. Toutefois, globalement, l’hôpital public a réussi à augmenter son activité durant les dernières années.
La tarification des groupes homogènes de séjours (GHS), se fonde sur les coûts moyens de l’échelle nationale des coûts. Un établissement fait donc chuter le coût unitaire en augmentant le nombre d’actes pratiqués, ce qui conduit à la spécialisation. Les établissements ont donc intérêt à réduire leur offre de GHS puisqu’on ne peut pas les rémunérer autrement qu’au coût moyen.
Notre enquête sur l’insertion de la T2A a mis aussi en évidence l’extrême difficulté qu’il y a à établir un lien entre les coûts et les tarifs. Pour réduire les écarts, il faudrait sans doute mieux faire correspondre le mode de calcul de certains tarifs aux coûts des hôpitaux. Ainsi, un même acte pratiqué dans un CHU coûte souvent plus cher que dans un centre hospitalier, parce qu’il a une gamme d’activités plus vaste.
Par ailleurs, il faudrait encore mieux distinguer les missions qui sont toujours financées par dotation, pour centrer la tarification à l’activité sur des soins qui soient comparables d’un établissement à l’autre. L’Institut de recherche et documentation en économie de la santé a publié une étude fondée sur des comparaisons internationales qui montre que la T2A doit être un processus continu d’adaptation. Cela étant, comme il faut inciter les hôpitaux à réaliser des économies, il vaudrait mieux éviter d’encourager ceux qui ont des coûts corrects à remonter au niveau d’un coût moyen qui serait tiré vers le haut par d’autres. La tâche est compliquée. Nous avons essayé cette année de démythifier la T2A, mais il reste beaucoup à faire pour connaître ses effets pervers, mais aussi bénéfiques.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous n’avons pas encore basculé entièrement dans la T2A, nous restons partiellement dans le forfaitaire, et nous n’avons pas d’éléments de comparaison. Dans ces conditions, comment mesurer l’efficience d’un établissement hospitalier ?
Mme Rolande Ruellan. Dans l’absolu, on ne sait pas comment faire. On ne peut procéder que par comparaison, en tenant compte de l’environnement propre et de la patientèle, pour déterminer si un établissement a des progrès à faire. Il reste aussi la qualité des soins que nous n’avons pas examinée. Nous avons considéré qu’une meilleure organisation et un meilleur fonctionnement vont forcément dans le sens de la qualité des soins, mais cela reste à démontrer.
M. Noël Diricq. Un indice est très révélateur des difficultés rencontrées : l’évolution de la part forfaitaire. Rien ne prouve qu’elle va baisser. On tâtonne et on ajuste – le ministère ne sait pas tout –, en fonction des circonstances. On lâche périodiquement, sous des motifs divers, des enveloppes complémentaires, et il n’est pas exclu que le système doive vivre durablement avec une partie des financements fondés sur une approximation des coûts et une autre sous forme de provisions.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Ce n’est pas choquant, mais il faudrait savoir pourquoi.
Mme Rolande Ruellan. Il y a plusieurs types de part forfaitaire. Si les missions d’études, de recherche, de recours et d’innovation, et, au sein des MIGAC, les « missions d’intérêt général » sont de mieux en mieux cadrées, la partie « aide à la contractualisation » reste une « boîte noire ». Les fonds qui devaient financer l’investissement financent en réalité des rallonges pour garder péniblement les hôpitaux la tête hors de l’eau. C’est cette partie qui pollue la logique de la T2A. Le remède a sans doute été trop violent compte tenu de la capacité d’adaptation des établissements. Objectivement, ils n’ont réussi ni à se restructurer avec leurs voisins, ni à se réorganiser en interne pour absorber le choc, si bien qu’ils obtiennent des rallonges – surtout les CHU qui sont tous en déficit. Une des causes tient certainement à l’appréciation de la répartition de leurs activités. Mais les aides à la contractualisation qui viennent des ARH – lesquelles ont constitué une cagnotte pour les mauvais jours –, ainsi que de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) n’encouragent pas les établissements à faire des progrès car personne ne semble se préoccuper que les contreparties demandées aux établissements ne soient pas au rendez-vous.
M. le coprésident Pierre Morange. De nombreuses dispositions ne sont pas appliquées. En vous fondant sur votre rapport, quelle hiérarchie établissez-vous entre elles et quelles sont celles qu’il faudrait impérativement mettre en œuvre ?
Mme Rolande Ruellan. Il faudrait commencer par améliorer la connaissance du système par les ARH-ARS. C’est un problème de volonté car les outils existent. Le préfet, quand il était chargé de noter un directeur d’hôpital, se fondait avant tout sur le maintien de la paix sociale. Cela explique sans doute la difficulté à réformer l’hôpital. Il faut commencer par mettre en place une comptabilité analytique fine. Je vous renvoie à notre rapport : « intégrer un calendrier de déploiement d’une comptabilité analytique pertinente, des tableaux de bord associés, […] faire une analyse des secteurs d’activité présentant des surcoûts pour corriger les dysfonctionnements et réduire les écarts de productivité, donner aux responsables de pôle les outils de connaissance sur leur activité et les compétences appropriées ». On est là dans la gouvernance au quotidien, qui est de la responsabilité des directeurs ou du directoire. Mais cela passe par une parfaite entente entre médecins et administratifs, et c’est tout le problème.
M. Maxime Gremetz. Je siège au conseil d’administration du CHU d’Amiens. Le directeur a appliqué la T2A et il a réduit tous les coûts, mais au prix de 200 licenciements. On fait aussi des économies de bout de chandelle sur les produits d’entretien. Les économies, le directeur en a fait. Le résultat ? Le CHU est encore plus endetté et les gens plus mal soignés. Ce n’est pas moi qui le dis : c’est la Chambre régionale des comptes dans son rapport !
M. Dominique Tian. La convergence entre les tarifs du public et du privé, principe maintes fois rappelé dans le PLFSS, doit, selon la ministre, être repoussée jusqu’en 2018. Qu’en pensez-vous ?
Mme Rolande Ruellan. Il y a trois ans, nous avions déjà émis des doutes sur sa faisabilité dans des délais restreints. Cette année, nous avons dit prudemment que la clarification des MIGAC permettait de mieux faire la part entre les dotations qui s’adressent surtout au secteur public et la tarification à l’activité, donc de mieux rémunérer les deux secteurs en fonction de leurs activités respectives. Les tarifs des GHS pourraient théoriquement être les mêmes si les urgences, la prise en charge de la population précaire ou les activités d’enseignement étaient isolées. Dans le même temps, nous sommes passés de 950 à 2 500 GHS, en principe pour mieux cerner les activités. Mais il semblerait – il est trop tôt pour en faire la démonstration –, que cette nouvelle classification ne soit pas du tout favorable aux CHU car, finalement, 80 % de leurs actes ne sont pas si difficiles. Néanmoins, la sophistication de la grille, sans aller trop loin non plus, permettra également de mieux tenir compte de la réalité des actes dispensés à l’intérieur d’un même secteur et entre les deux secteurs.
En revanche, la question de la rémunération des médecins se posera toujours. On peut imaginer que les tarifs convergent sans se rejoindre, mais on bute sur un problème d’affichage dans la mesure où, à l’hôpital, les prix sont « tout compris », mais pas dans les cliniques. Il nous semble raisonnable d’avoir repoussé l’échéance de façon à continuer d’améliorer la connaissance des coûts dans chacun des deux secteurs. Maintenant, les cliniques privées sont dans l’échelle nationale de coûts commune, mais subsiste la difficulté de la rémunération des médecins. La démarche de la convergence aura au moins le mérite de pousser à la connaissance des coûts de part et d’autre, de sorte que des actes identiques donnent lieu à une rémunération identique. Cela dit, il y aura toujours des différences d’activité entre les deux secteurs, qui légitimeront un financement par dotation du secteur public.
Nous avons dit aussi qu’il fallait faire une pause. Les établissements hospitaliers n’en peuvent plus d’être soumis chaque année à une évolution des modalités de tarification, qui leur sont transmises en avril ou en mai. La DHOS n’a pas trop apprécié, mais nous recommandons une pause de trois ans, ne serait-ce que pour laisser le temps de voir clair sur les effets du système actuel.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Avez-vous des éléments concernant la gestion du personnel, qu’il s’agisse des effectifs, de la gestion des carrières ou des conditions de travail, notamment ?
Mme Rolande Ruellan. Nous avons travaillé l’année dernière sur les personnels médico-hospitaliers, mais nous ne sommes pas allés au-delà. La qualité des équipes est essentielle dans le fonctionnement d’un établissement et vous pourriez interroger la DHOS sur la nomination des directeurs. Nous avons été surpris de voir nommer à la tête d’un CHU le directeur d’un établissement qui avait connu de graves difficultés. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Il faudrait se pencher aussi sur la formation des directeurs qui sont, nous dit-on, d’une très grande hétérogénéité.
Mme Carole Pelletier. Au-delà des considérations individuelles, le directeur d’hôpital est au centre de pressions multiples et très fortes : de l’élu local qui est à la tête du conseil d’administration, des représentants syndicaux du personnel, des médecins qui sont très actifs, de la tutelle, enfin. Nous avons le sentiment que c’est souvent celui qui presse le plus fort qui emporte la décision. Le talent personnel intervient aussi, mais le métier est difficile, parce que les pressions, d’origines différentes, sont toujours intenses dans un contexte de réformes très importantes ces dernières années. Enfin, la T2A correspond à une réallocation d’enveloppe. Elle a donc fait des gagnants et des perdants. C’est cet ensemble de paramètres qui fait qu’un directeur réussit plus ou moins.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires va-t-elle modifier les choses ?
M. Noël Diricq. La personnalité du nouveau président du conseil de surveillance sera décisive. Il aura peut-être toujours pour premier souci l’emploi dans sa commune, mais ce ne sera pas toujours le maire.
Mme Carole Pelletier. La loi renforcera les pouvoirs du directeur, mais les pressions, elles, persisteront.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le directeur aura plus de pouvoirs, mais il aura ipso facto plus de pressions puisqu’il ne pourra même plus équilibrer les pouvoirs entre eux en les utilisant : il sera seul. Que dire des autres personnels ?
Mme Rolande Ruellan. Vous n’attendiez pas de la Cour qu’elle conclue qu’il faudrait augmenter le personnel à l’hôpital ! La répartition est mauvaise : les gens ne sont pas là où ils devraient être, au bon moment. Par ailleurs, l’absentéisme est en augmentation, ce qui désorganise le fonctionnement de l’hôpital et entraîne des coûts supplémentaires. Quand on se déplace dans les hôpitaux, on est toujours frappé de constater qu’il y a des services qui vivent tranquillement tandis que d’autres sont complètement débordés. Comment faire pour changer petit à petit cette situation ? C’est une question de management interne. Pour les médecins, c’est très compliqué. Les stratégies de recrutement des responsables médicaux expliquent pas mal de choses, mais on ne comprend pas très bien pourquoi les personnels non médicaux ne sont pas mieux répartis.
On est aussi frappé par le faible niveau d’activité d’un certain nombre de praticiens. En chirurgie, quand on fait la moyenne, on s’aperçoit qu’il n’y a pas une intervention par semaine et par praticien.
Mme Catherine Génisson. Cela dépend de l’activité chirurgicale dans le privé.
M. Noël Diricq. Notre moyenne tournait à autant d’interventions par chirurgien dans une année que de jours ouvrables, ce qui n’est tout de même pas beaucoup. Il est probable que ce chiffre dissimule des cas où le nombre tombe à zéro, même si les chirurgiens en question comptent toujours dans les effectifs rémunérés. Cela plombe la moyenne.
Mme Catherine Génisson. Bien qu’elle soit devenue extrêmement administrée, la gestion de personnel manque d’efficacité. Ce qu’on appelait autrefois les « surveillantes », et qui étaient les bras droits des chefs de service, font dorénavant partie du personnel administratif. La chape de plomb administrative sur les personnels paramédicaux est de plus en plus prégnante. Dans un souci d’efficacité, on a enlevé aux cadres infirmiers qui géraient les services leur fonction de soignant, mais sans amélioration notable du service, pour dire le moins. La perte de relation aux soins n’est pas opportune.
Mme Rolande Ruellan. On espère que les pôles favoriseront une plus grande mutualisation, même si les infirmières ne sont pas interchangeables à l’infini. Mutualiser un peu plus permettrait de limiter le recours à l’intérim et d’améliorer le fonctionnement global de l’établissement. Mais, à l’hôpital, il est extrêmement difficile d’obtenir l’acceptation des personnels.
Mme Carole Pelletier. Même en descendant au niveau du service, il est difficile d’appréhender l’écart entre les effectifs moyens et la situation au quotidien. Les plannings sont établis au moins un mois à l’avance, à partir d’une activité moyenne, sans rapport avec celle réalisée. Et si la première est supérieure à la seconde, les effectifs surdimensionnés manqueront au moment des pointes saisonnières. À cela s’ajoute un absentéisme croissant. On s’aperçoit en arrivant qu’il manque une ou deux infirmières dans le service, et il faut s’en accommoder. Les écarts entre les effectifs prévus et les effectifs présents sont extrêmement variables, et très difficiles à vivre sur le terrain. Les personnels ont l’impression que le nombre des présents n’est jamais le bon. C’est aussi une source de désorganisation et de stress. On demande à la dernière minute à ceux qui sont là de rester. Beaucoup de cadres de santé passent la matinée à gérer le planning. Là où l’on tente de réduire leur nombre, ils s’occupent de plusieurs services et passent leur temps à courir pour trouver un remplaçant, en intérim, à l’intérieur de l’hôpital, à l’intérieur du pôle, à l’intérieur du service. Il y a une perte d’énergie considérable dans la gestion de la variabilité.
Mme Catherine Génisson. L’absentéisme est un vrai sujet. Les cadres ont de plus en plus de mal à trouver des remplaçants au dernier moment parce que les personnels désignés ne répondent plus : les portables sont éteints.
M. Noël Diricq. Par souci de gestion, certains établissements ont supprimé les pools destinés à parer aux absences imprévues. Résultat : ils sont pris au dépourvu.
M. le coprésident Pierre Morange. S’agissant des autres dépenses telles que les transports sanitaires, le nettoyage ou les passations de marché, avez-vous pu établir un standard et faire des comparaisons ?
Mme Carole Pelletier. En ce qui concerne le coût de l’entretien, le groupe d’Angers pour l’amélioration de la comptabilité analytique hospitalière a calculé une unité d’œuvre à partir d’échantillons représentatifs et les résultats sont publics. Quand un établissement est déficitaire, son premier réflexe est de faire des économies sur ces postes parce que c’est moins douloureux et même si, en tout état de cause, c’est insuffisant. Les groupements d’achat régionaux se sont aussi développés, en Île-de-France notamment, pour essayer d’acheter moins cher. Les comparaisons commencent à être possibles.
M. Noël Diricq. Il y a un poste dont la progression est particulièrement redoutable : les médicaments coûteux. Jusqu’à présent, les hôpitaux s’y sont d’autant moins intéressés que la liste « en sus » des médicaments financés hors GHS ne les incitait pas à le faire. Le mécanisme de régulation en est à ses débuts, et il doit faire ses preuves. L’enjeu n’est rien de moins qu’un point d’ONDAM.
M. le coprésident Pierre Morange. Le rapport de la MECSS sur le médicament soulignait que l’augmentation de la dépense pharmaceutique était largement liée à la prise en charge complète des molécules onéreuses délivrées à l’hôpital. La mise en œuvre du dispositif de 2004 n’en est que plus urgente.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Avez-vous eu l’occasion d’examiner des fusions entre établissements ? Et, si oui, à quoi ont-elles abouti ?
Mme Rolande Ruellan. Nous n’avons travaillé que sur l’organisation. En 2002, nous avions conclu que les économies viendraient en priorité d’une réorganisation interne, plutôt que des fusions. L’une n’empêche pas les autres, mais celles-ci ont leurs limites.
M. Noël Diricq. Dans les fusions, on trouve de tout. Je vous citerai deux cas, aux antipodes l’un de l’autre. La fusion des établissements de Belfort et de Montbéliard a abouti à une stricte duplication de tout, sauf du poste de directeur ! Mais le poste de président alterne tous les ans entre les deux villes. En revanche, le Centre hospitalier intercommunal Loire-Vendée-Océan semble avoir réparti astucieusement les activités – médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) d’un côté, et soins de longue durée de l’autre –, et enclenché un cercle vertueux d’économies.
Mme Carole Pelletier. Le sud de l’Île-de-France a quelques années d’avance sur Poissy-Saint-Germain. Il existe aussi un autre cas de figure qui peut être intéressant : le projet médical de territoire entre Meaux, Lagny et Coulommiers visant à répartir les services entre les trois établissements qui conserveront leur autonomie. Indépendamment de notre enquête, vous pouvez vous référer aux rapports des chambres régionales des comptes.
Mme Rolande Ruellan. Il faut faire preuve de patience et de persévérance car certaines opérations mettent du temps avant de produire leurs fruits. Elles doivent impérativement être bordées juridiquement car, pour les ARH, elles sont source de contentieux, les établissements que l’on oblige à se marier ou à abandonner une activité exploitant la moindre faille juridique. Et, si le tribunal administratif prononce une annulation, il faut tout reprendre de zéro. Une telle perspective peut expliquer une certaine frilosité.
Mme Catherine Génisson. Il existe quelques mariages heureux, par exemple celui qui unit la clinique Bois-Bernard et l’hôpital de Lens. Alors, il vaudrait mieux éviter de détruire ce qui marche bien, surtout entre secteur public et secteur privé !
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous voulons seulement comprendre avant de faire des préconisations. Et nous avons du chemin à faire.
Nous vous remercions, mesdames, monsieur, d’avoir répondu longuement à nos questions.
*
Audition, à huis clos, de M. Jean-Yves Bertucci, président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, et de Mme Sylvie Boutereau-Tichet, conseillère référendaire à la Cour des comptes.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous souhaite la bienvenue, madame, monsieur, à la MECSS de l’Assemblée nationale.
Nous nous intéressons aujourd’hui au fonctionnement interne de l’hôpital en nous efforçant en particulier d’évaluer l’efficience de notre arsenal législatif et règlementaire à partir des expériences qui nous reviennent du terrain mais, également, du rapport de la Cour des comptes – dont nous avons eu récemment l’occasion d’entendre le Premier président en Commission des affaires sociales – qui consacre un chapitre important à cette question. Nous sollicitons votre expertise afin que vous déterminiez des axes de réflexions et d’éventuelles mesures pragmatiques permettant de remédier aux dysfonctionnements qui se font jour, en particulier à partir des conclusions du contrôle que vous avez effectué à l’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
M. Jean Mallot, coprésident et rapporteur, mais également M. Dominique Tian, chargé du rapport de la mission relative au croisement des fichiers permettant de lutter contre les fraudes sociales collectives ou individuelles, seront bien entendu particulièrement attentifs à vos propos.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pourriez-vous rappeler les principales conclusions de vos travaux concernant le Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain ?
M. Jean-Yves Bertucci, président de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France. Je vous remercie de votre accueil.
Nous avons effectué un contrôle dit « organique » du Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en ce sens qu’il tend à l’établissement d’un diagnostic global sur la gestion financière et organisationnelle de l’établissement. La chambre régionale des comptes d’Île-de-France, sans avoir besoin d’être saisie par une autorité extérieure – comme le fait parfois l’ARH –, procède périodiquement à ce type de contrôle des hôpitaux de l’AP-HP ainsi que des autres centres, les contrôles concernant les premiers étant thématiques, ceux des seconds procédant par « roulements » qui, en quatre années environ, permettent d’opérer les vérifications qui s’imposent sur l’ensemble d’une zone. Dès lors que le président de la chambre a programmé un contrôle, il désigne un rapporteur – en l’occurrence, Mme Boutereau-Tichet – et ce contrôle suit une procédure assez longue car contradictoire : dans le cas d’espèce, elle a duré plus d’un an, la période d’instruction au sens strict s’étant étendue quant à elle sur quelques mois seulement. Je précise que ces contrôles ne sont pas nécessairement liés à ceux de la Cour des comptes ou d’autres chambres régionales même si, depuis plusieurs années, la plupart des démarches sont concertées dans le cadre d’un groupe « hospitalier » comprenant des magistrats de la sixième chambre de la Cour des comptes ainsi que des magistrats des chambres régionales spécialisés dans les questions hospitalières. C’est cette structure qui décide des sujets d’enquêtes menées sur le plan national, lesquels peuvent être éventuellement traités au sein du rapport annuel sur la loi de financement de la sécurité sociale, par exemple ; elle réalise les synthèses qui aboutissent à des conclusions et à des recommandations générales.
J’ajoute, enfin, que le contrôle des établissements hospitaliers mobilise l’une des huit sections de la chambre que j’ai l’honneur de présider, celle-ci comprenant cent cinquante personnes, dont une cinquantaine de magistrats – de quatre à six d’entre eux étant affectés à cette section, ce qui n’est pas considérable compte tenu des masses financières en jeu.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet, conseillère référendaire à la Cour des comptes. Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) est né en 1997 de la fusion de deux établissements que séparaient sept kilomètres à peine. Si leurs activités médicales étaient comparables, il n’en allait pas de même de leurs cultures puisque les médecins exerçant à Saint-Germain-en-Laye travaillaient principalement à temps partiel, ceux de Poissy exerçant pour la plupart sous convention universitaire et bénéficiant donc d’un statut de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH).
Ce contrôle, effectué à la fin de 2007 et au début de 2008, a montré qu’en dépit de réels efforts organisationnels, de nombreux doublons n’en subsistent pas moins en raison notamment du statut un peu particulier du CHIPS qui l’apparente aux CHU – dont nous connaissons par ailleurs les difficultés financières.
Avec un budget de 260 millions – dont 240 pour la médecine, la chirurgie et l’obstétrique –, plus de 300 médecins et 3 000 équivalents temps plein (ETP) non médicaux, le CHIPS est le deuxième établissement hospitalier d’Île-de-France. En 2006 et 2007, les déficits se sont élevés à 26 ou 27 millions en raison de l’apurement de reports de charges – à l’instar de nombreux établissements hospitaliers, le CHIPS s’est en effet exonéré de la taxe sur les salaires à partir de 2002. Bien qu’il ait également bénéficié de crédits exceptionnels, son déficit n’en demeure pas moins en moyenne de 30 millions, preuve que les difficultés rencontrées sont structurelles. Ses activités, quant à elles, ont certes crû, mais nous manquons d’instruments permettant de procéder à un certain nombre de comparaisons qui seraient pourtant utiles.
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous utilisé les outils de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH) ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. J’ai consulté les travaux de la mission, certes, mais ils concernent des thèmes bien particuliers comme, par exemple, les blocs opératoires.
M. le coprésident Pierre Morange. Utilisez-vous la grille de lecture qu’elle propose s’agissant des ratios de personnels en fonction des activités, cette grille pouvant d’ailleurs constituer un outil pédagogique utile pour le rétablissement de l’équilibre financier ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Nous avons en quelque sorte constitué une « bases de données » publiques notamment à partir de celles fournies par la Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) et la MEAH, mais également à partir des comptes des hôpitaux d’Île-de-France dont nous disposons.
Il n’en reste pas moins que, compte tenu du nombre de doublons et de l’importance des personnels médicaux et non médicaux, les coûts du CHIPS sont plus élevés que ceux des établissements comparables.
M. le coprésident Pierre Morange. A-t-on une idée des proportions ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. On y dénombre environ 1,5 fois plus de personnels que dans d’autres établissements non universitaires comparables en province.
M. Maxime Gremetz. Le statut du CHIPS est toutefois assez proche, avez-vous dit, de celui des CHU.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Même si le nombre de publications scientifiques n’est pas comparable, le CHIPS dispose en effet d’une centaine d’internes qui doivent être formés. Mais une question se pose : ces derniers lui coûtent-ils ou lui rapportent-ils de l’argent ?
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pourquoi ces doublons subsistent-ils alors que la fusion visait précisément à rationaliser la gestion et que tous les établissements sont loin d’être dans le même cas ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Outre que, par exemple, la fusion des centres de Corbeil et d’Évry s’est également mal passée, la gestion de nouveaux bâtiments et des différences culturelles entre établissements ne va pas du tout de soi. Je précise, de surcroît, que des progrès certains ont été accomplis puisque les services de pédiatrie ou de cardiologie, par exemple, ont été regroupés. Enfin, il faut tenir compte des réticences des médecins ou des politiques, la fusion ayant parfois été vécue comme un simple transfert, à Poissy, des activités considérées comme les plus « nobles ».
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les caractéristiques de la fusion n’avaient donc été ni annoncées ni acceptées par l’ensemble des personnels ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Qu’elles n’aient pas été acceptées, c’est certain, mais j’ignore quelle est la procédure qui a été suivie en 1997.
M. Maxime Gremetz. Fusionner, n’est-ce pas aussi purement et simplement « liquider » un établissement ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Il s’agit en l’occurrence d’une fusion administrative donnant lieu à la création d’un établissement unique.
M. Maxime Gremetz. L’Hôpital Nord, à Amiens, a pourtant bel et bien été « liquidé », la chambre régionale des comptes de Picardie ayant d’ailleurs fait état dans son rapport de l’imbécillité – pour ne pas dire plus – de cette décision. Vous connaissez ce texte ?
M. Jean-Yves Bertucci. J’ai certes présidé cette chambre, mais c’était il y a plus de dix ans. Sans doute faites-vous allusion à un travail beaucoup plus récent.
M. Maxime Gremetz. Vous connaissez tout de même le projet dont il est question, ce qui vous permettra sans aucun doute de vous livrer à d’utiles comparaisons entre la fusion administrative et ce que l’on pourrait appeler la « fusion par démolition ».
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. La fusion qui nous préoccupe devrait en tout cas se matérialiser par la construction d’un troisième hôpital.
M. le coprésident Pierre Morange. Il sera en effet à Chambourcy et aura une vocation universitaire.
Le déficit structurel annuel s’élève donc à une trentaine de millions.
M. Maxime Gremetz. Quand il est de 52 millions à Amiens !
M. le coprésident Pierre Morange. Le déficit cumulé du CHIPS pendant les six dernières années, monsieur Gremetz, s’élève à 150 millions. Par ailleurs, quels que soient les chiffres, je rappelle tout de même que c’est de la santé des Français qu’il est question.
Ce déficit s’explique-t-il uniquement par le nombre important de personnels auquel vous avez fait allusion ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Il convient également d’examiner le mode d’organisation des séjours hospitaliers : si la mise en place de la T2A incite les hôpitaux à « faire de l’activité » et à éviter de trop longs séjours – comme en atteste d’ailleurs l’étude réalisée en 2006 par le directeur du département de l’information médicale (DIM) du CHIPS –, il n’en demeure pas moins que l’on peut s’interroger sur les trop longs séjours : sont-ils dus à des pathologies lourdes ou à une mauvaise organisation ? Cibler les séjours qui dépassent d’une journée la moyenne de ceux qui ont permis d’élaborer les tarifs permet ainsi de mettre en évidence les dysfonctionnements, lesquels concernent essentiellement la chirurgie. En dépit des progrès indubitablement réalisés, il devrait donc être encore possible d’améliorer le système.
M. le coprésident Pierre Morange. Peut-on distinguer les secteurs dans lesquels les sureffectifs des personnels non médicaux sont financièrement les plus pénalisants ?
Par ailleurs, comment expliquez-vous le taux de fuite des patients du bassin de vie de Poissy-Saint-Germain-en-Laye vers d’autres établissements hospitaliers ?
Enfin, il semble que la collecte des recettes soit insuffisante : en effet, en l’absence de présentation de facture, un certain nombre de patients ne paient pas les consultations ou les hospitalisations. Les sommes en jeu sont loin d’être négligeables !
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Faute d’un référentiel précis, je ne peux répondre à votre première question, à moins de considérer que les situations diffèrent sans doute en fonction de la structure des établissements.
S’agissant du taux de fuite, la concurrence s’exerce fortement dans ce territoire tant l’offre de soins est importante dans les secteurs public – avec l’AP-HP – ou privé.
M. le coprésident Pierre Morange. Est-il identique à celui des autres établissements hospitaliers de la Grande couronne ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Il est bien plus élevé dans d’autres secteurs.
M. le coprésident Pierre Morange. Il est donc possible de l’évaluer ?
M. Jean-Yves Bertucci. Les contrôles le permettent, en effet.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. J’ajoute que cet hôpital a plutôt bonne presse.
M. le coprésident Pierre Morange. Il est hors de question, cela va de soi, de faire le procès du CHIPS, dont nous connaissons la compétence et le dévouement des personnels : il s’agit, dans un esprit pédagogique, de comprendre sa situation financière compte tenu de ses objectifs, de la qualité de ses résultats et du plan de retour à l’équilibre financier (PREF) qui a été mis en œuvre.
M. Maxime Gremetz. Qu’est-ce qui a motivé la fusion ? Les objectifs de celle-ci ont-ils été atteints ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Les deux établissements, je le répète, étaient géographiquement très proches et se faisaient concurrence – d’où la nécessité de réaliser des économies.
M. le coprésident Pierre Morange. Je précise à M. Gremetz que c’est le député auquel j’ai succédé qui a pris la décision de la fusion, ce qui me rend d’autant plus libre pour en parler.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Enfin, si le non-recouvrement des recettes ne concerne pas le seul CHIPS, il n’en demeure pas moins vrai que des consultations ou des actes externes peuvent « passer à la trappe », à la différence des séjours hospitaliers.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Est-ce délibérément ou par négligence ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Jusqu’à une période récente, la facturation ou la non-facturation de ce type d’acte ne modifiait pas sensiblement les comptes des hôpitaux, ces derniers étant financés par des dotations globales.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le système a tout de même changé depuis quelques années.
M. Dominique Tian. Quid du forfait hospitalier ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Ce dernier relève bien entendu du séjour à hôpital, même si des problèmes de recouvrement peuvent également se poser.
M. Dominique Tian. Disposez-vous de statistiques ?
Je précise que, dans le secteur privé, une clinique serait contrainte de défalquer de son budget les éventuels impayés.
M. le coprésident Pierre Morange. La chambre régionale des comptes d’Île-de-France aurait tout intérêt à évaluer leur ampleur.
En ce qui concerne plus précisément le CHIPS, je note que des problèmes de saisies informatiques et de disque dur se sont posés lors de la collecte.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Ils s’expliquent par un changement de logiciel, comme ce fut d’ailleurs le cas à l’hôpital de Lagny, mais la situation est aujourd’hui rétablie.
J’insiste : il convient de distinguer entre les séjours hospitaliers, facturés – fût-ce mal, les services financiers des hôpitaux éprouvant parfois des difficultés pour connaître l’étendue des droits ouverts pour leurs patients – et les actes ou consultations externes.
M. Dominique Tian. Des personnes qui n’ont pas de droits peuvent fort bien être admises à l’hôpital.
M. le coprésident Pierre Morange. L’interconnexion des fichiers permettra d’y voir plus clair.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. La question des étrangers en situation irrégulière se pose également.
M. Jean-Yves Bertucci. En particulier en Seine-Saint-Denis et, plus précisément, non loin de Roissy…
M. Dominique Tian. Tout comme se pose la question des patients étrangers repartis dans leur pays sans payer !
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. La situation s’est présentée au CHIPS mais, dorénavant, un devis leur est préalablement proposé et ces patients acquittent une somme forfaitaire.
M. le coprésident Pierre Morange. Est-il possible d’apprécier le pourcentage d’actes non facturés ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. C’est très difficile puisqu’ils concernent les consultations et les actes externes. Entre 2006 et 2007, les pertes relatives aux premières se sont élevées à 1,5 million d’euros, même s’il est délicat, en raison notamment des difficultés qui se sont fait jour entre le directeur financier et le directeur de l’information médicale, d’en déterminer les causes précises : baisse d’activité ou non-enregistrement de l’ensemble des actes ? À cela s’ajoute qu’il faut se rendre dans les différents services où l’enregistrement de l’activité a lieu et qu’une secrétaire médicale peut fort bien enregistrer une consultation externe mais non l’acte qui, éventuellement, l’accompagne.
M. Maxime Gremetz. En Picardie, les méthodes sont radicales et exemplaires pour ne pas perdre un centime. À cet égard, je me permets de vous renvoyer au rapport de la chambre régionale.
M. Dominique Tian. Ne faut-il pas distinguer la non-facturation des soins externes, le mauvais renseignement de la T2A dû aux difficultés rencontrées par les techniciens d’information médicale (TIM) et les médecins des DIM en matière de codage et, en l’occurrence, les problèmes relationnels entre le directeur financier et la direction médicale ?
M. le coprésident Pierre Morange. En effet. Les professionnels de santé, faute peut-être d’un investissement suffisant, maîtrisent parfois mal le codage, l’administration et les médecins se renvoyant quant à eux la responsabilité de la définition des actes.
M. Dominique Tian. Il est tout à fait significatif que Mme Boutereau-Tichet ait évoqué le cas d’une secrétaire comprenant mal le codage du médecin.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. En l’espèce, il ne s’agit pas tant d’un dysfonctionnement entre la direction financière et le DIM que d’un problème de culture, d’information et de formation du personnel médical et médico-social.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Compte tenu des différents cas de figure que nous venons d’évoquer, il est difficile de procéder autrement qu’à tâtons.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Il est en effet délicat de formuler une appréciation même si, je le répète, les recettes des consultations externes, entre 2006 et 2007, ont baissé de 1,5 million d’euros, chiffre qui, s’il est important au regard du déficit, n’en est pas pour autant déterminant.
M. Maxime Gremetz. De ce point de vue, j’admire les cliniques privées. À Abbeville, mon frère a eu la surprise de constater une multiplication soudaine par cinq du coût d’un examen qu’il subissait régulièrement ; il s’est même vu facturer une journée entière d’hospitalisation. Après enquête, il est apparu que 98 % des patients étaient dans la même situation. Et voilà comment on vole la sécurité sociale ! J’invite donc les responsables des hôpitaux publics à prendre des cours auprès des cliniques privées afin qu’ils apprennent à réaliser des économies.
M. Jean-Yves Bertucci. On peut difficilement leur faire ce type de recommandation !
M. Maxime Gremetz. Je plaisantais, mais telle est bel et bien la culture du secteur privé.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment expliquer qu’aucune mesure n’ait été prise, malgré vos préconisations passées, pour remédier à cette situation ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) a été signé en 2004 entre l’ARH et le directeur du CHIPS, qui prévoyait à l’horizon de 2008 un déficit de 30 millions – ce qui est tout de même paradoxal pour un instrument censé favoriser l’équilibre financier ! J’ajoute qu’en fin d’instruction un nouveau CREF devait être signé sur les mêmes bases déficitaires.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment l’expliquer ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Il n’y a aucune chance de revenir à l’équilibre financier tant que l’organisation structurelle ne change pas.
M. le coprésident Pierre Morange. Le plan de retour à l’équilibre financier voté par le conseil d’administration fait état d’un délai de six ans, la réduction des déficits étant compensée par une participation financière de la future ARS.
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales a-t-elle rédigé un rapport sur le CHIPS ?
M. Jean-Yves Bertucci. Il doit être postérieur à notre propre contrôle.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous aurons donc l’occasion d’y revenir.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Que pensez-vous des 95 propositions formulées en son temps par Capgemini ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Un audit a eu lieu alors qu’il était question de maintenir les deux structures.
M. le coprésident Pierre Morange. Celui que nous évoquons s’est déroulé en 2008.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Je n’en ai pas eu connaissance.
M. Jean-Yves Bertucci. Vous l’avez compris : nous n’exerçons pas de tutelle permanente sur les hôpitaux et, si nous recueillons certaines informations entre deux contrôles, ce n’est pas systématique. Lorsqu’il en est toutefois ainsi, nous nous en servons pour le contrôle suivant, mais il est difficile de faire mieux avec quatre ou cinq magistrats seulement.
M. Maxime Gremetz. Je comprends ! C’est pour cela que les rapports restent sans suite.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. La tutelle est quant à elle exercée par l’ARH, laquelle a été bien entendu informée de la situation de l’hôpital comme en attestent les comptes rendus des comités de suivi suite à la mise en place du CREF.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. En l’occurrence, les causes de dysfonctionnement sont multiples, mais il me semble souhaitable d’insister sur le caractère incomplet de la fusion puisque des doublons, générateurs de surcoûts, subsistent, ainsi que sur les négligences en matière de facturation. Peut-on pour autant aller jusqu’à imaginer de graves irrégularités de gestion, s’agissant, par exemple, des marchés publics ou de la gestion du personnel ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. En ce qui concerne le second point, je note qu’à l’instar de 90 % des hôpitaux, les heures supplémentaires sont payées sur une base déclarative, ce qui interdit d’apprécier leur raison d’être effective. Pour le cas qui nous préoccupe, elles sont contestables concernant les manipulateurs radio puisque nous n’en manquons plus en Île-de-France, alors qu’ils avaient naguère consenti à un paiement forfaitaire de leurs heures supplémentaires.
M. Maxime Gremetz. Pourquoi ne pas en avoir embauché alors ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Les candidats ne se bousculaient pas dans le secteur public faute de salaires suffisamment attractifs. J’ajoute que la situation est probablement identique dans d’autres services, les sages-femmes, par exemple, bénéficiant du même régime d’heures supplémentaires.
En revanche, nous n’avons pas étudié la question des marchés publics.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourquoi ?
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Les contrôles concernent un certain nombre de thèmes sans qu’il soit possible de les traiter tous. Si, néanmoins, j’avais eu vent d’irrégularités à ce sujet, j’aurais été y voir de plus près.
M. Jean-Yves Bertucci. Nous sommes bien entendu attentifs aux procédures de marchés publics dans le cadre des opérations de construction ou de reconstruction très importantes.
M. Maxime Gremetz. En payant des heures supplémentaires, les hôpitaux gagnent de l’argent puisqu’ils n’ont pas besoin d’embaucher.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Je précise que les cadres infirmiers ont le choix entre un régime forfaitaire et le décompte horaire de leurs heures supplémentaires.
M. Dominique Tian. Sachant que le CHIPS compte beaucoup plus de personnels que d’autres hôpitaux comparables, les intérimaires et les sous-traitants doivent y être moins nombreux.
Mme Sylvie Boutereau-Tichet. Les prémisses de notre contrôle étant fondées sur la cherté de ses coûts compte tenu notamment du nombre de personnels soignants, notre inspection a porté plus précisément sur l’organisation du système de soins sans que nous ayons particulièrement examiné, entre autres, la situation des personnels administratifs ou d’entretien.
M. Jean-Yves Bertucci. Les contrôles sont effectués sur des thèmes précis, tels que les systèmes informatiques, sans qu’il soit en effet possible de procéder à un examen complet : ou nous sommes tributaires d’une enquête nationale, ou le rapporteur détermine son champ d’action.
M. Maxime Gremetz. À l’instar de l’hôpital d’Amiens, le CHIPS utilise-t-il les services d’agences chargées d’aller recruter des médecins étrangers ?
M. Jean-Yves Bertucci. Ce n’est pas le cas en Île-de-France, mais je sais que c’est un véritable problème en Picardie.
M. Maxime Gremetz. Je le répète : je souhaite que le rapport de la chambre régionale des comptes de Picardie vous soit transmis.
M. le coprésident Pierre Morange. Madame, monsieur, je vous remercie.
Il apparaît une fois de plus de nos auditions qu’il faut avant tout mettre en œuvre notre important dispositif législatif et réglementaire, ce qui exige du temps et de la ténacité.
*
AUDITIONS DU 8 OCTOBRE 2009
Audition, à huis clos, de M. Marc Buisson, ancien directeur général du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans le cadre des travaux de la MECSS sur le fonctionnement de l’hôpital, nous accueillons M. Marc Buisson, ancien directeur général du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Nous avons en effet choisi d’étudier un certain nombre de cas concrets, représentatifs des différents types d’hôpitaux.
Je rappelle que la Cour des comptes, dont un membre est ici présent, Mme Carole Pelletier, a consacré un chapitre entier de son dernier rapport public sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale à la question du fonctionnement de l’hôpital.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous nous interrogeons sur la dégradation spectaculaire de la situation financière de l’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. La fusion intervenue entre les deux hôpitaux de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye a certainement joué un rôle, de même que le maintien de doublons entre les structures, mais n’y a-t-il pas eu d’autres causes ?
Nous aimerions savoir quels sont les éléments d’explication liés au contexte local et ceux qui pourraient s’appliquer à d’autres hôpitaux. Comme l’a indiqué Pierre Morange, notre but est de tirer un certain nombre d’enseignements à partir de cas particuliers.
M. Marc Buisson, ancien directeur général du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Avant d’assurer la direction du Centre hospitalier de Poissy entre 1988 et 1997, date à laquelle la fusion a été réalisée, j’ai été en poste à Niort, à Saint-Germain-en-Laye – de 1973 à 1979 –, puis à Angoulême et à Bordeaux. De 2007 à 2009, j’ai ensuite exercé les fonctions de conseiller général des établissements de santé, fonctions que j’ai quittées en août dernier.
Pour y avoir travaillé pendant six ans, je connaissais l’établissement de Saint-Germain avant même d’être nommé à Poissy. Et même si la tarification à l’activité n’existait pas encore, nous nous sommes très vite aperçus, mon homologue de Saint-Germain-en-Laye et moi-même, qu’une réorganisation des deux établissements était nécessaire pour des raisons tant financières que structurelles.
Une fusion a donc été décidée malgré les différences entre les deux établissements : à Poissy, la part des services hospitalo-universitaires était de 50 %, tous les postes étaient occupés à temps plein et il y avait une maternité de niveau 3, dotée d’un service de réanimation néonatale ; on comptait, en revanche, un certain nombre de médecins exerçant à temps partiel à l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye, à proximité duquel des cliniques présentant une certaine importance étaient implantées.
La fusion des deux établissements se justifiait par l’existence de doublons pour 75 %, voire 80 % des services : à quelques kilomètres de distance, il y avait deux services de médecine, deux services de chirurgie viscérale, deux services de chirurgie orthopédique ou encore deux services ORL. Il reste que la décision a été politique.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Qu’entendez-vous par là ?
M. Marc Buisson. La décision a été prise par les députés-maires des deux communes intéressées.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Quel autre type de décision pouvait-on envisager ?
M. Marc Buisson. On aurait pu imaginer une démarche d’origine médicale ou administrative : les deux établissements auraient pu commencer par élaborer des projets communs, aboutissant par la suite à une fusion ou bien à d’autres formes de rapprochement : un syndicat interhospitalier, par exemple, ou encore un système de conventions.
La décision a été prise sur le plan politique : les deux députés-maires ont demandé à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), alors compétente en la matière, de prononcer la fusion des deux établissements, sans qu’un projet médical commun ait été élaboré au préalable. Il faut dire que les deux hôpitaux se regardaient en chiens de faïence à cette époque-là.
Nous avions bien tenté de conclure des conventions, notamment pour l’installation d’équipements lourds, mais nous étions très vite arrivés aux limites de l’exercice : outre la délicate question de l’implantation des équipements, nous nous heurtions à l’impossibilité de mener à bien des restructurations sans la constitution d’un établissement unique, doté d’un seul conseil d’administration, d’une seule commission médicale, d’une seule direction et d’une seule trésorerie.
Comme j’avais auparavant exercé mes fonctions à Saint-Germain-en-Laye, j’ai été appelé à prendre la tête du nouvel établissement à la demande de Michel Péricard, qui était alors député et maire de la commune. L’idée de constituer un syndicat interhospitalier avait été écartée parce qu’il aurait fallu obtenir un accord des deux établissements avant toute opération de restructuration. Le pari a été fait qu’un établissement unique serait obligé de définir un projet commun.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Du point de vue financier, les deux établissements étaient-ils en équilibre avant la fusion ?
M. Marc Buisson. La situation était catastrophique lorsque je suis arrivé à Poissy, en 1988, mais nous avons remonté la pente en deux ans. Au moment de la fusion, l’hôpital de Poissy était en équilibre, et celui de Saint-Germain-en-Laye l’était à peu près.
Une fois que la fusion a été décidée, nous avons mis environ un an à constituer une structure unique – il a fallu installer le conseil d’administration, recomposer l’équipe de direction et mettre en place toutes les instances. Nous avons élaboré un projet d’établissement tendant à constituer des pôles d’excellence et à rendre les deux établissements complémentaires en les spécialisant pour partie. Nous avons ainsi regroupé 14 services ou départements, notamment grâce au départ à la retraite de plusieurs chefs de service, et nous avons transféré certaines activités d’un site à l’autre.
La commission médicale avait en outre demandé le regroupement des services de courts séjours sur un site unique, ce qui ne signifiait pas, contrairement à ce que l’on a pu avancer, que l’un des deux établissements devait disparaître : il a toujours été prévu de maintenir des structures de proximité. À Saint-Germain-en-Laye, un plateau de consultation devait notamment subsister, ainsi qu’un plateau d’explorations fonctionnelles, des structures psychiatriques et d’autres pour personnes âgées. En revanche, il était évident que les évolutions de certains services devaient aller de pair : en cas de regroupement des services de maternité sur un seul site, ceux de diabétologie devaient suivre.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pensez-vous que les déficits auxquels la fusion a conduit aient été prévisibles ? Dans l’affirmative, aviez-vous alerté les responsables politiques ?
M. Marc Buisson. Il faut rappeler que le budget global bloquait tout développement des structures. La fusion avait pour but de restructurer les établissements afin de réaliser des gains de productivité, tout en garantissant l’offre de soins dans l’ensemble du secteur géographique concerné.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Même si les deux établissements étaient initialement à l’équilibre, on peut comprendre que la situation financière se soit transitoirement dégradée, le temps de réaliser certaines opérations de rationalisation. Cependant, les déficits ont ensuite perduré et se sont même amplifiés. Comment l’expliquer ?
M. Marc Buisson. Les déficits sont apparus au moment où il a fallu appliquer la tarification à l’activité et la réduction du temps de travail des personnels médicaux, notamment les médecins. Nous avons dû multiplier les gardes, ce qui nous a posé des problèmes d’effectifs et de financement. Le durcissement des règles de sécurité a également pesé sur la situation financière de l’établissement.
La fusion a été mal vécue à Saint-Germain-en-Laye, aussi bien parmi le personnel médical que chez les responsables politiques, car on a cru qu’il s’agissait de supprimer un site. Or, ce n’était pas le cas. Si des terrains avaient été disponibles à Saint-Germain-en-Laye, on aurait pu assurément envisager que le nouvel établissement de court séjour s’y installe.
Du fait des blocages politiques, aucun choix n’a été opéré, ce qui a entraîné une détérioration de la situation de l’établissement. Dans le secteur privé, des cliniques qui décident de se regrouper s’installent généralement sur un site nouveau et ne se contentent pas de juxtaposer les services antérieurs : elles se restructurent pour définir une offre de soins rationnelle. Nous n’avons pas pu en faire autant.
Il en est résulté des situations caricaturales et parfois dangereuses : afin de maintenir en activité le service de maternité à Saint-Germain-en-Laye, comme cela nous avait été imposé, il avait été décidé que les femmes accoucheraient sur place, avant que d’être transportées à Poissy. En dépit de toutes les précautions prises, des décès se sont produits à cause d’une présence pédiatrique insuffisante.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Par qui la décision vous a-t-elle été « imposée » ?
M. Marc Buisson. La décision de maintenir une maternité sur le site de Saint-Germain-en-Laye a été prise au niveau politique.
De même, tout regroupement des services de cardiologie nous a été interdit. Les patients de Saint-Germain-en-Laye devaient se rendre à Poissy pour subir une angioplastie avant de retourner dans leur commune, au risque d’accidents graves : par exemple, on ne pouvait pas réopérer à Saint-Germain-en-Laye des patients auxquels on avait posé un stent.
Si les charges financières ont augmenté, c’est que nous n’avons pas pu supprimer les doublons et qu’il a fallu multiplier les gardes.
Nous avons confié à une société spécialisée le soin d’identifier un site d’implantation commune, si possible entre Saint-Germain-en-Laye et Poissy. Nous n’avions aucun a priori en la matière. Il n’a pas été possible de trouver un terrain à Saint-Germain-en-Laye. En revanche, il y en avait un disponible dans la commune de Fourqueux, mais il était difficile d’accès et le maire ne souhaitait pas notre installation. À Chambourcy, un terrain nous intéressait, mais nous n’avons pas obtenu de réponse positive de la municipalité.
M. le coprésident Pierre Morange. Les maires de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye, alternativement présidents et vice-présidents de l’établissement, devaient adresser une demande conjointe au maire de Chambourcy que je suis. En l’absence de cette démarche, aucune suite n’a pu être donnée au dossier. Le maire de Chambourcy ne participe pas au conseil d’administration de l’établissement de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Sans faire de commentaire sur la fusion décidée par le maire de Poissy et par celui de Saint-Germain-en-Laye, qui m’a précédé en tant que député de la circonscription, j’observe que les budgets des deux établissements étaient auparavant en équilibre.
Par ailleurs, les documents qui nous sont parvenus, aussi bien de la chambre régionale des comptes que de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), font état d’une dégradation des comptes depuis la fusion : l’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye présente la caractéristique peu enviable d’être l’un des plus déficitaires de France.
Nous souhaitons comprendre comment on a pu arriver à une telle situation. On observe une inflation de la masse salariale, notamment sous forme de recours à l’intérim, et nous avons appris, lors d’une précédente audition, que la DDASS se posait un certain nombre de questions, en particulier sur le respect du code des marchés publics. La chambre régionale des comptes nous a également indiqué qu’une part importante des recettes n’était pas perçue, notamment au titre des consultations.
M. Marc Buisson. Il n’y a pas eu d’accord, au plan politique, pour débloquer la situation. N’étant que le directeur de l’établissement, je n’avais naturellement pas compétence pour l’imposer.
M. le coprésident Pierre Morange. Dès que j’ai reçu une demande conjointe des maires intéressés, j’ai fait en sorte qu’un terrain soit acquis. Une promesse de vente a été signée à la mi-2009.
M. Marc Buisson. Je suis ravi qu’une solution ait été trouvée, ce qui n’avait malheureusement jamais eu lieu pendant que je dirigeais l’établissement. En dix ans, aucune décision d’implantation n’avait pu être adoptée.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je comprends bien que d’autres acteurs aient joué un rôle déterminant dans ce dossier, mais la situation a tout de même perduré pendant dix ans. Face à une situation dangereuse sur le plan financier et sanitaire, on ne peut pas s’abriter sans fin derrière des décisions politiques, et il y a un moment où il faut tirer la sonnette d’alarme.
M. Marc Buisson. Le conseil d’administration et la commission médicale ont été saisis des problèmes qui se posaient et nous avons fait rédiger différents rapports, notamment par un conseiller technique du ministre et par un cabinet d’expert, la SANESCO. Nous avons également fait appel à la mission d’appui et de conseil du ministère.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Rien de tout cela n’a eu de suite ?
M. Marc Buisson. Malheureusement non. Aucune décision n’a été prise sur le plan politique, et celles du conseil d’administration n’ont jamais été appliquées.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Que pouvez-nous dire du problème de sous-facturation – ou de non-facturation, je ne sais quel terme employer –, sur lequel la chambre régionale des comptes a appelé notre attention ?
M. Marc Buisson. Comme de nombreux hôpitaux, nous nous sommes trouvés confrontés à des difficultés lors du passage à la tarification à l’activité. À cela se sont ajoutées des difficultés qui nous étaient propres : l’existence de nombreux doublons et la multiplication des gardes.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Cela n’explique pas que des prestations n’aient pas été facturées.
M. Marc Buisson. Nous avons subi d’importantes difficultés informatiques en matière de facturation. Pour y remédier, nous avons restructuré le bureau des entrées et celui des consultations externes ; nous avons, en outre, augmenté le nombre des régies afin de pouvoir encaisser directement les consultations, lesquelles représentent souvent des sommes faibles, mais qui sont impossibles à recouvrer si l’on ne procède pas à leur recouvrement immédiatement.
Sur ce plan, il faut reconnaître que nous ne sommes pas parvenus à redresser la situation. À certains moments, nous avons presque été dans l’incapacité de facturer les prestations. Cela étant, nous n’étions pas les seuls dans ce cas dans la région d’Île-de-France.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Ces difficultés de facturation ont-elles été concomitantes du passage à la tarification à l’activité ? Y avait-il un lien ?
M. Marc Buisson. Bien sûr.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Dans ces conditions, on devrait rencontrer le même type de difficultés dans tous les établissements.
M. Marc Buisson. Ce fut précisément le cas, notamment à Rosny-sous-Bois, à Montreuil et à Argenteuil, où les difficultés de facturation ont été aussi grandes que les nôtres.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les montants en question sont tout de même très importants.
M. Marc Buisson. C’est vrai, mais les crédits ont été votés par le conseil d’administration et approuvés par les autorités de tutelle.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. En somme, la situation était catastrophique, mais tout le monde faisait son travail.
M. Marc Buisson. Nous avons pâti d’un excès de dépenses qui aurait pu être évité si l’hôpital avait été restructuré. Quand il existe deux services de pédiatrie, par exemple, il faut deux pédiatres. Nous avons dû multiplier les gardes en pédiatrie, mais aussi en chirurgie et en cardiologie.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le rapport de la DDASS fait apparaître un certain nombre de difficultés en matière de marchés publics au cours de la période 2006-2008, pendant laquelle vous étiez à la tête de l’établissement.
M. Marc Buisson. J’ai quitté mes fonctions en juin 2007.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Par ailleurs, les enquêteurs de la DDASS ont eu des difficultés à accéder aux informations nécessaires, les documents ayant disparu.
M. le coprésident Pierre Morange. Il semble que tous les dossiers antérieurs à 2003 aient été « mis à la benne » ; je cite le rapport de la DDASS.
M. Marc Buisson. J’en suis très étonné. Les commissions d’appel d’offres se réunissaient régulièrement et nous avons spectaculairement augmenté le nombre des marchés mis en concurrence. Par ailleurs, les marchés étaient soumis à l’approbation de la DDASS.
Pour le reste, je ne peux pas vous répondre. J’ignore ce que les documents en question sont devenus.
J’ajoute que nous n’avons jamais fait l’objet d’observations à ce sujet de la part de la DDASS, ni même de la chambre régionale des comptes, laquelle m’a pourtant auditionné lorsque j’étais encore conseiller général des hôpitaux.
M. le coprésident Pierre Morange. Le rapport de la DDASS observe que la durée légale de conservation des archives n’a pas été respectée et s’interroge sur un certain nombre de contrats antérieurs à votre départ en 2007.
M. Marc Buisson. Je ne peux pas vous apporter de réponse en ce qui concerne la disparition des documents, mais il doit tout de même y en avoir des exemplaires à la DDASS. Par ailleurs, le directeur des services économiques faisait chaque année un rapport au conseil d’administration. Ces rapports doivent figurer dans les registres du conseil d’administration.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Sur les dix-neuf marchés étudiés par la DDASS, quinze seraient irréguliers, ce qui fait tout de même beaucoup.
M. Marc Buisson. Sur quelle période portaient-ils ?
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Entre 2006 et 2008. Il y a notamment un marché de nettoyage de vitres, datant de 2006, pour lequel un certain nombre de dépenses auraient été engagées « hors marché » ; le rapport évoque pudiquement des « dépenses non formalisées ».
M. Marc Buisson. Pouvez-vous me dire de quelle entreprise il s’agissait ?
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. De l’entreprise Derichebourg.
M. Marc Buisson. Nous avons changé plusieurs fois de prestataire, parce que nous n’étions pas satisfaits, et nous avons lancé, à chaque fois, de nouveaux appels d’offres.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le rapport cite également un marché de transports sanitaires. Quels éclaircissements pouvez-vous nous apporter à propos de ces marchés ?
M. Marc Buisson. Je ne peux pas vous en dire davantage, faute d’avoir pu prendre connaissance du rapport. Par ailleurs, je ne comprends pas comment des documents ont pu disparaître.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous entendrons tout à l’heure le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui nous en apprendra sans doute davantage. Je rappelle que notre seul but est de comprendre ce qui s’est passé en vue de faire la part entre des facteurs nationaux et des causes propres à votre établissement.
Nous ne sommes pas une commission d’enquête : nous cherchons seulement à comprendre comment on a pu en arriver à une telle situation.
J’entends bien qu’il y a eu des difficultés liées à la fusion, mais il y a certainement eu d’autres causes – les services de la DDASS s’interrogent notamment sur le niveau de sous-facturation atteint dans votre établissement, ainsi que sur d’autres éléments jugés fort étranges. Dans le cas d’un marché conclu en 2006, par exemple, les dépenses « formalisées » s’élèveraient à 1,214 million d’euros, et les dépenses « non formalisées » à 217 000 euros.
M. Marc Buisson. C’est-à-dire engagées sans avenant ?
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Sans qu’un avenant ait été retrouvé.
M. Marc Buisson. Ce qui est tout de même très différent. Je suis catégorique : nous n’avons jamais engagé de dépenses supplémentaires sans signer d’avenants.
M. le coprésident Pierre Morange. Siégiez-vous au sein de toutes les commissions d’appel d’offres ?
M. Marc Buisson. Pas nécessairement, mais il y avait toujours un représentant de la direction et le receveur de l’établissement assistait à quasiment toutes les réunions.
Le fait que les documents n’aient pas été retrouvés – ce que je ne m’explique pas – ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu d’avenants. Les directives données étaient en effet claires : quand le plafond d’un marché était dépassé, il fallait signer un avenant.
M. le coprésident Pierre Morange. Quels qu’aient été les représentants de l’établissement, il existe une chaîne de responsabilités. Le code pénal est très clair à ce sujet.
Le rapport de la DDASS fait état de dysfonctionnements en matière d’appel d’offres et de collecte des recettes. Outre l’absence de certaines pièces, les enquêteurs ont constaté des anomalies concernant les règles de publicité et de plafonds posées par le code des marchés publics. Comment l’expliquer ?
M. Marc Buisson. Pour vous répondre, il faudrait que je connaisse les marchés concernés ainsi que la nature précise des dysfonctionnements visés. Tout ce que je peux vous dire, c’est que nous avons substantiellement augmenté la part des marchés soumis à appel d’offres et que les instructions étaient de conclure systématiquement des avenants.
M. le coprésident Pierre Morange. Si je comprends bien, vous n’avez pas eu connaissance de ces anomalies et de ces infractions. Elles sont le fait de tierces personnes.
M. Marc Buisson. Si j’avais eu connaissance de telles anomalies, j’aurais immédiatement pris les dispositions nécessaires pour y mettre un terme.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous demanderons à la DDASS si le dossier peut vous être communiqué. J’en profite pour rappeler que les travaux de la MECSS sont rendus publics : tout le monde pourra en prendre connaissance, notamment la presse.
M. Jean-Luc Préel. Sauf erreur de ma part, les deux établissements étaient originellement à l’équilibre. À combien s’élevait le déficit après la fusion ?
M. Marc Buisson. Lorsque j’ai quitté la direction de l’hôpital en 2007, il était d’environ 14 millions d’euros.
M. Jean-Luc Préel. J’ai connu des fusions d’établissements qui se passaient plutôt bien, alors que les conditions étaient similaires au début. Par ailleurs, il revient aux agences régionales de l’hospitalisation et aux DRASS d’intervenir en cas de problème, notamment par l’intermédiaire de contrats d’objectifs et de moyens.
Lorsque les fusions se passent bien, on observe que c’est souvent grâce à l’implication personnelle du directeur, qui parvient à faire valider un projet par la commission médicale d’établissement et par le conseil d’administration.
Les problèmes médicaux que vous avez cités, notamment en ce qui concerne la maternité, me paraissent intolérables. Comment se fait-il qu’ils n’aient pas été résolus ? Sur quels obstacles avez-vous buté ?
M. Marc Buisson. Sur des obstacles politiques. Les instances de l’établissement ont arrêté des dispositions qui n’ont jamais été mises en œuvre. Certains regroupements ont été impossibles à réaliser parce qu’il aurait fallu que certains services quittent le site de Saint-Germain-en-Laye. Nous nous sommes donc retrouvés avec des structures inadaptées et surdimensionnées.
M. Jean-Luc Préel. Et la tutelle n’a pas joué son rôle ?
M. Marc Buisson. C’est exact. Aucune décision n’a été prise. Nous avons été dans l’impossibilité de réaliser un certain nombre d’économies qui auraient pourtant pu être substantielles.
Nous avons signé des contrats de retour à l’équilibre, validés par la DDASS puis faisant l’objet d’un comité de suivi, réuni tous les mois autour de la secrétaire générale de l’agence régionale de l’hospitalisation. De façon très classique, il s’agissait d’augmenter notre activité tout en réduisant les dépenses.
Nous sommes à peu près parvenus à atteindre le second objectif et nous avons dépassé nos engagements en matière d’activité. Cela étant, nous avons continué à dépenser d’un côté ce que nous économisions de l’autre, car les restructurations nécessaires n’ont pas été réalisées. On constate d’ailleurs un phénomène similaire dans le secteur privé : des entreprises qui fusionnent sans réaliser de restructuration ne peuvent qu’être en déficit.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Votre établissement a bénéficié d’aides financières substantielles. Pensez-vous que ces bouffées d’oxygène aient contribué à retarder la prise de décision ?
M. Marc Buisson. Ces aides étaient conditionnées au respect d’un certain nombre d’engagements – réduction des dépenses et augmentation de l’activité, comme je l’ai indiqué. Si nous y sommes en partie arrivés, c’était en réalisant des économies de bouts de chandelles qui ont suscité le mécontentement du personnel, sans réussir à agir sur le cœur du problème, à savoir la persistance de doublons.
M. Jean-Luc Préel. Les contrats de retour à l’équilibre ne faisaient-ils pas mention de leur suppression ?
M. Marc Buisson. Non, car celle-ci relevait du projet médical et du projet d’établissement. Or, la suppression de certains services, notamment ceux de pédiatrie et de cardiologie à Saint-Germain-en-Laye, s’est toujours heurtée à des refus catégoriques. Il en est résulté des situations dramatiques dont un reportage s’est récemment fait l’écho. Les atermoiements qui ont eu lieu pendant dix ans ont conduit à une situation catastrophique.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pensez-vous que les nouvelles règles de gouvernance qui ont été adoptées auraient pu éviter d’en arriver là ?
M. Marc Buisson. Nous étions très en avance en matière de gouvernance, car je travaillais déjà constamment avec le président de la commission médicale, et les décisions stratégiques étaient prises par un conseil exécutif, composé pour moitié de membres de l’administration et pour moitié de membres du corps médical.
Les instances de l’hôpital ont joué leur rôle, mais leurs décisions n’ont pas été appliquées faute d’un soutien de l’agence régionale de l’hospitalisation et des responsables politiques. Je n’ai jamais pu supprimer les doublons et aucune décision n’a jamais été prise en ce qui concerne l’implantation des services de court séjour.
M. Jean-Luc Préel. On constate habituellement le contraire : c’est plutôt la tutelle qui impose des décisions…
M. Marc Buisson. J’aurais tellement aimé que ce soit le cas !
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. En somme, des décisions politiques échappant à votre contrôle vous ont placé dans une situation délicate, les solutions de rationalisation de la gestion que vous proposiez ont été refusées par votre tutelle, et les difficultés de fonctionnement interne, notamment en matière de facturation, sont le résultat de défaillances informatiques.
M. Marc Buisson. Je ne mets pas tout sur le compte de l’informatique, même si nous avons effectivement rencontré des difficultés considérables dans ce domaine. Comme je l’ai indiqué, il y avait aussi un problème d’organisation du bureau des entrées.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Si l’on suit vos explications, le rôle du directeur général est tout de même bien modeste.
M. Jean-Luc Préel. Il a pourtant été reconnu, puisque vous avez été nommé conseiller général des hôpitaux…
M. Marc Buisson. Il convient de faire la part des choses : en l’absence de restructuration, nous n’avons fait que poser des rustines quand des économies considérables auraient pu être réalisées. Au demeurant, cela n’a pas emporté que des conséquences financières : ces restructurations auraient permis d’améliorer l’offre de soins et d’éviter la démotivation du personnel – certains ont même choisi de quitter l’établissement. J’ai vécu un véritable calvaire pendant dix ans.
Je précise que le corps non médical avait entièrement adhéré au projet de fusion – il y a d’ailleurs eu des échanges de personnel d’une structure à l’autre –, comme environ 80 % du personnel médical, et qu’il n’y a jamais eu de grèves organisées pour des motifs locaux. Mais cela n’a rien changé.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous avez dit que la suppression des doublons aurait permis de réaliser des économies. Pensez-vous que les déficits auraient pu être supprimés de la sorte ?
M. Marc Buisson. Oui, je le pense. Il suffit de considérer le coût des gardes pour s’en convaincre. Compte tenu du taux d’occupation de certains services et de la présence de cliniques de grande qualité à proximité – la clinique de l’Europe, la clinique Louis-XIV ou encore la clinique Marie-Thérèse –, il n’y avait pas lieu de maintenir un service de chirurgie à Saint-Germain-en-Laye, par exemple.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Disposiez-vous d’un système de comptabilité analytique vous permettant de mesurer efficacement les coûts ?
M. Marc Buisson. L’établissement de Saint-Germain-en-Laye avait fait partie de l’échantillon retenu pour établir l’échelle nationale des coûts. Il existait donc des indicateurs qui, sans être parfaits, permettaient de prendre la mesure de la situation.
D’autre part, on sait très bien quelles économies on peut réaliser en supprimant un service : il suffit d’additionner les coûts – les dépenses de personnel, par exemple, ou encore le coût des consommations de fluides.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Si je vous pose la question, c’est parce que le rapport de la Cour des comptes déplore l’absence de comptabilité analytique dans la plupart des hôpitaux.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans le cas de l’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, la chambre régionale des comptes a observé qu’il n’existait pas la moindre comptabilité analytique, même rudimentaire, ce qui rendait en particulier impossible toute comparaison avec les pratiques vertueuses retenues sur le plan national. Or, la nouvelle équipe a su établir une telle comptabilité en moins de douze mois.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pour compléter mes propos concernant les manquements au code des marchés publics, le rapport de la DDASS fait notamment état d’infractions graves, représentant des sommes considérables, dans le cas d’un contrat de location et de maintenance de photocopieurs : il y aurait eu des dépenses non justifiées par un écrit.
M. Marc Buisson. Vous avez vous-même indiqué que des documents n’ont pas été retrouvés…
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. On peut également penser qu’ils n’existent pas. Selon les éléments dont disposent les enquêteurs, des dépenses auraient été engagées sans justification écrite. En matière de transports sanitaires, les obligations des cocontractants n’auraient pas non plus été respectées, et j’en passe.
M. Marc Buisson. J’aimerais vous répondre, mais c’est impossible faute de connaître tous les détails.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous avez dit que vous aviez réussi à augmenter l’activité de l’établissement. Or la chambre régionale des comptes a constaté un report de certains patients vers d’autres hôpitaux. Comment concilier ces deux phénomènes ?
M. Marc Buisson. Les difficultés de l’hôpital, qui ont été largement médiatisées, n’inspiraient pas confiance à la population. Les femmes qui devaient accoucher se posaient notamment bien des questions. Un certain nombre de problèmes de sécurité et des incertitudes sur le maintien de certaines activités ont détourné une partie de la clientèle.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Mais vous êtes parvenu à augmenter l’activité.
M. Marc Buisson. Oui. En un an, nous avons rempli les objectifs fixés par le contrat de retour à l’équilibre pour une durée de deux ans, voire deux ans et demi. Il y a eu des pertes d’activité, notamment dans les services de chirurgie et de maternité, mais la fréquentation est repartie à la hausse quand nous sommes parvenus à clarifier notre organisation.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie, monsieur Buisson.
*
Audition, à huis clos, de M. Luc Paraire, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines.
M. le coprésident Pierre Morange. La MECSS est heureuse de vous accueillir en son sein, monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines, afin de vous entendre sur le fonctionnement interne de l’hôpital, plus précisément sur le cas particulier du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
La MECSS disposait déjà d’un certain nombre de documents : ceux communiqués par la nouvelle équipe qui anime le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye depuis mi-2007, ainsi que le rapport de la chambre régionale des comptes. Mme Pelletier, membre de la Cour des comptes, est là pour nous assister dans cette démarche de contrôle et d’évaluation. Nous disposons désormais du rapport de la DDASS relatif aux marchés publics passés par le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Nous avons été stupéfiés par les violations au code des marchés publics relevées dans ce rapport, et nous aimerions que vous nous éclairiez davantage, notamment quant aux responsabilités de ces dysfonctionnements et à leurs implications réglementaires, voire juridiques.
M. Luc Paraire, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines. J’ai transmis ce rapport au procureur de la République en juillet 2009, en application de l’article 40 du code de procédure pénale s’agissant d’infractions susceptibles de faire l’objet d’une incrimination pénale.
M. le coprésident Pierre Morange. Savez-vous si une enquête sur ces faits a été diligentée ?
M. Luc Paraire. Pas pour l’instant, mais je suis disposé à me constituer partie civile avant la fin de l’année si les choses ne vont pas plus vite.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous préciser la date exacte de la saisine du parquet de Versailles ?
M. Luc Paraire. Le procureur de la République de Versailles a été saisi le 3 juillet 2009.
J’ai pris mes fonctions le 16 août 2007, et ce dossier a été le premier que j’ai eu à examiner. Dans un contexte juridique assez difficile, j’ai eu assez vite le sentiment que certaines procédures internes n’étaient pas suffisamment « calées ». J’ai en outre été alerté par des rumeurs de favoritisme sur un marché de transports sanitaires. Il semblait par ailleurs que des changements importants dans la direction de l’établissement avaient fait apparaître des clivages au sein de l’équipe dirigeante. Or la personne responsable des marchés avant l’arrivée du nouveau directeur ne m’avait pas paru consacrer l’intégralité de ses compétences à sa fonction de surveillance des marchés. En un mot, cette fonction de contrôle des marchés ne me paraissait pas correctement remplie.
Pour toutes ces raisons, j’ai chargé un inspecteur principal et un inspecteur administratif chevronnés d’une enquête qui a abouti à ce rapport. Je dois préciser que ce rapport n’est pas totalement contradictoire, le directeur général actuel n’ayant pas pu obtenir du cadre concerné à l’époque des faits des réponses aux conclusions dudit rapport. Cette absence de réponse a d’ailleurs été l’une des raisons essentielles de mon dépôt de plainte.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous voulez dire que le directeur général du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n’a pas été en mesure de vous apporter des explications ?
M. Luc Paraire. Il m’a donné de premiers éléments de réponse, que j’ai d’ailleurs transmis au parquet, mais ils sont loin d’être suffisants. J’ai laissé trois mois à l’établissement pour répondre aux conclusions du rapport, et ce n’est qu’à l’issue de ce délai et devant l’incapacité de répondre du directeur général que j’ai déposé plainte.
M. le coprésident Pierre Morange. Il semble que la nouvelle équipe dirigeante ait eu à cœur d’agir d’une façon plus conforme à la réglementation.
M. Luc Paraire. C’est incontestable.
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous été amené à enquêter auprès d’échelons administratifs supérieurs ?
M. Luc Paraire. À partir du moment où j’avais déposé plainte, j’ai considéré ne pas pouvoir aller plus loin. Quant à l’équipe actuelle, je confirme qu’elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour réintroduire de la rigueur dans la passation de marchés publics par l’établissement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le contrôle porte sur la période 2007-2008. Pourquoi n’avez-vous pas contrôlé l’activité de l’établissement plus en amont ?
M. Luc Paraire. Il m’a semblé que, étant donné le turn-over extrêmement rapide qui avait affecté une partie de l’équipe, j’avais encore moins de chance de réunir des éléments fiables sur une période encore antérieure. Surtout, les éléments inadmissibles que nous avions déjà collectés me semblaient suffire au parquet pour qu’il se fasse une religion.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’est-ce qui vous a le plus choqué ?
M. Luc Paraire. La violation de la loi.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelles sont les infractions qui sont constituées ? De quelles sanctions sont-elles susceptibles ? Quelles sont les personnes dont la responsabilité peut-être mise en cause ?
M. Luc Paraire. Nous avons relevé trois infractions majeures.
Premièrement : l’absence totale de prévision. Il n’y avait pas de politique d’achat : c’était au petit bonheur la chance, en fonction des besoins. J’espère du moins que c’est cela, et que ce n’était pas en fonction des relations, des désirs ou des souhaits.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous allez jusqu’à envisager une telle hypothèse ?
M. Luc Paraire. Je peux ne pas l’exclure, mais ce sera au parquet de le dire. Dans la première hypothèse, il s’agirait moins d’une infraction que d’une absence totale de gestion, ce qui est déjà en soi fort regrettable.
Deuxièmement, ce qui aurait dû être soumis aux procédures de marché ne l’a pas toujours été. Dans ce domaine, l’extrême modestie de nos moyens d’investigation ne nous a pas permis de vérifier la réalité de certaines décisions.
Troisièmement, certains marchés ont été augmentés d’avenants divers et variés à l’insu de tous, qui ont totalement déséquilibré l’économie générale du marché originel. De tels faits sont au minimum constitutifs d’une violation du droit à la concurrence.
M. le coprésident Pierre Morange. Et du délit de favoritisme passible de l’article 432-14 du code pénal ?
M. Luc Paraire. Ce n’est pas à exclure, et c’est ce qui est suggéré dans notre rapport.
M. le coprésident Pierre Morange. Quels sont les responsables ?
M. Luc Paraire. Au premier rang le directeur de l’établissement, puisque les faits en cause relèvent de son pouvoir propre. Mais il s’agit à mon avis d’une responsabilité partagée, du moins sur le plan administratif, par le cadre dirigeant en charge de la passation des marchés au sein de l’établissement.
M. le coprésident Pierre Morange. Il n’y a pas d’autre responsable ?
M. Luc Paraire. Je ne suis pas capable de vous le dire à ce stade de mon enquête.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelle a été la réaction de votre prédécesseur à cette place face aux rumeurs qui ont attiré votre attention ?
M. Luc Paraire. Je suis incapable de vous le dire. Je n’en ai en tout cas trouvé nulle trace écrite dans les archives.
M. le coprésident Pierre Morange. Il semble en effet que les dossiers relatifs aux faits en cause aient été « mis à la benne » avant 2003, en violation des délais décennal et trentenaire de conservation des archives.
M. Luc Paraire. Absolument.
M. le coprésident Pierre Morange. Les informations ne sont apparues qu’à votre arrivée ?
M. Luc Paraire. Les rumeurs, du moins, se sont intensifiées au moment de mon arrivée. Sur ce dossier, j’ai été en contact fructueux et permanent avec l’agence régionale de l’hopitalisation.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelle a été la réaction de l’agence ?
M. Luc Paraire. M. Métais, directeur de l’agence régionale de l’hopitalisation, m’a indiqué qu’il était aussi inquiet que moi et m’a assuré de son soutien dans toutes mes actions pénales.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Selon l’ex-directeur général, les procédures de passation de marchés étaient régulières.
M. Luc Paraire. Si j’avais partagé cette opinion, je n’aurais pas saisi le parquet : je serais resté sur un plan administratif.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il considère qu’il serait plus à même de répondre à nos questions s’il avait eu connaissance du rapport.
M. Luc Paraire. Ce rapport est à la disposition du parquet, de M. Métais et de la directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé.
M. le coprésident Pierre Morange. Et désormais de la MECSS !
M. Jean-Luc Préel. La responsabilité de la commission d’appel d’offres peut-elle être mise en cause ?
M. Luc Paraire. Je constate qu’elle n’est pas intervenue autant qu’elle l’aurait dû, mais le rapport ne remonte pas jusqu’à ce niveau de mise en cause. Il n’est pas exclu qu’elle n’ait pas disposé de toutes les informations nécessaires au moment de prendre ses décisions.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce qui est frappant, c’est la diversité des compétences en matière de marchés publics, et l’incompétence à tous les échelons.
M. Luc Paraire. Du moins une forte désorganisation, depuis le service chargé des achats jusqu’à la direction générale, en passant par les cadres intermédiaires.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le rapport parle même de « dépenses non formalisées ».
M. Luc Paraire. En plus de trente ans de carrière, je n’ai jamais vu des dysfonctionnements aussi graves. J’espère qu’il ne s’agit que d’incompétence ou de manque de conscience, et que cette désorganisation n’était pas organisée. Mais le doute m’a conduit à saisir le parquet.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est malheureusement un système de gestion des ressources humaines qui n’est pas rare dans l’administration !
Mme Bérangère Poletti. Quelle proportion du déficit de l’établissement attribuez-vous à ces dysfonctionnements dans la passation des marchés ?
M. Luc Paraire. Je m’inquiète surtout du montant considérable des dommages qu’il faudrait verser aux prestataires lésés au cas où ces marchés seraient annulés.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Ces dysfonctionnements n’expliquent pas le déficit structurel de l’établissement, qui est fort ancien. Comment l’analysez-vous ? Quelles sont les mesures à prendre ?
M. Luc Paraire. À mon avis, le choix de maintenir une structure bicéphale constituée de deux établissements distants de cinq kilomètres seulement n’était pas viable : ils couvrent des bassins de population trop proches, d’où les surcoûts, les doublons. Ces difficultés ont été aggravées par la désorganisation de certains services et une méconnaissance totale de l’activité réelle de l’établissement, dont on ne pouvait avoir qu’une connaissance fragmentaire, lacunaire, non exhaustive. On ne sortira pas de cette situation tant qu’on n’aura pas un programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), fiable et exhaustif. Des actes n’étaient pas facturés ; de 8 à 10 millions d’euros de créances non recouvrables étaient systématiquement admis en non-valeur. L’ensemble de ces éléments n’a fait qu’aggraver les conséquences de l’erreur initiale.
M. le coprésident Pierre Morange. Il n’est pas rare de trouver des établissements aussi proches : si l’on devait appliquer votre raisonnement aux hôpitaux de Paris, c’est la moitié du parc hospitalier parisien qu’il faudrait supprimer !
Ce qui nous a frappés, c’est que les comptes des deux établissements qui ont été fusionnés dans le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye étaient équilibrés. Quand l’admission en non-valeur concerne chaque année de 8 à 10 millions d’euros de créances, à quoi s’ajoute le fait que de nombreuses journées d’hospitalisation n’étaient même pas facturées – apparemment à cause de problèmes informatiques ou de codage, mais cela reste injustifiable –, toutes ces recettes non perçues finissent par représenter une part du déficit qui n’est pas marginale : cela représente un tiers d’un déficit moyen annuel de 20 à 25 millions d’euros, déficit qui a même dépassé 30 millions d’euros.
M. Luc Paraire. Tout à fait.
M. Jean-Luc Préel. Quelle a été la réaction de la tutelle quand elle constatait de tels montants non recouvrés chaque année ?
M. Luc Paraire. Il me semble que des solutions auraient pu être trouvées, comme l’apport ponctuel de personnels auprès du trésorier pour assurer le recouvrement de la dette. Je ne sais pas pourquoi rien n’a été fait.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous nous avez indiqué le coût du non-recouvrement de créances ; pouvez-vous estimer celui des actes non facturés ? Y a-t-il des documents ?
M. Luc Paraire. Je ne peux pas vous répondre sur ce point.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous indiquer le taux moyen d’actes non facturés pour l’Île-de-France ? La chambre régionale des comptes nous a dit qu’un tel pourcentage n’avait rien d’exceptionnel, ce qui interpelle quelque peu les élus de la Nation que nous sommes. Pouvez-vous nous indiquer au moins une fourchette ?
M. Luc Paraire. Le coût des actes non facturés pour le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est de 15 % environ pour 200 millions d’euros de recettes, soit 30 millions d’euros.
M. Jean-Luc Préel. Vous voulez parler des soins d’urgence et des consultations ?
M. Luc Paraire. Non : de l’ensemble des actes non facturés.
Mme Carole Pelletier, rapporteure à la Cour des comptes. 15 % des facturations ?
M. Luc Paraire. Non : 15 % du montant total des recettes. C’est un chiffre approximatif, à repréciser. C’est un ordre de grandeur.
M. le coprésident Pierre Morange. Un taux de 10 % d’actes non facturés représenterait déjà un coût de 20 millions d’euros ! Si l’on y ajoute 10 millions d’euros de créances non recouvrées, on peut dire que les comptes seraient à l’équilibre si les recettes étaient correctement perçues ?
M. Luc Paraire. Dans une très large mesure.
M. Jean-Luc Préel. Qu’en est-il de l’ensemble des établissements français ?
M. Luc Paraire. Beaucoup ont de gros efforts à faire en matière de PMSI, de facturation et de connaissance de leur activité, mais j’ai rarement vu un tel niveau de dysfonctionnement.
M. le coprésident Pierre Morange. Je reprécise la question : quel est le pourcentage moyen de recettes non perçues par les établissements hospitaliers ?
M. Luc Paraire. Probablement plus de 5 %.
M. le coprésident Pierre Morange. Voilà un élément à prendre en compte dans notre réflexion sur le contrôle et l’évaluation de l’utilisation des deniers publics.
M. Jean-Luc Préel. Cela dit, si ces actes étaient facturés, cela aggraverait encore le déficit de la sécurité sociale !
M. le coprésident Pierre Morange. La dépense est là de toute façon. C’est un jeu de dominos, qui entraîne des dysfonctionnements sur le plan sanitaire.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il y a en outre le coût des dotations que les pouvoirs publics doivent verser pour combler les déficits.
À votre avis, le passage à la T2A a-t-il permis de mettre en évidence cette situation de sous-facturation ?
M. Luc Paraire. Le système antérieur de la dotation globale masquait en effet la sous-facturation, alors que la T2A a fait apparaître ce déficit, tout en faisant progresser la connaissance réelle de l’activité de chaque établissement. Or, sans connaissance précise de l’activité de l’établissement, il n’est pas possible de mener une politique intelligente de recrutement ni de travailler convenablement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’ancien directeur général incrimine certaines décisions politiques dans son incapacité à gérer plus efficacement l’établissement. Il assure qu’il a tiré la sonnette d’alarme auprès de ses tutelles, sans que celles-ci ne réagissent s’agissant des doublons et des problèmes de gestion.
M. Luc Paraire. Je n’ai pas connu cette période. Il est clair cependant que, dans ce dossier, certains paramètres échappent largement à la compétence de la DDASS, voire de l’agence régionale de l’hospitalisation car elles ne relèvent pas de la politique de santé publique, mais plutôt, dans le cas d’espèce, de considérations d’aménagement du territoire. Nous sommes en effet sur un territoire socialement hétérogène, où il s’agit de préserver des équilibres complexes.
Je ne doute pas que les prédécesseurs de M. Chodorge aient alerté ponctuellement l’agence régionale de l’hospitalisation, qui exerce la tutelle depuis 2000, mais je suis incapable de dire comment ces alertes ont été traitées. Je constate simplement le manque de détermination des directions successives. Les paramètres politiques ne dispensaient pas la direction d’avoir un PMSI impeccable, des procédures de marché tirées au cordeau, une bonne gestion et un bon recrutement des personnels.
M. le coprésident Pierre Morange. Si les recettes avaient été correctement collectées, il n’y aurait quasiment pas de déficit.
M. Luc Paraire. Disons qu’il y aurait un déficit moins « malsain », de 10 à 15 millions d’euros.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le plan de redressement est-il de nature à remettre l’établissement sur de bons rails ?
M. Luc Paraire. Je crois que M. Chodorge et son équipe ont pris la mesure des problèmes et que les dysfonctionnements les plus courants sont en voie de règlement. Dans le cas contraire, la DDASS n’aurait pas émis un avis favorable à la signature du contrat de retour à l’équilibre, qui engage l’agence régionale de l’hospitalisation à accorder au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye une dotation qui représente tout de même la moitié de l’aide destinée à toute l’Île-de-France.
Les axes du contrat sont les suivants : fiabilisation, bonne connaissance de l’activité et poursuite de son augmentation, valorisation des séjours et diminution des dépenses – sur ce dernier point, M. Chodorge a déjà pris des mesures de compression de la masse salariale et de réduction des doublons. L’équipe fait également tout son possible, dans un contexte difficile, en matière de connaissance de l’activité et de réorientation de l’activité de l’établissement sur son cœur de métier, même si les résultats ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous sur le plan financier. Mais ce redressement demande une vigilance de tous les instants.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Réalisez-vous des bilans d’étape ?
M. Luc Paraire. Nous faisons un point d’étape tous les deux mois au moins, voire tous les mois, dans le cadre du comité de pilotage tripartite mis en place à l’occasion du contrat de retour à l’équilibre.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous exercez votre tutelle, en un mot ?
M. Luc Paraire. Oui.
M. Jean-Luc Préel. Votre plainte a-t-elle été déposée au nom de la DDASS ?
M. Luc Paraire. Elle l’a été au nom du préfet, qui était alors compétent en matière de légalité des marchés publics.
M. le coprésident Pierre Morange. La chaîne de responsabilité va donc de la préfecture à la direction de l’hôpital, en passant par la DDASS ?
M. Luc Paraire. Á condition que le préfet soit en possession de tous les éléments.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur Paraire, nous vous remercions.
*
AUDITIONS DU 22 OCTOBRE 2009
Audition, à huis clos, de M. Emmanuel Lamy, président du conseil d’administration du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et maire de Saint-Germain-en-Laye.
M. le coprésident Jean Mallot. Bonjour et merci, monsieur Lamy, d’être venu jusqu’à nous. Je vous prie d’excuser l’absence du coprésident de notre mission, Pierre Morange, qui participe à un colloque. L’objet de nos travaux, aujourd’hui, est le fonctionnement de l’hôpital : vaste programme, qui nous a poussés à partir de cas concrets pour en tirer des enseignements généralisables. Nous avons déjà pris connaissance de différents documents concernant le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, produit d’une fusion encore inachevée et qui souffre de difficultés importantes, à commencer par des déficits persistants, et commencé les auditions pour mieux comprendre ce qui a pu se passer. Nous souhaitons savoir comment vous analysez la procédure de fusion, le fonctionnement de l’établissement et les raisons de ses difficultés, et comment vous pensez possible d’y porter remède.
M. Emmanuel Lamy, président du conseil d’administration du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et maire de Saint-Germain-en-Laye. Sachez d’abord que j’aurai été la plupart du temps dans l’opposition du conseil d’administration, et cela que j’en soie le président ou le premier vice-président – je crois que c’est le terme – puisque le maire de Poissy et moi devions alterner à ces postes. Dix années durant, j’ai été un opposant résolu à la politique de la direction générale de l’établissement, soutenue par le député-maire de Poissy. La fusion entre les établissements de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye s’est cristallisée sur un regroupement de l’ensemble des forces vives à Poissy, ce qui a, de mon point de vue, occulté largement les problèmes de gestion qui sont survenus.
Ensuite, il faut garder à l’esprit que le président du conseil d’administration, pas plus ici qu’ailleurs, n’a de pouvoirs de gestion. Si le directeur l’associe à son action, il est bien informé. Sinon, il n’est qu’une potiche qui peut néanmoins essayer d’user de son influence politique pour peser sur certaines orientations.
Je pense que la fusion entre les deux établissements était vouée à l’échec pour deux raisons.
La première est qu’il n’y a pas de communauté de bassin de vie entre Saint-Germain – 43 000 habitants – et Poissy – 36 000 habitants. Saint-Germain est une ville bourgeoise, qui perçoit Poissy comme très différente. Dès que les patients se sont rendu compte qu’ils avaient le choix, pour ce qui est des interventions lourdes, entre Poissy et ailleurs, ils ont massivement voté pour l’« ailleurs ». Les statistiques montrent que la part de marché du centre hospitaliser s’est largement amenuisée. Les Saint-Germanois – je parle ici de l’ensemble du bassin de vie de Saint-Germain – se sont dirigés vers le secteur privé, se rendant notamment à la clinique de l’Europe, à Port-Marly, et vers les grands hôpitaux parisiens. Dans une économie de santé concurrentielle, et avec la très forte attraction de Paris, c’était une erreur de ne pas voir que les Saint-Germanois fuiraient Poissy.
La deuxième raison est que, lorsqu’on fusionne deux hôpitaux de taille similaire, on évite de mettre à la tête du nouvel établissement le directeur de l’un ou de l’autre. À cette époque, j’étais adjoint au maire : j’ai voté la fusion par loyauté, parce que mon prédécesseur Michel Péricard me l’avait demandé, sans y être hostile mais sans en comprendre l’utilité malgré les discours sur les synergies. Mais du jour où il a été clair que le nouveau directeur serait celui de Poissy, je suis entré dans l’opposition. Cette querelle entre les deux pôles, l’ancien directeur a dû vous le dire aussi, a tout biaisé par la suite. La volonté que j’ai montrée, avec les autres administrateurs représentant Saint-Germain, de ne pas laisser tout filer à Poissy l’a certainement poussé à se focaliser sur cette question et à négliger le reste.
Un conseil d’administration est très largement une chambre d’enregistrement. Le pouvoir est en quasi-totalité dans les mains du directeur. Les médecins constituent le seul contre-pouvoir, mais assez fragile dans la mesure où ils dépendent du directeur pour leur fonctionnement. Le conseil d’administration n’a pas les moyens de contester les propositions du directeur, qui restent de toute façon peu détaillées. Voter un budget, par exemple, est un leurre. On vous présente des dépenses agglomérées par catégorie en vous faisant comprendre que le projet a l’accord de l’agence régionale de l’hospitalisation, et il est difficile d’argumenter contre. Si en outre on est dans l’opposition, qu’on a contre soi à la fois le pouvoir politique du député-maire et des élus de Poissy et le corps médical, on n’a plus le choix qu’entre se soumettre et se démettre.
En ce qui me concerne, les dernières années, j’ai quitté à plusieurs reprises le conseil d’administration en claquant la porte. J’ai même dû dénoncer des procès-verbaux établis à charge contre mes interventions – c’est facile à vérifier. Bref, nous ne pouvions pratiquement rien exprimer à part des votes d’approbation et, bien sûr, l’opposition entre Poissy et Saint-Germain.
M. le coprésident Jean Mallot. Sur quel genre de point votre désaccord pouvait-il porter ?
M. Emmanuel Lamy. Sur un des projets médicaux, par exemple – clash, suspension de séance dramatique, rédaction d’un compromis parce que l’agence régionale de l’hospitalisation ne souhaitait pas que le projet soit adopté par les Pisciacais contre les Saint-Germanois… J’ai aussi refusé de voter un budget – je me suis abstenu, un réflexe de haut fonctionnaire m’empêchant de voter contre. Et j’ai quitté des réunions absolument furieux à plusieurs reprises. Les circonstances locales empêchaient le conseil d’administration de jouer son rôle critique, de prendre du recul, bref de jouer son rôle d’organe délibérant. Du temps de M. Buisson, que je sois président ou premier vice-président, on ne m’adressait même pas les comptes rendus de la commission médicale d’établissement. Les décisions se prenaient entre le président, le patron de la commission médicale d’établissement et lui – c’est-à-dire dans un consensus certain. Il restait juste à voter, sachant que les Saint-Germanois étaient minoritaires. Il n’y avait aucune alternative aux propositions du directeur. Les documents étaient disponibles au dernier moment, et de toute façon d’une généralité et d’une complexité telles qu’ils n’étaient pas exploitables.
Dans ces conditions, j’aimais porter l’attaque sur certains points bien précis, comme le non-recouvrement des créances de l’hôpital. En fait, il s’agissait d’un phénomène global, qui commençait par la non-facturation. Les deux sites étant en effet d’architecture assez ancienne, il était très facile d’aller se faire soigner et de repartir sans payer.
M. le coprésident Jean Mallot. Mais cela peut-il être mis en évidence ?
M. Emmanuel Lamy. Seulement si l’on peut comparer la facturation à l’activité médicale. Mais un autre de nos problèmes spécifiques était justement, jusqu’à une période récente, une informatique complètement défaillante et en tout cas utilisée uniquement pour la gestion et non pour l’activité médicale. Cette situation, ajoutée à l’organisation des services qui permettait donc aux gens de se rendre à un rendez-vous et de repartir sans payer, sans aucun circuit organisé qui les enregistre pour tel ou tel acte, nous a valu pendant des années d’approuver des listes impressionnantes de créances abandonnées faute de pouvoir les recouvrer. Je ne saurais vous en dire le montant global, mais cela peut se retrouver.
À ce problème de gouvernance s’est ajouté un autre facteur : au moment de la fusion, les deux hôpitaux étaient sensiblement de la même taille. Celui de Poissy était un peu plus dynamique, avec des chefs de service un peu plus jeunes, ceux de Saint-Germain étant plutôt des notables – de qualité. Le budget était équilibré à Saint-Germain et déficitaire à Poissy. Les chefs de service et le personnel hospitalier de Saint-Germain étaient largement employés à temps partiel, ceux de Poissy à temps plein. Or, les emplois à temps partiel n’étaient pas pris en considération dans le vote pour la constitution de la commission médicale d’établissement initiale. Dès le départ donc, le pouvoir médical s’est trouvé totalement pisciacais, avec seulement un président de la commission médicale d’établissement saint-germanois les deux ou trois premières années. Pour résumer la situation, il y avait un pouvoir politique plus fort à Poissy qu’à Saint-Germain, un directeur complètement acquis à l’idée de tout regrouper à Poissy – certainement, de son point de vue, pour des raisons de bonne gestion et d’efficacité médicale – et une commission médicale d’établissement totalement acquise à cette thèse. Les problèmes généraux de gouvernance, d’informatique ou d’organisation physique des locaux ont été occultés, dans les faits, par la bataille qui a pendant dix ans opposé les deux sites qui, décidément, ne se trouvaient rien en commun.
Dix années pendant lesquelles les pouvoirs publics ont d’ailleurs changé quatre fois de position, hésitant sans cesse entre le site unique et les deux sites. Lorsqu’ils s’étaient décidés pour le site unique, M. Masdeu-Arus, M. Buisson et le président de la commission médicale d’établissement pesaient pour qu’il soit installé à Poissy, mais les Saint-Germanois se précipitaient chez le ministre et il était finalement décidé d’en revenir à deux sites. Et, dans cette autre optique, le pouvoir dominant pisciacais décidait de consolider une toute petite partie de Saint-Germain et de transférer le reste à Poissy – ce qu’ils appelaient d’ailleurs « restructuration du site de Poissy » en public, mais « Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain à Poissy » dans leurs dossiers.
Jusqu’à ce que s’impose finalement l’idée que j’avais défendue avec Dominique Coudreau, premier patron de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France : si site unique il doit y avoir, qu’il se fasse ailleurs, sans quoi on n’y arrivera jamais. Mais il a fallu notamment convaincre Pierre Morange d’accepter l’idée de l’implanter à Chambourcy, seul endroit où des terrains étaient disponibles, alors que la commune avait bien d’autres idées que d’accueillir un centre hospitalier qui ne paye pas de taxe professionnelle.
M. le coprésident Jean Mallot. Ces difficultés n’expliquent pas vraiment comment la fusion de deux centres hospitaliers à peu près similaires, l’un au budget équilibré et l’autre presque, a pu aboutir à un établissement lourdement déficitaire.
M. Emmanuel Lamy. Je pense que la dérive n’a pas été claire tout de suite. Il y a eu deux ou trois plans successifs de l’agence régionale de l’hospitalisation, jamais respectés mais sans que cela ait de réelles conséquences. J’ai très peu d’éléments concernant cette période mais, à chaque fois que je « râlais », on me répondait que l’agence régionale de l’hospitalisation n’y trouvait rien à redire. Les budgets que nous votions étaient plus de l’ordre du souhaitable que du crédible, et le décalage de plus en plus grand, mais ils étaient à chaque fois approuvés par l’agence régionale de l’hospitalisation. On a continué comme cela sans véritable alerte, parce que les déficits n’apparaissaient pas formellement dans les budgets. De vive voix, M. Buisson nous disait benoîtement ce qu’il ne pouvait pas payer – il n’a pas acquitté la taxe sur les salaires pendant des années ! –, mais le représentant de l’agence régionale de l’hospitalisation ne réagissait pas. C’était assez irréaliste. C’est dans ce contexte que j’ai refusé de voter un budget. Tout le monde a fini par savoir, les administrateurs y compris, que le budget ne voulait rien dire, mais on votait, et devant l’agence régionale de l’hospitalisation !
M. le coprésident Jean Mallot. Qui bouchait le trou à la fin de l’année.
M. Emmanuel Lamy. Plus ou moins.
Il faut aussi comprendre que nous n’avions aucun élément d’analyse. Lorsque des missions ou des audits ont eu lieu, j’ai dit aux enquêteurs de s’adresser à la directrice financière de l’hôpital de Saint-Germain, Mlle Romano, en qui j’ai toute confiance et qui disposait des chiffres. Elle m’avait alerté sur la situation, mais M. Buisson lui a toujours interdit de parler.
M. Dominique Tian. Vous en êtes-vous entretenu avec Dominique Coudreau ?
M. Emmanuel Lamy. Non. Je le connaissais bien, nous avons été chef de bureau ensemble à la direction du budget mais, à l’époque, le dérapage n’était pas encore tellement perceptible.
M. Dominique Tian. Et avec son successeur ?
M. Emmanuel Lamy. Nos rapports ont très vite été très tendus.
M. Dominique Tian. Pourquoi la direction de l’hôpital a-t-elle été couverte pendant si longtemps ?
M. Emmanuel Lamy. Je n’en sais rien. Mon sentiment est qu’il existe une très forte consanguinité entre les personnes sorties de la même école de la santé et que, face aux politiques, ils se serrent les coudes. Mon combat premier a été de défendre l’intérêt du bassin de vie de Saint-Germain, plus grand arrondissement de France. Je me suis heurté avec les successeurs de Dominique Coudreau à des solidarités extrêmement fortes. J’ai très vite eu l’impression qu’ils laissaient toute latitude à M. Buisson en espérant qu’il arriverait à liquider Saint-Germain. J’ai eu de très mauvais rapports avec M. Ritter. J’étais en fait l’empêcheur de tourner en rond – de tout mettre à Poissy et de fermer Saint-Germain. Il a fallu aller plusieurs fois voir le ministre, souvent avec Pierre Morange, juste pour rétablir le principe de départ : une fusion sur deux sites équilibrés. J’ai accepté assez vite, contrairement à mon prédécesseur, l’organisation à laquelle nous finissons enfin par aboutir : le lourd à Poissy, le programmé et l’ambulatoire à Saint-Germain. Mais ce que M. Buisson voulait, sans jamais l’exprimer, c’est tout déplacer à Poissy.
M. le coprésident Jean Mallot. Vous êtes aujourd’hui le président de l’établissement. Il y a un nouveau directeur général. Un contrat d’objectifs et de moyens a été signé, même s’il prévoit un déficit récurrent. Comment pensez-vous améliorer les choses ?
M. Emmanuel Lamy. Je refuse de mélanger les responsabilités : je ne m’engage donc pas dans la gestion, qui demeure de la responsabilité exclusive de M. Chodorge. En revanche, je suis mieux informé et je ne vis plus un rapport d’agression permanent. Les conseils d’administration sont pacifiés. Cela n’aurait pas été possible sans le départ du précédent directeur, que j’ai demandé pendant des années. Pour l’anecdote, je préciserai qu’il a fallu qu’il soit promu et décoré de la Légion d’honneur pour partir, mais c’était un préalable absolu. Ensuite, je vous rappelle que l’hôpital était en retard sur l’informatique, la connaissance de l’activité, la gestion des recouvrements. Il fallait remettre tout cela à jour. C’est la première tâche que Gilbert Chodorge s’est donnée, et je le soutiens.
Je pense que le conseil d’administration s’était rendu compte que cette opposition entre les deux sites, cette agression permanente contre le maire de Saint-Germain ne pouvaient mener nulle part. Au départ, les deux maires devaient présider par alternance. Puis la loi a changé et il a fallu élire le président – M. Buisson n’a d’ailleurs pas appliqué tout de suite la nouvelle loi pour laisser M. Masdeu-Arus terminer son mandat, mais il me l’a opposée lorsque j’ai proposé de prolonger l’alternance d’un an pour régler la situation transitoire ! Quoi qu’il en soit, nous avons voté. J’avais contre moi la direction générale, le pouvoir médical, le pouvoir administratif et les représentants des médecins libéraux et des patients, puisque j’ « enquiquinais » toujours tout le monde mais, à la surprise générale, j’ai battu M. Masdeu-Arus, d’une voix. Cela prouve sans doute que le conseil d’administration voulait sortir de l’impasse.
M. le coprésident Jean Mallot. Peut-être aussi le vote à bulletin secret a-t-il pris tout son sens…
M. Emmanuel Lamy. Je ne sais pas. J’ai sans doute bénéficié des voix des représentants des usagers. Je n’exclus pas que le préfet ait fait exprès d’en désigner deux de Saint-Germain et un de Poissy…
Je ne vous ai pas parlé des innombrables rumeurs qui ont circulé concernant les marchés publics parce que je n’ai aucun élément à vous communiquer. Lorsque j’ai été élu président, des gens sont venus me voir en me racontant des choses sinistres et j’en ai fait part à l’agence régionale de l’hospitalisation. Cela s’arrête là.
M. le coprésident Jean Mallot. Le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) est édifiant !
M. Georges Colombier. Pour en revenir au départ de l’ancien directeur de l’établissement, je rappellerai qu’il n’y a malheureusement pas que chez vous que les gens sont promus et décorés pour laisser leur place.
M. Emmanuel Lamy. Je ne voudrais pas donner une fausse impression de M. Buisson. J’ai condamné ses méthodes, sa politique et, lâchons le mot, une collusion avec le pouvoir politique de Poissy, mais c’était un homme compétent. Il savait tenir son monde. Il était craint des médecins. C’était un vrai directeur, qui assumait ses fonctions avec autorité et compétence.
M. le coprésident Jean Mallot. Aujourd’hui, la fusion – au sens d’élimination des doublons – se poursuit et vous avez des perspectives d’installation sur un site unique, à Chambourcy. Cela ne serait-il pas le remède à un certain nombre de dysfonctionnements ?
M. Emmanuel Lamy. Premièrement, l’installation à Chambourcy est loin d’être acquise. Le centre hospitalier doit d’abord remplir certaines conditions, à commencer par le redressement de ses comptes. Il doit aussi dégager une marge d’autofinancement puisque l’aide de l’État dans le cadre du plan Hôpital 2012 ne consiste qu’à compenser le surcoût de frais financiers liés aux emprunts, pas à subventionner la construction. Pour financer cette construction, le centre hospitalier doit vendre ses actifs fonciers à Saint-Germain, en cœur de ville, qui valent extrêmement cher, et des actifs à Poissy, moins bien placés, qui valent cher. Encore faut-il que les deux maires ne dévalorisent pas ces terrains dans une autre optique, et que l’établissement de Poissy ne soit pas reconverti en site d’enseignement médical, ce qui nous priverait du produit de sa vente. Mais cela ne suffira pas. Or, et quels que soient les efforts de Gilbert Chodorge, je ne pense pas que l’hôpital puisse faire mieux que parvenir à l’équilibre – ce qui serait déjà formidable. Il n’aura pas de marges pour financer une implantation à Chambourcy. Cela ne peut donc venir que d’une décision politique, dans laquelle Pierre Morange aura un poids déterminant. Nous souhaitons tous que cette décision soit prise : le bassin de vie de Saint-Germain recouvre 350 000 habitants, celui de Poissy 300 000, soit plus que certains départements de province. Nous avons tous intérêt à éviter le report des patients vers Paris et vers le secteur privé. Mais je demeure sceptique sur la réalisation de cette implantation.
Deuxièmement, les affrontements n’ont pas disparu. Aujourd’hui, le directeur essaie de les apaiser, même si la balance penche toujours du côté de Poissy, surtout parmi le personnel médical. Aussitôt qu’il faut nommer un chef de service commun, c’est toujours Poissy qui l’emporte puisqu’ils ont la majorité. Supprimer les urgences et la réanimation à Saint-Germain, comme l’envisage le projet en cours, signerait la mort de notre hôpital. J’ai déjà fait voter à l’unanimité du conseil municipal une motion contre, mais le directeur de l’hôpital essaie d’avoir un point de vue médical. Je pense qu’on devrait tout de même éviter le clash.
Troisièmement, il n’y a pas de culture de l’hôpital unique, ni à Poissy, ni à Saint-Germain. Dès qu’il y a eu une menace sur les urgences et la réanimation à Saint-Germain, les chefs de service du site ont signé une pétition, même après dix ans et malgré mes efforts à la tête du conseil d’administration, où j’ai été réélu. Je soutiens Gilbert Chodorge et j’ai avec M. Métais des rapports beaucoup plus courtois. On peut imaginer aujourd’hui une répartition des rôles conforme aux souhaits de l’agence régionale de l’hospitalisation, avec les urgences et la réanimation à Poissy, et l’ambulatoire et le programmé à Saint-Germain.
Je ne défends pas mon clocher à tout prix et j’ai accepté le départ de nombreux services, notamment de la maternité – on ne naît plus dans le public à Saint-Germain – et de la cardiologie, mais je veux garder un hôpital de proximité, au moins jusqu’à Chambourcy.
Gilbert Chodorge a des qualités humaines, et il a lancé une indispensable modernisation de l’informatique pour mettre à jour l’information, connaître véritablement l’activité et pouvoir la facturer. L’agence régionale de l’hospitalisation paraît satisfaite. Mais il y aura encore des jours difficiles – je le dis même si je suis plus optimiste que par le passé.
Il n’est pas bon qu’un maire soit président du conseil d’administration d’un hôpital. C’est une évidence car il est pris en otage. Si, demain, on découvre un scandale sur les marchés, par exemple, le maire sera éclaboussé. Il est responsable, il prend des coups, mais sans rien contrôler du tout.
Une dernière anecdote : quand je présidais le conseil d’administration, les pouvoirs publics ont décidé de revenir au site unique. M. Buisson sait qu’il n’y a pas de terrain constructible à Saint-Germain mais il paye une étude très chère pour le faire dire. Il n’y en a pas non plus à Poissy, mais le député-maire de la ville suggère de faire un programme d’intérêt général, condamné d’avance, pour s’affranchir des règles locales d’urbanisme. Il me demande de convoquer un conseil d’administration pour entériner. Voyant le piège, j’use de mon seul pouvoir en refusant de signer les convocations. Jacques Masdeu-Arus vérifie que, dans pareil cas, c’est une majorité d’administrateurs qui doit demander la convocation du conseil. La veille, je reçois sur un fax de la mairie de Saint-Germain-en-Laye des convocations, mal rédigées et non signées. Je renonce à lancer une procédure mais, malgré la demande d’une majorité d’administrateurs, je refuse de les signer. M. Buisson est passé outre et le conseil d’administration, présidé par M. Masdeu-Arus, a sans surprise choisi Poissy. En cas de refus du président du conseil d’administration, c’est au patron de l’agence régionale de l’hospitalisation, de convoquer le conseil d’administration sur l’ordre du jour qu’il arrête. J’ai donc envoyé du papier bleu à Buisson, puis à l’agence régionale de l’hospitalisation pour faire invalider une délibération manifestement illégale. L’agence régionale de l’hospitalisation ne réagissant pas, j’en parle à Pierre Morange et nous allons voir le ministre qui, en présence de Jacques Masdeu-Arus, consent du bout des lèvres à dire que la convocation était illégale. Son attitude a d’ailleurs été le prélude à un nouveau changement de pied du Gouvernement. La seule excuse, ou plutôt la seule explication, que je trouve au comportement de M. Buisson est que l’acharnement qu’il mettait dans sa guerre contre moi et contre Saint-Germain ne lui permettait pas de faire de la gestion.
M. le coprésident Jean Mallot. Monsieur le maire, nous vous remercions.
*
Audition, à huis clos, sous forme de table ronde, de responsables de pôles médicaux et du président de la commission médicale d’établissement du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye : M. Jean-Pierre Gayno, chef du pôle « médecine interne et cardiovasculaire », M. Hervé Outin, chef du service de réanimation, président de la commission médicale d’établissement, M. Nicolas Simon, chef du pôle « urgences-réanimation-pédiatrie », et M. Nicolas Tabary, chef du pôle « chirurgie-anesthésie-bloc opératoire ».
M. le coprésident Jean Mallot. Nous accueillons maintenant M. Jean-Pierre Gayno, chef du pôle « médecine interne et cardiovasculaire », M. Hervé Outin, chef du service de réanimation et président de la commission médicale d’établissement, M. Nicolas Simon, chef du pôle « urgences-réanimation-pédiatrie », et M. Nicolas Tabary, chef du pôle « chirurgie-anesthésie-bloc opératoire ».
Messieurs, je vous remercie d’être venus jusqu’à nous et vous demande d’excuser l’absence de Pierre Morange, coprésident de la MECSS : il préside aujourd’hui un colloque.
Avant de vous laisser la parole, je dirai quelques mots sur la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale.
La MECSS travaille sur différents sujets selon les années, et elle a entrepris d’examiner le fonctionnement de l’hôpital en commençant par se pencher sur des cas concrets, parmi lesquels le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain, compte tenu de ses particularités que vous connaissez. Nous souhaitons aller au-delà des rapports et mieux saisir les raisons des dysfonctionnements qui l’ont conduit là où il est, afin d’en tirer des enseignements pour la politique à venir.
M. Hervé Outin, chef du service de réanimation, président de la commission médicale d’établissement. Le projet de fusion remonte à plus de douze ans. C’est vraiment très long, quand on compare à ce qui se fait dans l’industrie, et toute la communauté hospitalière trouve la situation très pénible. Cinq ministres de la santé successifs sont intervenus : Bernard Kouchner en 1998 ; Jean-François Mattei en septembre 2003 ; Philippe Douste-Blazy en octobre 2004 ; Xavier Bertrand en septembre 2005 ; et Roselyne Bachelot à plusieurs reprises, en particulier en 2008 pour officialiser le choix du site unique des Vergers de la Plaine prévu pour 2015. Dix-huit ans se seront écoulés depuis la décision de fusionner Poissy et Saint-Germain. Les rebondissements politiques successifs ont été très mal vécus par l’ensemble des personnels. La fusion a été décidée, puis annulée ; des travaux ont été suspendus à la suite de la mission Delanoë en 2003, concernant notamment la rénovation du bâtiment des urgences et de la réanimation, ce qui a considérablement gêné le fonctionnement de l’établissement et perturbé les regroupements ultérieurs.
On nous a toujours prêché la complémentarité. Nous nous y sommes essayés mais nous nous sommes heurtés à des oppositions nettes – opposition structurée de la part de la communauté médicale de Saint-Germain, qui défendait « son » hôpital avec des appuis extérieurs. Vous n’êtes pas sans savoir que les hommes politiques ont pesé dans cette affaire, à côté desquels nous nous sommes sentis comme des fétus de paille. Nous respectons les élus mais le problème est de savoir qui dirige : le directeur ou le politique ? La perspective de 2015 reste conditionnelle puisque nous avons un déficit considérable : quand Gilbert Chodorge est arrivé en 2007, le déficit annuel était de 44 millions d’euros. Nous espérons cette année le ramener à 24 millions ; nous avons du mal. Mon collègue s’acharne à restructurer les blocs opératoires, mais c’est extraordinairement compliqué dans un établissement bi-site. On rencontre des résistances, notamment de la part de chirurgiens, qu’il est très difficile d’éviter. L’objectif d’un déficit de 12 millions en 2010 sera très difficile à tenir.
Il faut nous aider à restructurer. Cela ne veut pas dire que rien n’a été fait, loin de là. La première grande opération a été le regroupement de la maternité et de la néonatologie en 2003. Elle s’est heurtée à de très fortes résistances de la part d’Emmanuel Lamy, qui estimait qu’il fallait une maternité publique à Saint-Germain. Le professeur Ville, qui est un homme énergique, a fini par réussir en 2004, malgré les prétendus risques pour la population qui ont été avancés. Je suis devenu président de la commission médicale d’établissement en 2005 et, immédiatement, j’ai fait procéder à l’unification des laboratoires. Ensuite, est venu le tour de la pédiatrie et de la cardiologie sous la direction de Marc Buisson, qui a été fort courageux. Tous les médecins spécialisés en pédiatrie et en cardiologie ont dû signer une lettre pour demander à exercer sur un même site en vue de concentrer les compétences et de diminuer le poids des gardes. La moindre ligne de garde coûte 170 000 euros. Or notre établissement en compte vingt. Les écueils ont été très nombreux, mais nous avons réussi. D’autres services ont été regroupés, tels que l’ORL et l’ophtalmologie, qui ont un chef de service unique. Sous la houlette de Nicolas Tabary, les blocs opératoires ont été unifiés récemment. Grâce à l’énergique M. Coudreau, de l’agence régionale d’hospitalisation, on a fermé les urgences la nuit à Saint-Germain, en dépit de manifestations hostiles. Des améliorations ont été apportées et les urgences fonctionnent, y compris à Saint-Germain, dont le rapport Delanoë avait pourtant préconisé la fermeture.
Les partenariats public-privé nous ont posé beaucoup de problèmes à cause de la très mauvaise volonté de nos interlocuteurs. Au cours des séances consacrées à l’élaboration des coopérations, on nous disait oui pour la permanence de soins au scanner, avant d’ajouter que le privé avait autre chose à faire que des gardes. À la rigueur, on voulait bien assurer une ou deux permanences par an. Dans ces conditions, il n’y a pas de convention qui tienne. Si les partenariats public-privé sont vides, ce n’est pas de notre fait. J’ignore les raisons de l’attitude des cliniques privées, mais j’ai vraiment eu l’impression que les partenaires privés voulaient le moins de lien possible avec nous pour s’affranchir de toute obligation envers le service public et, ainsi, mieux valoriser leur bien. Pourtant, des partenariats auraient été possibles, dans l’anesthésie notamment. On a essayé beaucoup de choses.
L’apogée de mon mandat a été la constitution des pôles. Vous n’imaginez pas les obstacles que j’ai rencontrés. Je me suis heurté à un groupement de médecins qui pensaient qu’il fallait absolument maintenir une organisation complète dans chaque hôpital. Je me suis battu pour introduire de la transversalité dans le dispositif. Celle-ci a des inconvénients, mais aussi des avantages. Sans elle, Nicolas Tabary ne pourrait pas optimiser l’activité chirurgicale, qui passe par une spécialisation des sites : les urgences et les interventions lourdes à Poissy, et la chirurgie ambulatoire et programmée à Saint-Germain. Mais l’application est difficile car il se trouve toujours des acteurs pour ne pas jouer le jeu. Il existe désormais sept pôles d’activité clinique. Ils sont tous transversaux, à l’exception de l’oncologie médicale et l’infectiologie, dont presque tous les services sont à Saint-Germain, sauf la gastro-entérologie. La périnatalité est aussi uni-site. On compte également deux pôles médico-techniques et trois pôles administratifs – projets, activités, ressources.
M. Nicolas Tabary, chef du pôle « chirurgie-anesthésie-bloc opératoire ». Le diagnostic est simple : deux hôpitaux, deux blocs trop petits l’un comme l’autre pour réunir l’activité chirurgicale ; donc des coûts de structure plus lourds à cause des doublons. Le projet du pôle consistait à différencier les deux blocs, l’un dédié à la chirurgie lourde et aux urgences, l’autre à la chirurgie ambulatoire et programmée. C’était faire abstraction de certaines personnes qui ne veulent pas changer de site. Quand il n’y a plus qu’un chef de service, c’est plus facile, mais il reste encore deux services de chirurgie viscérale qui ne veulent pas travailler ensemble, et même un Chef de pôle, avec un grand C, n’y peut pas grand-chose.
Le bicéphalisme n’est pas, malheureusement, la seule difficulté puisque, en orthopédie, nous n’avons pas de chef de service, aucun des deux responsables ne voulant assumer la responsabilité de l’autre site.
En outre, depuis douze ans que dure cette fusion, tout le monde sait qu’une décision signée, et même votée à l’unanimité en commission médicale d’établissement, peut être invalidée, et chacun continue à agir à sa guise. On avance malgré tout. Avec les départs à la retraite et l’arrivée de nouveaux venus, les mentalités évoluent et on espère petit à petit faire disparaître les doublons.
En dehors de ces blocages, nous nous sommes efforcés de rendre les blocs les plus efficients possible. La Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH) nous a énormément aidés. De chaque côté, il y a de l’activité et les gens travaillent, mais nous n’avons pratiquement pas d’éléments de comparaison quand on nous annonce que nous faisons 32 millions d’euros d’activité chirurgicale par an, mais 10 millions d’euros de déficit. Nous ne savons pas comment nous améliorer. Chaque hôpital mesure les choses à sa façon. Les chiffres proposés par la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers nous ont permis d’identifier l’organisation et l’occupation des salles sur lesquels nous avons travaillé. Tous les doublons ne sont pas éliminés, mais nous faisons 12 000 actes par an, 600 de plus que prévu au 1er octobre, avec en moyenne 150 salles de moins. L’amélioration est sensible.
La démographie du corps des anesthésistes est fragile. Il est difficile de recruter, les médecins sont de plus en plus âgés, et l’anesthésie est vraiment le goulet d’étranglement de l’activité chirurgicale, d’autant qu’il faut aussi des anesthésistes en maternité et périnatalité, où l’activité a tendance à augmenter.
Les avancées sont tangibles, mais elles sont trop lentes et nos structures sont trop petites. Un site unique et un bloc un peu plus grand – inutile qu’il soit deux fois plus grand que chacun des deux que nous avons – permettraient de regrouper la totalité des activités sur un seul site. Ce serait à mon avis le seul moyen d’accroître sensiblement l’efficience, par rapport aux petites améliorations que nous pouvons faire au quotidien.
M. Jean-Pierre Gayno, chef du pôle « médecine interne et cardiovasculaire ». Je suis le seul médecin saint-germanois ici, mais, de toute façon, je suis un peu à part. J’exerce la médecine à l’hôpital depuis près de trente ans. Nous avons subi trois ou quatre audits, et je trouve que c’est beaucoup. Nous y avons consacré beaucoup de temps et ce qui a été décidé n’a pas été appliqué.
M. le coprésident Jean Mallot. Par exemple ?
M. Jean-Pierre Gayno. Au départ, un audit avait recommandé de faire les urgences d’un côté et le programmé de l’autre. Cela ne s’est pas fait notamment à cause de réticences médicales. Il a été décidé ensuite de faire un hôpital unique. Après un énorme travail et beaucoup de dévouement de l’ancienne direction, on a pris sept ans de retard dans la fusion. Si la fusion avait eu lieu et n’avait pas rencontré toutes ces obstructions, notre établissement serait dans une situation meilleure, qu’il s’agisse des soins prodigués ou de ses finances.
M. le coprésident Jean Mallot. D’où ces obstructions venaient-elles ?
M. Jean-Pierre Gayno. Je ne sais pas. J’ai un gros problème pour comprendre qui décide dans les hôpitaux. La communauté médicale ? Les municipalités ? L’agence régionale de l’hospitalisation ? Le ministère ? En tout cas, c’est très long. Nous avons eu beaucoup de réunions très tendues, notamment avec ceux qui opposaient leur force d’inertie à la fusion. Mais il est très difficile de faire marcher un hôpital en sécurité – c’est l’essentiel pour nous, médecins – sur deux sites. Cela engendre inévitablement des surcoûts, si bien que la seule solution, qui me paraît évidente depuis bien longtemps, consiste en une fusion sur un seul site.
Nous avons du mal à recruter. Les gens sont fatigués d’être mobilisés en permanence autour de projets qui n’aboutissent pas. Et pas seulement les médecins ! Nous n’arrivons plus à recruter d’infirmières. J’y vois une conséquence de tout notre parcours.
Pour ce qui est de mon pôle, le projet est quasiment appliqué, ou sur le point de l’être, mais il n’est que transitoire, en attendant le futur hôpital de Chambourcy, si jamais il existe un jour.
M. le coprésident Jean Mallot. Vous en doutez ?
M. Jean-Pierre Gayno. J’espère profondément que Chambourcy verra le jour. Si la décision était prise et affichée une bonne fois pour toutes, ce serait bon pour le moral de l’établissement.
M. le coprésident Jean Mallot. Vous avez été échaudé…
M. Jean-Pierre Gayno. Comme je ne sais pas très bien comment cela fonctionne, je crains d’être à la merci d’un changement de ministre ou de maire…
M. Dominique Tian. À quoi attribuez-vous les retards ? À la commission médicale d’établissement ? Au pouvoir politique ?
M. Jean-Pierre Gayno. Ma réponse est oui. C’est vrai, les discussions sont vives en commission médicale d’établissement pour faire marcher un hôpital en sécurité sur deux sites. Il faut aussi comprendre les Saint-Germanois qui ont perdu plus que Poissy. Cela a créé un ressenti négatif, ce qui est compréhensible. Les médecins de Saint-Germain ont pesé, mais la décision politique n’a pas été prise. Quand on discute depuis vingt ans, il faut prendre la décision et ceux qui ne sont pas contents n’ont qu’à partir !
M. Dominique Tian. Mais l’idée du regroupement est-elle bonne ? Que chacun des deux sites soit entouré d’un bassin de population de 300 000 habitants au moins ne justifie-t-il pas l’existence de deux hôpitaux ?
M. Jean-Pierre Gayno. Ce n’est plus possible, pour des raisons financières.
M. Dominique Tian. À ce moment-là, ne sont-ce pas les cliniques privées qui vont en profiter, puisque vous ne pourrez pas prendre toutes les urgences ni la maternité, ainsi que les hôpitaux parisiens ?
M. Jean-Pierre Gayno. Je ne pense pas, vu de chez moi, dans ma spécialité.
M. le coprésident Jean Mallot. À l’origine, il y avait deux établissements qui avaient des budgets à peu près équilibrés. Puis on les a fusionnés, et un déficit très important est apparu. Comment l’expliquez-vous ?
Vous avez dit que la fusion impliquait, si l’on voulait garantir un fonctionnement sécurisé, des surcoûts.
M. Jean-Pierre Gayno. Non : les surcoûts auraient été les mêmes sans la fusion.
M. Hervé Outin. Le budget global fonctionnait différemment : on n’évaluait pas les déficits de la même manière. Avec l’arrivée de la tarification à l’activité, ils ont été dévoilés et objectivés. Désormais, il faut prouver que l’on a fait quelque chose avant d’être rémunéré. Résultat : le déficit est devenu flagrant. De nombreux établissements publics de santé se trouvent probablement dans la même situation.
Nos deux établissements disposaient d’une certaine cohérence. Pourquoi a-t-on décidé, en 1997, de les fusionner ? C’est Michel Péricard qui l’a souhaité, et qui a demandé un audit.
M. le coprésident Jean Mallot. Pourquoi ?
M. Hervé Outin. À l’époque, l’hôpital de Saint-Germain voyait son activité décliner ; c’était un établissement de moindre taille. L’hôpital de Poissy avait d’autres ambitions, avec six ou sept conventions hospitalo-universitaires. Depuis, les choses ont changé : Saint-Germain s’est étoffé grâce à l’arrivée de nouvelles compétences.
Structurellement, les deux établissements sont très différents : Saint-Germain est un hôpital « dans les murs », dont le personnel habite dans le voisinage, tandis que Poissy est un hôpital « hors les murs ».
Michel Péricard est décédé peu de temps après la fusion. Quel était son véritable dessein ? Seul Emmanuel Lamy pourrait vous le dire.
M. Jean-Pierre Gayno. C’est très simple : il pensait que l’hôpital de Saint-Germain était déclinant et qu’il fallait le protéger !
M. Nicolas Simon, chef du pôle « urgences-réanimation-pédiatrie ». La fusion résulte de sa réaction à chaud aux conclusions d’un audit d’Arthur Andersen qui prédisait la transformation de l’hôpital de Saint-Germain en hôpital de long séjour. Il faut savoir que Michel Péricard était très impliqué dans la vie de l’hôpital, dont il assurait de facto la direction : tout se décidait dans son bureau. Pour le sauver, il a annoncé sa fusion avec celui de Poissy. Personne n’était au courant, aucune étude de faisabilité n’avait été faite : il a fallu faire avec.
Était-ce justifié ? Avec le recul, je pense que non. On compte 600 000 habitants sur le bassin de vie de Poissy-Saint-Germain : il y avait largement la place pour deux hôpitaux. Moi qui suis « bi-site » – et le revendique –, je suis confronté au quotidien à deux structures, deux cultures, deux conceptions de l’existence. Saint-Germain, ce n’est pas la même chose que Poissy. Saint-Germain est un hôpital familial, où les liens interpersonnels sont très forts ; Poissy est une structure technocratique : on est là pour produire.
M. le coprésident Jean Mallot. Ils sont pourtant de taille similaire. À quoi tient cette différence ?
M. Nicolas Simon. Elle est en partie liée au recrutement.
En outre, les Saint-Germanois se sont sentis agressés par les Pisciacais et se sont repliés sur eux-mêmes. Quant aux Pisciacais, sûrs d’eux-mêmes, ils ne se sont pas sentis concernés et n’ont pas organisé de réunions de concertation.
À cela, sont venues s’ajouter d’autres difficultés : des injonctions de réussite provenant de la hiérarchie administrative, ainsi que des pressions politiques – au demeurant fort compréhensibles – visant à défendre l’hôpital de Saint-Germain.
M. le coprésident Jean Mallot. Bref, la situation était bloquée.
M. Nicolas Simon. Oui.
Malgré tout, les personnels ont relevé le défi de la fusion. Aujourd’hui, on ne peut plus faire marche arrière : les hôpitaux ont réellement fusionné. Toutefois, pour les personnes qui ont connu l’ancienne configuration, la fusion reste difficile à intérioriser et à vivre au quotidien. On est toujours de l’un ou de l’autre ; on continue à parler de « l’hôpital », et non du « site », de Poissy ou de Saint-Germain – et encore moins du « CHIPS » !
Il reste que nous avons un service à rendre à la population. Le regroupement sur un site tiers est la seule solution possible. Il s’agira d’une grosse structure, bénéficiant d’une bonne situation et d’une bonne accessibilité depuis les deux villes. Il n’existe plus d’opposition véritable à ce projet : les médecins qui auraient encore pu nourrir des arrière-pensées savent que, d’ici là, ils seront partis à la retraite.
M. Nicolas Tabary. En effet : comme, du fait de notre situation catastrophique, nous ne recrutons pas, le corps médical est vieillissant !
M. Nicolas Simon. La création du nouveau site provoquera un appel d’air.
Certes, il existe tout autour d’autres structures médicales relativement importantes. La clinique de Saint-Germain, dont on a fait des montagnes, est toutefois un petit établissement, actuellement en difficulté financière. Ce n’est pas un danger.
M. Hervé Outin. Elle détient 10 % des parts de marché, contre 47 % pour notre hôpital et 17 % pour la clinique de l’Europe.
M. le coprésident Jean Mallot. Le changement d’implantation géographique aura-t-il des conséquences sur la fréquentation de l’hôpital ?
M. Nicolas Simon. Pour l’instant, nous déplorons un taux de fuite d’environ 40 % : des patients qui devraient venir chez nous préfèrent aller se faire soigner à Paris. Il s’agit surtout de Saint-Germanois : le site de Poissy joue davantage le rôle d’un hôpital de proximité. Il faudrait que notre hôpital soit plus attractif.
M. Dominique Tian. Vous avez évoqué avec regret l’ancienne splendeur des hôpitaux, mais vous étiez à l’époque protégés par le budget global. On a tenté, sans grand succès, de mettre en place le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et la tarification à l’activité (T2A). Pourquoi la commission médicale d’établissement et la direction de l’hôpital ne se sont-elles pas attelées à la tâche plus vaillamment ?
M. Hervé Outin. La mise en œuvre de la T2A nécessite un système d’information parfaitement huilé. À l’époque de Marc Buisson, le système informatique n’était pas opérationnel. Durant la période d’intérim, Maurice Toullalan a essayé de mettre en cohérence le recueil des données et les dossiers médicaux en utilisant un même éditeur, mais ce fut au prix de dysfonctionnements. La nouvelle direction a jugé ce système inopportun et l’a modifié. Ces atermoiements ont désorganisé les choses.
M. Dominique Tian. Des personnes que nous avons auditionnées ont en outre évoqué une gestion administrative peu rigoureuse, avec des patients qui partent sans payer.
M. Hervé Outin. Il est habituel que les directeurs incriminent les médecins, en leur reprochant de ne pas coder correctement les actes médicaux !
Le système de la T2A exige un codage extrêmement rigoureux. Contrairement aux établissements à but lucratif, dans notre hôpital, le case-mix est très diversifié : nous enregistrons 350 groupes homogènes de malades (GHM) quand ils en comptent à peine 150. Le codage des actes est donc particulièrement complexe, d’autant que les règles changent d’une année sur l’autre. De surcroît, l’information doit ensuite être mise en cohérence avec le logiciel administratif – ce qui n’a pas été le cas. En conséquence, un grand nombre de dossiers n’ont pu être facturés. Quant aux consultations, il existe un service dédié à leur facturation, mais il rencontre lui aussi des difficultés informatiques.
Toujours est-il que la bonne volonté des médecins n’est pas en cause : nous ne faisons pas le codage plus mal qu’ailleurs. Il s’agit d’une opération particulièrement complexe, pour laquelle il existe même des logiciels d’apprentissage. On vous y apprend à « optimiser » les résultats. Ainsi, certains établissements à but lucratif multiplient les unités de surveillance continue, dont les moyens ne sont pas fixés par décret : ils peuvent prévoir une infirmière pour dix personnes, et ils font passer systématiquement les patients en surveillance post-interventionnelle, de manière à pouvoir les coder ensuite en unité de surveillance continue et toucher à chaque fois un supplément de 300 ou 400 euros. Nous refusons de verser dans ces pratiques malhonnêtes qui, un jour ou l’autre, viendront à la connaissance de la sécurité sociale.
Je suis pour ma part persuadé que la plupart des difficultés proviennent de la médiocrité du système d’information.
M. Nicolas Simon. Du temps de la dotation globale, moins il y avait de patients qui payaient, plus c’était intéressant pour l’hôpital, puisque l’on déduisait de la dotation tout ce qui était facturé, que ce soit encaissé ou non. Il était donc préférable de facturer le moins possible. Désormais, il faut remplacer ce « libre-service » par un « passage à la caisse » : cela ne peut se faire du jour au lendemain !
J’ai regardé comment procédaient les établissements privés. La clinique de Trappes, dont les activités d’urgence sont à peu près équivalentes aux nôtres, a affecté huit personnes au seul encaissement des passages aux urgences ; les contentieux sont traités directement, et rapidement, par une société spécialisée. La clinique rentre dans ses frais. À Poissy-Saint-Germain, nous n’avons que trois personnes pour accomplir cette tâche. Cela ne peut pas marcher ! Les moyens dont dispose l’hôpital public sont inadaptés à ce mode de fonctionnement.
Il y a quelques années, le responsable de la clientèle m’avait suggéré de demander leur carte d’identité aux personnes reçues aux urgences. J’avais refusé : je ne suis pas « flic ». Mais si l’on veut facturer une consultation, il faut bien connaître l’identité et l’adresse du patient ! Désormais, quand on reçoit un patient, la première chose à faire est de chercher à savoir ce qui l’amène, la seconde de lui demander sa carte d’identité et sa carte Vitale. Avant, on ne demandait rien aux gens, on les soignait. C’est un sacré changement !
Tout cela implique de nouveaux modes de gestion. Cela suppose aussi que les personnels médicaux modifient leurs pratiques dans un sens qui ne correspond pas forcément à leur conception du métier. Ils n’auront jamais la même rigueur qu’un agent administratif. Ce qu’il faudrait, c’est un investissement de départ afin d’embaucher du personnel dédié, nuit et jour, dimanche compris. Avec un déficit de 25 millions d’euros, nous en sommes bien incapables ! Du coup, nécessairement, cela prend du temps.
Ce n’est pas la faute de tel ou tel. On a changé de paradigme : avant, la santé était gratuite ; désormais, on tient compte de son coût. Il faut trouver des solutions.
M. le coprésident Jean Mallot. Cela suppose une mutation culturelle, la formation de tous les personnels, médicaux et non médicaux, aux modes de fonctionnement en vigueur, le recrutement de personnels dédiés à de nouvelles tâches et des systèmes d’information performants : bref, il y a tout à refaire !
M. Nicolas Simon. Et il faut de l’argent ! Normalement, un système d’information représente de 10 à 12 % du budget pour l’investissement de départ, puis de 4 à 6 % pour l’entretien. À Poissy-Saint-Germain, on atteint au mieux 1 % : cela ne peut pas fonctionner !
M. Jean-Pierre Gayno. En tant que chefs de pôles, nous avons besoin d’éléments financiers. Actuellement, il n’existe qu’un embryon d’analyse médico-économique. Les médecins progressent en ce domaine : si nous n’avons pas de formation économique, nous sommes capables de raisonner en termes de rapport à l’activité. Mais nous ne pouvons pas tout faire en même temps. La priorité, pour l’instant, est la diminution du déficit. En ce qui concerne l’organisation des pôles, il reste beaucoup à faire : par exemple, il n’y a pas de délégation de gestion, ni de véritable analyse économique du fonctionnement. Les frais de structure sont effrayants !
M. Dominique Tian. À quoi est-ce dû ?
M. Jean-Pierre Gayno. Nous aimerions bien le savoir…
M. Nicolas Tabary. Personne ne peut nous répondre !
M. Jean-Pierre Gayno. Nous avons des missions d’intérêt général. Par exemple, pour ce qui concerne la prison de Poissy, nous sommes déficitaires de 150 000 euros ; mais il m’a fallu un an pour savoir combien nous recevions au titre de cette activité.
M. Dominique Tian. La Cour des comptes a réalisé un audit sur l’hôpital. N’en avez-vous pas discuté en commission médicale d’établissement ou en conseil d’administration ? Ne disposez-vous pas d’outils de gestion permettant d’analyser la situation économique de l’établissement ?
M. Hervé Outin. En 2008 a été mis en place un compte de résultat analytique (CREA), mais il n’a pas été diffusé à l’ensemble de l’établissement, car la direction des affaires financières peine à analyser la totalité des éléments. En conséquence, nous n’aurons pas de véritable outil de pilotage ni de données économiques précises pour 2009. C’est très embarrassant. Résultat : dans les réunions, j’en suis réduit à donner des chiffres globaux : 32 millions d’euros d’activité et 10 millions d’euros de déficit.
M. Nicolas Tabary. Sans que l’on sache exactement à quoi ces chiffres correspondent : les déficits sont répartis partout, mais nous ignorons où le bât blesse. Un chirurgien m’a dit qu’avec notre clé de répartition, chaque fois qu’il réalisait un acte, il générait du déficit. Il ne lui reste plus qu’à arrêter de travailler !
M. Jean-Pierre Gayno. C’est démoralisant !
M. Hervé Outin. Un exemple a été popularisé par une émission de télévision : dans une matinée, le même chirurgien faisait huit opérations de la cataracte dans une clinique, mais seulement deux dans une autre, tellement l’organisation y était mauvaise ! Chez nous, le service d’ophtalmologie tourne bien : on opère six cataractes dans une matinée, la chef de service est très active, elle assure des consultations – bien qu’à l’hôpital celles-ci, comme tous les actes intellectuels en général, soient honteusement sous-payées –, le recrutement est bon, le matériel aussi, et pour un coût raisonnable. Les frais induits par la répartition sur deux sites ne sont pas trop élevés. Pourtant, cette spécialité, qui est rentable dans tous les établissements privés, ne l’est pas à l’hôpital de Poissy-Saint-Germain ! Nous ne comprenons pas pourquoi. Et c’est la même chose pour le service de maladies infectieuses. C’est décourageant !
M. Jean-Pierre Gayno. Quand vous avez l’impression de bien faire votre travail et que l’on ne cesse de vous dire, depuis dix ans, que vous êtes financièrement mauvais, c’est pénible. Il existe une réelle souffrance des personnels médicaux et paramédicaux, parce que la fusion n’a pas abouti. Si nous travaillons dans la fonction publique, ce n’est pas pour l’argent, c’est un choix de vie ! Et quand on vous dit que vous coûtez 40 millions d’euros au contribuable, c’est démoralisant !
M. le coprésident Jean Mallot. En quoi est-ce lié à la fusion ?
M. Jean-Pierre Gayno. Je n’ai pas dit cela.
M. le coprésident Jean Mallot. Vous avez dit que les personnels étaient impatients de voir la fusion aboutir.
M. Jean-Pierre Gayno. Je pense que le fait d’être sur un seul site changera beaucoup de choses – mais peut-être n’est-ce qu’un leurre.
M. Dominique Tian. N’est-ce pas précisément le problème ? Vous attendez tout de la fusion, alors qu’elle ne résoudra pas l’ensemble des difficultés. Le renouvellement du personnel, par exemple, relève plutôt de la démographie médicale.
M. Nicolas Simon. Pour le coup, la fusion rendra l’hôpital plus attractif.
M. le coprésident Jean Mallot. Certes, mais la qualité des systèmes d’information ou la formation médico-économique des personnels n’ont rien à voir avec elle.
M. Jean-Pierre Gayno. Ce n’est pas de notre responsabilité.
M. le coprésident Jean Mallot. Mais vous êtes les utilisateurs !
M. Nicolas Tabary. Quand on établit le CREA, on voit que l’hôpital produit de l’activité, mais que les coûts de structure sont tellement importants qu’il est toujours déficitaire. On a essayé d’analyser le phénomène. Serait-ce dû à l’utilisation d’un matériel très coûteux ? Pourtant, deux chirurgiens travaillant de façons totalement différentes généreront le même déficit. Faute de CREA suffisamment finalisé, la seule explication possible, à l’heure actuelle, est que l’activité est répartie entre deux structures. La fusion sur un même site permettra de résorber les surcoûts liés aux doublons – du moins, c’est ce que nous espérons.
M. Hervé Outin. Certaines activités sont sous-financées, comme les missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation (MIGAC). Tout dépend de la négociation initiale, puis de la renégociation de ces activités. Par exemple, les services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) sont valorisés : on nous reverse les sommes correspondantes.
L’autre poste extrêmement important, ce sont les gardes et astreintes en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) – dont le budget s’élève à quelque 250 millions d’euros –, qui représentent pour notre établissement quelque 6,6 millions d’euros. Avec Jean-Yves Grall, qui était à l’époque conseiller auprès du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, nous avions essayé de limiter les gardes. Nous étions arrivés à la conclusion que l’on ne pouvait pas faire mieux. Les gardes ayant été débasées, on nous a alloué une somme d’environ 2,4 millions d’euros. Pour un établissement sur un seul site, ce serait acceptable, mais comme nous avons deux structures, cela constitue pour nous une perte sèche de 4 millions d’euros. Cela nous paraît une injustice criante !
M. le coprésident Jean Mallot. Que répond l’autorité de tutelle à ces arguments ?
M. Hervé Outin. Qu’elle les connaît déjà. C’est ainsi, elle se contente de nous renvoyer à nos résultats. D’ailleurs, notre autorité de tutelle dépend elle-même d’autres personnes placées encore plus haut…
Reste que nous sommes coincés par notre organisation structurelle. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons été autorisés à être « hors des clous ». Dans le cas contraire, il aurait fallu fermer un établissement.
M. le coprésident Jean Mallot. Les repères ne sont pas adaptés, mais on vous autorise à être hors des clous.
M. Hervé Outin. Des progrès importants ont tout de même été accomplis. Mais il est difficile de faire plus, et ce pour de multiples raisons. Nous pourrions en parler des heures durant tant la situation est compliquée.
Tous les acteurs de l’établissement sont très impliqués, mais il est extrêmement démotivant de se faire traiter de cancres alors que l’on essaie de se donner entièrement au service public. Certes, comme certains nous le disent parfois de façon inélégante, nous pourrions aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte. Mais nous croyons en ce que nous faisons. Nous pensons que notre établissement est de qualité et qu’il dispose de capacités importantes. Notre espoir est que les choses changeront quand le regroupement sur un site unique à Chambourcy sera définitivement engagé – mais certaines personnes mettent cela en doute, ce qui entretient la démotivation. Nous ne demandons qu’à y croire, pourtant.
M. le coprésident Jean Mallot. Merci pour votre participation très éclairante.
*
Audition, à huis clos, de M. Jacques Masdeu-Arus, ancien président du conseil d’administration du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
M. le coprésident Jean Mallot. Merci, monsieur Masdeu-Arus, d’avoir répondu à notre invitation.
Vous connaissez le rôle de notre mission. La MECSS a décidé cette année de consacrer ses travaux au fonctionnement de l’hôpital, l’objectif étant d’étudier des cas précis et éventuellement d’en tirer des enseignements généralisables. Le premier cas que nous avons choisi d’observer est celui du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Après avoir commencé à travailler à partir des documents fournis par l’agence régionale de l’hospitalisation, nous procédons à des auditions afin de mieux comprendre la situation économique et financière de cet établissement. Celle-ci trouve-t-elle son origine dans la fusion entre deux établissements décidée en 1997, ou au contraire dans l’absence de fusion – car sa réalité est l’objet d’un débat ?
Nous venons de parler à plusieurs chefs de pôle, et nous avons déjà auditionné l’ancien directeur général du Centre hospitalier, ainsi que le nouveau président du conseil d’administration. Notre but est de comprendre ce qui s’est passé et, le cas échéant, de faire des propositions pour améliorer la gestion des hôpitaux dans notre pays.
Je vous suggère donc de nous présenter votre propre vision des choses, après quoi nous vous poserons des questions.
M. Jacques Masdeu-Arus, ancien président du conseil d’administration du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Nous devons en revenir au début, c’est-à-dire à l’époque de Michel Péricard, lorsque nous avons pris conscience de la nécessité de fusionner ces deux hôpitaux distants de seulement sept kilomètres. Le premier objectif, à terme, était d’organiser des pôles d’excellence avant de regrouper les services sur un même site, de façon à supprimer les doublons et à faire des économies d’échelle. Les conclusions des multiples études menées par l’agence régionale de l’hospitalisation ou par le ministère allaient toutes dans ce sens. Mais au fil des ans, des difficultés sont apparues, tenant notamment à un conflit entre le personnel médical de Poissy et celui de Saint-Germain. Il ne s’agissait pas véritablement d’une concurrence, mais plutôt d’une hostilité au regroupement dans un site unique.
Les torts sont probablement partagés. Les deux hôpitaux sont différents : celui de Poissy est plus moderne, et son bâtiment de construction plus récente, tandis que la configuration du site de Saint-Germain et son ancienneté rendent son fonctionnement difficile.
M. le coprésident Jean Mallot. Lorsque la fusion a été envisagée, le choix entre les deux options – un site unique ou deux sites articulés entre eux – avait-il été clairement déterminé ?
M. Jacques Masdeu-Arus. On s’est très vite rendu compte qu’il fallait supprimer des doublons, sans quoi l’opération n’aurait pas eu de sens. Pour Michel Péricard et moi-même, il était clair qu’une fusion était nécessaire, mais peut-être en conservant deux sites.
M. le coprésident Jean Mallot. Tout le monde n’avait peut-être pas la même vision des choses.
M. Jacques Masdeu-Arus. Il y avait une ambiguïté. L’intention des équipes médicales, mais aussi des maires de Poissy et de Saint-Germain, était de trouver une organisation équilibrée entre les deux sites. Cependant, ce principe s’est vite heurté à des obstacles techniques. Ainsi, la maternité de Poissy était d’un niveau supérieur à celle de Saint-Germain, et il est vite apparu qu’il serait impossible, en raison de la résistance des équipes, de transférer la seconde sur le site de la première. Peu à peu, la situation s’est également détériorée dans d’autres services. Par exemple, avec l’autorité de tutelle, nous avons voulu faire comprendre aux médecins qu’il n’y avait aucun sens à conserver dans chaque site un service d’urgences ouvert en permanence. Il me semblait aller de soi que les urgences de nuit devaient être supprimées à Saint-Germain, mais cette vision, que Michel Péricard aurait certainement su imposer s’il avait vécu plus longtemps, s’est heurtée à une volonté farouche des équipes médicales de conserver les mêmes fonctions sur les deux sites. Dans le cas des urgences, cela posait un problème, dans la mesure où, faute de structures adaptées, certains patients déposés à Saint-Germain devaient parfois être transférés aux urgences de Poissy. Finalement, nous ne sommes pas parvenus à regrouper les deux services pendant la nuit. La même chose s’est passée pour les maternités. Nous avons fini par vendre une partie des installations de Saint-Germain à des cliniques privées pour conserver ce service.
L’ancien président de la commission médicale d’établissement, que j’ai croisé à l’instant, ou son prédécesseur, le docteur Renou, étaient pleinement conscients – comme d’ailleurs l’était l’agence régionale de l’hospitalisation – de la nécessité, pour supprimer les doublons, de fusionner les services, quitte à les répartir entre les deux sites. Mais ils ne sont pas parvenus à imposer cette idée. Les guerres intestines ont duré des années, et le conflit s’est transformé en un conflit entre les maires des deux communes. Les médecins maintenaient une forte pression sur le maire de Saint-Germain, lequel n’a pas eu la volonté d’imposer la fusion. Et le fait que chaque maire occupait en alternance la présidence du conseil d’administration n’a pas arrangé les choses.
M. le coprésident Jean Mallot. Tout cela peut expliquer le blocage, pendant de longues années, du processus de regroupement des deux hôpitaux. Mais qu’en est-il du déficit structurel que connaît le Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ? Au départ, chacun des deux établissements qui le constituent n’était pas en mauvaise santé financière. Pourquoi sont-ils devenus déficitaires ?
M. Jacques Masdeu-Arus. Une raison est que des investissements ont été effectués sur les deux sites, ce que le regroupement en un seul lieu aurait permis d’éviter. Il fallait effectuer des travaux à Poissy et à Saint-Germain, acquérir le même matériel en double, etc.
M. le coprésident Jean Mallot. Ainsi, non seulement on n’a pas su réduire le nombre de doublons, mais on a eu tendance à l’augmenter !
M. Jacques Masdeu-Arus. C’est certain. Dans le domaine de l’imagerie médicale, par exemple, il fallait acheter deux fois le même matériel : IRM, scanners…
M. Dominique Tian. D’après les audits qui ont été réalisés et les propos des personnes que nous avons auditionnées, la gestion de l’hôpital n’était pas très efficiente. Les gens avaient, semble-t-il, l’habitude de partir sans payer, sans que l’on s’en préoccupe véritablement, le système informatique était apparemment déficient, la mise en place de la T2A était sans cesse retardée, l’information manquait. Les médecins que nous avons reçus nous ont dit avoir ignoré l’ampleur du déficit ; selon eux, il n’y avait pas véritablement de volonté d’y remédier.
M. Jacques Masdeu-Arus. Il était impossible d’ignorer l’ampleur du déficit, car les chiffres nous étaient communiqués à chaque conseil d’administration, mais je ne pourrais dire s’ils étaient corrects. Et si la fusion n’était pas accomplie sur le plan physique, elle l’était du point de vue de la gestion. Les comptes portaient donc sur l’activité des deux sites – ils n’étaient pas différenciés.
M. le coprésident Jean Mallot. On peut comprendre qu’en tant que président du conseil d’administration, vous n’ayez pas disposé de tous les éléments – même si l’on peut aussi trouver cela regrettable. Mais les chiffres qui auraient permis d’y voir plus clair, existaient-ils quelque part ?
M. Jacques Masdeu-Arus. Bien sûr : la tutelle en disposait. Nous travaillions en permanence avec l’agence régionale de l’hospitalisation. L’agence ayant fortement abondé le budget de l’hôpital, je suppose que les comptes étaient vérifiés. Régulièrement, les directeurs y allaient pour réclamer de l’argent afin de payer le personnel et les fournisseurs.
M. Dominique Tian. Ce qui est étonnant, c’est que la réunion de deux hôpitaux en relatif équilibre – l’un était excédentaire, l’autre en léger déficit – ait finalement donné naissance à un établissement dont le déficit atteint 40 millions. Alors que la fusion était destinée à faire des économies, on s’aperçoit qu’au contraire la situation financière tend à déraper. En outre, selon les médecins que nous venons de rencontrer, le personnel est démotivé, parce que même lorsqu’une activité leur semble financièrement optimisée et correspondre à un besoin réel, la direction estime qu’elle coûte trop cher. Il en est ainsi du service d’ophtalmologie : les médecins estiment qu’il est de très haut niveau, alors que la direction rétorque qu’il est gravement déficitaire. Il semble que la gestion de l’hôpital souffre d’un manque d’explications.
M. Jacques Masdeu-Arus. Dans ce domaine, je n’étais pas compétent. Je n’avais accès qu’aux documents présentés au conseil d’administration, où tout le monde était présent – représentants de l’agence régionale de l’hospitalisation, des deux sites, entre autres. Mais je ne saurais dire si l’informatique était déficiente ou si l’on ne facturait pas suffisamment. Je sais seulement que l’application de la T2A a posé des problèmes.
M. le coprésident Jean Mallot. Le fait que certaines prestations n’étaient pas facturées était-il évoqué au sein du conseil d’administration ? Cela pourrait expliquer le déficit.
M. Jacques Masdeu-Arus. Mon analyse est que des coûts trop importants sur le site par rapport à l’exploitation expliquent mieux le déficit que les factures impayées.
M. le coprésident Jean Mallot. Certes, les coûts de fonctionnement sont supérieurs aux recettes. Mais deux autres phénomènes peuvent expliquer le déficit : d’abord, une part importante des prestations – jusqu’à 15 %, nous a-t-on dit – n’étaient pas facturées ; ensuite, quand elles l’étaient, les créances n’étaient pas toujours recouvrées. Je suppose que la question a été abordée au conseil d’administration.
M. Jacques Masdeu-Arus. En effet. Mais si nous connaissions l’ampleur du déficit, nous ne dispositions pas des détails. Nous ne savions pas quelle part pouvait être attribuée aux défauts de paiement, au fonctionnement ou même à l’investissement.
M. le coprésident Jean Mallot. L’établissement a été soumis à des audits et a dû suivre à plusieurs reprises des plans de retour à l’équilibre financier imposé par l’agence régionale de l’hospitalisation – même si celle-ci finissait toujours par combler le déficit à la fin de l’année. Dans ces conditions, le moment ne vient-il pas où le conseil d’administration doit s’interroger sur les causes du problème et les moyens d’y remédier ?
M. Jacques Masdeu-Arus. Il faudrait consulter les procès-verbaux des réunions, qui ont été conservés aux archives. Mais nous avions conscience des dysfonctionnements provoqués par l’existence de deux sites. De mon point de vue, conserver Saint-Germain n’avait pas de sens, car tout y est plus compliqué : il faut plus de personnel pour transporter les malades, et les frais d’entretien, notamment de chauffage, y sont plus élevés. Par ailleurs, l’activité privée sur le site de Saint-Germain était loin d’être négligeable – un médecin a d’ailleurs dû quitter l’hôpital pour cette raison. Je ne connais pas la part respective des activités publiques et des activités privées – la tutelle a les chiffres –, mais cet aspect a toujours posé problème à Saint-Germain. D’une manière générale, il était difficile de gérer le personnel médical de ce site – surtout les médecins.
Quant aux gens qui partaient sans payer, je ne sais pas si le phénomène avait plus d’ampleur au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye que dans d’autres établissements. Il est vrai que le département compte de nombreux gens du voyage. J’ignore par ailleurs si le paiement des prestations finissait par être recouvré, et au bout de quel délai.
M. le coprésident Jean Mallot. Vous pouvez peut-être nous éclairer sur le processus de décision. Pendant une période allant au moins de 1997 à 2007, l’établissement a connu une situation dans laquelle la fusion, bien que décidée, n’était pas réalisée dans les faits. Un jour on parlait de supprimer les doublons, le lendemain on jugeait préférable de regrouper tout sur le même site, et ainsi de suite. Pendant ce temps, le déficit structurel perdurait et le personnel était malheureux. Comment expliquer qu’à aucun moment la question n’ait été définitivement tranchée ?
M. Jacques Masdeu-Arus. À mon avis, la décision ne pouvait pas être prise par le conseil d’administration de l’hôpital ; seule la tutelle aurait pu la prendre. Et c’est ce qui s’est produit, d’une certaine façon, puisqu’une étude sur la réalisation d’un nouveau site a été lancée et que l’on a commencé à rechercher un terrain disponible. On a parlé de Fourqueux, de Saint-Germain, de Poissy, de Chambourcy. Mais nous avons joué de malchance : à Poissy, un terrain était disponible, mais situé dans la « coulée verte », ce qui rendait nécessaire l’adoption d’un projet d’intérêt général. Un préfet a lancé la procédure, mais son successeur n’a pas persévéré. Même lorsque le ministère a pris la décision de tout regrouper sur un site unique, les choses ont continué de traîner. Selon moi, il a manqué une volonté politique forte, car ce genre de décision doit être pris rapidement et fermement. Le secteur industriel en donne un bon exemple : quand Peugeot a décidé de conserver le site de Poissy, il a « mis le paquet » et fait en sorte que l’usine soit l’une des plus modernes du groupe. Et c’est dans la même ville, au sein de son nouveau siège opérationnel, que PSA a décidé de regrouper plusieurs directions. Une entreprise qui ne se restructure pas finit par mourir. Bien sûr, un tel regroupement entraîne une réduction du personnel, mais on réalise ainsi des économies d’échelle.
S’agissant du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, un des projets de regroupement a été abandonné au prétexte que le terrain était situé entre l’A 14 et la RN 13, et qu’il aurait fallu une importante isolation phonique ; un autre s’est heurté à d’importantes manifestations ; le troisième dépendait de l’adoption d’un projet d’intérêt général (PIG). On a aussi envisagé le site de la Plaine de la Jonction, mais il est classé. Tous ces événements ont entraîné des pertes de temps considérable. Aujourd’hui, la décision a été enfin prise de construire l’hôpital à Chambourcy, entre l’A 14 et la RN 13 ! C’est étonnant : ce qui n’était pas envisageable, il y a dix ans, à cause du bruit et de la pollution, est désormais possible, tandis que les médecins de Saint-Germain acceptent aujourd’hui de quitter leur bâtiment, ce qu’ils refusaient hier. Si l’on avait adopté notre proposition dès le départ, l’hôpital existerait aujourd’hui et nous aurions réduit depuis longtemps les frais de son fonctionnement.
Il faut admettre, à la décharge des personnels, que tous ces retards finissent par être décourageants, au point que d’éminents médecins, comme le professeur Ville, en sont venus à quitter le Centre hospitalier. Pourtant, la maternité de Poissy est de grande qualité : de niveau 3, elle accueille des malades venant de partout, certains par hélicoptère. Est-ce qu’une maternité d’un tel niveau coûte plus cher ? Est-ce qu’elle participe au déficit ? Je ne me suis pas posé la question : ce service est le fleuron de notre département !
Nous avons donc accumulé les problèmes : équipements à renouveler, personnels refusant de travailler sur un autre site, manifestations, par exemple.
M. le coprésident Jean Mallot. Si je résume, la fusion a été décidée sans que ses modalités soient clairement définies ; pendant dix ans, elle n’a pas fonctionné ; on n’est pas parvenu à éliminer les doublons ; le regroupement en un site était décidé un jour, abandonné le lendemain. En conséquence, le personnel est malheureux, et une partie des patients va voir ailleurs…
M. Jacques Masdeu-Arus. La clinique de l’Europe a fait fortune !
M. le coprésident Jean Mallot. …l’équipe médicale n’est pas renouvelée et sa moyenne d’âge tend à augmenter. Bref, on a tout faux du début à la fin, mais rien ne se passe !
M. Jacques Masdeu-Arus. De nombreux ministres de la santé se sont succédé pendant la période. Ils subissaient des pressions de la part des élus locaux – tel mon voisin Pierre Morange –, et certains désavouaient leur prédécesseur. En outre, la mésentente régnait entre le maire de Saint-Germain et le député de la circonscription. Tous ces conflits contribuaient à bloquer la situation. Dans ces conditions, une entreprise privée aurait fermé depuis longtemps.
M. le coprésident Jean Mallot. Une entreprise privée ne pourrait pas compter sur l’agence régionale de l’hospitalisation pour combler chaque année son déficit.
M. Jacques Masdeu-Arus. En effet. Il s’agit d’un cas d’école. Mais si la situation est grave, elle ne l’est pas que sur le plan financier : le personnel souffre également.
M. le coprésident Jean Mallot. Tout cela nuit en effet à l’ambiance de l’établissement, d’autant qu’il faut y ajouter des rumeurs concernant la régularité des marchés publics. Nous avons d’ailleurs reçu un rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) à ce sujet.
M. Jacques Masdeu-Arus. Je suis surpris. Je n’ai jamais rien entendu de tel lorsque j’étais au conseil d’administration. Mais je ne siégeais pas à la commission des appels d’offres.
M. le coprésident Jean Mallot. Cela ne relève pas de notre compétence, de toute façon. En outre, cela ne peut pas expliquer le déficit, mais on peut l’interpréter comme un signe que la gestion de l’hôpital était plus souple qu’il n’aurait été souhaitable.
M. Dominique Tian. Tout le monde reconnaît en effet qu’un certain laxisme régnait dans la gestion de l’établissement.
M. Jacques Masdeu-Arus. Il faut dire qu’en attendant la construction d’un nouvel hôpital, il est nécessaire de maintenir l’équipement existant, fut-il obsolète, en parfait état, ce qui représente un coût de fonctionnement important. C’est la santé d’hommes et de femmes qui est en jeu. Or le site de Saint-Germain est un bâtiment historique, peu adapté. Les patients sont transportés sur des brancards et, en cas d’incendie, ils devraient être évacués par les toits. En raison de son architecture, le bâtiment n’est plus fonctionnel. Michel Péricard, qui voyait loin, l’avait d’ailleurs parfaitement compris. J’ai connu la même situation avec un centre de moyen et long séjour de Poissy, situé dans un bâtiment classé, et dont l’ascenseur ne pouvait accueillir une personne en position allongée. En cas d’incendie, il aurait fallu évacuer les malades par les escaliers.
M. le coprésident Jean Mallot. C’est troublant : pourquoi Michel Péricard a-t-il milité pour la fusion en sachant pertinemment que, du simple point de vue architectural, elle ne pourrait pas se faire à Saint-Germain ? Il ne devait certainement pas avoir envie de transporter l’hôpital à Poissy. Avait-il un site nouveau en perspective ? Si oui, où ?
M. Jacques Masdeu-Arus. C’était aussi une autre époque : les choses ont énormément évolué, et pas seulement au niveau technique. Il y a dix ou quinze ans, il n’y avait ni salles de bains ni toilettes dans la plupart des chambres, que le bâtiment soit classé ou non. Depuis, on a quasiment doublé les surfaces. Et peut-être Michel Péricard avait-il en tête que les praticiens vieillissants de Saint-Germain allaient être remplacés par de nouveaux, plus enclins aux changements.
M. le coprésident Jean Mallot. Au final, quelles leçons tirez-vous de cette expérience ?
M. Jacques Masdeu-Arus. Surtout qu’il est absolument impossible de fusionner sur deux sites. Il est possible de répartir les activités entre les deux, mais en veillant à les séparer strictement et à conserver toute la chaîne de matériel nécessaire en un seul endroit. Les appareils médicaux sont devenus tellement sophistiqués et onéreux qu’il n’est pas question d’avoir les mêmes sur les deux sites, pas plus que des professeurs faisant doublon. Mais le personnel d’un site ne doit pas être obligé de mettre les patients dans une ambulance à chaque fois qu’il a besoin d’un examen ! À ce propos, le va-et-vient actuel des ambulances représente sans doute quelques centaines de milliers d’euros par an. Le laboratoire étant installé à Poissy, on passe son temps à transporter de petites boîtes de sang.
Bref, on ne compte plus les inconvénients financiers de la fusion ! Songez aux deux services d’urgences de nuit : tous les directeurs ont voulu fermer celui de Saint-Germain, où personne n’allait et dont le coût pesait sur le budget, mais les médecins de Saint-Germain ont refusé. Je ne suis pas sûr qu’il n’existe pas encore. Ou alors l’arrivée de nouveaux médecins a-t-elle permis de changer les choses ?
Il a été décidé que Saint-Germain devienne un centre cancérologique de haut niveau. Il y a eu des investissements lourds et le matériel a commencé à arriver. Il pourra être transporté dans le futur hôpital. Mais, au final, la gestion sur deux sites se révèle vraiment très compliquée.
M. le coprésident Jean Mallot. Merci d’être venu nous donner toutes ces explications.
M. Jacques Masdeu-Arus. Tout se retrouve in extenso dans les comptes rendus des conseils d’administration.
*
AUDITIONS DU 5 NOVEMBRE 2009
Audition, à huis clos, de M. Gilbert Chodorge, directeur général du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur le directeur, je vous souhaite la bienvenue au nom de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), dont les auditions sont consacrées cette année au fonctionnement interne de l’hôpital, en partant de cas concrets. Nous avons choisi le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) dont la situation financière est extraordinairement dégradée. Le rapport de M. Paraire, directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), est particulièrement éclairant. Toutes les procédures, ou presque, d’appel d’offres des marchés publics qu’il a examinés sont entachées d’illégalité. Quelles sont selon vous les raisons qui ont conduit à cette situation et quelles actions avez-vous menées pour y remédier ?
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Dans quel état avez-vous trouvé cet établissement à votre arrivée il y a deux ans ?
M. Gilbert Chodorge, directeur général du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Je commencerai par un historique, celui de mon parcours professionnel et celui du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Pour comprendre le fonctionnement de l’hôpital, il faut remonter à l’ancien cadre législatif et à l’organisation qu’elle sous-tendait.
Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est le quatrième établissement que je dirige. Après l’École de la santé, j’ai d’abord été directeur à l’Assistance Publique, puis directeur-adjoint d’un hôpital psychiatrique de la région parisienne, avant de passer huit ans au ministère de la santé puis d’être successivement directeur des centres hospitaliers d’Orsay, de Belfort-Montbéliard – issu d’une fusion – et de Saint-Denis où l’on m’a proposé de prendre la direction du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
La situation, vous avez raison, y était complètement anormale. D’habitude, le déficit d’exploitation est de l’ordre de 3 ou 4 %. Au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, il était de 14 %. Je suis vraiment étonné que la presse spécialisée n’en ait jamais parlé. La situation devait être connue, au moins du cabinet de la ministre.
Une sorte de cogestion administrative et syndicale existe au niveau de la direction des hôpitaux et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). D’ordinaire, le président du conseil d’administration choisit le directeur. En l’espèce, Antoine Perrin, qui était le directeur-adjoint du cabinet de la ministre, m’a demandé de poser ma candidature. Il m’a même imposé contre le choix du président du conseil d’administration.
En arrivant le 15 octobre 2007, je m’aperçois assez rapidement que les comptes ne sont pas sincères. Il y avait un arriéré d’une dizaine d’années de taxe sur les salaires et nous avons dû emprunter pour rembourser. La semaine prochaine, je dois d’ailleurs me rendre pour la troisième fois au Conseil d’État, devant le comité de contentieux fiscal, pour éviter d’avoir à payer des pénalités. La direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines, qui doit contrôler les délibérations du conseil d’administration et les écritures, a dû être frappée de cécité trois ou quatre ans avant mon arrivée ! Le Trésor public également alors que, dans mes différents postes, j’avais été auditionné par les chambres régionales des comptes.
M. le coprésident Pierre Morange. Sur le plan des responsabilités, vous parlez du prédécesseur de M. Paraire, qui n’aurait pas joué son rôle, et de la chambre régionale des comptes ?
M. Gilbert Chodorge. La chambre régionale des comptes fait un contrôle a posteriori. Elle m’interroge aujourd’hui sur la gestion de M. Buisson. Il n’est pas question pour moi de personnaliser. Mais vous me comprenez à demi-mot.
M. le coprésident Pierre Morange. Qui était chargé du contrôle de légalité ?
M. Gilbert Chodorge. Il y a eu un premier plan de retour à l’équilibre, appelé alors contrat de retour à l’équilibre, qui couvrait les cinq années antérieures à 2007. De l’argent a été injecté, mais il n’y a eu aucun contrôle. Le plan était alors piloté par Maryse Lépée, à l’époque numéro deux de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) d’Île-de-France, et maintenant à la retraite. À Saint-Denis aussi, il y avait un plan de retour à l’équilibre, mais nous avions des réunions mensuelles de suivi. C’était la même agence régionale de l’hospitalisation, qui couvre les huit départements, et les mêmes fonctionnaires. Il y a eu des ordres politiques. Mais ce n’est pas à moi de tirer ces conclusions.
Une fois découvert le vrai déficit, je suis obligé de faire un vrai plan de retour à l’équilibre. Nous sommes passés ainsi de moins 39 millions à moins 23,6 millions cette année, sachant que l’on va nous demander de ramener le déficit à 10 ou 12 millions. Or les tarifs hospitaliers diminuent chaque année, si bien que la réduction de moitié du déficit – de 24 millions à 12 millions – représente un effort bien plus important que les seules 12 millions d’économies. Je suis véritablement dans une économie de guerre.
Quand je découvre que les comptes sont faux, personne ne m’aide vraiment. Je mets à l’écart Joséphine Romano, et je fais venir une collègue compétente, Gaëlle Fonlupt. À ce stade, la profession me met à l’écart et on me demande de quitter mon syndicat. Mon agence régionale de l’hospitalisation me soutient, mais parle de « broutilles » quand j’explique que les anciens adjoints n’ont pas fait leur travail. Quant au centre national de gestion, il a toujours défendu les adjoints incompétents pour les aider à ne pas perdre la face.
S’il y a une leçon à tirer, c’est qu’il ne suffit pas de changer le chef d’établissement défaillant – qui a tout de même été promu conseiller général des établissements de santé. Un hôpital, c’est une petite entreprise. Avec un budget de 260 millions, si vous n’avez pas de directeur financier, pas de responsable du personnel, pas de responsable de la logistique, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Avant de chercher les responsabilités, il faut chercher les causes des dysfonctionnements. Je ne suis pas meilleur que d’autres, mais je suis expérimenté. Si on change le chef d’établissement, il faut laisser le nouveau s’entourer de gens compétents.
Dans le premier plan de retour à l’équilibre, l’argent prélevé sur les crédits des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), votés dans le cadre de l’objectif national des dépenses de l’assurance maladie (ONDAM), n’a servi à rien, puisque le déficit a continué de s’accroître. Quant à M. Dogué, le directeur des ressources humaines, il a trouvé un poste dans un établissement voisin – un peu grâce à moi, selon lui, ce qui n’est pas faux. Quand on veut réorganiser, il faut déclencher une crise, comme l’a fait mon collègue qui est arrivé à Versailles en même temps que moi.
La tarification à l’activité (T2A) a révolutionné les compétences. Avant, un directeur d’hôpital ne se souciait pas de ses recettes, il ne se préoccupait que de ses dépenses. Aujourd’hui, j’ai une ligne de trésorerie de 20 millions, et tous les matins je dois faxer à ma banque avant dix heures mon besoin de trésorerie.
M. le coprésident Pierre Morange. Existe-t-il à votre connaissance des cas similaires au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ?
M. Gilbert Chodorge. Sur le plan national, je pense à Nancy, encore qu’une inflexion récente ait eu lieu ces deux dernières années, sous l’impulsion de Mme Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, qui cherche à nommer des gens compétents, en particulier, le nouveau directeur de Nancy.
M. le coprésident Pierre Morange. Et dans les Yvelines ?
M. Gilbert Chodorge. Il reste des établissements hors T2A : les établissements psychiatriques. Les établissements astreints à la T2A sont, eux, obligés de présenter des comptes sincères. Mon adjoint incompétent a été mis à la tête d’un hôpital psychiatrique.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous en dire plus ?
M. Gilbert Chodorge. J’ai déjà subi assez de pressions. Je dirai simplement que la profession est cogérée par les syndicats du ministère de la santé.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Tous les établissements ne sont pas déficitaires, même après avoir changé de mode de gestion. Au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, le déficit est en quelque sorte structurel. Vous êtes-vous interrogé, au-delà des incompétences, sur la fusion décidée en 1997 ?
M. Gilbert Chodorge. Au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, deux phénomènes se conjuguent.
Tout d’abord, un manque total de préparation au passage à la T2A. Dans sa sagesse, le législateur avait d’ailleurs prévu des paliers. Les cliniques, elles, facturent depuis toujours. Les hôpitaux, eux, vivaient de leur dotation globale, et recevaient des douzièmes. D’une façon générale, mes collègues ont géré, mais en surveillant les dépenses. Dans le cas précis, le chef d’établissement n’a pas suivi la révolution copernicienne de la T2A ; il ne s’occupait pas d’informatique. Les gens étaient peu adaptés, mais il y en a qu’on a pu recycler, par exemple l’ancienne directrice financière.
Ensuite, la persistance des difficultés, douze ans après la fusion. Que ce soit à Belfort-Montbéliard, ou à Quimper-Concarneau, seules les premières années ont été difficiles, après la mise en place d’une nouvelle administration. La fusion entre Poissy et Saint-Germain-en-Laye, décidée à l’initiative d’un homme, Michel Péricard, maire de Saint-Germain-en-Laye, et qui est décédé l’année suivant la décision, n’a pas été ensuite appuyée par une volonté politique, et la fusion est restée virtuelle : administrative, mais pas médicale. Les économies de frais de structure – un seul directeur financier, un seul directeur des achats,… – ne sont que la partie émergée de l’iceberg. L’important, ce sont les synergies médicales. Résultat : on a toutes les charges en double : gardes de nuit, réduction du temps de travail des médecins et des personnels, etc.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment est-on passé de deux établissements séparés à peu près en équilibre, à un établissement unique déficitaire ?
M. Gilbert Chodorge. Premièrement, les comptes étaient faux. Avant la T2A, le mot « déficit » n’avait pas de sens en raison de l’absence de sincérité dans les comptes. Pendant dix ans, on n’a pas payé la taxe sur les salaires. Dans le secteur privé, les commissaires aux comptes n’auraient pas certifié les comptes. Il aurait fallu aussi enregistrer les charges liées à la réduction du temps de travail dans un compte hors-bilan.
Deuxièmement, le directeur devait faire avec un budget global, c’est-à-dire passer son temps à récolter le plus de crédits possibles auprès de l’agence régionale de l’hospitalisation et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Reprenez les plaquettes éditées par mon prédécesseur. Elles vantaient un établissement de 1 500 ou 1 600 lits, le plus grand hôpital hors Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), aux équipements toujours nouveaux. La chute n’en a été que plus dure. C’était ce que le privé reprochait à l’hôpital public : l’équilibre n’était qu’apparent.
Les hôpitaux fonctionnaient parfaitement sous l’empire du budget global. Simplement, dans chaque région, certains vivaient au-dessus de leurs moyens. Le budget global créait une sorte d’économie de la rente. Je ne suis pas sûr d’ailleurs qu’au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, il y ait jamais eu un vrai équilibre comptable, puisque, déjà, on n’y payait pas la taxe sur les salaires. C’est en tout cas certainement à partir de 2000-2001 que les comptes se sont progressivement dégradés.
Troisièmement, la fusion n’aurait pas dû se faire avec les gens en place. Quand on m’a nommé à Montbéliard, le directeur auquel je succédais venait de partir en retraite et le directeur de Belfort était parti à Metz. Or, on a nommé à la tête du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye le directeur de Poissy. Quand on sait la sensibilité des élus locaux, des médecins, de la population, la seule conclusion qu’ils pouvaient en tirer c’est que Poissy avait absorbé Saint-Germain. Le maire de Saint-Germain continue d’ailleurs à me demander de le protéger de Poissy – un hôpital qui n’existe plus depuis douze ans ! Confier la responsabilité de la fusion à un des acteurs en place revient quasiment à la condamner.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons été frappés, à la suite de l’audition de M. Paraire, le directeur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, par l’insuffisance spectaculaire des recettes autres que budgétaires, et par le non-respect des procédures prévues par le code des marchés publics. Quelle est la part de la responsabilité de la fusion, confiée, de fait, à Poissy ?
M. Gilbert Chodorge. Que le directeur de Poissy soit devenu le directeur de l’ensemble a eu pour conséquence de le laisser en place pendant dix-neuf ans. C’est beaucoup. Je suis resté huit ans au poste que j’ai occupé le plus longtemps. Le principe devrait être le même que pour les préfets. Au bout de cinq ou six ans, en effet, la routine s’installe. Je crois savoir qu’il y a eu aussi des problèmes au niveau du partage de la présidence du conseil d’administration. L’impression que Poissy l’avait emporté s’est alors transformée en certitude.
En ce qui concerne la facturation, quand je quitte Belfort-Montbéliard en 2003 pour Saint-Denis, la T2A en est à ses prémices, mais la couverture maladie universelle (CMU) de base, la CMU complémentaire (CMUC) et l’aide médicale d’État pour les étrangers en situation irrégulière ont été mises en place. J’ai alors changé le système informatique – le sujet de l’informatique hospitalière mériterait d’ailleurs que vous vous y intéressiez – et créé des caisses décentralisées afin que les secrétariats médicaux prennent l’identité des gens. Nous sommes dans un pays où la couverture est presque universelle et où les syndicats répètent qu’ils ne veulent pas embêter les gens en les faisant payer. Mais à partir du moment où on impose une convergence entre le public et le privé, il faut que tout le monde paie, quitte, en contrepartie, à ouvrir des droits sociaux.
La Poste nous retourne tous les jours des factures avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Il faut donc s’assurer des coordonnées des gens car une carte Vitale peut s’emprunter ou se faire voler. Une application permet, en accord avec la Sécurité sociale, de vérifier, à partir de la carte Vitale, si les droits sociaux sont ouverts, système qui n’avait pas été mis en place à Poissy-Saint-Germain. Aussi, j’essaie avec la nouvelle équipe de direction et d’un consultant de former toutes les secrétaires médicales aux nouvelles règles de facturation pour faire payer les patients à la source. Avec le ticket modérateur, ils paient trois ou quatre euros. Sinon, ils reçoivent la facture six mois après à leur domicile et dans ces conditions, soit ils n’ont pas de droits sociaux et ils ne peuvent donc pas payer, sachant que le moindre séjour hospitalier coûte 5 000 ou 6 000 euros, soit ils laissent traîner, ce qui pèse sur la trésorerie et ce qui explique que le travail qui nous incombe soit dur, faute d’avoir été fait en temps utile.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. À quelle hauteur situez-vous la sous-facturation ?
M. Gilbert Chodorge. Il m’est difficile de vous répondre. Quand je suis arrivé, la décision avait déjà été prise de changer le système informatique à la fin de 2007. Mais il ne portait que sur les recettes, pas sur les dépenses. C’est ce qui explique le changement apporté depuis. Un logiciel, utilisé au sein de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), nous a ainsi permis de récupérer 7 ou 8 millions d’euros sur 2007 et 2008. On n’arrivera jamais à 100 %. Aujourd’hui, sur un budget de 260 millions d’euros, j’ai à peu près 100 millions d’euros de recettes T2A. Même si je recouvre 80 %, ce qui relève du miracle avec une organisation aussi chaotique, il me manquera 20 millions.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous voudrions y voir clair dans la gestion du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, mais nous voudrions pouvoir tirer des enseignements généralisables à d’autres établissements. Certains dysfonctionnements, ceux liés à la fusion ou aux insuffisances professionnelles, sont amplifiés par rapport à ce que l’on peut constater ailleurs. Mais d’autres sont, du moins peut-on l’espérer, plus spécifiques comme le non-respect de la réglementation souligné par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dans son rapport sur les marchés publics : sur dix-neuf marchés étudiés, quinze sont passibles du tribunal !
M. Gilbert Chodorge. Je le répète à mes adjoints, avec la T2A nous sommes tous directeurs des finances. Il ne suffit plus que le directeur des ressources humaines contrôle ses dépenses de personnel, l’économe ses dépenses d’économat, et ainsi de suite. Il faut pouvoir aider le médecin qui augmente son activité et ses recettes en lui fournissant plus de personnel et plus de matériel. C’est ce qu’on appelle le détour productif.
La direction des finances exerce désormais trois fonctions, souvent distinctes dans les grands CHU : la facturation-recouvrement, l’élaboration du budget et la tenue des comptes – fonction classique de la direction des finances – et le contrôle de gestion. Pour le moment, au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, seules les deux premières sont assurées respectivement par Mme Romano et par Gaëlle Fonlupt.
Le contrôle de gestion sert à connaître les coûts directs de chaque équipe médicale. Les coûts indirects étant plus difficile à cerner, j’ai embauché récemment deux contrôleurs de gestion, l’un qui vient d’un hôpital de Bretagne et l’autre, une jeune femme, qui sort d’une école de commerce. Aujourd’hui, de nombreux hôpitaux n’ont pas de contrôleur de gestion. Or, l’analyse médico-économique ne suffit pas, il faut la traduire en langage médical. Un cardiologue compte ses pontages coronariens, mais ne se préoccupe pas de savoir si l’on gaspille le combustible du chauffage. En T2A, l’étude nationale des coûts sert à calculer les tarifs, ce que ne comprennent pas certains médecins.
M. le coprésident Pierre Morange. S’agissant des appels d’offres, vous avez demandé un complément d’enquête à M. le directeur départemental de l’action sociale, M. Paraire, après les illégalités qu’il avait constatées sur les marchés, par exemple l’acquisition en 2007 par l’hôpital d’un matériel de radiothérapie datant de 1999, c’est-à-dire doté d’une technologie vieille de dix ans.
M. Gilbert Chodorge. Ce cas illustre la gestion des hôpitaux et la tutelle hospitalière. Quand j’arrive, je n’ai aucune raison de suspecter mes collègues. On m’a envoyé au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour rétablir l’équilibre financier sans que personne ne m’ait dit qu’il y avait un problème relatif aux marchés. Or voilà qu’en me rendant à une conférence sanitaire de secteur, l’inspecteur principal m’annonce que ses membres ont convoqué la directrice-adjointe chargée des services économiques pour lui demander des explications sur les marchés. C’est la première fois en trente ans d’expérience que je vois convoquer quelqu’un pour lui demander des comptes sur les marchés, sans prévenir son patron !
Quelques mois plus tard – c’est là que je me suis définitivement fait mal voir de ma profession alors que je ne faisais que constater une pratique inhabituelle – j’ai demandé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d’intervenir. Il a fallu changer les serrures parce que les pièces disparaissaient et que l’on retrouvait des boîtes d’archives vides. M. Paraire m’a dit pour sa part qu’il transmettrait au procureur. Cela fait presque six mois, et il ne s’est rien passé.
Je prendrai un exemple. Depuis août, une machine quasiment neuve, puisqu’elle était en service depuis dix-huit mois, connaissait des pannes répétées avant de tomber définitivement en panne. La tutelle me demandant des comptes à propos d’une machine mise en route un mois et demi avant mon arrivée, je fais alors rechercher l’ensemble du dossier. C’est là que je me rends compte que certaines boîtes étaient vides. Selon l’historique, la commission d’appel d’offres avait procédé à l’ouverture des plis en septembre 1999 pour deux machines, avant que la commission compétente en matière de choix ne siège en novembre. Les deux machines étaient destinées au service de radiothérapie qui devait ouvrir en 2001 à Poissy, projet qui fut par la suite abandonné. Autant pour l’hôpital à Chambourcy, je vais commencer à acheter les matériels six mois voire un an avant son ouverture, autant là on annonçait une ouverture en 2001 sans même avoir déposé de permis de construire ! Un acompte, au sujet duquel j’ai fait un rapport circonstancié, a pourtant été versé en 2002 à Siemens – choix logique puisque les négociations avaient principalement lieu avec cette société –, sachant qu’en novembre 1999, on était passé à un marché négocié après avoir jugé, en invoquant des options trop nombreuses, que les offres n’étaient pas comparables.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Quel est le prix de ces machines ?
M. Gilbert Chodorge. Aujourd’hui, elles valent 1,3 million chacune contre de l’ordre de 1 million à l’époque.
M. le coprésident Pierre Morange. Un acompte a donc été versé en 2002 pour un matériel qui reposait sur un concept flou.
M. Gilbert Chodorge. En 2005, le centre est construit à Saint-Germain-en-Laye, et le marché est confirmé pour un prix inchangé afin d’éviter un nouvel appel d’offres. Si le prix ne change pas – j’ai les lettres commerciales de Siemens –, c’est à cause des options : il y en a moins.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pourtant, tout était caduc en 2005. Il aurait fallu relancer le marché.
M. Gilbert Chodorge. En droit, vous avez raison. Il y a eu un échange de lettres commerciales entre l’hôpital et Siemens qui, « au nom des bonnes relations », a maintenu le prix. Début 2007, un avenant est alors rédigé par l’hôpital pour régulariser ce marché qui porte le numéro 2000-152, et Siemens signe le 30 juin 2007. Le centre ayant ouvert le 1er septembre, je suis persuadé que tout cela est antidaté. Je connais trop les fournisseurs pour ignorer qu’ils ne livrent pas une machine sans être assurés du paiement. Chez Siemens, il y a un contrôleur de gestion !
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Chez Siemens aussi, ils connaissent le code des marchés publics.
M. Gilbert Chodorge. On aurait pu aussi dire à Siemens que, depuis le versement de l’acompte, il y avait eu des améliorations technologiques et qu’on ne voulait plus de la vieille machine.
M. le président Jean Mallot, rapporteur. Entre-temps, un autre fournisseur aurait pu commercialiser une autre machine moins chère. Il fallait, sans hésiter, relancer l’appel d’offres.
M. Gilbert Chodorge. Nous sommes d’accord. La procédure de 1999 devrait être soumise à enquête. De toute façon, même si le marché initial avait été correct, ce qui s’est passé en 2005 et 2007 pose problème. Ce n’est pas à moi à accuser telle ou telle personne. Mais tout ça n’a pas été fait sans ordres. Je vois mal un adjoint décider. Alors, est-ce venu du président du conseil d’administration de l’époque, du directeur, de pressions industrielles et syndicales ? Je n’en sais rien. C’est pourquoi j’ai écrit pour demander à M. Paraire d’enquêter. On en revient au même malaise. Comment a-t-on pu laisser les choses se dégrader ainsi ? C’était Le Bateau Ivre.
Une fois nommé, je me suis adressé à l’agence régionale de l’hospitalisation, laquelle m’a adressé à un consultant, Capgemini, en me répétant qu’elle me soutenait. Il aurait fallu que le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation soit entendu par le conseil d’administration et demande aux élus d’arrêter les pressions. L’inspecteur principal que l’on m’a envoyé arrivait à peine à prendre la parole. S’il n’y a pas de volonté de l’administration et de l’ARH-ARS (agence régionale de santé) de mettre un terme aux déficits, il y en aura toujours. Pourtant, le retour à l’équilibre est possible.
Je n’attends qu’une chose de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), que le conseil de surveillance définisse une stratégie. Il ne s’agit pas d’écarter les élus, mais ce n’est pas à eux de passer les marchés et les écritures comptables. À l’agence régionale de santé d’élaborer la politique de santé régionale, et à nous de l’appliquer chacun dans notre domaine.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. On peut discuter des règles de responsabilité, mais, en tout état de cause, elles sont claires. Vous dites qu’il est possible de revenir à l’équilibre. Certes, mais on peut être en déficit pour des raisons respectables, à condition que la législation soit respectée, que les outils de gestion existent et qu’ils soient utilisés. Au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, on a vraiment l’impression que tout dysfonctionne.
M. Gilbert Chodorge. Nous sommes en train de remettre de l’ordre. Je dispose aujourd’hui d’un tableau de bord de trésorerie, d’un suivi des effectifs. À mon avis, le déficit caché était de l’ordre de 44 millions d’euros. On est passé à 30 millions, puis à 26 millions. Mais un claquement de doigts ne suffit pas. En 2009, on doit être à 80 % des objectifs. Quand je suis arrivé, j’avais l’impression d’être dans un pays du Sud. Le directeur des ressources humaines de l’époque, M. Michel Louis-Joseph Dogué, m’a expliqué qu’il ne suivait pas ses dépenses de personnel.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il ne voulait pas, ou il ne pouvait pas ?
M. Gilbert Chodorge. Il ne pouvait pas parce qu’il ne s’en donnait pas les moyens. Le seul outil à sa disposition, c’était sa cotisation aux œuvres sociales, calculée en pourcentage de la masse salariale.
M. le coprésident Pierre Morange. Pour information, ce monsieur vient d’être nommé directeur du centre hospitalier de Montesson.
M. Gilbert Chodorge. Il faut continuer à améliorer nos outils, mais c’est aussi un problème culturel. Quand nous sommes arrivés en décembre 2007, certains médecins, en commission médicale d’établissement, nous ont ri au nez. Cela faisait dix ans qu’on leur répétait que l’hôpital était en déficit et il ne se passait rien. Si Dexia, ma banque, me coupe ma ligne de crédit, je ne pourrai pas assurer la paye, mais je suis le seul à m’en inquiéter. Depuis mon arrivée, nous avons tenté d’instaurer un dialogue médico-économique, en mettant au point un compte de résultat par activité. Les tableaux de bord sont diffusés par notre intranet. Mais cela remonte à un semestre seulement.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur le directeur, nous prenons acte de vos efforts – et de vos résultats – pour redresser les comptes du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, après la dégradation spectaculaire de sa situation financière dans les années antérieures.
*
Audition, à huis clos, sous forme d’une table ronde, de responsables de pôles et de services administratifs du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye : Mme Gaëlle Fonlupt, responsable du pôle « activité », et Mme Joséphine Romano, directrice de la clientèle, M. Nicolas-Raphaël Fouque, responsable du pôle « ressources », et Mme Florence Ardilly, directrice des achats.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a choisi de s’intéresser au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (CHIPS), un établissement largement déficitaire, en espérant pouvoir en tirer quelques enseignements pour d’autres établissements, même si toutes ses caractéristiques ne sont pas généralisables.
Depuis deux ans, un nouveau directeur général a mis en place des outils de gestion pour remédier aux dysfonctionnements. À votre avis, d’où ceux-ci proviennent-ils ? Les difficultés semblent tenir à la fois de la méconnaissance, de l’opacité et même du non-respect des règles de droit puisqu’un rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales fait apparaître des pratiques qui relèvent de la justice.
Mme Gaëlle Fonlupt, responsable du pôle « activité ». Pour comprendre comment on a pu en arriver là, je commencerai par rapprocher les résultats affichés entre 2001 et 2006, pratiquement à l’équilibre, et les déficits réels tels que nous les avons calculés, avec la collègue qui m’a précédée à ce poste. Jusqu’en 2005, le résultat oscille autour de zéro. Il plonge brutalement à moins 26 millions en 2006. Je suis arrivée en novembre 2007, pour procéder à un audit financier.
En retraitant les chiffres, nous nous sommes aperçues, avec Joséphine Romano, que le résultat s’était dégradé petit à petit, de 2001 à 2006, le déficit passant de 2,3 millions à 26 millions en 2006, et à 27 millions en 2007. Je laisserai Mme Romano expliquer le pourquoi de cette politique d’affichage.
En tout état de cause, savoir qu’on va droit sur l’iceberg quand on n’a ni carte, ni boussole, n’aide pas. Aucun indicateur ne permettait de tirer le signal d’alarme. Seul un travail de comptable aurait permis de prendre la mesure de la gravité de la situation. Il aurait aussi fallu l’accepter.
Mme Joséphine Romano, directrice de la clientèle. L’écart constaté entre 2001 et 2007 provient de la non-prise en compte de l’ensemble des charges de l’établissement, et ce volontairement.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’entendez par là ?
Mme Joséphine Romano. Pour rendre le résultat acceptable, on n’a pas provisionné l’ensemble des dépenses, notamment la taxe sur les salaires et les provisions pour créances irrécouvrables. S’agissant de la première, nous étions un peu contraints et forcés parce qu’elle nous valait des pénalités ; s’agissant des secondes, c’était un ordre.
M. le coprésident Pierre Morange. De qui ?
Mme Joséphine Romano. Du directeur, parce que le résultat était diffusé.
M. le coprésident Pierre Morange. Personne d’autre ?
Mme Joséphine Romano. Non. Les dépenses ont continué à déraper. Du côté des recettes, nos différents systèmes informatiques n’étaient pas très performants et ils ne permettaient pas un suivi agressif des recettes. Quant au suivi des dépenses, il existait mais il a été très vite mis en défaut, et abandonné pour des raisons inconnues. Dès 2005, le suivi régulier des dépenses engagées n’a plus existé.
M. le coprésident Pierre Morange. Sur ordre, là aussi ?
Mme Joséphine Romano. Ce n’était pas un ordre. Il a été abandonné avec le temps. Le directeur financier ne peut pas engager de dépenses seules ; il a obligatoirement recours à ses collègues de la direction des ressources humaines et des services économiques. Il peut tout au plus suivre les amortissements et les provisions. La direction des ressources humaines ne suivait pas ses dépenses, elle se contentait des effectifs en équivalent temps plein (ETP). Même si les résultats étaient contre elle, même si je la prévenais qu’on dépensait de plus en plus, la réponse était : « Non, ce n’est pas possible. J’ai de moins en moins d’effectifs. » Quant aux dépenses pharmaceutiques et médicales, le suivi était fait, rigoureusement, tous les mois, avec l’équipe des services économiques. Mais il a été abandonné au gré des changements de poste. On n’a pas souhaité continuer à le faire. Et sans éléments, on ne peut pas faire.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Même si une certaine latitude existe, il y a tout de même des règles nationales de gestion. Les textes n’ont donc pas été respectés ?
Mme Joséphine Romano. Pour les reports de charges, c’est sûr.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Et même pour le suivi de la masse salariale.
Mme Joséphine Romano. Pour la masse salariale, chacun semblait vouloir être responsable de son domaine. Les financiers se faisaient traiter d’oiseaux de mauvais augure.
M. Nicolas-Raphaël Fouque, responsable du pôle « ressources ». Je confirme les propos de ma collègue, même si je n’étais pas présent à l’époque.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourriez-vous nous donner les noms des responsables des différentes divisions ?
M. Nicolas-Raphaël Fouque. Mon prédécesseur s’appelait Michel Louis-Joseph-Dogué. En arrivant, j’ai été nommé à la direction des finances et du contrôle de gestion, en tant qu’intérimaire, puis, un mois après, le 1er mars 2008, responsable de la direction des ressources humaines. Un des premiers constats que j’ai pu faire, c’était précisément le paradoxe apparent entre la diminution des effectifs et l’augmentation concomitante des coûts. Le solde des effectifs était négatif, mais ce n’était pas les « bons » effectifs qui diminuaient, puisqu’il s’agissait des personnels spécialisés, ceux qui, dans le cadre d’une tarification à l’activité, sont susceptibles de générer une activité. En revanche, le personnel non qualifié ou bien celui imputé sur les coûts de structure augmentait de façon conséquente. Par exemple, nos charges de structure sont de 27 % supérieures à ce qu’elles devraient être dans un établissement de la taille du nôtre. En outre, pour remplacer le personnel spécialisé et infirmier, on recourait massivement à l’intérim qui revient cher puisqu’à la rémunération du salarié – souvent plus élevée que celle des titulaires – s’ajoute le coût de l’intermédiation.
Quand je suis arrivé à la direction des ressources humaines, les dépenses d’intérim se chiffraient à 2,6 millions. Et si la tendance était restée la même, nous aurions terminé l’année à plus de 4 millions d’euros, ce qui aurait encore aggravé le déficit. D’ailleurs, à l’époque, le déficit prévisionnel atteignait 50 millions d’euros.
On a donc repyramidé les effectifs, et réexaminé le recours à l’intérim. Nous étions arrivés à des niveaux de 55 équivalents temps plein par mois. Aujourd’hui, nous oscillons entre 10 et 15. Le suivi en équivalents temps plein n’est pas un outil de pilotage pertinent, mais il est révélateur d’une méthode de travail en silo alors qu’il faut travailler en transversalité. C’est ce que souhaitait le nouveau directeur et c’est cette logique qui a guidé la restructuration de l’équipe de direction en pôles administratifs.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous voudrions aborder également les difficultés du secteur des achats puisque le directeur a demandé à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d’enquêter sur les marchés publics.
Mme Florence Ardilly, directrice des achats. Le service m’a été confié en septembre 2008. Et dès les premières semaines, j’ai constaté que la situation juridique était particulièrement préoccupante.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Si j’ai bien compris, vous n’étiez pas encombrée par les archives…
Mme Florence Ardilly. Ils jetaient les dossiers au bout de cinq ans.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Qui, « ils » ?
Mme Florence Ardilly. Je ne peux pas vous le dire car je ne connais pas l’historique. Mais la durée de conservation de dix ans n’était pas absolument respectée.
Les achats concernant les marchés de travaux sont gérés par la direction des travaux et je suis incapable de vous dire si elle conserve des archives. Je ne peux que constater ce qui se passait dans le service qui m’a été confié. Non seulement certains documents relatifs aux marchés n’avaient pas été conservés pendant dix ans, mais les dossiers étaient mélangés, parfois absents, même s’ils avaient moins de cinq ans. Surtout, je me suis rendu compte que les marchés étaient tacitement reconduits, que des recours intempestifs étaient faits aux marchés complémentaires, qu’il y avait parfois des actes d’engagement non signés, que certains achats étaient faits sans mise en concurrence, et que les seuils n’étaient pas respectés. Les procédures n’étaient pas conformes à la réglementation. Bref, tout le droit des marchés publics était…
M. le coprésident Pierre Morange. …violé.
Mme Florence Ardilly. Tout à fait.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Du début à la fin.
Mme Florence Ardilly. Les agents semblaient tout ignorer de la réglementation, ce qui m’a alertée puisqu’il y a des marchés importants, de plusieurs millions d’euros. Je suis certaine que les agents n’avaient jamais ouvert un code des marchés publics.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Et n’avaient jamais été formés non plus.
Mme Florence Ardilly. En effet.
M. le coprésident Pierre Morange. Et vous vous êtes ouverte de ce problème à votre prédécesseur.
Mme Florence Ardilly. Non, nous n’avons pas communiqué.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous voulez bien nous donner le nom de cette personne ?
Mme Florence Ardilly. Mme Patricia Colonnello.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous avez mis en place un outil pour suivre, si l’on peut dire, les « marchés » en cours.
Mme Florence Ardilly. Il a fallu cette année relancer tous les marchés, ce qui représente une tâche très importante. Nous en sommes cette année à 300 marchés. Il faut tout refaire dans l’urgence.
Il ne faut pas oublier non plus l’aspect économique. Sur le marché des transports sanitaires, nous avons ainsi constaté des dérives importantes.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourriez-vous nous donner des précisions sur ce marché ? Qui présidait la commission d’appel d’offres ? Comment était-elle composée ?
Mme Florence Ardilly. La commission consultative était composée de la présidente, Mme Viviane Humbert, d’un représentant syndical, administrateur suppléant, et du personnel en charge du dossier.
M. le coprésident Pierre Morange. Le marché porte sur 3 millions d’euros ?
Mme Florence Ardilly. En fait, sur 2 millions.
Il y avait quelques interrogations sur le prestataire qui était le même depuis très longtemps.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. C’est-à-dire ?
Mme Florence Ardilly. Je n’ai pas les documents pour pouvoir vous répondre, mais il nous a dit lui-même s’occuper de Poissy depuis 1962, sans interruption.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il n’y avait peut-être pas de concurrence.
Mme Florence Ardilly. J’ai été très étonnée de l’existence d’un seul prestataire. En tout cas, quand je suis arrivée en septembre, nous en étions au moment de la notification, après que la publicité eut été faite et la consultation lancée en mai. À l’époque, il y avait encore une commission d’appel d’offres en bonne et due forme – elles ont été supprimées par décret fin 2008.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourtant, il y a d’autres prestataires possibles.
Mme Florence Ardilly. En effet puisque cette fois-ci, trois soumissionnaires ont répondu. En tout état de cause, nous allons gagner de l’argent : 162 000 euros par an à peu près.
M. le coprésident Pierre Morange. Sur 2 millions, ce n’est pas négligeable.
Mme Florence Ardilly. Nous devrions récupérer aussi les transferts payés par l’établissement et qui auraient dû l’être par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), soit au minimum 200 000 euros. Le principe a été validé par la caisse. Autre point en discussion avec elle : la prise en charge des transferts définitifs aux urgences. Si la caisse accepte, nous recevrons 200 000 euros également.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourriez-vous nous préciser le déroulement de la nouvelle commission d’appel d’offres sur les transports sanitaires, présidée par Mme Viviane Humbert ?
Mme Florence Ardilly. Les critères de choix ont reposé à 55 % sur les qualités techniques et sur le respect de la réglementation, et, à 45 %, sur le prix. Les offres étaient à peu près équivalentes sur le plan technique. Le prestataire finalement retenu avait un petit avantage dans la mesure où ses véhicules étaient un peu plus récents. J’ai fait valoir à la précédente responsable qu’en termes de prix, cela n’avait rien à voir avec l’offre précédente : la prise en charge était de 50 euros au lieu de 63 euros et couvrait les trois premiers kilomètres, ce qui n’était pas le cas avant – il y avait alors surfacturation puisqu’on payait pour dix kilomètres un trajet de six kilomètres. J’ai cependant envoyé un courrier pour expliquer que l’avenant qui avait été signé entre la caisse primaire d’assurance maladie et les ambulanciers des Yvelines liait les parties.
M. le coprésident Pierre Morange. Je crois également que les deux réanimateurs qui auraient dû être rémunérés par l’entreprise de transports sanitaires l’étaient par le centre hospitalier, contrairement aux termes du marché initial.
Mme Florence Ardilly. Oui. Cette clause qui a été insérée est très curieuse. On devrait par ailleurs récupérer le montant des rémunérations pour les transports de réanimation et d’urgence.
M. le coprésident Pierre Morange. Depuis combien de temps n’ont-elles pas été versées ?
Mme Florence Ardilly. Je n’ai pas les documents. Ils ont été détruits, malheureusement. J’ai pu remonter cinq ans en arrière, ce qui fait un peu moins de 500 000 euros.
M. le coprésident Pierre Morange. Pour la première fois, l’appel d’offres s’est déroulé dans les conditions prévues par les textes.
Mme Florence Ardilly. Absolument.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. De toute façon, le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a été transmis au procureur. Nous n’avons pas l’intention de nous substituer à une quelconque juridiction, mais nous voudrions comprendre ce qui s’est passé et voir quels enseignements on peut en tirer pour l’ensemble des établissements. Certains dysfonctionnements sont, nous l’espérons, ponctuels. Les marchés ne sont pas gérés partout en France, comme ils l’ont été au centre hospitalier. Il reste qu’une part importante du déficit et des difficultés de gestion est vraisemblablement liée à son historique. L’établissement a connu une fusion, décidée en 1997, qui est loin d’être achevée. Quels dysfonctionnements avez-vous relevés ?
M. Nicolas-Raphaël Fouque. Ma collègue vient de vous expliquer ce qui avait été fait dans le secteur des achats. Dans celui des ressources humaines, nous avons enregistré, par rapport à l’exercice précédent, une diminution des dépenses de l’ordre de 4 millions d’euros sur le plan conjoncturel et de 5 millions d’euros sur le plan structurel. L’écart provient de l’apurement d’heures travaillées qui n’avaient jamais été provisionnées. La régularisation devrait être terminée à la fin de l’exercice 2009.
Je termine par les grandes actions entreprises dans mon secteur. Nous avons travaillé principalement sur un repyramidage des effectifs, sur les fonctions, sur une diminution de l’intérim. Nous avons réévalué nos coûts moyens, parce qu’ils étaient plus élevés que les moyennes nationale et régionale.
M. le coprésident Pierre Morange. De combien ?
M. Nicolas-Raphaël Fouque. Nous étions à 2 000 ou 3 000 euros au-dessus de l’équivalent temps plein moyen qui coûte à peu près 40 000 euros. La politique de la commission administrative paritaire était assez généreuse. Les possibilités qu’offraient les textes s’étaient progressivement transformées en devoirs. La prodigalité n’est plus de mise, et nous sommes revenus à des niveaux plus adaptés. Nous avions un taux de contractuels bien inférieur à la moyenne nationale. La mise en stage systématique et rapide ne permettait pas d’évaluer les prestations des agents, si bien que les sureffectifs dans les services étaient fréquents. Nous avions beaucoup de reclassements et les postes « productifs » au regard de la tarification à l’activité (T2A) n’étaient pas toujours pourvus par des personnes physiques.
Il a aussi fallu repenser notre politique vis-à-vis des écoles paramédicales puisque nous avons un déficit très important. Nous sommes donc en discussion avec le conseil régional à qui nous avons demandé un audit pour vérifier sur place et sur pièces la véracité de nos affirmations. Nous travaillons aussi sur les budgets annexes.
Mme Gaëlle Fonlupt. Concernant les dysfonctionnements passés et les corrections qui y ont été apportées, j’insisterai plus sur les finances et le recouvrement des recettes. Après ma prise de fonction, je me suis rapidement aperçue qu’il y avait un différentiel important entre l’activité réelle sur le terrain et celle facturée à l’assurance maladie ou au patient, de l’ordre de 10 millions d’euros par an.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment avez-vous fait cette évaluation ?
Mme Gaëlle Fonlupt. Grâce à un travail de fourmi. Nous sommes passés dans tous les services pour relever l’activité telle qu’elle était établie manuellement ou de manière artisanale, séjour par séjour, et avons comparé avec ce qui était facturé. Nous avons fait une valorisation au coût moyen d’un dossier. Rien que sur l’année 2008, nous avons pu recouvrer 4,8 millions, en facturant des choses qui ne l’étaient pas et en recouvrant des factures qui n’étaient pas honorées. Tous les services étaient concernés, qu’il s’agisse des passages aux urgences, qui n’étaient même pas enregistrés, ou des molécules onéreuses qui sont remboursables en sus du séjour et qui n’étaient pas, ou mal, facturées.
L’objectif qui nous est assigné par le plan de retour à l’équilibre financier conclu avec l’agence régionale de l’hospitalisation est de revenir à l’équilibre dans un délai de trois ans. L’état prévisionnel des dépenses et des recettes pour 2009 mentionne un rattrapage d’activité de 3,5 millions. À ce jour, nous en sommes aujourd’hui à 3,9 millions, ce qui prouve qu’il reste des marges de manœuvre. Le premier devoir de l’hôpital public est au minimum de valoriser l’intégralité de son activité, puisqu’il s’agit de sa principale source de financement.
La gestion des ressources humaines a permis de faire 4 millions d’euros d’économie sur l’année 2009.
De telles actions ne sont pas envisageables sans outils de contrôle de gestion. Autrement dit, elles n’auraient pas été possibles avant 2007 du fait de la défaillance du système d’information : absence totale d’interfaçage entre les logiciels, et absence de volonté d’y consacrer du temps et de l’argent de la part de la direction.
La première réforme qui a été mise en œuvre à l’été 2008 a consisté à reconsidérer intégralement le fichier commun de structures, qui découpe l’établissement en unités fonctionnelles, en centres de coût, pour pouvoir localiser les surcoûts et les sous-valorisations. C’est la première étape de la comptabilité analytique. Depuis, les premiers comptes de résultat par pôle et par service ont été édités en septembre 2008, pour l’année 2007, et à l’été 2009 pour l’année 2008. On s’est alors aperçu que les surcoûts n’étaient pas répartis de manière homogène, qu’ils étaient concentrés sur certains secteurs. C’est ce qui a permis d’orienter le plan de retour à l’équilibre financier. Il reste des marges de manœuvre importantes car le redressement qui nous est demandé ne peut pas s’accomplir en quelques semaines. Mais nous sommes sur la bonne voie.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les outils qui sont à votre disposition vous donnent-ils satisfaction ? Beaucoup d’établissements n’ont pas de système de comptabilité analytique.
Mme Gaëlle Fonlupt. Les comptes de résultat analytique par service sont l’aboutissement d’une démarche de comptabilité analytique. Ceux qui ont été diffusés pour l’année 2007 n’étaient pas très fiables. En revanche, ceux de 2008 sont fiabilisés à 95 %. Il reste quelques clefs de répartition à affiner, ce que nous sommes en train de faire. Nous avons désormais une image fiable de l’ensemble de l’établissement. Nous avons aussi sorti des tableaux de bord mensuels, pour gagner en réactivité infra-annuelle, et qui manquaient à l’établissement. Les outils de pilotage médico-économique faisaient défaut et empêchaient toute réactivité à court terme.
Depuis mars 2009, les services ont été, par vagues successives, destinataires de tableaux de bord mensuels qui retracent leur activité, l’intégralité des effectifs et des dépenses correspondantes – les consommations d’examens de laboratoire, d’imagerie, etc. Une synthèse retrace l’intégralité des recettes et des charges directes, plus les charges médico-techniques, qui donne, mois par mois, une image de la marge sur coût direct de chaque service.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment les services réagissent-ils ?
Mme Gaëlle Fonlupt. Plutôt favorablement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Que font-ils de ces informations ?
Mme Gaëlle Fonlupt. Le problème vient de ce que l’appropriation prend du temps. Et certains services ne se sont pas encore approprié ces outils. Après le déploiement, nous avons organisé des réunions de présentation dans les pôles et les services. Certains pôles sont très avancés, comme la périnatalité qui était le service pilote. Elle s’en sert au jour le jour et adapte sa gestion en fonction des résultats. D’autres pôles sont plus lents à s’y mettre.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous avez prévu un système de formation ?
Mme Gaëlle Fonlupt. Nous sommes présents à chaque réunion de pôle pour expliquer la démarche. J’ai conçu un guide méthodologique « Comment lire les comptes de résultat analytique » qui est distribué dans les pôles et qui se veut relativement pédagogique.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment expliquez-vous que tout ce que vous êtes en train de faire n’ait pas été fait plus tôt, alors que les établissements hospitaliers sont suivis par la tutelle, qu’il y a des inspections, que les règles du jeu existent ?
Mme Joséphine Romano. Avec le recul, je me rends compte que j’ai fait partie d’une équipe qui ne souhaitait pas parler d’argent, comme si l’argent était un gros mot.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous dites bien « qui ne souhaitait pas » ?
Mme Joséphine Romano. L’équipe ne souhaitait pas parler d’argent. Quand j’arrivais avec des chiffres, j’étais accueillie par des « Tu vas encore nous parler d’argent ! ».
Mme Gaëlle Fonlupt. Je confirme.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Cette allergie, était-elle culturelle ou bien résultait-elle d’une volonté délibérée de préserver un mode de fonctionnement ?
Mme Joséphine Romano. Je pense qu’il s’agissait d’une volonté délibérée, mais il y avait aussi des lacunes.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Ce n’est pas la même chose.
Mme Joséphine Romano. Je pense qu’il y avait les deux. Il y avait une catégorie ancienne de directeur qui ne parlait pas d’argent parce que c’était la belle époque.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La culture de l’époque arrangeait tout le monde, en quelque sorte ?
Mme Joséphine Romano. Oui. C’est tellement plus facile de dire oui. Pardonnez-moi d’être aussi brutale, mais on ne pouvait pas parler d’argent en équipe de direction, a fortiori avec les médecins. Or comment aurions-nous pu les convaincre, si nous-mêmes n’étions pas convaincus ? C’était une question de culture. L’« argent » était un gros mot, je le répète, même si cela semble aberrant.
M. le coprésident Pierre Morange. En dehors de cette culture, qui fait fi de la bonne utilisation de l’argent public, il y a tout de même des problèmes de compétence professionnelle, y compris dans le corps des directeurs.
Mme Joséphine Romano. J’ai essayé de convaincre, mais je n’ai pas réussi. Et je crois avoir perdu du temps et du savoir-faire. On se lasse de se battre.
M. le coprésident Pierre Morange. On constate une absence d’outil de gestion, de volonté hiérarchique et politique de mettre au point les instruments qui auraient permis d’atteindre les objectifs.
Quelles ont été les réactions à l’arrivée de la nouvelle direction ? Avez-vous subi des pressions, suscité des réactions hostiles ?
M. Nicolas-Raphaël Fouque. Nous étions tels le messager grec porteur de mauvaises nouvelles, d’autant que la légitimité même du projet que nous incarnions était contestée. Il faut distinguer les réactions en interne, où il y a eu une prise de conscience générale que le niveau de dépenses n’était pas soutenable. Au début de l’année 2008, la situation n’était pas connue et les personnels, y compris les délégués syndicaux, pensaient en toute bonne foi que l’hôpital était à l’équilibre. Quand on leur a annoncé que le déficit se comptait en dizaines de millions d’euros, la surprise a été totale. Même si notre mission est essentiellement financière, elle porte en germe un projet d’établissement unique à vocation universitaire, qui est suffisamment porteur pour être un facteur de mobilisation.
M. le coprésident Pierre Morange. Et vous, madame Ardilly, avez-vous rencontré hostilités, pressions ?
Mme Florence Ardilly. Je ne parlerai pas de pressions. En revanche, il y a des habitudes bien ancrées qu’il faut modifier. Il était plus facile d’obtenir ce qu’on voulait avant qu’aujourd’hui. Comme le disait Joséphine Romano, c’est difficile de dire non, mais il le faut bien.
M. le coprésident Pierre Morange. Au fil des auditions, l’insuffisance des instruments de mesure a été soulignée de manière répétée. Elle est certes particulièrement flagrante au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Des anomalies ont été relevées dans les procédures d’appel d’offres, en particulier dans le rapport de M. Paraire dont la justice devra tirer les conséquences. Notre propos est de dépasser le cas particulier du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, et de favoriser la diffusion d’une culture plus vertueuse au service de la santé de la population en dégageant des enseignements. S’agissant de l’absence de comptabilité analytique, le cas de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n’est apparemment pas marginal.
Les insuffisances dans la facturation étaient largement connues des services de l’État, de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la chambre régionale des comptes et de l’agence régionale de l’hospitalisation. Chaque fois, on invoquait les défaillances de la comptabilité analytique, la culture des établissements de santé. La MECSS a du mal à se satisfaire de ses arguments, dans la mesure où on peut toujours faire appel, comme vous, à des prestataires extérieurs. Qu’en pensez-vous ?
Mme Joséphine Romano. Il faut de la volonté.
M. Nicolas-Raphaël Fouque. Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est le deuxième hôpital dans lequel j’interviens et c’est la deuxième restructuration à laquelle je participe puisque j’étais auparavant directeur-adjoint à Saint-Denis. L’établissement présentait un déficit, certes moins élevé, mais qui passait pour un des cas les plus difficiles de métropole. La restructuration a été menée à bien puisqu’on est passé d’un déficit de 5 % du chiffre d’affaires à une situation légèrement excédentaire. Le déficit du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est trois fois plus élevé proportionnellement et la tutelle nous a laissé le même délai, trois ans. À Saint-Denis, on n’a pas chômé et le délai a été tenu. Au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, je doute moins du résultat que du respect du calendrier.
Ce qui, à mon avis, mériterait d’être plus approfondi, ce sont les outils d’appui. Vous avez parlé du prestataire extérieur, Capgemini. Il apporte des ressources précieuses mais coûteuses. L’agence régionale de l’hospitalisation nous a aidés à financer l’audit, mais il existe aussi des outils internes à la fonction publique. On devrait pouvoir bénéficier soit de missions d’appui, soit de l’expertise des conseillers généraux des établissements publics de santé. C’est ce qui s’est passé au Centre hospitalier du Havre. Les ressources existent, mais elles ne sont pas toujours optimisées. Le conseiller général intervient seul tandis que Capgemini mobilise des équipes qui peuvent compter de cinq à dix consultants. Cela permet d’aller plus vite et de se rendre sur le terrain.
M. le coprésident Pierre Morange. Combien la prestation de Capgemini a-t-elle coûté ?
Mme Gaëlle Fonlupt. 800 000 euros la première année.
M. le coprésident Pierre Morange. Rapportée au déficit, la dépense était pertinente.
M. Nicolas-Raphaël Fouque. Certainement. Capgemini continue de nous accompagner, quelques semaines encore, sur les restructurations et sur le projet médical.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il nous reste à vous remercier.
M. le coprésident Pierre Morange. Et à vous féliciter pour le travail que vous avez engagé.
*
Audition, à huis clos, sous forme d’une table ronde, de Mme Patricia Colonnello, directrice des affaires hôtelières, logistiques et biomédicales du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, de M. Michel Louis-Joseph Dogué, ancien directeur des ressources humaines, directeur du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson, et de Mme Viviane Humbert, directrice du projet « nouvel hôpital ».
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Notre Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale a fait le choix, s’agissant du vaste sujet du fonctionnement de l’hôpital, de s’appuyer sur des cas précis afin d’en tirer des enseignements pour l’ensemble des établissements hospitaliers. Nous nous sommes ainsi intéressés au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, notamment parce que le déficit qu’il a enregistré depuis de nombreuses années aiguise pour le moins la curiosité.
Bien évidemment, les établissements ont tous leurs spécificités. En l’occurrence, la fusion décidée en 1997, qui a beaucoup marqué l’établissement et qui n’est pas encore tout à fait digérée, a produit certains effets, voire des dysfonctionnements. Il est des éléments que l’on retrouve dans d’autres établissements, par exemple la déficience de certains outils de gestion au regard de la comptabilité analytique ou encore de la facturation des prestations – qui à Poissy-Saint-Germain-en-Laye a tout de même atteint certains sommets. Enfin, d’autres dysfonctionnements plus graves ont pu apparaître, qui résultent apparemment du non-respect de règles juridiques – je pense en particulier au rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) sur des marchés publics passés récemment par l’établissement.
Par votre expérience dans vos fonctions antérieures, quelle analyse faites-vous de ces dysfonctionnements ? D’où provenaient-ils et quelles mesures avez-vous prises à l’époque ? Comment expliquez-vous finalement que cette situation soit apparue et qu’elle ait pu durer aussi longtemps ?
M. Michel Louis-Joseph Dogué, ancien directeur des ressources humaines du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, directeur du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson. Nous avons vécu la fusion la plus importante de France. Aussi a-t-il fallu tout défricher, ce qui a été du reste une aventure passionnante, qui a connu des épisodes assez variés et parfois curieux. La première opération de rationalisation a consisté à fusionner les directions administratives de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye, ce qui a d’ailleurs conduit à une direction unique moins importante que la seule direction précédente de Saint-Germain-en-Laye.
En dépit de l’effort considérable que cela a représenté, la collaboration s’est très bien passée entre le directeur délégué du site Poissy que j’étais, celui du site de Saint-Germain-en-Laye, qui était un ami de promotion, et le directeur général de l’époque, Marc Buisson, ainsi qu’avec ses successeurs.
La première étape importante a été réalisée de 1997 à 2003, lorsque nous avons tous œuvré pour un hôpital unique.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’idée était de faire un établissement dans un seul ou dans plusieurs lieux, pour éviter les doublons ?
M. Michel Louis-Joseph Dogué. La charte de fusion avait pour objectif d’améliorer l’offre de soins, de rationaliser la production des soins – ce qui n’était pas destiné, ainsi que cela avait frappé le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France à l’époque, Dominique Coudreau, à réaliser des économies sur le plan du personnel – et de supprimer les doublons inutiles.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Sinon, pourquoi fusionner ?
M. Michel Louis-Joseph Dogué. Tout à fait, encore que devoir qualifier un chef de service de « doublon inutile » promettait des moments heureux !
Après avoir fusionné les équipes de direction, nous nous sommes penchés sur les restructurations. Nous nous sommes alors vite rendu compte, au moyen de différentes projections, en particulier en termes de démographie médicale, que si nous voulions maintenir deux structures hospitalières autonomes, la restructuration de chacune serait si lourde – sachant par exemple que l’établissement de Poissy n’était plus conforme en matière de sécurité – qu’elle coûterait beaucoup plus cher qu’un hôpital neuf. Tel est le principe qui a sous-tendu l’idée de l’hôpital unique sur un site unique.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pourquoi cela n’a-t-il pas alors été fait ?
M. Michel Louis-Joseph Dogué. Parce que si nous étions parvenus en 2003 à avoir un superbe projet d’hôpital unique et si une mission d’appui, diligentée cette année-là par le ministère, avait conclu à la nécessité de disposer d’un hôpital unique et de trouver rapidement des terrains afin de pouvoir émarger au plan hôpital 2007, le ministre de la santé d’alors, Jean-François Mattei, a abandonné, le 27 août 2003, le projet d’hôpital unique – pour des raisons sur lesquelles je n’ai pas à revenir – et décidé que l’hôpital resterait sur deux sites. Toute l’énergie que nous avions consacrée à faire adhérer tous les acteurs à un projet économique rationnel d’amélioration notable de l’offre de soins fut alors redirigée dans l’optique d’un hôpital sur deux sites, comprenant chacun des pôles d’excellence, ce qui impliquait des restructurations sur chaque site, notamment avec la construction d’un hôpital neuf à Poissy puisque celui qui existait n’était plus conforme.
Nous nous sommes ainsi lancés à la recherche de terrains pour Poissy tout en engageant la restructuration du site de Saint-Germain-en-Laye, jusqu’à ce qu’en 2007, à ma grande satisfaction, la ministre de la santé de l’époque, Mme Bachelot-Narquin, revienne à la seule solution possible, celle du site unique, nous donnant ainsi finalement raison. Le maire de Saint-Germain-en-Laye, M. Lamy, s’étant toujours déclaré favorable à un site unique et tiers, c’est-à-dire qui ne soit ni à Poissy ni à Saint-Germain-en-Laye, un accord fut alors trouvé avec le maire de Chambourcy, M. Morange, pour une installation dans cette dernière ville.
M. le coprésident Pierre Morange. Ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le préciser, le maire de Chambourcy ne pouvait accepter le principe d’un site unique qu’à partir du moment où il répondait à une demande conjointe des maires de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye. Le site unique qui avait été envisagé à Poissy – puisque l’opération de fusion visait en fait la disparition du site hospitalier de Saint-Germain-en-Laye – aurait pour sa part été installé dans des espaces en violation flagrante du droit de l’urbanisme.
M. Michel Louis-Joseph Dogué. En termes de rationalité en tout cas, le regroupement de l’hôpital sur un site unique ne pouvait être que la seule solution. Le maintien des deux sites engendrait des coûts considérables.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il reste que pendant toute cette période d’une dizaine d’années, vous avez été conduit à gérer un établissement éclaté sur deux sites, qui s’est révélé en déficit. Or, prises séparément, les deux structures ne l’étaient pas auparavant. Sauf à prétendre que la fusion crée des déficits, comment analysez-vous ce résultat et comment avez-vous tenté – sans manifestement y réussir – de maîtriser ces déficits ?
Mme Viviane Humbert, directrice du projet « nouvel hôpital ». Je finis justement par me demander si la fusion ne crée pas le déficit. J’ai en effet participé dans un autre cadre, au sein de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à une fusion entre deux établissements qui étaient en équilibre financier, à savoir Cochin et Saint-Vincent-de-Paul : un an après, l’hôpital fusionné était en déficit.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pouvez-vous en analyser les raisons ?
Mme Viviane Humbert. D’une part, les deux cultures étaient assez différentes. D’autre part, l’on s’est très vite trouvé confrontés à la difficulté de fusionner non seulement des équipes médicales, mais également – ce qui ne fut pas le cas à Poissy-Saint-Germain-en-Laye – des équipes administratives et techniques, le tout avec une forte résistance syndicale, contrairement aussi à la situation actuelle.
Pour parvenir à un fonctionnement satisfaisant à Poissy-Saint-Germain-en-Laye, il aurait d’abord fallu, quand cela était possible, regrouper des activités médicales sur un seul site. Or cela a, de façon systématique, entraîné non seulement des débats internes extrêmement importants, mais également des interventions externes.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Qu’entendez-vous par là ?
Mme Viviane Humbert. Dès lors qu’une décision était prise, les personnes qui n’étaient pas d’accord se rendaient immédiatement auprès du maire de Saint-Germain-en-Laye ou de celui de Poissy.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Quid du directeur général de l’établissement ?
Mme Viviane Humbert. Tant le directeur général que le président de la commission médicale d’établissement (CME) étaient assez fréquemment court-circuités, des demandes d’intervention étant formulées auprès du maire de l’une ou de l’autre commune, voire du cabinet du ministre.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pourriez-vous nous donner des exemples ?
Mme Viviane Humbert. Tel a été le cas lorsque la maternité a été regroupée sur le site de Poissy et, en 2005, lorsque l’agence régionale de l’hospitalisation, dans le cadre du premier plan d’économies que nous avons eu à réaliser et que nous n’avons malheureusement pu mener à son terme, nous a demandé de regrouper la cardiologie et la pédiatrie.
Nous avions beaucoup de mal à obtenir un consensus médical sur les différents projets, sans compter l’obligation, en raison soit des textes soit de la seule nécessité, de maintenir sur chacun des sites des structures logistiques.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Si les structures existaient, pourquoi ont-elles alors coûté plus cher ?
Mme Patricia Colonnello, directrice des affaires hôtelières, logistiques et biomédicales du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. N’oublions pas la mise en place en 1996 – c’est-à-dire au moment de la fusion, dans un contexte déjà difficile – des allocations budgétaires au regard de l’activité, avec la mise en place du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Alors que jusque-là les budgets étaient alloués sous la forme d’un budget global reconduit chaque année avec un taux directeur, l’activité des établissements, prise dorénavant en compte, a sans doute – nous n’en faisions pas partie à l’époque – été insuffisamment productive, voire « rentable », pour que les deux sites continuent à être en équilibre sur le plan budgétaire.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. C’est un problème indépendant de la fusion.
Mme Patricia Colonnello. Peut-être, mais, auparavant, chacun des deux sites hospitaliers fonctionnait de son côté avec ses activités. Avec la fusion, le coût de la prise en charge d’une pathologie a été considéré de façon globale, comme si le centre hospitalier était un site unique.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le déficit, en quelque sorte, est le produit de la T2A, la tarification à l’activité…
Mme Patricia Colonnello. Ce n’est pas ce que je veux dire.
On appliquait un coût à partir de l’échelle nationale des coûts comme s’il s’agissait d’un site unique. Or, des activités continuaient à fonctionner en doublon et coûtaient donc plus cher.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Disposiez-vous des outils de comptabilité analytique qui vous auraient permis de contester cette façon de procéder ?
Mme Patricia Colonnello. Je ne sais pas ce qui existait en 1996, puisque je n’appartenais pas alors à la structure, mais lorsque je suis arrivé en 2004, il y avait, pour ce que j’en sais, une comptabilité analytique de base, rudimentaire.
M. le coprésident Pierre Morange. Pour reprendre les remarques de la chambre régionale des comptes ainsi que de M. Paraire, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, rien n’existait en la matière.
Jamais dans toute sa carrière professionnelle, ce dernier n’avait d’ailleurs constaté, dans la gestion de ce site, une telle somme d’incompétences ou d’insuffisances professionnelles de la part tant des directeurs des départements que des directeurs généraux. Telles sont les conclusions du rapport qu’il nous a communiqué suite à un audit des procédures d’appels d’offres. Pour résumer, les dix-neuf appels d’offre qu’il a étudiés étaient quasiment tous illégaux et constituaient autant de violations du code des marchés publics.
M. Michel Louis-Joseph Dogué. La mission mesure certainement la gravité des propos tenus.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Tout est enregistré.
M. le coprésident Pierre Morange. Je n’ai fait pour ma part que rappeler les propos de M. Paraire.
M. Michel Louis-Joseph Dogué. Ce que vous dites en clair, monsieur Morange, c’est que l’ensemble de la structure administrative tutélaire de l’établissement ne remplissait pas sa mission.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est ce que nous a dit M. Paraire.
M. Michel Louis-Joseph Dogué. Tous les cadres de direction sont évalués tous les ans, dans le cadre d’une procédure contradictoire absolument transparente, et l’évaluation est transmise à la fois au centre national de gestion et aux autorités de tutelle directe. Nous étions en outre soumis à un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) et au contrôle direct de l’agence régionale de l’hospitalisation – Mme Lepée, secrétaire générale de l’agence régionale d’hospitalisation de l’Île-de-France, nous accompagnait régulièrement dans le cadre de nos travaux.
Ce contrôle direct, attentif, qui allait du cabinet du ministre jusqu’à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en passant par l’agence régionale de l’hospitalisation, aurait donc totalement ignoré le fait que ces directeurs étaient totalement incompétents, qu’ils ne respectaient pas la réglementation en vigueur, et que tout cela se déroulait au vu et au su d’un conseil d’administration qui votait allègrement les propositions que nous lui faisions ? C’est extrêmement grave : c’est toute la chaîne que vous mettez en cause, y compris celui dont vous citez le nom.
M. le coprésident Pierre Morange. Je ne fais, je le rappelle, que répéter les propos de M. Paraire qui nous a dit textuellement que, dans toute sa carrière, il n’avait jamais constaté autant d’anomalies qui témoignaient – je parle sous le contrôle du rapporteur qui ne me contredira pas – d’une insuffisance professionnelle s’agissant notamment des dix-neuf procédures d’appels d’offre qu’il avait eu vocation à étudier dans le cadre de son audit, ce qui interpellait la responsabilité à la fois de son prédécesseur, des autorités de tutelle, s’agissant du contrôle de légalité, et des différents échelons administratifs qui avaient, au sein de l’hôpital, compétence pour intervenir.
Pour le reste, la MECSS n’est pas une instance judiciaire. M. Paraire, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, a saisi le procureur de la République de Versailles d’une demande d’ouverture d’une information judiciaire, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.
Mme Patricia Colonnello. Puisque nous en sommes arrivés là, parlons clairement.
Concernant le contrôle des marchés publics – et donc ce rapport auquel je n’ai pas répondu, mais je reviendrai sur ce point – les choses se sont passées de la façon suivante :
Il faut d’abord savoir que c’est en consultant ma messagerie que j’ai appris, fin août 2008, que si je serais toujours responsable à partir du 1er septembre des achats et des marchés en matière de biomédical, je ne le serais plus pour tout ce qui avait trait à l’hôtellerie et à la logistique. Je n’ai donc pu que répondre par la suite à l’inspecteur et au secrétaire administratif de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales venus procéder à un contrôle des marchés publics, hors opérations de travaux proprement dites, que non seulement je n’étais plus en charge des achats et des marchés, sauf pour ce qui concernait le biomédical, mais que je n’avais également jamais eu en charge les marchés relatifs à l’informatique, aux assurances et à la pharmacie.
Mes deux interlocuteurs se sont donc adressés à la personne recrutée pour prendre en charge les achats à partir du 1er septembre 2008, afin de se procurer les dossiers qui les intéressaient. Ce n’est que plus tard, au mois de mars 2009, qu’ils ont officiellement demandé à me rencontrer afin de faire le point. Les marchés qu’ils avaient examinés portaient tous sur ceux dont j’avais eu la responsabilité. Aucun n’avait trait à l’informatique, aux assurances ou à la pharmacie. Ils m’avouèrent d’ailleurs avoir procédé par sondage à partir des documents que leur avait fourni la nouvelle directrice des achats.
Ils m’ont d’abord parlé d’un marché concernant un logiciel de gestion des marchés publics dont ladite directrice leur avait dit ne pas connaître l’existence. C’était totalement impossible puisque je l’en avais informée : j’ai par chance retrouvé le mail l’informant de l’existence de ce marché.
Ils ont ensuite regretté – ce qui m’a également fait bondir – l’absence de marché de fourniture des denrées alimentaires. Comment peut-on imaginer qu’un établissement comme celui de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n’ait pas de marché de denrées alimentaires, impliquant des sommes aussi importantes ? Non seulement nous avions lancé un appel d’offres, mais la direction des achats était en train de reprendre, pour établir le nouveau cahier des charges en la matière, celui que nous avions nous-même mis au point à l’époque.
À la suite de cette rencontre, ces personnes ont poursuivi leurs investigations sans que je les revoie, sinon à deux reprises et de façon officieuse pour leur répondre à brûle-pourpoint, après les avoir croisées dans le couloir, à des questions portant sur des marchés qu’il me fallait reconstituer trois ou quatre ans plus tard, sachant que j’avais eu à en connaître 500 ou 600.
Lorsque leur rapport a été rédigé, j’ai demandé, puisque je devais y répondre, à pouvoir consulter les dossiers sur lesquels il reposait. En effet, le rapport avançait qu’il n’y avait eu, s’agissant notamment du marché de fourniture des denrées alimentaires, ni d’avis de publicité ni d’avis de pré-information, ce qui était totalement faux. Je me demande d’ailleurs comment le Trésor public aurait pu accepter de payer des factures en l’absence de marché, d’autant que l’autorité de tutelle, à qui sont transmis les marchés sur appel d’offre, doit veiller à leur bonne élaboration. J’ai d’ailleurs pu retrouver au sein d’une autre direction les avis qui avaient été communiqués à l’autorité de tutelle avec bordereau d’envoi à l’appui, mais qui apparemment ne figuraient pas dans le dossier qui avait été remis aux contrôleurs.
Ma collègue directrice des achats m’ayant demandé les jours et heures auxquels je désirais consulter les dossiers, je me suis présentée à la porte de son bureau un vendredi pour me procurer la clé de la salle concernée – dès que le contrôle s’est terminé, toutes les serrures avaient en effet été changées, comme si j’allais subtiliser je ne sais quoi dans les dossiers pour faire disparaître des preuves –, sauf que je m’étais trompé de jour, ayant confondu le vendredi à la place du jeudi…
M. le coprésident Pierre Morange. Pourriez-vous nous expliquer…
Mme Patricia Colonnello. Je…
M. le coprésident Pierre Morange. Pardonnez-moi, mais en ma qualité de coprésident, j’ai tout pouvoir pour conduire les débats avec mon collègue Jean Mallot.
Je souhaite que vous puissiez expliciter quelques points en particulier, mais comprenez bien que notre démarche est celle de représentants du peuple, de législateurs et de contrôleurs de la bonne utilisation de l’argent public. La démarche judiciaire n’est pas la nôtre. Nous étudions, nous contrôlons, nous évaluons, tout travail que nous effectuons sur la base de rapports issus des services de l’État. C’est dans ce contexte que nous avons reçu des rapports de la chambre régionale des comptes et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales faisant état de certains constats que semble-t-il vous contestez. Notre propos n’est pas de dire le vrai, ni, pour revenir sur la saisine du procureur de la République de Versailles, de faire une pré-instruction. Une telle démarche dépend d’une procédure qui n’est pas la nôtre.
Pour autant, plusieurs éléments frappants sont apparus lors de l’examen de ce dossier, au-delà du constat fait par M. Paraire concernant le caractère illégal de certaines procédures d’appels d’offres :
Premièrement, une partie des documents nécessaires à la démarche des contrôleurs a manqué à ces derniers soit parce que les règles de procédure de conservation n’avaient pas été respectées soit, comme vous l’avez fait remarquer, parce que ces documents étaient détenus dans d’autres services ;
Deuxièmement, l’absence totale d’outil de comptabilité analytique rendait difficile l’élaboration d’un plan de retour à l’équilibre financier ;
Troisièmement, l’insuffisance de la collecte de recettes du fait, soit de non-facturations, soit de facturations non recouvrées, a porté sur des sommes importantes puisqu’elles représentent quasiment la moitié des 150 millions d’euros de déficit cumulé – ce qui en fait l’un les plus élevés de France – de ce site hospitalier dont le budget annuel tourne autour de 230 millions d’euros.
Ces constats reposent sur des documents officiels, c’est-à-dire que nous ne sommes pas dans l’interprétation – ni, je le répète, dans la pré-instruction.
Mme Patricia Colonnello. Je souhaite justement expliquer pourquoi je n’ai pas répondu au rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, contrairement à ce qui est la règle dans le cadre de la procédure contradictoire.
Le fait que je n’ai pu avoir accès aux dossiers en raison de mon erreur sur le jour de consultation, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Ce jour-là, je n’ai plus pu supporter la situation que je subissais depuis un certain temps à Poissy-Saint-Germain-en-Laye, au point que j’ai été mise en arrêt maladie pour dépression. Étant arrêtée, je n’ai donc pu répondre dans le délai de trente jours aux observations faites sur les marchés publics. J’en étais psychologiquement incapable.
Lors de mon retour dans l’établissement, le directeur général m’a précisé que, compte tenu de mon absence, il avait lui-même répondu au rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Je n’ai pas eu copie de la réponse. Je lui avais moi-même écrit ainsi qu’à M. Paraire pour les prévenir que je ne répondrais pas au rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compte tenu des conditions dans lesquelles les contrôles s’étaient déroulés, mais surtout de l’impossibilité psychologique dans laquelle je me trouvais. Aujourd’hui encore, dès que je reprends le rapport, tout remonte.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous comprenons que tout le monde puisse faire valoir son argumentation. Mais admettez que les documents qui nous ont été fournis en masse aussi bien par l’agence régionale de l’hospitalisation que par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou la chambre régionale des comptes étaient pour le moins étonnants, à l’exemple de la disparition de dossiers d’appels d’offre, surtout s’agissant de marchés qui durent depuis des décennies.
Mme Patricia Colonnello. Pour ce qui est par exemple du marché des transports sanitaires sur lequel M. Chodorge souhaitait faire le point, tous les documents qu’il m’avait demandés au mois de juillet 2008, qu’il s’agisse du cahier des charges ou encore du rapport de présentation à la commission d’appel d’offres, lui ont été transmis. Les observations dont il m’a fait part ont conclu à la conformité du dossier, sachant notamment que la mise en concurrence avait eu lieu – tout avait d’ailleurs été transmis aux autorités de tutelle.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Dans ces conditions, n’y aurait-il pas intérêt à ce que le procureur donne suite à sa saisine de façon que tout le monde puisse faire valoir ses arguments ?
Mme Patricia Colonnello. Je serais pour ma part psychologiquement incapable de le supporter. La pression que je subis depuis plus d’un an au Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est telle que j’ai été arrêtée pour dépression et que je resterai psychologiquement atteinte jusqu’à la fin de mes jours. Pourtant je ne suis pas quelqu’un qui se laisse abattre facilement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Concrètement, un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ayant entre les mains un rapport comme celui que nous avons pu lire, n’avait d’autre choix – je suis moi-même ancien fonctionnaire – que celui de la saisine sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale. C’est pourquoi, je me demandais s’il ne valait pas mieux que le procureur donne suite, de façon que chacun puisse au moins faire valoir ses arguments.
M. le coprésident Pierre Morange. M. Paraire a tenu à préciser que s’il n’y avait pas d’action menée par le procureur avant la fin de l’année, soit d’ici à quelques semaines, il se constituerait partie civile.
M. Michel Louis-Joseph Dogué. Concernant notre incompétence,...
M. le coprésident Pierre Morange. Dixit M. Paraire.
M. Michel Louis-Joseph Dogué. …je souhaite préciser que, dans le cadre de l’évaluation des cadres de direction à laquelle j’ai fait référence, j’ai été amené à porter à la connaissance de la commission administrative paritaire nationale mon désaccord quant à l’évaluation effectuée à mon encontre par l’actuel directeur général de l’établissement, et à ses conséquences sur la prime de fonction. Le dossier, dont l’examen a été reporté parce que le directeur général ne répondait pas aux demandes du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a été finalement traité le 15 octobre.
Alors que j’étais accusé d’être dans l’incapacité d’évoluer et d’imaginer un suivi de contrôle des dépenses par un directeur des ressources humaines plutôt que par un directeur financier, et, plus généralement, d’avoir commis une faute grave préjudiciable à l’établissement, accusation à l’appui de laquelle des documents étaient fournis, la commission administrative paritaire nationale a émis le 15 octobre 2009, soit il y a à peine trois semaines, un avis unanime – y compris donc des représentants de l’administration et des trois syndicats représentatifs des directeurs – qui me donnait raison. Toutes les accusations portées contre moi n’ont pas été estimées crédibles une seule seconde.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Par qui étaient émises ces accusations ?
M. Michel Louis-Joseph Dogué. Par l’actuel directeur général du Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Dans les documents qui venaient à l’appui de l’accusation de faute grave, figurait notamment une erreur flagrante d’appréciation de la procédure budgétaire des collectivités territoriales. Tout était comme cela pour prouver mon incompétence.
M. le coprésident Pierre Morange. Là encore je rappelle que la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale prend acte des rapports et des observations qui nous sont fournis par les services de l’État. Celui qui a été évoqué, à savoir celui de M. Paraire, s’adosse sur un audit portant sur dix-neuf marchés d’appels d’offre, notamment en matière de ressources humaines et de transports sanitaires – marché attribué semble-t-il depuis plusieurs décennies au même prestataire. Notre propos n’a trait ni aux éventuelles sanctions administratives, lesquelles relèvent des hiérarchies compétentes, ni à la saisine de l’instance judiciaire ou à la constitution de partie civile.
Nous faisons des constats pour en tirer des règles générales afin qu’elles puissent être bénéfiques à l’ensemble des établissements hospitaliers. Pour autant, les sujets tels que les outils de comptabilité évoqués par notre rapporteur – qui a été contrôleur financier dans une vie antérieure – ou la collecte des recettes, ne sont pas neutres.
M. Michel Louis-Joseph Dogué. S’agissant des ressources humaines, permettez-moi de vous renvoyer aux documents écrits que sont les bilans sociaux. À Poissy-Saint-Germain-en-Laye, le directeur des ressources humaines que j’étais à l’époque introduisait chaque bilan social par des considérations d’ordre stratégico-politique : je donnais mon avis quant aux conséquences sur l’établissement de la politique de ressources humaines. C’est ainsi que, pendant des années, j’ai pu écrire que si ce dernier ne restructurait pas beaucoup plus rapidement ses activités, on irait dans le mur, que nous vivions au-dessus de nos moyens ou encore que l’accumulation des crédits ouverts en termes de compte épargne temps ou d’heures supplémentaires constituait une bombe à retardement. Tout cela a été lu par toutes les instances de l’établissement, y compris par le conseil d’administration et la tutelle, sans émouvoir personne.
Je veux bien que l’on dise après que le directeur-adjoint dans cette affaire a une responsabilité forte puisque c’est celle d’un directeur d’hôpital, mais les choses étaient, en toute transparence, écrites et pas seulement suggérées.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Chacun peut penser de bonne foi avoir fait son travail, mais le résultat est quand même là, à savoir un établissement dont la gestion est pour le moins problématique. On peut difficilement se satisfaire du montant des déficits accumulés. Pour comprendre, il faut donc aller plus loin que la simple distribution des bons et des mauvais points.
Il est pour nous assez difficile d’admettre que cette situation ait pu durer aussi longtemps sans que l’on s’interroge sur les outils de gestion ou les moyens de suivi. Il y a bien eu un moment où des décisions inopportunes ont été prises.
M. le coprésident Pierre Morange. Le propos de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale n’est pas de clouer X ou Y au pilori, mais de définir, dans le cadre de la gestion collective ou de la responsabilité partagée, où se situe une coresponsabilité au titre tout simplement des contrôles effectués par les différents services que ce soit au niveau des directeurs, du conseil d’administration ou des services de l’État.
La vérité ultime sera dégagée par les instances dites supérieures. Notre propos, lui, n’est pas, je le répète, de cibler X ou Y, mais de comprendre les mécanismes qui ont conduit sur le plan financier à un déficit tout de même pharaonique, qui s’est échelonné sur les huit dernières années.
Mme Viviane Humbert. À mon arrivée, j’ai trouvé une comptabilité analytique très rudimentaire par rapport à ce qui existait dans des établissements que j’avais connus précédemment.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est le moins que l’on puisse dire. Il est pourtant difficile de mener des réflexions stratégiques en termes d’évolution de la masse salariale, qui constitue 70 % du budget hospitalier, si l’on ne dispose pas d’outils pour la mesurer.
Pour autant, la gestion d’un établissement hospitalier qui a tout de même un budget annuel de quelque 260 millions d’euros, nécessite non seulement des outils de mesure, mais également une mémoire. À cet égard, il n’a pas été répondu à notre question concernant l’archivage. Le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a en effet relevé que les plus anciens dossiers d’appels d’offre dataient de 2003 alors que les textes exigent de les conserver dix ans voire trente ans dans certains cas. Cela ne peut, pour le moins, que laisser perplexe. Qui s’occupe de la destruction des dossiers ou plutôt qui donne les ordres pour procéder à la conservation de la mémoire, conformément aux textes ?
Mme Patricia Colonnello. Nous avons très peu de place à Poissy-Saint-Germain-en-Laye et, du coup, nous éliminons régulièrement des dossiers de marché, même si les contrôles de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) nécessitent de les garder pendant dix ans. Néanmoins, si ces derniers n’étaient plus sur le site hospitalier, il est clair que si l’inspection en avait eu besoin – je n’ai jamais été sollicitée à ce propos – j’aurais fait des pieds et des mains pour les récupérer, notamment auprès du Trésor public qui en a un exemplaire, voire des autorités de tutelle puisque tous nos appels d’offre sont transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Il est évident que s’ils n’étaient pas en interne, je me serais débrouillé pour aller les récupérer là où ils étaient.
M. le coprésident Pierre Morange. Pardonnez-moi, mais il ne faut quand même pas dépasser les bornes. Dire qu’il manque de la place à Poissy-Saint-Germain-en-Laye alors que des milliers de mètres carrés y sont disponibles est peut-être un tout petit peu excessif.
Mme Patricia Colonnello. Il ne s’agissait pas de détruire des preuves qui auraient pu être compromettantes.
M. le coprésident Pierre Morange. Je ne vous ai pas dit cela.
Mme Patricia Colonnello. Très sincèrement, je le vis comme cela.
M. le coprésident Pierre Morange. Je ne suis pas arrivé à cette conclusion. Je vous dis simplement que prétendre qu’il n’y a pas quelques pièces disponibles sur le site de Poissy-Saint-Germain-en-Laye pour stocker des documents est déraisonnable.
Mme Patricia Colonnello. S’il y a tant de place à Poissy-Saint-Germain-en-Laye, dites-moi alors pourquoi l’on stocke pour des centaines de milliers d’euros des archives médicales à l’extérieur de l’hôpital ?
M. le coprésident Pierre Morange. C’est une très bonne question.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Compte tenu de l’heure, chacun pourrait s’exprimer une dernière fois avant que la séance ne s’achève.
M. Michel Louis-Joseph Dogué. Il me semble important d’évoquer la notion d’outil de mesure. Le Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye était organisé de telle manière que la direction des ressources humaines disposait d’un outil très précis de mesure des effectifs. Je fournissais ainsi tous les mois à l’ensemble de mes collègues un suivi extrêmement précis des effectifs par statut, par fonction, etc., la direction financière suivant pour sa part la partie financière, sachant bien évidemment que les choses étaient confrontées dans l’année.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Ce n’est donc pas vous qui suiviez la masse salariale.
M. Michel Louis-Joseph Dogué. Non, je suivais les effectifs.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous gériez des personnels sans savoir combien ils coûtaient ?
M. Michel Louis-Joseph Dogué. Je connaissais bien sûr le coût moyen d’un agent, mais, en termes de comptabilité, je ne suivais pas la partie financière.
M. le coprésident Pierre Morange. En qualité de directeur du personnel, vous ne disposiez pas de tableaux de bord de la masse salariale ?
M. Michel Louis-Joseph Dogué. Cette masse salariale était quasiment implicite puisque je connaissais le coût moyen d’un aide-soignant ou d’un infirmier, par exemple.
Une fois que l’on suit les effectifs par grade, par statut, par type de contrat, et que l’on connaît le GVT, on a une connaissance parfaite de la situation financière des personnels.
Mme Viviane Humbert. Au-delà de la comptabilité analytique, il me semble qu’en matière de facturation nous avons raté deux virages, d’abord celui de l’informatique – nous n’avons pas mis en place les bons outils au bon moment –, ensuite celui de la T2A, que personne n’avait anticipé.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Merci à vous trois de vous être prêtés à cet exercice difficile, mais qui était nécessaire pour nous. Nous continuerons nos travaux sur ces bases.
*
AUDITIONS DU 19 NOVEMBRE 2009
Audition, à huis clos, de M. Jacques Métais, directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Jacques Métais, directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) d’Île-de-France, dans le cadre des travaux de la MECSS sur le fonctionnement de l’hôpital, étant entendu que nous avons choisi d’étudier un cas particulier, celui du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, afin d’alimenter notre réflexion et de formuler, par la suite, des préconisations à vocation générale.
Cet hôpital, qui est le plus important d’Île-de-France, exception faite de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), est aussi celui qui présente les déficits cumulés les plus élevés. Après avoir procédé à de nombreuses auditions, aussi bien des services compétents de l’État, notamment ceux en charge du contrôle de légalité, que de l’ensemble des personnels d’encadrement, nous avons souhaité vous entendre, monsieur Métais, afin d’enrichir notre réflexion.
M. Jacques Métais, directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France. En raison de sa situation particulière, caractérisée par un déséquilibre persistant de sa gestion, l’établissement de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est la principale préoccupation de l’agence régionale de l’hospitalisation depuis maintenant trois ans que je la dirige.
Sans retracer toute l’histoire des hôpitaux de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye, je rappellerai que ces deux établissements ont décidé de fusionner en 1997 sans avoir défini au préalable un projet médical précis. Il est très vite apparu à l’agence régionale de l’hospitalisation que la seule façon de réussir la fusion était de construire un nouvel hôpital sur un autre site. L’idée était simple, mais il a fallu du temps pour qu’elle s’impose et il a fallu que l’agence défende cette solution avec beaucoup de ténacité auprès des élus locaux et du cabinet du ministre. Ce dernier ayant fini par se ranger à cette idée voilà deux ans, il a été décidé que le projet serait financé dans le cadre du plan « Hôpital 2012 » – il constituera d’ailleurs la plus importante réalisation de sa deuxième tranche.
Un deuxième sujet de préoccupation concerne l’évolution de l’hôpital avant la construction du nouveau site. En attendant le rassemblement des services et des activités, qui aura pour effet de mutualiser les moyens et de faciliter la gestion, l’établissement a signé un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF), certes très difficile à respecter, mais nécessaire au vu des résultats effrayants de l’hôpital, dont le déficit s’élève à environ 32 millions d’euros. Le déficit, qui devait être ramené à 19 millions d’euros cette année, avoisinera en réalité 23 millions. Il devrait ensuite passer à 10 millions d’euros l’année prochaine et à 1,5 million en 2011, avant un retour à l’équilibre en 2012. Nous avons conscience que c’est un défi très difficile à relever et c’est pourquoi nous soutenons pleinement les efforts de la direction pour adopter des mesures appropriées à la situation, tout à fait exceptionnelle par l’ampleur de la dégradation des comptes.
Au plan régional, nous sommes en passe de réduire sensiblement l’ensemble des déficits des hôpitaux d’Île-de-France, qui ont déjà décru de moitié en un an. Ils ont en effet été ramenés de 130 à 65 millions, hors hôpitaux en excédent, et nous devrions quasiment arriver à l’équilibre cette année malgré les résultats de l’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, de loin les plus préoccupants.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. De quels leviers disposez-vous ?
M. Jacques Métais. Notre intervention repose sur la signature de contrats de retour à l’équilibre avec les établissements hospitaliers, après un examen commun des secteurs où les efforts doivent porter.
La tarification à l’activité (T2A), fixée au plan national, a défavorisé les hôpitaux franciliens, qui disposaient historiquement de moyens supérieurs à ceux des autres établissements. Malgré une majoration de 7 % des tarifs applicables en Île-de-France, la situation s’est dégradée dans des proportions plus importantes que dans le reste du pays.
Une première génération de contrats a été signée en 2004 par mon prédécesseur, Philippe Ritter, avec environ vingt-cinq établissements. À quelques exceptions près, ces contrats ont été un échec : la plupart des hôpitaux espéraient, avant tout, que la T2A permettrait d’améliorer leurs résultats grâce à une augmentation de leur activité.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. De quoi pouvait-elle résulter ?
M. Jacques Métais. Certains établissements, comme celui de Versailles, ont pu augmenter leur activité dans le cadre des restructurations hospitalières ou du fait de l’augmentation de la population des bassins concernés, par exemple dans les villes nouvelles, mais rien n’a changé dans les autres cas.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons appris qu’il y avait des « fuites de patients » : ceux-ci se détournent d’établissements souffrant de difficultés de fonctionnement. Toutefois, il s’agit d’un système de vases communicants.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. C’est un jeu à somme nulle.
M. Jacques Métais. Une deuxième génération de contrats a été lancée il y a un an et demi. À cette occasion, l’agence régionale de l’hospitalisation est entrée beaucoup plus dans le détail des économies à réaliser. Ces économies constituent le principal moyen d’action : les moyens doivent être réduits s’ils ne sont pas adaptés à l’activité réelle.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. De quels moyens s’agit-il ? Des effectifs ?
M. Jacques Métais. Tous les moyens sont concernés en général, mais ceux en personnel le sont plus particulièrement, car ils représentent 70 % du total.
La signature des contrats est précédée d’une étude, parfois confiée à un consultant extérieur, parfois réalisée avec le concours d’une mission d’expertise et d’audit mise à notre disposition par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). L’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France est le premier utilisateur de telles missions, dont nous sommes globalement satisfaits, car elles permettent de bien identifier les secteurs dans lesquels des économies peuvent être réalisées.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous avons appris, au cours de précédentes auditions, que l’instauration de systèmes de comptabilité analytique performants était très inégale – et c’est une litote. Or, on voit mal comment gérer de manière satisfaisante un hôpital sans disposer d’informations suffisantes.
M. Jacques Métais. Vous avez raison. Il se trouve que les hôpitaux publics ont été financés, de 1984 à 2004, par le système du budget global, qui n’incitait pas les établissements à développer de tels outils comptables. Puis, contrairement aux cliniques privées, les hôpitaux ne se sont pas adaptés rapidement au nouveau système.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment inciter les établissements à le faire ?
M. Jacques Métais. L’étude analytique qui précède généralement la signature des contrats de retour à l’équilibre tend à identifier les secteurs où l’hôpital perd de l’argent, ceux où elle en gagne, ceux où l’activité est insuffisante et ceux, au contraire, où il faudrait la développer – c’est, en effet, une hypothèse à prendre en compte si l’on ne veut pas perdre de vue le rôle et les missions de l’hôpital public.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les personnels sont-ils prêts et formés à de telles évolutions ?
M. Jacques Métais. Je ne pourrais pas l’affirmer catégoriquement. Tout changement de logique est extrêmement difficile à réaliser, notamment du fait de l’existence de différents de statuts.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous préciser l’étendue du parc hospitalier placé sous votre direction : combien compte-t-on d’établissements et de lits ?
L’absence de comptabilité analytique, pourtant prévue par les textes en vigueur, empêche d’avoir une vision lucide de la situation et d’effectuer une gestion prévisionnelle. Pouvez-vous nous dire quelle était la proportion d’établissements dotés d’outils de comptabilité analytique avant la signature des contrats de deuxième génération, quelle est la situation aujourd’hui et quelles sont les perspectives ?
Vous avez évoqué la question du statut des personnels, et le rapporteur celle de leur formation. Pour accélérer les évolutions dans l’intérêt des patients et de la bonne gestion des comptes publics, ne peut-on pas faire appel à des partenaires extérieurs ?
M. Jacques Métais. On compte environ 450 établissements de santé en Île-de-France, dont 37 sont gérés par une administration unique, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), sur laquelle l’agence régionale de l’hospitalisation n’avait pas la tutelle financière jusqu’à cette année. Faute de levier financier, l’intégration des hôpitaux parisiens au sein de l’offre de soins régionale était malaisée. Le ministère de la santé a souhaité, il y a deux ans, que l’agence régionale de l’hospitalisation soit chargée d’assurer l’instruction de la tutelle de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, ce qui l’a amenée à connaître de sa situation financière, puis la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a confié à l’agence régionale de santé (ARS) la tutelle financière, cette disposition étant d’application immédiate selon les précisions apportées par le ministère.
Vous m’avez interrogé sur le nombre d’établissements placés « sous ma direction ». Ce terme n’est pas tout à fait exact, car les agences régionales de l’hospitalisation n’ont pas été créées pour gérer les établissements à leur place. Ce serait, à mon sens, une erreur de penser que les établissements de santé ont vocation à être gérés de façon centralisée au niveau régional. Les agences régionales de l’hospitalisation ont été instaurées en 1996 pour restructurer les tissus hospitaliers régionaux en les adaptant aux besoins de la population, notamment par le biais de schémas d’organisation sanitaires, et pour assurer le financement des établissements publics et privés – le prix de journée d’hospitalisation dans les cliniques était ainsi fixé par les agences régionales de l’hospitalisation. Depuis lors, la tarification a été unifiée sur le plan national, mais cela ne signifie pas que le rôle financier de l’agence régionale de l’hospitalisation a régressé, bien au contraire : nous n’avons jamais passé autant de temps qu’aujourd’hui à soutenir les établissements en difficulté, comme celui de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
M. le coprésident Pierre Morange. Je reviens à ma deuxième question : combien d’établissements de santé disposent aujourd’hui d’outils de comptabilité analytique ?
M. Jacques Métais. N’ayant pas fait de recensement, je ne peux pas vous indiquer quel est le pourcentage exact. On peut estimer, très grossièrement, qu’un tiers des hôpitaux publics dispose aujourd’hui d’une comptabilité analytique digne de ce nom, y compris l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est un ordre de grandeur stupéfiant : deux tiers des établissements ne disposent pas de comptabilité analytique ! Il va de soi que nous serions très intéressés par des chiffres plus précis si vous pouviez les obtenir. Nous portons également le plus grand intérêt aux moyens – recrutement de personnels supplémentaires ou recours à des cabinets extérieurs – qui permettraient enfin aux établissements d’assumer leurs responsabilités.
Nous avons été frappés, au cours de précédentes auditions, par le caractère quelque peu aléatoire et rudimentaire de la facturation, sujet sur lequel la chambre régionale des comptes a notamment appelé notre attention : certaines factures ne sont pas recouvrées et d’autres ne sont même pas établies. Indépendamment de la question de la prise en charge des personnes en situation de grande précarité, il semble qu’il y ait là un véritable problème systémique, qui contribue aux déficits constatés dans certains établissements. Quelle est, selon vous, l’ampleur de ces phénomènes ?
M. Jacques Métais. La situation évolue de manière favorable. La T2A, qui couvre 100 % des financements depuis 2008 alors que beaucoup pensaient que son application resterait partielle, constitue une forte incitation à développer des outils de comptabilité analytique, très utiles pour déterminer la taille critique de certaines activités en dessous de laquelle il y a peu de chance de parvenir à l’équilibre. L’agence régionale de l’hospitalisation, qui exerce une fonction de contrôle de gestion, aide naturellement les établissements dans cette tâche. On peut penser que tous les établissements seront dotés d’une comptabilité analytique correcte dans les deux ans qui viennent.
S’agissant de la facturation, il faut distinguer plusieurs éléments : le principal problème résulte d’une mauvaise organisation du circuit d’information reliant le département d’information médicale (DIM), qui recense les pathologies traitées à l’hôpital, et le service de facturation. Le passage à la T2A impose en effet de mêler des informations de nature médicale et d’autres de nature administrative. Cette idée peut paraître naturelle, mais elle n’est pas toujours d’une application aisée. Il reste que très peu d’établissements continuent à souffrir de réelles difficultés dans ce domaine, car ils ont intérêt à facturer un maximum d’activités médicales.
M. le coprésident Pierre Morange. Si je comprends bien, le problème est devenu marginal.
M. Jacques Métais. C’est exact. Nos contrôles ont permis de constater qu’un certain nombre d’établissements, appartenant parfois au secteur public, essaient plutôt d’optimiser leur situation en s’affranchissant des règles de facturation : ils trichent, tout simplement.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est de la surfacturation !
M. Jacques Métais. Oui, et nous allons d’ailleurs épingler un certain nombre d’hôpitaux, qui seront sanctionnés financièrement en application de dispositions adoptées en 2007. Certains n’ont que trop compris l’intérêt de majorer au maximum leur activité.
Une autre difficulté est que la facturation individuelle n’est pas en vigueur dans les établissements publics, alors qu’elle a été imposée aux cliniques privées, dès 2004. Au lieu d’envoyer des factures individuelles à l’assurance maladie, chaque établissement déclare son activité à l’agence régionale de l’hospitalisation, laquelle doit ensuite indiquer à la caisse primaire ce qu’il convient de verser au titre du mois précédent. J’ignore quand le ministère décidera d’abandonner ce système très bureaucratique et très archaïque pour passer à la facturation individuelle, qui semble plus conforme au bon sens.
En dernier lieu, certains établissements éprouvent des difficultés à encaisser une partie de leurs recettes, notamment dans le cadre des consultations externes et des urgences. C’est un vrai problème pour certains établissements, mais on constate que d’autres ont su s’organiser, y compris dans des zones de précarité où la clientèle est non seulement défavorisée mais aussi difficile à localiser : certains patients n’ont pas de domicile, n’ont pas de carte Vitale ou utilisent de fausses cartes.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. On pourrait sans doute s’inspirer des bonnes pratiques dans d’autres établissements.
M. le coprésident Pierre Morange. Effectivement. Peut-on généraliser ces pratiques vertueuses, même en l’absence de dynamique interne à l’établissement ? Si nous insistons sur l’insuffisance du recouvrement des factures, c’est que le phénomène n’est visiblement pas marginal. Selon la chambre régionale des comptes, entre 5 et 10 % des factures seraient concernées…
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. …et même 15 % au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
M. Jacques Métais. En réalité, le montant des créances irrécouvrables ne dépasse pas 20 millions d’euros, quand le chiffre d’affaires des hôpitaux publics et des établissements participant au service public hospitalier en Île-de-France s’élève à près de 13 milliards d’euros – dont la moitié est réalisée par L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Il est difficile d’évaluer le montant des créances irrécouvrables, mais je serais très étonné qu’elle dépasse 20 millions d’euros. Au total, on est donc très loin d’atteindre 5 % des recettes.
Mme Catherine Génisson. Étant praticienne des hôpitaux et membre de la commission exécutive (COMEX) de l’Agence régionale de l’hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais, je peux témoigner que les départements d’information médicale jouent un rôle essentiel. Bien souvent, il y a malheureusement des problèmes de collecte des données auprès des patients et des professionnels.
Force est de constater que le secteur privé a su s’organiser de façon beaucoup plus efficace pour colliger les données. Il est vrai que la tâche est plus simple dans ces structures, dont les activités sont moins étendues que celles du secteur public – je pense notamment aux services d’urgences et aux consultations externes. Cela étant, ne faudrait-il pas s’inspirer des cliniques privées en affectant des personnels spécifiques à la collecte des données ? On peut se demander si c’est réellement aux professionnels de santé de s’en occuper.
Dans bien des cas, la facturation immédiate permet de donner une image plus fidèle de l’activité des établissements. Il n’en reste pas moins que cette pratique « vertueuse » est facile à contourner : il suffit de se rendre à l’hôpital en dehors des heures où l’on peut matériellement établir une facturation. Pour y remédier, ne pourrait-on pas faire en sorte que le personnel administratif et le personnel soignant aient des horaires similaires ?
M. Jacques Métais. Je partage votre avis sur le rôle essentiel joué par les départements d’information médicale dans les établissements, qu’ils soient publics ou privés. Un des avantages de la tarification à l’activité est que, pour la première fois, le système de financement dépend de l’activité médicale de l’établissement – ce qui est la moindre des choses. Or, l’hôpital étant financé selon les pathologies qu’il traite, il importe de connaître précisément ce qu’ont fait les médecins. Le clinicien doit donc fournir un certain nombre d’informations sur le patient qu’il vient de traiter, de la même façon qu’il remplirait une feuille de maladie, par exemple. Le rapprochement peut paraître audacieux, mais il signifie seulement que l’on ne lui demande rien de surhumain : il s’agit de noter le diagnostic d’entrée, le diagnostic de sortie, les actes principaux effectués sur le patient…
Mme Catherine Génisson. Le diagnostic secondaire également : l’environnement joue un rôle important.
M. Jacques Métais. Dans certaines disciplines, comme la chirurgie, le nombre de champs à renseigner est moins important. Dans d’autres cas – comme celui d’une personne âgée multipathologique –, cela peut prendre plus de temps. En tout état de cause, le clinicien est le seul à pouvoir le faire.
Mme Catherine Génisson. Dans le privé, pourtant, ce travail est effectué le plus souvent par un professionnel.
M. Jacques Métais. Je ne crois pas. Il ne peut pas être dévolu à une personne déconnectée des soins. Seule la personne qui a vu le patient et sait de quoi elle parle peut s’en charger.
Mme Catherine Génisson. Oui, c’est la situation idéale !
M. Jacques Métais. Une fois ces informations collectées, le clinicien doit les envoyer en temps réel. Cela suppose qu’il ne fasse pas grève, comme à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris l’année dernière, car un tel travail est très difficile à effectuer a posteriori. Les informations doivent donc être transmises très régulièrement, au jour le jour. Dans cette perspective, l’informatique est un outil essentiel. Si l’hôpital est informatisé, il est possible d’établir une connexion avec la partie administrative du dossier du malade. C’est beaucoup plus difficile lorsque les dossiers sont remplis à la main.
M. le coprésident Pierre Morange. La MECSS s’est justement intéressée à l’état des systèmes informatiques dans les hôpitaux français, qu’il s’agisse du traitement des données médicales ou administratives. De nombreuses personnes auditionnées ont décrit une situation très précaire – parc informatique inadapté ou vieillissant –, même si des efforts ont été accomplis. Quel est l’état des lieux en ce domaine ? Il paraît notamment nécessaire d’harmoniser les systèmes et de les connecter avec les autorités de tutelle et avec l’assurance maladie.
M. Jacques Métais. Vous faites allusion à l’informatisation du dossier patient.
M. le coprésident Pierre Morange. Et de sa partie administrative.
M. Jacques Métais. Les deux vont de pair.
En ce domaine, je ne dispose pas de chiffres précis. Mais on peut estimer que dans le secteur privé, plus de 90 % des établissements ont informatisé les données médicales et administratives relatives aux patients. Dans le secteur public, seulement un tiers des établissements disposent d’un système intégrant l’ensemble des informations sur la totalité de leurs activités. Ce résultat s’explique par un effet de taille et par la réticence du corps médical du secteur public à se conformer aux exigences d’un système centralisé.
M. le coprésident Pierre Morange. On nous a cité, dans le cadre de la MECSS ou de la Mission d’information sur la gouvernance hospitalière, des pourcentages encore moins élevés, de l’ordre de 5 à 10 %. Par ailleurs, si j’ai insisté sur le problème posé par l’informatisation de la partie administrative du dossier, c’est parce que, dans la réalité, les volets médical et administratif sont souvent déconnectés.
Plusieurs personnes ont également souligné la complexité des échanges informatiques entre hôpitaux ou avec les autorités de tutelle. Certaines situations, à cet égard, sont tout simplement ubuesques. Des progrès ont-ils été accomplis en ce domaine ? Quelles prévisions peut-on faire ? Vous avez évoqué un délai de deux ans pour la mise en place d’outils de comptabilité analytique : cela signifie que l’informatisation de l’administration des hôpitaux est en bonne voie. Pensez-vous que le développement de l’informatique médicale et surtout la communication entre les systèmes procéderont du même agenda ?
M. Jacques Métais. Les progrès, dans ce domaine, seront très largement liés aux aides financières assorties au plan Hôpital 2012. En effet, selon les vœux de M. Xavier Bertrand, qui en est l’initiateur, 20 % des ressources doivent être consacrées aux systèmes d’information. L’agence régionale de l’hospitalisation a la responsabilité de désigner les établissements éligibles à ce plan, et nous avons reçu à ce titre de très nombreux dossiers de la part d’établissements publics et privé. Dans le privé, il s’agit généralement de compléter un système déjà en place, mais dans le public, le projet est souvent de créer un système qui n’existe pas. Les nouveaux financements devraient donc constituer un levier important de progression pour le processus d’informatisation des hôpitaux. Cela étant, il faudra de deux à quatre ans pour changer véritablement les choses. Encore une fois, la culture du budget global n’a pas aidé les établissements publics à envisager une facturation individuelle de leurs services auprès de l’Assurance maladie.
Sur le plan régional, des initiatives ont été prises par certaines agences pour développer une sorte de schéma régional des systèmes d’information hospitaliers ; c’est le cas en Île-de-France. Mais le rôle de l’agence régionale de l’hospitalisation est purement incitatif. Elle peut apporter des financements, mais ne peut pas contraindre un hôpital à s’informatiser si son directeur s’y refuse. S’agissant d’un problème d’organisation interne, et en vertu du principe – légitime – de l’autonomie de gestion des hôpitaux, il appartient à la direction de l’établissement d’en décider.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans la mesure où vous êtes comptables des pathologies traitées, donc des financements, il serait pourtant légitime que les hôpitaux soient astreints à fournir ces informations.
Mme Catherine Génisson. Et si nous exigeons la plus grande rigueur dans la transmission de l’information, je ne vois pas comment nous pourrions éviter d’obliger les établissements à se doter d’un système informatique adapté. La question de l’informatisation des hôpitaux constitue un véritable scandale. Même dans ceux qui se sont dotés d’un système informatique, pendant très longtemps, aucune connexion n’était réalisée entre les volets administratif et médical.
Vous dites qu’il convient de respecter l’autonomie de gestion des hôpitaux, mais il me semble que l’on pourrait imposer des systèmes standardisés selon le type d’établissement. Dans ce domaine, on a pu observer le meilleur comme le pire ; l’hôpital a fait figure de vache à lait, et des centaines de millions de francs ont été gaspillées. Depuis, cette question a le don de me mettre en colère. C’est un immense gâchis qui a entraîné des gains de productivité proche de zéro.
M. Jacques Métais. La « mutualisation » des solutions informatiques est un des principes que nous avons mis en avant pour l’attribution des subventions accordées dans le cadre du plan Hôpital 2012. Nous avons annoncé clairement que les financements seraient essentiellement attribués à des solutions harmonisées par territoire de santé ou par catégorie d’établissement.
Il faut savoir que la politique du ministère de la santé au sujet des systèmes d’information a manqué de stabilité. Pendant la décennie 1980, la décision avait été prise de procéder à l’informatisation des hôpitaux au niveau régional, avec l’aide des centres régionaux d’informatique hospitalière (CRIH). Ce fut un échec. En 1989, une circulaire du directeur des hôpitaux a traduit un changement de doctrine : chaque hôpital pouvait désormais décider en toute indépendance. À nouveau, ce fut l’échec. Aujourd’hui, une formule intermédiaire a été adoptée : on incite vivement les établissements à informatiser leurs activités, mais avec des solutions mutualisées. Les industriels du secteur ont d’ailleurs regretté tous ces changements de politique. Ils répugnaient en particulier à investir dans le développement de systèmes différents d’un hôpital à l’autre. C’est pourquoi la plupart des systèmes intégrés présents sur le marché sont d’origine anglo-saxonne, car ils ont déjà été rentabilisés sur un marché très large – en particulier aux États-Unis. Pour autant, ils ne fonctionnent pas toujours. En effet, en cherchant à appliquer aux réalités hospitalières françaises, sans préparation ni formation des personnels, des systèmes typiquement anglo-saxons – qui, pourtant, donnent de très bons résultats dans plusieurs centaines d’hôpitaux étrangers –, certains établissements, y compris de grands CHU, ont connu des échecs très coûteux.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous l’avez compris, nous sommes partis d’un cas particulier – et nous en étudierons d’autres dans les semaines à venir – pour tenter de tirer de nos observations des enseignements généralisables. À cet égard, vos propos nous aident à mettre en perspective tout ce que nous avions pu noter lors d’auditions précédentes. L’étude de la situation du Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a ainsi été l’occasion d’évoquer différents problèmes sur lesquels je souhaite revenir afin de savoir s’ils peuvent également concerner d’autres établissements. Bien sûr, certains dysfonctionnements sont spécifiques au Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye : les soupçons d’irrégularités sur la passation de marchés, dont la presse commence à faire état, en sont le meilleur exemple. Mais il y en a d’autres.
Ainsi, l’analyse des documents qui nous ont été transmis par la chambre régionale des comptes ou le ministère des finances nous conduit à nous interroger sur la sincérité des comptes. L’expression est forte, mais nous avons, par exemple, observé des imputations d’une année sur l’autre de la taxe sur les salaires qui rendent plus difficile l’analyse financière.
Une autre particularité de cet établissement, qui a été source de dysfonctionnements sur une longue durée, est la question de la fusion plus ou moins réussie – ou ratée – entre les sites de Poissy et de Saint-Germain. Quels enseignements peut-on en tirer ?
Enfin, nous avons le sentiment que le mode de gestion de l’établissement a conduit à ce qu’une situation défavorable perdure au cours du temps. À cet égard, il semble que les aides financières qui lui ont été régulièrement accordées ne l’ont pas incité à prendre les mesures radicales qui lui auraient permis de s’en sortir.
Des difficultés semblables permettent-elles d’expliquer la situation d’autres établissements de notre pays ?
M. le coprésident Pierre Morange. Vous avez rappelé que les directeurs d’établissement étaient responsables de la mise en œuvre du projet médical, mais aussi des préconisations formulées par l’agence régionale de l’hospitalisation en tant qu’autorité de tutelle stratégique. Dans ce but, il doit pouvoir exercer une gestion dynamique de ses effectifs. Or celle-ci semble parfois se heurter à certaines structures centrales comme le Centre national de gestion, dont la réactivité ne s’inscrit pas dans le même temps. Cela peut poser des problèmes lorsque l’agenda est contraint, notamment lorsqu’il s’agit d’appliquer un plan de retour à l’équilibre financier. Par ailleurs, le directeur d’établissement ne devrait-il pas disposer de marges de manœuvre plus importantes en matière de gestion des ressources humaines – dans le respect, bien sûr, du statut de la fonction publique hospitalière ?
M. Jacques Métais. En application d’une réglementation parfois difficile à comprendre, les marchés des hôpitaux publics ne font pas partie du domaine de tutelle de l’agence régionale de l’hospitalisation, mais relèvent du préfet de département, par l’intermédiaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). La situation va changer avec la mise en place des agences régionales de santé, mais pour l’instant, ces questions ne remontent pas à l’agence régionale de l’hospitalisation. Si l’administration centrale estime que les règles concernant les marchés publics n’ont pas été respectées, elle peut évidemment commanditer une inspection générale à la suite de laquelle, le cas échéant, un recours sera formé devant la cour de discipline budgétaire.
Lorsque nous avons été informés que les marchés du Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain n’avaient peut-être pas été passés dans des conditions normales, j’ai incité, en accord avec la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la santé, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à faire une inspection. Celui-ci m’a informé par la suite qu’il souhaitait transmettre les résultats au procureur de la République. Je lui ai donné mon aval – dont, en l’occurrence, il pouvait très bien se passer. Nous étions en effet d’accord pour estimer qu’il appartenait au procureur d’apprécier si certains éléments de ce rapport étaient de nature à mettre en cause un responsable.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pour l’instant, nous en sommes donc là : une procédure est lancée sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
M. Jacques Métais. Exactement. Quant à la sincérité des comptes, elle peut être appréciée à plusieurs niveaux. Au temps du budget global, quand le budget était limitatif, une pratique courante consistait à reporter les charges en payant l’année suivante une facture de l’année en cours. Est-ce une insincérité ? Oui, de toute évidence. L’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a eu recours à cette technique, qui peut paraître assez naturelle à un établissement, voire un élu local, dont le budget est dépassé.
M. le coprésident Pierre Morange. Chez un élu local, la chose est rare, tout de même.
M. Jacques Métais. Sans doute, mais cela peut arriver. Quoi qu’il en soit, un certain nombre d’établissements hospitaliers publics connaissant des difficultés financières ont agi de la sorte, et c’était le cas de l’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye avant l’institution de la tarification à l’activité. Il masquait ainsi des déficits en les reportant sur l’année suivante. Toutefois, nous n’avons pas eu connaissance de cas d’insincérité dans l’affectation des dépenses. En ce qui concerne la taxe sur les salaires, le problème vient plutôt du fait qu’elle n’était pas payée, alors qu’il s’agit d’une dépense obligatoire – le défaut de paiement peut d’ailleurs être sanctionné par une forte amende. Mais d’une manière générale, je n’ai pas connaissance d’un problème d’insincérité des comptes en dehors de la pratique du report des charges. Cette dernière est tout à fait anormale, je le reconnais, puisqu’elle implique qu’un établissement dépense plus que ce dont il dispose – jusqu’au jour où cela n’est plus possible.
Le troisième problème que vous avez évoqué est la difficulté pour les directeurs successifs de gérer la fusion décidée en 1997. Le précédent directeur de l’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui est resté plus de dix ans, n’était pas en phase avec les élus avec lesquels il devait travailler. La situation était d’autant plus compliquée que deux maires étaient principalement concernés : celui de Poissy et celui de Saint-Germain. Progressivement, les difficultés ont été telles que le directeur a fini par se réfugier dans une certaine inaction : ne pouvant agir à sa guise, il n’a plus cherché à changer l’existant. Je n’ai pas observé directement ce processus, mais je l’ai compris a posteriori. Ainsi, lorsque je suis arrivé dans la région, j’ai considéré que ce directeur était « grillé », c’est-à-dire qu’il se trouvait dans une situation où il ne pouvait plus agir, ni dans un sens, ni dans l’autre. Il avait perdu la confiance des élus, de certains médecins et d’une partie de la communauté hospitalière. Toutefois, les agences régionales de l’hospitalisation n’ont pas la possibilité de prendre des sanctions ou des mesures vis-à-vis des médecins ou des directeurs d’hôpitaux ; nous ne pouvons qu’inciter l’administration centrale à le faire. Il m’est ainsi arrivé, dans cette région comme dans d’autres, de demander le déplacement d’un directeur pour incompétence, lorsque j’estimais que son maintien serait nuisible à la structure placée sous ses ordres. J’ai donc demandé avec insistance que l’ancien directeur du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye soit déchargé de ses fonctions, et après un certain délai, j’ai obtenu gain de cause.
Le problème est que cette inaction objective avait nui aux intérêts de l’établissement, qui n’avait plus de projet et ne savait plus où il allait. Une démotivation s’était installée à tous les niveaux, des « parts de marché » avaient été perdues, la situation financière n’était pas assainie et les problèmes d’organisation interne n’étaient pas réglés. Ainsi, un des principaux enseignements de l’audit que j’avais commandé en 2006 était que l’hôpital ne disposait d’aucun contrôle budgétaire – sans même parler de comptabilité analytique. Pour un établissement disposant d’un budget de 250 millions d’euros, cela paraît stupéfiant.
Quant à la fusion, si elle n’a pas réussi, c’est parce que les deux établissements ne savaient pas où ils allaient. En outre, le projet initial était fondé sur des opinions contradictoires, et aucun des élus n’en attendait la même chose. Or comme l’a dit un homme célèbre, on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’âne de Buridan l’a payé de sa vie…
M. Jacques Métais. La seule façon de s’en sortir était de reconstruire l’hôpital sur un autre site. C’était d’autant plus justifié que l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye, situé dans des bâtiments historiques, est impossible à moderniser. Quant à celui de Poissy, dont les installations ne respectent pas toutes les normes de sécurité, il pourrait certes être mis aux normes, mais à un coût tel que le résultat serait peu satisfaisant. Le seul projet autour duquel tout le monde pouvait se mobiliser était donc la reconstruction – à condition qu’elle soit effectuée sur un troisième site.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je comprends vos propos sur l’inaction prolongée du directeur général. On peut également parler d’un blocage dû à une indécision politique. Mais la tutelle n’a-t-elle pas aussi fait preuve d’inaction prolongée ? Pendant très longtemps, en effet, on a donné chaque année à l’hôpital les moyens de persévérer dans l’inaction.
M. Jacques Métais. Si sous le terme de « tutelle » vous incluez également le ministre, alors la réponse est oui. En effet, en 2002 ou en 2003, l’agence régionale de l’hospitalisation avait déjà commandé une mission d’audit, laquelle avait conclu qu’il était nécessaire de reconstruire l’hôpital sur un site tiers. Cette solution avait donc déjà été envisagée, et pourtant, trois ministres successifs ont pris des positions contraires. On a perdu beaucoup de temps.
J’en viens aux aides exceptionnelles. De 2004 à 2008, l’agence régionale de l’hospitalisation a versé 50 millions d’euros à l’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, ce qui est un montant considérable. Cet établissement est celui qui a été le plus aidé dans la région, et pour quel résultat ? Un déficit de 32 millions d’euros en 2008, qui dépasse tous les records.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous avez évoqué la logique d’inaction à laquelle les responsables de l’hôpital avaient été structurellement contraints…
M. Jacques Métais. Je ne les excuse pas en disant cela. Un directeur peut mettre sa démission dans la balance pour imposer ses vues.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous ne sommes de toute façon pas ici pour distribuer des bons ou des mauvais points, et encore moins pour instruire un procès. Nous cherchons à analyser, à comprendre, puis à établir des préconisations générales de façon à instaurer une dynamique vertueuse, dans l’intérêt de la santé de nos concitoyens et d’une bonne utilisation de l’argent public.
Mais la nouvelle équipe, désormais porteuse d’un beau projet d’avenir, a mis en œuvre un certain nombre de mesures qui auraient très bien pu être prises plus tôt. On se demande pourquoi l’attribution d’aides supplémentaires n’a pas été accompagnée de mesures correctrices destinées à limiter les dégâts.
Par ailleurs, qu’en est-il de ma question sur le centre national de gestion ? N’est-il pas contradictoire de demander à des directeurs d’établissement de prendre des initiatives en faveur de l’équilibre financier sans leur donner les moyens de gérer leurs ressources humaines de manière autonome ?
M. Jacques Métais. Il existe aujourd’hui une liste d’établissements importants – incluant notamment les CHU, mais aussi certains hôpitaux généraux – dont les directeurs sont nommés pour une période de quatre ans. À l’issue de ce délai, leur activité est évaluée et une décision est prise sur l’opportunité de renouveler leurs fonctions. C’est ce que l’on appelle la liste des postes en détachement, et bien entendu, l’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en fait partie. Autrement dit, lorsque le nouveau directeur a été nommé, je lui ai donné sa lettre de mission, des objectifs annuels, et je lui ai clairement indiqué que je prononcerais, en cas d’échec, un avis défavorable au renouvellement de son mandat. Il m’est déjà arrivé de donner un tel avis à propos du directeur d’un établissement important, mais – voyez comme notre système est compliqué – je n’ai pas été suivi au niveau national, et notamment par le centre national de gestion. D’une manière générale, en matière de gestion de ressources humaines, le service public éprouve de grandes difficultés lorsqu’il s’agit de sanctionner quelqu’un.
M. le coprésident Pierre Morange. Je pensais moins au directeur qu’aux cadres placés sous ses ordres. La MECSS a pris acte des mesures non négligeables qui ont été mises en œuvre par l’hôpital pour réaliser des économies. Mais pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés, le directeur devrait avoir la possibilité de recruter ou, au contraire, de remettre à la disposition du centre national de gestion des cadres hospitaliers qu’il juge inadaptés à la fonction qu’ils occupent.
M. Jacques Métais. À cet égard, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires apporte des changements. Elle indique en effet que les directeurs d’établissement ne seront pas obligatoirement recrutés dans le cadre du statut des directeurs d’hôpitaux. Sur ce point, les décrets d’application sont en cours de rédaction. Par ailleurs, la loi donne au directeur général de l’agence régionale de santé le pouvoir de nommer ces directeurs. Le rôle de l’institution régionale sera donc beaucoup plus important dans le nouveau système. Reste à évaluer ce dispositif : tout dépendra de l’application qui en est faite.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Merci, monsieur le directeur, pour ces informations très intéressantes.
*
Audition, à huis clos, de M. François Devif, directeur chez Capgemini Consulting, responsable de la mission d’audit du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons maintenant le plaisir d’accueillir M. François Devif.
Le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye étant l’un des hôpitaux les plus déficitaires de France, nous cherchons à comprendre les raisons de cet état de fait afin d’en tirer des préconisations dans le cadre d’une réflexion plus générale sur le fonctionnement de l’hôpital.
Vous avez la parole, monsieur Devif, pour un propos liminaire sur l’audit que vous avez conduit.
M. François Devif, directeur chez Capgemini Consulting, responsable de la mission d’audit du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Nous avons été mandatés pour réaliser un audit sur le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye entre juin et octobre 2008 puis, à l’occasion d’un autre appel d’offres, pour accompagner la mise en œuvre du plan de retour à l’équilibre financier défini à l’occasion de cet audit. L’audit initial avait, en effet, deux ambitions : premièrement, dresser un état des lieux de la situation de l’établissement au terme du deuxième quadrimestre 2008, deuxièmement, qualifier avec l’établissement les meilleures options de son retour à l’équilibre financier, une injonction de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France demandant au directeur général, M. Gilbert Chodorge, de proposer, pour octobre au plus tard, un plan de redressement pour la période 2008-2012.
L’établissement était très mal en point sur le plan financier. Il souffrait d’un fort déficit, qui s’était aggravé en trois paliers : un premier déficit s’était constitué sur la période 2001-2004, il était brutalement passé de 11 millions d’euros à 27 millions d’euros en 2007 et un accroissement de celui-ci était prévu pour la fin 2008, le portant à 37 millions d’euros, soit près de 14 % du budget de l’hôpital.
Nous n’avons pas eu les éléments d’analyse sur la période 2001-2004 permettant de savoir comment le premier déficit de 10 millions d’euros s’était constitué. En fait, facialement, ce déficit n’existait pas, il était masqué par des charges qui n’avaient pas été honorées sur l’exercice en question et qui l’ont été ultérieurement, en particulier en 2006.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pourquoi ne disposiez-vous pas d’éléments pour cette période ? Étaient-ils absents ou ne vous ont-ils pas été donnés ?
M. François Devif. Tous les éléments n’étaient pas à notre disposition et nous avons focalisé notre analyse sur le palier des années 2006 et 2007 ainsi que sur les anticipations pour 2008.
Le système d’information de l’établissement est tout juste installé et, par le passé, il n’était pas besoin, dans le cadre du budget global, de recenser l’activité avec autant de soin que maintenant.
Le premier déficit résultait notamment de retards de paiement de la taxe sur les salaires, qui sont intervenus brutalement en 2006.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Quels étaient les autres postes responsables du déficit ?
M. François Devif. L’aggravation complémentaire provient, d’une part, d’une diminution des recettes d’activité au fur et à mesure de la mise en place, sur la période 2004-2008, de la tarification à l’activité (T2A), d’autre part, d’une non-maîtrise de la masse salariale : pour la seule année 2006, il y a eu un accroissement du titre I, c’est-à-dire des dépenses de personnel, de 5 millions d’euros, ce qui correspondait à un glissement-vieillesse-technicité (GVT) complètement hallucinant.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment ces 5 millions d’euros étaient-ils expliqués dans les documents dont vous avez eu connaissance ?
M. François Devif. Ils n’étaient pas expliqués car ils n’étaient pas tracés.
Une autre difficulté à laquelle nous avons été confrontés est la discontinuité de l’équipe de pilotage de l’hôpital. Celle que nous avions en face de nous était installée depuis 2007, voire pour une partie, depuis début 2008.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous n’avez pas retrouvé des interlocuteurs de l’époque antérieure qui auraient pu répondre à vos questions ?
M. François Devif. À ce stade, nous ne faisions pas une rétrospective des causes du déficit et de son accroissement. Nous avons mis en exergue que le déficit facial 2006 avait été creusé au cours de toute la période 2001-2004 et maintenu jusqu’en 2006. Nous avons ensuite analysé l’écart complémentaire en 2007. Puis, nous avons commencé à nous interroger sur les raisons d’un nouvel accroissement du déficit en 2008 et à chercher où étaient les dérives.
M. le coprésident Pierre Morange. Il n’y avait aucune comptabilité des ressources humaines !
M. François Devif. Non. Nous avons également découvert un mauvais approvisionnement des comptes épargne-temps. Non seulement ces derniers n’étaient pas payés, mais ils n’étaient pas non plus intégrés dans les comptes de façon à pouvoir être rattachés à l’exercice qui les concernait et neutralisés.
Pour la taxe sur les salaires, il n’y a pas eu non plus de provision. L’absence de paiement de cette taxe n’a visiblement ému personne au sein de l’établissement. Il est étonnant que le rattrapage ait pu être fait en une seule année.
Lors de la première tentative de comptabilité analytique au sein du centre hospitalier, en 2006, les arriérés de taxe sur les salaires des trois années antérieures ont été embarqués dans les coûts, ce qui montre qu’il n’y avait aucune analyse de la dépense annuelle de l’établissement, ce qui n’est pas recevable d’un point de vue comptable.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Cette absence de gestion est-elle la marque d’une incompétence ou a-t-elle favorisé le développement de pratiques moins innocentes ?
M. François Devif. Les travaux que nous avons été amenés à faire, en particulier avec la directrice des affaires financières de l’époque, ont montré qu’il s’agissait plus d’une incompétence que d’une intention de nuire ou d’une volonté d’engager d’autres pratiques.
N’ayant pas livré, dans le cadre de notre mission, d’audit sur l’ensemble des achats de l’établissement, je n’ai aucun élément objectivé permettant de dire si, dans le cadre de la poursuite engagée par le procureur sur les marchés publics de l’époque, il y a eu ou non une intention particulière de détourner des fonds.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’une des raisons évoquées pour expliquer le dysfonctionnement en termes de gestion de l’établissement hospitalier est la décision de fusion des deux établissements.
M. François Devif. Il existe encore aujourd’hui une forte opposition de culture entre les deux sites. Celle-ci est prégnante au sein de l’équipe médicale et diffuse dans l’ensemble du personnel de chacun des deux sites.
D’un côté, il y a un site à vocation universitaire, doté d’une forte technicité et d’un plateau technique de haut niveau, qui considère que la valeur ajoutée de l’hôpital public est dans sa capacité à assumer des recours.
De l’autre côté, le site de Saint-Germain-en-Laye assume beaucoup plus, par sa situation, un rôle d’interface avec la ville et cherche à assurer un continuum de soins avec un hôpital un peu hors les murs et suivant une relation plus naturelle avec son environnement.
Au-delà de cette opposition de culture, il y a eu, notamment au cours de la période 2004-2006 – cela a été exprimé de manière très forte par les représentants du personnel et par l’ensemble des chefs de service que nous avons auditionnés – une volonté d’étouffer l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye au bénéfice de celui de Poissy : on a ralenti l’activité du premier en n’étant pas aussi réactif pour assurer les remplacements de personnel.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. D’où émanait cette volonté ?
M. François Devif. Je ne faisais pas partie de la mission à l’époque mais il est clairement exprimé dans les témoignages que la direction générale souhaitait accélérer la fusion car elle considérait que la coexistence de deux sites était génératrice de surcoûts.
En fait, de nombreux freins existaient. Outre l’opposition de culture au sein du corps médical, il y avait aussi celle, plus politique, des communes, qui défendaient l’une et l’autre l’offre de soins pour leur population. Ces tensions sont profondément ancrées dans le vécu de l’un et l’autre site.
Je pense que le site de Poissy n’a plus, aujourd’hui, la volonté d’absorber celui de Saint-Germain-en-Laye. Il est aligné sur la perspective de la création d’un nouvel hôpital sur Chambourcy.
À Saint-Germain-en-Laye, on continue à craindre que toute action engagée lors de la période transitoire mène à un déport de l’activité au bénéfice de Poissy. Toute proposition de fermeture ou de restructuration se heurte à des réactions très fortes.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La perspective d’un regroupement des deux établissements sur un seul site ne risque-t-elle pas de décourager la mise en œuvre des préconisations que vous n’avez certainement pas manqué de faire ?
M. François Devif. Nos préconisations ont un peu la forme d’un plan de retour à l’équilibre financier pour la période 2008-2012 : elles se décomposent en 95 mesures articulées autour de cinq axes.
Le premier axe porte sur la valorisation de l’activité, autrement dit la prise en compte des exigences de la T2A et de l’alignement des fonctionnements internes, à la fois des fondamentaux – système d’information, dialogue de gestion – et de l’implication de chacun des acteurs dans le recueil de cette activité – dans sa codification et dans sa valorisation.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Qu’avez-vous constaté dans ce domaine ?
M. François Devif. Nous avons constaté une sous-valorisation de l’hôpital de l’ordre de 12 millions d’euros.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment parvenez-vous à mesurer une sous-valorisation ? Il n’est pas facile de mesurer l’invisible.
M. François Devif. L’invisible laisse parfois des traces. Une analyse fine de l’ensemble des séjours, des sondages réalisés périodiquement sur des services de soins de façon à appréhender la partie capturée par le système d’information et celle qui lui échappe, des confrontations entre des agendas de rendez-vous de médecins et le décompte des consultations résultant de ces rendez-vous nous ont permis, pas à pas, de décomposer, sur un certain nombre de sujets, les manques au niveau des laboratoires, de l’imagerie et des séjours hospitaliers. Nous avons ensuite essayé d’identifier, dans tout le schéma, à quel niveau se situait la défaillance. Elle peut être dans le recueil initial qui est à la charge des praticiens. Elle peut aussi être dans le système d’information. La production d’une facture hospitalière n’est possible, comme vous le savez, que par la réunion d’un certain nombre d’éléments et, maintenant, de différents sous-systèmes. Dans l’établissement hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, les interfaces entre ces différents sous-systèmes étaient, pour la plupart, défaillantes, avec beaucoup de perte en ligne. Nous avons constaté des stocks d’actes réalisés, par exemple, aux urgences que l’on ne retrouvait plus du tout dans la consolidation pour facturation en aval du système d’information.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Cette sous-valorisation explique quasiment tout le déficit !
M. François Devif. Le déficit tel qu’il était anticipé en août 2008 était de 37 millions d’euros. Je n’en explique qu’un tiers.
M. le coprésident Pierre Morange. Selon le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, la sous-valorisation que vous évoquez explique la moitié du déficit cumulé estimé à quelque 150 millions d’euros. Les 10 ou 12 millions de perte de recettes en ligne par an dont vous parlez représentent 60 millions sur la demi-douzaine d’années qui se sont écoulées. Ce raisonnement vous semble-t-il cohérent ?
M. François Devif. Oui, à cette nuance près qu’il ne tient pas compte du fait que la montée en puissance de la T2A a créé et accéléré ce déficit. En 2004, le déficit en termes de qualité est nul, par construction, puisqu’on est en budget global.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La T2A ne crée pas le déficit. Elle le fait apparaître !
M. François Devif. Ce que la T2A objective, c’est une inadéquation entre la dotation de l’établissement et son niveau d’activité. D’un point de vue comptable, il n’y a pas de déficit en 2004. Celui-ci s’accroît, de 2004 à 2008, au fur et à mesure que le pourcentage d’application de la T2A devient important. Le déficit est maximum en 2008. Il est à mi-parcours, si l’on suit la trajectoire de montée en puissance de la T2A, en 2006, de l’ordre de 6 millions d’euros.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. D’aucuns reprochent à la T2A d’inciter les établissements à orienter leurs facturations dans un sens favorable à de meilleures ressources et à surestimer certaines activités par rapport à d’autres. Cela peut-il se produire ?
M. François Devif. Cela peut se produire en théorie mais, en pratique, c’est plus compliqué.
Le secteur public et le secteur privé ne sont pas en mesure de tirer parti de la même façon d’une interprétation un peu décalée de la T2A. Il est beaucoup plus facile pour une clinique privée que pour un hôpital public de sélectionner ses patients ou de ne prendre en charge que certains types d’activités. Par ailleurs, le financement T2A et le niveau de marge que l’on peut espérer en dégager ne sont pas identiques d’un groupe homogène de séjour (GHS) à un autre. Il peut dès lors y avoir intérêt à prendre certains GHS plutôt que d’autres de façon à maximiser son profit dans le cadre de l’activité réalisée. Dans le secteur public, qui ne peut pas sélectionner ses patients, la question est de savoir quel est le groupage favorable à l’établissement et quels sont les éléments permettant d’optimiser la valorisation de l’activité réalisée.
En théorie, on peut penser que la T2A incite à identifier les critères discriminants permettant d’orienter les séjours vers les GHS les plus rémunérés. Mais le rythme des réformes intervenues depuis sa mise en œuvre n’a pas permis que cela se passe. Ces réformes ont été très lourdes puisque l’ensemble des critères déterminant le groupage d’un séjour dans tel ou tel GHS ont complètement été modifiés. C’est donner beaucoup de crédit aux personnels hospitaliers que de croire qu’ils ont réussi à absorber, au fil des réformes, l’ensemble de ces modifications.
De 2006 à 2008, il y a eu un apprentissage qui a pu permettre à certains de solliciter auprès des médecins producteurs de soins les éléments permettant de maximiser le groupage, en employant des discours du genre : « Êtes-vous sûr qu’il n’y a pas tel critère complémentaire, qui aurait un impact important sur votre valorisation ? » ou encore « Dans la valorisation qui pourrait être faite de votre activité qui est aujourd’hui déficitaire, on pourrait espérer que, si vous vous orientiez plus vers ce type de GHS, la situation devienne plus équilibrée ». Dans l’hôpital public, je n’ai pas vu de médecins producteurs de soins céder à ce genre de sirènes.
Dans une démarche de contrôle de gestion ou de recherche d’un codage juste de l’activité réalisée, il est certain qu’un bon gestionnaire et un bon directeur de l’information médicale vont s’employer à recueillir l’ensemble des éléments permettant d’obtenir une juste valorisation. Que la T2A, qui met en avant des critères valorisants, ait pu être une incitation au recueil de ce type de critères, cela fait peu de doute. Mais je ne suis pas convaincu aujourd’hui qu’au sein d’un hôpital public, les médecins soient de nature à se laisser embarquer sur ce terrain.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Que pouvez-vous nous dire des systèmes d’information qui ont été mis en place et de la formation et de la compétence de celles et ceux qui les actionnent ?
M. François Devif. Le système d’information dans les établissements de santé s’est développé, dans le secteur privé comme dans le secteur public, au fur et à mesure que son importance dans l’équilibre financier de l’établissement s’est accrue.
Le secteur privé a agi beaucoup plus tôt puisqu’il était dans une logique de rémunération à l’acte. Il y avait directement intérêt. Les établissements privés ont mis en place très tôt un système d’information à la fois vascularisé et suffisamment intégré pour que l’ensemble des éléments de l’activité puisse être dûment valorisé.
Dans le secteur public, l’informatique hospitalière n’a eu de sens que par rapport à ce qu’elle a apporté dans la production de soins. Ce secteur a développé des outils qui étaient des aides à l’exercice médical et s’est focalisé sur les spécialités pour lesquelles l’informatique a le plus grand rapport : l’imagerie et la biologie. Dans toutes les spécialités cliniques, l’informatique est, de prime abord, d’un piètre recours. Son intérêt apparaît quand on s’intéresse au continuum de soins : quand on a besoin d’accéder à un dossier patient, il est beaucoup plus simple que celui-ci soit dématérialisé. C’est par ce biais que, progressivement, l’informatisation s’est imposée à l’hôpital public.
Son application dans le domaine financier est récente pour le secteur public. Ce n’est qu’à l’occasion du passage en T2A qu’il a pris conscience que le recueil de l’information et son exploitation pour consolider les fins de facturation devenaient une absolue nécessité. L’hôpital public et en particulier le Centre hospitalier intercommunal Poissy-Saint-Germain-en-Laye ne se sont pas du tout préparés à ce changement : non seulement, personne n’a suivi de formation pour comprendre les modifications apportées par cette réforme, mais aucun crédit n’a été consacré au devenir de cette réforme. Les dirigeants considéraient que la T2A ne s’imposerait pas au secteur public à terme.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Cette croyance résultait-elle d’une négligence, d’un scepticisme, d’une incompétence ou d’une volonté particulière ?
M. François Devif. Elle résultait aussi d’un courant politique au sein de la profession qui n’était pas convaincue qu’une tarification à l’activité soit la meilleure façon de permettre à l’hôpital public d’assurer ses missions.
Au début de la mise en place de la T2A, il n’était pas encore envisagé d’isoler certaines missions d’intérêt général qui sont, par construction, des facteurs de surcoût. Ce qui a toujours été redouté au sein de la Fédération hospitalière de France (FHF) et dans les établissements publics, c’est que la T2A soit, à terme, la même pour le secteur privé et pour le secteur public. Ce dernier avait l’ambition et le besoin, d’une part, de faire reconnaître un périmètre d’activités complémentaire de celui assumé par le secteur privé n’ayant pas vocation à entrer dans une tarification commune à l’ensemble des deux secteurs, d’autre part, de jouer la montre quant à des réorganisations et des restructurations le rendant économiquement plus concurrentiel de l’offre portée par le secteur hospitalier privé.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous pensez qu’un courant politique a souhaité saboter la mise en place de la T2A ?
M. François Devif. Au moment où la T2A a été mise en vigueur, j’étais salarié de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) et en charge du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Je participais, auprès de l’Assurance maladie comme du ministère de la santé, aux commissions qui préparaient l’ensemble des décrets d’application de ce PMSI et qui allaient donner naissance à la mission T2A. J’ai eu l’occasion de travailler, pendant plusieurs années, avec Mme Martine Aoustin qui a ensuite pris ses fonctions au sein du ministère.
À ce moment-là, la demande du secteur privé de basculer vers un système de rémunération à l’activité était très forte. Le financement de moyens accordé au secteur public ne lui paraissait pas légitime et la T2A lui semblait un bon moyen de rééquilibrer les dotations.
Le secteur public était beaucoup plus circonspect : d’une part, il demandait à ce que soient définis des champs comparables ; d’autre part, il entendait se donner les moyens d’observer sur le terrain la réalité des coûts. Comme vous le savez, la T2A résulte d’une étude nationale de coûts sur un échantillon d’établissements. Ces coûts n’étaient pas définis par des experts ou sur la base de protocoles de soins définis a priori correspondant à une prestation-type prise en charge par la collectivité mais résultaient d’une observation sur le terrain du coût de revient général mâtiné de quelques aménagements tarifaires permettant d’inciter ou de freiner le développement de telle ou telle activité.
Il y a eu un frein à la mise en place de la T2A du côté du secteur hospitalier public, du moins tant que les points que j’ai cités n’ont pas été levés. Vous n’êtes pas sans savoir que l’Étude nationale des coûts à méthodologie commune (ENCC) lancée dernièrement, a dû être arrêtée, renvoyant à beaucoup plus tard une convergence qui était initialement prévue pour 2012.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le fait d’avoir une opinion nuancée sur la T2A peut difficilement justifier une forme d’obscurantisme dans la gestion même de l’hôpital allant jusqu’à l’absence totale d’une comptabilité analytique de base. Une chose est de contester des modes de gestion, une autre est de ne pas vouloir savoir ce qui se passe.
M. François Devif. Nul n’étant supposé – et encore moins un directeur d’établissement hospitalier – ignorer la loi, il n’est pas normal que le premier effort de comptabilité analytique, qui s’est traduit par un échec au sein du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, n’ait été envisagé qu’en 2006.
Lorsque nous sommes arrivés et que nous avons demandé communication de ce document, la directrice financière nous a rétorqué qu’il n’en existait plus aucune copie ni aucune trace informatique, compte tenu des dégâts qu’il avait causés. Nous avons, néanmoins, pu récupérer un exemplaire papier dont disposait un des médecins de l’établissement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Ce genre de dysfonctionnement de base se rencontre-t-il dans d’autres établissements ?
M. François Devif. Plus aujourd’hui. Si l’hôpital public a tardé dans la mise en place de comptabilités analytiques, aujourd’hui des comptes de résultat par pôle ou, de manière plus détaillée, par service, sont disponibles dans la quasi-totalité des établissements publics. Ces comptes sont cependant plus ou moins fiables puisqu’il n’y a pas, par principe, de comptabilité analytique juste. Il n’en est que d’acceptée par la collectivité, qui reconnaît une certaine équité des clés de répartition qui ventilent les charges entre les services.
La reconnaissance de l’acceptabilité d’une comptabilité analytique résulte d’un dialogue de gestion qui doit être nourri et qui s’inscrit donc dans le temps. Celui-ci aurait dû être initié dès 2004 pour accompagner les grandes transformations résultant de l’introduction de la T2A. Il n’est pas normal que le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n’ait mis en œuvre, ni le système d’information qui était nécessaire pour le recueil de l’information, ni les éléments de base permettant un dialogue de gestion éclairé entre administratifs et professionnels de santé visant à orienter leurs pratiques au gré des observations et des résultats qui seraient apparus à travers cette comptabilité analytique.
M. le coprésident Pierre Morange. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales nous a dit ne pas avoir trouvé, dans le cadre de l’audit portant sur les achats de l’établissement, de documents antérieurs à 2005, ce qui place le Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye en infraction par rapport à la nécessaire conservation des documents pendant dix ou trente ans suivant le type de marchés réalisés. Avez-vous rencontré d’autres difficultés pour obtenir des documents ?
M. François Devif. D’une façon générale, l’accès à l’information quand nous sommes arrivés dans l’établissement, en juin 2008, a été très compliqué, tant au niveau des éléments financiers que de l’activité médicale de l’établissement. Le directeur de l’information médicale (DIM) était visiblement omnipotent : il était le seul à disposer d’informations sur l’activité réalisée et il en restituait, à l’occasion, des éléments partiels, arguant que leur complexité rendait leur partage difficile. On était dans une culture où seul un petit nombre d’éclairés étaient en mesure de comprendre ce qui se passait dans l’établissement et il fallait être médecin pour être en mesure de bien l’analyser.
Il n’y avait aucun pilotage, aucune responsabilisation des acteurs. Chacun travaillait dans son service en aveugle, considérant bien faire son travail. Et aucun élément ne lui permettait d’en douter.
Nous avons dû tout reconstruire de A à Z. Nous avons même dû opérer des copies de base pour les retraiter nous-mêmes. Comme je l’ai déjà indiqué, nous ne disposions d’aucuns éléments de suivi d’engagements budgétaires ni de comptabilité analytique. Après l’expérience malheureuse de 2006, la direction financière ne se sentait plus l’autorité ni la légitimité pour réamorcer une nouvelle démarche de cette nature, tellement elle avait subi de critiques de l’ensemble du corps médical.
Même si nous avions voulu discuter en 2008 avec les praticiens, nous ne serions pas tombés d’accord. Les chiffres issus des informations dont nous disposions ne correspondaient pas avec ceux qu’eux-mêmes constataient dans leur propre service. Les comptes ne reflétant pas le déficit tel qu’il était réellement, aucun élément ne pouvait faire douter les producteurs de soins de la qualité et de l’efficience de l’activité qu’ils réalisaient.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Notre rôle est d’essayer, à partir du cas du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et d’autres, de tirer des enseignements et des préconisations pour le fonctionnement interne de l’hôpital. Quels sont les dysfonctionnements propres au Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye que l’on ne retrouve pas ailleurs ?
M. François Devif. La spécificité du déficit du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est son décalage dans le temps. Cet établissement a laissé perdurer une situation qui aurait dû être corrigée trois ou quatre ans plus tôt.
Les CHU ont pris le virage beaucoup plus tôt. Mais d’autres centres hospitaliers ont, eux aussi, tardé à s’aligner sur les exigences de la T2A.
Les dysfonctionnements constatés à la mi-2008 sont aujourd’hui en grande partie redressés, ce qui montre que, quand on s’attaque au sujet, il n’y a rien d’inéluctable et que la T2A n’est pas aussi indigeste qu’on le dit pour les établissements publics qui souhaitent s’engager dans cette réforme et la mettre en œuvre comme il se doit.
À l’hôpital public – je le constate dans un certain nombre d’établissements sur lesquels j’ai également travaillé, comme le CHU de Nancy –, c’est la prise en compte de l’ensemble du continuum de soins qui peut rendre possible un gain d’efficience. Le financement de l’hôpital nécessite de créer des filières de prise en charge à travers l’ensemble des services, de l’accueil des consultations externes à l’accueil des urgences, en passant par le plateau technique d’imagerie et de biologie, le bloc opératoire, le service d’hospitalisation et les structures d’aval.
Or, jusqu’à présent, chaque chef de service était tout puissant au sein de sa structure et définissait des stratégies spécifiques à chacune de ces unités, avec un règlement lui aussi spécifique. Lorsqu’ils étaient chirurgiens, ces chefs de service disposaient même de tout un appareil de production complémentaire avec des blocs opératoires qui pouvaient être dédiés par spécialité. Ces moyens lourds et coûteux n’étaient en place que pour une seule et même logique, sans aucune recherche de mutualisation.
La réforme importante à conduire dans les hôpitaux publics est de distinguer entre ce qui relève du spécifique et ce qui relève d’une valeur ajoutée mutualisable et transverse afin de mieux amortir les coûts fixes des grosses structures – imagerie, laboratoires, blocs opératoires – qui pèsent lourdement dans les comptes de résultat. Il faut les mettre au service d’une stratégie générale afin de pouvoir prioriser les actions, les équilibrer d’une spécialité à l’autre et décider collégialement de leur augmentation ou de leur diminution en fonction des besoins de l’activité sans se heurter à un domaine de responsabilité ou d’influence d’un chef de service.
Le gros enseignement que l’on peut tirer du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye comme d’autres établissements est la nécessité de lutter progressivement contre la démultiplication de moyens qui amène chacun de ces moyens à n’être que partiellement exploité et à l’être dans des logiques qui ne sont pas forcément alignées sur la logique même de l’institution.
La réinstallation de ces fonctions transverses, jointe à la création de filières de prise en charge, permettrait un fonctionnement harmonieux et bien dimensionné d’un bout à l’autre de la filière et éviterait la création, à certains endroits, de goulets d’étranglement générateurs de dysfonctionnements ou de transferts onéreux pour la collectivité et, à d’autres endroits, de gisements d’efficience non exploités du simple fait qu’on a souhaité créer une zone de confort pour tel ou tel acteur.
Une des raisons de moindre efficience de l’hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye est un mauvais dimensionnement de ses services de soins : alors qu’il y a 30 lits par étage – ce qui correspond au chiffre optimum en termes de mutualisation de la charge et donc de présence de personnels non médicaux auprès de ces lits, le volume d’activité porté par chaque spécialité de l’établissement ne correspond qu’à une vingtaine de lits, ce qui génère, mécaniquement, chaque nuit un tiers de surcoût. Comme il est compliqué de faire comprendre aux différents acteurs la nécessité d’augmenter leur niveau d’activité de 50 % pour pouvoir prendre en charge les 30 lits, mieux vaut redescendre à 15 lits et coupler le service avec un autre afin de mieux mutualiser les coûts. Mais il faut savoir que cela remet en cause la patrimonialité du service d’hospitalisation.
Ce que j’ai dit des blocs vaut pour les lits. Des décloisonnements sont aujourd’hui nécessaires car ils permettraient des gains d’efficience. Mais cela suppose des choix politiques lourds puisque cela reviendrait à accepter de prendre en charge moins de malades, à charge de trouver une autre solution pour ces patients.
M. le coprésident Pierre Morange. D’où l’intérêt d’un partenariat public-privé.
M. François Devif. Ou d’une communauté hospitalière de territoire.
M. le coprésident Pierre Morange. L’important est que le patient trouve, quel que soit le type de statut, une même qualité de prestation sanitaire et une même prise en charge assurantielle. C’est l’un des objets de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Nous vous remercions, monsieur Devif.
*
Audition, à huis clos, de M. Philippe Ritter, président du conseil d’administration de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, et M. Christian Anastasy, directeur général.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir maintenant M. Philippe Ritter, président du conseil d’administration de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), et M. Christian Anastasy, directeur général.
Je vous donne la parole, monsieur Ritter, pour un propos liminaire sur la mise en place de l’agence et la programmation de ses travaux.
M. Philippe Ritter, président du conseil d’administration de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Je vais, en quelques mots, expliquer les raisons de la création de l’ANAP, puis le directeur général présentera son programme de travail.
Deux structures ont été créées dans le cadre du plan hôpital 2007 : la Mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier (MAINH) et la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier (MEAH). Quelques années auparavant, avait été mis en place le Groupement pour la modernisation du système d’information hospitalière (GMSIH), qui était un groupement d’intérêt public (GIP). Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) santé-solidarité, il est paru utile de réunir, dans une vision commune, ce qui concerne l’investissement, l’organisation et les systèmes d’information, le fait que chacun travaille dans son coin ne paraissant pas la meilleure formule.
Mme Roselyne Bachelot m’a confié la rédaction d’un rapport, que j’ai remis en octobre 2008. Il n’y était plus question d’une agence d’appui à l’« efficience hospitalière », comme indiqué à la commande, mais à la « performance des établissements de santé et médico-sociaux ». Cette évolution de vocabulaire tenait compte des attentes des professionnels, des fédérations, des présidents de commissions médicales d’établissement (CME), des présidents de groupes de travail des chirurgiens hospitalo-universitaires (GTCHU), des directeurs généraux de centres hospitaliers (DGCH) et du secteur médico-social. Tout le monde souhaitait que cette agence ait un périmètre correspondant à celui des agences régionales de santé (ARS) et s’intéresse non seulement à l’hôpital, mais aussi au médico-social afin d’assurer la fluidité des parcours de soins.
Le terme de « performance » nous est apparu plus complet que celui d’« efficience ». L’objectif de l’agence n’est pas simplement d’aider les établissements à atteindre une efficience économique, mais surtout d’assurer la qualité des soins. Dans la mesure où une bonne organisation contribue aussi à améliorer la qualité des soins, ce changement de vocabulaire nous a paru s’imposer.
Par ailleurs, nous avons considéré que l’agence devait apporter un appui et non pas décider à la place de l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH), de l’agence régionale de santé, de l’établissement, voire du ministère. Elle devait être une agence d’expertise et donner un certain nombre de boîtes à outils aux agences régionales de santé et aux établissements dans le cadre de la mission qui sera de plus en plus la leur : utiliser au mieux l’argent public pour répondre le mieux possible aux besoins de santé.
Finalement, c’est un groupement d’intérêt public qui a été créé, regroupant à la fois les directions d’administration centrale concernées, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et l’ensemble des fédérations sanitaires et médico-sociales.
Initialement prévue dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, la création de l’agence a été finalement vue comme un cavalier budgétaire et repoussée de six mois en étant prévue dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Mais nous n’avons pas vraiment perdu de temps puisque, avant même le vote de la loi, nous avons sélectionné un directeur préfigurateur, qui s’est trouvé confirmé par la suite. M. Anastasy a ainsi pu prendre ses fonctions dès le mois d’avril. Nous avons également préparé, pendant cette période, la convention constitutive qui fixe le cadre de fonctionnement de l’ANAP. Dès la publication de la convention constitutive approuvée, Mme Roselyne Bachelot a installé le conseil d’administration, le 26 octobre 2009. L’ANAP est pleinement opérationnelle depuis bientôt un mois.
Malgré les bouleversements induits par la fusion de trois structures qui n’avaient ni les mêmes cultures, ni les mêmes habitudes, ni les mêmes statuts, 2009 a permis un certain nombre d’avancées dont M. Anastasy va maintenant vous parler.
M. Christian Anastasy, directeur général de l’ANAP. Je suis arrivé à l’ANAP le 1er avril 2009. Je dirigeais avant un groupe de cliniques privées, après avoir fait une carrière à la fois dans le secteur associatif et dans le secteur hospitalier public. J’ai toujours travaillé dans le monde de la santé.
J’ai fixé mes objectifs en fonction de la lettre de mission qui m’avait été donnée par les trois ministres. Dans ce métier complexe qui consiste à accompagner et à appuyer les agences régionales de santé et les établissements sans se substituer à eux mais en étant à leur côté, il faut des gens qui partagent des valeurs communes et qui soient organisés de façon simple, selon des critères à la fois d’évaluation et de management, et qui portent des projets.
J’applique une démarche assez pragmatique. Un projet de l’ANAP doit répondre à six critères.
Premièrement, un projet est engagé.
Deuxièmement, le projet est mené à son terme.
Troisièmement, nous essayons de l’évaluer sur le plan économique, c’est-à-dire de déterminer son prix de revient. Je demande à tous mes collaborateurs de préciser le coût des études nécessaires pour cette évaluation. L’ANAP s’est dotée d’instruments permettant de le faire. Je rappelle à tout le personnel que nous travaillons avec de l’argent public et qu’il faut, par conséquent, être en mesure de rendre compte de l’usage que nous en faisons.
Quatrièmement, nous essayons de mesurer l’impact du projet, c’est-à-dire son retour sur investissement.
Cinquièmement, nous essayons de voir si les collaborateurs qui ont travaillé à ce projet ont rehaussé leur niveau de compétence. L’agence est, selon la qualification des sociologues, une entreprise apprenante, c’est-à-dire une entreprise constituée uniquement de cadres qui s’enrichit en permanence de nouvelles compétences.
Sixièmement, nous demandons au client final, qui peut être l’hôpital public, l’établissement de santé privé, l’hôpital privé sans but lucratif participant au service public hospitalier (PSPH), l’agence régionale de l’hospitalisation et, demain, l’agence régionale de santé, s’il est satisfait du travail fourni. Ce dernier peut-il être généralisé grâce à un CD-ROM permettant d’aider utilement les décideurs publics, privés, le gestionnaire de l’établissement ou son collaborateur ?
Ces six critères d’appréciation sont, à la fois, des critères de management d’un projet et des critères d’évaluation de la performance des responsables, depuis le premier niveau jusqu’à celui du directeur général. Ces critères de performance seront connus, affichés, publics, et permettront à des personnes morales comme à des parlementaires d’avoir tous les détails sur les projets engagés.
C’est le premier travail de l’ANAP.
M. Philippe Ritter. Au moment où nous avons décidé de regrouper les trois structures, il y avait 209 chantiers en cours, parfois très ponctuels, dont la liste ressemblait à un inventaire à la Prévert. Nous avons, en fonction des critères d’utilité et d’efficacité des prestations de l’ANAP et, surtout, d’une estimation des retours sur investissement, défini des priorités stratégiques pour 2010.
M. Christian Anastasy. Après avoir mis en ordre les équipes, nous nous sommes employés à hiérarchiser la commande publique qui, comme vient de le préciser M. Ritter, comportait 209 objectifs prioritaires au 1er avril. Six leviers de changement nous ont permis de clarifier notre positionnement, que nous avons fait partager par les grandes directions, dont la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie (UNCAM).
En gros, 72 % des 209 actions ont été engagées. Les 30 % qui n’ont pas pu être menées, soit n’étaient pas conformes aux objectifs de l’ANAP, soit n’entraient pas dans le champ spécifique de ses compétences : elles pouvaient être concurrentes des démarches qui pouvaient être réalisées par la Haute Autorité de santé (HAS), par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) ou par d’autres organismes.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pouvez-vous donner quelques exemples d’actions retenues, le nombre d’établissements concernés par ces actions et le nombre de personnels que compte l’ANAP pour s’occuper de ces actions ?
M. Christian Anastasy. Nous avons essayé de regrouper les projets par grands thèmes. Les 209 chantiers de la commande publique n’étaient pas forcément des actions ou des objectifs. Ils ont été compactés en 73 projets, dont 53 ont été jugés importants.
M. le coprésident Pierre Morange. Un projet concerne-t-il un seul établissement ou plusieurs ?
M. Christian Anastasy. Un projet peut concerner un ou plusieurs établissements. Je vais en mettre six en perspective.
Je citerai un premier exemple qui, bien qu’il ait mobilisé beaucoup de ressources, ne concerne qu’un seul établissement : la cellule de mobilité des personnels à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Le directeur général de l’AP-HM est l’un des rares qui aient attiré notre attention sur le fait que des fermetures de services induisaient des fermetures de postes et, par voie de conséquence, des reconversions de personnels. Le personnel est souvent considéré comme une charge fixe dans l’administration. Or, il y a là une richesse. Pour l’AP-HM, nous avons mis en place, à titre expérimental, une cellule de mobilité des professionnels concernés par des restructurations. Nous verrons ensuite dans quelle mesure celle-ci peut être adaptée à d’autres établissements.
M. Philippe Ritter. Dans le stock d’études réalisées par la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier, il est assez frappant de voir que, alors qu’il existe quantité de monographies sur l’organisation des blocs, voire sur la blanchisserie, il n’y a aucune étude particulière sur la gestion des ressources humaines ni sur l’organisation médicale. Or, le personnel pèse pour 70 % dans les budgets, et l’organisation médicale est le cœur même du métier de l’hôpital. L’ANAP a prévu des études sur ces deux sujets importants. C’est un exemple des nouvelles orientations introduites par l’agence.
M. le coprésident Pierre Morange. Tandis que les structures antérieures avaient une approche de type verticale, la vôtre est de type horizontale. Bien que l’on ne soit pas dans une logique de taylorisation et qu’il soit difficile de trouver des formules « standardisables », il ne serait pas absurde d’établir, à partir de différentes analyses, un modèle de référence, par exemple pour des plateaux de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) servant à l’ensemble des établissements hospitaliers. Cela existe-t-il ?
M. Philippe Ritter. Il existe d’excellentes études, par exemple, sur les blocs opératoires mais elles ne parlent pas de l’organisation des activités connexes, telles que le brancardage et l’anesthésie. En parcellisant les choses, on peut apporter des améliorations ponctuelles mais on n’améliore pas l’organisation globale, en tout cas pas automatiquement.
M. Christian Anastasy. Après avoir cité un exemple concernant la gestion humaine dans un seul établissement, je citerai un deuxième exemple qui concerne 50 établissements.
M. Éric Woerth avait exprimé le souhait que soient réalisés des audits sur les 50 plus gros établissements déficitaires. Par dialogues successifs et itératifs avec les représentants du budget, nous sommes passés de la notion d’audit à celle de projet de performance ayant pour objectif d’éradiquer les causes de déficit. Celles-ci sont, en effet, multidimensionnelles et ne concernent parfois qu’un problème de facturation. Certains CHU ne facturent pas, par exemple, des recettes auxquelles ils ont droit.
Aux diagnostics purement économiques, nous substituons des diagnostics médico-économiques. La fonction de l’hôpital étant de produire du service médical, il faut connaître la nature de ce service médical, son volume et son coût. Si on ne parle pas de l’intérieur de l’appareil de production, on ne sait pas de quoi on parle.
Nous avons fait valider ces 50 projets de performance par des méthodologistes : Capgemini et McKinsey.
M. le coprésident Pierre Morange. L’intervention de McKinsey sur les urgences de l’hôpital Beaujon a permis d’augmenter leur efficience de 30 à 40 %, à coût constant !
M. Christian Anastasy. Nous avons choisi ces deux organismes, après appel d’offres, car ils connaissaient les restructurations de grande ampleur intervenues aux États-Unis et en Angleterre. Ils nous ont utilement aidés à comprendre ce qui se passait dans cette transformation.
Voilà un deuxième exemple d’actions qui s’appuient sur une méthodologie robuste et concernent 50 établissements.
Mon troisième exemple a trait aux systèmes d’information et concerne 130 établissements. Nous nous sommes rendu compte, en faisant le bilan du plan hôpital 2007 que 75 % des projets qui ont été aidés pour leur système d’information se sont « cassés la figure ». Nous avons cherché à comprendre pourquoi.
Nous nous sommes aperçu, avec consternation, qu’il y a une déconnexion totale entre le management de tête et les systèmes d’information. Pour les directeurs d’hôpitaux et les médecins, les systèmes d’information sont de la basse intendance qu’ils sous-traitent à des ingénieurs informaticiens qui sont parfois tout frais sortis de l’école de Rennes et n’ont aucune expérience. Nous avons créé un dispositif d’appui pour 130 établissements qui ont bénéficié d’aide au système d’information. Dans celui-ci, nous les informons que les aides seront désormais subordonnées aux efforts réalisés par l’établissement en matière d’information et nous essayons de convaincre les directeurs d’hôpitaux de la nécessité de s’impliquer dans la problématique des systèmes d’information, ces derniers étant un des éléments essentiels de la stratégie d’un établissement.
Quatrième exemple d’action : en concertation avec les directions concernées, notamment la direction du budget et la direction de la sécurité sociale, l’ANAP a défini une liste de trente critères conditionnant l’octroi d’une subvention « hôpital 2012 » à un établissement.
Bien que nous arrivions un peu après la bataille en matière de système d’information puisque la première tranche de subventions est passée, ces trente critères induisent une philosophie simple : on ne verse pas d’argent pour des projets sophistiqués, par exemple l’intercommutabilité en temps réel entre le bloc et le laboratoire, si l’établissement n’est pas capable d’avoir un système de facturation qui fonctionne. Ne peuvent passer à la Formule 1 que ceux qui ont fait la preuve qu’ils savaient piloter une voiture…
Pour la partie immobilier, le versement d’une subvention est subordonné à la capacité d’autofinancement de l’établissement. L’analyse du plan hôpital 2007 a montré que les établissements qui ont été aidés se trouvent aujourd’hui dans une situation financière plus dégradée qu’avant de recevoir une aide. Nous devons faire comprendre aux gestionnaires que, quand on les aide à hauteur de 50 % pour un investissement qui est complètement surdimensionné par rapport à leurs besoins, cela entraîne ensuite pour eux des coûts considérables.
Cette grille de trente critères, qui constitue mon quatrième exemple d’action, concerne l’ensemble des établissements.
Nous avons réalisé également une étude concernant les urgences afin d’essayer de réduire le temps d’attente. À Nancy, où nous avons travaillé sur ce sujet avec la direction générale de la modernisation de l’État, le temps moyen de prise en charge d’un patient admis en urgence est de cinq heures cinquante. Nous trouvons cela anormal. Les établissements hospitaliers ne doivent pas s’étonner ensuite que les patients s’en aillent dans la clinique en face.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. D’autant que cinq heures et demie sont une moyenne : l’attente peut être de cinq minutes comme de douze heures !
M. Christian Anastasy. Absolument ! Nous avons essayé de sensibiliser les établissements à ce problème et, dans quarante d’entre eux, nous avons réduit l’attente de 9 %.
Dernier exemple : nous essayons de convaincre les établissements, notamment publics, de la nécessité de facturer. Un sondage montre que 22 CHU sur 27 ne facturent pas les 18 euros qui sont dus par l’assurance maladie à tout établissement qui fait des actes supérieurs à KC 50. Quand j’étais directeur d’un établissement privé, je facturai 100 % de ces 18 euros. Je ne manque pas de demander à un directeur de CHU dont l’établissement accuse un fort déficit pourquoi il ne le fait pas.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Que vous répond-il ?
M. Christian Anastasy. Rien !
M. Philippe Ritter. Je crois que beaucoup n’ont pas encore pleinement conscience que l’on ne calcule plus en budget global mais en T2A.
M. le coprésident Pierre Morange. À combien estimez-vous la perte de recettes induites par ces non-facturations ? La chambre régionale des comptes d’Île-de-France donne une fourchette de 5 à 7 %. Validez-vous cette estimation ?
M. Philippe Ritter. Nous ne sommes pas en état de le faire. Il entre davantage dans les compétences de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) de vous donner des renseignements à ce sujet.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous demande votre sentiment sur le sujet car vous avez un certain recul de par vos fonctions antérieures et même actuelles.
M. Philippe Ritter. Il est exact que, ayant accepté de prendre la présidence d’un établissement participant au service public hospitalier, l’hôpital Foch à Suresnes, qui est pourtant un très bel établissement universitaire, à la pointe en neurochirurgie, en cardiologie et en urologie, je fais quelques découvertes assez surprenantes. J’ai découvert une insuffisante rigueur dans les facturations et dans les recouvrements. J’ai constaté qu’il n’y avait pas d’indicateur d’activité ni d’indicateur financier tous les mois. De plus, l’établissement souffre d’un gros déficit. S’il n’y a pas de tableau de bord, comment voulez-vous maîtriser les choses ? Le service du département d’information médicale (DIM) est tout à fait insuffisant par rapport à l’activité. Le chef du département de l’information médicale n’ayant pas préparé ses services au passage à la version V11 de la classification des groupes homogènes de séjour, il y a eu, pendant deux ou trois mois, des cafouillages dans le codage des actes selon cette classification.
Il y a beaucoup de points à redresser. En fait, c’est surtout une culture qu’il faut inculquer. Jusqu’à présent, les médecins considéraient que faire du codage n’était pas leur boulot et, pour, les administratifs, le service de l’information était une structure qui fonctionnait comme les autres.
Une anecdote à ce propos : lorsque j’étais directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de l’Île-de-France, j’ai été frappé de constater que, dans nombre d’établissements, notamment dans les banlieues de l’Ouest et du Nord de l’Île-de-France, la caisse fermait à trois heures de l’après-midi alors que les sorties se faisaient vers dix-sept heures. On s’étonnait ensuite qu’il soit difficile de faire payer les factures à la clientèle, une fois rentrée chez elle.
L’ANAP souhaite, de manière pragmatique, mettre l’accent sur un certain nombre de problèmes d’organisation et donner des boîtes à outils aussi simples et opérationnelles que possible. Elle souhaite être un appui aux futures agences régionales de santé dont la fonction sera de veiller à la performance des établissements. S’il revient à l’ANAP de piloter les premiers contrats de performance en 2009 et en 2010, elle devra, dès que les agences régionales de santé seront opérationnelles, leur fournir des méthodologies pour qu’elles prennent le relais. L’ANAP interviendra, éventuellement, en tant qu’expert pour des cas particulièrement difficiles mais elle ne devra se substituer ni aux agences régionales de santé, ni aux établissements. Ces derniers doivent comprendre qu’ils sont responsables de leur gestion et qu’ils doivent se prendre en main. C’est ainsi que l’on peut espérer voir changer les choses.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous avez parlé d’une culture à inculquer. Pour pouvoir la faire passer dans les établissements, encore faut-il l’inscrire dans la formation de celles et ceux qui occupent des postes de cadre. Des démarches sont-elles entreprises pour faire remonter ce souci ?
M. Philippe Ritter. Cette question se posera aux agences régionales de santé. Les agences régionales de l’hospitalisation n’ont pas été formées pour cela. Il ne suffit pas de regrouper les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS), les agences régionales de l’hospitalisation, les unions régionales des caisses d’assurance-maladie (URCAM) etc. pour avoir un outil opérationnel. Il faudra que les agences régionales de santé acquièrent une culture axée sur la performance. C’est d’ailleurs l’une des préoccupations du secrétaire général actuellement chargé de la mise en place des agences régionales de santé. Il prévoit, à cet effet, des modules de formation à la fois des préfigurateurs et des équipes qui seront intégrées dans les agences régionales de santé.
Lorsque j’étais à l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France, je me suis rendu compte des lacunes qui existaient : outre que le niveau central n’exerçait aucune pression pour nous pousser à nous intéresser à la performance des établissements, nous n’avions pas les compétences internes suffisantes.
M. Christian Anastasy. Comme je suis un homme de terrain, j’aime qu’on me parle de choses concrètes. C’est le cas dans l’étude réalisée par McKinsey sur les urgences, qui est un sujet qui concerne les gens. Quand le délai moyen de prise en charge dans un service des urgences est de cinq heures, c’est qu’il y a un problème d’organisation quelque part.
Certains directeurs généraux de CHU me prennent parfois à partie en faisant valoir que la performance n’est qu’une notion économique. Non. La performance en santé a été définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle a pour but d’améliorer la qualité de la santé des gens, de réduire les iniquités de financement et d’améliorer la réactivité du système.
Toutes nos actions 2010 répondent à la volonté d’agir sur des choses concrètes perceptibles par tout le monde.
Je prends un exemple : la distribution du repas du soir dans les établissements médico-sociaux de long séjour qui, à 75 % – soit pas moins de 30 000 établissements – n’ont aucun tableau de bord.
Comme les gens des cuisines prennent leur service à sept heures trente ou huit heures le matin, ils préparent le repas du soir à quinze heures et demandent aux aides-soignantes de ne pas le servir trop tard pour qu’il ne refroidisse pas, si bien que les plateaux-repas sont distribués entre dix-sept heures et dix-huit heures. Une émission de Canal + en a parlé dernièrement. Une personne âgée n’a pas faim à dix-sept heures trente. Donc elle ne mange pas. L’aide-soignante, plaisantant sur le fait que « la Mamie ou le Papi n’a pas faim ce soir-là », lui reprend son plateau vers dix-huit heures trente ou dix-neuf heures, et la personne âgée a une période de jeûne supérieure aux onze heures reconnues comme un maximum par toutes les sociétés françaises et internationales de gérontologie. La personne âgée, dénutrie, est désorientée et elle a des escarres, qui doivent être prises en charge par des aides-soignantes, des infirmières et des médecins. Cela n’intéresse personne de soigner des escarres et, de plus, ça fait mal.
Résultat : on accueille des personnes âgées dans des établissements sanitaires ou médico-sociaux pour leur faire mal ! Et, en plus, on dépense beaucoup d’argent. Cherchez l’erreur ! Le NHS3I, qui est l’équivalent anglais de l’ANAP, a estimé que les escarres représentaient 4 % du budget de l’assurance maladie dans ce pays.
Avant de m’occuper d’objectifs très sophistiqués, comme l’interopérabilité des systèmes d’information, dont on parle depuis des années, je veux m’attaquer à des problèmes concrets qui touchent à la fois la vie des personnes hébergées et celle des personnels. Quand je tiens un tel discours, aucun syndicat ne peut m’accuser de n’être que dans la recherche de l’efficience. Selon la Haute Autorité de santé, le coût de la non-qualité dans un établissement de santé représente 25 % des charges d’exploitation. Donc, si on traque les niches d’improductivité, on améliorera le système.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il y a des malentendus sur le mot performance et la T2A est encore souvent mal vue. Comment parvenez-vous à réconcilier performance, amélioration des conditions de travail et amélioration de la qualité du service ?
M. Philippe Ritter. Si l’on a préféré le mot « performance » à celui d’« efficience », c’est parce que ce dernier a une connotation très économique. Le terme « performance » est plus global et intègre la notion de qualité des soins.
C’est ce que nous essayons de faire comprendre, comme nous essayons de faire comprendre – et je crois que cela commence à venir – que la non-qualité et la mauvaise organisation entraînent une mauvaise prise en charge, sans parler des surcoûts induits.
Un moyen efficace, on le voit depuis quelques années, est ce que l’on appelle le benchmarking. Les équipes médicales ou soignantes sont sensibles aux comparaisons que l’on peut faire avec d’autres établissements et aux classements. Ceux réalisés par Le Point ou d’autres organismes en ont fait admettre le principe, alors que le sujet était tabou il y a encore une dizaine d’années. La Haute Autorité de santé a également beaucoup contribué à introduire l’idée que l’activité d’un établissement ou d’un service est comparable à celle d’un autre établissement ou d’un autre service. Les comparaisons étant entrées dans les mœurs, les responsables, qu’ils soient administratifs, financiers, soignants ou médicaux, commencent à être un peu gênés aux entournures quand l’ANAP ou l’agence régionale de l’hospitalisation leur demandent d’expliquer pourquoi, à activité comparable, ils ont besoin de 30 % de plus de personnels que tel établissement ou pourquoi ils ont des surcoûts ou des délais d’attente sans commune mesure avec tel autre.
C’est par le biais de comparaisons avec d’autres établissements et par la diffusion de bonnes pratiques qu’on arrivera à faire évoluer les choses. C’est pourquoi l’ANAP ne se fixe pas uniquement pour but d’améliorer la situation de tel ou tel établissement déficitaire. Son rôle est plus de fournir des référentiels et des éléments de comparaison permettant aux gestionnaires de s’approprier le sujet et de chercher, par eux-mêmes, à améliorer l’organisation de leur établissement et la prise en charge assurée par celui-ci.
M. Christian Anastasy. Quand j’exerçais les fonctions de directeur d’un groupe de six établissements, principalement orientés vers la chirurgie, j’ai utilisé, face aux directeurs de chacun, des indicateurs mis au point par la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier pour analyser la production des blocs opératoires. Un jour, j’ai convoqué les directeurs de deux cliniques pour leur demander pourquoi, pour faire 100 000 indices de coûts relatifs (ICR), il y avait 38 équivalents temps plein (ETP) dans un établissement et 28 dans l’autre. Y avait-il gabegie de moyens dans le premier cas ou sous-qualité dans le second ? Je me suis rendu compte que la différence venait d’un problème de planning dans le premier, qui accordait des temps partiels en fonction des désirs des gens : quand une personne demandait 75 % d’ETP mais exprimait son désappointement que cela ne cadre pas avec les ressources qu’elle escomptait, la direction la mettait à 0,79 ETP. La direction arrondissait les choses mais cela aboutissait à une désorganisation des services : quand vous « achetez » de l’intérim, vous achetez un emploi, pas 0,79 % ! Le diable se nichant dans les détails, on arrivait de la sorte en année pleine à un total de 10 ETP de plus pour faire 100 000 ICR.
Cet exemple montre que l’outil de comparaison, en permettant de poser des questions, permet ensuite de remonter aux causes.
Je ferai une seconde remarque pour illustrer le propos de M. Ritter. Parmi les six leviers de changement qui nous ont permis de hiérarchiser la commande publique, il en est un qui pose la question suivante : le projet que vous nous commandez contribue-t-il à la diffusion de la culture de la performance ? Si oui, selon quelles modalités et selon quels critères ? Souvent, la comparaison est un bon élément de propagation de la culture de la performance.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La comparaison est un bon outil pour poser les problèmes mais il ne faudrait pas qu’elle devienne l’outil de mesure de la réussite. Comment faites-vous pour évaluer ce qui est l’objectif ultime de votre démarche, à savoir l’amélioration de la qualité du service produit et des conditions de travail. Comment associez-vous les personnels à la démarche et comment leur montrez-vous qu’il n’y a pas automatiquement de contradiction entre la recherche d’une forme de performance et l’amélioration de leurs conditions de travail ?
M. Christian Anastasy. Je répondrai à votre question en prenant un exemple.
Le projet médical d’un CHU faisait ressortir que la capacité de chirurgie ambulatoire devait être portée de dix à douze places. Or, on sait aujourd’hui, dans la plupart des pays du monde, que, sur cent malades, quatre-vingt-cinq peuvent être pris en charge chirurgicalement en ambulatoire. Pour ne parler que de l’Europe – car, si je cite les États-Unis, on va me dire que c’est un système libéral inégalitaire –, alors que le taux de pénétration du marché de la chirurgie ambulatoire est de 90 % en Belgique et en Italie, il n’est que de 50 % en France, ce qui signifie que nos services chirurgicaux sont « surconsommateurs » de ressources, y compris humaines. Le CHU en question ayant 500 lits, ce nombre passait à 150 s’il mettait en place une organisation ambulatoire, ce qui entraînait des constrictions de personnels assez importantes.
Nous avions deux éléments de langage vis-à-vis des personnels.
En premier lieu, nous leur disions que tous les emplois seraient préservés mais qu’ils passeraient de la chirurgie, où il n’y avait pas besoin d’autant de personnels, vers des services d’accueil pour personnes âgées ou des services médico-sociaux. Nous leur faisions valoir qu’ils passeraient d’un service où ils étaient faiblement utiles à un service où ils seraient très utiles à la population. Ce premier élément de langage était assez bien perçu.
En second lieu, nous disions à ceux – et ils étaient assez nombreux – qui restaient en chirurgie ambulatoire, que leurs conditions de travail seraient améliorées puisque, comme la chirurgie se fait dans la journée, il n’y aurait plus de gardes la nuit et le week-end.
Nous essayons toujours de faire le lien entre l’optimum recherché sur le plan de l’organisation et les conséquences qu’il induit pour les professionnels.
Les six leviers de hiérarchisation de la commande publique permettent de déterminer, premièrement, en quoi le projet permet de rendre l’établissement plus performant ; deuxièmement, en quoi il induit une meilleure qualité au meilleur coût ; troisièmement, en quoi il favorise l’optimisation des parcours de santé – par exemple s’il évite de faire attendre des personnes âgées dans des services de court séjour parce qu’il n’y a pas de place en moyen ou en long séjour ; quatrièmement, en quoi le projet suscite une optimisation de l’organisation des ressources humaines ; cinquièmement, en quoi il entraîne des investissements efficaces ; sixièmement, en quoi il contribue à la diffusion de la culture de la performance.
Sans négliger la dimension économique ni l’amélioration des conditions de travail, ces six critères mettent en avant l’amélioration des conditions de prise en charge des personnes, comme dans l’exemple des escarres que j’ai cité. Ils permettent de faire un tri dans les commandes publiques, qui sont innombrables. Ainsi, même si cela ne fait pas plaisir à l’administration qui nous l’a soumise, nous rejetons, à l’aune des six critères, toute demande d’évaluation de la motivation des cadres A dans la fonction publique hospitalière.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Si vous pouvez nous communiquer des documents, nous vous en serions reconnaissants.
M. Christian Anastasy. Nous pourrons vous communiquer ceux que nous avons préparés pour le pré-conseil d’administration du 27 novembre.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Travaillez-vous sur des fusions d’établissements ?
M. Philippe Ritter. Je vais exprimer ma conception personnelle. Autant je crois que, dans le cadre de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, il est tout à fait judicieux de se placer dans une perspective d’organisation territoriale de l’offre, donc de coopération et de complémentarité entre des établissements sur un territoire donné, autant je ne suis pas partisan de la fusion pour la fusion. Beaucoup de fusions ont échoué parce qu’elles ont été réalisées pour le principe et non en fonction d’un projet médical : une fois la fusion réalisée, on s’interrogeait sur sa motivation… Il faut inverser les facteurs : une fusion peut réussir quand elle se fonde sur un projet médical, si possible consensuel.
Il vaut parfois mieux conclure des accords de coopération et de complémentarité plutôt que de décider des fusions juridiques qui posent souvent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. Dans le cadre des 50 projets de performance, je ne crois pas que la question se pose.
La fusion est, pour moi, un problème plus de structure juridique que de bonne organisation de l’offre de soins. En tout état de cause, elle ne peut être une réponse systématique à des problèmes d’organisation de l’offre.
À Lamure, on a fermé la chirurgie, les urgences et la maternité dans le cadre d’une coopération forte avec le CHU de Grenoble : celui-ci envoie sur place des équipes médicales pour faire des vacations alors qu’il n’y avait plus de médecins compétents. C’est plus au travers de tels regroupements qu’on réussit à faire bouger les choses et à faire adhérer à la fois les personnels et les élus : le maire de Lamure est devenu un porte-parole de ce regroupement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pour vous, la fusion n’est pas une réponse aux problématiques de terrain…
M. Philippe Ritter. Ce peut en être une mais ce n’en est pas une en soi.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. …mais, quand une fusion est considérée comme opportune, ou en tout cas, est envisagée, avez-vous des éléments d’interventions sur le plan méthodologique ?
M. Christian Anastasy. A priori, non. Je dis a priori parce que je ne connais pas toutes les études qui ont été menées depuis des années. En tout cas, cela n’apparaît pas comme tel dans le programme de travail que nous envisageons.
En revanche, nous imaginons une réflexion assez volontariste sur l’organisation et les conséquences des communautés hospitalières de territoire. Plutôt que de bâtir des organisations a priori, par fusion ou remembrement, nous préférons avoir un projet médical de territoire qui corresponde aux besoins de santé. À partir de là, les acteurs peuvent se répartir.
Je prends un exemple. Le CHU de Reims, situé à 50 minutes de Paris, réalise chaque année 420 interventions de chirurgie cardiaque. Est-il nécessaire de maintenir une activité aussi lourde et aussi consommatrice de ressources alors que, selon la communauté médicale nationale et selon les différents acteurs concernés, le seuil minimum requis pour faire de la chirurgie cardiaque est de 400 interventions ? Ne serait-il pas plus intelligent de conclure un accord de coopération entre Reims et l’Assistance publique de Paris, qui pourrait elle-même consolider ses plateaux techniques et ses équipes avec les 400 cas pris en charge jusqu’alors à Reims ?
Je cite ce cas car j’ai rencontré un médecin qui revenait d’une mission en Australie. Dans ce pays qui compte 22 millions d’habitants sur un territoire équivalent à celui de l’Europe, une personne habitant un lieu correspondant à Helsinki et qui a un problème cardiaque doit aller, pour se faire opérer, à ce qui correspondrait à Madrid, où se situe le seul établissement de chirurgie cardiaque du pays.
Est-il bien raisonnable d’avoir de la chirurgie cardiaque tous les cent kilomètres ? C’est une question à se poser dans le cadre d’une recomposition des territoires visant également à améliorer la performance des équipes. La Haute Autorité de santé a montré qu’en cancérologie et en cardiologie, plus on opère fréquemment, mieux on traite les gens. Il faut donc réfléchir aux recompositions possibles et souhaitables avant de penser fusion, démembrement, reconstruction ou reconstitution de tels ou tels établissements.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le personnel de l’ANAP est-il nombreux ? Est-il regroupé à Paris ?
M. Christian Anastasy. Nous sommes tous à Paris. Comme M. Ritter y a fait allusion tout à l’heure, l’objectif est d’atteindre un effectif de soixante personnes à la fin de cette année, et d’environ quatre-vingt à la fin de l’année prochaine.
Avec douze recrutements et treize départs, les choses ont beaucoup bougé en 2009. Le profil recherché est celui de cadre polyvalent : ingénieurs travaux, ingénieurs système d’information, médecins, soignants, médico-sociaux, sanitaires. Nous nous employons à ne pas avoir des profils convenus. Il n’y a pas que des directeurs d’hôpitaux, ni que des médecins professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH). Nous avons besoin de personnels aux profils très diversifiés, multiculturels et de toutes origines.
Le budget de l’ANAP représente, grosso modo, 40 millions d’euros. Avec les 50 projets de performance, il devrait se situer aux alentours d’une soixantaine de millions.
M. Philippe Ritter. Le montant de 60 correspond en gros à l’addition des personnels des trois structures préexistantes. L’organisation de l’ANAP ressemble un peu à celle de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier : son rôle n’est pas de faire les travaux en régie, mais de les faire avec des consultants et donc de passer des marchés de consultants, ce qui suppose d’avoir de bonnes équipes en interne.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. De bonnes équipes et de bonnes ressources !
M. Philippe Ritter. Oui, mais il faut aussi pouvoir payer les personnels en interne.
Le principe retenu par les ministères de tutelle, dont Bercy, est de constituer une équipe qui ne dépasse pas, à terme, quatre-vingts ou quatre-vingt-dix personnes, mais qui réunisse des personnels de haut niveau dans leur spécialité pour pouvoir contractualiser…
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Sans se faire « balader » par les cabinets conseils !
M. Philippe Ritter. D’où un budget étude important. Le budget de l’ANAP prend en compte les frais de personnel et les frais d’étude.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les études sont-elles comprises dans le budget que vous avez annoncé ?
M. Christian Anastasy. Oui. J’ai indiqué le budget de fonctionnement, tout compris.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous vous remercions, messieurs.
*
AUDITIONS DU 26 NOVEMBRE 2009
Audition de de M. Pierre Vollot, directeur du Centre hospitalier intercommunal Loire-Vendée-Océan.
M. le coprésident Pierre Morange. Monsieur Vollot, votre expérience du terrain et vos réflexions nous permettront, je l’espère, de formuler des préconisations générales dont pourraient bénéficier tous les établissements de soins. Je vous propose donc de présenter d’abord succinctement les activités de votre établissement.
M. Pierre Vollot, directeur du Centre hospitalier intercommunal Loire-Vendée-Océan. Le Centre hospitalier intercommunal Loire-Vendée-Océan a été créé en 1999 par le rapprochement de deux petits établissements – Machecoul, en Loire-Atlantique, et Challans, en Vendée – qui étaient alors en concurrence sur les mêmes créneaux d’activité et sont désormais complémentaires. Cet établissement de proximité répond aux besoins d’une population de 100 000 à 125 000 habitants, qui atteint 400 000 personnes en été du fait de la fréquentation saisonnière du littoral. Il couvre l’ensemble des secteurs de la médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), ainsi que la psychiatrie ; il a une grande activité en soins de suite et il possède aussi un centre d’hébergement de personnes âgées.
M. le coprésident Pierre Morange. Les questions de fusion, de restructuration et d’optimisation sont au cœur de la réflexion de la MECSS, qui a déjà examiné l’exemple d’autres établissements pour lesquels la fusion a été laborieuse et a fait apparaître diverses insuffisances. Dans votre cas, il semble que la fusion se soit bien opérée et produise des résultats satisfaisants, notamment sur le plan budgétaire. Ces résultats s’accompagnent-ils d’une offre de soins accessibles à tous, permettant de répondre aux besoins des populations ?
M. Pierre Vollot. L’offre de soins n’est pas encore accessible à tous. Bien que, depuis la création de l’établissement voici neuf ans, l’activité ait augmenté d’environ 30 % et que nous ayons repris des parts de marché, l’offre ne répond pas encore à l’ensemble des besoins. De fait, la Vendée se caractérise par des taux de fuite importants vers l’agglomération nantaise : une hospitalisation sur trois et une chimiothérapie sur deux ont lieu hors du département. C’est l’un des enjeux que de réduire l’inégalité d’accès aux soins sur le territoire de recours sur lequel sont situés notre établissement et ceux, plus importants, de La Roche-sur-Yon, des Sables-d’Olonne et de Fontenay-le-Comte.
M. le coprésident Pierre Morange. Lors des auditions précédentes, les services de l’État ont évoqué des insuffisances en matière de comptabilité analytique et de contrôle de gestion, ainsi qu’en matière de facturation, car le recouvrement laisse souvent à désirer et l’absence de facturation n’est pas rare. Ces insuffisances, je le précise, ne concernent pas votre établissement, qui connaît des excédents. Pensez-vous cependant avoir en la matière une marge de progression ?
M. Pierre Vollot. Nous avons pris le parti de responsabiliser les médecins, qui saisissent eux-mêmes les codes des actes qu’ils produisent. De fait, le département de l’information médicale ne doit pas se substituer aux médecins. Quant à notre facturation, elle n’accuse pas de retards, sinon pour les urgences de cet été – mais nous nous employons à revoir ce processus.
Le suivi de la gestion s’appuie sur des tableaux de bord mensuels, qui permettent de suivre la valorisation des recettes par service et les durées de séjour – qui sont un facteur déterminant pour les recettes –, ainsi que les dépenses et l’absentéisme. Nous ne disposons pas encore d’une comptabilité analytique pleinement opérationnelle, mais nous avons une bonne appréhension des coûts. Pour les services administratifs, logistiques et médico-techniques, nous adhérons à la base de données d’Angers, qui permet de comparer les coûts de ces services avec ceux d’une centaine d’établissements. Pour les services cliniques, nous ne disposons pas d’une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts par séjour, mais nous y parviendrons certainement.
Nous avons commencé par mettre en place divers autres outils, comme des tableaux de bord généraux et par pôle, afin que chaque responsable de pôle puisse suivre la réalisation de ses objectifs d’activité et de qualité. De nombreux indicateurs permettent des comparaisons à l’échelle nationale et nous connaissons exactement le niveau de productivité de nos services cliniques, en termes de durée moyenne de séjour (DMS) ou de productivité par médecin ou soignant. Nous avons identifié les quelques services qui présentent des durées de séjour élevées. Ces indicateurs permettent de suivre les écarts en termes de durée de séjour et de valorisation de recettes, et de rectifier le tir avec les médecins.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pouvez-vous nous donner quelques exemples récents de mesures que vous avez été amenés à prendre à la suite de ces comparaisons ?
M. Pierre Vollot. Comme d’autres établissements, nous avons participé à des études de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH), dont l’une, consacrée aux blocs opératoires et aujourd’hui largement diffusée, a permis d’impliquer les acteurs concernés. Malgré une bonne productivité du personnel du bloc opératoire, les plages d’utilisation des salles devaient encore être optimisées. C’est ce que nous avons fait en étendant les horaires jusqu’à 18 heures au lieu de 16 heures. Nous travaillons actuellement à la possibilité de les étendre encore.
M. le coprésident Pierre Morange. Comment réagissent les personnels ?
M. Pierre Vollot. Leur attitude est très constructive. Il importe d’instituer une culture du dialogue et de l’échange. Les processus de soins hospitaliers sont complexes et les problèmes d’interfaces entre les services sont complexes : il faut donc mettre autour de la table les acteurs des différents services pour examiner les implications des changements souhaités. Ce processus est laborieux et ne se fait pas en un jour. Pour ce qui concerne les blocs opératoires, par exemple, il faut parfois reprendre la discussion au début parce qu’un anesthésiste qui n’a pas participé aux échanges précédents vient contredire ce qui a été décidé. Cependant, avec de la patience, on peut résoudre ces problèmes.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Qui a décidé la fusion des deux établissements concurrents, et pour quelles raisons ? Comment cette décision a-t-elle été mise en œuvre ?
M. Pierre Vollot. Cette opération, qui a été engagée dans les années 1990 par mon prédécesseur, est le résultat d’une implication très forte de la tutelle. L’impulsion donnée par M. Bernard Marrot, directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, puis par M. Benoît Péricard, directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH), a en effet été décisive. Le succès tient aussi aux élus, qui étaient notamment convaincus que, faute d’une taille critique suffisante, le déclin de l’activité du plus petit des deux établissements était inévitable et qu’il importait de trouver d’autres créneaux d’activité porteurs. De fait, le service de rééducation cardiovasculaire de Machecoul a désormais une portée interdépartementale et est une vitrine de cet établissement.
Les deux établissements ont donc été gagnants : le plus petit a gagné de nouveaux services – rééducation cardiovasculaire et soins de suite polyvalents – et un plus grand nombre de lits, et a bénéficié d’un accompagnement financier qui a permis la modernisation des locaux. Les acteurs hospitaliers, qu’il s’agisse de la direction ou du corps médical, ont bien joué le jeu, car notre établissement a une culture de dialogue et un esprit constructif. Ainsi, malgré les craintes suscitées par les évolutions, aucune opposition majeure ne s’est manifestée. Le temps a eu son rôle dans ce processus, qui a débuté en 1993 avec l’instauration d’une direction commune et s’est poursuivi dans les années 1995 à 1997, avant la fusion opérée en 1999. Arrivé un an après cette date, je n’ai fait qu’approfondir ce mouvement, notamment sur les plans logistique et médico-technique, par exemple en supprimant l’une des deux pharmacies et l’une des deux cuisines. Face aux craintes de transfert d’emplois d’un site vers l’autre, il a fallu rassurer et montrer que les transferts pouvaient aussi se faire dans l’autre sens.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il s’agit donc d’une situation où deux établissements en bonne santé financière et que leurs responsables souhaitaient rapprocher sont partis à la conquête de nouvelles parts de marché en rationalisant leur organisation, puis ont fusionné.
M. Pierre Vollot. Avant la fusion, les deux établissements avaient déjà une direction commune. Quant à la santé financière, elle était probablement moins bonne qu’aujourd’hui. Une chose est sûre : si les deux établissements étaient restés séparés, ils n’auraient pas survécu à la tarification à l’activité (T2A), car ils n’avaient pas la taille critique suffisante. La fusion a permis de mutualiser une grande partie des services et d’acquérir un environnement nécessaire à la politique de qualité, notamment pour le système d’information, qui est un enjeu majeur pour les établissements.
M. le coprésident Pierre Morange. Lors de précédentes auditions a été évoquée l’insuffisance de l’informatique, tant administrative que médicale. Il est notamment apparu que l’interconnexion avec d’autres systèmes informatiques était difficile, ce qui compromet la gestion prévisionnelle. Par ailleurs, alors que le rôle du département de l’information médicale était conçu pour se limiter à la coordination et à la stratégie, laissant aux professionnels de santé la responsabilité de la collecte de l’information, il semble que ces derniers soient parfois réticents à s’acquitter de ce rôle et à adopter cette nouvelle culture. Quelles analyses vous suggère votre expérience en la matière ?
M. Pierre Vollot. Nous avons voulu que l’information soit saisie au plus près du terrain par celui qui réalise l’acte.
M. le coprésident Pierre Morange. Combien de temps vous a-t-il fallu pour y parvenir ?
M. Pierre Vollot. Trois ou quatre ans. Les actes de radiologie, par exemple, sont maintenant saisis par le manipulateur ou par le radiologue. Cela suppose bien évidemment de disposer d’un logiciel assez ergonomique pour que le médecin n’ait pas besoin d’y consacrer plus de trente secondes. À défaut, nous risquerions de grosses difficultés. De fait, dans une communauté de soixante-dix médecins, on en trouve toujours un ou deux qui sont réfractaires à l’informatique. Si le médecin concerné est proche de la retraite, il est inutile de s’acharner, mais s’il a encore quelques années d’activité devant lui, il faut l’accompagner. Dans certains cas, le directeur des systèmes d’information a dû investir beaucoup de son temps pour permettre à des médecins d’apprivoiser la souris et l’ordinateur.
M. le coprésident Pierre Morange. Le codage des actes est plus ou moins aisé selon les disciplines. S’il est, par exemple, relativement maîtrisé pour la chirurgie, il est complexe en médecine. Le sujet peut sembler aride, mais il touche aux recettes et aux équilibres budgétaires qui en dépendent, et n’a donc rien d’anecdotique.
M. Pierre Vollot. Le département d’information médical (DIM) doit s’efforcer de former et d’accompagner personnellement tous les nouveaux médecins. Dans la région des Pays de la Loire, avec l’aide de l’agence régionale de l’hospitalisation, une mission d’accompagnement dont se charge à mi-temps le département d’information médical de mon établissement a été mise en œuvre pour assurer, avec le concours du Conservatoire des arts et métiers (CNAM) des Pays de Loire, la formation des médecins, des responsables de pôles et des directeurs financiers à la tarification à l’activité et la formation des techniciens de l’information médicale au codage. Cette mutualisation régionale porte ses fruits.
M. le coprésident Pierre Morange. Pour ce qui concerne les insuffisances de la facturation, on nous a signalé que, dans certaines structures, le fait que les caisses ferment en milieu d’après-midi empêche les patients de régler les consultations externes ou les urgences, et que l’inertie administrative se traduit parfois par l’absence de recouvrement, voire d’identification du patient. Avez-vous été confronté à de telles situations et, si c’est le cas, quelles mesures avez-vous prises ?
M. Pierre Vollot. Des secrétaires médicales sont présentes le week-end et jusqu’à 21 heures. Nous avons également créé un secrétariat médico-administratif, qui évite que certaines secrétaires soient exclusivement employées à la dactylographie des comptes rendus et à la gestion des rendez-vous, et d’autres à la facturation. Les secrétariats polyvalents sont chargés à la fois de la partie médicale et de la facturation, ce qui simplifie le parcours du patient et, grâce à une approche plus globale de la prise en charge, permet de disposer de données administratives plus correctes.
Il nous reste à résoudre les difficultés que nous avons rencontrées cet été avec l’informatisation des urgences, certains urgentistes n’acceptant pas de saisir les actes. Les équipes des urgences – douze personnes dans notre établissement – sont difficiles à gérer, car ces personnels sont plus individualistes que dans d’autres services et ont moins l’esprit d’équipe. Nous travaillons actuellement avec les médecins afin que chacun fasse son travail et que, les actes étant saisis, les secrétaires puissent relancer la facturation dans de bonnes conditions.
M. le coprésident Pierre Morange. J’avais initié en 2005 une démarche visant à simplifier le parcours du patient, notamment aux urgences. Sur ce point, on peut citer l’exemple de l’accès aux urgences de l’hôpital Beaujon, où le délai moyen d’attente était de l’ordre de cinq heures à cinq heures et demie, avec des délais extrêmes de deux à dix-huit heures. L’intervention du cabinet McKinsey, mandaté par la directrice générale de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) de l’époque, a permis en quatre mois de réduire de 40 % ce délai d’attente, qui est la première image concrète de l’hôpital que perçoit le patient et qui illustre pour lui l’offre de soins. Avez-vous une réflexion sur ce paramètre relativement facile à mesurer ? Si c’est le cas, avez-vous observé des améliorations à apporter et avez-vous pris des mesures à cet égard ?
M. Pierre Vollot. Comme d’autres établissements, nous nous sommes engagés sur ce terrain avec la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier. Les temps d’attente, qui étaient en moyenne de trois heures et pouvaient atteindre sept à huit heures l’été du fait de l’afflux saisonnier, n’ont pas diminué, mais l’activité a augmenté – de 4 % cette année. Les locaux, conçus pour 15 000 passages, en reçoivent 25 000, ce qui pose d’énormes problèmes. Nous ne manquons pas de médecins ni d’infirmières, mais de boxes pour recevoir correctement les patients.
Nous avons pris des mesures en aval pour que les urgentistes puissent joindre plus facilement les spécialistes et savoir en temps réel quels sont les lits disponibles dans les différents services. J’espère par ailleurs que nous sommes parvenus à convaincre toute l’équipe du bien-fondé de la création d’une filière rapide et que celle-ci pourra être mise en place dès l’année prochaine, permettant de distinguer les flux de patients en fonction de leurs problèmes et de gagner du temps.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pouvez-vous présenter le groupement de coopération sanitaire (GCS) auquel vous appartenez et le dossier de soins commun mis en place dans ce cadre ?
M. Pierre Vollot. Le groupement de coopération sanitaire rassemble onze ou douze établissements de santé et médico-sociaux du territoire de santé de proximité de Challans, soit un bassin de 100 000 habitants. Sur ce territoire, l’explosion démographique des personnes âgées est bien plus importante que sur l’ensemble du territoire national, car de nombreuses personnes viennent prendre leur retraite sur le littoral. Le problème est double : les besoins d’hospitalisation d’une population vieillissante rapidement vont croissant et le nombre de places médicalisées en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dont l’augmentation est pourtant prévue en Vendée, est loin de suivre la courbe démographique des plus de quatre-vingt-cinq ans. Ainsi, le taux d’équipements rapporté à la population de quatre-vingt-cinq ans et plus sera presque divisé par deux d’ici 2013. Je crains donc que nous ne rencontrions des problèmes en aval de l’hôpital et que nos services ne soient ainsi victimes d’embolie.
Il s’agit donc de bien définir une filière gériatrique : c’est là l’une des missions du groupement de coopération sanitaire, qui peut d’ailleurs avoir une politique coordonnée avec les autres établissements du territoire. Il s’agit aussi de créer un réseau de santé gérontologique avec le centre local d’information et de coordination (CLIC) et les médecins libéraux.
Le groupement de coordination sanitaire succède à une communauté d’établissements créée en 1998 et comporte des services mutualisés – assistantes sociales, médecine du travail, hygiène, soins palliatifs et, depuis peu, filière gériatrique. Cette dernière répond au souci de réfléchir à un projet médical gérontologique de territoire définissant notamment le rôle et les missions de chacun des établissements, ce qui a donné lieu à des restructurations. Nous avons identifié trois hôpitaux locaux qui auront une importante activité de soins de suite – à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Noirmoutier et sur l’île d’Yeu. Nous nous apprêtons à reprendre le 1er janvier 2010, dans la commune de La Guérinière, sur l’île de Noirmoutier, un établissement privé dont les 43 lits seront redéployés d’ici deux ans dans les trois hôpitaux que je viens d’évoquer.
Pour le dossier de soins, nous avons choisi, grâce à des crédits hôpital 2007 relativement limités, un logiciel commun à sept établissements permettant l’accès au dossier patient et au dossier de soins et l’informatisation du circuit du médicament. Les serveurs sont situés sur le site de Challans et la maintenance du logiciel est assurée, pour toute la communauté, par l’équipe informatique de ce centre hospitalier. Nous souhaitons en outre que chaque établissement possède une base de données autonome, car, lorsqu’un patient se rend d’un établissement dans un autre, l’accès à ses données n’est pas automatique. L’enjeu des deux prochaines années est donc d’assurer une gestion multi-établissements.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Est-ce une question purement technique ?
M. Pierre Vollot. Sur le plan administratif, tout le monde est convaincu de l’utilité de cette démarche.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les médecins de ville ont-ils également accès au dossier du patient ?
M. Pierre Vollot. Les médecins généralistes et spécialistes du territoire auront accès aux dossiers d’ici au début de l’année prochaine, car le logiciel le permet et la création du site internet nécessaire est en cours. Cet accès sera néanmoins partiel.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Cette action est-elle liée au plan ministériel consacré au dossier médical personnel (DMP) ?
M. Pierre Vollot. Pour être franc, nous ne nous sommes guère préoccupés du DMP – et peut-être avons-nous bien fait ! Nous nous sommes principalement attachés à ce que les médecins libéraux puissent avoir facilement accès aux dossiers de leurs patients. Nous souhaitons aussi que les comptes rendus médicaux puissent également être acheminés par voie électronique, et non plus par courrier, ce qui fera gagner beaucoup de temps.
M. Jean-Luc Préel. Monsieur Vollot, je suis heureux de vous accueillir ici, d’autant que je connais un peu le Centre hospitalier intercommunal Loire-Vendée-Océan… J’aimerais savoir quelles sont, selon vous, les conditions de réussite d’une fusion d’établissements. Vous avez vous-même fusionné deux établissements implantés dans deux départements différents – difficulté supplémentaire, que la forte volonté de la tutelle, notamment de l’agence régionale de l’hospitalisation et la mobilisation des élus ont permis de surmonter.
Vous avez mis en place un fonctionnement en réseau avec des établissements de proximité, avec le Centre hospitalier départemental de Vendée et le Centre hospitalier universitaire de Nantes. Je précise que vous dirigez par ailleurs l’hôpital de l’île d’Yeu. En tant que responsable départemental des établissements publics, pourriez-vous nous donner votre avis sur la fusion du Centre hospitalier départemental de Vendée avec les hôpitaux de Luçon et de Montaigu, qui ont des activités MCO ? Répond-elle aux besoins de la population ? A-t-elle permis, comme je le crois, un retour à l’équilibre financier ?
Enfin, je tiens à faire savoir qu’il existe en Vendée un système d’hospitalisation à domicile, dont le Centre hospitalier intercommunal Loire-Vendée-Océan est un des membres fondateurs.
M. Pierre Vollot. Je confirme qu’il faut une forte implication de l’agence régionale de l’hospitalisation et des élus ; qu’il faut du temps ; qu’il faut, sinon créer, du moins entretenir une culture d’établissement ; la fusion étant faite, il faut enfin que l’établissement ait un projet. Les agences régionales de l’hospitalisation ne raisonnent qu’à partir de contrats d’objectifs et de moyens, qui sont devenus des contrats d’adhésion avec des orientations nationales traduites en orientations régionales, l’établissement n’ayant plus qu’à signer un contrat qui lui est imposé. C’est une erreur de s’en tenir là. Il faut donner de la lisibilité et des orientations à l’établissement pour que la communauté se mobilise autour d’un projet faisant consensus, lequel pourra alors être suivi d’effets. Une de nos forces est d’avoir réalisé, depuis 2000, deux projets d’établissements avec des orientations qui, n’étant pas des vœux pieux, ont pu se mettre en place. Le but de nos contrats internes de pôles était que chacun s’approprie le projet médical et que ses objectifs soient bien perçus et mis en œuvre ; des tableaux de bord permettent de vérifier que ces objectifs sont atteints.
S’agissant du Centre hospitalier départemental, avec qui nous aurons peut-être un jour à faire une communauté hospitalière de territoire, les établissements s’y retrouvent mieux sur le plan budgétaire. Nous avons gagné en efficience.
L’hospitalisation à domicile est également un acteur très pertinent. En Vendée, elle repose essentiellement sur les médecins libéraux. Ce service fonctionne très bien et il complète l’action des établissements.
Étant directeur de l’hôpital de l’île d’Yeu, j’ai été confronté au problème de la médecine ambulatoire. L’année dernière, trois des cinq médecins qui travaillaient dans l’île sont partis. On s’est adressé à l’hôpital, l’île attirant peu les médecins libéraux. Il a donc fallu construire un autre modèle. Dès cette année, j’ai été amené à salarier un médecin et on nous a demandé de créer un centre de santé au 1er janvier 2010. Je pense que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales agréera sans difficulté ce centre de santé, mais je n’ai pas encore de réponse de l’Assurance maladie concernant son conventionnement, au motif que c’est la première fois qu’est créé un centre de santé géré par un hôpital. La caisse primaire d’assurance maladie attend la réponse de la caisse nationale et j’espère que nous l’aurons dans les tout prochains jours, pour être opérationnels le 1er janvier prochain. Cela prouve en tout cas qu’on doit sortir de son hôpital et avoir une vision plus globale de la santé.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous avez évoqué la constitution de ce groupement de coopération sanitaire qui regroupe onze établissements. Vous avez fait référence au cadre législatif des communautés hospitalières de territoires. Dans le cadre d’une vision globale et d’une mutualisation de l’offre de soins, avez-vous réfléchi aux procédures d’appel d’offres mutualisées, pour trouver des réponses pertinentes sur le plan budgétaire, soit au sein de ce groupement de coopération sanitaire, voire dans un bassin d’établissements plus large ?
M. Pierre Vollot. Sous l’impulsion de l’agence régionale de l’hospitalisation, un groupement de commandes régionales s’est mis en place, qui englobe quatre ou cinq domaines, mais pas le domaine pharmaceutique, ce qui est un peu dommage.
M. le coprésident Pierre Morange. De mémoire, dans la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, ce thème avait déjà été évoqué. Une centrale d’achat, au minimum régionale, voire nationale, serait une formule particulièrement adaptée pour dégager des marges de manœuvre financière. Pouvez-vous définir précisément les domaines exploités au niveau régional ? On pourrait raisonnablement penser aux transports sanitaires ou aux fournitures informatiques.
M. Pierre Vollot. S’agissant des fournitures informatiques, une mutualisation régionale porterait sûrement ses fruits. S’agissant des transports sanitaires, je suis moins convaincu. Les transports en ambulance s’organisent à un niveau plus local, voire départemental – sauf les transports héliportés qui s’organisent dans un cadre beaucoup plus global, via le CHU.
Pour assurer les transports sanitaires, nous devons faire face à des coûts de plus en plus importants. Dans le cadre de nos services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR), nous faisons appel à des ambulanciers privés. On nous a demandé de réviser nos tarifs pour que la mission puisse se poursuivre. En termes de coûts, nous sommes plutôt sur une pente ascendante, ce qui constitue une de nos préoccupations.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Dans le document que vous nous avez fait parvenir, on lit que la fusion entre l’hôpital local de l’île d’Yeu et le centre hospitalier est fortement envisagée, mais qu’elle se heurte à des problèmes financiers liés à la T2A. Pourriez-vous nous en dire davantage ? Que pensez-vous, plus généralement, de la T2A ? Quelles difficultés celle-ci a-t-elle pu poser dans votre établissement ? Dans quelle mesure son application oriente-t-elle les activités de celui-ci ?
M. Pierre Vollot. Aujourd’hui, l’hôpital local de l’île d’Yeu n’est pas soumis à la tarification à l’activité. Nous envisageons très sérieusement une fusion avec cet établissement pour simplifier la gestion administrative, pour faire des économies de coût logistique et pour ne pas avoir à réunir trente-six fois les mêmes instances. Mais cela impliquerait que nous appliquions la T2A aux séjours à l’île d’Yeu, qui sont financés aujourd’hui par dotation globale. Étant un peu plus légers, ils seront moins côtés que des séjours sur le continent. On hospitalise à l’île d’Yeu des patients pour de la surveillance et afin d’éviter de les transférer. Les mêmes patients n’auraient peut-être pas été hospitalisés sur le continent, en raison de la proximité d’un service d’urgence ; du moins, leur durée de séjour aurait été plus courte. Il y a là un problème à prendre en compte, en prévoyant, pour le moins, un coefficient correcteur. Si on applique purement et simplement les systèmes de financement, nous risquons de perdre environ 200 000 euros dans l’affaire. Vous comprendrez que le corps médical du Centre Loire-Vendée-Océan ne soit pas très enthousiaste vis-à-vis du processus de rapprochement…
Nous payons par ailleurs un peu le fait que le centre hospitalier sert de support logistique à l’île d’Yeu. Nous avons de nombreuses consultations avancées sur l’île d’Yeu, ce qui entraîne du temps de transport, des frais d’hélicoptère pour que le médecin puisse s’y rendre, mais n’est pas absolument pris en compte – ni au titre d’une mission d’intérêt général, ni par une quelconque contractualisation. J’ose espérer que l’agence régionale de santé sera davantage à l’écoute que ce n’est le cas avec l’organisation actuelle des organismes de tutelle.
On voit bien, à travers cet exemple, que la T2A peut avoir des effets négatifs. Mais, globalement, elle a eu des effets bénéfiques. Le Centre Loire-Vendée-Océan n’aurait pas pu poursuivre et développer ses activités sans un tel financement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous voulez dire que, dans l’ancien système, la dotation était trop faible ?
M. Pierre Vollot. La dotation reposait sur des bases historiques. Il y avait deux petits établissements, dont l’activité était moins élevée. Le territoire était en pleine croissance démographique, avec des besoins de santé de plus en plus importants. Il fallait présenter à la tutelle de nombreux rapports pour lui expliquer pourquoi il fallait augmenter les capacités, développer les activités, créer un poste de praticien hospitalier, ce qui prenait des mois, voire des années. Avec la T2A, la situation est beaucoup plus simple : le juge de paix, c’est l’activité.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Ce système est donc plus simple et plus conforme à la réalité ?
M. Pierre Vollot. Il est aussi plus équitable. Il permet aux hôpitaux qui travaillent d’avoir des moyens.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pour que vous puissiez mesurer la réalité, il vous faut, notamment, un système de comptabilité analytique et de suivi de gestion permettant de rapprocher les coûts réels de ce que vous rapporte la T2A. Vous nous avez dit que, par rapport à d’autres établissements, vous n’étiez pas en retard en termes d’outils de gestion, mais que vous étiez loin d’avoir obtenu l’optimum. Qu’allez-vous faire maintenant pour progresser ?
M. Pierre Vollot. Lorsque je crée des activités – par exemple, l’année prochaine, je vais ouvrir des lits de médecine supplémentaires pour répondre aux besoins – nous faisons des simulations relativement précises sur les recettes et les dépenses et je rappelle aux cadres de santé et aux personnels que les moyens dépendront des recettes qui seront dégagées. Cela permet de réduire un peu les prétentions, qui sont parfois excessives. Nous travaillons toujours dans ce sens.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous utilisez la T2A et les outils de gestion interne de votre établissement de façon à optimiser cette gestion et à faire en sorte que le service produit le soit dans les meilleures conditions possible. D’autres logiques existent. On nous parle, entre autres, de la convergence avec les établissements privés : il s’agit de rapprocher, par le biais de la gestion et de la tarification, des établissements qui ont des raisons d’être et des modes de fonctionnement très différents. Que pensez-vous de cette convergence ?
M. Pierre Vollot. La T2A est un système plus équitable. Cependant, il doit être relativement stable dans le temps. Or ce n’est pas le cas aujourd’hui. La nouvelle classification V11 des actes médicaux n’a pas été très satisfaisante. Savoir avec quel montant de recettes on allait terminer l’année a relevé de l’art divinatoire.
Ensuite, les règles ont été fortement perturbées cette année et, paradoxalement, on a plutôt pénalisé les établissements qui avaient des durées de séjour courtes ; on a modifié les règles de financement des unités de surveillance continue, ce qui a été très défavorable aux hôpitaux qui avaient des unités de surveillance continue non adossées à des unités de réanimation. Sans doute la société savante des réanimateurs a-t-elle été beaucoup plus pertinente dans la définition des critères. Quoi qu’il en soit, on a oublié de consulter certains autres interlocuteurs. Le système de financement n’étant pas du tout adapté, des établissements ont subi de lourdes pertes.
Enfin, pour que le système soit satisfaisant, il faut qu’il soit lisible. Il l’est, bien qu’étant compliqué, pour la T2A des actes de médecine, chirurgie et obstétrique. En revanche, on ne voit pas très bien comment va fonctionner le programme de médicalisation des systèmes d’information en soins de suite ou de réadaptation (PMSI SSR) et le PMSI psychiatrie, dont les règles sont d’une complexité rare. Pour que les acteurs s’emparent du sujet, il faudra bâtir des systèmes à peu près compréhensibles pour tout le monde.
S’agissant de la convergence des tarifs applicables aux établissements publics avec ceux concernant les établissements privés, je ne pense pas que je vous répondrai mieux qu’ont pu le faire d’autres représentants plus éminents. D’accord pour la convergence, mais il faut comparer ce qui est comparable. Ce n’est pas le cas des honoraires ; on doit inclure ceux des médecins libéraux dans les cliniques privés. Ce n’est pas non plus le cas des activités, qui ne sont pas tout à fait convergentes. Une bonne part de l’activité publique est une activité de médecine clinique, qu’on ne retrouve pas dans le secteur libéral. Tout cela soulève des questions.
M. le coprésident Pierre Morange. Merci pour vos réponses si précises.
*
Audition de Mme Véronique Anatole-Touzet, directrice générale du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons maintenant le plaisir d’accueillir Mme Véronique Anatole-Touzet, directrice générale du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, accompagnée de M. Dominique Peljak, directeur général adjoint, et Mme Diane Petter, directrice des finances.
Mme Véronique Anatole-Touzet. Nous nous félicitons que la MECSS ait choisi d’auditionner des acteurs de terrain dans le cadre de ce rapport sur le fonctionnement de l’hôpital.
Le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville est classé dans la catégorie des CHR-CHU. Il s’agit d’un centre hospitalier régional qui, en termes d’activité médicale, se situe environ au dixième rang, et dont le budget tourne autour de 400 millions d’euros. C’est donc un établissement de taille importante, avec 2 000 lits et places. Il a deux caractéristiques : c’est un établissement bi-sites puisqu’il regroupe les établissements hospitaliers préexistants de Metz et de Thionville qui ont été fusionnés en 1977 ; il a un programme d’investissement important et son déficit, bien qu’en réduction notamment depuis deux ans et demi, reste un problème épineux. Tout cela ressort de la note de synthèse que j’ai transmis à la mission.
Le fait que le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville soit un établissement bi-sites est source de complexité, mais est aussi très important au regard de l’offre de soins pour le territoire nord et le bassin de santé nord-lorrain.
La chambre régionale des comptes a analysé son déficit structurel à l’aune d’une sous-dotation historique et d’une maîtrise des dépenses jugée à l’époque insuffisante.
Dans la note qui vous a été transmise, nous avons souligné l’importance du projet de construction d’un nouvel hôpital à Metz, qui devrait ouvrir début 2012, et des besoins d’investissements majeurs sur le site de Thionville – qui représente 40 % de l’activité du centre hospitalier régional – compte tenu du taux de vétusté des installations et des équipements.
Nous avons également résumé dans cette note les actions que nous avons engagées : une dynamique d’amélioration de la performance, à la fois dans la gestion des recettes, la maîtrise des dépenses et l’organisation médicale, qui constitue, depuis ces dernières années, un axe prioritaire de travail.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous rappeler les préconisations générales de la chambre régionale des comptes ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Au-delà de l’analyse générale des comptes de l’établissement, la chambre régionale des comptes avait axé son dernier rapport sur deux sujets particuliers : les urgences et les systèmes d’information, et sur un certain nombre de recommandations relatives à la gestion des marchés et à la situation financière compte tenu du déficit notamment constitué par un report de charges de l’ordre de 19 millions d’euros en 2006. Je suis arrivée dans l’établissement en juillet 2007, ainsi que mes collaborateurs, et nous avons engagé très rapidement une politique de retour à l’équilibre financier.
M. le coprésident Pierre Morange. Sur l’informatique médicale et sur les marchés, quelles avaient été les remarques de la chambre régionale des comptes ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Sur l’informatique médicale, la carence du pilotage du système d’information avait été pointée par la chambre régionale des comptes. À l’époque, le système d’information était relativement éclaté, le pilotage global n’étant pas vraiment mis en œuvre. L’ensemble des recommandations sur l’informatisation, notamment médicale, ont été mises en œuvre. J’ai remplacé le directeur informatique, dès mon arrivée. Nous avons mis en place un comité de pilotage des systèmes d’information, élaboré un schéma directeur des systèmes d’information qui donne à ceux-ci une cohérence globale, ce qui manquait fortement dans la période antérieure. Nous avons également engagé l’informatisation du dossier médical, qui doit se mettre en place dans l’ensemble des services de l’établissement dès l’année prochaine. Nous sommes simplement en attente d’une aide du plan Hôpital 2012, car l’enjeu financier est important : l’ensemble du schéma directeur coûtera environ 15 millions d’euros, si l’on veut véritablement informatiser et rattraper le retard.
S’agissant des urgences, la chambre régionale des comptes n’a pas fait de recommandations majeures. Il s’agissait plutôt d’un constat. Leur fonctionnement, tout en méritant d’être amélioré, avait montré un certain nombre de points forts, comme la gestion des circuits de prise en charge des patients. À Metz comme à Thionville, à travers les circuits (courts ou longs) et les filières (maladies graves, chirurgie ou médecine), nous avons déjà engagé une démarche d’amélioration de la prise en charge et de la qualité, qui a été reconnue.
L’ensemble des recommandations de la chambre régionale ont également été prises en compte pour les marchés et la gestion financière. Tant pour la maîtrise des dépenses que pour l’amélioration des recettes, nous avons obtenu des résultats tangibles. Le déficit financier, qui était de 12,7 millions d’euros en 2007, est passé à 6 millions d’euros en 2008. Un effort de mobilisation très important de la communauté hospitalière et des praticiens a été engagé, à la fois dans la gestion des recettes (le codage des activités médicales accusait un retard considérable), la facturation (les délais ont pu être divisés par deux) et la maîtrise des dépenses. Nous avons mené de nombreuses réorganisations médicales : regroupements de services, fermeture d’hôpitaux de semaine sous-occupés, développement de la chirurgie ambulatoire, regroupement des activités d’hôpital de jour de médecine, réorganisation du fonctionnement du plateau technique.
Travailler à l’organisation médicale, en partenariat bien sûr avec la communauté médicale, l’encadrement soignant, et en associant les organisations syndicales en amont est vraiment la clé pour aller vers l’efficience. C’est de cette manière que l’on peut dégager des marges de manœuvres tout en préservant la qualité et la sécurité des soins.
M. le coprésident Pierre Morange. La maîtrise de l’information suppose de disposer d’outils de mesure, dans le cadre d’une stratégie de gestion prévisionnelle. Je suppose que vous avez maintenant une comptabilité analytique et un contrôle de gestion opérationnels.
Mme Véronique Anatole-Touzet. Tout à fait, depuis une période relativement récente. Lorsque je suis arrivée, mon prédécesseur venait d’engager, en 2006, la mise en œuvre d’une comptabilité analytique, avec la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier. Nous avons institué des tableaux de bord systématiques en matière de gestion, à la fois globale pour l’ensemble des suivis des différents types de dépenses et de recettes, et par pôle. Tous les pôles disposent de comptes de résultats analytiques et de comptes de résultats par objectif des secteurs médicotechniques, ce qui assez novateur. C’est Mme Petter qui s’occupe de ce dossier. Ces tableaux de bord existent, il faut maintenant les faire vivre dans le temps et les utiliser dans le cadre des contrats de pôle et des outils de pilotage internes.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est un long chemin que celui de la cohérence budgétaire et de la rationalisation des moyens mis à disposition. Y a-t-il encore des marges de progression pour le recouvrement, voire pour l’identification des cas de non-facturation lorsque certaines consultations ou certains passages aux urgences ne sont pas comptabilisés ? Toujours dans le cadre de la maîtrise de l’information, deux écoles s’opposent : soit la cotation doit être effectuée et mise en œuvre en direct par le département d’information médicale, soit elle doit l’être sur le terrain, au chevet du patient, par les professionnels de santé, qui ont une connaissance intime de l’activité médicale. Quel est votre point de vue ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Je répondrai à votre seconde question et Mme Petter à la première.
S’agissant du codage, il existe en effet deux écoles : le codage centralisé et le codage décentralisé. Lorsque je suis arrivée au centre hospitalier régional, le codage était centralisé. Nous avons constaté qu’il n’était pas performant, dans la mesure où il conduisait à un retard considérable de transmission, à de nouvelles saisies, donc à des coûts supplémentaires, notamment en personnel. J’ai ainsi décidé de passer à un codage décentralisé, comme je l’avais fait dans d’autres établissements. Nous avons fait le pari de responsabiliser les praticiens.
M. le coprésident Pierre Morange. Combien de temps vous a-t-il fallu ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Six mois. Pour soixante-quinze services, c’est une performance ! Nous avons mené une politique très volontariste pour y parvenir. Ce fut même la priorité, dans le cadre de notre démarche de retour à l’équilibre financier. Avant même de faire des économies, encore faut-il que les recettes entrent dans les caisses par rapport à l’activité réellement réalisée. Nous avons mobilisé la communauté médicale. Le président de la commission médicale d’établissement s’est également investi. Nous avons mis sur intranet un palmarès mensuel systématique du retard du codage. Nous avons mobilisé le département d’information médicale pour le recentrer sur son métier, qui est plutôt l’analyse qualitative, le conseil et l’aide aux services, que la saisie des actes.
Nous avons mis à disposition des praticiens des outils pour que ce codage prenne le moins de temps possible, même si cela reste pour eux une charge de travail. Au début, il y a eu une certaine résistance de leur part mais au fur et à mesure, l’enjeu a été compris par l’ensemble de la communauté médicale. Aujourd’hui, la qualité et le délai du codage se sont nettement améliorés.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le fait que ce changement ait été opéré en seulement six mois met d’autant plus en évidence la différence existant entre les deux systèmes. Vous devez mesurer de manière assez précise les pertes de ressources pour l’établissement qu’entraînait l’ancien système.
Mme Véronique Anatole-Touzet. En effet. Nous avions environ, en trésorerie, un million d’euros de retard de codage par mois. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce genre de problèmes nous a été rapporté par une chambre régionale des comptes, concernant d’autres structures. Nous avons entendu parler de 5 % à 10 % voire 12 % de facturations non recouvrées, ce qui n’a rien de négligeable en termes de recettes. Vous êtes-vous retrouvée dans des situations similaires ? Grâce à la correction que vous avez opérée, vous avez dû observer une différence. À combien l’estimez-vous ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Je vous répondrai, sous le contrôle de la directrice des finances, que cette différence est de l’ordre de 5 %. Nous étions en effet à 94 % d’exhaustivité et nous en sommes à 99 %. Cela porte sur les recettes liées aux tarifs des groupes homogènes de séjours, donc sur des sommes importantes.
Mme Diane Petter. 200 millions d’euros pour les séjours financés en T2A.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce qui correspond à 10 millions d’euros. Dans le cadre d’une enveloppe hospitalière qui approche les 60 milliards d’euros par an, ce n’est pas anodin.
Mme Véronique Anatole-Touzet. Si nous avons fait de l’amélioration du codage une priorité, c’est qu’il y a là une marge de manœuvre importante. Je pense que de nombreux établissements ont engagé une telle politique.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’établissement que vous dirigez est la résultante de la fusion de deux établissements dont la santé financière n’était pas excellente. Quelle a été, selon vous, la raison de cette fusion à l’époque : a-t-elle été motivée par un souci de bonne gestion financière ou de rationalisation des soins ? Quelles ont été ses modalités, mais aussi ses incidences sur le plan financier à court et à plus long terme ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Élevé au rang de centre hospitalier régional par Mme Simone Veil, alors ministre des affaires sociales, en 1977, l’établissement issu de la fusion du centre hospitalier de Metz avec le centre hospitalier de Thionville traduit la volonté politique d’assurer une offre de soins à la mesure de l’importance de la population et du territoire desservis.
Les fusions d’établissements ont le double objectif d’améliorer l’offre de soins et de contribuer à une certaine efficience médico-économique.
Il est assez difficile d’évaluer leur résultat en termes financiers, et je ne pense pas que cela ait été souvent fait en France, même si cela mériterait de l’être. S’agissant de la fusion en question, la réforme des règles budgétaires et comptables intervenue ces dernières années, notamment l’instauration de la tarification à l’activité (T2A), rend encore plus difficile son bilan précis d’autant que son objectif n’était pas financier. Une première recommandation serait peut-être de donner justement un tel objectif à ces regroupements d’établissements.
L’objectif d’optimisation de l’offre de soins, en revanche, est fondamental. Une telle fusion permet en effet d’assurer la cohérence de l’offre de soins sur un territoire donné, notamment par la mise en place de pôles d’activité médicale intersites, garantissant un dialogue sur le plan médical concernant à la fois les priorités de développement de l’activité médicale et la répartition cohérente de l’activité entre les deux sites.
Sur le plan médico-économique, la fusion contribue à l’optimisation des dépenses. Concrètement, certaines activités hyperspécialisées ont été concentrées sur le site de Metz, telles l’hématologie, la chirurgie cardiaque, le plateau technique lourd. Nous veillons cependant à ce que la répartition entre les deux sites reste équilibrée, le territoire de Thionville nécessitant une grosse offre de soins compte tenu de l’importance de sa population.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La construction du nouvel hôpital de Metz s’inscrit-elle dans le prolongement du processus de fusion et de rationalisation, ou s’agit-il simplement de remplacer un équipement par un autre ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Les deux. En tout état de cause, la vétusté des installations rendait nécessaire la construction d’un nouvel hôpital à Metz, étant donné l’implantation du site en centre ville, les problèmes d’accès et de parking, le manque de fonctionnalité et de surface. Le site de Thionville a également besoin d’être rénové, et le projet de Metz tient compte de la nécessité de l’équilibre de l’offre de soins entre les deux sites.
À ma connaissance cependant, un projet unique commun aux deux sites n’a jamais été envisagé. Cela n’aurait pas été opportun, étant donné l’existence de deux bassins de population importants, distincts et éloignés. Il fallait d’abord construire là où la population était la plus importante, sans négliger les besoins de rénovation du site de Thionville.
M. le coprésident Pierre Morange. L’appartenance de votre groupe hospitalier au groupement de coopération sanitaire (GCS) du Grand-Est répond à la nécessité de s’inscrire dans une vision globale des problèmes sanitaires d’un vaste bassin démographique. La création d’une telle structure traduit-elle une volonté de mutualisation et de rationalisation financière, notamment en matière d’appels d’offres ? L’existence d’un groupement de coopération sanitaire tend-elle, en particulier, à constituer une centrale d’achat, comme vous y autorise la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Ce n’est pas l’objectif du groupement de coopération sanitaire Grand-Est, mais il est vrai que tous les établissements appartenant au groupement adhèrent par ailleurs au groupement de coopération sanitaire UniHA, afin de mutualiser leur politique d’achat et de réaliser des économies d’échelle. Après une montée en charge progressive, cette politique a permis des économies sensibles, en tout cas dans mon établissement.
L’objectif initial du groupement de coopération sanitaire Grand-Est, qui regroupe les CHU et le centre hospitalier régional de ce territoire, est principalement de favoriser le développement de la recherche clinique. L’enjeu est essentiel, à l’heure où les grands établissements hospitaliers français souhaitent promouvoir la recherche clinique en leur sein. Dans cette perspective, le groupement de coopération sanitaire nous permet de répondre de manière coordonnée aux appels d’offre nationaux d’un certain nombre d’organismes de recherche, et de conduire au niveau interrégional une politique de recherche commune. Une direction interrégionale de la recherche clinique est spécialement chargée de cette coordination. Elle a également permis la mise en œuvre de moyens dédiés à la recherche dans les CHU et le centre hospitalier régional du Grand-Est.
Le deuxième objectif de ce groupement de coopération sanitaire est de coordonner l’offre médicale au niveau interrégional, conformément aux schémas interrégionaux d’organisation sanitaire. Ceux-ci sont arrêtés par les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation et organisent l’offre de soins dans des activités hautement spécialisées. Les agences régionales de l’hospitalisation du Grand-Est sont d’ailleurs représentées au sein du groupement de coopération sanitaire Grand-Est.
Le groupement de coopération sanitaire a pour troisième objectif d’aller plus loin, notamment en termes de formation universitaire. Cette structure nous permet d’échanger avec les doyens des facultés de médecine et de réfléchir ensemble aux moyens de mieux répondre aux enjeux de démographie médicale – on sait que c’est un problème plus difficile dans le Grand-Est que dans le Sud de la France, par exemple. Tous ces aspects ont vocation à se développer dans le cadre du groupement de coopération sanitaire.
M. le coprésident Pierre Morange. Avez-vous entamé un travail de préfiguration des dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires élargissant le champ de compétence des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS), notamment au secteur ambulatoire, qui doivent s’appliquer à partir du deuxième trimestre 2010 ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Le centre hospitalier régional se montre exemplaire en la matière. Nous nous sommes en effet efforcés d’anticiper le nouveau cadre législatif en étant très actifs en matière de politique de territoire. Depuis plus de dix ans, le centre hospitalier régional a noué des liens de coopération très étroits avec la médecine de ville, dans le cadre notamment du service d’urgences et de la maison médicale de Metz, et nous luttons ensemble contre l’épidémie de grippe actuelle.
L’agence régionale de l’hospitalisation nous a en outre sollicités pour venir en soutien d’établissements, publics ou privés, en difficulté. Nous appuyons notamment l’hôpital de Briey, en Meurthe-et-Moselle. Grâce au soutien du centre hospitalier régional, cet établissement de plus de 400 lits, qui connaissait de grandes difficultés, à la fois financières, institutionnelles et médicales, est en voie de redressement sur le plan tant de l’activité médicale que de la situation financière. Nous avons également, avec le soutien de l’agence régionale de l’hospitalisation, sauvé une maternité de Metz, un établissement privé à but non lucratif assurant plus de 2 000 accouchements, qui était dans une situation financière difficile.
S’agissant du volet médico-social, le centre hospitalier régional compte une filière gériatrique importante, et coopère, par le biais de conventions, avec l’ensemble des acteurs des réseaux gérontologiques. Il assure lui-même la gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées. La coopération avec le secteur médico-social est donc ancienne et déjà ancrée dans les pratiques locales.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment assurez-vous l’adéquation entre le personnel disponible et les besoins ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. La gestion des ressources humaines est un enjeu majeur pour nos établissements. La réponse n’est pas la même selon qu’il s’agit des praticiens ou des personnels non médicaux.
En matière de gestion du personnel médical, nous sommes confrontés à une démographie médicale défavorable, environ la moitié des praticiens formés par le CHU quittant la Lorraine. L’objectif essentiel est d’attirer et de conserver au sein de l’hôpital public – qui reste, en dépit des nouveaux outils législatifs, moins attractif en termes de rémunérations que le secteur privé – un nombre suffisant de praticiens pour répondre aux besoins sanitaires d’un territoire très peuplé.
Le centre hospitalier régional pratique une politique très offensive de recrutement pour maintenir son offre de soins. S’agissant de certaines spécialités particulièrement déficitaires, et cela dans tous les établissements publics compte tenu des écarts de rémunération, telles l’anesthésie, la néphrologie ou la radiologie, les solutions sont multiples. Nous sommes pour notre part engagés dans une politique de coopération très forte avec le CHU, dont le doyen fait désormais partie de notre conseil d’administration. Une telle politique est essentielle pour fidéliser les praticiens par le biais de la gestion des internes, de la formation ou de l’investissement dans la coopération universitaire.
S’agissant des personnels paramédicaux, nous n’avons pas de difficultés majeures pour recruter du personnel infirmier. Nous manquons en revanche de manipulateurs d’électroradiologie médicale ou de kinésithérapeutes. Là encore, nous nous efforçons d’agir en amont, au niveau de la formation.
Nous nous efforçons de fidéliser les personnels par des titularisations assez courtes, plus opportunes dans un environnement concurrentiel. C’est pourquoi, même dans le cadre d’une politique de maîtrise de la masse salariale, nous sommes obligés de maintenir un volant contractuel, même si nous nous efforçons de le réduire, en pleine concertation avec les organisations syndicales.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Des crédits sont donc pré-affectés aux contrats de courte durée ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. En effet. C’est une pratique inhérente au fonctionnement hospitalier, puisque, avant même leur titularisation, certains personnels, telles les infirmières, doivent être recrutés par la voie du contrat. Nous essayons cependant de réduire au minimum la part de celui-ci dans la masse salariale.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’objectif est de faire en sorte que les contrats à durée déterminée soient le sas d’entrée vers une pérennisation ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Tout à fait.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelle est la part du personnel d’intérim par rapport à la masse salariale ? On sait en effet à quel point une proportion trop importante de ce type de personnels peut affecter un budget hospitalier, dont la masse salariale constitue les trois quarts. Je vous renvoie à ce sujet aux observations de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers. De nombreux établissements hospitaliers n’ayant pas, comme nos auditions nous l’ont appris, de comptabilité analytique et étant de ce fait incapables de faire de la gestion prévisionnelle, ils recourent par facilité à des personnels intérimaires. Ils initient ainsi un cercle vicieux sur le plan budgétaire, qui participe à la dégradation des comptes.
Mme Véronique Anatole-Touzet. Il faut distinguer entre personnels contractuels et intérimaires, entre lesquels il faut encore distinguer selon qu’il s’agit d’intérim médical ou non médical.
Nos dépenses d’intérim médical sont faibles, puisqu’on ne recourt à des praticiens intérimaires que dans des disciplines très déficitaires, telles que l’anesthésie. Nous n’en employons que dans le centre hospitalier de Briey, actuellement géré par le centre hospitalier régional dans le cadre d’une convention de direction commune.
Il en va de même dans le domaine paramédical, puisque nous avons pu recruter du personnel soignant en nombre suffisant pour satisfaire nos besoins. Il s’agit essentiellement de titulaires – et de contractuels pour les personnels en voie de recrutement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Ce qui est désormais la règle de gestion de base des établissements hospitaliers, à savoir la T2A, a-t-elle posé ou résolu des problèmes ? Est-elle susceptible d’orienter l’activité médicale ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Sur le principe, les hospitaliers sont favorables à la mise en œuvre d’une tarification à l’activité pour des raisons d’équité, de justice et de bonne gestion, cette règle favorisant l’ajustement des moyens à la réalité de l’activité médicale.
Quant aux modalités de la T2A, elles sont critiquables, du fait notamment des délais trop courts de mise en œuvre et des règles du jeu fluctuantes, notamment ces dernières années. Pour mener à bien cette réforme, j’estime nécessaire, au même titre d’ailleurs que votre Assemblée, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou la Cour des comptes, de stabiliser les règles du jeu afin de donner de la visibilité aux établissements. Il convient également de mieux déterminer les coûts, notamment quand on compare les établissements publics et les établissements privés. Il faut aussi mieux évaluer la permanence des soins : même si l’on a beaucoup progressé dans ce domaine cette année, les résultats doivent être pérennisés.
La prise en compte de la précarité est l’autre élément positif. Mais il faut, avant d’entreprendre la convergence tarifaire, établir la réalité des coûts en tenant compte des spécificités de la prise en charge par l’hôpital public.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment peut-on juger mauvaise l’évaluation de certains coûts quand aussi peu d’établissements disposent d’une comptabilité analytique digne de ce nom ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Il reste en effet beaucoup de progrès à faire en la matière, et c’est pourquoi nous avons fait du développement de la comptabilité analytique une de nos priorités.
Cependant, au-delà de la nécessité d’outils de comptabilité analytique au niveau des établissements, le problème est aussi celui de la fixation des tarifs au niveau national et de la répartition entre les différents secteurs d’activité au sein de l’objectif national des dépenses de l’assurance maladie (ONDAM).
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. En tout état de cause, en cas d’écart important entre ce que rapporte une prestation et ce qu’elle coûte, le gestionnaire n’aura-t-il pas tendance à privilégier celle qui rapporte plus qu’elle ne lui coûte ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Pas à l’hôpital public en tout cas, si j’en crois mon expérience à Paris, en Normandie ou en Lorraine aujourd’hui. L’hôpital public ne sélectionne pas ses patients en fonction de la rentabilité de leur prise en charge dans le cadre de la tarification à l’activité. Si tel était le cas, il n’y aurait pas autant d’établissements déficitaires !
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il faut en effet craindre, non seulement la comparaison entre le coût et le bénéfice d’une prestation, mais également entre le secteur public et un secteur privé qui obéit à une logique différente : peut-on raisonnablement pousser la convergence tarifaire entre les deux secteurs jusqu’à l’identique ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Le débat a été provisoirement tranché par le Parlement…
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Disons plutôt qu’il a été reporté.
Mme Véronique Anatole-Touzet. En tout état de cause, je ne pense pas qu’on puisse aller beaucoup plus loin.
Vous avez raison de souligner que la question est double : celle de la fixation des tarifs par rapport au coût des prestations, d’une part, et celle de la comparaison des coûts entre le public et le privé, d’autre part.
S’agissant du premier aspect de la question, il est aujourd’hui démontré, notamment par les études de la Fédération hospitalière de France, que certaines activités de l’hôpital public sont structurellement déficitaires. Dans les unités neuro-vasculaires, dans les services de réanimation, d’endocrinologie ou de pédiatrie générale, il est difficile d’ajuster les tarifs des prestations à leur coût afin d’équilibrer les comptes de ces secteurs d’activité. Il en va de même dans les services de médecine qui sont surreprésentés dans l’hôpital public.
En ce qui concerne la convergence tarifaire, les tarifs doivent être appréciés en tenant compte des spécificités de l’hôpital public. Or, aucune étude n’a encore été consacrée à ce sujet. On sait en revanche que certaines activités constituent pour les hôpitaux privés de véritables rentes de situation. Ainsi le tarif d’une chirurgie de la cataracte est-il nettement supérieur à son coût.
M. le coprésident Pierre Morange. Selon certaines autorités de tutelle que nous avons auditionnées, un délai de trois à quatre ans est raisonnable pour doter d’une comptabilité analytique l’ensemble des établissements de santé d’une certaine taille. Partagez-vous cet avis, et quel est, selon le vous, le délai minimal nécessaire ?
Mme Véronique Anatole-Touzet. Toutes choses égales par ailleurs, ce délai me paraît raisonnable pour des établissements d’une taille significative. Encore faut-il s’entendre sur le degré de comptabilité analytique que l’on souhaite : on pourrait certainement établir plus rapidement une comptabilité analytique générale. En revanche, l’établissement d’outils de gestion validés par les partenaires en interne et mis à disposition des pôles demande plus de temps. Un délai moyen de trois ans me paraît raisonnable, quoique confortable, étant donné l’extrême variabilité des situations d’un établissement à l’autre.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous remercions, madame.
*
Audition de M. Philippe Roussel, directeur général du Centre hospitalier du Mans, et Mme Céline Lagrais, directrice chargée des affaires financières et du contrôle de gestion, M. Lucien Vicenzutti, directeur du Centre hospitalier de Lens, et Mme Véronique Vosgien, vice-présidente de la commission médicale d’établissement, et M. Philip Vrouvakis, directeur général de la Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle.
M. le coprésident Pierre Morange. Si nous avons souhaité, mesdames, messieurs, vous entendre dans le cadre de notre réflexion sur le fonctionnement de l’hôpital, c’est que nous attendons des acteurs de terrain qu’ils nous offrent une approche pragmatique de la problématique hospitalière, afin d’en tirer des préconisations profitables à tous.
M. Philippe Roussel, directeur général du Centre hospitalier du Mans. Le centre hospitalier du Mans est un établissement important, tant en nombre de lits que par le bassin qu’il dessert. Il s’inscrit en effet dans un territoire sarthois de 500 000 habitants. Dans certaines disciplines telles que la pédiatrie, son activité s’étend même à la Mayenne, l’Eure-et-Loir et l’Indre-et-Loire, et concerne jusqu’à un million d’habitants.
C’est un établissement « jeune », son développement ne datant que d’une vingtaine d’années. Il compte 1 700 lits, dont 1 200 lits actifs, les lits restant étant des lits de long séjour en cours de reclassement entre les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes et les unités de soins de longue durée.
Cet établissement, qui n’est pas un centre hospitalier universitaire, se trouve à proximité de deux CHU, ce qui lui pose un incontestable problème de positionnement stratégique. Il y a cinquante ans, au moment de la création des CHU, c’était un hôpital-hospice. Ces vingt dernières années, les élus locaux et le ministère ont eu la volonté d’y faire venir des médecins de qualité et de varier ses activités. Depuis, le centre hospitalier compte des disciplines qui ne sont d’ordinaire pratiquées que dans les CHU, telle la chirurgie pédiatrique de pointe.
Cet établissement s’est très vite engagé dans la nouvelle gouvernance hospitalière, au point d’être expérimentateur en ce domaine. Voilà quelques années, à partir d’une culture financière inexistante, il a fait le pari d’une plus grande implication de la communauté médicale dans la gestion, mais aussi dans la prise de décision stratégique. Cela a demandé un travail très important : la création à titre expérimental d’un conseil exécutif dès 2003, la mise en place de contrats de pôle, une implication forte dans la comptabilité analytique en référence à l’échelle nationale des coûts ; enfin, au fur et à mesure que nous disposions des éléments nécessaires, du benchmarking interétablissement à partir d’une base de données augmentée chaque année.
Enfin, l’hôpital réalise depuis des années d’importants investissements, qui n’ont pas toujours été approuvés par l’agence régionale de l’hospitalisation – je pense notamment à la construction d’un bâtiment à une époque que je n’ai pas connue. Cela explique la dette relativement importante de l’établissement.
Dans le cadre du plan Hôpital 2007, la poursuite de la modernisation du centre hospitalier bénéficiera d’un financement à hauteur de 50 %.
Le centre a manifesté assez tôt une attention à la maîtrise des coûts, qui n’a fait que se renforcer au fur et à mesure de la montée en puissance de la T2A. En 2008, l’hôpital a conclu avec l’agence régionale de l’hospitalisation un contrat de retour à l’équilibre. Il respecte depuis, dans toute la mesure du possible, les conditions de ce plan exigeant, grâce à l’implication forte de tous les partenaires, personnels y compris. C’est que l’établissement connaît depuis quelques années une véritable mutation culturelle, grâce à la nouvelle gouvernance, au contrat de retour à l’équilibre, et à un plan de développement stratégique qui a été largement expliqué et négocié. Aujourd’hui, la performance hospitalière fait l’objet, chez tous les acteurs, d’une véritable réflexion.
M. Lucien Vicenzutti, directeur du Centre hospitalier de Lens. Le centre hospitalier de Lens – sachant que le CHU n’est distant que de quarante kilomètres – est un grand établissement de 1 200 lits, dont 800 sont actifs. Son rayon d’action de dix kilomètres couvre le cœur très urbanisé de l’ancien pays minier, soit 400 000 habitants. Cette population est pour partie en difficulté sociale, ce qui se traduit par un accès problématique aux soins, par des indicateurs de santé parmi les plus bas de France et par des efforts de prévention qui se heurtent à une attitude de méfiance.
Avec Béthune, Douai et Arras, la zone sanitaire de l’Artois comprend plus d’un million d’habitants. Le centre hospitalier dispense l’ensemble des prestations de proximité – médecine, chirurgie – et dispose de pôles d’excellence en cardiologie, neurologie, en soins de réanimation, en néonatologie, et, en partenariat avec le privé, en cancérologie, radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie cardiaque.
L’établissement a connu une crise financière grave à partir de 2006. Elle reflétait l’impréparation du centre à la tarification à l’activité. Le secteur privé, à but lucratif ou non, a su attirer les compétences qui travaillaient autrefois au centre hospitalier dont la perte d’attractivité s’est traduite par un manque à gagner, au point que les recettes ne couvraient plus les coûts. Pour un budget de 180 millions d’euros, nous encourions au début de l’année 2007 un déficit de 19 millions d’euros. Grâce à l’agence régionale de l’hospitalisation et aux conseillers généraux siégeant au sein des établissements de santé, une prise de conscience est intervenue qui a permis de mettre en place un plan de retour à l’équilibre pour stopper l’hémorragie. Le déficit a été ramené à 13 millions d’euros en 2007 pour un déficit structurel se situant autour de 9 millions. Avec les aides de l’agence régionale de l’hospitalisation, il a été de 8 millions en 2007 et de 2,5 millions l’an dernier.
La prise de conscience a eu aussi des effets pervers. Les restructurations que nous avons engagées en regroupant des unités, en supprimant des postes – 130 en deux ans – n’ont pas permis de procéder à une réorganisation fine des services. Malgré la réduction de certains avantages sociaux – en matière de gestion des réductions du temps de travail notamment –, l’absentéisme a eu tendance à augmenter de même que les heures supplémentaires. La réforme a été mal vécue sur le plan social puisque l’établissement n’avait pas de visibilité à long terme.
Nous sommes passés l’année dernière d’une logique de plan de retour à l’équilibre à une logique de plan de développement stratégique qui place les coopérations au cœur du projet. L’hôpital de Lens fait partie d’une communauté hospitalière de territoire dont la constitution est souhaitée par les hôpitaux de Béthune et d’Arras. La reconstruction du centre s’impose à cause de l’inadaptation des bâtiments actuels, pavillonnaires, qui sont vétustes et probablement à l’origine d’une partie de nos surcoûts. Nous l’engagerons en partenariat avec le privé à but non lucratif et en coopération avec d’autres sites à Hénin-Beaumont et Liévin.
Nous allons donc réorganiser une offre de soins fédérée au niveau de l’Artois, autour d’un site compact en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie. Nous espérons aussi pouvoir développer avec le CHU tout proche des missions de formation ou encore de recherche dans un cadre régional. La coopération donnera un sens au projet de reconstruction qui nécessitera certainement des investissements importants, supérieurs à 200 millions d’euros. Mais ce projet, qui recueille l’adhésion des personnels et des médecins, ne se concrétisera que si nous revenons à l’équilibre.
L’autre axe du plan est donc la performance – c’est-à-dire la qualité, sans laquelle l’offre ne peut rencontrer la demande – et l’efficience. Il s’agit de faire la meilleure prestation au moindre coût. C’est sur cet objectif que nous pouvons mobiliser et accélérer le basculement culturel qui s’opère doucement depuis deux ans. Après la prise de conscience, il faut faire naître l’espoir autour d’un projet et prouver la capacité des unités de soins en mobilisant les équipes soignantes et en optimisant l’organisation. Il nous reste encore des étapes à franchir puisque nous devons trouver 10 millions d’euros, soit en augmentant l’activité – par le dépistage des cancers ou des maladies vasculaires dont a, hélas, besoin la population –, soit en réformant encore nos structures de coût, cette fois-ci non plus par une impulsion verticale, mais en partant du terrain.
Nous nous appuyons sur les pôles que nous avons créés dans le cadre du plan de retour à l’équilibre. Cette année, un comité de pilotage réunissant les trois pôles a beaucoup travaillé sur les données médico-administratives.
M. le coprésident Pierre Morange. Disposez-vous d’une comptabilité analytique voire d’un contrôle de gestion ? Comment est organisée la facturation, qui, si elle est déficiente, peut constituer un manque à gagner pouvant atteindre entre 5 % et 10 % des recettes ?
M. Lucien Vicenzutti. Nous disposons à la fois d’une comptabilité analytique et d’un contrôle de gestion. Quant à la facturation, le plan de retour à l’équilibre a été l’occasion de se pencher sur la question.
Le recouvrement des factures d’actes techniques et des consultations aux urgences était insuffisant. La perte peut être évaluée à 2,5 millions d’euros sur des recettes d’activité de 100 millions. Le reste des ressources provient des enveloppes globalisées : psychiatrie, missions d’intérêt général ou gériatrie.
La sous-facturation était ciblée sur certains secteurs. Les consultations étaient plutôt bien couvertes, mais le codage des actes insuffisant. Nous avons récupéré 500 000 euros en 2007 sur les consultations, 600 000 euros l’an dernier et de l’ordre de 400 000 euros cette année. S’agissant des séjours, il y avait également une sous-codification. Faute de taper les lettres de sortie rapidement, on perdait en précision et en exhaustivité. En travaillant activement avec le département d’information médicale (DIM), nous avons récupéré 2,5 millions sur les séjours.
M. le coprésident Pierre Morange. Entre l’option centralisée – codification par le département de l’information médicale – et l’option décentralisée – codage effectué par les praticiens – apparemment plus réactive et plus précise, laquelle avez-vous choisie ?
M. Lucien Vicenzutti. La taille de l’établissement est telle que le directeur de l’information médicale ne peut être partout. L’enjeu est donc de responsabiliser les pôles et le personnel médical. Nous y parvenons dans certains pôles, beaucoup moins dans d’autres.
Le pivot du système est le secrétariat médical puisque la facturation suit une chaîne qui va du dossier médical à la lettre de sortie adressée au médecin traitant, pour le fidéliser. C’est à partir de cette lettre que le codage est effectué. Nous avons opté pour une solution de compromis puisque nous avons créé la fonction de technicien d’information médicale qui, sur la base de la description de l’acte et de la pathologie du patient, propose un codage qui est entré dans la V10 ou la V11 de la T2A. Le logiciel dont nous sommes équipés permet une simulation en direct. Les postes sont occupés par des secrétaires médicales qui sont ensuite formées par le département de l’information médicale. Elles travaillent en étroite collaboration avec le médecin qui est chargé de contrôler. C’est une façon pour nous de les impliquer dans le système.
M. le coprésident Pierre Morange. Le délai de six mois nécessaire, selon les expériences passées, pour l’appropriation du codage par les médecins est-il raisonnable ?
M. Lucien Vicenzutti. Les délais sont longs à l’hôpital, surtout pendant les phases de restructuration où les réformes et changements de tous ordres s’accumulent. La comptabilité analytique et les tableaux de bord facilitent cependant la prise de conscience.
Ensuite, il faut sur le terrain mobiliser des médecins, trouver des alliés dans les pôles ou une responsable du secrétariat médical pour servir de relais. Réorganiser prend du temps, mais avec une volonté forte et la mobilisation des acteurs c’est possible, même si les délais sont très variables d’un pôle à l’autre.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pourquoi les délais de mise en place du codage à la source sont-ils très variables – de quelques mois à plusieurs années – d’un établissement à l’autre ?
M. Vouvrakis, vous avez maintenant la parole pour nous présenter l’établissement que vous dirigez.
M. Philip Vouvrakis, directeur général de la Maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle. La Fondation Bagatelle comprend plusieurs établissements. Celui que je dirige participe au service public hospitalier. Il appartient donc au secteur privé à but non lucratif. Le chiffre d’affaires total de la Fondation est de 65 millions d’euros environ, dont 45 millions environ pour l’hôpital. Nous comptons 200 lits à l’hôpital Bagatelle, 200 lits d’hospitalisation à domicile et une soixantaine de lits en soins de suite et de réadaptation.
Les caractéristiques de la Fondation sont celles du secteur privé sans but lucratif participant au service public hospitalier (PSPH), qui a su faire preuve d’un dynamisme certain, et a été parfois un vecteur de l’innovation. Ainsi, nous avons été parmi les premiers à lancer l’hospitalisation à domicile en France. La Fondation a développé, en périphérie de son projet hospitalier, des capacités d’accueil temporaire pour les personnes âgées qui font encore l’effet de projets pilotes. En même temps, l’institution s’est reposée sur son prestige, si bien que ses résultats sont négatifs depuis 2000 et que, à la fin de l’année 2007, elle s’est retrouvée en cessation de paiement. Si elle a pu s’en sortir, c’est grâce aux aides financières extérieures.
Dès mon arrivée le 2 janvier 2008, un conseiller de Capgemini est venu m’épauler, ce qui m’a fait gagner beaucoup de temps pendant les six mois de son mandat. Ensemble, nous avons remis à plat tout le fonctionnement de la fondation. Le conseil d’administration a été renouvelé pour moitié – parfois dans des conditions difficiles – et son fonctionnement reconsidéré. La direction a été remaniée aux trois quarts.
Nous n’avons pas gardé grand-chose de l’organisation initiale même si la Fondation avait, par exemple, profité d’une zone grise de la réglementation pour faire appel à des médecins libéraux, mais la frontière entre les activités libérales et non lucratives restait floue – les médecins étaient rémunérés d’après leur relevé d’activité, l’établissement étant sous le régime de la dotation globale. Les deux mondes ignoraient délibérément leurs différences, notamment au niveau du codage que les médecins libéraux, traditionnellement payés à l’acte, maîtrisent rapidement. Depuis quelque temps, nous avons conditionné le règlement au codage des dossiers et les médecins ont vite compris.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pouvez-vous quantifier les résultats ?
M. Philip Vrouvakis. Nous avons surtout gagné du temps. Comme beaucoup d’établissements publics, la Fondation avait mal anticipé l’impact de la T2A sur son chiffre d’affaires, qui bouleverse l’importance relative de certains métiers au sein de l’hôpital. Avec la T2A, la facturation est devenue un métier phare et il a fallu faire en six mois ce que les autres ont eu six ans pour préparer. Les choses se sont plutôt bien passées. L’atmosphère était anxiogène, mais chacun a compris qu’il n’était pas visé en particulier et qu’il avait sa pierre à apporter à l’édifice. Parallèlement, nous avons entrepris un important travail de communication interne. L’amélioration qualitative et quantitative du codage a permis de récupérer plus de 10 % du chiffre d’affaires T2A, soit 450 000 euros. La culture du service public hospitalier faisait que certains services n’étaient jamais facturés. Le circuit du patient n’était pas organisé autour de la facturation.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La concomitance entre le foisonnement des plans de retour à l’équilibre financier et la mise en œuvre de la T2A a-t-elle révélé des déséquilibres ou en a-t-elle créé ? Quel est son impact dans la gestion des établissements ?
M. Philippe Roussel. La T2A a certainement été un révélateur car elle incite à réfléchir sur les pratiques professionnelles. Elle est indissociable de la mise en œuvre d’une comptabilité analytique et d’outils de comparaison. L’aspect positif est qu’elle a été pour nous un élément moteur important.
L’aspect négatif, c’est l’absence de stabilisation des tarifs et, partant, de visibilité. Après la montée en charge, il y a eu les changements de tarifs, de périmètre avec la V11, ce qui complique non seulement l’exercice de prévision mais aussi nos efforts de pédagogie auprès des médecins. Nous les avions entraînés dans une sorte de démarche de gestionnaire, et ils ont vécu ces événements comme une perte de repère. Nous demandons donc une stabilisation des tarifs pour pouvoir continuer à avancer.
La T2A a rapidement introduit la culture économique dans l’hôpital à tous les niveaux, y compris auprès des partenaires sociaux. Ils ont bien compris que la logique sur le terrain a changé, même s’ils la contestent sur le plan politique. Nous en sommes à intégrer la nécessaire réflexion organisationnelle à l’intérieur des pôles, puisque nous diffusons un compte de résultat analytique par pôle et, depuis cette année, le tableau coûts/case mix (TCCM) qui permet de comparer les données de coûts et d’activité d’un établissement avec les données de la base de l’étude nationale de coûts (ENC). Cette démarche suscite des réflexions sur les moyens de remédier aux écarts de coût de revient.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pourriez-vous nous donner des exemples précis ?
M. Philippe Roussel. L’exemple le plus frappant, c’est la chirurgie. Pour des raisons géographiques et historiques, nous avons choisi d’avoir un important pôle de chirurgie, et non pas plusieurs pôles organisés autour de différentes pathologies d’organes. Ses premiers résultats analytiques étant fortement déficitaires, nous avons engagé une réflexion avec un consultant extérieur et élaboré un plan de retour à l’équilibre propre au pôle, se traduisant par des fermetures ou des transformations de lit. Le tableau coûts/case mix met en évidence que l’hospitalisation en chirurgie est 3 % moins chère que la moyenne des coûts des autres établissements de la base de l’étude nationale de coûts. Mais, si l’on intègre les consultations de chirurgie, elle devient plus chère que la moyenne. Nous essayons de comprendre pourquoi en analysant la formation des coûts.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment les personnels réagissent-ils ?
M. Philippe Roussel. Nous sommes partis de l’idée que le contrat de retour à l’équilibre – expression que je n’aime pas parce qu’elle renvoie à un éden passé qui n’a jamais existé – ne serait que le prélude du plan de développement stratégique. En présentant ce changement de culture, nous avons souligné que les règles nouvelles résultaient d’une volonté nationale de comparer les établissements publics entre eux, mais aussi avec les établissements privés. Les personnels ont fini, plus ou moins, par s’engager dans la démarche. La diffusion des tableaux de bord prouve que des progrès ont été enregistrés, notamment dans l’organisation à certains endroits. La réduction du temps de travail a été renégociée globalement, avec un objectif financier, mais aussi dans certains pôles, ce qui a permis de montrer que les pratiques médicales pouvaient être modifiées pour faciliter les récupérations de réductions de temps de travail.
En définitive, notre principale mission a consisté à expliquer le pourquoi de la démarche, en particulier qu’elle n’avait pas forcément pour objectif de faire des économies. J’ai été agréablement surpris de voir que la notion de reconstitution de la capacité d’autofinancement, qui est tout de même très abstraite, pouvait devenir un élément moteur auprès des médecins.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le privé n’obéit pas à la même logique.
M. Philippe Roussel. Pour répondre aux arguments que vous avez entendus maintes fois, nous avons privilégié, avec le conseil exécutif et la commission médicale d’établissement, une approche en termes de qualité et de service médical rendu. Le jour où on arrivera à cerner la notion coût/qualité en englobant le critère de l’opportunité de l’acte, aussi bien dans le public que dans le privé, on aura beaucoup progressé. Pourquoi y a-t-il beaucoup de chirurgie ambulatoire dans le privé ? Parce que, objectivement, les pathologies associées sont souvent moins lourdes que ce soit pour une cataracte, un canal carpien ou autre. Les patients qui sont récusés par les cliniques du Mans viennent chez nous.
Le jour où l’assurance maladie le voudra, elle pourra aller plus loin dans l’analyse et comparer effectivement les coûts. L’hôpital public a son histoire, mais il faudra qu’il évolue dans le temps, notamment en ce qui concerne les statuts du personnel.
M. Lucien Vicenzutti. La T2A révèle des fragilités stratégiques et des problèmes de facturation et de coût. De toute façon, elle est devenue une réalité et, que l’on soit d’accord ou non, on va vers la convergence tarifaire. Le problème vient de ce que les obligations ne sont pas les mêmes, de part et d’autre. L’hôpital n’a plus l’exclusivité de la mission de service public, qui peut désormais être partagée, mais il continue d’accueillir des patients qui n’iront pas ailleurs. Pour autant, le management médical et administratif répète que, sans adaptation, des pans entiers d’activité vont disparaître. C’est une remarque dont nous tenons compte dans la prospective stratégique. Ainsi, nous savons très bien que nous ne pourrons pas garder la chirurgie viscérale. Aussi allons-nous nous organiser avec notre partenaire privé. En revanche, si nous mettons l’accent sur le dépistage et la prévention, nous pourrons reconquérir des activités et redevenir leader, par exemple en cancérologie et en médecine vasculaire.
Il faut veiller constamment à l’équilibre économique en s’assurant que les besoins sont couverts, sans céder à la tentation de prendre des activités rentables. Le tableau médico-économique de chaque pôle met en évidence des activités structurellement déficitaires : la réanimation, l’hématologie, les urgences. Pourtant, on ne peut pas ne pas en faire. Mais la cardiologie est excédentaire, et la maternité se porte bien aussi. Il faut chercher à développer des activités tout en travaillant sur les coûts et l’organisation. La chirurgie est encore largement déficitaire parce que chacun a gardé l’habitude de tout faire dans son service.
Changer prend du temps car on ne peut pas agir sans l’adhésion des acteurs. Nous le faisons dans la transparence et, à cet égard, les tableaux de bord y contribuent. Le benchmarking est intéressant et nous n’hésitons pas à nous comparer à nos voisins. Il n’y a pas de fatalité au déficit, même si la précarité des patients n’est pas suffisamment prise en compte. Il faut sortir du défaitisme pour s’inscrire dans un axe de développement. La population autour de Lens a encore besoin de soins. Il faut travailler avec les partenaires à l’organisation des soins.
Mme Véronique Vosgien, vice-présidente de la commission médicale d’établissement du Centre hospitalier de Lens. Les gens sont prêts à travailler sur les coûts, mais la rapidité de réaction tient surtout à l’autonomie qui est laissée aux pôles, en termes d’organisation ou de gestion de personnel. L’autonomie contribue à une meilleure visibilité et à une responsabilisation accrue des acteurs de terrain pour viser un objectif commun qui ne peut en aucun cas être exclusivement économique. Pour que cela marche, il faut aussi mettre l’accent sur la qualité. Une fois cette étape franchie, l’hôpital pourra retrouver un deuxième souffle et travailler différemment.
N’oublions pas que le passif est lourd. On ne parlait jamais d’argent à l’hôpital. Quand il a fallu expliquer à nos équipes soignantes qu’elles devaient se préoccuper des coûts, ce fut une révolution. Il a fallu du temps, mais, à Lens, au bout de deux ans, la prise de conscience a eu lieu. Le challenge, maintenant, c’est d’être au plus près du terrain, c’est-à-dire du lit du patient. C’est de cette façon qu’on pourra encore améliorer les coûts.
Il faut porter un regard précis et aigu sur les flux de patients, précaires notamment, pour voir comment ils vont évoluer dans le temps sous l’effet de la tarification. Étant psychiatre, je suis peu concernée, mais mes collègues se demandent aussi comment établir un budget prévisionnel si les tarifs changent tous les ans.
M. Jean-Luc Préel. Les difficultés des blocs opératoires tiendraient en partie, dit-on, à l’indépendance traditionnelle des chirurgiens qui s’organisent à leur guise. En sont-ils conscients et sont-ils prêts à coopérer ?
M. Lucien Vicenzutti. Le bloc opératoire fait partie des six priorités de notre plan stratégique de développement. C’est un élément clef pour attirer sur notre plateau technique les praticiens de demain. La tendance historique était d’avoir un bloc par praticien ou chirurgien. Il faut travailler à la fois sur la planification des plages en amont, en fonction des besoins, et sur les délais. Il est important de commencer à l’heure, de ne pas perdre de temps entre deux interventions – ce qui touche aux comportements et aux habitudes – et de se coordonner avec l’amont, comme l’instrumentation, et l’aval, avec l’évacuation des déchets contaminés. Il faut revoir toute la chaîne. Un bloc opératoire, c’est aussi compliqué à gérer qu’un aéroport.
M. Jean-Luc Préel. Le statut du praticien hospitalier peut-il être un moyen de l’intéresser au bon fonctionnement ?
M. Lucien Vicenzutti. Je vois deux moyens de l’intéresser. Le premier tient à la transparence et au regard porté collectivement sur les habitudes de travail. Le fait d’afficher en direct le temps pris pour ouvrir le bloc ou passer d’une intervention à l’autre, et de l’évaluer régulièrement dans le cadre du conseil de bloc, permet de valider collectivement les comportements individuels.
Le second moyen est relatif à l’introduction d’un élément de variabilité dans la rémunération. Si, par exemple, un chirurgien était en partie rémunéré à l’activité, il aurait intérêt à une organisation plus efficiente. Mais ce n’est pas la seule réponse à apporter. Il faut d’abord un travail de groupe pour définir une organisation efficace. On peut très bien accueillir demain des praticiens salariés. Mais il faut, en tout état de cause, un bloc efficient.
M. Philip Vrouvakis. Au départ, les établissements privés associatifs croyaient que, au fur et à mesure de la montée en puissance de la T2A dans le budget, leur activité se développerait et que leur effort serait reconnu.
Nous souffrons nous aussi du manque de lisibilité. Établir des budgets sur la base des tarifs de l’année antérieure ne facilite pas la gestion. Et c’est très démobilisant pour les médecins.
En outre, certaines erreurs majeures ne devraient plus être commises aujourd’hui. La V11 fait apparaître une difficulté en ce qui concerne les durées de séjour inférieures à la borne basse, laquelle est corrélée à la lourdeur de la pathologie. Sur ce point, le passage de la V10 à la V11 a coûté à l’hôpital de Bagatelle la somme de 800 000 euros. L’étude de l’agence régionale de l’hospitalisation montre que nous sommes l’un des établissements les plus touchés en Aquitaine. Cela tient peut-être à un case mix spécifique.
La T2A est destinée également à induire des pratiques. À cet égard, il faut maintenant convaincre les chirurgiens d’allonger les séjours d’une journée après tout le discours qui leur a été tenu depuis dix ans sur l’intérêt qu’il y avait à les raccourcir !
Avec l’agence régionale et l’assurance maladie, nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi nous étions si touchés. Il semble qu’il y ait deux causes. La première est que nous faisons appel à des médecins libéraux qui, sans jugement de valeur de ma part, sont ipso facto incités à vider plus rapidement les lits. La seconde serait que les durées de séjour type dans la nouvelle version du programme de médicalisation des systèmes d’information résultent de moyennes qui intègrent les services d’urgence. Or un patient admis aux urgences est souvent opéré le lendemain car les vraies urgences sont rares. Le périmètre rallongerait de façon un peu artificielle la durée de séjour, les établissements qui n’ont pas de services d’urgence ayant une durée de séjour plus courte. C’est une piste que nous allons creuser avec l’Assurance maladie. Toujours est-il que nous faisons passer le message aux chirurgiens de garder leurs patients une nuit de plus.
M. Philippe Roussel. Le succès des réformes, de la T2A et de la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, repose sur une double démarche : une dynamique collective forte impulsée par une équipe directeur-médecins et un pilotage au plus près du terrain. À cet égard, l’exemple du bloc opératoire est typique des difficultés que nous avons tous rencontrées au long de notre carrière. Quand on a laissé les acteurs de terrain réfléchir avec l’aide de la Mission nationale d’audit et d’expertise hospitaliers, ils ont trouvé de nouveaux outils qu’on utilise désormais couramment, comme le TROS, c’est-à-dire le temps réel d’occupation des salles, qui est un indicateur terriblement efficace. J’espère que demain ce sera le directoire qui donnera l’impulsion et qu’un organe, du type de l’assemblée des responsables de pôle que nous avons créée, pilotera la démarche sur le terrain.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous remercions pour la qualité des informations que vous nous avez données. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les compléter par écrit et nous faire des propositions, y compris d’ordre réglementaire, voire législatif.
*
AUDITIONS DU 3 DÉCEMBRE 2009
Audition de M. Gérard Vincent, délégué général de la Fédération hospitalière de France (FHF), et de M. Yves Gaubert, responsable du pôle finances.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous entendrons ce matin les représentants des trois fédérations d’établissements hospitaliers. Dans le cadre du travail qu’elle a engagé sur le fonctionnement de l’hôpital, la MECSS a commencé par examiner des cas particuliers pour en tirer des enseignements susceptibles d’être généralisés à l’ensemble des établissements hospitaliers. Nous avons notamment étudié le cas du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, pour tirer des leçons de son déficit, ainsi que d’autres établissements qui ont connu des processus de fusion plus ou moins réussis.
Nous avons voulu vous recevoir, messieurs, pour connaître votre analyse de la situation financière des hôpitaux et du traitement des déficits. Le renflouement par les tutelles ne fait-il que prolonger la maladie, ou est-il susceptible de rétablir la bonne santé financière des établissements ?
Par ailleurs, au moment où entre en vigueur la tarification à l’activité, les établissements ne disposent pas toujours des outils nécessaires à une comptabilité analytique performante. De fait, les outils informatiques et la formation des personnels, ainsi que leurs habitudes de travail, pourraient être améliorés. Quant à la facturation des prestations, elle est parfois lacunaire. Que peut-on, enfin, attendre des tutelles – quel peut-être, par exemple, le rôle de l’Agence nationale pour l’appui à la performance hospitalière (ANAP) ?
M. Gérard Vincent, délégué général de la Fédération hospitalière de France. Je soulignerai d’emblée que la collectivité ne renfloue pas les hôpitaux en déficit. En réalité, alors que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) hospitalier est respecté, le déficit – qui représente 600 à 700 millions d’euros chaque année, soit 1,5 % seulement de la masse budgétaire malgré l’importance de la somme – est pris sur la substance des hôpitaux, c’est-à-dire sur leurs réserves et leurs fonds de roulement, ce qui présage pour les années à venir des difficultés en termes d’investissement. En effet, l’investissement hospitalier est en partie financé par les établissements eux-mêmes, à partir de l’amortissement ou des excédents d’exploitation. La diminution de la capacité d’autofinancement des hôpitaux est masquée par les apports en capital des plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 – qui, je le rappelle, figurent dans l’ONDAM sous forme de prise en compte des surcoûts liés aux emprunts, alors que le secteur privé bénéficie de dotations en capital. Sans ces aides, les hôpitaux ne pourraient plus investir. Cependant, si modeste soit-il, un déficit est toujours excessif.
Bien que nos concurrents privés affirment que la convergence entre public et privé doit être accélérée parce que les hôpitaux publics sont plus chers, l’avenir nous montrera que l’hôpital public est sous-financé par rapport au poids de ses missions de service public.
Le seul moyen de rester dans les limites des enveloppes qui nous sont accordées consiste à réduire l’emploi. De fait, la masse salariale représente aujourd’hui de 68 % à 70 % de nos charges et les 7,5 % à 8 % liés au coût des médicaments progressent à un rythme très supérieur à celui de l’inflation, balayant les effets des économies réalisées sur les fonctions logistiques ou de support. La seule variable d’ajustement est donc la masse salariale. Cette question est moins taboue qu’elle ne l’était voilà encore quelques années. La réduction de l’emploi doit cependant, pour être indolore, se faire le plus intelligemment possible, c’est-à-dire par la réorganisation des activités, notamment médicales. C’est là une question de volonté – et c’est précisément là que l’on rencontre des blocages politiques, parce que l’hôpital est un symbole, qu’il est le plus gros employeur local et qu’il est encore politiquement incorrect de toucher à l’emploi. Si donc les professionnels ont compris que la réduction de l’emploi était la seule solution pour tenir les budgets, il n’est pas certain que la collectivité nationale en soit déjà consciente. Le différentiel qui se creuse chaque année entre l’augmentation des charges et celle de l’ONDAM hospitalier confirme toutefois que, faute de pouvoir limiter l’activité dans le cadre de la tarification à l’activité (T2A), il faut jouer sur les moyens humains.
Nous sommes entrés dans une spirale inflationniste. De fait, l’ONDAM définit chaque année une augmentation des tarifs et du volume d’activité prévisionnel. Un établissement qui n’atteint pas l’augmentation prescrite – fixée par les pouvoirs publics à 1,7 % – ne percevra pas la partie de l’ONDAM correspondante, tandis que ses dépenses continueront à courir, ce qui le mettra dans une situation budgétaire difficile.
Je ne suis pas certain qu’il soit raisonnable d’obliger les hôpitaux à développer leur activité. Jean Leonetti, président par intérim de la FHF, soulignerait sans doute à ce propos l’importance de l’évaluation de la pertinence des actes et des interventions. Dans certains secteurs, comme la chirurgie, l’activité est en effet trop importante. On fait des choses inutiles et il y a là une source de vraies économies. Cependant, la suppression des activités inutiles se traduit par une diminution du chiffre d’affaires – à moins qu’elle ne s’accompagne d’une augmentation des tarifs.
Aujourd’hui, cette question n’intéresse personne. Les statistiques comparant les taux de césarienne par département, que nous avons publiées en décembre dernier, révèlent des écarts choquants, mais rien n’a été fait depuis – même s’il est probable que les professionnels ont modifié certains comportements. Comment expliquer que les arthroscopies du genou soient plus fréquentes dans un département plat qu’en Savoie ou en Haute-Savoie ? Cela révèle des comportements inacceptables, mais c’est là encore un sujet tabou. Les abus sont bien plus nombreux dans les cliniques privées que dans les hôpitaux, et l’on y opère des malades qui ne devraient pas être opérés. Il y a là des excès, et même des scandales.
L’évaluation de la pertinence des actes et des interventions est sans doute le dossier de santé publique de demain, pour des raisons tant financières que de santé publique. Je rappelle à ce propos que, voilà une trentaine d’années, les statistiques de prévalence par département de cette intervention grave qu’est l’hystérectomie totale ont fait apparaître des différences considérables, ce qui est monstrueux.
Quant à la maîtrise des dépenses, la seule solution est, je le répète, compte tenu de la contrainte économique, de toucher à l’emploi – en le faisant le plus intelligemment possible. Dans cette perspective, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires devrait permettre de rationaliser l’offre de soins hospitalière dans le secteur public. De fait, à la différence d’un établissement privé, un hôpital public ne peut pas se contenter de fermer lorsqu’il connaît des difficultés.
La Fédération hospitalière de France vise non seulement à défendre le service public auprès des pouvoirs publics, mais aussi et surtout à animer le milieu, car le service public sera d’autant plus fort qu’il s’adaptera à l’évolution des besoins de la population et à l’évolution de la médecine. Elle cherche donc à développer une stratégie de groupe, qui permet d’élaborer un projet médical commun pour chaque territoire de santé, d’éviter les doublons et de réaliser des économies sur les fonctions de support, grâce aux gains de productivité réalisés sur la logistique.
La situation de déficit, même si elle n’est pas dramatique compte tenu des masses financières en jeu, ne nous satisfait pas. La seule solution est, je le redis encore, de réduire de la manière la plus indolore possible la masse salariale, en l’accompagnant d’une réorganisation de nature à éviter les drames et les conflits sociaux qui pourraient naître d’une restructuration hâtive et non réfléchie.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Certains hôpitaux connaissent des situations particulières et font l’objet d’un plan de retour à l’équilibre et de diverses mesures prévoyant parfois la réduction des effectifs ou une réorganisation et s’accompagnant de dotations supplémentaires. Pourriez-vous donc, après le raisonnement « macro » que vous venez d’exposer, évoquer la gestion des hôpitaux d’un point de vue « micro » ? Ce sera l’occasion d’évoquer aussi, entre autres choses, l’application de la T2A.
M. Gérard Vincent. Au moins autant que la convergence entre les secteurs public et privé, il convient d’opérer une convergence intrasectorielle, à l’intérieur même du secteur public. Il n’y a aucune raison pour que certains hôpitaux soient, à activité égale, beaucoup plus chers que d’autres, et tous devraient se rapprocher de la médiane. Ce mouvement est en route. La T2A est un système de financement par les tarifs, ce qui suppose un calcul de coûts moyens sur la base d’échantillons – l’étude nationale de coûts. Il est dès lors inévitable que certains établissements se situent au-dessus de la moyenne, et d’autres au-dessous. Les établissements en difficulté sont ceux dont les coûts sont supérieurs au tarif, qui encaissent moins qu’ils ne dépensent. Ces établissements doivent faire des économies – lesquelles, une fois encore, supposent de toucher à l’emploi, compte tenu en particulier du dérapage des dépenses de médicament, qui balaie les économies que l’on peut réaliser sur l’alimentation, le ménage ou l’électricité. Il semble en effet que le Comité économique des produits de santé encadre davantage le prix du médicament en ville qu’à l’hôpital, de telle sorte que l’hospitalisation paie le prix de l’encadrement du prix du médicament en ville. Redisons-le : si l’ONDAM est insuffisant pour maintenir la masse salariale existante, il faut faire des économies sur celle-ci.
Lorsque je tenais ces propos voici quelques années devant le conseil d’administration de la FHF, la seule personne qui déclarait ouvertement partager ce raisonnement était l’actuel directeur général de l’Assistance publique, homme très courageux qui était alors en poste à Lyon. Il est irréaliste de chercher à traquer d’hypothétiques économies cachées.
M. Jean-Luc Préel. Je souscris à votre analyse quant à la masse salariale. Il est d’ailleurs arrivé à plusieurs reprises que des mesures de revalorisation du personnel n’aient pas été financées.
Quelle est votre interprétation du rapport de la Cour des comptes qui a fait apparaître des différences très importantes selon les établissements – parfois de 1 à 10 – en termes d’encadrement de personnel ?
Par ailleurs, que pensez-vous du fait que seule l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) soit autorisée par la loi à voter un état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) en déséquilibre ?
Enfin, le statut des praticiens hospitaliers est-il adapté à la T2A ? Comment ces médecins peuvent-ils être intéressés à un développement de l’activité ?
M. Gérard Vincent. Nous avons publié un communiqué de presse saluant le rapport de la Cour des comptes. Il est tout de même rare qu’un organisme donne raison à la Cour des comptes lorsqu’elle critique ses adhérents ! Certains écarts entre établissements ne sont pas acceptables – mais la situation des responsables d’établissements n’est pas facile et je ne leur jette pas la pierre.
Ces écarts sont souvent le fruit de l’histoire. Ainsi, un directeur d’hôpital dont je ne citerai pas le nom, après avoir été considéré pendant trente ans comme l’exemple même du gestionnaire avisé et efficace dans le cadre de la dotation globale de financement parce qu’il avait de l’entregent, était soutenu par les politiques et obtenait chaque année une confortable augmentation de son enveloppe, accumulant ainsi des moyens et recrutant du personnel, est devenu d’un coup, avec l’instauration de la T2A, le plus mauvais gestionnaire de France !
La Cour des comptes a donc raison de dire qu’il faut réduire les inégalités. C’est précisément ce que j’appelle la convergence intrasectorielle – et nous faisons tout pour aider les hôpitaux à y parvenir. Nous avons ainsi mis en place depuis quelques années la banque de données hospitalière de France, bien connue des spécialistes, qui permet aux établissements de se situer sur l’ensemble des activités et de prendre les décisions qui s’imposent.
Toutefois, nous avons été surpris par les écarts, parfois de 1 à 5, relevés par la Cour des comptes, qui compile les rapports des chambres régionales des comptes. Ces écarts, qui existent peut-être sur de très petits créneaux, sont curieux et nous avons du mal à y croire. Sur le principe, en revanche, la convergence des moyens des hôpitaux est nécessaire – c’est d’ailleurs bien ce que traduisent les plans de retour à l’équilibre.
Pour ce qui concerne l’Assistance publique, il ne me semble pas opportun d’attaquer cette belle maison hospitalière, car ce « vaisseau amiral » connaît des problèmes et supporte des charges spécifiques. S’il est vrai, par exemple, que les médecins de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) travaillent moins que les autres, il faut aussi rappeler que ces médecins sont plus souvent que d’autres dans les congrès internationaux, contribuant à assurer à la médecine française l’audience et le respect dont elle jouit dans le monde. Quant à permettre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de présenter un état prévisionnel de recettes et de dépenses en déséquilibre, cela relève du principe de réalité.
Gardons-nous de faire de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris un bouc émissaire. Une restructuration est certes nécessaire, mais son directeur général s’y emploie précisément en remettant à plat toutes les activités médicales, avec d’ailleurs l’appui courageux du président de la commission médicale d’établissement. Ces mesures – suppression d’activités dans certains hôpitaux et regroupements – devraient porter leurs fruits assez rapidement.
Quant à savoir si le statut des praticiens hospitaliers est adapté à la T2A, cela revient à dire, si je vous entends bien, qu’ils n’ont pas toujours intérêt à agir pour produire des soins. Nous nous sommes battus, dans le cadre de la discussion de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, pour que les hôpitaux puissent, lorsque c’était nécessaire, recruter des médecins sous contrat pour les intéresser à leur activité. Nous regrettons d’ailleurs que cette possibilité soit limitée aux postes à pourvoir et pensons qu’on aurait dû pouvoir recruter des contractuels. Cela aurait permis de bousculer un peu les statuts, car il est bon qu’il y ait une petite dose d’émulation et d’intéressement, même dans le service public.
M. Dominique Tian. Il faut aussi penser aux recettes, en particulier dans le contexte de la T2A. Qu’en est-il de la sous-facturation, voire de la non-facturation d’actes – et, en tout cas, de la mauvaise valorisation des actes – qu’on observe dans certains hôpitaux ?
M. Gérard Vincent. Ce sont deux problèmes distincts. Il y a, d’une part, avec l’absence de facturation et de recettes pour une activité qui a eu lieu, des défaillances administratives condamnables : l’administration n’a pas fait son travail pour assurer la facturation. Il y a, d’autre part, la question qualitative de savoir si la codification des actes est bien faite. Certains établissements ont ainsi perdu beaucoup d’argent parce que les activités étaient mal cotées. C’est là un problème de compétence, c’est-à-dire de qualification et de formation, continue notamment, des médecins des départements d’information médicale, qui sont la cheville ouvrière de la qualité des systèmes d’information et de la facturation. Je partage votre point de vue : il n’est pas normal qu’un hôpital perde des recettes parce qu’il est mal organisé.
M. Dominique Tian. Ma question était plus précise : avez-vous une idée de l’échelle de ces déperditions ? Comment s’expliquent les dysfonctionnements ? Quels sont, en outre, les progrès enregistrés ?
M. Yves Gaubert, responsable du pôle finances de la Fédération hospitalière de France. On ne peut pas évaluer très précisément la perte de recettes. La facturation systématique de tous les actes ne fait pas partie de la culture des cliniciens, ce qui explique sans doute une partie des pertes. Les chiffres de l’année en cours révèlent une progression à mesure que les médecins s’approprient ces nouveaux outils. Les volumes financiers perdus ne sont du reste pas considérables – quelques points de pourcentage en début d’exercice, avec une correction en cours d’exercice. En revanche, des pertes financières ont été causées par des retards de l’évolution de la législation, notamment pour le forfait sur les urgences. En effet, n’étaient intégrables dans l’activité que les éléments pris en charge par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui éliminait une partie des activités forfaitaires, d’une part, pour les patients étrangers bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME) et, d’autre part, pour les patients habitant les régions frontalières et non intégrés dans l’UNCAM. Ce problème technique indépendant des hôpitaux sera corrigé en 2010.
M. le coprésident Pierre Morange. Lors des précédentes auditions auxquelles a procédé la mission, l’état du système informatique hospitalier a été fréquemment évoqué, notamment pour ce qui concerne la saisie administrative. Il a été souligné que la comptabilité analytique était présente, au mieux, dans un tiers du parc hospitalier, et que le chemin était encore long pour assurer convenablement la saisie de la cotation des actes – d’où un recouvrement insuffisant. Selon les chambres régionales des comptes, les recettes non récupérées seraient dans l’ensemble de l’ordre de 5 % à 7 %. Dans des cas « aigus », le pourcentage pourrait atteindre 12 % à 15 %, ce qui renvoie à la question souvent abordée de l’alimentation financière de l’enveloppe hospitalière au sein de l’ONDAM et des moyens nécessaires pour remplir les différentes missions de l’hôpital. Confirmez-vous que, comme cela nous a été indiqué, la comptabilité analytique pourrait être à peu près opérationnelle dans l’ensemble du parc hospitalier d’ici à dix-huit mois ?
Par ailleurs, un dispositif informatique véritablement efficient pourrait-il être mis en place d’ici trois à quatre ans – question qui pose d’ailleurs celle de savoir comment la comptabilité analytique pourrait être mise en place avant le système informatique qui la rend possible ?
Quelle est, enfin, votre analyse de la question de la récupération des recettes ?
M. Yves Gaubert. Il y a plusieurs façons d’aborder la question de la comptabilité analytique. Les hôpitaux publics disposent déjà d’un système généralisé de comptabilité analytique qui n’est nullement négligeable : le « compte administratif retraité ». Celui-ci est constitué des retraitements comptables obligatoires pour tous les hôpitaux publics, lesquels sont transmis chaque année aux agences régionales de l’hospitalisation, font l’objet d’un traitement national au niveau du ministère et sont traités par nous-mêmes dans notre banque de données, où ils sont publics. Il existe certes un écart entre le compte administratif retraité, qui est la base de la comptabilité analytique – mais qui, notons-le, n’existe pas pour le secteur privé, ce qui interdit de procéder à des comparaisons –, et une comptabilité analytique développée, qui est celle de l’échelle nationale des coûts de la base d’Angers et qui concerne aujourd’hui une minorité d’établissements. Entre ces deux extrêmes, la marge de progression est large pour analyser dans le détail la comptabilité clinique, notamment les groupes homogènes de malades (GHM), ou pour contrôler la valorisation, la Fédération hospitalière de France assurant le traitement technique de la base d’Angers.
S’agissant des pertes de valorisation liées aux séjours, il est difficile d’avoir une visibilité précise des activités théoriquement perdues au sens de la classification des groupes homogènes de malades et des contrôles auxquels procède l’assurance maladie. Aujourd’hui, en effet, la seule base de vérification dont nous disposions pour la partie des séjours est constituée par les contrôles que réalise l’assurance maladie dans tous les hôpitaux publics et privés. Or, l’assurance maladie ne communique que sur les paiements indus et les sanctions qui en découlent, et nous ne disposons pas de mesure précise de ce qui devrait être valorisé et de ce qui ne l’est pas. En revanche, de l’argent est perdu du fait des admissions en non-valeur et des difficultés de récupération de sommes facturées pour lesquelles sont émis des titres de recettes non recouvrées. Cela renvoie notamment à la question du développement important que connaissent depuis quelques années les activités d’urgence, du fait que des patients qui se dirigeaient précédemment vers la médecine de ville viennent désormais à l’hôpital faute de permanence des soins ou, dans certains cas, parce qu’ils savent qu’ils pourront partir sans payer. À ce gros volume de passage correspondent de petites créances, de l’ordre de 50 euros, pour lesquelles le comptable public arrêtera très vite les poursuites, sachant que les coûts de recouvrement seront plus élevés que le montant des créances.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelle est la proportion des établissements, peu nombreux selon vous, qui disposent d’une comptabilité analytique ?
M. Yves Gaubert. Ceux qui disposent du système le plus développé représentent environ 10 % du parc. Pour ceux qui possèdent une comptabilité analytique intermédiaire entre cette contrainte forte et le compte administratif retraité, l’éventail est progressif et les chiffres difficiles à évaluer. La comptabilité analytique est cependant une tendance lourde dans le secteur public et ne diffère guère de celle qui est utilisée dans le secteur privé – peut-être est-elle même meilleure, car elle dispose de données, publiables de surcroît.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous paraît-il réaliste de considérer que la comptabilité analytique sera généralisée d’ici à dix-huit mois ?
M. Yves Gaubert. Le seul élément dont nous disposons pour en juger est le taux d’équipement en systèmes de comptabilité détaillée. Sur les 500 à 600 établissements pratiquant la tarification à l’activité dans le champ de la médecine, de la chirurgie et de l’obstétrique (MCO), plus de 300 sont équipés d’outils assez performants. L’utilisation de ces outils est progressive, mais il est réaliste de penser que ces systèmes se généraliseront d’ici à dix-huit mois.
M. le coprésident Pierre Morange. Cette généralisation se caractérisera-t-elle par une urbanisation et une interopérabilité ?
M. Yves Gaubert. L’interopérabilité est complexe, lorsqu’il est par exemple question de données relatives aux séjours, à la distribution des médicaments, aux actes de laboratoire et à l’imagerie. Le système fermé, global et unique de l’hôpital exige une montée en charge qui prendra plus de dix-huit mois.
M. Jean-Luc Préel. Je vous remercie d’avoir souligné l’importance de l’évaluation de la pertinence des actes et interventions.
Comment interprétez-vous les variations régulières de la T2A ? Nous en sommes en effet à la version 11, ou « V11 », qui semble démobiliser certains acteurs, car elle conduit à augmenter la durée de séjour alors que l’on incitait auparavant à réduire celle-ci. Que fait la Fédération hospitalière de France pour tenir compte de cette situation ?
M. Gérard Vincent. Pour compléter la réponse à la question de Monsieur le président Morange, je préciserai d’abord que le fait que tous les établissements ne sont pas équipés d’une comptabilité analytique parfaite ne signifie pas que les gestionnaires ou les décideurs hospitaliers pilotent dans le brouillard, comme cela se produisait au début de ma carrière, lorsque j’étais directeur d’hôpital. Ils disposent en effet de nombreuses informations qui leur permettent de prendre des décisions. La banque de données de la Fédération hospitalière de France, par exemple, leur permet de se comparer dans tous les domaines avec d’autres établissements. Nous sommes d’ailleurs tout à fait disposés à vous présenter un jour, si vous le souhaitez, à partir d’un exemple concret, les informations qui figurent dans cette banque de données.
M. le coprésident Pierre Morange. Lors de certaines auditions, il a été fait état de cas récents de pilotage en aveugle.
M. Gérard Vincent. Cela signifie que les gestionnaires n’utilisaient pas les données à leur disposition. De fait, il a été difficile, pendant quelques années, d’inciter les gestionnaires à utiliser ces bases de données très riches.
Monsieur Préel, la T2A va encore évoluer pendant quelques années, car ce système a été lancé assez vite malgré son imperfection – ce qui valait sans doute mieux que d’attendre qu’il fût parfait. La V11 a notamment permis de mieux décrire les activités médicales et, par conséquent, de multiplier les tarifs quasiment par trois. Tout cela va dans le sens d’une meilleure connaissance des activités, et donc d’un meilleur financement de chacune d’entre elles.
L’évolution n’est pas terminée et des ajustements interviendront sans doute encore dans les prochaines années. Cette situation perturbe un peu les établissements – qui nous demandent pourquoi nous acceptons des variations si subites et si profondes –, mais il faut que le système s’adapte, et nous sommes les premiers à le demander, car il décrit mal les activités et traduit mal la réalité des coûts sur le plan tarifaire.
M. Jean-Luc Préel. L’établissement qui faisait l’objet d’une audition précédente a indiqué qu’il avait motivé ses équipes pour réduire la durée de séjour, mais que la V11 allait dans le sens inverse. Comment interprétez-vous ce point ?
M. Yves Gaubert. L’évolution vers la V11 a été assez complexe, car elle supposait de diviser chacun des groupes homogènes de malades précédents en trois ou quatre niveaux. Quelques erreurs ont été commises, qui seront corrigées rapidement lors de la campagne 2010 grâce à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
Cette évolution était néanmoins nécessaire, notamment pour décrire les comorbidités, pour lesquelles le système précédent était assez réducteur. La prise en charge peut en effet être très différente selon que le patient présente ou non des pathologies associées. C’est particulièrement le cas en médecine car, si le système de la classification commune des actes médicaux (CCAM) technique est bien adapté pour décrire en détail les activités chirurgicales à l’acte, nous ne disposons en revanche toujours pas de CCAM clinique. Avant la V11, la variance expliquée des coûts en médecine était de l’ordre de 40 % ou 41 %, c’est-à-dire que l’outil de mesure était d’une relative imprécision. La classification V11 a permis, autant que cela était possible, une amélioration dans le cadre d’une classification fondée sur une échelle de coûts. L’évolution prochaine et souhaitable serait donc de disposer d’une CCAM clinique qui prenne en compte correctement des activités autres que les actes techniques, en comptabilisant le temps médical.
M. le coprésident Pierre Morange. Messieurs, je vous remercie.
*
Audition de M. Jean-Loup Durousset, président de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), et de M. Laurent Castra, directeur des affaires économiques.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir maintenant M. Jean-Loup Durousset, président de la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), et M. Laurent Castra, directeur des affaires économiques.
Dans le cadre de nos travaux sur le fonctionnement interne de l’hôpital, nous avons souhaité vous entendre sur la mise en œuvre, dans le secteur privé, du cadre réglementaire et législatif désormais opposable.
M. Jean-Loup Durousset, président de la Fédération de l’hospitalisation privée. Nous vous remercions de nous accueillir. Et comme les auditions sont publiques, nous nous sommes permis d’écouter la fin de l’intervention de nos confrères du secteur public.
Le grand principe qui, depuis quelques années, régit la politique hospitalière est théoriquement la convergence des acteurs, qu’ils soient publics ou privés, dans le but de tendre vers une seule tarification, mais par secteur. Or, force est de constater que celle-ci a du mal à se mettre en place. Décidée par la loi de 2004 instituant la tarification à l’activité, avec application dès 2005, elle devait être réalisée à 50 % en 2008 pour devenir effective en 2012. Cette date a été repoussée à 2018 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Nous ne pouvons que le regretter, compte tenu des implications que cela a sur le terrain.
Si l’on nous dit que la convergence ne peut être réalisée à cause des importants efforts qu’elle nécessite, c’est oublier que les établissements privés ont déjà dû faire d’énormes efforts depuis 2005. Ils ont subi, chaque année, une baisse ou une hausse de leur rémunération – la convergence s’établissant par rapport à un point défini comme médian – allant jusqu’à 3 % de leur chiffre d’affaires. Vous pouvez imaginer l’impact que peut avoir sur un établissement une perte annuelle de 3 % d’activité depuis 2005…
Cette difficulté, récurrente, nous l’assumons. Pour autant, elle ne justifie pas la non-convergence entre les deux secteurs ; il doit y avoir une autre raison.
Dans le même temps, le législateur et les agences régionales de santé ont appelé les acteurs de terrain à coopérer et à proposer des solutions de soins harmonisées. Depuis 2005, un certain nombre de tentatives de rapprochement entre cliniques privées et hôpitaux publics ont eu lieu. Mais comment peut-on travailler ensemble si le point essentiel, à savoir la ressource, constitue un élément de divergence ? Pour notre part, nous appelions de nos vœux une convergence tarifaire parce qu’elle nous semblait de nature à faciliter les coopérations sur le terrain.
Dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le législateur a de nouveau tenté, par la création des groupements de coopération sanitaire, de rapprocher les établissements afin qu’ils offrent à la population des soins de qualité et cessent de se comparer ou de s’analyser. Mais, tant qu’il n’y aura pas convergence, les difficultés sur le terrain resteront grandes, la convergence étant quasiment, pour nous, un devoir de santé publique.
Nous aurions souhaité qu’un point d’horizon soit fixé. C’est pourquoi nous reprochons à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 d’avoir repoussé l’échéance à 2018. Nous espérions qu’un amendement fixe au moins les modalités ou oblige le ministère et, en particulier, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation de soins (DHOS) à définir la méthode pour parvenir à cette convergence. On peut comprendre que le chemin soit long, mais pas qu’aucune méthode n’ait été arrêtée depuis 2005, au prétexte qu’il est nécessaire de mener des études complémentaires pour connaître les raisons permettant d’expliquer les différences de coûts entre les acteurs. En tant que gestionnaire de plusieurs établissements, c’est un argument que je ne peux pas présenter ; je ne me vois pas dire à des établissements : « Des études sont en cours. Je répondrai à votre demande lorsque celles-ci seront terminées. »
La méthode permettant de parvenir à la convergence aurait dû, selon nous, être présentée aux parlementaires cette année. De fait, vous risquez de vous entendre dire, chaque année, qu’une autre étude est nécessaire et que la méthode vous sera donnée une fois toutes les études finies !
La direction de l’hospitalisation et de l’organisation de soins ayant annoncé que les études devraient être terminées en 2012, cela signifie qu’une méthode devrait être présentée en 2013, pour une application en 2018. Si le principe de convergence consiste bien à rapprocher les tarifs des établissements publics et ceux des établissements privés, avec un écart de 25 %, on peut d’ores et déjà prédire que la convergence ne sera pas atteinte en 2018.
La Fédération hospitalière de France a réagi en 2009 à la décision, prise sans concertation, de reporter la date de mise en place de la convergence. Pas plus sur la loi de financement de la sécurité sociale que sur le principe de convergence ou encore sur la V11, il n’y a eu de véritable concertation entre les acteurs. Encore un autre reproche à adresser.
Nous aurions souhaité l’institution d’un principe de « contractualisation ». Ce terme n’étant peut-être pas le plus approprié, je m’explique. Nous pensons que la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l’hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne sont des acteurs responsables. Pour que la sécurité sociale aille mieux, il faut, à l’évidence, que les acteurs soient responsabilisés. Or, la responsabilisation implique deux protagonistes – l’État, qui fait valoir qu’il a des obligations, et les acteurs, qui mettent en avant qu’ils ont des contraintes – et consiste à trouver un point d’équilibre. C’est d’ailleurs pourquoi, nous aurions souhaité qu’il y ait une contractualisation des trois fédérations sur des objectifs communs.
L’un de ces objectifs aurait pu être le développement de la chirurgie ambulatoire, système qui est bon pour la collectivité car le passage d’un séjour hospitalier à une hospitalisation d’un jour génère une économie substantielle. C’est également relativement bon pour les établissements puisque, comme les patients n’y restent plus qu’un jour au lieu de cinq, ils peuvent supprimer le personnel de nuit et réorganiser les services à d’autres fins. Enfin, c’est bon pour les patients car il a été démontré qu’une hospitalisation prolongée n’apportait rien à la qualité des soins et faisait peser des risques d’infections nosocomiales.
À l’inverse de 1982, il nous est proposé, non de nous contractualiser, mais de nous soumettre à une entente préalable et de nous sanctionner. De ce fait, nous ne nous considérons plus comme des acteurs responsables, mais comme des acteurs à contrôler.
Or comment juger de la pertinence des actes, sinon en s’adressant à des acteurs responsables et en définissant une méthode à utiliser pour, par exemple, opérer une prothèse de hanche ou procéder à une appendicectomie. Le cadre étant posé, la règle ayant été définie et acceptée par tous, les professionnels et l’État peuvent s’engager, et il peut y avoir contrôle. La délégation ou la responsabilité n’exclut pas ce dernier.
Proposer comme a priori le contrôle et la sanction n’est pas sans soulever des difficultés, d’autant que se pose le problème majeur de l’interprétation des dispositions envisagées. La dernière version de la V11 aurait fait, nous a-t-on dit, l’objet de concertations entre l’Assurance maladie et l’État. Mais à nos questions sur l’interprétation à faire des conclusions qui avaient résulté de ces concertations, nous n’avons pas reçu de réponse autre que celle nous informant que nous allions être contrôlés et probablement sanctionnés puisque notre interprétation risquait d’être différente.
Nous regrettons l’absence d’engagements forts de l’État sur des projets qui auraient pu être contractualisés, qu’il s’agisse des grandes orientations à donner aux établissements sanitaires, du développement de la médecine, des soins palliatifs ou de la chirurgie ambulatoire, du travail spécifique sur la gériatrie. Nous sommes prêts à nous engager sur de tels projets au plan national et à les décliner à l’échelon régional.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous appelions le Parlement à prendre position en faveur de la contractualisation, car celle-ci est importante.
Bien sûr, des difficultés se présentent, des établissements doivent être restructurés, des réticences se font jour, mais pourquoi nous considérer comme des acteurs irresponsables, alors que nous est confiée la chose la plus importante pour nos concitoyens : leur santé ?
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je comprends votre logique. En même temps, je pense qu’une part de la difficulté vient de l’acception qui est faite du terme « convergence ». La convergence est souvent perçue, dans le cadre du débat politique, comme une marche vers une identité de tarifs entre le secteur public et le secteur privé. Et c’est peut-être une des raisons pour lesquelles les études préalables au lancement de la marche vers cette convergence sont un peu plus longues qu’il n’était prévu au départ.
Par ailleurs, le lien « convergence-T2A » suppose que les outils soient en place pour y voir clair. Or, dans certains établissements, il n’y a toujours pas de comptabilité analytique. À partir du moment où il y a une tarification à l’activité, il faut que les tarifs soient justes et correspondent à une réalité, et que le gestionnaire puisse les comparer à ceux pratiqués dans son établissement. La situation des établissements que vous représentez est-elle bonne de ce point de vue ? Les systèmes d’information et la formation des cadres chargés de les gérer et des personnels amenés à les activer sont-elles suffisantes ?
M. Jean-Loup Durousset. Dans vos propos, je sens l’ambiguïté qui existe entre tarification à l’activité et gestion de l’hôpital.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Elle est réelle.
M. Jean-Loup Durousset. Certes, mais si le ministère de la santé doit être le régulateur du système de soins, il n’a pas forcément vocation à devenir le gestionnaire de l’hôpital, car cela serait source d’ambiguïté.
Je reconnais au législateur et à l’Assurance maladie le droit de fixer des tarifs. Un tarif est une incitation à faire ou à ne pas faire : si on réduit le tarif du traitement de la cataracte et qu’on augmente le tarif de traitement du cancer du colon, par exemple, on incite les acteurs à bouger ou à ne pas bouger.
Si l’on est dans une logique de gestion de l’hôpital, on voudra que la tarification n’ait pas de conséquences sur l’équilibre de l’établissement. On essaiera donc, comme vous venez de le dire, de déterminer les coûts.
Les établissements privés maîtrisent la comptabilité analytique. Mais 85 % des ressources d’un hôpital sont consacrées à des frais fixes. Par exemple, un bâtiment qui a été construit une bonne fois pour toutes représente un coût fixe de 12 % des coûts fixes, coût qui correspond à un loyer.
Ensuite, selon la clé de répartition choisie, on peut faire dire tout ce qu’on veut en matière de comptabilité analytique : on peut expliquer qu’en impactant davantage telle ou telle charge, le tarif de l’accouchement va monter ou baisser. C’est pourquoi nous avons demandé à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation de soins, d’une part, d’essayer d’éclairer les tarifs par les coûts mais pas de les déterminer par les coûts, et, d’autre part, d’accepter l’idée que certains tarifs puissent être négatifs, dans la mesure où ils constituent une incitation à faire baisser les coûts.
Les acteurs ont tout intérêt à dire qu’ils ne s’en sortent pas, que leurs coûts augmentent et que les tarifs fixés sont inférieurs aux coûts réels : c’est un vieux principe appliqué par l’hôpital public. Dans le cas des cliniques privées, c’est l’Assurance maladie qui a toujours fixé les tarifs, et quand les coûts d’un établissement sont supérieurs, elle lui demande de les baisser.
Les regroupements opérés dans le secteur hospitalier privé, le développement de la chirurgie ambulatoire dans ce secteur ainsi que la mise en place d’un certain nombre d’alternatives à l’hospitalisation ont été favorisés par une pression économique. Elle n’est pas forcément agréable à subir mais elle est un facteur incitatif fort.
Les tarifs doivent donc être déterminés par un acteur de l’État en fonction de sa politique sanitaire. S’il veut développer la médecine, il devra « tarifer » fortement la médecine et baisser les tarifs de la chirurgie. C’est un choix et nous l’acceptons. Ensuite, que les tarifs donnés soient éclairés par les coûts, c’est tout à fait normal.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit une ambiguïté, et c’est pourquoi nous aurions souhaité que le gestionnaire soit différent du régulateur.
La comptabilité analytique de mon établissement est établie par service, parce que mes charges sont fixes du fait de la normalisation des règles imposées : si mon service de réanimation doit avoir une infirmière pour deux malades et si j’ai dix lits, je connais mon taux d’activité ; quant au coût de mon service de réanimation, il varie du simple au double si j’ai cinq malades dans les dix lits ou si j’en ai dix. Quand l’État me demande quel est le coût d’un service, je lui réponds qu’il varie d’un mois sur l’autre en fonction de la pathologie et du nombre des malades. Par contre, je suis en mesure d’indiquer son coût annuel. Cela dit, il m’incombe de faire en sorte que mes coûts soient les plus corrects possibles pour assurer le fonctionnement de mon établissement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il y a, en effet, plusieurs ambiguïtés, puisqu’on veut faire converger des secteurs différents, répondant à des logiques différentes.
Par ailleurs, deux écoles de pensée s’opposent. D’un côté, la tarification à l’activité peut être perçue, comme vous nous y invitez, comme un outil de pilotage du système : en définissant les tarifs, la collectivité oriente dans un sens ou dans un autre. Toutefois, le pilotage est très délicat et n’est pas toujours efficace, comme on peut le constater en agriculture. D’un autre côté, on peut considérer qu’en apportant une sorte de vérité des prix, la T2A assainirait le système et permettrait une gestion équilibrée. Il faudra forcément trouver, au bout du compte, un équilibre entre ces deux conceptions contradictoires.
En attendant, si nous ne disposons pas d’éléments de mesure, nous resterons au stade de la querelle. Or je ne suis pas sûr que l’on ait aujourd’hui ces outils, ni même que l’on dispose de lieux d’échange de l’information.
M. Jean-Loup Durousset. L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) finance une centaine d’établissements publics et privés participant à l’enseignement et au service public pour qu’ils fassent de la comptabilité analytique, afin de produire des coûts. Nous ne contestons pas la méthode, et les sites qui ont été choisis délivrent une information. Toutefois, celle-ci ne peut qu’éclairer les tarifs car, d’un établissement à l’autre, et même d’un site expérimentateur à l’autre, les coûts varient. On ne pourra tirer de cette information qu’une échelle de coûts, permettant de déterminer le poids de l’accouchement par rapport à une prothèse de hanche. En aucun cas, elle ne permettra de déterminer le bon coût de la prothèse de hanche ; et si vous voulez le faire, je vous mets en garde contre le poids de la structure, lequel est terrible pour un gestionnaire : les variations peuvent aller du simple au double entre un CHU bien organisé et un autre qui l’est moins.
Il est, me semble-t-il, dans la logique de l’État, d’une part, d’exercer une vigilance sur l’équilibre économique global du dispositif de soins, parce qu’il ne serait pas souhaitable que l’ensemble des établissements hospitaliers soient en déficit ou, à l’inverse, en excédent de façon massive, et, d’autre part, de définir une vraie politique tarifaire.
Ce que nous souhaiterions, c’est ne plus vivre dans l’ambiguïté actuelle, d’autant que nous n’avons rien demandé. La loi a posé le principe de la convergence. Il y a une enveloppe commune au secteur public et au secteur privé et il est demandé aux deux secteurs d’obéir aux mêmes principes et de coopérer sur le terrain. Nous sommes respectueux de la loi, mais, sur le terrain, nous redevenons différents, ce qui n’est pas très correct.
À la limite, qu’il n’y ait pas de convergence ne nous gênerait pas, à condition de nous le dire. Il peut très bien y avoir, à côté du secteur public, un secteur privé qui ne soit pas financé à 100 % par l’Assurance maladie et qui cherche ses ressources auprès des patients et des complémentaires. Il peut y avoir une enveloppe hospitalière publique et une enveloppe hospitalière privée, chaque secteur négociant et vivant sa vie.
La situation actuelle est très dommageable pour nous parce que nous travaillons dans l’esprit d’une convergence alors que, en fait, sur le terrain, nous sommes divergents.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je pense que l’ambiguïté concerne tout le monde. Cela étant, il me semble percevoir dans vos propos le souhait qu’il y ait une économie administrée de la santé, secteur dans lequel la puissance publique, à partir des éléments dont elle dispose, déterminerait les tarifs et orienterait les choses dans tel ou tel sens ?
M. Jean-Loup Durousset. Permettez-moi de vous dire que c’est déjà le cas.
L’année dernière, vous avez voté un objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) en progression de 3 %. Or la direction hospitalière ayant décidé de remettre à plat la tarification des cliniques privées, celles-ci ont connu des variations spectaculaires pouvant atteindre 20 % en plus ou en moins. Si ce n’est pas une réorientation totale de l’activité, dites-moi ce que c’est. L’administration gère et planifie ; elle pèse totalement sur l’organisation hospitalière. Au reste, je préviens toujours mes collègues qu’ils ne détermineront jamais ni leur lieu d’implantation, ni leur activité, ni leur organisation, ni même leur tarification. Si cela ne résulte pas d’une politique administrée de la santé, j’aimerais savoir de quoi cela résulte !
M. Dominique Tian. Certains disent que la T2A a beaucoup profité aux cliniques. Vous tenez un propos différent. A-t-on enregistré de nombreux regroupements d’établissements privés ? Y a-t-il eu beaucoup d’accords passés avec les hôpitaux dans les régions ? Pouvez-vous nous brosser un panorama des établissements que vous représentez en précisant leur nombre, leurs activités et leur situation ?
M. Jean-Loup Durousset. La Fédération hospitalière de France regroupe 1 200 établissements, répartis en trois grandes catégories : quelque 700 établissements dans le secteur de médecine, de chirurgie et d’obstétrique (MCO), quelque 400 établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) et une centaine d’établissements de psychiatrie. Le secteur soins de suite et de réadaptation connaît un certain développement puisqu’il a bénéficié de quelques autorisations de création d’établissements.
Le secteur hospitalier privé a connu, au cours des quinze dernières années, une forte restructuration puisqu’il a perdu 500 établissements. L’hôpital public, de son côté, n’en a perdu aucun. C’est vraiment, comme le soulignait M. Claude Evin, la grande différence entre l’hôpital et les cliniques. Dans le même temps, les cliniques se sont regroupées et ont réfléchi à une nouvelle organisation de leurs structures tandis que l’hôpital a eu du mal à faire sa restructuration.
La situation économique des cliniques est sur le fil, du fait, notamment, des grands bouleversements tarifaires intervenus l’année dernière : près de 40 % d’entre elles sont en déficit et plus de 60 % ont connu une année déficitaire au cours des trois dernières années. La rentabilité moyenne des structures ne cesse de se dégrader depuis trois ans. Selon les dernières études réalisées, elle s’établirait à 1 % du chiffre d’affaires.
Cela signifie que, quand Mme Podeur décide une variation, elle déséquilibre assez vite la situation d’une structure privée. La tension est très forte. Nous sommes sur le qui-vive, constamment à l’affût.
En dépit de l’augmentation de 3 % de l’ONDAM l’an dernier, les établissements de santé privés, notamment ceux du secteur MCO, n’ont bénéficié que d’une hausse tarifaire de 0,45 %, soit bien inférieure à l’évolution de leurs coûts, ne serait-ce qu’à celle du coût des salaires ; si bien que la Fédération a proposé, l’an dernier, de ne pas augmenter les salaires. Cette année, la hausse ne devrait être encore que de 0,30 ou 0,40 % car, selon l’analyse du ministère, les missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation (MIGAC) doivent évoluer plus vite que l’ONDAM. Il y a captation d’une ressource significative dans l’enveloppe destinée aux tarifs. On nous explique ensuite qu’il faudra déduire l’effet volume, puisque nous allons enregistrer une progression. Or la progression est très variable d’un établissement à l’autre. Ainsi, dans une ville où l’hôpital est dans un processus de redynamisation, une clinique privée dont l’activité est déjà stabilisée ne pourra que connaître un phénomène de baisse, à moins de mener une politique agressive vis-à-vis de l’hôpital public. Toutefois, selon la loi, elle doit non pas être agressive, mais coopérer. Nous retrouvons là l’ambiguïté que je dénonce depuis le début de mon propos.
Bref, une augmentation des tarifs de 0,45 % est stupide puisqu’elle provoque des tensions sur les volumes alors que l’État nous demande de coopérer.
Nous avons réclamé au ministère une évolution significative des tarifs. Ceux-ci doivent être revalorisés car, si vous affichez un effet volume à 1,7 %, vous affichez clairement, par là même, votre souhait que les établissements se concurrencent. Toutefois, il ne sera pas facile d’augmenter le volume de 1,7 % car, d’une part, l’on ne trouve pas de nouveaux patients tous les jours et, d’autre part, les exigences en matière de qualité de la prestation des soins vont croissant.
M. Jean-Luc Préel. Les missions de service public que la loi vous confie incluent l’accueil des urgences, ce qui entraînera une modification de la chirurgie programmée à laquelle vous êtes habitués. Comment envisagez-vous cette évolution ? Cela induira-t-il beaucoup de changements ?
Par ailleurs, comment comptez-vous impliquer les praticiens dans cette réforme ? Quel rôle allez-vous donner aux conférences médicales d’établissement ?
M. Jean-Loup Durousset. Quand a été reconnu, dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le droit aux établissements privés de participer aux missions de service public, cela a été un moment de satisfaction pour nous. Cela faisait plusieurs années que nous le souhaitions. D’ailleurs, 139 établissements privés assurent déjà sur le territoire la mission des urgences. Agréés par les agences régionales de l’hospitalisation au même titre qu’un hôpital public, ils ont les mêmes contraintes que ce dernier, remplissent les mêmes missions et accueillent tout un chacun au tarif opposable. Plus ces missions seront élargies, plus l’hospitalisation privée sera satisfaite. Quand les 139 établissements ont été reconnus, 200 candidats participaient déjà au dispositif d’urgence sur le territoire.
Nous allons également pouvoir remplir la mission de formation. Pour nous, un bon système de santé doit présenter aux étudiants en médecine toute la palette d’activités qu’ils peuvent être appelés à exercer. Alors que 50 % des étudiants iront dans le secteur privé et 50 % dans le secteur public, on ne peut pas continuer à leur proposer une formation que dans un seul secteur : imaginez que tous les ingénieurs informaticiens soient formés chez IBM, cela poserait certainement quelques problèmes au terme des études. La palette des activités enseignées doit être suffisamment ouverte pour inclure la médecine générale et la médecine exercée dans les campagnes. Pour notre part, nous sommes prêts à remplir cette mission. Elle entraînera des contraintes supplémentaires car accepter une mission, c’est prendre des engagements. La question clé, pour nous, est l’accueil de tout un chacun sans distinction liée à la rémunération de l’acte ; nous sommes pour une politique de reste à charge le plus faible possible. Mais, pour y parvenir, il faudrait que nous soyons aidés et que notre demande de convergence des tarifs soit entendue. Si vous nous dites que les mutuelles doivent financer le secteur privé, cela pose un problème pour l’accueil de tous.
Ce qui a fait la force de l’hospitalisation privée, c’est son mode d’organisation médicale : pendant longtemps, nous avons échangé avec les médecins – pas seulement nous, mais également l’État – de la liberté contre de la responsabilité. J’ai eu le grand plaisir de gérer des établissements avec des médecins libéraux. Il n’y a jamais eu de problème pour assurer la permanence des services d’urgence ou de la maternité : les médecins libéraux s’auto-organisaient pour assurer, chaque jour, une présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans que j’aie besoin de les réunir pour fixer le calendrier. Il y avait échange de responsabilité contre liberté. Or ce système risque de changer. On le voit dans la médecine de ville : étant donné qu’il y a moins de liberté, il y a moins de responsabilité, et les médecins attendent de l’administration des consignes d’organisation et des indemnisations. C’est un choix de société. Les vertus de l’exercice libéral n’ont pas été perçues : tant pis pour nous.
Nous négocions avec les médecins un certain nombre de règles dans plusieurs domaines.
Premièrement, nous leur rappelons qu’il est du devoir d’un médecin d’assurer la permanence des soins dans les établissements qui ont choisi de le faire. Les médecins sont tenus, de par le règlement, de pratiquer les urgences en secteur 1.
Deuxièmement, nous leur conseillons, dans leur pratique, d’avoir des tarifs transparents. Ce n’est pas parce que l’État et l’administration les autorisent à pratiquer des suppléments d’honoraires qu’ils doivent faire n’importe quoi. Nous souhaiterions qu’ils rentrent dans une logique de contractualisation sur l’hospitalisation, de manière à ce que le patient dispose d’une information claire sur la totalité de la note qu’il devra acquitter, ce qui n’est pas encore tout à fait le cas.
Nous formons beaucoup d’espoir sur le secteur optionnel, lequel devrait faire l’objet d’une reconnaissance réglementaire. Il présente l’avantage de fixer les règles du jeu pour les médecins, ce qui introduit de la transparence dans le fonctionnement.
L’histoire des établissements privés est fondée sur l’initiative médicale. C’étaient les médecins qui étaient propriétaires des structures et qui décidaient du mode d’organisation et du mode de fonctionnement de celles-ci. Pendant longtemps, la commission médicale d’établissement n’avait pas de sens puisque les conseils d’administration des établissements étaient composés uniquement des médecins libéraux exerçant dans l’établissement – à la différence du secteur public, où le gestionnaire n’est pas le médecin. Avec le temps, les établissements privés ont évolué : 40 % d’entre eux sont gérés aujourd’hui par des non-médecins. La commission médicale d’établissement prend donc plus d’importance. Nous souhaitons donc que son rôle soit clarifié. A-t-elle un rôle corporatiste, c’est-à-dire de représentation du corps médical face à l’administration ? Ou a-t-elle un rôle constructif et de suggestion ?
Si la commission médicale d’établissement participe à l’élaboration du projet médical, est une source de propositions dynamiques et a la possibilité, une fois le projet validé, de le faire respecter par le corps médical, elle nous intéresse parce que nous préférons discuter avec dix membres de la commission médicale d’établissement plutôt qu’avec cent cinquante ou deux cents médecins. En revanche, si elle se borne à donner un avis, nous préférons continuer à traiter avec les cent cinquante médecins en court-circuitant la commission médicale d’établissement.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous aimerions connaître votre méthodologie de travail, d’une part, en matière de facturation et de recouvrement et, d’autre part, en matière de cotation des actes. Cette cotation est-elle assurée par les professionnels de santé eux-mêmes – ils sont les mieux à même de le faire mais cela suppose qu’ils connaissent cette codification – ou déléguez-vous cette responsabilité à un médecin ou à un administratif affecté spécialement à cette tâche ?
M. Jean-Loup Durousset. Notre histoire passée avec l’Assurance maladie nous a habitués aux contrôles. Nous restons sur cette logique du conventionnement : les établissements de santé privés envoient régulièrement des factures à l’Assurance maladie, ainsi qu’aux patients et aux mutuelles. Je rappelle que la loi prévoit que l’hôpital public fasse de même ; or on nous explique que c’est difficile. Mais je ne vois pas en quoi puisque tous les établissements de santé privés le font et que leur facturation est plus complexe que celle de l’hôpital public dans la mesure où elle comporte une partie haute, correspondant à la partie hospitalière, et une partie basse, reprenant la cotation de chaque médecin. La facturation de l’hôpital public ne comporte, quant à elle, qu’une partie haute qui regroupe dans son groupe homogène de séjour (GHS) la rémunération des médecins et celle de l’établissement.
L’Assurance maladie pratique sur nous des contrôles a priori. Quand j’envoie mon projet de facturation, elle procède par le biais de l’informatique à un certain nombre de vérifications. Entre 4 et 5 % de nos factures sont rejetées, pour des problèmes divers – alors que l’hôpital public fait une déclaration statistique.
Nous demandons à ce que la pratique soit standardisée, que tout le monde élabore une facture et que le patient soit informé du coût du séjour, de la partie prise en charge par la sécurité sociale et du montant qui reste à sa charge – une telle information éclairerait nos concitoyens sur le système de soins. Notre demande n’a toujours pas abouti.
Nous avons une vieille culture du contrôle : des médecins contrôleurs – ils s’appelaient médecins conseil auparavant – de l’Assurance maladie viennent régulièrement, depuis 1972, effectuer des contrôles dans nos établissements. Ce que disait tout à l’heure M. Gérard Vincent, délégué général de la Fédération hospitalière de France, sur la pertinence des actes nous intéresse parce que nos médecins ont tous été contrôlés, ce qui n’est pas le cas de l’hôpital public. Nos médecins sont habitués à avoir des « descentes » de médecins de l’Assurance maladie qui viennent contrôler, entre autres, que l’acte facturé a bien été réalisé.
Dans le cadre du conventionnement des médecins, figure un article très important selon lequel nul ne peut coter un acte si celui-ci n’a pas été pratiqué par lui-même. Nous appliquons cette règle : c’est le médecin, et lui seul, qui cote. L’administratif que je suis ne peut pas modifier la cotation du médecin sans son accord car ce dernier est le seul à pouvoir mettre sur sa feuille ce qui a été fait. S’il se trompe, il en porte la responsabilité, mais sa responsabilité engage, bien évidemment, l’établissement.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est ce que je voulais vous entendre dire.
Nous vous remercions, messieurs.
*
Audition de M. Antoine Dubout, président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP), et de M. Yves-Jean Dupuis, directeur général.
M. le coprésident Pierre Morange. Je souhaite la bienvenue à M. Antoine Dubout, président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP) et à M. Yves-Jean Dupuis, son directeur général.
Nos travaux, vous le savez, portent sur le fonctionnement interne de l’hôpital, que nous examinons à la lumière de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Nous souhaitons notamment pouvoir bénéficier de vos analyses sur l’articulation entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social dans les établissements de santé. Notre approche de la philosophie générale de la loi et de sa mise en œuvre sur le terrain est pragmatique.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’examen de cas particuliers nous a déjà permis de tirer quelques enseignements. Nous nous intéressons aux modalités de gestion des établissements, à leur santé financière, à la tarification à l’activité (T2A), aux systèmes d’information et à la comptabilité analytique. Que peut-on dire de la santé financière des établissements de votre fédération au regard de celle des établissements des deux fédérations que nous avons déjà auditionnées ? Présentent-ils des spécificités de mise en œuvre de la comptabilité analytique, de la gestion du personnel, de la cotation des actes, bref des outils qui permettent aux gestionnaires des établissements de les piloter, dans un contexte de mise en place progressive de la tarification à l’activité et une optique de convergence entre les secteurs ?
M. Antoine Dubout, président de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP). La FEHAP a pour spécificité de regrouper des établissements d’accueil de handicapés, médico-sociaux et sanitaires.
Les établissements de santé qui lui sont affiliés partagent les valeurs de l’hôpital public – globalement – et les contraintes des établissements privés. Un élément très prégnant est que, au contraire de l’hôpital public, la faillite est possible chaque année et qu’elle survient parfois. Cette contrainte très sévère nous interdit d’être très longtemps en déficit.
Certains de nos établissements ayant été placés autrefois sous le régime de l’objectif quantifié national (OQN), et d’autres sous celui de la dotation globale, nous sommes à même de comparer les deux systèmes. Quoique leur grande diversité m’empêche de vous faire part de statistiques globales, je peux néanmoins vous indiquer que la situation d’ensemble des établissements est fragile, voire très fragile. Ils sont dans l’obligation d’être, au moins à moyen terme, à l’équilibre. Dans le cas contraire, il nous revient de les rapprocher, voire de les faire disparaître. De telles décisions sont prises tous les ans. Le taux de rapprochement et de concentration est très voisin de celui de l’hôpital privé ; pour ce qui est du pourcentage de disparitions, il est d’environ 30 % depuis dix ans. En revanche, je ne suis pas capable de vous indiquer combien d’établissements sont en déficit.
Contrairement à une idée parfois reçue, les établissements participant au service public hospitalier (PSPH) ne sont pas des établissements publics, mais des organismes privés.
Enfin, notre secteur partage avec le secteur privé lucratif la spécificité forte d’une gouvernance simple et claire. Chaque structure est dotée d’un président et d’un directeur général. Nommé par le président, le directeur général a autorité sur l’ensemble du personnel. Cette gouvernance permet d’identifier les responsabilités et d’en tirer les conséquences en cas de dérive.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Que pouvez-vous nous dire de plus sur les outils de gestion ?
M. Antoine Dubout. La quasi-totalité des établissements disposent d’outils de comptabilité analytique. Certes, cet outil n’est pas sans ambiguïtés : les résultats qu’il produit dépendent du paramétrage qui a été choisi. Cependant, nos établissements ne peuvent pas fonctionner sans lui.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les résultats dépendent en effet des paramètres. Mais s’il en allait autrement, les chiffres nous gouverneraient.
Les outils de comptabilité analytique dont ils disposent permettent-ils aux établissements de comparer leurs coûts réels aux tarifs qui servent à les rémunérer, et d’orienter leurs activités en conséquence ?
M. Antoine Dubout. Absolument. Cependant, le deuxième élément qui nous gouverne, c’est-à-dire nos valeurs, conduit à prendre des décisions qui ne sont pas seulement financières, par exemple le maintien d’activités qui, analytiquement parlant, sont déficitaires.
M. le coprésident Pierre Morange. Telle personnalité auditionnée, exerçant des responsabilités en établissement PSPH après avoir occupé des fonctions éminentes dans des structures publiques d’organisation d’offres de soins, a fait état de difficultés en matière de comptabilité. Elle a notamment évoqué des insuffisances notoires en matière de facturation et de recouvrement de recettes. Ces propos ne sont-ils pas incompatibles avec les vôtres ?
M. Antoine Dubout. Mes propos, je l’ai dit, valent pour la quasi-totalité des établissements. Celui auquel vous faites allusion est…
M. le coprésident Pierre Morange. … l’exception qui confirme la règle ?
M. Antoine Dubout. La qualité de la gestion des établissements affiliés à notre fédération – une centaine – n’est pas égale. Les établissements en difficulté que nous sommes obligés de fermer chaque année en constituent la preuve. La rigueur nécessaire a manqué à celui que vous évoquez – par ailleurs médiatiquement très connu. Nous avons nous-mêmes proposé à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) une action commune. Le récent changement de gouvernance nous a rassurés.
M. le coprésident Pierre Morange. Je conclus de vos propos que le secteur que vous représentez a bien compris la nécessité des outils de mesure. Pour reprendre une litote des administrations compétentes, le secteur public, lui, dispose encore d’une marge de progression.
Au-delà du recouvrement et de la facturation, nous nous intéressons aussi à l’organisation de la cotation des actes, élément stratégique qui constitue la base des recettes. Par qui la cotation doit-elle être établie ? Par le professionnel de santé ? Par un praticien maîtrisant de façon plus approfondie l’informatique médicale et ayant reçu délégation ? Par délégation encore, par un membre du personnel administratif disposant d’une culture médicale ? Ces solutions sont toutes utilisées. Indissociable de l’acte, la cotation engage la responsabilité du professionnel et de l’établissement.
M. Antoine Dubout. Les solutions sont en effet très diverses. L’établissement que je préside, l’hôpital Saint-Joseph de Marseille, est, avec plus de 800 lits, le plus important hôpital PSPH de France. Il est en bonne santé financière. Les cotations y sont effectuées par les praticiens. Cependant, un médecin spécialisé, embauché à cet effet, les vérifie toutes et les reprend si nécessaire avec ses collègues. Mais peut-être est-ce la dimension de l’établissement qui permet cette solution ?
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le médecin spécialisé vérifie-t-il avec ses collègues la pertinence des cotations, ou les reprend-il pour s’assurer, en cas de doute, qu’elles sont effectuées dans un sens profitable à l’établissement ?
M. Antoine Dubout. Il les reprend pour en vérifier la pertinence.
M. Yves-Jean Dupuis, directeur général de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne. La réponse n’est pas univoque. Le médecin spécialisé reprend la cotation pour évaluer la pertinence de l’acte. Il arrive aussi que des médecins oublient de coter un acte complémentaire qui pourrait faire basculer la cotation du séjour. Du fait de l’évolution et de la complexité accrue des règles de nomenclature, notamment sous l’effet de la version 11 (V11) de la classification des groupes homogènes de malades (GHM), il est utile qu’un médecin spécialiste puisse éclairer ses confrères. En tout état de cause, ce n’est pas celui-ci, mais bien le médecin qui a effectué l’acte qui va le coter. Nous restons bien dans cette logique de responsabilité.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pour certaines cotations, une marge d’appréciation peut être à l’origine d’un débat entre le médecin qui effectue l’acte et celui qui cote.
M. Yves-Jean Dupuis. En effet, le médecin qui effectue l’acte peut ne pas connaître l’incidence de la non-cotation d’un acte réalisé mais non-enregistré.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelle est votre analyse du financement direct des actes par l’Assurance maladie sur présentation des factures ? Dans le secteur public, le financement se fait sur la base d’un état statistique communiqué aux agences régionales de l’hospitalisation. Quelle méthode appliquez-vous ? Plus généralement, quel est le degré d’interopérabilité des systèmes d’information et d’informatique ? La maîtrise de l’information, pour chacune des parties administrative et strictement médicale, est un élément stratégique.
M. Yves-Jean Dupuis. Nous bénéficions de l’expérience des établissements ex-OQN. Lors de la mise en place de la T2A à 100 %, ils ont dû s’adapter rapidement pour pouvoir transférer sans difficulté les bordereaux. Avec les services de l’Assurance maladie et des assurances complémentaires, nous avons donc travaillé à ce que les bordereaux correspondent aux activités de nos établissements et permettent une facturation rapide.
Nous nous attendions à une poursuite à l’identique de ces travaux dans le secteur de l’hôpital public. Lorsque les groupes de travail se sont réunis au ministère, nous avons donc été très présents – ainsi que l’Assurance maladie et les assurances complémentaires – pour y décliner la même logique. Aujourd’hui, nous sommes prêts. La FEHAP a mis en place une cellule informatique, dotée d’un responsable, pour accompagner nos établissements. Leurs systèmes informatiques devront en effet être mis en adéquation avec ceux qui seront retenus par l’Assurance maladie. Malheureusement, le groupe de travail progresse peu…
M. Dominique Tian. La semaine dernière, vous avez lancé une campagne de publicité sur le coefficient correcteur. Pourriez-vous nous expliquer la notion de différentiel de coût, qui a fait l’objet de débats récents à l’Assemblée nationale et qui fonde une revendication très forte de la FEHAP ?
M. Antoine Dubout. Ce débat est commun avec ceux de la convergence et de la T2A. Si la FEHAP est favorable à la convergence, les termes de celle-ci doivent être rendus objectifs. Convergence ne signifie pas forcément tarif unique. Que l’hôpital public supporte des charges spécifiques est parfaitement concevable ; encore faut-il qu’elles soient identifiées et quantifiées.
Le débasage effectué l’an dernier au profit des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) et au détriment de la T2A nous a profondément heurtés. La Cour des comptes s’y est du reste intéressée. Alors que l’augmentation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) hospitalier avait été fixée à 3 % environ, ce débasage a paradoxalement limité l’augmentation des tarifs à 0,4 % seulement. En 2010, en application des mêmes règles, l’augmentation de l’ONDAM de 2,8 % devrait se traduire par une diminution des tarifs de 0,3 % ou 0,4 %. Ce dispositif ne pourra pas perdurer bien longtemps.
De façon choquante, alors que ce débasage a abouti à un transfert de 800 millions d’euros de l’ONDAM aux MIGAC, aucune justification n’en a été fournie. Nous avons pourtant demandé, par écrit, des justifications à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation de soins, puis à la ministre. Devant leur silence, nous envisageons de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), pour qu’elle impose au ministère de nous laisser accéder aux justificatifs.
Par ailleurs, une mission de l’Inspection générale des affaires sociales, conduite à la demande de la ministre, avait conclu à l’existence d’une différence de charges de 4,05 % entre le secteur public et le secteur privé non lucratif, au détriment de celui-ci. Cette analyse a été validée l’an dernier par une étude complémentaire.
Nous sommes favorables à la convergence. La différence de charges ayant été objectivement mise en évidence par un organisme d’État – nous considérions jusqu’alors qu’elle était de 9 % –, nous avons demandé qu’elle soit compensée. Dans la mesure où elle était validée par les services mêmes de l’État, cette demande, qui ne constituait évidemment pas une attaque contre l’hôpital public, nous a paru justifiée. Tel a du reste été l’avis de la commission mixte paritaire qui a examiné le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Par ailleurs, après avoir évalué le surcoût à 500 millions d’euros, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation de soins l’a réduit à un montant de 180 à 200 millions d’euros. Jusqu’à preuve du contraire – mais comment cette preuve pourrait-elle être fournie, puisque l’accès aux chiffres nous est refusé ? –, nous considérons qu’il faut y ajouter 80 à 100 millions d’euros. Ces conditions de présentation ont perturbé la représentation parlementaire elle-même.
Telles sont les raisons qui nous ont amenés – et surtout certains de nos adhérents – à un peu d’agressivité.
M. Yves-Jean Dupuis. L’échelle tarifaire qui nous est appliquée est commune avec celle de l’hôpital public. Les salaires nets de notre secteur en étant très proches, nous sommes tenus, pour un même acte, de dégager une productivité supérieure de 4 % à la sienne pour obtenir les mêmes résultats. Comme nous avons l’obligation d’équilibrer nos résultats, la gestion de nos établissements est soumise à un double défi : d’une part, gagner en productivité par rapport à l’hôpital public pour chaque tarif et, d’autre part, être à l’équilibre en fin d’exercice, faute de quoi les reports de charges ainsi créés peuvent aboutir au déclenchement de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes, avec les lourdes conséquences qui peuvent s’ensuivre sur le fonctionnement de l’établissement.
L’importance des gains de productivité qui nous sont demandés met certains établissements en situation de grande détresse. De façon générale, la situation de nos établissements est légèrement déficitaire. Mais, entre les établissements en bonne santé et ceux qui sont dans les situations les plus difficiles, les écarts sont élevés, peut-être les plus élevés du secteur hospitalier. En 2009, un établissement de 1 000 salariés a fermé ses portes avant d’être vendu à l’acquéreur le mieux disant au prix… d’un euro symbolique. Si le différentiel de charges avait été pris en compte – son cumul, année par année, finit par représenter des montants considérables ! –, cet établissement aurait pu continuer à exister.
M. Jean-Luc Préel. Merci de ces précisions. La convergence entre les établissements de soins publics et privés – dont font partie ceux qui relèvent de la FEHAP – comporte des déclinaisons intrasectorielles. Les difficultés budgétaires de certains établissements dans la mise en œuvre de celles-ci sont-elles dues à des problèmes de tarification ou de gestion interne ?
M. Yves-Jean Dupuis. La gestion peut bien sûr être mise en cause. Un exemple a été cité. Cependant, les cas sont relativement rares. Les gestionnaires sont soumis à un double contrôle : le contrôle annuel qu’est l’établissement du budget et le suivi des commissaires aux comptes, qui vérifient la bonne exécution de celui-ci.
Les raisons des difficultés actuelles sont en réalité multiples. L’inadaptation de certaines activités par rapport aux besoins de la population en est une. Les variations inexpliquées de tarifs d’une année à l’autre en sont une autre. Une variation majeure d’un tarif d’une année à l’autre – lors de son audition, le président de la Fédération de l’hospitalisation privée, M. Jean-Loup Durousset, a cité l’exemple d’une diminution de 20 % – pourra mettre en grande difficulté un établissement à l’équilibre et le contraindre à aménager son activité en cours d’exercice : ainsi, un établissement de la région de Nice, en situation d’équilibre, qui avait pris en charge la cardiologie pour le compte de l’hôpital local, a vu l’année suivante ses résultats dans ce secteur d’activité diminuer de 10 % en raison de la modification des tarifs. La V11, avec notamment la mise en place de bornes hautes et basses, accentue ces déséquilibres. Enfin, certains établissements peuvent rencontrer des difficultés d’adaptation. Cependant, c’est peut-être une des forces de notre fédération que d’être capable d’adapter très rapidement les organisations aux besoins des populations.
M. le coprésident Pierre Morange. Quelles sont vos relations avec des structures comme la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH), désormais intégrée à l’Agence nationale pour l’appui à la performance hospitalière (ANAP) ? Un travail d’accompagnement est-il effectué en vue d’une recherche permanente d’amélioration de l’efficience ? Au-delà des critères organisationnels et financiers, que nous avons abordés à plusieurs reprises, la mesure des prestations rendues aux citoyens, du service rendu à l’assuré, prend-elle en compte des paramètres facilement lisibles, comme le temps d’attente aux urgences ? Dans ce domaine, J’avais lancé une expérience au sein des hôpitaux Bichat et Beaujon, avec l’assistance du cabinet McKinsey et l’appui financier de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. La participation du personnel a été remarquable. La réussite a été au rendez-vous : à moyens humains et financiers constants, le temps d’attente a diminué de 40 % en l’espace de quelques mois.
M. Antoine Dubout. Comme je l’ai dit en introduction, notre secteur est très divers. Nous travaillons avec la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH), mais peut-être de façon moins structurée que l’hôpital public. Nous avons défini des critères de qualité. En revanche, nous n’avons pas jusqu’à présent procédé à leur généralisation. La qualité est mesurée plutôt établissement par établissement, par le biais d’enquêtes de satisfaction anonymes à domicile une semaine ou deux après l’hospitalisation par exemple. Nous allons engager une réflexion d’ensemble sur la qualité : son lancement officiel aura lieu dans deux semaines à l’hôpital de la Croix Saint-Simon, à Paris.
Je voudrais enfin souligner que la mise en place de la V11 cette année a représenté la caricature de ce qu’il ne faut pas faire. La V11 n’a été connue qu’au printemps. À ce retard se sont ajoutées des difficultés avec les logiciels fournis. De ce fait, nos établissements n’ont pu connaître leurs ressources qu’à la fin du printemps. Comment un établissement, qui a dû attendre la fin du mois de mai pour calculer ses recettes, peut-il redresser en six mois un déséquilibre ? Comme je l’ai dit à Mme la ministre, les résultats de cette pratique ont été catastrophiques.
M. le coprésident Pierre Morange. Merci, messieurs. Si vous souhaitez faire à la mission des propositions précises pour améliorer le service rendu à nos concitoyens, nous étudierons avec une très grande attention les conditions dans lesquelles elles pourraient être déclinées sur le plan législatif ou réglementaire. Nous entendons remettre notre rapport dans le courant du mois de janvier.
*
AUDITIONS DU 10 DÉCEMBRE 2009
Audition de Mme Maryse Chodorge, directrice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pour commencer les auditions de cette matinée, j’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Mme Maryse Chodorge, directrice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
Dans le cadre du travail que nous avons entrepris sur le fonctionnement de l’hôpital, nous avons d’abord examiné des cas précis, notamment celui du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Nous avons ensuite mis en perspective nos premiers constats, en essayant de distinguer ce qui était spécifique à tel ou tel établissement et ce qui pouvait être extrapolé à d’autres, voire à tous, et donc donner lieu de notre part à des préconisations. Nous sommes bien entendu très intéressés, madame la directrice, par l’activité de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, que je vous invite tout d’abord à nous présenter.
Mme Maryse Chodorge, directrice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation. L’Agence, dont la mission porte sur l’information relative à l’hospitalisation des patients, a été créée par un décret du 26 décembre 2000. Nommée en décembre 2001, j’ai pris mes fonctions en janvier 2002, pour l’installer en octobre 2002 sur deux sites, à Lyon – où nous devions développer principalement notre activité – et à Paris – où nous sommes amenés à travailler de plus en plus avec le ministère de la santé, en particulier avec la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). Fin 2002, nous étions vingt-trois personnes ; nous sommes maintenant cent neuf. L’élaboration du contrat d’objectifs et de moyens 2007-2011 avait mis en évidence le fait que l’Agence ne disposait pas des moyens suffisants pour accomplir ses missions – ce que la Cour des comptes, à l’occasion de son rapport sur la tarification à l’activité, avait elle-même souligné. Par ailleurs, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a souhaité que nous intégrions une partie des missions du bureau F1, chargé de la synthèse financière.
L’Agence a pour première activité de recueillir de l’information. Elle est responsable du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), qui a été généralisé en 1996. Et alors que celui-ci ne concernait au départ que la médecine, la chirurgie et l’obstétrique, nous l’avons étendu aux soins de suite et de réadaptation, à l’hospitalisation à domicile et à la psychiatrie – domaine dans lequel, alors que jusqu’à 2007 nous n’avions que très peu d’informations, nous disposons maintenant des données de 85 % des établissements.
La reprise de l’activité d’une partie du bureau F1 nous a amenés à développer par ailleurs le recueil de données en matière budgétaire et comptable ainsi qu’en matière financière. L’Agence dispose, pour le secteur ex-DG, c’est-à-dire antérieurement financé par une dotation globale, de l’ensemble des données financières – états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD), suivi quadrimestriel de ces budgets prévisionnels, comptes financiers. Elle dispose également de retraitements comptables, premier niveau de comptabilité analytique qui permet de mieux connaître, par section d’imputation, les charges des établissements. Enfin, elle a repris l’enquête nationale des coûts, calculés pour chacun des groupes homogènes de malades (GHM) – il en existe environ 2 280, à l’origine directement issus de la classification américaine DRG (diagnosis related group).
Bien entendu, une fois ces données recueillies, l’agence les exploite. Nous rédigeons donc, notamment à l’attention de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, des notes d’analyse financière et des points réguliers sur les états prévisionnels de recettes et de dépenses, sur les rapports quadrimestriels et sur les comptes financiers. Cette année, grâce au renforcement de nos effectifs, nous avons commencé à assurer un suivi plus rapproché, notamment à partir des informations relatives aux recettes – puisque le programme de médicalisation des systèmes d’information permet, pour les établissements publics, de calculer les recettes et de préparer les arrêtés de versement pour les agences régionales de l’hospitalisation (ARH). Nous établissons aussi des rapports, tel celui que nous avons publié en début d’année sur les centres hospitaliers universitaires (CHU) à la demande de la commission Marescaux. Actuellement, nous travaillons sur les personnes âgées pour le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie. Et bien sûr, nous répondons aux questions de la Cour des comptes.
Enfin, nous contribuons avec l’assurance maladie à la préparation des contrôles externes. La tarification à l’activité (T2A) s’accompagne en effet de la mise en place d’un système de contrôle, visant à vérifier si ce que l’établissement déclare – soit dans sa facture s’il appartient au secteur privé, soit dans le recueil au titre du programme de médicalisation des systèmes d’information – est bien conforme au dossier du patient. Lorsque le tarif du séjour, dans la classification des groupes homogènes de séjours (GHS) n’a pas été calculé en référence au bon groupe homogène de malades (GHM), autrement dit quand la déclaration est erronée quant au diagnostic et aux actes, l’établissement doit payer un indu à l’assurance maladie, versement auquel s’ajoute une sanction. Nous fournissons à l’assurance maladie l’ensemble des éléments logiciels nécessaires à ce travail, et par ailleurs nous animons un groupe technique, réunissant la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, l’Assurance maladie et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, dont le but est de prévoir les campagnes de contrôle et de faire en sorte que les logiciels répondent aux besoins des utilisateurs – principalement les médecins contrôleurs de l’assurance maladie.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Merci pour cet exposé introductif complet.
Vous avez parlé du suivi des coûts et d’un premier niveau de comptabilité analytique, mais celle-ci demeure malheureusement très succincte dans la plupart des établissements. Cela peut-il fragiliser vos travaux ?
Mme Maryse Chodorge. L’étude de coûts que nous menons est une enquête très compliquée auprès des établissements. Pour 2007, nous avons recueilli des données sur soixante-deux établissements du secteur public et un peu plus de quarante du secteur privé. Nous avons travaillé pendant deux ans avec les fédérations et le ministère à une méthodologie commune de comptabilité analytique, visant à connaître le « coût de production » d’un séjour – dont le calcul est évidemment plus complexe que celui d’une voiture. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte : la pathologie principale, les pathologies associées qui peuvent compliquer le séjour, les actes, les médicaments et les dispositifs médicaux implantables, le passage éventuel en service de réanimation ou, à l’entrée, par les urgences… La méthode que nous avons élaborée permet aux établissements, dans le cadre de sections d’analyse, soit cliniques – lorsqu’il s’agit de médecine ou de chirurgie – soit médico-techniques – pour la radiologie, la biologie, les blocs opératoires –, de construire des « unités d’œuvre ». Ensuite, il faut procéder à la répartition en descendant au niveau des groupes homogènes de malades.
Tout cela nous permet d’avoir, pour les établissements concernés – nous augmentons la taille de l’échantillon chaque année –, une référence moyenne, que nous traitons avec d’infinies précautions car un échantillon, pour être représentatif, doit normalement résulter d’un tirage au sort, alors que les établissements que nous étudions sont volontaires. Nous effectuons donc un gros travail statistique afin de rapprocher la microphotographie que nous avons obtenue des données nationales exhaustives du programme de médicalisation des systèmes d’information. Nous avons mis quelque temps à élaborer cette technique – d’ailleurs avec l’aide du spécialiste des sondages de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), que j’avais embauché pour cela –, et nous l’améliorons encore chaque année. Mais la méthode fonctionne très bien. Elle demande du temps et de gros serveurs informatiques, mais elle permet d’obtenir un coût moyen assez proche de la réalité nationale. Nous calculons aussi un intervalle de confiance, c’est-à-dire une estimation de la précision de ce coût moyen.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous comprenons bien toutes les précautions que vous prenez pour tirer des conclusions nationales à partir de votre échantillonnage mais, comme le soulignait notre rapporteur, il ressort des auditions que nous avons menées que dans beaucoup d’établissements, il est difficile de collecter des informations : les outils de mesure sont souvent rudimentaires, la comptabilité analytique est très peu développée et, s’agissant des recettes, les taux de recouvrement des facturations laissent à désirer. Cela apparaît-il dans vos analyses, dès lors qu’elles sont adossées sur un échantillon d’établissements qui sont volontaires, et dont on peut donc imaginer qu’ils ont une certaine rigueur ?
Mme Maryse Chodorge. D’abord, tous les établissements volontaires ne sont pas retenus : nous choisissons parmi eux les établissements qui feront partie de l’étude – ce qui nous vaut parfois des divergences avec les fédérations –, en nous fondant en premier lieu sur leur système d’information. Sans doute ne sont-ils pas exemplaires, mais si l’on devait attendre que tout soit parfait, on ne ferait plus rien… La situation des établissements est très hétérogène en matière de systèmes de facturation, de systèmes informatiques et de gestion en général, mais pour notre étude de coûts nous faisons en sorte que ces établissements améliorent au préalable leur système d’information. Nous sommes très pointilleux : en fonction du score qu’obtient un établissement au questionnaire que nous avons préparé, nous acceptons ou non que cet établissement fasse partie de l’étude. Par ailleurs nous apportons notre aide à certains, parfois sur la base d’un audit.
Notre étude des coûts n’est donc pas parfaite, mais elle donne de bonnes indications en termes de hiérarchie. En ce qui concerne les groupes homogènes de malades pour lesquels nous ne disposons pas d’observations en nombre suffisant, nous avons des dispositifs techniques qui nous permettent de calculer les tarifs.
S’agissant de la comptabilité analytique proprement dite, les retraitements comptables sont obligatoires pour tous les établissements. Ils répondent tous à cette obligation – en cas de besoin après une relance de notre part. Certes, le contrôle de qualité n’est pas le même que pour l’étude nationale des coûts mais, comme je le fais souvent remarquer, plus nos données seront utilisées, meilleures elles seront. L’un de mes anciens collègues de l’Institut national de la statistique et des études économiques avait cette formule : l’information, à l’inverse des piles Wonder, ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ! Par exemple, les retraitements comptables permettent de calculer le nombre de praticiens nécessaire pour arriver à tel niveau de recettes. Nous avons un dispositif appelé « système national de l’information sur l’hospitalisation », plusieurs centaines de tableaux de bord, et notamment, à la demande de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et à la suite d’un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), celui qui est relatif à l’efficience et à la performance, comportant divers indicateurs qui permettent de comparer les établissements entre eux. Il est très important de les mettre à disposition le plus largement possible. Ces informations sont utilisées par les agences régionales de l’hospitalisation, le ministère, la Cour des comptes, les conseillers généraux des établissements de santé, voire l’Inspection générale des affaires sociales. Bien entendu, il faut ensuite les analyser : s’apercevoir, par exemple, que les recettes de T2A d’un établissement ne vont pas couvrir ses charges est une chose, mais il reste à chercher l’explication.
M. le coprésident Pierre Morange. J’insiste sur notre interrogation. Les établissements sont tenus de mettre en place une comptabilité suffisamment structurée, permettant la collecte d’informations pertinentes. Or il ressort de nos auditions que seulement un tiers d’entre eux ont une comptabilité digne de ce nom et qu’il faudra encore dix-huit mois pour atteindre un niveau acceptable. Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Concernant la facturation, le recouvrement direct auprès de l’assurance maladie, prévu pour début 2006, a été reporté au 1er juillet 2011 pour cause de défaut de pilotage et de difficultés techniques. Pouvez-vous nous dire ce qui, à votre avis, bloque cette réforme et pourquoi, encore aujourd’hui, les hôpitaux reçoivent des agences régionales de l’hospitalisation des financements calculés sur la base d’états statistiques ?
Mme Maryse Chodorge. Je m’inscris totalement en faux sur ce point ! Je suis prête à en débattre avec les personnes qui vous ont affirmé cela, comme avec celles qui vous ont dit qu’un tiers seulement des établissements avaient une comptabilité correcte. Je parle à titre personnel, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation n’étant chargée ni de l’organisation et du fonctionnement des établissements, ni du suivi des systèmes d’information hospitaliers. Permettez-moi de douter qu’un établissement public, soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes, et passant par un trésorier qui est un représentant de la direction générale de la comptabilité publique, puisse se permettre de ne pas avoir une gestion comptable correcte. Il est possible qu’il oublie certaines factures ou taxes, mais je pense que tous les établissements ont un fichier de structure – qui découpe l’établissement en sections d’analyse – et qu’ils sont tous obligés, surtout depuis la T2A, d’enregistrer l’ensemble de leurs dépenses. Si le budget de l’établissement, l’état prévisionnel de recettes et de dépenses, voté par le conseil d’administration en présence d’un représentant de l’agence régionale de l’hospitalisation et validé par cette dernière, n’est pas sincère, je vous laisse, en tant que mission d’évaluation et de contrôle, en tirer les conclusions ! Je suis moi-même directrice d’un établissement public ; je présente mon budget chaque année, l’agent comptable présente le compte financier, nous expliquons tout aux administrateurs, à charge pour eux de vérifier si nous avons payé la taxe sur les salaires ou pas !
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous ne parlons peut-être pas de la même chose. Personne ici ne met en doute le fait que le comptable de l’établissement respecte les règles, mais il travaille sur les informations qui lui parviennent. Si, en amont, il y a sous-facturation des prestations, le comptable ne travaillera que sur une partie de l’activité. Par ailleurs, le fait que les règles de gestion soient scrupuleusement respectées n’enlève rien à la nécessité d’une analyse des coûts, par le biais d’une comptabilité analytique ; à cet égard, les besoins sont encore grands.
Mme Maryse Chodorge. Pour ce qui est de la sous-facturation dans les établissements antérieurement financés par une dotation globale, nous constatons à travers le recueil au titre du programme de médicalisation des systèmes d’information que les données progressent chaque année en exhaustivité – mais recueillir les données d’un patient n’est pas si simple. Beaucoup d’établissements ont, dès 2004, fait le nécessaire pour assurer la collecte des informations sur les séjours, les pathologies et les actes. En accord avec le ministère, nous avons un peu compliqué la demande : concernant les molécules onéreuses, par exemple, nous demandons un rattachement aux données administratives du patient, comme pour les données médicalisées ; je vous laisse imaginer le travail que cela représente, puisque tout est anonymisé. De nombreux enregistrements doivent maintenant être rapprochés des droits du patient. Pour cela, la personne qui fait la facture, à l’hôpital, doit se connecter à Internet, retrouver le patient dans un fichier, en espérant que sa carte Vitale soit à jour, et identifier ses droits. Ce n’est que si elle comporte tous les éléments de droits du patient que nous considérons qu’une facture est correcte, et je vous assure que nos logiciels permettent des contrôles aussi sophistiqués que ceux des caisses d’assurance maladie.
On pourrait tout de même simplifier la vie des établissements : il ne paraît pas insurmontable, en 2009, de créer un système de requête informatisée qui aille chercher automatiquement les droits du patient, plutôt que de le faire faire à la personne de l’accueil !
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Mais pourquoi n’est-ce pas encore le cas ?
Mme Maryse Chodorge. Ce n’est pas à moi qu’il faut le demander. Vous savez qu’il existe de nombreux régimes d’assurance maladie. Une autre difficulté vient du fait que l’hôpital doit désormais contrôler le parcours du patient, c’est-à-dire vérifier s’il a un médecin traitant et s’il a respecté le parcours de soins ; il est obligé pour cela de ressaisir toutes les données. On critique beaucoup les systèmes d’information hospitaliers mais, s’il est vrai que les établissements avaient pris du retard dans ce domaine, ils se sont bien modernisés.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous avez parlé de la préparation des contrôles externes avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) – c’est-à-dire, en fait, du contrôle de l’application de la tarification. À quels constats ces contrôles conduisent-ils ?
Mme Maryse Chodorge. Les montants sont beaucoup moins élevés que ce qu’on imaginait, malgré un nombre de contrôles élevé. La peur du gendarme jouant, les établissements font attention à leurs codages, d’autant que les médecins contrôleurs de l’assurance maladie sont devenus très experts et examinent les dossiers méticuleusement.
L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation joue un rôle d’expertise. Nous sommes saisis des désaccords entre contrôleurs de l’assurance maladie et établissements sur les codages médicaux. Dans neuf cas sur dix, nous donnons raison au contrôleur de l’assurance maladie, dans 5 % des cas à l’établissement et pour le reste, nous considérons que nous ne disposons pas des éléments nécessaires pour nous prononcer, notamment parce que nous ne sommes pas habilités à remonter jusqu’aux dossiers médicaux. L’Agence établit tous les ans un rapport sur le sujet. Le programme des campagnes de contrôle est décidé au niveau national par la direction du contentieux de l’assurance maladie, puis discuté dans chaque région au sein des commissions exécutives des agences régionales de l’hospitalisation. Les outils que nous avons mis en place permettent aussi bien d’examiner tous les dossiers faisant l’objet d’un contrôle ciblé national, de procéder à un contrôle particulier sur une région, ou encore d’effectuer des contrôles particuliers, établissement par établissement : chaque contrôleur peut constituer son « panier de la ménagère » avec ces trois types de contrôle.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’objet de tout contrôle est de se rendre inutile à terme – mais on en est probablement encore loin. Considérez-vous qu’il y a eu des progrès importants dans le codage – dans sa fidélité à la réalité et dans les modes opératoires des établissements ? Constatez-vous des biais ou des stratégies de la part des établissements ?
M. le coprésident Pierre Morange. J’ajoute que la fameuse norme V11 a fait l’objet de nombreuses remarques au cours de nos auditions. Beaucoup de responsables d’établissement ont insisté sur la nécessité de la décliner sur le terrain, afin de mieux refléter la réalité médicale. Ils ont souligné que cela demandait du temps et regretté que des changements surviennent alors que la référence antérieure n’était pas encore totalement maîtrisée. Ils souhaitent une plus grande stabilité dans les outils de mesure. Quel est votre sentiment ?
Mme Maryse Chodorge. Nous avons, pour la première fois, étudié le comportement de codage, sur les six premiers mois codés en V11. Il s’agissait notamment de vérifier les diagnostics associés – qui donnent accès aux niveaux 2, 3 et 4 des groupes homogènes de malades, mieux payés que le niveau 1. Nous avons effectivement constaté certaines pratiques, même si les montants en cause ne sont pas très élevés, dans certains types d’établissement. Nous avons donc diffusé une notice sur le codage des diagnostics associés, qui a un intérêt pédagogique évident pour les établissements mais qui est également utile aux contrôleurs de l’assurance maladie, puisqu’elle est opposable. Il est très important que ces contrôles se poursuivent, même si les recettes ne sont pas à la hauteur des espérances, car ils constituent un garde-fou contre les déviances dans le codage.
Pour la première fois donc, nous sommes en mesure de dire que certaines pratiques doivent disparaître. Des codes vont pouvoir être exclus de certains enregistrements médicalisés, d’autres ne pourront plus donner accès à des niveaux de sévérité plus hauts ; et les règles de codage pourront être vérifiées par les contrôleurs de l’assurance maladie. La V11 nous donne donc les moyens de suivre le codage de mois en mois et d’adapter les règles continuellement. Tout l’intérêt de notre dispositif franco-français, que certains critiquent, est bien de nous donner la possibilité de faire ce travail et d’améliorer la classification en fonction des comportements de codage.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Faut-il comprendre que vous répondez à ceux qui reprochent au système de la tarification à l’activité son instabilité que, précisément, l’instabilité permet d’améliorer continuellement le système ?
Mme Maryse Chodorge. La première classification, qui remonte au début de 1995, a été peu utilisée, et dans un but de modulation de la dotation globale. Dans le cadre de la tarification à l’activité, on s’est préoccupé de donner un juste prix aux séjours. Une classification a donc été élaborée, d’abord pour financer correctement les séjours de moins d’un jour. À la demande de la fédération du privé, nous sommes passés à la version 10, parce d’aucuns considéraient que certains groupes homogènes de malades, notamment chirurgicaux, étaient mal financés. Nous sommes enfin passés à la version 11, qui devrait durer encore quelques années. Elle se rapproche des versions allemande et australienne et permet de mieux faire la part entre le patient « standard » et le patient « lourd », qui a des complications et dont la prise en charge coûte plus cher. La V11 simplifie le système : il y a 650 grands types d’activité, et pour chacun d’entre eux, les niveaux 1, 2, 3 et 4 ou le « zéro jour » – correspondant à la politique de développement de la chirurgie ambulatoire.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pour quand la version 12 est-elle prévue ?
Mme Maryse Chodorge. Pour l’instant, elle n’est pas prévue. La V11 sera modifiée à la marge l’année prochaine : à la demande de certains établissements, nous avons ajouté les séjours de très courte durée ; nous avons aussi modifié le système des bornes basses, dont les établissements s’étaient beaucoup plaints, sans se rendre compte que lorsqu’il y a beaucoup de bornes basses – donc des séjours financés plus bas – cette masse va nourrir les groupes homogènes de malades les plus lourds. Ils trouvaient qu’il y en avait trop et que ce n’était pas lisible médicalement ; nous avons donc réfléchi à une diminution drastique des bornes basses, qui ne modifie en rien la classification mais qui donnera aux praticiens un signe en faveur d’une réduction des durées moyennes de séjour, puisque ces bornes basses seront mieux rémunérées. Enfin, des erreurs manifestes portant sur deux ou trois groupes homogènes de malades vont être corrigées mais au total, on peut parler de grande stabilité de la classification. La stabilité des tarifs est un autre sujet.
M. Jean-Luc Préel. Merci pour cette présentation passionnante. Vous avez parlé d’un tableau de bord de performance et d’efficience. Or un rapport de la Cour des comptes a montré que le nombre de praticiens ou de soignants pouvait varier de un à cinq, voire de un à dix selon les établissements. Avez-vous constaté ces déviances ? Comment expliquez-vous qu’elles puissent perdurer ?
Mme Maryse Chodorge. L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation est chargée de produire des chiffres, non de les analyser. La Cour des comptes se sert de nos indicateurs.
Les divergences que nous constatons entre établissements peuvent en effet être énormes. Nous rappelons d’ailleurs régulièrement à l’ordre les agences régionales de l’hospitalisation, qui sont censées valider les chiffres qui nous arrivent des établissements car dans certains cas, nous pensons qu’il s’agit d’erreurs de déclaration. Cela dit, il est compliqué de compter le nombre de praticiens dans un hôpital car certains sont à temps plein, d’autres à temps partiel, d’autres vacataires… La vérité des chiffres passe donc, je le répète, par leur utilisation la plus large possible.
Lorsqu’un problème apparaît, il faut aller interroger les responsables de l’établissement. L’intérêt du tableau de bord de performance et d’efficience est qu’il comporte une trentaine d’indicateurs, suffisamment variés pour qu’on puisse en examiner la cohérence. Nous réalisons également chaque année depuis trois ans un tableau de bord appelé « diagnostic flash », mis au point pour décider des missions d’audit à effectuer dans les établissements.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il me reste à vous remercier pour votre contribution à nos travaux.
*
Audition de M. Antoine Flahault, directeur de l’École des hautes études en santé publique, accompagné de M. Christian Queyroux, secrétaire général.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir de recevoir maintenant M. Antoine Flahault, directeur de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), et M. Christian Queyroux, secrétaire général.
Messieurs, vous savez que nous travaillons depuis quelques mois sur le fonctionnement de l’hôpital, en vue de formuler des préconisations pour optimiser l’emploi des deniers publics dans les établissements de soins. Nous souhaitons connaître votre sentiment sur la manière dont la formation des cadres des établissements hospitaliers prend en compte ce défi. Les auditions précédentes ont montré que des marges de progression existaient en matière de maîtrise de l’information et d’outils de pilotage. L’établissement de formation que vous dirigez a-t-il modifié ses programmes ou adopté une stratégie pour assurer aux cadres hospitaliers les connaissances techniques nécessaires en matière financière et comptable et dans le domaine de la gestion des ressources humaines ?
M. Antoine Flahault, directeur de l’École des hautes études en santé publique. Merci de nous recevoir. Nous allons tenter de répondre à vos questions, avant d’être très certainement éclairés nous-mêmes par le rapport de votre mission.
L’École des hautes études en santé publique, dont le statut est issu de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, fonctionne comme telle depuis le 1er janvier 2008. Je reviendrai sur les évolutions qu’autorise, en matière de formation, son caractère d’établissement d’enseignement supérieur.
La complexité de l’hôpital et de son management tient tout d’abord à ce que le service y est individualisé à l’extrême. Très peu d’organisations atteignent ce niveau de granularité, qui tient du reste à la première des deux valeurs fondamentales de l’hôpital : le patient doit être au centre du dispositif. Cette idée, souvent affichée comme un slogan, doit être une culture pour l’ensemble des personnels de cette entreprise particulière, qu’il s’agisse des soignants ou de ceux qui sont chargés de l’administration et de la gestion. La charge humaine et émotionnelle qui sous-tend le service hospitalier complique encore la tâche : il est difficile de travailler dans un univers où, en règle générale, le patient n’entre pas par choix. De plus, l’hôpital concentre beaucoup de risques – risque social lié à la gestion d’une entreprise qui est souvent le plus gros employeur de la commune, complexité d’un fonctionnement qui doit être assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, risques physiques, chimiques, nucléaires et microbiologiques dans un environnement très contraint, le plus souvent en zone urbanisée.
La deuxième valeur fondamentale de l’hôpital est le travail en équipe. Nous devons nous efforcer de l’apprendre à de futurs gestionnaires qui auront souvent affaire à des individualités très fortes – la culture des médecins est par essence individualiste. Pour que l’hôpital fonctionne bien, il faut rompre les étanchéités, tant entre l’administration et les soignants qu’au sein même des services et entre les disciplines – car les soins sont désormais de plus en plus interdisciplinaires et la gestion des personnes ne peut se faire « en silo », sous peine d’inefficience.
La technicité que vous avez évoquée et l’efficience économique doivent être conçues comme dérivées de ces préambules essentiels. L’objectif est de délivrer des soins de la meilleure qualité possible, en mettant toujours le patient au centre des préoccupations, à tous les niveaux de la production du soin – depuis la prise de rendez-vous au standard, où la personne âgée qui répète plusieurs fois la même chose doit trouver en face d’elle une personne qui répond avec humilité et patience à toutes ses questions, jusqu’au retour en ville, où le lien doit être assuré avec le médecin traitant.
Le fait de dispenser des soins de qualité aussi efficaces que possible, conformes à l’état de l’art et aux recommandations scientifiques formulées notamment par la Haute Autorité de santé, ne peut qu’avoir des effets positifs en termes de coût. L’ensemble des outils concourant à la mise en œuvre d’un système d’information performant et permettant d’éviter les duplications – trop souvent, les patients doivent subir deux fois les mêmes examens – doit avoir pour premier objet le service du patient. La priorité donnée au patient et le travail en équipe ne peuvent qu’être bénéfiques en termes financiers.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment la difficulté du métier est-elle prise en compte dans le mode de sélection et la formation des élèves de l’École des hautes études en santé publique ?
M. Antoine Flahault. Christian Queyroux, qui a une formation de directeur d’hôpital, complétera certainement mes réponses. J’ai pour ma part une formation de médecin, professeur des universités et praticien hospitalier.
La sélection de nos élèves se fait par concours. L’école de Rennes – qui forme à quatorze métiers – est reconnue dans le monde entier pour la qualité de la formation des directeurs d’hôpitaux ; ma toute récente élection à la présidence de l’Association des écoles de santé publique de la région européenne résulte de son renom à ce titre. Néanmoins, nous ne maîtrisons pas les modalités de sélection des élèves.
M. Christian Queyroux, secrétaire général de l’École des hautes études en santé publique. Le concours d’entrée, très classiquement, a d’abord pour objet de vérifier que les matières correspondant aux diplômes qui permettent d’accéder à ce concours ont bien été assimilées. À l’exception peut-être du grand oral auquel sont soumis les candidats qui ont passé la barrière de l’écrit, peu d’éléments de ce concours permettent d’examiner l’aptitude à l’exercice du métier. La sélection en cours de formation, en revanche, fait l’objet d’une réflexion – un arrêt du Conseil d’État a d’ailleurs débouté en 2003 un auditeur de justice qui contestait le refus de sa titularisation à l’issue de sa formation, au motif que la période de stage que constitue la formation à l’école n’est pas seulement destinée à être sanctionnée par des notes rendant compte de l’aptitude à répondre à des exigences techniques, mais doit permettre au jury d’apprécier l’aptitude à occuper l’emploi visé. La restructuration engagée par l’école, à la demande des ministères sociaux, pour accompagner les changements en cours témoigne d’une évolution en ce sens. Nous pouvons tirer parti de la durée assez longue de la formation – vingt-quatre mois pour les directeurs d’établissements sanitaires et sociaux et vingt-sept pour les directeurs d’hôpitaux – non seulement pour outiller les élèves sur le plan technique, mais aussi pour les mettre en mesure d’occuper leur futur emploi et, le cas échéant, constater que certains n’ont pas l’aptitude.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pouvez-vous préciser ?
M. Christian Queyroux. Nous travaillons avec la direction des études sur les mises en situation, notamment à travers les stages professionnels, afin que les élèves éprouvent sur le terrain l’enseignement théorique de l’école et se préparent à affronter le monde complexe qu’évoquait M. Flahault, marqué notamment par le contexte de la douleur et de la maladie. L’autre solution serait de rallonger les épreuves du concours afin de mieux cerner la personnalité des candidats ; notre choix est plutôt d’utiliser à cette fin la période, assez longue, de formation.
M. Antoine Flahault. L’École des hautes études en santé publique concourt actuellement pour obtenir une accréditation délivrée par la seule agence internationale d’accréditation des écoles de santé publique, établie à Washington et très imprégnée du modèle des écoles de santé publique nord-américaines, lesquelles sont parmi les meilleures du monde – avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Venus visiter l’« École de Rennes » dans son fonctionnement traditionnel, les experts de cette agence ont observé que le mode de sélection, s’il ne dépendait pas de nous, nous amenait d’excellents étudiants et que la formation de vingt-sept mois, dont onze mois de stage, nous permettait de délivrer dès maintenant, compte tenu du statut conféré à l’école par décret, des diplômes d’établissement. Nos interlocuteurs ont comparé la formation de l’École des hautes études en santé publique à des joint degrees, doubles diplômes associant un master de santé publique et un Healthcare MBA, c’est-à-dire un master de management dans le domaine des organisations de santé. De même, la formation des directeurs des établissements sociaux correspondrait à un Social Care MBA. Ainsi, nos formations s’apparentent fortement à celles qui sont dispensées aux futurs directeurs des grands hôpitaux américains.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Donc, tout va bien ?
M. Antoine Flahault. Certes non. Dans le système nord-américain, les profils entrants sont très hétérogènes. Nous avons besoin de plus de concurrence et nos élèves doivent pouvoir suivre des cursus différents. L’École des hautes études en santé publique étant désormais un établissement universitaire, nous pouvons, dans le cadre du système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS), rendre nos formations diplômantes en les « mastérisant ». Les crédits pourront être acquis dans d’autres établissements, comme l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), l’école des Hautes études commerciales (HEC) ou la London School of Economics. Nous devons permettre à nos élèves une certaine exogamie, en irriguant nos formations diplômantes par des élèves non-fonctionnaires et étrangers. Nous devons aussi leur permettre d’aller chercher ailleurs des équivalences, que nous reconnaîtrons par nos diplômes.
M. le coprésident Pierre Morange. L’approche de la MECSS se caractérise par son pragmatisme. Vous rappeliez à très juste titre le double défi que constitue l’offre d’une prestation très individualisée dans le cadre d’une dynamique collective complexe. Les hôpitaux français connaissent indéniablement des problèmes variés. À l’occasion des précédentes auditions, ont notamment été évoquées l’insuffisante maîtrise de l’information et la faiblesse des outils de mesure, notamment en vue d’une gestion prévisionnelle des moyens. Sans parler de contradiction avec les principes d’excellence que vous nous exposez, il semble qu’il existe une forme d’inertie et une nécessité d’évolution culturelle. Quels correctifs conviendrait-il d’apporter, selon vous, aux programmes pédagogiques ?
M. Antoine Flahault. Selon notre analyse, nos formations sont trop étanches vis-à-vis du corps médical et, plus généralement, du milieu des soignants. Par ailleurs, le mode de sélection de nos élèves – dont nous ne nous plaignons pas, tout en soulignant que nous devons pouvoir, le cas échéant, empêcher ceux qui n’auraient pas les qualités requises d’accéder aux métiers de direction – se traduit par un manque de connaissances en sciences quantitatives, notamment en économie, épidémiologie et biostatistique.
Nous avons décidé de renforcer fortement, dès la rentrée 2010, la formation sur les questions biostatistiques et épidémiologiques. Elle n’a pas toujours fait défaut : lorsque M. Queyroux étudiait à l’École de Rennes, par exemple, une formation en épidémiologie était prévue pour les directeurs d’hôpitaux.
M. le coprésident Pierre Morange. Ces matières sont fondamentales pour gérer un établissement de soins. Combien de temps la zone d’ombre a-t-elle duré ?
M. Christian Queyroux. La formation des directeurs d’hôpitaux a connu un mouvement alterné.
Lorsque j’étais à l’école, en 1977, la formation portait aussi sur les statistiques et sur la maladie et les pathologies. J’ai ainsi eu l’occasion de passer deux années d’assistanat dans des établissements.
Les stages de onze mois ont une perspective différente de celle de ces expériences d’immersion. À mesure que l’on a demandé aux directeurs d’hôpitaux d’être davantage gestionnaires, sont apparues des spécialisations liées à la gestion biostatistique ou au suivi épidémiologique. La fonction de direction s’est alors cantonnée à des champs perçus comme plus directement pertinents, au détriment sans doute d’une culture commune. Je souscris sur ce point à l’opinion du professeur Flahault.
La gouvernance qui a prévalu ensuite, associant médecins et directeurs pour prendre des décisions stratégiques qui, de ce fait, intégraient tant les aspects économiques que les logiques médicales, était un progrès sensible ; j’ai pu le constater comme directeur général de centre hospitalier universitaire en Franche-Comté.
La réforme entreprise à l’École des hautes études en santé publique pour enseigner les « fondamentaux de santé publique » à tous les élèves, quelle que soit leur filière – médecins inspecteurs, directeurs d’hôpitaux, directeurs de soins, ingénieurs – est une bonne chose. Nous prévoyons parallèlement, bien sûr, des spécialisations pour chacun des métiers – par exemple en contrôle de gestion pour les directeurs d’hôpitaux, car il y avait là une lacune à combler.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Jusqu’à une période récente, l’accent aurait donc été mis sur la gestion dans la formation initiale. Pourtant, les établissements ne sont pas en très bonne santé financière et, semble-t-il, n’ont pas d’outils de gestion très performants. N’y a-t-il pas là un paradoxe ?
Par ailleurs, comment articulez-vous votre action avec celles d’autres organismes susceptibles de prolonger cette formation initiale, comme le Centre national de gestion ?
M. Antoine Flahault. Nous allons poursuivre nos réflexions sur la pédagogie en matière d’outils de gestion et de systèmes d’information. La transformation de l’école, anciennement établissement public administratif, en établissement d’enseignement supérieur va permettre d’adosser la formation à la recherche, ce qui est très important. Nous avons entrepris de créer des unités mixtes de recherche dans nos domaines de compétence et d’intérêt. Nous avons notamment créé un réseau doctoral avec dix écoles doctorales, dont HEC – qui possède la plus belle école doctorale de management, mais sans aucun laboratoire travaillant dans le domaine de la santé. Le réseau comporte également l’École des hautes études en sciences sociales, ainsi que diverses universités – de Rennes, Bordeaux, Nancy, Paris, Marseille – particulièrement impliquées dans les problèmes de santé publique. Nous proposerons ainsi des formations enrichies par la recherche. Il est difficile aujourd’hui d’évaluer le système sans disposer d’outils de comparaison, y compris avec des hôpitaux étrangers ; dans le cadre de recherches à caractère opérationnel, nous pourrions comparer divers systèmes d’information et de gestion.
Nous mettons également en place un doctorat très professionnalisant avec l’université de Berkeley, l’université de Caroline du Nord de Chapel Hill et la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Des directeurs d’hôpitaux déjà en poste peuvent ainsi entreprendre un doctorat qui leur assure une formation de très haut niveau et la possibilité de mener des recherches dans des domaines qui n’ont guère été explorés jusqu’à présent en France.
De même que l’hôpital est un extraordinaire outil pour recueillir des informations et des données utiles à l’épidémiologie et au pilotage de certaines politiques de santé, la recherche doit éclairer la décision publique – à l’instar de publications de grandes écoles commerciales américaines ou de la London School of Economics qui ont permis d’améliorer les systèmes de gestion ou de gouvernance de grandes entreprises.
M. le coprésident Pierre Morange. La formation que vous dispensez intègre-t-elle les expérimentations considérées comme modèles de bonnes pratiques ? Je citerai l’exemple, qui m’est cher, de l’expérimentation menée par le cabinet McKinsey sous la direction de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) aux urgences de Bichat et Beaujon et qui a permis, en l’espace de trois ou quatre mois, de réduire de plus de 40 % le temps d’attente des patients aux urgences. Je m’étais personnellement investi dans cette expérimentation dans l’espoir de démontrer que l’on pouvait, à masse financière constante, améliorer dans une large mesure le service rendu aux patients. Ces bonnes pratiques sont-elles non seulement intégrées à la formation initiale, mais diffusées, au titre de la formation continue, aux directeurs d’établissement en poste ?
M. Antoine Flahault. C’est exactement ainsi que nous concevons le développement d’expérimentations dans le cadre de masters ou de doctorats professionnels.
M. le coprésident Pierre Morange. L’exemple que j’ai cité date de 2005 mais n’a jamais été généralisé.
M. Antoine Flahault. Le sujet m’intéresse et me préoccupe. Permettez-moi de citer moi aussi une anecdote : lorsque j’étais chef du département de santé publique de l’hôpital Tenon, j’ai mis au point un projet consistant à informer les patients par voie de panneaux lumineux – comme sur le boulevard périphérique ! – de la durée d’attente prévisible. J’ai même déposé un brevet à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris pour les algorithmes développés à cette fin, mais l’expérience n’a jamais été généralisée. De telles recherches sont trop rares dans notre pays. Lorsqu’elles seront plus nombreuses et publiées dans des revues internationales, elles pourront être commercialisées et valorisées – mais cela prendra du temps. Notre école a précisément le potentiel pour le faire.
En matière de formation continue, nous avons deux programmes importants de management. Le premier, intitulé Hôpital Plus, est un programme résidentiel de très haut niveau, d’une durée de cinq semaines, dont une à l’étranger, pour des petites classes de vingt-cinq personnes.
M. le coprésident Pierre Morange. Combien de chefs d’établissement ce programme a-t-il formés ?
M. Christian Queyroux. Hôpital Plus, qui en est à sa quinzième édition, forme vingt-cinq personnes par an. Il est destiné à des chefs d’établissement qui ont déjà une certaine ancienneté. Il accueille parfois aussi des médecins, présidents de commissions médicales d’établissement, en tandem avec le directeur de l’établissement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’impact de cette formation a-t-il été évalué ?
M. Christian Queyroux. Les directeurs d’établissement, qui déplorent souvent de ne pas pouvoir prendre de recul pour mettre en perspective leur activité quotidienne, déclarent généralement que cette formation modulaire, qui comporte un voyage d’étude au Québec, leur permet d’appuyer sur une théorie des pratiques qu’ils ne formalisaient pas ou de systématiser des approches intuitives et personnelles.
J’ajoute que chaque année près de 8 000 personnes reçoivent une formation continue à l’École des hautes études en santé publique, en complément du millier qui sont en formation initiale. Certaines formations initiales ou continues sont organisées en collaboration avec la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH) en vue de diffuser les conclusions d’une série d’études financées sur divers domaines de l’hôpital et de montrer que certaines améliorations peuvent être reproduites.
Cette reproduction des initiatives est cependant très difficile. J’ai jadis expérimenté, dans l’établissement que je dirigeais alors, l’approche participative assez efficace à laquelle l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) recommandait de former les personnels, en vue de rendre les organisations plus efficientes avec les gens qui les composaient. Des sociologues avaient été chargés par la direction des hôpitaux de tirer le bilan de cette démarche. Cependant, de telles expériences ne se généralisent jamais pleinement ; il est difficile de diffuser une innovation pour en faire un outil de base – car ce qui est un grand succès à un endroit peut se transformer en grand échec ailleurs.
M. Antoine Flahault. Nous venons de lancer une formation de très haut niveau en management, intitulée Executive Health MBA, dispensée intégralement en langue anglaise et organisée avec la London School of Economics et l’université Columbia. Elle s’adresse à des personnes possédant déjà une très grande expérience. Il s’agit en quelque sorte d’un pendant anglophone d’Hôpital Plus, qui permet d’attirer des publics différents – et, de fait, les inscrits sont pour l’instant presque exclusivement des étrangers anglophones. C’est un nouveau vecteur de formation continue.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Un sujet particulièrement important est celui de la gestion du personnel. On sait que les coûts de personnel représentent 70 % des charges de fonctionnement de l’hôpital. Les difficultés de gestion tiennent souvent à ce que les personnels ont du mal à s’adapter à un environnement en évolution rapide et à des conditions de travail souvent difficiles. Comment préparez-vous les futurs cadres à cet aspect de la gestion ?
M. Antoine Flahault. Nous venons de recruter un nouvel enseignant, un Français qui enseignait précédemment au Canada, dans une université de l’Ontario. L’ouverture de l’École des hautes études en santé publique à l’international nous paraissait urgente, conformément à la loi de santé publique qui en a fait l’une des quatre missions de l’école.
M. le coprésident Pierre Morange. C’était l’un des souhaits du président Jean-Michel Dubernard, qui y voyait un élément important d’une stratégie d’influence de notre pays.
M. Antoine Flahault. La France, qui est considérée comme un pays possédant un bon système de santé, est en effet très silencieuse dans le concert international. Il est étonnant de constater que, lorsqu’ils cherchent un modèle de système de santé, les Américains évoquent aujourd’hui plus spontanément le système britannique, pourtant moins proche du leur que le système français, qui fait cohabiter privé et public.
Nous venons donc, disais-je, de recruter un professeur français venu d’Amérique du Nord et dont la production scientifique sur les ressources humaines nous a paru particulièrement pertinente. Plutôt que des dogmes et une idéologie, nous devons apporter un enseignement critique, irradié par la recherche, c’est-à-dire par le tâtonnement de nouvelles expérimentations et par l’évaluation des éventuelles politiques d’établissement. En cela, la formation aux ressources humaines est importante, d’autant qu’un certain nombre de nos élèves sont appelés à être directeurs des ressources humaines dans les hôpitaux.
M. Christian Queyroux. J’ai moi-même été directeur des ressources humaines pendant plus de la moitié de ma carrière et nous nous sommes intéressés dès 1982 à la gestion prévisionnelle des personnels, dans le cadre de travaux produits pour l’école.
La présentation des ressources humaines à l’hôpital est souvent schématique et focalisée sur des pratiques professionnelles très circonscrites. L’expérience m’a convaincu que, pour l’essentiel, les personnels sont formés à leur métier et ont à cœur de remplir leurs missions en atteignant les résultats que l’on attend d’eux – même s’il peut arriver que ces objectifs soient mal énoncés. Certains laissent entendre que nous serions de bons directeurs et aurions de bons hôpitaux si nous avions de bons médecins et de bons agents. Ce discours me consterne car c’est en faisant confiance aux personnes avec qui l’on travaille et en les traitant comme des professionnels responsables que l’on produit des effets d’entraînement positifs sur nos organisations. Le débat sur les ressources humaines risque toujours d’être marqué par les plaintes de ceux qui affirment que le système ne fonctionne pas. Quant à moi, mon expérience de plus de trente ans dans les hôpitaux m’a le plus souvent fait voir des professionnels décidés à agir, alors qu’ils étaient parfois confrontés à des organisations qui diminuaient leurs performances.
S’il y a un travail à faire pour rendre les hôpitaux plus efficaces, c’est de s’interroger sur l’utilité des règles – au regard d’un seul objectif, celui de délivrer les meilleurs soins au meilleur coût. Évitons au personnel des hôpitaux d’avoir à lutter non seulement contre les maladies, mais aussi contre leur propre organisation. Il faut rechercher les simplifications possibles et, sans doute, faire un peu plus confiance aux acteurs : mieux vaut les contrôler a posteriori que les enfermer dans des normes et des règles qui les empêchent d’agir.
M. le coprésident Pierre Morange. Messieurs, je vous remercie de la précision de vos réponses.
*
Audition de Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), à qui je souhaite la bienvenue. Dans le cadre de notre mission d’évaluation, de contrôle et de rationalisation de l’utilisation des deniers publics, nous voudrions vous entendre, madame la directrice générale, sur le fonctionnement interne de l’hôpital.
Nous souhaiterions que vous nous présentiez d’abord les missions et les responsabilités du Centre national de gestion, notamment depuis que la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires en a fait l’un des acteurs centraux du système de soins.
Mme Danielle Toupillier, directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. L’organisation et le fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ont été définis par un décret du 4 mai 2007. Installé officieusement le 1er septembre 2007, le Centre national de gestion est juridiquement, administrativement et financièrement compétent depuis le 13 décembre 2007, date de son premier conseil d’administration.
Le décret lui confiait, tout d’abord, la gestion des 36 000 praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans la fonction publique hospitalière. Depuis le 1er janvier 2009, notre compétence s’est étendue à la gestion de 6 000 praticiens hospitaliers à temps partiel, transférée des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Cela permet d’unifier, au niveau national, la gestion des praticiens hospitaliers, dans la perspective éventuelle, à terme, d’une fusion des deux statuts. Le Centre national de gestion a également en charge la gestion de 5 300 directeurs d’établissement, dont 3 500 directeurs d’hôpital et 1 800 directeurs d’établissements de santé, social et médico-social (D3S).
Il est en outre chargé de l’organisation de dix-sept concours nationaux, administratifs et médicaux, dont une partie par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre de la santé. Nous organisons notamment tous les internats – médecine, pharmacie, odontologie, médecine du travail, internat européen, internat à titre étranger –, le concours national de praticiens hospitaliers et toutes les procédures et concours concernant les praticiens à diplôme d’un pays hors Union européenne. Nous organisons également les cycles préparatoires et concours de directeur d’hôpital, de directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social, d’attaché d’administration hospitalière et de directeur de soins.
Le Centre national de gestion dispose de 109 emplois autorisés jusqu’à la fin de l’année 2009 et en comptera 115 en 2010 – par transfert de six emplois de l’administration centrale du ministère de la santé, en raison d’un transfert de missions de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et des conséquences de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Celle-ci nous confie la gestion nationale des directeurs des soins, soit environ un millier de personnes, dont la gestion relevait jusqu’ici de chaque établissement. Nous aurons également en charge la contractualisation et le suivi des étudiants qui, à partir de la deuxième année de médecine, s’engageront, en contrepartie du versement par l’État d’une allocation mensuelle, à exercer à l’issue de leur formation dans un territoire sous-médicalisé ou dans une spécialité connaissant des besoins de recrutement, pendant une période égale à celle pendant laquelle l’allocation leur aura été versée.
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière devra également gérer le dispositif de détachement des directeurs d’hôpitaux et des praticiens hospitaliers, innovation introduite par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et nécessaire à la modernisation de la gestion des ressources humaines. Les personnes pourront continuer à relever de la même fonction publique, du même établissement, voire du même poste, dans le cadre de contrats dont il reviendra au centre d’assurer le suivi.
En outre, la nomination des chefs d’établissement, qui restait de la compétence du ministre de la santé, relève désormais du Centre national de gestion, par délégation directe du ministre. En revanche, dans le cadre du nouveau dispositif concernant les plus hauts emplois hospitaliers, les directeurs de centres hospitaliers universitaires seront nommés par décret.
Quelques mots enfin sur notre budget. En 2007, année où nous avons travaillé dix-huit jours puisque le Centre national de gestion a été juridiquement compétent à compter du 13 décembre, nous avons consommé environ 17 millions d’euros. Notre budget a été de 40 millions en 2008 et de 46 millions en 2009. Pour 2010, il sera de 49 millions, du fait de l’impact de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui entraîne aussi la prise en charge par le centre des rémunérations des directeurs en congé spécial et des personnels affectés en surnombre dans les établissements hospitaliers.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui couvre l’essentiel du champ des personnels, joue un rôle charnière entre les établissements et, en amont, ceux qui décident des règles de gestion et ceux qui forment les personnels. Cette place centrale vous confère de fait des responsabilités réelles dans le fonctionnement des établissements de soins. Comment faites-vous pour assurer l’adéquation du système de sélection et de formation aux besoins des établissements ?
Mme Danielle Toupillier. Les processus de sélection et de formation ne relèvent pas de la compétence du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, si ce n’est pour l’organisation matérielle et logistique des concours. Nous avons néanmoins un rôle d’observateur et d’éclaireur. Ainsi, à partir de l’observation des dynamiques de carrière, des entrées et des départs, nous éclairons le ministère sur le nombre de places à mettre aux concours. En ce qui concerne la sélection, nous gérons les concours internes, avec l’organisation de cycles préparatoires. Par ailleurs, nous avons mis en place un dispositif de « mobilité et développement professionnel », animé par une équipe issue tant du secteur privé que du secteur public.
Les responsables du département de gestion, administrateurs civils formés aux ressources humaines, assurent une sélection de parcours professionnels. La commission des carrières, émanation de la commission administrative paritaire nationale, repère les personnes à haut potentiel qu’elle juge aptes à occuper les plus hauts emplois, qu’elles viennent de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Elle joue un rôle de sélection à partir des propositions de l’administration. On distingue trois niveaux d’agrément, le troisième qualifiant les professionnels capables de gérer les centres hospitaliers universitaires. La commission a également pour rôle de fixer, pour chaque poste publié, une short list des profils correspondants.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. On voit que la gestion quantitative des personnels relève d’une mécanique bien huilée. Mais comment le système se régénère-t-il sur le plan qualitatif ? Recherche-t-on, en amont, des profils susceptibles de correspondre aux besoins des établissements ?
Mme Danielle Toupillier. Nous nous efforçons de développer des partenariats. À la demande de la ministre, j’ai signé un accord impliquant les trois fonctions publiques et un groupe de partenaires privés, afin de sélectionner des personnes susceptibles de s’intégrer dans notre vivier de hauts potentiels.
Nous essayons également de favoriser la mobilité. Nous travaillons actuellement avec le Conseil d’État pour permettre à un directeur d’établissement de devenir conseiller de tribunal administratif ou de cour administrative d’appel. Nous allons très prochainement passer avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) un accord visant à établir des passerelles entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Nous avons également passé des accords avec la Mission de facilitation de l’accueil dans les fonctions publiques (MFAFP).
Ces partenariats doivent nous permettre d’échanger nos viviers, et donc de diversifier les parcours d’origine et les cultures professionnelles. Jusqu’à présent, le corps des directeurs a surtout été constitué d’anciens élèves des instituts d’études politiques. Mme la ministre a chargé deux conseillers généraux des établissements de santé de proposer une modification substantielle des épreuves du concours d’entrée à l’École des hautes études en santé publique, afin de mieux repérer les savoir-faire et les « savoir-être ». Les connaissances acquises dans le champ universitaire ou durant les parcours professionnels seraient complétées par des exercices pratiques dans des centres de formation adaptés.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Ce sont des méthodes de chasseurs de têtes…
Mme Danielle Toupillier. C’est un peu le rôle qu’on nous demande de jouer. Nous avons d’ailleurs déjà agréé des candidats venant de la fonction publique d’État, et nous en avons repéré d’autres qui sont issus de la fonction publique territoriale. En janvier 2009, nous avons signé, à la demande de la ministre, un accord avec des partenaires du secteur public et du secteur privé, qui doit permettre une plus grande mobilité et, à terme, un système de mise à disposition réciproque entre secteurs public et privé.
M. Jean-Luc Préel. On ne peut qu’être favorable à l’idée de repérer les hauts potentiels. Mais pour bien connaître le fonctionnement des établissements hospitaliers, je m’interroge sur la possibilité pour le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de vraiment tenir compte des compétences ou des incompétences. On sait très bien que les commissions paritaires servent surtout à défendre les collègues. Je connais ainsi des praticiens qui, depuis des années, sont payés à ne rien faire alors qu’ils auraient dû être soit considérés comme inaptes, soit sanctionnés. Comment concilier la défense des personnes et une véritable gestion des ressources humaines ?
M. le coprésident Pierre Morange. La question de M. Préel mérite d’être généralisée à l’organisation des établissements de soins mise en place par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui vise à ce qu’il y ait enfin « un pilote dans l’avion ». La situation déficitaire d’un certain nombre d’établissements a conduit les agences régionales de l’hospitalisation à mettre en place des plans de retour à l’équilibre financier. Comment les nouvelles obligations pesant sur les directeurs d’établissement s’articulent-elles avec la compétence générale dont vous parliez ?
Mme Danielle Toupillier. Nous n’avons que deux ans d’existence et nous héritons de situations passées. Nous essayons néanmoins de rendre toute leur efficacité aux procédures – qui n’étaient pas toujours engagées à bon escient.
Je pense notamment à la « recherche d’affectation », dispositif original créé en 2005, inspiré de ce qui avait été fait pour la fonction publique territoriale à la fin des années 1980. La moitié de notre budget est ainsi consacrée aux sorties du dispositif hospitalier, lorsque c’est légitime, ou à la prévention des risques. La recherche d’affectation est une position statutaire dans laquelle des directeurs d’établissement ou des praticiens hospitaliers sont rattachés administrativement au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pendant une période de deux ans maximum.
M. le coprésident Pierre Morange. Pourriez-vous nous préciser les critères de recours à ce dispositif ? La décision est-elle prise par le directeur d’établissement ou par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ?
Mme Danielle Toupillier. Nous nous sommes rendu compte que ce dispositif était souvent détourné de sa finalité, certains des cas qui nous étaient signalés relevant plutôt d’un suivi médical, d’autres d’une procédure disciplinaire. Les établissements n’ont malheureusement pas toujours assuré la « traçabilité » des dossiers, et certaines des demandes qui nous sont adressées ne réunissent pas les conditions requises.
À la création du dispositif, il était bien clair pour les autorités de tutelle – ministère de la santé, ministère du budget, contrôle général économique et financier, direction de la sécurité sociale, qui le finance à hauteur de 90 % – qu’il ne se substituait à aucune autre procédure, et qu’il fallait, le cas échéant, utiliser des procédures plus adéquates, notamment disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle.
En ce qui concerne les praticiens hospitaliers, en 2008 nous avons réuni trois fois le conseil de discipline et j’ai, au nom de la ministre, prononcé deux révocations. Nous avons également infligé, sans procédure disciplinaire, deux blâmes et deux avertissements. En 2009, nous avons réuni deux fois le conseil de discipline et prononcé une réduction d’ancienneté de deux ans et trois blâmes.
L’insuffisance professionnelle des praticiens hospitaliers n’a donné lieu à aucune procédure en 2008. En 2009, nous avons engagé à ce titre deux procédures, actuellement en cours. Nous ouvrons la voie en ce domaine, la notion étant très mal définie.
Nous avons également pris des mesures disciplinaires à l’encontre de directeurs d’établissement. En 2008, nous avons prononcé un blâme et une exclusion de fonction de trois mois, qui relève des sanctions du troisième groupe. En 2009, quatre directeurs d’hôpital ont fait l’objet de procédures disciplinaires, qui ont abouti à une mise à la retraite d’office, une rétrogradation et deux révocations, soit les sanctions les plus graves. À l’encontre des directeurs d’établissements de santé, social et médico-social, nous avons prononcé deux avertissements et un abaissement d’échelon.
S’agissant de la recherche d’affectation, les délais sont aujourd’hui extrêmement rapides. Le placement d’un praticien hospitalier en position de recherche d’affectation est décidé après avis motivé de la commission médicale d’établissement, du conseil exécutif de l’établissement public de santé et de la commission statutaire nationale. Pour les directeurs, les demandes de mise en recherche d’affectation d’office émanent le plus souvent de l’agence régionale de l’hospitalisation, à la suite d’une restructuration.
La demande peut aussi être le fait de l’intéressé lui-même, qui souhaite changer d’environnement professionnel. Il s’agit alors pour le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d’accompagner un processus de reconversion. À l’heure actuelle, nous accompagnons 206 personnes et nous traitons 45 recherches d’affectation, dont une vingtaine concerne des directeurs d’établissement ; dans la moitié des cas, c’est à l’initiative des administrations, et dans l’autre à l’initiative des professionnels eux-mêmes. Bien entendu, notre premier rôle est d’apporter notre appui aux établissements.
M. Jean-Luc Préel. Tout le monde souhaite avoir les meilleurs aux meilleurs postes. Mais de mon point de vue, le statut même de praticien hospitalier, avec ses changements d’échelon automatiques, n’est pas le plus susceptible de promouvoir le mérite.
À mes débuts de chef de service, j’ai naïvement donné de bonnes notes à ceux que je jugeais bons et de mauvaises aux autres. On m’en a dissuadé, en me disant que si tous ne recevaient pas la même note, les commissions corrigeraient ma notation. J’ai connu le cas d’un praticien hospitalier chargé de l’aide médicale d’urgence qui ne s’entendait avec personne, ni avec les ambulanciers privés, ni avec les pompiers. Mais les membres de la commission médicale d’établissement (CME), comme de bien entendu, n’ont pas voulu approuver une sanction contre un collègue. Ce que voyant, l’agence régionale de l’hospitalisation a décidé de le rémunérer à ne rien faire, et cela dure depuis dix ans… Je connais d’autres cas où les syndicats se sont opposés aux sanctions.
Je ne vois pas comment un système fonctionnant avec des commissions paritaires pourrait assurer réellement la prise en compte des mérites. Je souhaiterais qu’on puisse mieux récompenser les bons et écarter les incapables autrement qu’en les nommant conseillers généraux !
Mme Danielle Toupillier. Il est désormais possible d’assurer la « traçabilité » des faits, de constituer des dossiers. La jurisprudence a souvent été sévère à l’égard de l’administration, mais nous avons maintenant la matière pour justifier les sanctions prises.
Les praticiens hospitaliers sont aujourd’hui régis par un statut unique, quelle que soit leur spécialité. Leur carrière obéit à un système d’avancement d’échelon à l’ancienneté. Mais leur rémunération comporte diverses primes et indemnités tenant compte de sujétions particulières – postes difficiles ou isolés, gardes, astreintes… ; elle varie donc en fonction de leurs obligations et des lieux où ils exercent.
Dans le cadre du nouveau dispositif prévu par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires – permettant aux praticiens hospitaliers d’être détachés sur un contrat de clinicien hospitalier –, la rémunération de ces cliniciens comprendra des éléments variables en fonction d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, fixés par le directeur d’établissement en concertation avec la communauté médicale.
Il est vrai que l’évaluation des praticiens hospitaliers se résume, comme pour toute la fonction publique, à une notation comportant un élément chiffré et des appréciations. Mais le système évolue dans les trois fonctions publiques. Dans la fonction publique hospitalière, la part variable de la rémunération des directeurs d’hôpital, depuis août 2005, et des directeurs d’établissements de santé, social et médico-social depuis décembre 2007, modulée dans une fourchette de plus ou moins 20 % du montant maximum prévu pour la classe et l’emploi auxquels appartient le bénéficiaire, dépend étroitement de l’évaluation. Si l’autorité ayant le pouvoir d’évaluation décide de diminuer cette rémunération, elle doit le justifier dans un rapport. Même si ces cas sont rares, certains directeurs voient leur carrière ralentie.
J’ai suivi l’évolution des commissions paritaires. La nouvelle gouvernance hospitalière mise en place par l’ordonnance du 2 mai 2005 et confortée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a changé le regard des directeurs et des praticiens hospitaliers, notamment des responsables de pôles et des présidents de commissions médicales d’établissement. Nous nous félicitons aujourd’hui d’avoir affaire à des communautés hospitalières très responsables, qui ne couvrent pas la gestion de leurs pairs quand c’est illégitime. Même s’il ne s’agit pas d’un changement massif, nous constatons un sursaut : toutes les sanctions que nous avions décidées, à l’exception de deux, ont été votées à l’unanimité des commissions administratives paritaires, qu’elles aient concerné des directeurs d’établissement ou des praticiens hospitaliers – y compris les révocations. Les cas de « placardisation » sont de moins en moins tolérés, tant des professionnels non médicaux que des communautés médicales. La T2A a modifié considérablement les stratégies d’établissement.
M. le coprésident Pierre Morange. Parallèlement à la stratégie de repérage des hauts potentiels, ne faudrait-il pas une stratégie de repérage des faibles potentiels ? Ne pas se donner les moyens de les identifier, n’est-ce pas mettre en danger nos concitoyens ?
En dépit de faits particulièrement surprenants relevés par les services compétents de l’État, des directeurs d’établissement n’ont pas pu obtenir le départ des cadres hospitaliers en cause. Que vous inspire cette contradiction entre l’impuissance de directeurs d’établissement à l’égard de collaborateurs défaillants et l’importance de la mission dont il s’agit ?
Mme Danielle Toupillier. Je mesure d’autant plus l’importance de ce que vous dites que j’ai moi-même en tête certains cas. Le repérage des faibles potentiels est un enjeu majeur. Parmi les 206 directeurs d’établissement dont nous assurons le suivi, certains sont à nos yeux peu aptes à cette fonction. Nous les encourageons à passer des concours de niveau inférieur et nous recherchons les moyens de les faire sortir de l’institution hospitalière, par la voie du détachement ou de la mise en disponibilité.
Certains d’entre eux nous ont demandé de leur propre chef de sortir de l’institution par la voie de la mise en recherche d’affectation, alors qu’ils étaient susceptibles de relever d’une procédure disciplinaire ; nous nous attachons dans ce cas à faire toute la lumière nécessaire.
Je peux citer l’exemple d’un directeur adjoint de centre hospitalier universitaire, dont le cas avait été signalé par trois directeurs généraux successifs. Dans le cadre d’un plan de retour à l’équilibre, ce centre hospitalier universitaire a décidé de supprimer des emplois de direction. Cela nous a permis de soumettre le cas de ce directeur adjoint, qui depuis longtemps ne remplissait plus ses fonctions, à la commission administrative paritaire. Le dossier étant proposé dans le cadre d’une restructuration, il réunissait les conditions pour la mise en recherche d’affectation – qui sinon aurait été considérée comme un détournement de procédure et une sanction déguisée, motif qui a déjà valu à l’État de se faire condamner.
Au moment de la création du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, le cadre d’utilisation de la mise en recherche d’affectation a été bien défini. Nous sommes aujourd’hui en situation d’éclairer les établissements sur le choix de la procédure la plus adaptée.
M. le coprésident Pierre Morange. Qu’il y ait mise en recherche d’affectation ou procédure disciplinaire, est-il possible que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière avalise des promotions ou des primes de carrière pour des personnes ayant fait l’objet de rapports défavorables des services compétents de l’État ?
Mme Danielle Toupillier. Il est vrai que deux ou trois cas ont fait l’objet d’une attention particulière, mais la plupart du temps nous émettons un avis défavorable aux recours sur les évaluations. Lorsque nous avons constaté que celles-ci comportaient des nuances plutôt favorables, nous avons suivi la logique de l’autorité d’évaluation ; mais c’est cette dernière, non le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou le ministre, qui décide du montant de la prime et qui peut réformer sa décision. C’est la logique de la gouvernance hospitalière.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. De quelle marge de manœuvre dispose le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour la rémunération des praticiens hospitaliers et des cadres de direction, tant en matière de rémunération de base que de rémunération complémentaire, voire d’intéressement ?
M. Jean-Luc Préel. Je voudrais compléter la question. En application de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les agences régionales de santé (ARS) pourront décider de la part variable de la rémunération des directeurs ; comment les choses se passeront-elles avec le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ?
Mme Danielle Toupillier. Nous n’avons pas de marge de manœuvre : le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’a aucune compétence en matière de rémunérations. Actuellement – la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires va apporter des modifications –, les chefs d’établissement sont nommés par le ministre et, par délégation du ministre, par le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Les directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires sont évalués par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, au nom du ministre. Les autres directeurs d’établissement sont évalués par l’agence régionale de l’hospitalisation, qui fixe le montant des primes. Quant aux directeurs adjoints, ils sont évalués par les directeurs d’établissement. Leur rémunération est assurée par l’établissement employeur, conformément aux textes réglementaires en vigueur, qui fixent la part fixe et la part variable.
Personnellement, je milite depuis longtemps en faveur de l’intéressement, qu’il soit collectif ou individuel. Mais je reconnais que sa mise en place est difficile. Le ministère de la santé avait créé par arrêté un dispositif expérimental de rémunération complémentaire des chirurgiens et des psychiatres, cette rémunération variant en fonction de la réalisation de certains objectifs, dans la limite de 15 %. Très peu d’établissements ont adhéré à ce dispositif.
Les praticiens hospitaliers n’étant pas des fonctionnaires, mais des agents publics sous statut national d’emploi, essentiellement régis par des dispositions réglementaires, tandis que les autres personnels relèvent de dispositifs législatifs, nous ne disposons pas de dispositifs juridiques permettant d’intéresser individuellement les personnels, hormis ceux prévus par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : je pense notamment à la possibilité de détacher sur contrat des praticiens hospitaliers ou des directeurs, qui pourra donner lieu à une forme d’intéressement en fonction de l’engagement et de la prise de risque.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Dans le dispositif expérimental que vous avez cité, quels objectifs a-t-on retenus ?
Mme Danielle Toupillier. Pour les chirurgiens, ils ont été définis en concertation avec le Conseil national de la chirurgie. C’est une combinaison d’objectifs quantitatifs, tels que le taux d’infections nosocomiales ou le nombre de reprises sur une intervention primaire, et d’objectifs qualitatifs – les plus nombreux. Ils sont orientés vers la mesure de la performance de la pratique professionnelle, à partir de protocoles fixés par les sociétés savantes et de comparaisons européennes et internationales.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Quels peuvent être les critères pour les personnels de direction ?
Mme Danielle Toupillier. Pour les adjoints, ils sont fixés par le chef d’établissement. Pour les directeurs d’établissement, ils sont déterminés par l’autorité de tutelle – direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou agence régionale de santé.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La santé financière de l’établissement en fait-elle partie ?
Mme Danielle Toupillier. Ce n’était pas le cas avant 2005 et la réforme du statut des directeurs d’établissement. Depuis, des critères tels que l’état d’avancement du plan de retour à l’équilibre ou la santé financière de l’établissement figurent explicitement au nombre des critères d’évaluation et servent de fondement à certains recours. Y figurent également des appréciations sur le management, la capacité à arbitrer, à décider, à contrôler.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. C’est donc une appréciation générale de la manière de servir, mais il est un peu paradoxal de lier l’intéressement à la mise en œuvre d’un plan de retour à l’équilibre…
M. le coprésident Pierre Morange. Madame la directrice, nous vous remercions de votre contribution à nos travaux.
*
AUDITIONS DU 17 DÉCEMBRE 2009
Audition de Mme Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des sports.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Vous connaissez la MECSS et la thématique qu’elle a choisie, le fonctionnement interne de l’hôpital. Nous nous intéressons à un certain nombre d’expériences de terrain dans le but de formuler des préconisations générales tendant à améliorer l’efficience des établissements et à optimiser l’utilisation des fonds publics.
En compagnie de Jean Mallot, coprésident de la MECSS et rapporteur sur ce sujet, je vous propose de commencer par un exposé synthétique.
Mme Anne-Marie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des sports. La question de l’efficience des établissements hospitaliers, et plus généralement de l’ensemble des « offreurs » de soins, est au cœur des préoccupations de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS). Nous devons, en effet, assurer la pérennité de notre système de santé, de nature solidaire, en garantissant son équilibre financier à terme.
Je vais essayer d’apporter des réponses aussi factuelles que possible aux questions que vous m’avez transmises, mais il ne me sera pas forcément aisé d’être concise, car ces questions appellent un certain nombre de développements.
La première question portait sur l’existence d’un tableau de bord des établissements hospitaliers. Un tableau de bord de l’efficience hospitalière a effectivement été mis en place en 2007 par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. Renseigné en ligne, il est accessible sur le site du système national d’information sur l’hospitalisation (SNATIH) qui est géré par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation. Il comporte une vingtaine d’indicateurs permettant de situer la performance de chaque établissement, sous le rapport aussi bien de la qualité des soins que de l’efficience – les deux choses allant d’ailleurs généralement de pair.
Ces indicateurs portent aussi bien sur l’insertion de l’établissement dans son environnement – parts de marché, positionnement stratégique –, que sur ses finances – capacité d’autofinancement, taux d’endettement, déficit –, sur son organisation, sur la qualité et sur la sécurité. Après avoir pris en compte l’indice composite d’activité de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN), nous avons pour ambition d’intégrer progressivement l’ensemble des indicateurs publiés par la Haute Autorité de santé (HAS) et gérés par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, tels que la tenue du dossier des patients et la sécurité anesthésique. Ce sont autant d’éléments qui permettront de vérifier l’efficience des établissements de santé et la qualité des soins prodigués.
Selon les sondages que nous avons réalisés, certains établissements ne fournissent pas les données permettant de calculer automatiquement les indicateurs du tableau de bord de performance.
M. le coprésident Pierre Morange. Quels sont ces établissements ?
Mme Anne-Marie Podeur. Lors d’entretiens avec la direction de certains centres hospitaliers universitaires (CHU) ou avec la direction de certains établissements en difficulté, nous nous apercevons parfois que les indicateurs de productivité, très révélateurs en matière d’organisation interne, ne sont pas remplis. Nous rappelons alors l’obligation qui est faite de renseigner les données, et j’ai demandé à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation de relancer les établissements concernés. Ce tableau de bord est, en effet, très instructif : dans chaque catégorie, chaque établissement est classé dans un quartile, allant du plus performant au moins performant. Nous avons fait part des résultats à la Cour des comptes lorsqu’elle a réalisé son travail d’enquête.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Quelle est la proportion des établissements ne renseignant pas les indicateurs ?
Mme Anne-Marie Podeur. Je n’ai pas connaissance du chiffre exact, mais je peux demander à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, si vous le souhaitez, de calculer le pourcentage des indicateurs de productivité – les plus intéressants – qui ont été effectivement renseignés pour 2008.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Ce serait effectivement très utile. Comme vous le savez, nous avons travaillé sur quelques cas précis, et nous essayons de faire le partage entre les difficultés qui pourraient s’expliquer par un dysfonctionnement ou par une spécificité locale et celles qui pourraient donner lieu à des préconisations générales, valables pour l’ensemble des établissements.
C’est pourquoi nous souhaitons non seulement vérifier auprès de vous un certain nombre de constats que nous avons faits au cours des auditions, mais aussi mieux comprendre comment se réalise l’équilibre entre l’autonomie de gestion des établissements et la nécessaire coordination qu’exercent les différentes autorités de tutelle, dont vous constituez le « chapeau ».
Mme Anne-Marie Podeur. Disons la tête de réseau…
Je vous fournirai les chiffres de l’année 2008, et vous pourrez également consulter directement le système national d’information sur l’hospitalisation.
Le tableau de bord n’ayant été créé qu’en 2007 – nous en sommes à sa deuxième édition –, il faut un peu de temps pour que l’acculturation se fasse. Mais il faudra essayer d’aller très vite.
Nous disposons également d’autres instruments, tels que le suivi des établissements en difficulté financière. Nous suivons 238 établissements engagés dans une procédure de retour à l’équilibre, dont 165 ont déjà signé un contrat de retour à l’équilibre financier (CREF) et font, à ce titre, l’objet d’un tableau de bord spécifique, réalisé par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation.
M. le coprésident Pierre Morange. Les services placés sous votre responsabilité et les autorités de tutelle au niveau régional ont fait état de progrès à réaliser en matière de saisie des informations et d’instruments de mesure, étant entendu qu’il n’est pas forcément nécessaire de disposer d’une comptabilité analytique très pointue dans les établissements de petite taille. Ces interlocuteurs ont également insisté sur la nécessité de moderniser le parc informatique afin d’améliorer la qualité de l’information. Quel est votre sentiment à ce sujet ?
Mme Anne-Marie Podeur. La réalisation des contrats de retour à l’équilibre financier nécessite en particulier l’existence d’une bonne comptabilité analytique. Une enquête diligentée au niveau national en 2008 a révélé que 65 % des établissements publics de santé, hors hôpitaux locaux, qui sont des petites structures, et 100 % des CHU déclaraient s’être dotés d’outils à cet effet.
Cela étant, il faut être conscient qu’il existe différents niveaux de comptabilité analytique. Le premier niveau consiste à produire un compte administratif retraité, c’est-à-dire à procéder à des imputations à peu près correctes des charges générales sur les pôles d’activité. Le second niveau se caractérise par l’utilisation de la base « d’Angers » qui permet de produire des ratios sur des unités d’œuvre bien déterminées et de procéder à un parangonnage, autrement appelé benchmarking. Seuls atteignent le troisième niveau les établissements, peu nombreux, disposant d’un tableau « coût case-mix » (TCCM) et susceptibles de participer, à ce titre, à l’étude nationale des coûts – je les invite à le faire, car cela nous permettrait d’améliorer notre échantillon et de mieux cibler les évolutions de la tarification à l’activité.
Un plan d’action 2010-2011 sera mis en œuvre à la faveur d’une nouvelle organisation de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, qui est aujourd’hui en cours de définition et devrait être effective en mars prochain. L’objectif est d’harmoniser et de mettre en cohérence l’ensemble des outils en publiant une nouvelle édition du guide de comptabilité analytique. Datant de 1997, ce guide a certes été révisé en 2004, puis en 2008 pour tenir compte de la tarification à l’activité, mais nous ne sommes pas encore allés très loin dans l’analyse méthodologique. Cet exercice nous permettra de généraliser la comptabilité analytique. Des différences de niveau subsisteront entre les établissements, mais ceux-ci devront désormais aller plus loin que le seul retraitement comptable.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous avez indiqué que 65 % des établissements ont mis en place une comptabilité analytique plus ou moins perfectionnée. Quelle est la répartition des établissements selon les trois niveaux que vous avez distingués ?
Mme Anne-Marie Podeur. Je ne suis pas en mesure de vous le dire à l’instant, mais je vous communiquerai cette information si vous le souhaitez.
M. Dominique Tian. Certains pays européens paraissent très en avance sur nous : après avoir procédé à une rationalisation des programmes informatiques, nos voisins allemands ont ainsi développé un système assez original qui consiste à sous-traiter à un organisme central, privé, la gestion analytique d’un certain nombre d’établissements. En revanche, il existe aujourd’hui, dans les hôpitaux français, entre quinze et soixante-dix programmes informatiques distincts et gérés par des personnes différentes, ce qui ne facilite pas le récolement des données. Comptez-vous vous inspirer du modèle allemand pour avancer ?
Nous avons été très impressionnés par la part des actes qui est aujourd’hui non facturée – entre 5 et 10 % du total dans le meilleur des cas. Je rappelle que la délivrance d’une facture de sortie à chaque malade est sans cesse repoussée de projet de loi de financement de la sécurité sociale en projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Mme Anne-Marie Podeur. Le plan d’action 2010-2011 prévoit une redéfinition des méthodes : la révision du guide de comptabilité analytique fournira une ossature commune aux différents éditeurs de logiciels et permettra ainsi d’éviter la multiplication des méthodes comptables.
L’exemple allemand est très intéressant – je lirai d’ailleurs vos conclusions sur ce sujet avec grand intérêt –, mais nous n’avons pas suivi le même chemin : nous ne faisons qu’héberger des données transitant par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, sans les gérer de façon centralisée. L’intérêt d’un système de comptabilité analytique tient beaucoup à la faculté donnée aux établissements et aux pôles d’activité de se l’approprier – la déclinaison de la comptabilité analytique par pôle devant tenir une place essentielle à l’avenir.
Afin que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), soit en mesure d’effectuer un contrôle ex ante, avant paiement, et non pas seulement un contrôle ex post comme c’est le cas aujourd’hui, il convient de développer la facturation directe. Plusieurs raisons contribuent à expliquer qu’elle ne soit aujourd’hui effective que dans les établissements privés, et non dans les établissements publics. Tout d’abord, les volumes ne sont pas comparables : les caisses primaires d’assurance maladie, qui traitent aujourd’hui 6,5 millions de factures, devront en gérer 60 millions, ce qui nécessitera une dématérialisation complète des procédures. Il existe en outre, au sein de l’hôpital public, un plus grand nombre d’acteurs, réalisant des actes beaucoup plus divers que dans le secteur privé. Une autre difficulté, tout aussi essentielle, résulte de la multiplicité des logiciels de gestion comptable.
Pour sortir de la situation actuelle – la facturation directe a été reportée à plusieurs reprises, comme vous l’avez indiqué –, nous allons mener une expérimentation sous la conduite d’un chef de projet rattaché à ma direction, en liaison directe avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et avec les éditeurs de logiciels. Nous souhaitons engager cette expérimentation dès 2010 en vue d’une généralisation ultérieure. Il faut rappeler que le rapport – très nuancé – remis l’an dernier par l’inspection générale des affaires sociales et par l’inspection générale des finances a pointé un certain nombre de difficultés techniques, résultant non seulement de la diversité des logiciels employés mais aussi de l’absence d’interopérabilité entre les systèmes d’information du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et du Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM).
Il faudra mener une réflexion approfondie, en toute objectivité, pour vérifier si notre système, qui consiste à effectuer une valorisation à partir du programme de médicalisation des systèmes d’information, n’est pas finalement opérant, étant entendu qu’il empêche tout contrôle de facturation ex ante, ce qui pose un problème à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Nous allons donc travailler ensemble sur ce sujet en vue de retenir, au terme de l’expérimentation, un système réaliste, tant du point de vue de l’efficience que de celui de la gestion des ressources humaines – il ne faudrait pas aggraver les coûts de l’Assurance maladie.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous avez rappelé les diverses difficultés auxquelles se heurte la facturation : la multiplicité des logiciels utilisés et celle des modes de saisie des données, à quoi s’ajoutent probablement des biais dans le codage – nous y reviendrons peut-être plus tard. Mais il y a aussi un problème en amont : dans certains établissements, une part variable des actes échappe à toute facturation, ce qui réduit d’autant leurs ressources. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Mme Anne-Marie Podeur. C’est toute l’histoire de nos hôpitaux. Le système de la dotation globale, qui consistait en un pilotage en fonction des dépenses, avec une « rallonge » régulièrement accordée en fin d’année, a pu conduire à ne pas être très vigilant en matière de facturation.
Alors que la chaîne de facturation est un process sous contrôle dans les établissements privés, tout l’intérêt de la facturation directe étant de parvenir à l’exhaustivité, ces préoccupations sont récentes au sein des établissements publics : c’est la tarification à l’activité qui a conduit à une plus grande vigilance en matière de facturation. Jusqu’à une période récente, les meilleurs éléments du personnel n’étaient pas affectés à ce genre de tâches. Nous allons donc devoir réaliser un saut qualitatif en matière de qualification et de formation des personnels pour assurer la facturation et le recensement de l’information.
Le programme de médicalisation des systèmes d’information permet d’arriver à un taux d’exhaustivité proche de 100 % dans tous les établissements. Cela étant, il suffit de voir le temps d’adaptation que requiert le changement d’une classification pour prendre conscience des difficultés. Nous avons constaté, en 2007, un creux dans les consultations externes quand nous avons demandé, pour la première fois, un appariement des données de l’activité médicale et des données administratives pour chaque bénéficiaire : il a fallu que les établissements revoient leur process pour parvenir à atteindre cet objectif. Toute évolution nécessitera un recalibrage.
Je n’ai pas connaissance des chiffres qui ont été cités en matière de non-facturation, et j’aimerais bien savoir à quoi ils correspondent exactement.
M. le coprésident Pierre Morange. Les responsables des agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et des chambres régionales des comptes que nous avons auditionnés nous ont indiqué que les insuffisances constatées dans la facturation ne les étonnaient pas : loin d’être le seul fait de certains établissements présentant des dysfonctionnements spectaculaires, ce problème serait fréquent.
Il résulte soit de l’absence d’identification des patients, soit du non-recouvrement de factures en raison de difficultés informatiques ou de problèmes d’interopérabilité. Ajoutons à cela que le financement actuel des hôpitaux repose sur un état statistique fourni aux agences régionales de l’hospitalisation, et non sur un retraitement par l’Assurance maladie des facturations, ce qui n’est sans doute pas sans incidence.
Il en résulte, au total, des pertes de recettes comprises entre 5 et 15 % des dépenses.
Mme Anne-Marie Podeur. Si c’était avéré, nous pourrions combler les déficits des hôpitaux !
M. le coprésident Pierre Morange. Une telle hémorragie financière a de quoi laisser perplexe. Elle contribue certainement aux difficultés des 238 hôpitaux que vous avez évoqués – cela représente tout de même près d’un quart du parc hospitalier.
Les auditions nous ont permis de constater que des progrès considérables restent à faire dans le domaine des outils de mesure, notamment en ce qui concerne la comptabilité analytique, ainsi que dans le domaine de la facturation. Des audits réalisés par les services de l’État en charge du contrôle de légalité ont également révélé des dysfonctionnements spectaculaires en matière de passation des marchés publics, lesquels nécessitent, selon les responsables que nous avons auditionnés, une grande maîtrise de la part des personnels et donc une formation adaptée.
Ne pensez-vous qu’une action particulière s’impose, dans ces différents domaines, à l’égard des 238 hôpitaux en difficulté financière ? Il y a peut-être des marges de manœuvre budgétaires à exploiter.
Mme Anne-Marie Podeur. Je crois qu’il faut distinguer clairement les objectifs et l’apport des différents outils.
L’objectif de la comptabilité analytique est d’assurer la traçabilité des coûts et de favoriser le parangonnage : il s’agit d’identifier les gains de productivité potentiels par rapport à d’autres établissements appartenant à une même catégorie. C’est une question d’analyse et de constat.
La chaîne de facturation est un autre sujet, qui concerne la capacité des établissements à recouvrer les recettes correspondant à une activité donnée.
Une première difficulté tient au codage du programme de médicalisation des systèmes d’information. Des avancées considérables ont été réalisées dans ce domaine, mais il y a encore des progrès à faire dans certains établissements, où l’on pourrait améliorer l’exhaustivité et la qualité du codage. Les problèmes constatés résultent d’une structuration ou d’une professionnalisation insuffisante des équipes concernées, et c’est en général dans les établissements en difficulté que des progrès peuvent être réalisés, comme vous l’avez suggéré. Cela étant, je mets en garde les établissements contre les risques de surcodage.
Une fois que la traçabilité de l’activité est assurée, il faut réaliser un appariement avec des données administratives, lesquelles doivent avoir été enregistrées au préalable. C’est là un deuxième niveau.
En troisième lieu, les établissements doivent être en mesure de facturer à des tiers – organismes complémentaires ou usagers – les restes à charge, notamment le forfait de 18 euros applicable aux actes dont le coefficient est supérieur à K50. Comme il s’agit de très petites sommes, cela implique une grande mobilisation et une bonne structuration de la chaîne de facturation.
Une quatrième exigence, qui présente un intérêt manifeste aussi bien pour l’ordonnateur que pour le comptable, est la capacité à recouvrer les créances. Chacun sait qu’il s’agit d’un sujet particulièrement douloureux dans certains départements où la précarité est plus importante qu’ailleurs. En tout état de cause, les créances irrécouvrables doivent être considérées comme telles : il ne faut pas les conserver dans la comptabilité comme des recettes à percevoir aux calendes grecques.
J’en viens aux marchés publics, dont le contrôle de légalité relevait jusqu’à présent de la responsabilité des préfets et n’incombait pas directement aux agences régionales de l’hospitalisation. Certains marchés publics étant particulièrement complexes, ce contrôle est essentiel, mais le contrôle de régularité exercé par le comptable ne l’est pas moins. Et surtout, les vrais gains d’efficience portent sur les politiques d’achat : il faut définir les besoins, accepter une limitation des référencements, puis procéder à des groupements de commandes afin d’obtenir les meilleurs prix auprès des fournisseurs.
M. le coprésident Pierre Morange. J’en suis bien d’accord. C’est pourquoi je suggérais que les 238 établissements connaissant actuellement des difficultés financières fassent l’objet d’une attention particulière sur ces différents volets : les outils de mesure, la facturation, ainsi que le respect du code des marchés publics. Il pourrait être utile de réaliser des audits de contrôle portant non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond.
Mme Anne-Marie Podeur. Tout à fait.
M. le coprésident Pierre Morange. Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ayant mis en évidence des dysfonctionnements dans certains cas, on pourrait envisager une approche plus sélective, en fonction des déficits constatés.
Mme Anne-Marie Podeur. Je rappelle que l’élaboration des contrats de retour à l’équilibre est fondée sur un diagnostic. Lorsque les dépenses du titre III, notamment certains achats externes, sont plus élevées que la moyenne, il faut réagir. Mais cela ne dispense pas de prendre en considération d’autres dépenses, notamment les dépenses médicales du titre II. La réflexion à mener en matière de référencement et l’implication des médecins dans les prescriptions sont, en effet, au moins aussi importantes que la bonne application du code des marchés publics. En général, les prix sont quasiment administrés, ce qui ne permet pas de réaliser des gains considérables, sauf dans quelques domaines particuliers, et le marché est parfois constitué de quasi-oligopoles – je pense notamment à la gaze médicale.
M. Dominique Tian. L’une des spécificités du secteur hospitalier public en matière d’achats publics est d’avoir peu recours à la sous-traitance. Or, cela peut être un moyen de rétablir un peu de concurrence et de dégager des marges.
Nous avons appris, au cours des auditions, que l’activité des CHU est pour 80 % celle d’hôpitaux généraux. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
Mme Anne-Marie Podeur. Les CHU n’ont pas été exclusivement conçus pour exercer une activité de recours : ce sont également des établissements de santé de proximité. Certains pays ont fait le choix d’une gradation complète des activités, faisant appel à des entités juridiques différentes, mais ce n’est pas la voie que nous avons empruntée. Les CHU exercent, en effet, trois missions : les soins, l’enseignement et la recherche.
Ces deux dernières activités sont, pour l’essentiel, financées par les dotations au titre des missions d’enseignement, de recherche, de référence et innovation (MERRI), pour un montant de deux milliards d’euros. Selon une étude réalisée par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, les activités de recours relevant spécifiquement des CHU représentent environ 15 % de leur activité. Le chiffre est d’ailleurs plus faible si l’on considère seulement le nombre des séjours, peu nombreux, mais très hautement valorisés, car exigeant un environnement médico-technique très sophistiqué, et donc coûteux.
Il faut accepter cette situation et en tirer toutes les conséquences : pour une fraction importante de leur activité, les CHU doivent répondre aux mêmes impératifs d’efficience que les autres hôpitaux, leurs missions d’enseignement étant compensées par le mécanisme des dotations MERRI. Pour les activités de recours, nous devons veiller à bien prendre en compte le surcoût de l’environnement dans certains cas, notamment les greffes et certains traitements très spécifiques, tels que les curiethérapies. Le principe de gradation des soins implique d’offrir aux patients ce que l’on peut faire de mieux dans un nombre limité d’établissements en s’efforçant d’amortir raisonnablement les surcoûts.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Merci pour toutes les réponses que vous venez d’apporter sur ces différents sujets. Je dois avouer, pour ma part, que je suis frappé par la lenteur de certaines évolutions, notamment quand il s’agit de généraliser les bonnes pratiques : on peut se demander si l’on ne pourrait pas aller un peu plus vite dans certains cas.
Nous sommes bien sûr intéressés par tout document complémentaire que vous pourriez nous faire parvenir afin de continuer à nourrir notre réflexion : nous devrons étayer nos recommandations par des éléments incontestables.
J’aimerais maintenant revenir sur les ressources humaines, qui constituent l’un des principaux coûts à l’hôpital – près de 70 % des charges. En la matière, il existe de grandes différences selon les établissements, les pôles, mais aussi les activités concernées. La Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH), désormais intégrée dans l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), et la Cour des comptes ont établi des comparaisons qui appellent l’attention. Comment expliquer ces différences et comment améliorer la situation ?
M. le coprésident Pierre Morange. Et surtout selon quel calendrier ?
Mme Anne-Marie Podeur. Je rappellerai tout d’abord que nous avons remis au Parlement plusieurs rapports sur l’application de la tarification à l’activité, notamment sur les dotations MERRI. Les évolutions vous paraissent peut-être lentes, mais elles sont en réalité rapides si on les rapporte à celles des décennies précédentes. Le rythme s’accélère singulièrement aujourd’hui.
En ce qui concerne le titre I des dépenses hospitalières, à savoir les ressources humaines, il y a effectivement des écarts de productivité, qui font l’objet d’une analyse dans le cadre des tableaux de bord. La direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, qui a été chargée de piloter la mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers, puis d’agir en tant que chef de file de la commande publique à l’égard de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, ne s’est pas contentée d’établir des constats : elle a également été à l’origine d’un certain nombre d’initiatives – je pense à « Horizon blocs », mais aussi aux travaux portant sur les consultations externes et sur l’organisation du temps de travail médical.
Il faut maintenant aller plus loin en généralisant la collecte de données et en utilisant celles-ci concrètement : nous devons parvenir à établir des indicateurs d’encadrement – et non des normes. Le piège serait de raisonner en termes de lits, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. Certains lits étant vides, il faut prendre en compte la productivité, c’est-à-dire le ratio entre les équivalents temps plein employés et l’activité.
La réduction des écarts passe par la redéfinition de l’offre hospitalière sur un territoire donné, afin d’éviter les doublons. À l’échelle des établissements, il faut assurer une bonne structuration des pôles d’activité, dont l’existence ne traduit pas une remise en cause de la structuration, retenue dans une approche médicale, en entités internes, en services ou en unités fonctionnelles ; c’est un moyen de mutualisation, en particulier pour les effectifs soignants.
Au sein de ces pôles et de ces unités, nous avons besoin d’une formation des cadres infirmiers à la gestion des plannings : il faut en effet raisonner en termes de « présentéisme », veiller à adapter la présence des soignants à l’intensité des soins à prodiguer au fil de la journée – celle-ci est variable, sauf dans le cas de certaines unités travaillant en soins continus, comme les urgences, les services de réanimation et quelques services de soins critiques.
La structuration des séjours importe également : il est possible de réaliser des gains de productivité considérables en développant la prise en charge ambulatoire et l’hospitalisation de semaine à la place de l’hospitalisation conventionnelle.
Pour redresser la situation d’un établissement en difficulté, le plan de retour à l’équilibre ne doit pas se contenter de prévoir quelques actions à réaliser en parallèle des économies : il faut définir un plan d’action et une méthode pour l’appliquer. Il ne saurait exister de bon contrat de retour à l’équilibre, produisant des résultats proportionnés aux enjeux, sans des actions d’appui diligentées par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ou pilotées demain par les agences régionales de santé – celles-ci devront comporter des pôles d’efficience, composés de professionnels capables d’apporter un accompagnement. Mais cela n’exonère pas les établissements eux-mêmes, notamment les plus grands d’entre eux, de la responsabilité de développer des structures de contrôle interne et d’audit, capables de faire des constats, mais aussi d’apporter des correctifs.
M. le coprésident Pierre Morange. Le rôle de la MECSS est de s’assurer du bon usage des budgets votés par la représentation nationale. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur le calendrier d’application des contrats de retour à l’équilibre, comme sur celui de la mise en œuvre des préconisations relatives à l’ensemble du parc hospitalier, qu’il s’agisse des outils de mesure, de la facturation ou de la gestion des ressources humaines ?
Mme Anne-Marie Podeur. Le calendrier a été fixé par le Président de la République : le retour à l’équilibre doit être effectif en 2012.
M. le coprésident Pierre Morange. Confirmez-vous que les 238 établissements concernés seront à l’équilibre à cette date ?
Mme Anne-Marie Podeur. Nous avons constaté une amélioration de la situation financière des établissements de santé l’an dernier – je pourrai vous communiquer des données précises à ce sujet, si vous le souhaitez. Cette amélioration a été sensible aussi bien en ce qui concerne le recouvrement des recettes que la maîtrise des dépenses, en particulier celles de personnel. L’année 2008 a été marquée par une rupture dans ce domaine.
Les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation se voient fixer, chaque année, un objectif de réduction des déficits d’exploitation. Hormis certaines régions handicapées par un niveau de déficits élevé, les objectifs ont été tenus – 20 % en 2008 et 25 % en 2009. En Île-de-France, le déficit global est passé de 148 à 108 millions en 2008, ce qui est un résultat considérable. L’effort va se poursuivre dans les années à venir : les écarts vont se résorber progressivement et la pression pour atteindre les objectifs va s’accroître à mesure que nous nous rapprocherons de l’année 2012.
Cela étant, il ne faut pas se cacher que nous rencontrerons de graves difficultés avec les établissements dont la structure d’exploitation est déséquilibrée par des investissements trop massifs et par un endettement excessif, et dont les dépenses du titre IV sont très supérieures à un niveau habituellement supportable. Cela fait des années que la part de ces dépenses dépasse 5 %, voire 10 % du budget dans certains établissements. Or, il est très difficile de s’en sortir en jouant sur d’autres dépenses, comme celles du titre I, qui concernent les effectifs soignants présents au chevet des malades. Il importe de ne pas altérer la qualité des soins.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je me garderai bien de commenter la date de 2012…
Mme Anne-Marie Podeur. C’est un objectif que j’assume parfaitement.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La méthode que vous appliquez consiste à partir des besoins, puis à rationaliser et à améliorer l’organisation. Il faut parvenir à expliquer les différences entre les établissements, ce qui doit permettre à la fois de réaliser des économies et d’améliorer le service rendu – je fais partie de ceux qui considèrent qu’un service mieux géré n’est pas de moins bonne qualité, bien au contraire. Mais il faut aussi du temps pour appliquer les solutions retenues. À cet égard, on peut craindre que l’échéance de 2012 ne conduise à tailler à la serpe dans le titre I, ce qui tendrait à dégrader la qualité du service, en contradiction avec l’objectif ultime. Un certain nombre d’éléments dans l’actualité accrédite malheureusement cette hypothèse.
Mme Anne-Marie Podeur. Les situations sont très contrastées selon les régions et selon les établissements considérés. Au niveau national, le déficit du compte de résultat principal, hors budgets annexes, s’élevait à 592 millions en 2008, contre 679 millions en 2007. L’amélioration a donc été notable.
Afin d’optimiser les ressources du titre I, il faut distinguer les dépenses de personnel médical et les autres dépenses – il faut d’ailleurs différencier les personnels soignants et les personnels administratifs et techniques. Il faut également prendre en compte le turn over dans les établissements, notamment les départs « naturels » en retraite et les départs programmés. Les départs seront massifs dans les dix années qui viennent, même s’ils n’auront pas lieu immédiatement, beaucoup d’agents différant leur retraite. Ce sera l’occasion de réaliser un recalibrage à terme. Dans l’immédiat, nous disposons également de marges de manœuvre : il faut commencer par limiter le recours à l’intérim et aux contrats à durée déterminée en redéployant les effectifs existants. Les effectifs concernés sont très variables, mais ils peuvent atteindre jusqu’à 30 % du total dans certains cas, ce qui signifie que l’on ne parvient pas à stabiliser les équipes dans certains services. Ces dépenses sont en général faciles à modifier, mais il existe une viscosité plus importante pour les personnels techniques et logistiques, qui ont été recrutés en nombre dans certaines régions à une époque où l’on ne posait guère de questions.
Des externalisations permettraient de réduire les effectifs, c’est l’évidence, mais peut-être pas de réduire les dépenses dans tous les cas. Une étude a en effet montré que certains établissements ont été conduits à ré-internaliser certaines dépenses, le véritable enjeu n’étant pas tant les effectifs employés que leur productivité. La question est de savoir si l’on est capable, dans le service public, de faire preuve de la même efficience que des acteurs du secteur privé. Si une externalisation permet de faire un meilleur usage des deniers publics, sans mettre à mal la qualité du service, cette voie doit être suivie. Si l’on est en revanche capable, grâce à une redéfinition du process, grâce à une meilleure organisation et grâce à un meilleur management, de produire le même service au même coût, la question ne se pose pas.
On peut difficilement envisager de remettre en cause des postes de fonctionnaires en place, car ces derniers bénéficient de garanties statutaires. Mais il serait faux de croire qu’il n’existe pas de marges de manœuvre dans l’attente des départs en retraite à venir, et que la réduction des déficits et la maîtrise des dépenses de personnel conduisent inexorablement à une dégradation de la qualité du service. Il faut savoir utiliser les marges disponibles, en particulier en matière d’intérim.
Je rappelle également que la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a permis de recourir à des contrats de cliniciens hospitaliers, certes attractifs mais assortis d’objectifs en matière d’activité et de qualité des soins, dans certaines spécialités souffrant de problèmes de recrutement – on sait, en effet, que les revenus des praticiens exerçant à titre libéral peuvent atteindre le double de celui des praticiens hospitaliers – je pense, par exemple, aux radiologues.
M. le coprésident Pierre Morange. Faire ou faire faire, c’est effectivement un grand débat, qui n’est pas propre au secteur sanitaire.
M. Dominique Tian. La gestion des ressources humaines à l’hôpital mériterait, à elle seule, une séance de travail spécifique de la MECSS.
Parmi les problèmes souvent évoqués figure le manque d’attractivité de l’hôpital pour les médecins français ayant effectué leurs études dans les universités françaises. De leur côté, de nombreux médecins étrangers se plaignent de leur statut, voire de leur absence de statut, et considèrent qu’on exige d’eux ce qu’on n’exigerait pas de nationaux. La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) s’est émue de cette situation, qui constitue une véritable bombe à retardement pour les hôpitaux. N’ayant pas le droit de s’installer, ces médecins ont pour seule possibilité d’exercer à l’hôpital dans des conditions de travail assez différentes de celles d’autres catégories de personnel. N’y a-t-il pas là de quoi s’interroger ?
Mme Anne-Marie Podeur. Il faut distinguer le cas des ressortissants européens, désormais nombreux à travailler dans nos hôpitaux et jouissant de possibilités identiques à celles des ressortissants français, et celui des praticiens qui ne sont pas originaires de l’Union européenne. Ces derniers ont un statut différent.
Même si nous avons considérablement relevé le numerus clausus au cours des dernières années, ce qui signifie plus d’internes à former, nous avons également considéré qu’il fallait apporter une réponse aux personnels exerçant depuis très longtemps dans notre pays – il existe pour eux des procédures adaptées, reposant soit sur des examens professionnels, soit sur des concours, qui leur permettent ensuite d’exercer en tant que praticiens hospitaliers.
Il faut également distinguer le cas des praticiens qui souhaitent seulement être formés dans notre pays et qui ont vocation, non à rester sur notre territoire, mais à rejoindre les rangs des élites médicales de leur pays d’origine.
Je précise que les relations avec les médecins concernés sont désormais excellentes. Les syndicats qui les représentent savent que les portes de ma direction leur sont ouvertes, et la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a prévu des modalités d’intégration répondant aux attentes. Un problème a peut-être existé il y a quelques années, mais les règles du jeu sont désormais clairement établies – c’est d’ailleurs une nécessité bien au-delà de ce problème particulier, quand on vise à l’efficience et à la performance.
Vous trouverez peut-être que le processus est un peu lent, mais il faut admettre que nous avons établi des règles du jeu, et que les premiers résultats sont là en matière d’efficience et de redressement de la santé financière des établissements hospitaliers.
M. le coprésident Pierre Morange. Merci, madame la directrice, pour ces propos chargés d’espoir à la veille de l’année 2010. Vous savez que nous prêterons une attention particulière à leur mise en œuvre.
*
Audition de M. Christophe Alfandari, président du directoire de la Clinique Saint-Gatien, M. Philippe Choupin, directeur général délégué des Nouvelles cliniques nantaises, et M. Gérard Reysseguier, directeur de la Clinique Sarrus-Teinturiers.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à MM. Christophe Alfandari, président du directoire de la clinique Saint-Gatien, Philippe Choupin, directeur général délégué des Nouvelles cliniques nantaises et Gérard Reysseguier, directeur de la clinique Sarrus-Teinturiers.
Dans le cadre de ses travaux portant sur le fonctionnement de l’hôpital – de l’hôpital public en particulier – et visant, à partir de constats précis, à formuler des préconisations généralisables à l’ensemble des établissements de santé, la MECSS a souhaité aujourd’hui examiner la situation singulière de trois structures que je vous laisse dans un premier temps, Messieurs, le soin de présenter.
M. Christophe Alfandari, président du directoire de la clinique Saint-Gatien. Plus ancien établissement hospitalier de Tours, la clinique Saint-Gatien est située dans le cœur historique de la ville. Clinique privée à vocation médico-chirurgicale, elle est spécialisée dans les pathologies cardio-vasculaires, dispose d’un service d’urgence cardiologique et a été autorisée, dans le cadre du schéma interrégional d’organisation sanitaire (SIOS), à ouvrir la seule antenne de chirurgie cardiaque du grand Ouest. Le groupe Saint-Gatien, que je dirige, est également propriétaire de la clinique de l’Alliance, au nord de Tours, qui comporte notamment un service d’urgences.
En outre, nous sommes en train de procéder au regroupement de plusieurs établissements au nord d’Orléans – sur un bassin de 439 000 habitants – afin de créer un pôle de cliniques privées offrant 500 lits, qui sera le pendant du centre hospitalier régional d’Orléans et qui remplira des missions de service public, notamment dans le domaine des urgences – SOS Main, SOS Cœur, urgences générales – et de l’obstétrique, avec une maternité de niveau II.
Enfin, dans le cadre d’un rapprochement entre les secteurs public et privé, notre clinique médico-chirurgicale de Melun s’est associée au Centre hospitalier Marc-Jacquet pour créer une nouvelle plateforme dont la première pierre sera posée en 2011.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous sommes également intéressés par la question des fusions d’établissements dont MM. Choupin et Reysseguier peuvent peut-être nous entretenir.
M. Philippe Choupin, directeur général délégué des Nouvelles cliniques nantaises. L’établissement que je dirige est en effet issu d’une restructuration : si, en 1991, l’agglomération nantaise comptait 17 cliniques, on n’y dénombre plus aujourd’hui que cinq pôles de santé. Créée voilà onze ans, la société Nouvelles cliniques nantaises résulte du regroupement, par fusion ou absorption, de trois établissements de santé privés, lucratifs et non lucratifs. Appartenant exclusivement aux médecins qui y travaillent, le groupe est indépendant ; il comprend 95 médecins, 750 salariés, 350 lits de médecine et de chirurgie, un service d’urgences. Nous avons également des activités « phares », correspondant à des missions de service public : cardiologie interventionnelle et urgences cancérologiques sont les principales. J’ajoute que, chaque année, nous accueillons 62 000 patients et procédons à 41 000 interventions chirurgicales.
M. Gérard Reysseguier, directeur de la clinique Sarrus-Teinturiers. Propriété d’un praticien, située au centre de Toulouse, la clinique Sarrus-Teinturiers est quant à elle issue de la fusion, en 1990, de deux établissements spécialisés, l’un dans les pathologies vasculaires, l’autre dans l’obstétrique. Elle comporte 165 lits et places, emploie 280 équivalents temps plein, une soixantaine de praticiens y travaillent et elle accueille 15 000 patients par an ; par ailleurs, 3 400 accouchements s’y déroulent chaque année dans le cadre d’une maternité de niveau II, à laquelle est adjoint un service de néonatologie. Outre l’obstétrique et la chirurgie cardio-vasculaire, elle est spécialisée dans la chirurgie pédiatrique, ORL et cancérologique. Par ailleurs, une fusion est en cours avec la clinique ophtalmologique Saint-Nicolas qui comprend 35 lits et places.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Qu’en est-il de la santé financière de vos établissements ? Comment l’améliorer ou la préserver ? Quid de la gestion des personnels ainsi que des systèmes de facturation et de codage ?
M. Christophe Alfandari. Compte tenu du nombre de projets en cours, la santé financière de notre établissement est évidemment cruciale. Par la force des choses, nous sommes donc très attachés à l’amélioration de la productivité, laquelle passe par l’amélioration de notre organisation : en effet, outre que depuis deux ou trois ans la revalorisation des tarifs prévus dans le cadre de l’objectif national des dépenses de l’Assurance maladie (ONDAM) est extrêmement basse – en particulier au regard de l’inflation, la T2A a accru la concurrence avec le secteur public, ce qui est d’ailleurs tout à fait normal. En conséquence, notre chiffre d’affaires stagne. Afin de remédier à cette situation, nous sommes particulièrement attentifs au développement de la médecine ambulatoire et à la gestion des lits, ce qui appelle une adaptation du planning des personnels.
M. Philippe Choupin. Le regroupement d’établissements de santé privés est motivé par le souci d’améliorer l’offre de soins, d’intensifier les échanges entre les différents spécialistes, mais aussi d’accroître les capacités d’investissement.
Par ailleurs, la gestion de projets telle qu’elle se pratique dans le secteur privé peut avoir une valeur exemplaire pour l’hôpital public : en effet, non seulement toute entreprise médicale doit se fixer un certain nombre d’objectifs à atteindre à court ou moyen terme, mais les médecins doivent y être intéressés économiquement et juridiquement. En ce qui nous concerne, la restructuration a été l’occasion de modifier les règles de fonctionnement préexistantes et de fixer un nombre de patients précis, une durée moyenne de séjour ainsi qu’un objectif de développement de la médecine ambulatoire – à ce dernier égard, nous sommes encore loin du taux de 80 % atteint aux États-Unis, ce qui nous laisse une grande marge de progression, au bénéfice de l’Assurance maladie comme des établissements.
J’ajoute que la question du management des personnels est fondamentale : si, dans le secteur public, les charges salariales absorbent 75 % du financement, le pourcentage est encore de 50 % à 55 % dans le secteur privé – la différence tenant à ce que nous n’avons pas à prendre en charge les honoraires des médecins.
M. Gérard Reysseguier. Si la fusion dont notre clinique est le fruit s’est faite à partir de deux petits établissements qui fonctionnaient au mieux, les médecins qui en étaient propriétaires se sont néanmoins rendu compte qu’ils ne pourraient pas garantir longtemps la même qualité de soins, compte tenu de la progression des dépenses d’investissement et de personnel.
J’ai eu naguère l’occasion de comparer notre gestion des effectifs et des plannings avec celle de l’hôpital des enfants de Toulouse et j’ai pu constater combien les différences étaient importantes : outre que nous savons combien l’obstétrique requiert de personnel, nous sommes particulièrement attentifs à l’efficience de nos investissements – notamment en ce qui concerne les locaux – et au non-dépassement des budgets dont nous disposons. Le roulement de nos équipes s’effectue d’une manière relativement souple, nos cadres sont proches de l’ensemble des salariés et les praticiens sont intéressés au bon fonctionnement de « leur » service.
M. le coprésident Pierre Morange. La maîtrise des systèmes d’information et, notamment, du codage des actes médicaux est stratégique. Considérez-vous que ce codage doit être effectué par un praticien spécialisé ou par chacun d’entre eux, « au lit du malade » ?
Par ailleurs, votre démarche de rationalisation s’est-elle inspirée des préconisations de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé (ANAP) – anciennement Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH) – ou bien résulte-t-elle de votre seule pratique ?
M. Philippe Choupin. Ces agences sont parfaitement adaptées aux objectifs que le Parlement leur a fixés.
En ce qui concerne le codage, le secteur hospitalier privé a deux avantages sur le secteur public : nous avons toujours pratiqué un mode de facturation à l’activité – « à la journée », disait-on autrefois – et nos médecins sont rémunérés à l’acte, de sorte qu’ils procèdent eux-mêmes au codage – leur rémunération en dépend – afin de prévenir toute inexactitude ou omission ; dans chaque zone, une « salle Sécu » est réservée à cet effet. J’ajoute que nous avons fusionné les deux équipes du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et de facturation.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les processus de rationalisation ou de fusion ayant leurs limites, la tentation n’est-elle pas grande, quand elles sont atteintes, de sélectionner certains types d’activité ? La tarification à l’activité pousse-t-elle en ce sens, ou en sens contraire ?
M. Gérard Reysseguier. En tant que directeur administratif de deux établissements de soins, je me contente de gérer et je laisse aux médecins la pleine responsabilité des soins. Il n’a jamais été question de faire des choix : parmi nos patients, plus de 10 % bénéficient de la couverture maladie universelle (CMU) et 40 % de nos médecins relèvent du secteur 1.
Un établissement de soins est une entreprise. Dire cela n’implique nullement une obligation de résultats économiques, mais signifie qu’un processus de gestion est nécessaire : notre première contrainte, en effet, est de soigner toute la population. C’est à cette fin que nous constituons des alliances tout en veillant à rechercher les équilibres nécessaires – si les charges augmentent chaque année de quatre points sans qu’il en aille de même des tarifs, les établissements de santé privés ferment leur porte, comme le ferait n’importe quelle entreprise. En 2003, l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) nous a demandé de créer en deux mois un service de néonatologie. Même si, compte tenu de la tarification actuelle, c’est un gouffre financier – la clinique perd 500 000 euros par an, nous disposons néanmoins de neuf lits et de quatre infirmières. Je n’envisage d’ailleurs pas un instant qu’il en soit autrement car cela fait partie de la mission d’une maternité de niveau II à Toulouse. En revanche, je me dois de trouver des marges de manœuvre ailleurs afin de parvenir à équilibrer notre projet médical.
M. Christophe Alfandari. Je pense qu’il nous est encore possible d’aller plus loin dans la rationalisation – en améliorant, par exemple, une informatisation encore balbutiante –, ce qui interdit un pessimisme excessif, quelles que soient les tensions que nous connaissons.
Par ailleurs, la croissance de nos structures nous conduit à prendre en charge des bassins de population plus importants et nous considérons que c’est là notre mission, qui implique d’adapter notre organisation en conséquence.
M. Philippe Choupin. Lorsque nous avons demandé, dans les années 2000, l’autorisation de mettre en place un service d’urgence, aucune tarification n’était prévue pour le secteur privé. Néanmoins, tous les médecins membres du conseil d’administration et, donc, défenseurs au premier chef des intérêts de leur entreprise, se sont prononcés en faveur de cette création tant il leur paraissait incongru qu’un établissement de cette taille soit dépourvu d’un tel service. Il appartient ensuite à nos instances représentatives de faire valoir auprès du Gouvernement ou du Parlement les effets de cette non-tarification ou de la sous-tarification de telle ou telle pathologie – à moins que nous ne cessions de traiter celle-ci au cas où la concurrence ferait mieux. Cela étant, la notion de territorialité incluse dans la loi nous permet de travailler en synergie avec les établissements voisins. Le secteur privé ne se trouve plus « en marge ».
Si les cliniques privées se cantonnaient autrefois dans certaines spécialités, c’est que la tarification les y obligeait. Lorsque j’étais directeur d’un établissement de la Croix-Rouge, mon supérieur hiérarchique avait attiré mon attention sur le secteur de la cardiologie, qui était déficitaire : « Je vous donne six mois, m’avait-il dit alors, pour trouver une solution ou pour le fermer ». C’était pourtant la Croix-Rouge française…
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Compte tenu de ce que les établissements privés peuvent prendre en charge des missions d’intérêt général et que tous les hôpitaux sont progressivement soumis au même système de tarification, comment concevez-vous précisément cette convergence et, en particulier, que pensez-vous de l’évolution de la T2A ? Ne va-t-on pas vers une quasi-assimilation ?
M. Philippe Choupin. Je suis ravi que les établissements de santé soient rémunérés pour ce qu’ils font, et non pour ce qu’ils sont – publics ou privés.
Par ailleurs, des enveloppes spécifiquement dédiées permettent chaque année de faire face aux missions d’intérêt général.
M. Dominique Tian. Lorsque nous les avons entendus, les présidents de la Fédération hospitalière de France et de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne semblaient pessimistes quant à l’avenir financier d’un certain nombre d’établissements. Qu’en est-il plus précisément des vôtres ?
M. Gérard Reysseguier. Je suis inquiet, en ce qui me concerne, pour l’avenir de ma maternité. Il est tout de même aberrant et préoccupant que les mêmes soins apportés à un nouveau-né de 2,5 kg coûtent tant à tel endroit et 25 % de plus à tel autre. Comment expliquer cette différence de tarifs ? Sur chaque accouchement pratiqué à la clinique Sarrus-Teinturiers, à la clinique Ambroise-Paré ou à l’hôpital Joseph-Ducuing, la Sécurité sociale économise 281 euros. Si je ne conteste pas les différences de structures, par exemple, avec le CHU de Toulouse ou l’hôpital de Castres, je ne suis pas moins surpris d’une telle différence de traitement.
Alors que notre chiffre d’affaires s’élève à 21 millions par an – dont 18 millions issus de la T2A – et que notre clinique a investi sept millions en sept ans, nous avons eu un résultat net de 400 000 euros et le prochain sera immanquablement négatif. Outre que nous réalisons 3 400 accouchements par an et que nous accomplissons nos missions de service public, l’État est si convaincu de notre raison d’être que nous fonctionnons aujourd’hui sous réquisition ! Par ailleurs, lorsque j’ai élaboré mon budget, je n’avais pas envisagé que la nouvelle version de la tarification – la « V11 » – entraînerait une baisse de 10 % des recettes sur une activité majeure – en peu de temps, le nombre de maternités privées est d’ailleurs passé de 218 à 180. En l’état et en dépit du soutien de deux millions de l’agence régionale de l’hospitalisation à la fusion avec la clinique Saint-Nicolas – qui en coûte 20 –, nous avons été contraints de bloquer nos investissements.
Par ailleurs, si je regrette que Mme la ministre de la santé et des sports ne soit pas venue s’exprimer dans le cadre de nos rencontres professionnelles, je n’en demeure pas moins convaincu que les éléments sont en place pour accélérer la convergence sur la majorité des groupes homogènes de séjours (GHS). Cependant, s’il y avait augmentation parallèle des dotations au titre des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC), l’économie serait nulle. Enfin, il me semble que la convergence doit d’abord s’organiser autour d’un certain nombre d’actes simples, qui sont les mêmes pour tous.
M. Christophe Alfandari. S’il est vrai que la situation nous contraint à faire preuve d’inventivité, les plans Hôpitaux 2007 et 2012 nous ont considérablement aidés, notamment afin que l’immobilier n’absorbe pas plus de 10 % des coûts d’exploitation.
M. Philippe Choupin. Outre que nos salariés sont en moyenne rémunérés 10 % de moins que dans le secteur public et que nos salaires sont bloqués depuis deux ans, nous avons dû harmoniser trois conventions collectives de trois cliniques et faire face aux 35 heures. Or tout cela a eu lieu sans que nous ayons à supporter un seul jour de grève jusqu’à l’année dernière.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Que proposeriez-vous afin d’améliorer la gestion de l’hôpital public ?
M. Gérard Reysseguier. Tout d’abord, faire en sorte que les Français connaissent le coût de leur santé personnelle. Il serait si simple de leur envoyer à chacun une facture quand, à la clinique, nous disposons tous les matins des montants facturés la veille à l’Assurance maladie ! Aller à l’hôpital, ce n’est pas gratuit !
Ensuite, que ce soit dans le public ou dans le privé, beaucoup dépend de la qualité des managers et des moyens dont ils disposent.
Enfin, une rationalisation s’impose sans doute en matière d’effectifs. Nous avons coutume de dire en petit comité que le maire ne devrait plus présider le conseil d’administration de l’hôpital public. En tout cas, il faudrait réfléchir à cette question – à tout le moins connaître le nombre exact des personnels.
M. Philippe Choupin. Les gestions de projet, des ressources humaines et des flux me semblent fondamentales pour bénéficier d’un management efficient – nous devons en particulier avoir une vision globale du parcours du patient, depuis la prévisite avec l’anesthésiste jusqu’à l’après-sortie.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie.
N’hésitez pas à nous faire part d’autres préconisations précises permettant d’améliorer le fonctionnement de nos hôpitaux au profit de l’ensemble de nos concitoyens.
*
Audition de M. Gérard Baron, directeur général de la clinique Belledonne, de M. Philippe Plagès, directeur par intérim de la polyclinique Majorelle, accompagné par M. Frédéric Dubois, président-directeur général du groupe Médi-Partenaires, et de M. Sami Franck Rifaï, directeur général de la clinique Tivoli.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je souhaite la bienvenue à M. Gérard Baron, directeur général de la clinique Belledonne, à M. Philippe Plagès, directeur par intérim de la polyclinique Majorelle, accompagné par M. Frédéric Dubois, président-directeur général du groupe Médi-Partenaires, et à M. Sami Franck Rifaï, directeur général de la clinique Tivoli.
Dans le cadre de nos travaux sur le fonctionnement interne de l’hôpital, nous avons souhaité examiner la situation précise de quelques établissements en France, dans le but de mettre en perspective les éléments recueillis et d’en tirer des enseignements généralisables.
Je vous propose tout d’abord, messieurs, de présenter vos établissements respectifs.
M. Gérard Baron, directeur général de la clinique Belledonne. Située dans l’agglomération grenobloise, la clinique Belledonne compte 281 lits et places ; nous avons également, à l’autre bout de l’agglomération, un établissement de 59 lits et places, soit un total de 330. Nous accueillons environ 35 000 patients par an en médecine, chirurgie et obstétrique. La maternité assure près de 3 000 accouchements par an et nous sommes dotés depuis 2003 d’un service de néonatologie. En ce domaine, nos préoccupations rejoignent celles que le directeur de la clinique Sarrus-Teinturiers a exprimées lors de l’audition précédente. La clinique pratique la chirurgie cardiaque et comprend également, depuis 2007, un service de réanimation polyvalente. Au total, notre activité est assez large.
M. Philippe Plagès, directeur par intérim de la polyclinique Majorelle. La polyclinique Majorelle est un établissement nancéen de 146 lits issu de la fusion, il y a quinze ans, de deux établissements, la clinique de l’Espérance et la clinique Majorelle. Elle est essentiellement tournée vers la femme et l’enfant, avec une importante maternité – 2 100 accouchements – et des activités de traitement des cancers féminins. Son chiffre d’affaires s’élève à 17 millions d’euros. Elle traite environ 13 000 patients par an. Elle se situe dans un pôle relativement concentré d’établissements privés.
M. Sami Franck Rifaï, directeur général de la clinique Tivoli. La clinique Tivoli, à Bordeaux, est un établissement indépendant qui appartient aux médecins et dont la création remonte à 1922. Son activité se répartit entre la chirurgie, pour 75 %, et la cancérologie, pour le reste. Elle réalise environ 13 500 chimiothérapies par an, pour une file active de 8 500 patients. La moyenne d’âge des chirurgiens de la clinique est une des plus basses d’Aquitaine : 41 ans.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Quelle est la santé financière de vos établissements et quels outils utilisez-vous pour la surveiller ? La logique du privé n’est pas la même que celle du secteur public. Pour autant, la tarification à l’activité vous rend passible du même traitement à terme et introduit une forme de concurrence, tant en ce qui concerne les personnels qu’en ce qui concerne les patients. Dans cet environnement, quelles méthodes et quelles stratégies mettez-vous en œuvre pour atteindre vos objectifs d’entreprise ?
M. Sami Franck Rifaï. En matière de gestion, nous devons faire preuve de beaucoup de créativité. En effet, le schéma régional d’organisation sanitaire nous enferme dans un quota d’activité réparti entre les différentes spécialités que nous exerçons. Nous sommes « capés », nous n’avons pas la possibilité de nous développer comme n’importe quelle entreprise commerciale.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. C’est l’activité globale qui ne peut augmenter. En revanche, vous pouvez capter des parts de marché en les prenant à la concurrence.
M. Sami Franck Rifaï. Non, notre activité est capée : nous ne pouvons aller au-delà d’un certain nombre d’interventions chirurgicales par an…
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. À structure donnée…
M. Sami Franck Rifaï. Oui, en ce qui concerne les établissements. Le contrat d’objectifs pluriannuel que nous signons avec l’agence régionale de l’hospitalisation enferme notre activité dans un certain nombre de critères, si bien que notre chiffre d’affaires n’a pas varié durant les quatre ou cinq dernières années et que nos marges se réduisent comme peau de chagrin. Les tarifs ne sont pas revalorisés alors que nos charges augmentent. Pris dans cet étau, nous devons être très inventifs pour trouver des leviers de gestion. La seule possibilité est de jouer sur les coûts de production. Le levier le plus important, mais aussi le plus fragile socialement, est la masse salariale – 45 à 47 % du chiffre d’affaires pour les meilleurs gestionnaires, autour de 60 % pour ceux qui ont le plus de mal.
Nous sommes également contraints de trouver les ressources nécessaires pour renouveler notre matériel et pour répondre à toutes les contraintes imposées par les tutelles – Haute Autorité de santé, agence régionale de l’hospitalisation –, en matière de traçabilité notamment.
En tant que gestionnaire et directeur d’établissement, j’ai du mal aujourd’hui à trouver ces ressources.
M. Philippe Plagès. Une clinique privée est une entreprise comme une autre, mais nous devons affronter plusieurs soucis, au premier rang desquels le fait que subissons les tarifs. La V11, entrée en vigueur cette année, est encore plus complexe que la tarification précédente. Nous aurons mis un an à nous adapter, en attendant que l’on nous sorte une V12 ou une V11 bis ! Bien souvent, la rentabilité des cliniques est assurée par les suppléments hôteliers – quand on est parvenu à se doter d’une capacité importante en chambres individuelles –, et non par le cœur du métier.
Par ailleurs, les cliniques sont des entreprises qui ont des besoins considérables en investissements, notamment pour l’entretien et le renouvellement des plateaux techniques. Une très bonne clinique privée, c’est d’abord une très bonne équipe médicale, et, pour attirer les meilleurs praticiens, il faut que les plateaux techniques soient à la pointe de la technologie. Assurer la rentabilité de ces investissements devient très délicat pour nous.
Nous rencontrons également des difficultés sociales. À travail identique, la rémunération de nos personnels paramédicaux est de 10 à 15 % inférieure à celle des personnels du public. Nous sommes donc soumis à une pression permanente susceptible de fragiliser nos entreprises.
C’est en termes d’organisation que notre apport a été le plus important. Une étude de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier (MEAH) a ainsi démontré que nous étions très en avance pour ce qui est de l’utilisation des blocs opératoires. Ces capacités, ainsi que les domaines d’excellence de chaque établissement, nous permettent de trouver des ressources pour tenter de rendre nos activités un peu plus pérennes.
M. Gérard Baron. Nous recherchons tous l’efficience pour gommer cet « effet tarif » qui nous pénalise et nous préoccupe. L’efficience repose sur le parangonnage ou benchmarking, donc sur des systèmes d’information. La comptabilité analytique est vitale pour le secteur privé puisque celui-ci doit maîtriser ses coûts. Elle utilise à la fois la base de données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI), ce qui suppose que les actes soient cotés et codés, et la facturation. Nous ne pourrions imaginer de fonctionner sans disposer quotidiennement de renseignements fiables nous permettant de savoir où nous en sommes en temps réel. Si l’hôpital public se révèle incapable de produire des factures, il n’est pas à même de maîtriser ses coûts – et, sans facture, le patient a tendance à penser que tout cela est gratuit…
Comme les intervenants de l’audition précédente, je considère que c’est le médecin qui doit coter les actes au plus près du malade. Le système mis en place avec la V11 est d’une grande complexité. Nous sommes passés de 800 à près de 2 500 groupes homogènes de malades (GHM) et de 2 500 comorbidités associées (CMA) à presque 5 000. Il serait aberrant de charger un médecin responsable du département d’informations médicales (DIM) de coter et de coder l’ensemble de l’activité hospitalière : selon l’abord chirurgical, le GHM sera différent et seul le médecin ou le chirurgien qui a soigné ou opéré le patient peut effectivement coter.
Dès lors, la meilleure façon de nous assurer la participation active des praticiens est de leur fournir un outil informatique efficace leur permettant de coter leurs actes et de coder les pathologies. La clinique Belledonne a développé son propre système d’information : la page de cotation – qui détermine le versement des honoraires – se situe juste derrière la page du codage, et ces deux éléments permettent d’établir la facture.
M. Dominique Tian, suppléant M. le coprésident Pierre Morange. On reproche souvent au secteur privé de choisir ses malades en privilégiant les plus « rentables » et en laissant les autres à la charge de l’hôpital public.
M. Philippe Plagès. Une clinique privée, c’est d’abord un projet médical susceptible de rassembler les meilleurs praticiens. Nous développons nos activités en fonction de ce projet. Il est impossible de sélectionner les patients en fonction de l’âge ou de la pathologie, par exemple, pour s’assurer d’une quelconque rentabilité. La gestion des établissements privés est une gestion de flux, l’activité de certains permettant le développement d’autres activités. L’important est de donner un sens au projet médical et d’assurer la prise en charge des patients quelle que soit la filière : lorsque l’on a une maternité, on a aussi un service de néonatologie. Nous ne sélectionnons en aucun cas des activités plus « performantes » que d’autres en termes de tarifs : ce serait mettre en péril la pérennité de l’entreprise.
M. Sami Franck Rifaï. Lorsqu’un établissement a regroupé une équipe médicale autour d’un projet, il ne va pas se mettre à choisir ses malades. D’abord, c’est éthiquement inconcevable. Ensuite, que ferions-nous des médecins spécialisés dans des pathologies que le hasard des tarifications rendrait moins « intéressantes » ? La réalité est que notre case-mix – la cartographie de l’ensemble des pathologies que nous soignons – reste le même d’une année sur l’autre.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je comprends que vous n’entriez pas dans cette logique, mais la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet un tel choix.
Beaucoup de cliniques remplissent certaines missions d’intérêt général, si bien que, de ce point de vue, la frontière entre public et privé se trouve atténuée. Pour autant, les logiques de gestion sont différentes. Pensez-vous que l’on peut se diriger vers une convergence où tout le monde exercerait des missions d’intérêt général, avec un système unique de tarification ?
M. Sami Franck Rifaï. En soignant les personnes malades, nous contribuons au service public et nous le revendiquons. Nous sommes capables d’assurer toutes les missions de service public.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Toutes ?
M. Sami Franck Rifaï. Si l’on nous en donne les moyens.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Telles qu’énumérées dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, certaines paraissent a priori éloignées de l’objectif premier d’une clinique privée.
M. Sami Franck Rifaï. Les médecins qui exercent dans nos établissements viennent du service public. Ils ont été formés dans les CHU, où ils assuraient toutes les missions de service public et où ils pratiquaient l’enseignement et la recherche. Ils sont parfaitement capables de reproduire ce schéma.
M. Philippe Plagès. Dès lors que le financement existe, nous pouvons tout faire. Je pense néanmoins que toutes les cliniques privées ne sont pas à même de faire de la recherche ou d’assurer les urgences, par exemple. Il existe certains seuils.
Cela dit, nous ne sommes absolument pas considérés comme de vrais acteurs du système de santé lorsque nous discutons des tarifs. La convergence voudrait que le même acte traitant la même pathologie nous vaille la même rémunération qu’au secteur public, c’est un fait, mais comment l’hôpital, qui a déjà tellement de mal à gérer ses budgets, pourrait-il supporter cette différence de 30 % ? Pour nous, l’important est de pouvoir continuer notre évolution en assurant des missions de service public dans nos domaines. Il faut nous en donner les moyens et, pour cela, nous prendre plus en considération et faire évoluer différemment l’approche tarifaire des pathologies. La rémunération doit correspondre à ce que nous faisons et nous permettre de retrouver les moyens de travailler correctement et de réinvestir dans nos outils.
M. Gérard Baron. La convergence tarifaire est prévue et souhaitée. En 2000, un journal économique de la région Rhône-Alpes avait mené une enquête consacrée à « ce que coûte réellement l’hôpital public », en mettant en avant la notion de « coût idéal par séjour ». L’idée de convergence entre public et privé pour améliorer la prise en charge des patients était déjà dans l’air. Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation Rhône-Alpes, M. Philippe Ritter, avait notamment démontré que le coût d’un accouchement dans un établissement privé concurrent de la région permettait une économie de 150 francs par jour. J’avais alors fait le calcul pour mon établissement, où le coût s’est révélé encore inférieur. Le désir de se comparer les uns aux autres existe depuis longtemps.
La T2A devrait permettre de rémunérer de façon égale le public et le privé, indépendamment des missions d’enseignement et de recherche. Il est nécessaire de se diriger vers cette convergence, ne serait-ce que par souci de bonne gestion. Par quels moyens ? La question est posée.
M. Frédéric Dubois, président-directeur général du groupe Médi-Partenaires. La coexistence des secteurs public et privé est une chance pour la France. Elle est enviée par tous et reste inégalable : nous sommes le seul pays de l’OCDE qui arrive à conjuguer la solidarité à l’extrême – avec l’aide médicale d’État – et la liberté de choix du patient.
Cette coexistence a été rendue possible par le grand dynamisme du secteur privé depuis quarante ans, d’abord à l’initiative des praticiens libéraux. Tout le problème de ce secteur, qui a connu une mutation considérable depuis les années 1980, est de rationaliser l’offre de soins pour la mettre en adéquation avec la demande de soins. À l’inverse de l’hôpital public, qui a toujours fonctionné comme un centre de coûts – au temps de la dotation globale du moins –, il ne peut investir que sur ses propres moyens de financement, en quête d’une efficience optimale.
Le rôle des pouvoirs publics, en l’espèce, est d’organiser la production de soins de qualité au meilleur coût possible. Il est établi que le secteur privé a montré la voie depuis une vingtaine d’années en se distinguant du secteur public par sa faculté d’anticipation et par sa réactivité. La base de son fonctionnement est le projet médical, dont chaque clinique est dotée et qui fixe des objectifs à cinq ou dix ans. Lors du débat sur la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, on a essayé d’étendre ce principe à l’hôpital public, malheureusement sans grand succès. Pourtant, toute l’organisation sanitaire des régions et des territoires dépend du projet médical, qui est d’abord construit par le corps médical.
Il faut désormais organiser l’ensemble des ressources, publiques ou privées, de façon à utiliser le mieux possible l’environnement de travail mis à la disposition des médecins. À partir du projet médical, on construit un projet d’entreprise qui nécessite une stabilité dans le temps. La force actuelle du privé est de disposer de ces projets à moyen terme, mais il nous manque la visibilité nécessaire.
Lorsque votre mission a demandé à M. Gérard Vincent, délégué général de la Fédération hospitalière de France, ce qu’il fallait faire pour améliorer la gestion de l’hôpital, il a estimé que la seule variable d’ajustement était la masse salariale mais que, par définition, on ne pouvait y toucher, en raison des garanties statutaires. La réponse n’est donc pas là. Alors que tous les rapports – Cour des comptes, inspection générale des affaires sociales, directions régionales des affaires sanitaires et sociales… – établissent clairement que le secteur privé est le bon élève, qu’il montre la voie et est capable d’arriver au meilleur coût de production, le problème est maintenant de faire correspondre un tarif à ce coût. Or on sait que le coût de production est difficilement contrôlable dans le public. Si certains hôpitaux, en appliquant des méthodes du privé, réalisent un effort de gestion considérable et arrivent à dégager un excédent, les autres restent en déficit.
En l’état, la T2A ne correspond pas véritablement à la recherche du meilleur tarif adapté au véritable coût : c’est seulement un moyen de forcer l’hôpital public à s’améliorer. Repousser la convergence de 2012 à 2018 revient à donner du temps au temps mais sans visibilité sur un projet, faute de coercition ou de sanction. Le directeur d’hôpital pourra toujours répondre qu’il ne peut faire mieux, à moins de mettre des centaines de salariés dans la rue.
Le privé est accoutumé à optimiser l’utilisation de ses ressources, mais il est ici confronté au caractère arbitraire des tarifs fixés. La ministre de la santé a beau jeu de faire valoir un objectif national des dépenses de l’assurance maladie en progression de 3 % alors que tous les autres secteurs d’activité sont en crise, et de constater que nous arrivons à survivre. C’est prendre des risques. Le bon élève va se retrouver la tête sous l’eau, et cela à cause d’une marge de manœuvre – la progression de l’objectif national des dépenses de l’assurance maladie – qui n’est absolument pas significative pour ce qui est des tarifs. Pendant ce temps, les dotations au titre des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation continuent de croître et protègent l’hôpital public au prétexte d’une différenciation des activités qui n’a plus aucune réalité.
Si, dans les années 1970 et 1980, les cliniques disposaient de l’atout du libre choix des pathologies, ce n’est plus le cas. Certaines sont devenues de petits CHU. Il faut qu’elles puissent continuer à montrer la voie pour rendre le meilleur service possible à la population. Or ce n’est pas le cas. On nous a indiqué il y a quelques jours que la loi permet certes de passer des appels d’offres, mais seulement « en cas de carence de l’hôpital public ». À chaque fois, on place un écran destiné à cantonner les cliniques dans un certain rôle, pour mieux affirmer par la suite qu’elles ne font pas la même chose que l’hôpital public !
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous soulignez l’importance du projet médical et de la réactivité dans le secteur privé, tandis que le secteur public buterait sur le statut des personnels. Est-ce à dire qu’en levant le verrou du statut, on résoudrait tous les problèmes ?
Vous semblez dénoncer aussi un certain arbitraire des tarifs, pourtant censés être construits à partir de l’analyse de la réalité par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et par d’autres instances. La mise en place d’outils de suivi analytique dans les établissements devrait permettre des comparaisons et un pilotage.
M. Sami Franck Rifaï. J’ai demandé à Mme Martine Aoustin quelles avaient été les modalités du calcul aboutissant au montant qu’elle annonçait pour des actes effectués en dehors du bloc opératoire. Elle a décompté un peu de temps d’infirmière, un peu de matériel, etc., comme s’il s’agissait d’une recette de cuisine. Lorsque je lui ai demandé ce qu’elle faisait du reste – l’établissement, l’entretien du bâtiment, le personnel administratif, etc., l’expression de son visage montrait bien que cela n’avait pas été pris en compte !
M. Philippe Plagès. La T2A est la résultante des tarifs précédents, qui correspondaient aux frais de salle d’opération, à des actes cotés en K et à des prix de journée pour chaque pathologie. L’étude nationale des coûts permettra peut-être la prise en compte des pathologies dans les tarifs mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. On ne veut pas entendre parler de marges à l’intérieur des tarifs ; pourtant, c’est bien un prix de revient que l’on étudie et il faut que l’on assure à l’entreprise son développement et sa rentabilité.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. En somme, le système de tarification est selon vous grossier et arbitraire et ne tient pas compte de vos caractéristiques. C’est assez différent de ce que l’on nous a dit jusqu’à présent. Comment pouvez-vous gérer dans ces conditions ? On est dans l’impasse !
M. Philippe Plagès. La comptabilité analytique nous servirait si nous étions à même de générer un prix de vente et si l’Assurance maladie lançait des appels d’offres pour certains traitements de patients en fonction des pathologies.
Les nouvelles techniques de cœliochirurgie, par exemple, permettent d’éviter d’ouvrir le patient. Le coût des matériels utilisés, qui faisait auparavant l’objet d’une facturation en sus, a été intégré dans le tarif mais à partir d’une moyenne calculée sur l’ensemble de la France, ce qui fait que le chirurgien utilisant les techniques les plus récentes est perdant et celui qui opère à l’ancienne est bénéficiaire ! Il s’agit donc plus d’une dotation transformée en tarif que d’un tarif correspondant au coût réel.
M. Sami Franck Rifaï. Comme nous nous devons d’être attractifs vis-à-vis des praticiens et d’utiliser des techniques moins invasives et douloureuses pour le patient – et donc moins coûteuses pour la sécurité sociale –, nous nous plaçons dans une démarche d’innovation, mais au prix de l’autofinancement. Le traitement des varices, par exemple, suppose trois à quatre jours d’arrêt maladie avec la technique usuelle, un seul avec le laser vasculaire qui pourtant n’est pas reconnu par la sécurité sociale.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. On peut comprendre un certain délai entre l’innovation et sa prise en compte dans le système de tarification. Mais ce que vous dénoncez aussi, c’est la déconnexion avec la réalité. Pensez-vous que l’évolution du système permettra de résoudre la question sous ces deux aspects ?
M. Philippe Plagès. L’Assurance maladie pousse tous les établissements, publics et privés, à faire de l’ambulatoire – c’est d’ailleurs une pratique que les cliniques privées ont développée depuis longtemps. Or l’analyse de la V11 montre que l’on est mieux rémunéré si l’on garde un patient deux ou trois jours au lieu de le traiter en ambulatoire ! C’est bien la preuve que l’on est déconnecté des techniques modernes d’anesthésie et de chirurgie qui permettent aux personnes d’être opérées dans les meilleures conditions et de reprendre plus rapidement leur activité.
M. Frédéric Dubois. La T2A devrait être l’outil permettant d’assurer l’efficience de l’offre de soins en France. La recherche du juste coût du GHS est un processus très complexe et empirique. On aboutit forcément à un coût médian : c’est l’objet même de l’étude nationale de coûts à méthodologie commune (ENCC), qui était au départ intersectorielle. Or, comme il existe un écart initial sensible entre les deux secteurs, on a progressivement introduit la notion de convergence intrasectorielle. Comme deux entreprises ne sont jamais les mêmes, l’une pourra dégager une marge par rapport à un forfait de coût de production, l’autre pas.
Il faut du temps pour organiser la convergence intersectorielle. Si on l’appliquait brutalement, beaucoup d’hôpitaux publics ne pourraient plus faire face. Néanmoins, ce qui compte à l’arrivée est la production de GHS de qualité dans des conditions de sécurité égales. Cela, les établissements privés le revendiquent sur tout le spectre des soins.
On passe donc par des étapes intermédiaires et, chaque année, l’objectif national des dépenses de l’assurance maladie « cape ». Du fait de l’existence des déficits et de l’attribution de 99 % de l’enveloppe des dotations au titre des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation au secteur public, on laisse dériver une partie des dotations vers les MIGAC, dont la masse correspond à celle de l’objectif des dépenses d’assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologique (ODMCO) des établissements de santé du secteur privé. On ne peut forcer le bon élève à améliorer encore son efficience sans lui permettre un niveau de revenu qui couvre son coût de production. Or les revenus issus de la sécurité sociale ne couvrent pas ces coûts pour le secteur privé. Celui-ci ne peut que s’en remettre à ses compléments, à sa réactivité et à son inventivité pour survivre, parfois pour dégager les marges nécessaires à l’investissement. L’étau se resserre dangereusement et notre secteur risque l’étouffement. Certes, on aura forcé l’hôpital à se moderniser progressivement, mais on aura aussi tué celui par qui l’émulation est arrivée.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. C’est un point de vue…
Pourriez-vous décrire les modes de gestion – intérim, CDD, etc. – et de rémunération – intéressement compris – des personnels dans vos entreprises ?
M. Sami Franck Rifaï. Nous avons la chance d’avoir des équipes dévouées et motivées, même si le nerf de la guerre reste l’argent. Le taux de rotation témoigne de la fidélité de nos personnels et de leur attachement aux établissements. Nous menons en effet des politiques de gestion sociale au plus près du terrain. Pourtant, nous avons les plus grandes difficultés à répondre à des besoins primaires, tout en bas de la pyramide de Maslow. On rémunère nos salariés au lance-pierres. C’est honteux !
La promesse faite par M. Xavier Bertrand en 2006, alors qu’il était ministre de la santé, n’a pas été tenue. Il est pourtant impératif que nos salariés puissent vivre normalement. Beaucoup de nos infirmières ou de nos aides-soignantes sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Elles appartiennent à une population fragile et il faut pouvoir les aider. Leur qualification est reconnue, mais pas par la rémunération.
Nous aimerions bien sûr verser un intéressement, mais sur quelle base ? Nous n’avons pas de résultat à distribuer.
Bref, nous sommes sur la corde raide et le climat social risque de se dégrader fortement. Il est urgent de revaloriser une partie de nos tarifs pour nous permettre de répondre à un besoin salarial vital.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous avez souligné pourtant la nécessité d’être attractif en offrant des rémunérations convenables. J’imagine que les praticiens bénéficient de telles rémunérations, et que l’écart se creuse entre le haut et le bas de l’échelle.
Par ailleurs, le statut des personnels du secteur public semblait tout à l’heure faire difficulté pour vous. Faire sauter ce verrou ne reviendrait-il pas à généraliser la situation que l’on déplore dans le privé ?
M. Philippe Plagès. On en revient toujours à la question des tarifs. Certes, comme mon établissement est rentable, il a passé des contrats d’intéressement avec le personnel. Nous faisons également beaucoup d’efforts en matière de formation et nous nous montrons très souples dans l’élaboration des plannings, de manière à nous démarquer des rigidités de l’hôpital. Mais il s’agit d’artifices liés aux conditions de travail. Pour ce qui est de la rémunération elle-même, nous sommes soumis à une vraie pression. Lorsque l’hôpital embauche du personnel, nous avons de grandes difficultés à recruter. L’enveloppe promise par M. Xavier Bertrand aurait été une bonne chose.
M. Gérard Baron. Mme Roselyne Bachelot-Narquin a annoncé hier un budget de 500 millions d’euros pour la revalorisation de la profession d’infirmière. Cette mesure, qui correspond grosso modo à un treizième mois, sera prochainement mise en place dans le public. Il est paradoxal d’affirmer que le public doit agir sur sa masse salariale et d’accroître dans le même temps la différence entre les salaires du public et ceux du privé. Dans le secteur public, une infirmière gagne en moyenne 10 % de plus que dans le privé, et les charges salariales sont de 10 %, contre 24 % dans le privé.
Si nous arrivons à conserver nos salariés, c’est en effet parce que nous leur offrons de bonnes conditions de travail. Nous avons moins de strates de décision, ce qui nous permet de mieux prendre en compte les besoins de chacun. Mais arrivera un moment où la différence de salaire sera si importante que nous ne pourrons plus gérer la situation.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Si vous aviez une seule suggestion à faire pour améliorer le fonctionnement des hôpitaux en France, quelle serait-elle ?
M. Philippe Plagès. Comme la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires semble le prévoir, il faut un patron à l’hôpital. La partition entre le pouvoir médical et le pouvoir administratif a toujours été un obstacle à la mise en place d’une organisation performante. Mais il est à craindre que la disposition n’ait d’ores et déjà été revue et corrigée. La multiplication des pouvoirs et des strates est un handicap énorme.
M. Frédéric Dubois. J’émettrai une revendication politiquement iconoclaste : confier au secteur privé, à titre expérimental, la gestion de plateaux techniques au sein des hôpitaux. Certaines restructurations donnent lieu à des ouvertures intéressantes de ce point de vue. De jeunes directeurs dynamiques essaient d’appliquer nos méthodes dans leur hôpital et nous suggèrent de créer des plateaux techniques communs et de partager l’activité… avant de solliciter l’agence régionale de santé pour financer les équipements sur fonds publics.
Pour ce qui est de la responsabilité de la gestion, voilà un certain temps que le secteur privé a démontré qu’il est le plus efficient. Il serait dommage de ne pas lui donner la possibilité d’aider à l’amélioration de l’offre de soins et de la productivité dans l’hôpital.
M. Gérard Baron. Comme M. Reysseguier dans la précédente audition, je pense que la production d’une facture est une priorité. C’est la partie émergée de l’iceberg. Lorsque l’hôpital en sera capable, cela signifiera qu’il maîtrise la structure des coûts, la chaîne de prise en charge du patient et les flux financiers.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il me reste à vous remercier pour cette contribution très détaillée à nos travaux.
*
AUDITIONS DU 14 JANVIER 2010
Audition de Mme Nathalie Canieux, secrétaire générale de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, M. Thierry Petyst de Morcourt, chargé de la fonction publique hospitalière à la Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC, M. Philippe Crépel, responsable de la politique revendicatrice de la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, M. Denis Basset, secrétaire fédéral de la branche santé de la Fédération des personnels des services publics et de santé Force Ouvrière, et M. Jean-Yves Daviaud, assistant fédéral de la branche santé, M. Jean-Marie Sala, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale SUD santé sociaux, et M. Dominique Russo, secrétaire général de l’UNSA-Directeur, représentant l’Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans le cadre de son étude du fonctionnement interne de l’hôpital, la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale a souhaité recueillir les analyses, les sentiments et les propositions des représentants des personnels hospitaliers. Certes, le fonctionnement de l’hôpital a déjà fait l’objet de très nombreux rapports. Mais notre démarche s’inscrit dans le nouveau cadre législatif institué par la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Nous privilégions en outre une approche pragmatique, quotidienne et « de terrain » des problématiques de l’hôpital. C’est la raison pour laquelle, après avoir auditionné nombre de responsables d’établissements de santé, de représentants des tutelles et du ministère, nous devions entendre également la représentation des différents personnels.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les auditions que la mission conduit depuis des mois nous ont permis d’accumuler informations, témoignages, avis et propositions sur le fonctionnement de l’hôpital. Notre méthode a été d’étudier le fonctionnement d’établissements particuliers pour en tirer des enseignements valables pour tous, une fois la part faite de ce qui relève de la spécificité de chacun. Mais aucune analyse du fonctionnement hospitalier ne saurait faire l’économie de la parole des personnels qui en ont la charge, d’autant que les charges de personnels représentent 70 % du budget des établissements hospitaliers. Cette seule raison justifierait que nous recueillions vos analyses et vos propositions concernant les questions budgétaires, la gestion des ressources humaines, les conditions de travail, la qualité du service rendu et tous autres éléments tels que l’informatisation à l’hôpital ou la tarification à l’activité (T2A), etc.
Mme Nathalie Canieux, secrétaire générale de la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT. Vaste sujet ! Je vais tenter de résumer notre position en quelques points.
Je veux dire d’abord combien les établissements sont déstabilisés par les réformes qui se succèdent depuis des années sans objectif clairement assigné. Chaque réforme s’accompagne de nouveaux outils qui contraignent les équipes, cadres et personnels, à remettre régulièrement en cause leur organisation de travail. Ces constants bouleversements sans objectif clair sont extrêmement difficiles à gérer pour les directeurs, comme pour les cadres et les personnels.
On peut ainsi s’interroger sur la finalité de la T2A, dernière innovation en date, ou sur celle de la réforme de la gouvernance prévue par la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Quand on voit qu’on demande à des équipes qui ne sont pas fédérées autour d’un objectif clair de mettre en place des outils parfois contradictoires, on se demande où on va : quel est le projet de la France pour son hôpital ?
Il faut parler aussi des énormes difficultés qui pèsent sur la gestion du personnel, notamment dans les grands établissements. Au-delà du problème des effectifs, nous mettons très clairement en cause l’organisation du travail, plus précisément l’inadéquation entre l’organisation médicale et l’organisation du travail des personnels.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pouvez-vous éclairer votre propos d’une illustration concrète ?
Mme Nathalie Canieux. Comment une équipe totalement dépendante de l’organisation du médecin qui prescrit les actes peut-elle travailler si sa propre organisation n’est pas en adéquation avec l’organisation médicale ? Au-delà se pose la question de savoir si la gestion des ressources humaines à l’hôpital fait l’objet d’une attention suffisante de la part de personnels suffisamment qualifiés. Cette question est d’autant plus préoccupante qu’on ne cesse de nous rabâcher que la masse salariale représente 70 % du budget des établissements. Comment justifier dans ce cas l’absence de tout accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ? Comment justifier que le dernier bilan social établi par la direction des hôpitaux date de 2007 ? On ne peut que s’interroger sur l’intérêt réel que l’on accorde à la gestion de 70 % du budget !
M. le coprésident Pierre Morange. Vous avez évoqué la nécessité d’une gestion prévisionnelle des effectifs, dont on connaît le caractère stratégique. Or une des observations que nous avons entendues le plus souvent au cours de nos auditions est l’insuffisance notoire d’outils de mesure et de pilotage permettant une mobilisation optimale des personnels, notamment d’une comptabilité analytique. Partagez-vous ce sentiment ?
Mme Nathalie Canieux. La véritable question est celle de la méthode employée pour mener les réformes : on impose d’emblée de nouveaux outils, sans préparer en amont leur mise en place. Tel a été le cas pour la T2A : il est désormais un peu tard pour s’interroger sur la nécessité d’une comptabilité analytique… C’est en procédant de la sorte que l’on déstabilise profondément les équipes.
En ce qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’échelon des agences régionales de santé (ARS) nous semble aujourd’hui le plus pertinent : il permettrait une gestion territoriale et transversale de l’offre et de la demande d’emplois, que les établissements soient publics ou privés. La formation relevant en grande partie des conseils régionaux, il serait cohérent de confier aux agences régionales de santé la gestion de l’emploi hospitalier.
Il faut enfin mobiliser les instances représentatives du personnel autour de cette question des ressources humaines. Or celles-ci, au contraire, perdent progressivement la faculté d’exercer leur droit de regard sur la gestion des personnels et des effectifs, alors que cela fait partie de leur rôle. Le fait que le comité technique d’établissement (CTE) soit progressivement dépouillé de ses attributions, notamment en matière économique, de gestion et d’utilisation des fonds, me semble particulièrement dommageable.
M. Thierry Petyst de Morcourt, chargé de la fonction publique hospitalière à la Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC. Cela fait des décennies que le financement des hôpitaux publics évolue, passant du prix de journée au budget global puis, aujourd’hui, à la T2A, qu’on pourrait assimiler à un prix de journée amélioré, toutes ces réformes ayant pour objectif de réduire le déficit de la sécurité sociale.
En réalité, ces réformes sans fin constituent en elles-mêmes un problème supplémentaire pour les établissements, notamment sur le plan de la lisibilité financière. Ainsi l’instauration de la T2A a rendu d’une certaine manière caducs les contrats passés sur la base du budget global entre agences régionales de l’hospitalisation et établissements hospitaliers. C’est ainsi que s’explique le déficit structurel dont souffrent certains établissements. Or, s’il est vrai que les charges de personnels représentent aujourd’hui 70 % des dépenses des établissements hospitaliers, les frais d’amortissement et les frais financiers en représentent 7,5 %, soit une part non négligeable d’un déficit, qui atteint 1 à 2 % environ.
La gouvernance hospitalière n’a cessé également d’évoluer, passant du chef de service au département, puis au pôle, et aujourd’hui au pôle avec délégation de gestion. De tels changements ne sont pas de nature à stabiliser l’organisation des établissements, d’autant qu’une réforme succède à l’autre sans que la pertinence de cette dernière n’ait été évaluée. Ainsi, dans le nouveau dispositif institué par la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui se déploie autour des pôles, que deviennent les cadres supérieurs de santé, dont on connaît pourtant le rôle essentiel dans le fonctionnement de l’hôpital ?
Il faut aussi parler de l’importance des évolutions médicales et techniques que l’hôpital connaît depuis trente ans et de leur rôle dans l’augmentation des effectifs jusqu’en 2008. Il y a une trentaine d’années, une chambre de réanimation ne comptait que quatre à huit prises électriques ; aujourd’hui, elle peut comporter jusqu’à trente-deux branchements. Cette technicité accrue suppose des personnels paramédicaux aptes à la maîtriser. Or l’impact financier de ces évolutions sur les charges de personnels, et non pas seulement sur le coût du matériel, n’est pas forcément pris en compte.
En outre, de nouvelles contraintes pèsent sur le personnel du fait de la diminution du nombre de lits et de la chute de la durée moyenne de séjour, qui a concentré la charge de travail sur un temps très court, d’où une augmentation du stress et des risques de burn out chez les personnels. Il est établi qu’en moyenne une carrière d’infirmière ne dure que vingt-cinq ans.
Pourtant, aujourd’hui, ce sont les effectifs qui sont utilisés comme variable d’ajustement comptable. Pourquoi ne pas rechercher des économies ailleurs, notamment en réduisant les frais financiers ?
M. le coprésident Pierre Morange. Le dernier rapport de la Cour des comptes consacré à l’hôpital fait état d’écarts considérables, pouvant aller d’un à huit, entre les taux d’encadrement dans des établissements similaires. Quel est votre sentiment à ce propos ?
M. Thierry Petyst de Morcourt. Les variations d’effectifs d’un établissement à un autre sont difficiles à analyser à partir de données chiffrées brutes, sans étudier chaque cas en détail. Plusieurs facteurs peuvent justifier de telles différences. Certains établissements de petite taille peuvent ne pas connaître de pics d’activité…
M. le coprésident Pierre Morange. La Cour des comptes a justement pris soin d’étudier des cas similaires, afin d’éviter les biais statistiques.
M. Thierry Petyst de Morcourt. Il restera toujours des différences d’organisation. Il peut arriver, par exemple, que des personnels interviennent dans des services dans lesquels ils ne sont pas affectés. C’est pourquoi il est difficile de se prononcer sans descendre dans le détail des actes médicaux.
M. le coprésident Pierre Morange. Vous n’avez donc pas le sentiment que cet écart d’un à huit reflète une réalité observable sur le terrain ?
M. Thierry Petyst de Morcourt. Ce n’est pas mon sentiment, en effet. Il faut comparer ce qui est comparable, tant sur le plan des établissements que sur celui des activités, et pour cela il faut des analyses plus précises.
Je voudrais enfin évoquer les difficultés de la psychiatrie. Depuis une dizaine d’années, le nombre de lits psychiatriques a été divisé par deux. Aujourd’hui, leur taux d’occupation est proche de 100 %, et la proposition de créer des établissements médico-sociaux spécifiques, un moment évoquée, est finalement restée lettre morte. Cela pose des problèmes de prise en charge, et des personnes relevant de la psychiatrie se retrouvent « dans la nature ». Il s’agit là d’un problème de santé publique, même si les personnels hospitaliers n’en supportent pas directement la charge.
M. Philippe Crépel, responsable de la politique revendicatrice de la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT. La politique en matière d’emploi hospitalier est marquée par l’absence d’anticipation et de pilotage national. Ainsi la dernière enquête sur les départs en retraite dans la fonction publique hospitalière date de 2003. Cette absence d’anticipation se retrouve en matière de numerus clausus des médecins ou de quotas de personnels paramédicaux, ce qui explique les graves tensions qui pèsent sur le recrutement de ces personnels dans certains territoires, s’agissant notamment des infirmières ou des manipulateurs en radiologie.
En ce qui concerne le financement ou la gouvernance des établissements, on saute de réforme en réforme, sans jamais dresser le bilan de l’étape précédente. J’en veux pour exemple la T2A. Le problème de ce dispositif, c’est qu’il s’agit d’une enveloppe fermée, fixée au niveau national, invariable quelle que soit l’activité de l’établissement. C’est pourquoi nous jugeons quelque peu fallacieuse l’appellation de « tarification à l’activité » : en réalité, ce n’est pas l’activité qui guide le financement, mais le financement qui détermine le tarif. Si notre syndicat souhaite que l’Assemblée nationale continue à arbitrer en la matière, nous demandons qu’une révision complète de l’évaluation des besoins réels de chaque territoire lui permette d’avoir connaissance de ces besoins au moment de voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce serait le seul moyen de pallier les disparités régionales, puisque la péréquation semble avoir été abandonnée depuis quelques années, les enveloppes affectées aux missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation (MIGAC), pourtant censées y remédier, aggravant même ces disparités, au détriment des régions les plus en difficulté.
Peu de gens se penchent sur le financement du médicament, alors que sa part progresse chaque année de 1 à 2 %, jusqu’à représenter plus de 20 % des dépenses hospitalières. Or, cette question centrale ne fait pas l’objet d’une réponse coordonnée, puisqu’il existe cinq modes différents de financement. Aucun contrôle n’est exercé sur le prix de certaines molécules. C’est pourtant ce dernier qui rend structurellement déficitaires certains services, comme ceux d’hématologie. C’est pour éviter que les hôpitaux servent à abonder les caisses des industries pharmaceutiques que nous sommes favorables à ce que les établissements d’un même territoire constituent des groupements d’achat.
M. le coprésident Pierre Morange. Cette disposition figure déjà dans la loi de 2004, qui autorise les établissements à mutualiser leurs achats.
M. Philippe Crépel. Certes, mais elle n’a été mise en œuvre que par les centres hospitaliers universitaires (CHU), qui se sont regroupés pour acheter moins cher. Encore une fois, ils sont les seuls à tirer leur épingle du jeu.
Nous dénonçons également le caractère très autoritaire du fonctionnement hospitalier. Alors que le contrat est au cœur de ce fonctionnement, liant l’État à la région, la région à l’établissement, et l’établissement au pôle, les relations contractuelles sont marquées par l’absence de transparence. Nous voulons que le contenu de ces contrats soit accessible à tous, afin d’assainir le fonctionnement de l’hôpital. En outre, l’État ne respecte pas toujours les engagements pris dans le cadre des contrats passés avec les établissements. Nous nous retrouvons de fait dans une relation dissymétrique, où une partie au contrat – l’établissement – consent aux efforts auxquels elle s’est engagée, alors que l’autre – l’État – n’assure pas l’accompagnement financier qui devait être la contrepartie de ces efforts. C’est là aussi un problème de gouvernance des établissements hospitaliers, que l’on prive ainsi de lisibilité.
S’agissant de la gouvernance hospitalière, sur laquelle une enquête de l’inspection générale des affaires sociales est en cours, nous proposons que les personnels puissent être consultés sur la plupart des sujets, avec un droit de veto sur les questions qui les concernent directement. Il n’est pas normal que le personnel d’encadrement soit aujourd’hui réduit au rang de simple exécutant et ne soit pas consulté sur les orientations de l’établissement et sur sa propre feuille de route.
Nous dénonçons également l’absence de dialogue social dans les établissements : faire du budget le seul guide des relations sociales, c’est inévitablement nourrir les conflits sociaux. En la matière, notamment sur les effectifs, les carrières et l’organisation du travail, l’État devrait être exemplaire au niveau national, comme aux niveaux régional et local. Or le dialogue social est totalement absent au niveau régional, même dans le nouveau cadre législatif institué par la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : ce ne sont pas les conférences de santé régionales qui vont créer un réel dialogue social de proximité. Au sein du ministère lui-même, on se heurte à cette absence totale de dialogue qu’on retrouve à tous les échelons. L’exemple le plus récent nous en a été donné par la négociation sur la revalorisation du statut infirmier : alors que tous les syndicats étaient opposés à la remise en cause de la possibilité d’une retraite anticipée, le ministère persiste dans cette voie.
M. Denis Basset, secrétaire fédéral de la branche santé de la Fédération des personnels des services publics et de santé Force Ouvrière. L’hôpital aujourd’hui, c’est 2 500 établissements publics de santé, 1,26 million de personnels non médicaux et 45 000 médecins ; un maillage territorial important, puisque c’est le premier employeur et le premier donneur d’ordre dans beaucoup de nos communes.
Or l’hôpital a connu un véritable empilement de réformes, jusqu’à la nouvelle gouvernance et la T2A en 2005, sans qu’aucune n’ait été évaluée avant de passer à l’étape suivante – aujourd’hui la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et la mise en place des agences régionales de santé.
L’hôpital connaît en outre des tensions budgétaires importantes, dues notamment à la fixation d’un objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Nous sommes dans une situation véritablement schizophrénique : une majorité d’établissements, du fait du déficit dont souffre leur budget, se voient imposer par les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) un plan de retour à l’équilibre qui pèse sur leur masse salariale, alors que la démographie médicale est extrêmement tendue : toutes les études statistiques, notamment celle du Conseil national de l’ordre des médecins, montrent qu’à l’horizon 2015, certaines spécialités hospitalières seront gravement déficitaires et qu’environ 200 000 à 300 000 postes vont disparaître. Il faudrait lancer aujourd’hui pour l’hôpital un « Plan Marshall » de la formation, qui serait aussi une chance pour la Nation.
Ce déficit va conduire à accélérer les restructurations hospitalières et à réduire l’activité pour des raisons budgétaires ou du fait de l’absence de personnels compétents : d’où des fermetures et des délocalisations d’activités de pointe sans qu’on ait réfléchi à leurs conséquences sur le plan de la santé publique. Aujourd’hui, on n’est pas soigné de la même manière, selon que l’on habite dans le VIIe arrondissement de Paris ou au fin fond de la Lozère.
M. le coprésident Pierre Morange. Notre rapporteur est particulièrement sensible à cette dernière remarque…
M. Denis Basset. Les établissements ont dû affronter seuls ces problèmes, faute d’une volonté politique nationale de favoriser une réponse de santé publique cohérente sur le plan territorial. Actuellement, les établissements d’un même territoire sont en concurrence sur les mêmes activités ; il faudrait au contraire mutualiser l’activité médicale dans le cadre de projets médicaux de territoire construits autour de pôles de compétence. Ainsi, dans un territoire donné, chaque établissement public de santé pourrait devenir un pôle d’excellence dans une activité donnée, doté des moyens suffisants et d’un plateau technique de référence.
C’est d’ailleurs une des finalités de la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dont nous attendons avec impatience les décrets d’application. Mais cela ne suffit pas : il faut aussi la volonté politique de donner aux agences régionales de santé, aux établissements et aux partenaires sociaux un véritable rôle de proposition, de contrôle et de participation à la définition des orientations et des choix stratégiques de l’établissement, alors qu’aujourd’hui nous sommes limités à un rôle de constat. Si la population hospitalière s’implique dans la réflexion et dans le projet d’établissement, des contraintes purement budgétaires et organisationnelles imposées de l’extérieur réduisent cet investissement à zéro.
Sans faire de catastrophisme, nous pensons que l’hôpital est à la croisée des chemins. Certes, je comprends combien la position d’un parlementaire peut être schizophrénique : en tant que maire, il défend l’établissement hospitalier dont il préside le conseil d’administration et qui est souvent le premier employeur de sa commune ; au Parlement, il doit voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais l’hôpital mérite un véritable « arrêt sur images », afin d’analyser la réponse de santé publique qu’il dispense sur l’ensemble du territoire.
M. Jean-Marie Sala, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale SUD santé sociaux. J’ajouterai aux précédentes interventions les difficultés créées par l’empilement de réformes sans qu’un bilan en soit fait. Nous avons été très étonnés que le Président de la République affirme l’an dernier que l’hôpital n’avait pas connu de réformes depuis vingt ans : celle qui vient d’être lancée est la cinquième !
Les réformes liées aux plans hôpital 2007 et hôpital 2012, encore en cours, se télescopent avec la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. De ce fait, les responsables d’établissement se trouvent contraints d’agir sur des bases nouvelles alors que les réformes précédentes ne sont pas encore entièrement entrées en vigueur. Cela pèse aussi sur la motivation des personnels.
Notre critique de la tarification à l’activité ne concerne pas seulement « l’enveloppe fermée » qu’elle institue ; la T2A prend en compte essentiellement les pathologies et non pas les patients. Or, les besoins de patients souffrant de la même pathologie peuvent être différents.
La T2A privilégie aussi les actes techniques au détriment des soins au long cours. Aujourd’hui, c’est pourtant à des maladies chroniques que nous devons majoritairement faire face.
Elle entraîne des actes inutiles. Certains établissements abusent ainsi visiblement des opérations de la cataracte, des appendicectomies, des césariennes, au détriment de réels besoins. Ce comportement provoque une inflation des coûts.
L’effort de raccourcissement à tout prix de la durée moyenne des séjours a souvent pour conséquence de nouvelles hospitalisations pour une autre cause, avec un surcoût par rapport à une hospitalisation initiale plus longue.
La réforme impose aussi des regroupements d’activités ; aujourd’hui nous parlons d’usines à soins, et – pour les maternités – d’usines à bébés. L’expression « humanisation de l’hôpital », longtemps employée, est tombée en désuétude. Pourtant, au-delà des actes, nous devons prendre en compte les patients ! Nombre de collègues considèrent que l’obligation de produire des actes à la chaîne, en négligeant les patients, leur fait perdre le sens de leur travail et les soignants sont démotivés, de jeunes professionnels très investis perdant même très rapidement courage en raison de leur charge de travail.
De plus, alors que la démocratie doit être au cœur des réformes, la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires instaure un mode de gestion autoritaire. Les critères de qualités des soins ne pèsent désormais que peu au regard des critères comptables.
L’essentiel des dépenses étant constitué des charges de personnel, c’est sur ce poste que l’on recherche des économies rapides, au prix d’horaires de plus en plus variables, établis sans concertation, de charges de travail totalement déséquilibrées par rapport à la vie personnelle, et, finalement, d’une démotivation des personnels ; quelle que soit leur envie de travailler à l’hôpital, ils veulent pouvoir mener une vie personnelle et non être entièrement soumis aux besoins du service, comme c’est aujourd’hui le cas !
Nous constatons aussi que l’emploi est de plus en plus précaire. Des personnels affectés à des emplois permanents restent pendant des années sous statut de contractuel. Outre que les équipes ont besoin de stabilité, la motivation ne viendra pas seulement de la revalorisation salariale mais aussi d’une vie au travail intéressante. Les idées du personnel ne sont absolument pas prises en compte. Le malaise est réel et il hypothèque ainsi l’avenir.
M. Dominique Russo, secrétaire général de l’UNSA-Directeur, représentant l’Union nationale des syndicats autonomes santé et sociaux. Je rejoins nombre des propos qui viennent d’être tenus. À l’hôpital, l’humain est essentiel. Si la T2A permet de contrôler le bien-fondé de la dépense, sa mise en œuvre amène à perdre quelque peu de vue les objectifs de l’hôpital. Ne comprenant plus tout à fait le sens de leur métier, les personnels se démotivent.
J’entendais récemment sur les ondes le représentant du Médiateur de la République chargé des difficultés à l’hôpital détailler l’accroissement phénoménal du nombre de plaintes de personnes soignées à l’encontre du personnel soignant. L’accent mis sur les actes techniques, l’accroissement de la productivité – l’hôpital effectue désormais plus d’actes avec moins de personnel – se sont accompagnés d’une perte de la qualité de l’accueil et de l’écoute. Traiter la maladie, notamment dans les phases de fin de vie, ce n’est pas seulement prodiguer des soins. L’écoute fait partie des vocations de l’hôpital public. La T2A a pour le moins sous-estimé les dotations affectées au financement des missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation. Le coût de certains patients de l’hôpital public, les personnes sans domicile fixe par exemple, ne peut qu’entraîner son échec. Leur accueil ne pouvant que déséquilibrer profondément le budget d’un établissement, ils seront donc sommairement soignés avant d’être rapidement renvoyés.
L’hôpital fait aussi partie d’un réseau de soins. Or, au contraire de ceux de l’hôpital, les modes de fonctionnement de ce dernier n’ont pas été modifiés. Si les patients sont désormais rapidement renvoyés chez eux, les médecins sont-ils formés à traiter des personnes qui ne sont pas parfaitement guéries ? Le service de soins infirmiers à domicile est-il à la hauteur des attentes de la population ? Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les maisons de retraite – je suis chef d’établissement de l’une d’elles – sont-elles structurées pour accueillir des personnes encore en cours de traitement ? L’ensemble du champ doit être pris en compte : la maladie ne s’arrête pas à la sortie de l’hôpital. Les agences régionales de santé devraient apporter une solution.
C’est à l’hôpital, en psychiatrie notamment, qu’aboutissent les personnes socialement déficitaires. Comme le côté social des activités de l’hôpital public a été sous-estimé, on les en fait sortir très vite. La réforme se fait donc au détriment de la population.
L’empilement des réformes, une tous les deux ans environ – même si, nous dit-on, il n’en aurait pas été conduite depuis vingt ans… – a aussi désorienté les personnels. Alors qu’il y a vingt ans, ils étaient très heureux d’effectuer quarante ans de carrière en milieu hospitalier, désormais, on entre à l’hôpital comme à l’usine, et on est très heureux d’en partir. Si la productivité s’est accrue, la qualité a diminué. Au-delà des questions financières, il faut donc sans doute repenser l’accueil, la prise en charge, la formation, la motivation des personnels.
Sans parler de la création de l’Ordre des infirmiers – une ineptie – nombre de mesures, sources de clivages, ont suscité des malaises qui font aujourd’hui les choux gras de la presse. Avant-hier, le représentant du médiateur recevait des appels de personnes qui avaient patienté pendant sept heures aux urgences avant d’être renvoyées chez elles sans soins et sans explications. Ce type d’exemples fait forcément douter de l’intérêt des milliards d’euros dépensés. Alors que plus de 90 % des personnels font bien leur travail, les 4 % ou 5 % mentionnés devant le médiateur font la une des journaux pendant des semaines. Or, l’hôpital reste un dispositif bien structuré et bien organisé. Si des économies y sont possibles, il ne doit pas perdre sa vocation humaine.
M. le coprésident Pierre Morange. S’agissant du traitement du thème de l’hôpital dans les médias, notre mission n’est sans doute pas pour vous le bon interlocuteur…
Nous avons déjà procédé à des auditions sur l’amélioration des pratiques médicales. Sur les formations, la motivation, la gestion prévisionnelle des effectifs et la masse salariale - 70 % du budget d’un hôpital – des préconisations et recommandations ont été formulées par les agences régionales de l’hospitalisation et par la Haute Autorité de santé. En tant que responsables syndicaux, quelle est votre analyse ? Dans le cadre du dialogue social, quelles améliorations méthodologiques pourriez-vous proposer pour l’amélioration de la santé de nos concitoyens ?
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Quelle est votre perception de la recherche de bonnes pratiques ? Quel est leur impact sur les établissements ? Comment les personnels peuvent-ils se les approprier ?
Comment voyez-vous les rôles respectifs des secteurs public et privé ?
Certains considèrent que les statuts bloquent l’amélioration de la gestion. Qu’en pensez-vous ?
Comment percevez-vous l’idée d’une rémunération liée à l’intéressement ? Quels devraient être ses critères ?
Enfin, quelles propositions concrètes pourriez-vous faire afin d’améliorer le fonctionnement de l’hôpital ?
Mme Nathalie Canieux. En matière de bonnes pratiques, il faut d’abord faire confiance aux salariés. Des expériences engagées ici où là méritent bien sûr d’être mutualisées, ou au moins mises en valeur. À cette fin la concertation avec les salariés doit être dynamisée dans les établissements : qui sait mieux qu’eux comment organiser le travail au sein des services ? Il faut demander leur avis sur ces expériences, qui doivent en outre être conduites en adéquation avec l’organisation médicale.
Quant à la convergence, nous ne savons pas aujourd’hui comment sont calculées les tarifications – et ce n’est pas faute d’avoir posé, à plusieurs reprises, la question. Autrement dit, nous ne connaissons pas le coût de production d’un soin dans le secteur privé ou le secteur public. Si nous savons que les facteurs – charges, salaires, conventions collectives – divergent, nous ne sommes pas en mesure de prendre en compte la formation du personnel, la qualité du soin, le temps de personnel requis. Les bases de comparaison ne peuvent pas non plus être les mêmes selon qu’un soin est effectué dans un service de semaine ou un service ouvert en continu à tous les types de public : la charge du service public entre évidemment en compte dans le calcul du coût de production de la santé.
Payer mieux les salariés n’améliore pas leurs conditions de travail. La souffrance au travail ne se résoudra pas par l’intéressement ou des augmentations de salaire, pour nécessaires qu’elles soient. Ce dont les personnels ont d’abord besoin, c’est de pouvoir venir travailler avec le sourire et d’appliquer ce qu’ils ont appris durant leur formation. Aujourd’hui, une infirmière diplômée qui sort de l’école s’est fait beaucoup d’illusions durant sa formation, et a rêvé d’un métier qu’elle ne peut pas exercer à l’hôpital. Le nombre des étudiants qui quittent la formation lors de la troisième année, celle où ils commencent à effectuer des stages dans les services, est particulièrement inquiétant : en découvrant l’hôpital, ils comprennent que ce n’est pas ainsi qu’ils veulent travailler ! L’intéressement n’y changera rien.
Nous avons déjà exposé nos propositions : obliger les établissements à revoir l’organisation du travail, en adéquation avec l’organisation médicale, faire participer à cette revue les équipes, qui connaissent le détail de leur métier et leurs besoins, et, en collaboration avec les partenaires sociaux, ouvrir un chantier sur la gestion prévisionnelle des emplois dans le territoire.
M. Thierry Petyst de Morcourt. Faut-il entendre par amélioration des bonnes pratiques des transferts d’activités médicales vers des personnels tels que les sages-femmes ou les infirmiers anesthésistes diplômés d’État ? De tels transferts ne pouvant être effectués que dans le respect des règles déontologiques des professions concernées, l’impact qu’on peut en attendre est limité. Dans certains secteurs comme la gynécologie et l’obstétrique, nous allons au-devant de difficultés de démographie médicale. La modification consécutive du champ d’activité des personnels – dans ce cas, les sages-femmes – devra alors se traduire en termes de rémunération.
Le statut des personnels de la fonction publique n’a aucun impact sur l’éventuelle réallocation des tâches entre le secteur public et le secteur privé. La base de discussion des conventions collectives du secteur privé est en général constituée par les rémunérations du secteur public. C’est tout particulièrement vrai pour les infirmières. Le statut n’est donc pas un point de blocage. De plus, les contractuels sont nombreux dans les établissements hospitaliers publics ; la variable d’ajustement, c’est eux !
Il faut aussi fixer les termes de la convergence entre le secteur public et le secteur privé. Le mode de fonctionnement et d’organisation, y compris comptable, des établissements du secteur privé, est totalement différent de celui du secteur public. Ainsi, dans les cliniques privées, il peut arriver que des anesthésistes soient rémunérés par des voies qui ne passent pas par la clinique et même qu’ils rémunèrent eux-mêmes les infirmières qui les assistent. Au contraire, dans un établissement hospitalier public, tous les coûts sont comptabilisés. Les comparaisons nécessitent donc des études très fines.
L’investissement est un élément central de l’amélioration du fonctionnement de l’hôpital. Ce sont les investissements, notamment ceux prévus par le plan hôpital 2012, qui ont creusé les déficits et la dette de l’hôpital. Pour y remédier, ne faut-il pas créer une structure parallèle à l’hôpital ? La proportion de 7,5 % pour les frais d’amortissement et les frais financiers que j’ai citée doit être comparée aux 4 % retenus par la T2A. Le remboursement de la dette entraînée par ce différentiel est financé par des contraintes sur le fonctionnement de l’hôpital : l’effectif des personnels hospitaliers devient un instrument d’ajustement pour le traitement de la dette.
M. Philippe Crépel. Dans les années 1990, les établissements ont réalisé de nombreux travaux sur les bonnes pratiques, auxquels les personnels ont consacré du temps. Ils sont aujourd’hui consignés dans des classeurs et il convient donc désormais de les traduire dans les faits, en s’appuyant sur les moyens et sur l’organisation.
En 2002, ces éléments avaient été l’un des enjeux de la réduction du temps de travail, des médecins et des autres personnels. En dépit des efforts accomplis dans nombre d’établissements, où l’on a recentré le pouvoir sur quelques acteurs, la coordination n’a pas été entièrement réussie.
La réorganisation permanente est une constante de l’hôpital. Nous devons sans cesse retravailler les plans de soins ! L’activité ne peut être programmée précisément : les évolutions et les conséquences de la maladie – complications, crises d’angoisse – sont imprévisibles.
Clarifier les rôles respectifs des secteurs public et privé est indispensable. Un pôle public fort est nécessaire. Aujourd’hui, il se compose des établissements hospitaliers publics mais aussi des établissements à but non lucratif. Nous verrions avec faveur un regroupement de ces deux composantes sous le statut de la fonction publique. Le pôle privé doit rester additionnel et optionnel, et les financements publics qui y sont consacrés minimes, à l’exception des quelques cas où ces établissements sont devenus indispensables : le code de la santé publique leur a donné une place claire dans l’offre de soins, avec une délégation de service public contractualisée sur dix ans, sans concurrence du public. La séparation doit être plus tranchée entre le secteur public et un secteur privé qui – de manière choquante – gagne de l’argent et dépend d’actionnaires dont l’objectif est la rentabilité. Certaines négociations salariales y aboutissent même à l’attribution d’actions au personnel ! Alors que la santé ne doit pas être l’instrument de tels objectifs, ce modèle se développe de façon considérable dans la prise en charge des personnes âgées et de plus en plus de places sont créées dans le secteur lucratif au lieu de l’être dans des maisons de retraite publiques. Certains appellent même l’accueil des personnes âgées « l’or blanc »… Le financeur public ne doit pas participer à cette évolution, qui aboutit à servir des actionnaires qui sont dans certains cas des fonds de pensions américains.
Nous sommes opposés à l’intéressement. Il est pour nous contradictoire avec une mission de service public. Comment un intéressement, collectif ou personnel, peut-il être recherché sur la base des moyens mis à disposition du service public ?
Nos propositions sont simples, ouvrir l’enveloppe, et faire en sorte que les choix de ceux qui décident de son affectation soient éclairés, transparents et faits en conscience.
Il faut aussi cesser d’importer dans le secteur public les méthodes de gestion du secteur privé, marchand et industriel. Elles ne sont pas faites pour lui : alors que l’hôpital aujourd’hui n’a la liberté de décider ni de ses moyens ni de son organisation, comment peut-on lui donner la liberté de fonctionnement d’une entreprise privée ?
La productivité nous paraît un objectif un peu surprenant, alors qu’il conviendrait plutôt de viser l’efficacité et la réponse aux besoins. Contrairement à ce que titrent certains médias, la satisfaction des usagers de l’hôpital public reste grande. Même s’ils se rendent compte des difficultés de l’hôpital, ils continuent à lui faire confiance et à venir y consulter. Autrement, sa place dans la permanence des soins ne serait pas aussi centrale.
Aujourd’hui – c’est une boutade – le premier établissement d’hébergement psychiatrique de France est le métro de Paris ! Nous souhaitons la création d’établissements départementaux de financement de la psychiatrie car, si la psychiatrie a été de plus en plus intégrée au sein des hôpitaux généraux, elle n’est pas au cœur de leur métier. Son financement est bien souvent traité sous forme de budget annexe ou complémentaire. Au moins pour le financement et l’organisation du soin, un pilotage départemental indépendant de l’hôpital général serait préférable et permettrait une meilleure organisation de la prise en charge dans chaque territoire. Cela dit, que les centres de traitement soient implantés dans les hôpitaux généraux n’est pas pour nous un souci : nous sommes favorables à la proximité des soins.
Nous devons aussi rendre un sens au travail des personnels – le débat d’aujourd’hui n’a du reste pas pu y échapper. Ils deviennent de véritables machines à produire du soin, sans plus avoir l’occasion de s’interroger sur le sens de leur action. Cette évolution est en contradiction avec les raisons qui fondent leur mission.
Enfin, s’agissant du dialogue social, toute parole est bonne dans l’hôpital. De l’agent d’entretien, qui peut se rendre compte de lourds dysfonctionnements, au premier responsable de la commission médicale d’établissement ou aux directeurs de service, chacun doit disposer d’un droit à l’expression. Nous devons travailler de nouveau sur la parole des agents et, surtout, sur sa prise en compte. Si les agents sont beaucoup mis à contribution, leur travail n’est pas pris en compte. Leurs suggestions sont rejetées par manque de moyens. Dans l’hôpital où je travaille, 1 000 agents avaient travaillé à un projet d’établissement ; une seule personne a pris la décision. Ce mode de gouvernance est un souci.
M. Denis Basset. Je voudrais faire preuve d’optimisme. Quinze millions de nos concitoyens fréquentent l’hôpital au moins une fois par an, pas toujours pour une hospitalisation mais aussi pour une consultation ou un acte biologique. Les Français se reconnaissent largement dans leur hôpital public. Celui-ci est aussi largement à l’origine de la puissance mondiale des industries pharmaceutique et de l’équipement médical français.
L’évolution depuis vingt ans des professions, des actes et des relations entre les médecins et le personnel paramédical ont mis de plus en plus les compétences partagées à l’ordre du jour. Le moment est celui de la « ré-ingénierie » et de « l’universitarisation » des formations initiales. Des groupes de travail sur les compétences partagées et les pratiques avancées ont été créés. Nous y avons délégué des professionnels qualifiés. Pour nous, les pratiques avancées doivent se traduire par une formation initiale adaptée aux actes qui seront demandés aux futurs professionnels, par la délivrance d’un diplôme et bien entendu ensuite par une reconnaissance statutaire.
Les métiers du secteur public et du secteur privé ne sont pas tout à fait identiques. Au sein du secteur privé, le secteur non lucratif exerce souvent des missions concourant au service public. Son personnel, médical ou non médical, a droit au regard attentif des élus et des organisations syndicales. Nous devons travailler avec lui à l’instauration d’une relation intelligente et constructive en faveur d’une organisation cohérente du soin.
Nous formulons deux propositions. La première est l’élaboration à l’échelle nationale d’un plan de formation majeur : d’ici cinq ans, 300 000 personnels vont libérer leur emploi. Ce plan devra être décliné à l’échelon régional. Il serait sans doute bon d’effectuer un « arrêt sur image » sur les transferts effectués en application des lois de décentralisation. Quelle est la situation de la gestion des instituts de formation des professions paramédicales, transférée aux exécutifs régionaux ? Quel est l’état d’avancement des synergies mises en place par l’exécutif régional entre les instituts de formation aux soins infirmiers et leur université de référence ? Les régions ont-elles toutes avancé d’un même pas ?
Par ailleurs, l’hôpital – c’est une de ses particularités – compte plus 80 % de personnel féminin. Le personnel médical lui-même se féminise de plus en plus : aujourd’hui, les femmes sont majoritaires parmi les étudiants en médecine ; les modes de fonctionnement et d’organisation du travail à l’hôpital vont en être – et c’est tant mieux – profondément modifiés. Il est indispensable de mener dès à présent une réflexion qui évitera d’être confronté à une situation dans laquelle il faudra prendre des décisions en urgence.
Notre deuxième proposition est la tenue d’états généraux aux échelons national et régional, en vue d’une planification régionale des coopérations entre établissements permettant une cohérence des projets dans chaque territoire.
M. Jean-Marie Sala. Les bonnes pratiques doivent se diffuser partout. Leur objectif ne doit pas être seulement de déterminer des protocoles de soins destinés à assurer la traçabilité des actes techniques. Elles doivent aussi traiter de la mise en place de personnels qualifiés et en nombre suffisant. Une telle démarche est loin d’être généralisée aujourd’hui, notamment en gériatrie.
Loin d’être un carcan, le statut de fonctionnaire est un instrument qui permet aux personnels de se projeter dans l’avenir et d’être acteur de leur profession. C’est donc un élément à la fois de protection et d’évolution. Ces trente dernières années, le statut n’a pas été un frein à l’évolution du monde hospitalier public. Dans la mesure où elle empêche un engagement plein et la projection dans l’avenir, c’est au contraire la précarisation de l’emploi qui nuit à la qualité.
Nous sommes opposés à l’intéressement. Pour nous, l’une des conditions de la qualité des soins, c’est le travail en équipe. Au lieu de mettre les personnels en concurrence, il faut souder les équipes, à l’inverse de la tendance aux clivages et à la « balkanisation » de l’hôpital observée ces dernières années. Un renforcement du dialogue entre les catégories, y compris les médecins, sera un gage de qualité.
Par ailleurs, seules les activités dites rentables pourront servir de base à un intéressement. Quel que soit leur intérêt éminent pour la population, les autres seront laissées pour compte.
Les cinq ou six plus grands groupes de cliniques privées commerciales sont détenus par des fonds spéculatifs. S’ils trouvent demain des activités plus rentables, ils y transféreront leurs investissements. Voilà bien une interrogation pour l’avenir de la santé.
Nous proposons d’abord que l’on réintroduise plus de démocratie à l’intérieur des établissements. Les personnels doivent pouvoir s’exprimer. Des espaces de parole doivent être réinstallés, ainsi qu’un dialogue social mature, au contraire de la gestion à la hussarde qui prévaut aujourd’hui, qui fait peut-être gagner du temps mais pas d’efficacité. Nous sommes très inquiets des ouvertures qu’offre la loi pour la réduction de la parole et de l’intervention des personnels et de leurs représentants. S’il est légitime qu’il y ait « un pilote dans l’avion », un dialogue permanent est nécessaire. L’hôpital n’est pas une usine. Ses personnels y sont en permanence en contact avec la population, dont les besoins évoluent.
M. Dominique Russo. La diffusion des bonnes pratiques s’effectuant essentiellement par le biais de la formation, celle-ci doit bénéficier d’un investissement significatif.
Au cours des cinq à dix prochaines années, près de la moitié du personnel hospitalier sera renouvelé. Il faudra accompagner ce renouvellement : la motivation des nouveaux embauchés n’est pas forcément à l’égal de celle des partants. Il faut aimer l’hôpital public !
Prévoir au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale une enveloppe spécifique pour la formation continue est un signe fort envers les personnels, marquant une reconnaissance de leur travail et de la progression de leur carrière.
Les dispositifs de validation des acquis de l’expérience doivent également être renforcés et pilotés sur un mode stratégique.
La représentation des personnels au sein des comités techniques d’établissement, mise à mal par la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, doit être restaurée. Le rétablissement de leur confiance envers la gouvernance suppose la possibilité pour eux de s’exprimer, au moins par la voix de leurs représentants. Un comité technique d’établissement, c’est une agora ; faire l’économie de la communication n’est pas raisonnable.
Enfin, nous pensons, comme Thierry Petyst de Morcourt, que la création d’un office public de gestion du patrimoine hospitalier est une piste intéressante pour distinguer ce qui va au soin et identifier le poids du bâti sur la santé. Le bâti doit pouvoir être géré au niveau national, le soin seul faisant l’objet d’une enveloppe spécifique.
M. le coprésident Pierre Morange. Merci, messieurs, pour la précision de vos propos. N’hésitez pas à nous communiquer par écrit les observations complémentaires ou les propositions que vous voudriez formuler, dans l’esprit de l’approche pragmatique qui est celle de la mission.
*
Audition de M. Pierre Faraggi, président de la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH) et M. Jean-Claude Penochet, vice-président et président du Syndicat des psychiatres des hôpitaux, Mme Rachel Bocher, présidente de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH), et M. Alain Jacob, secrétaire général, M. François Aubart, président de la Coordination médicale hospitalière (CMH), M. Roland Rymer, président du Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP), M. Jean-Pierre Esterni, secrétaire général, et M. André Elhadad, vice-président.
M. le coprésident Pierre Morange. Bienvenue à l’Assemblée nationale.
Dans le cadre des travaux de notre mission, nous avons déjà entendu nombre de responsables de l’hôpital. Notre objectif est d’élaborer un état des lieux du fonctionnement interne de ce dernier. Celui-ci a fait l’objet de nombreux rapports. La législation est très riche ; pour certains, elle est même parfois une source d’instabilité. À la lueur de la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dont l’approche est transversale, notre réflexion est marquée par le pragmatisme et le souci du terrain. Grâce aux avis des différents représentants des personnels, nous espérons pouvoir tirer, à partir d’exemples précis, des préconisations susceptibles d’améliorer de façon très concrète le fonctionnement de l’hôpital au profit de nos concitoyens, et de faire en sorte que les personnels de santé puissent s’y investir d’une façon aussi efficiente que possible.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Selon une démarche un peu différente de nos habitudes, nous nous sommes penchés, au cours de la présente mission, sur le fonctionnement d’un certain nombre d’établissements. Dans la phase actuelle de nos travaux, nous essayons de mettre en perspective nos premiers constats et d’en tirer des enseignements et des préconisations générales.
Quels sont à vos yeux les principaux dysfonctionnements de l’hôpital ? Quelles réponses proposez-vous d’y apporter pour qu’il puisse rendre un service meilleur encore ? Quelles propositions pouvez-vous faire quant aux relations entre les secteurs public et privé, le monde médical et les autres, les systèmes informatiques, la tarification à l’activité ? Comment analysez-vous les effets sur le fonctionnement de l’hôpital des conditions de travail, des statuts, de l’intéressement, de la gestion des personnels, de la formation, du codage des actes et de ses conditions ?
M. Pierre Faraggi, président de la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH). La question du statut est essentielle pour la qualité de la distribution des soins de nos établissements. Nous sommes soumis à un assaut de critiques. Notre statut, avec ce qu’il peut représenter de garanties pour la pérennité de chaque carrière et de sécurité pour l’exercice d’une profession qui comporte souvent de hauts risques, serait un handicap pour la dynamisation et la remise en question régulière des missions entre établissements. Il est même fait parfois mention de blocages liés à cette garantie statutaire.
Si nous-mêmes et les décideurs publics continuons à souhaiter que l’hôpital reste, au cœur de notre système de santé, un moteur de performance pour la distribution des soins et l’accès à ceux-ci de nos concitoyens – en particulier les plus défavorisés – nous devons nous pencher sur la démographie médicale.
Les insuffisances que celle-ci comporte déjà dans la plupart des disciplines sont appelées à se développer. Actuellement, le sous-effectif des praticiens hospitaliers, qui varie selon les disciplines et les régions, est en moyenne de 20 %. Depuis quelques années, il ne cesse de s’accroître.
Comment rénover l’attractivité d’un corps professionnel composé en majorité de praticiens au moins quinquagénaires et entrant en fin de carrière ? Attirer les plus jeunes vers les carrières hospitalières est essentiel.
Aujourd’hui, de façon générale comme en matière de permanence des soins – cette mission fait partie des charges et des responsabilités des médecins hospitaliers – le différentiel des rémunérations avec le secteur libéral est dissuasif. Précariser le statut ou le contractualiser serait donc une erreur grave. Après les évolutions plutôt peu favorables de ces vingt dernières années, le statut a au contraire besoin d’être revalorisé. Il doit permettre le maintien de perspectives attractives de carrière, de sécurité d’emploi et de retraite – même si ce point n’est pas l’objet de la présente réunion, il est crucial. Ces éléments sont indispensables pour attirer à l’hôpital de jeunes praticiens, par ailleurs intéressés par le caractère stimulant et la qualité des tâches qui y sont proposées, la dynamique du travail en équipe, la prise de responsabilité. Les conditions aujourd’hui ne sont pas remplies. Une rémunération davantage contractualisée, établie sur la base d’indicateurs de performance, serait à l’opposé de la revalorisation nécessaire. Bien sûr, rien n’interdit que, ici où là, à la marge, des dispositifs complémentaires soient mis en place. Mais les dimensions de pérennité et de non-précarité du statut sont essentielles. Comme l’hôpital public n’aura jamais les moyens d’offrir les rémunérations contractuelles du secteur privé, et que nos jeunes collègues radiologues ou chirurgiens ne rencontreront aucune difficulté s’ils choisissent les cliniques privées ou le secteur libéral, la question du statut est au cœur des mesures à prendre en faveur de l’hôpital public.
M. Jean-Claude Penochet, vice-président de la Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH), président du Syndicat des psychiatres des hôpitaux. Il n’est pas exagéré de dire que les réformes successives de l’hôpital ont provoqué chez les praticiens hospitaliers un grand désenchantement, pouvant confiner à l’amertume, et des difficultés d’exercice au quotidien. De façon certaine, ces éléments vont être accrus par les modifications induites par la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Les praticiens ont en effet l’impression d’une perte de reconnaissance, et éprouvent des difficultés à se repérer dans la nouvelle organisation.
Certes, sa mise en place n’étant pas entièrement achevée, certains espèrent que sa progression amènera une amélioration de la situation. Tel n’est cependant pas mon avis. Un mode de fonctionnement et d’exercice, fondé sur ce qu’on appelle l’équipe médicale, l’unité à taille humaine que représentait le service, travaillant dans une dimension quasi-familiale, a été brisée. La mise en place de pôles d’une échelle beaucoup plus large a dispersé entre médecins les repères anciens qui étaient fondés sur la compétence, notamment celle dont était dépositaire le chef de service en matière d’organisation ou de savoir.
À cet ancien repérage s’en substitue aujourd’hui un autre, plus bureaucratique et disciplinaire. Certes, l’hôpital – l’avion – est désormais dirigé par un seul pilote. Mais celui-ci sera-t-il en situation de le piloter ? La machine n’est pas seulement administrative ou financière, elle doit produire des actes médicaux. Or la production d’actes médicaux est fondée sur l’organisation et la conduite d’une équipe médicale.
Dans les années 1970, les spécialistes ont réalisé des études sur le management de l’hôpital. Nous savions, que, de manière irréductible, il comportait deux zones de pouvoir qui devaient marcher de front, le management administratif et financier et le travail médical. Le mode de management imposé à l’hôpital n’est pas conforme à cette organisation. La responsabilité et l’organisation médicales doivent être respectées ; elles ont une légitimité parallèle à celle de l’administration.
C’est un mode de management calqué sur celui de l’entreprise qui a été plaqué sur l’hôpital. Pourtant l’avenir montrera bien que l’hôpital n’est pas une entreprise comme les autres. Peut-être est-il encore temps de prendre en considération ses éléments spécifiques… Il est essentiel de retrouver la possibilité d’une équipe médicale valorisée et cohérente. La légitimité du fonctionnement de l’hôpital ne doit pas découler essentiellement d’une hiérarchie administrative. Ce point est, au quotidien, extrêmement délicat.
Les différents rapports publiés sur l’hôpital ont mis en évidence les variations sensibles que comporte l’application du statut. La part variable de la rémunération des praticiens présente des différences considérables selon les spécialités et les types d’activités, - activité libérale à l’hôpital, gardes… Nous sommes favorables à un plateau statutaire unique assorti de possibilités de modulation. La contractualisation ne nous paraît pas un mode de rémunération satisfaisant. Aller trop loin dans cette direction et dans l’institution d’une rémunération à l’activité supprimera tout intérêt pour les praticiens de demeurer à l’hôpital ; ils préféreront alors l’activité libérale, où les contraintes qui leur seront imposées seront moins fortes. L’hôpital doit y réfléchir. Indépendamment du montant des rémunérations, il ne peut pas être suscité d’intérêt de travailler à l’hôpital à travers la rémunération à l’activité et la contractualisation.
Enfin, et c’est un point fondamental, la décision de confier des activités de service public au secteur privé modifie l’ensemble des paramètres. Elle impose l’élaboration, en quelque sorte, d’une philosophie du service public. Dans quelles conditions des objectifs lucratifs et des comptes à rendre aux actionnaires peuvent-ils être conciliés avec une problématique de santé publique ? Une réflexion est à conduire. Des règles doivent être établies pour l’attribution de missions de santé publique au secteur privé. Elles devront tenir compte des risques de santé publique qu’induit à nos yeux, pour la population, une démarche lucrative. L’attribution de missions de santé publique au secteur privé doit-elle être la résultante de marchés confiés aux mieux offrants ? Faut-il au contraire instituer d’autres règles ?
Mme Rachel Bocher, présidente de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH). Dans une récente enquête, 45 % des 2 000 praticiens que nous avons interrogés afin de connaître l’attractivité du statut de praticien hospitalier, se disent satisfaits d’avoir choisi l’hôpital public, contre 60 % il y a dix ans.
Cette audition tombe à pic, car 2010 sera l’année d’une nouvelle loi de santé publique. À ce titre, nous ouvrirons prochainement des négociations statutaires.
Quant à la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, nous n’y étions pas totalement favorables, car l’hôpital a connu en vingt ans vingt-six réformes, qui écartent souvent les médecins, pourtant partie prenante du fonctionnement de l’hôpital. Cela étant, la réforme initiée par M. Jean-François Mattei était intéressante.
Nous savons que l’hôpital connaît des difficultés. À l’Intersyndicat, nous n’avons rien contre les réformes, à condition qu’elles soient nécessaires. Mais la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires n’est pas la réponse que nous attendions. S’agissant de la gouvernance, par exemple, il est clair que trop de management tue le management. Les règlements tatillons gênent les praticiens, qui se voient comme des prestataires de services. C’est dommage. Nous essaierons de proposer certaines améliorations lors de l’examen de la prochaine loi afin d’accroître la place des praticiens au sein de la commission médicale d’établissement et du directoire.
Selon notre enquête, les praticiens choisissent l’hôpital public pour l’engagement de service public, le fait de faire partie d’une équipe et l’implication au sein d’un système qui permet de construire des projets. Ils doivent donc être intégrés au management de l’hôpital. Sur ce point, nous devons être prudents. Les praticiens ont l’impression que le système fonctionne avec deux têtes – d’un côté ceux qui gouvernent, de l’autre ceux qui soignent – ce qui provoque un turn over très regrettable. J’ai rencontré cette situation au sein du pôle que je dirige au Centre hospitalier universitaire de Nantes, et il est extrêmement difficile, dans ces conditions, de mener à bien nos projets, d’autant que le centre hospitalier universitaire connaît des difficultés financières majeures.
La place du praticien et l’existence d’un contre-pouvoir sont donc primordiales, et sur ce point la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires n’est pas satisfaisante. Comme vous le savez, l’hôpital est administré de façon verticale : le ministre nomme le directeur, qui lui-même nomme le directeur de pôle, qui choisit ses collaborateurs. Ce système comporte des risques, d’autant plus grands que le système hospitalier est complexe.
La deuxième préoccupation importante des praticiens est la logique comptable qui prévaut dans les établissements hospitaliers. Les praticiens, qui sont conscients et responsables, savent bien que l’argent est compté, mais il leur est difficile d’admettre des suppressions de postes uniquement justifiées par le retour à l’équilibre financier, sans que l’on tienne compte de la nécessité d’apporter les soins nécessaires à tous les patients. Cette logique est très préoccupante, car l’hôpital public a vocation à soigner tout le monde et, sauf si nous n’avons plus de lit disponible, nous ne laissons jamais un malade au bord de la route. Ce n’est pas la même chose dans le système libéral. Le risque de cette logique purement comptable est de voir l’hôpital pratiquer la sélection des patients et réduire la qualité des soins, ce qui, pour les médecins que nous sommes, est insupportable. Si cette logique perdure, nous nous tournerons vers un système qui nous donnera la possibilité de soigner en accord avec notre idéologie, notre éthique et notre indépendance professionnelle.
Il faut veiller à associer le maximum d’acteurs, en particulier les médecins, aux projets de l’établissement. La logique comptable nous conduit à supprimer quarante postes, soit, mais encore faut-il savoir où les supprimer ! Contrairement à d’autres domaines de la fonction publique, l’hôpital est confronté, s’il veut assurer la permanence des soins, à la précarité et à des obligations qui renvoient les médecins à leur vocation, qui consiste à soigner tous les patients. Nous avons fini par accepter la réforme initiée par M. Jean-François Mattei. Pourquoi la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires remet-elle en cause les conseils de pôle, qui sont indispensables ? Comment faire fonctionner un pôle si les médecins n’y sont pas associés ? Le rapport remis à la ministre de la santé et des sports, au mois de juillet 2009, par M. Élie Aboud sur la promotion et la modernisation des recrutements médicaux à l’hôpital public comporte un certain nombre de propositions intéressantes, mais il y a urgence, compte tenu des difficultés démographiques dont souffrent certaines spécialités.
Nous, médecins publics, n’avons pas vocation à être les parents pauvres du système de santé. Nos jeunes collègues, internes et chefs de clinique, ne comprennent pas pourquoi ils seraient privés d’une telle manne. Nous aimons notre métier, nous avons envie de faire partie d’une équipe. La question de la rémunération, si elle n’est pas essentielle, est réelle, dans un monde où l’argent tient une place importante. En matière d’harmonisation et d’évolution statutaire, nous devons avancer. Nous sommes attachés à un statut national des praticiens, comportant des responsabilités et des rémunérations contractuelles, sur la base du volontariat et de l’indépendance professionnelle. L’enquête que nous avons menée montre que 80 % des praticiens sont défavorables à une rémunération exclusivement à l’activité. Nous estimons que l’intéressement lié à l’activité et une rémunération prévoyant une part forfaitaire et une part contractuelle peuvent être acceptés, à condition que cela soit effectué en toute transparence et en toute indépendance.
Dans notre système actuel de management, le directeur occupe la « pole position » en matière de recrutement. De par ma fonction à l’Intersyndicat, je travaille depuis fort longtemps avec les directeurs : j’entretiens avec eux un dialogue responsable. Ce n’est pas en nous opposant les uns aux autres que nous avancerons, et c’est bien le reproche que je fais à la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Le directeur n’est rien sans les médecins. S’il assume correctement son rôle de manager, il peut être d’une grande utilité. Mais ne lui donnons pas tous les pouvoirs. Il faut instaurer des contre-pouvoirs.
Pour assurer le parcours du patient, les agences régionales de l’hospitalisation jouent parfaitement leur rôle. Le domaine de la santé compte différents acteurs : l’hôpital, mais également les soins ambulatoires. Ceux-ci doivent être développés. Notre système de soins est trop hospitalo-centré. Il faut développer les articulations entre médecine générale et spécialiste, entre les soins médicaux et paramédicaux, entre les structures sanitaires et médico-sociales. Les praticiens souhaitent être davantage impliqués au sein des agences régionales de santé, pour donner à celles-ci une plus grande tonalité médicale, éviter les doublons et faciliter les restructurations.
M. Alain Jacob, secrétaire général de l’Intersyndicat national des praticiens hospitaliers. Dans l’offre de soins nationale, l’hôpital public, en dépit des problèmes auxquels il doit faire face, joue un rôle très important. Il correspond à ce qui se fait actuellement de mieux en termes de permanence des soins, d’accueil, d’équité et d’accès aux soins. Il était important de le rappeler. Il est de la responsabilité de tous de défendre une telle qualité. L’hôpital est également le lieu de l’enseignement et de la recherche médicale. Là encore, nous avons le devoir de maintenir cette qualité, enviable, et enviée dans de nombreux pays.
Pour cela, la démographie médicale joue un rôle important. Si elle est affectée par le creux du numerus clausus et le départ à la retraite des papy et mamy-boomers, le nombre de praticiens hospitaliers a pourtant augmenté de manière considérable. Cela dit, les activités des praticiens ne sont pas toutes équivalentes. Depuis quelques années, on voit des médecins généralistes occuper à l’hôpital des postes de médecins urgentistes ou de gériatres. Ceci est dû à la réduction du temps de travail et à la mise en œuvre de la permanence des soins.
La question de la démographie va devenir primordiale. Nous ne devons pas nous contenter de chiffres généraux, mais évaluer les besoins pour chaque spécialité. Certaines sont de plus en plus assurées par le secteur privé. Les spécialités liées au cancer - chimiothérapeutes, radiothérapeutes, anatomopathologistes – souffriront bientôt du départ à la retraite d’un grand nombre de praticiens : il est impératif de recruter des praticiens dans ces disciplines.
Si l’on veut attirer les praticiens à l’hôpital, il faut qu’ils se sentent acteurs de leur activité et que leur place à l’hôpital soit valorisée. Hélas, leurs efforts ne sont pas toujours reconnus, et le départ d’un praticien vers le secteur privé correspond souvent à une accumulation d’incidents et de vexations.
Cette reconnaissance doit s’accompagner d’une valorisation, à la fois financière et professionnelle. En outre, il faut faire en sorte que les trajectoires professionnelles des praticiens soient plus lisibles. Pour les sécuriser, l’hôpital doit assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences médicales. L’avancement ne doit pas être uniquement lié à la démographie ou au départ du chef de service, mais à une formation continue de qualité, à un projet médical mené à bien. Cette lisibilité serait à mon avis de nature à attirer les praticiens à l’hôpital, à les fidéliser et à leur donner une place enviable dans la société.
M. le coprésident Pierre Morange. Le codage des actes est l’interface entre les soins délivrés et les problématiques organisationnelles qui résultent notamment de la tarification à l’activité. Quelle est votre approche de ce sujet ?
M. François Aubart, président de la Coordination médicale hospitalière (CMH). Je souhaite aborder devant vous les questions du financement – l’argent est le nerf de la guerre –, des structures, des hommes qui les animent et des malades.
Je commencerai par les hommes – et plus précisément par les femmes – en soulignant le rôle important des infirmières. Je voudrais dénoncer une ambiguïté. La notion de suppression de postes est une boîte de Pandore pleine de préjugés et de sous-entendus. À l’hôpital travaillent 82 000 médecins et 94 000 personnels administratifs. Les infirmières sont la cheville ouvrière de la qualité des soins, même si cette dernière est imprévisible. Il me paraît important de le souligner, dans un contexte de contraintes financières durables. Les récents propos tenus par le Président de la République à Perpignan, le 12 janvier 2010, qui engagent tous les hôpitaux publics à équilibrer leurs comptes en 2012, sont quelque peu irréalistes car il faudrait d’abord équilibrer le budget de l’État… Parce qu’ils mettent une pression considérable sur l’hôpital ces propos sont aussi contre-productifs. La Coordination médicale hospitalière considère les effectifs, l’évolution, la promotion et les formations des infirmières comme une chasse gardée. Si nous voulons apporter sinon de la sérénité, tout au moins du sens au principe de réduction des effectifs, disons-le clairement : aucun poste d’infirmière ne doit être supprimé à l’hôpital.
J’en viens aux médecins. L’hôpital n’est pas la somme des statuts, bien que le rapport demandé par la ministre de la santé et présenté par M. Élie Aboud porte sur « la promotion et la modernisation des recrutements médicaux à l’hôpital public ». Sur les 41 000 praticiens hospitaliers en exercice, beaucoup ont déjà de nombreuses années de carrière. Ce qui importe aujourd’hui, c’est l’avis des jeunes médecins. Les éléments qui doivent prévaloir pour attirer l’excellence à l’hôpital sont moins quantitatifs que qualitatifs. La modularité de la carrière est un élément important. Imaginer que l’on occupera la même fonction pendant près de trente ans est forcément démotivant. Est-il supportable pour un médecin urgentiste d’imaginer qu’il restera aux services des urgences de l’hôpital de Poissy toute sa vie ? Il faut donc s’intéresser davantage à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Il faut également ouvrir des chantiers tabous, comme le temps de travail, et faire évoluer un statut qui date de 1983 et n’a d’unique que le nom. Ce statut prévoit des rémunérations variables, mais qui sont attribuées de manière totalement opaque, ce qui entraîne des rapports de force permanents entre les spécialités, les disciplines et les situations locales.
J’en viens aux structures. Notre organisation n’a pas condamné la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. La création des agences régionales de santé et l’organisation territoriale de la santé étaient indispensables. Ce n’est pas au niveau d’un établissement que l’équilibre financier doit être obtenu, mais au niveau d’un territoire. C’est le seul moyen de bien répartir les missions, les plateaux techniques, les équipes et les hommes. Certains établissements sont contraints à des dépenses plus importantes que d’autres, qui réaliseront de meilleures recettes. D’où l’intérêt d’une gestion territoriale.
Je reviens sur le caractère boiteux de la tarification à l’activité, qui tient compte uniquement des actes techniques. Quant à la classification commune des actes médicaux (CCAM) cliniques, elle n’a cessé de péricliter, du fait des groupes de pression et intérêts divers. À l’hôpital, il n’y a pas que des actes techniques et cliniques : les échanges entre le malade et le soignant ne relèvent pas de l’acte marchand. Cet élément, très subtil, doit également être pris en compte. D’autant que si l’hôpital bénéficie d’un financement socialisé – dont vous êtes, en tant que parlementaires, les garants – le secteur privé a la capacité de sélectionner à la fois les pratiques, les praticiens et les patients, ce qui, naturellement, rend la comparaison impossible.
Le temps de travail est un sujet tabou. Mais là encore, nous sommes devant un paradoxe : les médecins qui travaillent pendant leur temps de RTT côtoient les mercenaires, ceux qui font des heures supplémentaires, et, parmi les personnels non médicaux, de jeunes retraités qui reviennent travailler à l’hôpital en tant qu’intérimaires. Cette incohérence est préoccupante. Il faut mettre à plat les temps de travail des uns et des autres, sans toutefois remettre en cause les principales garanties. Mais notre système est mourant, il faut le remettre sur pieds.
Je terminerai par les malades. À l’hôpital, même si elle est imprévisible, la qualité est au centre du management. Mais nous ne disposons pas d’indicateurs suffisants pour garantir aux patients cette fameuse « bientraitance » à laquelle nombre d’acteurs travaillent actuellement. De quelle façon traduire dans les engagements des équipes médicales la qualité des prestations, des compétences, des services rendus ? Les recertifications pourront-elles garantir cette qualité durant toute une carrière ? Un jeune chef de clinique qui, à un moment donné, choisit de s’établir en secteur 2, dans un établissement privé, disposera d’un droit de tirage tout au long de sa carrière. À l’hôpital comme en ville, que l’on utilise ou non le terme de recertification, il faudra bien un jour évaluer la qualité, la compétence et l’engagement des médecins.
M. Roland Rymer, président du Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP). Je souscris à tout ce qui vient d’être dit. En 2003, alors que l’hôpital était en crise – crise démographique, l’hôpital se vidait de ses meilleurs éléments, crise des vocations et crise financière – le budget global était à bout de souffle. La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, initiée par M. Jean-François Mattei, a marqué un progrès important. Nous l’avons soutenue et avons même participé à sa promotion. La création du conseil exécutif et des pôles a permis de décloisonner l’hôpital, même si ceux-ci auraient été plus efficaces en étant plus centrés sur le métier. Mais nous sommes restés au milieu du gué et la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie nous a partiellement déçus. Le principe de la délégation de gestion aux pôles n’a pas été réellement appliqué. Même si des contrats ont été signés, ceux-ci n’ont pas été appliqués et la réforme a finalement été vidée de son sens. Elle est en grande partie responsable de l’échec partiel de la loi.
Fallait-il pour autant une loi supplémentaire ? Rien n’est moins sûr, mais la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a été votée et il nous reste à en supporter les conséquences. Elle ne correspond pas tout à fait à nos attentes, même si les discussions en cours sur les décrets d’application pourraient aller dans le bon sens.
Trois problèmes cruciaux se posent encore à l’hôpital. Le premier concerne la performance technique : l’hôpital en a longtemps eu l’apanage, ce n’est désormais plus le cas, il la partage avec le secteur privé. C’est une bonne chose pour la population, mais il ne faudrait pas que l’équilibre s’inverse et que les hôpitaux deviennent les parents pauvres de la santé. L’hôpital accueille des malades lourds et doit pouvoir les traiter dans les meilleures conditions.
Autre problème de l’hôpital, l’entretien du patrimoine. Sur ce point, nous sommes extrêmement inquiets car ce patrimoine est depuis longtemps délaissé et les contraintes financières ne peuvent qu’aggraver cette situation. Nous sommes confrontés à des problèmes de gestion des risques et de sécurité et les conditions d’accueil deviennent désastreuses. Cette situation a un impact sur la démographie médicale.
J’en viens justement à la démographie médicale. L’hôpital doit être capable de garder les médecins, en particulier ceux qui répondent le mieux à leur mission. Ce n’est pas uniquement un problème de rémunération. L’exercice hospitalier est pénible. Le problème majeur est celui de la masse critique : les équipes trop petites sont insuffisamment équipées et les médecins sont isolés. La recherche en pâtit, notamment dans les centres hospitaliers universitaires. Ceux-ci connaissent une crise des médecins hospitaliers universitaires due en partie aux contraintes hospitalières qui se sont accrues considérablement au cours des dernières années, au détriment de la recherche. Les jeunes générations de médecins sont beaucoup plus ouvertes à la recherche que les précédentes mais l’hôpital, de plus en plus prégnant, en gêne l’exercice. Tout ceci suscite un malaise important.
Par ailleurs, s’agissant des points positifs de la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, nous attendons avec beaucoup d’intérêt les textes d’application du volet territorial de la loi, concernant les agences régionales de santé, les communautés hospitalières de territoire et les mises en réseau d’établissements qui nous paraissent de nature à sortir l’hôpital de son isolement. Encore faut-il que les communautés hospitalières de territoire soient suffisamment intégrées. Il ne faudrait pas qu’elles ne soient qu’un échelon administratif de plus.
J’en viens au malaise des praticiens hospitalo-universitaires, dû en particulier à la question de leur retraite. Comme vous le savez, ceux-ci dépendent de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Or, cette institution se trouve dans une situation très inquiétante. Cela met en danger la recherche, car les praticiens hospitalo-universitaires ne bénéficient, pour leur retraite, que d’un complément minime sur la part hospitalière, l’hôpital n’étant pas leur employeur principal.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’instauration de bonnes pratiques ne fonctionne pas au mieux. Peut-on aller plus loin en ce sens ? Quelles propositions concrètes pouvez-vous faire ?
M. André Elhadad, vice-président du Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux publics. La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie avait trouvé un bon équilibre entre le service, lieu de haute technicité, dirigé par un chef de service reconnu pour sa compétence, et le pôle, dont le responsable est un chef de pôle, sorte de manager médical, conformément au fameux principe de subsidiarité. La définition de pôles avait une vocation pédagogique et visait à décloisonner l’hôpital. Cet objectif n’a pas été atteint en raison de l’échec de la délégation de gestion, dont les directeurs des hôpitaux sont, en grande partie, responsables. La loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a presque fait disparaître les services, mais les députés les ont sauvés en prévoyant dans la loi que les pôles peuvent comporter des « structures internes » de prise en charge des malades. La difficulté est maintenant de les faire exister dans les textes réglementaires, et pas uniquement dans le règlement intérieur de l’hôpital.
La légitimité du management au niveau du pôle se rattache aux devoirs éthiques du médecin. Nous sommes passés de la médecine de la contemplation, qui ne pouvait prodiguer aux patients que de l’humanité, à une médecine terriblement efficace, avec pour corollaire la iatrogénie et les dégâts qu’elle peut entraîner. Il faut donc assurer la sécurité aux patients, et c’est le premier devoir éthique des médecins, le deuxième étant l’efficacité des soins. Pour cela, il convient d’utiliser le plus possible les résultats des recherches scientifiques et la médecine fondée sur la preuve – Evidence based-medicine. Nous ne disposons malheureusement que de 15 à 20 % de ces preuves : utilisons-les.
Le troisième devoir éthique est la performance. Lorsque l’efficacité peut être atteinte à un moindre coût, pourquoi s’en priver ? En tant que médecin, je considère que le management – la recherche de la performance – est un élément d’efficacité et de sécurité, et par conséquent un devoir éthique. C’est cette pédagogie qu’il faut introduire dans les hôpitaux. Nos collègues doivent accepter cette nécessité, sans pour autant nier l’importance du service. Le chef de pôle, qui, bien que n’étant pas le chef hiérarchique, est formé pour le management, pour mener des projets médicaux au nom de la communauté des chefs de service, doit rechercher la performance. Nous sommes, au sein de notre syndicat, sensibles à cet argument, mais cette pédagogie ne pourra être mise en place que s’il existe une véritable délégation de gestion. À cet égard, nous attendons avec impatience les textes réglementaires.
M. Jean-Pierre Esterni, secrétaire général du Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux publics. Je vais tenter de répondre à votre question concernant la qualité et l’hétérogénéité des référentiels. J’aborderai trois points : la motivation et l’organisation du travail à l’hôpital, la gouvernance territoriale et les statuts.
S’agissant de la motivation, l’environnement dans lequel nous travaillons a considérablement changé. J’exerce la médecine hospitalière depuis près de trente-cinq ans : je suis devenu un médecin interactif. Je suis désormais confronté à des priorités de santé publique, à une concurrence de plus en plus aiguë entre les plateaux techniques, publics et privés. Au sein de ma structure, je dois faire face à des disciplines et à des métiers de plus en plus nombreux, notamment avec les fameux codages et les nouveaux systèmes d’information.
Le système d’information hospitalier, à la fois balbutiant et très sophistiqué, souffre d’un manque d’harmonisation. J’ai pour ma part du mal à m’y intégrer, bien que la collecte des informations à la source fasse partie de ma fonction. Mais je me trouve dans une chaîne de production. Centrer la tarification à l’activité sur certains actes médicaux a une conséquence : les actes cliniques et intellectuels ne sont absolument pas valorisés, et moins encore les actes de coordination, qui assurent pourtant la qualité des soins à l’hôpital. L’acte médical n’est qu’un des éléments d’une chaîne de production ; le secrétariat, l’accueil, l’administration, l’écoute téléphonique sont tout aussi importants pour assurer l’efficience. Pourquoi, dans ces conditions, avons-nous un codage au tarif, et non à l’efficience ?
Quant au système d’information, il n’est absolument pas optimisé. Certains établissements utilisent la base d’Angers, d’autres codent à la main, d’autres encore pratiquent le case-mix. Tout cela est très opaque, et il est difficile d’effectuer des comparaisons et de faire évoluer les tarifs au juste prix.
Si, en matière de référentiel qualité, les choses ne vont pas assez vite, c’est que l’obligation concerne uniquement la profession médicale. Or, les médecins ne sont pas les seuls acteurs de la qualité au sein de l’hôpital. Pour que la qualité augmente dans tous les établissements, il faut réduire l’hétérogénéité territoriale. En l’absence de politique territoriale et d’harmonisation des communautés hospitalières, nous ne pourrons améliorer la qualité. Tant que le pôle sera situé à l’intérieur d’une structure hospitalière, il ne s’intéressera pas à la structure voisine, se contentant d’être compétitif.
La fameuse interactivité est déséquilibrée. Moi qui exerce depuis trente ans, j’ai subi une régression en matière de pouvoir de décision, et je me demande si je ne deviens pas un simple agent d’exécution en matière de permanence des soins ou de tarification. Pour un jeune médecin, ce n’est pas très motivant !
Pour ce qui est de la gouvernance territoriale, nous avons soutenu les réformes tendant à instaurer une gouvernance médico-administrative. La tendance à une gouvernance verticale que nous constatons aujourd’hui ne nous paraît pas aller dans le bon sens, car elle priorise la mise en œuvre de projets qui ne sont ni des projets d’établissement ni des projets médicalisés, mais des projets de retour à l’équilibre. Cette tendance n’est pas un bon modèle de gouvernance. Si j’osais un parallèle, je dirais que le pilotage vertical du plan grippe n’a pas été un modèle, pas plus au plan de l’efficacité qu’au plan économique. En bref, il faut mettre en place une véritable délégation de gestion et nous appuyer sur les projets médicalisés, en partant de ceux-ci au lieu de les adapter aux objectifs. Les agences régionales de santé nous en donneront peut-être l’occasion.
J’en viens aux statuts. Il faut, dans ce domaine, diversifier et reconnaître la diversité des parcours. Il est impensable pour un praticien d’envisager une carrière linéaire. Il faut par ailleurs revoir la politique d’intéressement, tant sur le plan matériel qu’en termes d’autonomie. Un médecin autonome éprouve plus d’intérêt pour son métier.
Il faut valoriser les actes intellectuels et cliniques, associer les personnels non médicaux, dont chacun reconnaît l’importance, à l’intéressement et valoriser le professionnalisme. Le médecin doit rester un manager. Pour cela, il faut admettre la délégation de gestion et de responsabilité.
M. Roland Rymer. S’agissant du passage d’un établissement à l’autre, nous attendons beaucoup de la communauté hospitalière de territoire, nouvelle organisation territoriale et régionale de l’hôpital, à condition qu’elle ne soit pas un échelon administratif supplémentaire.
M. le coprésident Pierre Morange. La Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH) et, désormais, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) réalisent un travail de grande qualité. Nous regrettons que les bonnes pratiques concernant les motivations du personnel, le rapport coût-efficacité et les dimensions éthiques, sanitaires et financières, ne soient pas généralisées. Savez-vous qu’à l’hôpital Beaujon, nous avons réussi, par des mesures simples, à réduire de 40 % en quelques mois le délai d’attente aux urgences ? Les solutions existent donc. Nous regrettons l’inertie qui prévaut en matière d’organisation du travail.
M. Roland Rymer. Je partage votre analyse. À l’hôpital dans lequel je travaille, nous avons utilisé très largement des référentiels de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers.
M. François Aubart. Je suis d’accord avec les intervenants précédents. Les structures de qualité font le miel de l’Administration, mais il existe un hiatus entre ces structures et le réseau matriciel de l’hôpital. En bref, nous sommes allergiques à l’Administration…
M. le coprésident Pierre Morange. Merci pour votre sincérité !
M. François Aubart. Je ne nie pas la place de l’Administration, mais il importe de médicaliser la décision sans multiplier les structures tutélaires et les strates intermédiaires. Il faut mobiliser les structures professionnelles et référentes qui nous sont naturelles – collèges, sociétés savantes et scientifiques –, responsabiliser les équipes et les doter de chefs d’équipe leaders. Comme l’a fort bien dit Freud : « Il y a un délire beaucoup plus grand que celui de l’incohérence, c’est le délire de la cohérence ». N’abusons pas de l’homogénéité !
M. Mallot a posé une question essentielle : que sera l’hôpital en 2020 ? Certes, les législateurs n’investissent, notamment à travers les lois de financement de la sécurité sociale, que dans l’immédiateté. Mais si nous n’engageons pas une réflexion sur ce que seront notre système de santé et l’hôpital en 2020, comment saurons-nous si nous avançons dans la bonne direction ?
M. Jean-Claude Penochet, vice-président et président du Syndicat des psychiatres des hôpitaux. Vous nous avez demandé d’indiquer nos préconisations pour améliorer les pratiques et la qualité à l’hôpital. Celui-ci est devenu une véritable usine à gaz, en particulier à cause des accréditations. Nous avons bureaucratisé la qualité, ce qui est le meilleur moyen d’aboutir à un échec. Il faut revenir à des pratiques plus simples. Ce sera peut-être difficile, pourtant nous savons qu’un simple questionnaire avant une intervention chirurgicale réduit de 40 % le nombre des conséquences malheureuses. Il faut adopter des procédures simples, qui sont au demeurant peu coûteuses.
Qu’est-ce, d’ailleurs, que la qualité ? Il convient tout d’abord d’encourager certaines pratiques, notamment à travers les rémunérations. Mais il y a un écueil : la préoccupation de qualité se limite aux secteurs qui ont décidé de l’appliquer, elle ne concerne pas le patient qui attend dans le couloir ! La qualité doit être comprise dans sa globalité, et l’ensemble des acteurs doivent se l’approprier.
Les médecins sont naturellement intéressés par la qualité, mais lorsque les procédures d’accréditation parviennent à l’hôpital, on voit bien qu’ils ne se les sont pas appropriées, ce qui pose la question de l’organisation et du management à l’hôpital. Un médecin qui appartient à une équipe est heureux de participer aux actions de soins. Entre le pôle et la cellule de base, il manque un échelon que l’on a cassé : le service. Il faut absolument le recomposer, sur une base médicale. Un médecin doit pouvoir décider à quel poste, à l’intérieur du service, il veut affecter les infirmières. Or, la décision ne lui appartient plus. Et l’échelon du pôle, beaucoup trop important, ne permet pas au chef de pôle de gérer ces affectations au quotidien.
Par ailleurs, il faut financer la formation des médecins, et ce financement doit être totalement déconnecté des intérêts de l’industrie pharmaceutique. Si la République veut des hôpitaux qui fonctionnent bien, elle doit en garantir la qualité et donner aux médecins les moyens d’être financés. Or, la formation médicale continue représente 1 % de la masse salariale !
Il est essentiel de réévaluer la rémunération de base, car 20 % des postes sont budgétisés mais ne sont pas occupés. Il nous manque aujourd’hui un médecin sur cinq ! Comment, dans ces conditions, proposer une médecine de qualité ? Certaines populations de 70 000 à 100 000 habitants n’ont pas de psychiatre ! N’est-ce pas là qu’il faut améliorer la qualité ? Nous ne nous en sortirons pas sans engager une réflexion sur la place du praticien au sein de l’hôpital.
M. Pierre Faraggi, président de la Confédération des praticiens des hôpitaux. Je suis parfaitement d’accord avec ce qui vient d’être dit. Je rappelle que la qualité et l’accessibilité des soins à l’hôpital se réfèrent d’abord à la démographie professionnelle. François Aubart a eu raison de souligner le rôle des infirmières. Le déficit des effectifs médicaux se réfère à l’attractivité des carrières médicales à l’hôpital, qui repose sur la responsabilité des praticiens, l’initiative et la promesse d’un parcours professionnel exaltant. Nous sommes issus de spécialités différentes, mais chacun d’entre nous reconnaît qu’il exerce un métier passionnant. Il faut qu’il le reste, et l’attractivité de notre métier passe par l’indépendance professionnelle et les capacités d’initiative. Pour assurer la qualité des soins et la cohérence des pratiques, il faut médicaliser la décision. C’est incontournable.
L’attractivité de la carrière médicale à l’hôpital public repose également sur des conditions de rémunération attractives. Cette attractivité doit être renforcée, ou tout au moins préservée.
M. le coprésident Pierre Morange. Je vous remercie d’avoir répondu de façon précise sur un sujet aussi vaste, et je vous invite à nous faire part de toute proposition complémentaire.
*
AUDITIONS DU 28 JANVIER 2010
Audition de M. Laurent Degos, président de la Haute Autorité de santé, MM. Jean-Michel Dubernard et Jean-Paul Guérin, membres du collège, et M. François Romaneix, directeur.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous accueillons, pour cette première audition d’aujourd’hui, M. Laurent Degos, président de la Haute Autorité de santé (HAS), M. Jean-Michel Dubernard et M. Jean-Paul Guérin, membres du collège, et M. François Romaneix, directeur.
La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale a conduit ses auditions sur le fonctionnement de l’hôpital selon une nouvelle méthode, consistant à étudier des cas particuliers d’établissements hospitaliers afin d’en tirer des enseignements susceptibles d’être étendus à l’ensemble des établissements. C’est pourquoi il nous a paru opportun, à ce stade de notre travail, d’auditionner la Haute Autorité de santé, étant donné l’importance de son rôle en la matière.
M. Laurent Degos, président de la Haute Autorité de santé. Il est vrai que l’optimisation des soins au sein de l’hôpital est une des missions majeures de la Haute Autorité de santé. Je vous ai d’ailleurs transmis un rapport de la Haute Autorité de santé consacré au recours à l’hospitalisation en Europe, comparant l’organisation des soins dans les différents pays européens. Il apparaît que cette organisation varie à un tel point que les conclusions générales qu’on peut en tirer n’ont pas de portée pratique.
On peut cependant observer que tous les pays, et pas seulement les pays européens, cherchent à réduire, par l’accès – optimisé ou recommandé – ou par d’autres moyens, le poids de l’hôpital dans le parcours de soins.
Par ailleurs, une étude de Victor Rodwin comparant les taux d’hospitalisation évitable place la France en bonne place, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne. Je pourrais également vous transmettre un rapport du Commonwealth Fund portant sur les différences dans l’accès à l’hospitalisation.
La première question qu’il faut se poser est de savoir si on veut accroître ou diminuer la place de l’hôpital dans le parcours de soins. La tarification à l’activité (T2A) est un excellent moyen pour accroître l’activité de l’hôpital – cet outil a d’ailleurs été utilisé dans les pays qui souffraient d’un défaut d’accès à l’hôpital. En revanche, si on veut diminuer le poids de l’hôpital, la T2A doit être contrebalancée par ce que nous appelons la qualité des soins : c’est là que la Haute Autorité de santé prend toute sa place, notamment par sa mission de certification des établissements de santé, en particulier dans le cadre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Le financement des établissements ne doit pas en effet tenir seulement à l’activité mais également à la qualité.
Dans le même ordre d’idées, nous avons étudié, avec l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), le lien entre le volume d’activité des hôpitaux et la qualité des soins en France. Il en résulte, schématiquement, que le volume d’activité n’a pas grande incidence sur la qualité des soins courants. En revanche, plus la technicité de l’intervention s’accroît, plus le lien entre qualité et volume se renforce, avec des effets de seuil pour les opérations les plus complexes, notamment les greffes, à savoir que la qualité n’est obtenue qu’à partir d’un certain volume.
Si l’on veut voir diminuer le poids de l’hôpital, une deuxième question se pose alors : celle de la part de la chirurgie et de la médecine ambulatoires. La France se distingue en effet par un faible taux de prise en charge en chirurgie ambulatoire : 30 %, contre 80 % dans d’autres pays. La Haute Autorité de santé est ainsi prête à favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire, dans le cadre notamment de la convention de partenariat passée avec l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), par le biais de l’évaluation des actes et des procédures, de la définition de check-list, de la promotion des bonnes pratiques, etc. MM. Jean-Michel Dubernard et Jean-Paul Guérin vous en parleront plus longuement, puisqu’ils ont participé ici même au colloque consacré à la chirurgie ambulatoire, intitulé « La chirurgie ambulatoire : enjeux et perspectives », organisé sous la présidence du Professeur Olivier Jardé, député de la Somme, avec le concours de la Haute Autorité de santé, de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et de l’Association française de chirurgie ambulatoire (AFCA).
Cette question nous interroge sur la finalité de la T2A : celle-ci conduit-elle plutôt à rendre transparente la facturation, afin de connaître le juste coût, ou à changer les pratiques ? Ainsi, en surfacturant très nettement les soins palliatifs et la dénutrition sévère, la V11, dernière version de la T2A, incite les hôpitaux à prendre en charge les personnes en fin de vie ou sévèrement dénutris. Il apparaît donc que la T2A est à la fois un moyen d’appréhender le juste coût et un levier. À cet égard, une incitation tarifaire serait à même de valoriser la chirurgie ambulatoire, puisqu’il vaut mieux actuellement, du point de vue du tarif, hospitaliser les patients plus de vingt-quatre heures.
Ces considérations relatives à la chirurgie ambulatoire pourraient être étendues à la médecine ambulatoire dans son ensemble, notamment à la cancérologie ambulatoire, où la marge de progression est significative.
La troisième question est celle de la place de l’hôpital au sein du parcours de soins. Il serait aujourd’hui préférable d’évaluer ce parcours pour chaque pathologie, depuis les premiers symptômes jusqu’à la fin de la prise en charge, plutôt que d’analyser, secteur par secteur, les actes du médecin traitant, du spécialiste, de l’hôpital, etc. C’est ce qu’a fait la Haute Autorité de santé pour l’infarctus du myocarde ou l’accident vasculaire cérébral (AVC). Considérer ainsi le parcours de soins maladie par maladie, et non plus structure par structure, constitue une véritable révolution culturelle dans l’organisation des soins, dans notre pays du moins, car d’autres nous ont précédés : je pense notamment aux bundles, les « bouquets », qui décrivent la prise en charge du patient tout au long du parcours de soins.
Nous sommes prêts à inscrire notre travail avec les futures agences régionales de santé (ARS), dans cette nouvelle perspective, non seulement en adaptant les indicateurs actuels de comparaison de structures permettant de réexaminer les process – du médecin traitant ou de l’hôpital, sujet qui nous préoccupe aujourd’hui –, mais également en élaborant des indicateurs de résultat mesurant un parcours de soins dans son ensemble, maladie par maladie. Il s’agirait, par exemple, d’établir un indicateur de mortalité ou de morbidité pour l’infarctus du myocarde, pour l’accident vasculaire cérébral, etc.
Quatrième question : peut-on ou non accroître les bonnes pratiques, conformément à la mission assignée à la Haute Autorité de santé ? Celle-ci ne se contente pas de favoriser les bonnes pratiques : elle se mobilise pour que les professionnels s’approprient ce travail. Ainsi, nous avons fait en sorte que les recommandations soient plutôt faites par les professionnels eux-mêmes – la Haute Autorité de santé se réservant la labellisation –, dans le cadre de collèges de bonnes pratiques – désormais conseils nationaux : celui de la médecine générale regroupe quarante-sept organisations.
Nous avons également assuré, par le biais de 102 organismes agréés, la mise en œuvre effective du concept du développement professionnel continu (DPC), avec 25 000 médecins concernés, qui rassemble la formation médicale continue (FMC) et l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). Toutefois, si la méthodologie et l’évaluation de ce nouveau dispositif relève de la mission de la Haute Autorité de santé, sa mise en œuvre doit être assurée par les professionnels eux-mêmes.
Toujours dans le cadre de l’évaluation des bonnes pratiques, nous travaillons à l’amélioration de la sécurité des soins, au moyen notamment du dispositif d’accréditation des médecins exerçant dans des spécialités à risque, et nous avons établi non seulement des revues de mortalité et de morbidité, mais également des check-lists, relatives notamment à la sécurité des soins au bloc opératoire.
Par ailleurs, nous nous demandons si le développement professionnel continu n’aurait pas vocation à s’adresser aux autres professions, notamment aux cadres soignants. Le rôle de ces derniers doit-il en effet se limiter à l’organisation des plannings ou ne doit-il pas être axé sur la prestation de soins ?
En conclusion, l’évolution de la médecine, qui ne cesse de gagner en complexité, nous conduit à nous interroger sur le parcours de soins et la place de l’hôpital dans ce parcours. C’est ce que fait la Haute Autorité de santé, en collaboration avec les agences régionales de santé, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, et d’autres organismes compétents dans le domaine de l’hôpital.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La T2A a souvent été évoquée au cours de nos auditions : on s’est interrogé notamment sur la question de savoir si ce qui est censé être un outil de gestion objective des coûts n’a pas pour effet pervers d’orienter l’activité de l’hôpital – cette dernière réponse étant généralement retenue. Si je vous ai bien compris, il serait possible d’utiliser la T2A afin d’améliorer la qualité des soins. Que faudrait-il faire pour aller dans cette voie ? Les autorités qui définissent et mettent en œuvre la T2A sont-elles sur cette ligne ?
À ce propos, nous avons été frappés par le grand nombre d’organismes qui ont pour mission de contrôler la gestion et les pratiques de l’hôpital. Il arrive en outre que ces structures changent de nom ou se regroupent, ce qui ne contribue pas à la lisibilité et à l’efficacité du système et tend plutôt à renforcer l’écart entre les bonnes intentions de ces organismes et la réalité du terrain. Cela explique également l’inertie que le système oppose à la diffusion des pratiques innovantes dans l’ensemble des établissements. Pouvez-vous nous éclairer sur cet aspect de la question ?
M. Laurent Degos. À mes yeux, la T2A peut constituer un levier pour favoriser la chirurgie et la médecine ambulatoires par le biais d’incitations tarifaires. Je ne crois pas en revanche qu’on puisse favoriser à la fois la quantité et la qualité de l’activité par le biais de la T2A : il s’agirait de faire contrepoids à la productivité au moyen d’une autre source de financement, telle que l’enveloppe affectée aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), susceptible de prendre en compte la qualité. Il s’agirait de prévoir, dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens, deux enveloppes, l’une destinée à des objectifs quantitatifs, l’autre conditionnée à des critères qualitatifs.
M. Jean-Michel Dubernard, membre du collège de la Haute Autorité de santé. J’approuve cette distinction entre quantité et qualité. Il faut cependant rappeler que la notion de tarification à l’activité était destinée à combler ce qui apparaissait comme un écart considérable entre la gestion des établissements privés et celle des hôpitaux publics. Il s’agissait de mieux mesurer les coûts et d’aligner les moyens sur ces coûts, tout en tenant compte des missions spécifiques de l’hôpital public.
En ce qui concerne la chirurgie ambulatoire, l’Assemblée nationale a la chance de compter en son sein un expert en matière de chirurgie ambulatoire en la personne de M. Olivier Jardé. Grâce à lui, nous avons pu, avec MM. Jean-Paul Guérin, Raymond Le Moign, directeur de l’accréditation et de la certification de la Haute Autorité de santé, et François Romaneix, consacrer à la chirurgie ambulatoire un colloque qui nous a permis de mesurer l’ampleur du retard que nous avons sur les Américains, et même les Britanniques. Nous nous sommes surtout aperçus que rien n’était fait pour combler ce retard.
Comme le soulignait M. Gilles Bontemps, de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, si, dans dix ans, nous parvenons au niveau actuel des Américains en matière de chirurgie ambulatoire, 90 % de nos lits de chirurgie ne serviront plus à rien. D’où l’importance cruciale pour l’hôpital de pouvoir anticiper. Faute d’une vision anticipatrice, les 10,7 milliards d’euros mobilisés par le président Jacques Chirac dans le cadre du plan Hôpital 2007 – dotation d’une ampleur sans précédent, même à l’occasion de la mise en place des centres hospitalo-universitaires – n’ont servi qu’à perpétuer l’existant. Or, si on en croit les Américains, au-delà de vingt-cinq ans, les structures hospitalières sont frappées d’obsolescence par l’évolution de la médecine et des besoins des patients.
En matière de chirurgie ambulatoire, il y a un énorme effort de pédagogie à fournir, à tous les niveaux, et d’abord auprès des patients, dont il faut apaiser les craintes légitimes. Il faut simplement leur expliquer que ce dispositif suppose la mise en place d’un réseau de surveillance, comme cela se fait ailleurs, et que les risques de développer une infection nosocomiale sont cinq fois moindres qu’au cours d’une hospitalisation classique. Convaincre les médecins n’est pas non plus une mince affaire, d’autant qu’un bon chirurgien est une personne anxieuse, qui ne se résout pas facilement à laisser sortir le patient dans la journée. L’administration est tout aussi difficile à convaincre. À titre d’exemple, les douze lits de chirurgie ambulatoire que j’avais ouverts pour les interventions courantes d’urologie dans le service que je dirigeais ont été fermés par l’administration sous prétexte qu’ils étaient moins rentables. Autre exemple, une durée d’hospitalisation d’un jour et demi est obligatoire pour créer une fistule artérioveineuse pour dialyse, alors que cette intervention pourrait être traitée en chirurgie ambulatoire.
M. Jean-Paul Guérin, membre du collège de la Haute Autorité de santé. La chirurgie ambulatoire présente en outre l’intérêt de diminuer le nombre de mètres carrés utilisés, lesquels coûtent cher à l’hôpital. On peut penser qu’à l’avenir toute la médecine sera ambulatoire et que l’hôpital de demain sera réduit à un grand plateau technique, avec très peu de lits d’hospitalisation. Nos réflexions doivent s’inscrire dans cette perspective.
En matière d’efficience des soins, une étroite collaboration entre la Haute Autorité de santé, en charge de la qualité des soins, et l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ne peut être que féconde. En effet, l’efficience est une composante de la qualité : on ne peut pas prétendre à la qualité si on est incapable de gérer correctement les ressources confiées à l’hôpital. J’ai bon espoir puisque la convention qui lie désormais nos deux établissements prévoit la représentation de la Haute Autorité de santé au conseil scientifique de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Nous sommes en outre convenus de coopérer dans les domaines essentiels. Je ne reviendrai pas sur le sujet de la chirurgie ambulatoire, déjà longuement développé par M. Jean-Michel Dubernard. Nous devons également réfléchir ensemble aux moyens de réduire le coût de certains services particulièrement onéreux, tels que le bloc opératoire, dont on doit améliorer l’efficience dans l’hôpital public. Nous devons également travailler ensemble sur des thèmes comme les urgences ou les systèmes d’information hospitaliers, dont vous n’ignorez pas la complexité.
Quant à la gestion du patrimoine hospitalier et au nombre de mètres carrés, ils nous sont apparus, dès nos premiers échanges, comme des gisements d’économies. C’est une dimension qui devra absolument être prise en compte dans le cadre du plan Hôpital 2012 si on veut arriver à des résultats satisfaisants : c’est aujourd’hui que l’avenir se construit.
Autre point essentiel, il faut absolument sortir de l’« hospitalocentrisme », afin que les ressources puissent être réorientées vers la médecine générale dans le cadre du parcours de soins évoqué par M. Laurent Degos.
La T2A permet à l’hôpital de disposer de ressources en fonction de sa production : c’est là sa finalité essentielle et incontestée. Là où le bât blesse, c’est qu’elle est susceptible de favoriser des dérapages tels que des interventions injustifiées. C’est pour parer à ce risque que les attributions de la Haute Autorité de santé en matière de qualité des soins sont utiles. Il ne faut pas oublier non plus les agences régionales de santé, qui doivent se mettre en place sous peu, et qui comptent également la qualité des soins dans leur périmètre de compétence. Leur mission devra s’articuler avec les pouvoirs des présidents des commissions médicales d’établissement, appelés à devenir les « grands managers de la qualité » dans leur établissement.
Plus généralement, La Haute Autorité de santé, institution centralisée, ne pourra pas faire l’économie d’une collaboration avec les acteurs de terrain. Dans cet esprit, le président et le directeur travaillent à doter la Haute Autorité de santé d’un système d’information performant qui nous permettra de mettre à la disposition des agences régionales de santé des tableaux de bord plus lisibles afin qu’ils puissent intégrer la qualité dans leur démarche de contractualisation.
La certification des établissements, autre attribution de la Haute Autorité de santé, est, elle aussi, un outil important pour améliorer la qualité du fonctionnement de l’hôpital, à condition, là encore, d’articuler cette compétence avec celles de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et des agences régionales de santé.
M. Laurent Degos. On voit qu’il y a deux types de leviers : premièrement, dans le cadre de la T2A, on peut orienter l’activité hospitalière vers l’ambulatoire ; deuxièmement, dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens, on peut réserver à l’objectif de qualité une enveloppe spécifique, à côté de l’objectif de productivité.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je crains qu’il n’y ait là deux logiques indépendantes, qui ne se rencontrent jamais : celle de la T2A, imposée par les ordinateurs de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) qui définit les règles ; celle de la Haute Autorité de santé et des agences régionales de santé, qui privilégie la qualité. Comment faire la synthèse entre les deux ? Il y a quand même une contradiction entre la T2A et votre proposition de deux enveloppes.
M. Laurent Degos. La première logique, celle de la productivité, peut être utilisée pour assurer la transparence des coûts – c’est la facturation – mais aussi servir de levier, comme cela a été fait pour les soins palliatifs, dont la tarification a été fixée à un niveau bien supérieur à leur coût réel : cela fonctionne, puisque les hôpitaux cherchent à ouvrir des lits de soins palliatifs. On pourrait tout à fait utiliser le même levier pour favoriser le développement de la chirurgie ambulatoire.
La logique qualitative pourrait présider la signature des contrats d’objectifs et de moyens, qui pourraient être utilisés pour inciter, non seulement à la productivité, mais à la qualité des soins. Puisque nous mettrons à la disposition des agences régionales de santé toutes les données concernant la qualité des soins, par le biais des indicateurs et de la certification des établissements, leur politique de contractualisation pourra comporter des objectifs de qualité. Les agences pourront ainsi prévoir un système de double enveloppe, ayant certes pour objectif principal la productivité, mais pour objectif secondaire la qualité, comme un contrepoids, dont on peut faire varier l’importance : si on souhaite diminuer le poids de l’hôpital dans le parcours de soins, il suffira de faire décroître l’incitation à la productivité en augmentant la deuxième enveloppe.
M. le coprésident Pierre Morange. On voit qu’en France, la réflexion est intense et les travaux préparatoires de qualité : le problème, c’est le passage à l’acte. Pouvez-vous nous indiquer un agenda de mise en œuvre de ces réformes pour l’ensemble du parc hospitalier et le réseau de soins, dans l’hypothèse d’une volonté politique forte – que l’installation des préfigurateurs des agences régionales de santé semble attester ?
Où en est notamment la procédure de certification des logiciels d’aide à la prescription (LAP) que vous aviez évoqués lors d’une précédente audition et qui pourraient constituer un outil commun au secteur de ville et au secteur hospitalier ?
M. Laurent Degos. La promotion de la chirurgie ambulatoire peut commencer dès demain, et c’est précisément la conscience de cette possibilité qui a poussé MM. Jean-Michel Dubernard et Jean-Paul Guérin à imaginer le colloque parlementaire. Comme l’a dit M. Dubernard, cela nous permettrait de fermer 80 % des lits de chirurgie d’ici dix ans. Mais pour inciter les établissements à une mutation organisationnelle et culturelle d’une telle ampleur – faire passer le taux de la chirurgie ambulatoire de 30 % à 80 % de l’activité des établissements –, il faut mobiliser au départ un financement minimal. Cela suppose la valorisation tarifaire de la chirurgie ambulatoire : un changement tarifaire, même pour trois ans, suffira à faire bouger tout le monde. C’est là une décision politique simple. Or, la tarification actuelle incite au contraire à réduire la place de l’ambulatoire puisque les établissements perdent de l’argent s’ils font de l’ambulatoire.
Je veux insister sur le fait qu’il y a deux types de chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire courante, dont M. Jean-Michel Dubernard a donné des exemples, permettrait déjà des progrès considérables. Mais il y a une chirurgie ambulatoire beaucoup plus complexe, qui nous a été exposée lors du colloque parlementaire : si elle suppose des procédures de sécurité plus sophistiquées, elle est susceptible, par sa dimension d’expertise et d’innovation, de provoquer l’engouement des centres hospitaliers universitaires. Là encore, c’est une question de tarification : seul un changement de tarification pourrait inciter les hôpitaux à adopter l’organisation spécifique qu’impose la chirurgie ambulatoire.
M. François Romaneix, directeur de la Haute Autorité de santé. En ce qui concerne les logiciels d’aide à la prescription, nous avons établi le référentiel de certification des logiciels d’aide à la prescription à partir d’une charte qualité des bases de données médicamenteuses, instrument indispensable pour faire fonctionner le logiciel.
M. le coprésident Pierre Morange. Pouvez-vous nous éclairer sur la coopération entre la Haute Autorité de santé et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) dans la mise en place d’une base de données relative aux médicaments accessible à tous les praticiens ?
M. François Romaneix. L’expression « base de données » est polysémique. Celles dont je parle ici sont celles qui servent de support aux logiciels d’aide à la prescription certifiés.
Le référentiel de certification des logiciels d’aide à la prescription en médecine ambulatoire existe depuis un an, mais un seul logiciel d’aide à la prescription est actuellement certifié dans ce domaine. Nous devons donc réfléchir cette année à mettre en place un système, incitatif ou contraignant, pour faire entrer l’ensemble des éditeurs de logiciels dans le dispositif.
Nous n’avions souhaité définir le référentiel de certification des logiciels d’aide à la prescription hospitaliers que dans un deuxième temps, en raison de la forte imbrication entre ces derniers et les systèmes d’information hospitaliers. Ce travail est en cours et devrait être terminé d’ici la fin de l’année. Nous pourrons alors lancer la procédure de certification des logiciels d’aide à la prescription hospitaliers, à la condition, là encore, que nous ayons traité la question de l’entrée des éditeurs de logiciels dans le dispositif, soit par la voie de l’incitation, soit par celle de l’obligation.
En ce qui concerne la mise à la disposition du public de l’information sur le médicament, le ministère de la santé a mis en ligne un portail internet unique donnant accès aux différentes sources d’information que sont le Haute Autorité de santé, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et l’Assurance maladie. Ce site est appelé à évoluer, les fonctionnalités de la version actuelle étant limitées. Le ministère travaille notamment à la constitution d’un moteur de recherche permettant l’accès à l’ensemble des données.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Que pensent les organismes en charge de l’hôpital de votre proposition relative à la T2A et pourquoi celle-ci n’est-elle pas mise en œuvre ?
M. Laurent Degos. Je pense que l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est sur la même ligne que nous : c’est plutôt au niveau des autorités chargées de la tarification que cela bloque. Nous sommes prêts, nous, à travailler à tout ce qui contribue à l’efficience des soins hospitaliers, mais la décision relève du politique.
M. Jean-Michel Dubernard. Je veux souligner que chirurgie ambulatoire n’est pas synonyme de petite chirurgie. Ainsi, aux États-Unis et au Royaume-Uni, les prostatectomies radicales relèvent de la chirurgie ambulatoire.
Il est vrai, monsieur le coprésident, que la difficulté de passer à l’acte est un mal français – il suffit de voir le cas des agences régionales de santé, qui ne sont toujours pas mises en place. Mais à l’hôpital, ce mal s’explique par l’absence de gouvernance. Or si la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires comporte beaucoup d’avancées en matière de coopération entre le secteur public et le secteur privé au sein des territoires, elle ne règle en rien le problème de la gouvernance – c’est un avis personnel.
Il n’y a pas d’autre pays, que je sache, où le maire préside le conseil d’administration des hôpitaux. Certes la loi l’autorise à ne plus l’être. Nous verrons bien ce qu’il en sera.
Partout ailleurs, dans les grands pays développés, le président du conseil d’administration est issu des personnalités qualifiées et celui-ci nomme un directeur d’établissement qui ne sort pas forcément d’une école spécialisée en santé publique, comme l’École des hautes études en santé publique de Rennes. Surtout, le président du conseil d’administration nomme un directeur médical chargé d’appliquer les décisions de la commission médicale d’établissement.
C’est là le fond du problème : il n’y a aucune autorité à l’hôpital, que ce soit sur le plan administratif ou sur celui de l’organisation médicale. Si vous voulez savoir comment un établissement doit fonctionner, je vous invite à auditionner des représentants du CHU de Liège. Son président est un ancien assureur et son directeur général est issu de la Cour des comptes. Le directeur médical règle les trois quarts des problèmes. En France, on a créé une organisation en pôles d’activité mais sans supprimer les services.
Régler ce problème de gouvernance est la clé de la réussite de l’hôpital.
M. Laurent Degos. Les propos de M. Dubernard n’expriment pas la position officielle de la Haute Autorité de santé, qui est bien décidée à faire au mieux avec la loi.
M. Jean-Paul Guérin. Je voudrais évoquer un problème qui n’a pas encore été abordé : celui de la gestion du personnel, dont mon expérience à la tête d’établissements hospitaliers m’a appris l’extrême complexité. Je ne suis d’ailleurs pas sûr qu’elle soit plus simple dans les cliniques.
Or, si demain l’activité hospitalière est surtout ambulatoire, nombre de difficultés en matière de gestion du personnel s’en trouveront réglées. Certes, cela ne résoudra pas les problèmes de fond, notamment statutaires. On ne doit pas négliger l’inertie et les résistances qui, surtout dans les grandes structures, s’opposent à tout passage à l’acte.
Il faut cependant noter que notre nouvelle procédure de certification des établissements de santé, qui débute cette année, prend mieux en compte tous les points que nous venons d’évoquer, notamment la chirurgie ambulatoire. Nous pouvons également nous féliciter de la convention que nous avons passée avec l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, signée, le 16 décembre 2009, à l’Assemblée nationale. Certes, nous ne réglerons pas à nous seuls le problème de l’hôpital, mais nous apporterons notre pierre à l’édifice.
Nous voudrions enfin insister sur l’importance des critères de qualité en matière de gestion du personnel. Il y a là une piste, déjà répertoriée dans la procédure de certification, mais qui reste encore largement à explorer.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous en sommes d’accord, il n’est pas possible de traiter de la qualité sans nous intéresser à ceux qui la mettent en œuvre. Les personnels sont donc au cœur du raisonnement. Cependant la question dépasse celle des statuts, quelle que soit leur importance.
Modifier aussi profondément le fonctionnement de l’hôpital et les modalités de production de ses services ne peut non plus se faire sans prendre en compte les réactions des usagers. Ils sont directement concernés.
M. Laurent Degos. La Haute autorité de santé se préoccupe de la situation du personnel par le biais de la vie à l’hôpital – c’est-à-dire du travail –, de l’évaluation des pratiques et de la formulation de recommandations. Nous travaillons avec les personnels.
La situation de l’usager, en revanche, constitue une problématique relativement nouvelle. La Haute Autorité de santé va prochainement publier un rapport sur l’information du public. Nous travaillons aussi sur l’impact clinique de la qualité sur le patient. Au cours d’un symposium organisé avec le British Medical Journal le 19 avril 2009, 300 équipes françaises ont pu montrer l’impact clinique des programmes d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins sur la morbidité et la mortalité.
Enfin, nous nous préoccupons de la maltraitance – et donc de la bientraitance ou de la satisfaction. Nous avons réuni hier une conférence de presse sur la maltraitance ordinaire. Non seulement on doit respecter le malade lorsqu’on lui parle, mais on doit aussi l’écouter et l’informer. Nous avons également organisé avec les usagers un séminaire de recherche, réparti sur trois séances, pour comprendre ce qu’ils attendaient de nous. Après avoir privilégié ses rapports avec les institutionnels, pendant ses deux premières années d’existence, puis avec les professionnels, pendant les deux suivantes, la Haute Autorité de santé s’est tournée ces deux dernières années vers l’usager, le patient, sous les angles à la fois de la maltraitance ordinaire, de l’information qui doit lui être apportée, de son engagement comme acteur de sa santé et de son implication dans la conception de l’organisation.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Merci d’avoir répondu d’aussi bonne grâce à nos questions. Merci d’avance, également, de nous communiquer d’éventuels éléments complémentaires qui pourraient vous paraître utiles à nos travaux.
*
Audition de Mme Claude Rambaud, présidente de l’Association de lutte, d’information et d’étude des infections nosocomiales – Le Lien, membre du collectif interassociatif sur la santé (CISS) et de M. Nicolas Brun, chargé de la santé à l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et président d’honneur du Collectif interassociatif sur la santé.
M. Le coprésident Pierre Morange. Nous souhaitons maintenant la bienvenue à Mme Claude Rambaud, présidente de l’Association de lutte, d’information et d’étude des infections nosocomiales – Le Lien, membre du Collectif interassociatif sur la santé et à M. Nicolas Brun, chargé de la santé à l’Union nationale des associations familiales et président d’honneur du Collectif interassociatif sur la santé.
Mme Claude Rambaud, présidente de l’Association de lutte, d’information et d’étude des infections nosocomiales – Le Lien, membre du collectif interassociatif sur la santé. Le Lien, dont je suis la présidente, est partie prenante de la lutte contre les infections nosocomiales au sein du Collectif interassociatif sur la santé qui regroupe des associations intervenant dans le champ de la santé. L’association ayant élargi son action à la sécurité des patients, c’est sur cet aspect, sur lequel je travaille depuis de très nombreuses années, que sera centré mon propos.
M. Nicolas Brun, chargé de la santé à l’Union nationale des associations familiales et président d’honneur du Collectif interassociatif sur la santé. La qualité et la sécurité des soins, pour ce qui est du point de vue des usagers, nous ont en effet semblé, à la lecture des différentes auditions auxquelles vous avez procédé, constituer un sujet intéressant pour débuter cette audition.
M. le coprésident Pierre Morange. La Haute Autorité de santé a adopté la même démarche. Elle élabore des référentiels qui ont vocation à être mis en œuvre dans l’ensemble des établissements de soins. Elle travaille aussi sur la qualité de la relation avec le malade, sur celle des soins prodigués, et sur la bientraitance du patient qui, par essence, est mis en situation de fragilité, en raison de sa pathologie et de sa dépendance, du fait de ses relations avec les professionnels de santé.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Chacun cherche à optimiser l’articulation entre une certaine efficacité de l’utilisation des moyens donnés à l’hôpital et la nécessaire qualité des services fournis. Cette recherche pose forcément la question à la fois de la place que doivent y avoir les usagers et de la gouvernance de l’hôpital sous le nouveau régime de la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Quelles sont les conditions d’accès des patients à leur dossier médical ? Comment sont-ils dirigés dans le parcours de soins ? Quelles préconisations formulez-vous pour la gestion interne de l’hôpital, en matière de tarification, de relations entre secteurs public et privé et d’articulation de ces secteurs sur le territoire ?
M. Nicolas Brun. En 1996, la présence de deux représentants des usagers au sein des conseils d’administration des hôpitaux a été instituée par ordonnance ; le décret du 7 juillet 2005 a élargi ce nombre à trois. Néanmoins, il n’a pas été facile aux représentants des usagers de trouver leur place au sein des conseils d’administration et autres commissions des relations avec les usagers. La justification de leur présence a été contestée : on leur a fait savoir que chacun connaissait les attentes des usagers, qu’il s’agisse du directeur qui, en cas de conflit, voit arriver ceux-ci dans son bureau, ou encore des chefs de services, des médecins, et de façon générale du personnel qui, étant en contact permanent avec les usagers, ont le sentiment de connaître leurs attentes. Trouver notre place et affirmer notre différence à l’égard des autres membres des conseils d’administration n’a donc pas toujours été facile.
Aujourd’hui cependant, plus personne ne doute de l’intérêt de la représentation des usagers. Certes, celle-ci reste très hétérogène, du fait de sa nouveauté et de sa composition : les représentants sont, le cas échéant, des personnes malades, donc elles-mêmes fragilisées.
Si les ordonnances de 1996 visant à réformer la sécurité sociale et la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ont permis la représentation des usagers, elles n’en ont pas forcément créé les conditions d’exercice. Bien souvent, l’organisation de l’hôpital prime sur la participation des usagers : les réunions ont toutes lieu en journée, pendant les heures de travail des professionnels. Elles s’égrènent parfois tout au long de la semaine, alors que les regrouper au sein d’une même journée faciliterait l’exercice de leur mandat par les représentants. La participation de ceux-ci peut donc se trouver obérée par ce mode d’organisation du fait de leurs contraintes professionnelles.
Alors que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait institué pour eux une sorte de statut, incluant congé de représentation et possibilités d’indemnisation – des frais de transport notamment –, il faut bien constater que sa mise en œuvre est insatisfaisante : méconnus, y compris par les employeurs des représentants, les congés de représentation sont très peu utilisés ; le remboursement des frais n’est pas assuré : beaucoup d’hôpitaux soit arguent de leur déficit pour s’en dispenser, soit même s’interrogent sur leur droit à prendre en charge ces frais. Pourtant, ce n’est pas faute de notre part de réclamer, auprès de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, l’envoi de circulaires rappelant aux établissements leurs obligations. Faire vivre la démocratie sanitaire au sein des établissements comme du reste dans d’autres structures – conférences régionales ou autres groupes de travail locaux, départementaux ou régionaux – est donc une vraie difficulté. Or, si la représentation des usagers n’est pas considérée comme un atout pour la santé, elle risque d’être laissée en déshérence. En conséquence les usagers pourront en venir à désespérer de pouvoir exercer leur mandat.
L’accréditation et la certification ont aussi permis aux usagers, par leur participation, de montrer que le regard extérieur qu’ils peuvent porter sur l’hôpital est utile aux professionnels de santé, et que leur relation avec eux n’est pas une relation de conflit.
L’une des craintes initiales majeures des professionnels était celle du consumérisme médical. Nous pouvons tous constater aujourd’hui que, en portant sur les pratiques un regard critique, en aiguillonnant les équipes, en leur demandant, par exemple, si les difficultés, d’organisation ou de personnel qu’ils rencontrent ne sont pas liées à des habitudes qui ne permettent plus de prendre conscience du caractère déviant, voire maltraitant, de certaines pratiques, les représentants des usagers concourent plutôt à l’amélioration de la qualité.
Leur regard extérieur libère également la parole des professionnels : à la fin des années quatre-vingt-dix, lors de réunions sur ces thèmes, c’était le plus souvent le chef de service qui s’exprimait, le reste de l’équipe, notamment les infirmières, restant muet. Une douzaine d’années plus tard, il se révèle possible de tenir une discussion, parfois animée, sur la qualité, sans pour autant que les professionnels aient l’impression d’être soumis à un jugement et de recevoir des leçons de la part des usagers. Nous voulons renforcer cette dynamique, afin de permettre à l’hôpital d’évoluer en fonction non seulement des textes et des techniques, mais aussi du regard des usagers.
Le traitement des plaintes et réclamations est un autre exemple intéressant : à la différence d’autres secteurs, industriels ou commerciaux, l’hôpital autrefois ne tirait aucune conséquence des plaintes et réclamations. L’attitude pouvait même être celle du mépris envers des récriminations de personnes qui avaient déjà la chance d’être soignées.
Aujourd’hui, bon nombre d’établissements ont compris l’intérêt d’utiliser la parole des usagers pour repérer et identifier des dysfonctionnements, valoriser des bonnes pratiques. Nous sommes toujours attentifs aux lettres d’usagers faisant l’éloge de leur prise en charge ou de telle ou telle pratique au sein des services, afin d’étendre ces procédés à l’établissement.
En s’inscrivant dans une démarche de qualité plutôt que dans un mode de gouvernance administrative, la participation des usagers dans les établissements apparaît comme un levier d’évolution de l’hôpital.
Mme Claude Rambaud. Plus que sur la qualité, j’insisterai pour ma part sur la sécurité. Le cœur d’activité du Lien a en effet trait à la détection des dysfonctionnements qui conduisent souvent à des désastres humains pour la famille et qui peuvent laisser des équipes en état de choc.
Comment développer la prévention ? La réforme hospitalière la plus significative est celle qui, il y a trente ans, a créé en faveur des personnels les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle a enfoncé un coin dans le pouvoir des directeurs. Le CHSCT est, avec le droit d’alerte, le droit de retrait et la capacité à mener des enquêtes, la seule institution représentative à disposer de véritables moyens.
À cet égard, nous demandons – ce qui manque dans la réforme récente – la création d’une structure équivalente au profit des usagers des établissements de santé, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Rien ne justifie que les patients ne disposent pas eux aussi d’une structure capable de mettre en œuvre des moyens d’instruction, d’enquête, voire d’alerte des tutelles. Aujourd’hui, in fine, le directeur pilote sans contrôle. Alors que, dans les grandes industries à risque, des directeurs d’audit disposent de la capacité de suspendre une organisation défaillante, tel n’est pas le cas à l’hôpital. De ce fait, s’instaure une zone que j’appellerai de confort, où chacun trouve son compte mais où des désastres peuvent tranquillement se préparer. La prévention que permettrait une telle structure créée au profit des usagers serait source d’économies de ressources tant humaines que matérielles.
Pour promouvoir la qualité, nous devons aussi nous intéresser aux gestionnaires de risques. Aujourd’hui des jeunes sans aucune expérience des soins sont nommés à de tels postes. Mais comprendre la complexité d’un geste techniquement aussi simple que la pose d’une perfusion réclame une formation solide. La loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires doit pouvoir le permettre et faire aussi en sorte qu’ils disposent d’une autorité fonctionnelle – c’est vrai aussi pour les présidents des comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) : aujourd’hui, s’ils formulent des recommandations et sont très bien informés, ils ne disposent d’aucune autorité pour suspendre une organisation défaillante et créatrice de risques pour le patient.
Par ailleurs, rejoignant ici le discours sur les indicateurs de qualité et de sécurité, nous souhaitons que les revues de mortalité et de morbidité (RMM) soient rendues obligatoires et non pas conduites sur la base du volontariat. Comment un praticien peut-il envisager de ne pas connaître le processus morbide du patient qu’il a en charge ? L’excuse du manque de temps avancée par les médecins n’est pas recevable : ces revues sont menées sans difficulté dans les pays anglo-saxons. La France ne doit pas être en retard.
La certification des établissements de santé, qui est obligatoire, constitue un levier majeur. Ses résultats doivent être intégrés dans les dossiers de demandes d’autorisation et les agences régionales de santé devraient en tenir compte lorsqu’elles prennent leurs décisions. Autrefois, en Île-de-France, ils figuraient dans les dossiers présentés au comité régional de l’organisation sanitaire (CROS) – je le sais pour y siéger. Tel n’est plus le cas aujourd’hui : avant de prendre une décision, il nous faut aller les rechercher sur le site de la Haute Autorité de santé. En cas de dysfonctionnement majeur pointé par celle-ci, le lien doit être fait avec l’agence régionale de l’hospitalisation de façon à en trouver l’explication. Après dix ans de pédagogie, il faut aujourd’hui passer à une nouvelle étape.
Enfin, non seulement l’accréditation des praticiens est limitée aux disciplines à risque, mais elle a un caractère volontaire. Or, rien ne justifie que les référentiels sur lesquels s’engagent les praticiens qui se font accréditer ne bénéficient pas à l’ensemble des patients relevant de ces disciplines à risque.
De plus, alors que l’accréditation ouvre aux praticiens volontaires du secteur libéral et privé une prise en charge financière d’une partie de leur assurance responsabilité civile professionnelle, il n’y a pas de raison, dès lors que les médecins du secteur public sont demandeurs, qu’un dispositif de prise en charge par l’Assurance maladie comparable à celui existant pour le secteur libéral ne soit pas trouvé en leur faveur.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La durée d’hospitalisation est de plus en plus courte. Si, pour moi, c’est un élément positif, elle aboutit à faire évoluer quelque peu votre action en faveur des usagers : ne vous faut-il pas désormais vous intéresser aussi à l’amont et à l’aval du séjour à l’hôpital, et donc à l’ensemble du parcours du patient ?
M. Nicolas Brun. Nous nous félicitons de la diminution de la durée des séjours à l’hôpital, y compris du point de vue de la sécurité : il vaut mieux sortir de l’hôpital qu’y rester ! Cependant, la sortie doit être préparée. Avant de faire sortir un patient, l’établissement doit s’assurer que l’environnement dans lequel il va vivre peut l’accueillir. Or, aujourd’hui, tel n’est souvent pas le cas. Dans les réclamations qui nous parviennent, nous constatons que parfois la personne sort sans que quiconque se soit assuré qu’elle n’est pas seule à son domicile, que ses conditions de logement permettent une prise en charge et que, sur le terrain, les professionnels de santé éventuellement nécessaires sont présents.
Nous allons nous intéresser de plus en plus près à l’amont et à l’aval de l’hospitalisation. Il est indispensable que la réforme instaure effectivement une logique de parcours, et que, au-delà des services de l’hôpital, celle-ci englobe l’amont, l’aval, mais aussi l’environnement économique et social du patient : celui-ci peut grever entièrement un parcours thérapeutique techniquement parfait. L’hôpital doit donc mieux connaître l’environnement du patient et considérer que, loin de se limiter aux soins qu’il effectue entre ses quatre murs, il est garant de la sécurité de l’ensemble du patient en amont et en aval. C’est un changement culturel.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment faire ?
M. Nicolas Brun. Il y faut d’abord des instruments de collaboration : l’établissement ne doit pas être centré sur lui-même. Des conventions, des modalités d’organisation, doivent pouvoir favoriser cette évolution.
Le travail social à l’hôpital doit aussi être valorisé : il fait partie des soins.
La loi doit également se traduire pleinement en termes d’action sur les territoires. Aujourd’hui, à propos de la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la population n’entend que rationalisation des soins, fermeture d’établissements, expulsion des malades après un séjour plus court pour des raisons d’économies. Pour la rassurer, il faut remettre cette loi en perspective, rappeler que de nouvelles organisations sont en cours de mise en place, les rendre effectives. Nous constatons parfois que la création de maisons de santé, de garde, de collaborations, n’est pas suivie d’effet.
Il peut même arriver que des dispositifs soient élaborés sans que le public soit au courant. Des maisons de santé ou de garde sont ainsi créées sans que la population y ait recours parce qu’elle ne sait pas qu’elles existent ou à quoi elles servent. Un travail pédagogique est donc indispensable pour que le parcours proposé aux patients soit clairement identifié, compréhensible et lisible. Un tel travail reste à faire.
Mme Claude Rambaud. Le parcours du patient est en effet une question sensible. Au Lien, il ne se passe pas de semaine sans que nous recevions un dossier mettant en cause le premier recours. Il est urgent d’agir pour les urgences ! Faut-il qu’elles soient assurées dans des maisons médicales de proximité ? Comment mettre fin aux déserts médicaux ? La question de l’accès aux soins pour tous est cruciale.
Hier soir encore, un courrier reçu sur ma messagerie faisait état d’un patient qui, venant de subir une grave crise d’épilepsie dans un restaurant et transporté aux urgences par les pompiers, y a attendu trois heures, pendant lesquelles il a fait une seconde crise, au cours de laquelle une chute lui a causé un traumatisme crânien : aujourd’hui, il est handicapé à vie. Or il faut savoir que les dossiers que nous recevons ne révèlent qu’une toute petite partie des dysfonctionnements de l’hôpital.
Cela dit, vous avez raison d’évoquer l’amont et l’aval. Aujourd’hui, en matière de qualité de soins et de sécurité des patients, deux secteurs sont mal voire pas du tout évalués : la médecine de ville et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Alors que ces établissements hébergent des personnes très fragiles, les plus vulnérables, elles ne sont pas dotées de système d’accréditation ou d’évaluation.
Nous souhaitons des mesures en faveur de la lutte contre les infections associées aux soins en médecine de ville. Les cabinets de radiologie nous préoccupent particulièrement. Cette action, dont le dossier est aujourd’hui à la Direction générale de la santé, faisait partie du plan stratégique de lutte contre les affections associées aux soins. Nous nous sommes attaqués au dossier de la désinfection des sondes d’échographie endocavitaire. C’est un bras de fer que nous avons engagé avec la profession, qui se protège. Son raisonnement, aux termes duquel, pour agir, il faut d’abord que des victimes aient été repérées, n’est pas acceptable : d’une part, comme on touche à l’intimité, celles-ci ne se feront pas connaître ; d’autre part, il n’est pas possible de distinguer les infections dues à cette cause et les contaminations par voie sexuelle.
La recommandation actuelle en matière de désinfection est que la décision doit être prise après examen visuel du praticien. Peut-être aujourd’hui ceux-ci voient-ils les bactéries à l’œil nu… En médecine de ville une évaluation devait être engagée et des contrôles conduits. Alors que, depuis plusieurs années, les ministres se sont engagés en ce sens, rien ne progresse. Au passage une telle action serait aussi source d’emplois.
Un effort d’évaluation considérable des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est aussi à conduire. Ils reçoivent des personnes extrêmement vulnérables, en perte d’autonomie, qui ne peuvent plus s’exprimer correctement, ni faire valoir leurs droits.
Nous devrons aussi faire un effort dans le secteur de la maternité. La règle du court séjour peut y être cause de graves troubles familiaux et sociaux. Aujourd’hui, des jeunes femmes – de plus en plus nombreuses – qui n’ont pas la chance de pouvoir être assistées de leur mère à la maison, sortent de la maternité après un séjour de 24 ou 48 heures, sans savoir comment s’occuper de leur bébé. Cette situation peut être cause de rupture au sein du ménage, de rupture sociale, et, en conséquence, de conditions de croissance catastrophiques pour un enfant. Mettre en place, en ville, des structures de périnatalité, éventuellement associatives, pour prendre en charge les mamans, mères de leur premier enfant ou non, devient urgent. Dans le département des Hauts-de-Seine, malgré tous nos efforts, nous n’y avons pas réussi. Nous devons nous occuper de ce problème.
M. le coprésident Pierre Morange. Quel est votre sentiment sur la logique du parcours de soins ? Nous ne pouvons pas découpler notre réflexion sur l’hôpital d’une réflexion sur l’amont et l’aval, c’est-à-dire sur le secteur ambulatoire, dit encore de ville. La logique du parcours de soins renvoie en effet non seulement à des schémas d’organisation, mais aussi au fil rouge que constituent la maîtrise et le partage de l’information, auxquels les représentants des usagers sont – très légitimement – attachés.
Le dossier, très lourd et complexe, du dossier médical partagé a connu bien des aléas. Les pays qui ont voulu le mettre en œuvre n’y sont parvenus qu’après plusieurs années ; les incidences financières sont toujours sensibles.
À l’issue de réflexions précédentes, la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale avait proposé un dispositif d’attente en vue d’un partage de l’information entre les professionnels de santé et aussi les patients, susceptible de permettre un processus d’autosurveillance très vertueux. Il consistait en un support informatique sécurisé, une clé USB par exemple, détenu par le patient lui-même. Grâce à ce support, celui-ci est le détenteur de son propre dossier. Ce dispositif s’inscrivait dans une logique de sécurisation – pour répondre à l’obligation de confidentialité – et aussi de transmission et de partage des données. Pragmatique, d’un coût infiniment moindre que le dossier médical personnel (DMP), il ne fermait pas la voie à l’implantation progressive de celui-ci.
À la suite de ces travaux, mes collègues de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, notamment MM. Dominique Tian et Jean-Pierre Door, et moi-même avons déposé une proposition de loi instituant une clé USB détenue par le patient et présentée à chaque consultation auprès d’un praticien.
Des dispositions législatives ont été présentées, sous forme d’amendements, puis adoptées. Ce n’est que pour des raisons de forme – elles ont été considérées comme des « cavaliers » législatifs – qu’elles ont été annulées par le Conseil constitutionnel. Pour autant, nous avons cru comprendre que certaines associations de patients y étaient opposées, les qualifiant de « crécelle du XXIe siècle ». Notre philosophie était pourtant, dans une démarche politique, de répondre à la fois à la logique du parcours de soins, aux besoins des patients et à la nécessaire transmission des informations entre professionnels de santé. Nous le savons, les systèmes informatiques hospitaliers et ambulatoires ne sont encore ni interconnectés ni normalisés. Le dispositif nous paraissait clair, lisible, fonctionnel, éminemment démocratique et – du fait de la détention des informations par le patient – inscrit dans une logique de sécurité sanitaire. Quel est à cet égard votre sentiment ?
Mme Claude Rambaud. Le collectif n’a formulé de réserves qu’au titre de la sécurité et de la confidentialité des données. La clé USB permettrait peut-être de régler aussi le problème de l’exposition aux rayons X lors des radiodiagnostics à répétition et qui sont enregistrés par l’organisme pour toute la vie. Il arrive que, par exemple en réanimation néonatale – mon expérience humanitaire l’a confirmé –, l’on fasse à un nourrisson deux radios par jour, et durant plusieurs jours, sans la moindre protection des gonades ou des ovaires et sans que cela ne dérange personne. Et vous ne seriez pas plus protégé vous-même si vous alliez faire une radio du poignet. La clé USB apporterait une traçabilité des examens, sachant que des cancers sont provoqués par un trop grand nombre de radiodiagnostics, comme dans le cas de scolioses.
M. le coprésident Pierre Morange. Je suis heureux de vous l’entendre dire. Dans notre proposition législative – car nous sommes tenaces – cette clé USB est sécurisée, avec un double cryptage ; elle ne peut en aucun cas être exploitée en cas de perte ; la Commission nationale de l’informatique et des Libertés (CNIL) est consultée et ses prescriptions sont reprises dans un décret.
Mme Claude Rambaud. À l’époque, nos doutes concernaient la protection de la confidentialité des données hébergées sur la carte à puce. Aujourd’hui, j’ai bien noté qu’elle appartiendrait au patient.
M. le coprésident Pierre Morange. Je prends acte de votre appui à notre action législative en la matière. Il s’agit d’une démarche au service du patient : en dehors de ce dernier et des praticiens choisis par lui, personne d’autre n’aura accès à la clé et à ses données. On rediscutera donc de la proposition de loi en tenant compte des demandes que vous avez formulées depuis de nombreuses années.
Mme Claude Rambaud. Lorsque j’ai commencé à m’intéresser voilà vingt-cinq ans à la iatrogénie, j’ai alors découvert que l’Assurance maladie ne conservait pas en archives les dossiers des patients.
M. le coprésident Pierre Morange. Et donc la clé USB pallierait cette carence…
Mme Claude Rambaud. Ce serait bien utile : en effet, quand un patient change d’établissement on recommence, dans la plupart des cas, tous les examens. Cela permettrait aussi une traçabilité de l’ensemble du parcours du patient dans une pathologie déterminée, ce qui permettrait peut-être un jour de disposer d’une visibilité sur la iatrogénie.
M. le coprésident Pierre Morange. C’est toute la vocation du stockage des données, sachant que les technologies continueraient à évoluer puisqu’on pourra embarquer de l’imagerie grâce à la compression numérique.
M. Dominique Tian. Une des dernières lois de financement de la sécurité sociale fait obligation de délivrer, en fin de séjour, une facture à chaque patient. Mais cette obligation, respectée par les cliniques privées, paraît impossible à mettre en œuvre à l’hôpital. Êtes-vous favorable à ce qu’elle y devienne rapidement une réalité ? Ce serait un élément de transparence important qui permettrait au patient de savoir quel acte a été effectué et combien il coûte à la collectivité.
M. Nicolas Brun. Nous sommes favorables à la transparence de l’information, médicale comme économique. Il faut que les usagers, en vue de leur responsabilisation, sachent, d’une part, ce qu’on leur a fait, d’autre part combien cela coûte. Non pour mettre l’accent sur le coût, mais pour informer. Je m’explique.
Aujourd’hui, dans les services d’urgences, les personnes attendent parfois plusieurs heures avant d’être enregistrées – pour les services, le délai de prise en charge ne court d’ailleurs qu’à partir de l’enregistrement et non de l’arrivée du patient à l’hôpital –, puis d’être examinées. C’est ce qui explique que certaines d’entre elles, déjà enregistrées, repartent de l’hôpital sans voir personne. Or cela ne les empêche pas de recevoir quelques semaines plus tard une facture, tout comme d’ailleurs celles qui, bien qu’ayant été reçues, sans savoir d’ailleurs s’il s’agissait d’un médecin ou d’un infirmier, n’ont reçu aucun soin. Il leur faut une explication car la seule information économique ne peut, dans leur cas, qu’être que source d’incompréhension.
M. Dominique Tian. La nature de vos relations avec les ordres professionnels, notamment des médecins, est-elle satisfaisante ?
M. Nicolas Brun. Les rapports sont parfois difficiles, par exemple avec les conseils départementaux de l’Ordre des médecins sur des problèmes de refus de soins. Non seulement les patients se montrent réticents à porter plainte devant un conseil départemental – soit parce qu’ils considèrent que l’ordre se protège, soit parce qu’ils ont été persuadés que cela ne sert à rien –, mais les décrets pris dans le cadre de la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires conduisent à une organisation sinon impossible à mettre en place, du moins très longue, compliquée et n’assurant pas l’équité.
Pour autant, nous collaborons régulièrement avec les ordres, en particulier celui des médecins avec lequel nous tenons des réunions thématiques. Mais de là à dire que nous sommes satisfaits de l’organisation locale des ordres, c’est un pas que nous ne franchirons pas.
Mme Claude Rambaud. La transparence doit valoir également, au-delà de l’aspect financier, pour les actes médicaux. Or, si la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé prévoit que tout patient doit être informé de l’événement iatrogénique dont il est victime, et que chaque établissement ou professionnel – même anonymement – doit déclarer à l’autorité administrative les accidents dont il a pu être témoin, aucune de ces deux règles n’est aujourd’hui appliquée. On est encore au stade de l’expérimentation d’un document CERFA, et un coup de pouce de votre part en la matière serait précieux.
Pour notre part, nous préférons la prévention aux sanctions pénales et nous sommes d’ailleurs favorables à une modification de la loi pénale dans le domaine médical. Mais on ne pourra prévenir que pour autant que l’on connaît. Aussi conviendrait-il à tout le moins que la loi soit appliquée.
Concernant les méthodes de financement des établissements et la tarification à l’activité (T2A), il faut être attentif à la promotion des actes techniques. M. Brun a pu parler à cet égard de valorisation de l’acte social, mais on pourrait également citer l’acte éducatif ou l’acte de santé publique. Sachant en effet que les méthodes de financement ont un impact sur les pratiques médicales et que l’on attribue une cotation à une pratique, cette dernière se trouvera promue. Il arrive donc qu’on fasse plus d’actes à cotation avantageuse qu’il ne conviendrait d’en faire. La justification de l’acte devrait donc figurer dans le dossier du patient.
M. Nicolas Brun. Sans remettre en cause la T2A, car le budget global présentait nombre de déficiences, celle-ci ne doit pas conduire à une sélection des patients ou des pathologies. Dans le cas d’un établissement déficitaire, quelle sera la marge de manœuvre du directeur – qui est également jugé sur sa capacité à un retour à l’équilibre financier –, pour continuer à prendre en charge des pathologies par définition déficitaires parce que mal cotées ? Il y a là un risque de discrimination dans les prises en charge et des inégalités devant l’accès aux soins. La T2A a certes des vertus, mais elle ne doit pas inciter à une logique de régulation économique des soins qui aurait pour conséquence la non prise en charge, par des établissements, de certains patients ou de certaines pathologies.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le patient est à la fois un agent économique, un contribuable un cotisant et un citoyen, et on ne peut ignorer cette composante de la tarification et de l’équilibre économique des établissements.
Pour sa part, la T2A est un sujet complexe, comme on a encore pu le constater dans nos échanges avec les représentants de la Haute Autorité de santé.
La T2A répond d’abord à une logique du juste prix, avec la mise en place d’un système d’analyse des coûts permettant de trouver la bonne tarification pour la prestation fournie. Cela suppose que le codage des actes soit réalisé de façon objective, ce qui, en toute bonne foi, n’est pas toujours simple. C’est ainsi que tel ou tel codage – voire telle ou telle réponse sanitaire – peut être privilégié parce qu’il se révèle plus intéressant qu’un autre, ce que nous sommes tous d’accord pour condamner. Mais la T2A peut aussi être comprise comme étant un outil de tarification et de gestion qui doit aussi servir à la puissance publique pour orienter les activités hospitalières, par exemple en direction de la chirurgie ambulatoire – si on souhaite la développer. Quel est votre sentiment ?
Par ailleurs, la T2A s’inscrit par référence au secteur privé avec, en ligne de mire, la convergence, ou la cohérence, des deux secteurs. Mais alors que l’on veut clarifier et rationaliser, on ajoute des compensations – les MIGAC ou les enveloppes qualité –, ce qui n’est pas forcément favorable à la lisibilité du système et à sa bonne gestion. Quels sont, à cet égard, votre avis et vos suggestions ?
Mme Claude Rambaud. Avant de parler de convergence, il conviendrait d’abord de redéfinir les missions de l’hôpital – sachant que les établissements privés participent également au service public –, ce qui soulève notamment le problème des dépassements d’honoraires et de la révision des statuts des personnels de la fonction publique hospitalière. Mais nos associations ne sont pas vraiment compétentes pour en discuter encore que je proposerais pour la promotion de la carrière de se fonder notamment sur des résultats en termes de qualité et de certification. En tout cas, il ne peut y avoir de convergence sans révision des statuts.
M. Nicolas Brun. La T2A peut pousser à l’élaboration de nouvelles organisations, et c’est pourquoi le Collectif interassociatif sur la santé ne s’est jamais manifesté contre cette tarification en tant que telle. Encore faut-il faire attention à ce qu’elle ne dévie pas de ses objectifs initiaux. Il existe des directeurs d’hôpital qui demandent à leurs chefs de service de ne pas réorienter certains patients vers le secteur libéral, même si cent personnes attendent aux urgences, car cela entraînerait une diminution du chiffre d’affaires de l’établissement. Il faudra donc trouver une position vertueuse entre deux tendances contraires : l’une qui pousse à faire des actes, afin d’obtenir un budget plus élevé ; l’autre qui tend à ne pas développer de nouvelles organisations au prétexte que le système de tarification tend à l’empêcher. La ligne de crête est difficile à suivre et il nous faudra à la fois valoriser le côté positif de la T2A et dénoncer les déviances.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous remercions de vos réponses. N’hésitez pas à nous faire parvenir toute information qui viendrait compléter notre échange ainsi que toute proposition qui vous semblerait utile.
*
AUDITIONS DU 11 FÉVRIER 2010
Audition de M. Benoît Leclercq, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, M. Paul Castel, directeur général des Hospices civils de Lyon et président de la Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires, M. Jean-Pierre Dewitte, directeur général du Centre hospitalier universitaire de Poitiers, et M. Denis Fréchou, président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Cherchant à analyser le fonctionnement de l’hôpital, nous nous sommes intéressés à un certain nombre de cas particuliers en vue d’en tirer des préconisations susceptibles de valoir pour l’ensemble des établissements. Avant d’achever nos travaux, il nous a semblé utile de vous entendre, vous qui représentez une part importante, à bien des égards, de notre système hospitalier, afin de mettre en perspective les éléments que nous avons collectés. Je vous donne donc sans plus tarder la parole pour un premier tour de table.
M. Benoît Leclercq, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est un établissement public de santé qui regroupe 37 hôpitaux pour un total de 22 400 lits situés à plus de 90 % en Île-de-France. Elle assure chaque année un million d’hospitalisations, 1 100 000 urgences et 4 millions de consultations externes. Son effectif est de quelque 70 000 personnes, pour le personnel non médical, et de 9 000 équivalents temps plein, pour le personnel médical. Son budget est de 6,4 milliards d’euros, dont 4 pour les salaires.
Le plan stratégique qui devrait être validé en mai ou juin prochain vise pour l’essentiel à regrouper les 37 hôpitaux au sein de 12 groupes hospitaliers afin de gagner en masse critique, de supprimer les doublons et, surtout, d’offrir à la population une gamme de soins comparable à celle d’un centre hospitalier universitaire (CHU).
Un autre objectif est de concentrer dans un ou deux sites des activités lourdes et complexes comme les transplantations, la cardiologie et la neurologie interventionnelle, voire la génétique moléculaire.
Ce plan stratégique s’accompagne d’un plan d’efficience qui doit conduire l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à un déficit nul d’ici à 2012, comme le lui ont demandé les pouvoirs publics. Pour y parvenir, nous misons non seulement sur les regroupements entre hôpitaux mais aussi sur celui qui concerne notre siège, qui doit s’achever en 2011 et permettre d’importants gains de productivité.
L’écart de convergence est aujourd’hui de l’ordre de 300 millions d’euros et nous travaillons à le ramener à zéro avant la fin de 2012. Pour cela, nous nous appuyons à hauteur de 20 à 30 % sur des évolutions de l’activité et des améliorations des recettes, le reste devant provenir d’économies structurelles obtenues par l’amélioration de notre organisation médicale, administrative et logistique. Tout cela se traduira par une réduction de la voilure de certains établissements, voire par des fermetures.
Pour 2009, l’état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) avait été accepté par la tutelle nationale avec un déficit contenu à hauteur de 95 millions d’euros. Au vu des résultats disponibles à ce jour, je puis vous dire que nous serons « dans les clous », voire que nous ferons un peu mieux.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Afin de réduire l’écart de convergence, vous entendez à la fois accroître les activités, donc les recettes, et réduire la voilure. Mais comment accueillir davantage de patients dans moins d’établissements et avec moins de personnels ?
M. Benoît Leclercq. Il faut pour cela optimiser l’utilisation de nos bâtiments dont certains, historiques et vétustes – c’est en particulier le cas de l’Hôtel-Dieu –, ne sauraient être des hôpitaux du XXIe siècle. En effet, il faudrait, pour en faire des établissements simplement moyens, engager des sommes disproportionnées au regard des résultats attendus. La réduction de voilure de l’Hôtel-Dieu fait donc partie des solutions. Mais l’activité de chirurgie thoracique et digestive et de pneumologie qui y est aujourd’hui réalisée va être transférée progressivement à Cochin, dans des bâtiments existants et dans d’autres à construire.
L’investissement est la variable qui nous permet de faire cela : nous préférons libérer des sites et construire des bâtiments répondant aux normes actuelles.
Réduire l’écart de convergence de 300 millions d’euros suppose d’agir sur l’ensemble des dépenses : médicales, d’hôtellerie-restauration, mais aussi de personnels. Nos efforts portent en particulier sur les fonctions « supports » non médicales, et nous conduisent à ne pas remplacer tous ceux qui partent en retraite, grâce notamment à des réorganisations internes ou, pour ce qui est de la logistique, à des externalisations.
S’agissant des services soignants médicaux, j’illustrerai notre action par l’exemple du regroupement, à l’est de Paris, des hôpitaux Tenon, Saint-Antoine, Rothschild et Trousseau. Il nous est aisé de regrouper le service de chirurgie digestive isolé à Tenon et l’énorme dispositif médico-chirugical digestif de Saint-Antoine dans ce dernier hôpital, avec des moyens pratiquement constants, ceux de Saint-Antoine, en y créant dix lits et en en supprimant une trentaine à Tenon. On voit bien que cela améliore l’activité sans nuire à la qualité ni à la proximité des soins.
M. Paul Castel, directeur général des Hospices civils de Lyon et président de la Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et universitaires. Les Hospices civils de Lyon regroupent 5 700 lits et places dans 17 établissements au sein de six groupements hospitaliers, deux établissements étant supprimés par fusion avec d’autres hôpitaux de proximité. Nous employons 23 000 salariés dont 5 000 personnels médicaux. Notre budget de fonctionnement s’élève à 1,5 milliard d’euros et notre budget d’investissement à 200 millions.
Notre situation financière est dégradée, mais cette détérioration s’est ralentie puisque notre déficit, passé de 36 à 86 millions entre 2007 et 2008, a été ramené à 60 millions en 2009 et devrait s’établir à 40 millions en 2010.
Un plan de retour à l’équilibre, approuvé par le ministère de la santé en juin dernier, a été élaboré dans le cadre de notre projet d’établissement 2009-2013, qui a fait l’objet d’une large concertation.
Pour atteindre les objectifs pluriannuels de retour à l’équilibre, une démarche de modernisation a été engagée il y a plusieurs années, en particulier avec quatre grands projets de construction-restructuration aboutissant à de très importants regroupements d’activités dans l’agglomération lyonnaise.
Un effort d’investissement de plus de 600 millions d’euros a été conduit et devrait être poursuivi pour un même montant jusqu’en 2013.
Grâce à notre politique de maîtrise, la masse salariale, qui avait augmenté de 1,3 % en 2008, a diminué de 0,5 % en 2009 et cette tendance devrait être confirmée en 2010. Cela se traduit par environ 200 suppressions d’emplois chaque année, sans licenciement.
Ce programme sera poursuivi dans le cadre du plan 2009-2013 et accompagné d’un programme pluriannuel d’investissement.
En complément des mesures de modernisation, de regroupement et d’amélioration de l’efficience, nous avons la chance de pouvoir utiliser notre important patrimoine immobilier, qui vient d’être valorisé à environ 600 millions d’euros, pour procéder à des réorganisations et à des ventes, pour un montant estimé à 130 millions d’ici à 2013. Ce patrimoine est également mobilisé dans le cadre du projet social de l’établissement, essentiellement pour offrir des logements aux personnels soignants et rendre ainsi les Hospices civils plus attractifs. Cela paraît d’autant plus nécessaire que les loyers sont particulièrement élevés à Lyon et que la pénurie d’infirmières perdure dans les grandes métropoles.
M. Jean-Pierre Dewitte, directeur général du Centre hospitalier universitaire de Poitiers. Je fais un peu ici figure de Petit Poucet puisque je dirige un centre hospitalier universitaire de 1 600 lits seulement, avec un budget d’exploitation de 460 millions d’euros et un budget d’investissement de 40 millions par an en moyenne, autofinancé à 80 %.
L’établissement est situé dans une région qui compte des centres hospitaliers importants dans des villes de taille équivalente à celle de Poitiers : La Rochelle, Angoulême et Niort. Ainsi, l’offre de soins est assez bien répartie sur le territoire.
Notre centre hospitalier universitaire se caractérise par sa jeunesse puisqu’il a débuté sa croissance avec dix à quinze ans de retard. Il y a dix ans, lorsque j’en ai pris la direction, l’offre de soins était jugée insuffisante pour répondre aux besoins de la région Poitou-Charentes – le diagnostic était le même pour le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie –, et nous n’avons eu de cesse de l’améliorer depuis lors. Nous continuons à créer de l’activité de court séjour afin de répondre à une demande croissante de santé, sans doute liée au vieillissement de la population dans cette région.
Notre développement s’explique aussi par le fait que notre région ne disposait pas d’un centre régional de lutte contre le cancer, alors que ces pathologies sont en augmentation. C’est ce qui nous a conduits à ouvrir, en mars dernier, un bâtiment de 150 lits, exclusivement consacré au cancer et regroupant toutes les activités possibles dans ce domaine.
Nous avons par ailleurs fait le choix de conserver une filière complète de soins qui allie court séjour, soins de suite et filière sanitaire du long séjour, ce qui nous a probablement été utile pour passer à la tarification à l’activité (T2A).
Nous comptons assez peu de médecins : 66 professeurs des universités-praticiens hospitalier (PU-PH), soit le plus faible effectif de tous les centres hospitaliers universitaires français, et 250 praticiens hospitaliers. Leur activité est donc particulièrement importante. Par ailleurs, en cinq ans, le numerus clausus est passé de 70 à 180 et le nombre des internes de 200 à 353. Cette forte croissance s’est accompagnée de la reconstruction de la faculté de médecine sur le site du centre hospitalier universitaire.
Nous avons jusqu’à présent réussi à maîtriser notre budget grâce à une réorganisation des structures logistiques et médico-techniques, et nous avons même pour objectif de dégager un léger excédent, de 1 %. Nous réinvestissons les marges ainsi obtenues dans la recherche, ce qui nous permet aujourd’hui de disposer de quatre équipes labellisées Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) alors que nous n’en avions aucune il y a cinq ans.
M. Denis Fréchou, président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers. Je dirige deux établissements de taille encore plus modeste. Situés tout près de Paris et du bois de Vincennes, ils sont géographiquement très proches, relèvent d’une direction commune et sont engagés dans une fusion qui devrait s’achever en 2011. Ils sont atypiques en raison de leur activité qui relève à 45 % de la psychiatrie, à 30 % des soins de suite et de la réadaptation (SSR), à 15 % de la gynécologie, de l’obstétrique et de la néo-natalité, à 10 % de la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique. Ainsi, 20 % seulement de l’activité totale relèvent de la T2A, tandis que le reste est encore dépendant de dotations, les choses étant toutefois en train de changer pour les soins de suite et de réadaptation.
Ces établissements sont également atypiques dans la mesure où ils sont pour l’instant à l’équilibre financier et ont jusqu’à présent réussi à financer presque complètement leurs investissements.
Avec un budget d’environ 150 millions d’euros, nous employons 2 500 agents, dont 10 % de personnel médical.
Les difficultés que nous rencontrons tiennent à l’évolution de l’activité de psychiatrie, dont 90 % s’exercent désormais en dehors du site principal, dans de petites structures dispersées dans Paris et dans le Val-de-Marne ; au fait que notre bâtiment principal est classé monument historique, ce qui pose des problèmes particuliers de maintenance et d’aménagement ; mais aussi au rapprochement et à la fusion de deux établissements à l’activité et à la culture très différentes. Ainsi, l’établissement qui se consacre principalement à la rééducation a un caractère national et il était, jusqu’à très récemment, directement piloté par le ministère de la santé. Encore aujourd’hui, on trouve à sa tête, non pas un élu, mais un fonctionnaire.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous avons donc devant nous, ce matin, des représentants d’établissements assez divers, par leur taille, leur patrimoine ou leur ancienneté. Mais l’intérêt de cette réunion est précisément d’essayer de dégager des éléments communs.
Nous savons que les regroupements et les fusions sont des outils de rationalisation difficiles à manier, qu’un projet médical fait souvent défaut et que les fusions décrétées d’en haut réussissent rarement. Quelle est selon vous la méthode la plus propice au succès ?
Un autre sujet qui revient fréquemment dans nos auditions est celui de la mécanique de la tarification, des systèmes informatiques, du codage. Pourriez-vous nous aider à y voir plus clair en la matière ?
M. Benoît Leclercq. L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris constituant juridiquement un ensemble unique, nous ne procédons pas à des fusions mais à des rapprochements hospitaliers qui y ressemblent.
Si la relative proximité géographique est une des premières clés de la réussite, vous avez tout à fait raison d’insister sur le projet médical.
Je prendrai l’exemple de deux hôpitaux à la fois très proches et très différents, Saint-Louis et Lariboisière, qui forment aujourd’hui un groupe hospitalier. Le premier est orienté vers la médecine programmée, la cancérologie et l’hématologie ; le second est plus généraliste, même s’il exerce des activités de pointe comme la neurochirurgie, et il est orienté vers les urgences et la médecine non programmée. Nous avons décidé de constituer des pôles de grande taille, en particulier en ORL, domaine dans lequel nous avons transféré vers le service beaucoup plus important de Lariboisière celui qui existait à Saint-Louis, tout en maintenant dans ce dernier établissement des antennes de consultation et de liaison. De la sorte, nous avons pu atteindre dans cette discipline une masse critique, ce qui a paradoxalement permis d’améliorer l’offre de soins grâce au nombre de médecins présents, à une meilleure continuité des soins et au développement des compétences hospitalo-universitaires. Cela a été possible parce que ces projets médicaux ont bénéficié de l’implication des équipes, notamment des présidents des comités consultatifs médicaux, élus par leurs pairs.
Outre qu’une forte volonté de la direction générale est bien évidemment nécessaire, une autre condition de succès tient à la possibilité d’instituer une gouvernance médico-administrative et une équipe de direction uniques. Pour reprendre l’exemple de Saint-Louis-Lariboisière, l’ensemble des deux hôpitaux est désormais géré par un seul directeur et par un seul directoire médical et administratif. Cela ne signifie pas que les fonctions de proximité ne sont plus assurées dans chacun des deux établissements, mais que les ressources humaines, les affaires financières, les affaires économiques, la qualité, la sécurité, la technique, sont désormais regroupées et gérées à ce niveau, comme dans n’importe quel centre hospitalier universitaire, ce qui permet de réunir les forces et les compétences et de gagner en productivité.
Le succès de la fusion suppose aussi de doter le groupe, dans le cadre de la gestion du projet et de la délégation de compétences, d’outils de pilotage permettant d’atteindre les objectifs médicaux, organisationnels, économiques, financiers et sociaux.
Une politique très pointue d’accompagnement social de la mobilité me paraît également nécessaire. Nous y travaillons avec l’aide du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, qui apporte un soutien financier à la mobilité interne et, éventuellement, externe.
Enfin, même à Paris, nous devons travailler avec les élus locaux afin d’expliquer que notre logique n’est pas comptable mais fondée sur la recherche de la performance et de l’efficience médicale. Il est par exemple évident que l’hématologie pratiquée à Saint-Louis n’est pas une activité de proximité et que notre seul souci est de faire en sorte qu’elle fonctionne bien et que les regroupements nous permettent d’atteindre des masses critiques. Nous ne parvenons pas toujours à convaincre les élus, mais au moins faisons-nous passer le message que la réduction de voilure n’est pas destinée à diminuer l’offre mais à la maintenir et à la développer tout en l’améliorant qualitativement, par l’accroissement des compétences, et en préservant, j’y insiste beaucoup, la continuité et la permanence des soins.
Tout cela s’inscrit dans un contexte de fort déclin de la démographie médicale : 45 praticiens hospitaliers de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris partiront en retraite en 2010, le double en 2011 et le triple en 2012. Par la suite, jusqu’en 2015, ce sont chaque année 200 médecins qui partiront en retraite, soit 18 % de nos effectifs, et nous savons bien qu’ils ne seront pas tous remplacés. Nous devons donc anticiper cette évolution et, dans cette perspective, les regroupements nous permettront de mieux utiliser le temps médical.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Dans ces regroupements et fusions, il y a donc, à la fois, un projet médical et une volonté de rationaliser pour remédier aux déséquilibres financiers et aux effets de la démographie médicale – ce dernier point renvoyant d’ailleurs aux insuffisances de la formation.
Pour ma part, j’aimerais que cette démarche, qui apparaît quand même motivée par la volonté de faire des économies – ce que l’on peut comprendre de la part des gestionnaires que vous êtes –, s’accompagne de la volonté de répondre aux besoins de santé de la population en envisageant ce que sera l’hôpital dans dix ou vingt ans, en particulier avec le développement de la chirurgie ambulatoire.
M. Benoît Leclercq. Au début de 2008, lorsque nous avons commencé à préparer notre plan stratégique pour 2010-2014, nous nous sommes d’abord demandé quelle vision nous avions de ce que serait un hôpital universitaire en 2020 ou 2025. Si l’on observe ce qui se passe en France, en Europe et aux États-Unis, on constate un développement de la chirurgie et de la médecine ambulatoires, donc de l’hôpital de jour ; une forte progression de la médecine, de la chirurgie et de la radiologie mini-invasives, sécurisées, au service du confort du patient ; la difficulté croissante de petites équipes à exercer, en dehors des grands ensembles hospitalo-universitaires, à la fois les fonctions de recours, de spécialisation, d’enseignement et de recherche. Il apparaît donc nécessaire de regrouper les équipes pour atteindre une masse critique suffisante et la réflexion actuellement menée sur les réformes de la recherche médicale pousse d’ailleurs également en ce sens.
Il faut aussi envisager tous les aspects relatifs à la technologie : il n’est pas envisageable de multiplier à l’infini les appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM), les pet (positron emission tomography) scans, les scanners, voire demain les cyclotrons, alors qu’il s’agit de matériels coûteux et qui nécessitent des personnels très spécialisés et rares.
Il convient également de regrouper les compétences dans la mesure où l’avenir est sans doute dans une médecine multidisciplinaire.
Penser l’hôpital de demain conduit aussi à prendre en compte l’évolution des biotechnologies, y compris des médicaments biologiques. Si nous sommes capables demain de régénérer les cellules cardiaques après un infarctus, l’approche médicale en sera modifiée en profondeur. Il faut donc anticiper des mouvements d’une ampleur comparable à celui qui a emporté la disparition des sanatoriums après la découverte du Rimifon.
Par ailleurs, en dépit de son faible impact sanitaire, l’épisode de la grippe H1N1 nous montre que la mondialisation peut favoriser des pandémies auxquels nous devons être capables de faire face. Il faut donc réfléchir à l’accueil : si nous sommes les meilleurs spécialistes de la neurochirurgie, il faudra aussi que nous soyons capables d’absorber des flux de patients en cas de pandémie.
Mme Jacqueline Fraysse. À la fois comme députée des Hauts-de-Seine et comme médecin, je constate, monsieur Leclercq, que le plan stratégique 2010-2014 de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris soulève de très fortes interrogations et de vives protestations au sein de l’opinion publique comme chez les professionnels concernés.
On peut comprendre ce que vous nous dites quant à la nécessité d’anticiper les évolutions de l’hôpital. En effet, les modes de vie de nos concitoyens ont beaucoup changé ; leurs besoins ont évolué ; les techniques médicales ont beaucoup progressé ; les interventions chirurgicales sont de moins en moins lourdes et il y a de plus en plus de gestes ambulatoires ; les séjours sont de moins en moins longs. On peut aussi envisager de regrouper certaines activités. Mais je ne discerne pas sur quelle évaluation des besoins vous vous fondez pour annoncer la suppression de milliers de postes. Peut-être pourriez-vous d’ailleurs nous préciser comment l’on est passé de 1 000 suppressions annoncées à 3 000, voire à 4 000.
Certes, vous nous dites que cela ne répond pas seulement à des motivations économiques mais qu’il s’agit également d’améliorer les soins. Mais, si je vois bien l’intérêt économique qu’il y a à supprimer des postes car la masse salariale pèse lourd dans les budgets, en revanche, je ne comprends pas comment l’on ferait mieux avec 3 000 personnes en moins !
Aujourd’hui, ces dernières travaillent dans des conditions très difficiles et cela ne tient pas seulement à des problèmes d’organisation, comme on voudrait nous le faire croire, mais aussi à des questions d’effectifs. Dans ces conditions, je ne pense pas que vous parveniez à convaincre du bien-fondé de votre action.
M. le coprésident Pierre Morange. Ce que vient de dire Jacqueline Fraysse nous renvoie à des questions que nous avons beaucoup abordées lors de nos auditions précédentes et qui intéressent notre mission parce que c’est tout simplement la bonne utilisation des deniers publics qui est en jeu. J’aimerais donc que, au-delà des propos généraux, vous nous donniez des informations précises sur ce qui est fait ou non dans vos établissements en matière d’outils de mesure, de comptabilité analytique, de gestion prévisionnelle des carrières permettant de mettre en adéquation l’offre sanitaire et la demande de la population, de maîtrise des systèmes d’information, de codification des actes, de partage des connaissances permettant à l’ensemble des professionnels de se les approprier.
M. Benoît Leclercq. Madame Fraysse, je n’ai pas sorti de mon chapeau le nombre de suppressions d’emplois : il résulte d’une approche comparative qui nous permet de dire que, pour telle activité, à un niveau donné de qualité et de quantité, nous avons besoin de tant de personnes présentant tel type de qualification.
Pour ne pas me contenter de propos généraux, je reprends l’exemple de l’Hôtel-Dieu, dont nous sommes obligés de réduire la voilure. En mars et avril prochains, nous transférerons la chirurgie digestive dans des locaux libérés à Cochin, ce qui nous permettra de développer la chirurgie thoracique à l’Hôtel-Dieu. Quand tout cela aura été mené à bien, nous aurons ainsi davantage de chirurgie digestive et davantage de chirurgie thoracique et nous aurons vraisemblablement économisé 40 emplois.
De la même façon, j’ai demandé que, dans le cadre du rapprochement Cochin-Hôtel-Dieu-Broca, on rapatrie à Cochin l’ensemble de la biologie de l’Hôtel-Dieu, à l’exception de ce qui nécessaire aux urgences et aux soins de proximité. De la sorte, 20 à 30 emplois seront économisés sans que la qualité en soit affectée.
C’est ainsi, par la multiplication de micro-projets de ce type, que nous approcherons les 3 000 à 4 000 suppressions d’emplois sur la durée du plan – c’est une fourchette –, soit 1 000 suppressions par an.
J’en viens à la question de M. Morange. Oui, nous disposons de plusieurs outils de pilotage, en particulier d’un tableau de bord, pour partie mensuel, qui nous permet de suivre les grands indicateurs classiques de gestion, aux niveaux de l’Assistance publique, des groupes hospitaliers et des pôles d’activité médicale. On y retrouve les principaux critères quantitatifs mais aussi qualitatifs. Ainsi, nous observons le nombre des patients qui attendent moins de quatre heures aux urgences : c’est un indicateur qualitatif loin d’être négligeable qui nous permet de mieux répondre à l’attente de la population. Un indice Saphora nous permet également de mesurer le taux de satisfaction des patients.
En ce qui concerne la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, nous savons que 1 700 à 1 900 personnes partent chaque année à la retraite, à proportion des catégories, soit deux tiers de soignants et un tiers de non-soignants. Nous enregistrons en outre environ 4 000 départs par mutation en province, vers d’autres fonctions et vers d’autres hôpitaux. Rapporté aux 70 000 emplois, le turn-over est donc important.
La gestion prévisionnelle des emplois nous permet d’anticiper les besoins, notamment en emplois qualifiés d’infirmiers et d’aides-soignants. Je pense que nous avons résolu la question des aides-soignants grâce à nos centres de formation et à notre politique de promotion des agents de service. S’agissant des personnels infirmiers et infirmiers spécialisés, qui sont la cheville ouvrière du fonctionnement hospitalier, outre que, comme l’a souligné Paul Castel, la pénurie perdure, pas moins de 1 700 équivalents temps plein bénéficient chaque année de notre politique de promotion professionnelle, ce qui signifie que ces personnes sont payées par les établissements pour faire des études et, surtout, doivent être remplacées.
Nous devons également anticiper les effets de l’application aux infirmiers de la réforme licence-master-doctorat (LMD) et de son corollaire, le passage en catégorie A. Les infirmiers étant ainsi appelés à prendre leur retraite plus tardivement, le fonctionnement des hôpitaux s’en trouvera temporairement facilité, mais le GVT (glissement-vieillesse-technicité) en sera alourdi dans la mesure où l’on recrutera moins de jeunes pendant quelques années.
Autre exemple en matière de gestion prévisionnelle des effectifs : en dépit des protestations, j’ai supprimé la promotion professionnelle pour les infirmiers aides-anesthésistes parce que j’ai considéré qu’ils étaient suffisamment nombreux au sein de la fonction publique et qu’il suffisait donc de recourir au marché du travail pour faire fonctionner nos systèmes. À l’inverse, j’ai maintenu un taux très important de formation des infirmiers de bloc opératoire car nous en manquons.
Nous devons également tenir compte de l’apparition de nouveaux métiers : dans les laboratoires, nous aurons bientôt plus besoin d’ingénieurs que de biologistes. Sans doute aurons-nous également davantage besoin d’infirmières de niveau bac + 5 pour occuper des fonctions plus complexes, par exemple en matière de recherche.
Dans la perspective de la nécessaire diminution de la masse salariale, nous devons aussi nous intéresser tout particulièrement aux emplois non soignants, sachant qu’il est difficile de recycler un ouvrier professionnel ou un cuisinier et que le taux de renouvellement est beaucoup plus faible que chez les personnels soignants. Afin de faciliter la mobilité, nous nous appuyons sur le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés.
Au sein des centres de gestion, la comptabilité analytique est à peu près au point même si elle n’est pas parfaite. Au sein des groupes homogènes de séjour (GHS), il est particulièrement intéressant de connaître les éléments de coûts variables – médicaments et prestations hôtelières – ainsi que les coûts fixes, comme le temps passé par les personnels auprès des patients. Actuellement, la répartition se fait dans l’échelle nationale des coûts au prorata du nombre de journées et cet outil mériterait sans doute d’être affiné. Cette échelle nous permet non seulement de suivre notre activité, mais surtout de vérifier si notre structure de coûts par groupe homogène de séjour est ou non dans la norme.
Il nous est également fort utile, par exemple si l’on veut développer la chirurgie thoracique, d’avoir une connaissance parfaite des groupes homogènes de séjour et du nombre d’actes, car cela nous permet d’élaborer un modèle de développement en faisant en sorte que les coûts – variables et fixes, directs et indirects – soient inférieurs ou égaux aux tarifs, donc à l’échelle nationale des coûts.
La codification des actes est un exercice complexe, nécessitant une adaptation constante des médecins et des techniciens qui en ont la charge car on est aujourd’hui à la onzième version de la tarification. Cela dit, en nous faisant passer en 2009 de 780 groupes de séjours à plus de 2 000 items, cette version a nettement amélioré la codification. Nous devons encore progresser en la matière, mais d’ores et déjà les dispositifs institués par les pouvoirs publics permettent d’éviter les dérives. Ainsi, la directive dite « frontière » entre les actes d’hospitalisation et les actes d’hôpital de jour nous a amenés, par des contrôles réguliers, à requalifier un certain nombre d’actes, ce qui a eu des effets sur les remboursements. Pour la première fois, nous allons payer des pénalités au titre de 2009.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons été informés d’importants problèmes de recouvrement des factures, qui ont eu des effets non négligeables sur le déficit de certains établissements. L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est-elle confrontée à un tel phénomène, dont l’éradication permettrait d’améliorer ses recettes ?
M. Benoît Leclercq. Une grande partie du recouvrement est automatique, grâce à la transmission des éléments de facturation à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM). Pour le reste, l’amélioration du taux de recouvrement dans l’année aurait incontestablement des effets sur notre équilibre financier. Mais nous sommes dans un processus constant d’amélioration, ce taux ayant progressé, pour l’hospitalisation, de 6 % de 2008 à 2009, pour atteindre 70 % au cours de l’année.
M. le coprésident Pierre Morange. Les chambres régionales des comptes ont aussi observé un phénomène de non-facturation, en particulier faute d’identification lors du passage aux consultations ou aux urgences. Ce problème concerne-t-il uniquement quelques établissements ou est-il plus général ?
M. Benoît Leclercq. Il arrive encore que des passages aux consultations ou aux urgences ne soient pas repérés mais ce phénomène est aujourd’hui marginal, en particulier grâce à des mécanismes de contrôle – ainsi, nous demandons désormais non seulement la carte Vitale mais aussi une pièce d’identité – que le public juge un peu inquisitoriaux mais qui sont fort utiles.
M. Paul Castel. Le projet médical est véritablement l’épine dorsale de notre plan stratégique. Notre projet d’établissement 2009-2013 n’a en aucune façon procédé d’une démarche allant du haut vers le bas : élaboré au cours de quelque 150 réunions avec les équipes médicales, il est le fruit d’une très large concertation.
Les regroupements ne relèvent donc pas d’une approche comptable ou technocratique, mais sont le résultat de discussions sur le projet médical, dans le cadre d’une démarche de service public. Ils sont destinés à éliminer des doublons et concernent pour l’essentiel des activités de recours comme les greffes hépatiques, les transplantations, etc. Ils s’accompagnent d’investissements colossaux – 600 millions d’euros pour la construction de quatre hôpitaux. Ils ne concernent d’ailleurs pas uniquement les soins, mais aussi la logistique – blanchisserie, stérilisation, cuisine, etc. Et, comme l’a souligné Benoît Leclercq, ce mouvement est accompagné par le Fonds de modernisation et par d’autres instruments de soutien.
Tout cela débouche sur de meilleures conditions d’accueil et sur de meilleures conditions de travail pour les salariés. Pour autant, on ne saurait perdre de vue que, dans le cadre de la T2A, nous nous situons dans une démarche concurrentielle, et qu’exerçant à 85 % ou 90 % une activité de proximité, nous sommes entourés d’établissements privés qui se sont regroupés et beaucoup modernisés. Ce contexte nous oblige à améliorer notre efficience.
S’agissant de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les Hospices civils de Lyon enregistrent environ 1 600 départs par an, en raison des départs en retraite et du turn-over. Nous avons opté pour le non-remplacement de trois agents administratifs sur quatre et le remplacement de trois soignants sur quatre, les infirmières n’étant pas concernées.
Tout cela n’est pas fait de façon abrupte, mais en relation avec les regroupements et réorganisations.
Mme Jacqueline Fraysse. Nous devons d’abord veiller à l’intérêt général. Les décisions sont-elles prises à partir de l’évaluation des besoins de la population ? C’est vraiment ce qui me préoccupe.
M. Paul Castel. Telle est bien notre démarche : dans le cadre de l’élaboration du projet d’établissement, nous avons demandé à des prestataires de services extérieurs d’utiliser des méthodes d’enquête pour mesurer les besoins.
M. Jean-Pierre Dewitte. En ce qui concerne la politique de territoire, il y a ce dont aura besoin la population et ce qu’on pourra lui offrir. Nous connaissons avec une quasi-certitude l’évolution de la démographie médicale au cours des dix prochaines années et nous savons donc qu’il faut anticiper des déficits dans certaines disciplines. Nous devons aussi prendre en compte les aspirations du personnel médical à des modes de travail différents et à un exercice plus groupé et plus partagé. Enfin, quand on essaie de définir le paysage hospitalier de demain, on ne saurait négliger la persistance du caractère fortement rural de notre région.
Pour nous, les regroupements concernent des établissements juridiquement indépendants et s’opèrent non pas au sein du centre hospitalier universitaire de Poitiers mais entre des établissements immédiatement voisins dans le cadre départemental. Pour les mener à bien, il faut une volonté et une prise de décision et je suis persuadé que les agences régionales de santé (ARS) joueront en la matière un rôle essentiel. Une fois la décision prise, il faut mettre les gens au travail pour élaborer un projet médical et un projet pour les soignants. Cela ne me semble pas le plus difficile : quand le cadre aura été dessiné, le projet nous aidera à le remplir.
Je rejoins par ailleurs Benoît Leclercq : il faut avoir le courage de dire qu’une gouvernance unique sera nécessaire. De ce point de vue, je suis quelque peu déçu que la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires soit restée timide sur les notions de communauté hospitalière de territoire et de gouvernance. Alors que les établissements privés se sont rapprochés sous une gouvernance unique, j’ai l’impression que, dans les régions, nous avons plutôt tendance, avec les groupements de coopération sanitaire, à juxtaposer les niveaux, au risque qu’il y en ait autant que de disciplines médicales et que cela nuise à la cohérence d’ensemble.
Il me semble également indispensable, dans la perspective d’un regroupement de plateaux techniques de plus en plus sophistiqués et médicalement multicompétents, qui n’accueilleront les patients que pendant 48 heures, de réfléchir à une politique des transports, en particulier de développer l’héliportage.
S’agissant de la facturation, nous n’avons pas, pour notre part, de problème pour repérer et identifier les patients. Mais si la T2A a mis l’accent sur le séjour, je crois que l’on a omis de prendre en compte la rémunération des consultations à l’hôpital : outre que la facturation est très onéreuse au regard des recettes, elle ne reflète que très imparfaitement le coût réel des consultations et mériterait donc d’être revue.
Enfin, je suis un adepte fervent de l’étude nationale des coûts : dans le cadre de la stratégie de développement, avant de lancer une nouvelle activité, on conduit désormais une étude médico-économique à laquelle participent les médecins et qui nous est fort utile. Alors que le corps médical a spontanément tendance à comparer tarif et activité, une telle étude permet de remédier à l’absence de visibilité qui nous pénalise, en particulier dans notre démarche de contractualisation qui se développe fortement et à laquelle les médecins adhèrent. Le mode actuel de facturation ne nous donne pas cette visibilité.
M. Denis Fréchou. Qu’il s’agisse de fusions, de regroupements ou de restructurations de sites existants, de nombreux établissements hospitaliers sont confrontés à la difficulté d’adapter le dispositif à l’évolution des besoins et de la demande des patients. Il me semble donc à moi aussi essentiel de mettre en avant un projet élaboré en commun et partagé.
Mais, si l’on a en général une assez bonne idée de ce que doit être un projet à quatre ou cinq ans, des restructurations lourdes exigent que l’on ait une vision à quinze ou vingt ans et l’on est beaucoup moins certain de ce que seront les évolutions à une telle échéance.
Il me semble par ailleurs que l’on a peu évoqué la nécessité de communiquer sur ces opérations. C’est pourtant tout à fait indispensable si l’on veut éviter les réactions des personnels et de la population vis-à-vis de changements de culture qui sont toujours longs et difficiles.
On l’a dit, les restructurations passent par des investissements très lourds. Or, les établissements ne sont aidés qu’à hauteur de 50 ou 60 % et ils doivent donc dégager eux-mêmes des marges importantes pour pouvoir se restructurer.
Enfin, il me semble que l’on ne mesure pas toujours assez, sur le terrain, le temps qui est nécessaire pour élaborer un projet, pour changer les cultures et pour conduire les opérations. Si les centres hospitaliers universitaires se sont restructurés plus rapidement et plus profondément, les hôpitaux généraux ont pour leur part pris un retard qui est encore appelé à s’accentuer au regard de la logique de regroupement mise en avant par la loi du 29 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
M. le coprésident Pierre Morange. Ces sujets sont extrêmement vastes mais nous sommes, hélas, contraints par le temps. Merci d’avoir répondu de façon aussi précise à nos questions. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions concrètes pour améliorer le fonctionnement de notre système hospitalier.
*
Audition de M. Pierre Boissier, chef de l’Inspection générale des affaires sociales, Mme Françoise Lalande et M. Christophe Lannelongue, inspecteurs généraux des affaires sociales, et M. Denis Debrosse, conseiller général des établissements de santé.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Pour étudier le fonctionnement interne de l’hôpital, nous avons adopté une méthode quelque peu inhabituelle, consistant à examiner des cas particuliers de dysfonctionnement et, tout en tenant compte des spécificités des établissements observés, à essayer d’en tirer des enseignements et des préconisations susceptibles d’être généralisés.
Nous disposons déjà de « pré-conclusions » qui portent notamment sur les réorganisations hospitalières, par fusion ou regroupement, sur la gestion des personnels – dont on attend souvent des économies, les charges salariales représentant 70 % des charges des établissements –, sur les systèmes d’information, de tarification, de codification des actes et de facturation, sur la convergence et sur la concurrence avec le secteur privé ou entre établissements mêmes.
Nous nous interrogeons sur les biais de tarification et sur l’évaluation de la pertinence des soins, ainsi que sur le rôle des tutelles, qu’il s’agisse des agences techniques ou des administrations centrales, qui défendent parfois des analyses que ne confirment pas nos constats.
M. Pierre Boissier, chef de l’Inspection générale des affaires sociales. l’Inspection générale des affaires sociales est en train de revoir assez profondément ses modes d’intervention dans le secteur hospitalier, à la suite des modifications intervenues dans son environnement proche : réorganisation de l’administration centrale, notamment de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) qui se consacrera désormais davantage à une fonction de pilotage ; rattachement, depuis le mois dernier, du Conseil général des établissements de santé (CGES) à l’inspection générale ; mise en place de l’Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), avec laquelle nous devons nous coordonner car, si elle est surtout compétente pour la méthodologie, elle veille aussi à une trentaine de risques spécifiques.
Jusqu’ici, l’Inspection générale des affaires sociales s’est surtout consacrée à des missions d’inspection et de contrôle, en cas d’accidents ou de dysfonctionnements graves, comme à Poissy-Saint-Germain…
M. le coprésident Pierre Morange. Sur ce sujet, nous attendons un rapport qui devait impérativement être remis avant le 31 janvier.
M. Pierre Boissier. La confection de ce rapport a pris en effet un peu de retard. Nous en avons conféré avec le cabinet et il est apparu que le délai n’était pas raisonnable, même si cette mission a été confiée à une équipe relativement importante. Il s’agit d’un sujet complexe et nous tenons à remettre un document pleinement pertinent.
M. le coprésident Pierre Morange. Aucune autorité administrative ne dispose de la latitude de modifier elle-même la date de remise d’un rapport qui lui a été commandé. La MECSS, en partie à l’origine de celui-ci, attend impatiemment son dépôt, afin d’en nourrir sa propre réflexion. J’ajoute qu’il importe qu’on y remonte suffisamment loin dans le temps, pour permettre de tirer de cette affaire des conclusions générales.
M. Pierre Boissier. L’Inspection générale des affaires sociales, disais-je, s’est surtout consacrée jusqu’ici à des missions d’inspection et de contrôle et à des interventions sur des sujets « transverses ». Le rapprochement avec le Conseil général des établissements de santé va la conduire, en sus, à apporter un appui aux établissements de santé et, le cas échéant, à intervenir dans la mise en place d’une administration provisoire lorsqu’ils connaissent de graves difficultés. Ces nouvelles missions devraient pouvoir être exercées d’ici à trois mois.
M. Denis Debrosse, conseiller général des établissements de santé. Il a été donné pour objectif aux établissements de santé de revenir à l’équilibre financier en 2012. Les quatre-vingts missions d’appui et de conseil effectuées par le Conseil général des établissements de santé depuis quatre ans ont confirmé ce dont m’avait convaincu mon expérience depuis 1972 : il existe, au sein des hôpitaux, une culture traditionnelle qui consiste à expliquer les déficits par l’insuffisance des moyens au regard des exigences du service public. L’introduction de la tarification à l’activité (T2A) a donc représenté une sorte de « big bang ». Nombre d’hôpitaux ont su s’adapter, certains non. Car il serait faux de dire que tous les hôpitaux publics, que tous les centres hospitaliers universitaires sont en déficit : ce qui est vrai, c’est qu’une trentaine d’établissements, dont les plus importants, sont en grande difficulté – sont de « grands malades ».
Le déficit a ordinairement trois causes : tout d’abord, une activité insuffisante, les cliniques privées ayant, après s’être restructurées, conquis une partie du terrain auparavant occupé par l’hôpital public ; or, plus les établissements étaient importants, moins ils se sont préoccupés de cette concurrence.
Deuxième cause : l’inadaptation de l’offre de soins à l’activité réelle, qu’illustre la présence parfois de personnes âgées dans les services de chirurgie où elles n’ont rien à faire. On parle à ce propos de patients « inadéquats », mais ce sont bien évidemment les structures qui sont inadéquates. Aujourd’hui, on ne peut plus redessiner le paysage hospitalier en partant de l’organisation en place : il faut partir des besoins de santé et de l’activité réelle. Si l’on adopte cette logique, l’hôpital idéal auquel on arrive n’a rien à voir avec celui qu’on voit fonctionner. C’est le signe certain que les réorganisations indispensables n’ont pas eu lieu. Y procéder est certes une tâche redoutable : cela implique que des services ou des fonctions disparaissent tandis qu’il faut en développer d’autres : médecine gériatrique, médecine « chronique »… L’expansion des soins ambulatoires casse d’ailleurs déjà l’organisation traditionnelle de l’hospitalisation. On déplore souvent, et moi comme bien d’autres, un manque de personnel auprès des lits des patients, mais le problème est mal posé : il résulte, non d’une insuffisance d’effectifs, mais de l’absence de réorganisation – ainsi que d’une mauvaise gestion des RTT, pour lesquelles on constate des disparités considérables entre établissements : certains accordent 22 jours de congé, d’autres 14, soit une différence équivalant à quatre-vingts postes dans un hôpital de 2 500 salariés !
Dernière source de difficultés : une gestion défaillante. Les établissements en situation périlleuse se distinguent par leur incapacité à fournir des chiffres comparables d’une année à l’autre, des séries statistiques continues. Ils ne disposent même pas d’indicateurs simples comme le nombre de patients, la durée moyenne de séjour, la situation de trésorerie…
Le système s’est complètement délité. Comment y remédier ? Cinq pistes sont à explorer.
En premier lieu, il faut réexaminer les choix faits en matière d’investissements. Des hôpitaux espèrent améliorer leur situation en accroissant leur activité, mais, faute de fonds propres, cela les condamne à emprunter, donc à s’endetter encore davantage. D’autre part, l’activité à laquelle ils songent est souvent exercée par d’autres… Enfin, je doute qu’on puisse reconstruire à échéance de six ans un établissement de 1 200 lits, comme certains le projettent.
Deuxièmement, il faut définir l’offre médicale en tenant compte des besoins du bassin de population et des offres de soins alternatives à celles de l’hôpital, fournies par les cliniques privées et par la médecine ambulatoire, ce afin de combler des manques plutôt que d’affronter une concurrence.
Troisièmement, il faut une meilleure gestion des ressources humaines.
Quatrièmement, il faut rompre avec un système financier permissif qui autorise des établissements en grande difficulté à souscrire des emprunts alors qu’ils ne disposent plus de fonds propres et sont fortement endettés – ce qui entretient une confiance illusoire en l’avenir.
Enfin, « l’écosystème » hospitalier étant très résistant au changement, il faut tenir, depuis le plus haut niveau jusqu’au plus bas, un discours clair sur les finalités des indispensables réorganisations, à savoir une bonne prise en charge des patients et une bonne qualité des soins, faute de quoi on restera prisonnier du discours traditionnel, dont se régale toute une série de lobbies, sur l’insuffisance des moyens.
M. Christophe Lannelongue, inspecteur général des affaires sociales. Une équipe de l’Inspection générale des affaires sociales et du Conseil général des établissements de santé avait étudié, en 2007 et 2008, les mesures prises dans cinq régions par dix-neuf établissements, dont quatre centres hospitaliers universitaires, dans le cadre des contrats de retour à l’équilibre financier. Elle avait observé que cette politique de rétablissement financier, bien qu’ayant mobilisé 700 à 800 millions d’euros par an depuis 2006, n’était pas efficace. Les contrats étaient très peu ambitieux et insuffisamment centrés sur les causes réelles des déficits, liées à l’organisation de l’hôpital. Ils souffraient également de l’absence de sanctions en cas de non-respect de leurs stipulations et d’un pilotage trop faible de la procédure tant au niveau national que régional, à quoi s’ajoutaient de graves lacunes dans le management des établissements concernés.
Une évolution importante s’est produite depuis lors, comme l’a constaté une commission des suites, mise en place en septembre 2009 pour réexaminer toutes les mesures prises aux différents niveaux, en application ou non de ce rapport.
La mission avait d’abord proposé de mieux encadrer juridiquement la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre des contrats. Des dispositions sont intervenues en ce sens dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, dans un décret du 28 juin 2008 et, surtout, dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui conduit à ce que les contrats et les plans de redressement interviennent davantage à l’initiative des agences régionales de santé et soient mieux encadrés dans le temps. La loi permet ainsi au directeur général de l’agence régionale de santé d’imposer à un établissement de présenter un plan de redressement dans un délai compris entre un et trois mois et, à défaut, de le placer sous administration provisoire sans avoir besoin, comme par le passé, d’un avis préalable de la chambre régionale des comptes.
La deuxième proposition tendait, pour améliorer les capacités de management des établissements, à renforcer les pouvoirs de leur direction et à développer les outils de gestion modernes – systèmes d’information et comptabilité analytique –, notamment dans le domaine des ressources humaines. Des progrès ont également été enregistrés sur ce point : l’action de la Mission d’expertise et d’audit hospitalier (MEAH), devenue l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, s’est intensifiée, permettant notamment de rationaliser la gestion des blocs opératoires.
En troisième lieu, la mission insistait sur l’importance des ressources humaines comme facteur de réussite des réorganisations. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires comporte à cet égard des dispositions importantes, mais il faut bien reconnaître que les évolutions sont lentes sur ces sujets : ainsi en matière de gestion des carrières des directeurs et des praticiens hospitaliers, que l’on visait à moderniser grâce à la création du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG). La mission avait constaté, dans nombre d’établissements, une grande difficulté à faire évoluer l’organisation des équipes médicales, en particulier faute d’instruments facilitant la mobilité et la reconversion professionnelle. Or la procédure de retour en instance d’affectation, permettant de reconvertir des praticiens, a été peu utilisée : elle ne concerne à ce jour que quelques dizaines de médecins, au lieu des mille huit cents attendus.
M. le coprésident Pierre Morange. Est-ce la responsabilité des établissements ou bien du Centre national de gestion ?
M. Christophe Lannelongue. La procédure est lourde mais, à tous les niveaux, y compris à celui du Centre national de gestion, on constate une forte timidité à s’y engager.
Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de novembre 2009, sur « le financement de la recherche, de l’enseignement et des missions d’intérêt général dans les établissements de santé », a fait les mêmes constats que la mission sur les restructurations : on rencontre des difficultés dans la gestion des enveloppes de missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation (MIGAC), particulièrement pour le financement de la recherche et de l’enseignement, mais aussi pour les autres missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation, comme celle qui concerne la permanence des soins. Les préconisations de ce rapport sont trop récentes pour être déjà mises en œuvre, mais il s’agit là d’un point crucial pour l’évolution de la gestion des établissements.
Dans les cinq régions inspectées, on observe cependant des progrès récents, et tout à fait notables, à travers l’apparition d’une nouvelle génération de contrats qui ont d’ores et déjà permis des résultats effectifs.
Mme Jacqueline Fraysse. Vous avez signalé l’importance des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, mais je perçois mal à quoi tendait le reste de votre propos sur le sujet…
M. Christophe Lannelongue. Le financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation obéit à une logique « historique » : il s’agit de rendre aux établissements ce qu’ils percevaient avant l’institution de la T2A, mais ce faisant, on ne prend pas en compte la réalité des charges et des besoins. En résultent ou bien des situations de rente, ou bien une insuffisance de financement, particulièrement inquiétante pour ce qui est de la recherche et de la permanence des soins. C’est pourquoi la mission préconisait une rationalisation dans la répartition des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation.
Mme Françoise Lalande, inspectrice générale des affaires sociales. Les établissements de santé confrontés à des accidents ou à des dysfonctionnements réagissent toujours de la même façon : ils les imputent à une insuffisance de leurs moyens. Notre analyse montre au contraire qu’il en est assez rarement ainsi.
La pertinence des soins peut se définir comme leur adéquation aux besoins des patients, laquelle peut faire l’objet d’analyses individuelles – c’est la tâche des médecins contrôleurs de la sécurité sociale – ou collectives. La Haute Autorité de santé a identifié quatre causes principales de non-pertinence : c’est d’abord la mauvaise organisation des soins, qui se traduit par exemple par des temps d’attente excessifs aux urgences. Ce sont ensuite des décisions médicales inadéquates, comme des prescriptions abusives, mais on les décèle aussi dans la remontée actuelle de la consommation de produits sanguins labiles, assez difficile à expliquer car elle fait suite à la diminution observée après l’affaire du sang contaminé sans qu’aucun problème de santé publique la justifie, et son amplitude varie du simple au double selon les régions. Une troisième cause tient aux patients ou à leur entourage : ainsi ce dernier peut provoquer le placement de personnes âgées ou handicapées, souffrant de simples troubles du comportement, en hôpital psychiatrique où elles côtoient parfois des malades dangereux. Enfin, la dernière cause est le manque de structures relais, notamment pour le maintien à domicile ou pour la réadaptation. Les problèmes financiers, en revanche, ne jouent qu’un rôle secondaire.
La qualité des soins dépend avant tout de l’existence de procédures et de bonnes pratiques, qui doivent être écrites, actualisées, connues, évaluées ; de l’existence de contrôles, internes et externes ; de formations adéquates, initiales et continues ; de l’adaptation des personnels à leurs tâches, ce qui exige la tenue de fiches de postes ; de l’existence d’indicateurs de moyens et de résultats ; de retours d’expérience en cas d’accident et de dysfonctionnement. Plusieurs missions de l’Inspection générale des affaires sociales ont montré que, dans certains établissements, aucune de ces exigences n’était satisfaite. Or, même si toutes les situations ne sont pas aussi critiques, les accidents à l’hôpital résultent généralement d’une conjugaison de dysfonctionnements dus à l’ignorance de ces bonnes méthodes.
Comment développer l’évaluation et l’assurance qualité à l’hôpital ? Il convient d’abord de publier régulièrement des indicateurs de qualité, tels que la mortalité constatée par rapport à la mortalité attendue, les taux de reprises opératoires, de maladies nosocomiales, de fugue en psychiatrie ou de mort aux urgences de malades en fin de vie connus comme tels, ou encore le volume d’activité – dont un rapport de l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) a montré qu’il était souvent en corrélation avec la qualité des soins. Il faut également miser sur les certifications par la Haute Autorité de santé – qu’il faut cependant inviter à se montrer plus rigoureuse, l’hôpital d’Épinal, qui en est à sa cinquième inspection, ayant obtenu sa certification – ou par le Comité français d’accréditation (COFRAC), ainsi que sur les contrôles de conformité de premier niveau.
Les dysfonctionnements sériels devraient être, par thèmes, analysés au niveau national. Nous avons suggéré l’élaboration d’un plan tendant notamment à mieux exploiter les retours d’expérience, mais la Mission d’expertise et d’audit hospitalier a aussi défini une méthode qu’il conviendrait de généraliser…
M. le coprésident Pierre Morange. Il existe nombre de rapports riches d’informations et de propositions et nous ne manquons pas de structures chargées d’évaluer et de préconiser les bonnes pratiques. Ce qui manque, ce ne sont donc pas les idées, c’est le « passage à l’acte » – problème bien français. C’est bien d’être intelligent, mais c’est encore mieux d’être « opérationnel ».
Mme Françoise Lalande. Lors d’inspections récentes dans deux hôpitaux psychiatriques connaissant des dysfonctionnements graves, j’ai été confrontée à deux attitudes opposées : dans l’un, on refusait le retour d’expérience, on se contentait de mettre en cause le manque de moyens et on se réfugiait derrière une explication fausse des accidents survenus ; dans l’autre, on a procédé au retour d’expérience et réalisé un effort d’information interne afin que tout le personnel puisse s’approprier le diagnostic.
M. Pierre Boissier. Pour le « passage à l’acte », la valeur de l’exemple est fondamentale.
Le nombre d’établissements en grande difficulté est relativement limité. Pour résoudre leurs problèmes, il faut procéder par phases successives : d’abord établir un diagnostic précis qui englobe l’ensemble des problèmes et des procédures ; ensuite, sur le fondement de ce diagnostic, établir un plan d’action concret, assorti d’un calendrier. Si ce plan n’est pas mis en œuvre, il existe aujourd’hui des instruments efficaces à la disposition des agences régionales de santé, qui pourront agir à l’égard des établissements un peu comme une holding à l’égard de ses filiales. Il n’est sans doute pas indiqué de recourir trop vite à l’administration provisoire, dispositif lourd, compliqué et traumatisant. En revanche, on pourrait très bien imaginer de recourir, sur le modèle du management de transition utilisé pour le redressement d’entreprises privées, à un système d’administration d’intérim, animé par des gens compétents et à l’abri de tout conflit d’intérêts. Une fois mise en œuvre la totalité du plan, la responsabilité de la gestion serait remise à un directeur, qui hériterait d’une situation assainie.
Si on réalise cela dans quelques établissements, les situations des hôpitaux étant relativement homogènes, l’exemplarité jouera son rôle.
M. Christophe Lannelongue. L’Inspection générale des affaires sociales, en liaison avec le Conseil général des établissements de santé, a rédigé, sur la rémunération des médecins et chirurgiens hospitaliers, un rapport qui montre une forte déconnexion entre le niveau de rémunération, d’une part, la compétence, l’activité et les résultats, d’autre part. Cette situation est au détriment d’une gestion efficace des personnels et du développement de l’hôpital public. Nous avions donc proposé que les équipes médicales réfléchissent à l’organisation de leur activité, en vue de parvenir à un meilleur équilibre, en leur sein, entre la contribution et la rétribution, compte tenu de la participation de chacun aux différentes activités, de soin, d’enseignement, etc. Un des leviers majeurs de la restructuration est en effet, à mon sens, l’émergence d’un autre management, opérationnel, dont les praticiens bénéficieront en retour.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Merci pour toutes ces pistes de réflexion.
*
Audition de M. Alain Destée, président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires, M. Francis Fellinger, président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers, M. Didier Gaillard, président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des établissements de santé privés à but non lucratif, M. Jean-Pierre Genet, président d’honneur, M. Marc Hayat, vice-président, et M. Jean Halligon, ancien président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement de l’hospitalisation privée.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Nos travaux portent sur le fonctionnement de l’hôpital. Nous avons choisi d’étudier des établissements particuliers pour cerner leurs dysfonctionnements afin d’en tirer des enseignements valables pour tous, une fois la part faite de ce qui tient à la spécificité de chacun. Je vous invite à nous dire à quoi vous attribuez ces dysfonctionnements et quelles sont, selon vous, leurs conséquences sur les plans humain et budgétaire et sur la production de soins. Nous vous écouterons avec un intérêt particulier parler de l’articulation entre responsabilité administrative et responsabilité médicale, dont nous savons qu’elle a une influence directe sur l’efficacité du système hospitalier.
M. Alain Destée, président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires. La communauté médicale que je représente est consciente qu’on peut la tenir pour responsable, au moins partiellement, de certains dysfonctionnements, qu’il s’agisse de la qualité des soins, parfois critiquable, ou de l’expansion du coût de la santé en France, tout particulièrement du coût des hôpitaux publics et plus spécifiquement encore des centres hospitaliers universitaires dont on se plaît, année après année, à rappeler les déficits.
J’aimerais cependant que la Nation, dont vous êtes les représentants, prenne conscience que la santé a un coût et qu’aucune des composantes de ce coût n’est vouée à diminuer : la population s’accroît, elle vieillit, le nombre de pathologies prises en charge efficacement augmente. Ainsi, dans ma discipline, la neurologie, il n’existait pas de traitement efficace de la maladie d’Alzheimer ou de la sclérose en plaques il y a quelques années ; nous en disposons à présent. Le coût de ces traitements augmente et, dans le même temps, les malades, bien informés de ces progrès médicaux, demandent à en bénéficier, ce qu’on peut difficilement leur refuser.
Mme Jacqueline Fraysse. Heureusement !
M. Alain Destée. Tel est le contexte. Cela étant, nous pensons, comme vous, que l’optimisation des dépenses hospitalières est nécessaire et que l’efficience doit progresser. Depuis la réforme Hôpital 2007 mise en œuvre par M. Jean-François Mattei, mais auparavant déjà, nous nous y sommes attachés et nous avons pris des mesures propres à améliorer le ratio coût/efficacité de la santé, en tout cas dans les établissements que je représente. Les cliniques médicales de l’établissement dans lequel j’exerce, installées bien avant les pôles créés par la réforme de 2007, avaient un impact sur la gestion. Alors que j’en étais coordonnateur, j’ai eu à gérer une enveloppe de mensualités du personnel, j’ai pu bénéficier d’un intéressement et, pour être ainsi directement impliqué dans la gestion, j’ai pu découvrir une organisation nouvelle de l’hôpital bien avant l’heure.
Nous continuerons de nous impliquer dans ce travail d’optimisation, dans le cadre de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Nous avons soutenu ce texte, et nous l’avons dit plusieurs fois à Mme la ministre de la santé ; toutefois, la partie relative à la gouvernance nous trouble. En effet, une complicité efficace entre administrateurs et médecins est nécessaire au sein des établissements hospitaliers pour que la vision administrative et financière d’une part, la vision médicale d’autre part, se complètent de manière à avoir une gestion médico-économique, et non une gestion strictement financière. Or la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, à certains égards, favorise une gestion financière plutôt qu’une gestion médico-économique de l’hôpital, et nous le regrettons. L’organisation verticale – ministère, directeur de l’agence régionale de santé, directeur d’établissement, chef de pôle – est révélatrice des « lignes de force » à l’hôpital. C’est ce qui nous a conduits à demander instamment le maintien de la commission médicale d’établissement. Si l’on souhaite obtenir l’adhésion des médecins au projet hospitalier, la collectivité médicale doit être représentée, de manière que la prise de décisions soit médicalisée. Certaines situations imposent que des mesures soient prises, nous en sommes conscients. La situation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris illustre cette nécessité de manière criante, mais mon collègue Pierre Coriat a clairement indiqué qu’il approuverait les mesures envisagées par le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris pourvu que la réflexion conduisant aux choix soit fondée sur des considérations médicales et non purement comptables.
M. Francis Fellinger, président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers. J’approuve, pour l’essentiel, ce qui vient d’être dit. Je représente les commissions médicales de 520 centres hospitaliers, un groupe très hétérogène qui constitue la première offre de soins hospitaliers en France, et qui traite de nombreuses pathologies lourdes. Je soulignerai en préambule que, même si des améliorations sont possibles en matière de gestion et de qualité des soins, notre système hospitalier, envisagé dans sa globalité, n’est pas aussi inefficace qu’on veut bien le dire, et l’augmentation de l’activité des hôpitaux en témoigne. Or on a tendance à se focaliser sur les établissements en difficulté. Ainsi, on parle beaucoup des établissements en déficit, mais l’on semble oublier que, si les plus gros sont effectivement déficitaires, la majorité ne l’est pas. Il faut, certes, comprendre les raisons des dysfonctionnements pour y remédier, mais il faut aussi savoir mettre en exergue ce qui fonctionne, et rappeler que les praticiens hospitaliers sont attachés à leur établissement, fiers des missions qu’ils exercent et qu’ils cherchent à remplir de leur mieux.
Pour autant, les difficultés sont réelles. En premier lieu, de nombreux centres hospitaliers n’ont pas défini leur positionnement. La création des schémas régionaux a permis des améliorations mais la réflexion stratégique pèche encore. Les centres hospitaliers veulent continuer à faire un peu de tout, ce qui, manifestement, ne se peut plus. Il faut désormais dessiner une cohérence territoriale. Nous avons soutenu le principe de la tarification à l’activité (T2A) qui nous semblait favoriser l’équité par une juste répartition des moyens, jusqu’à présent très hétérogène pour des raisons historiques. Nous ne sommes pas entièrement d’accord avec la manière dont elle est appliquée. Il faut en effet que les missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation tiennent compte des missions de service public ; pour parler clairement, la province ne veut pas continuer à payer pour l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Outre cela, la T2A vise l’amélioration de l’efficacité de chaque établissement. Il en résulte que les équipes dirigeantes les plus efficaces auront des établissements performants sur le plan économique, mais cela ne préjuge en rien de la performance sanitaire territoriale. Or chaque patient doit obtenir une réponse coordonnée, graduée et efficace, en fonction de son état, sur le territoire où il vit. Il faudra donc prendre garde à concilier la planification territoriale que vont imposer les agences régionales de santé par des contrats très asymétriques et l’autonomie des établissements publics, auxquels on demande d’être hyperperformants. Actuellement, ces deux objectifs se contredisent.
Nous sommes confrontés à une autre grave difficulté : l’évolution de la démographie professionnelle. À Paris, le problème concerne plutôt les professions paramédicales ; en province, les médecins. Le nombre de médecins disponibles diminue et ce mouvement va s’aggravant, même si nos jeunes confrères se dirigent plutôt vers le salariat. De plus, on assiste à une sur-spécialisation. Lorsque j’ai commencé ma carrière de praticien hospitalier, notre service comptait quatre cardiologues polyvalents. Aujourd’hui, le service dans lequel j’exerce compte douze cardiologues, dont quatre ne participent plus aux gardes car, spécialisés en hémodynamique, ils ne sont plus capables de faire une échographie… Si l’on veut être efficace, il faut repenser l’organisation territoriale en concentrant les plateaux techniques pour atteindre la masse critique. Si l’on ne le fait pas, on ne trouvera plus de praticiens, car les jeunes médecins ne veulent plus travailler seuls – que le lieu soit agréable ou qu’il ne le soit pas – mais en équipe, à la fois pour partager la charge de travail et pour avoir des échanges intellectuels enrichissants. Ne l’oublions pas, le personnel de l’hôpital public est soumis à la forte contrainte de devoir assurer la permanence des soins secondaires spécialisés, ce qui pose aussi problème. À l’hôpital public, un radiologue gagne moins bien sa vie que dans un établissement privé, et il doit travailler les week-ends et les nuits ; on n’en trouve plus.
Aussi la question des ressources médicales est-elle pour nous un problème crucial. Si la tendance actuelle ne s’infléchit pas, on se dirige tout droit, pour les disciplines les plus difficiles, vers une « starisation » des médecins qui n’aura rien à envier à celle des joueurs de football : ils se vendront au plus offrant, monnayeront leurs compétences et leur présence et n’hésiteront pas à changer d’établissement. Il faut en prendre conscience et anticiper cette évolution.
Nous avons, nous aussi, globalement soutenu la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, bien que nous n’approuvions pas la partie du texte relative à la gouvernance ; nous l’avions dit, à l’époque, devant votre commission des affaires sociales. Le texte finalement adopté traduit un équilibre acceptable pour les médecins. Dans tout établissement hospitalier, une complicité quotidienne est obligatoire entre l’administration et les médecins, sinon le dysfonctionnement est certain. Nous considérons la création des agences régionales de santé comme un progrès, même si nous éprouvons quelques craintes sur l’« ingénierie administrative » que cela implique. On passe en effet d’agences régionales de l’hospitalisation très efficaces, chacune dotée d’un seul décideur, à des structures organisées sur un mode quelque peu préfectoral. Nous redoutons des circuits de décision compliqués, qui constitueront un facteur de complexité accrue pour les praticiens hospitaliers. Il est bon que les agences régionales de santé aient un champ de compétences plus large – trop large sur certains points – que n’avaient les agences régionales de l’hospitalisation, mais la difficulté sera de trouver l’interlocuteur juste, pour obtenir des réponses rapides ; nous verrons à l’usage.
De plus, quelle marge de manœuvre auront les agences régionales de santé s’agissant de la médecine de ville ? Faute de moyens de pression comme elles en auront sur les hôpitaux, elles useront d’incitations et de leur pouvoir de conviction, mais sans doute n’obtiendront-elles pas de résultats immédiats. Ne pensez pas que nos relations avec nos confrères qui exercent en ville soient mauvaises : nous nous entendons bien avec eux, mais nous vivons sur des planètes différentes ; à tout le moins devons-nous être sur la même orbite…
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet l’utilisation de nouveaux outils, tels que la télémédecine, qui nous faciliteront la vie et constitueront un progrès majeur pour nous, si l’on avance vite. Le texte laisse toutefois des questions en suspens. Ainsi, on va probablement demander aux centres hospitaliers d’ouvrir des centres de santé pour pallier les carences du réseau de premiers soins dans certaines zones ; y parviendront-ils ? Trouvera-t-on des médecins qui accepteront d’exercer dans les zones urbaines sensibles ou à la campagne ?
La partie du texte qui concerne les communautés hospitalières de territoire nous a beaucoup déçus. Ce sont des laboratoires d’idées intéressants mais elles sont dépourvues de vrais outils. Nous espérions pourtant qu’elles permettraient de restructurer l’hôpital public, en démantelant les cathédrales hospitalières actuelles, en concentrant les plateaux techniques, en développant la médecine ambulatoire, l’hospitalisation à domicile, les centres de prise en charge d’urgence un peu plus éloignés et des centres de santé, en créant, en bref, un réseau structuré d’hospitalisation publique. C’est notre rêve mais, sur ce point, la loi nous paraît très frileuse.
Par le biais de la T2A, les médecins hospitaliers se sont approprié la réflexion médico-économique – peut-être trop bien à certains égards. Maintenant, nous demandons la stabilisation du système car, si les règles changent tous les ans, l’absence de prévisibilité empêche toute anticipation.
Pour obtenir l’adhésion des équipes médicales, il faut aussi une subsidiarité réelle. Des études conduites sur les hôpitaux américains dits « magnétiques » ont montré qu’ils sont excellents parce qu’ils sont à taille humaine, mais aussi parce qu’ils font une place à l’informel. On peut définir toutes les procédures que l’on veut, on court au dysfonctionnement si personne ne sait laquelle appliquer. Actuellement, un temps médical considérable est consacré à l’informatisation des circuits de médicaments ; bien sûr, la certification et la réflexion sur la qualité doivent avancer, mais il faut savoir trouver un équilibre.
Enfin, la formation managériale des médecins et notamment des quelque 5 000 chefs de pôle est impérative et urgente. Les chefs de service ont une vision manifestement très lointaine des questions de gouvernance et de ce qu’elles recouvrent. Il est indispensable d’enseigner aux uns et aux autres ce qu’est la vie hospitalière, ce que sont un budget et un projet hospitaliers, pour leur permettre d’adhérer aux projets collectifs. Ainsi chaque établissement pourra-t-il s’engager dans un projet médical.
M. Didier Gaillard, président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des établissements de santé privés à but non lucratif. Historiquement, les établissements de santé privés à but non lucratif que nous représentons n’étaient pas orientés vers la performance. L’application de la T2A nous a fait entrer dans ce schéma.
Nos établissements représentent 15 % de l’offre de soins en France et une part importante des soins de suite et de réadaptation, des soins psychiatriques, des dialyses et du médico-social. Au cours de l’année 2009, leur existence a été sérieusement menacée et nous avons subi une violente douche écossaise. Dans un premier temps, nous avons été consultés lors de la préparation de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; ensuite, la commission Larcher a vanté notre modèle ; après quoi, nous apprenions que la loi nous rayait de la carte sanitaire française. Nos intenses efforts de persuasion ont porté leurs fruits – je remercie le Parlement de nous avoir soutenus – et nous avons finalement pu retrouver une place.
Notre étonnement avait été d’autant plus vif que nous étions favorables à l’esprit de la loi, favorables à la création des agences régionales de santé, favorables à l’organisation conventionnelle des schémas régionaux, favorables à la contractualisation. En revanche, nous ne nous étions pas saisis de la question de la gouvernance. Cela s’explique : si les hôpitaux publics sentaient la possibilité d’une rivalité entre direction administrative et direction médicale, ce n’était pas notre cas, puisque nous fonctionnions déjà avec un conseil d’administration et une commission médicale d’établissement.
Le projet de loi prévoyait que, dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) – ce que nous sommes désormais –, la commission médicale devenait une « conférence médicale ». Notre position à l’intérieur des établissements changeait donc du tout au tout ; nous avons tenté de le faire valoir sans y parvenir réellement. Que l’on classe les établissements privés à but non lucratif dans la même catégorie que les hôpitaux privés à but lucratif n’a rien d’anormal puisque nous sommes de statut privé. Seulement, nous ne sommes pas des médecins libéraux mais, en quasi-totalité, des médecins salariés. L’évolution intervenue nous a déstabilisés, d’autant que nos établissements fonctionnent bien davantage sur le modèle des hôpitaux publics que sur celui des hôpitaux privés. Le fait que nous ayons été rétablis, mais dans un statut beaucoup plus précaire, nous met dans une situation plus critique. On peut en effet imaginer qu’un président de conseil d’administration tout puissant décide seul de toute la stratégie d’un établissement donné, comme cela s’observe dans certains établissements à but lucratif.
Bon nombre de nos établissements participent du service public. Certains sont dans une situation financière quelque peu délicate ; les restructurations en cours depuis quelques années permettent de les remettre peu à peu dans le droit chemin. Comme nous sommes des établissements de droit privé, quand nous sommes en déficit, la fondation ou l’association dont nous dépendons doivent combler le trou, avec l’aide de l’État. Mais, pourquoi la décision politique a-t-elle été prise de ne pas nous accorder le différentiel de charges, évalué à 4,5 % par l’Inspection générale des affaires sociales, qui correspond à nos missions de service public ? Nous contribuons à la couverture médicale du territoire, et c’est une chance pour la collectivité nationale, car les filières, les réseaux, la répartition médecine de ville-hôpital et les soins post-hospitaliers sont déjà bien structurés dans nos établissements, qui assurent déjà beaucoup des soins de suite et de rééducation et d’hospitalisation à domicile.
Le recrutement des médecins est compliqué pour nos établissements car, comparée à celle des établissements sous d’autres statuts, notre convention n’est pas très favorable. On prétend que les médecins qui exercent dans les établissements privés participant au service public hospitalier seraient mieux payés qu’à l’hôpital public, mais il suffit de comparer des profils de carrière pour constater que c’est faux. C’est pour nous un problème réel, qui oblige à trouver un meilleur mode de rémunération des médecins exerçant dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif – peut-être par le biais de l’intéressement.
Nos établissements sont aussi engagés depuis très longtemps dans la formation et dans la prévention. Aussi souhaitons-nous une prise en compte plus réaliste des missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation, en particulier des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) que nous assurons. Je sais que des commissions étudient cette question.
La tarification à l’activité était indispensable et son entrée en vigueur a permis de restructurer des établissements. Cependant, une tarification à l’activité complète n’a pas de sens dans des établissements où la prise en charge de certaines catégories de la population n’est pas prise en compte. Actuellement, la T2A privilégie les actes techniques de la nomenclature générale des actes professionnels – les plus faciles à comptabiliser – au détriment de l’acte médical intellectuel, plus difficile à coter. Un rééquilibrage est nécessaire ; mon collègue Jean-Pierre Genet y travaille au sein de la commission chargée de la réflexion sur la classification commune des actes médicaux cliniques. C’est une bonne chose, car le sujet est important.
J’en viens à un point déjà évoqué par mes collègues, le besoin de stabilité. Nous avons vécu des restructurations et des fusions, phénomènes inconnus à ce jour du milieu médical. Ce sont des expériences intéressantes mais lourdes et compliquées et il vient un moment où les établissements doivent connaître la stabilité tarifaire. On leur demande de faire des business plans – mais comment pourraient-ils le faire s’ils ne connaissent pas les tarifs sur lesquels appuyer leur calcul, ni les réorganisations à venir ? On parle de faire des économies ; soit. À cette fin, on nous invite par exemple à développer l’hospitalisation de jour. Mais ce n’est pas parce qu’une procédure est possible qu’elle sera suivie si les médecins ne sont pas convaincus de la justesse de la méthode – et, s’agissant de l’hôpital de jour, les chirurgiens ne le sont pas tous. L’hospitalisation de jour est une bonne chose et sa généralisation réduira vraisemblablement les coûts hospitaliers, mais un bilan ultérieur devra le confirmer. Pour autant, on ne peut pas demander aux établissements hospitaliers de créer des services d’hospitalisation de jour pour décider ensuite que, finalement, les patients seront traités en consultations externes ! Une réflexion globale s’impose, à laquelle les médecins doivent être associés. D’autre part, la charge que représente l’activité « hôpital de jour », notamment chirurgicale, est notoirement sous-évaluée dans nos établissements, contrairement à ce qui vaut pour les établissements privés à but lucratif, où la part hôtelière et la part « rémunération » sont distinguées. La tarification en groupes homogènes de séjour entraîne pour nos établissements une sous-évaluation de fait. Quant à l’objectif annoncé de 80 % d’activité chirurgicale en hôpital de jour, il me semble excessivement ambitieux : si l’on parvenait à 50 %, ce serait déjà bien.
Je traiterai pour finir de la situation sociale en soulignant que la qualité et la sécurité des soins supposent en premier lieu l’amélioration de l’organisation de nos établissements. La réflexion des médecins à ce sujet a certainement pris du retard ; nous sommes d’accord pour participer à cette démarche. La tarification à l’activité montre que réduction des coûts et maintien de la qualité et de la sécurité des soins ne sont pas antagoniques, mais vient un moment où il faut cesser de réduire le personnel présent dans les services. Nous ne sommes pas loin d’avoir atteint ce moment.
M. Marc Hayat, vice-président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement des établissements de santé privés à but non lucratif. Je compléterai le propos de M. Gaillard en traitant de trois aspects concernant plus spécialement la psychiatrie, mais certainement aussi d’autres secteurs de la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique (MCO). J’aborderai en premier lieu la gestion du personnel, qui est un problème en soi pour les psychiatres praticiens hospitaliers. Imaginez les problèmes qui se posent à nous lorsqu’une infirmière spécialisée absente est remplacée au débotté par une infirmière de réanimation ! Tout devient immédiatement plus compliqué. Il est impératif que les médecins soient associés à la gestion du personnel et à sa mobilité. Par ailleurs, les critères de certification sont essentiellement faits pour les disciplines médicales et chirurgicales et pour l’obstétrique. Leur application à la psychiatrie apparaît parfois très improbable, et une anecdote vous en convaincra sans mal. Que pensez-vous de ce questionnaire de satisfaction adressé à un patient hospitalisé en service psychiatrique, prié de répondre à la question suivante : « Recommanderiez-vous cet établissement à l’un de vos proches » ? Autant dire que nous ne pouvons appliquer en psychiatrie, sans les adapter, les critères recommandés par la Haute Autorité de santé.
Un mot, ensuite, sur la gouvernance. Il faut effectivement passer à l’action – et non à l’acte… –, mais l’une des difficultés tient à la qualité de la relation entre les médecins et leurs interlocuteurs – directeurs d’établissement, ou représentants de l’État ou des collectivités locales. À chaque fois que nous participons à des auditions du type de celle qui nous réunit ce matin ou à des réunions au ministère, la première question que nous posent ensuite nos confrères est : « À quelle sauce allons-nous être mangés ? ». D’évidence, un climat de défiance s’est installé entre les directeurs d’établissement, vus comme des suppôts de l’État, et les médecins inquiets pour le respect de l’éthique, la qualité des soins et le bien-être des patients. Il faut parvenir à restaurer la confiance et je sais combien c’est difficile par la loi. Pour ce qui concerne la psychiatrie en tout cas, il convient d’instaurer un triumvirat associant le directeur d’établissement, les médecins et les représentants des usagers et de leur famille. On évitera ainsi un face-à-face dangereux et l’on améliorera la gouvernance des hôpitaux. Les élus locaux sont la voix du peuple mais il faut parvenir à une association dynamique entre ces trois piliers de l’hôpital.
M. Jean Halligon, ancien président de la Conférence des présidents de commissions médicales d’établissement de l’hospitalisation privée. Je représente les cliniques, des établissements dans lesquels exercent des médecins libéraux. Ils sont recrutés sur le fondement de contrats individuels mais, au cours de la décennie écoulée, des tâches connexes aux soins leur ont été dévolues, parfois accomplies par tous les médecins – c’est le cas pour le contrôle de la qualité et de la sécurité des soins – mais parfois aussi par quelques-uns au bénéfice de tous. Ce sont les obligations transversales : lutte contre la douleur et contre les infections nosocomiales, réflexion sur l’alimentation… Bien qu’obligatoires, ces tâches ne sont pas rémunérées dans nos établissements ; en revanche, dans les établissements hospitaliers où les médecins sont salariés, elles font partie des tâches de service. Cela n’est pas le cas chez nous et c’est regrettable à plusieurs titres. D’une part, c’est inéquitable ; d’autre part, cela fait craindre pour la pérennité de ces activités, car les bonnes volontés s’épuisent. Enfin, ce n’est pas une garantie de qualité, car il n’est pas d’exigences possibles sans contrepartie ; on en est même venu à me dire « Ne demandez pas à être rémunéré pour ces obligations particulières : vous devrez rendre des comptes » ! L’absence de valorisation des obligations transversales est un élément clef des difficultés des médecins libéraux dans les cliniques privées.
La loi nous a fixé d’autres tâches : les missions de service public. Quelque 150 établissements hospitaliers privés accueillent déjà les patients dans les services d’urgence, beaucoup d’autres y sont prêts. Vraisemblablement, nous devrons aussi enseigner, puisque certaines activités majoritairement pratiquées dans nos établissements devront être enseignées à nos jeunes collègues. Par ailleurs, il est indispensable de structurer la conférence médicale d’établissement. Avant l’adoption de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, cette structure était définie en trois lignes. Sa description s’est un peu étoffée, mais elle demeure insuffisante. Le défaut est que l’on ne sait pas comment sera constituée la commission médicale d’établissement qui sera consultée. En l’état, n’importe quel médecin peut réunir trois confrères qui éliront un président de commission médicale d’établissement, lequel sera chargé par eux d’aller discuter avec la direction de l’établissement. Même si cette démarche n’est pas légitime, elle sera légale, rien dans la loi n’encadrant la constitution d’une commission médicale d’établissement. De même, tout directeur d’établissement un tant soit peu paranoïaque peut rassembler des médecins à sa botte et créer une conférence médicale d’établissement fantoche. Les pouvoirs publics doivent s’assurer que les décisions de gestion sont des décisions médicalement éclairées. C’est indispensable, mais ni la loi ni les décrets ne le prévoient, en dépit de nos demandes réitérées. Il va sans dire que l’adhésion de la communauté médicale au projet d’établissement se renforcera si la commission médicale d’établissement est correctement structurée. J’y insiste, l’enjeu est capital pour tous les établissements de santé.
L’autre problème qui se pose est celui de la contractualisation, aussi bien en interne que vis-à-vis des agences régionales de santé. En l’état, les autorités de tutelle n’auront face à elles que des gestionnaires et non un couple médico-économique. Même le retour d’informations n’est pas explicitement prévu ! Cela démontre un défaut d’intervention de l’État, régulateur et financeur, qui paye pour obtenir un service : des soins à la population. Il résulte de cette lacune que la réponse aux besoins de santé risque d’être prise en fonction de considérations uniquement économiques, et non pas médico-économiques comme il serait souhaitable. Nous déplorons de ne pas avoir été suffisamment entendus à ce sujet lors de l’élaboration de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, même si la représentation nationale a été plus attentive à nos observations que certains cabinets ministériels.
M. le coprésident Pierre Morange. Le temps nous manque pour poursuivre ce débat. Aussi, je vous invite à nous faire parvenir vos suggestions et vos recommandations écrites, qu’il s’agisse de la maîtrise de l’information et de son partage au long du parcours de soins ou de la cotation des actes et de l’appropriation par les praticiens hospitaliers de la nouvelle procédure. Enfin, nous avons pris note de votre appel ardent à la stabilisation des règles.
Mme Jacqueline Fraysse. À propos de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des convictions fortes se sont affrontées au cours de débats très vifs. La table ronde qui s’achève me réconforte car, si les précédentes étaient utiles et intéressantes, celle-ci a mis en exergue le déséquilibre persistant entre préoccupations économiques et préoccupations humanistes. Grâce à vous, messieurs, nous avons enfin entendu s’exprimer la crainte que seules les considérations financières priment. Dans le même temps, vous avez dit fortement que les médecins s’impliquent dans la réduction des coûts. Selon moi, nous ne réussirons pas si nous ne rééquilibrons pas une loi qui, en l’état, fait une part congrue aux projets médicaux propres à répondre aux besoins exprimés par la population. M. Hayat a fort justement évoqué la nécessité d’un triptyque associant l’administration, les médecins et les usagers ; mais où sont les usagers dans la loi ? Nous avions vivement protesté à ce sujet.
Ayant entendu vos propos, je souhaite que l’on prenne mieux en considération la question humaine mise en avant par les praticiens. Il est de notre devoir de députés de traduire ce message dans les textes, tout en soulignant que cet impératif catégorique ne s’oppose pas à la meilleure utilisation des deniers publics. À ce jour, les médecins n’adhèrent pas au projet gouvernemental. On a entendu parler de « résistances », et c’est heureux, car les déséquilibres que perpétue la loi sont, selon moi, dangereux. Nous avons entendu des propos raisonnables ; nous devons en tenir compte. Les médecins nous l’ont dit, ils adhéreront à un projet médical. Si le projet est autre, ils n’y adhéreront pas et, dans ce cas, la réforme n’aboutira pas. J’espère, messieurs, que les instances dirigeantes de notre pays vous entendront, comme elles le doivent.
M. le coprésident Pierre Morange. La mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, à la création de laquelle j’ai largement participé avec MM. Claude Evin et Jean-Michel Dubernard, est une instance collégiale, qui tient compte des diverses sensibilités politiques de ses membres sans toutefois souffrir des affrontements plus communs en d’autres matières. On y débat avec passion de la chose sanitaire et sociale sans dissocier rationalisation et optimisation de la dépense d’une part, prise en compte de l’humain d’autre part, puisque notre objectif à tous est d’être au service de l’homme. Messieurs, je vous remercie.
*
AUDITIONS DU 18 FÉVRIER 2010
Audition de M. Frédéric van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, et de M. Jean-Marc Aubert, directeur délégué à l’organisation des soins à la CNAMTS.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir M. Frédéric van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, accompagné de M. Jean-Marc Aubert, directeur délégué à l’organisation des soins à la CNAMTS.
La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale conduit ses auditions sur le fonctionnement de l’hôpital suivant une nouvelle approche, consistant à partir d’expériences de terrain pour tirer des préconisations générales, dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de notre système hospitalier.
Nous avons souhaité, à ce stade de notre travail, recueillir la vision de l’assurance maladie, dont le rôle transversal au sein de notre système de santé a été accru par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Le secteur hospitalier consommant une part importante des dépenses d’assurance maladie dans notre pays, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ne peut être indifférente à son fonctionnement. Quelles sont vos propositions afin de l’améliorer ?
M. Frédéric van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Le secteur hospitalier – c’est-à-dire les établissements de santé publics et privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite ou de réadaptation – constitue en effet le premier poste de dépenses de l’assurance maladie, non seulement en volume, mais également en taux de prise en charge, dans la mesure où l’assurance maladie prend en charge plus de 85 % des dépenses hospitalières. Pourtant, c’est sur cette offre de soins que l’assurance maladie a le moins de prise, ce qui, du point de vue économique, peut paraître étonnant.
Historiquement, l’État a pris une place croissance dans le pilotage et la régulation des établissements de santé, d’abord avec la création des agences régionales de l’hospitalisation, puis le transfert en 1999 de certaines responsabilités de fixation des tarifs des établissements aux agences régionales de l’hospitalisation. L’assurance maladie s’est ainsi vu retirer le rôle historique qu’elle jouait dans le secteur privé.
Aujourd’hui, l’État est le régulateur du système tant au niveau régional qu’au niveau national : il fixe les tarifs, il encadre l’évolution des tarifs de chaque établissement de soins indépendamment des tarifs nationaux, il contractualise avec chaque offreur public de soins et, bien qu’ils soient historiquement des établissements publics locaux dotés d’un conseil d’administration, il les contrôle de facto puisqu’il nomme les directeurs des établissements et les médecins. La séparation des rôles de régulation, de pilotage et de gestion a pourtant fait l’objet de très nombreuses réflexions dans d’autres secteurs économiques, comme les télécommunications.
Les équipes hospitalières de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, dissoutes en 1999, ont été en partie reconstituées à la suite de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, qui imposait à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de participer à la mise en œuvre de la politique hospitalière. Toutefois, nous ne nous sommes pas saisis de tous les domaines de l’activité hospitalière.
Ainsi, nous avons considéré que l’organisation sanitaire hospitalière ressortissait à l’État et aux agences régionales de l’hospitalisation, via les schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS).
De même, le fonctionnement interne des établissements est de la responsabilité du gestionnaire de l’établissement ou d’instances comme la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers (MEAH) ou, désormais, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) – dont nous sommes toutefois membres du conseil d’administration.
La Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers, l’un des principaux facteurs d’amélioration du fonctionnement interne des hôpitaux, a été créée assez tardivement, en 2003, à l’extérieur de l’administration centrale et sous l’impulsion de M. Jean-François Mattei, lorsqu’il était ministre en charge de la santé, – de même que la tarification à l’activité (T2A). Ses activités n’ont pas permis, pour l’heure, d’aboutir à un classement des établissements de soins en fonction de leurs performances ; nous ne disposons d’aucun benchmark, ce qui ne favorise ni la transparence ni les comparaisons entre les établissements de santé, et empêche toute émulation au sein du secteur hospitalier, public comme privé. Il n’y a pas de publication d’objectifs nationaux de qualité de service, ni de politique de contractualisation en la matière, comme cela peut exister pour d’autres grands réseaux ou dans d’autres pays, et l’on ne possède aucune information sur les dépenses ou la productivité hospitalières, non plus que sur leur évolution – hormis les données de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés sur les recettes des hôpitaux. Or, selon la Cour des comptes, les effectifs hospitaliers ont crû de 140 000 personnes entre 2000 et 2006 !
Enfin, nous n’avons pas jugé légitime d’intervenir sur la qualité des soins hospitaliers, qui relèvent à la fois des professionnels, via l’évaluation des pratiques médicales, et de la Haute Autorité de santé, via la certification des établissements de santé et la définition des référentiels de qualité.
En revanche, nous apportons notre contribution à l’amélioration de l’efficacité du système hospitalier ; nous menons ainsi des réflexions sur l’accompagnement des établissements en difficulté, sur le développement des alternatives à l’hospitalisation et sur l’évolution tarifaire, notamment sur le processus de convergence des tarifs des secteurs public et privé, qui a donné lieu à un débat à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Nous nous efforçons également de contrôler le bien-fondé des prescriptions hospitalières, grâce au suivi des effets de la mise en place de la tarification à l’activité (T2A) et au développement de contrôles annuels sur une cible d’établissements définie à partir des informations dont nous disposons, par l’intermédiaire notamment du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI).
Nous intervenons sur l’amélioration de l’articulation entre la médecine de ville et l’hôpital, notamment par le retour à domicile des patients. Nous avons lancé une expérimentation sur les sorties de maternité, afin d’éviter que, pour les grossesses physiologiques, l’hospitalisation aiguë et l’hospitalisation à domicile ne s’enchaînent. Nous travaillons également, en liaison avec les agences régionales de santé (ARS) qui doivent être mises en place prochainement, sur l’organisation du secteur libéral, la régulation de l’installation des infirmières, et la bonne articulation des soins de kinésithérapie avec les soins de suite et de réadaptation et les soins à domicile.
Enfin, nous souhaitons améliorer l’information des assurés sociaux sur la qualité et les coûts des soins, afin de combler le retard de la France en la matière. Nous avons déjà imposé la transparence sur les dépassements d’honoraires et les tarifs des médecins de ville, mais il nous semble nécessaire de compléter ce dispositif par la mise à la disposition des assurés des indicateurs de qualité produits par les institutions compétentes, notamment la Haute Autorité de santé et le ministère, de manière que les assurés puissent faire leurs choix en connaissance de cause.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Décidément, la gestion du système hospitalier français est fort complexe !
S’agissant des alternatives à l’hospitalisation, c’est-à-dire de la modification du périmètre de l’hôpital, disposez-vous de pistes de travail ?
Quant à la tarification – qui, certes, n’est pas de votre ressort –, que pensez-vous de son évolution, de ses éventuels effets pervers et de la manière dont les établissements hospitaliers gèrent les systèmes d’information et le codage des actes ?
M. le coprésident Pierre Morange. Comment assurez-vous concrètement l’accompagnement des établissements en situation financière délicate – qui représenteraient, selon Mme Annie Podeur, directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, près du quart du total des établissements hospitaliers ? Comment s’articulent le rôle de l’assureur et celui de la direction centrale, chargée de la mise en œuvre des consignes devant assurer le retour à l’orthodoxie budgétaire ?
Comment remplissez-vous, concrètement, vos missions de contrôle et d’évaluation – cet aspect étant particulièrement cher à la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale ?
L’expérimentation menée avec succès à l’hôpital Beaujon afin de réduire les temps d’attente aux urgences a-t-elle été généralisée ?
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, quelles seront les compétences précises de l’assurance maladie en matière de contrôle ?
M. Frédéric van Roekeghem. La T2A a été mise en place en 2005 ; le Parlement avait souhaité que l’on converge vers un tarif unique quelle que soit l’offre de soins qui délivre la prestation. Les établissements de santé reçoivent en outre, au titre des missions d’intérêt général, des financements complémentaires relativement importants, ainsi que des aides à la contractualisation.
À l’Assurance maladie, nous pensons que le financement des établissements de santé devra à terme comporter trois composantes – comme celui des médecins de ville.
Le premier niveau est le financement de fonctions, par exemple les missions d’intérêt général ; les objectifs, à terme, sont de disposer en ce domaine d’un cahier des charges précis et d’une comptabilité analytique, et de veiller à l’adéquation entre la dotation versée et la réalité du service rendu.
Le deuxième niveau correspond à la tarification : du point de vue de l’assureur, les tarifs doivent être comparables d’un secteur à l’autre – sachant que, dans le secteur privé, les médecins peuvent facturer des compléments d’honoraires qui limitent quelque peu cette possibilité.
Enfin, le troisième niveau serait une rémunération en fonction des résultats, par exemple au titre de la qualité de la sortie d’hôpital, évalués conformément aux référentiels médicaux.
La T2A a été instaurée afin de renforcer le dynamisme des établissements de santé publics et de remédier aux effets pervers de la dotation globale, qui ne tenait pas compte de l’activité réelle des établissements. Nous y sommes favorables. Toutefois, nous ne nions pas qu’elle présente certains inconvénients. Par ailleurs, pour qu’elle soit utile, les tarifs doivent être pilotés de manière rationnelle et transparente, avec une visibilité à moyen terme, tenant compte de la contrainte annuelle de l’exercice budgétaire et de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM).
Le conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés souhaite par conséquent que les règles du jeu cessent de changer continuellement. Les gestionnaires des hôpitaux doivent pouvoir développer des politiques médicales cohérentes dans le temps. Or, chaque année, des modifications importantes sont apportées non seulement à la valeur des actes, mais aussi à la structure de la T2A.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Cette instabilité relative ne résulte-t-elle pas d’une certaine ambiguïté de la T2A, qui est présentée tantôt comme une méthode permettant de fixer le tarif des prestations à leur juste prix, tantôt comme un outil d’orientation de l’activité hospitalière ?
M. Jean-Marc Aubert, directeur délégué à l’organisation des soins. Pour la fixation des tarifs, on s’appuie sur l’étude nationale des coûts – ce que d’aucuns considèrent comme une supériorité française. Pourtant, cela ne me semble pas le plus important. Les échelles de coûts sont des instruments comptables qui ne correspondent qu’imparfaitement à la réalité et qui peuvent varier d’un établissement à l’autre. Il importe de compléter cette vision par une localisation des gisements d’économies en termes de coûts de production. Ainsi, une étude comparative parue dans un journal international montre que le tarif d’un acte de chirurgie ambulatoire varie, en Europe, de 900 à 1 550 euros ; la France est, avec les Pays-Bas, le pays où le tarif est le plus élevé. Il faudrait compléter l’étude nationale des coûts par des évaluations de ce type.
Par ailleurs, vouloir connaître avec exactitude les coûts est irréaliste. Il faut faire évoluer les tarifs en fonction non des coûts, mais des capacités de redéploiement des établissements. Dans le cas de la biologie, par exemple, avec l’organisation actuelle, la marge d’économies n’est que de 3 à 4 % ; mais la différence de productivité avec l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou la Belgique est de 40 à 50 %. Prenons garde à ne pas utiliser les tarifs pour reproduire le système.
M. Frédéric van Roekeghem. Disposer d’une visibilité à moyen terme ne signifie pas que l’on ne gère pas activement les tarifs. L’enjeu, aujourd’hui, est de savoir comment améliorer l’organisation actuelle de façon à dégager de nouvelles marges. C’est un travail complexe, qui doit nécessairement s’appuyer sur une vision analytique des coûts des établissements par rapport aux activités qu’ils génèrent.
La question est de savoir si la stratégie actuelle de convergence vers la moyenne est compatible avec un durcissement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, et si l’on part de l’hypothèse qu’il sera nécessaire dans les prochaines années de rechercher une plus grande efficience du système de soins eu égard à la situation des finances publiques. Les deux vont en effet de pair. Par exemple, la restructuration des laboratoires de biologie engagée il y a quelques années par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a permis de diminuer les coûts et d’accroître l’efficience de la biologie hospitalière ; si les tarifs avaient été fixés en fonction des coûts initiaux, ils auraient été beaucoup plus élevés.
Il convient donc de disposer, indépendamment des tarifs, d’informations sur les performances des fonctions concernées, de porter à la connaissance des gestionnaires les objectifs recherchés et de soutenir l’effort de réorganisation, parallèlement à la fixation des tarifs : c’est ainsi que l’on pourra déployer des programmes pluriannuels.
M. Jean-Luc Préel. Si les établissements de santé constituent pour la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés le premier poste de dépenses, vous avez peu de leviers pour agir. En particulier, vous ne disposez d’aucun pouvoir de décision sur la T2A, ni sur les dotations pour les missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation (MIGAC).
En revanche, vous intervenez sur le contrôle médical. Y a-t-il un réel contrôle de la codification ? Quelles sont les conséquences des contrôles ? Peut-on mieux faire ? Comment vous partagez-vous la tâche avec les observatoires régionaux de santé ?
La comptabilité et le budget, c’est bien, mais c’est la qualité des soins qui importe ! Comment pensez-vous pouvoir l’évaluer au sein des établissements et des services, et en informer le patient ?
Que pensez-vous des différences de coûts pour un même acte entre les différentes catégories d’établissement ? Sont-elles appelées à durer ?
Enfin, les missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation correspondent-elles réellement à des missions d’intérêt général et de contractualisation ou servent-elles à combler les déficits des établissements ?
M. Frédéric van Roekeghem. Nous vous transmettrons les documents concernant les contrôles.
Pour chaque campagne, nous ciblons les établissements à contrôler en fonction de l’exploitation des bases de données. Nous réalisons les contrôles, nous exploitons les résultats et nous suivons l’application des sanctions, agence régionale de l’hospitalisation par agence régionale de l’hospitalisation. Les campagnes s’étalent sur un an et demi.
Pour la campagne 2008, par exemple, nous avions ciblé les séjours d’hospitalisation complète, la chirurgie esthétique, les soins palliatifs, les séjours de zéro jours et certaines autorisations données. Les enjeux financiers avaient été évalués à 47 millions d’euros. Nous avons notifié 24 millions d’indus aux établissements contrôlés à la fin de l’année 2009, dont quelque 16 millions d’euros aux établissements publics et environ 7 millions aux cliniques privées ; nous avons récupéré 16 millions d’euros, soit 67 % des montants notifiés. Des sanctions financières ont été proposées à l’unité de coordination régionale contre 127 établissements – 78 publics et 49 privés – pour un montant total de 20 millions d’euros ; 41 établissements ont été effectivement sanctionnés par les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation ; nous sommes en mesure de vous donner pour chaque agence régionale de l’hospitalisation, le pourcentage de sanctions financières prononcées ainsi que les références des établissements concernés.
Pour la campagne 2009, nous avons également notifié un certain nombre d’indus.
M. le coprésident Pierre Morange. Quels thèmes avez-vous retenus pour la campagne 2010 ?
M. Frédéric van Roekeghem. M. Jean-Marc Aubert vous les précisera.
Le contrôle est un sujet d’inquiétude pour nous. Les conseils de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ont émis une recommandation au Gouvernement, pour qu’il veille à la transparence et à une claire répartition des rôles, dans la mesure la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires renvoie pour partie ces questions à des ordonnances.
Nous souhaitons d’abord que l’on maintienne le principe d’une commission paritaire entre l’Assurance maladie et les agences régionales de santé afin de s’assurer de la bonne coordination en matière de contrôle.
Par ailleurs, la commission exécutive des agences régionales de l’hospitalisation disparaissant, le pouvoir de décision en matière de contrôle va échoir au directeur de l’agence régionale de santé. Le projet de texte qui nous a été présenté par le Gouvernement prévoit que, lorsque le directeur de l’agence régionale de santé ne suit pas les recommandations de la commission, il motive sa décision. Le conseil de l’Assurance maladie a demandé que cette décision motivée soit rendue à la connaissance, non seulement des membres de la commission, mais aussi au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé, afin que la fonction de régulation et d’allocation des ressources des agences régionales de santé n’ait pas de conséquences inappropriées sur le respect des textes de droit public. Le commissaire du Gouvernement a précisé, en séance, que le Gouvernement prévoyait d’introduire dans un décret d’application un minimum de transparence pour les décisions publiques. Quoi qu’il en soit, nous continuerons, comme cela est prévu par les textes, à publier chaque année le bilan des opérations de contrôle.
S’agissant de l’information du patient, M. Jean-Marc Aubert va vous répondre, mais il est évident qu’il faut rattraper le retard de la France en la matière. Nous proposons, dans le cadre du contrat qui doit être conclu entre l’État et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, de mettre à la disposition des assurés, outre les tarifs, un certain nombre d’indicateurs de qualité, par exemple par l’intermédiaire de notre site internet « ameli-direct ».
M. Jean-Marc Aubert. Les systèmes d’information de l’État et de l’Assurance maladie permettent d’ores et déjà de construire quelques indicateurs. À la fin de ce semestre, nous en diffuserons un certain nombre sur « ameli-direct », ainsi que les tarifs de l’ensemble du secteur de l’hospitalisation – comme nous avons déjà commencé à le faire pour la médecine de ville. À terme, nous pourrions même publier des taux de survie ou des suivis de cohortes de patients.
Le système est appelé à s’améliorer dans les deux ou trois prochaines années. Ce qui importe, c’est de trouver des indicateurs suffisamment synthétiques pour être compréhensibles. On pourrait également demander au patient lui-même de se prononcer sur la qualité de l’établissement, à l’instar de ce qui se fait en Angleterre. Son point de vue est en effet particulièrement important pour tout ce qui concerne le confort, l’accueil et, surtout, la compréhension de son traitement et sa capacité ou non à faire des choix – c’est d’ailleurs le premier item retenu par le National Health Service (NHS). Alors qu’il existe aujourd’hui plusieurs choix possibles pour la plupart des traitements, la décision revient plus souvent au médecin qu’au patient.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La plupart des personnes que nous avons auditionnées nous ont dit que les systèmes d’information des établissements hospitaliers ne permettaient pas de tenir une comptabilité analytique digne de ce nom ni de comparer les activités et les tarifs, et ont contesté la fiabilité de ces outils. Pourtant vous affirmez pouvoir publier des données qui permettront à l’usager de faire des choix éclairés. N’est-ce pas contradictoire ?
M. Frédéric van Roekeghem. Il convient de distinguer les recettes – c’est-à-dire nos dépenses, celles des ménages et celles des assureurs complémentaires – et les coûts. Nous savons quelles sommes nous versons aux établissements de soins.
M. le coprésident Pierre Morange. De nombreuses personnes auditionnées ont déploré que le financement des établissements hospitaliers soit arrêté sur la base d’états statistiques globaux élaborés par les agences régionales de l’hospitalisation. Il serait préférable que la liquidation des prestations correspondant à chacun des séjours se fasse directement entre l’établissement hospitalier et l’Assurance maladie afin d’améliorer la traçabilité et la pérennité des financements.
Où en est l’urbanisation des systèmes d’information ? Le pouvoir exécutif devrait exiger que les systèmes mis en place soient interconnectables.
M. Frédéric van Roekeghem. De notre point de vue, la grande différence entre le secteur public et le secteur privé, c’est que, grâce à la facturation individuelle, nous sommes en mesure de contrôler les assurés qui fréquentent les établissements privés, alors que, pour les établissements publics, nous avons affaire à un paiement global, sur la base des arrêtés des agences régionales de l’hospitalisation – et, désormais, des agences régionales de santé – et que nous ne pouvons contrôler la totalité de la chaîne pas plus que la traçabilité des soins et prestations. C’est d’ailleurs pourquoi le Parlement avait souhaité, dès 2003, mettre en place la facturation individuelle hospitalière. Ce chantier a plusieurs fois été reporté.
Toutefois, depuis l’adoption de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, nous constatons une réelle volonté du secrétariat général du ministère d’avancer dans cette direction, avec notamment la nomination d’un chef de projet.
M. le coprésident Pierre Morange. Quand la facturation individuelle sera-t-elle opérationnelle ?
M. Jean-Marc Aubert. Une expérimentation doit être lancée dans un an ; la généralisation du dispositif est prévue pour l’automne 2011.
M. Frédéric van Roekeghem. On ne commence véritablement que maintenant.
M. le coprésident Pierre Morange. La disposition date pourtant de 2003 !
M. Frédéric van Roekeghem. La facturation individuelle introduira davantage de transparence dans les activités des établissements ; elle permettra de vérifier que les paiements se font à bon droit et favorisera la mise en place de programmes d’accompagnement des patients ainsi que le déclenchement d’actions de prévention secondaire ou tertiaire.
S’agissant de l’urbanisation des systèmes d’information, il convient de rester modestes.
M. le coprésident Pierre Morange. Le premier thème de réflexion de la mission portait en effet sur les coûts de gestion de l’assurance maladie et sur les retards de son plan informatique.
M. Frédéric van Roekeghem. Entre-temps, nous avons progressé. Nous connaissons maintenant les causes du goulet d’étranglement sur les développements. La difficulté, avec les systèmes lourds, est de répondre à la fois aux commandes courantes et aux transformations structurelles induites par les modifications des règles de droit. Actuellement, notre capacité de développement, exprimée en jours/hommes, est inférieure à ce qui serait nécessaire pour mener les deux de front. Nous avons toutefois la chance d’avoir un système national.
Pour ce qui concerne l’interconnexion, vous avez malheureusement raison. Faire converger les systèmes d’informatisation des hôpitaux est un projet en soi. La question est de savoir qui le conduit.
M. le coprésident Pierre Morange. Il n’y en a donc pas ?
M. Frédéric van Roekeghem. Je l’ignore : il faut que vous posiez la question à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins. En revanche, je sais que le ministère de la santé et des sports mène en interne une réflexion sur l’organisation stratégique des systèmes d’information. Le secrétaire général ou le représentant de la ministre seront plus à même de vous en parler.
M. le coprésident Pierre Morange. Pour l’Assurance maladie, quand aurez-vous abouti ?
M. Frédéric van Roekeghem. Le basculement sous UNIX a été plus tardif que prévu. Par ailleurs, on n’avait pas prévu les modifications postérieures à la réforme de 2004, comme la mise en place des parcours coordonnés, les évolutions de la franchise médicale et les fusions des organismes, qui occupent actuellement l’essentiel de nos capacités de développement.
Pour notre plan stratégique 2010-2013, nous avons progressé dans la connaissance de la répartition des charges et nous sommes en mesure de procéder aux arbitrages nécessaires. Pendant plusieurs années, on s’est engagé sur des objectifs sans vérifier que l’on possédait les moyens humains et organisationnels nécessaires.
M. le coprésident Pierre Morange. En pratique, quand serez-vous opérationnels ?
M. Frédéric van Roekeghem. Le champ de l’urbanisation n’a été initié que partiellement, sur trois programmes cœurs de notre moteur de tarification Iris. Le désenclavement des programmes cœurs d’Iris est en cours. Priorité est donnée au remboursement des produits de santé, avec la mise en place d’automates permettant d’activer des programmes.
L’objectif de l’urbanisation est de découper les programmes cœurs des gros moteurs de production pour pouvoir les faire évoluer plus rapidement. Nous souhaitons aboutir à l’issue du prochain programme de quatre ans, c’est-à-dire en 2013. Il convient de gérer le projet par les délais, et non par les ambitions, ce qui suppose de modifier l’organisation interne de notre fonction informatique et la contractualisation avec les sous-traitants, afin de redéployer progressivement nos personnels de l’exploitation informatique vers le développement, la qualification et le cycle de vie des logiciels. Il s’agit d’un projet global.
M. Jean-Marc Aubert. En termes de fonctionnalité, nous sommes au rendez-vous : nous pouvons quasiment facturer les établissements de santé. Ce qui nous manque, ce sont les dernières règles qui doivent être définies cette année dans le cadre de l’expérimentation. Nous pourrons donc, dès l’année prochaine, facturer l’ensemble des établissements de santé au niveau national et suivre les prescriptions des établissements patient par patient.
M. Frédéric van Roekeghem. Nous avons en effet adapté nos systèmes d’information pour mettre en œuvre la facturation individuelle, mais je rappelle que le dispositif est déjà opérationnel pour les établissements privés.
La facturation individuelle n’est pas qu’un projet informatique ; elle vise également à améliorer l’organisation des établissements de santé et à mieux anticiper la sortie des patients, afin d’améliorer la fluidité des parcours.
S’agissant des différences de coûts entre les établissements, si nous recherchons une plus grande transparence en matière de qualité, il faut que la concurrence entre les établissements via le choix du patient puisse s’exercer dans des conditions relativement équilibrées.
Avant la mise en place de la T2A, les tarifs reflétaient le budget des établissements. Ils sont en train d’évoluer à travers le mécanisme de la T2A, mais en convergeant vers les moyennes. De fait, il subsiste des différences de tarifs, à soins et comorbidité identiques.
Si nous souhaitons construire un système qui encourage la compétition entre les établissements dans l’objectif d’améliorer la qualité des soins, il faut pouvoir comparer les sommes allouées à chaque établissement. Mais il faut aussi reconnaître que les établissements de santé publics ont des contraintes spécifiques : des contraintes liées au non-programmé – bien que celui-ci puisse être organisé, comme l’a montré l’expérimentation menée à l’hôpital Beaujon ; des contraintes de respect très strict de la réglementation sanitaire, et des contraintes statutaires, puisque c’est l’État qui négocie les modifications statutaires.
Il semble toutefois normal de veiller à ce que l’évolution des tarifs soit liée à la qualité des soins et aux services délivrés plutôt qu’à des situations historiques. Cela suppose de réévaluer les missions d’intérêt général à leur juste tarif, c’est-à-dire de disposer dans tous les établissements de santé d’une comptabilité analytique faisant appel à une nomenclature comparable.
M. Jean-Marc Aubert. S’agissant du programme de contrôle pour 2010, les trois principaux thèmes d’étude sont le saucissonnage des séjours, le rapport entre la pertinence des actes et le codage, et la comorbidité. La France est le pays qui possède le plus grand nombre de groupes homogènes de séjours (GHS) dans ce domaine – 2 000 à ce jour, mais 8 000 potentiellement. Ailleurs, on considère qu’à partir de 1 000 ou 1 500 tarifs, on perd toute capacité de gérer et de contrôler, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
L’alternative à l’hospitalisation est un enjeu fondamental. On a pris du retard sur la chirurgie ambulatoire, et on est en train d’en prendre sur le développement des centres de santé libéraux. On finance aujourd’hui des médicaments anticancéreux dont l’intérêt est de pouvoir être dispensés chez le patient ; or on continue à les donner à l’hôpital. Cela nécessite probablement des investissements dans les soins de ville, nettement insuffisants en France, mais, eu égard aux contraintes budgétaires actuelles, une garantie collective semble nécessaire. Il convient donc que ces financements supplémentaires s’accompagnent d’économies sur les modes actuels de délivrance.
M. Frédéric van Roekeghem. Nous considérons que nous n’avons pas tiré toutes les conséquences de la mise en place de la T2A. Il convient d’en tirer tous les avantages – que les établissements soit rémunérés en fonction de leur activité et que ceux qui ne sont pas suffisamment dynamiques soient obligés de se restructurer – et d’en maîtriser les inconvénients, notamment le risque d’augmentation artificielle du nombre des séjours. Il est évident que, plus le nombre de groupes homogènes de séjours est grand, plus il y a de risque de dérive. Il faudrait pouvoir vérifier les comorbidités de tous les patients ; or cela ne se fera que pour les établissements dont la dérive du case mix (classification des séjours des malades en fonction des moyens requis pour leur prise en charge) est aberrante. La stratégie de multiplication du nombre de groupes homogènes de séjours risque de nuire à l’efficacité du contrôle et à la transparence.
Inversement, si l’on réduit le nombre de groupes homogènes de séjours, il faut veiller, comme le font certains pays, à ce qu’il n’y ait pas de sélection des patients. En la matière, la transparence est une stratégie d’équilibre. Ainsi, la mise en place de la T2A dans les maternités aura des conséquences sur la durée des séjours, ce qui est sans doute nécessaire, sous réserve que leur réduction soit raisonnable. Si l’on publie les durées moyennes de séjour, les patientes pourront disposer d’un indicateur sur la qualité du service rendu.
De même, il faudrait que les patients puissent à terme apprécier la qualité de l’hébergement et des services dans les établissements de soins. L’expérience du National Health Service montre que, lorsque les normes déontologiques sont relativement strictes et que le nombre de réponses est suffisant, une telle enquête est fructueuse.
S’agissant des expérimentations locales, comme celle de l’hôpital Beaujon, ces opérations d’accompagnement des professionnels par des cabinets spécialisés ont permis des gains substantiels. Nous sommes d’accord avec le Gouvernement quand il estime que l’on peut obtenir des gains importants en améliorant l’organisation des établissements. L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, présidée par M. Philippe Ritter, travaille d’ailleurs sur le sujet.
Pour ce faire, un bon management est cependant indispensable. Il faut d’abord définir les objectifs à atteindre grâce à une comptabilité analytique, puis déployer les processus retenus par des contractualisations entre les agences régionales de santé et les établissements de santé. On ne réussira à faire évoluer ces structures qui peuvent regrouper des milliers de salariés que si l’on délègue les responsabilités et que l’on associe très étroitement les personnels concernés.
Mais ne nous berçons pas d’illusions : ces évolutions prendront des années. Nous devons cependant persévérer dans cette direction et mobiliser tous les outils dont nous disposons.
S’agissant des établissements en situation financière délicate, nous vous transmettrons des documents. Nous avons conclu un accord avec la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins afin d’utiliser une méthode d’identification commune, reposant sur des indicateurs de premier, deuxième et troisième niveaux, laquelle nous permettra d’identifier ces établissements de façon rationnelle et de comparer leurs situations à celles de la concurrence – le patient étant libre de son choix. Il reste à mettre en œuvre cette méthode et à apporter des solutions.
M. le coprésident Pierre Morange. Messieurs, je vous remercie pour la précision de vos réponses.
*
Audition de M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des sports.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous accueillons maintenant M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des sports.
Je passe tout de suite la parole à notre rapporteur, M. Jean Mallot, à qui je demande tout d’abord de bien vouloir préciser, à l’intention de la presse, quand il compte remettre son rapport.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Après les auditions de ce matin, nous procéderons encore à celle de la ministre de la santé et des sports.
Compte tenu de l’interruption des travaux de l’Assemblée nationale au mois de mars, je pense que le rapport devrait pouvoir être présenté début avril ou à la charnière de mars et d’avril.
La mission est heureuse de vous retrouver, monsieur Dominique Libault, sur le thème du fonctionnement de l’hôpital.
Comment se situe la direction de la sécurité sociale dans la nébuleuse des organismes de tutelle, d’observation ou de pilotage que sont, par exemple, les agences régionales de l’hospitalisation, qui seront remplacées demain par les agences régionales de santé, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, l’ancienne mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier ou encore la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, dont nous venons d’entendre le directeur général ?
Par ailleurs, nous sommes frappés par le décalage qui existe entre ce que nous disent ces différents organismes de tutelle d’envergure nationale et les informations qui nous remontent du terrain sur le fonctionnement des établissements hospitaliers. Comment est-il possible, selon vous, de réduire ce décalage ?
M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des sports. Je vous remercie de m’entendre aujourd’hui sur ce sujet très important qu’est le fonctionnement de l’hôpital.
Comme vous, je suis frappé par la double image qui nous en est présentée : d’un côté, les experts insistent sur la nécessité pour les établissements hospitaliers de gagner en efficience et, de l’autre, un certain nombre d’acteurs du secteur hospitalier – personnels soignants ou non soignants – font part de difficultés, de charges de travail importantes, voire de pénibilité. Ces deux réalités doivent être prises en compte. Elles ne sont, d’ailleurs, pas incompatibles : les difficultés exprimées par les agents du secteur n’excluent pas que le système hospitalier ait besoin d’accroître son efficience.
La direction de la sécurité sociale essaie de piloter l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, c’est-à-dire les équilibres financiers de l’Assurance maladie. En votant un objectif national des dépenses d’assurance maladie en augmentation de 3 %, alors que la croissance spontanée des dépenses de santé est de 4,5 % ou 5 %, le Parlement fait le choix de limiter les sommes que la Nation est prête à affecter au financement de la dépense publique de santé par rapport à la croissance naturelle des dépenses de santé. Pour parvenir à cet objectif, il n’y a que deux moyens : soit on modère le coût des prestations de santé payées par l’assurance maladie solidaire, c’est-à-dire le volume global des services de santé et leurs tarifications individuelles, soit on diminue le « panier » acheté par l’assurance maladie solidaire, c’est-à-dire la prise en charge des services de santé, ce qui a un impact sur les droits sociaux de nos concitoyens. Si l’on ne veut pas trop réduire ces droits, on est obligé de s’intéresser au coût des prestations et des services de santé, notamment des établissements de santé qui représentent une part très importante de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie : quelque 70 milliards d’euros.
Il importe, par ailleurs, de déterminer, lorsqu’on réfléchit à l’évolution des dépenses de santé sur le long terme, sur quels secteurs on peut espérer diminuer la progression du coût des prestations de santé pour l’assurance maladie solidaire, toujours dans l’optique de maintenir le maximum de prise en charge.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Outre le décalage observé entre le discours national et les avis sur le terrain, il en existe un autre entre les outils de gestion et de management, à ces deux niveaux : au niveau national, ont été mis en place des outils d’information très performants, dont la T2A, tandis que, dans les établissements, il n’y a pas encore de comptabilité analytique digne de ce nom, si bien que l’on trouve encore souvent des sous-facturations, ce qui empêche de comparer les coûts réels des établissements à la tarification qu’on leur demande d’appliquer. Qu’est-ce qu’un système d’information s’appuyant sur des données partielles ?
M. Dominique Libault. Il ne faut pas oublier qu’on part d’un système d’allocation de ressources – la dotation globale. L’unique préoccupation des établissements était de rester dans l’allocation globale qui leur était versée : ils ne se posaient pas la question du coût des différentes activités proposées.
C’est depuis l’instauration d’un levier tarifaire que se posent les questions de facturation exhaustive, d’analyse de coûts et d’organisation. La T2A exige des changements profonds. Comme l’a dit M. Frédéric van Roekeghem, cela demande du temps, d’autant qu’il existe des écarts de coûts importants entre les établissements de santé. Ceux dont les coûts sont loin de la moyenne sur laquelle repose la nouvelle échelle d’allocations de ressources doivent faire plus d’efforts, ce qui peut être vécu de diverses manières.
Le système d’allocation budgétaire mis en place est vertueux mais il a ses limites : il permet d’impulser des changements mais ne donne pas le chemin pour y parvenir.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La T2A est-elle conçue comme un moyen pour établir une vérité des coûts ou bien comme un outil de pilotage et d’orientation du système ? L’instauration de la vérité des coûts repose sur la comptabilité analytique dans toute sa froideur et sur la mesure tandis que le pilotage du système repose sur l’augmentation ou la diminution de certains tarifs pour orienter l’activité vers telle ou telle priorité.
M. Dominique Libault. L’orientation prise par les pouvoirs publics a plutôt été en faveur de la vérité des coûts.
La T2A a été mise en place à partir du coût moyen par activité. Un débat a eu lieu au sein de l’administration à ce sujet. Nous voulions fixer la T2A un peu plus haut que la moyenne pour que le système soit plus efficient. La T2A n’a pas été conçue pour « gagner de l’argent » : elle est une réallocation de ressources entre établissements en fonction de l’activité, de façon à donner la même somme pour la même activité.
La T2A étant maintenant mise en place, la seconde finalité que vous avez évoquée peut être envisagée : détacher le coût d’une activité de la moyenne pour inciter les établissements à la réaliser ou, au contraire, à la laisser à la charge d’une alternative à l’hospitalisation.
Cela étant, je pense que les pouvoirs publics ont eu raison de partir de la moyenne pour établir une lisibilité et une transparence des coûts. La T2A n’a pas été établie en fonction de desseins plus ou moins opaques. La démarche de M. Jean-François Mattei, lorsqu’il était ministre en charge de la santé, et de ses équipes, lorsqu’ils l’ont instituée, a été de partir des coûts constatés afin de redistribuer les allocations.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous revenons toujours au même sujet, à savoir la maîtrise de l’information, qu’elle soit d’ordre sanitaire, administrative ou assurancielle. Les plans informatiques en cours de réalisation dans les établissements hospitaliers français sont-ils adossés à un principe général d’urbanisation et d’interconnexion ?
M. Dominique Libault. J’avoue la limite de ma compétence sur le sujet puisque je ne suis pas directement chargé de l’informatisation de l’hospitalisation. Pour autant, je suis frappé par la différence des démarches en la matière.
Dans les décennies 1980 et 1990, l’informatisation des caisses de sécurité sociale a été prise en charge par un plan d’informatisation globale cohérente et pilotée nationalement, ce qui a créé parfois des conflits avec certains établissements de base qui contestaient cette vision d’une informatique nationale. Je considère que cela a été un bon choix.
L’informatique hospitalière n’a pas de pilotage national unique, ce qui entraîne un manque de cohérence entre les établissements et s’oppose à l’objectif d’interconnexion souhaité par les pouvoirs publics. La facturation individuelle a pris un retard considérable bien que nous essayions de la relancer. C’est un sujet auquel la direction de la sécurité sociale tient beaucoup. La mise en place des franchises est également lente et la réaction des établissements très hétérogène.
J’observe cependant un souci de donner plus de cohérence à cette approche. Une délégation au système de santé est sur le point de se mettre en place au sein du ministère de la santé auprès du secrétaire général, et nombre d’établissements sont conscients de l’enjeu. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire.
C’est un élément très important dans l’évolution du système, tant pour le pilotage interne des établissements que pour le reporting (suivi d’indicateurs) et le benchmark (analyse comparative).
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les charges de personnel représentant près de 70 % du budget des établissements, certains responsables d’organisations professionnelles voient en celles-ci un gisement important d’économies permettant de retrouver des équilibres financiers. Quelle est votre position à ce sujet ?
M. Dominique Libault. Avant de considérer les personnels, nous devons nous poser une question fondamentale, celle de savoir quelle activité de santé on veut que l’hôpital assure aujourd’hui et demain.
Aucun système n’étant parfait, la T2A a des vertus, mais aussi des limites. Elle a la vertu d’induire l’ensemble des établissements à se rapprocher du coût moyen et donc à faire des efforts d’efficience. Mais, plus d’activités engendrant plus de ressources, elle peut également inciter à « faire de l’activité ». Or, dans un système d’assurance maladie solidaire, se pose la question du meilleur service de santé au moindre coût. La recherche d’activité n’est pas forcément compatible avec cet objectif, le moindre coût pouvant être réalisé par des actes effectués en dehors de l’hôpital. La mise en place des agences régionales de santé est, de ce point de vue, très importante. Il est nécessaire d’avoir un regard sur l’ensemble des services de santé d’une région.
La question concernant les personnels se décline de la manière suivante : combien de personnes, et pour quelle activité, d’abord ? Certains établissements peuvent avoir la tentation, pour répondre au défi de la T2A, d’augmenter leurs parts de marché et de construire plus de blocs opératoires. Si, dans de tels cas, on implique moins de personnels, des problèmes apparaîtront.
Une fois déterminés le type et le volume d’activités, il convient de s’interroger sur les bonnes pratiques qui génèrent les moindres coûts. Ce n’est pas un sujet spécifique à l’hôpital. Nous faisons un même constat d’hétérogénéité pour les caisses de sécurité sociale pour lesquelles nous dressons des tableaux mettant en regard leurs qualités et leurs coûts. Un quart des établissements offrent des services de qualité à un faible coût. Ils doivent servir de modèles pour améliorer la performance de l’ensemble du réseau.
Un levier essentiel, pour lequel la direction de la sécurité sociale a beaucoup milité, est la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitalier, devenue l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. L’amélioration de l’efficience ne consiste pas uniquement en l’augmentation des effectifs, mais aussi en un meilleur service pour tout le monde. Des expériences ont été menées sur la gestion des blocs opératoires, des urgences, des lits, de la nutrition, des sorties, qui montrent qu’une meilleure gestion fluidifie l’organisation : on améliore la qualité du travail du personnel soignant et le relationnel entre celui-ci et les agents. Un système de non-qualité crée à la fois une surcharge de travail et le sentiment de ne pas accomplir un travail gratifiant. En travaillant sur l’organisation, non seulement on peut offrir un meilleur service, mais encore on peut faire en sorte que le personnel se sente plus à l’aise. C’est ce à quoi il faut tendre.
On parle toujours de ce qui va mal à l’hôpital, mais il y a beaucoup de belles expériences. La Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers demandait toujours aux personnes qu’elle rencontrait de raconter leurs belles histoires.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Les échanges d’expériences se font difficilement. Comment l’expliquez-vous ?
M. Dominique Libault. Je fais le même constat que vous. La mise au point de référentiels de bonnes pratiques en matière de gestion des blocs opératoires, des lits et de la nutrition a pris du temps. Elle a été réalisée sur la base du volontariat, c’est-à-dire à partir d’établissements volontaires. Les agences régionales de l’hospitalisation n’étaient pas en position de relayer la démarche comme pourront le faire les agences régionales de santé – c’est d’ailleurs l’enjeu majeur de leur création. Sur le plan national, si la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers a fait son travail, la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins n’a pas pris suffisamment en charge la diffusion des bonnes pratiques constatées. La création, au sein de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, d’une sous-direction chargée de l’efficience devrait pallier ce manque. Tant au niveau national qu’au niveau régional, nous sommes en train de nous doter d’outils plus satisfaisants.
Une réflexion est également en cours sur les métiers au sein de l’hôpital. On a constaté qu’une bonne organisation était due à une bonne association des soignants et des non-soignants. Aucun progrès ne peut se faire sans les personnels soignants, et encore moins contre eux. Les projets doivent être portés par des équipes médicales et bénéficier d’un accompagnement administratif adéquat. Les établissements réfléchissent à la manière de positionner ce que j’appelle des ingénieurs du fonctionnement interne hospitalier pour faire en sorte que les équipes travaillent bien ensemble.
Il n’y a pas de modèle unique. Il faut respecter la diversité, l’histoire et la culture des établissements. Trop souvent, dans les établissements, une belle histoire prend fin du fait du départ de la personne qui s’en occupait. Il faut se donner des moyens de gouvernance interne à l’hôpital pour que ces belles histoires deviennent pérennes.
Là encore, je pense qu’on est dans la bonne direction.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. C’est un aspect qui était au cœur de la discussion de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Pensez-vous que l’on ait atteint un bon équilibre avec ce texte ?
M. Dominique Libault. Il est indispensable d’avoir un peu de stabilité dans les leviers, mais il faut donner du temps au temps. On a fourni des outils de gouvernance internes à l’hôpital. Il importe que les établissements se les approprient et les fassent vivre. Nous devons donner le temps à ces outils de produire leurs effets.
Je considère que la loi offre un certain nombre de leviers. L’un des enjeux fondamentaux est que les acteurs se les approprient. S’ils ont l’impression qu’une contrainte externe s’exerce contre eux, cela ne pourra pas marcher. S’ils ont le sentiment que c’est dans leur intérêt, une dynamique se mettra en place et induira des initiatives positives.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Cette orientation est-elle partagée par tous les acteurs du système hospitalier ? Pensez-vous que les outils de formation des personnels soient en phase avec celle-ci ?
M. Dominique Libault. Quoique le sujet soit un peu éloigné de ceux que je gère en direct, je dirai qu’il y a beaucoup à dire sur les outils de formation.
Même si les sujets touchant à l’organisation sont déjà traités lors de la formation initiale à l’École des hautes études en santé publique, il y a matière à amélioration, y compris pour les directeurs d’hôpitaux eux-mêmes.
Par ailleurs, bien qu’il y ait un peu d’économie de la santé dans le cursus des études médicales, ces sujets ne sont pas beaucoup évoqués. Il y a donc un gros travail à faire dans le cadre de la formation des médecins. Nous saurons que nous aurons réussi quand il n’y aura plus de clivage entre personnels soignants et personnels non soignants. C’est déjà le cas dans certains établissements où responsables médicaux et chefs d’établissement travaillent en lien.
Quoi qu’on en dise, la situation a beaucoup progressé depuis vingt ans, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire, notamment dans les très gros établissements, où ces dynamiques sont plus difficiles à mettre en place.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Si je comprends bien, le système de tarification a été posé pour établir une vérité des prix, mais il peut progressivement devenir un outil d’orientation. Cela suppose que les appareils informatiques soient organisés en conséquence. Par ailleurs, des échanges d’expériences vertueuses et de bonnes pratiques sont en cours et l’on étudie des alternatives à l’hospitalisation.
La poursuite de ces démarches permettra-t-elle de retrouver l’équilibre financier des établissements de santé et d’améliorer l’efficience du système pour une meilleure santé de la population ? On se heurtera certainement à quelques obstacles. Quels en sont, selon vous, les principaux ?
M. Dominique Libault. Vous avez assez bien résumé la situation.
Il faut d’abord assurer un bon équilibre entre les différents outils : budgétaire, informatique, intéressement des acteurs au sein de l’hôpital, définition de l’activité attendue de l’hôpital. Ce qui est un peu compliqué, c’est d’arriver à les faire progresser parallèlement.
La définition de l’activité que l’on veut à l’hôpital n’est pas aussi avancée que nous le souhaiterions. Nous devons travailler en priorité sur ce thème.
Au cours des dernières années, le Parlement a voté un objectif national des dépenses d’assurance maladie hospitalier égal à l’objectif national des dépenses d’assurance maladie soins de ville. Est-on sûr que l’on s’autorise ainsi la meilleure allocation des ressources ? Personnellement, je n’en sais rien, mais il faut que nous fassions des projections pour nous en assurer. C’est une question fondamentale, qui n’est pas assez expertisée.
Il importe ensuite de travailler, de façon cohérente, sur les différents leviers. Une grande transparence est nécessaire, non seulement des établissements vis-à-vis de l’extérieur, mais également des décisions publiques vis-à-vis des établissements. Les hospitaliers vivent mal l’impression d’opacité de certaines règles du jeu et les modifications de celles-ci sans explications.
Enfin, il faut tenir compte de la volonté du Parlement de réallouer les ressources au sein des territoires entre hôpital et ville, et entre les territoires eux-mêmes.
Nous devons être actifs sur tous ces fronts et nous doter des outils les plus objectifs pour qu’ils soient le moins contestés possible.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. L’outil concernant ce dernier point est certainement pour vous l’agence régionale de santé.
M. Dominique Libault. Pas seulement. Pour décider combien il faut allouer à telle ou telle région, il faudra que les agences régionales de santé sachent quelles sont les régions qui sont sous-dotées et celles qui sont surdotées, ce qui suppose des outils d’analyse dont nous ne disposons pas encore. Ceux à notre disposition sont un peu frustes. Nous devrons les affiner.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment comptez-vous progresser dans ce domaine ?
M. Dominique Libault. Un premier moyen consistera à rapporter à la population le coût des dépenses de santé, en faisant intervenir différents facteurs, dont l’âge. On peut étudier également les possibilités de transfert d’une population donnée dans une autre région pour avoir accès à l’offre de soins. S’il faut, dans certains cas, veiller à maintenir, voire à développer, une offre de soins de proximité, il en est d’autres, comme dans le cadre de la lutte contre le cancer, où des centres de référence peuvent être créés vers lesquels convergerait la population de plusieurs territoires. Cela induirait des parcours de soins qu’il faudrait prendre en compte de manière fine dans l’évaluation des inégalités territoriales d’accès aux soins. Le sujet est complexe.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous vous remercions, monsieur le directeur.
*
Audition de M. Benjamin Maurice, directeur de la Mission sur la tarification à l’activité et chef du bureau du financement de l’hospitalisation privée à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des sports.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous vous souhaitons la bienvenue, messieurs, à l’Assemblée nationale.
La tarification à l’activité (T2A) a souvent été évoquée au cours de nos auditions. Cette grille tarifaire, qui est un outil de référence en matière d’efficience au service des patients et un référentiel toujours plus affiné, peut paraître complexe à celles et ceux qui l’utilisent.
Récemment, un représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés nous indiquait que la philosophie de la T2A était d’établir des moyennes sur une pratique dont les modalités sont parfois issues du passé. Cet outil de référence, utilisé dans le secteur public à des fins de convergence et d’harmonisation, prend-il parfaitement en compte les opportunités qui se présentent pour améliorer le fonctionnement des établissements de soins et promouvoir les thérapeutiques ?
Plusieurs personnalités, dont le président de la Haute Autorité de santé et M. Jean-Michel Dubernard, ancien président de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, soulignent la pertinence du développement de la chirurgie ambulatoire et de la gestion de l’amont et de l’aval des établissements de santé. Toutefois, ils s’interrogent sur la possibilité d’adapter la grille tarifaire afin de la rendre plus favorable au développement de la chirurgie ambulatoire.
Si la T2A contribue à pérenniser les pratiques de qualité, elle n’améliore pas forcément l’offre de soins pour nos concitoyens et ses conséquences en termes de durée d’hospitalisation, de souffrances et de complications post-opératoires. Quoi qu’il en soit, il importe de développer la chirurgie ambulatoire et de mieux la valoriser dans les tarifs.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. On ne peut parler du fonctionnement de l’hôpital sans évoquer son financement, qui est le nerf de la guerre. La T2A est-elle le reflet de la vérité des coûts ou un outil d’orientation de l’activité ? Comment voyez-vous son avenir, compte tenu de la situation sanitaire, économique et budgétaire de nos établissements ?
M. Benjamin Maurice, directeur de la Mission sur la tarification à l’activité et chef du bureau du financement de l’hospitalisation privée à la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des sports. Nous connaissons vos préoccupations, et nous les prenons en compte lorsque nous construisons les modèles de financement et de tarification. Je vais vous le démontrer au cours de cette audition.
Je commencerai par dresser un bilan de la T2A.
Sur le champ des activités médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) et odontologie, nous avons parcouru un long chemin, depuis 2004. Notre but est de construire un système équilibré, basé sur une ressource tarifaire prédominante – elle représente près des trois quarts des ressources des établissements sur le champ médecine, chirurgie, obstétrique – et sur des financements complémentaires – dotations, forfaits, sans oublier la « liste en sus » pour certains dispositifs médicaux et les molécules onéreuses. Si notre système focalise l’attention sur l’aspect tarifaire, il ne faut pas oublier les ressources complémentaires que sont les dotations, qui permettent d’équilibrer le financement et de mener une politique de santé publique.
Souhaitant que la réforme soit mise en place progressivement, nous avons instauré des coefficients de transition. Le processus de convergence intrasectorielle est en cours dans tous les établissements et sa fin est programmée pour 2012.
La réforme prévoyait également la convergence intersectorielle. La méthodologie ayant été clairement expliquée, celle-ci a donné lieu à des résultats très sensibles l’année dernière en termes de rapprochement des masses tarifaires entre le secteur public et le secteur privé.
J’en viens à ce qui sera mis en place dans le cadre de la prochaine campagne tarifaire. Nous avons entendu les remarques dont vous vous faites l’écho. Cette campagne doit s’inscrire dans la continuité : continuité des outils et des politiques, continuité dans la classification des « groupes homogènes de malades » et dans l’utilisation raisonnée des données issues de l’étude nationale de coûts à méthodologie commune.
Les politiques tarifaires s’inscrivent dans la continuité puisque nous poursuivons l’accompagnement des priorités de santé publique que sont le cancer, les soins palliatifs, ainsi que les politiques incitatives en direction du développement de la chirurgie ambulatoire. Cette préoccupation, clairement affichée, trouve sa traduction dans les tarifs.
Notre souci de continuité se traduit enfin par des ajustements, sur les séjours courts et certains dispositifs comme la surveillance continue.
La T2A est en marche, elle poursuit son chemin avec le souci de répondre aux préoccupations des établissements et aux objectifs de santé publique.
Dans le domaine des soins de suite et de réadaptation, nous avons mis en place l’année dernière un système de modulation des ressources, par le biais d’un indice de valorisation de l’activité. C’est un premier pas, qui montre que des initiatives ont été prises.
S’agissant de la psychiatrie, nous n’en sommes pas là, mais l’année 2010 sera celle de la mise en place de la valorisation de l’activité.
Tous ces éléments étaient précisés dans le rapport sur la tarification à l’activité qui a été transmis au Parlement, à l’automne dernier.
Certains sont opposés au modèle tel qu’il existe. Les critiques les plus courantes concernent son opacité, sa complexité et le fait qu’il ne rémunère pas suffisamment certaines activités. Pourtant, ce système a soutenu le développement des activités de soins et des établissements de santé. Il contribue en outre à réduire les inégalités, car la tarification nationale met tous les établissements sur un pied d’égalité, et permet de financer l’enseignement, la recherche et l’innovation. Il est sans doute perfectible, mais il se révèle complet et solide.
D’autres éléments interviennent dans le financement des établissements. Le premier est macroéconomique : il s’agit des ressources que le Parlement alloue chaque année aux établissements de santé, et qui correspondent plus ou moins à leurs espérances. Cette composante intervient dans les constructions tarifaires. En réalité, c’est non pas la T2A qui est en cause, mais le niveau de la ressource injectée dans le système.
L’autre élément, qui est au cœur de vos préoccupations et de vos réflexions, est l’appropriation par les établissements de ce modèle de financement.
La T2A est neutre : elle ne vise pas à favoriser tel ou tel établissement. En revanche, elle est un puissant levier d’efficience, un instrument qui invite les établissements à réfléchir au processus de production des soins et à leur organisation, et éventuellement à opérer certains réajustements.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Comment voyez-vous à l’avenir l’articulation de votre mission parmi les institutions qui participent au pilotage du système hospitalier – la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et les agences régionales de santé ?
Le décalage qui existe entre les schémas, très rationnels, qui nous sont présentés par les institutions comme la vôtre et la réalité du terrain – outils d’information peu efficaces, trous dans la facturation – nous laisse perplexes.
Enfin, de quelle manière entendez-vous simplifier la T2A ?
M. Benjamin Maurice. La Mission T2A, qui est un service de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, cessera son activité le 31 décembre 2010, selon les termes du décret du 22 mai 2008 relatif à l’agence. Pour autant, la fin de la Mission ne signifie pas la fin de la T2A, de même que la disparition de la mission programme de médicalisation du système d’information n’a pas signifié la fin du projet. Il est important que les missions soient poursuivies et elles le seront, dans le cadre de la réorganisation et de la mise en place de la nouvelle direction générale de l’offre de soins. Il y aura donc continuité, à la fois des méthodes, du programme et des agents. Le chemin a été tracé : il n’y aura donc aucune rupture, car la T2A transcende les organisations. M. Dominique Libault, que vous venez d’auditionner, a indiqué que toutes les directions administratives s’étaient approprié la T2A.
Vous soulignez le décalage entre le modèle que nous vous présentons et la réalité. Bien entendu, ce modèle n’est pas parfait. C’est la raison pour laquelle nous procédons à des ajustements, qui découlent des observations et des critiques qui nous sont faites, et surtout des contributions des établissements. Ce système tend à être le plus équilibré possible, mais il peut souffrir de déséquilibres, que nous essayons de corriger.
On lui reproche d’être complexe, mais c’est le lot de tout système. Certes, notre grille tarifaire est foisonnante, mais en Allemagne la grille équivalente, destinée à classifier les groupes homogènes de malades, est beaucoup plus importante. Quoi qu’il en soit, nous travaillons à sa simplification.
M. le coprésident Pierre Morange. Je voudrais, à propos de cette simplification, vous faire part de deux critiques importantes : d’une part, nous avons dépassé les 1 500 groupes – c’est un chiffre symbolique, au-delà duquel la maîtrise de la grille tarifaire n’est plus envisageable – ; d’autre part, vous dites que la grille doit être appropriée par les personnes qui ont vocation à réaliser le codage, mais ce sont les professionnels de santé, au chevet des patients, qui sont les mieux placés pour établir cette codification et procéder à sa modification, et non les informaticiens médicaux, totalement déconnectés de la réalité médicale. Pour s’approprier cette culture peut-être encore plus complexe que la matière médicale, ils ont ardemment réclamé une pause.
M. Benjamin Maurice. La complexité de cette grille résulte de la demande, tout à fait légitime, exprimée par les représentants des établissements, les sociétés savantes et les experts, de décrire parfaitement l’activité. C’est pour répondre à leur demande, donc pour des raisons médicales, que nous avons procédé à un découpage aussi fin de l’activité. Cela dit, les 1 300 groupes homogènes de malades sont regroupés en un peu plus de 600 groupes. Cette grille est le fruit d’une stratification, réalisée année après année, et le résultat de travaux longs et complexes, menés en parfaite concertation avec les professionnels. Mais j’ai bien entendu votre argument. Notre objectif doit être de travailler à la simplification. C’est ce que nous faisons, et nous continuerons.
L’appropriation de l’instrument tarifaire doit naturellement revenir aux professionnels. Ceux-ci sont très aguerris, bien plus que je ne le suis. Nous avons constaté cette année – l’audition de Mme Maryse Chodorge, directrice de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation, l’a démontré – que les établissements s’étaient approprié ces nouvelles classifications. Il existe sans nul doute une complexité, mais elle est intégrée par l’ensemble du personnel hospitalier.
M. le coprésident Pierre Morange. Concrètement, la tarification à l’activité vous paraît-elle appropriée, à hauteur de 60, de 80 ou de 90 % ? Pouvez-vous estimer le degré d’appropriation et de mise en œuvre de cette grille tarifaire ?
M. Benjamin Maurice. Il faut voir les choses différemment. L’exhaustivité du codage est un révélateur du degré d’appropriation de la grille de tarification puisqu’elle montre que les professionnels – en particulier les départements d’information médicale – sont aguerris sur ces techniques.
Vous me demandez mon sentiment sur les simplifications nécessaires. Je ne vous répondrai pas : d’une part, je ne suis pas médecin ; d’autre part, je pense que cette classification permet une description fine de l’activité ainsi qu’un suivi du codage et du comportement des établissements.
En matière d’appropriation de la T2A, je ne peux vous donner de chiffres précis. Je vous renvoie à la lecture de la classification commune des actes médicaux.
En tout état de cause, la simplification est un chantier qu’il nous faut intégrer, mais elle doit être acceptée et partagée, et les demandes qui pourraient surgir ça et là s’inscrivent dans ce schéma. Notre véritable souci est d’adapter la grille à la réalité médicale et aux attentes légitimes des professionnels.
M. le coprésident Pierre Morange. Selon vous, la tarification à l’activité serait incitative en matière de stratégie thérapeutique, notamment pour développer la chirurgie ambulatoire. Tel n’est pas le sentiment du président de la Haute Autorité de santé. Comment expliquez-vous cette divergence ?
M. Benjamin Maurice. Je ne me permettrai pas de critiquer le président de la Haute Autorité de santé. Le développement de la chirurgie ambulatoire et les politiques tarifaires incitatives qui visent à la promouvoir sont une constante de la politique du ministère de la santé, et ce depuis plusieurs années, en relation étroite avec la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Cette politique s’est traduite, l’année dernière et cette année, par des rapprochements entre les tarifs de la chirurgie ambulatoire et de l’hospitalisation sur une série de groupes homogènes de malades correspondant à des interventions courantes – point sur lequel la communauté médicale espère des progrès notables.
Le recours à la chirurgie ambulatoire se situe entre 20 et 25 % dans le secteur public et aux alentours de 40 % dans le secteur privé. Ces chiffres, s’ils sont significatifs, pourraient être encore améliorés. C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette politique tarifaire, que nous allons poursuivre cette année.
M. le coprésident Pierre Morange. Allez-vous la renforcer ou l’étendre à d’autres champs opératoires ?
M. Benjamin Maurice. Il s’agit pour l’instant de poursuivre l’effort concentré sur ces groupes homogènes de malades correspondant aux opérations du canal carpien, du cristallin ou des oreilles décollées et à la pose de drains. Sur les interventions classiques, bien connues des établissements de santé, il reste des progrès à faire. Actuellement, 85 % à 90 % des interventions du canal carpien sont effectués en ambulatoire ; celles réalisées sur le cristallin atteignent 75 ou 80 %. Mais nous venons de loin : auparavant, dans le secteur public, l’ambulatoire ne représentait que 45 % pour cette intervention. Entre 2006 et 2009, nous sommes passés de 45 % à 75 %. J’ai la faiblesse de penser que ce progrès significatif est en grande partie la conséquence de la politique tarifaire qui a été mise en œuvre.
Le développement de la chirurgie ambulatoire n’est pas facile car celle-ci remet en cause certains gestes traditionnels. Elle suppose une organisation adaptée et exige que des explications détaillées soient fournies aux patients, qui ne sont pas habitués à quitter aussi rapidement l’établissement de santé. Néanmoins, tout le monde s’accorde à considérer la chirurgie ambulatoire comme un facteur de qualité et d’efficience. Et, si la politique tarifaire a un sens, c’est bien celui de développer certaines pratiques.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. On comprend que la T2A puisse devenir un outil d’orientation des activités hospitalières, mais qui définit ces orientations prioritaires, dans la nébuleuse des tutelles qui se penchent sur l’hôpital ? L’autorité de tutelle pourra-t-elle modifier son orientation de façon arbitraire pour que la chirurgie en hospitalisation complète rapporte moins à l’établissement hospitalier ? J’avoue que cela me pose un problème.
M. Benjamin Maurice. Les orientations tarifaires sont définies et assumées par les pouvoirs publics, l’Assurance maladie, les autorités compétentes telles que la Haute Autorité de santé et les médecins.
Une tarification incitative est mise en place sur une liste limitée de groupes homogènes de malades afin d’inciter au développement de certaines activités.
M. le coprésident Pierre Morange. Qui dresse cette liste ?
M. Benjamin Maurice. Le ministère de la santé.
M. le coprésident Pierre Morange. Dans la mesure où l’analyse médico-économique a été confiée à la Haute Autorité de santé, existe-t-il un lien structurel fort entre ses préconisations et la Mission T2A ?
M. Benjamin Maurice. Concrètement, si l’impulsion tarifaire est donnée par le ministère de la santé, la politique est construite en relation étroite avec les outils et les référentiels de la Haute Autorité de santé et de l’Assurance maladie. Il s’agit donc bien d’une politique concertée et partagée. Par ailleurs, un ensemble d’éléments entrent en ligne de compte pour fixer le niveau d’incitation, comme la ressource allouée par le Parlement, chaque année. Il est clair que, dans un système d’enveloppes fermées, donner une impulsion en faveur de la chirurgie ambulatoire alourdit l’effort qui pèse sur les tarifs des autres activités.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La T2A est un peu comme la première partie de la loi de finances, qui met en place des dispositifs fiscaux, comme les niches fiscales visant à encourager la rénovation des logements, ou la taxe carbone destinée à modifier les comportements en matière de consommation d’énergie. Dans le domaine médical, si l’on découvre un médicament qui évite d’amputer telle ou telle partie du corps humain, quelqu’un orientera les tarifs en offrant un avantage tarifaire aux établissements qui iront dans ce sens. Ce procédé est un peu décalé par rapport à ce que devrait être la T2A par rapport au budget global, c’est-à-dire son coût effectif pour les établissements.
M. Benjamin Maurice. La réalité des coûts est prise en compte dans les résultats de l’Étude nationale de coûts à méthodologie commune, construite à partir de la comptabilité analytique d’un certain nombre d’établissements. Il n’y a donc pas de déconnexion entre tarification et structure de coûts. Néanmoins, le tarif n’est pas égal au coût. Nous savons tous que le coût est une convention, qui peut varier d’un établissement à l’autre. Le coût permet d’éclairer et de hiérarchiser les tarifs les uns par rapport aux autres. Il existe donc un lien très fort entre ces tarifs et la réalité économique des établissements.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Cela suppose que les établissements disposent des outils d’information leur permettant d’apprécier avec précision l’activité économique. Or, nous avons appris que ces outils étaient insuffisants.
M. Benjamin Maurice. Les établissements qui participent à l’étude nationale de coûts à méthodologie commune ont été sélectionnés. Ils disposent tous d’une comptabilité analytique et sont en mesure de retranscrire leur comptabilité. Il est important que toutes les catégories d’établissements, tous secteurs confondus, participent à cette étude nationale.
Quant à la diversité des pratiques en matière de comptabilité analytique, ce qui est vrai des établissements de santé l’est de n’importe quelle autre catégorie d’organismes de production. Des progrès considérables ont été réalisés, comme l’ont attesté les personnes que vous avez auditionnées. Le représentant d’un centre hospitalier de Loire-Atlantique que vous avez entendu a ainsi souligné l’importance de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion pour son établissement. Néanmoins, il reste des gains d’efficience à réaliser.
La tarification à l’activité est un élément de pilotage très important pour les établissements. Certains d’entre eux ont encore du chemin à parcourir, parce que cela suppose d’acquérir des compétences, de s’adapter à de nouveaux systèmes d’information et de diffuser cette culture, car les informations, pour être mieux acceptées, doivent être partagées.
Il existe effectivement une hétérogénéité en termes d’outils de comptabilité analytique, mais les études réalisées révèlent que les établissements de santé et les établissements publics font des efforts considérables pour se doter d’outils de comptabilité analytique et de contrôle de gestion performants pour mesurer leurs performances et se comparer aux autres.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. La T2A est un sujet passionnant qui peut donner l’impression, au premier abord, d’être une science exacte. Ensuite, on se rend compte que le système a besoin d’être corrigé, et c’est ce qui explique la création des missions d’intérêt général.
M. Benjamin Maurice. Le système a besoin d’être complété.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il doit en tout cas permettre des orientations politiques. Nous avons l’impression que tout cela est complexe, que nous hésitons entre la vérité des prix et l’orientation.
Vous avez dit tout à l’heure que les personnes chargées dans les établissements du codage ou de l’application des grilles tarifaires étaient aguerries et s’étaient approprié le système. Cela signifie-t-il qu’elles aient appris à lire la grille et à l’appliquer, ou à l’utiliser en servant au mieux les intérêts de l’établissement ? En clair, le système peut-il générer des comportements aboutissant à des effets pervers, sachant que, plus la grille est complexe, plus on peut s’en servir d’une façon qui n’est pas forcément conforme aux intentions de ses concepteurs ?
M. Benjamin Maurice. Je reviens à l’appropriation. Il est très important d’insister sur le rôle du département d’information médicale, qui est le vecteur de propagation de la culture médico-économique de la T2A.
Vous avez sans doute fait allusion aux comportements de surcodage ou d’optimisation du codage. Nul doute qu’ils existent, mais des contrôles très pointus sont réalisés. La version 11 de la classification des groupes homogènes de séjour (V11), avec le degré de finesse de description de l’activité qu’elle autorise, permet de débusquer de tels comportements. Il en est de même des contrôles réalisés par l’Assurance maladie. Les stratégies de contournement sont malheureusement inévitables, mais je pense que, dans la plupart des cas, la description de l’activité est juste et complète.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Il existe deux comportements décalés, mais tout aussi inquiétants : celui qui consiste à coder un acte de façon optimale, et celui qui consiste à orienter l’activité vers des actes éventuellement non pertinents mais qui serviraient les intérêts de l’établissement.
M. Benjamin Maurice. Les comportements non pertinents ne sont pas souhaitables car ils engendrent de grands risques médicaux.
La T2A fait partie d’un tout, et le comportement des acteurs ne doit pas être guidé par des considérations uniquement économiques. L’intérêt du malade doit passer avant tout. Ce principe doit être sans cesse réaffirmé.
Nous sommes très attachés au fait que les comportements de contournement ne se généralisent pas. Nous y veillons, à travers les contrôles et les régulations régionales. Le risque existe, comme il existe dans tout système structuré qui peut donner lieu à interprétation.
La grille tarifaire et la classification des groupes homogènes de malades sont diffusées aux établissements, accompagnées de circulaires et de notices d’explication. Le site internet de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation rassemble des éléments techniques très précis à l’attention des utilisateurs, ainsi que des foires aux questions. Des échanges permanents ont lieu sur le codage et les contrôles. Tout est prévu pour donner l’information la plus pertinente et la plus opérationnelle possible.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. On voit bien que vous cherchez à perfectionner le système, votre objectif ultime étant la qualité des soins et la garantie d’une sécurité optimale. Cette qualité peut-elle être assurée par l’évolution du système de tarification ou par une dotation spécifique complémentaire ?
M. Benjamin Maurice. Le système de tarification en place intègre des éléments de qualité et d’incitation au développement de la qualité, notamment grâce au « contrat de bon usage » pour les dispositifs médicaux et les molécules onéreuses, lequel vise justement à intéresser les établissements à l’observation de bonnes pratiques. Ce système a prouvé sa pertinence.
Il est nécessaire d’élargir le champ de l’incitation. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires oblige désormais les établissements à diffuser des indicateurs sur les prises en charge, les infections nosocomiales ou la sécurité des interventions. C’est une bonne chose. Le ministère de la santé établit également des indicateurs de référence par rapport auxquels les établissements peuvent se positionner.
Le système intègre donc déjà la qualité. Est-il besoin d’aller plus loin ? Certainement, mais dans un premier temps, je pense qu’il faut laisser les établissements appliquer les dispositions de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. La qualité est un élément d’efficience, un outil de pilotage interne et de comparaison entre établissements, et un élément d’appréciation pour les patients. Il faut qu’ils puissent identifier les établissements proposant les interventions les plus sûres et le risque le moins élevé d’infections nosocomiales. Outre l’incitation tarifaire, qui existe déjà, il faudrait prévoir des dispositifs plus ancrés. Le ministère de la santé et la Haute Autorité de santé sont en train de développer de tels dispositifs, qui seront bientôt imposés aux établissements.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Vous considérez donc que la qualité est un objectif partagé, qui n’a pas besoin d’être rémunéré de façon spécifique.
M. Benjamin Maurice. C’est un présupposé. Il existe à ce titre deux écoles : l’incitation positive et le mécanisme de sanctions, qui est inclus dans le contrat de bon usage. Il est indéniable qu’il faut encourager les établissements à offrir la plus grande qualité possible, parce que tout le monde y gagne.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Nous vous remercions.
*
AUDITION DU 30 MARS 2010
Audition de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports.
M. le coprésident Pierre Morange. Nous avons le plaisir d’accueillir ce matin Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, dans le cadre de nos travaux sur le fonctionnement de l’hôpital.
À travers l’examen de cas concrets, notre Mission cherche à tirer des préconisations concernant les missions de l’hôpital telles qu’elles sont définies dans la loi la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires que vous avez portée, madame la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports. L’hôpital public emploie un million de personnes et le secteur hospitalier représente dans son ensemble 71 milliards d’euros de dépenses d’assurance maladie par an.
L’hôpital est au cœur de la vie de nos cités. Il évolue, se modernise et s’adapte aux enjeux de demain et ces évolutions sont attendues non seulement par les patients mais aussi par les professionnels de santé. Les défis que l’hôpital doit relever sont très nombreux : vieillissement de la population, développement des maladies chroniques et de la dépendance, intégration de très importants progrès technologiques, évolutions des demandes des usagers et de leurs familles, tous éléments qui modifient les prises en charge.
Nous voulons relever ces défis en poursuivant les réformes engagées puisque se moderniser, c’est d’abord mieux concilier la qualité des soins et l’efficacité de leur organisation.
J’ai, de par ma fonction de ministre de la santé, la responsabilité de garantir à tous les Français l’accès à des soins de qualité tout en maîtrisant les dépenses engagées. J’entends assumer cette responsabilité en cherchant l’équilibre entre deux objectifs impondérables : la santé publique et la responsabilité financière, ce qui suppose d’inscrire toutes mes actions dans la durée et la cohérence.
L’action publique s’inscrit dans le long terme. De ce point de vue, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires à laquelle vous avez fait allusion, M. Morange, a marqué une étape essentielle puisqu’elle va permettre de mettre en place le cadre de fonctionnement des établissements de santé pour au moins une décennie.
Les problématiques en matière de santé ont évolué, ce qui nous impose d’avoir une vision prospective. Les soins seront de plus en plus individualisés : ils seront non seulement adaptés à l’âge et à la pathologie du patient mais également à ses souhaits, à son environnement et même à son profil génétique – comme on le voit déjà en cancérologie. Les progrès de l’imagerie et des techniques interventionnelles font reculer la chirurgie invasive et les anesthésies complètes. Les systèmes d’information – dont nous favorisons le développement – permettent un suivi à distance en liaison avec les professionnels libéraux et les outils de télémédecine se déploient jusqu’au domicile des patients.
La loi la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires répond à ces nouvelles problématiques en favorisant de nouvelles formes d’organisation, des coopérations entre plusieurs hôpitaux qui, à l’échelle d’un territoire, d’une région, parfois même d’une interrégion, offrent une palette de soins graduée du plus simple au plus technique. Les établissements publics mutualisent et devront de plus en plus mutualiser leurs ressources et leurs compétences pour apporter une réponse adaptée aux besoins de nos concitoyens. C’est le sens des communautés hospitalières de territoire et des groupements de coopération sanitaire, qui vont permettre d’opérer des recompositions et d’offrir des complémentarités médicales.
Le dynamisme des hôpitaux publics passe par un pilotage renforcé autour d’un projet médical. J’insiste sur le mot « médical » car il est consubstantiel à un projet hospitalier. La loi permet d’avoir un responsable et un décideur unique à l’hôpital : le directeur qui, recruté selon des modalités professionnalisées et formé aux techniques managériales, dispose d’une plus grande autonomie et d’une plus grande souplesse de gestion.
La rénovation du cadre d’exercice des médecins est essentielle. J’ai voulu, là aussi, assouplir les statuts et créer des passerelles.
Les personnels hospitaliers doivent être également mieux associés aux évolutions de l’hôpital. La France est sans doute le seul pays d’Europe où il existe de telles frontières de compétences entre les personnels soignants et les médecins. Je veux y remédier. La levée de ces frontières, d’une part, permettra des soins efficients et, d’autre part, répondra aux aspirations des personnels.
Pour garantir la qualité des soins – ce qui est le fil rouge de mon action ministérielle –, les professionnels de santé doivent être mieux formés.
Nous devons, par ailleurs, renforcer l’attractivité des carrières à l’hôpital. Je veux également, avec le ministère de l’enseignement supérieur, encourager la recherche et l’enseignement.
En décidant d’appliquer le dispositif Licence-Master-Doctorat (LMD), j’ai voulu valoriser les professionnels paramédicaux, leur ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles, créer de nouveaux métiers et permettre une délégation plus large des actes.
Les difficultés que nous connaissons en matière de démographie médicale – je suis reconnaissante, à ce sujet, au Président de la République d’avoir inscrit cette question comme une des priorités de la seconde partie de son quinquennat –, nous invitent à recentrer les médecins sur leur cœur de métier pour libérer du temps médical, en ville comme à l’hôpital.
Afin d’améliorer la continuité des soins, j’ai donc souhaité que les personnels paramédicaux soient mieux reconnus et puissent assumer une plus grande part de soins dans les domaines de la rééducation, de l’action thérapeutique, de la prévention et de la coordination d’accompagnement. Ils le méritent et nous avons besoin d’eux. C’est une stratégie gagnant-gagnant.
Nous sommes à J–2 de la création des agences régionales de santé (ARS) qui sont la clé de voûte de la loi. Je suis très heureuse de venir devant votre Mission à quelques heures de ce lancement.
En matière hospitalière, les agences régionales de santé vont entraîner deux changements.
D’une part, elles vont unifier le pilotage de l’offre de soins ambulatoires hospitaliers et médico-sociaux, ce qui devrait faciliter la sortie de ce que certains ont appelé l’hospitalo-centrisme au profit de l’intégration de l’hôpital dans un projet territorial permettant de prendre en compte l’amont et l’aval de celui-ci.
D’autre part, les agences régionales de santé vont enrichir le suivi de l’hôpital, qui ne va plus se limiter à une juste répartition de l’offre de soins hospitaliers sur un territoire mais qui va désormais inclure la performance de l’hôpital, de la qualité des soins aux résultats financiers. Le pilotage de la performance de l’hôpital va donc être renforcé.
La création des agences précédera de quelques jours, pour ne pas dire de quelques heures, la publication des textes sur la gouvernance des établissements publics de santé, laquelle donnera le coup d’envoi de la mise en place de la réforme dans les hôpitaux.
La création des agences régionales de santé et la mise en place de la gouvernance hospitalière sont deux piliers de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Il faut se réjouir que la réforme progresse.
Parallèlement à l’action publique, j’ai souhaité mettre en œuvre un autre chantier, lui aussi de longue haleine : celui du financement de l’hospitalisation, socle fondamental reposant sur un certain nombre de leviers contenus dans la loi. Sans une analyse de ce socle, on ne peut comprendre ni l’évolution passée ni l’évolution à venir de l’organisation du fonctionnement de notre hôpital.
Un système de financement adapté est un système qui garantit la performance globale de l’hôpital – entendue comme la conjonction d’un haut niveau de qualité et de sécurité des soins – et une exigence d’efficience médico-économique.
La mise en place, en 2004, de la tarification à l’activité (T2A) comme outil de financement des établissements de santé, publics et privés, a constitué une réforme majeure et structurante qui a répondu aux objectifs de mes prédécesseurs. Elle a institué un financement plus équitable, lié à la production effective de soins – ce qui évite les rentes de situation et donne aux établissements des moyens cohérents par rapport aux coûts constatés – ; un financement qui permet de mieux accompagner les innovations scientifiques et techniques – notamment grâce à l’instauration d’une liste de médicaments et de dispositifs médicaux facturés en sus des tarifs – ; un financement, enfin, plus responsable qui a modifié la culture hospitalière en lui imposant un pilotage des recettes et une recherche d’efficience.
Dans leur très grande majorité, les professionnels ne remettent pas en cause les principes de la T2A. Ils lui reconnaissent de nombreuses vertus car ils sont conscients qu’elle a pour objet une juste et pertinente répartition des ressources hospitalières disponibles. D’ailleurs, quand on demande à certains professionnels qui critiquent la T2A, ou certains aspects de cette tarification, s’ils souhaiteraient revenir au système précédent, il est amusant de constater qu’ils répondent vivement par la négative : ils en connaissent trop les effets pervers.
On peut d’ailleurs remarquer que l’instauration de la T2A n’a pas eu d’effet sur l’enveloppe globale destinée à l’hôpital. Les ressources hospitalières n’ont pas baissé. Elles dépendent toujours du niveau de l’Objectif national des dépenses de l’assurance maladie (ONDAM) voté chaque année par le Parlement et qui croît chaque année de façon beaucoup plus importante que la richesse nationale. Il a encore progressé de 2,8 % en 2010, c’est-à-dire de deux milliards d’euros par rapport à 2009.
Il est important de rappeler que notre pays consacre une part importante de sa richesse nationale à sa santé.
La T2A est montée en puissance progressivement, sur plusieurs années, dans le respect des établissements, afin de lisser les effets redistributifs. Cependant, je ne méconnais pas ses conséquences : il y a eu des gagnants et des perdants. Si la T2A est appliquée à 100 % depuis 2008, les effets redistributifs liés à ce taux d’application ne sont pas encore pleins et entiers. Une période de transition est prévue jusqu’en 2012 pour permettre aux établissements publics et privés de disposer d’un temps suffisant d’adaptation.
La T2A n’est pas un modèle figé : elle s’adapte d’année en année dans l’optique de gagner en précision et en justesse dans l’allocation des financements aux établissements de santé.
Les deux dernières années ont été marquées par des évolutions importantes.
Par l’introduction d’une nouvelle version des tarifs hospitaliers, appelée V11, je veux à la fois mieux financer les séjours des patients atteints d’une pathologie lourde et prendre en compte les surcoûts liés à la prise en charge des patients en situation de précarité.
Les modes de financement de la permanence des soins hospitaliers ont été également modifiés afin de mieux cibler les établissements qui prennent en charge ce coût.
Les missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) ont été réévaluées en 2008 et consolidées en 2009. Il a été proposé un nouveau modèle de financement des missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI).
La complexité du fonctionnement de l’hôpital et, notamment, la multiplicité des missions et des activités mises en œuvre ne permettaient pas d’obtenir un financement parfait dès la première année. L’un des enjeux des prochaines années est de trouver un compromis entre raffinement des règles de financement et demande de stabilité : on ne souhaite rien de moins, en effet, qu’un modèle de plus en plus juste et de plus en plus stable dans un milieu en perpétuel changement, ce qui est un peu paradoxal.
Pour répondre à cette demande de stabilité des professionnels, la campagne tarifaire 2010 s’emploiera à consolider les évolutions antérieures et ne comportera pas d’évolution systémique de grande ampleur.
Des améliorations seront apportées.
J’ai décidé d’augmenter de 50 % l’enveloppe de prise en charge des personnes en situation de précarité. La lutte contre les inégalités en matière de santé est, vous le savez, un des fils rouges de ma politique.
Des chantiers importants nous attendent dans les années à venir. Je pense tout particulièrement à l’élargissement du champ d’application de la T2A aux secteurs d’activité qui en avaient été exclus en 2004 : les soins de suite et de réadaptation (SSR), la psychiatrie, les hôpitaux locaux. Dans aucun de ces secteurs, le modèle cible n’a encore été appliqué. J’entends lancer une très large concertation avec les professionnels concernés car je veux me conformer à la méthode de travail qui a guidé les évolutions antérieures.
Un système de financement adapté doit également garantir l’efficience médico-économique des acteurs.
Le Président de la République avait réaffirmé, vous vous en souvenez, la nécessité pour nos hôpitaux publics de revenir à l’équilibre financier d’ici à 2012. Cet objectif a été fixé dans l’intérêt même des établissements concernés : aucun hôpital ne peut accumuler durablement les déficits sans remettre en cause son existence sur le long terme. Le retour à l’équilibre est une condition de la pérennité de nos établissements de santé. Une situation financière saine est indispensable pour continuer à mettre en œuvre des projets nouveaux et pour investir dans des bâtiments neufs ou dans des équipements biomédicaux de pointe.
Le déficit de l’hôpital n’est pas une fatalité. Des résultats encourageants ont été obtenus au cours des deux dernières années. Le déficit global des hôpitaux a ainsi décru de près de 90 millions entre 2007 et 2008. La même tendance doit être observée entre 2008 et 2009. Les premiers chiffres sont très encourageants.
En 2008, 61 % des établissements publics de santé étaient à l’équilibre ou en excédent. Les 39 % qui étaient encore en déficit ne l’étaient pas tous dans les mêmes conditions, la majorité de ce déficit étant concentré sur un nombre très limité d’établissements qui n’avaient pas su procéder aux réformes de gestion nécessaires.
Les difficultés budgétaires sont le plus souvent dues à une mauvaise utilisation des moyens alloués, cette mauvaise utilisation étant elle-même liée à une organisation inadaptée. Je récuse l’idée selon laquelle les déficits auraient pour origine l’insuffisance des ressources allouées aux hôpitaux. De ce point de vue, la tarification à l’activité a joué le rôle de révélateur de la lourdeur de certaines organisations internes et du manque de productivité de certains hôpitaux. Cette situation est elle-même liée, très souvent, à un déficit de pilotage. C’est pour tenir compte de cette grande diversité de situation que la politique que je conduis depuis maintenant trois ans s’est matérialisée à la fois par une fermeté dans la fixation des objectifs, un suivi des résultats obtenus et une confiance dans la capacité des acteurs à relever le défi, capacité que j’ai encouragée par un accompagnement méthodologique et financier. Je n’ai jamais « laissé tomber » les acteurs qui s’impliquaient dans cette démarche.
Les bons résultats obtenus sont donc à mettre au crédit à la fois d’une plus grande responsabilisation des établissements, permise par la tarification à l’activité, et d’une mobilisation des services du ministère. Les deux se sont donné les moyens et les outils pour mener à bien cette politique.
Un cadre juridique adapté à la mise en œuvre de l’objectif fixé par le Président de la République a été mis en place, avec l’obligation de conclusion d’un contrat de retour à l’équilibre quand l’établissement connaît une situation financière dégradée, ou la possibilité de mise sous administration provisoire quand la situation est vraiment très détériorée et que les mesures de redressement n’ont pas été mises en œuvre ou ont échoué. C’est ainsi que 238 établissements se sont engagés dans une procédure de retour à l’équilibre, ce qui représente une proportion bien supérieure à celle qu’implique l’application des critères de dégradation financière contenus dans le décret du 27 juin 2008. Cela prouve qu’il y a eu une démarche d’anticipation de la part d’un certain nombre d’établissements, signe qu’une autre culture prévaut à l’hôpital : une culture de prévention, complément indispensable de l’action curative. Cela vaut pour la médecine comme pour la gestion.
Les établissements ne sont pas seuls. Le ministère les a accompagnés tout au long du processus. Les agences régionales de l’hospitalisation (ARH) ont vu leur marge de manœuvre budgétaire augmenter de 100 millions d’euros pour aider les établissements qui devaient être aidés. Cet accompagnement budgétaire, quantitatif, s’est doublé d’un accompagnement qualitatif, méthodologique, d’aide à la réorganisation parce que seules les réformes de structure sont de nature à dégager avec pertinence des marges de manœuvre pour assurer le rétablissement durable de la situation budgétaire d’un établissement. Si l’on se contente de donner de l’argent et qu’on laisse perdurer les mécanismes délétères qui ont causé le déficit, on ne règle rien et la situation financière de l’établissement de santé se dégradera à nouveau. Le retour à l’équilibre est indispensable à l’exercice des missions de l’hôpital au service des patients et à la qualité des soins. Il vise un objectif de qualité de soins plus que d’assainissement comptable.
Cette approche a exigé la création de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux qui a vocation à apporter un soutien méthodologique aux hôpitaux, en s’engageant dans des réorganisations de leurs activités, et à diffuser les enseignements tirés de ces réorganisations. En plus d’aider les établissements de santé, il constitue une sorte de lieu de collecte des bonnes pratiques pour que tout le monde puisse en profiter.
Certains cas particuliers accréditent malheureusement la thèse de l’insuffisance des efforts de gestion des hôpitaux. Mais je veux nuancer cette affirmation et rendre justice aux efforts consentis ces dernières années par la très grande majorité des établissements publics. La conjonction de la politique de retour à l’équilibre des comptes des établissements de santé et du processus de convergence intrasectorielle a contraint les établissements de santé publics et leurs personnels à un effort sans précédent de rationalisation de leurs organisations et de leurs coûts. Bien qu’il reste encore insuffisant, il faut reconnaître cet effort à sa juste hauteur et à sa juste valeur. Je souhaite que les établissements de santé entendent les paroles de reconnaissance que je leur adresse.
Je veux impulser une politique hospitalière ambitieuse, responsable, réaliste. Elle doit être responsable parce qu’elle doit permettre de maîtriser les dépenses de santé pour préserver notre système hospitalier. Elle doit également être ambitieuse parce qu’elle porte une vision moderne de l’hôpital de demain. Les évolutions étant lourdes, elles doivent être anticipées plusieurs années à l’avance.
Les patients et les professionnels de santé verront ainsi leurs besoins et leurs aspirations mieux pris en compte. L’ambition d’articuler étroitement la qualité des pratiques et l’efficacité économique est au cœur de la politique que je veux mener au service du système hospitalier de notre pays.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Je vous remercie, madame la ministre, pour ce propos introductif.
Par l’étude de cas précis, notre Mission essaie de saisir, autant qu’elle le peut – je ne suis pas, personnellement, praticien de ce secteur – la réalité du fonctionnement de l’hôpital sur le terrain, ce qui m’amène à vous poser quelques questions.
Vous tablez sur un retour à l’équilibre financier des hôpitaux à l’horizon 2012. Pensez-vous que cet objectif sera atteint ?
J’ai ressenti un décalage assez important entre le système de la T2A mis en place sur le plan national et la situation réelle dans les établissements : absence de système de comptabilité analytique réellement performant, sous-facturation de certaines prestations, systèmes d’information peu homogènes et peu satisfaisants. Malgré leur sophistication et leur affinement régulier, les outils de gestion ne suscitent pas un management aussi efficace qu’on pourrait l’espérer sur le terrain.
Ce phénomène est lié à l’ambiguïté de l’objectif de la T2A : cette tarification est-elle un outil pour mesurer le juste coût des prestations ou pour orienter les activités des établissements de santé ?
Mme la ministre. Contrairement à ce que l’on entend ici ou là, la situation financière des hôpitaux s’est significativement améliorée ces dernières années.
Après une lente dégradation des comptes des hôpitaux jusqu’en 2007, il s’est produit une inversion de tendance en 2008. Le résultat d’exploitation et la capacité d’autofinancement des établissements publics de santé se sont améliorés.
Au niveau national, le déficit du compte de résultat principal s’est établi à 592 millions d’euros en 2008, contre 679 millions en 2007, ce qui représente une amélioration notable. Toujours en 2008, 61 % des établissements réalisaient un excédent à hauteur de 211 millions d’euros et 41 % accusaient un déficit sur leur compte de résultat principal pour un montant de 803 millions d’euros, 11 établissements, dont 9 CHU, concentrant à eux seuls 40 % de ce déficit. Le déficit des Hospices civils de Lyon, par exemple, s’élevait à 94 millions d’euros, celui de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à 58 millions d’euros et celui de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à 20,8 millions d’euros.
Cette amélioration du compte de résultat principal s’explique en partie par une progression plus modérée des charges de personnel – 3,4 % en 2008, contre 4 % en 2007, ce qui montre qu’il n’y a pas de réduction des dépenses de personnel mais une progression plus modérée – et par une progression plus importante des recettes : 4,8 % en 2008, contre 3,4 % en 2007.
La capacité d’autofinancement s’est établie à 3,39 milliards d’euros en 2008 – ce qui correspond à une augmentation de 530 millions par rapport à 2007, soit 18 % d’augmentation – et représente 5,1 % du total des recettes. Cette augmentation s’explique par l’amélioration du résultat d’exploitation et par la dynamique insufflée par le plan Hôpital 2007.
Les premiers chiffres dont nous disposons sur 2009 semblent confirmer cette tendance. Ils doivent être interprétés avec prudence car tous les établissements n’ont pas transmis leurs comptes, mais les chiffres fournis par 1 151 établissements sur 1 674 font apparaître, sous réserve de la validation définitive, une tendance forte à l’amélioration.
Certains établissements très importants ont vu leur situation s’améliorer très significativement. Le déficit des Hospices civils de Lyon est passé de 94 millions d’euros à 79 millions d’euros, celui de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), de 58 à 36 millions d’euros. Je veux saluer les efforts que cela représente pour les gestionnaires et l’ensemble de la communauté hospitalière.
Certains établissements marquent une tendance inverse. En particulier l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) devrait voir passer son déficit de 20 à 96 millions d’euros, creusant ainsi de 67 millions d’euros le déficit national, ce qui témoigne de la nécessité de procéder à des réorganisations, d’autant que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris bénéficie d’un rebasage particulièrement favorable.
La dynamique et les résultats obtenus depuis 2007 permettent d’espérer un retour à l’équilibre en 2012.
On constate une prise de conscience de la part des acteurs de l’hôpital. Ces derniers ont compris que l’objectif de retour à l’équilibre était dans leur intérêt. Cette prise de conscience est à mettre au compte de la tarification à l’activité, associée à la mise en œuvre progressive de l’organisation en pôles et de la délégation de gestion inhérente à cette organisation, qui ont permis la diffusion d’une culture médico-économique.
Nous assistons vraiment à un mouvement de fond, si bien que les risques d’un retour en arrière me paraissent extrêmement limités.
Si nous parvenons à garantir aux hôpitaux un certain taux de progression de leurs ressources dans les prochaines années, j’estime que le retour à l’équilibre en 2012 est à notre portée. Je vais être extrêmement vigilante sur cet objectif, qui m’a été fixé par le Président de la République.
Nous souhaitons, bien entendu, améliorer le management médico-économique de l’hôpital. Cela passe par la clarification de la gouvernance, dont nous avons abondamment parlé, et par le renforcement de la compétence du pilotage des établissements, notamment par le développement des outils de la comptabilité analytique et, plus largement, du contrôle de gestion. Ces outils sont indispensables pour évaluer l’activité, la gestion, analyser les coûts, les écarts et tirer les conclusions qui permettent de prendre de bonnes décisions en termes de sécurité, de qualité, de performance de prestations.
La direction générale de l’offre de soins (DGOS), qui remplace la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), conduit actuellement, avec l’ensemble des acteurs de la comptabilité analytique hospitalière, un chantier visant à accélérer le processus de généralisation de la comptabilité analytique dans les établissements de santé. Cela introduira une plus grande lisibilité et une plus grande pertinence dans le dispositif qui encadre la comptabilité analytique hospitalière. Nous débuterons par une harmonisation des outils et des méthodes de calcul des coûts, attendue à la fois par l’hôpital et par les éditeurs des systèmes d’information, qui pourront ainsi proposer des logiciels de gestion adaptés. Une mission d’appui et d’accompagnement au changement est conduite par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux afin de promouvoir le renforcement des compétences en matière d’analyse et de prise en compte des résultats de gestion dans le pilotage stratégique et opérationnel des établissements.
La T2A doit-elle être utilisée pour rémunérer les actes au juste prix ou pour réorienter l’offre ? Elle doit faire les deux, même si la conciliation des deux objectifs peut paraître complexe. Je ne méconnais cependant pas les difficultés.
Un tarif, c’est à la fois la compensation d’une charge supportée par l’établissement, l’évaluation du prix d’une prestation de soins existante ou à venir dans le cadre d’une innovation, un instrument incitatif – je l’ai utilisé pour la chirurgie ambulatoire et les soins palliatifs – et une modalité de répartition d’une ressource allouée par le Parlement dans le cadre général de l’ONDAM.
La construction des tarifs se fait en trois étapes – tarifs bruts, tarifs repères et tarifs de campagne – et permet de fonder le calcul de ceux-ci sur les coûts observés dans chacun des secteurs en soutenant certaines activités au titre des politiques de santé publique, tout en prenant en compte les revenus qui peuvent être ainsi produits.
La dimension « juste prix » est présente dans la construction tarifaire lorsque nous partons, entre autres, des éléments qui nous sont fournis par l’étude nationale de coûts à méthodologie commune.
La dimension « réorientation de l’offre » est également présente. Le mode de financement est en effet structurant. Dans un dispositif T2A, les acteurs économiques réagissent en faisant des choix orientés vers le développement d’activités qui correspondent à un besoin effectif. Une baisse de tarif peut répondre à la régulation d’une activité qui ne répond plus aux besoins de la population. A contrario, l’instauration de tarifs adaptés favorise la création d’une offre et le développement d’activités nécessaires. Je citerai à cet égard trois exemples.
La chirurgie ambulatoire – domaine où la France accuse un grand retard par rapport à d’autres pays comme le Danemark où elle est pratiquée pratiquement à 80 % – a fait l’objet de mesures incitatives dans le cadre de la T2A : rapprochement des tarifs des groupes homogènes de malades (GHM) correspondants avec ceux des mêmes prestations en hospitalisation complète. L’analyse de l’évolution des séjours confirme une tendance à la hausse des séjours de chirurgie ambulatoire et, corrélativement, une tendance à la baisse des GHM homologues en hospitalisation.
La notion de soins palliatifs, à laquelle je suis, comme la représentation nationale, très attachée, a été reconnue au plan financier et la création de structures correspondantes a été favorisée via des tarifications incitatives.
L’activité de transplantation d’organes s’est vue octroyer des financements spécifiques qui favorisent une organisation des prélèvements et des greffes.
Même si ce n’est pas facile, je veux continuer sur cette base.
M. Jean-Pierre Door. J’apporterai tout d’abord un témoignage qui confirme les progrès réalisés en matière d’équilibre hospitalier.
Lors de l’inauguration, qui a eu lieu hier, d’un service de médecine psychiatrique et d’un service de médecine générale dans ma circonscription – service de médecine générale que vous avez d’ailleurs visité, madame la ministre –, l’ancien directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation m’a confirmé que, pour toute la région, l’équilibre était plus qu’atteint : la majorité des établissements, y compris le CHU, sont en excédent. Deux petits hôpitaux posent encore quelques problèmes de retour à l’équilibre mais, sur la région, le service hospitalier fonctionne bien, ce dont on ne peut que se réjouir.
Ma première question concernera le nombre d’hôpitaux en France, qui est de 3 000 et quelques. N’y a-t-il pas trop d’hôpitaux en France ? L’Allemagne n’en compte qu’un peu plus de 2 000.
Par ailleurs, pressés, comme vous, que la T2A fonctionne bien, nous avons été nombreux à regretter que la convergence des tarifs public-privé soit reportée en 2018. Nous avons l’impression d’aller clopin-clopant et voudrions aller plus vite. Qu’en pensez-vous ?
Ma troisième question portera sur le fonctionnement des services hospitaliers. L’entrée à l’hôpital et la sortie de celui-ci posent encore des difficultés, si bien qu’il y a des embouteillages en amont comme en aval. Comment peut-on remédier à ces dysfonctionnements ?
Ma quatrième question concernera les missions d’intérêt général – je laisse de côté, pour l’instant, l’aide à la contractualisation. Les missions d’intérêt général sont, comme l’a souligné la Cour des comptes, très variables d’un centre hospitalier à l’autre puisqu’elles représentent entre 8 % et 20 % de leurs activités. Il peut s’y ajouter, à votre demande, madame la ministre, ou à celle du Président de la République, le lancement de plans, comme le plan « cancer ». Cela risque de déséquilibrer l’ONDAM si des financements supplémentaires ne sont pas prévus. Comment faire pour répondre aux demandes prioritaires de l’État et respecter l’ONDAM ?
Ma dernière question portera sur la mission présidée par M. Jean-Pierre Fourcade que vous avez mise en place sur le suivi de la réforme de l’hôpital : qu’en attendez-vous ?
Mme Catherine Génisson. Je commencerai, comme M. Jean-Pierre Door, par apporter un témoignage. J’étais de garde, dimanche dernier, à l’hôpital d’Arras dans le cadre du SAMU-centre 15 et je dois dire qu’il existe un décalage entre le vécu des professionnels de santé à l’intérieur de l’hôpital public et le tableau que vous en avez brossé.
L’équilibre financier des hôpitaux pourra être atteint en 2012, soit par une diminution arbitraire des dépenses, soit par une augmentation, ce qui serait extraordinaire, des recettes.
L’hôpital public vit aujourd’hui non seulement une diminution de ses dépenses, mais également la révision générale des politiques publiques, laquelle se traduit par le non-remplacement de certains personnels. Des coupes sombres sont actuellement opérées, et ce de manière arbitraire entre les personnels soignants et non soignants. Cette question mériterait d’être regardée de manière attentive.
La T2A en tant qu’outil d’orientation ne défend pas toujours les bonnes causes : elle pousse parfois à privilégier les activités dites rentables. Un grand nombre d’hôpitaux abandonnent certaines pratiques, non parce qu’elles sont inutiles, désuètes ou n’ont plus lieu d’être, mais parce qu’elles ne sont pas rentables, ce qui provoque parfois le report de celles-ci sur de grands établissements qui voient ainsi se creuser leur déficit. La T2A en tant qu’outil d’orientation nécessiterait un encadrement très fort afin que l’hôpital public n’abandonne pas sa fonction essentielle, qui est d’accueillir tout le monde.
J’ai toujours été perplexe sur la définition des missions d’intérêt général. Je pense qu’elle devrait être beaucoup plus précise.
Malgré les améliorations que vous avez apportées avec la V11, il me semble nécessaire d’affiner encore l’analyse afin de prendre en compte, non seulement les situations de précarité, mais encore la situation sociale de tous les patients accueillis à l’hôpital public.
Tout en reconnaissant les progrès réalisés en matière de chirurgie – il fallait, en effet, plus parler de désorganisation que d’organisation des blocs opératoires –, je tiens à faire remarquer que ce ne sont pas les mêmes patients qui sont accueillis à l’hôpital public et en chirurgie ambulatoire. Tout ce qui est ambulatoire est basé sur la responsabilisation du patient et de son entourage. Or, force est de constater qu’on est souvent contraint de garder des patients à l’hôpital public car, faute d’une organisation adéquate de l’aval, comme l’a souligné M. Jean-Pierre Door, on ne peut pas renvoyer rapidement les patients chez eux.
Enfin, je précise que cela fait longtemps que la gestion médico-économique est consubstantielle au fonctionnement des professionnels de santé à l’intérieur de l’hôpital public.
Mme la ministre. Compte-t-on trop d’hôpitaux dans notre pays ? Question ontologique ! Une évaluation objective du maillage hospitalier français montre en effet qu’il est le plus dense du monde, ce qui représente moins une charge qu’une chance. Dans le contexte de difficultés que connaît la démographie médicale et du fait de l’exigence de décloisonnement, l’hôpital de proximité constitue un élément fondamental auquel peut s’adosser la médecine de premier recours. Cela exige des évolutions du tissu hospitalier car on ne pourra pas tout faire partout. C’est pourquoi, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit les indispensables concepts de gradation des soins et de coopération entre établissements. On voit clairement se dessiner l’évolution de l’hôpital vers des équipements techniques extrêmement perfectionnés, des hospitalisations courtes, assurées par des personnels de plus en plus spécialisés, pouvant aller jusqu’à une centaine de personnes autour d’un plateau chirurgical performant. L’image du chirurgien qui effectue seul, dans un petit hôpital local, toutes les prestations est aujourd’hui révolue. Il faut une gradation des soins, selon laquelle l’hôpital de proximité, absolument nécessaire pour garantir l’offre de soins, doit traiter les urgences, les soins courants et les soins post-aigus. On ne peut donc pas dire, d’une façon technocratique et inhumaine, qu’il y a trop d’hôpitaux dans notre pays.
Le report de la convergence à 2018 traduit, là encore, le refus d’une vision technocratique imposant une évolution à marche forcée. La convergence ne signifie pas l’égalité, mais l’évaluation des charges spécifiques imposées aux établissements, ainsi que le permet l’introduction dans la V11 de facteurs correctifs tenant compte de la sévérité des pathologies et de la situation de précarité des patients. À charges égales, rémunérations égales, mais à charges différentes, rémunérations différentes. J’ai donc reporté la convergence dans l’attente de l’évaluation des contraintes des établissements, d’ailleurs déjà étudiées par une mission parlementaire.
Le décloisonnement devrait permettre, en amont, de mieux gérer l’entrée des malades à l’hôpital et, en aval, de mieux les orienter à leur sortie car, aujourd’hui, certains d’entre eux restent hospitalisés faute de solution thérapeutique au dehors. On constate aux urgences un afflux important de malades qui n’ont pas vu préalablement de généraliste. Or dix-sept millions de personnes sont passées par les urgences à l’hôpital en 2008. Des mesures ont été prises afin d’améliorer la prise en charge de soins non programmés et de soulager ainsi les urgences hospitalières. La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires rénove le dispositif de la permanence de soins en créant une obligation pour les médecins libéraux d’assurer cette mission de service public dans le cadre de leur activité, et selon l’organisation définie par les directeurs généraux des agences régionales de santé, qui transmettent les informations nécessaires aux préfets. Elle réaffirme le rôle essentiel de la régulation médicale préalable dans le système de prise en charge des soins de premier recours en faisant du « 15 » le numéro national d’appel. Un médecin libéral peut assurer la permanence d’un centre « 15 » hébergé par un établissement de santé. Cette régulation sert de premier filtre pour réorienter éventuellement le malade vers la médecine de ville. Le développement des maisons médicales de garde offre une autre alternative à l’urgence hospitalière tout en s’appuyant sur les structures de l’hôpital, comme le recommande la circulaire ministérielle de 2007.
L’organisation de la permanence des soins, sous l’égide du directeur général de l’agence régionale de santé, fera l’objet d’un suivi particulier, dont un des indicateurs de performances pourrait être l’évolution du taux de passage aux urgences en première partie de nuit. Cette mise en place, dans le cadre des établissements hospitaliers, poursuit trois objectifs : l’accès permanent aux soins urgents, l’optimisation de la ressource médicale et paramédicale et, enfin, l’efficience du dispositif. Son organisation sera territoriale, pilotée par les agences régionales de santé sur la base des schémas régionaux d’organisation des soins (SROS) qui intègrent aussi la médecine ambulatoire.
Le coût des gardes et des astreintes médicales a été retiré des tarifs en 2009 afin de constituer une enveloppe MIGAC permettant aux agences régionales de santé de rémunérer directement les établissements en fonction de leur prise en charge effective de la permanence des soins hospitaliers. L’enveloppe s’élève à un montant annuel de 760 millions d’euros en année pleine.
La création des agences régionales de santé vise aussi à décloisonner les secteurs social et médico-social. Le taux d’occupation de la médecine-chirurgie et gynécologie-obstétrique (MCO) en court séjour dans notre pays est l’un des plus faibles d’Europe. Il existe donc des capacités de réorganisation importantes, qui se situent au centre des objectifs de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Les marges étant considérables en ce domaine, nous avons créé des outils tels que celui de la fongibilité asymétrique, qui entraînera les réorganisations vers les soins post-aigus, c’est-à-dire là où sont les besoins.
Les missions d’intérêt général de l’hôpital sont-elles perturbées par les plans de santé publique ? Elles sont bien davantage menacées par les déséquilibres budgétaires des établissements car, en situation de déficit, la tentation est de compenser les insuffisances financières par les dotations au titre des missions d’intérêt général, qui servent alors de variables d’ajustement. Nous nous efforçons de garantir l’équilibre entre la partie qui relève des missions d’intérêt général et la partie tarifaire, dans le respect de l’enveloppe globale de l’ONDAM, qui progresse plus vite que la richesse nationale et qui intègre les mesures nouvelles, lesquelles représentent 2 milliards d’euros, alors que les plans de santé publique s’élèvent à 500 millions d’euros. Du fait de leur caractère pluriannuel, la première année d’application de ceux-ci est financièrement blanche. En outre, les actions de prévention ou d’amélioration des prises en charge qu’ils comportent correspondent à des stratégies à terme gagnantes au niveau de l’hôpital public. Ils constituent enfin des démarches de réorganisation mobilisant des moyens souvent déjà existants. Leur « mise en péril » des missions d’intérêt général est donc pour le moins à relativiser.
La mission « Fourcade » pourrait tout aussi bien s’appeler mission « Door » puisque vous y représentez, monsieur le député, l’Assemblée nationale. Elle a été installée à la fin du mois de janvier 2010, en application des dispositions prévues par l’article 35 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Elle correspond aussi aux nouveaux pouvoirs conférés au Parlement. Elle a pour objet l’évaluation de la mise en œuvre du titre Ier de la loi, relatif à la modernisation des établissements de santé et visant notamment leurs missions, leur statut, la coopération hospitalière et le rôle joué par les agences régionales de santé. Son rapport doit être remis deux ans après la promulgation de la loi, soit le 20 juillet 2011. Mais, avant cette date, je serai attentive à tout rapport d’étape ou compte rendu provisoire de nature à fournir un outil de pilotage du suivi de l’application de la loi.
Les termes employés par Mme Catherine Génisson ne me permettent pas de reconnaître la réalité.
Non seulement les dépenses hospitalières ne diminuent pas, mais elles augmentent nettement plus vite que la richesse nationale, ainsi réorientée pour partie vers la santé publique. Dans ce domaine, les dépenses sont illimitées. Elles seraient toujours insuffisantes quand bien même elles atteindraient 100 % de la richesse nationale.
La France figure parmi les trois pays au monde qui consacrent à la santé la part la plus élevée de leur revenu national. Elle est celui dont le niveau des dépenses hospitalières est le plus fort par habitant. Les charges de personnels ne subissent pas de coupes sombres. Le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ne touche pas le secteur hospitalier. Le retour à l’équilibre financier des hôpitaux est obtenu par tous moyens : les ajustements d’effectifs n’interviennent qu’à la marge. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas diminué au cours des dernières années : ils ont même progressé de 11,4 % en dix ans.
L’observation de l’évolution des différents secteurs financés par l’Assurance-maladie montre que le secteur médico-social occupe une place de plus en plus importante, ayant créé 20 000 emplois en 2008, quand, dans le même temps, le secteur hospitalier en créait 5 000. Le phénomène va s’accélérer. Globalement, notre système de santé embauche. Le chômage ne touche pas les métiers médicaux et paramédicaux. Dans notre société en pleine mutation, quel autre secteur d’activités crée-t-il autant d’emplois, peu qualifiés comme très qualifiés, partout dans le monde et dans tous les départements français ?
La T2A ne conduit pas à privilégier les activités rentables de l’hôpital puisque son mécanisme empêche qu’elles le restent, du fait de l’ajustement continu des tarifs à la réalité des coûts. En outre, les activités hospitalières ne peuvent être rapidement modifiées et répondent à des besoins qui viennent de l’extérieur. Aucune n’a d’ailleurs vocation à devenir rentable. Un établissement hospitalier qui chercherait à agir dans ce sens commettrait une grave erreur. Les rémunérations doivent correspondre à la réalité des coûts et l’offre correspondre à celle des besoins.
M. le coprésident Pierre Morange. La philosophie de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale est d’optimiser l’usage des deniers publics afin d’assurer des soins de qualité pour tous. Le déficit budgétaire d’aujourd’hui, c’est le risque sanitaire de demain.
La montée en charge des outils de comptabilité analytique et d’urbanisation des plans d’informatisation au sein des hôpitaux répondent à un impératif de partage des connaissances, tant sur le plan budgétaire que sur celui de la gestion prévisionnelle. L’interopérabilité des systèmes informatiques est essentielle. Quel est son agenda de mise en œuvre opérationnelle au sein du parc hospitalier français ?
La France doit rattraper son retard par rapport à d’autres pays dans le domaine de la chirurgie ambulatoire. La réévaluation de celle-ci au sein de la T2A est-elle suffisante pour favoriser la promotion de certaines conduites thérapeutiques ? Ou faut-il encore progresser dans ce sens ? Ou bien cela correspond-t-il à des pratiques culturelles professionnelles qui nécessitent un peu de temps pour être mises en œuvre ? Ou, enfin, est-ce lié à des questions de gouvernance hospitalière dans le cadre de la restructuration des services ?
Mme la ministre. La mise en place d’outils et de pratiques de pilotage pour améliorer la gestion des hôpitaux comprend beaucoup d’éléments : la généralisation de systèmes d’information performants et interopérables, essentiels en vue du décloisonnement, la comptabilité analytique, la chaîne de facturation et de recouvrement, notamment. Existe-t-il encore des marges pour progresser ? L’intervention de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, opérateur de services ministériels, va permettre d’amplifier les efforts déjà accomplis et d’appuyer des projets nouveaux en jouant sur six leviers : l’accompagnement de la transformation d’un établissement, notamment dans le cadre de la gradation des soins au niveau d’un territoire, l’amélioration des grands processus de production « métier », concernant non seulement les soins mais aussi la logistique et la gestion, le développement de parcours innovants d’accompagnement et de prise en charge des patients, l’amélioration de la gestion des ressources humaines et des compétences, l’optimisation des investissements et l’appropriation d’une culture de la performance chez l’ensemble des acteurs, objectif qui se traduit aussi dans les chantiers lancés par la direction générale de l’offre de soins.
À la suite des préconisations du rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires sociales, seront menées des expérimentations de facturation individuelle. Ce sera l’occasion de mettre en avant la nécessité pour l’ensemble des établissements de se préparer à l’enjeu majeur d’une facturation efficace, et de repérer les bonnes pratiques d’organisation afin de pouvoir les généraliser. Dans le cadre de sa mission de pilotage de la performance, la direction générale de l’offre de soins a mis au point un tableau de bord de l’efficience, réalisé par l’Agence technique d’informatisation de l’hospitalisation (ATIH), disponible sur le site du Système national d’information sur l’hospitalisation (SNATIH) et comportant une vingtaine d’indicateurs qui permettent de situer et de comparer les établissements entre eux sur différents champs de la performance : l’insertion de l’établissement dans son environnement, ses finances, son organisation, etc. On mesure pour chacun sa valeur propre, rapportée à celle de la moyenne régionale, de la moyenne nationale et de la moyenne de la catégorie d’établissements auquel il appartient. On dispose ainsi, pour chaque hôpital, d’une vision globale et synthétique de ses performances et de son positionnement. Ce qui favorise le repérage des bonnes pratiques par le ministère, qui peut ensuite en assurer la diffusion.
Par ailleurs, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux déploie de nombreuses opérations sectorielles visant à accroître les performances dans plusieurs établissements en même temps. On peut ainsi procéder à des comparaisons, définir des organisations optimales, selon les principes de capitalisation des expériences et de généralisation de leurs applications.
En dehors des six leviers précités, on relève des démarches vertueuses de certains établissements qui comparent leurs organisations en toute transparence et introduisent des mesures correctrices. Cohabitent ainsi une démarche verticale et une démarche horizontale.
Au niveau régional, les agences régionales de santé, dans leur fonction d’appui et de conseil, apportent aux établissements des compétences et des outils d’adaptation à l’évolution de la demande, qui anticipent aussi les risques, notamment de dégradation financière, et qui font progresser la sécurité et la qualité des soins.
La T2A, par son rôle de structuration de l’offre, est-elle suffisante, compte tenu de ses évolutions, pour développer la médecine et la chirurgie ambulatoires ? Aujourd’hui, 40 % des 13 millions de consultations ambulatoires sont dispensés dans les CHU. La chirurgie ambulatoire n’est donc pas l’apanage des hôpitaux généraux et des cliniques privées : les CHU remplissent aussi une mission d’hôpital de proximité. Le projet de décret sur les conditions d’implantation des activités de soins de médecine et de chirurgie, qui a fait l’objet de concertations approfondies ces derniers mois, prévoit que les établissements autorisés en chirurgie devront développer les deux modalités de prise en charge des malades, en hospitalisation à temps complet et à temps partiel, ce qui permettra d’augmenter la part de cette dernière. La proportion de chirurgie ambulatoire doit en effet progresser : en 2008, elle n’est que de 32 % en France, contre 78 % au Danemark et 79 % au Royaume-Uni. La moyenne française recouvre une grande hétérogénéité au niveau régional, mais montre l’existence de marges de développement. Des mesures incitatives ont donc été prises en faveur de cet enjeu stratégique majeur, s’appliquant aux tarifs, à l’organisation, aux schémas territoriaux et aux établissements. L’Assurance maladie accompagne le mouvement avec, depuis 2008, la mise sous accord préalable. Les régions ont mis en place des plans spécifiques et ont passé des conventions avec les établissements de santé. Après la modulation de la T2A en ce sens, toutes les actions encourageant le développement de la médecine ambulatoire seront encore accrues en 2010 : les incitations tarifaires à travers une meilleure valorisation des séjours concernés, la généralisation de l’activité de chirurgie ambulatoire, l’insertion dans les autorisations de soins de chirurgie de l’obligation d’en réaliser une part en ambulatoire, le développement de centres de chirurgie ambulatoire exclusive, inscrits dans l’offre régionale, le développement d’une politique de qualité et de sécurité car il ne saurait y avoir de chirurgie à deux vitesses, enfin le développement de pratiques efficientes. L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux a inscrit la mission ambulatoire dans ses chantiers d’organisation performante de la chirurgie.
M. le coprésident Jean Mallot, rapporteur. Considérer qu’atteindre l’équilibre financier prouve qu’un établissement fonctionne bien me semble un peu rapide. Vous nous avez dit que la situation financière des hôpitaux s’était améliorée, mais à quel prix ? Parmi les personnels hospitaliers que nous avons entendus ici, tous ne nous sont pas apparus remplis d’aise par l’évolution qu’ils vivent dans les établissements. Comment mieux les associer à la modernisation de l’hôpital, sachant que les dépenses de personnels représentent 70 % du budget et qu’il serait tentant, selon des personnes entendues ici, d’obtenir l’équilibre financier en diminuant ces dépenses à due concurrence ? Or, on ne peut considérer les ressources humaines comme une variable d’ajustement. Comment éviter d’entrer dans ce raisonnement ?
Les tutelles et les contrôles sur les établissements hospitaliers sont nombreux, définissant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent être gérés et adoptant parfois des orientations différentes. Il revient certes à la ministre de procéder aux arbitrages. Mais il reste peut-être des incompréhensions.
Comment s’intéresse-t-on à la pertinence des soins ?
Comment, dans le système d’allocation des ressources entre les hôpitaux, rémunérer la qualité compte tenu de la T2A corrigée ?
Mme la ministre. Nous ne nous préoccupons pas que du financement des établissements. L’hôpital constitue d’abord une communauté de personnes, avec des personnels et des malades. L’enjeu du processus Licence-Master-Doctorat (LMD) est au cœur de l’hôpital de demain. L’amélioration des ressources humaines, point cardinal de ma démarche, implique trois grandes actions.
La première est l’individualisation des parcours professionnels. Historiquement, la gestion des ressources humaines dans la fonction publique hospitalière s’est construite autour de grandes masses d’agents, aux droits et aux rémunérations identiques. Les personnels, qui devraient en être les premiers bénéficiaires, se montrent eux-mêmes parfois réticents au changement de culture en la matière. Mais nous devons combiner l’adaptation de la gestion des ressources humaines aux capacités, aux besoins et aux spécificités des personnels tenant compte des souhaits de chaque agent tout au long de sa vie professionnelle avec le respect des valeurs et du consensus collectif qui touche à l’égalité des fonctionnaires et à la sécurité de leur avancement, principes auxquels je reste attachée. L’évolution que nous voulons passe par le développement de la mobilité et par l’accompagnement des parcours professionnels conformément à la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, par des modes de recrutement plus efficaces, notamment la généralisation des concours sur titres, la reconnaissance de l’expérience professionnelle dans les épreuves de concours, la rénovation des modalités d’évaluation individuelle et la construction de parcours de formation individualisés. L’entretien professionnel et l’entretien annuel de formation sont systématisés, dès 2010. L’ensemble des dispositifs prévus par le décret du 21 août 2008 relatif au droit individuel à la formation et au passeport formation, contribuent aussi à cette évolution, considérablement renforcée par la réforme des études selon le cursus LMD qui va permettre un vrai parcours et offrir de nouvelles perspectives, y compris sur le plan de la rémunération et sur le plan hiérarchique. Après l’institution de la prime de fonction et de résultat (PFR) qui permet de mieux reconnaître la spécificité de chacun dans une logique de gestion individuelle des compétences, la mise en place progressive de la loi d’intégration des personnes handicapées permet de mieux accompagner individuellement l’agent frappé par un drame de la vie.
La deuxième action porte sur le positionnement de la gestion des ressources humaines comme acteur clé en amont des changements, selon le concept des ressources humaines partenaires, et non plus comme une conséquence des changements subis. Le directeur des ressources humaines, dont la formation revêt un caractère essentiel, doit pouvoir produire une connaissance sur la démographie de ses personnels, les caractéristiques des flux dans son bassin d’emploi, l’organisation durable du travail, elle-même productrice et facilitatrice des changements à mener.
La troisième action vise la professionnalisation de la gestion des ressources humaines afin d’organiser, au-delà du suivi des droits statutaires individuels, une architecture de pilotage à tous les échelons de la décision.
La gestion prévisionnelle des métiers a fait l’objet d’un nouveau répertoire publié en 2009, outil de référence intégré dans les programmes pédagogiques de l’École des hautes études en santé publique de Rennes dans le cadre de la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences (GPMC). Les établissements sont incités financièrement à déployer ces méthodes par le biais des crédits du fonds de modernisation des hôpitaux. Des conventions entre les agences régionales de santé et les établissements hospitaliers en vue de développer des démarches de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences s’intègrent maintenant dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
Nous devons faire évoluer les systèmes d’information dans le cadre des ressources humaines et mener des projets d’amélioration de la performance « ressources humaines ». La création de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux participe de cette démarche.
Les exigences réglementaires fixées dans les bilans sociaux des établissements de santé doivent soutenir la transformation des systèmes d’information, initialement conçus pour un suivi statutaire individuel et devant désormais piloter également le dialogue social, ce qui implique un changement de culture.
L’intéressement collectif des personnels hospitaliers est conforme aux valeurs du service public : il convient de mobiliser collectivement les agents autour d’un projet de service qui fait l’objet de discussions, qui constitue un levier de l’amélioration de la qualité du service rendu et de la performance, participant ainsi à la réalisation des politiques publiques.
La démarche humaniste d’amélioration des ressources humaines et de la qualité de l’hôpital ne peut passer par des oppositions entre les catégories de personnels. Des négociations approfondies ont été engagées avec les organisations syndicales en vue de la mise en place de dispositifs d’intéressement sur les trois versants de la fonction publique. Un accord cadre entre l’État et les syndicats de fonctionnaires pourrait ensuite se décliner dans la fonction publique hospitalière. S’agissant de l’accompagnement de la modernisation, dans la mesure où les syndicats ont refusé de signer l’accord cadre, je serais favorable à ce qu’une disposition législative intervienne pour valoriser la performance collective à l’hôpital.
La T2A améliore et valorise la qualité et la pertinence des actes. La quantité de soins inutiles et redondants diminue, les durées de séjour raccourcissent, le rétablissement des malades intervenant plus vite et dégageant ainsi de nouvelles marges pour les hôpitaux.
Elle est complétée à ce titre par la certification des hôpitaux que délivre la Haute Autorité de santé, le renforcement de la transparence par la publication d’indicateurs de qualité prévus par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ainsi que par les travaux de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux.
De nombreuses et récentes publications de presse ont présenté le palmarès des hôpitaux. Leur degré de qualité des soins finit par être connu par le public. Dès lors, les patients « votent avec leurs pieds », se détournant des hôpitaux de proximité trop petits pour assurer convenablement certains soins.
M. le coprésident Pierre Morange. Madame la ministre, nous vous remercions.
*
1 () Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines a indiqué, lors de son audition par la MECSS, avoir transmis, au mois de juillet 2009, le rapport d’inspection établi par ses services sur les marchés publics du Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-German-en-Laye au procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, ledit rapport mettant en évidence des infractions susceptibles de faire l’objet d’une qualification pénale.
© Assemblée nationale