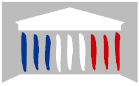N° 2688
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juin 2010.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
préalable au débat d’orientation des finances publiques pour 2011,
ET PRÉSENTÉ
par M. Yves Bur,
Député.
——
RAPPORT 5
1. Une reprise encore timide 8
2. Quelles nouvelles recettes pour les régimes sociaux ? 10
3. L’action sur les dépenses 13
4. La question de la dette 16
TRAVAUX DE LA COMMISSION 19
1. Audition de M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes 19
2. Examen du rapport 47
Le débat d’orientation des finances publiques et, au sein de ce débat, la place qui y est réservée aux finances sociales, apport de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale de 2005 (LOLFSS), font désormais partie intégrante de notre « paysage » institutionnel et financier.
Aujourd’hui plus que jamais, personne ne pourra nier l’utilité d’un examen parlementaire de ces questions au début de l’été, dans la perspective des grands textes financiers de l’automne, et d’une approche globale des finances publiques, incluant donc notamment les finances sociales. Le respect des engagements européens de la France plaidait déjà de longue date en ce sens ; l’organisation gouvernementale mise en place depuis 2007 et confirmée cette année, associant sous la responsabilité d’un même ministre le budget et les comptes publics, est également venue conférer une plus grande unité au pilotage de nos finances publiques. Cela n’empêche évidemment pas de conserver à l’esprit la spécificité des dépenses de sécurité sociale – le plus souvent des prestations versées en application de dispositions légales – ainsi que leur rôle d’amortisseur en période de crise, mais aussi le rôle des partenaires sociaux dans la gestion de la protection sociale.
Dans ce contexte, il apparaît particulièrement significatif que notre débat s’inscrive dans le cadre du nouvel article 50-1 de la Constitution, qui dispose que le Gouvernement peut, devant l’une ou l’autre des assemblées, « faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité ». Ce vote confère, en effet, une solennité toute particulière à l’intervention des Assemblées face à la grave crise que traversent nos finances publiques.
Mais indépendamment de la procédure retenue, le moment choisi chaque année pour ce débat apparaît particulièrement opportun s’agissant plus précisément des finances sociales, et ce pour deux raisons au moins.
D’une part, la Cour des comptes, une semaine après son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques qu’elle a élaboré préalablement au présent débat d’orientation des finances publiques et que son premier président, M. Didier Migaud, a présenté à nos commissions des affaires sociales et des finances le 23 juin dernier, a adopté le 22 juin son rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale pour l’exercice 2009. Comme Philippe Séguin, alors premier président, l’avait rappelé l’année dernière devant votre commission des affaires sociales, la certification, au-delà de son caractère en apparence très technique, est riche à la fois d’informations sur les comptes et d’améliorations à apporter à notre système de protection sociale.
La Cour, qui avait refusé de certifier les comptes de deux des branches (famille et vieillesse) l’année passée, n’oppose cette fois-ci de refus qu’à l’égard de la branche vieillesse, plus de 7 % des dossiers restant entachés d’erreurs de calcul. Par ailleurs, elle conteste une fois de plus l’exclusion du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) du périmètre de combinaison des comptes de cette branche. Elle évalue à 2,8 milliards d’euros la quote-part du résultat (négatif) du FSV pour 2009 qui serait à rattacher au résultat de la branche retraite pour ce même exercice. Après intégration de cette quote-part, le déficit de la branche serait porté à 10 milliards d’euros au lieu de 7,2 milliards d’euros.
D’autre part, la réunion « de printemps » de la Commission des comptes de la sécurité sociale s’est tenue le 9 juin dernier. Les résultats de 2009 et les estimations révisées de 2010 sont donc désormais connus.
Soldes du régime général par branche (2007-2010)
(en milliards d’euros)
2007 |
2008 |
2009 |
2010 (*) | |
Maladie Accidents du travail Vieillesse Famille |
- 4,6 - 0,5 - 4,6 + 0,2 |
- 4,4 + 0,2 - 5,6 – 0,3 |
- 10,6 - 0,7 - 7,2 – 1,8 |
- 13,1 – 0,6 - 9,3 – 3,8 |
Total régime général |
- 9,5 |
- 10,2 |
- 20,3 |
- 26,8 |
FSV |
+ 0,2 |
+ 0,8 |
– 3,2 |
– 4,3 |
Régime général et FSV |
- 9,3 |
- 9,4 |
- 23,5 |
- 31,1 |
(*) Prévision
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (juin 2010).
Le rapport présenté à la Commission des comptes indique que les déficits constatés en 2009 et attendus pour 2010 sont moins élevés que dans les prévisions inscrites en loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. En 2009, le déficit du régime général (hors FSV) s’est élevé à 20,3 milliards d’euros, alors que la loi de financement pour 2010 prévoyait un montant de 23,4 milliards d’euros, la différence s’expliquant pour moitié par une hypothèse trop pessimiste d’évolution de la masse salariale. En 2010, l’exécution serait améliorée de 3,7 milliards d’euros par rapport à la prévision, compte tenu notamment de la révision apportée à la base 2009 initialement retenue et, à nouveau, d’une évolution plus favorable de la masse salariale.
S’arrêter à cette « bonne nouvelle » constituerait bien évidemment une profonde erreur : à l’instar de la situation actuelle des finances publiques en général, celle des finances sociales n’a en effet jamais été aussi préoccupante, et ce pour plusieurs raisons.
Pour ce qui est d’abord du passé et du présent, si les déficits 2009 et 2010 sont finalement moins élevés qu’on ne pouvait le craindre, c’est pour atteindre des ordres de grandeur inconnus jusqu’alors : le taux de couverture des charges du régime général par ses produits n’est plus que de 91,6 %, alors qu’il atteignait encore près de 97 % en 2007 et en 2008. Autrement dit, sur 10 euros de prestations versés en 2010, près de 1 euro sera financé ultérieurement – par nous-mêmes, par nos enfants ou peut-être encore par nos petits-enfants ?
L’avenir est encore plus préoccupant, car toutes choses égales par ailleurs, c’est la persistance des déficits qui se trouve devant nous. Membre de la Commission des comptes, votre rapporteur estime que s’il ne fallait retenir qu’une seule idée forte de sa réunion du 9 juin dernier, ce serait celle énoncée par son secrétaire général, M. François Monier au cours de la présentation de son rapport. Selon lui, on ne peut plus parler de déficits « conjoncturels », car ceux-ci deviennent essentiellement structurels, se maintenant à un niveau de 30 milliards d’euros par an durant plusieurs exercices et donnant ainsi la mesure de l’effort à accomplir pour redresser les comptes.
Or, une lecture plus approfondie des comptes pour 2009 et 2010 fait apparaître une tendance particulièrement significative, à savoir l’évolution en ciseaux des recettes et des dépenses.
Produits nets et prestations du régime général (2009-2010)
(en %)
2009 |
2010 (*) | |
Produits nets Maladie Retraite Famille |
– 0,7 + 2,3 – 0,3 |
+ 1,6 + 1,8 – 0,1 |
Prestations Maladie Retraite Famille |
+ 4,0 + 4,8 + 3,4 |
+ 3,1 + 4,4 + 0,8 |
(*) Prévision
Source : rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (juin 2010).
Ainsi malgré la crise, les dépenses donnent l’impression d’évoluer comme si de rien n’était : face à la quasi-stagnation des recettes, les prestations du régime général progresseraient encore globalement de 3,2 % en 2010. Conséquence inévitable de cette tendance, le besoin de financement de l’ACOSS, qui atteignait 24 milliards d’euros en 2009, avoisinerait 55 milliards d’euros en 2010. S’y ajoute la dette non encore remboursée par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), qui s’élevait à 96,5 milliards d’euros fin 2009. En outre, si l’on se fonde sur les projections figurant à l’annexe B de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le déficit cumulé de l’ensemble des régimes de sécurité sociale pour la période 2011-2013, FSV inclus, approcherait 104 milliards d’euros. Autrement dit, fin 2013, l’ensemble de la dette sociale se situerait entre 250 et 300 milliards d’euros.
Combien de temps allons-nous continuer à financer des dépenses courantes par la dette ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que deux éléments exogènes, sur lesquels nous n’avons pas prise, doivent être pris en compte :
– d’une part, nous bénéficions actuellement de taux d’intérêt exceptionnellement bas. Ainsi, la valeur moyenne du taux Eonia (interbancaire au jour le jour) est passée de 3,86 % en 2008 à 0,71 % en 2009, et même à seulement 0,35 % depuis le dernier trimestre 2009. Corrélativement, le jour où les taux d’intérêt repartiront à la hausse, l’effet s’en fera très durement sentir, vu les volumes de dette à financer. Il faut rappeler ici qu’avant la dernière reprise de dette par la CADES, les frais financiers annuels de l’ACOSS dépassaient 1 milliard d’euros, tandis qu’ils ont été réduits à environ 100 millions d’euros en 2009 et à 200 millions d’euros en 2010 ;
– d’autre part, ainsi que le fait observer la Cour des comptes, la divergence avec nos partenaires, particulièrement l’Allemagne mais aussi l’Italie, se creuse dangereusement depuis 2006. Les déficits publics français, après avoir été le plus souvent moindres que ceux de l’Allemagne entre 2002 et 2005, n’ont pas cessé, depuis 2006, de leur être supérieurs de façon croissante. La Cour relève en outre qu’ils ont également été supérieurs, pour la troisième année consécutive, à ceux de l’Italie. Or, cette divergence des finances publiques ne peut que se traduire par une croissance des différentiels de taux d’intérêt traduisant la moindre confiance de nos créanciers. De fait, alors que le spread entre la France et l’Allemagne était très réduit, il s’est accru très rapidement au cours des derniers mois pour atteindre 50 points de base au début du mois sur les emprunts à 10 ans.
Dès lors, il n’est plus temps d’implorer « encore une minute, monsieur le bourreau ». À force de retarder la prise de décision, son coût devient de plus en plus élevé, au sens propre comme au sens figuré. On le voit déjà très clairement lorsque la Cour des comptes montre que même avec des traitements extrêmes et limités dans le temps (mais à effet rapide) appliqués aux principales branches, tels une progression annuelle de l’ONDAM limitée à 2 % et un gel des prestations vieillesse et famille, le déficit demeure élevé : plus de 26 milliards d’euros en 2011 et encore près de 17 milliards d’euros en 2013.
L’heure n’est donc plus aux demi-mesures, mais à la mobilisation générale contre les déficits si nous voulons conserver notre crédibilité par rapport à nos voisins.
Avant d’envisager les issues possibles, il convient d’abord d’examiner le contexte économique des mois à venir. À cette fin, le tableau ci-dessous met en regard les hypothèses de croissance retenues par le Gouvernement, d’une part, et celles présentées par différents organismes internationaux, d’autre part.
Hypothèses de croissance du PIB (2010-2011)
(en %)
2010 |
2011 | |
Gouvernement |
1,4 |
2,5 |
OCDE |
1,7 |
2,1 |
FMI |
1,5 |
1,8 |
Consensus Economics |
1,4 |
1,7 |
Euroframe |
1,1 |
1,7 |
Commission européenne |
1,3 |
1,5 |
OFCE |
0,9 |
1,4 |
IfW (Kiel) |
1,6 |
1,2 |
Or, s’il apparaît que pour 2010, l’hypothèse du Gouvernement se situe à l’intérieur de la fourchette comprise entre la plus optimiste et la plus pessimiste, les prévisions de croissance pour 2011 se placent, selon les organismes, entre 0,4 et 1,3 point en-dessous de la croissance escomptée par le Gouvernement.
Au-delà même de la croissance, l’élément-clef du financement des régimes sociaux, compte tenu de l’assiette des prélèvements qui leur sont affectés, est l’évolution de la masse salariale. En 2009, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la masse salariale avait reculé (– 1,3 %). Pour 2010, le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale se fonde sur une croissance de 0,3 %, tandis que dans ses dernières publications, l’ACOSS table pour sa part sur une croissance de 0,5 % en glissement annuel. Cette année serait donc marquée par une timide convalescence des recettes, puisque ces 1,6 à 1,8 point de masse salariale supplémentaire par rapport à 2009 équivalent mécaniquement à un montant de recettes de 3,2 à 3,6 milliards d’euros. Autrement dit, si la progression de la masse salariale s’était maintenue en 2009 et 2010 au niveau de 2008 (+ 3,8 %), le régime général aurait encaissé respectivement 10 milliards d’euros et 7 milliards d’euros supplémentaires.
Il est trop pour évaluer avec suffisamment de précision ce que pourrait être l’évolution en 2011. Cependant, il faut d’ores et déjà relever que l’OCDE ne prévoit qu’un léger recul du chômage, qui resterait ainsi à un niveau supérieur à celui de 2009, tandis qu’il est peu probable, dans un contexte de sortie de crise, que les salaires augmentent rapidement. Dans ces conditions, si l’on table sur une progression de 1,5 à 1,7 % de la masse salariale, ce seraient encore près de 6 milliards d’euros de recettes supplémentaires par rapport au creux de 2009 et un manque à gagner de plus de 4 milliards d’euros par rapport à la tendance de 2008. Mais au vu de l’effort colossal à accomplir, il ne sera évidemment pas possible de se contenter de ce retour progressif à la normale.
Si la France veut respecter ses engagements européens pris dans le cadre de son programme de stabilité et, hors même cette contrainte, tout simplement assainir ses finances sociales, elle doit revenir à un déficit de 3 % à l’horizon 2013 : cela signifie, pour les régimes sociaux, passer de 30 milliards d’euros de déficit à 10 milliards d’euros, soit un effort de 20 milliards d’euros par an.
Il faudra donc nécessairement trouver de nouvelles recettes et aller plus loin dans la maîtrise des dépenses.
2. Quelles nouvelles recettes pour les régimes sociaux ?
La première piste consiste bien entendu à rechercher parmi les exonérations de cotisations sociales, dont le coût pour les régimes sociaux, certes compensé à 90 % par l’État, est de l’ordre d’un dixième de leurs recettes.
S’agissant des allégements généraux, le Gouvernement a d’ores et déjà repris à son compte, dans le cadre de la réforme des retraites, l’une des propositions formulées au printemps 2008 par la mission d’information commune à nos commissions des affaires sociales et des finances sur les exonérations de cotisations sociales, consistant à annualiser le calcul des allégements généraux. Générateur d’effets d’aubaine, voire d’abus, le mode de calcul actuel devait en effet être modifié : mesure d’équité, l’annualisation a également pour mérite de réduire de 2 milliards d’euros la perte de recettes pour les régimes sociaux. En l’état, cette somme bénéficierait toutefois à l’ensemble des branches, et non à la seule branche vieillesse, mais les textes financiers de l’automne – lois de finances et loi de financement – permettront de mettre en place les mécanismes nécessaires pour que cette mesure bénéficie de manière effective à la branche vieillesse.
Votre Rapporteur estime cependant qu’il est possible d’aller plus loin dans ce domaine, en s’inspirant d’une autre des propositions de la mission d’information commune, à savoir la forfaitisation du plafond de ces allégements, actuellement défini en fonction du SMIC (en l’occurrence 1,6 SMIC). Si ce plafond était exprimé en euros, l’incidence des allégements serait ipso facto réduite au gré de l’inflation. L’avantage d’une telle désindexation consiste notamment dans son caractère progressif. En outre, la modération actuelle de la hausse des prix rendrait cette mesure initialement peu sensible.
Il faut, en effet, être conscient que l’évolution du SMIC en tant que telle pèse de manière très significative sur le coût des allégements généraux. Il suffit de rappeler que la DARES, auditionnée par la mission d’information commune, avait indiqué qu’à barème constant, une augmentation de 1 % du SMIC accroît mécaniquement le coût des allégements généraux d’environ 600 millions d’euros. En 2009, la hausse du SMIC, qui s’est élevée à 1,3 % au 1er juillet, a donc entraîné une majoration de près de 800 millions d’euros du coût des allégements généraux. De même, la hausse décidée au 1er janvier dernier (+ 0,5 %) accroît la charge d’environ 300 millions d’euros. Avec une inflation que l’OCDE évalue à 1,7 % en 2010, le gain qui pourrait être engrangé dès 2011 si le plafond de sortie des allégements généraux demeurait inchangé en euros serait de l’ordre de 1 milliard d’euros.
Les économies consécutives à la non-revalorisation du plafond des allégements généraux pourraient même être supérieures à cette évaluation : on sait, en effet, que toute progression du SMIC plus rapide que celle du salaire moyen entraîne une augmentation de l’effectif concerné par les allégements généraux et, partant, de leur coût.
Votre Rapporteur pense que les exonérations ciblées bénéficiant à certains secteurs économiques ou à certains territoires doivent consentir le même effort que les niches fiscales, c’est-à-dire faire l’objet, selon l’expression consacrée, d’un « rabotage » de 10 %, qui rapporterait donc 300 millions d’euros. La remise en question de ces mesures, entamée depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 avec la modification du régime des organismes d’intérêt général en zones de revitalisation rurale (ZRR), doit être activement poursuivie. Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement s’était engagé à procéder à des évaluations de l’ensemble de ces dispositifs au plus tard en juin 2011. Cette phase de travail est cruciale, car si l’on veut rationaliser le recours à de tels dispositifs, il est indispensable que chacun puisse disposer de ces éléments d’évaluation sur leur utilité et leur coût.
Pour ce qui est des niches sociales, la réforme des retraites présentée par le Gouvernement comporte également des mesures visant à les réduire, que ce soit la majoration du taux des contributions salariale et patronale sur les stock-options et attributions gratuites d’actions (70 millions d’euros en 2011) ou la création d’une contribution salariale sur les « retraites-chapeaux » et l’assujettissement de l’employeur dès le premier euro en cas d’option pour une contribution « à la sortie » (110 millions d’euros en 2011).
Mais votre Rapporteur considère qu’il est possible, ici aussi, d’aller plus loin.
L’annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale procède à un recensement exhaustif des taux réduits de cotisations, des cotisations forfaitaires, des assiettes forfaitaires, des assiettes ad hoc, des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels et autres prélèvements dérogatoires bénéficiant à diverses professions ou catégories de revenus. Il est dommage que ce document n’évalue pas systématiquement le coût de ces régimes particuliers, se bornant trop souvent à donner des indications sur les taux ou sur l’assiette. Mais, il ne fait pas de doute que leur réexamen offrirait d’importants gisements de ressources, le retour au droit commun des cotisations et prélèvements pouvant être étalé, pour chacun d’entre eux, sur une période de trois ans.
Au demeurant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a marqué le début d’un aménagement de ces dispositions, tant à l’initiative du Gouvernement qu’à celle du Parlement, avec la suppression du seuil annuel de cession de valeurs mobilières et droits sociaux pour l’imposition des plus-values aux prélèvements sociaux (article 17), la modification du régime des contrats d’assurance vie au regard des contributions sociales en cas de décès (article 18), l’instauration d’une contribution sur les gains résultant des appels surtaxés effectués dans le cadre des jeux télévisés (article 19) et l’assujettissement aux cotisations et contributions sociales du bonus accordé aux salariés chargés de constituer des fonds de capital-risque, autrement dit des carried interests (article 21).
L’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a, par ailleurs, porté de 2 à 4 % le taux du forfait social institué l’année précédente, à la charge de l’employeur, sur certaines des rémunérations ou gains assujettis à la CSG mais exclus de l’assiette des cotisations sociales. Le même article a étendu l’assiette de cette contribution aux sommes perçues par les dirigeants d’entreprise au titre de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale, dans les mêmes conditions que les salariés et aux jetons de présence ainsi qu’aux sommes perçues au titre de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et les membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme.
L’assiette du forfait social n’a donc été étendue que de façon marginale, alors qu’en sont encore exclus des montants importants. C’est notamment le cas des contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, soit une assiette évaluée à 13,5 milliards d’euros pour 2010 : leur assujettissement au forfait social rapporterait donc 540 millions d’euros.
C’est également le cas des indemnités de licenciement, dont certaines atteignent des montants qui justifieraient leur inclusion dans le forfait social ou même leur assujettissement pur et simple aux cotisations et contributions sociales de droit commun, par la voie d’une remise en cause des plafonds d’exonération, qui se situent actuellement à un niveau très élevé. L’annexe 5 au projet de loi de financement évaluait ces sommes à 3,5 milliards d’euros. Dans son rapport 2007 sur la sécurité sociale, la Cour des comptes, pour sa part, se fondant sur une enquête de l’INSEE de 2002 estimant à 9 000 euros le montant moyen de ces indemnités et sur la base de 870 000 licenciements annuels, indiquait que la seule perte de recettes pouvait être évaluée à 3,6 milliards d’euros, correspondant à une perte d’assiette de près de 9 milliards d’euros.
Les données recueillies en 2008 par l’ACOSS via les déclarations automatisées des données sociales (DADS) font apparaître qu’un peu plus de 90 % des indemnités de licenciement sont inférieures au plafond annuel de la sécurité sociale (qui s’élevait en 2008 à 33 276 euros). Le montant moyen de l’indemnité atteignait un peu moins de 13 000 euros, mais 1 511 indemnités dépassaient six fois le plafond annuel, soit 200 000 euros. Selon les indications fournies à votre Rapporteur, il est fort probable que ces chiffres sont sous-estimés compte tenu du fait que les employeurs ne remplissent pas toujours correctement les DADS.
Votre Rapporteur juge qu’il n’est pas juste que ces sommes échappent à toute participation au financement de la sécurité sociale. Or, les montants versés aux salariés licenciés sont manifestement très disparates. Un assujettissement aux prélèvements sociaux de droit commun ne serait pas injustifié pour les indemnités supérieures à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 69 240 euros.
Il serait en outre souhaitable de distinguer le cas des indemnités versées dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle. L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle obéit au même régime que l’indemnité légale, à laquelle elle ne peut être inférieure : elle est donc exonérée de cotisations et prélèvements dans les mêmes limites, comme le confirme la circulaire interministérielle N° DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009. Ici aussi, plus de 90 % des indemnités versées en 2008 étaient inférieures au plafond de la sécurité sociale, pour un montant moyen de 10 500 euros. S’agissant toutefois de données portant sur l’année 2008, elles ne tiennent pas compte de la très forte montée en charge de la rupture conventionnelle, soit 160 000 ruptures comptabilisées en octobre 2009 contre seulement 20 106 en 2008. En tout état de cause, il ne serait pas illogique de soumettre l’intégralité du montant de ces indemnités spécifiques au droit commun des cotisations et contributions.
Dans la partie de son rapport annuel 2007 consacrée à l’assiette des prélèvements sociaux, la Cour des comptes s’est non seulement intéressée aux niches proprement dites – on se souvient des développements qu’elle avait consacrés aux stock-options – mais a mis en lumière le fait que les cotisations des employeurs publics dérogent au droit commun du régime général. Au moment où nous nous engageons, grâce à la réforme des retraites, vers un juste alignement des cotisations salariales des secteurs public et privé dans la branche vieillesse, il serait cohérent d’emprunter cette même voie dans la branche maladie.
Or, la Cour évalue à 2,5 points l’insuffisance du taux de cotisation maladie à la charge des employeurs publics. Outre ce décalage de taux, l’assiette est minorée par la non-prise en compte des primes, soit environ 20 % en moyenne des rémunérations soumises à cotisations. La perte pour l’assurance maladie peut être estimée à 3 milliards d’euros au titre de l’alignement des taux et à 600 millions d’euros au titre de l’harmonisation de l’assiette. Bien évidemment, une majoration du taux et une extension de l’assiette demeureraient neutres à l’échelon de la sphère publique, puisqu’elles reviendraient à un transfert des employeurs publics vers les régimes sociaux. Mais, elle serait importante en termes de transparence et de cohérence du système.
Parallèlement à la mise en œuvre de ces nouvelles ressources, il faut bien entendu agir sur les dépenses.
Comme ce n’est pas ici le lieu d’anticiper nos débats sur la réforme des retraites, la réflexion doit se concentrer essentiellement sur les branches maladie et famille.
Pour l’assurance maladie, votre Rapporteur se félicite que le Gouvernement semble ne plus admettre que le respect de l’ONDAM, en exécution, ne se transforme en réalité en respect de l’ONDAM majoré de la marge restant en-dessous du seuil de déclenchement constaté par le comité d’alerte. Ainsi, cette année, bien que le comité eût chiffré le dépassement prévisible de l’ONDAM à 600 millions d’euros et que les pouvoirs publics ne fussent donc pas contraints d’intervenir, des mesures de rétablissement des comptes ont immédiatement été annoncées.
Au-delà, votre Rapporteur suggère qu’un plan pluriannuel de trois à cinq ans soit adopté, afin de redresser les comptes à hauteur de 4 milliards d’euros par an et de retrouver ainsi l’équilibre en fin de période. Plusieurs mesures pourraient y contribuer.
Dans le secteur de la médecine de ville, il faut d’abord aller plus loin dans la voie ouverte avec succès par le contrat d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI) : l’étape suivante pourrait consister à lier les honoraires des médecins au niveau et à la qualité de prescription.
S’agissant des établissements de santé, il est essentiel d’avancer plus activement en faveur d’une maîtrise des coûts. Votre Rapporteur s’interroge par exemple sur l’étendue de leur patrimoine immobilier. En effet, une part non négligeable en est affectée à des usages qui ne sont pas de nature sanitaire. Alors que l’État a entrepris de rationaliser la gestion de son patrimoine immobilier, il conviendrait que les établissements de santé s’engagent dans une démarche comparable.
Dans son récent rapport sur le fonctionnement de l’hôpital au nom de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), notre collègue Jean Mallot relève que « le patrimoine immobilier des hôpitaux publics n’est pas précisément connu, mais [qu’]il serait d’une surface supérieure à celui de l’État et pourrait représenter plusieurs dizaines de milliards d’euros ».
Des informations sur la valeur du patrimoine immobilier des établissements publics de santé sont certes disponibles via les données de la direction générale des finances publiques (DGFiP) qui centralise l’ensemble des données comptables de ces établissements. Il s’agit de données comptables, donc établies en coûts historiques. Elles peuvent être déterminées en valeur brute (coût historique) et nette (déduction faite des amortissements pratiqués), mais ne correspondent pas à la valeur vénale de ces biens, qui n’est en général déterminée que lorsqu’un projet de cession est envisagé. Selon les données de la DGFiP pour 2008, le patrimoine global des établissements de santé (terrains et agencements, constructions et immobilisations en cours) atteint 50 860 millions d’euros en valeur (historique) brute. Le cumul des amortissements afférents constatés dans la comptabilité atteignant quant à elle 20 664 millions d’euros, la valeur nette comptable est estimée à 30 196 millions d’euros.
Votre Rapporteur fait pleinement siennes les conclusions de la MECSS, qui plaide pour un recensement exhaustif du patrimoine afin d’en estimer la valeur, ce qui nécessite, « dans un objectif de gestion médico-économique plus active du patrimoine hospitalier », d’instaurer l’obligation pour les établissements de santé d’établir un bilan patrimonial annuel précis et réévalué chaque année. Elle préconise par ailleurs d’étudier les voies d’améliorations possibles de la gestion du patrimoine immobilier des hôpitaux, passant par la mise en place de plans de gestion par les établissements. Une autre solution consistant à confier la gestion à un office public de gestion du patrimoine hospitalier pourrait aussi être étudiée, afin de décharger les établissements.
Il est grand temps que cet aspect de la gestion hospitalière soit sérieusement pris en compte et il y a donc tout lieu de se féliciter que l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), parmi les dix chantiers qu’elle doit entreprendre, ait prévu de réaliser une étude sur la gestion patrimoniale des établissements de santé.
La politique du médicament doit aussi être entièrement reconsidérée. Des clauses de non-remboursement devraient être appliquées si l’efficacité d’un médicament n’est pas avérée. Par ailleurs, le Comité économique des produits de santé devrait étendre à davantage de spécialités le recours aux tarifs forfaitaires de responsabilité, calculés à partir du prix des génériques et faisant ainsi bénéficier de tarifs inférieurs l’assurance maladie aussi bien que les assurés sociaux.
Enfin, dans son rapport annuel 2006, la Cour des comptes indique que la rémunération des organismes auxquels est déléguée la gestion de l’assurance obligatoire aurait dépassé 550 millions d’euros en 2004, dont 425 millions d’euros pour les fonctionnaires, les salariés et les étudiants. La Caisse nationale d’assurance maladie, quant à elle, avait évalué à 250 millions d’euros le bénéfice net d’une reprise par les caisses primaires d’assurance maladie en gestion directe de l’ensemble des assurés. Les difficultés de la période actuelle font qu’il n’est désormais plus possible de négliger les économies qu’entraînerait la réforme de ces mécanismes de gestion.
Pour la branche famille, votre Rapporteur, à la demande du Premier ministre, avait été chargé en avril 2009 d’une mission sur l’évolution du financement de la politique familiale, qui l’a naturellement amené à réfléchir aux dépenses – y compris fiscales – engagées dans ce domaine. Plusieurs « niveaux d’ambition » lui paraissaient pouvoir être envisagés :
– un « statu quo » consistant à maintenir le système global de prestations familiales inchangé, mais sans évidemment réaliser quelque économie que ce soit ;
– une « révision des dépenses », maximisant les économies dans le sens d’une plus grande équité socio-fiscale sans innover et permettant de dégager près de 1,5 milliard d’euros d’économies, principalement sur le champ du budget de l’État (quotient familial, réductions d’impôts, ...) ;
– une « réforme mesurée » conciliant une certaine rationalisation de la dépense et innovation, avec des économies liées à la mise en œuvre du choix entre allocations familiales et quotient familial à partir d’un certain seuil de revenu, pour un montant de près de 2 milliards d’euros ;
– une « réforme volontariste », enfin, s’efforçant de concilier rationalisation poussée de la dépense (s’agissant notamment du complément de libre choix d’activité-CLCA) et innovation (économies liées à la mise en œuvre du choix entre allocations familiales et quotient familial à partir d’un certain seuil de revenu), qui se traduirait par plus de 2,6 milliards d’euros d’économies.
Mais avant que la situation économique ne redevienne plus favorable, que les nouvelles recettes ne soient engrangées et que les économies de dépenses ne commencent à porter leurs fruits, il est vital de s’attaquer au problème de la dette.
Il ne fait pas de doute que la gestion du stock de dette actuel et futur passera nécessairement par une combinaison de deux types d’actions : un allongement de la durée de remboursement et l’affectation de ressources nouvelles à la CADES.
D’ores et déjà, le Gouvernement souhaite, dans le cadre de la réforme des retraites, affecter à la CADES la principale recette du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), à savoir le prélèvement de 2 % sur les revenus du capital, qui a rapporté 1 417 millions d’euros en 2009 et dont le produit devrait se monter à 1 461 millions d’euros en 2010. Ces recettes supplémentaires permettraient à la CADES de reprendre le montant des déficits attendus de la branche vieillesse entre 2011 et 2018, date du retour à l’équilibre.
Mais la question des autres branches demeure posée, particulièrement celle de la branche maladie. Les hypothèses suivantes, que votre Rapporteur remercie la CADES d’avoir bien voulu lui communiquer, permettent de mesurer l’effort qui devra, ici aussi, être consenti.
Dans le cadre des dispositions organiques en vigueur, pour reprendre 10 milliards d’euros de dette au début 2011, il faut augmenter la CRDS de 0,085 point. Pour les 55 milliards d’euros qui se seront accumulés à fin 2010, il faudrait donc porter le taux de la CRDS de 0,5 à 0,9675 %.
Si l’on s’affranchit des dispositions organiques actuellement en vigueur, la CADES pourrait amortir entre 60 et 65 milliards d’euros de dette supplémentaire à un horizon moyen de 2030.
En combinant les deux critères (durée de remboursement et taux), pour reprendre 150 milliards d’euros début 2011 et en se fixant pour objectif de rembourser la totalité du stock vers 2030, il faudrait augmenter la CRDS d’environ 0,4 point, soit la porter à 0,90 %.
Même si les futures recettes supplémentaires de la CADES ne proviendront pas nécessairement d’une augmentation de la CRDS mais d’une réaffectation de recettes existantes ou bien de recettes nouvelles, l’évolution théorique de la CRDS, malgré un allongement de l’échéance de remboursement, fournit une indication très parlante sur l’importance des efforts à accomplir.
1. Audition de M. Didier Migaud,
premier président de la Cour des comptes
Au cours de sa séance du mercredi 23 juin 2010, la commission des affaires sociales entend, en audition conjointe avec la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, sur le rapport préalable au débat d’orientation des finances publiques.
M. le président Jérôme Cahuzac. Je suis heureux, monsieur le Premier président, de vous souhaiter la bienvenue pour la deuxième fois en un mois. Nous vous avons en effet entendu le 26 mai dernier au sujet de la certification des comptes de l’État et du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2009. Nos questions avaient parfois débordé sur les perspectives pour l’année en cours et les années suivantes et vous aviez renvoyé vos réponses à l’audition d’aujourd’hui, consacrée à la présentation du rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques.
La préoccupation majeure, pour la Cour comme pour le Parlement, est celle de la soutenabilité des finances publiques. Cette problématique, à laquelle se consacre également le groupe de travail Camdessus sur l’équilibre des finances publiques, fera l’objet d’un débat en séance publique le 6 juillet prochain.
En 2009, les dépenses fiscales ont crû de 6,2 %. La Cour estime-t-elle, comme on pourrait le comprendre à la lecture de son rapport, qu’elles ne sont plus sous contrôle ? Le cas échéant, quelles mesures préconiserait-elle pour retrouver la maîtrise de ces dépenses ?
Du reste, la Cour remarque que la définition même des dépenses fiscales est ambiguë et que leur liste n’est pas d’une cohérence irréprochable.
La Cour estime également que le montant du plan de relance s’élève à 46,2 milliards d’euros, c’est-à-dire plus que les 35,5 milliards d’euros prévus. Ce n’est pas en soi répréhensible, mais il semble que certaines dépenses censées être réversibles ne le seraient pas. Pourriez-vous nous indiquer lesquelles, et le coût que cela pourrait représenter les années suivantes ?
Par ailleurs, une disposition organique – dont notre collègue Jean-Luc Warsmann est à l’origine – prévoit que tout transfert de dette à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la CADES, doit s’accompagner d’un transfert correspondant de recettes. La Cour préconise-t-elle que l’on revienne sur cette disposition et que l’on permette l’allongement de la durée d’amortissement de la CADES, en faisant davantage peser sur les générations futures les dettes constituées par les générations précédentes ? Recommande-t-elle plutôt que l’on maintienne cette disposition, ce qui suppose, dans le cas de transferts de dettes, des transferts de recettes ?
Sans porter de jugement sur la nature même de l’opération, estimez-vous suffisant le montant des recettes que l’on s’apprête à transférer du Fonds de réserve pour les retraites, le FRR, vers la CADES pour éponger le déficit du régime de retraites dans les dix prochaines années ?
La Cour envisage la possibilité de prélèvements ciblés supplémentaires. Elle suggère à juste titre que ces prélèvements ne pénalisent pas l’emploi et évoque des pistes telles que l’impôt foncier ou les taxes environnementales. Peut-on avoir des précisions ?
S’agissant enfin de la réduction des niches fiscales, la Cour appelle là aussi à prendre en compte le critère de l’emploi afin de ne pas le pénaliser. Selon elle, l’abaissement du plafond des dépenses ouvrant droit à une réduction d’impôt pour emploi à domicile – aujourd’hui fixé à 15 000 euros – présente-t-il ce risque ? La même question se pose pour la prime pour l’emploi (PPE).
M. le président Pierre Méhaignerie. Je salue amicalement M. Didier Migaud, que je suis heureux de revoir.
La Commission des affaires sociales et la Commission des finances ont besoin de travailler ensemble. Lorsque l’on additionne la branche vieillesse, les dépenses de santé et les vingt-cinq prestations sociales dispensées de la naissance à la mort, le poids des dépenses sociales atteint 500 milliards d’euros. M. Jérôme Vignon, président des Semaines sociales de France, nous a récemment indiqué que nous avions largement dépassé la Suède en la matière mais que les résultats n’étaient pas à la mesure de ces dépenses. Dans ce secteur également, nous devons rechercher ensemble l’efficience.
M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes. C’est un grand honneur de vous présenter aujourd’hui, en ma qualité de Premier président de la Cour des comptes, le rapport 2010 sur la situation et les perspectives des finances publiques. Je suis accompagné de M. Christian Babusiaux et Mme Rolande Ruellan, présidents de chambre, et de plusieurs collègues qui ont participé à l’élaboration de ce rapport, MM. Jean-Raphaël Alventosa, François Monier et François Écalle.
Je me réjouis de cette nouvelle audition commune à vos deux Commissions, qui donne toute sa portée au tableau d’ensemble de nos finances publiques que je vais vous exposer.
Le rapport dont je vous rends compte aujourd’hui a été établi conformément à l’article 58-3 de la LOLF. Il est destiné à nourrir vos débats d’orientation budgétaire et sur les finances sociales que vous tiendrez conjointement. Il complète le rapport sur les résultats et l’exécution du budget de l’État et l’acte de certification de ses comptes, que j’ai présentés à la commission des finances de votre Assemblée le 26 mai dernier, ainsi que l’acte de certification des comptes du régime général de sécurité sociale, qui a été rendu public hier. Avant l’été, votre commission des Finances sera également destinataire de la communication sur l’exécution du plan de relance qu’elle nous a demandée.
S’il fallait résumer les conclusions de ce rapport, je vous dirais que l’état de nos finances publiques s’est aggravé de façon très sérieuse en 2009 et début 2010, mais que la situation n’est pas encore irréversible si la France s’attelle dès maintenant à une action de redressement forte, crédible et durable.
Dans ses rapports précédents, la Cour avait souligné déjà la dégradation de notre situation financière et la nécessité d’un effort de consolidation sans précédent. Mais dans ce rapport, nous constatons que si la gravité du mal dont nos finances publiques sont atteintes est de longue date chronique, ce mal a franchi un nouveau stade. Il y a donc urgence à prendre des mesures immédiates, sauf à hypothéquer notre indépendance et notre souveraineté si les tendances actuelles devaient un tant soit peu se poursuivre. Avant de décrire les perspectives de nos finances publiques, arrêtons-nous quelques instants sur l’exercice 2009 et sur 2010.
La très forte augmentation du déficit et de l’endettement publics constatée l’an dernier est principalement attribuable à la récession et aux mesures de relance prises pour y faire face. Mais les variations conjoncturelles n’expliquent pas tout, tant s’en faut : le déficit structurel de nos finances publiques a continué en effet de se creuser l’an dernier.
En 2009, notre déficit et notre endettement publics ont atteint un niveau sans précédent depuis l’après-guerre. Le déficit public s’est élevé à 7,5 % du PIB, en raison de la forte croissance des dépenses publiques, qui a atteint 3,7 % en volume, et de la baisse du produit des prélèvements obligatoires de plus de 5 % par rapport à 2008.
Effets de la crise, pourrait-on penser en première analyse ? C’est effectivement le cas s’agissant des dépenses du plan de relance, pour un montant de plus de 7 milliards d’euros, des investissements locaux induits par le remboursement anticipé de TVA aux collectivités, pour probablement moins de 1 milliard d’euros, et de l’accroissement de plus de 4 milliards d’euros des allocations chômage versées.
Mais si l’on exclut ces différentes mesures, on constate un rythme d’augmentation des dépenses publiques de 2,4 %, légèrement supérieur à l’évolution constatée depuis 1998 – 2,3 % –, loin du 1 % prévu dans la loi de programmation des finances publiques pour 2008-2012.
Pourtant, les charges d’intérêt payées au titre de la dette ont fortement diminué du fait de la baisse des taux. Ce sont donc les dépenses courantes, hors intérêts de la dette, hors investissement, et hors mesures de relance et d’assurance chômage, qui ont fortement progressé, de 3,7 % en volume. Comme le craignait Philippe Séguin l’année dernière devant vous, il y a bien eu un phénomène de « décompensation » en 2009, avec un relâchement des efforts de maîtrise des dépenses publiques, y compris dans des secteurs qui n’étaient pas directement concernés par les mesures de soutien à l’économie.
La baisse des recettes est très majoritairement attribuable à la récession, ainsi que, dans une moindre mesure, au volet fiscal du plan de relance. Mais il y a eu également des baisses pérennes de prélèvements obligatoires consenties par l’État, comme la diminution du taux de TVA sur la restauration, et en sens inverse des hausses de recettes affectées aux organismes de protection sociale ou décidées par les collectivités territoriales. Au total, le coût net de ces mesures nouvelles aurait aggravé le déficit public de 2,5 milliards d’euros en 2009.
On voit donc que, du côté des dépenses comme des recettes, la crise a indéniablement pesé. Elle n’explique toutefois qu’une partie de la dégradation de nos finances publiques. Pour dresser un diagnostic précis du mal qui les frappe, il est nécessaire de distinguer entre les composantes conjoncturelles et structurelles du déficit. Il faut pour cela procéder à des calculs compliqués, sur la base d’une prévision de croissance potentielle, dont on pense qu’elle pourrait être durablement affectée par la récession de 2009.
Je signale que le chiffrage de la Cour ne prend pas en compte les mesures de relance que nous avons considérées comme non pérennes, à la différence de la Commission européenne qui arrive à un niveau de déficit structurel sensiblement plus élevé que le nôtre.
Aux termes de ces calculs, la Cour estime que le déficit structurel a encore progressé par rapport à 2008, où il atteignait 3,9 %. Il s’élèverait à environ 5 % du PIB en 2009 et représenterait donc les deux tiers du déficit constaté. La crise et les mesures de relance n’expliqueraient pour leur part qu’un tiers du déficit global.
La forte augmentation du déficit public de 4,2 points de PIB est principalement attribuable à l’État et à ses divers organismes d’administration centrale.
Je n’y reviens pas, puisque j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer devant votre commission des finances à l’occasion de la présentation du rapport sur les résultats et l’exécution budgétaire de l’État.
L’année 2009 aura également été marquée par une forte hausse des déficits sociaux. Là encore, les mêmes causes produisent les mêmes effets : une forte croissance des dépenses, +4,5 % après +3,1 % en 2008, avec diminution des recettes due à la baisse en valeur de la masse salariale privée, de -1,3 %.
Ce déficit est principalement concentré sur le régime général de sécurité sociale.
Celui-ci atteint 20,3 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter 3,2 milliards de déficit pour le Fonds de solidarité vieillesse, le FSV. En 2009, les quatre branches du régime général sont dans le rouge :
L’assurance maladie, dont le solde est négatif de plus de 10 milliards d’euros, est responsable de la moitié du déficit d’ensemble des branches. L’Objectif national de dépenses d’assurance maladie – ONDAM – a été à nouveau dépassé de 700 millions d’euros en 2009, du fait d’une sous-estimation des dépenses hospitalières et de la réalisation incomplète des économies prévues en loi de financement ;
La branche retraite voit son déficit se creuser à nouveau, à 7,2 milliards d’euros, confirmant la tendance observée depuis 2005, et ce malgré une croissance moins vive des prestations servies grâce au ralentissement des départs anticipés ;
La branche famille enregistre également un déficit important de 1,8 milliard d’euros, alors qu’elle était proche de l’équilibre en 2008 ;
Quant à l’assurance chômage, qui avait dégagé d’importants excédents en 2007 et 2008, elle est redevenue déficitaire en 2009 avec un résultat négatif de plus de 1 milliard d’euros.
Dans ce panorama, les collectivités territoriales se distinguent puisque leur déficit a diminué de plus de 3 milliards d’euros en 2009 et représente désormais 0,3 % du PIB, contre 0,4 % en 2008.
Leurs recettes ont progressé plus fortement que leurs dépenses, grâce aux remboursements anticipés de TVA, qui ont constitué un concours de trésorerie exceptionnelle sans avoir un effet très important sur l’investissement.
Les dépenses de fonctionnement des collectivités ont pour leur part décéléré sensiblement par rapport aux années précédentes, sauf pour les intercommunalités. Ces évolutions positives masquent l’aggravation de la situation financière de nombreux départements, victimes d’un « effet de ciseau » entre le dynamisme des dépenses sociales et la faible progression de leurs recettes.
Plus préoccupant, le déficit primaire, c’est-à-dire hors charges d’intérêt de la dette, est passé de 0,5 % du PIB en 2008 à 5,1 % en 2009. Dans ces conditions, il est impossible de stabiliser l’endettement en pourcentage du PIB, la France devant emprunter pour payer non seulement les intérêts de la dette, mais aussi une partie des dépenses courantes hors intérêt. C’est le fameux effet « boule-de-neige » que Philippe Séguin avait décrit l’année dernière.
La dette au sens du traité de Maastricht a augmenté en une seule année de plus de 10 points de PIB. Elle représente 78,1 % du PIB, et atteint presque 1 500 milliards d’euros.
La dette publique est portée à près de 80 % par l’État et les organismes qui lui sont rattachés, dont l’endettement a progressé de 135 milliards d’euros en 2009. La dette sociale a augmenté pour sa part de 31 milliards, en comptant le découvert de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, qui a atteint plus de 24 milliards d’euros à la fin de 2009. Au total, avec les déficits transférés à la CADES et non amortis, la dette sociale atteint près de 150 milliards d’euros, soit quasiment le niveau de la dette locale, qui s’établit à 157 milliards d’euros, en hausse de 9 milliards d’euros. Toutefois, ces deux dettes présentent une différence fondamentale : la dette sociale est profondément anormale, nos principes de sécurité sociale voulant que les cotisations couvrent les prestations ; la dette locale résulte quant à elle d’investissements et a pour contrepartie des actifs.
Pour comprendre mieux encore l’état réel de nos finances publiques, au-delà des chiffres que je viens de citer, il nous faut recourir à des comparaisons internationales. Notre position était défavorable en 2008, elle l’est restée en 2009.
Notre déficit et notre dette publics ont augmenté dans les mêmes proportions que dans les autres pays européens, alors même que la récession a été moins violente en France que dans le reste de l’Europe et bien que notre plan de relance ait été d’une ampleur plus limitée.
Mais le plus inquiétant, c’est le décrochage de la France par rapport à l’Allemagne. Alors même qu’entre 2002 et 2005, notre déficit public était inférieur à celui constaté outre-Rhin, il n’a cessé depuis lors de diverger de manière croissante : il est ainsi supérieur de plus de 4 points de PIB en 2009.
Notre déficit structurel, qui était supérieur de 1 point de PIB à celui de l’Allemagne en 2006, le dépasse désormais de 4 points.
Quant à l’écart entre les soldes primaires français et allemand, il dépasse pour la troisième année consécutive les 3 points de PIB, et n’a jamais été aussi important. Notre dette publique, qui était inférieure à celle de l’Allemagne jusqu’à fin 2007, lui est désormais supérieure de 5 points.
Ces écarts croissants tiennent, pourriez-vous dire, à une gestion trop restrictive des finances publiques en Allemagne. Il ne me revient pas de trancher ce débat. Mais je note que la dégradation de notre position en Europe est également patente lorsque l’on compare la France à l’Italie. Notre déficit public comme notre solde structurel sont ainsi supérieurs depuis trois ans à ceux de l’Italie, même si notre dette reste inférieure.
En 2010, au sortir de la récession et alors que le plan de relance s’achève, nous pouvions espérer un rétablissement. Il n’en est rien. Les prévisions du Gouvernement pour 2010 annoncent en effet une nouvelle dégradation.
Le déficit public atteindrait 8 % du PIB en 2010, en augmentation d’un demi-point par rapport à 2009. La dette publique passerait quant à elle de 78,1 à 83,7 % du PIB.
Comment expliquer cette nouvelle dégradation ? À nouveau, par une croissance encore trop forte des dépenses publiques, qui s’établirait à 1,7 % en volume hors relance et allocations chômage, soit un niveau bien supérieur à l’objectif de 0,6 % retenu pour la période 2011-2013 ; et par une insuffisante sécurisation des recettes, avec en particulier l’effet de la réforme de la taxe professionnelle.
Dès lors, le déficit structurel compte non tenu des mesures de relance atteindrait 5,7 % du PIB, soit plus de 100 milliards d’euros, en hausse de plus d’un demi-point par rapport à 2009.
L’ensemble des administrations publiques serait concerné en 2010, même si les organismes sociaux seront les plus affectés en raison du faible dynamisme de la masse salariale.
En retenant les hypothèses du Gouvernement, le déficit du régime général serait proche de 27 milliards d’euros, dont la moitié proviendrait de l’assurance maladie. Il faut y ajouter le déficit du FSV, qui s’élèverait à 4,3 milliards d’euros.
L’assurance chômage verrait son besoin de financement croître fortement, pour s’élever à 4,1 milliards d’euros, son déficit cumulé dépassant 10 milliards à la fin de 2010.
Le déficit budgétaire de l’État atteindrait un niveau inégalé, de 152 milliards d’euros. Pourtant l’État anticipe un fort rebond de ses recettes fiscales nettes. Cette prévision apparaît volontariste au regard de la précédente récession de 1993, qui s’était traduite par une élasticité des recettes fiscales sensiblement inférieure à l’évolution du PIB pendant trois ans. L’augmentation de près de 12 milliards d’euros de recettes fiscales à la fin d’avril 2010 doit dans ce contexte être interprétée avec une grande précaution. Elle traduit surtout le contrecoup des mesures de relance de début 2009.
L’explication de ce déficit record, c’est que 2010 verra le plein effet de mesures nouvelles ayant une forte incidence sur le budget de l’État : la réforme de la taxe professionnelle, qui aura un coût net de 12,7 milliards d’euros, et les investissements d’avenir au titre desquels l’État versera 35 milliards d’euros à divers organismes.
Certes, ces investissements d’avenir auront un faible impact en 2010 sur le déficit et l’endettement publics au sens de Maastricht, car les 35 milliards seront déposés auprès du Trésor. Une partie de ces dépenses sera versée par tranches de 4 à 5 milliards d’euros chaque année sur une période de quatre ans, sans jamais être incluse dans la norme de dépenses. Le reste de cette somme est non consomptible et donne lieu au versement d’intérêts, à hauteur de 600 millions d’euros par an. Ces intérêts versés seront intégrés quant à eux dans la norme de dépense, accroissant d’autant l’effort nécessaire de réduction des dépenses courantes de l’État.
Ce programme d’investissement aura toutefois à moyen terme un impact sur la dette : elle devrait augmenter de ce fait de 19 milliards d’euros à l’horizon 2014, sans compter la charge cumulée des intérêts, qui devrait dépasser 11 milliards d’euros sur le total des années 2010 à 2020.
L’année 2010 sera probablement marquée par une nouvelle dégradation de la capacité d’autofinancement des collectivités territoriales, et en particulier des départements du fait de la forte croissance des dépenses sociales. Leur besoin de financement devrait également progresser, dans un contexte d’incertitudes sur l’évolution du cadre institutionnel et financier des collectivités territoriales et de baisse des remboursements de TVA.
En 2010 à nouveau, la France serait mal positionnée par rapport à ses principaux partenaires. Son déficit public serait à nouveau supérieur à ceux de la zone euro et de l’Union européenne, hors France, et supérieur de trois points de PIB à celui de l’Allemagne. La dette publique resterait dans les moyennes communautaires, mais son déficit structurel serait à nouveau supérieur.
Le passé et le présent de nos finances publiques sont, vous l’aurez compris, préoccupants. Leur futur n’est pas davantage rassurant, malgré les objectifs affichés par le Gouvernement qui entend ramener le déficit public à 3 % du PIB en 2013. Mais la Cour est dans son rôle lorsqu’elle indique que les conditions de ce rétablissement sont loin d’être assurées à ce jour.
Le programme de stabilité adressé à la Commission européenne est tout d’abord fondé sur une croissance du PIB de 2,5 % par an entre 2011 et 2013, sensiblement au-dessus des prévisions internationales.
Le Gouvernement a privilégié en effet un scénario de rattrapage rapide des pertes de production, plus favorable que les scénarios du rapport Cotis-Champsaur qui estime que les pertes de recettes fiscales et sociales auront un caractère durable.
L’élasticité des recettes à la croissance pourrait être aussi surévaluée, tandis que l’objectif de progression des dépenses de 0,6 % par an est particulièrement ambitieux au regard des évolutions antérieures.
Ces hypothèses de dépenses obligent à dégager 45 milliards d’économie sur la période, et beaucoup plus sur les dépenses primaires pour compenser la hausse des charges d’intérêt. Les dépenses de l’État devront baisser en valeur pour compenser la hausse prévisible des charges d’intérêt et des pensions des fonctionnaires. Or, les décisions d’investissement envisagées à la suite du Livre blanc sur la défense nationale, ou l’accroissement des dépenses fiscales prévues au titre du Grenelle de l’environnement, font d’ores et déjà peser des risques sur l’évolution des dépenses et des recettes.
Il sera en outre difficile à l’État de diminuer de 1 à 2 points le rythme des dépenses des administrations locales et sociales, faute de leviers efficaces pour les réguler.
La soutenabilité des finances publiques de la France n’apparaît dès lors pas assurée à moyen terme, sauf si, bien sûr, des mesures sont prises.
Si l’on retient une évolution légèrement moins soutenue de la croissance, de l’ordre de 2,25 %, soit le scénario bas du Gouvernement, qui est déjà très favorable compte tenu d’une croissance potentielle qui est plutôt de 1,8 %, et si l’on prolonge l’évolution tendancielle des dépenses constatées ces dernières années, le déficit public dépasserait en 2013 les 6 % du PIB et la dette atteindrait 93 % de la richesse nationale, soit plus de 2000 milliards d’euros.
C’est dire que le redressement des finances publiques est une urgence immédiate et impérieuse. Il faut un traitement immédiat, continu et massif de nos déséquilibres financiers.
C’est en effet comme si nous souhaitions faire atterrir un avion gros porteur sur une piste de taille réduite. Car nous arrivons si j’ose dire à pleine vitesse et alors même que notre endettement atteint un niveau de moins en moins supportable.
Des déséquilibres menacent en effet à court terme la soutenabilité des finances publiques. C’est le cas des retraites avant la mise en œuvre des mesures récemment annoncées par le Gouvernement. Le rôle de la Cour n’est pas de prendre parti sur ces mesures, mais de mesurer l’impact qu’elles pourraient avoir sur le déficit et la dette publics.
Vous connaissez le chiffrage du besoin de financement du Conseil d’orientation des retraites, le COR, à l’horizon 2050 : 114 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes de retraite, dans le scénario le plus pessimiste, soit 3 % du PIB. Compte tenu de ce que l’on sait aujourd’hui, la réforme devrait avoir un effet structurel massif à long terme, c’est-à-dire à horizon 2020.
Mais ces calculs ne tiennent pas compte des charges d’intérêt qu’il faudrait payer au titre des déficits cumulés des régimes. Ces charges seraient en 2050 supérieures à ces 114 milliards d’euros.
Les mesures annoncées par le Gouvernement, si elles ont vocation à apporter une réponse à l’horizon 2018, réduiront relativement peu le déficit à court terme alors qu’il y a urgence. Or, la moitié du problème de financement des retraites se pose dès maintenant, puisque le déficit hors intérêt serait, selon le COR, de 1,7 % du PIB en 2010, et doit donc être traité par des mesures d’impact immédiat pour enrayer l’effet boule-de-neige des intérêts de la dette.
Si l’on analyse, au-delà des retraites, la soutenabilité à long terme en faisant des comparaisons internationales, il apparaît que la France devra faire un effort de redressement équivalent aux autres pays européens alors même que nos perspectives démographiques sont moins mauvaises. C’est qu’il nous faudra compenser la situation initiale plus dégradée de nos finances publiques.
Cela signifie également que la réforme de seules retraites sera insuffisante. La France est confrontée à un problème financier global, qui appelle des mesures continues et vigoureuses de l’État, des organismes sociaux et des collectivités territoriales.
Depuis des années, la France n’est pas parvenue à mettre en phase l’évolution de ses dépenses publiques avec son niveau de croissance. Il y a donc un décalage permanent entre les dépenses et les recettes publiques, les dépenses n’étant en 2009 couvertes qu’à hauteur de 86 %. Et pour l’État, ses recettes ne couvrent qu’à peine plus de la moitié de ses dépenses nettes.
Le Gouvernement a annoncé des mesures « d’approche » pour réduire la progression des dépenses publiques, et notamment des dépenses fiscales, des dépenses d’intervention ou des dépenses de fonctionnement de l’État et de ses opérateurs. La diminution du déficit structurel de 1 point de PIB chaque année sur la période 2011-2013, soit 20 milliards d’euros par an, auquel il s’est engagé devant le Conseil de l’Union européenne, devra être impérativement tenue si l’on souhaite stabiliser la dette publique à un horizon qui ne soit pas trop lointain.
Cet ajustement budgétaire n’est pas impossible, comme l’ont prouvé de nombreux pays, même si la Cour en reconnaît la grande difficulté. Selon quelles modalités devrait-il être opéré ?
Il revient au Gouvernement et au Parlement d’en décider, et la Cour n’a aucune intention, ni aucune légitimité, à formuler un programme qui engagerait des choix collectifs ou modifierait les conditions actuelles de l’organisation économique et sociale de notre pays.
En revanche, elle est fondée à identifier les termes du débat, à montrer le niveau des efforts à accomplir, et à formuler des pistes de nature à contribuer aux réflexions du Gouvernement et du Parlement. Elle remplit ainsi la mission d’assistance qui lui a été confiée par la Constitution.
Les termes du débat sont tout d’abord de déterminer la part respective que doivent jouer la hausse des recettes et la réduction des dépenses dans le redressement, sachant que les deux sont nécessaires. La Cour recommande que l’effort porte prioritairement sur la dépense publique, dont les effets sont plus durables pour la consolidation des comptes publics qu’un relèvement des recettes.
Cela implique une politique de maîtrise beaucoup plus ambitieuse que celle menée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la RGPP. Il faudrait réexaminer l’ensemble des dépenses publiques, et notamment les plus coûteuses : les prestations sociales, qui représentent le tiers des dépenses publiques, les rémunérations, qui en constituent le quart, mais également les dépenses d’assurance maladie, dont le déséquilibre est tout aussi fort que celui des retraites.
De telles réformes structurelles nécessitent au préalable une évaluation qui permette de s’interroger sur le bien-fondé et sur l’efficacité de l’intervention publique, afin de ne pas dégrader la qualité du service rendu. La revue générale des programmes reste devant nous. La Cour entend y prendre toute sa part dans le cadre de la nouvelle mission que lui a confiée la Constitution dans ce domaine. C’est le message que j’ai voulu porter à la connaissance du comité d’évaluation et de contrôle de votre Assemblée, qui m’a auditionné il y a quelques jours.
Les réformes structurelles nécessitent du temps et leur impact budgétaire est souvent très progressif. Il faut donc engager dès à présent des réflexions qui devraient prioritairement porter sur les dépenses d’intervention.
Depuis de trop nombreuses années, nous avons pris la mauvaise habitude de tenir un guichet ouvert pour des publics sans cesse plus nombreux. La dépense publique est donc insuffisamment sélective et conduit à un saupoudrage, comme la Cour l’a déjà souligné pour les aides personnelles au logement ou pour celles destinées au développement des entreprises.
Dans l’attente, des mesures à effet rapide et massif devraient être prises dans les meilleurs délais, quitte à ce qu’elles soient temporaires. Toute nouvelle dépense publique pourrait être gagée systématiquement et strictement. Ainsi, la satisfaction de nouveaux besoins ne serait réalisée que par redéploiement. Il serait en effet paradoxal de vouloir réduire sa vitesse à l’atterrissage, tout en appuyant en même temps sur la manette des gaz.
C’est qu’il ne faut pas attendre d’être en bout de piste pour actionner les freins. La Cour identifie plusieurs mesures qui favoriseraient une consolidation rapide des comptes publics. Il s’agit, si vous me permettez l’expression, d’une « boîte à outils » qui pourrait permettre de peser sur certains des facteurs d’évolution de la dépense publique.
En matière de dépenses de personnels, les réductions d’effectifs ont des limites inévitables. La prochaine négociation salariale pluriannuelle dans la fonction publique sera dès lors déterminante au regard de ses enjeux financiers. La hausse de 1 % de la valeur du point fonction publique représente 1,8 milliard d’euros en année pleine. D’autres pays ont déjà pris des décisions de gel, voire même de baisse des rémunérations de l’ensemble des fonctionnaires, ou des seuls hauts fonctionnaires. Toutefois, l’alignement progressif des cotisations retraite de la fonction publique sur le régime général, annoncé par le Gouvernement, pèsera déjà sur l’évolution des rémunérations versées.
Ramener les comptes du régime général de sécurité sociale à l’équilibre en 2013 nécessitera également un cocktail de mesures à effet rapide et de réformes structurelles, qui devrait répartir justement l’effort entre les assurés, les bénéficiaires d’allocations et les professionnels de santé.
La réforme des retraites annoncée par le Gouvernement devrait contribuer à ralentir la croissance des pensions, avec un relèvement de l’âge d’ouverture des droits. Mais l’indexation des pensions continuera d’entretenir le dynamisme de ces dépenses, tout comme la revalorisation des prestations légales qui accroît le rythme de progression des prestations familiales.
D’autres mesures sont possibles, comme en matière de maladie avec la baisse du prix des médicaments, une plus grande sélectivité des admissions au régime des affections de longue durée ou une non-revalorisation des actes et consultations au-delà de ce qui a été déjà décidé.
L’ensemble de ces mesures ne dispensera pas d’une action sur les recettes : il faut impérativement, selon la Cour, arrêter les baisses d’impôt et limiter la progression des dépenses fiscales qui ont augmenté à périmètre constant de plus de 5 % par an depuis 2000, et même de 8,5 % chaque année depuis 2004. Ces deux phénomènes sont en effet la cause principale du déficit structurel.
Une hausse ciblée des prélèvements obligatoires est inévitable. Elle devrait s’opérer en priorité par un réexamen des dépenses fiscales ainsi que des niches sociales. Ce serait une mesure d’équité.
De nombreux dispositifs ont été retirés depuis quelques années des dépenses fiscales, sans que les explications apportées par les ministères financiers ne convainquent totalement. Les critères d’ancienneté et de généralité manquent de pertinence et ne sont pas utilisés de manière cohérente. Leur chiffrage, qui est un exercice difficile, pourrait également progresser par une meilleure utilisation des déclarations fiscales et un croisement plus fréquent avec des données statistiques.
Cet effort ne devrait pas être limité aux 6 milliards d’euros annoncés par le Gouvernement à l’horizon 2013 : car 6 milliards d’euros, cela correspond à la hausse moyenne des dépenses fiscales chaque année, en grande partie due au dynamisme de certaines niches à législation inchangée. Un objectif de 10 milliards d’euros devrait dès lors être visé en application de la règle posée par la loi de programmation qui limite à 4 ans la durée de vie des dépenses fiscales créées à partir de 2009.
La démarche d’évaluation des dépenses fiscales et de suppression de celles qui sont inefficaces pourrait être complétée par un abaissement du plafond global des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu qui a été instauré en 2009, ou une réduction forfaitaire de tous les crédits et réductions d’impôts. C’est le désormais fameux « coup de rabot ». Nous recommandons que, si de telles mesures devaient être décidées, elles soient appliquées de manière systématique et uniforme, et en priorité aux réductions et crédits d’impôts.
Pour répondre plus précisément à votre question, monsieur le président de la Commission des finances, il n’y a ni norme ni réel contrôle sur les dépenses fiscales. La règle de gage n’a pas vraiment fonctionné. La liste est instable : certaines années, on passe d’une dépense fiscale à une modalité de calcul de l’impôt.
La Cour recommande donc que l’on renforce la règle de gage, que l’on établisse une norme spécifique, que la liste ne soit plus établie sur simple décision ministérielle et qu’elle soit davantage ciblée afin de ne pas représenter des guichets ouverts.
Le retour à l’équilibre des comptes sociaux pourra quant à lui difficilement être obtenu sans un apport de nouvelles recettes. Il doit être recherché en priorité dans un réexamen systématique des exonérations de cotisations et des réductions d’assiette. On pourrait agir en particulier sur les dispositifs d’entreprise, comme l’intéressement ou la protection sociale complémentaire, qui sont générateurs de fortes inégalités entre entreprises et donc entre salariés.
Enfin, l’apport des actifs du Fonds de réserve pour les retraites à la CADES décidé par le Gouvernement ne fournit pas de réponse au traitement de la dette accumulée par l’ACOSS au titre de la maladie. Cette dette devrait rapidement être transférée à la CADES, ce qui imposera sans doute de combiner un relèvement du taux de la CRDS et un allongement de la durée de vie de la dette sociale, à condition qu’elle soit remboursable dans un délai maximum de 10 à 15 ans.
La France est entrée en 2009 dans une récession d’une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, lestée de finances publiques déjà fortement dégradées. Elle en ressort aujourd’hui avec des niveaux de déficit et d’endettement sans précédent et qui ne lui permettraient pas de faire face à un éventuel retournement conjoncturel ou à une nouvelle crise financière sans craindre les réactions de ses créanciers – je ne parle pas des marchés : à partir du moment où nous sommes un pays endetté, nous dépendons pour partie de prêteurs.
Les marges de manœuvre de l’État se trouvent progressivement réduites par l’effet boule-de-neige de notre endettement. Plus nous attendrons, plus les efforts à réaliser seront importants parce qu’il faudra payer les charges d’intérêts de notre dette.
Il faut bien comprendre que le coût de l’inaction est supérieur à celui des mesures immédiates : la dette a augmenté de près de 15 points de PIB entre fin 2007 et fin 2009, ce qui génère chaque année des charges d’intérêts supplémentaires de 10 milliards d’euros au taux d’intérêt théorique de 3,5 %. 10 milliards, cela représente chaque année deux tiers des aides personnelles au logement, qui sont versées à plus de 6 millions de personnes.
C’est pourquoi il faut engager dès 2011 la consolidation des comptes publics. C’est le principal message que la Cour souhaite délivrer avec ce rapport et j’ai bon espoir qu’il sera entendu.
Ce message ne doit toutefois pas nous pousser au pessimisme, bien au contraire. Il nous oblige à être lucides sur les efforts que nous devrons accomplir pour redresser notre situation financière et à reconnaître également que la France dispose de nombreux atouts pour y parvenir. Il est désormais nécessaire de s’engager de manière crédible et durable dans cette voie pour donner à tous la conviction d’un effort collectif, partagé et équitable. C’est à cette condition que les comportements d’épargne de précaution défavorables à la croissance pourront être débloqués et que la confiance dans la situation financière de notre pays sera confortée.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Votre présentation n’incite pas à un optimisme béat, monsieur le Premier président, mais elle est lucide. Nous sommes confrontés à une dégradation de notre solde structurel, c’est-à-dire de l’écart entre les coûts et les recettes.
Je prendrai deux exemples pour illustrer cette dégradation en 2009.
Premièrement, tout le monde croit que le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux permet de stabiliser la masse salariale des fonctionnaires. C’est faux. L’exécution 2009 fait apparaître un dérapage de 600 millions d’euros par rapport à la prévision en loi de finances initiale. Entre l’exécution 2008 et l’exécution 2009, l’augmentation est de 800 millions. Dans ces conditions, l’objectif d’une progression « zéro valeur » de la masse salariale, qui représente plus de 80 milliards d’euros dans le budget de l’État, vous paraît-il tenable et à quelles conditions ? Le gel du point d’indice, alors que l’on sera amené en parallèle à augmenter progressivement le taux de cotisation des fonctionnaires, pose un problème.
Deuxièmement, la dépense fiscale ne peut continuer ainsi. Par exemple, nous avons tous, à tour de rôle, défendu l’article 200 quater du code général des impôts, qui vise à favoriser les économies d’énergie et des énergies renouvelables dans le logement. La prévision de dépenses en loi de finances initiales pour 2009 était de 1,3 milliard d’euros. L’exécution en est à 2,8 milliards. À l’automne 2008, nous avons convoqué et interrogé pendant deux heures les ministres responsables pour exiger qu’ils revoient les arrêtés listant les équipements éligibles à ces avantages fiscaux. On nous a fait des avalanches de promesses, on nous a certifié que la dépense serait maîtrisée. Au bout du compte, elle ne l’est pas ! Et l’on pourrait multiplier les exemples...
Le Premier ministre vient de publier une courageuse circulaire qui interdit aux ministres d’égrener des mesures fiscales ou sociales dans leurs projets de loi, celles-ci étant réservées aux lois de finances et aux lois de financement.
Le moment n’est-il pas venu de faire comme en Allemagne et de revenir à des subventions ? Lorsque l’on veut aider telle ou telle activité, on la subventionne ; et, si les crédits sont épuisés au mois d’octobre, on attend le mois de janvier. Ne serait-il pas pertinent d’appliquer ce système, par exemple, au dispositif d’aide à l’accession sociale au logement ? Pourquoi avoir transformé un système de subventions inscrites au budget de l’État, qui a fonctionné pendant 25 ans, en un crédit d’impôt que l’on ne maîtrise plus, toutes les dépenses étant en guichet ?
Dans le cadre du programme de stabilité, pensez-vous qu’une réduction en volume est envisageable, au vu de la tendance moyenne des dernières années qui se situait à un peu plus de deux points en volume, l’inflation s’y ajoutant. Le programme transmis à Bruxelles prévoit 0,6 %. Ce chiffre est-il à l’échelle de l’ambition fixée ?
Le déficit de cette année est à huit points de PIB, un point représentant presque 20 milliards d’euros. L’objectif est de passer à trois points en 2013, soit 60 milliards. Il y a donc 100 milliards à trouver.
Mais parlons plutôt de 2011, où il faudra passer de 8 à 6 % en trouvant 40 milliards d’euros. Un tel effort vous paraît-il possible en matière de dépenses ?
La dépense publique totale – État, sécurité sociale, collectivités – s’élève à 1 000 milliards d’euros. Depuis des années, ce montant augmente d’un peu plus de 4 % en valeur, soit 40 milliards tous les ans. Il faut absolument diviser cette progression par deux et arriver à 20 milliards d’euros.
Pour ce qui concerne le budget de l’État, les dépenses de fonctionnement sont mineures par rapport à la masse salariale. Pour avoir participé aux exercices de RGPP, je puis témoigner que l’on n’a traité qu’une toute petite partie de la question de la maîtrise de la dépense.
Les dépenses d’intervention – plus de 60 milliards d’euros – représentent un ensemble important. Dans une lettre sur les perspectives pluriannuelles qu’il a adressée aux ministres, le Premier ministre a souhaité qu’on les réduise de 10 % en trois ans, avec un abaissement de 5 % dès 2011.
Vous avez également évoqué, monsieur le Premier président, différentes mesures, comme la non-indexation de certaines prestations ou le resserrement des systèmes de guichet. Pourriez-vous nous en dire plus au sujet des travaux que la Cour mène sur ces différentes hypothèses ?
En matière de recettes, pensez-vous que la seule action sur la dépense fiscale, à hauteur de 6 milliards d’euros, c’est-à-dire 0,3 point de PIB, est suffisante ?
Pour la reconstitution naturelle des recettes, on table sur un taux d’élasticité de 1,2 % qui, vous l’avez remarqué, n’a jamais été observé par le passé en période de sortie de crise. Quelles hypothèses d’élasticité la Cour serait-elle encline à proposer ?
Au-delà de la reconstitution de recettes par le biais de l’interdiction de baisser les impôts et de la réduction de certaines niches fiscales, vous avez implicitement envisagé des hausses d’impôt. Quelles sont les propositions de la Cour en la matière ?
La conjugaison d’un effort sur les dépenses – incluant les dépenses d’intervention, ce qui est très difficile – et d’un effort sur les recettes vous paraît-elle à la hauteur de l’enjeu, à savoir la réduction de 5 points de PIB pour passer de 160 à 60 milliards d’euros de déficit à l’horizon 2013.
S’agissant des collectivités locales, l’exécution 2009 fait apparaître un phénomène curieux. Le plan de relance comportait une mesure d’incitation à l’investissement par le biais du Fonds de compensation de la TVA, le FCTVA. Or, si cette mesure s’est révélée très efficace – en consommation, par rapport à une prévision de 2,5 milliards d’euros de remboursements supplémentaires, on est passé à 3,8 milliards –, le besoin de financement des collectivités locales a en même temps fortement diminué, comme si celles-ci avaient stocké leurs remboursements au titre du FCTVA en fin d’année 2009. Peut-on espérer qu’elles utiliseront ces sommes, conformément aux conventions qu’elles sont signées, dans le courant de l’année 2010 ?
Si l’on additionne les dotations aux collectivités locales et les exonérations et dégrèvements d’impôts pris en charge par l’État, on arrive à 70 milliards d’euros, soit 20 % du budget de l’État, ce qui en fait le premier poste. Compte tenu des problèmes auxquels nous sommes confrontés, il est tout à fait légitime de geler, en « zéro valeur », l’ensemble de ces dotations et exonérations.
Cela dit, la situation est très différente selon les types de collectivités. La dépense continue d’augmenter dans les intercommunalités. En raisonnant en dépenses consolidées – c’est-à-dire communes et intercommunalités confondues –, la dépense par habitant des 10 % qui dépensent le moins est trois fois inférieure à celle des 10 % qui dépensent le plus. Cette observation est parfaitement corrélée au niveau des ressources. Comme les ressources sont principalement constituées de dotations, nous devons avoir le courage d’aller beaucoup plus loin dans la péréquation.
Pourtant, quelle que soit la péréquation, quels que soient les efforts des exécutifs locaux – qui, globalement, se montrent très responsables –, l’échelon du département est susceptible de poser un réel problème. En effet, une partie des guichets, dont le Premier président a souligné le fonctionnement non limitatif et non contrôlé, a été transférée aux départements : l’allocation personnalisée d’autonomie – APA –, l’ensemble constitué par le RMI et le RSA, la prestation compensatoire du handicap – PCH –. Quelle analyse la Cour porte-t-elle sur la situation des finances départementales d’ici à 2013 ?
M. Yves Bur. Nous avons maintenant la conviction que c’est à une mobilisation générale contre les déficits que l’on nous appelle, tant la situation est tendue.
Dans tous ses rapports, la Cour des comptes déploie une sorte de pédagogie de la répétition en faveur de pratiques qui ont du mal à s’installer dans notre pays. Il s’agit aujourd’hui de savoir comment et à quel rythme nous devons engager les réformes qui nous permettront de conserver une crédibilité par rapport aux politiques entreprises par nos voisins. Ceux-ci adoptent l’un après l’autre des plans de rigueur ou d’austérité. La France ne pourra pas longtemps donner le sentiment qu’elle s’exonère de cet effort.
La Cour laisse aussi entendre que le temps n’est plus aux demi-mesures. Comment fermer le guichet ouvert que constituent à la fois les dépenses publiques et les dépenses sociales ?
Pour ce qui est des comptes sociaux, partant d’un déficit structurel de 31 milliards d’euros, vous estimez que l’on pourrait parvenir à une économie de 12,2 milliards à l’horizon 2013, moyennant une limitation de l’ONDAM à 2 %, au lieu des 2,9 et 2,8 % proposés pour 2011 et 2012, et gel des prestations légales de retraite et de famille.
Même avec ces mesures extrêmes, le déficit resterait de près de 17 milliards d’euros.
La Cour estime-t-elle qu’une progression de l’ONDAM de 2,9 et 2,8 % en 2011 et 2012 reste soutenable pour nos finances sociales ?
Le rapport laisse également entendre que l’on pourrait réaliser une économie de 10 milliards d’euros sur les exonérations et les niches sociales. Pourriez-vous détailler ce point ? Quel impact la forfaitisation des exonérations pourrait-elle avoir sur la politique de l’emploi ?
Vous suggérez également de supprimer les niches liées aux dépenses de prévoyance dans les entreprises. Ne craignez-vous pas que, ce faisant, nous réduisions la qualité de la couverture sociale des salariés ?
En matière d’assurance maladie, avez-vous chiffré les marges d’économies encore exploitables, tant au niveau ambulatoire qu’au niveau hospitalier ? La Cour recommande une politique du médicament qui s’alignerait sur les efforts entrepris en Allemagne et en Grande-Bretagne, pour une économie d’environ 2 milliards d’euros. Ne devrait-on pas étendre les économies à l’ensemble des prescriptions ? Par exemple, ne conviendrait-il pas de généraliser et de renforcer les CAPI – contrats d’amélioration des pratiques individuelles –, que l’assurance maladie a partiellement initiés l’année dernière.
Pour ce qui est des hôpitaux, pensez-vous que les contrats de retour à l’équilibre financier sont réellement respectés et que leur évolution est plus positive que celle du dispositif précédent ? Là aussi, quelle est la marge qui permettra de ramener les dépenses à un niveau soutenable ?
Plus généralement, pourrons-nous éviter une augmentation des contributions d’assurance maladie, même si nous faisons une partie du chemin par l’optimisation de la dépense et une autre par un retour à meilleure croissance ?
En tout état de cause, votre rapport montre que la situation de l’assurance maladie reste extrêmement tendue et que le déficit, pour l’essentiel, se poursuivra dans les années à venir.
M. le président Pierre Méhaignerie. En novembre 2007, l’ONDAM avait progressé moins vite que la richesse nationale pour la deuxième année consécutive. Et nous pensions tous transférer 1,5 point de cotisation UNEDIC vers les régimes de retraite. On le voit : la crise a totalement changé la donne.
M. Didier Migaud. La Cour des comptes ne peut pas se substituer aux responsables politiques. Elle ne peut que les éclairer dans leurs choix, par exemple en inventoriant les économies possibles et en les chiffrant. Plusieurs pistes sont décrites dans notre rapport, que je ne détaillerai donc pas ici. La situation exige d’agir à la fois sur les dépenses et sur les recettes, tant pour le budget de l’État que pour celui de la Sécurité sociale. La norme d’évolution des dépenses n’est pas respectée. Si nous voulons tenir nos engagements européens et contenir notre endettement, il faut aller encore plus loin dans la maîtrise des dépenses et vraisemblablement accroître les recettes dès lors que la seule action sur les dépenses ne suffira pas.
S’agissant du déficit des régimes de retraite, la Cour insiste sur le fait que la situation est peut-être plus difficile encore que le COR ne l’a dit dans la mesure où il existe déjà un déficit. Des mesures immédiates doivent être prises, qui, selon nous, doivent jouer sur l’ensemble des paramètres : âge de départ, durée de cotisation, montant et assiette des cotisations. Il ne serait pas raisonnable d’en omettre un.
Le déficit de l’assurance maladie est lui aussi préoccupant. Là encore, il convient d’agir à la fois sur les dépenses et sur les recettes. Mon prédécesseur, Philippe Séguin, et la présidente de la sixième chambre, Rolande Ruellan, avaient suggéré des pistes concernant certaines exonérations de cotisations sociales au profit des entreprises. Nous avons chiffré l’ensemble de ces mesures. Il appartient maintenant au Gouvernement de faire des choix. Si vous souhaitez que la Cour vous apporte des précisions complémentaires sur tel ou tel élément de chiffrage, elle y est tout à fait disposée, dans la limite bien évidemment des moyens dont elle dispose. Lors de la présentation en septembre prochain de notre rapport sur l’exécution de la loi de financement de la sécurité sociale, nous formulerons de nouvelles recommandations.
Pour ce qui est des dépenses fiscales, le montant annoncé de 6 milliards d’euros nous paraît sous-estimé, d’autant qu’on ne sait pas exactement ce qu’il recouvre. Il est avéré que ces dépenses augmentent nettement plus que les dépenses budgétaires : il faut contenir cette évolution et certaines de ces dépenses, inévitablement, devront être remises en question. Les propositions de Gilles Carrez nous paraissent aller tout à fait dans le bon sens. Ce n’est pas d’hier que des dépenses budgétaires ont été transformées en dépenses fiscales. Il serait aujourd’hui pertinent de rebudgétiser certaines dépenses, en leur fixant des normes d’évolution précises. De même, certaines niches fiscales, déjà ouvertes, ont été étendues, se révélant au total extrêmement coûteuses. L’initiative du Premier ministre visant à ce qu’aucune dépense fiscale ne puisse plus être proposée hors loi de finances ou loi de financement de la sécurité sociale va dans le bon sens mais on ne pourra se dispenser de remettre à plat certaines de ces dépenses, notamment pour en évaluer la pertinence au regard de leur objectif initial.
S’agissant de la masse salariale de la fonction publique, nous avons chiffré ce que représente son augmentation, ce que pourrait représenter le gel du point d’indice ou des primes. Nous n’avons fait qu’inventorier un ensemble de mesures, de façon que les responsables politiques puissent faire leurs choix en toute connaissance de cause.
Ramener l’augmentation de l’ONDAM de 3 % à 2,9 % ne représente que 150 millions d’euros d’économies à mettre en regard des dix milliards d’euros du déficit. C’est dire qu’il faut agir sur l’ensemble des paramètres et être plus sélectif dans les politiques conduites.
Voilà des années que la Cour des comptes insiste sur la nécessité de mieux maîtriser les dépenses publiques. Il n’y a là rien de nouveau mais la répétition finira-t-elle peut-être par avoir vertu pédagogique…
S’agissant des collectivités territoriales, nous n’anticipons pas de reprise particulière des investissements locaux. Les remboursements anticipés de TVA au titre du FCTVA leur ont servi à assainir le financement d’investissements déjà prévus mais n’ont pas créé de stock pouvant enclencher en 2010-2011 une dynamique supplémentaire. Nous reviendrons sur ce point lors de la présentation de notre rapport sur le plan de relance.
Enfin, sachez que la Cour travaille actuellement sur la prime pour l’emploi. Des travaux antérieurs avaient montré que cette mesure, peu lisible, était insuffisamment ciblée et d’un coût élevé pour un bénéfice relativement faible auprès de ceux qui en auraient le plus besoin et qui connaissent d’ailleurs mal leurs droits ou plus exactement n’en ont connaissance qu’avec un décalage dans le temps.
M. Pierre-Alain Muet. Le constat lucide de la Cour des comptes est sans appel. La crise n’explique qu’un tiers du déficit actuel. Celui-ci, qui représente 7,5 % du PIB, ne résulte qu’à hauteur de 1,5 % de la conjoncture et de 1 % des mesures du plan de relance. Les 5 % restants constituent un déficit structurel, accumulé avant la crise. Contrairement à d’autres pays européens, la France présentait déjà en 2008 un fort déficit qui bien entendu n’a pu que se creuser avec la crise. Le rapport de la Cour nous apprend qu’un point de déficit structurel supplémentaire entre 2008 et 2009 s’explique à hauteur de 0,6 point par des baisses de prélèvements et pour le reste par des dépenses supplémentaires. Si notre pays se retrouve dans la situation qui est la sienne aujourd’hui, c’est non seulement parce que les récents gouvernements n’ont pas su réduire les déficits en période de croissance mais les ont aussi laissés dériver ensuite en sus des effets propres de la crise.
La comparaison avec l’Allemagne est particulièrement éclairante : en 2004-2005, celle-ci présentait comme la France un déficit excessif. Elle l’a ramené à zéro avant la crise et ne l’a pas laissé s’aggraver ensuite, autrement que du seul fait de la crise. Et en 2009, il ne représentait que 3,3 % de son PIB. Comme l’indique la Cour dans son rapport, alors que la récession a été moindre en France que dans les autres pays de la zone euro, l’augmentation du déficit y a été identique. Et ce n’est pas le plan de relance qui peut l’expliquer car il n’a pas été de plus grande ampleur chez nous – il a même été légèrement plus faible. La hausse du déficit observée en France n’a été dépassée que dans les États les plus affectés par la crise, comme l’Irlande ou l’Espagne. Un déficit primaire passant de 0,5 % à 5 % du PIB, cela ne s’était jamais vu ! C’est dire que notre pays finance aujourd’hui par l’emprunt non seulement les intérêts de sa dette mais aussi une bonne partie de ses dépenses courantes, en tout cas la moitié des dépenses du budget général de l’État. Ce n’est pas tenable ! Le Gouvernement a beau jeu de tenir des discours sur la rigueur et les mesures futures à prendre pour maîtriser les déficits. Le bilan de ce qui a été fait depuis quelques années est accablant.
Le rapport de la Cour permet aussi de couper court aux allégations selon lesquelles les collectivités locales seraient mal gérées. En effet, elles seules sont parvenues à réduire leur déficit en 2009, le ramenant de 0,4 % à 0,3 % sachant en outre qu’elles ne peuvent financer par l’emprunt que leurs investissements.
Selon la Cour, le déficit devrait représenter 7 % du PIB en 2011 et encore plus de 6 % en 2013. À cet horizon, la dette atteindrait, selon elle, 2 000 milliards d’euros, 1 800 milliards seulement selon le Gouvernement. Même dans l’hypothèse la plus optimiste, la dette de la France aura donc doublé en dix ans. En effet, à l’été 2002, elle était inférieure à 900 milliards d’euros. À l’avenir, le service de la dette représentera à lui seul 3,8 points de PIB soit davantage que le déficit des retraites ! La politique conduite ces dix dernières années a vraiment été irresponsable.
Dans le programme de stabilité que le Gouvernement a adressé à Bruxelles, il fait l’hypothèse d’une croissance annuelle de 2,5 % sur la période 2011-2013. Or, tous les organismes internationaux sont beaucoup moins optimistes : la Commission européenne ne prévoit que 1,5 % et le FMI 1,8 %. Il est donc particulièrement imprudent de fonder des prévisions de réduction du déficit sur des hypothèses aussi peu réalistes. Il faut d’ailleurs remarquer que les prévisions du Gouvernement varient selon la perspective dans laquelle il se place. Lorsqu’il s’agit de réduire les déficits, il anticipe que tous les effets de la crise vont être immédiatement annulés et n’hésite pas à retenir des hypothèses particulièrement optimistes, voire irréalistes. Mais lorsqu’il s’agit des déficits des régimes de retraite, c’est alors le pessimisme qui est de mise avec des prévisions de croissance ne dépassant pas 1,5 % ou 1,8 %. Or, avec une croissance annuelle de 2 % seulement, inférieure donc à celle retenue par le Gouvernement pour le court terme, une bonne part du déficit des retraites serait résorbée. Je ne dis pas que des réformes ne sont pas nécessaires, seulement que la manière dont sont effectuées les prévisions est pour le moins orientée et discutable.
Il est faux de laisser accroire que le produit des prélèvements obligatoires augmentera de deux points de PIB en 2013 grâce à une élasticité des recettes à la croissance de 2 en 2010 et de 1,2 les années suivantes. Une telle élasticité n’a jamais été constatée par le passé. Une telle augmentation du produit ne pourra donc être obtenue que par une hausse du taux des prélèvements obligatoires. J’aimerais connaître l’avis de la Cour des comptes sur ce sujet.
Puisque j’ai entendu invoquer le courage pour s’attaquer aux niches fiscales, il en est une à laquelle il faudrait s’intéresser tout particulièrement. C’est la niche dite « Copé », dont le coût, évalué à 4,3 milliards d’euros en 2008, passerait à 12,5 milliards, d’après le rapport. Si l’on cherche des économies, il en est que l’on peut faire sans problème…
M. le président Pierre Méhaignerie. La vérité exige de dire que les dépenses des collectivités locales ont fortement augmenté et que les dotations de l’État à leur profit, y compris le remboursement des exonérations et dégrèvements de taxes, ont elles aussi beaucoup augmenté. Il serait trop facile aux collectivités de s’exonérer de leurs propres responsabilités.
M. Hervé Mariton. Notre collègue Pierre-Alain Muet serait-il prêt à soutenir des mesures de redressement analogues à celles adoptées par l’Allemagne ?
Nous avons bien compris, monsieur le Premier président, que l’effort de consolidation, tel qu’aujourd’hui calibré, était insuffisant. L’objectif aujourd’hui annoncé pour les comptes publics à l’horizon 2013 est-il atteignable ou non ? Quel est l’avis de la Cour sur ce point ? De même, pourrait-elle nous donner un ordre de grandeur de la réduction du déficit nécessaire et possible ? Qu’est-il raisonnable d’escompter ? Enfin, comment l’effort pourrait-il se répartir entre recettes et dépenses ? La Cour n’a certes pas à se prononcer sur l’opportunité politique de telle ou telle mesure mais elle n’hésite pas à dire qu’il convient d’agir d’abord sur les dépenses. Quel objectif raisonnable s’assigner ? Ni le Gouvernement ni le Parlement, bien que s’y étant essayés, n’arrivent à formuler en France de propositions d’économies à la hauteur de ce qui serait nécessaire, quand d’autres pays y parviennent. La Cour pourrait-elle nous y aider ? Vous avez évoqué tout à l’heure, monsieur le Premier président, l’évolution des dépenses courantes. Pourriez-vous donner nous donner quelques exemples « pathologiques » d’augmentation de ces dépenses : je parle des dépenses courantes au sens strict. Et quelles seraient selon vous les possibilités d’économies significatives ?
La Cour des comptes, le Gouvernement et le Parlement ont-ils aujourd’hui une même définition du déficit primaire et du déficit structurel ? Lors de la présentation du budget comme de divers rapports de la Cour, on a assisté à des échanges entre pouvoirs publics ne nous aidant pas à y voir clair ni nos concitoyens à bien comprendre. N’y aurait-il pas des progrès à réaliser ?
Pour assurer le financement d’actions au profit des personnes âgées, un gouvernement antérieur avait supprimé le caractère chômé du lundi de Pentecôte, ce qui avait ensuite été transformé en suppression d’un jour de RTT. La suppression d’un autre jour de RTT serait-elle, selon vous, efficace pour combler une partie de la dette sociale ou couvrir d’autres dépenses sociales ?
M. Michel Bouvard, président. Les dépenses fiscales sapent depuis longtemps les recettes budgétaires de l’État puisqu’elles sont passées de 56 milliards d’euros en 2000 à 73 milliards en 2010, auxquels il faudrait ajouter les 2 milliards de celles du plan de relance. Il est difficile d’évaluer précisément le volume de dépenses représentées par chaque niche : dans les rapports annuels de performances, les RAP, trop de cases demeurent encore vides ! Peut-on progresser en ce domaine et la Cour pourrait-elle nous aider à évaluer l’efficacité de certaines de ces dépenses ? En effet, au-delà de l’indispensable coup de rabot, il faudra carrément supprimer les niches dont l’efficacité ni économique ni sociale n’a été avérée.
Ma deuxième question a trait aux opérateurs – vous n’en avez pas parlé dans votre intervention, monsieur le Premier président, mais elle est évoquée dans le rapport. Ce que l’on appelle dans la comptabilité nationale les organismes divers d’administration centrale, les ODAC, souvent des opérateurs, engagent désormais 71 milliards d’euros de dépenses, lesquelles ont crû de 11 % en volume au cours de l’exercice écoulé, dont 9,8 % pour le seul fonctionnement. Tout comme la dépense fiscale, c’est un moyen de contourner la norme budgétaire. Éric Woerth avait en son temps préconisé avec courage l’application aux opérateurs des plafonds d’autorisation d’emplois ainsi que de la règle du non-remplacement d’un départ en retraite sur deux. Comment limiter aujourd’hui le dérapage des dépenses de ces organismes, qui ont dérivé de sept milliards d’euros en un seul exercice ?
L’annuité de la dette a diminué cette année du fait de la baisse des taux d’intérêt. Mais de 2006 à 2009, la part à rembourser est passée de 16,9 à 26,7 % et sur deux ans, de 29 à 36,3 %. La durée de nos emprunts a été raccourcie pour nous permettre de bénéficier pleinement de la baisse des taux mais sait-on l’incidence qui en résulterait en cas de remontée des taux ? Si la structure actuelle de notre dette nous procure un gain immédiat, cela va, hélas, de pair avec une fragilité accrue dans l’avenir.
Enfin, de 2008 à 2009, le découvert de trésorerie de l’ACOSS est passé de 17,3 à 24,1 milliards d’euros. La mesure de ce découvert au 31 décembre de l’année est-elle toutefois pertinente ? Ne vaudrait-il pas mieux en calculer la moyenne quand on sait que certaines avances sont aujourd’hui effectuées sur 364 jours ? …
Mme Marisol Touraine. Le tableau que vous avez dressé, monsieur le Premier président, est implacable, d’autant qu’il a l’objectivité d’un tableau clinique. La situation actuelle de nos comptes publics est effroyable. Si on ne peut écarter l’incidence de la crise, il serait éminemment réducteur d’en faire le seul facteur explicatif. En même temps que des mesures conjoncturelles d’urgence, il faut prendre des mesures structurelles, lesquelles auraient, à l’évidence, dû être prises plus tôt.
La majorité ne cesse de dire, et le président de la Commission des affaires sociales a lui-même repris ce discours tout à l’heure dans son intervention liminaire, que la dette sociale serait le sujet le plus préoccupant et qu’il faudrait essentiellement agir en la matière. S’il n’est pas question pour nous de nier l’ampleur de cette dette, et nous avons dit à plusieurs reprises, même si certains ont fait semblant de ne pas l’entendre, qu’il fallait engager une réforme structurelle à la fois en matière de retraites et d’assurance maladie, il est clair que le problème des déficits publics dans notre pays ne se résume pas à celui des comptes sociaux. Il n’est pas acceptable de faire croire à nos concitoyens que c’est par la réduction des dépenses sociales que l’on parviendrait pour l’essentiel à réduire les déficits.
Le projet de réforme des retraites du Gouvernement permettrait d’atteindre l’équilibre à l’horizon 2018 mais ne réglerait pas le problème du déficit des deux ou trois prochaines années, nous avez-vous dit, monsieur le Premier président. J’ajoute, pour ma part, qu’au-delà de 2018, les déficits seront de retour : preuve, s’il en était besoin, de la fragilité de l’équilibre atteint. Il faut donc trouver des ressources supplémentaires, avez-vous ajouté, n’excluant à court terme ni des hausses de fiscalité ni une réduction des niches sociales. La suppression, totale ou partielle, des exonérations de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises sur les salaires jusqu’à 1,6 fois le SMIC, constitue bien sûr un gisement considérable de ressources supplémentaires. Certains estiment toutefois que cela fragiliserait l’emploi dans notre pays. Qu’en pense la Cour ?
S’agissant de la CADES, vous avez indiqué qu’il serait vraisemblablement nécessaire à la fois de reporter la date butoir de 2021 à laquelle la dette est censée avoir été apurée et d’augmenter le taux de la contribution au remboursement de la dette sociale, la CRDS. Vous paraît-il impensable que l’effort repose tout entier sur une augmentation de la CRDS ? En effet, est-il raisonnable de continuer de transférer sur les générations futures le poids de notre dette sociale ?
Enfin, vous semblez assez réservé quant à une augmentation de la contribution sociale généralisée, la CSG. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ?
M. Jacques Domergue. Il aura fallu attendre trois quarts d’heure, monsieur le Premier président, pour relever dans votre présentation quelques notes d’espoir. Le bilan que vous avez dressé est, hélas, objectif. La crise n’explique qu’un tiers des déficits actuels, vous l’avez dit, et notre pays est confronté à des problèmes structurels qui pèsent lourdement dans nos comptes. Je soutiens les mesures proposées par le Gouvernement pour les réduire. Mais sont-elles suffisantes ? Cela étant, lorsqu’on propose d’aller plus loin que ce qui a été proposé jusqu’à présent, non seulement l’opinion publique est très réticente mais on se heurte aussi à un manque de cohésion nationale. Nos collègues socialistes qui ont la critique facile sont, hélas, souvent aux abonnés absents lorsqu’on leur demande de s’associer à une politique véritablement réformatrice…
Une autre question est de savoir si notre pays a les moyens d’assumer sa politique sociale. Mais dès qu’on évoque la simple hypothèse de revenir sur certains acquis, la levée de boucliers est immédiate. Ne faudrait-il pas profiter de la conjoncture actuelle, comme l’ont fait de nombreux pays, pour réformer l’architecture organisationnelle de l’État et faire en sorte que celui-ci facilite l’activité alors qu’aujourd’hui, il l’entrave plutôt ? Le problème principal de la France, c’est en effet le manque d’activité et de compétitivité par rapport à ses voisins. Si nous ne comblons pas ce fossé, jamais nous ne pourrons financer nos dépenses sociales.
M. Alain Rodet. Vous pointez dans votre rapport, monsieur le Premier président, la sous-estimation des dépenses militaires. Nous nous doutions bien que la mise en œuvre des mesures du livre blanc serait extrêmement délicate. Je m’interroge, pour ma part, sur la non-comptabilisation de la base d’Abou Dhabi. Est-il vrai qu’aucune provision n’ayant été constituée à cet effet, ce serait les Émirats arabes unis qui pourvoiraient au co-financement de cet investissement ?
Vous vous inquiétez du financement des mesures du Grenelle de l’environnement. Dois-je rappeler ici à notre collègue Hervé Mariton qu’il a été le rapporteur, zélé mais bien imprudent, de la cession du réseau autoroutier au privé, alors que les recettes qui en étaient retirées permettaient de financer les transports terrestres ?
Enfin, un dernier mot à l’intention de notre rapporteur général, maire du Perreux-sur-Marne, dont je sais qu’il n’est pas un fervent adepte de l’intercommunalité. Avant de lancer une charge contre ce type d’organisation, il devrait se souvenir que les structures intercommunales ont dû prendre en charge l’environnement opérationnel et les transports collectifs, deux secteurs qui représentent des dépenses extrêmement lourdes.
M. Guy Malherbe. Monsieur le Premier président, vous avez utilisé l’image d’un gros-porteur lancé à pleine vitesse qui aurait du mal à freiner à l’atterrissage. On pourrait aussi prendre celle d’un paquebot qui, en vitesse de croisière, aurait été surchargé par les gouvernements successifs depuis une trentaine d’années. La Cour pourrait-elle chiffrer le coût cumulé de l’abaissement de l’âge de la retraite de 65 ans à 60 ans et évaluer son incidence sur les finances publiques à ce jour ? De même, quel a été le coût cumulé du passage aux 35 heures ?
La masse salariale dans la fonction publique est elle aussi un paquebot difficile à ralentir sur sa lancée. Elle évolue en effet en fonction des effectifs, de la valeur du point d’indice, mais aussi de l’incontournable GVT – glissement vieillesse technicité. La Cour a-t-elle évalué le poids du seul GVT dans cette masse salariale ? Quelles économies faudrait-il faire, égales donc au moins à l’incidence financière du GVT, pour vraiment contenir à zéro la croissance de ces dépenses ? Quelles pistes la Cour pourrait-elle proposer en ce sens ?
Enfin, la Cour a-t-elle évalué l’incidence sur les comptes de la suppression des deux premiers acomptes d’impôt sur le revenu en 2009 ?
M. Olivier Carré. Nous n’avons pas abordé la question du chômage, si ce n’est indirectement quand le président de la commission des affaires sociales a rappelé qu’on avait nourri un temps l’espoir de transférer une partie des cotisations UNEDIC vers les cotisations retraites, mesure qui n’a, hélas, vu la conjoncture, pu voir le jour. A-t-on évalué précisément l’incidence de la hausse du chômage sur les comptes, notamment sociaux et, corrélativement, en fonction d’une élasticité elle aussi à évaluer, celle que pourrait avoir sa diminution sur l’amélioration de ces comptes ?
Enfin, que les ressources de TVA, hors effet de l’application du taux réduit à la restauration, aient diminué plus vite et plus fortement que le PIB, alors que la consommation s’est maintenue, demeure pour moi une énigme. Comment la Cour l’explique-t-elle ? Poursuit-on la réflexion sur les problèmes de TVA intracommunautaire et les risques de carrousels ?
M. Didier Migaud. Je vous remercie de toutes ces questions. Nous sommes tout à fait disposés à revenir travailler avec vous dans le cadre de la préparation de la prochaine loi de finances et de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, si vous souhaitez des informations complémentaires que nous soyons en mesure de vous apporter.
Je ne reviendrai pas sur les divers commentaires politiques que les uns et les autres avez pu formuler, pour m’en tenir aux prérogatives de la Cour.
Si la situation financière des collectivités territoriales s’est globalement améliorée, cela tient d’une part aux remboursements anticipés de TVA au titre du FCTVA, d’autre part à une certaine décélération dans l’augmentation de leurs dépenses de fonctionnement, qui n’en demeure pas moins élevée. Alors qu’elles avaient augmenté en moyenne de 6,4 % par an entre 2002 et 2007, leur progression a été limitée à 5,6 % en 2008 et 3,7 % en 2009.
Il est certes arrivé par le passé que l’élasticité soit supérieure à 1,2, hypothèse retenue par le Gouvernement. Mais un tel niveau a rarement été au rendez-vous dans les années d’après-crise. C’est ainsi que la Cour est conduite à juger volontaristes les hypothèses gouvernementales.
Monsieur Mariton, nous considérons que les hypothèses du Gouvernement sont optimistes aussi bien sur l’élasticité des recettes que sur l’évolution des dépenses. C’est pourquoi nous pensons qu’il faudra aller au-delà de ce qui est aujourd’hui prévu pour atteindre l’objectif fixé. Nous estimons toutefois que le redressement est tout à fait possible si des mesures immédiates, plus importantes, sont effectivement prises. Oui donc, l’objectif est « tenable », vraisemblablement pas à partir des hypothèses actuelles, et à la condition qu’on agisse à la fois sur les dépenses et sur les recettes. Dans quelle proportion ? Les économistes que nous avons rencontrés avec Christian Babusiaux pour préparer ce rapport, s’accordaient sur un ratio 1/4 recettes - 3/4 dépenses. Ce n’est pas à la Cour qu’il appartient d’effectuer de tels arbitrages.
S’agissant des dépenses courantes, il faudrait, au-delà de la RGPP, revoir tous les programmes, y compris les programmes militaires, et passer au tamis de la soutenabilité l’ensemble des politiques publiques d’intervention, y compris les dépenses sociales. On ne peut écarter d’emblée tout effort dans ce dernier domaine. Des mesures temporaires pourraient être prises et certaines aides mieux ciblées, compte tenu de la situation économique. Certaines propositions de la 6e chambre de la Cour sur les niches sociales pourraient également être mises en œuvre.
Monsieur Bouvard, la norme d’évolution de la dépense est contournée par le biais des dépenses fiscales et par le biais du transfert à des opérateurs de certaines dépenses auparavant assurées par l’État. Là aussi, des mesures s’imposent. Les opérateurs ne peuvent s’exonérer de l’effort de maîtrise des dépenses publiques.
Je ne reviens pas sur les pistes que nous avons proposées, dont quelques-unes ont été chiffrées et montrent qu’il faut vraisemblablement aller au-delà de ce que propose aujourd’hui le Gouvernement, d’autant que les recettes escomptées, sur la base d’une hypothèse de croissance et d’une élasticité toutes deux ambitieuses, peuvent ne pas être au rendez-vous. Cela n’en rend que plus nécessaire une action sur les dépenses et la remise en cause de certaines niches fiscales et sociales. À côté de mesures temporaires et conjoncturelles, des mesures structurelles sont indispensables. Disant cela, nous sommes bien conscients qu’il est délicat de passer de l’idée à son application pratique, comme on le voit avec le dossier des retraites.
La Cour n’est pas en mesure de chiffrer le coût qu’a représenté le passage à la retraite à 60 ans en 1983. Mais 62 ans en 2018, est-ce bien différent de 60 ans en 1983 ? On peut se poser la question.
Dès lors que la situation exige un effort particulier et que tous les pays voisins l’ont entrepris, il importe que la France ne s’en exonère pas, mais cet effort doit être partagé et chacun doit y participer en fonction de ses capacités. Un effort est d’autant plus acceptable et accepté qu’il est juste et partagé. Ce n’est là que bon sens.
Madame Touraine, la CRDS présente l’avantage d’être une ressource sûre, stable, claire et affectée. Plus la durée de vie de la CADES est réduite, plus l’amortissement d’une nouvelle reprise de la dette se réalise sur une durée plus courte et exige donc des recettes plus importantes. Il faut donc trouver le bon équilibre. La Cour pense qu’il faut sans doute jouer un peu sur les deux paramètres. En tout cas, la CRDS est un des éléments de la stabilisation nécessaire.
Toute diminution du chômage accroîtra mécaniquement les rentrées de cotisations sociales et les recettes fiscales, ce qui aura des répercussions positives à la fois sur le budget de l’État et sur les comptes sociaux. Tout ce qui peut contribuer à augmenter l’emploi dans notre pays va donc dans le bon sens. Nous avons évalué le coût de la hausse du chômage en 2009 à environ quatre milliards d’euros.
Pour ce qui est de la privatisation des sociétés d’autoroutes, la Cour a eu l’occasion de dire que les conditions de leur privatisation n’avaient pas été « optimales » pour le moins.
Monsieur Malherbe, le GVT représente 1,9 % de la masse salariale totale de la fonction publique qui s’élève à quelque 70 milliards d’euros. Des données chiffrées sur les dépenses de personnels – salaires et pensions – figurent dans notre rapport.
Monsieur Carré, l’évolution des recettes de TVA s’explique à la fois par des mesures temporaires comme les remboursements anticipés prévus dans le plan de relance – nous vous communiquerons des chiffres précis à ce sujet dans le cadre de notre rapport sur le plan de relance – et l’application du taux réduit à la restauration, mesure, elle, structurelle, sauf à considérer qu’elle pourrait être remise en question à partir de la loi de programmation.
Je l’ai dit, s’agissant des comptes sociaux, il faudra agir à la fois sur les dépenses et sur les recettes, notamment par le biais d’un éventuel élargissement de l’assiette des cotisations. Il y a là une marge de manœuvre dont il ne faut pas se priver vu l’urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures fortes à court terme, permettant d’engager des réformes de fond. Il faut être attentif à la situation de la France dans l’environnement international contraint qui est le sien. Il ne s’agit pas de répondre aux exigences des marchés mais de simplement rassurer nos créanciers. Acteurs économiques rationnels, les créanciers souhaitent avoir des assurances sur la capacité de leurs débiteurs à maîtriser l’évolution de leur endettement. L’objectif n’est pas hors d’atteinte pour notre pays mais son déficit structurel est plus élevé que celui d’autres. Cela nous impose de faire au moins autant d’efforts que les autres pour éviter que notre situation n’empire.
La Cour se veut lucide : tout en insistant sur le caractère sérieux de la situation, elle souligne aussi que notre pays a des atouts. Des mesures sont nécessaires. Nous ne doutons pas qu’elles pourront être prises dès lors que l’effort sera partagé.
M. le président Pierre Méhaignerie. Monsieur le Premier président, je vous remercie. Puisse cette rencontre à la fois renforcer nos convictions à tous et nous permettre de rapprocher nos points de vue.
Au cours de sa séance du mercredi 30 juin 2010, la commission des affaires sociales examine le rapport d’information de M. Yves Bur préalable au débat d’orientation des finances publiques.
Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.
M. Pierre Morange. J’interviens en tant que co-président de la MECCS. Le patrimoine hospitalier avoisinerait 30 milliards d’euros : c’est dire l’importance de ce gisement, susceptible notamment, dans le contexte de crise économique que nous connaissons, de contribuer fort utilement au financement du plan Hôpital 2012. Je rappelle que les conclusions formulées par Jean Mallot dans son rapport sur le fonctionnement de l’hôpital ont été votées à l’unanimité par les membres de la MECSS. Les services de l’État ont-il évalué le rendement qui pourrait être tiré de ce patrimoine des hôpitaux, comme cela a été fait pour le patrimoine de l’État ?
M. le rapporteur. Je dois dire que sur cette question, nous sommes dans l’opacité la plus totale. Les 30 milliards d’euros que vous évoquez correspondent à une évaluation « historique » qui n’a rien à voir avec la valeur réelle des biens. Par ailleurs, il faudrait distinguer, à l’intérieur de ce patrimoine, ce qui doit rester à l’activité sanitaire, ce qui pourrait être libéré par les restructurations hospitalières et mis sur le marché, et les biens, parfois issus de legs très anciens, qui n’ont rien à voir avec l’exercice de la mission sanitaire. Une solution serait de demander à l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) de procéder à une évaluation réelle de ce patrimoine. Lorsqu’il s’agira ensuite de le mobiliser, il faudra certainement que l’État s’implique davantage – car les communes ont des intérêts contradictoires : elles défendent l’hôpital qui se trouve sur leur territoire, mais si un terrain est libéré en centre-ville, elles se portent acquéreur au prix le plus bas possible. On le voit aujourd’hui à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) : on me dit qu’on peut mobiliser assez facilement 400 à 500 millions d’euros sur son patrimoine, mais si des emprises hospitalières se libèrent, la ville de Paris s’emploie à en limiter le prix. Il en va de même dans d’autres villes.
M. Pierre Morange. Je ne suis pas convaincu que l’ANAP soit la structure la plus adaptée pour évaluer et gérer le patrimoine hospitalier, même si une centralisation est nécessaire pour permettre à l’État d’en connaître la réalité. Il me semblerait logique de faire appel aux agences régionales de santé, plus propres à assurer la rationalisation de ce patrimoine.
M. le rapporteur. C’est la MECSS qui a, me semble-t-il, proposé de confier cette mission à l’ANAP.
M. le président Pierre Méhaignerie. Comme on n’entreprend rien sans optimisme, nous pouvons relativiser nos difficultés en les comparant à celles de nos voisins !
M. Jean Leonetti. On peut, en effet, relativiser : par exemple, les millions d’euros de déficit de nos hôpitaux ne représentent jamais qu’un dépassement de 1,5 point de leur budget… La situation reste maîtrisable.
Parmi les nombreuses pistes que vous avez ouvertes, monsieur le rapporteur, celle du CAPI me paraît particulièrement intéressante. À une logique comptable, qui heurte la communauté des personnels soignants et se révèle inefficace, nous devons préférer la voie de la maîtrise médicalisée par le contrôle de la pertinence et de la qualité des actes. La disparité des pratiques médicales selon les établissements et les territoires prouve l’inutilité de certains actes. Il vaudrait mieux inciter la Haute Autorité de santé (HAS) et la CNAM à traquer ces actes inutiles, plutôt que d’opter pour la méthode du « rabotage » systématique. Pourquoi continue-t-on à effectuer un million de radios du crâne, alors que chacun sait qu’elles ne servent plus à rien ? Pourquoi pose-t-on cinq fois plus de stents coronariens dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur que dans le Nord ? Il est temps d’entrer dans une logique de contrôle, non pas seulement de la qualité de l’acte, mais aussi de sa pertinence – car un acte peut être très bien exécuté, mais néanmoins non pertinent. La réalisation de certains actes résulte d’ailleurs souvent moins de la recherche de gains financiers que des pratiques médicales enseignées. Mieux vaut exercer ce contrôle que choisir la voie d’une réduction drastique en volume ; tout le monde y gagnera, aussi bien les médecins que les patients. Actuellement, tout pousse à l’augmentation du nombre des actes ; repenser la solidarité sous l’angle de la pertinence et de la qualité des actes permettrait de réaliser des économies substantielles.
M. Michel Issindou. Devant l’ampleur des déficits, que vous avez rappelée à juste titre, monsieur le rapporteur, on ne peut qu’être inquiet pour l’avenir de notre protection sociale, tant enviée et à laquelle nous sommes tous, du moins je l’espère, très attachés. Les perspectives de croissance n’incitent pas davantage à l’optimisme ; elles risquent de nous priver durablement de ressources.
Du côté des recettes comme du côté des dépenses, les pistes que vous avez indiquées ne sont pas nouvelles… C’est sur notre capacité à faire aboutir ces propositions que nous serons jugés.
S’agissant de la recherche de recettes supplémentaires, de nombreux groupes de pression feront entendre leur opposition. Je suis évidemment favorable à ce qu’on explore les solutions qui ont été évoquées. Je me réjouis que 2 milliards puissent être tirés de l’annualisation de l’allégement des charges. Il faudra aussi revoir le cas de l’intéressement et de la participation, le forfait de 4 % nous paraissant encore insuffisant sur ce que nous considérons comme des salaires déguisés. Quant au « rabotage » des exonérations ciblées et à la mise à contribution des stock-options et des retraites chapeaux, il reste à voir ce qu’il en adviendra à l’automne, au moment de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale : les années précédentes, nous avons été un peu déçus…
En ce qui concerne les fonctionnaires, pour lesquels on veut déjà aligner le taux de cotisation retraite sur celui des salariés du privé, je constate qu’on envisage maintenant d’augmenter la cotisation à l’assurance maladie.
M. le rapporteur. Il s’agit de la cotisation employeur.
M. Michel Issindou. Du côté des dépenses, j’approuve l’intervention de Jean Leonetti, mais là encore le débat s’annonce difficile. Vos propositions relatives au patrimoine des hôpitaux, à la politique du médicament, à la politique familiale ou à l’augmentation de la CRDS sont à approfondir, mais on verra en octobre si les intentions courageuses affichées par la majorité au début du mois de juillet auront résisté à la coalition des groupes de pression. Personnellement, l’expérience des projets de loi de financement passés m’incline à la prudence.
M. Jean-Luc Préel. Il est important d’avoir un débat sur les dépenses sociales dès le mois de juin. Je félicite le rapporteur d’avoir, encore une fois, fait preuve de la rigueur, du volontarisme et de l’absence de démagogie qui le caractérisent.
Le déficit auquel nous sommes confrontés est essentiellement dû à la diminution des recettes consécutive à la crise économique et à la diminution de la masse salariale. S’ajoute le problème du financement de la dette.
En ce qui concerne la branche vieillesse, le Gouvernement nous propose une réforme supposée permettre d’arriver à l’équilibre en 2018, le déficit devant être d’ici là financé par le Fonds de réserve pour les retraites. N’étant pas certains que l’équilibre puisse être assuré de cette façon, nous proposerons quelques recettes supplémentaires, également destinées à assurer la nécessaire équité entre le public et le privé.
S’agissant de la branche maladie, certes les dépenses de santé augmentent, notamment en raison du vieillissement de la population et du développement de nouvelles technologies et de nouveaux médicaments – parfois très chers, sans que l’on ait toujours la preuve de leur efficacité –, mais il ne faut pas oublier qu’elles contribuent au PIB.
En ce qui concerne la médecine ambulatoire, je suis favorable au développement du CAPI, notamment pour la prévention et la qualité des soins. S’agissant des hôpitaux, vous avez fait état, monsieur le rapporteur, des observations de la MECSS sur leur patrimoine, mais je ne suis pas sûr qu’on puisse en tirer des ressources importantes. Il faudrait surtout s’interroger sur le réalisme de l’ONDAM : comme la MECSS l’a montré, l’objectif d’un retour à l’équilibre des comptes des établissements en 2012 ne sera atteint que si l’ONDAM est fixé à un niveau suffisant.
Vos propositions de réduction des niches sociales sont tout à fait intéressantes.
J’en viens à la dette 2009-2010-2011, qui approchera les 100 milliards. Depuis des années, tout le monde est d’accord pour dire que nous ne devons pas confier à nos enfants le financement de nos propres dépenses. C’est pourquoi vous avez proposé, monsieur le rapporteur, et je vous ai soutenu, qu’une loi organique interdise de transférer à la CADES un déficit supplémentaire sans disposer des recettes correspondantes. On a déjà prolongé la CADES, qui devait disparaître en 2007, jusqu’en 2021… Je plaide, pour ma part, en faveur d’une augmentation de 0,85 % de la CRDS, afin que chacun finance ses propres dépenses. Toute autre piste me paraîtrait tout à fait déraisonnable.
M. Dominique Dord. Merci à notre collègue Yves Bur pour cet excellent rapport.
L’alignement des cotisations acquittées par les employeurs publics sur celles des employeurs du privé, si elle est conforme à l’équité, ne me semble cependant pas une piste très féconde : il ne faudrait pas, comme le sapeur Camember, creuser un trou pour en combler un autre, en l’espèce creuser le déficit de l’État pour combler celui des comptes sociaux.
Ce que vous nous dites du patrimoine hospitalier est assez incroyable. Dans ma circonscription, je vois l’Agence des participations de l’État recenser le patrimoine de l’État susceptible d’être vendu ; elle le fait très bien et très vite. Pourquoi ne pas faire appel à elle ?
Moi qui n’appartiens pas au monde médical, je suis également choqué d’apprendre par notre collègue Jean Leonetti qu’on réalise des actes médicaux inutiles. Comment est-ce possible ? Si c’est le cas, c’est évidemment là le premier gisement d’économies à exploiter.
La gestion du système lui-même a aussi quelque chose de scandaleux : à un moment où on cherche partout les moyens de faire des économies, il est insupportable d’apprendre que la Cour des comptes n’a pas certifié les comptes de la branche vieillesse.
Enfin, la réforme des retraites qui se prépare sera le navire amiral de la recherche d’économies et de la réduction des déficits. C’est pour ma part le rendez-vous que je donne à Michel Issindou et à l’ensemble de nos collègues de l’opposition : j’ai hâte de savoir jusqu’où ils auront le courage de nous suivre dans cette voie.
M. Guy Malherbe. Je m’associe aux félicitations qui ont été adressées au rapporteur pour l’importance de son travail.
Ne faudrait-il pas que nous tentions d’évaluer l’incidence qu’ont eue sur les comptes sociaux l’abaissement de l’âge de la retraite de 65 à 60 ans – il semble qu’il y aurait aujourd’hui des excédents si cette mesure n’avait pas été votée – et les 35 heures ? Lors de son audition, le Premier président de la Cour des comptes n’a pas pu me répondre.
Par ailleurs, dans le prolongement de ce qu’a dit Jean Leonetti sur la pertinence et la qualité des actes, il faudrait prévoir dans le projet de loi de financement les mesures nécessaires à l’application de la loi réformant l’hôpital (dite HPST) dans l’ensemble du parcours de soins, notamment en ce qui concerne les pharmaciens. Il y a là aussi un gisement d’économies.
M. Jacques Domergue. Nous marchons sur des œufs : d’un côté, des mesures trop drastiques risquent de casser la croissance, mais de l’autre, on ne peut pas éternellement creuser la dette. Est-il imaginable, dans le contexte actuel, de fixer l’ONDAM à 2,9 %, comme cela a été annoncé ?
M. Dominique Tian. Cela fait des années qu’on connaît les gaspillages évoqués à l’instant par Jean Leonetti. La sécurité sociale souffre d’un grave problème de gouvernance et d’un manque consternant de réactivité. Il existe environ 200 000 cartes Vitale dont on ne connaît pas réellement le propriétaire, le projet de carte Vitale sécurisée n’avance pas, chacun sait où en est le dossier médical personnel... Cela ne peut plus durer !
Ce qui me gêne dans vos propositions, monsieur le rapporteur, c’est que les classes moyennes vont, à nouveau, en faire les frais. Il serait particulièrement maladroit de soumettre à prélèvement les indemnités de licenciement dès 50 000 euros. Ce sont aussi les classes moyennes qui seront mises à contribution par des mesures sans aucune originalité relatives aux accords salariaux, aux tickets-restaurants, bref à tout ce qui renforce le pouvoir d’achat des salariés quand l’entreprise se porte bien… Année après année, vous proposez toujours les mêmes mesures, en vous contentant de les alourdir. C’est une spirale infernale, et je crains que tout cela finisse mal !
M. le président Pierre Méhaignerie. Il reste que, pour éviter d’autres drames, il faut trouver 4 milliards...
M. Jean Bardet. Je voudrais faire trois remarques.
Tout d’abord, il ne faut pas croire que le patrimoine des hôpitaux constitue une valeur immédiatement exploitable : ainsi les legs sont souvent assortis de conditions.
Ensuite, pour limiter le nombre d’actes inutiles, justement dénoncés par Jean Leonetti, la procédure de l’entente préalable était une bonne formule ; il faudrait reprendre ce système, sur la base du classement des actes établi par les conférences de consensus.
Enfin, les hôpitaux publics devraient mettre en place, comme c’est le cas de la plupart des établissements privés, des procédures administratives pour optimiser la T2A.
M. Christian Hutin. Je voudrais d’abord remercier Yves Bur pour le sérieux et le courage de son rapport. Il est certain qu’un projet de loi de financement plus volontariste nous permettrait de faire un grand pas dans la réduction d’un déficit dont notre collègue Jean Leonetti relevait à juste titre que, s’il était important en volume, il n’apparaissait pas aussi vertigineux quand on l’appréciait en pourcentage.
Instruit par l’examen des trois derniers projets de loi de financement de la sécurité sociale, je crains hélas que les feuilles de ce rapport ne tombent à l’automne. Je ne néglige pas l’importance de l’économie de la santé pour notre pays : elle crée de l’emploi et contribue à la production de richesses. Je déplore simplement que cette économie ait généré des groupes de pression corporatistes et parfois excessivement puissants, qui se coalisent à l’automne pour ruiner, morceau par morceau, toutes nos propositions.
J’approuve tout particulièrement votre proposition de faire contribuer les indemnités de licenciement à la réduction du déficit. Nous savons tous que certains contrats de travail comportent des clauses scandaleuses, qui permettent à certains de partir un ou deux ans plus tard en empochant des sommes colossales – qui sont en fait des retraites chapeaux déguisées. Il faut cependant veiller à ne pas imposer une double peine aux salariés qui ont obtenu de haute lutte des indemnités de licenciement destinées à leur permettre de survivre pendant deux ou trois ans.
Quant aux prélèvements sur les retraites chapeaux et les stock-options, c’est le moment ou jamais de les décider : surtout, n’hésitons pas et frappons fort ! C’est dans l’air du temps et les Français nous en féliciteront.
M. le président Pierre Méhaignerie. N’oublions quand même pas le risque de voir les sièges sociaux et les capitaux partir chez nos voisins.
M. Christian Hutin. Le développement du CAPI suppose de faire preuve de pédagogie, si on veut surmonter les réticences des médecins de ma génération. S’agissant du patrimoine des hôpitaux, je ne peux qu’approuver votre proposition : nous ne sommes pas suffisamment riches pour accepter d’ignorer l’étendue de notre patrimoine !
Enfin je voudrais ouvrir une petite piste toute personnelle. Il y a quelques années, dans le cadre d’un ensemble de mesures visant à éviter les conflits d’intérêt, on a décidé d’empêcher la consommation personnelle, par les médecins et leurs familles, d’échantillons distribués par les laboratoires. C’était une fausse bonne idée, d’autant plus que les médecins faisaient aussi de cette façon de la médecine sociale et humanitaire. Je serais curieux de savoir combien coûtent à l’assurance maladie les médicaments que désormais ils sont obligés de prescrire à leur famille ! Et personne ne me fera croire qu’on peut acheter des médecins avec des médicaments…
M. Pierre Morange. Je voudrais préciser que la MECSS n’a jamais préconisé que la gestion du patrimoine hospitalier soit confiée à l’ANAP. Il est simplement prévu qu’elle fasse une étude sur le sujet. Notre préconisation est de confier la gestion à un office national.
Par ailleurs, monsieur Bardet, il est évidemment hors de question de vendre la moitié ou le quart du patrimoine des hôpitaux. On peut en revanche imaginer qu’une exploitation rationnelle de 5 à 10 % de ce patrimoine nous permettrait de dégager des marges de manœuvre en termes d’investissement.
*
La commission autorise, en application de l’article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d’information en vue de sa publication.
© Assemblée nationale