

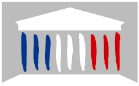
N° 2065
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 novembre 2009.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI de M. Jean-Marc AYRAULT et plusieurs de ses collègues relative au droit de finir sa vie dans la dignité (n° 1960 rectifié)
PAR M. Manuel VALLS,
Député.
——
A. LE DÉVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS 7
1. La consécration d’un droit à l’accès à des soins palliatifs 7
2. Un dispositif de soins palliatifs aujourd’hui bien identifié 8
B. LA LOI DU 22 AVRIL 2005 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET À LA FIN DE VIE 9
1. Le refus de l’« obstination déraisonnable » 9
2. L’application d’un traitement pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger la vie de la personne 10
3. Le refus ou l’arrêt des traitements 10
II.- UN DÉCALAGE ENTRE DES ATTENTES RÉELLES ET DES RÉPONSES RÉCENTES INSUFFISANTES 13
A. DES ATTENTES RÉELLES 13
1. Des attentes manifestes des personnes concernées, plus ou moins médiatisées 13
2. Des jurisprudences souvent clémentes 14
3. Des initiatives parlementaires concordantes 16
4. Des enquêtes d’opinion aux résultats constants 16
B. DES RÉPONSES RÉCENTES INSUFFISANTES 17
1. La mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 17
2. L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie 17
III.- LA NÉCESSITÉ DE FRANCHIR UN NOUVEAU PAS 19
A. L’EXEMPLE DE CERTAINS PAYS ÉTRANGERS 19
1. La loi néerlandaise du 12 avril 2001 19
2. La loi belge du 28 mai 2002 20
3. La loi luxembourgeoise du 16 mars 2009 21
4. Les éléments de bilan sur les pratiques existantes 22
B. L’INDISPENSABLE DÉVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS 24
C. LA SOLUTION RETENUE PAR LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI 25
1. L’exception d’euthanasie, solution difficile à mettre en œuvre en pratique 26
2. L’aide active à mourir 26
Article 1er : Définition de la situation de la personne pouvant demander à bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité 39
Article 2 : Encadrement de l’aide active à mourir en cas de demande libre, éclairée et réfléchie de la personne concernée 42
Article 3 : Directives anticipées 45
Article 4 : Encadrement de l’aide active à mourir d’une personne dans l’incapacité définitive d’exprimer une demande libre et éclairée 49
Article 5 : Commissions nationale et régionales de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité 52
Article 6 : Droit au refus en matière d’aide active à mourir 53
Article 7 : Effets sur les contrats où elle était partie du décès d’une personne ayant bénéficié d’une aide active à mourir 54
Article 8 : Formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie 55
Article 9 : Gage 55
TABLEAU COMPARATIF 57
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 65
ANNEXE : Liste des personnes auditionnées par le rapporteur 69
Avec la présente proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité, l’Assemblée nationale aborde, une fois encore, la question délicate de la fin de vie.
Le sujet n’est en effet pas nouveau. Depuis la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, jusqu’à la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, de très nombreuses avancées ont été réalisées, qui témoignent d’une prise de conscience toujours plus grande de ces sujets difficiles.
Aujourd’hui, avec l’établissement d’une aide active à mourir, et la consécration d’un droit à mourir dans la dignité, il est proposé d’accomplir un pas supplémentaire en prenant en compte des demandes récurrentes, qu’elles proviennent des personnes en fin de vie qui jugent leur souffrance insupportable, des médecins, laissés seuls face à la détresse de leurs patients et leur conscience, ou encore des familles, qui ne savent pas toujours vers qui se tourner.
Depuis plusieurs années, l’écart se creuse, entre les attentes de nombreuses personnes qui souffrent en fin de vie, qu’elles restent anonymes ou qu’elles se trouvent placées, du jour au lendemain, au cœur de l’actualité, et les réponses apportées par les pouvoirs publics.
Le sénateur Henri Caillavet avait le premier déposé une proposition de loi visant à permettre l’euthanasie en France, en 1978. Ces dernières années, d’autres parlementaires, de sensibilités politiques diverses, ont fait de même. Les enquêtes d’opinion le confirment : les esprits semblent prêts pour une évolution de la législation.
Les travaux récents de la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 ont certes permis de dégager des propositions intéressantes, dont l’une a été reprise sous la forme d’une proposition de loi discutée à l’Assemblée nationale le 17 février 2009, visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. La mission a insisté, avec justesse, sur la nécessité de favoriser une véritable « culture palliative » en France. Le développement des soins palliatifs est essentiel et doit, de fait, constituer une priorité.
Dans le même temps, ces propositions restent insuffisantes, car elles ne tendent pas à modifier l’équilibre général de la législation sur la fin de vie.
Est-il permis, sans naïveté, d’oser espérer le consensus ? La loi du 22 avril 2005 avait été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. La présente proposition de loi, à laquelle le groupe SRC a choisi de consacrer une séance d’initiative parlementaire, ne manquera pas de susciter un réel débat.
En proposant de légaliser l’aide active à mourir, l’euthanasie, tout en entourant le dispositif proposé de très strictes garanties juridiques, ce texte ne fait rien d’autre que s’efforcer d’apporter une réponse aux demandes évoquées précédemment. Il en va de la responsabilité du législateur et, bien plus encore, de la responsabilité de chacun.
I.- DE PREMIÈRES AVANCÉES INCONTESTABLES
Sur la question de la fin de vie, des progrès incontestables ont été réalisés depuis une vingtaine d’années, de la consécration d’un droit à l’accès à des soins palliatifs, notamment avec la loi du 9 juin 1999 ayant permis le développement d’une véritable organisation des soins palliatifs en France, aux avancées significatives rendues possibles par la loi du 22 avril 2005, en particulier en matière de limitations ou d’arrêts des traitements et de condamnation de l’« obstination déraisonnable ».
Les réflexions sur l’accompagnement de la fin de vie remontent à la fin des années 1970, mais c’est dans les années 1980 que se développent véritablement les soins palliatifs : la circulaire du 26 août 1986 – dite circulaire Laroque – relative « à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale » donne son assise juridique à l’organisation des soins palliatifs en France.
Une longue évolution législative (1) suit, amorcée avec la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, qui introduit les soins palliatifs dans les missions de tout établissement de santé puis, surtout, la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, adoptée à l’unanimité.
La loi du 9 juin 1999 a consacré le droit de « toute personne malade dont l’état le requiert » à « accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement », à l’article L. 1 A du code de la santé publique, devenu aujourd’hui l’article L. 1110-9. Ce droit a été réaffirmé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Il est proche de celui que la loi consacre, de manière plus générale, à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, selon lequel « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». Le même article ajoute que « les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort ». Parmi ces moyens figurent le traitement de la douleur et, plus généralement, les soins palliatifs.
Par-delà la consécration du droit, les soins palliatifs sont aussi définis par la loi du 9 juin 1999 précitée, à l’article L. 1er B du code de la santé publique, devenu aujourd’hui article L. 1110-10, comme « des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ».
C’est cette même loi qui institue aussi un congé d’accompagnement, au profit des personnes désireuses de consacrer du temps à un proche en fin de vie.
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, outre l’affirmation du droit pour tout malade de refuser un traitement (voir infra), réaffirme l’obligation faite aux établissements de disposer d’une offre de soins palliatifs et prévoit que les services ou établissements sociaux ou médico-sociaux peuvent dispenser des soins palliatifs.
Parallèlement à ces évolutions législatives sont mis en œuvre une série de programmes triennaux : programme national de développement des soins palliatifs 1999-2001, second programme pour la période 2002-2005, plan Cancer 2003-2007, puis troisième « programme de développement des soins palliatifs 2008-2012 », qui comporte trois axes : la poursuite du développement de l’offre hospitalière et l’essor des dispositifs de médecine de ville ; l’élaboration d’une politique de formation et de recherche ; l’encouragement à l’accompagnement par les proches. Au total, près de 229 millions d’euros doivent être mobilisés, au titre des dépenses de l’assurance maladie, pour les soins palliatifs sur cinq ans.
L’ensemble de ces efforts ont permis la mise en œuvre d’un dispositif d’organisation des soins palliatifs dont l’architecture est désormais bien établie : le premier niveau est celui de l’accompagnement palliatif dans un service hospitalier sans lit identifié ; le deuxième niveau celui de l’accompagnement palliatif au sein d’un service disposant de lits identifiés ; le troisième niveau est relatif aux unités de soins palliatifs, celles-ci pouvant être complétées par les équipes mobiles de soins palliatifs. Par ailleurs, les prises en charge en établissement sont relayées ou complétées en ville par l’hospitalisation à domicile ou les réseaux de soins palliatifs.
Au total, sur l’ensemble du territoire national, en 2007, on dénombre 89 unités de soins palliatifs regroupant près de 1 000 lits, 340 équipes mobiles de soins palliatifs – chiffre conforme à l’objectif fixé en 2002 d’une équipe mobile de soins palliatifs pour 200 000 habitants –, et plus de 3 000 lits identifiés soins palliatifs – l’objectif fixé en 2002 de 5 lits identifiés pour 100 000 habitants étant pratiquement atteint. On dénombre, en outre, près de 100 000 séjours en soins palliatifs dans les établissements de médecine, chirurgie et obstétrique en 2007.
Enfin, les dispositifs de prise en charge à domicile se sont développés, même si l’on ne peut dénombrer de manière fiable le nombre de personnes concernées par ce type d’organisations. Ainsi, on dénombre plus de 100 réseaux de soins palliatifs sur le territoire et près de 200 structures d’hospitalisation à domicile prenant en charge les patients en fin de vie.
La loi du 22 avril 2005, issue d’une proposition de loi présentée par M. Jean Leonetti et plusieurs de ses collègues, adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, a permis de compléter ces réalisations en apportant des outils juridiques nouveaux destinés à consacrer le refus de l’« obstination déraisonnable » (certains évoquaient jusque là l’acharnement thérapeutique), à régir la situation dans laquelle l’application d’un traitement peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie d’une personne, ou encore d’ouvrir la possibilité à une personne (notamment en fin de vie) de refuser ou d’arrêter un traitement.
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique reconnaît le droit de toute personne, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissance médicales avérées.
Il prévoit aussi que les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, faire courir à une personne de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Cet article a été complété par la loi du 22 avril 2005, qui a posé comme principe que ces actes de prévention, d’investigation ou de soins, ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable, prenant ainsi acte de l’évolution des esprits au sein de la société en général, et parmi les professionnels de santé en particulier.
La loi du 22 avril 2005 a également défini les cas dans lesquels l’obstination déraisonnable doit être proscrite, par le recours à deux critères : l’inutilité médicale d’une part, et la disproportion, d’autre part (« lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie »). Comme l’indiquait à titre d’illustration le rapport préparatoire à la discussion parlementaire (2), « sont par exemple inutiles des examens tels que des prélèvements sanguins ou des thérapeutiques comme ces chimiothérapies renouvelées, alors que l’on sait pertinemment qu’aucun traitement n’améliorera l’état de santé du malade ».
La loi du 22 avril 2005 a en outre précisé que, dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10, à savoir les soins palliatifs. Cet ajout avait en particulier pour objectif d’« encourager le passage d’une logique curative à une logique palliative et le développement de cette dernière », conformément aux explications figurant dans le rapport précité.
Le rapport de la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 a montré les difficultés qui existent pour quantifier l’impact de la loi, en raison du manque de données statistiques – les seules données comparatives disponibles portant sur l’activité des services de réanimation –, et a relevé, par exemple, qu’il conviendrait de mieux cerner la fréquence de ces décisions dans les services de cancérologie.
2. L’application d’un traitement pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger la vie de la personne
Autre avancée qui peut être soulignée, la loi du 22 avril 2005 a aussi modifié l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, pour prévoir les cas d’application d’un traitement pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger la vie de la personne, puisque tel est le cas pour certains traitements de la douleur (sédations ou morphine, par exemple).
Cet article prévoit aujourd’hui que si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il en informe le malade, la personne de confiance (3), la famille ou, à défaut, un des proches. La mise en œuvre de cette procédure fait l’objet d’une mention au dossier médical.
Enfin, la loi du 22 avril 2005 a organisé la manière dont une personne peut refuser ou arrêter un traitement.
Elle a d’abord consacré dans le code de la santé publique le droit général pour toute personne de refuser ou d’arrêter un traitement.
La loi du 4 mars 2002 précitée avait déjà prévu la situation d’une personne voulant refuser ou interrompre un traitement mettant sa vie en danger : le médecin a alors l’obligation de tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. La loi du 22 avril 2005 a étendu le champ d’application de ce droit au refus ou à l’interruption d’un traitement, en consacrant le droit au refus de « tout traitement », retenant ainsi une acception large de la notion de « traitement », incluant l’arrêt de l’alimentation (4).
Il est vrai que la définition de l’arrêt de « tout traitement » avait été débattue lors de la discussion parlementaire. Mais comme vient de le rappeler le Conseil d’État, même si, symboliquement, l’arrêt de l’alimentation d’un patient semble opérer une transgression plus forte que les autres gestes, du point de vue médical, l’ensemble des actes de suppléance vitale sont du même ordre : « on doit donc tirer des débats parlementaires l’idée que le législateur a bien entendu inclure l’arrêt des suppléances vitales dans la notion d’arrêt de traitement, et qu’il a plus particulièrement examiné le cas de l’alimentation car c’était celui qui posait le plus question » (5).
Par ailleurs, la loi a pris en compte la situation de la personne qui n’est pas en état d’exprimer sa volonté, pour ouvrir, dans cette hypothèse, la possibilité de limiter ou d’arrêter un traitement susceptible de mettre sa vie en danger (6).
Mais la loi du 22 avril 2005 a également prévu des droits spécifiques au profit des personnes en fin de vie, à savoir les personnes « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ». Aux termes d’un nouvel article L. 1111-10 du code de la santé publique, dans le cas où la personne est consciente, et décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin doit respecter sa volonté, après l’avoir informée des conséquences de son choix, la demande n’ayant pas à être réitérée. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. L’article précise, dans le même temps, que le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant des soins palliatifs. Le rapport établi par le rapporteur au nom de la commission spéciale précité soulignait que cette possibilité devait être envisagée comme le « pendant » de la disposition condamnant l’obstination déraisonnable.
En outre, la loi prend en compte la situation de la personne en fin de vie hors d’état d’exprimer sa volonté dans deux nouveaux articles L. 1111-12 et L. 1111-13. Aux termes de ces articles, le médecin a la possibilité de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions : l’existence d’une procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale ; la consultation de la personne de confiance (7), de la famille ou, à défaut, d’un proche et, le cas échéant, des directives anticipées ; l’inscription de la décision, motivée, du médecin dans le dossier médical. Comme il en va lorsque la personne est consciente, il est précisé que le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant des soins palliatifs.
Ce rappel à la fois de la récente histoire de l’évolution des soins palliatifs, et de l’inscription dans notre droit positif, en 2005, de dispositions importantes pour traiter la question de la fin de vie, montre combien, de façon à prendre en considération les attentes des personnes concernées, le législateur et, de manière générale, les pouvoirs publics ont pu, par le passé, prendre les décisions qui s’imposaient.
Cet acquis est important. D’une certaine façon, la loi du 22 avril 2005 a vraiment ouvert le débat sur les conditions dans lesquelles il est possible d’aider autrui en fin de vie.
Il n’est pas anodin de relire, à la lumière de ces premières évolutions, certains événements récents, telle la décision de la Cour de cassation italienne de novembre 2008, qui a ouvert la possibilité de l’arrêt de l’alimentation artificielle d’une femme de 38 ans, Eluana Englaro, plongée dans un coma végétatif irréversible à la suite d’un accident de voiture : les conditions du décès de cette personne ont donné lieu à des échanges nombreux. Or, ce que d’aucuns ont alors dénoncé comme un acte d’euthanasie relèverait, aux termes de la loi du 22 avril 2005, du « laisser mourir ». Ainsi que l’ont souligné alors certains commentateurs, « c’est en écoutant ce qui se dit en Italie que l’on mesure l’importance du pas franchi en France dans la prise en charge de la fin de vie » (8).
Si cet acquis ne saurait donc être minimisé, il doit aussi, à certains égards, être regardé comme insuffisant, compte tenu des attentes qui se manifestent aujourd’hui.
II.- UN DÉCALAGE ENTRE DES ATTENTES RÉELLES ET DES RÉPONSES RÉCENTES INSUFFISANTES
De nombreux éléments plaident aujourd’hui pour reconsidérer la législation sur la fin de vie et la question de l’euthanasie (9). Il existe en effet un décalage de plus en plus important entre les attentes réelles des Français et les réponses qui leur sont faites en cette matière, qu’il s’agisse des conclusions, en novembre 2008, de la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005, ou de l’annonce de la création d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, début 2009.
À l’évidence, les attentes des Français face à l’évolution de la législation sur la fin de vie sont grandes : les situations sont nombreuses, aujourd’hui, à ne pas recevoir de réponse dans le seul cadre juridique de la loi du 22 avril 2005 ; en cas de contentieux, les solutions retenues par les juridictions, clémentes souvent, inattendues parfois, ne sont pas toujours comprises ; le dépôt récurrent de propositions de loi sur ce sujet – par des personnalités issues de toutes les sensibilités politiques – comme l’existence d’enquêtes d’opinion aux résultats constants, sont autant de signes qui confirment ces attentes.
Alors que la loi du 22 avril 2005 avait suivi le drame lié à la mort de Vincent Humbert, il est, dans une certaine mesure, regrettable que, trop souvent, la question de la fin de vie soit avant tout abordée à l’occasion d’événements, auxquels les médias donnent un fort retentissement.
Apporter une réponse politique à un instant donné est une chose parfois nécessaire – la mission parlementaire d’évaluation de la loi du 22 avril 2005, constituée à la suite de la mort de Chantal Sébire, autre drame ayant occupé une place importante dans l’actualité, a permis la réalisation d’un travail important –, mais il est indispensable de prendre le temps de la réflexion aussi en l’absence de tels événements.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi : ne pas seulement apporter une réponse à des cas individuels et médiatisés, aussi dramatiques puissent-ils être.
Car, c’est une réalité de constater qu’aujourd’hui, un nombre non négligeable de situations ne correspondent pas à celles que tend à prendre en compte la législation actuelle.
On ne reviendra pas, dans les présents développements, sur les témoignages multiples mis en avant, par exemple, par le milieu associatif. L’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), entendue lors des auditions préparatoires au présent rapport, avance le chiffre de quelque 10 000 situations que pourrait avoir à prendre en considération une loi sur l’aide active à mourir.
Sans entrer dans une querelle de chiffres, comment ne pas entendre la multitude de témoignages qui, encore très récemment, font apparaître cette réalité ? (10)
La jurisprudence sur la question de la fin de vie est, de l’avis général, très clémente. Certains observateurs indiquent par exemple qu’en matière pénale, certaines décisions révèlent une certaine indulgence, les peines étant assorties d’un sursis : ainsi, le 11 mars 1998, la Cour d’assises d’Ille-et-Vilaine a jugé coupable l’auteur d’une euthanasie (l’acte ayant bien été qualifié d’assassinat) tout en ne prononçant qu’une peine de cinq ans d’emprisonnement assortis du sursis simple. De même, le 12 février 2001, la Cours d’assises du Rhône a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis un mari (poursuivi pour assassinat) qui avait tué sa femme gravement malade et qui avait tenté de se donner la mort ensuite (11).
Plus encore, en matière d’euthanasie, « si les condamnations sont rarissimes, c’est que les poursuites le sont tout autant (parce que les dénonciations sont quasi inexistantes) » : ainsi, dans un cas d’espèce qui a fait l’objet d’une certaine publicité, était en cause un médecin de Sévérac-le-Château, en Aveyron, qui avait administré une piqûre de chlorure de potassium à une malade âgée de 92 ans, hémiplégique, atteinte de gangrène et ayant sombré dans le coma. Il fut dénoncé par ses confères, mais le Procureur de la République de Millau préféra ne pas ouvrir d’information judiciaire et se contenta de saisir, sur le plan disciplinaire, l’ordre des médecins, dont la décision fit l’objet de recours jusqu’à un arrêt du Conseil d’État du 29 décembre 2000, aux termes duquel a été confirmée la peine d’interdiction d’exercice de la profession de médecin pendant un an. Comme le notent les mêmes observateurs, « ce qu’il importe ici de souligner n’est pas la condamnation mais sa mansuétude : aucune peine correctionnelle et encore moins criminelle, parce qu’aucune poursuite judiciaire n’avait été intentée ».
Pour analyser « la réalité de la répression pénale : une très grande modération », d’autres auteurs (12) démontrent que la jurisprudence opte, quand il y a des poursuites, non seulement pour le sursis mais aussi parfois pour l’acquittement : ainsi du cas de l’acquittement d’un homme ayant empoisonné sa femme atteinte d’un cancer en phase terminale (Cour d’assises d’Angers, 14 juin 2006 – voir aussi par exemple l’acquittement d’un infirmier, Cour d’assises du département du Bas-Rhin, 4 octobre 1985).
Il n’en va pas différemment dans des circonstances plus médiatisées. Dans le cas de Chantal Sébire, l’intéressée, avant de se suicider au moyen d’une substance létale, avait présenté une requête auprès d’un président de tribunal de grande instance, en vue de solliciter une autorisation pour son médecin traitant de lui prescrire le traitement nécessaire lui permettant de terminer sa vie dans le respect de sa dignité. Le tribunal de grande instance de Dijon a rejeté cette requête le 17 mars 2008, soulignant qu’en droit interne, le code de déontologie médicale s’oppose à ce qu’un médecin donne délibérément la mort. Mais sur le plan pénal, le juge s’est limité à mentionner que la demande de fournir à un médecin les moyens de procurer la mort s’oppose à la loi qui incrimine, en application de l’article 223-13 du code pénal, la « complicité de suicide ». Or, cette référence assez floue a été analysée par certains juristes comme destinée à éviter le recours à des qualifications juridiques qui auraient pu être jugées excessives, par exemple le crime d’empoisonnement.
Il existerait « un seul cas connu où des peines sévères ont été prononcées » (13): celui d’une infirmière, Christine Malèvre, qui a été reconnue coupable des assassinats de six patients à Mantes-la-Jolie entre 1997 et 1998 et condamnée à douze ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises de Paris, le 16 octobre 2003.
Cet aperçu de quelques jurisprudences et éléments de politique jurisprudentielle montre d’une part, qu’il peut être injuste d’exposer à la variation de la jurisprudence un certain nombre de situations, le législateur devant prendre ses responsabilités. Mais, il révèle aussi d’autre part, une certaine hypocrisie à refuser de prendre en compte dans la loi des situations qui, dans les faits, sont, dans une certaine mesure en tout cas, validées par les juridictions.
Prenant acte de cet état de fait, des parlementaires, depuis plusieurs années, ont déposé des propositions de loi sur la question de l’euthanasie. On peut bien sûr remonter à la proposition de loi du sénateur Henri Caillavet, déposée en avril 1978, qui serait la première à tendre à la légalisation de l’euthanasie. Plus récemment, au Sénat, avait été déposée, le 14 octobre 2004, une proposition de loi « relative au droit de bénéficier d’une euthanasie ».
À l’Assemblée nationale, a été enregistrée en avril 2003 une proposition de loi « relative au droit de finir sa vie dans la liberté », en mai 2008 une proposition de loi « relative à l’aide active à mourir », en juin 2009 une proposition de loi « instaurant le droit de vivre sa mort » ou encore en juillet 2009 une proposition de loi sur la « reconnaissance de l’exception d’euthanasie et de l’aide active à mourir ». Ces initiatives – dont la liste n’est pas exhaustive –, issues de personnalités de toutes les sensibilités politiques, attestent aussi de la prégnance, par-delà les clivages partisans, d’une même préoccupation.
Autre signe d’une attente forte des Français, et ce depuis de nombreuses années, les résultats des enquêtes d’opinion réalisées sur cette question concordent. En avril 2000, 86 % des personnes interrogées répondaient positivement à la question : « En cas de maladie grave et incurable s’accompagnant d’une souffrance jugée insupportable, seriez-vous favorable à ce que soit accordé le droit d’aider à mourir à sa demande ? ». De même, dans une enquête de la Sofres réalisée les 8 et 9 mars 2006, 86 % des Français se disaient favorables (dont 40 % très favorables) à une loi « permettant à un malade une assistance médicalisée pour mourir, dans le cas où cette personne est placée dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité » (14).
Plus récemment encore, en avril 2009, une enquête réalisée par l’institut BVA a montré que 86 % de personnes se diraient favorables à ce que l’euthanasie « soit dans certains cas autorisée en France, lorsqu’une personne atteinte d’une maladie incurable en phase terminale la réclame ».
Sans doute, sur de tels sujets, ne peut-on que relativiser la portée de ces résultats énoncés de manière très générale, alors que les personnes interrogées ne sont pas nécessairement directement confrontées à la situation évoquée. Dans le même temps, une telle constance dans les résultats témoigne aussi d’un état d’esprit et d’un degré d’attente que l’on ne peut ignorer.
Face à ces attentes, les solutions qui ont été proposées récemment sur la question de la fin de vie sont – indépendamment du thème déjà évoqué des soins palliatifs – ressenties comme insuffisantes.
Le rapport de la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005, établi en novembre 2008, a permis d’apporter un premier élément de réponse à des questions qui avaient resurgi à l’occasion de la mort de Chantal Sébire. Le rapport, extrêmement complet, fait le constat d’une loi méconnue, et mal appliquée par les personnels soignants, soulignant que la loi n’a pas fait l’objet d’une campagne d’information suffisante de la part du ministère de la santé.
Il insiste par exemple sur la nécessité de diffuser une « culture palliative » à l’hôpital et d’encourager la recherche universitaire dans ce domaine. Il propose la création d’une allocation d’accompagnement de fin de vie, ainsi que l’institution d’un observatoire des pratiques médicales de fin de vie. Il se prononce dans le même temps contre la légalisation de toute forme d’aide active à mourir.
Au total, les quelque vingt recommandations de la mission sont destinées à améliorer l’application de la loi du 22 avril 2005, mais n’en changent pas l’équilibre.
La proposition de loi visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, présentée par MM. Jean Leonetti, Gaëtan Gorce, Olivier Jardé et Michel Vaxès, a été, à la suite des travaux de la mission précitée, examinée par l’Assemblée nationale le mardi 17 février 2009. Cette initiative, consensuelle, est destinée à créer une allocation au profit des personnes procédant à l’accompagnement à domicile d’un proche en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. L’allocation serait versée dans la limite d’une durée de trois semaines. Son montant devrait être de 40 à 50 euros par jour, selon que la personne concernée est seule ou en couple.
On ne peut que saluer cette initiative qui va, à l’évidence, dans le bon sens, même si on en sait les limites. La durée de trois semaines est-elle suffisante ? Comme l’indiquait M. Bernard Perrut, rapporteur de cette proposition, seules 25 % des personnes prises en charge par un dispositif de soins palliatifs sont à domicile : que faire pour les 75 % qui se trouvent à l’hôpital ou en établissement spécialisé, et dont les proches ont également besoin d’être aidés dans leur accompagnement (15) ?
Mais surtout, on peut s’interroger sur la volonté du gouvernement de voir adopté ce texte qui, même de portée limitée, constituerait une avancée. La première lecture à l’Assemblée nationale a eu lieu il y a neuf mois, et la discussion en séance publique a duré deux heures. Depuis cette date, cette proposition de loi n’a toujours pas été examinée par le Sénat… L’ordre du jour de celui-ci était-il si chargé que deux heures ne pouvaient y être consacrées à l’examen de ce texte ?
Sur le fond, ces éléments révèlent combien il est nécessaire de mettre en œuvre aujourd’hui une véritable volonté politique et de franchir, sur cette question de l’évolution de la législation sur la fin de vie, un nouveau pas.
III.- LA NÉCESSITÉ DE FRANCHIR UN NOUVEAU PAS
L’heure est donc venue de franchir un nouveau pas. L’exemple des législations sur l’euthanasie de trois de nos voisins européens nous y invite. Cela ne signifie pas interrompre les efforts en faveur du développement des soins palliatifs, bien au contraire. Mais, il s’agit de compléter cette offre par un dispositif nouveau d’aide active à mourir.
Au cours des dix dernières années, trois pays voisins ont adopté des législations tendant à légaliser l’euthanasie, qui sont autant d’exemples dont il est possible de s’inspirer aujourd’hui, compte tenu, bien sûr, des spécificités nationales. Ces exemples montrent en particulier que l’aide active à mourir peut, en droit, être encadrée par une grande variété de garanties strictes.
La loi du 12 avril 2001 aux Pays-Bas a modifié le code pénal, en prévoyant que l’euthanasie ne constitue pas une infraction, lorsque le médecin agit dans le respect de six « critères de minutie », énumérés ci-après :
– le médecin a acquis la conviction que le patient a formulé sa demande librement, de façon mûrement réfléchie et constante ;
– le médecin a acquis la conviction que les souffrances du patient étaient sans perspectives d’amélioration et insupportables ;
– le médecin a informé le patient de sa situation et de ses perspectives ;
– le médecin est parvenu, en concertation avec le patient et compte tenu de la situation de ce dernier, à la conviction qu’aucune autre solution n’était envisageable ;
– le médecin a consulté au moins un autre médecin indépendant qui a examiné le patient et s’est fait une opinion quant aux premier et quatrième critères précités ;
– le médecin a pratiqué l’interruption de la vie avec toute la rigueur médicalement requise.
Le médecin qui procède à l’interruption de vie doit remplir un rapport permettant de vérifier qu’il a respecté les critères de minutie. Ce rapport est adressé au médecin légiste de la commune, qui le communique à la commission régionale de contrôle de l’euthanasie géographiquement compétente. La commission n’informe le ministère public que lorsqu’elle estime que le médecin a méconnu l’un des six critères de minutie.
Par ailleurs, la loi du 12 avril 2001 reconnaît aussi explicitement les demandes anticipées d’euthanasie émanant de patients âgés d’au moins seize ans. La personne doit, dans cette hypothèse, ne plus être en mesure d’exprimer sa volonté, mais il faut que l’on puisse estimer qu’elle a pu, avant de sombrer dans cet état, apprécier raisonnablement sa situation. La demande doit avoir été formulée par écrit. Dans un tel cas, le médecin est tenu au respect des critères de minutie, et la procédure de contrôle par la commission régionale géographiquement compétente s’applique.
La loi du 28 mai 2002 – adoptée en même temps qu’une loi relative aux soins palliatifs – définit l’euthanasie comme « l’acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne, à la demande de celle-ci ». La loi précise que l’euthanasie, dans la mesure où elle est pratiquée par un médecin qui respecte certaines conditions, ne constitue pas une infraction pénale.
Des conditions de fond concernent le patient : celui-ci doit être « capable et conscient » ; il doit formuler sa demande de manière « volontaire, réfléchie et répétée », et être libre de toute contrainte ; il doit se trouver « dans une situation médicale sans issue et [faire] état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ».
La demande de la personne concernée doit être établie par écrit, dans un document qu’elle rédige, date et signe. La demande n’a pas valeur contraignante vis-à-vis du médecin, aucun médecin n’étant tenu de participer à un acte d’euthanasie.
Le médecin a l’obligation de s’entretenir avec le patient et d’évoquer avec lui son état de santé et son espérance de vie, les possibilités thérapeutiques, les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit acquérir « la conviction qu’il n’y a là aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire ».
Le médecin doit avoir plusieurs entretiens « espacés d’un délai raisonnable » avec l’intéressé, afin de « s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée ».
Le médecin doit aussi consulter : un autre médecin, indépendant, spécialiste de la pathologie concernée, qui rédige un rapport constatant que les conditions de fond relatives à l’état de santé du patient sont remplies ; l’équipe soignante ; les proches que le patient a désignés, si tel est le souhait du patient.
Il doit aussi veiller à ce que le patient ait pu s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’il souhaite rencontrer.
Si le malade n’est pas en phase terminale, la loi impose au médecin de consulter en plus un second médecin indépendant.
La loi organise un contrôle a posteriori systématique des euthanasies, en obligeant le médecin à remplir un document et à le transmettre à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation dans les quatre jours qui suivent l’acte d’euthanasie. La commission se prononce dans un délai de deux mois. Lorsque l’euthanasie n’a pas eu lieu dans les conditions prévues par la loi, la commission décide à la majorité des deux tiers de saisir le ministère public.
Enfin, la loi ouvre la possibilité à un médecin de pratiquer l’euthanasie sur une personne qui n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, dès lors que celle-ci a préalablement manifesté sa volonté dans une déclaration anticipée ; dans cette déclaration, le patient désigne une ou plusieurs personnes de confiance majeures, qui mettent le médecin au courant de sa volonté et qui, le moment venu, décident à sa place au cas où il ne serait plus en mesure de le faire.
La personne doit : être « atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable » ; être inconsciente ; se trouver dans un état « irréversible selon l’état actuel de la science ».
Le médecin a l’obligation de consulter un autre médecin indépendant, l’équipe soignante, la personne de confiance, dans la mesure où le patient en a désigné une, ainsi que, le cas échéant, les proches du patient désignés par la personne de confiance. Les demandes du patient et les démarches du médecin accompagnées de leurs résultats doivent figurer dans le dossier médical.
Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 rend légale l’euthanasie pratiquée dans le respect d’un certain nombre de conditions.
Le patient doit être majeur, capable et conscient au moment de sa demande. La demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, répétée, et elle ne résulte pas d’une pression extérieure. Le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique. La demande du patient d’avoir recours à une euthanasie doit être consignée par écrit.
Le médecin doit respecter un certain nombre de conditions : informer le patient de son état de santé, l’informer sur les soins palliatifs ; s’assurer de la persistance de la souffrance du patient et de sa volonté réitérée ; consulter un autre médecin ; s’entretenir de la demande avec l’équipe soignante et avec la personne de confiance désignée par le patient ; s’informer auprès de la Commission nationale de contrôle et d’évaluation de l’enregistrement éventuel de dispositions de fin de vie.
La demande est actée par écrit. Le patient peut la révoquer à tout moment.
Par ailleurs, la loi luxembourgeoise prévoit aussi l’hypothèse où une personne ne pourrait plus manifester sa volonté : celle-ci peut consigner par écrit, dans des dispositions de fin de vie, les circonstances et conditions dans lesquelles elle désire subir une euthanasie si le médecin constate : que la personne est atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ; qu’elle est inconsciente ; et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.
Dans tous les cas, aucun médecin ne peut être tenu de pratiquer une euthanasie, ni aucune autre personne tenue de participer à celle-ci.
Ces exemples, mais aussi, pour les deux premiers d’entre eux, la pratique qui en résulte, montrent que légiférer sur cette question difficile n’est pas impossible. En particulier, ils révèlent la palette des garanties dont il est possible et nécessaire d’assortir la consécration juridique d’une aide active à mourir. C’est ce que confirment les éléments de bilan de ces pratiques aujourd’hui disponibles.
— Aux Pays-Bas, pour l’année 2008, les commissions régionales de contrôle de l’euthanasie ont enregistré 2 331 déclarations par application de la loi du 12 avril 2001, chiffre en augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente (2 120 cas en 2007), et ce pour la deuxième année consécutive (16). Dans 2 146 cas, il s’agissait d’euthanasie, dans 152 cas, d’aide au suicide, et dans 33 cas, d’une combinaison des deux.
Les affections dont souffraient les personnes concernées étaient très majoritairement le cancer (1 893 cas), puis, dans une moindre mesure, les pathologies du système nerveux (117 cas), les polypathologies (114 cas), ou encore des pathologies cardiovasculaires (62 cas).
Dans 1 851 situations, l’interruption de vie a été pratiquée au domicile du patient, dans 145 cas à l’hôpital, dans 87 cas dans un établissement de long séjour, dans 111 cas dans une maison de retraite médicalisée et dans 137 cas dans un autre lieu (structure d’accompagnement de fin de vie ou domicile d’un membre de la famille).
Dans chaque cas, les commissions régionales ont examiné si le médecin avait agi dans le respect des critères prévus par la loi. Le rapport souligne que « dans la presque totalité des cas, les commissions estiment que le médecin a respecté les critères de rigueur légaux ».
À dix reprises, les commissions ont estimé qu’il n’en avait pas été ainsi : ce chiffre atteste que les éventuelles dérives – au demeurant rares – sont dénoncées.
Le rapport des commissions régionales rend compte de certains cas où les critères de rigueur n’ont pas été respectés, lorsque cette publication ne saurait mettre en cause l’anonymat du patient. Le rapport a par exemple rappelé qu’un même médecin ne saurait à la fois pratiquer l’euthanasie et intervenir en tant que consultant ; de même, le médecin ne peut évidemment pratiquer l’interruption de la vie avant d’avoir pris connaissances des conclusions du consultant qu’il avait appelé.
– En Belgique, selon le troisième rapport de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie (17), après une augmentation importante du nombre de déclarations d’euthanasies en 2003 et en 2004, l’augmentation annuelle est continue mais relativement faible. Le nombre de documents d’enregistrement reçus par la commission a été de 429 en 2006 et de 495 en 2007, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 38 déclarations sur les deux ans. La proportion du nombre de décès par euthanasies déclarées en 2006 et en 2007 a été de 0,44 % de l’ensemble des décès du pays.
Toutes les affections qui ont donné lieu à euthanasie étaient, au moment de celle-ci, et conformément aux exigences de la loi de 2002, incurables et graves. La grande majorité d’entre elles étaient des cancers (750, soit 81 % du total) ; le second diagnostic, en termes de fréquence, était celui d’affection neuromusculaire évolutive mortelle (76 cas, soit 8 % du nombre d’euthanasies pratiquées). Chez la plupart des malades, plusieurs types de souffrances, tant physiques que psychiques, étaient présents simultanément.
En 2006 et 2007, 26 euthanasies de patients inconscients ont été pratiquées sur la base d’une déclaration anticipée.
Une proportion importante des euthanasies (49 %) a été pratiquée au domicile des patients ou en maison de repos, ce qui correspond, selon le rapport de la commission, « au désir fréquemment exprimé de terminer sa vie chez soi ».
Concernant le respect des dispositions légales, le rapport relève qu’aucun manquement aux prescriptions légales n’a été constaté, concernant la consultation obligatoire des médecins. En outre, les médecins ont fréquemment eu recours à des consultations supplémentaires de spécialistes, s’ajoutant aux obligations légales (388 médecins et 340 équipes palliatives) : la commission « considère le fait comme témoignant de la rigueur et du sérieux avec lequel les médecins déclarants ont agi ».
La procédure suivie par le médecin « a généralement été correcte et conforme à la loi ».
Au total, « aucune déclaration ne comportait d’éléments faisant douter du respect des conditions de fond de la loi et aucun dossier n’a donc été transmis à la justice ».
Le rapport indique, s’agissant des remarques ajoutées par certains médecins dans les déclarations, qu’« on relève dans plusieurs déclarations la mention d’une mort calme en quelques minutes, d’une atmosphère sereine avec accompagnement par des proches pendant l’acte ainsi que de remerciements adressés au médecin, tant par le patient dans ses derniers instants que par les proches ».
L’ensemble de ces évolutions ne s’opposent pas au développement des soins palliatifs dans ces pays, mais au contraire les accompagnent. Aux Pays-Bas, les soins palliatifs font partie intégrante des soins réguliers. Dès les années 1990 avait été lancé un « programme de stimulation », dans le but de promouvoir la recherche, la formation et la diffusion des soins palliatifs. En Belgique, le projet de déclaration de politique générale wallonne établi en juillet 2009 pour la période allant de 2009 à 2014 laisse une très large part au développement de la culture palliative. En outre, un récent article publié dans le British medical journal a montré, à partir d’études menées en Belgique sur la situation de mourants en 2005 et 2006 sur les trois dernières années de leur vie, que les décisions médicales visant à abréger la vie n’avaient pas entravé la pratique des soins palliatifs mais, au contraire, avaient souvent été prises dans le cadre de soins multidisciplinaires (18).
Aucune réforme en matière de fin de vie ne saurait méconnaître la nécessité du développement des soins palliatifs. Comme cela a été le cas des législations précédentes sur la fin de vie, il est essentiel de consacrer des droits nouveaux en matière de fin de vie, tout en favorisant le recours aux soins palliatifs.
De très nombreuses études (19), jusqu’à très récemment, ont souligné les avancées importantes réalisées en matière de développement des soins palliatifs, qu’il s’agisse de leur organisation ou de la mise en œuvre des pratiques professionnelles, dans un ensemble de structures diversifiées, qui ont été rappelées supra.
Mais ces travaux ont aussi souvent dénoncé les faiblesses de l’offre en soins palliatifs, et notamment :
– l’existence de fortes inégalités territoriales : à titre d’exemple, s’il existe plus de 100 réseaux de soins palliatifs en France, plus de 40 départements n’en comptent aucun ;
– des différences de diffusion et d’appropriation des démarches palliatives par les professionnels : comme le note par exemple le rapport de la DREES, « dans le secteur sanitaire, deux des trois dimensions des démarches palliatives sont déployées – les soins de confort et le traitement de la douleur –, mais la dimension d’accompagnement psychologique, spirituel et social reste peu présente » ; en outre, dans le secteur médico-social, les démarches palliatives ne sont pas distinguées des pratiques d’accompagnement de la fin de vie déployées à titre habituel ;
– l’insuffisance de la formation des professionnels : la formation initiale ne prend qu’insuffisamment en compte la question de la pluridisciplinarité ; quant à la formation continue, elle se compose surtout de temps de formation très courts et centrés sur un enseignement technique, au détriment de la dimension culturelle et éthique.
Ces insuffisances sont autant d’encouragements à développer encore les soins palliatifs. Les trois pistes d’amélioration proposées par la DREES – mais il en existe tant d’autres – sont les suivantes : améliorer la connaissance du dispositif global et de ses modes de fonctionnement réels ; accompagner les évolutions organisationnelles et culturelles des professionnels ; optimiser le système de gouvernance.
La généralisation du recours aux soins palliatifs – en faveur de laquelle tout doit être fait – ne saurait suffire. Cette généralisation ne répond pas, en effet, à toutes les situations de souffrance et à toutes les demandes des malades.
En outre, aller aujourd’hui dans le sens d’une légalisation de l’aide active à mourir paraît nécessaire pour les médecins eux-mêmes : face aux demandes réitérées de mourir, ils sont parfois laissés seuls face à la détresse de leur patient et à leur conscience.
Enfin, le législateur ne saurait se dérober à sa responsabilité et se défaire de ses compétences, en laissant la jurisprudence dire le droit au cas par cas : il convient donc qu’il puisse assumer ses responsabilités, en encadrant strictement l’aide active à mourir.
Face à ce qui apparaît donc comme une exigence, un certain nombre de propositions ont été faites ; en particulier, la proposition de la mise en place d’une formule d’« exception » a été avancée. Certains, partant du constat que le corps médical ne serait pas prêt, aujourd’hui, à appliquer un « droit général », préconisent une démarche plus progressive tendant, par exemple, à créer une haute autorité morale susceptible de rendre des avis, au cas par cas, et à titre exceptionnel, sur les demandes de malades souhaitant mourir. Ces avis pourraient ensuite éclairer les tribunaux, dans l’hypothèse de démarches judiciaires consécutives à la mort du patient.
Cette solution soulève cependant un certain nombre de questions pratiques : sur quels critères le législateur déterminerait-il la composition ou le champ exact de compétences de cette autorité ? En cas de refus par cette autorité d’accéder à la demande d’une personne, quelles seront les voies de recours ? Ne risque-t-on pas de créer ainsi une nouvelle source de contentieux ?
Pour l’ensemble de ces raisons, la présente proposition de loi crée une « aide active à mourir » de portée générale. Celle-ci peut bénéficier à toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et que cette personne juge insupportable.
La personne concernée s’adresse à son médecin traitant, qui réunit un collège en faisant appel à un minimum de trois autres praticiens. Si ce collège constate la situation d’impasse dans laquelle se trouve la personne, ainsi que le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, l’intéressé sera appelé à confirmer celle-ci, en présence d’une personne de confiance, qu’il aura préalablement désignée. L’aide active peut ensuite avoir lieu, au plus tôt deux jours après la confirmation de la demande par la personne concernée. La demande est révocable à tout moment.
Le médecin adresse à une commission régionale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité un rapport exposant les conditions du décès, dans les quatre jours de celui-ci.
En outre, la proposition de loi ouvre cette même possibilité aux personnes en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qui se trouvent de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, sous réserve que la personne en ait exprimé la volonté, au préalable, dans des directives anticipées.
C’est alors la personne de confiance de la personne concernée qui saisit de la demande le médecin traitant. Un collège d’au moins quatre médecins se prononce sur l’état de la personne, après consultation de l’équipe médicale et des personnes qui assistent au quotidien l’intéressé. La personne de confiance doit aussi confirmer la demande, en présence de deux témoins. L’acte d’aide active ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Le médecin adresse un rapport sur les conditions du décès à la commission régionale précitée.
Les commissions régionales qui estiment que les garanties prévues par la loi n’ont pas été respectées transmettent le dossier en cause à une commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité, instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé ; cette commission dispose de la faculté de transmettre le dossier au Procureur de la République.
Enfin, la proposition de loi garantit un droit au refus pour tout professionnel de santé d’apporter son concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Dans un tel cas, le médecin doit orienter l’auteur de la demande vers un autre praticien, susceptible de déférer à celle-ci.
La Commission examine la présente proposition de loi au cours de sa séance du mardi 10 novembre 2009.
Un débat suit l’exposé du rapporteur.
M. Jean Leonetti. Je sais gré à Manuel Valls de s’attaquer à ce sujet qui, effectivement, n’est pas tabou. Nous avions d’ailleurs prouvé antérieurement que nous pouvions l’aborder sereinement, en particulier dans le cadre de la mission d’information sur la fin de vie. Il dépasse tous les clivages : entre la droite et la gauche, entre les croyants et ceux pour qui le ciel est vide, comme entre ceux qui souhaitent une loi et ceux qui la refusent.
La mort est une expérience impossible que nous ne vivons, de manière douloureuse ou apaisée, qu’au travers de celle de nos proches. Ainsi, au plus profond de notre intimité, nous portons l’idée que nous pourrions mourir ainsi ou, au contraire, que nous ne voudrions pas mourir de cette façon. Cette réaction procède de trois peurs : de la peur légitime de mourir, l’homme étant le seul « animal » à savoir qu’il va mourir ; de la peur de souffrir – et nous savons qu’il y a encore peu de temps, dans ce pays, on pouvait malheureusement mourir dans d’atroces souffrances ; et d’une peur nouvelle, celle de la déchéance, c’est-à-dire la peur de mourir en offrant aux autres une image de soi dégradée, par rapport à la représentation que nous avons de nous-mêmes et que, probablement, la société nous impose.
J’ai lu avec intérêt cette proposition de loi et j’ai trouvé dans le propos de Manuel Valls des éléments fertiles, qu’on pourrait résumer par le doute. Parlant de la mort, celui qui dit « je sais » se trompe, et celui qui dit « je ne sais pas » a compris – quelle que soit la conclusion à laquelle il arrive – la complexité et le caractère personnel de la mort et aborde donc ce sujet avec humilité et modestie.
Je crois utile de rappeler l’apport de la loi existante.
Non seulement cette loi s’oppose à l’acharnement thérapeutique, mais elle permet aussi au malade de dire « non » à un traitement ou à des examens qu’il ne souhaite pas, et d’exiger des soins susceptibles d’apaiser ses douleurs ou ses souffrances. La demande de mort en fin de vie, en particulier en phase terminale, est motivée par deux grandes causes : l’abandon ou la solitude d’une part, et la souffrance physique et morale d’autre part – la souffrance physique, plus encore que la souffrance morale, déstructurant complètement l’individu au point d’altérer profondément sa lucidité. Qui n’a pas un jour, à cause de douleurs insuffisamment calmées, souhaité disparaître plutôt que de continuer à les subir jusqu’à la mort ? Ainsi, la loi impose au médecin de supprimer la souffrance du malade en phase terminale, même au prix d’abréger sa vie. Le double effet y est instauré, car la qualité de la fin de vie primant sur la durée de la vie, ce ne sont pas les doses utilisées qui sont prises en compte, mais la souffrance exprimée par le malade, physique ou morale, qui impose au médecin de répondre à sa demande.
En outre, les traitements peuvent être arrêtés, mais jamais les soins – les Anglo-saxons ont pour cela deux mots de sonorité voisine, cure, soigner, et care, prendre soin. C’est un dispositif « à la carte », et non pas un système paternaliste dans lequel le médecin pourrait dire : « Si je ne vous soigne pas comme je le veux, alors je ne vous soigne plus ». La loi impose au médecin d’accepter le refus de traitement et de soulager le patient, en vertu d’un principe de solidarité que nous, Français, appelons la fraternité – nous savons, malheureusement, que cela ne s’est pas toujours traduit dans les faits.
Car, c’est vrai, la loi est mal appliquée, mal connue. Très consensuelle en apparence, elle n’en bouleverse pas moins certains rapports humains, en particulier entre le soignant et le soigné. D’un système dans lequel le puissant, bien portant et sachant, imposait au mourant et au souffrant ses décisions, on est passé à un système où le patient en fin de vie reprend le dessus : la relation verticale, dans laquelle le patient s’entendait dire : « Je sais, je soigne et vous subissez », fait place à une relation beaucoup plus « horizontale ».
Après ma cent dixième réunion sur ce thème en France, j’ai le sentiment que la mentalité médicale, aussi bien que celle de nos concitoyens, ont beaucoup évolué. Les principes de non-abandon et de non-souffrance instaurés dans la loi s’imposent petit à petit et règlent donc assez bien, à mon sens, le problème de la phase terminale : plus aucun médecin n’a peur d’être envoyé en prison pour avoir utilisé des morphines à doses élevées, non plus qu’aucun réanimateur pour avoir arrêté un respirateur. En protégeant les médecins dont les pratiques sont conformes à leur déontologie d’accompagnement jusqu’au bout, mais sans acharnement thérapeutique, la loi permet au malade de partir de manière beaucoup plus sereine et apaisée.
En revanche, la situation n’est pas tout à fait la même lorsque la mort est éloignée, ou supposée l’être. Vincent Humbert n’était pas proche de la mort, Chantal Sébire était à des semaines, peut-être à des mois de la mort, de même que ce jeune homme paralysé des membres inférieurs qui s’est donné la mort après avoir écrit au Président de la République. Eux disaient, non pas « Je souffre trop, achevez-moi », mais « La vie que je mène ne mérite pas d’être vécue et je vous demande d’y mettre fin », renvoyant à un autre problème de société, celui du suicide assisté. À cet égard, la législation belge a évolué, partant d’une vision euthanasique pour s’orienter vers une législation du suicide assisté, se rapprochant ainsi de la législation suisse.
Or, au nom de la liberté et de l’autonomie, faut-il accepter un droit à la mort équivalent à un droit à la vie ? Face à cette vraie question, je n’ai pas de solution. La dignité étant le propre de l’homme et ne pouvant pas être évaluée, peut-on donner la mort à une personne lucide qui la demande ? Cette interrogation heurte certaines de nos valeurs. Doit-on réanimer, à son arrivée à l’hôpital, l’auteur d’une tentative de suicide, ou doit-on faire preuve de compassion et accepter son acte ? Certes, il y a eu le suicide stoïcien, mais Sénèque s’est donné la mort alors que les prétoriens attendaient pour achever le travail… Je me demande donc s’il faut vraiment considérer le suicide comme une liberté. Ce peut être le cas sur le papier, mais, en tant que législateurs, devons-nous considérer le nombre de suicides en France comme un marqueur de liberté ou comme un marqueur de souffrance, et devons-nous lutter contre la liberté ou contre la souffrance ? Doit-on tuer une personne qui souffre pour qu’elle ne souffre pas ? Doit-on s’orienter vers un modèle, ô combien individualiste et – pardon de le dire – américanisé, dans lequel le leitmotiv « c’est mon choix » s’impose aux autres, alors que devrait seulement prévaloir la solidarité à l’égard des personnes en souffrance ?
Où en est cette question au niveau international ? Les Pays-Bas se font admonester pour leurs pratiques euthanasiques par le Comité des droits de l’homme de l’ONU. Les Belges ont avoué pratiquer le suicide assisté et des dizaines d’euthanasies sur des enfants. Les Suisses reviennent sur leur législation sur le suicide assisté, constatant qu’en s’en tenant aux seules liberté et volonté, ils « suicidaient » 30 % de gens qui n’étaient pas atteints de maladie grave et incurable, mais qui étaient simplement las de vivre.
Dans le film Soleil vert – que j’ai vu dans ma jeunesse et dont je prêterai volontiers le DVD à Manuel Valls –, les gens ayant « fini » leur vie sont considérés comme inutiles et par conséquent éliminés. Aujourd’hui, je crains que l’on ne nous impose, dans une « barbarie civilisée » comme le dit M. Edgar Morin, de mettre à l’écart ou d’éliminer tout ce qui ne correspond pas aux modèles de jeunesse, de force, de rentabilité, d’efficacité. La demande, que l’on accepterait, d’une personne exprimant sa lassitude de vivre en raison de son âge et de ses problèmes, ne serait-elle pas, en fait, la demande d’une société qui n’accepterait pas la vulnérabilité et placerait au dessus de tout l’autonomie ? Ce serait contraire, non pas à une vision religieuse – ou non religieuse –, mais à une certaine idée que nous avons tous de l’homme et de la civilisation. De sa naissance jusqu’à sa mort, l’homme est digne par définition, et sa demande de mort doit lui être refusée, car la société doit supprimer les causes de cette demande, non l’individu qui en est l’auteur.
Telle est ma position, au terme du cheminement complexe effectué avec mes collègues Gaëtan Gorce, Michel Vaxès, Olivier Jardé et tant d’autres. Plus nous avançons, moins nous savons les choses et, paradoxalement, plus nous comprenons les autres, plus nous acceptons la complexité et moins nous souhaitons légiférer, car nous devons défendre un projet collectif pour notre société, et non un projet qui soit la somme de choix individuels. Avec toute l’estime que j’ai pour Manuel Valls, je pense que sa proposition de loi pourrait, dans des situations économiques tendues ou en des périodes où domine le souci de rentabilité, mettre en cause l’humain dans ce qu’il a de plus intime et de plus précieux : sa vulnérabilité.
M. Roland Muzeau. En proscrivant l'acharnement thérapeutique, la loi Leonetti du 22 avril 2005 a indiscutablement amélioré les droits des patients en fin de vie.
Pour être largement partagée, l’opinion que vient d’exprimer Jean Leonnetti n’est cependant pas celle de tous les parlementaires. Comme Manuel Valls et lui-même l’ont exposé, dans ce domaine, les clivages ne sont pas politiques. L’opinion est d’abord celle de chacun.
La loi Leonetti ne dépénalise pas l'euthanasie ; elle ne reconnaît pas le « droit à une aide active à mourir ». Bien qu'adoptée à la quasi-unanimité, elle a été fondée dès le départ sur un consensus fragile entre ceux pour qui elle constituait un point d'équilibre au-delà duquel il est impossible d'aller, et ceux qui y voyaient un point d'appui pour obtenir la légalisation de l'euthanasie et la reconnaissance du droit, pour toute personne malade, de faire respecter sa volonté de mourir dans la dignité, ainsi que l’ont décidé certains pays européens.
Ce débat sur l'euthanasie, auquel nos concitoyens semblent prêts, n'a cessé d'être entretenu par les membres de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), dont je fais partie. Il a été relancé à la suite de plusieurs affaires malheureuses, qui ont démontré que la loi française n'offre un cadre sécurisé ni aux patients sans espérance de guérison, mais dont les souffrances sont insupportables, ni aux médecins, qui sont parfois encore poursuivis et condamnés pour avoir abrégé les souffrances de patients en phase terminale d’un cancer. Notre collègue sénateur Robert Badinter a déclaré que « créer une législation pour des cas exceptionnels n'est pas la bonne façon de les résoudre ». Cependant, les cas dont il est question ne sont peut-être pas si exceptionnels qu’on le dit. Surtout, le législateur peut-il se décharger de sa responsabilité pour laisser au juge le soin de dire, au cas par cas, le droit et de décider s'il y a place ou non pour une « exception d'euthanasie », excusant ou atténuant l'acte d'homicide ?
S’inscrivant dans le cadre posé par la loi Leonetti, celui des droits de la personne en fin de vie, la proposition de loi vise à modifier le code de la santé publique – et non le code pénal – en créant un droit nouveau pour les malades en phase terminale : celui de bénéficier d'une aide active à mourir.
De « laisser mourir » à « aider à faire mourir dans la dignité », le pas est d’importance. À titre personnel, je souhaite que nous le franchissions. L’adoption éventuelle de la proposition de loi n'épuisera cependant pas le débat. Car, si elle renforce vis-à-vis du corps médical le caractère impératif des directives anticipées de fin de vie exprimées par le patient, son champ d'application est limité et en retrait sur la proposition de l'ADMD, qui vise aussi les personnes placées dans un état de dépendance incompatible avec leur dignité.
Dans la sensibilité qui est la mienne, les avis sont divers - irréductiblement divers. Mon opinion n’est pas celle, par exemple, de Michel Vaxès. Il vous le dira lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique. C’est donc en mon nom personnel que je viens de m’exprimer.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Les orateurs précédents l’ont dit, le sujet est délicat et nous interpelle au plus profond de nous-mêmes.
J’ai lu la loi Leonetti et le rapport d’information qui l’a précédée…
M. Jean Leonetti. Quoique mon orgueil soit très flatté de cette appellation, je rappelle que cette loi est issue d’une proposition de loi déposée par 32 parlementaires de tous bords.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Je me souviens très bien – j’étais alors déjà députée – de l’examen du rapport d’information puis du très important travail réalisé par la commission pour l’élaboration de la loi, au cours duquel les positions de beaucoup d’entre nous ont évolué.
Le texte présenté aujourd’hui ne s’inscrit pas dans un contexte médiatique. Il ne procède pas d’une envie de légiférer à partir de cas isolés qui ont ému l’opinion publique. C’est essentiel. Sur ce sujet complexe, il faut travailler dans la sérénité.
En même temps, l’intérêt de nos concitoyens est certain, nous le percevons bien. Beaucoup d’entre eux considèrent qu’il faut sans doute aller un peu au-delà du progrès que la loi du 22 avril 2005 a constitué.
Pourquoi ? D’abord, le rôle qui y est dévolu au médecin peut apparaître trop important au regard de la liberté accordée au malade en fin de vie. Nous avons donc entrepris d’élaborer un texte équilibré. L’importance des soins palliatifs y est rappelée. L’exposé des motifs insiste sur la nécessité d’en faire une priorité nationale. Nous le savons tous, la réalité est loin de nos souhaits. L’objectif de cinq lits pour 100 000 habitants fixé en 2005 par M. Douste-Blazy, alors ministre de la santé, n’a pas été atteint.
Par ailleurs, des souffrances comme celles qu’entraînent la maladie de Charcot ou certaines scléroses en plaques sont réfractaires aux soins palliatifs, même les plus avancés. Il faut donc encadrer ces situations connues et trop communes, qui sont souvent une source de préoccupation pour les médecins de soins palliatifs que nous rencontrons.
Combien d’euthanasies sont-elles pratiquées en France, sans que le patient ait eu le droit de dire « oui » ou « non » ? Bien sûr, ce type d’euthanasie n’étant pas autorisé, il ne peut y avoir de statistiques, mais on sait que, dans certains hôpitaux, faute de solution pour le malade, des médecins pratiquent cette aide active à mourir. Dans d’autres, parce que le médecin y sera peut-être moins favorable, le droit à mourir dignement ne pourra être exercé avec la même qualité.
Nous ne connaissons pas non plus tous un médecin qui pourra nous prescrire un traitement susceptible de nous aider à en finir plus vite.
Jean Leonetti a parlé de liberté. Pour moi, le droit à mourir dans la dignité est aussi une question d’égalité. Le patient ne doit pas dépendre du médecin. Il doit pouvoir donner son avis, surtout s’il ne veut pas mourir alors que les médecins considèrent que sa situation est désespérée. C’est pour cette raison que, comme la loi du 22 avril 2005, la proposition de loi insiste sur les directives anticipées et sur le rôle de la personne de confiance, révocable bien sûr. Notre volonté de dépasser la loi actuelle s’accompagne d’un dispositif d’encadrement. Il ne s’agit pas d’aider à mourir des personnes âgées lasses de la vie, mais des malades atteints de maladies graves et incurables et qui ont exprimé clairement leur volonté. La proposition de loi répond donc à une demande de liberté et d’égalité. Elle prévoit que plusieurs médecins, au moins quatre, donnent leur avis sur la situation, parce que nous ne sommes pas tous en mesure de juger de notre état médical ni de l’état de la médecine – je défendrai d’ailleurs un amendement sur ce point. Le patient doit savoir ce qui l’attend. Le temps est venu, aujourd’hui, d’aller un peu plus loin pour rendre tous les citoyens libres et égaux.
M. Bernard Perrut. Le décès d’un proche est un moment difficile. Il nous interroge sur la souffrance et la douleur. Pour autant, le texte qui nous est proposé aujourd’hui ne répond pas à mon attente. Je suis hostile à la fois à l’acharnement thérapeutique et à l’aide active à mourir – je préfère éviter le terme d’euthanasie.
Quels droits devons-nous reconnaître ? C’est d’abord le droit du malade à des soins utiles et proportionnés. Toute personne mérite d’être soignée jusqu’à la fin de sa vie, au moyen des techniques les plus efficaces, mais sans subir de traitements qui seraient jugés inutiles. Autant que possible, la personne doit alors être associée au choix des soins qu’elle reçoit. Elle doit pouvoir demander l’interruption des traitements devenus inutiles. C’est du reste le régime de la loi actuelle. Cet arrêt ne doit bien sûr être confondu ni avec l’aide active à mourir, ni avec l’euthanasie. Toute personne doit aussi pouvoir bénéficier jusqu’à la fin de sa vie de soins anti-douleur adaptés et d’un soutien personnalisé répondant à ses besoins physiques, psychologiques, voire spirituels. Nombre d’établissements ne prodiguent que très insuffisamment les soins anti-douleur, dont la pratique doit donc être renforcée.
Quel que soit son état physique ou mental, toute personne doit être regardée avec respect jusqu’au terme de sa vie : membre de la communauté humaine solidaire que nous constituons, elle ne peut à aucun moment être considérée comme inutile ou privée de dignité. Elle a donc un droit, qu’il faut réaffirmer et que nul ne conteste, aux soins palliatifs ; sa mort ne doit jamais être délibérément provoquée.
Le droit de toute personne en fin de vie comporte, outre le droit à des soins proportionnés, celui, essentiel, d’être accompagnée par les soignants et ses proches dans la confiance. Faire apparaître dans un texte de droit, la notion d’aide active à mourir pourrait bouleverser le malade, avant même qu’il n’atteigne la période de fin de vie. Le malade a besoin d’une relation de vérité sur sa situation. S’il le souhaite, nous devons aussi mettre tout en œuvre pour qu’il puisse finir ses jours à son domicile. Les chiffres le prouvent, ce n’est aujourd’hui que trop peu souvent possible en France.
Toute personne confrontée à une situation de santé difficile – diagnostic grave, lourde dépendance, angoisse face à la mort – ou à des tentations suicidaires doit être soutenue, réconfortée, entourée par les soignants, par ses proches ou par des bénévoles. La place de ces derniers, pour entourer, au terme de leur vie, les malades qui n’ont pas de proches, doit être réaffirmée dans nos établissements.
La notion d’aide active à mourir m’inquiète aussi par les risques de débordement qu’elle comporte. Une personne – un jeune par exemple – qui a voulu se suicider devrait-elle être confortée dans ses pensées de mort à son arrivée à l’hôpital ?
Je m’en tiens donc à l’affirmation de deux droits, le droit à des soins adaptés et proportionnés aux besoins du malade et à ses chances de vie, et le droit, essentiel, à l’accompagnement.
M. Jean-Frédéric Poisson. Je remercie le rapporteur pour son travail – la complexité du sujet impose d’avancer avec précaution – et pour sa clarté : la proposition de loi porte bien sur l’euthanasie, ou plus exactement le suicide assisté, si l’on peut faire cette distinction.
Au contraire de notre collègue Danièle Hoffman-Rispal, je ne suis pas sûr que les citoyens attendent une législation qui dépasse les dispositions de la loi Leonetti. Je ne vois pas non plus la nécessité, évoquée par le rapporteur, de franchir un nouveau pas.
Seraient-ce certains États voisins, ayant légiféré sur ce sujet, qui nous inviteraient à cette nouveauté ? Jean Leonetti a rappelé que les évolutions législatives dans ces pays n’étaient couronnées de succès, ni en termes d’efficacité médicale, ni en termes de normes de droit.
S’agirait-il de répondre à une attente des populations ? Membre d’un comité d’éthique et d’un réseau de soins palliatifs, je ne suis certain que de la très grande circonspection des soignants envers l’expression des demandes tant des personnes souffrantes que de leurs proches – et je suis moi-même circonspect devant des enquêtes d’opinion qui peuvent être inspirées par ce que relate la télévision plutôt qu’exprimer une volonté profonde.
La nouveauté que constitue la proposition de loi de notre collègue Manuel Valls ressortit à une volonté d’aller, non pas plus loin, mais ailleurs. Les lois successives ont maintenu une frontière étanche entre faire mourir activement et reconnaître que, chez un patient, la vie a « perdu la partie ». Cette distinction en commande une autre, sémantique, entre ce qu’il est improprement convenu d’appeler euthanasie active et euthanasie passive, ou encore entre l’euthanasie proprement dite et l’arrêt des soins, le refus de l’acharnement.
La législation doit maintenir le caractère infranchissable de cette frontière. La franchir, comme le propose la proposition de loi, nous exposerait à divers dangers. Vouloir traiter les situations complexes est compréhensible. Bien sûr, une fois accepté le franchissement de la limite dont je viens de parler, instituer une mécanique d’encadrement et de régulation éthique extrêmement précise, comportant des comités, des juges, des médecins, est indispensable. Mais que serait un corpus de droit intégrant un droit, une permission de donner délibérément la mort à quelqu’un d’autre que soi ? Pour avoir essayé de traiter diverses grandes difficultés dans la vie quotidienne des services hospitaliers, je pense que le plan symbolique du droit serait amputé de manière irréversible.
Ensuite – j’en ai souvent discuté avec Jean Leonetti –, l’équilibre de la loi du 22 avril 2005 est fragile. Comme tout ce qui est en équilibre, cette loi est en danger permanent. De façon à la fois très rassurante et très inquiétante, elle repose sur une confiance très grande, et fondée, dans l’exercice par le corps médical de son propre art, et nous confronte, quelle que soit notre position – législateurs, patients, spectateurs extérieurs à la relation entre le médecin et son patient –, à la limite, à l’incertitude, à la possibilité de l’erreur inhérentes à l’appréciation d’une situation par un ou plusieurs membres du corps médical : lorsqu’une question lui est posée, un médecin peut être sûr de son diagnostic, et sûr par exemple que la personne examinée ne recouvrera jamais ses facultés de conscience, mais parfois ce n’est pas le cas. Cette incertitude, qui reste l’un des nœuds gordiens de la loi du 22 avril 2005, doit être maintenue. Rationaliser, encadrer les pratiques et les décisions médicales en recherchant le moindre risque possible est une limite à l’exercice de l’art médical en tant que tel. L’encadrement de l’art médical ne doit pas être excessif. La loi ne peut pas régler cette situation imparfaite ; elle perdrait à le tenter.
Ce n’est pas non plus la première fois qu’une législation à caractère bioéthique, au sens large, tente de mettre en place des modalités d’encadrement ; les actuelles « lois bioéthiques » en regorgent. Or, jamais aucune de ces modalités d’encadrement n’a pu empêcher les dérives que nous craignons tous. Les situations dans ces domaines sont d’ailleurs tellement tendues que, malheureusement, à peu près aucune disposition ne pourrait en limiter la possibilité et donc la réalisation. Pour cette raison encore, et pour paraphraser le philosophe du XVIIIe siècle, le système actuel est le meilleur possible dans le moins pire des mondes possibles.
Enfin, je me souviens avoir rencontré les époux Pierra, dont le fils inconscient est décédé dans de très grandes souffrances. Je n’ai rien pu faire d’autre pour eux que les écouter. Ce que ces situations extrêmes, impossibles, de fin de vie interrogent, c’est notre propre capacité à y apporter une réponse collective. Avant de penser à faire partir le malade, il reste beaucoup à faire pour l’accueil et l’accompagnement, de toute nature, des familles concernées.
Pour ces raisons, je souhaite le maintien en vigueur du dispositif actuel ; je ne voterai donc pas la proposition de loi présentée par nos collègues.
M. Georges Colombier. Les propos de Jean Leonetti correspondent à ma pensée. Il est possible de refuser tout à la fois l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie.
Si les soins palliatifs rendent aujourd’hui possible la mort dans la dignité, des progrès supplémentaires doivent être faits en faveur de la lutte contre la souffrance et de la solidarité avec ceux qui souffrent. Même si certaines équipes sont très compétentes, la formation n’est peut-être pas homogène. Il faut l’améliorer, et développer un peu plus les soins palliatifs pour soulager la souffrance morale et physique de chaque personne.
Le débat dépasse les clivages entre droite et gauche. Mon opposition à la proposition de loi n’est pas de nature politique. Je respecte mes collègues qui pensent autrement que moi, quel que soit leur bord.
La tonalité de nos débats démontre à la fois la réalité d’une question de société et la nécessité du respect des opinions de chacun pour la réalisation de tout progrès dans ce domaine.
M. le rapporteur. Jean Leonetti a évoqué Soleil vert, un film culte d’anticipation qui évoque d’autres problèmes que la fin de vie dans la dignité, même si chacun se souvient de la scène où Edward G. Robinson décide de mourir. Cette mort était réservée à une élite, ce qui est d’ailleurs tout le problème.
Beaucoup ont fait référence aux notions de dignité, d’égalité, de liberté et de confiance. C’est effectivement en se référant à ces notions que nous devons nous efforcer d’ouvrir un chemin, nécessairement escarpé.
La loi de 2005 a ouvert un débat. Faut-il considérer ce texte comme un point d’aboutissement ou bien comme une simple étape dans l’évolution de la législation ? Nous devons prendre en compte la façon dont la loi est appliquée, notamment dans le domaine des soins palliatifs, ainsi que l’évolution de la société. Comme je l’ai indiqué devant la mission d’évaluation de la loi de 2005, il revient au législateur d’apprécier la situation et de décider s’il doit légiférer de nouveau.
C’est ce que nous vous proposons de faire : il faut légiférer, car il y a aujourd’hui un certain nombre de manques et de zones d’ombre dans la loi – ce qui était d’ailleurs inévitable.
Le texte que nous vous proposons limite le bénéfice de l’aide active à la fin de vie aux personnes arrivées au terme de leur existence. De même que la loi de 2005, il écarte tout risque de dérive vers une assistance automatique au suicide, revendiquée par l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, ou par certains intellectuels, tels que Mme Noëlle Châtelet. Cette position donne donc matière à débat, y compris d’ailleurs au sein de notre groupe.
La loi de 2005, même si elle a été adoptée à l’unanimité et a défini un équilibre, ouvrait également un débat, dans la mesure où elle permettait de donner la mort dans certaines circonstances. Et, comme notre proposition, elle entrait dans le détail.
C’est au nom de la liberté et de la responsabilité de chacun que nous vous proposons d’adopter ce texte. L’aide active à mourir permet, en effet, de faire cesser la souffrance : c’est une possibilité qui nous semble indissociable de la dignité de chacun. Mais, nous aurons l’occasion de revenir en séance publique sur la conception que nous pouvons avoir, les uns et les autres, de la dignité. Nous pourrons également revenir sur les pratiques qui ont cours dans certains pays étrangers, notamment les Pays-Bas et la Belgique. Sur ce point, je récuse en partie les propos qui ont été tenus, même si je reconnais volontiers que nos voisins ont des cultures différentes de la nôtre.
Nous pourrons également revenir plus largement sur la question de l’euthanasie, passive ou active, ainsi, bien sûr, que sur celle de l’aide active à mourir, qui n’est absolument pas contradictoire avec le développement des soins palliatifs, comme le montre l’exemple des Pays-Bas. Nous devrons d’ailleurs aller plus loin dans ce dernier domaine, car ces soins ne sont pas à la hauteur de ce que l’on pourrait attendre de notre pays.
Si nous vous proposons de rompre avec l’équilibre de la loi de 2005, c’est que le temps a passé. Le débat n’oppose pas la droite et la gauche : il porte avant tout sur la conception que l’on se fait de la loi et des évolutions de notre société.
La Commission examine les articles de la présente proposition de loi au cours de sa séance du mardi 10 novembre 2009.
Article 1er
Définition de la situation de la personne pouvant demander
à bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité
Cet article ouvre aux personnes dans la situation qu’il définit la possibilité de demander à bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité. À cet effet, il complète l’article L. 1110-9 du code de la santé publique d’une nouvelle phrase selon laquelle « Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité ».
1. L’ouverture de la possibilité de demander une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique dispose aujourd’hui que « toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». Cet article (anciennement l’article L. 1 A du même code) est issu de la loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs.
L’alinéa 1 de cet article 1er, en complétant l’article L. 1110-9, pose le principe du droit à demander une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité comme complément du droit à l’accès aux soins palliatifs et à un accompagnement : si le développement des soins palliatifs doit constituer une priorité nationale, les soins palliatifs ne sauraient être opposés au fait que toute personne, arrivée à un certain stade de sa maladie, doit pouvoir choisir la mort si elle le souhaite et recevoir pour cela l’aide dont elle a besoin.
La personne demande à bénéficier d’une « assistance médicalisée pour mourir dans la dignité » (alinéa 2 de l’article 1er) :
– une assistance médicalisée : c’est au médecin qu’il revient d’aider la personne aux termes du présent texte ; la notion d’« assistance » doit être comprise comme synonyme d’aide et même, en l’espèce, d’« aide active » à mourir, expression reprise dans le reste de la proposition de loi. C’est l’objet de ce texte que d’ouvrir, par-delà le droit pour une personne de limiter ou d’arrêter tout traitement, tel qu’il a été reconnu par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, une possibilité de bénéficier d’une aide active à mourir, dans des conditions strictement définies ;
– pour mourir dans la dignité : la notion de « dignité » est déjà présente dans le code de la santé publique, qu’il s’agisse de manière générale de la personne malade – dont le droit au respect de la dignité est consacré par l’article L. 1110-2 – ou de la personne en fin de vie – l’article L. 1110-10 dispose que les soins palliatifs visent à sauvegarder la dignité de la personne ; or le présent texte s’inscrit dans cette démarche d’ensemble, en proposant une nouvelle étape dans le processus que constitue l’évolution de la législation concernant la fin de vie.
2. Un encadrement strict de cette nouvelle possibilité
Comme le souligne l’alinéa 2 de l’article 1er, l’ouverture de cette possibilité ne se fait que « dans les conditions strictes prévues au présent titre ». L’aide active à mourir ne peut être mise en œuvre que sous la réserve d’un strict encadrement.
Le titre visé est le premier titre du livre premier de la première partie du code de la santé publique, titre intitulé « Droits des personnes malades et des usagers du système de santé ». C’est dans ce titre que la proposition de loi définit le régime de l’aide active à mourir (20).
La situation de la personne qui pourra demander à bénéficier de l’aide est définie par les éléments suivants :
– la personne doit être majeure : il s’agit d’une première garantie, calquée sur la définition retenue à l’article L. 1111-11 qui ne donne qu’aux personnes majeures la possibilité de rédiger des directives anticipées pour le cas où elles seraient un jour hors d’état d’exprimer leur volonté, ainsi que sur celle prévue à l’article L. 1111-6, relatif à la désignation par une personne majeure d’une personne de confiance qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté ;
– la personne doit être « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable » : ainsi est définie la fin de vie par la loi du 22 avril 2005 précitée.
Ce critère s’inspirait des recommandations de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), émises en 2002 s’agissant de la prise en charge de l’adulte nécessitant des soins palliatifs, tout en étant plus restrictif car exigeant le cumul des deux conditions : la « phase avancée ou terminale » et une « affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause ».
Ainsi étaient visées, conformément aux précisions apportées dans le rapport établi préalablement à la discussion par M. Jean Leonetti, « les personnes pour lesquelles, à la suite d’une maladie, d’un accident de la vie ou d’une extrême vieillesse, le pronostic vital est engagé et qui se trouvent, soit au terme plus ou moins proche de leur vie, soit dans la phase avancée mais encore consciente de leur affection grave ou incurable » (21).
– l’affection doit infliger « une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et [que la personne] juge insupportable » : ce critère n’est pas présent dans la loi du 22 avril 2005. L’objectif est en effet de limiter la possibilité de demander une aide active à mourir aux situations de souffrance (que celle-ci soit physique ou psychique) que la personne estime insupportables (22).
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 1 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Cet amendement a pour seul objet d’harmoniser la rédaction de l’article 1er avec la formulation retenue par la loi de 2005.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite un amendement AS 2 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. La personne concernée doit souffrir d’une affection grave et incurable, « qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable », dit la proposition de loi. Pour aller plus loin dans la reconnaissance des droits des malades, l’amendement tend à remplacer « et » par « ou » : c’est aux malades de décider si une souffrance est insupportable. Je précise qu’il s’agit naturellement de personnes en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Mme Catherine Lemorton. J’approuve cette proposition de loi, qui pose un cadre bien précis. En revanche, je ne peux pas accepter cet amendement, car son adoption ouvrirait la voie à l’arbitraire. Il faut prendre garde à la composante dépressive qui peut amener certaines personnes à souhaiter mettre fin à leur vie.
M. le rapporteur. Ce texte ayant pour but d’ouvrir le débat, je trouve normal que l’on envisage de franchir des étapes supplémentaires. L’essentiel est de laisser à chacun le soin de juger du caractère supportable ou non de sa souffrance. Sur cet amendement, je m’en remettrai à la sagesse de la Commission.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle rejette l’article 1er.
Article 2
Encadrement de l’aide active à mourir
en cas de demande libre, éclairée et réfléchie de la personne concernée
Cet article définit les modalités selon lesquelles peut être mise en œuvre l’aide active à mourir.
Alors que la loi du 22 avril 2005 a prévu les conditions dans lesquelles une personne en fin de vie peut décider de limiter ou d’arrêter tout traitement, à l’article L. 1111-10 du code de la santé publique, cet article 2 insère après cette dernière référence un nouvel article L. 1111-10-1 définissant la manière dont peut être mise en œuvre l’aide active à mourir (alinéa 1 de l’article 2). Trois étapes principales peuvent être distinguées.
1. La réunion d’un collège de médecins à l’initiative du médecin traitant saisi de la demande (alinéas 2 et 3 de l’article 2)
Le nouvel article L. 1111-10-1 du code de la santé publique reprend la définition de la situation de la personne concernée telle qu’elle figure à l’article L. 1110-9 (23) (voir le commentaire de l’article 1er). C’est cette personne qui adresse sa demande à son médecin traitant (24).
Dès lors que le médecin traitant est saisi de la demande, il doit à son tour, sans délai, saisir trois autres praticiens, afin de constituer le collège qui devra statuer sur celle-ci. Cette composition collégiale constitue une garantie importante dans la mise en œuvre de l’aide active à mourir.
Le collège ainsi formé doit statuer sur plusieurs points :
– d’une part, il doit « s’assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée ». Il s’agit pour les médecins de s’assurer de la conformité de l’état de la personne à l’état défini à l’article L. 1110-9 du code de la santé publique par l’article 1er de la proposition de loi, à savoir le fait qu’est concernée une « personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable », et qui estime que sa souffrance est insupportable.
Pour cette vérification, le médecin peut en outre faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’éclairer le collège, dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire. Ces conditions pourront, par exemple, concerner le délai dans lequel une telle consultation peut intervenir ;
– d’autre part, le collège doit vérifier « le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée », à l’occasion d’un entretien avec la personne concernée. Cette garantie importante est conforme au principe général énoncé à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, selon lequel « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». En l’espèce, non seulement le consentement doit être libre et éclairé, mais il doit être réfléchi : on verra que la confirmation de sa demande par l’intéressé est de nature à renforcer encore le caractère réfléchi de la demande ;
– enfin, lors de l’entretien au cours duquel les médecins vérifient le consentement de la personne concernée, ceux-ci doivent informer l’intéressé « des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie » : l’aide active à mourir ne doit pas être opposée aux soins palliatifs, dont on a vu que le développement est une nécessité.
Les médecins disposent d’un délai maximal de huit jours pour rendre leurs conclusions sur l’état de l’intéressé.
L’alinéa 7 de l’article 2 précise que ces conclusions sont versées au dossier médical de la personne concernée, et que ce document est annexé au rapport établi par le médecin sur les conditions du décès, ce qui implique bien sûr l’existence d’un écrit.
2. La confirmation de sa demande par la personne concernée (alinéas 4 et 5 de l’article 2)
Dès lors que les médecins ont rendu leurs conclusions, et confirmé l’état de la personne concernée – la situation d’« impasse », à savoir l’état défini à l’article L. 1110-9 du code de la santé publique – ainsi que le caractère à la fois « libre, éclairé et réfléchi » de la demande, l’intéressé, « s’il persiste », doit confirmer sa volonté.
Autre élément essentiel destiné à encadrer les conditions de mise en œuvre de l’aide, la confirmation de sa décision par la personne concernée implique la réitération et conforte encore le caractère « réfléchi » du consentement.
En outre, cette confirmation doit être faite « en présence de [la] personne de confiance » de la personne concernée. La « personne de confiance » est définie à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique (25) : toute personne majeure peut désigner une « personne de confiance », qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette personne de confiance peut accompagner le malade dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Le texte de la proposition de loi précise que le médecin traitant devra respecter « cette volonté », autrement dit la volonté de la personne concernée telle qu’elle a été confirmée dans les conditions ainsi définies.
L’alinéa 7 de l’article 2 prévoit que la confirmation sera également versée au dossier médical, ce qui implique l’existence d’un écrit.
3. L’aide active à mourir (alinéas 5 et 6 de l’article 2)
À compter de la confirmation de la demande, l’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai minimum de deux jours.
Ce délai peut cependant être abrégé à la demande de l’intéressé, à la condition que les médecins « précités », c’est-à-dire les médecins constituant le collège d’au moins quatre praticiens, estiment que « cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci ».
Il faudra manifestement considérer que, dans un tel cas, les médecins rendent de nouvelles conclusions, qui doivent donc également être versées au dossier médical de l’intéressé.
À tout moment, l’intéressé pourra révoquer sa demande. Cette précision est conforme à la règle posée de manière générale en matière d’actes médicaux et de traitements à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui précise qu’aucun acte ne peut être pratiqué sans le consentement de l’intéressé et que « ce consentement peut être retiré à tout moment ».
L’aide active à mourir est pratiquée « sous le contrôle » du médecin traitant : concrètement, s’il ne procède pas directement à cet acte, le médecin traitant doit donc au moins être en mesure de contrôler sa mise en œuvre, donc être présent.
Dans un délai maximal de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin « qui a apporté son concours à l’aide active à mourir » – ce peut être le médecin traitant, mais pas nécessairement – établit un rapport exposant les conditions du décès (alinéa 7 de l’article 2).
Il doit y annexer les documents qui ont été versés au dossier médical, à savoir : les conclusions du collège des médecins ainsi que le document attestant la confirmation de sa demande par la personne concernée.
Le rapport et ses annexes sont adressés à la commission régionale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité, telle qu’elle est prévue à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique par l’article 5 de la proposition de loi (voir le commentaire de cet article).
*
Après que le rapporteur a donné un avis favorable sur l’amendement AS 3 et s’en est remis à la sagesse de la Commission sur l’amendement AS 4, la Commission rejette successivement les amendements AS 3 et AS 4 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
La Commission examine ensuite l’amendement AS 14 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Le texte impose au médecin traitant de consulter trois autres praticiens pour « s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée », ce qui me paraît juridiquement peu satisfaisant et très ambigu. Mieux vaudrait demander à ces autres médecins de « rendre un avis médical sur l’état de la personne concernée ». Cet avis sera très utile, car le patient et le médecin traitant lui-même ne sont pas nécessairement au fait des dernières avancées médicales.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS 5 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Il s’agit de préciser que la « situation d’impasse » constatée par les médecins correspond aux conditions définies par la nouvelle rédaction de l’article L. 1110-9 du code de la santé publique qui nous est proposée à l’article 1er.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS 15 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise que la « personne de confiance » est celle que peut désigner toute personne majeure en application de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. Cette personne devra être présente lors de la confirmation de la demande d’aide active à mourir, et elle interviendra, par ailleurs, dans le cas où le patient serait dans l’incapacité définitive d’exprimer une demande libre et éclairée.
La Commission rejette cet amendement.
Après avis favorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS 6 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Puis elle rejette l’article 2.
Article 3
Directives anticipées
Cet article vise à étendre le champ d’application des directives anticipées aux situations où une personne demanderait à bénéficier d’une aide active à mourir, en procédant à une nouvelle rédaction de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique (alinéa 1 de l’article 3).
Il prévoit le recours aux directives dans le cas où la personne ne serait plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée et bénéficierait cependant d’une aide active à mourir (cet article est donc indissociable de l’article 4 relatif aux conditions de mise en œuvre de l’aide active à mourir dans cette situation).
1. La reprise du régime des directives anticipées tel qu’il a été fixé par la loi du 22 avril 2005
La loi du 22 avril 2005 a consacré à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique les directives anticipées, définies comme celles que peut rédiger toute personne majeure pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Le rapport présenté par M. Jean Leonetti préalablement à la discussion parlementaire exposait dans les termes figurant dans l’encadré présenté ci-après l’inspiration de cette mesure.
L’inspiration au fondement des directives anticipées « [Les directives anticipées] sont les instructions que donne par écrit une personne majeure et consciente, sur les conduites de limitation ou d'arrêt de traitement qu'elle souhaite voir suivre au moment de la fin de sa vie, dans le cas où elle serait incapable de s'exprimer. N'ayant qu'une valeur indicative et étant révocables à tout moment, elles doivent avoir été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience. Ce délai de trois ans a été institué pour : – protéger les personnes dont l'ancienneté des instructions serait telle que l'on pourrait douter qu'elles souhaitent toujours les faire appliquer ; – prendre en considération la fragilité (…) d'une opinion, exprimée dans l'idéal et dans l'abstrait par une personne en bonne santé et qui ne reflète plus son état d'esprit, lorsqu'elle est en phase avancée d'une maladie grave et a fortiori lorsqu'elle a conscience de sa finitude, l'être humain évoluant en fonction de son âge et de sa maladie ; – tenir compte du délai moyen, qui s'écoule le plus souvent entre le diagnostic de la maladie grave et incurable et la survenue des derniers moments et d'un éventuel état d'inconscience qui les précéderait. Éclairage des volontés de la personne à l'instant où elles sont rédigées, les directives anticipées ont donc une valeur relative. Toutefois, il sera d'autant plus facile à un médecin d'en tenir compte, si leur intitulé n'est ni standardisé ni général. Ainsi, des invitations à « ne pas réanimer », à « ne pas mettre en place des appareils de survie artificielle », formulées par crainte d'une survie longue, douloureuse et inutile, peuvent s'avérer contraires à l'intérêt d'un patient qui, grâce à ces techniques, pourrait voir ses souffrances soulagées. Les directives anticipées seront par ailleurs considérées comme nulles et non avenues, si elles placent le médecin dans l'illégalité. Sous ces réserves, elles peuvent présenter pour le patient et pour le médecin les avantages suivants : – elles permettent au malade de préparer et de maîtriser sa fin de vie. Elles pourraient en effet correspondre à une véritable planification des soins, établie après une discussion approfondie avec le médecin traitant, lorsqu'une maladie grave et incurable a été diagnostiquée : en définissant, en fonction des phases de la maladie ou de ses complications, les traitements qui peuvent être mis en œuvre et ceux qui ne doivent pas être tentés (réanimation, alimentation artificielle...) ou qui doivent être interrompus, les directives anticipées, assimilées à un contrat moral passé avec le médecin, rassureraient leur auteur sur la façon dont ses derniers instants seraient susceptibles de se dérouler ; – pour le médecin, les directives anticipées peuvent être : – une source utile de renseignements, puisque leur consultation lui permet de prendre en compte les choix thérapeutiques qu'avait exprimés la personne, aujourd'hui inconsciente et en fin de vie. Ce rôle d'information se révélera extrêmement important si, à la suite d'une hospitalisation, le médecin traitant ayant reçu le malade, ne connaît pas son parcours personnel et ne peut rien en apprendre, en raison de son état d'inconscience, sauf à recueillir l'avis de la famille ou de proches ; – une justification des traitements qu'il entreprend ou qu'il abandonne, lorsqu'il se trouve confronté à un entourage, qui soit conteste ses choix thérapeutiques, soit se déchire sur les décisions à prendre pour leur proche, mourant ». |
Rapport (n° 1929) établi par M. Jean Leonetti au nom de la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner la proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie (novembre 2004).
Cet article 3 ne modifie pas – pour l’essentiel – le dispositif prévu par la loi du 22 avril 2005 à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique pour les directives anticipées, concernant les souhaits d’une personne en fin de vie en matière de limitation ou d’arrêt d’un traitement (alinéa 2 de l’article 3) :
– toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté ;
– les directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à la fin de vie, en matière de limitation ou d’arrêt de traitement ;
– les directives sont révocables à tout moment ;
– à condition que les directives aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin « doit en tenir compte » pour « toute décision la concernant » : jusqu’ici, la formulation retenue par cet article était : le médecin « en tient compte » (mais le présent de l’indicatif vaut impératif) ; en outre, l’énumération relative à la prise en compte des directives « pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant » est supprimée, mais elle revêtait déjà un caractère très général.
2. L’extension de ce régime aux circonstances où la personne demande à bénéficier d’une aide active à mourir
En revanche, en procédant à une nouvelle rédaction de l’ensemble de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, cet article complète ce dispositif en étendant son champ d’application aux « circonstances [où la personne] désire bénéficier d’une aide active à mourir », telle que prévue, aux termes de la présente propositions de loi, dans le code de la santé publique (alinéa 2 de l’article 3).
Les directives anticipées sont alors soumises aux règles suivantes :
– la personne concernée désigne dans les directives la personne de confiance qui sera chargée de la représenter le moment venu, à savoir lorsqu’elle ne sera plus capable d’exprimer une demande libre et éclairée (il s’agit de la situation décrite à l’article 4 – voir ci-après le commentaire de cet article) ;
– les directives anticipées doivent être inscrites sur un registre national automatisé, tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, telle qu’elle est instituée à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique par l’article 5 de la proposition de loi (voir ci-après le commentaire de cet article) ; il est précisé cependant que cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document ;
– enfin, cet article 3 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités « de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande » : est ainsi ouverte la possibilité au médecin traitant de demander à consulter les directives anticipées, pour le cas où la personne ne serait plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée.
Pour le reste, l’article ne vise plus, comme dans sa version aujourd’hui en vigueur, la fixation par décret des conditions de validité et de confidentialité des directives anticipées. Il y a cependant tout lieu de penser que les règles posées par le décret n° 2006-119 du 6 février 2006, qui a précisé les modalités de mise en œuvre de cet article (aux articles R. 1111-17 à R. 1111-20 du code de la santé publique), pourront continuer à prévaloir. Ces règles sont, pour l’essentiel, les suivantes :
– Les directives anticipées doivent en principe être écrites, datées et signées par l’intéressé. Elles mentionnent ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Toutefois, le recours à deux témoins, dont la personne de confiance, est prévu dans le cas où le patient, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire : ces témoins attesteront que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée.
– Valables trois ans et librement révocables, les directives anticipées peuvent être renouvelées par période de trois ans, par simple décision de confirmation signée sur le document écrit, ou par le recours à des témoins.
– Les directives restent valables quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte, dès lors qu’elles ont été établies dans le délai de trois ans précédant l’état d’inconscience du patient ou le jour où il s’est trouvé hors d’état d’effectuer le renouvellement.
– Les directives doivent en principe être conservées dans le dossier médical du patient. Mais elles peuvent aussi être conservées par le patient, la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche. Ces modalités de conservation ne semblent pas s’opposer à l’enregistrement, par ailleurs, des directives dans le nouveau registre national automatisé.
– Lors de l’hospitalisation, toute personne peut signaler l’existence de directives anticipées. Le médecin, avant de prendre une décision de limitation ou d’arrêt de traitement, doit, à moins que les directives ne soient déjà dans le dossier médical en sa possession, s’enquérir de leur existence éventuelle auprès de ceux qui sont susceptibles d’en assurer la conservation (dont, désormais, la Commission nationale de contrôle des pratiques relative au droit de mourir dans la dignité).
*
La Commission examine l’amendement AS 7 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Afin de garantir que les patients restent seuls maîtres de leur propre vie, cet amendement vise à imposer au médecin de leur demander de confirmer leurs directives anticipées avant l’administration de tout traitement pouvant mettre en jeu leur pronostic vital ou leur capacité d’exprimer leur volonté.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Elle rejette ensuite l’article 3.
Article 4
Encadrement de l’aide active à mourir d’une personne
dans l’incapacité définitive d’exprimer une demande libre et éclairée
Cet article fixe les modalités selon lesquelles une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, dans l’incapacité définitive d’exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d’une aide active à mourir.
À cet effet, cet article 4 insère, après l’article L. 1111-13 du code de la santé publique – relatif aux modalités de la décision de limitation ou d’arrêt d’un traitement dans le cas où la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté (26) –, un nouvel article L. 1111-13-1, aux termes duquel trois étapes peuvent être distinguées (alinéa 1 de l’article 4) (27).
1. La réunion d’un collège de médecins à l’initiative du médecin traitant saisi de la demande (alinéa 2 de l’article 4)
Trois conditions doivent être remplies pour que puisse être mise en œuvre la demande d’aide :
– la personne concernée doit se trouver « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable » : il s’agit de la reprise de la définition de la fin de vie telle qu’elle figure dans la loi du 22 avril 2005.
La différence avec la situation visée à l’article L. 1111-10-1 est l’absence de référence à une souffrance jugée insupportable, puisque précisément la personne ne peut s’exprimer. En lieu et place figure la condition selon laquelle la personne doit en outre « se trouve[r] de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée » (et donc, a fortiori, réfléchie) ;
– la volonté de bénéficier d’une aide active à mourir doit résulter des directives anticipées que la personne a établies en application de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique ;
– la personne concernée doit avoir désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6 du même code : cette condition est implicite mais évidente puisque c’est la personne de confiance qui saisit de la demande le médecin traitant.
Le médecin traitant saisi transmet, comme dans le cas où la personne concernée peut exprimer sa volonté, la demande à trois autres praticiens au moins. Le collège ainsi constitué doit en outre aussi consulter : l’équipe médicale ; les personnes qui assistent au quotidien la personne concernée ; tout autre membre du corps médical susceptible de l’éclairer (dans des conditions définies par voie réglementaire).
Les médecins disposent d’un délai maximal de huit jours pour établir un rapport dont l’objet est de déterminer « si l’état de la personne concernée justifie qu’il soit mis fin à ses jours » : ils doivent donc s’assurer, à tout le moins, que la personne est bien en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, qu’elle se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée et que la volonté de bénéficier d’une aide active à mourir résulte de ses directives anticipées.
L’alinéa 4 de l’article 4 précise que le rapport des médecins est versé au dossier médical de la personne concernée.
2. La confirmation de la demande par la personne de confiance (alinéa 3 de l’article 4)
Dans le cas où le rapport des médecins a conclu à la possibilité d’une aide active à mourir, la personne de confiance doit procéder à la confirmation de sa demande.
Le texte de la proposition de loi prévoit que la confirmation intervient en présence de « deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée ».
3. L’aide active à mourir (alinéas 3 à 5 de l’article 4)
Le médecin traitant a l’obligation de respecter la volonté ainsi confirmée. Dans le cas où la confirmation a bien eu lieu, l’aide active à mourir n’intervient pas avant un délai minimal de deux jours à compter de cette confirmation.
Dans un délai maximal de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir doit adresser à la commission régionale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité (prévue à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique par l’article 5 de la présente proposition de loi) un rapport exposant les conditions du décès, auquel sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical – autrement dit les conclusions des médecins – ainsi que les directives anticipées.
*
Après avis favorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 8 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Elle examine ensuite l’amendement AS 9 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. L’article 4 fait référence à l’absence d’intérêt « matériel et moral » des deux témoins chargés de constater la confirmation de la demande formulée par la personne de confiance. Nous proposons de supprimer le terme « moral », d’application pratique délicate en l’espèce.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.
Elle rejette ensuite l’amendement AS 10 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Puis elle est saisie de l’amendement AS 11 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Cet amendement précise que la personne de confiance peut à tout moment révoquer la demande qu’elle aura formulée.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement AS 12 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Puis elle rejette l’article 4.
Article 5
Commissions nationale et régionales de contrôle des pratiques
relatives au droit de finir sa vie dans la dignité
Cet article crée une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité, ainsi que des commissions régionales ayant le même objet.
Il complète à cet effet la section du code de la santé publique consacrée à l’expression de la volonté des malades en fin de vie (28) d’un nouvel article L. 1111-14 (alinéa 1 de l’article 5).
Aux termes du premier alinéa de cet article (alinéa 2 de l’article 5), la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité est instituée à la fois auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé.
Est aussi instituée, dans chaque région, une commission régionale, présidée par le préfet de région ou son représentant. C’est à chacune de ces commissions régionales que sont transmis les rapports exposant les conditions du décès en cas d’aide active à mourir, auxquels sont annexés les différents documents versés au dossier médical (conclusions du collège des médecins, confirmation de la demande par la personne concernée) ainsi que les directives anticipées (en application des deux nouveaux articles L. 1111-10-1 et L. 1111-13-1).
Chaque commission régionale est chargée de contrôler, dès qu’elle reçoit un rapport d’aide active à mourir, si l’ensemble des dispositions légales telles qu’elles sont prévues par la présente proposition de loi, autrement dit l’ensemble des conditions encadrant l’aide active à mourir, ont été respectées.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 1111-14 du code de la santé publique (alinéa 3 de l’article 5), dans l’hypothèse où la commission régionale estime que des dispositions légales n’ont pas été respectées, et même en seul cas de doute, elle transmet le dossier à la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité.
La Commission nationale a la possibilité de transmettre le dossier au Procureur de la République.
La dernière phrase de l’alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions (tant nationale que régionales).
*
La Commission rejette l’article 5.
Article 6
Droit au refus en matière d’aide active à mourir
Cet article prévoit le droit pour les médecins ou les membres de l’équipe soignante de refuser d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir, ainsi que de suivre une formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie. Cet article complète à cet effet le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 (29) du code de la santé publique (alinéa 1 de l’article 6) de trois nouvelles phrases (alinéa 2 de l’article 6).
D’une part, est consacré le principe selon lequel les professionnels de santé ne sont en aucun cas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Le concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir doit s’entendre au sens large comme la participation, d’une manière ou d’une autre, à l’une des étapes prévues par la présente proposition de loi : sont donc visés le médecin traitant, mais aussi les praticiens auxquels celui-ci fait appel au sein du collège qui examine la demande, voire tout autre membre du corps médical auquel ce collège s’adresse pour être éclairé.
Sont également concernés les membres de l’équipe médicale, qui sont consultés dans le cas où la personne est, de manière définitive, dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée.
Le refus d’un médecin, ou de tout membre de l’équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir, sera notifié à l’auteur de la demande.
De manière à ce que ce dernier ne soit pas sans recours, il revient au médecin ayant refusé son concours d’orienter immédiatement la personne concernée vers un autre praticien, « susceptible de déférer à cette demande ».
Par ailleurs, cet article établit également un droit de refus des professionnels de santé de suivre une formation dispensée par un établissement en application de l’article L. 1112-4 du code de la santé publique. Ce dernier article prévoit, aux termes de l’article 8 de la proposition de loi (voir infra le commentaire de l’article 8), la création d’une formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie.
*
La Commission est saisie de l’amendement AS 13 de Mme Danièle Hoffman-Rispal.
Mme Danièle Hoffman-Rispal. Nous proposons d’étendre la garantie du droit de refuser le concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir aux personnes qui assistent au quotidien l’intéressé, qui doivent être consultées au préalable, dans le cas où la personne est dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée. Il n’est pas question de les obliger.
M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement, similaire à une disposition de la loi luxembourgeoise.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle rejette l’article 6.
Article 7
Effets sur les contrats où elle était partie
du décès d’une personne ayant bénéficié d’une aide active à mourir
Cet article vise à sécuriser les relations contractuelles qui avaient été établies entre la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir et ses co-contractants.
Dans ce but, il complète la section précitée du code de la santé publique, consacrée à l’expression de la volonté des malades en fin de vie, d’un nouvel article L. 1111-15 (alinéa 1 de l’article 7).
En assimilant, sur le plan de ses effets contractuels, la mort résultant d’une aide active à mourir à la mort naturelle, cet article entend éviter certaines ambiguïtés juridiques, liées en particulier, en matière assurancielle, à la qualification de la mort : si l’acte d’aide à mourir est considéré, au plan des assurances, comme un acte intentionnel dans le chef du patient couvert par une assurance pour la vie, ce peut être le régime applicable en cas de suicide qui prévaut, à savoir, aux termes de l’article L. 132-7 du code des assurances, notamment la règle selon laquelle « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat ».
Des questions similaires se sont posées au moment de l’élaboration de la loi belge de mai 2002 relative à l’euthanasie, qui ont alors conduit le législateur à prévoir un article 15 aux termes duquel « la personne décédée à la suite d’une euthanasie dans le respect des conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance » (30).
C’est pourquoi de même, l’alinéa 2 de cet article 7 institue un article L. 1111-15 aux termes duquel « est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique ».
Ce nouvel article L. 1111-15 comporte en outre, dans le même but, une dernière phrase précisant que « toute clause contraire [au principe ainsi posé] est réputée non écrite ».
*
La Commission rejette l’article 7.
Article 8
Formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie
Cet article a pour objet de prévoir, au profit des professionnels de santé, la mise en œuvre d’une formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie.
Il procède pour cela à un ajout au deuxième alinéa de l’article L. 1112-4 du code de la santé publique (alinéa 1 de l’article 8), qui prévoit que les centres hospitaliers et universitaires assurent la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la prise en charge de la douleur des patients et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert.
Conformément à la démarche d’ensemble retenue par la proposition de loi – ne pas opposer le développement des soins palliatifs et l’aide active à mourir –, l’article 8 complète cet alinéa d’une phrase prévoyant que les centres hospitaliers et universitaires assurent également, tant dans le cadre de la formation initiale que dans celui de la formation continue des professionnels de santé, une formation dont l’objet sont les conditions de réalisation d’une euthanasie (alinéa 2 de l’article 8).
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique, tel qu’il est rédigé par l’article 6 de la proposition de loi, donne cependant la possibilité aux professionnels de santé de refuser de suivre cette formation.
*
La Commission rejette l’article 8.
Cet article de gage a pour objet de prévoir la compensation des charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, droits dits « sur les tabacs ».
*
La Commission rejette l’article 9.
M. le président Pierre Méhaignerie. Le rejet de chacun des articles vaut rejet de la proposition de loi. En conséquence, aux termes de l’article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique aura lieu sur le texte initial de cette proposition de loi.
M. Pierre Cardo. Je voudrais qu’il soit fait état de mon abstention sur ce texte.
*
En conséquence, la Commission des affaires sociales rejette l’ensemble de la présente proposition de loi.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopté par la commission ___ |
Code de la santé publique |
Article 1er |
|
Art. L.1110-9. – Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. |
L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité. » |
||
|
Article 2 |
||
Après l’article L. 1111-10 du même code, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1111-10-1. –Lorsqu’une personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, demande à son médecin traitant le bénéfice d’une aide active à mourir, celui-ci doit saisir sans délai au moins trois autres praticiens pour s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Il peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, dans les conditions définies par voie réglementaire. |
||
« Le collège ainsi formé vérifie le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée, lors d'un entretien au cours duquel ils informent l'intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie. Les médecins rendent leurs conclusions sur l'état de l'intéressé dans un délai maximum de huit jours. |
||
« Lorsque les médecins constatent la situation d'impasse dans laquelle se trouve la personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa volonté en présence de sa personne de confiance. |
||
« Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d'aide active à mourir pratiqué sous son contrôle ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci. |
||
« L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande. |
||
« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir, adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l’article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. » |
||
|
Article 3 |
||
L’article L. 1111-11 du même code est ainsi rédigé : |
||
Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment. A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. |
« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment. À condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant. Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d’arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d’une aide active à mourir telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la personne de confiance chargée de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l’article L. 1111-14 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document. Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d’État. » |
|
|
Article 4 |
||
Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1111-13-1. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d’une aide active à mourir à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11. La personne de confiance saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet à trois autres praticiens au moins. Après avoir consulté l’équipe médicale et les personnes qui assistent au quotidien l’intéressé, et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire, les médecins établissent, dans un délai de huit jours au plus, un rapport déterminant si l’état de la personne concernée justifie qu’il soit mis fin à ses jours. |
||
Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une aide active à mourir, la personne de confiance doit confirmer sa demande en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette volonté. L’acte d’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. |
||
|
« Le rapport mentionné des médecins est versé au dossier médical de l’intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l’article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s’est déroulé. |
||
« À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. » |
||
|
Article 5 |
||
Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-14 ainsi rédigé : |
||
« Art. L.1111-14. – Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé “Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité”. Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’aide active à mourir, si les exigences légales ont été respectées. |
||
« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’État. » |
||
|
Article 6 |
||
Art. L. 1110-5. – Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111- 2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. |
Le dernier alinéa de l’article L. 1110-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir ni de suivre la formation dispensée par l’établissement en application de l’article L. 1112-4. Le refus du médecin, ou de tout membre de l’équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié à l’auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. » |
||
|
Article 7 |
||
Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-15 ainsi rédigé : |
||
« Art. L.1111-15. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. » |
||
|
Article 8 |
||
Art. L. 1112-4. –Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert, quelles que soient l'unité et la structure de soins dans laquelle ils sont accueillis. Pour les établissements de santé publics, ces moyens sont définis par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2. Pour les établissements de santé privés, ces moyens sont pris en compte par le contrat d'objectifs et de moyens mentionné aux articles L. 6114- 1, L. 6114-2 et L. 6114-3. |
Le deuxième alinéa de l’article L. 1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la réalisation de ces objectifs en ville comme dans les établissements. Ils favorisent le développement de la recherche. |
||
« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie. » |
||
|
Article 9 |
||
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
||
AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION
Amendement n° AS 1 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 1er
À l’alinéa 2, après les mots : « affection grave et incurable, », insérer les mots : « quelle qu’en soit la cause, ».
Amendement n° AS 2 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 1er
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable » les mots : « qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable ».
Amendement n° AS 3 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 2
À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « affection grave et incurable, », insérer les mots : « quelle qu’en soit la cause, ».
Amendement n° AS 4 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 2
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable », les mots : « qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable ».
Amendement n° AS 5 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 2
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « la situation d’impasse dans laquelle se trouve la personne », les mots : « la conformité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée à la situation définie à l’article L. 1110-9 ».
Amendement n° AS 6 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 2
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La confirmation est recueillie ou consignée sous la forme d’un écrit. »
Amendement n° AS 7 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 3
Après la quatrième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu’un traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital ou, de façon permanente, la capacité de l’intéressé à exprimer sa volonté, le médecin demande à la personne la confirmation des directives avant le début du traitement. »
Amendement n° AS 8 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 4
À la première phrase de l’alinéa 2, après les mots : « affection grave et incurable, », insérer les mots : « quelle qu’en soit la cause, ».
Amendement n° AS 9 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 4
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou moral ».
Amendement n° AS 10 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 4
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« La confirmation est recueillie ou consignée sous la forme d’un écrit. »
Amendement n° AS 11 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 4
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La personne de confiance peut à tout moment révoquer sa demande ».
Amendement n° AS 12 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 4
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « est versé », les mots : « et la confirmation de la demande sont versés ».
Amendement n° AS 13 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Jean-Paul Dupré, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Pierre Bourguignon, Mme Annick Lepetit, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Gisèle Biemouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Colette Langlade et M. Olivier Dussopt
Article 6
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Les professionnels de santé et les personnes qui assistent au quotidien l’intéressé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir. Les professionnels de santé ne sont pas tenus de suivre la formation dispensée par l’établissement en application de l’article L. 1112-4. Le refus du médecin, de tout membre de l’équipe soignante ou d’une personne qui assiste au quotidien l’intéressé de prêter son assistance à une aide active à mourir… » (le reste sans changement).
Amendement n° AS 14 présenté par Mme Danièle Hoffman-Rispal
Article 2
À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « s’assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. », les mots : « rendre un avis médical sur l’état de la personne concernée. ».
Amendement n° AS 15 présenté par M. Manuel Valls, rapporteur
Article 2
Compléter l’alinéa 4 par les mots : « , désignée en application de l’article L. 1111-6. ».
ANNEXE
Liste des personnes auditionnées par le rapporteur
(par ordre chronologique)
Ø Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) – M. Jean-Luc Romero, président, et M. Philippe Lohéac, délégué général
Ø Maître Antoine Beauquier, membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris
Ø Docteur Bernard Senet, médecin généraliste intervenant dans des services de soins palliatifs