


L’audition commence à dix-sept heures cinquante-cinq.
M. le président Luc Chatel. Le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) est un laboratoire d’excellence, qui a été distingué par un jury scientifique international désigné par l’Agence nationale de la recherche – ANR. Il évalue les politiques publiques dans une perspective interdisciplinaire et bénéficie de soutiens importants de l’État et de l’agence au titre des programmes d’investissements d’avenir. Il réunit une cinquantaine de chercheurs et de professeurs de Sciences Po et d’autres centres de recherche, qui l’ont cofondé. C’est dans ce cadre que M. Étienne Wasmer et M. Pierre-Henri Bono, à qui nous souhaitons la bienvenue, ont publié en mars 2014 une note intitulée Y a-t-il un exode des qualifiés français ?
Avant de vous entendre, messieurs, je vous demande, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Étienne Wasmer et M. Pierre-Henri Bono prêtent serment.)
M. Étienne Wasmer, codirecteur du LIEPP. Nous possédons sur l’expatriation des données moins précises que sur les autres secteurs de la vie économique et sociale, car il est difficile d’appréhender un phénomène extérieur au territoire national. Toutefois, des chiffres permettent de formuler un diagnostic, moyennant quelques réserves et quelques hypothèses.
Des données enregistrent, depuis les années 1980, le taux d’émigration, soit le nombre de personnes nées dans un pays et résidant à l’étranger, rapporté au volume de la population, immigrés inclus, vivant dans le pays de départ. Elles révèlent en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis une tendance à l’émigration. Le taux d’émigration de la France et des États-Unis est cependant inférieur à celui des autres pays. Entre 1980 et 2010, le nôtre passe d’un peu plus de 1 % à plus de 2 %.
C’est sans doute parce que la France n’a jamais été une terre d’émigration que les évolutions récentes nous surprennent. Par ailleurs, si son taux d’émigration augmente, celui-ci reste inférieur à celui du Royaume-Uni, des Pays-Bas ou de l’Allemagne, ce qui peut paraître rassurant. Cette impression se confirme si l’on observe le solde net, soit la comparaison des départs et des arrivées des diplômés du supérieur, baccalauréat inclus. La France est attractive : elle accueille un nombre croissant de personnes qualifiées, et celui-ci est supérieur à celui des personnes nées en France et résidant dans d’autres pays. On ne peut néanmoins établir ce résultat qu’à partir d’hypothèses qui portent sur une vingtaine de pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques – OCDE.
Ces pays nous envoient moins de diplômés que nous n’en envoyons vers eux. Si la France accuse un déficit vis-à-vis du Canada et des États-Unis, grands attracteurs nets de diplômés, elle reste bénéficiaire par rapport aux autres pays du monde. Je le répète : la France n’est pas un pays d’émigration. La sortie des diplômés, en augmentation, est compensée par les entrées, ce qui se traduit par un solde migratoire très positif pour les plus qualifiés.
Quatre points doivent retenir notre attention.
Si la France semble bénéficiaire nette au niveau mondial pour les diplômés du supérieur, elle ne l’est pas si l’on se limite aux entrées et sorties entre pays de l’OCDE.
L’échelle de définition des qualifications dont nous disposons étant grossière, nous réfléchissons sur l’éducation tertiaire, c’est-à-dire sur les titulaires d’un baccalauréat ou plus, sans savoir ce qu’il en est des « très hauts potentiels » – titulaires d’un doctorat, ingénieurs, innovateurs ou créateurs d’entreprise.
La note mettant l’accent sur les flux nets, plutôt que sur les départs, elle ignore la réflexion sur les moyens de faire revenir ceux qui pourraient le souhaiter.
Enfin, il faut réfléchir au moyen d’attirer les hauts potentiels qui résident à l’étranger.
La question des données disponibles appelle quelques éclaircissements. Le registre mondial des Français établis hors de France apporte des indications précieuses, mais l’inscription à ce registre est le résultat d’une démarche volontaire. Au 31 janvier 2012, il comptait 1,6 million d’inscrits, après avoir augmenté en moyenne de 4 % en dix ans. Les données brutes ne sont pas disponibles en ligne.
Certains biais de sélection ne sont pas faciles à contrôler. Le registre inclut plus spontanément les résidents français qui vivent dans des contrées éloignées, auxquels l’inscription au consulat peut procurer un avantage, par exemple en cas d’accident. Les Français habitant dans des pays très proches sont vraisemblablement sous-déclarés, tout comme ceux qui envisagent une expatriation définitive. Le niveau d’études influe aussi sur le comportement de déclaration, de même que certains événements conjoncturels : on enregistre plus d’inscriptions au consulat avant une élection. Dernière réserve : ces données ne se prêtent pas à une comparaison internationale.
Une mesure alternative, qui demanderait un travail considérable, consisterait à regarder, dans les recensements effectués dans chaque pays vers lequel nous pensons qu’il existe de l’émigration, le nombre de personnes nées en France. Puis on le comparerait à celui des nationaux de ces pays résidant en France. C’est la seule méthode qui procurerait des résultats fiables.
Nous avons utilisé des données financées par l’Union européenne et développées par un centre de recherche allemand, l’IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung). Elles portent sur vingt pays de l’OCDE qui, à l’exception de l’Italie et de la Belgique, représentent les destinations principales : l’Australie, l’Autriche, le Canada, le Chili, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis.
La base porte sur la population de plus de 25 ans, distingue trois niveaux d’études – primaire (niveau collège), secondaire (niveau lycée) et tertiaire (toutes les formations de l’enseignement supérieur) – et remonte jusqu’aux années 1980. Elle permet d’évaluer le nombre de Français vivant dans les pays concernés, comme le nombre de personnes nées dans ces pays et résidant en France. Toutefois, elle ne comptabilise pas le nombre de Français dans les anciennes colonies. Elle n’indique pas non plus l’âge de départ des émigrants ; dès lors, on ignore où ils ont fait leurs études et quel pays les a financées.
Une autre base de données concernant cent pays a été établie par l’OCDE, mais elle ne porte que sur l’année 2000. Le rapprochement des deux bases révèle que, pour la France et le niveau d’éducation tertiaire, les personnes vivant dans les dix-neuf pays étudiés par l’enquête de l’IAB représentent 79 % du nombre total de personnes nées en France et vivant à l’étranger. En d’autres termes, pour les plus diplômés, le biais de sous-estimation de l’IAB est de 20 %, dont 12 % concernent la Belgique, l’Italie et Israël. La marge d’erreur de 20 % n’inverse pas les conclusions que j’ai présentées sur le nombre de diplômés accueillis par la France et venant de tous les pays du monde.
M. Pierre-Henri Bono, chercheur au LIEPP. Nous avons approfondi les investigations présentées dans la note pour comparer la situation de la France et celle de ses voisins.
Le volume d’émigration des personnes nées en France a fortement augmenté : il est passé, pour tous les niveaux d’études, de 400 000 en 1980 à 1 million en 2010. Le phénomène a pris de l’ampleur dès les années 1990, avec une plus forte progression pour les personnes qualifiées, dont les départs sont quatre fois plus nombreux en 2010 qu’en 1980. N’oublions pas cependant que, pendant cette période, la France a vu son taux d’éducation augmenter de 150 %.
Le taux d’émigration a peu évolué : entre 1980 et 2010, il est passé de 4 % à 5 %. Au sein de ce volume global, la part des grands pays d’émigration que sont les États-Unis et le Canada diminue régulièrement, notamment au profit du Royaume-Uni et de l’Espagne, ce qui traduit une diversification de l’émigration.
Au niveau d’éducation tertiaire, le taux d’émigration de la France est inférieur à celui de tous les pays considérés, hors États-Unis. Entre 2005 et 2010, ce taux augmente partout, sauf en Allemagne, en Belgique et au Canada. Au Royaume-Uni, il s’élève à près de 20 %. Le taux d’émigration de la France est inférieur à celui du Nord de l’Europe. En Europe du Sud, seule l’Espagne a un taux inférieur au nôtre, mais la base ne comptabilise pas l’émigration vers l’Amérique du Sud. Au niveau mondial, le Japon, la Chine et l’Australie ont un taux inférieur à celui de la France, alors que la Nouvelle-Zélande est une terre de forte émigration.
Si notre pays possède un taux d’émigration très bas par rapport à ses voisins, c’était déjà le cas au début du xixe siècle. Entre 2005 et 2010, il évolue comme celui des autres pays du continent. Au niveau d’éducation tertiaire, le solde migratoire de la France est positif. Jusqu’en 2005, en revanche, il était négatif au Royaume-Uni pour les personnes de ce niveau. Celui de l’Allemagne est également déficitaire pour la même catégorie.
M. Étienne Wasmer. Dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur, que nous connaissons bien, beaucoup de Français tentent leur chance à l’étranger, au Royaume-Uni, en Espagne et aux États-Unis. Reste à savoir s’ils vont revenir en France et si, quand ils sont à l’étranger, ils apportent quelque chose à la collectivité nationale. Il semble que ce soit le cas. Pour ne citer qu’un exemple, c’est parce qu’un professeur français s’est expatrié à Berkeley que Sciences Po a développé un partenariat avec cette université.
Une autre question est de savoir si la France fait assez pour accueillir les hauts potentiels. Afin de les séduire, plusieurs pays ont développé des stratégies actives. Le Québec défiscalise, au moins temporairement, une part importante de leurs revenus.
M. le président. Avez-vous distingué l’émigration nécessaire – voire souhaitable dans un contexte mondialisé – et l’exil forcé des jeunes vers des zones de forte attractivité économique ?
Vous regrettez l’absence d’indicateurs précis en matière d’émigration. Quels baromètres faut-il mettre en place pour mieux apprécier le phénomène et, le cas échéant, y remédier ?
Avez-vous observé que, même quand ils reçoivent une proposition en France, les jeunes Français se tournent plus volontiers vers l’étranger ? Selon le cabinet Deloitte, ils sont 80 % à faire ce choix.
La France est-elle capable d’attirer les cadres internationaux ? Comment peut-on stimuler son attractivité ?
M. Étienne Wasmer. Il est très difficile de distinguer expatriation volontaire et départ subi, puisque les bases de données qui recensent la présence d’une personne dans un pays ne disent rien de ses motivations. On peut effectuer des enquêtes ponctuelles : hélas, elles ne sont pas représentatives.
Le départ des jeunes Français s’inscrit dans un cycle de vie. Au sortir de l’école, les diplômés n’ont pas encore charge de famille. Quand ils atteignent 35 ans et scolarisent leurs enfants, ils songent que, si les salaires, après impôt, sont plus élevés à l’étranger, les dépenses liées à la famille et à l’éducation y sont également plus lourdes.
Pour approfondir notre enquête, il nous serait précieux d’accéder aux données de l’administration fiscale. Nous pourrions alors suivre la situation des résidents comme des non-résidents qui établissent une déclaration en France, soit parce qu’ils y perçoivent encore des revenus, soit parce qu’ils y déclarent les revenus qu’ils perçoivent à l’étranger. Ces chiffres nous permettraient de faire la distinction entre expatriation temporaire et définitive. On peut considérer que quelqu’un qui ne remplit plus de déclaration en France a coupé les liens avec le pays.
Le marché du travail n’est pas un critère d’attractivité pour les hauts potentiels, qui ont rapidement accès à l’emploi. La fiscalité leur importe davantage. Certains pays financent par la défiscalisation l’arrivée de hauts cadres internationaux. Ces aides, qui couvrent les coûts d’expatriation et de déménagement, montrent aussi symboliquement, que le pays cherche à développer son attractivité. Ce sont surtout les pays jeunes qui usent de ce procédé. Peut-être la France a-t-elle moins besoin d’envoyer un signal aux étrangers qu’une petite province comme le Québec.
M. Pierre-Henri Bono. Du début du xixe siècle aux années 1970, l’émigration française a toujours été choisie. Il ressort d’un sondage réalisé par l’IFOP en 1946 que plus de 20 % des personnes interrogées désiraient quitter la France. Chez les moins de 35 ans, le chiffre s’élevait même à 38 %. Il signale cependant non un projet véritable, mais un désir ou une velléité d’émigration.
M. le président. Peut-on vraiment comparer l’intention d’émigrer, dans la France de l’après-guerre, et la situation que l’on observe aujourd’hui ? Selon la chambre de commerce et d’industrie de Paris, 50 % des jeunes diplômés – à moins de bac+3 – partent pour l’étranger, parce qu’ils ont du mal à trouver un emploi ou un salaire correspondant à leurs aspirations.
M. Pierre-Henri Bono. Le chiffre cité par le cabinet Deloitte s’entend-il à salaire constant ?
M. le président. Les salaires bruts versés à Londres et à Paris sont équivalents, mais le salaire net est plus important à Londres.
M. Yann Galut, rapporteur. Je vous remercie d’avoir réalisé, sur la question de l’émigration et de l’immigration, une étude scientifique, très différente des fantasmes qui traversent régulièrement la société française. Est-il exact que l’exil des forces vives se soit accéléré depuis deux ans ? Avez-vous déjà des chiffres pour cette période ou faudra-t-il attendre 2015, voire 2016, pour disposer de données précises ?
La notion de « cycle de vie » me semble intéressante. A-t-on étudié l’évolution des choix géographiques au gré des changements de situation familiale, ce qui pose plus généralement la question du pouvoir d’achat d’un expatrié dans un pays étranger ? La crise économique de 2009 a-t-elle fait augmenter le nombre de départs ?
Émettez-vous des réserves sur la méthode retenue par la Banque mondiale pour réaliser l’enquête sur laquelle vous vous êtes appuyés ? Comment les consulats, l’INSEE ou le ministère des Affaires étrangères pourraient-ils améliorer les données existantes ? L’appareil statistique des autres pays est-il plus performant que le nôtre ? Le cas échéant, peut-on s’en inspirer ?
Les économistes Augustin Landier et David Thesmar parlent, à propos de la France, d’« obsession égalitariste », de « bureaucratisation » et du « modèle du chercheur fonctionnaire ». Notre système est-il si anachronique qu’il fasse fuir les meilleurs chercheurs ?
L’expatriation des jeunes concerne-t-elle uniquement les diplômés ? Comment expliquer l’augmentation rapide du nombre de jeunes qualifiés étrangers qui s’installent en France ? D’où viennent-ils ? Quelle est leur nationalité ?
S’il existe en France des freins au retour, comment les lever ? Les étudiants de Sciences Po ont-ils changé depuis qu’ils sont obligés de passer un an à l’étranger ?
M. Étienne Wasmer. Oui : ils reviennent transformés. Les premières années – où je n’enseignais pas encore dans l’institution –, ils se sont plaint des exposés magistraux de leurs professeurs, alors que l’enseignement international se caractérise par une plus grande décontraction, un meilleur taux d’encadrement et un suivi de meilleure qualité. L’enseignement de Sciences Po s’est adapté aux pratiques étrangères.
La France ayant toujours été un pays de faible émigration, elle s’est peu interrogée sur le phénomène, ce qui explique que le débat n’en soit qu’à ses balbutiements. Il faudra se pencher sur le sujet dans les prochaines années, car l’expatriation des diplômés augmente, non seulement parce qu’il y a plus de diplômés – en taux, les évolutions sont moins marquées –, mais aussi parce qu’il est plus facile de vivre à l’étranger aujourd’hui qu’il y a quinze ou vingt ans, grâce au progrès des communications via internet ainsi qu’à l’abondance et au faible coût des transports. Le phénomène des migrations and return migrations a été étudié dans les pays en développement, mais la France a, comme ces pays, des réticences à étudier ce phénomène.
Nous avons souligné les limites de la base de données que nous avons utilisée. Le peigne est trop large, puisqu’il ne mesure pas précisément les niveaux de diplôme, et la base n’est pas exhaustive, puisqu’elle ne considère que dix-neuf pays sur plus d’une centaine.
Paradoxalement, l’émigration des Français est surtout intra-européenne. Le programme Erasmus facilite l’expatriation. Des jeunes qui ont passé un an en Espagne, en Italie ou au Danemark ont acquis une expérience internationale. Ils peuvent facilement s’exprimer dans une autre langue et travailler à l’étranger. C’est une chance que les jeunes Français se situent d’entrée dans un marché européen ou mondial. Il n’y a pas lieu de les retenir ni de limiter des départs inéluctables. En revanche, il faut réfléchir au moyen de les faire revenir dans de bonnes conditions ou d’inciter les étrangers à s’installer chez nous.
Les nombreux diplômés qui arrivent en France viennent des pays situés à l’extérieur de l’OCDE, particulièrement en Asie et en Afrique, mais le Canada ou les États-Unis en accueillent davantage. Cette situation s’explique par l’insuffisante flexibilité qui caractérise, en France, le monde économique ou celui de la recherche. Jusqu’à une date récente, il était difficile aux jeunes diplômés d’obtenir un important budget de recherche dans notre pays. L’Agence nationale de la recherche a fait beaucoup pour mettre à leur disposition des budgets blancs, qui permettent de démarrer rapidement des travaux, mais leur volume est sans commune mesure avec celui qu’on rencontre aux États-Unis, où l’on n’hésite pas à faire confiance, notamment dans les sciences dures, à de très jeunes chercheurs.
Il existe peu d’études sur le cycle de vie, mais le coût de la santé ou de l’éducation compte beaucoup dans la décision de se réinstaller en France. On parle souvent de la concurrence fiscale à laquelle se livrent les États pour attirer les entreprises. Le même phénomène s’observe vis-à-vis des ménages.
Pour l’heure, on constate un déséquilibre fiscal : la France paie des études à des gens brillants, qui, quand ils dépensent peu en termes de santé et d’éducation, travaillent à l’étranger, et reviennent quand ils doivent financer ces dépenses. Qu’en conclure ? Qu’il faut cesser de prendre en charge l’éducation ou la santé, ou que le pays doit être attractif à tout moment de la vie ? C’est là un débat de fond.
Mme Claudine Schmid. Il semble que, lorsqu’elles recrutent, les entreprises ne valorisent pas toujours le fait d’avoir fait carrière à l’étranger. Avez-vous étudié ce phénomène ?
M. Marc Goua. Existe-t-il des chiffres sur les binationaux ? Le retrait de la France en matière d’émigration n’explique-t-il pas nos difficultés en matière de commerce international ? Un petit pays comme les Pays-Bas profite de la présence de ses nationaux à l’étranger.
M. Pierre-Henri Bono. Nous ne disposons pas de chiffres sur les binationaux, puisque notre critère, pour définir l’émigration, est le pays de naissance. Il est beaucoup plus difficile de travailler sur la nationalité.
Un chercheur qui a fait une partie de sa carrière dans une bonne université étrangère, notamment américaine, est vraiment valorisé.
Mme Claudine Schmid. Et en dehors des chercheurs ?
M. Étienne Wasmer. Dans les secteurs en déclin, où il existe une file d’attente avant d’accéder à l’emploi, on propose spontanément les postes aux personnes restées en France, qui bénéficient d’un réseau. On ne constate pas le même phénomène dans les secteurs en expansion. Par ailleurs, si les grands groupes, comme Total, qui peuvent faire une comparaison internationale entre les diplômes, les parcours et les carrières, vont chercher des potentiels à l’étranger, ce n’est pas le cas des plus petites entreprises.
Il existe une corrélation flagrante entre le volume d’émigration et le flux de commerce, comme d’ailleurs de savoir, entre les pays. Quand nous avons des collègues français dans les grandes universités, nous nous invitons et nous échangeons des étudiants, ce qui est un facteur de rayonnement. C’est pourquoi nous défendons dans la note une vision dynamique de l’émigration, en nous demandant à la fois comment en tirer parti, comment éviter de se faire voler nos meilleurs étudiants et comment en attirer.
M. le président. Je vous remercie de cette étude intéressante, qui nourrira nos travaux.
L’audition s’achève à dix-huit heures cinquante.
*
* *
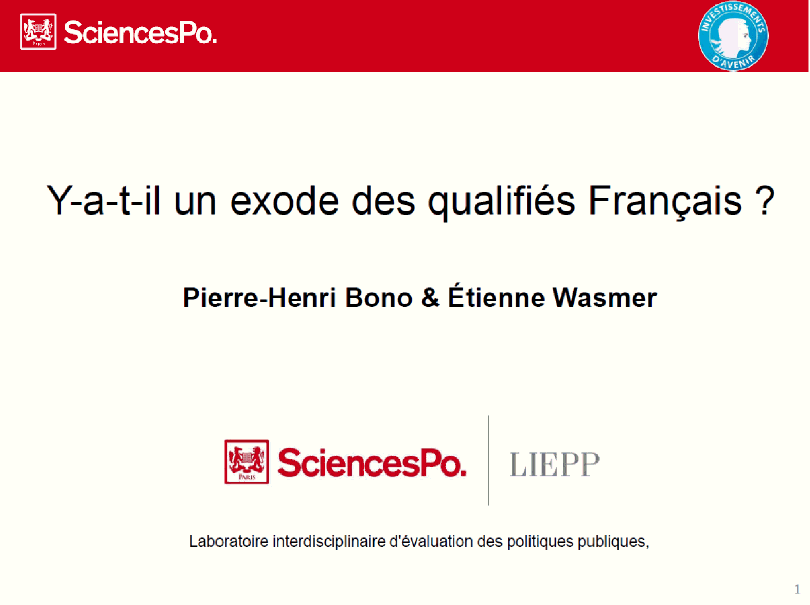
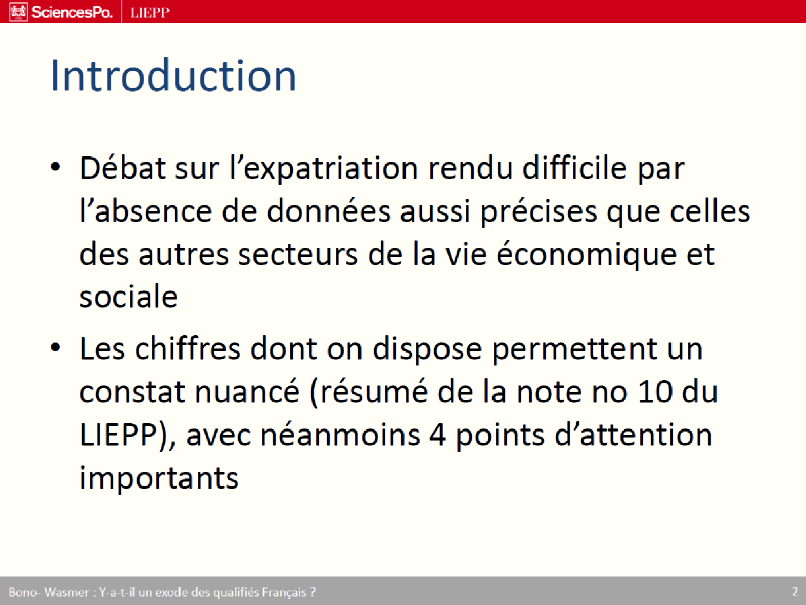
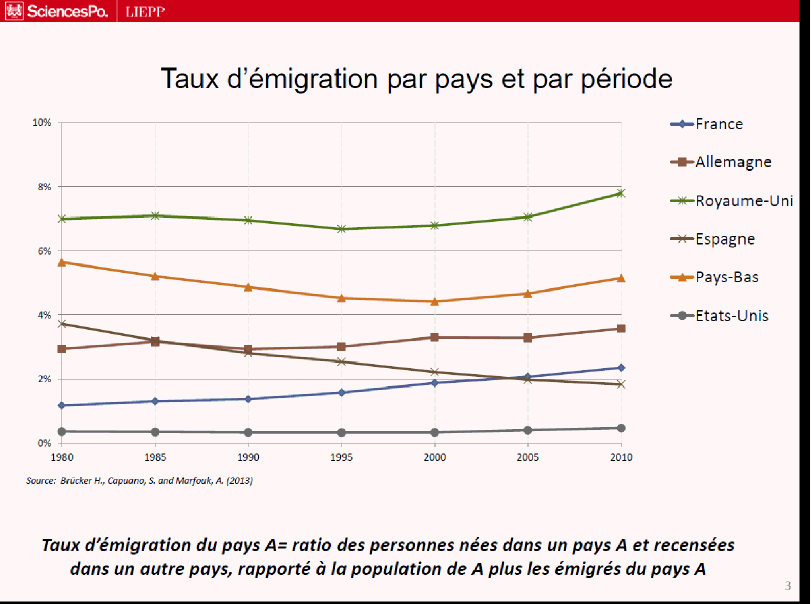
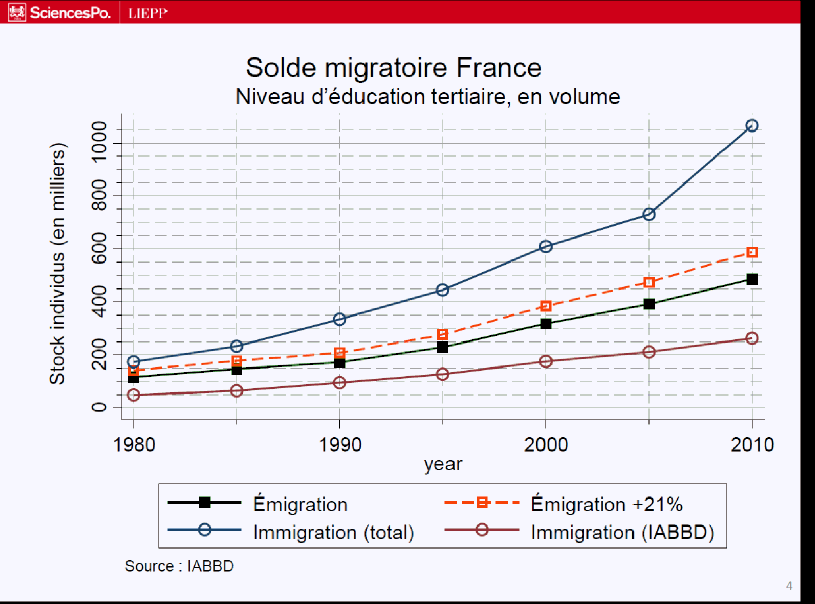
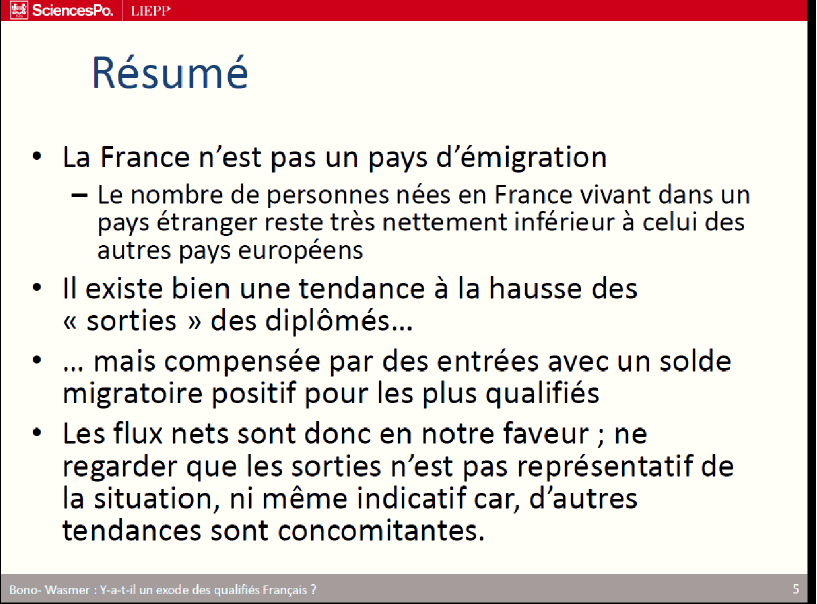
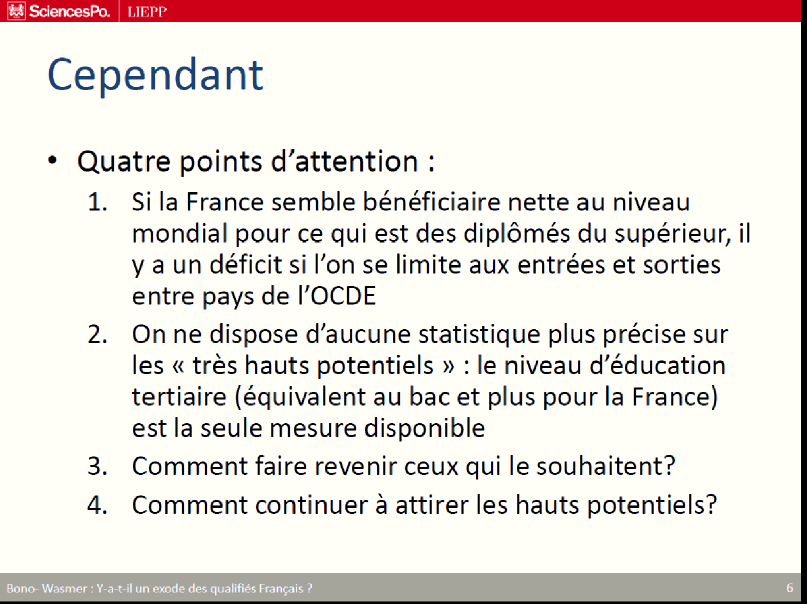
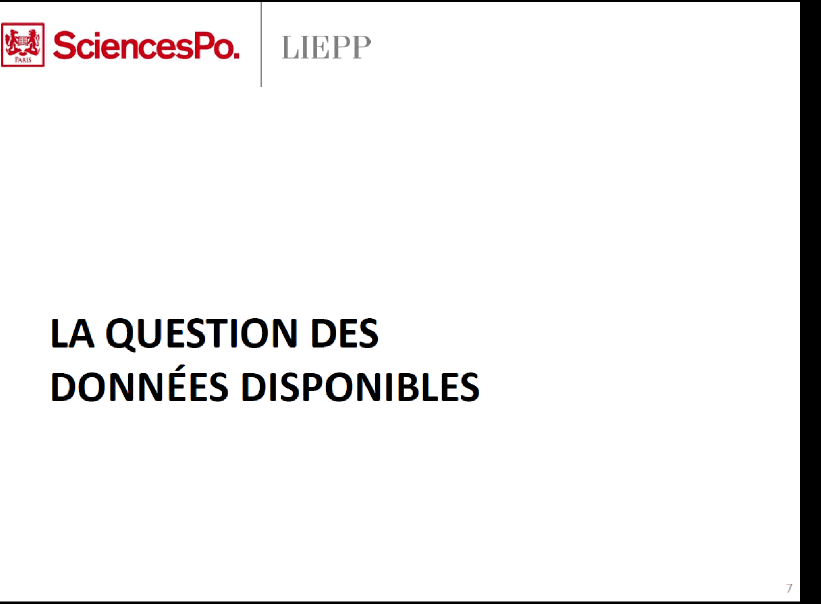
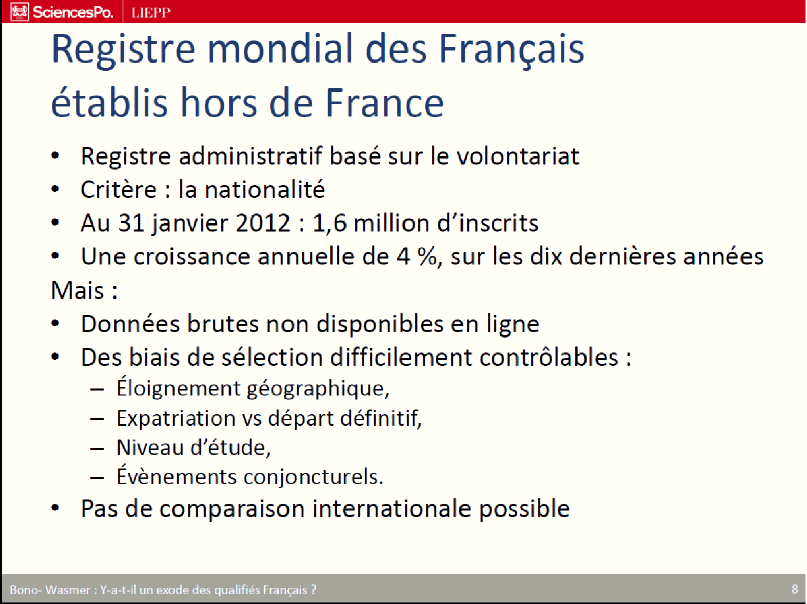
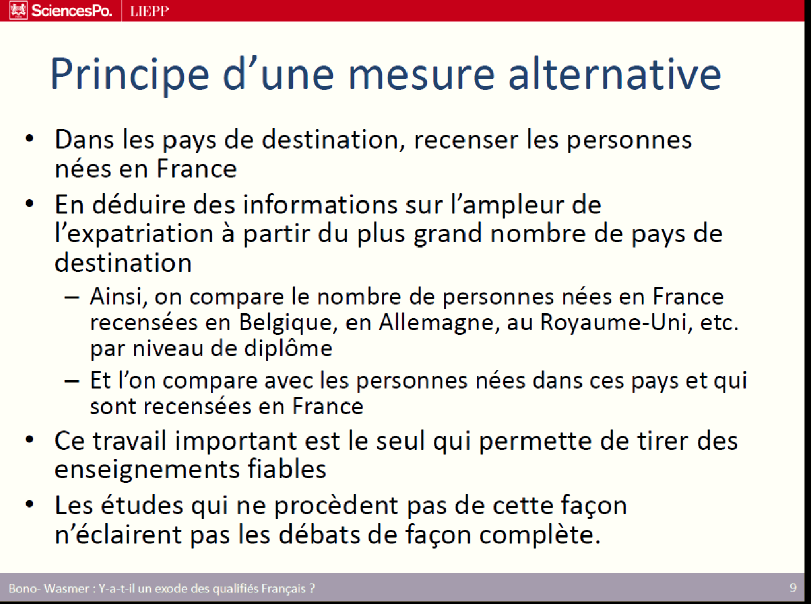
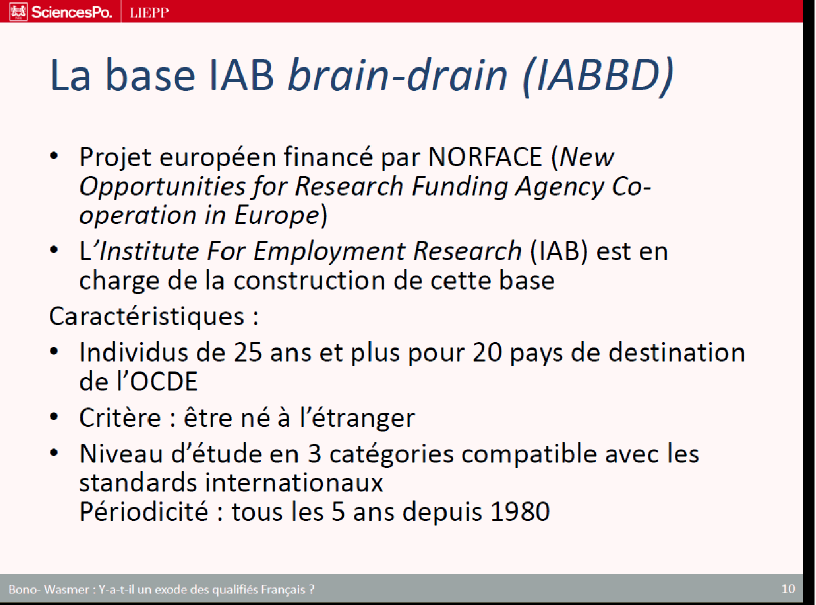


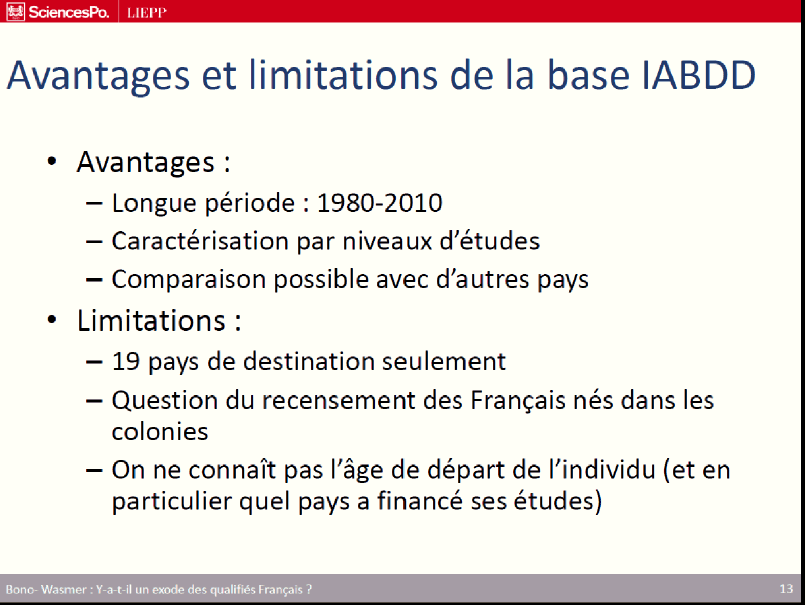
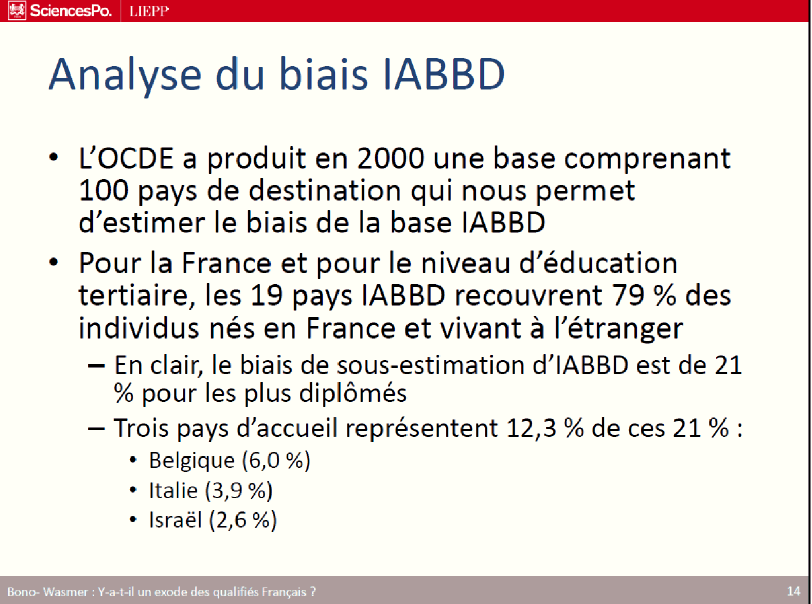
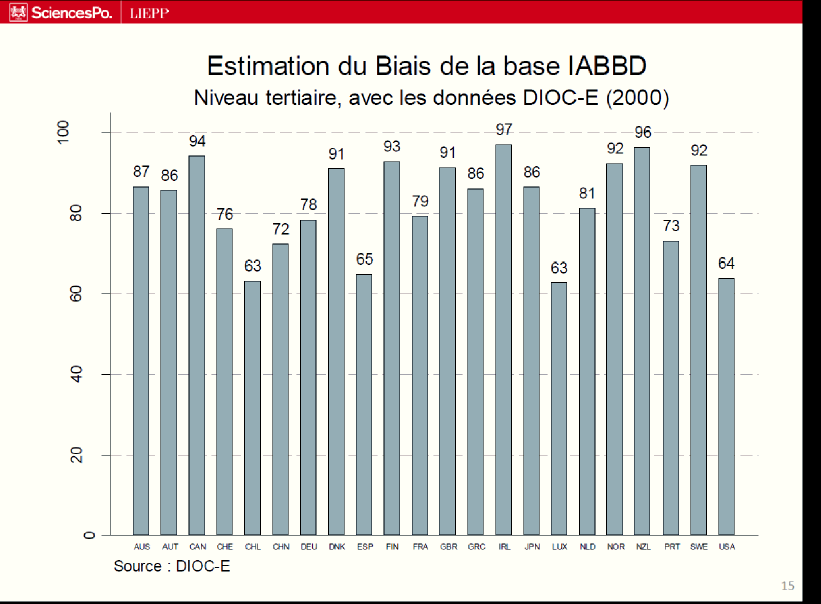
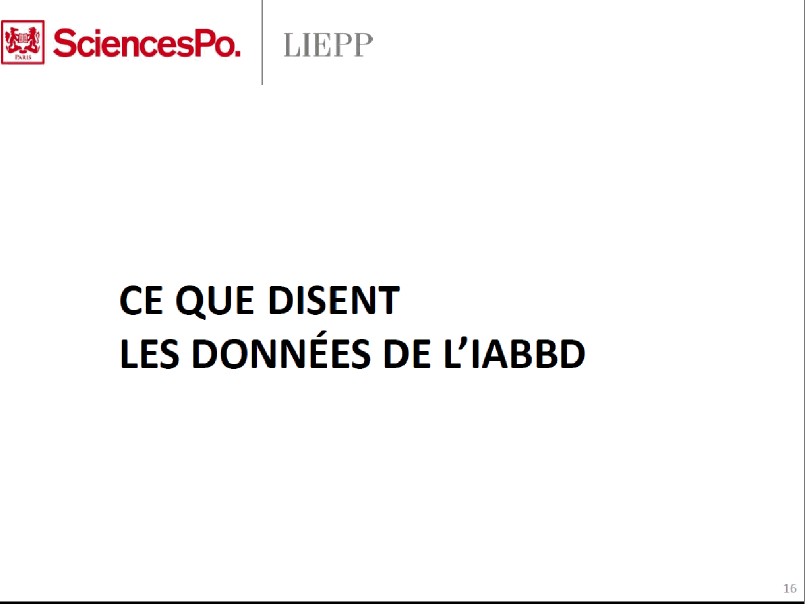
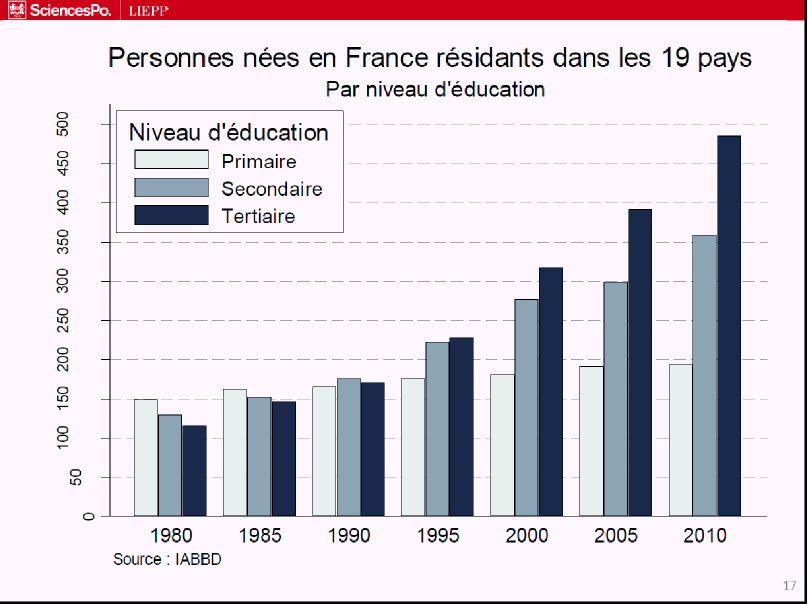
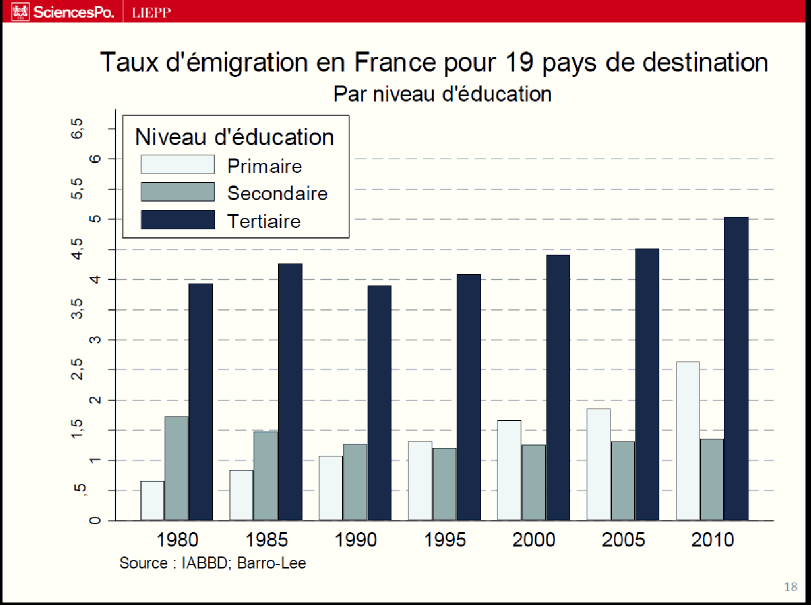
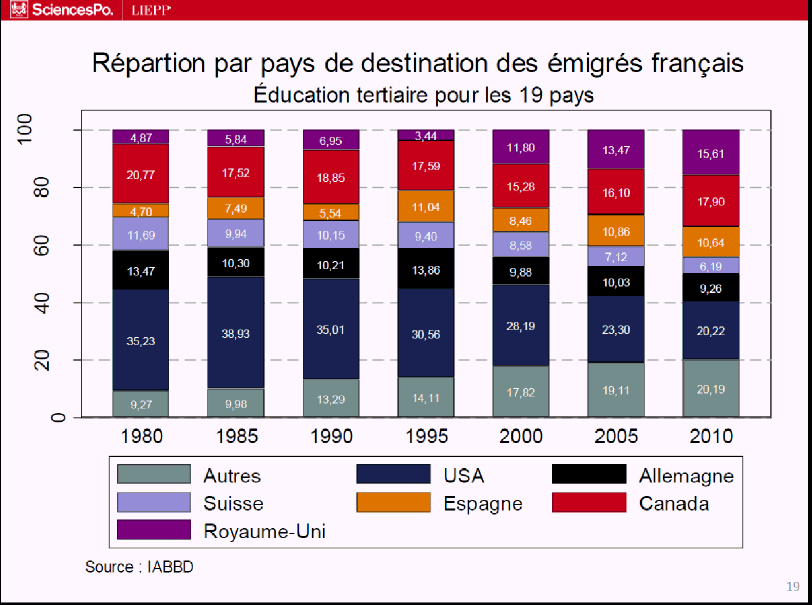
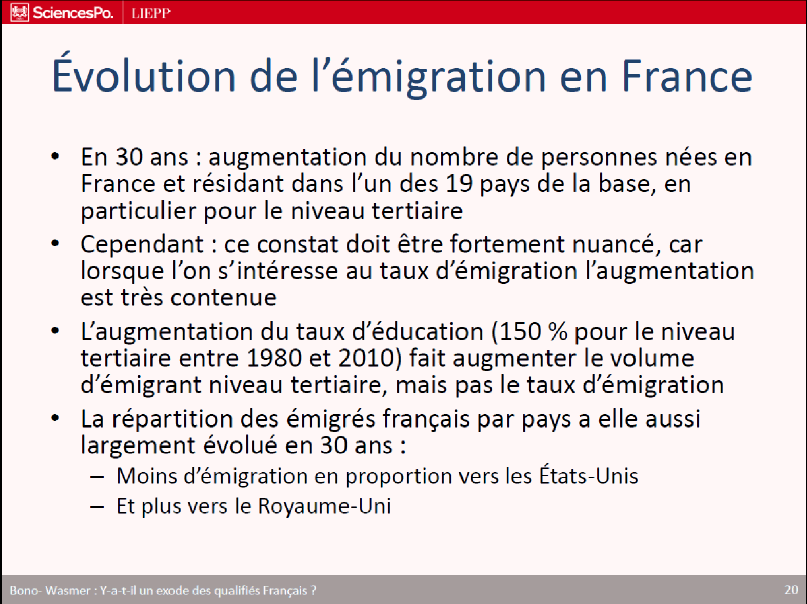
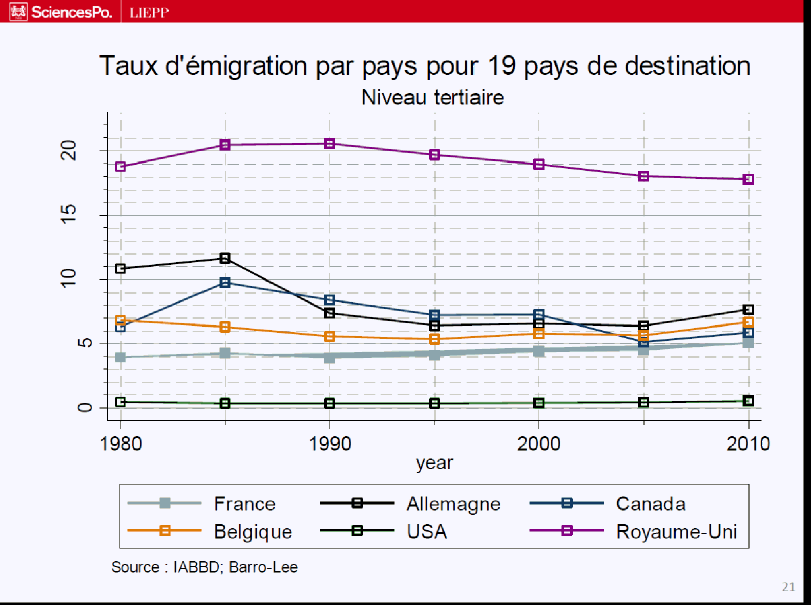
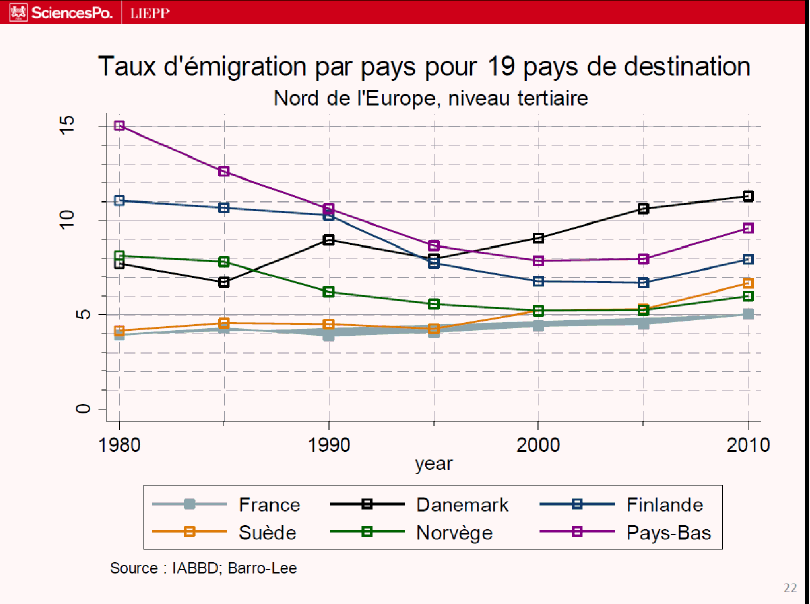
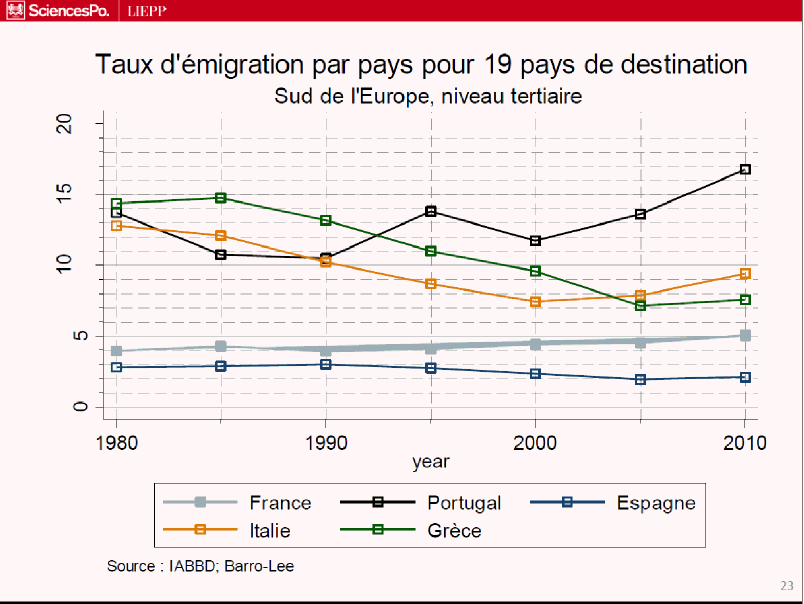
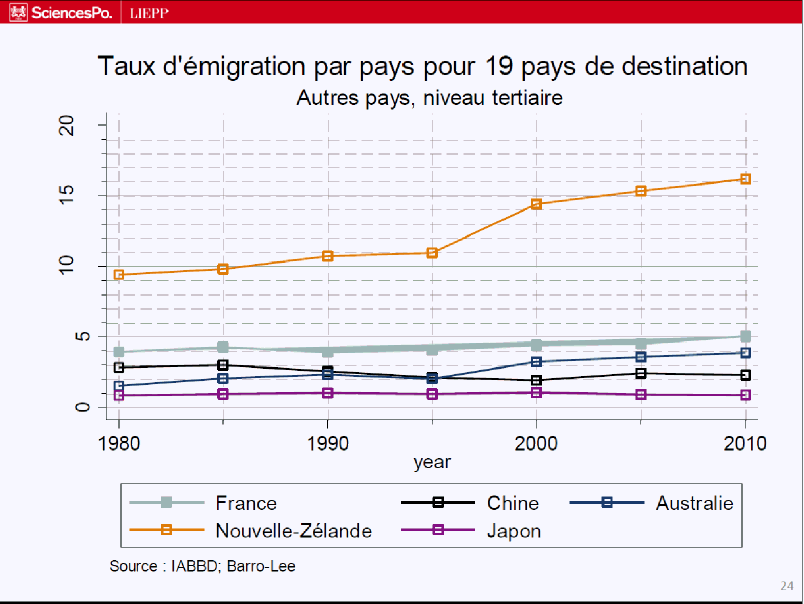
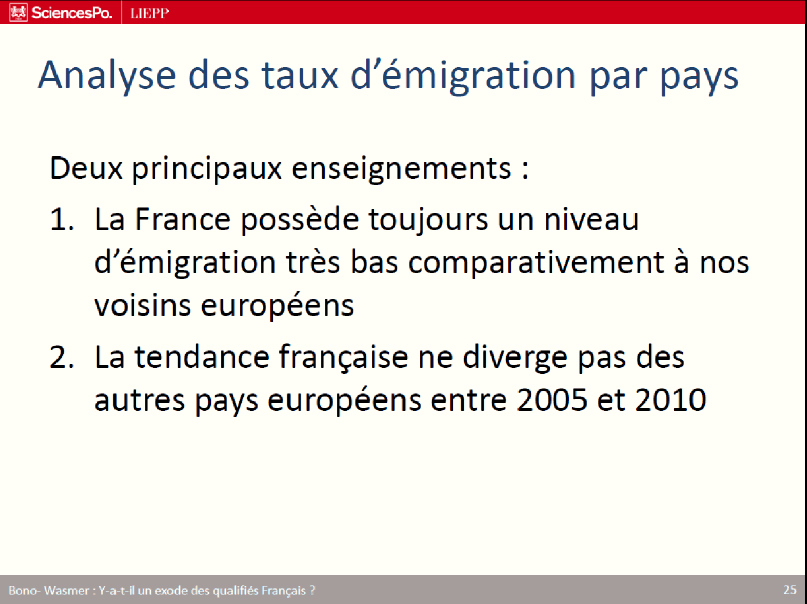
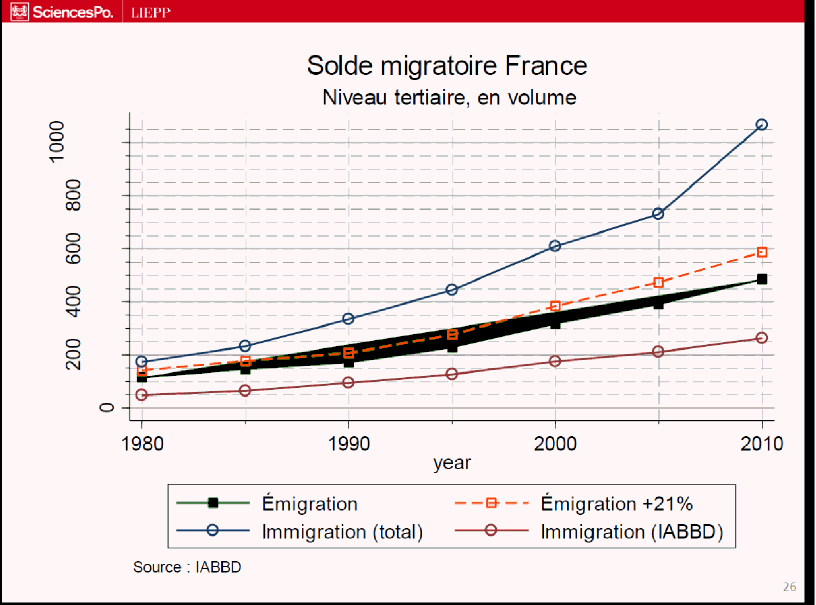
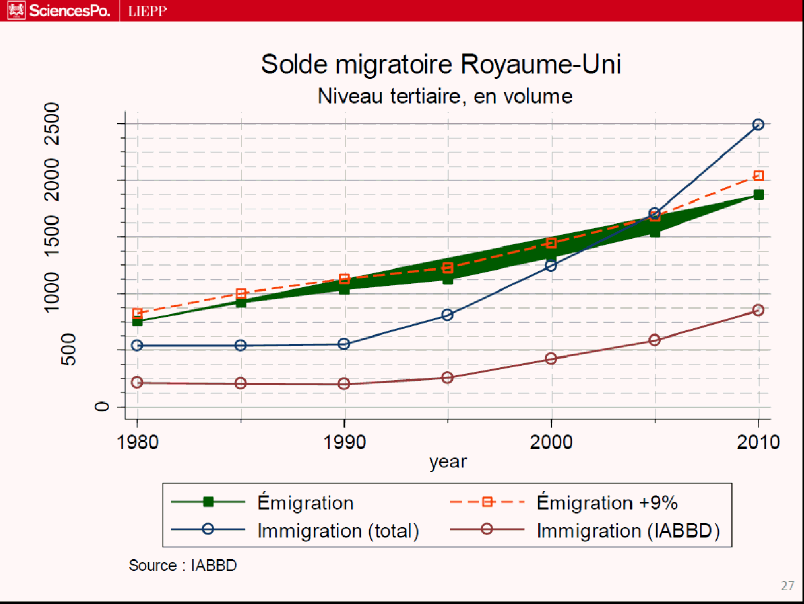
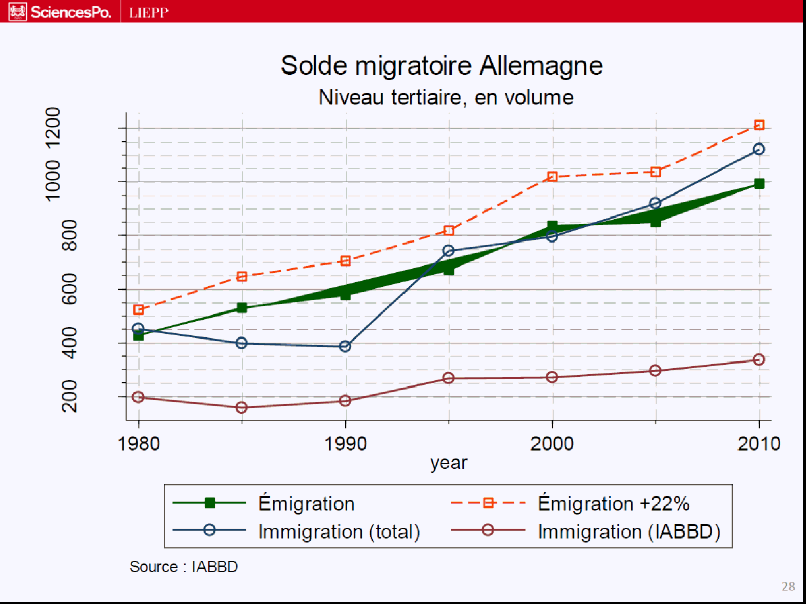
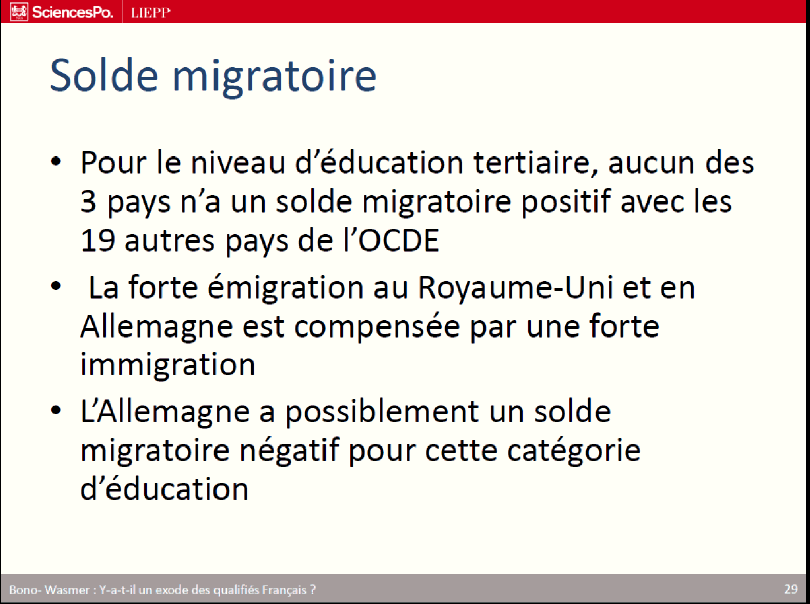
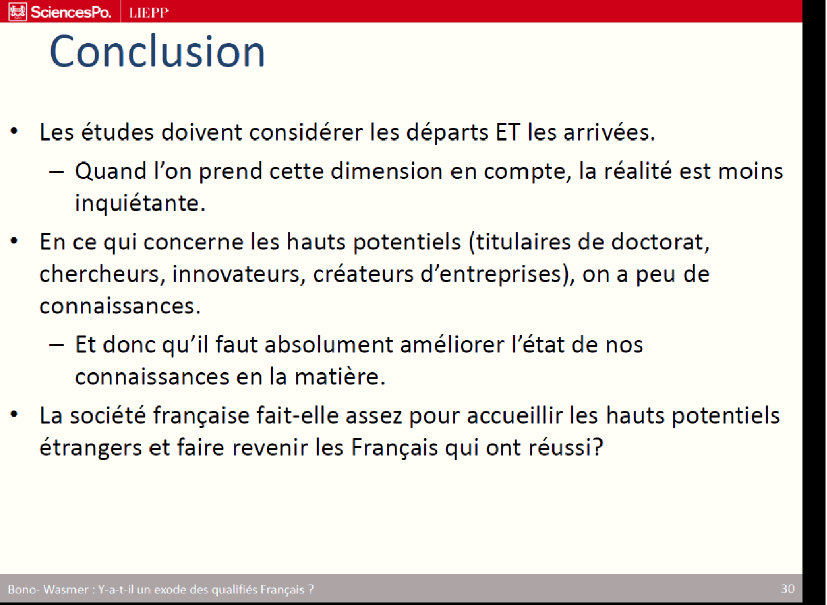

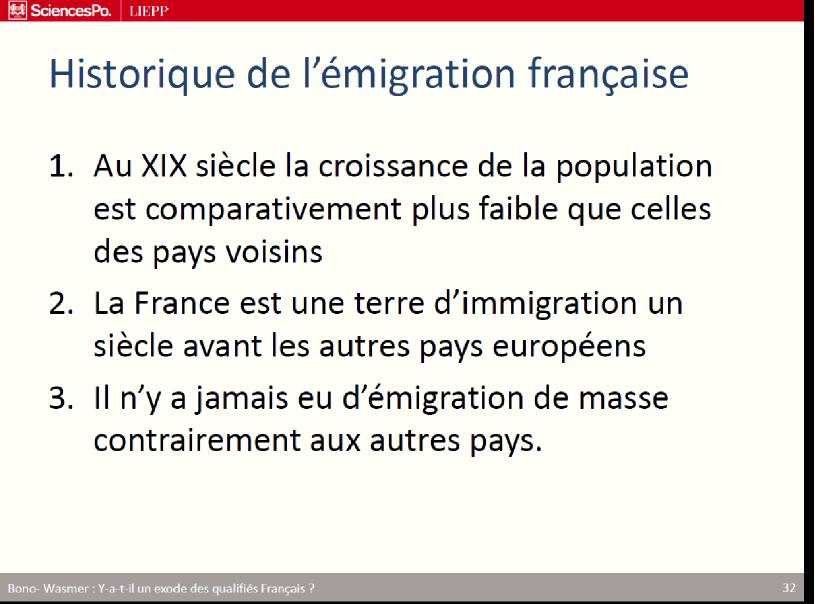
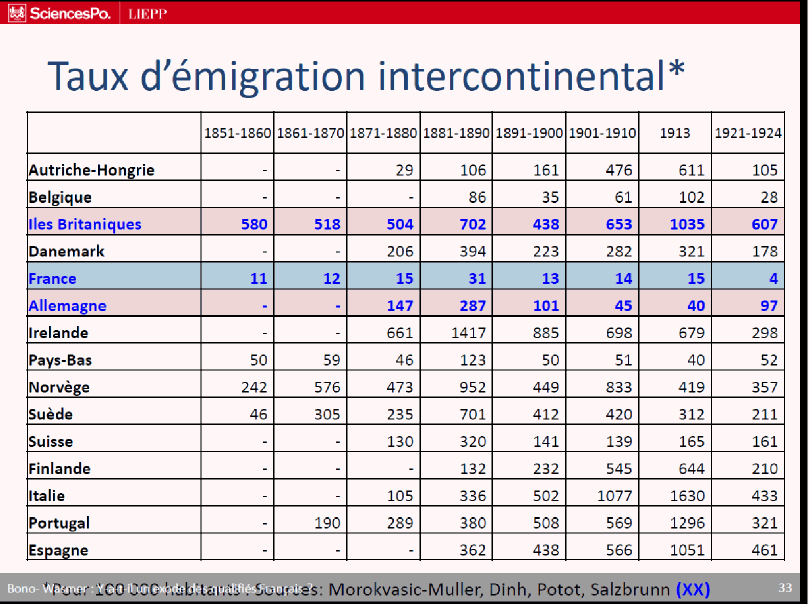
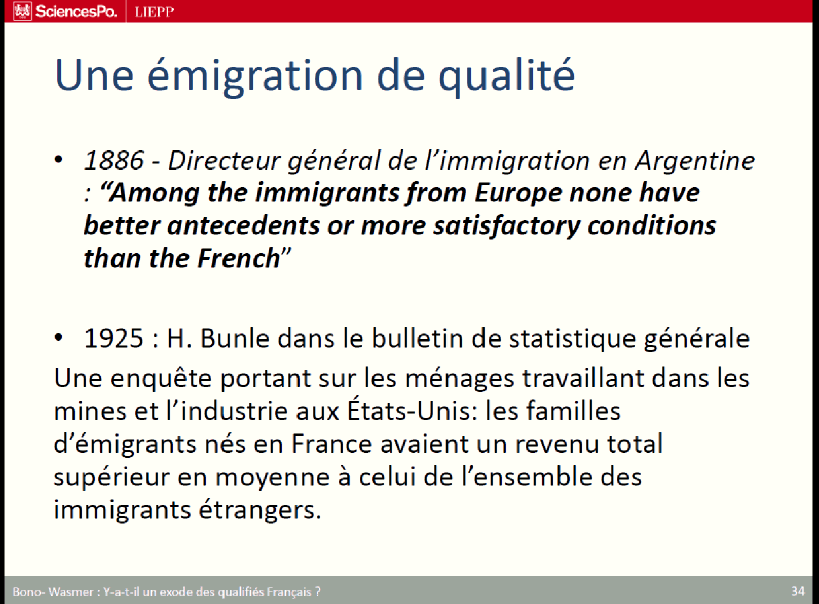
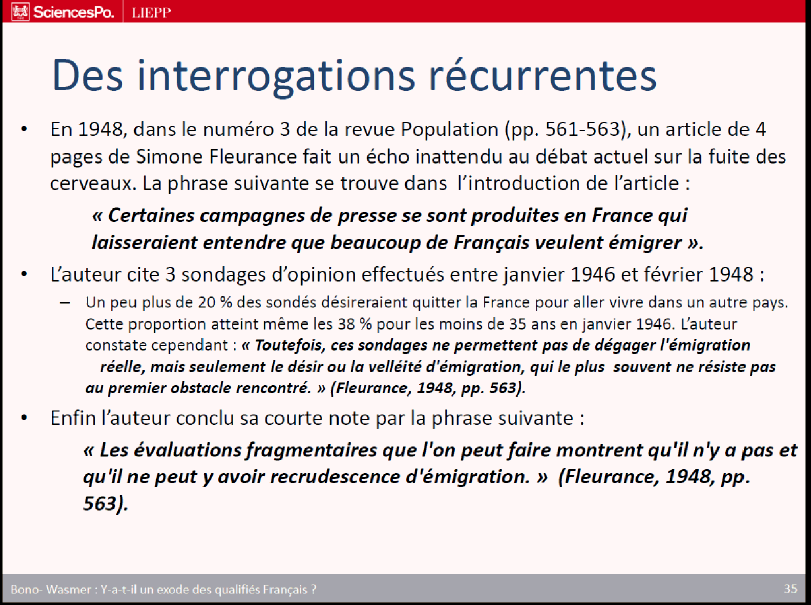
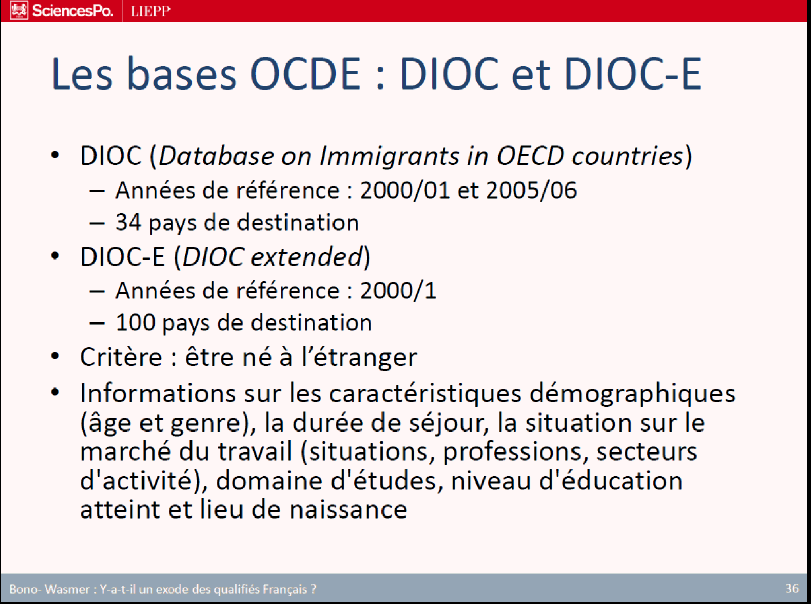
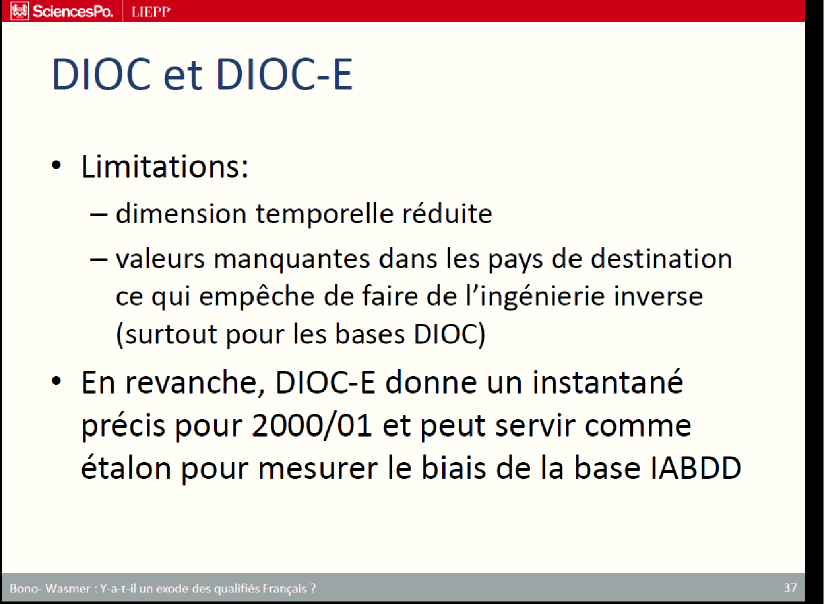
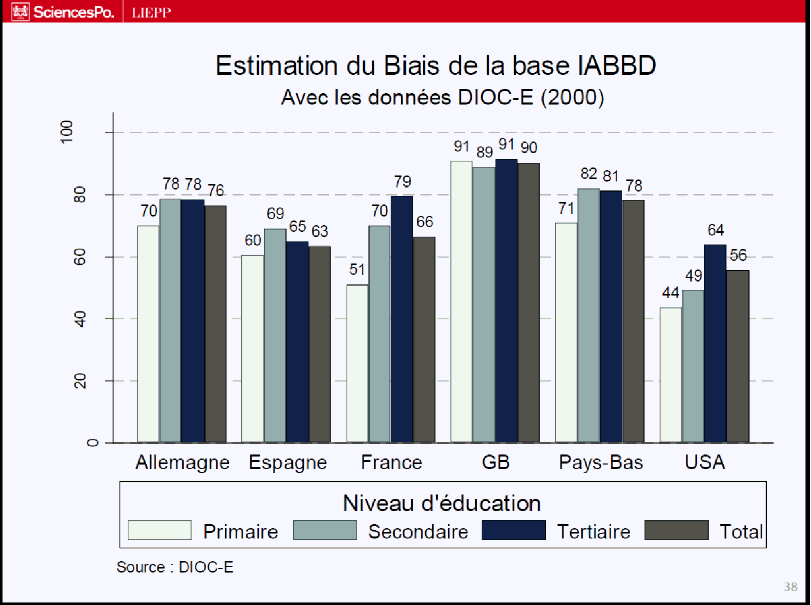
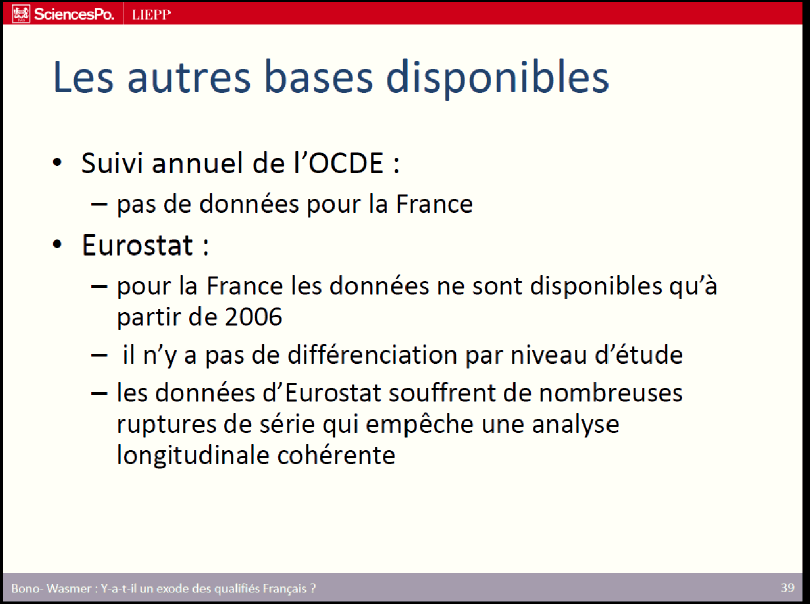
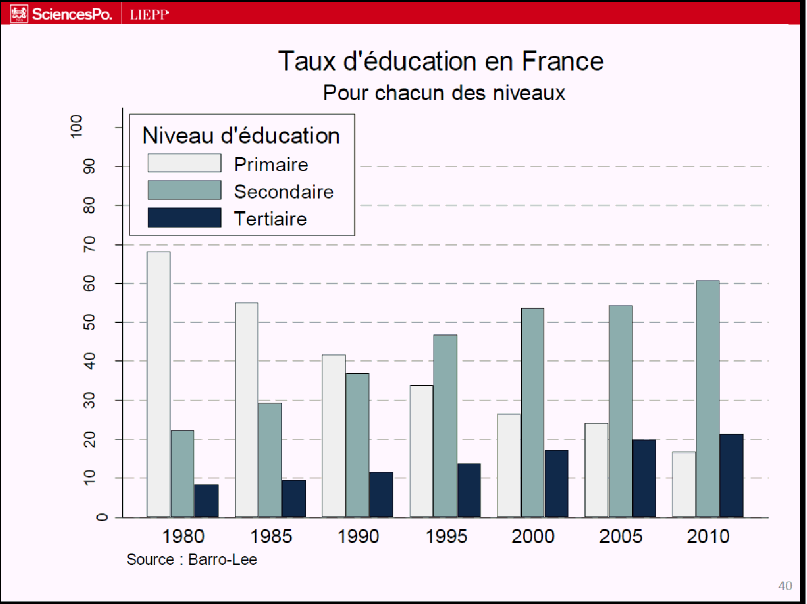
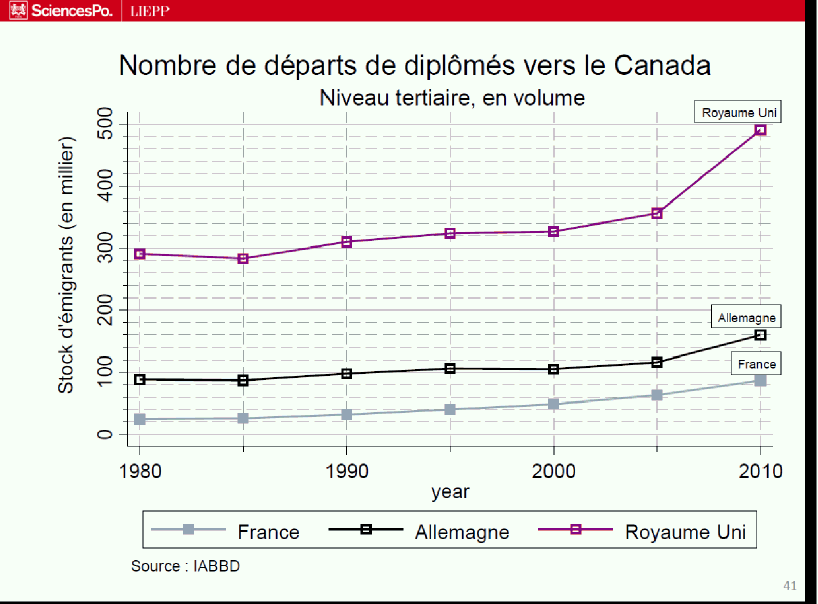
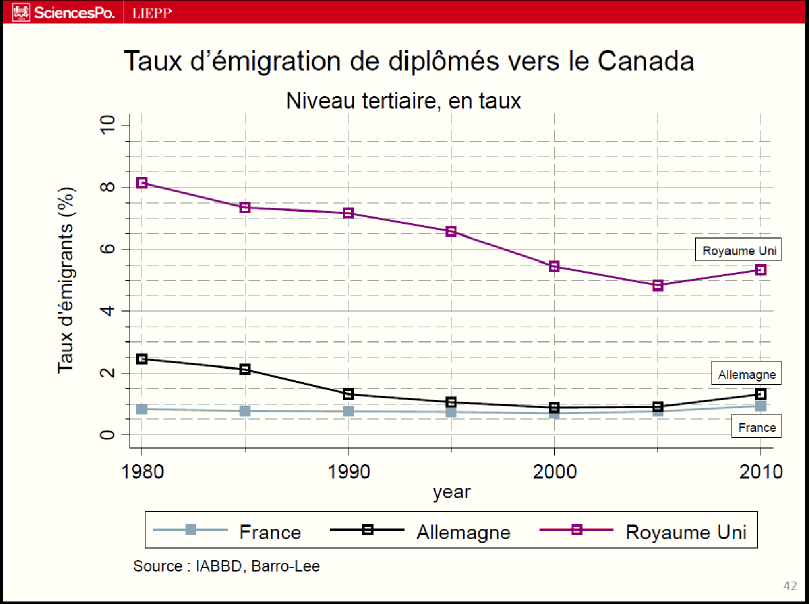
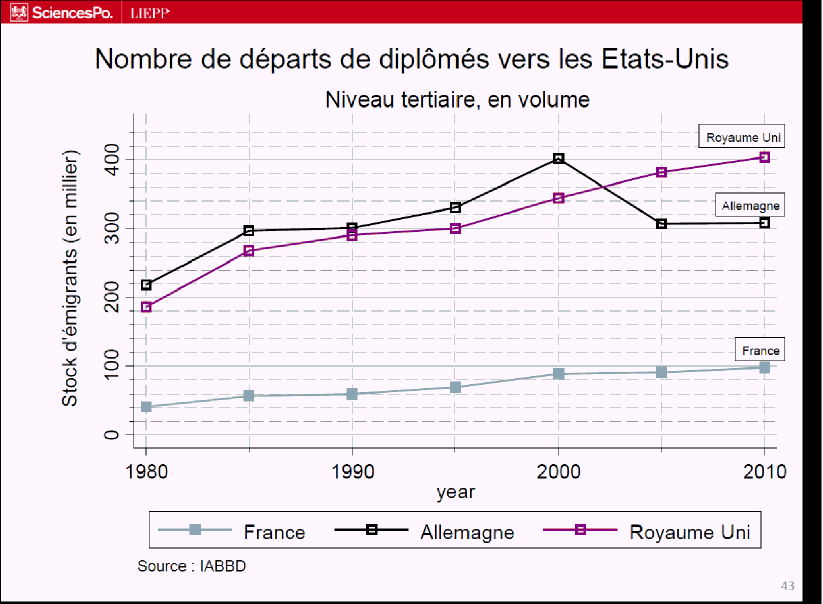
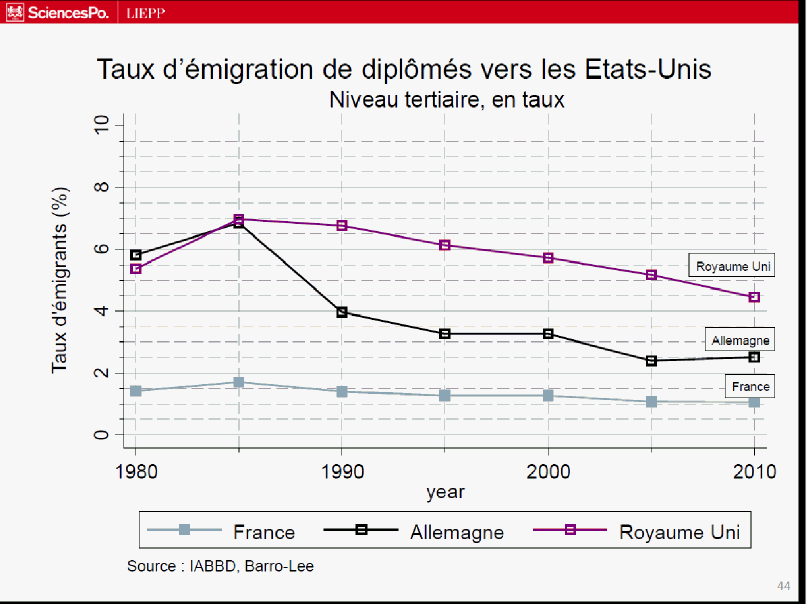
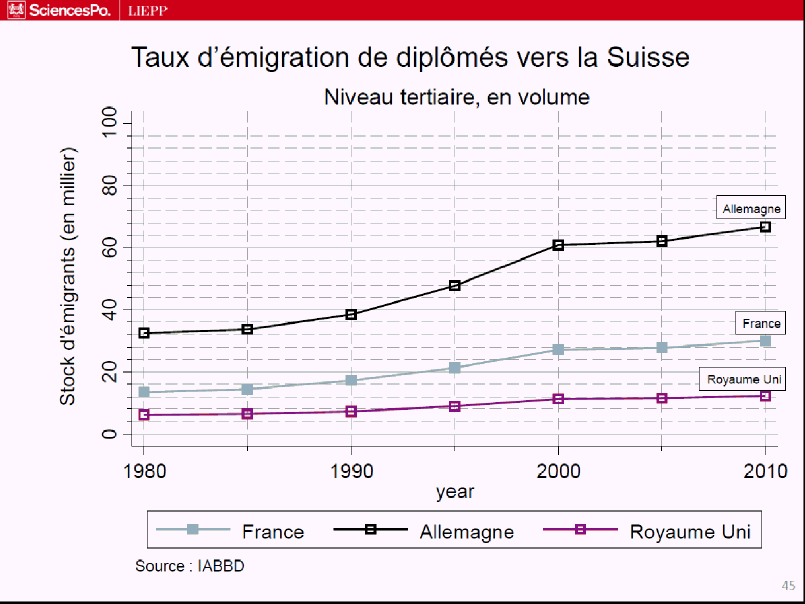
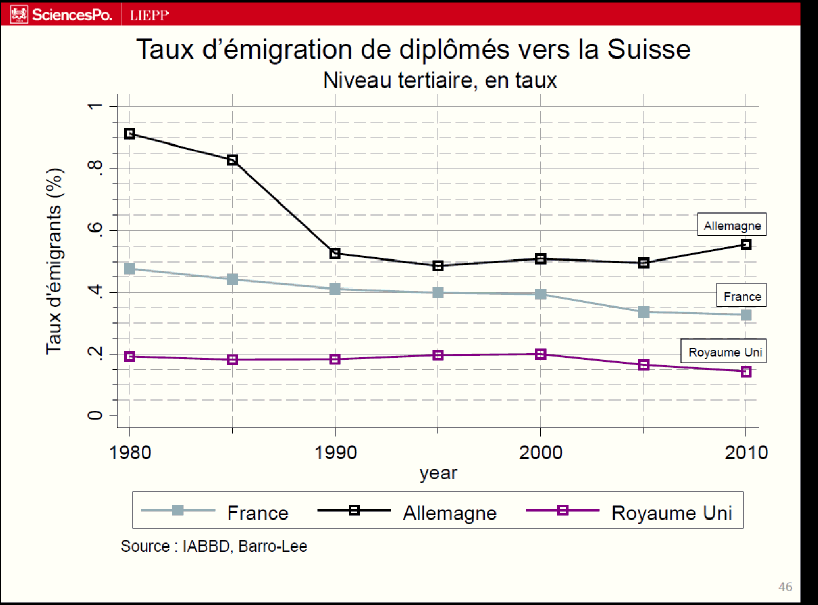
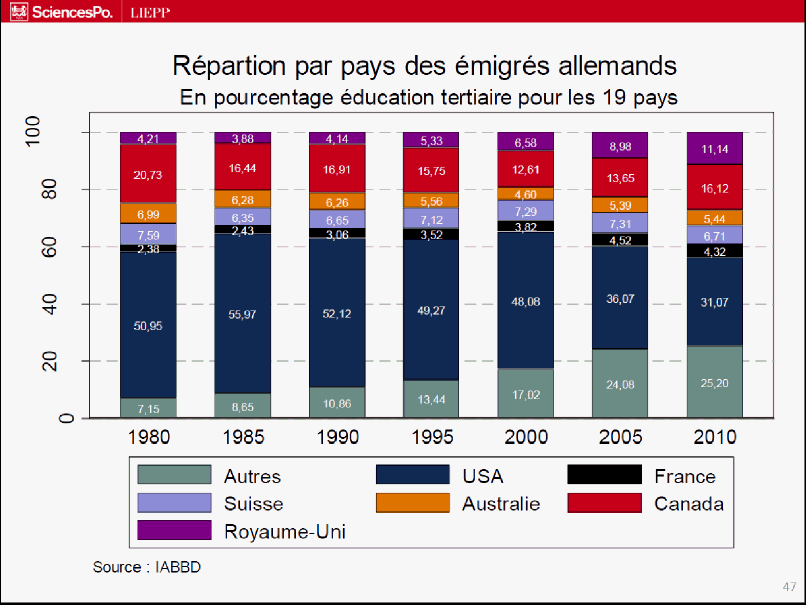
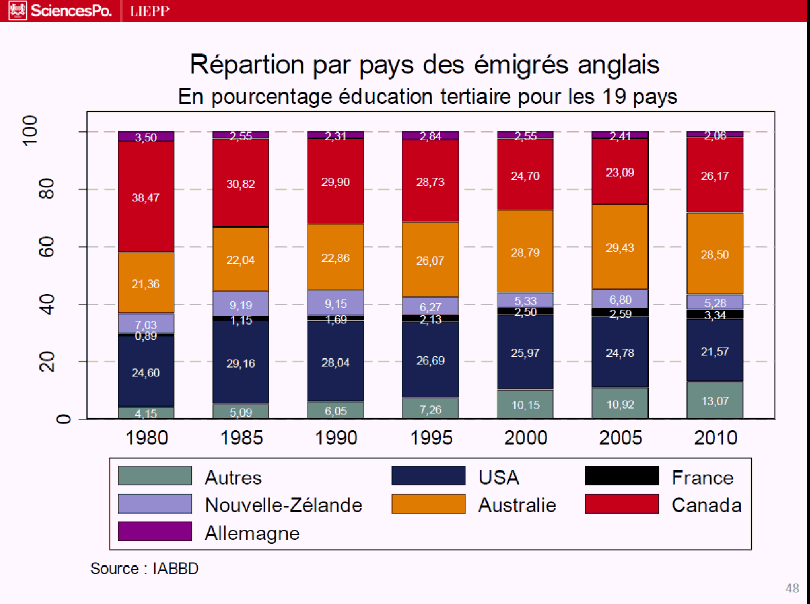
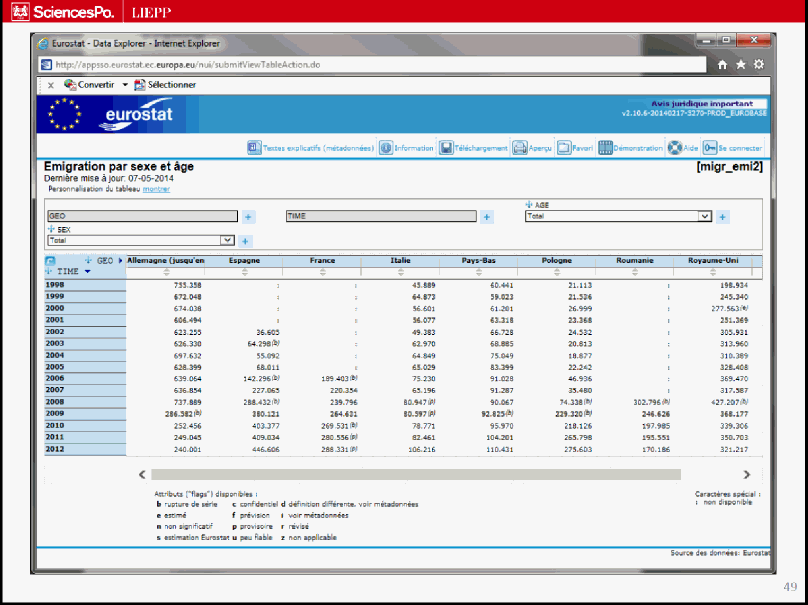
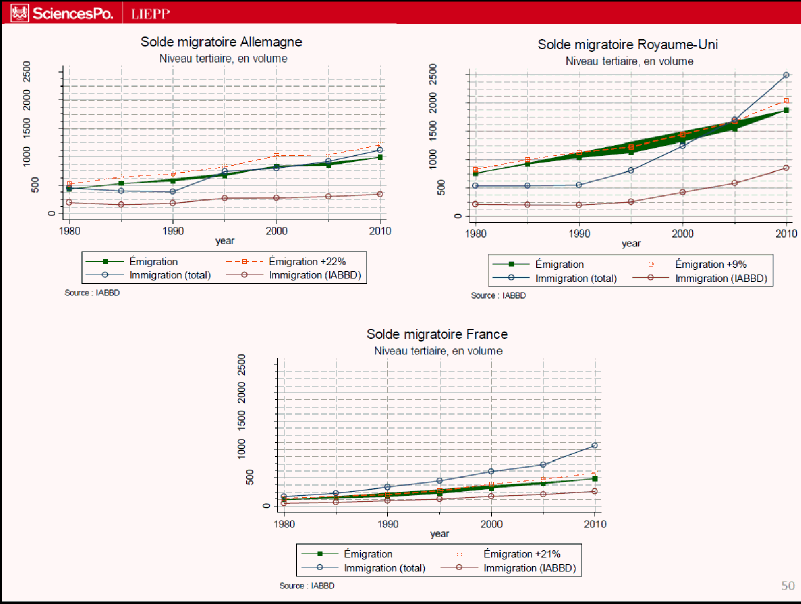
Membres présents ou excusés
Commission d'enquête sur l'exil des forces vives de France
Réunion du mardi 13 mai 2014 à 17 h 45
Présents. - M. Luc Chatel, M. Philip Cordery, M. Charles de Courson, M. Christian Franqueville, M. Yann Galut, M. Marc Goua, M. Gilbert Le Bris, M. Alain Rodet,
Mme Sophie Rohfritsch, Mme Claudine Schmid, M. Claude Sturni, M. Jean-Marie Tetart
Excusés. - Mme Nicole Ameline, Mme Monique Rabin
——fpfp——