


| Accueil > Contrôle, évaluation, information > Les comptes rendus de la mission d’évaluation et de contrôle |
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Madame, messieurs, merci d’avoir répondu à notre invitation. Je souligne que les échanges de la Cour des comptes avec la mission d’évaluation et de contrôle ont toujours été très fructueux. Nous souhaitions vous poser certaines questions, notamment sur les risques pesant sur les différentes dettes – de l’État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Je souligne d’ailleurs que la dette des collectivités territoriales est garantie, elle, par les habitants, même si l’État joue son rôle car tous les ans, les collectivités présentent des comptes en équilibre.
M. Raoul Briet, président de la première chambre de la Cour des comptes. La dette publique a augmenté de façon presque continue depuis le début des années 1970 comme l’illustre le graphique ci-dessous.
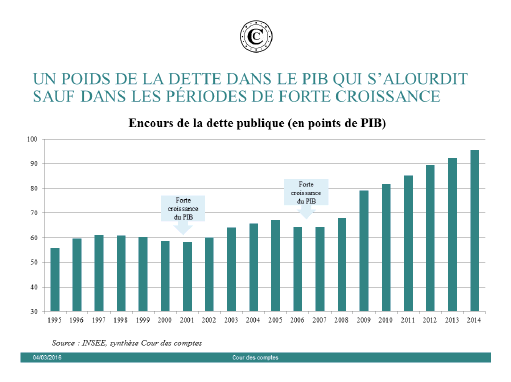
C’est le résultat d’une accumulation des déficits : depuis 2008, ceux-ci sont, en effet, systématiquement supérieurs au solde qui permettrait de stabiliser le poids de la dette dans le PIB. À l’exception des années 2006 et 2007, le solde public est même très nettement inférieur au solde stabilisant.
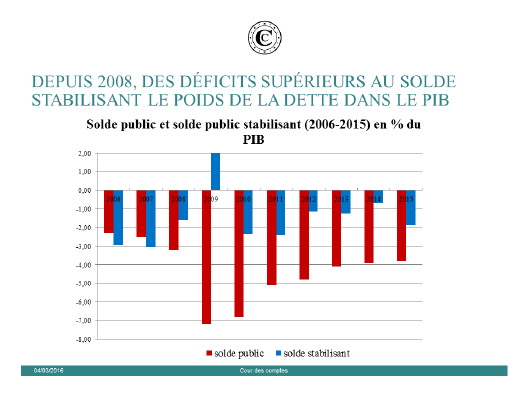
La dette représente près de 100 % du PIB : pour qu’elle soit stabilisée, le solde public ne devrait donc pas être supérieur à l’évolution du PIB nominal de l’année considérée. En 2015, il aurait ainsi fallu que le déficit public soit de l’ordre de 2 points de PIB : ce ne sera finalement pas loin du double de ce chiffre, puisque les dernières prévisions du Gouvernement comme de la Commission européenne situent le déficit aux alentours de 3,8 % du PIB.
Il n’y a eu que deux exceptions au cours des vingt dernières années : de 1998 à 2001, et 2006-2007. Il s’agissait, et ce n’est pas un hasard, de périodes de forte croissance économique. Rétrospectivement, on ne peut que constater que les périodes de croissance accrue ne sont guère mises à profit pour réduire suffisamment les déficits publics, et donc pour préparer les années de croissance plus faible qui suivent.
Je voudrais souligner ici que les autorités publiques ont trop souvent tendance à considérer comme durables les phases de croissance plus forte, c’est-à-dire le haut des cycles économiques. Cela a été le cas entre 1998 et 2001, comme en 2006 et 2007 pendant lesquelles des allégements fiscaux importants ont été consentis. Il serait donc à mon sens judicieux de piloter les finances publiques en utilisant la notion de « solde structurel », qui figure maintenant dans les textes, notamment dans la loi organique de décembre 2012, même si sa mesure et son utilisation en sont délicates. Le solde structurel a néanmoins le grand mérite de permettre une évaluation du solde effectif constaté par rapport à l’évaluation de la conjoncture, et donc d’éviter de commettre des erreurs.
Je souligne également que les autorités publiques sous-estiment aussi fréquemment l’effet de rémanence des crises sur le taux de croissance : les crises, et en particulier celle qui s’est enclenchée en 2007-2008, conduisent à un affaiblissement progressif de la croissance potentielle de l’économie française, et par conséquent à une surestimation de la croissance et à une sous-estimation des efforts nécessaires pour résorber les déficits.
En outre, depuis une vingtaine d’années, la croissance de l’endettement public s’est accélérée, croissance au sein de laquelle on peut distinguer trois périodes :
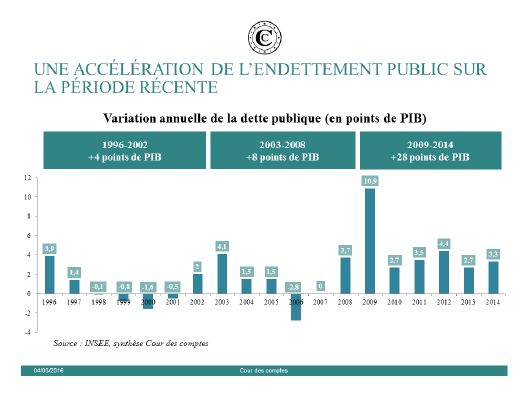
La France a abordé la crise de 2008-2009 avec un solde et une dette publique dégradés. Elle a laissé jouer les stabilisateurs automatiques et mené un plan de relance ; mais celui-ci a été d’une ampleur sensiblement moindre que chez nos voisins allemands, nos marges de manœuvre étant elles-mêmes sensiblement inférieures.
Le Premier Président de la Cour des comptes le dit régulièrement : la question de la maîtrise de la dette, est celle de la capacité de la France à opérer librement des choix, à décider en toute souveraineté de ses politiques publiques ; c’est une question politique, au sens noble du terme afin de pouvoir rester maîtres de notre destin.
Autre point, la dette de l’État représente l’essentiel de la dette publique française – près de 80 % en 2014.
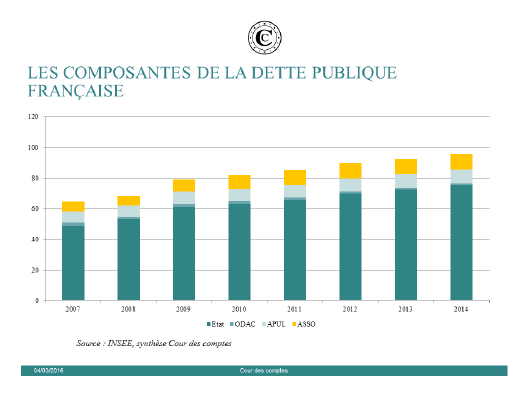
Au cours de la période récente, la dette de l’État a crû plus rapidement que celles des collectivités locales et de la sécurité sociale : elle a augmenté de 20 % entre 2010 et 2014, quand celle des administrations publiques locales (APUL) croissait de 7 % et celle des administrations de sécurité sociale (ASSO) de 16 %. Quant à la dette des opérateurs de l’État (organismes divers d’administration centrale, ODAC), elle a diminué de 31 % au cours de la même période.
Le fait que la dette de l’État progresse beaucoup plus vite que celle des administrations de sécurité sociale ou des collectivités locales ne signifie pas que l’État est beaucoup moins bien géré que celles-ci : l’augmentation de la dette n’est pas fonction du sérieux de la gestion des uns ou des autres. Dans notre système, en effet, l’État est le réassureur en dernier ressort : c’est la centrale du déficit… D’une certaine manière, la plupart des déficits publics et donc des dettes se reportent in fine, sur l’État. Ainsi, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a provoqué, pour le budget de l’État, une perte de recettes : le déficit, et donc la dette, se sont accrus. Je ne voudrais pas entamer ici une discussion des conséquences du CICE sur l’emploi et la masse salariale, mais ses effets sont bénéfiques à l’ensemble de la communauté nationale, et donc aussi aux administrations de sécurité sociale et aux collectivités locales.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Vous dites que c’est l’État qui a financé le CICE. Mais le pacte de responsabilité – quoi que l’on en pense par ailleurs – a imposé des efforts à tous : 20 milliards ont été demandés au budget de l’État, mais aussi 11 milliards aux collectivités locales et 20 milliards à la sécurité sociale. La perte de recettes a été partagée.
M. Raoul Briet. La perte a été supportée par l’État seul, mais à cette occasion il a essayé d’enclencher un mouvement de maîtrise des dépenses de l’ensemble des administrations publiques.
Pour juger des efforts consentis en matière de gestion, un seul paramètre compte à mon sens : le rythme de l’évolution des dépenses. C’est l’instrument de mesure le moins conventionnel et le moins discutable.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La Cour des comptes a montré, je crois, que les efforts de dépense nets demandés dans le cadre du CICE avaient porté à plus de 60 % sur les collectivités territoriales.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Pour financer le CICE, l’État met tout le monde à contribution. En baissant la dotation globale de fonctionnement (DGF), il oblige les collectivités à s’endetter – mais celles-ci sont dans l’obligation d’équilibrer leurs comptes. Cette dette-là sera donc remboursée ! C’est un transfert, en quelque sorte, mais dont l’État est toujours garant.
Le cas de la dette sociale est un peu différent, puisqu’il peut y avoir des résultats, les recettes peuvent augmenter.
M. Raoul Briet. Le juge de paix, je le redis, c’est l’évolution des dépenses des différentes catégories d’administrations publiques – l’évolution de chaque catégorie au cours d’une période donnée, ainsi que l’évolution comparée des différentes catégories. Cette analyse permet de mieux mesurer les efforts des uns et des autres – les efforts devant en effet être consentis par tous. La dette de l’État augmente davantage, mais cela ne veut pas dire qu’il est plus mal géré.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je ne dis pas que l’État ne fait pas d’efforts !
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. J’avais un jour naïvement proposé que l’État présente des comptes équilibrés… Je suis maire, je présente des comptes en équilibre, pourquoi pas l’État ? Mais l’on m’a répondu que l’État étant le dernier payeur, on ne pouvait pas lui imposer une telle règle.
M. Raoul Briet. De facto, l’État est le payeur en dernier ressort.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Mais l’État n’existe pas : le dernier payeur, c’est le citoyen !
M. Raoul Briet. De toute façon, le payeur, c’est bien le contribuable, national, local ou social : nous voyons la différence, mais je pense que les Français, souvent, ne la voient pas ! Pour eux, tout prélèvement est un revenu disponible en moins.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Que la dette de l’État joue un rôle particulier, pour des raisons liées aux fonctions régaliennes, je veux bien le comprendre. Le problème, au demeurant, ce n’est pas tant le montant de la dette que la capacité à la rembourser. Or l’État ne peut plus rembourser sa dette, puisque ses comptes sont systématiquement en déficit.
M. Raoul Briet. C’est en effet la dynamique de la dette qui est forte. Mon propos était, modestement, de souligner que l’augmentation plus forte de la dette de l’État par rapport à celle des administrations locales et des administrations de sécurité sociale ne signifiait en rien qu’il se serait montré particulièrement dispendieux.
La dette des collectivités locales représente aujourd’hui un peu moins de 10 % du volume total de la dette publique. Depuis une dizaine d’années, l’encours de cette dette a tendance à progresser, mais lentement.
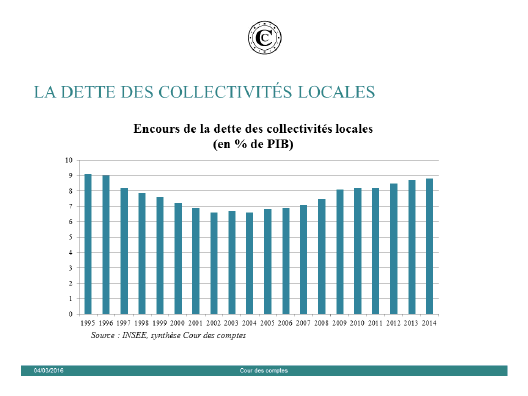
La dette sociale est du même ordre de grandeur : elle représente maintenant un peu plus de 10 points de PIB, avec une progression très sensible entre 2008 et 2014 : pour le seul régime général et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), cela représente 8 points de PIB. Elle devrait atteindre son plus haut point en 2015 alimentée par les déficits de la branche maladie et de la branche vieillesse.
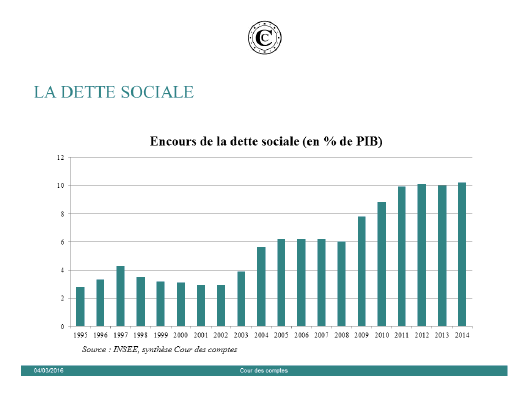
Cette dette se compose, vous le savez, de quatre sous-ensembles. La Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) amortit chaque année 16 milliards grâce aux ressources qui lui sont affectées. Son terme est estimé à 2024. Il faut souligner que s’est constituée, dans la période récente, une dette à court terme portée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui assure la trésorerie du régime général : cette dette atteignait près de 28 milliards d’euros à la fin de l’année 2014. L’ACOSS est donc un émetteur important de dette à court terme sur les marchés financiers. Quant à la dette des hôpitaux publics, elle représente 1,5 point de PIB mais il faut surtout souligner qu’elle a triplé entre 2002 et 2012, en raison des plans successifs de relance de l’investissement hospitalier qui se sont mis en place au début des années 2000. Enfin, il est plus particulièrement question en ce moment de la dette de l’UNEDIC. Elle représente environ 1 point de PIB.
La dette des administrations de sécurité sociale est exposée à un risque de remontée des taux, notamment pour sa part à court terme, naturellement, mais aussi pour la dette à long terme, qui est une dette à taux révisable.
Je rappellerai ici les recommandations classiques de la Cour des comptes : autant la Cour considère que le déficit de l’État peut être justifié, au regard de l’effort d’investissement qu’il consent, autant elle considère que les déficits de régimes de protection sociale – qui assurent des transferts instantanés entre actifs, ou entre actifs et retraités – n’ont pas de justification économique, en tout cas sur le moyen terme. Bien sûr, des lissages de cycles économiques peuvent expliquer une dette momentanée des organismes de sécurité sociale ; À moyen et long terme, il n’y a aucune justification de fond à financer des transferts par de la dette.
Nous nous sommes plus particulièrement inquiétés de la dette de l’ACOSS, très exposée à un risque de relèvement des taux. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a accéléré le calendrier de reprise de cette dette par la CADES, mais il restera un découvert de trésorerie d’environ 20 milliards d’euros à la fin de l’année 2016. Ces découverts seront financés par des émissions de court terme.
J’en viens maintenant aux principaux risques pesant sur la dette publique.
La trajectoire prévue dans le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une stabilisation du niveau de la dette publique aux alentours de 96,5 milliards à l’horizon 2016-2017.
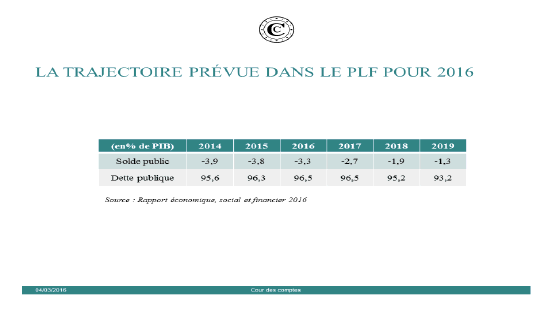
Le premier risque si cette trajectoire n’est pas suivie, c’est bien sûr de ne pas mener la réduction des déficits telle qu’elle est prévue. La Cour s’est exprimée sur ce point dans son rapport public annuel, en début d’année, et elle le refera au mois de juin. Je le disais : les phases de regain économique comme celui que nous connaissons actuellement, même s’il est modéré et fragile, ont historiquement correspondu à des phases de relâchement de l’effort budgétaire. Dans des pays comme l’Italie ou l’Espagne, on constate d’ailleurs qu’après des phases d’ajustement sévère et rapide des finances publiques, la réduction des déficits et l’effort sont moindres. Il y a donc un risque lié à la période.
Le déficit public devrait être de 3,3 % du PIB en 2016. Nous avons mis en évidence les risques qui s’attachent aux hypothèses macroéconomiques retenues – inflation, croissance, masse salariale – qui nous paraissaient un peu optimistes. Les informations qui nous sont parvenues depuis 2016 confirment plutôt nos inquiétudes : cela fait peser un risque sur les recettes de l’exercice 2016.
Du côté des dépenses, nous referons le point précisément, en juin 2016, à l’occasion du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. Le pari de la loi de finances pour 2016, c’est que les économies attendues sur la charge de la dette et les annulations de crédits de la réserve de précaution suffiront à compenser totalement les dépenses nouvelles décidées en fin d’année 2015 ou en début d’année 2016.
Voilà pour les risques à court terme.
Pour que le déficit se stabilise en 2017 par rapport à 2016, il faudrait que le solde public soit de 2,7 points de PIB. Il faudrait donc que l’objectif pour 2016 soit atteint, mais aussi que l’objectif pour 2017, qui prévoit une baisse du déficit public de 0,6 point de PIB, soit respecté. C’est à ces deux conditions que la dette se stabiliserait.
À moyen terme, il existe un risque de remontée des taux. Nous vivons une période particulière, exceptionnelle même, et dont personne ne sait combien de temps elle va durer : nos conditions de financement sont extraordinairement favorables. Les taux sont si bas, à court comme à moyen terme, que si l’encours de la dette de l’État a progressé de 70 % entre 2007 et 2015, la charge de la dette n’a progressé que de 7 %. Depuis 2012, la charge de la dette a même diminué.
Vous nous avez notamment interrogés sur la proportion d’encours de dette due à l’effet boule de neige. La France a peu pâti de ce phénomène, qui traduit le fait qu’à politiques données, toutes choses égales par ailleurs, lorsque le taux apparent de la dette, c’est-à-dire le taux moyen qui s’attache au stock de dette à un instant donné, est supérieur au taux de croissance de l’économie, alors le ratio entre la dette et le PIB se dégrade spontanément sous le seul effet du paiement des intérêts de la dette.
Nous avons calculé à partir des données de l’INSEE qu’au cours de la dernière décennie, l’effet boule de neige n’avait contribué à augmenter le poids de la dette par rapport au PIB que de 6 points de PIB sur un total de 30 points. Cet effet boule de neige devrait être quasiment nul en 2015 et en 2016, puisque le taux de croissance du PIB en valeur sera sans doute très proche du taux d’intérêt moyen sur la dette publique.
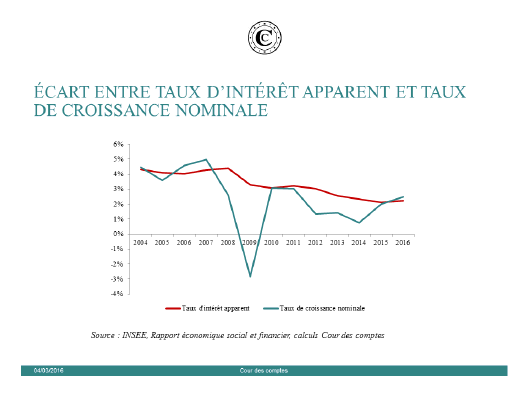
L’effet boule de neige n’explique donc l’augmentation de la dette depuis dix ans que pour un cinquième environ. En revanche, il pourrait devenir important en cas de remontée des taux. Au taux de 2007, c’est-à-dire avec un taux apparent de la dette de l’État de 4,5 % au lieu de 2,8 % actuellement, la charge de la dette en 2015 aurait été de 27 milliards supérieure à ce qu’elle a été : un retour au taux moyen d’avant la crise aurait représenté près de 1,5 point de PIB de dépenses supplémentaires, et donc, toutes choses égales par ailleurs, de déficit.
C’est une épée de Damoclès qui pèse sur nous à moyen terme.
Il faut aussi souligner que la trajectoire de notre dette publique diverge fortement par rapport à celle de la zone euro, de l’Union européenne, et plus nettement encore par rapport à celle de l’Allemagne : notre dette progresse de façon continue, même si cette augmentation s’est légèrement atténuée récemment, quand dans la zone euro, et dans l’Union européenne, ce poids de la dette commence à diminuer.
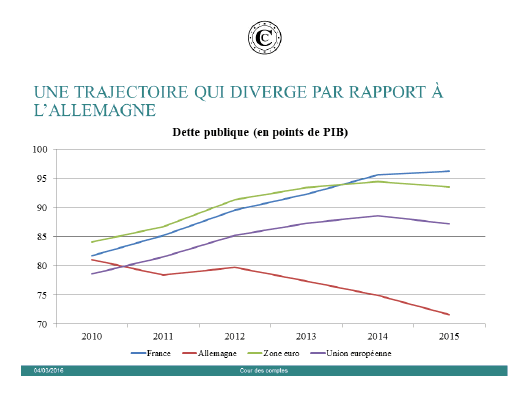
Il faut aussi avoir conscience que la perception des marchés peut devenir moins favorable pour nous qu’elle ne l’est aujourd’hui : la dette française reste considérée comme un actif sûr, ainsi qu’en attestent nos taux très bas. Mais elle représente aussi une part croissante de celle des États de la zone euro. La France est devenue le premier émetteur de dette : alors que nous représentions 19 % des émissions de moyen et long terme en zone euro en 2014, nous en représenterons selon l’Agence France Trésor 23 % en 2016. C’est la conséquence de l’inversion des courbes de la dette qui ne se constate pas pour la France.
Si cette tendance devait se poursuivre, l’Agence France Trésor serait sans doute amenée à devoir offrir des taux supérieurs pour placer la dette publique française.
Enfin, nos coûts de financement à dix ans demeurent très favorables.
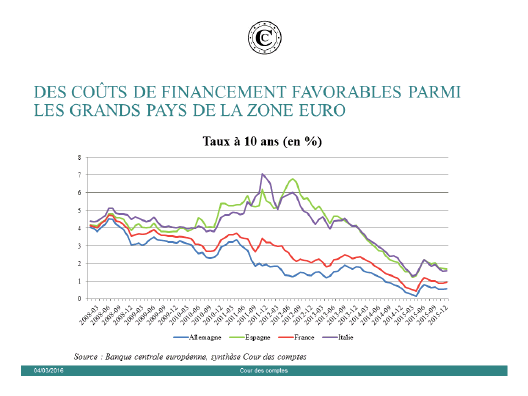
Toutefois, notre position relative est moins favorable qu’elle ne l’a été : elle demeure meilleure que celle de l’Espagne et de l’Italie, mais elle est moins favorable que celle de l’Allemagne. Si l’on laisse de côté ce dernier pays, on constate que la France se situe plutôt défavorablement par rapport au cœur de la zone euro – Autriche, Belgique, Finlande, Pays-Bas. Seule la Belgique a un niveau de taux légèrement plus élevé.
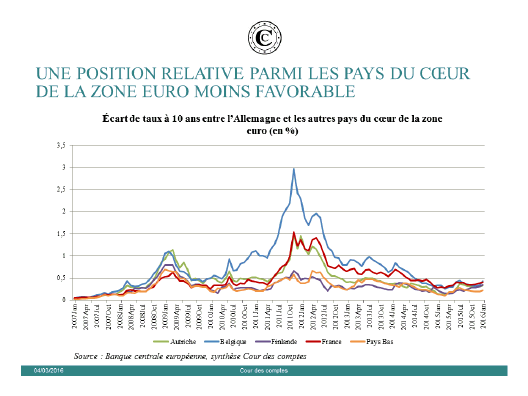
Notre situation est donc relativement fragile au regard de la perspective globale de remontée des taux.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Beaucoup de vos graphiques portent sur la période 2004-2015. C’est très court, notamment pour travailler sur l’effet boule de neige. Nous travaillons pour notre part sur la dette et sa construction depuis 1974 : l’effet boule de neige a eu, depuis quarante ans, des effets importants. La boule a beaucoup grossi à force de rouler…
Vous avez aussi dit que les périodes de croissance sont propices à un relâchement de l’effort, et notamment de l’effort fiscal. Nous en avons eu un exemple très clair avec la loi Travail, emploi, pouvoir d’achat (TEPA), ce que le président Gilles Carrez avait très bien expliqué dans son rapport de 2010. Pourriez-vous développer ce point ?
On connaît bien le discours ambiant sur les déficits et la dette : on dépense trop. Vous nous dites aussi qu’il y a un risque de taux. Mais, avec cette dette, il y a bien des gens qui gagnent de l’argent ! Même s’ils en gagnent peu parce que les taux sont bas, l’assiette est large, et au total cela fait des sommes élevées.
Enfin, l’Allemagne, d’un point de vue économique, pèse très lourd au sein de la zone euro : cela crée un biais méthodologique dans votre analyse, me semble-t-il.
M. Raoul Briet. S’agissant de la période, on pourrait évidemment remonter plus loin. Il faut néanmoins prendre en considération que la progression de la dette au cours de la période récente a été d’une intensité toute particulière. Il y a une véritable rupture, et une très forte accélération depuis 2008.
S’agissant de la comparaison avec différents pays, vous avez raison de signaler que le poids de l’Allemagne est important. Toutefois, il existe aujourd’hui un risque bien réel de divergence entre les dynamiques des dettes de la France et de ses voisins, même si on laisse de côté l’Allemagne. Et puis je continue à penser qu’il faut de temps en temps se comparer à l’Allemagne : si nous voulons peser au sein de l’Union européenne, il faut se comparer au plus fort !
S’agissant des baisses de recettes, j’ai cité les dernières périodes de forte croissance qui se sont accompagnées de baisses de recettes : les années 1998-2001, puis 2007-2008. Vous retrouverez toutes les données dans notre rapport annuel. Nous avons pris la mauvaise habitude de nous faire des illusions sur l’apport de la croissance au rééquilibrage des comptes : nous ne nous servons pas des périodes favorables pour améliorer nos comptes, et lorsque l’économie revient à son étiage précédent, nous retrouvons une situation dégradée. La Cour lance donc une mise en garde pour le futur.
Enfin, qui gagne ? C’est une question qu’il paraît aujourd’hui difficile de poser en ces termes : la dette est partagée par de très nombreux acteurs économiques, des épargnants français mais aussi du monde entier.
M. Éric Dubois, conseiller maître. Souvent, aujourd’hui, les taux offerts sont même négatifs, en France comme en Allemagne, en Suisse ou au Japon : les épargnants n’y gagnent plus, ils y perdent au contraire. Cette situation où des investisseurs acceptent de perdre de l’argent pour prêter aux États est tout à fait unique, en tout cas dans l’histoire des cinquante dernières années…
Mme Raphaëlle Eloy, rapporteure extérieure. Cette année, les taux courts de la France ont été négatifs toute l’année : cela a représenté des recettes de plusieurs centaines de millions d’euros.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Pourquoi des investisseurs acceptent-ils de perdre de l’argent ?
M. Raoul Briet. Si vous déposez de l’argent dans un coffre-fort, vous paierez la location du coffre, mais vous aurez la certitude d’y retrouver votre argent. De la même façon, ces investisseurs estiment qu’en achetant des titres émis par la France, ils pourront retrouver leur capital, moyennant des frais de garde. C’est pour eux une garantie. C’est une situation à tout le moins atypique, et guère rassurante sur le fond.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Le problème, c’est surtout que cela conduit beaucoup de nos concitoyens à penser que la dette ne coûte pas cher… Mais s’endetter pour payer du fonctionnement, c’est dangereux !
Avez-vous par ailleurs pu mesurer les conséquences des emprunts toxiques sur la dette des collectivités locales ? On doit commencer à voir des effets de ces contrats.
M. Raoul Briet. Sur ce point, il faut souligner que ces contrats structurés ont aussi, artificiellement et temporairement, réduit les charges financières de certaines collectivités. C’était un pari – certes, lorsque la conjoncture s’est retournée, c’est devenu très compliqué…
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Ils ont été bénéfiques pendant deux ans, ils seront nocifs pendant dix-huit !
M. Raoul Briet. Pour répondre précisément à votre question, nous n’avons pas mené d’étude particulière sur ce sujet. La première chambre de la Cour est en train d’achever un contrôle de la SFIL (Société de financement local), entité publique mise en place pour gérer la désensibilisation des prêts aux collectivités locales et pour intervenir dans le financement du secteur public local. Un rapport particulier sera donc rendu public prochainement, sans doute à la fin de ce semestre. Il se penchera sur la place qu’occupe aujourd’hui la SFIL : celle-ci a en effet été créée pour prendre la suite de Dexia, afin que les collectivités locales puissent continuer d’obtenir des crédits ; on craignait que les banques commerciales ne se retirent purement et simplement de ce secteur. Or ce n’est pas ce qui est arrivé, bien au contraire : les banques commerciales sont revenues, et la Caisse des dépôts est devenue un prêteur significatif aux collectivités locales, qui par ailleurs empruntent un peu moins. La place que la SFIL cherche à occuper, ou devrait occuper à moyen terme, doit donc être précisée.
M. Jean-Claude Buisine. Quels sont aujourd’hui les leviers possibles d’économies dans les dépenses publiques ?
M. Raoul Briet. On peut faire des économies partout, vous dirait le Premier Président de la Cour ! Nous essayons dans nos rapports, de repérer les pistes d’économies possibles. À mon sens, il faut faire porter les efforts partout, c’est-à-dire tant sur les transferts sociaux que sur les dépenses de l’État et des collectivités territoriales. Ce n’est pas un problème de gestion de chaque entité, mais bien un problème d’économie générale de notre système, de cohérence des différents acteurs publics intervenant sur de mêmes enjeux de politiques publiques.
Les leviers sont nombreux ; il faut prendre le risque de les actionner. C’est toute la question du choix politique.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La Cour s’est-elle penchée sur la question du solde primaire ? Autrement dit, quel serait notre solde si nous ne versions plus d’intérêts ? L’inflation est bien inférieure au taux moyen de 2,8 % que vous citiez : une différence de 1,8 point de PIB, ce n’est pas négligeable.
M. Éric Dubois. De mémoire, nous sommes depuis trente ans presque systématiquement en déficit primaire.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Non, nous étions en excédent entre 1997 et 2001, puis en 2006 et 2007 !
M. Raoul Briet. Absolument, mais ce sont les deux périodes qui ont été citées tout à l’heure.
M. Éric Dubois. Pour 2015, nous n’avons pas encore les résultats définitifs, mais nous serons en déficit primaire de 1,5 point de PIB environ.
Mme Raphaëlle Eloy, rapporteure extérieure. Pour ce qui est de l’État, nous disposons des chiffres définitifs : le déficit est de l’ordre de 70 milliards, et la charge de la dette de l’ordre de 42 milliards.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. La France doit sortir de sa situation de déficit. Bien sûr, il faudrait d’abord que la dette cesse de grossir – au moins par rapport au PIB.
Imaginons que nous voulions en revenir au niveau maximal de dette prévu par Maastricht, c’est-à-dire 60 % du PIB. On peut estimer – en mettant à part la dette sociale et la dette des collectivités, qui me paraissent relever d’un traitement différent – que nous avons une surcharge pondérale de l’ordre de 400 milliards. Il n’est pas nécessaire de penser réduire la dette à zéro : nous vivons tous avec des dettes, et notre pays peut être endetté, du moment qu’il peut rembourser… mais il y a un risque politique, et aussi un simple risque financier de retournement des taux, vous l’avez dit.
Est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions mettre ces 400 milliards de côté, dans une sorte de caisse d’amortissement de la dette de l’État ?
M. Raoul Briet. Une sorte d’équivalent de la CADES.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Absolument, avec une hausse de TVA de 2 points sur quinze ans qui permettrait de financer cet amortissement. Ne faisons pas payer nos erreurs à vos enfants ! Et nous respecterions ainsi nos engagements maastrichtiens, en essayant d’avoir des comptes à l’équilibre. C’est un mécanisme qui me paraît envisageable.
M. Raoul Briet. C’est le même raisonnement qui a été tenu pour la CADES, qui était conçue comme un dispositif provisoire, destiné à faire disparaître une dette qui n’avait pas lieu d’être. Malheureusement, le provisoire…
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. …est devenu définitif.
M. Raoul Briet. Disons durable. La CADES était destinée à rembourser une dette sociale considérée comme illégitime. Faudrait-il rassembler la dette de l’État et la dette sociale ? C’est une question qui est quelquefois posée. Mais la CADES permet, à mon sens, de rendre sensibles, visibles les déficits sociaux. Sans elle, les déficits sociaux apparaîtraient comme négligeables par rapport à l’ensemble des déficits publics et donc comme « normaux ».
Dès lors que la Cour est convaincue qu’il n’est pas normal, pas responsable, d’endetter les plus jeunes générations pour payer les soins de santé ou les retraites actuelles, il est préférable de maintenir la dette sociale à part, avec une affectation particulière.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Avec le mécanisme que je propose, on créerait une autre caisse pour les 400 milliards, et on augmenterait la TVA, sur le modèle de la CRDS. Il faut sortir de cette situation !
M. Nicolas Sansu, rapporteur. On peut se souvenir que l’impôt sur les grandes fortunes était censé payer le revenu minimum d’insertion… C’était aussi un fléchage d’un prélèvement pour financer une politique publique.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Encore avant, il y a eu la vignette automobile… Chacun peut avoir ses propositions. J’en avance une ici : on met la dette superflue dans une boîte, et on rembourse peu à peu en mettant un peu plus de côté. Ce n’est pas très différent du contrat que nous faisons tous les jours avec les locataires d’un logement social qui ne payent pas régulièrement leur loyer !
Il faudra bien inventer des mécanismes pour nous remettre en état.
M. Raoul Briet. Augmenter la TVA est un choix politique… À vrai dire, intégrer le produit de cette hausse au budget général, ou le flécher vers une caisse, serait une question de présentation plus que de contenu.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Ma proposition est de flécher clairement cette somme, justement pour éviter de refaire les mêmes erreurs.
M. Éric Dubois. On pourrait aussi craindre que le reste de la dette ne soit plus maîtrisé.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Écoutez, un jour, il faudra revenir à l’équilibre ! Tout le monde le dit. Il y a des groupes politiques qui proposent que l’État présente des comptes à l’équilibre – j’avais fait cette proposition en 2005, mais je n’ai pas eu beaucoup de succès…
Il y en a d’autres qui disent qu’il ne faut pas rembourser la dette ; d’autres encore qui disent qu’il faut sortir de l’euro pour retrouver l’inflation et la dévaluation… Voilà ce que proposent les extrêmes. Il y a peut-être des solutions plus modérées.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La TVA, qui est l’impôt le moins progressif, serait-elle vraiment le meilleur outil pour rembourser la dette ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Cette remarque est tout à fait idéologique.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La vôtre aussi, mon cher collègue. La TVA est le prélèvement le plus injuste qui soit, vous le savez comme moi.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Merci de vos interventions et de ces échanges.
——fpfp——