


| Accueil > Contrôle, évaluation, information > Les comptes rendus de la mission d’évaluation et de contrôle |
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Monsieur le directeur général, merci d’avoir répondu à notre sollicitation.
M. Anthony Requin, directeur général de l’Agence France Trésor (AFT). Merci de nous recevoir. Je commencerai par rappeler le panorama de la dette de l’État. La dette de l’État est incluse dans la dette publique, qui a atteint, d’après les données de l’INSEE, 96,9 % du PIB à la fin du troisième trimestre 2015, pour un montant total de 2 105 milliards d’euros. La dette de l’État s’élève à 1 671,6 milliards d’euros, soit presque 80 % de la dette publique. Pour le reste, les organismes divers d’administration centrale (ODAC) ont une dette de 22 milliards d’euros, les administrations publiques locales (APUL) de 184,6 milliards d’euros, et les administrations de sécurité sociale (ASSO) de 225 milliards d’euros.
Dans d’autres pays, la dette de l’État représente une part moindre de la dette publique. Ainsi, l’État fédéral allemand ne porte qu’environ 50 % de la dette totale.
Seule la dette négociable de l’État est gérée par l’Agence France Trésor.
Elle se répartit de la façon suivante : la dette à moyen terme nominale (obligations assimilables du Trésor, OAT, et bons du Trésor à intérêts annuels, BTAN) en représente 80,6 % ; la dette à court terme (bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés, BTF), c’est-à-dire à trois, six ou douze mois en représente 9 % ; enfin, le reste de la dette est indexée sur l’inflation, soit française – 4,4 % – soit européenne – 5,9 %.
Lors d’auditions précédentes, vous vous êtes demandés pourquoi les investisseurs, notamment les investisseurs étrangers, étaient intéressés par l’acquisition de titres de la dette française, malgré ce qui peut apparaître – c’est affaire de jugement – comme une dette publique élevée. Adoptons un instant le point de vue d’un investisseur qui doit placer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards d’euros : il se trouve confronté à un univers d’investissement où l’on trouve, notamment, les titres d’État des pays de l’OCDE, caractérisés par une certaine valeur de crédit et une certaine liquidité.
Ce graphique montre l’évolution, depuis le début des années 2000, de la dette publique de plusieurs pays en fonction de leur PIB.
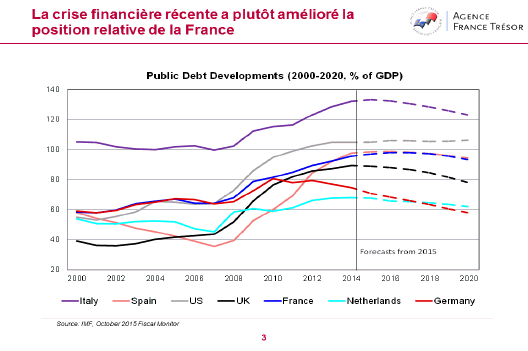
Il n’est pas évident que la situation relative de la France se soit détériorée au regard de ces indicateurs de finances publiques par rapport à certains de ses compétiteurs. Si on regarde la situation qui prévalait au début des années 2000, voire juste avant la crise aux États-Unis, au Royaume-Uni ou même en Espagne, on se rend compte que la situation de la France s’est relativement améliorée. Entre 2007 et 2015, la dette de la France a augmenté de 32 points de PIB ; elle a augmenté de 44 points de PIB au Royaume-Uni, de 43 points de PIB aux États-Unis, de 57 points de PIB au Japon. Il faut donc adopter une perspective plus large pour mieux juger de la situation française.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Nous ne sommes donc pas les plus mauvais…mais la dette devient une façon de vivre !
M. Anthony Requin. Les États ont subi en 2007-2008 un choc dont ils essayent de se remettre. La position relative de la France s’est améliorée par rapport à certains États, mais pas par rapport à l’Allemagne, par exemple. Ce graphique montre d’ailleurs la singularité de l’Allemagne, dont le ratio de dette par rapport au PIB a décru, et dont la position relative s’est beaucoup améliorée.
Les investisseurs regardent également le passé récent et l’avenir.
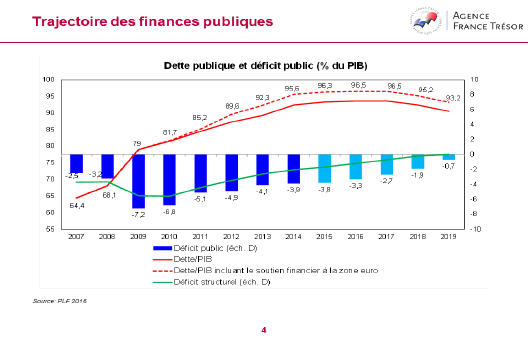
Il est frappant de constater que nous avons régulièrement, depuis 2009, réduit chaque année notre déficit rapporté au PIB – et ce quel que soit l’environnement d’inflation et de croissance. Le graphique montre également l’évolution de notre ratio entre dette et PIB, la ligne pointillée incorporant les engagements hors bilan pris par la France en garantissant les émissions obligataires effectuées par le Fonds européen de stabilité financière (FESF), c’est-à-dire le mécanisme financier mis en place par la zone euro pour aider les pays en difficulté – Irlande, Grèce, Portugal. Nous progressons chaque année de manière graduelle et nous devrions, en 2016, stabiliser ce ratio avant – nous l’espérons tous – d’entamer une décrue.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Pourquoi ce ratio devrait-il s’améliorer en 2017 ? Les années électorales sont-elles propices ?
M. Anthony Requin. Nous devrions voir en 2017 la poursuite de la réduction du déficit budgétaire, ainsi qu’un redémarrage de la croissance, qui devrait être de 1,5 % cette année. Les investisseurs valorisent cette évolution, la constance de ce chemin, la clarté de cette stratégie.
Je ne voudrais toutefois pas peindre devant vous une image trop rose. Nous entrons dans un moment crucial : L’histoire de la dette de la France sur les trente dernières années est celle d’une succession de chocs qui ont provoqué une augmentation de la dette ; à chaque fois, nous avons consenti des efforts pour la stabiliser, mais nous avons eu du mal à entamer un mouvement de réduction durable du ratio de dette par rapport au PIB.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. De quels chocs parlez-vous ?
M. Anthony Requin. Ce sont des chocs de croissance.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Ou plutôt de mécroissance !
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. En 1998, nous passons aux trente-cinq heures : la compensation des baisses de charge a représenté 300 milliards – qui ont alimenté le déficit, donc la dette ! Est-ce cela, un choc de croissance ?
M. Anthony Requin. Les moments où la France a quitté une situation de stabilisation du ratio de dette par rapport au PIB sont des moments où il y a eu des chocs de croissance, où il y a eu récession, où la croissance a dramatiquement diminué. S’ensuit une augmentation qui a un impact sur le déficit public qu’on essaie ensuite de réduire. Ces efforts permettent une stabilisation du ratio de dette par rapport au PIB, mais n’ont à ce jour pas été suffisants pour entamer une décrue avant que le prochain choc conjoncturel de cycle n’intervienne.
C’est ce que nous reprochent les agences de notation : par une maîtrise progressive de nos finances publiques nous arrivons à stabiliser une dérive, mais nous n’arrivons pas à l’infléchir. Ce qui est important pour leur analyse de crédit, c’est d’arriver à démontrer que l’on entame un mouvement durable de diminution du ratio de dette par rapport au PIB. Nous entrons aujourd’hui dans une phase très importante, puisque l’on devrait s’approcher en 2016-2017 du moment où le ratio dette sur PIB se stabilise ; il va falloir démontrer dans les années qui viennent notre capacité à diminuer ce ratio de manière durable.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Tout cela repose sur une hypothèse de déficit de – 0,7 % en 2019 : au vu des quarante dernières années, cela paraît impossible.
M. Anthony Requin. Ce qui importe, c’est la continuité dans l’effort.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. J’essaye de distinguer, dans votre graphique, la part de la projection, de celle du but recherché.
M. Anthony Requin. Les éléments de l’histogramme « déficit public » représentent le programme de stabilité déposé à Bruxelles par les autorités françaises en avril 2015.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Donc c’est un objectif. Pour analyser les risques sur la dette, nous allons vérifier si cet objectif tient ou pas.
M. Anthony Requin. Les investisseurs peuvent certes, comme vous, être dubitatifs sur l’avenir : mais nous pouvons montrer le chemin qui a été parcouru depuis 2009. Ce ne sont pas des projections, mais du réalisé.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Nous ne sommes toujours pas revenus à la situation de 2008. Or cette situation n’était déjà pas formidable. Je ne vois pas quels éléments structurels pourraient permettre, aujourd’hui, une diminution de la dette.
M. Anthony Requin. Les éléments structurels qui permettent à une dette de se stabiliser ou de diminuer sont doubles. Pour diminuer le ratio de la dette par rapport au PIB, il faut que le dénominateur – le PIB – augmente plus vite que le numérateur – la dette.
La première question que vous nous avez posée portait sur la justification de l’existence d’une agence autonome, ainsi que sur l’adéquation entre nos moyens et nos missions.
L’Agence France Trésor n’est pas une agence dotée de la personnalité morale ; c’est un service à compétence nationale, placée sous l’autorité du directeur général du Trésor et du ministre. Elle n’a donc pas ses comptes propres, elle fait partie intégrante de l’État. Elle a été créée pour donner de la visibilité, pour créer une marque reconnue par les investisseurs – ce qui est le cas. Il s’agissait aussi de lui donner une certaine autonomie dans les processus de marketing et de vente de la dette publique, dans un souci d’efficacité opérationnelle. Mais nous n’avons pas voulu couper les liens avec l’État et son insertion au sein du ministère des finances et de la Direction générale du Trésor, ainsi que nos liens avec la direction du Budget, avec la direction générale des Finances publiques, nous donnent accès à de nombreuses informations macro-économiques et budgétaires qui nous permettent d’apporter des réponses aux questions posées par les investisseurs.
L’AFT compte aujourd’hui 40 personnes, 18 femmes et 22 hommes, aux compétences et aux parcours très variés. Parmi ces personnes, il y a aujourd’hui 28 fonctionnaires, qui connaissent les processus financiers de l’État, et 12 contractuels, qui sont des professionnels des marchés. Nous avons une organisation sous forme de 8 cellules qui nous permettent de travailler opérationnellement avec efficacité.
Nous sommes assistés par un comité stratégique, dont vous avez reçu le président. Ce comité consultatif nous aide à tester des idées ; il nous permet d’avoir des échanges avec des professionnels de marché aux profils internationaux.
Quant aux moyens techniques, juridiques, matériels dont nous disposons, comme n’importe quel responsable d’administration publique on pourrait souhaiter naturellement en avoir davantage… Mais nous sommes très conscients des contraintes du secteur public, et j’estime que la qualité de notre personnel nous permet d’exercer notre mission correctement.
Votre deuxième question portait le processus d’adjudication. Vous vous demandiez si nous gagnions de l’argent sur le prix de vente aux enchères des titres de dette publique, et comment cet argent était employé.
Nous sommes, je l’ai dit, un service à compétence nationale : notre activité est retracée dans le programme 117 Charge de la dette et trésorerie de l’État et dans le compte de commerce Gestion de la dette et trésorerie de l’État, ainsi qu’à titre subsidiaire dans le compte de commerce Couverture des risques financiers de l’État. Nous ne disposons pas de budget propre, ni de compte de résultat : nous ne pouvons donc pas gagner de l’argent pour nous-mêmes ; tous nos gains reviennent au contribuable en moindre charge d’intérêt de la dette.
Une troisième question portait sur l’intérêt de connaître avec précision la base des investisseurs de la dette publique française. Vous nous demandiez également des précisions sur les territoires à partir desquels il était possible d’opérer pour acquérir de la dette française.
La connaissance précise de l’ensemble des détenteurs de la dette française serait une information intéressante bien sûr. Il serait cependant très difficile d’en avoir une photographie exacte à un moment donné : la dette française s’échange sur le marché secondaire, et change donc de mains de jour en jour. Ces transactions sont importantes : 10 milliards d’euros par jour, 3 600 milliards par an – chiffres à comparer à celui du stock, qui est de 1 600 milliards.
De plus, une obligation de déclaration qui s’imposerait aux détenteurs de dette française, et uniquement à eux, nous ferait prendre un risque car ce serait un désavantage compétitif par rapport aux autres États si une telle obligation ne s’appliquait pas à eux. Les investisseurs, en effet, n’aiment pas dévoiler leurs positions sur le marché, pour des raisons dont certaines me semblent légitimes.
Ainsi, beaucoup de nos investisseurs sont des banques centrales, qui doivent placer des réserves de change et souhaitent disposer d’actifs sûrs et liquides. Mais les banques centrales peuvent aussi, parfois, être amenées à réaliser des transactions dans le cadre de leur politique de change, donc à vendre des quantités de titres importantes. Elles font partie du secteur public d’un État étranger : de telles transactions massives pourraient les placer en position inconfortable vis-à-vis des pays émetteurs, car cela pourrait être interprété comme un signal négatif, un geste de défiance.
Quant aux investisseurs privés – assureurs, fonds de pension… – ils ne souhaitent pas dévoiler au marché, à tout moment, leurs positions. Ce serait pour eux un risque, car les marchés connaissent les règles de diversification et de prise de risque : ils pourraient donc savoir, dans certaines configurations de marché, quand ces investisseurs vont être obligés de vendre certains titres. La publication de leurs positions pourrait donc se retourner contre eux.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je peux entendre ce que vous dites sur la transparence, même si je ne peux pas être entièrement d’accord. Mais notre question portait principalement sur les paradis fiscaux. N’est-il pas surréaliste de prétendre lutter contre ceux-ci tout en acceptant qu’ils achètent des titres de dette souveraine – qui alimentent ainsi « une grande lessiveuse » ? Il y a là, je crois, un vrai problème.
D’autre part, des études, en particulier celle de Sandy Brian Hager sur les États-Unis, montrent que la dette est de plus en plus massivement détenue par le fameux « 1 % ». Une telle concentration se vérifie-t-elle en France ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Une telle concentration – aux mains d’une seule banque étrangère, ou d’un seul État – n’est-elle d’ailleurs pas risquée ?
M. Anthony Requin. Ce sont là d’excellentes questions. S’agissant des paradis fiscaux, des politiques sont en effet engagées pour lutter contre les territoires non coopératifs, mais chaque État demeure souverain dans la définition de sa fiscalité. Pour pouvoir acquérir de la dette française, il faut avoir un compte titre auprès d’un dépositaire, d’un conservateur de titres. Concrètement, certains fonds situés dans des paradis fiscaux achètent certainement des titres obligataires, mais ce sont des cheminements très difficiles à repérer : il peut y avoir des chaînes d’actions successives pour acquérir des titres de dette française – chaînes qu’il est extrêmement difficile de remonter. Il faut être conscient de cette limite.
Pour autant, nous disposons de sources d’information sur notre base d’investisseurs : nous avons quelques données « dures », et d’autres plus « molles ». Tout d’abord, nous disposons des statistiques de la balance des paiements, transmises par la Banque de France. Nous savons ainsi que 38 % environ de la base des investisseurs est située en France, ce qui nous place à peu près au même niveau que l’Allemagne.
Un rapport parlementaire a déjà pointé que, parmi ces 63 % de non-résidents, certains sont sans doute des Français qui détiennent des comptes à l’étranger. Mais l’image globale est certainement bonne.
Je souligne que le taux de détention de la dette publique par des non-résidents est légèrement inférieur au taux de détention de la dette de l’État : la dette de l’État est la plus liquide, et son crédit est plus élevé. C’est donc celle vers laquelle se portent prioritairement les grands investisseurs.
Par ailleurs, le FMI effectue régulièrement un sondage auprès des investisseurs, le Coordinated Portfolio Investment Survey, afin de déterminer notamment la nationalité de ceux qui détiennent des titres financiers. De cette enquête, on peut tirer qu’environ 50 % des non-résidents qui détiennent de la dette – toutes dettes confondues, car ce sondage ne concerne pas la seule dette publique – sont situés en zone euro. Si l’on fait l’hypothèse qu’il n’y a pas de forte différence de proportions entre la détention de dette publique et de dette privée – bancaire ou d’entreprise –, on peut déduire que parmi ces 63 % d’investisseurs non-résidents, la moitié réside en zone euro.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Il y a parfois des incongruités : en 2011, Patrick Artus expliquait que le deuxième pays détenteur de dette française était les Îles Caïmans…
M. Anthony Requin. Je ne sais pas d’où viennent ces données et je n’ai pas cet article en tête. En revanche, je confirme qu’il existe des incongruités : les analyses qu’essaye de mener le Trésor américain sur sa base d’investisseurs montrent que la Belgique détient des
quantités de dette américaine étonnantes. Cela s’explique par le fait que la Belgique est le siège d’Euroclear, organisme de dépôt et de règlement-livraison par lequel transitent un certain nombre de comptes. Mais derrière Euroclear il y a probablement des comptes-titres qui sont mouvementés depuis d’autres pays.
De l’analyse du FMI, on peut déduire que la dette est répartie entre un tiers d’investisseurs résidents, un tiers en zone euro et un tiers hors zone euro. L’euro étant notre monnaie : on peut considérer que nous avons deux tiers d’investisseurs résidents dans notre propre zone.
Ce graphique montre l’évolution des catégories d’investisseurs.
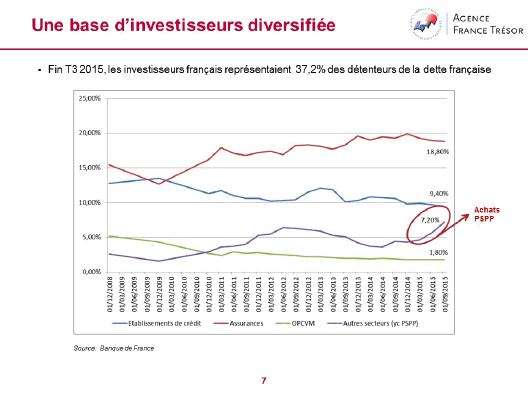
Tout instrument de mesure a ses limites, mais notre dette étant importante, on peut se fier à la loi des grands nombres… Ce qui nous intéresse comme émetteurs, ce n’est en effet pas de savoir si tel ou tel investisseur précis détient des titres de dette française mais de comprendre les grands mouvements de marché qui peuvent se produire. Pourquoi, par exemple, un grand investisseur décide-t-il de vendre ? Faut-il voir là le signe d’une défiance, la conséquence d’une évolution de la réglementation… ? C’est ce type d’information qui a de la valeur pour nous en tant qu’émetteur.
Cette base est relativement stable, même si l’on voit monter en puissance sur le schéma les « autres secteurs », c’est-à-dire le secteur public, qui comprend la Caisse des dépôts et consignations et la Banque de France. Cette montée en puissance est une conséquence de la politique d’assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne (BCE), qui s’opère par l’intermédiaire de la Banque de France (Public Sector Purchase Programme, PSPP).
Nous disposons également de données plus « molles », au sens où elles ne sont pas auditées. Nous ne les présentons donc pas publiquement. Elles proviennent de nos spécialistes en valeur du Trésor (SVT), ceux qui achètent lors de nos adjudications, pour revendre ensuite ces titres aux investisseurs sur le marché secondaire. Ils ont obligation de nous communiquer – c’est une règle de reporting commune aux États de la zone euro – leurs opérations d’achat et de vente, soit entre SVT, soit avec des investisseurs finaux, par type de maturité et par pays ou groupe de pays… Pour les pays de l’OCDE à l’exception du Japon, nous pouvons connaître les types d’acheteurs par pays – assureurs, trésoreries de banques, asset managers, gestion alternative… Parfois, nous avons ces données par groupe de pays. Il faut donc mixer ces données pour avoir de l’information.
De ces statistiques, nous pouvons déduire que par le passé, environ la moitié des flux de dette française étaient absorbés par les banques centrales et les entités du secteur public, c’est-à-dire les fonds souverains. C’est plutôt quelque chose dont il faut se réjouir.
Les banques centrales, qui ont au cours de la dernière décennie augmenté leurs réserves de change, souhaitent se diversifier en achetant des titres de dette française – elles ne veulent pas investir toutes leurs réserves de change dans une seule monnaie, par exemple le dollar. Cette volonté constitue, je le souligne, une bonne nouvelle : les banques centrales sont des investisseurs caractérisés par une relative insensibilité aux prix, mais aussi par une grande stabilité. Malgré les taux bas, elles continuent donc d’acheter de la dette française, comme des titres des autres grands pays bien notés de la zone euro.
Vous nous demandiez également si la faiblesse des taux d’intérêt actuels ne devait pas nous amener à renégocier de larges stocks de dette déjà existants à des conditions plus favorables. Vous souhaitiez savoir si nous pouvions profiter des taux bas pour allonger la maturité moyenne de la dette.
M. Jean-Pierre Gorges. C’est après tout ce que font les ménages : ils renégocient leurs emprunts.
M. Anthony Requin. Nous sommes un émetteur régulier et prévisible, deux caractéristiques très appréciées des investisseurs. Nous publions en fin d’année, à la suite du vote de la loi de finances, le programme de financement de l’État à moyen et long terme. Ce programme repose sur l’autorisation accordée par le Parlement. Pour les années 2015 et 2016, nous nous engageons à émettre jusqu’à 187 milliards d’euros nets des rachats sur les marchés.
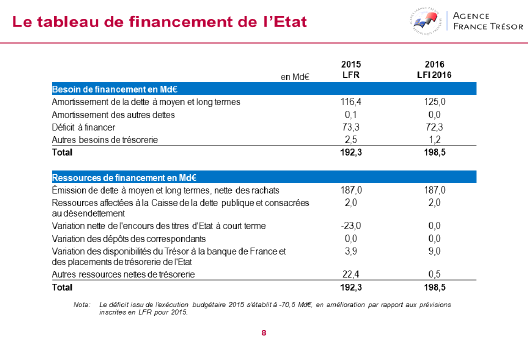
La taille de la dette nous impose de revenir régulièrement sur le marché. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d’être excessivement opportunistes, c’est-à-dire de surprendre le marché par de brusques à-coups dans notre politique d’émission : cela ne ferait que rendre les taux volatils. Nous communiquons donc un programme en amont, autant que nous le pouvons, et nous essayons de nous y tenir.
Nous ne renégocions pas de larges stocks de dette. En revanche, nous refinançons les tombées de dette en profitant des conditions d’emprunt actuelles : 116 milliards en 2015, et 125 milliards en 2016. C’est cette partie de la dette que nous allons refinancer en profitant de la baisse des taux qui est intervenue sur les titres qui viennent à maturité. Évidemment nous bénéficions de gains de refinancement.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Autrement dit, nous ne décidons plus rien… Si nous étions un État souverain, nous pourrions remettre toute notre dette en jeu pour essayer de gagner le plus possible. Cela pose un vrai problème de soumission au marché ! On est aujourd’hui à 2,6-2,7 de taux moyen. Je ne comprends pas qu’on n’ait pas décidé d’aller encore plus bas et de renégocier davantage dans l’intérêt du pays.
M. Anthony Requin. Nous essayons d’agir au mieux, en tenant compte de nos marges de manœuvre. Lorsque l’on regarde une courbe des taux, on raisonne en deux dimensions : la maturité, et le taux. Mais il y a une troisième dimension, qui nous échappe habituellement : c’est la profondeur de marché. Or celle-ci n’est pas infinie sur tous les points de la courbe : tous les investisseurs ne sont pas intéressés par tous les points de la courbe.
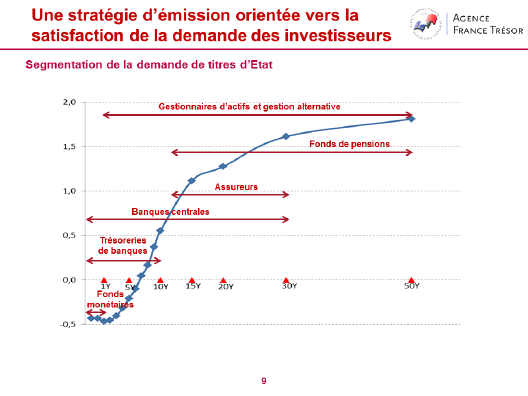
Ce graphique montre les différences entre les groupes d’investisseurs. Il permet de constater que très peu d’investisseurs sont intéressés par des titres à trente ou cinquante ans, hormis quelques entités de gestion alternative – les hedge funds – et des fonds de pensions. Ces derniers sont les seuls vrais investisseurs de long terme : les fonds de gestion alternative achètent et vendent souvent, pour essayer de faire des profits…
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Je complète ma question : cette renégociation de la dette pourrait aller de pair avec une renationalisation, ou une européanisation de la dette.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. En quoi le fait que sa dette soit détenue de façon importante par des non-résidents peut-il être gênant pour un pays, notamment pour sa sécurité ? Est-ce différent pour des résidents de la zone euro – qui ont donc la même monnaie que nous – et pour des résidents hors zone euro ?
M. Anthony Requin. Pour des raisons de profondeur de marché, nous ne pouvons pas – même pour profiter d’un moment où les taux sont particulièrement bas – émettre des quantités illimitées de titres à 30, 40 ou 50 ans. De plus, si nous devions racheter d’énormes quantités de dette émise précédemment, nous le ferions au cours de ces dettes au jour du rachat. Il n’y aurait donc pas de gain important : certes, nous pourrions racheter de la dette pour ré-émettre à taux bas, mais nous rachèterions cette dette à un prix beaucoup plus élevé. En taux actuariel, ce serait neutre, nous ne serions donc pas gagnants.
Notre objectif est de demeurer un émetteur régulier et transparent. Nous évitons de créer des embardées qui provoqueraient de brusques variations de notre courbe de taux – ce que les investisseurs n’aiment pas. Nous nous efforçons donc de lisser le profil d’amortissement. Nous effectuons parfois, pour cette raison, des rachats par anticipation de titres que nous n’émettons plus. On les voit sur ce graphique.
Pour l’année 2015, nous avions obtenu du Parlement l’autorisation d’émettre pour 187 milliards d’euros de dette, nette des rachats, et nous avons effectué des émissions brutes pour 220 milliards d’euros. Nous avons effectué 33 milliards de rachats, afin que notre programme en 2016 soit comparable à celui de l’année 2015.
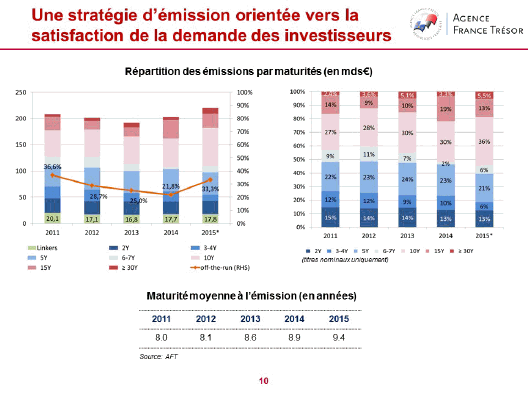
Nous avons donc tiré avantage des taux très bas, puisque nous avons sécurisé, pour une durée moyenne de 9,4 années, 220 milliards de dette à un taux historiquement bas de 0,63 % en moyenne.
Si nous avons pu le faire, c’est d’abord parce qu’il existe une demande du marché pour les titres de la dette française. Notre programme d’exécution régulier mois par mois se déroulait de façon satisfaisante : nous étions un peu en avance, et nous avons pu en profiter pour racheter un peu plus de titres et donc allonger la maturité moyenne à l’émission, parce que la demande était là. Inversement, au cours de la première partie de l’année 2015, les taux étaient très bas : les investisseurs finaux – assureurs, gestionnaires de fonds… – ne voulaient pas acheter nos titres à moyen et long terme à taux faible ou négatif. Ils ne sont revenus sur le marché qu’après le double mouvement de hausse des taux intervenu en avril et en mai. Ils étaient alors prêts à revenir acheter de la dette française pour des maturités un peu plus longues, à 10 ans, 15 ans. Si nous avions émis un surcroît de dette à maturité longue au premier trimestre 2015, l’absence de demande aurait provoqué un envol des taux ; c’est à partir du mois de juin, lorsque la demande telle qu’elle nous était rapportée par nos SVT est revenue, que nous avons pu émettre des titres longs. Et, à la fin de l’année 2015, la maturité moyenne d’émission était supérieure à celle de l’année 2014. Voilà comment nous nous efforçons de tirer avantage des taux bas ; mais nous ne pouvons pas forcer le marché à absorber des titres dont il ne voudrait pas.
En quoi le fait que la dette soit concentrée entre les mains de quelques investisseurs, voire d’un seul, est-il un problème ? Tout d’abord, les informations dont nous disposons nous laissent penser que cette situation n’est pas la nôtre : je ne pense pas qu’on puisse imaginer qu’un seul investisseur puisse détenir plus de 20 % de la dette française.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Cela ferait beaucoup.
M. Anthony Requin. Les banques centrales peuvent devoir placer des montants vraiment importants… Il faut surtout souligner qu’à la différence d’un actionnaire, un détenteur de titres obligataires est dépourvu du moindre moyen d’action sur la conduite de la politique de l’émetteur. Un actionnaire vote lors des assemblées générales ; il peut influer sur la vie de l’entreprise. Un détenteur obligataire ne peut que voter avec ses pieds – cesser d’acheter.
Nous sommes très désireux de disposer d’une base d’investisseurs aussi large et aussi diversifiée que possible. C’est une manière de nous protéger contre des chocs idiosyncratiques, des chocs qui affecteraient une catégorie particulière d’émetteurs ou un type particulier de pays. Ainsi, cette année, la chute des prix du pétrole entraîne une diminution des achats en provenance du Moyen-Orient : il est probable que les intérêts que nous payons et les amortissements que nous versons ne sont pas réinvestis en dette française, mais plutôt transférés vers les budgets nationaux. Fort heureusement, nous ne dépendons pas de cette seule catégorie d’investisseurs : si cela avait été le cas, nous aurions été à court d’acheteurs et les taux auraient fortement augmenté.
La diversité, à la fois géographique et catégorielle, est ce qui nous protège le plus efficacement contre ce type de chocs. C’est une chose importante, recherchée – par les autres pays comme par le nôtre : ainsi, l’Allemagne bénéficie d’un niveau semblable de diversification.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. La question des échecs du passé se pose : comment réinternaliser la dette ? Est-il imaginable de recréer un circuit du Trésor à l’échelle européenne qui permettrait qu’une part de la dette soit détenue en direct par des particuliers ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Inversement, une renationalisation de la dette ne nous conduirait-elle pas à payer notre argent plus cher que ce que permet aujourd’hui le marché ?
M. Anthony Requin. Il existe un marché structuré des OAT aux particuliers : ceux-ci peuvent, via Euronext, acquérir des titres d’État. Les SVT ont l’obligation de leur proposer des cotations. Mais en raison de la faiblesse des taux d’intérêt, les particuliers ne sont plus intéressés par ces titres. Ce n’est pas propre à la France : notre homologue, la Deutsche Finanzagentur, a pendant des années géré des comptes-titres de particuliers ; mais elle a fermé ce service en 2012, car il n’y avait plus de demande.
Les Français détiennent, il faut le souligner, beaucoup de dette française, mais pas en direct – via l’assurance-vie, les comptes bancaires, le livret A… qui apportent aussi une diversification des risques.
Les dernières opérations d’émissions directes vers les particuliers que j’ai en tête remontent aux années 2012 : elles ont été effectuées par le Trésor belge, EDF, le Crédit foncier de France sur des titres à 5 ans. Ils offraient en général des taux supérieurs de 150 à 200 points de base supérieurs à ceux proposés par l’État au même moment. Pour attirer les particuliers, il faut un certain niveau de rendement : aujourd’hui, cela se traduirait effectivement pour nous par une augmentation de la charge de la dette.
Vous nous avez également interrogés sur les risques pesant sur la dette publique française en cas de remontée des taux d’intérêt.
Nous publions, au titre de la justification au premier euro du programme 117, une analyse de sensibilité.
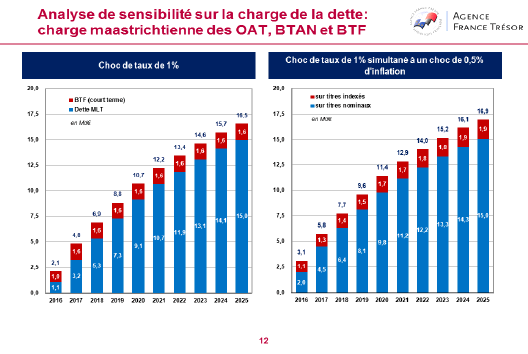
Ce graphique montre ce qui se produirait en cas de hausse brutale des taux de 100 points de base – dans le second cas, avec un choc simultané d’inflation de 0,5 %. Les conséquences sur la charge de la dette seraient d’abord modérées, puis augmenteraient progressivement.
Ce type de graphique a souvent un effet anxiogène : les conditions de taux actuelles sont très satisfaisantes, puisqu’elles nous permettent de stabiliser, voire de commencer à diminuer la charge de la dette, mais combien de temps cela durera-t-il ? Quand les taux se normaliseront, n’allons-nous pas faire face à une charge de la dette qui ne sera plus tenable ?
Ces inquiétudes sont parfois quelque peu excessives. Certes, un choc de taux peut être un choc de crédit : le marché, les agences de notation, les investisseurs cessent tout à coup de vous faire confiance, et ce qui se traduit par une hausse des taux de 100 points de base représentative d’une appréciation à la hausse du risque de crédit. Cela, effectivement, c’est dangereux. Mais un choc de taux peut aussi refléter un redémarrage de la croissance, et une anticipation d’inflation à la hausse : ce serait alors un choc positif, qui produirait sur les recettes fiscales un effet bien plus favorable que l’augmentation de la charge de la dette qui en résulterait. Nous serions, cette fois, gagnants.
Se focaliser seulement sur la charge de la dette est donc une erreur de raisonnement, une forme de myopie : il faut s’intéresser aussi aux recettes fiscales qui dépendent de la croissance et de l’inflation, nous avons plus à y gagner qu’à perdre. Au total, le choc est positif.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Vous supposez une relation entre croissance et inflation.
M. Anthony Requin. Historiquement, elle se vérifie plutôt, en tout cas sur plusieurs années. Cette année, nous avons eu une croissance plus forte mais sans redémarrage de l’inflation. Mais plusieurs années de croissance arriveraient sans doute à tendre les capacités de production, voire le marché du travail – ce que nous souhaitons tous : il y aurait alors probablement une augmentation des salaires et donc de l’inflation. Il faut aussi compter avec l’état du marché des matières premières.
M. Nicolas Sansu, rapporteur : Nous pourrons faire figurer dans le rapport ce graphique très clair. Il y a en effet beaucoup de fantasmes et d’idées fausses autour du choc de taux. Il y a une erreur grossière. Beaucoup de gens pensent que l’ensemble de la dette verrait ses taux augmenter d’un point, et que l’on paierait 16 milliards de plus dès la première année. C’est une aberration, mais c’est mieux qu’on puisse le dire clairement.
M. Anthony Requin. Il faut surtout souligner la nécessité de regarder, parallèlement, l’évolution des recettes fiscales de l’État. Le résultat peut être positif pour notre économie. Je ne veux pas être lénifiant : certains chocs de taux sont néfastes. Un choc de crédit ferait ainsi augmenter la charge de la dette, sans avoir le moindre effet positif sur les recettes fiscales.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Pouvez-vous nous dire quelques mots du programme de rachat d’actifs de la BCE ? N’y a-t-il pas un risque de bulle obligataire ?
M. Anthony Requin. Il est encore un peu tôt pour dresser le bilan du programme d’assouplissement quantitatif de la BCE : la politique monétaire accommodante remonte à plusieurs années, mais le programme d’achats de titres à grande échelle n’a encore qu’un an – il y a eu un décalage avec d’autres banques centrales qui ont entamé ce mouvement depuis plusieurs années. Cette politique semble avoir été efficace aux États-Unis, où la politique de quantitative easing a été mise en place dès 2008 : l’inflation de base y est maintenant proche de 2 %, voire légèrement supérieure. Tous les espoirs sont donc permis.
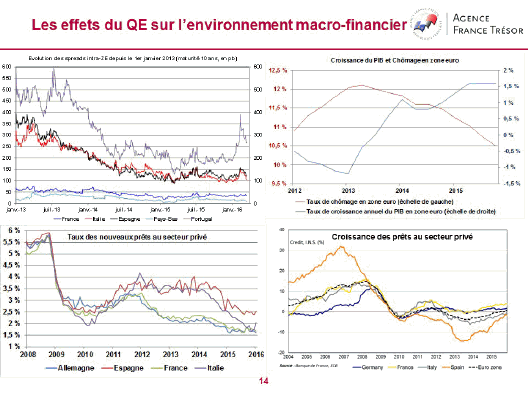
J’ajoute que l’on constate déjà des effets positifs de cette politique. Tout d’abord, la fragmentation financière au sein de la zone euro s’est réduite : on observe les conséquences de ce phénomène sur les dettes gouvernementales. Les taux, mais aussi les écarts de taux, se sont réduits.
On constate également une reconvergence des taux auxquels empruntent les entreprises quel que soit leur lieu d’établissement. C’est un phénomène sain pour la zone euro. On observe encore un redémarrage de la croissance, ainsi qu’une diminution du taux de chômage agrégé au sein de la zone euro. Le programme d’assouplissement quantitatif semble donc bien soutenir la croissance. Celle-ci se traduit enfin par une augmentation des prêts au secteur privé, alors que l’encours de prêts avait diminué dans certains pays.
Quant au risque de bulle obligataire, la BCE y est très attentive. Il y a bien une augmentation de la valorisation des actifs financiers, mais elle ne semble pas déconnectée de l’évolution de l’économie générale. L’augmentation de la valeur des titres obligataires est une conséquence directe de la baisse des taux d’intérêt. En ce qui concerne les actions, la hausse de la croissance et la dépréciation de l’euro peuvent avoir des effets sur les bénéfices des entreprises : la hausse du cours des actions peut donc tout à fait traduire une anticipation d’amélioration des résultats des entreprises. Il n’est donc à mon sens pas nécessaire à ce stade de s’inquiéter du risque de bulle financière.
M. Nicolas Sansu. Merci de ces explications. Je vais vous poser une dernière question : l’AFT est unanimement considérée comme l’une des meilleures agences de gestion de la dette au monde mais j’ai aussi l’impression que vous entretenez une certaine connivence avec le monde de la banque et des marchés financiers.
Les hauts fonctionnaires ne peuvent normalement pas être embauchés par une entreprise privée sans passer par un « sas de décontamination ». Qu’en est-il pour l’AFT, dont la directrice adjointe vient de rejoindre une grande banque française ?
M. Anthony Requin. Les fonctionnaires de l’AFT sont soumis, comme tous les autres fonctionnaires de l’État, à l’obligation de passer devant la Commission de déontologie de la fonction publique, qui émet un avis favorable ou défavorable – avis qui peut s’accompagner de restrictions des contacts que l’agent qui s’en va peut, ou pas, continuer d’avoir avec l’AFT.
Dans le cas que vous citez, ce départ s’est fait non pas vers une banque qui ferait partie des SVT mais vers une structure actionnariale de cette banque. La jurisprudence de la Commission de déontologie avait déjà autorisé par le passé à deux reprises des fonctionnaires du Trésor à occuper des fonctions dans cette association, la Fédération nationale du Crédit Agricole. Cette entité joue un rôle d’actionnaire représentant les banques régionales auprès de la société Crédit Agricole SA.
Je ne connais évidemment pas la nature des débats de la commission, et il s’agit d’affaires privées, comme vous le savez. Il me semble que ce cas particulier est conforme à la jurisprudence de la Commission de déontologie. En revanche, vous ne trouverez pas, je crois, de fonctionnaire de l’AFT qui ait rejoint un SVT.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Il fallait bien que je vous pose la question.
M. Anthony Requin. C’est une question parfaitement légitime, et que je vous remercie d’avoir posée – si vous ne l’aviez pas fait, d’autres auraient continué de se la poser.
M. Nicolas Sansu, rapporteur. Merci de cet échange très intéressant.
——fpfp——