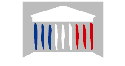______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 avril 2015
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 11 décembre 2013 (1)
sur les enjeux écologiques, économiques et géopolitiques du changement climatique en Arctique et en Antarctique
Président
M. HervÉ GAYMARD
Rapporteur
m. Noël MAMÈRE
Députés
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur l’Arctique et l’Antarctique est composée de : M. Hervé Gaymard, président ; M. Noël Mamère, rapporteur ; M. Jean-Luc Bleunven, M. Michel Destot, M. Philippe Gomes, Mme Chantal Guittet, Mme Françoise Imbert, M. Pierre Lellouche et M. Lionnel Luca.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 11
PREMIÈRE PARTIE : LA CATASTROPHE CLIMATIQUE ET ÉCOLOGIQUE QUI MENACE LES PÔLES 15
I. UN CHANGEMENT CLIMATIQUE PLUS RAPIDE ET PLUS VIOLENT DANS LES RÉGIONS POLAIRES 17
A. UNE HAUSSE DES TEMPÉRATURES PARTICULIÈREMENT FORTE 17
1. Des spécificités qui expliquent le réchauffement accéléré des régions polaires 18
2. Un réchauffement des régions polaires qui rétroagit sur le réchauffement général 20
B. LA FONTE ACCÉLÉRÉE DES GLACES 21
1. La glace de mer arctique 22
2. L’inlandsis groenlandais 24
3. Les glaciers de l’Antarctique 24
4. Les conséquences sur la circulation océanique 25
C. L’IMPACT ACCRU DE L’ACIDIFICATION 26
II. UNE FRAGILITÉ ÉCOLOGIQUE PLUS GRANDE DANS LES RÉGIONS POLAIRES 27
A. DES ÉCOSYSTÈMES STRUCTURELLEMENT FRAGILES 27
B. DES ÉCOSYSTÈMES PARTICULIÈREMENT SENSIBLES AUX POLLUTIONS 29
C. L’IMPOSSIBILITÉ DE TRAITER UN ACCIDENT ÉCOLOGIQUE MAJEUR DANS LES RÉGIONS POLAIRES 31
III. LA MISE EN CAUSE DES MODES DE VIE TRADITIONNELS DES PEUPLES DE L’ARCTIQUE 31
IV. CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE : LA CONFÉRENCE PARIS-CLIMAT 2015, SI ELLE RÉUSSIT, SERA PROBABLEMENT POUR L’ARCTIQUE L’ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT DE LA DÉCENNIE 33
DEUXIÈME PARTIE : L’ANTARCTIQUE, UN STATUT À PRÉSERVER 35
I. LE DERNIER « BOUT DU MONDE » 35
A. LE CONTINENT ANTARCTIQUE, TERRE DES EXTRÊMES 35
1. Des conditions exceptionnellement dures 35
2. Une exploration tardive 36
B. OCÉAN AUSTRAL ET ÎLES SUBANTARCTIQUES, UN ESPACE MARITIME LARGEMENT PRÉSERVÉ 37
II. UNE REMARQUABLE COOPÉRATION INTERNATIONALE, TANT INSTITUTIONNELLE QUE PRATIQUE 39
A. UN ENSEMBLE COORDONNÉ D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX 39
B. LE POINT DE DÉPART : INTERNATIONALISATION ET DÉMILITARISATION 40
1. Les revendications territoriales du début du XXème siècle 40
2. L’élaboration du Traité sur l’Antarctique 42
3. Le cœur du Traité sur l’Antarctique : coopération scientifique, démilitarisation et gel des revendications territoriales 44
C. UNE PRIORITÉ À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE QUI A PLEINEMENT PORTÉ SES FRUITS 45
1. Les opportunités uniques offertes par l’Antarctique à la science 45
2. De multiples coopérations internationales 47
D. UNE DIMENSION ENVIRONNEMENTALE PROGRESSIVEMENT RENFORCÉE 47
1. La Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique 48
2. La Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique 48
3. Le Protocole de Madrid : l’Antarctique dédiée à la science et mise à l’abri de toute exploitation minière 49
III. UN DISPOSITIF MENACÉ ? 51
1. Les principales ressources halieutiques des eaux antarctiques 52
2. Les aires marines protégées, une réponse nécessaire mais qui a du mal à s’imposer 53
C. LES VELLÉITÉS D’EXPLOITATION DES RESSOURCES DU SOUS-SOL 54
D. LES LIMITES DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL ACTUEL 55
TROISIÈME PARTIE : L’ARCTIQUE, UN STATUT À CONSTRUIRE 57
I. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES : UNE NOUVELLE « RUÉE VERS L’OR » ? 57
A. LES PERSPECTIVES DE LA PÊCHE : À LA POURSUITE DES STOCKS HALIEUTIQUES 58
B. LES HYDROCARBURES : UN POTENTIEL THÉORIQUE ÉNORME, MAIS UNE EXPLOITATION ENCORE LIMITÉE 60
C. LES AUTRES RESSOURCES MINIÈRES : UNE EXPLOITATION ANCIENNE MAIS EN DENTS DE SCIE 63
D. DE NOUVELLES VOIES MARITIMES ? 65
E. LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 69
II. UNE GOUVERNANCE EN DEVENIR 69
A. DES ENJEUX MILITAIRES QUI PARAISSENT APPARTENIR PLUTÔT AU PASSÉ 69
B. UN ESPACE MARITIME, DONC AVANT TOUT RÉGI PAR LE DROIT DE LA MER 70
1. La convention des Nations-Unies sur le droit de la mer de 1982 et ses limites 70
a. Les principales dispositions de la convention de Montego Bay 70
b. Un cadre imparfait qui laisse place à l’affrontement des souverainetés et des appétits économiques 71
i. Le différend sur le statut des passages du Nord-Ouest et du Nord-Est 72
ii. Les problèmes de délimitation des eaux territoriales et zones économiques exclusives 72
iii. La complexité de la définition du plateau continental et la « course au pôle Nord » qui en résulte 73
c. Une prise en compte limitée des spécificités de l’Arctique 79
2. Le développement d’instruments spécifiques de gestion des espaces marins 80
a. Les organisations régionales de gestion de la pêche 80
b. La convention OSPAR 84
c. Le Code polaire 87
C. LA MISE EN PLACE RÉCENTE D’UNE FORME DE GOUVERNANCE RÉGIONALE 88
1. Le Conseil arctique 88
2. Les instances ne concernant qu’une partie de l’Arctique 92
a. Le Conseil nordique 92
b. Le Conseil des États de la mer Baltique 92
c. La Région euro-arctique de Barents 92
d. Les réunions à cinq des États côtiers de l’océan Arctique 93
3. Les résultats et les limites des institutions arctiques mises en place 93
III. LES POSITIONS DE NOS PARTENAIRES 97
A. LES MEMBRES DU CONSEIL ARCTIQUE 97
1. La Norvège 97
a. L’Arctique, « priorité n° 1 » d’une diplomatie norvégienne pour laquelle une protection efficace doit reposer sur l’articulation de juridictions nationales solides et de la coopération internationale 98
i. L’Arctique, élément primordial de l’identité norvégienne 98
ii. L’Arctique perçu comme un espace de développement économique 99
iii. Une position d’ouverture à la coopération internationale, pourvu qu’elle soit pragmatique 100
iv. Un souci constant de conserver sur les sujets arctiques de bonnes relations avec la Russie 101
b. Le statut particulier du Svalbard 102
i. Le traité de Paris : un régime de souveraineté encadrée 103
ii. Un régime juridique jusqu’à présent factuellement protecteur, bien que fragile 104
c. Ny-Ålesund, village scientifique international 106
2. La Finlande et la Suède 108
3. L’Islande 109
a. Un « porte-avions » pour les intérêts asiatiques dans l’Arctique ? 109
b. Une revendication non satisfaite : se voir reconnaître le statut d’État côtier de l’océan Arctique 109
c. En conséquence, la promotion d’une coopération « ouverte » : The Arctic Circle 110
4. Le Danemark 111
a. Les interrogations sur l’avenir politique et économique du Groenland 111
b. Une revendication audacieuse sur le pôle Nord 113
5. Le Canada 113
a. L’Arctique canadien : une population peu nombreuse, des intérêts économiques qu’il ne faut pas surestimer 113
b. Le contraste entre un volontarisme politique affirmé et des moyens modestes 115
c. Des revendications de souveraineté ambitieuses 116
d. Une position défavorable à toute ingérence des États tiers dans la gestion des problèmes de l’Arctique 117
6. Les États-Unis 117
a. Des intérêts significatifs en Arctique 117
b. Mais aussi une politique active de préservation de l’environnement 118
c. Une présence militaire et scientifique traditionnellement forte 119
d. Cependant, une priorisation limitée de l’Arctique 119
e. Une approche coopérative des problèmes de l’Arctique 120
7. La Russie 121
a. Des enjeux économiques vitaux 121
b. Une présence massive 123
c. Une priorité affichée à l’Arctique 124
d. Mais une politique entravée par plusieurs contradictions 125
B. LES AUTRES ÉTATS ET ORGANISATIONS 127
1. L’Union européenne 127
a. Une légitimité incontestable à avoir une politique arctique 127
b. Mais des prises de position qui ont handicapé l’insertion de l’Union dans la gouvernance arctique 128
c. Aujourd’hui, une volonté de rattraper le temps perdu 130
2. Les principaux partenaires européens 131
a. Le Royaume-Uni 132
b. L’Allemagne 133
3. Les pays asiatiques 133
a. La Chine 134
b. Les autres pays asiatiques 135
QUATRIÈME PARTIE : LA PRÉSENCE FORTE DE LA FRANCE PRÈS DES DEUX PÔLES JUSTIFIE UN ENGAGEMENT PARTICULIER DE NOTRE PAYS POUR PROTÉGER L’ARCTIQUE 137
I. UNE INFLUENCE FONDÉE SUR DES POSITIONS FORTES 137
A. UNE TRADITION ANCIENNE DANS L’EXPLORATION ET LA RECHERCHE POLAIRES 137
B. UN POSITIONNEMENT EXCEPTIONNEL DANS L’ANTARCTIQUE ET LE SUBANTARCTIQUE 138
1. Les Terres australes et antarctiques françaises, un atout exceptionnel 138
a. Les districts des Terres australes et antarctiques françaises 139
b. Un point commun : l’absence de population permanente 140
c. Des enjeux écologiques et scientifiques majeurs 142
d. Les enjeux de souveraineté et économiques 143
i. Le différend avec Maurice sur Tromelin 144
ii. Le différend avec Madagascar sur les îles du canal du Mozambique 145
iii. Les enjeux économiques 146
2. L’administration des Terres australes et antarctiques françaises 147
a. Les moyens de la collectivité des TAAF 147
b. Une problématique majeure pour les TAAF : les moyens permettant d’assurer le ravitaillement des districts et les missions de souveraineté 148
3. Le rôle de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor 150
C. L’ARCTIQUE : UNE PRÉSENCE PLUS MODESTE ET UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE INCERTAINE 151
1. La recherche arctique française : de beaux résultats, malgré une structuration et des moyens faibles 151
a. Une présence plus modeste de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor 152
b. Le Chantier arctique : une volonté fédératrice en manque de moyens 152
c. Le sentiment général : un manque de structuration et de moyens qui perdure pour notre recherche arctique 154
2. Des moyens également limités pour notre diplomatie arctique 155
3. Une présence économique significative 156
4. Des enjeux stratégiques 157
II. LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION 158
A. L’ANTARCTIQUE 158
1. Mobiliser les opinions publiques pour préserver l’Antarctique de l’exploitation économique 158
2. Préserver les nécessaires outils de souveraineté dans les mers australes 158
3. Maintenir une priorité absolue à la préservation de la biodiversité exceptionnelle des îles australes françaises 159
B. L’ARCTIQUE 160
1. Clarifier nos positions en les rendant publiques et en affirmant une priorité claire à l’environnement 160
2. Renforcer et mieux structurer notre présence dans la recherche arctique et notre présence humaine institutionnelle en Arctique 160
3. Inscrire la question du changement climatique en Arctique au cœur de la Conférence Paris-climat 2015 163
4. Trouver les moyens d’une meilleure protection de l’Arctique 163
a. Le Traité sur l’Antarctique, modèle impossible à transposer ? 164
b. Soutenir la démarche pragmatique de l’Union européenne : la reconnaissance du rôle primordial du Conseil arctique doit s’accompagner d’un haut niveau d’exigence sur le contenu des politiques 164
c. Encourager les États arctiques à cogérer et protéger de l’exploitation économique la partie centrale de l’océan Arctique 165
d. Mettre le droit international, notamment celui de la mer, au service de la protection de l’Arctique et expertiser la possibilité de lui conférer la qualité de patrimoine naturel mondial ou de bien public mondial 166
i. La possibilité d’étendre en Arctique la juridiction des organisations régionales existantes ? 166
ii. La perspective de la négociation sur le statut de la haute mer dans le cadre de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer 167
iii. Les opportunités offertes par la Convention sur la diversité biologique 169
iv. La possibilité de mobiliser le dispositif du « patrimoine mondial » de l’Unesco 169
v. La notion de « bien public mondial » 170
PROPOSITIONS DE LA MISSION 173
TRAVAUX DE LA COMMISSION 177
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES PAR LA MISSION 187
Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques années, l’Arctique est « à la mode », car le changement climatique qui y est dramatiquement rapide suscite deux types d’intérêts bien différents :
– d’une part, les préoccupations des défenseurs de l’environnement quant aux effets d’un réchauffement très violent (deux fois plus marqué au moins que la moyenne mondiale) sur des écosystèmes très fragiles, sans oublier les effets de la pollution et les risques d’accident écologique majeur ;
– d’autre part, les appétits économiques sur les « opportunités » ouvertes par le changement climatique et la fonte de la banquise : hydrocarbures, pêche, tourisme, nouvelles routes maritimes… Un hebdomadaire titrait récemment : « À la poursuite du trésor de l’Arctique » (1).
Disons-le tout de suite, autant les menaces écologiques sont réelles et graves en Arctique, autant les perspectives d’exploitation économique accrue y restent assez incertaines pour toutes sortes de raisons. Sans doute faudrait-il se rappeler que les régions du grand nord ont déjà connu d’autres « ruées vers l’or » avec des lendemains qui déchantent, comme celle du Klondike à la fin du XIXème siècle, qui a fait quelques millionnaires, mais bien plus de morts de froid et de faim parmi les apprentis prospecteurs.
*
Le présent rapport ne traite pas seulement de l’Arctique, mais aussi de l’Antarctique : deux espaces très éloignés géographiquement, situés aux antipodes l’un de l’autre, mais qui ont plus de connexions que l’on ne pense en général. Leurs liens sont illustrés par un animal étonnant, la sterne arctique : cet oiseau qui pèse une centaine de grammes en moyenne migre tous les ans d’un pôle à l’autre ; pour ce faire, il parcourt jusqu’à 80 000 kilomètres par an ; au passage, il s’alimente dans tous les plans d’eau du monde, où il est exposé à toutes nos pollutions qu’il transporte ensuite dans les régions polaires. La vie de la sterne est une démonstration parfaite de l’interdépendance entre tous les milieux naturels de notre planète.
Plus généralement, il est particulièrement intéressant d’analyser la symétrie entre les deux pôles : quelles sont les similitudes entre eux et quelles sont au contraire les symétries au sens mathématique, c’est-à-dire les situations d’inversion ?
En fait, on se rend vite compte que les symétries inversées sont les plus nombreuses. Certes, les deux pôles ont en commun l’alternance de jours et de nuits polaires de six mois et un soleil, quand il est présent, toujours rasant sur l’horizon, d’où bien sûr les grands froids qui leur sont communs. Mais, pour le reste, il faut surtout être conscient d’une symétrie inversée géographique qui a des effets déterminants :
– le pôle Sud est au centre d’un vaste continent, l’Antarctique, entouré d’un espace marin gigantesque, l’océan Austral, qui le place à plusieurs milliers de kilomètres des autres continents ;
– a contrario, le pôle Nord est au centre d’un espace marin, l’océan Arctique, entouré par les masses continentales de l’Eurasie et de l’Amérique du Nord.
Cette opposition des géographies physiques a d’abord une conséquence climatique : la masse continentale de l’Antarctique y a permis la constitution d’une énorme calotte glaciaire de plusieurs kilomètres d’épaisseur, laquelle fait de la région le véritable « pôle du froid » – on y a enregistré 89 degrés Celsius en dessous de zéro et même estimé par télédétection un record à moins 93 degrés ! – et la dote d’une inertie exceptionnelle face aux évolutions climatiques. De fait, seule une partie de l’Antarctique est aujourd’hui touchée par le réchauffement climatique et la superficie de la banquise de mer qui l’entoure est stable. C’est l’inverse en Arctique, où les températures moyennes ont partout augmenté depuis quelques décennies, généralement de l’ordre de 2 degrés, et où la glace de mer va probablement disparaître en été d’ici quelques décennies.
Cette opposition physique entraîne aussi des situations complétement différentes en termes de géographie humaine et politique :
– compte tenu de son isolement et de l’extrême dureté des conditions climatiques qui y règnent, le continent Antarctique n’a été atteint par les hommes que très tardivement (sans doute en 1820 pour la première fois) et, aujourd’hui encore, ses seuls « habitants », pas vraiment « permanents », sont quelques milliers d’occupants des bases scientifiques. En revanche, les pourtours de l’Arctique sont peuplés depuis des milliers d’années par des peuples traditionnels dont les descendants sont aujourd’hui environ 500 000, parmi les 4 millions de personnes vivant au-delà du cercle polaire. Car, par ailleurs, les terres à la périphérie de l’océan Arctique ont également connu une colonisation d’origine européenne ;
– colonisées, les côtes de l’océan Arctique appartiennent à des États qui ont en commun d’être solides, développés, dotés des moyens d’assurer leur souveraineté sur leur territoire, voire sont souvent des « grandes puissances » – deux d’entre eux, les États-Unis et la Russie, sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations-Unies ; un troisième, le Canada, appartient avec eux au G8… Pour ces États, l’Arctique a toujours été une périphérie, l’essentiel de leur population étant localisée bien plus au sud, et une frontière de colonisation, d’où, généralement, un vif attachement à leur souveraineté dans la zone et une priorité à l’exploitation de ses ressources économiques. Cet état de fait a aussi pour conséquence que l’Arctique apparaît surtout comme la somme d’espaces nationaux périphériques, de sorte qu’il a du mal à exister en tant que « région géopolitique », a fortiori à devenir le lieu d’une forme d’intégration régionale. Pour certains des États (certes pas tous) qui sont possessionnés dans l’Arctique, donc « arctiques », cette dimension est, malgré la présence d’un intérêt national direct (du fait d’une emprise territoriale), assez secondaire dans les priorités de leur politique : c’est le cas des États-Unis en particulier, sans doute aussi dans une certaine mesure du Danemark.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les formes de coopération, gouvernance ou cogestion internationales que l’on a pu mettre en place dans les deux aires soient très différentes :
– en Antarctique, la communauté internationale a su créer, suite à la signature du Traité sur l’Antarctique de 1959, l’un des systèmes de gouvernance internationale les plus ambitieux et protecteurs de l’environnement. Ce dispositif interdit l’exploitation des ressources minérales, encadre la pêche et le tourisme, et consacre l’Antarctique aux activités scientifiques. Il oblige à la plus grande transparence et à la concertation sur les activités des différents pays, ce qui permet de dépasser complétement les souverainetés nationales revendiquées sur des parties du continent ;
– en Arctique, les terres émergées, qui sont à la périphérie, relèvent exclusivement des différentes souverainetés nationales, tandis que la partie centrale, étant océanique, relève principalement du droit international de la mer, lequel laisse une place limitée à la responsabilité commune des nations malgré les tentatives faites pour affirmer celle-ci. En effet, ce droit consacre surtout des prérogatives exclusives des États dans leurs eaux côtières, entendues au sens large (jusqu’à 200 milles marins, soit 370 kilomètres, voire à certains points de vue 350 milles, soit 648 kilomètres, même si la souveraineté étatique au sens plein ne s’applique que sur une bande beaucoup plus étroite) et, pour la « haute mer » située au-delà, un régime de liberté de naviguer mais aussi de pêcher sans en rendre compte.
Par ailleurs, une forme de coopération régionale s’est développée entre les États arctiques, en particulier dans le cadre du Conseil arctique créé en 1996, mais cette instance intergouvernementale, dont le fonctionnement repose sur le consensus et sur la diffusion de bonnes pratiques plutôt que sur l’édiction de règles de « droit dur », ne peut pas être comparée à des institutions régionales plus intégrées telles que l’Union européenne, même si ses réalisations ne sont pas négligeables.
*
Alors que de nombreux ouvrages très documentés sont aujourd’hui consacrés aux questions politiques concernant les régions polaires, en particulier arctiques, par des écrivains, des chercheurs, des think tank (2), et aussi, déjà, des parlementaires, avec les excellents rapports d’information du sénateur André Gattolin sur la politique européenne vis-à-vis de l’Arctique et sur le Groenland (3), le présent travail, en mettant en parallèle les situations de l’Arctique et de l’Antarctique, a un double objet.
Il s’agit d’abord de mettre en lumière l’extrême gravité des conséquences du changement climatique, dû aux activités humaines, dans les régions polaires, en particulier en Arctique. Cette gravité justifie que tout soit fait pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique et de l’acidification des mers, et plus généralement les pollutions. Dans cette optique, on peut affirmer qu’une réussite de la prochaine Conférence Paris-climat 2015, ou COP 21, serait un événement bien plus important pour l’avenir de l’Arctique que tout ce qui pourrait être décidé dans un cadre régional ou pour ce seul cadre régional.
Il s’agit ensuite de s’interroger sur la manière dont notre pays peut agir pour conforter le remarquable dispositif de cogestion internationale qui existe en Antarctique et pour rendre plus exigeante et plus protectrice la gouvernance commune qui devrait être son pendant en Arctique. À cet égard, si, pour des raisons politiques, il apparaît très difficile de transposer à l’Arctique le modèle de l’Antarctique, il faut rechercher des voies intermédiaires pour améliorer l’existant. La France peut contribuer à cette amélioration, notamment en s’appuyant sur son implication scientifique et économique en Arctique, à la condition de bien prendre en compte le fait qu’elle n’est pas un État arctique : nous sommes possessionnés en Antarctique et dans les mers australes, mais pas dans l’Arctique. Comme l’ont fait les États arctiques et la plupart des autres pays impliqués en Arctique, notre pays va prochainement rendre public un document gouvernemental définissant sa stratégie pour l’Arctique, dit Feuille de route nationale pour l’Arctique.
Votre rapporteur espère qu’avec le présent rapport l’Assemblée nationale pourra apporter son concours à ces deux exercices majeurs des mois prochains que sont la présentation de la Feuille de route nationale pour l’Arctique et plus encore la Conférence Paris-climat 2015.
PREMIÈRE PARTIE : LA CATASTROPHE CLIMATIQUE ET ÉCOLOGIQUE QUI MENACE LES PÔLES
Depuis qu’a été constitué en 1988 le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), celui-ci n’a cessé, au fil de ses rapports successifs, de confirmer ses prévisions pessimistes en les affinant et en renforçant leur degré de probabilité. Ces rapports établissent le lien entre l’évolution du climat et les émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2 provenant de l’utilisation des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel). Ils constatent la nécessité d’en limiter drastiquement le volume pour maintenir à 2°C le niveau de l’augmentation de la température terrestre par rapport à l’ère préindustrielle, niveau permettant de limiter les bouleversements et d’éviter que les changements ne deviennent incontrôlables.
Le changement climatique global (au niveau de la planète) est une réalité de plus en plus incontestable, n’en déplaise aux climato-sceptiques, même si le GIEC se garde et se gardera toujours d’afficher des certitudes absolues, mais seulement des probabilités (de plus en plus grandes) : c’est le propre d’une démarche scientifique et c’est donc ce qui fonde la crédibilité de cette institution.
Dans son dernier rapport, le cinquième, qui vient d’être publié, le GIEC évalue à 0,85 degré Celsius le réchauffement global de la planète au cours de la période 1880-2012. Il estime également que le réchauffement supplémentaire pour la période 2016-2035, comparé à la période 1986-2005, sera « probablement » compris entre 0,3 °C et 0,7 °C. L’évolution ultérieure est évidemment beaucoup plus incertaine, d’autant qu’aux marges d’erreur scientifiques s’ajoute l’incertitude fondamentale sur l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l’humanité sera en mesure de faire ; on rappellera donc simplement que dans les hypothèses les plus pessimistes, le réchauffement pourrait devenir cataclysmique et excéder 5 °C, voire 6 °C, à la fin du XXIème siècle.
L’évidence du réchauffement climatique s’impose d’ailleurs à nous au constat que, depuis qu’il existe des relevés fiables, depuis 1900, l’année 2014 a été en moyenne en France la plus chaude jamais observée, avec une température moyenne supérieure de 1,2 °C à la normale, devant deux autres années très récentes, 2011 et 2003. Ce constat vaut d’ailleurs aussi pour l’ensemble de l’Europe. Enfin, à l’échelle terrestre, l’Organisation météorologique mondiale indique que la température moyenne de l’air à la surface du globe a en 2014 dépassé de près de 0,57 °C la moyenne de référence (années 1961-1990), ce qui en fait l’année la plus chaude jamais observée, légèrement devant deux autres années récentes, 2010 et 2005.
Même si la variabilité intrinsèque des climats, qui ont toujours connu des fluctuations, complique les analyses, le GIEC (toujours dans son cinquième rapport) confirme sa quasi-certitude sur les causes de ce réchauffement : « il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXème siècle » (4).
Le GIEC confirme enfin la montée du niveau des mers : entre 1901 et 2010, le niveau moyen des mers à l’échelle du globe s’est élevé de 19 centimètres. Cette élévation apparaît en accélération constante : alors que sur tout le XXème siècle, elle a été, on le voit, inférieure en moyenne à 2 millimètres par an, elle semble avoir atteint un rythme moyen de 3,2 millimètres par an entre 1993 et 2010. D’ici à la fin du XXIème siècle, ce niveau devrait croître encore de 20 centimètres à 1 mètre selon les différents scénarios.
Les effets catastrophiques du dérèglement climatique se font déjà sentir, non seulement pour les écosystèmes, mais aussi pour les populations humaines : d’après le dernier rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés (5), 22 millions de personnes ont dû abandonner leur domicile en 2013 à la suite d’une catastrophe naturelle, généralement climatique, soit trois fois plus que de personnes déplacées à cause d’un conflit.
De plus, la hausse de la teneur de l’atmosphère en dioxyde de carbone (CO2) a d’autres conséquences qui renforcent les effets néfastes de l’effet de serre, en particulier dans les mers. On constate ainsi :
– une acidification, du fait de la dissolution accrue de CO2 dans les eaux marines, elle-même liée à l’élévation du taux de CO2 atmosphérique – l’acidité relative (pH) des océans aurait atteint un niveau sans précédent dans les soixante derniers millions d’années ;
– une baisse de la teneur des eaux en oxygène dissous, qui résulte tout à la fois de leur réchauffement, de leur acidification et des apports de produits azotés et phosphatés (provenant notamment des engrais et des déjections) par les rivières.
Le cumul des trois effets de réchauffement, d’acidification et de désoxygénation des mers aggrave considérablement les impacts sur la vie marine. L’acidification, en particulier, entrave le développement des exosquelettes des animaux marins et de certaines micro-algues (coquillages, coraux, mais aussi coccolithophores, qui sont un constituant essentiel du plancton…), voire les détruit.
Or, tous ces effets sont aggravés dans les régions polaires, où, de surcroît, les écosystèmes seront également déstabilisés par l’apport accru d’eau douce (fonte glaciaire, précipitations plus abondantes), donc la désalinisation relative des milieux marins.
I. UN CHANGEMENT CLIMATIQUE PLUS RAPIDE ET PLUS VIOLENT DANS LES RÉGIONS POLAIRES
A. UNE HAUSSE DES TEMPÉRATURES PARTICULIÈREMENT FORTE
La carte ci-après, élaborée par le Goddard Institute for Space Studies (GISS), qui dépend de la NASA, représente l’« anomalie », c’est-à-dire l’écart de la température moyenne constatée sur 2008-2012 par rapport à la moyenne des températures sur la période 1951-1980. En 2012, la température moyenne de la planète a globalement été, selon le GISS, de 0,6 °C supérieure à celle de la période de référence susmentionnée – donnée qui est en ligne avec celles du GIEC. Mais on voit bien que la carte ci-après que ce réchauffement est inégalement réparti :
– il concerne plus les masses continentales que l’atmosphère au-dessus des océans, qui jouent leur traditionnel rôle modérateur ;
– surtout, il est particulièrement marqué, de l’ordre de 2 °C, sur à peu près l’intégralité des régions arctiques – le réchauffement y apparaît donc environ trois fois plus fort que la moyenne mondiale !
– en revanche, la situation est plus contrastée en Antarctique, où coexistent des zones de fort réchauffement, comme la péninsule Antarctique, mais aussi des zones où l’on observe même un refroidissement (qui peut être une conséquence induite du dérèglement climatique général). C’est ainsi que l’accès à la base française de terre Adélie, Dumont d’Urville, est récemment devenu très difficile du fait d’une poussé des glaces.
La différence entre les températures moyennes de 2008-2012 et celles de 1951-1980
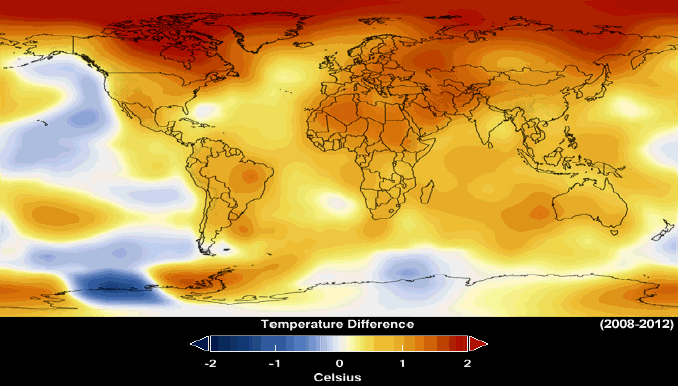
Source : NASA (http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-temps.html).
De nombreuses observations locales confirment ces observations générales. Ainsi, à Ny-Ålesund, village scientifique de l’archipel du Svalbard où votre président et votre rapporteur se sont rendus, le réchauffement a effectivement été d’environ 2 °C depuis quarante ans.
S’agissant de l’Antarctique, le réchauffement rapide de sa partie occidentale a fait l’objet d’une étude publiée fin 2012 dans la revue Nature Geoscience (6), d’où il ressort que la température moyenne y aurait augmenté d’environ 2,4 °C de 1958 à 2010. Mais ce réchauffement ne concerne qu’une partie du continent.
Dans la plupart des régions arctiques et certaines parties de l’Antarctique, le réchauffement constaté jusqu’à présent apparaît donc, étant de l’ordre de 2 °C, deux, voire trois fois plus fort que le réchauffement moyen de la Terre.
Les modèles climatiques confirment cet effet d’amplification du réchauffement dans les régions polaires, surtout arctiques. Cela signifie que si l’on devait gagner globalement, au niveau de la Terre, 5 °C d’ici la fin du siècle en cours (ce qui est prédit dans l’hypothèse où ne ferions aucun effort pour maîtriser les émissions de gaz à effet de serre), en Arctique, c’est peut-être sur 10 °C supplémentaires qu’il faudrait compter. Pour comparaison, en termes de températures moyennes annuelles, 10 °C correspondent à peu près à la différence entre les climats actuels de Naples et de Stockholm…
1. Des spécificités qui expliquent le réchauffement accéléré des régions polaires
Le fait que le réchauffement climatique concerne particulièrement les régions polaires, et spécialement celles de l’Arctique, s’expliquerait, selon les scientifiques, par plusieurs facteurs :
– il y a d’abord la vigueur inégale, selon les zones climatiques, des mouvements de convection, c’est-à-dire de circulation verticale de l’atmosphère. Dans les zones déjà chaudes, par exemple tropicales, le réchauffement climatique accroît ces mouvements, ce qui augmente en conséquence le brassage entre les différentes couches d’air et donc la répartition de la chaleur supplémentaire entre elles. En revanche, dans les régions polaires, les mouvements de convection restent faibles, car le réchauffement climatique ne conduit quand même pas à des températures susceptibles de les enclencher, et donc le gain de chaleur reste plus concentré dans les basses couches de l’atmosphère ;
– il y a surtout l’effet d’albédo. L’albédo mesure le pouvoir réfléchissant d’une surface, soit le rapport de l’énergie lumineuse réfléchie à l’énergie lumineuse reçue. Un albédo élevé, proche de 1, signifie qu’une surface renvoie vers l’espace l’essentiel de l’énergie solaire qu’elle reçoit et n’en absorbe qu’une faible part. Si l’albédo est faible, en revanche, une part plus grande de l’énergie solaire est absorbée, contribuant ainsi au réchauffement général. Les albédos les plus élevés sont atteint par les surfaces claires et réfléchissantes : un miroir parfait a un albédo de 1, tandis que l’albédo de la neige fraîche peut atteindre 0,9 – elle n’absorbe alors que 10 % de l’énergie solaire. A contrario, des surfaces sombres comme celles de l’eau libre, d’une forêt ou d’un sol foncé ont des albédos inférieurs à 0,15 – au moins 85 % de l’énergie solaire est recyclée en chaleur.
Le graphique qui suit applique ce raisonnement sur l’albédo au cas concret de l’océan Arctique et sa banquise.
L’effet d’albédo illustré (par l’océan Arctique et sa banquise au nord de l’Alaska)
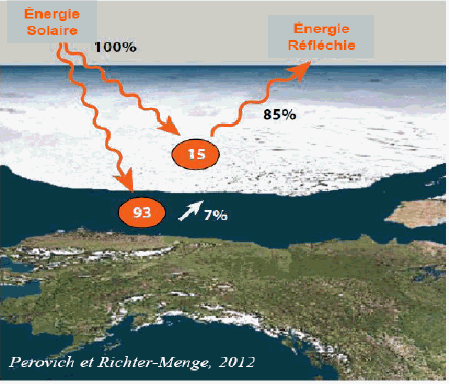
Source : « Les glaces marines arctiques », par Marie-Noëlle Houssais, CNRS-Laboratoire d’océanographie et du climat (LOCEAN-IPSL), Université Pierre et Marie Curie, Paris.
L’absorption de l’énergie solaire est donc directement liée aux superficies qui sont couvertes de neige ou de glace (qui a un albédo intermédiaire, souvent de l’ordre de 0,6) : quand ces surfaces reculent, une plus grande part de l’énergie solaire est absorbée par la planète, contribuant à son réchauffement. Il y a donc un effet cumulatif : le réchauffement climatique réduit les surfaces enneigées ou englacées, ce qui conduit par la réduction de l’albédo à un réchauffement accru.
Cet effet d’albédo est une explication possible des différences que l’on trouve entre l’Arctique, concerné par un réchauffement général massif, et l’Antarctique, où la situation est globalement moins désastreuse : alors que l’Arctique est principalement constitué de mers, couvertes par une mince banquise qui est en recul rapide (voir infra), d’où un changement tout aussi rapide de l’albédo, le continent Antarctique reste (et restera sauf changement climatique gigantesque) une énorme masse glacée.
Il faut également noter que la dégradation de l’albédo dans les régions polaires est accentuée par le phénomène de « carbone noir » : on constate le dépôt croissant de poussières de combustion – de la suie…– provenant pour une certaine part d’activités locales (circulations des navires au fuel), mais surtout de la pollution générale diffuse. Ces poussières noires, quand elles se déposent sur de la neige ou de la glace, en modifient l’albédo en augmentant l’absorption de l’énergie solaire.
2. Un réchauffement des régions polaires qui rétroagit sur le réchauffement général
À son tour, le réchauffement accéléré d’une grande part des régions polaires contribue et est susceptible de contribuer plus encore au réchauffement général de la planète.
On a évoqué supra l’effet cumulatif résultant de la baisse de l’albédo du fait du recul des surfaces enneigées ou englacées.
Il y a une autre raison pour laquelle le réchauffement polaire pourrait avoir un effet d’accélération du réchauffement général : le fond des mers très froides comme l’océan Arctique, ainsi que les sols gelés en permanence des terres polaires (pergélisol ou permafrost), retiennent en quantité importantes des gaz tels que le méthane, dont les molécules peuvent notamment être enfermées par des molécules d’eau dans certaines conditions (formation de « clathrates »). Or le méthane – qui est par ailleurs le composant principal du gaz naturel que nous brûlons – est un puissant responsable de l’effet de serre : à quantité égale, son « potentiel de réchauffement global » (7) à un siècle est considéré comme environ 25 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2). Pour le moment, le méthane relâché dans l’atmosphère du fait des activités humaines provient principalement de l’agriculture et des activités extractives. Mais il existe un risque de libération massive du méthane prisonnier du pergélisol et des eaux glacées du fait du réchauffement des régions polaires, ce qui représenterait une autre contribution additionnelle de celles-ci à l’effet de serre et donc au réchauffement général. Des observateurs soulignent que d’ores et déjà, certaines eaux de l’Arctique semblent bouillonner…
Ce point fait aujourd’hui l’objet de débats dans la communauté scientifique. Dans son dernier rapport précité, le GIEC fait preuve d’une grande prudence sur cette question : il en souligne les incertitudes, tout en concluant qu’au moins à moyen terme – pour le siècle en cours –, il ne semble pas que l’on aille vers une libération catastrophique de méthane : « les études de modélisation du bilan carbone dans le pergélisol en cas de réchauffement futur (…) ne produisent pas de résultats concordants, si ce n’est que le pergélisol d’aujourd’hui deviendra une source nette d’émission de carbone au XXIème siècle en vertu de scénarios de réchauffement futur plausibles (faible degré de confiance) (…). Il est très probable que le réchauffement anthropique entraînera une augmentation des émissions de [méthane] provenant de clathrates tant terrestres qu’océaniques. Les dépôts de clathrates de méthane en dessous du fond océanique pourraient être déstabilisés par le réchauffement des océans. Toutefois, l’élévation du niveau de la mer liée à la modification de la masse océanique renforce la stabilité des clathrates dans l’océan. Bien que leur évaluation formelle présente des difficultés, les estimations initiales de la rétroaction du XXIème siècle liée à la déstabilisation des clathrates de méthane sont modestes mais pas insignifiantes ».
La libération d’une partie du méthane piégé par le froid dans les régions polaires devrait donc contribuer à l’effet de serre et au réchauffement général, mais la question doit encore être étudiée et il est probable que le phénomène restera très progressif.
B. LA FONTE ACCÉLÉRÉE DES GLACES
Le réchauffement des régions polaires, particulièrement des régions arctiques, s’accompagne logiquement d’une fonte accélérée des glaces qui s’y trouvent, laquelle a une large responsabilité dans l’élévation globale du niveau des mers. Dans son dernier rapport précité, le GIEC attribue sur la période 1993-2010, « avec un degré de confiance élevé », une élévation de ce niveau d’environ 1,36 millimètre par an aux changements affectant les glaciers terrestres et les calottes du Groenland et de l’Antarctique. La fonte des glaces serait donc responsable de plus de 40 % de la hausse du niveau des mers, dont elle serait le premier facteur, devançant la dilatation thermique de l’eau des mers qui résulte de leur réchauffement, laquelle expliquerait environ 35 % de cette hausse globale.
Sur cette même période 1993-2010, tous ces glaciers auraient en moyenne perdu environ 275 milliards de tonnes par an… Cette énorme masse d’eau douce déversée dans les mers a forcément une influence sur leur salinité et sur la circulation de leurs eaux.
Sont naturellement particulièrement en cause les deux plus grosses masses glaciaires de notre planète que sont les inlandsis :
– l’inlandsis de l’Antarctique s’étend sur 14 millions de km² avec une épaisseur de glace moyenne de 2 000 mètres et des maximums pouvant atteindre 4 000 mètres ;
– celui du Groenland ne couvre « que » 1,7 million de km², avec une épaisseur comparable, mais est situé à des latitudes plus basses et donc beaucoup plus exposé à fondre du fait du réchauffement climatique.
La glace qui recouvre les mers et non les continents, dite banquise, s’inscrit dans une problématique différente : comme elle est épaisse de seulement quelques mètres et qu’elle est de surcroît en partie seulement émergée, sa fonte ne représente pas un enjeu significatif pour le niveau des mers ou leur salinité. Mais, du fait de l’effet albédo expliqué supra, la réduction de sa superficie est susceptible d’accélérer le réchauffement climatique.
De 1979 à 2013, la surface moyenne de la banquise arctique à son minimum annuel (atteint en septembre) est passée, corrigée des variations annuelles, d’environ 8 millions de km2 à moins de 5 millions. En moyenne, cette surface a diminué de 89 000 km2 par an (un sixième de la France métropolitaine) et de près de 14 % par décennie, avec de surcroît, comme on le voit bien sur le graphique ci-après, une nette accélération depuis la fin des années 1990. Deux points bas, qui sont des records catastrophiques, ont été enregistrés en 2007 et 2012, où la superficie de banquise est descendue à respectivement 4,3 millions de km2 et 3,6 millions.
Par ailleurs, cette banquise estivale apparaît de plus en plus mince : en quarante ans, son épaisseur moyenne serait passée de 3 mètres à 1,4 mètre, donc une diminution de plus de moitié. Si grosso modo, en moins d’un demi-siècle, tout à la fois la superficie de la banquise et son épaisseur ont été divisées par deux, cela signifie que son volume – la masse de glace qu’elle représente – a, quant à lui, été divisé par quatre. D’autres indicateurs, concernant notamment l’ancienneté moyenne des glaces qui forment la banquise ou leur vitesse de dérive, confirment la rapidité à laquelle celle-ci se fragilise.
Les modèles climatiques convergent pour annoncer une probable disparition totale de la banquise arctique en été à l’échéance du milieu du XXIème siècle. Seul un effort très rapide et volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui permettrait de contenir le réchauffement global en dessous de 2 °C, serait compatible avec le maintien d’un reliquat de banquise arctique estivale de l’ordre de 2 millions de km2.
Encore faut-il noter que le recul que l’on enregistre depuis une décennie est plus rapide que tout ce qu’annoncent les différents modèles, faisant craindre que l’échéance de la disparition de la glace de mer estivale en Arctique ne doive être anticipée. En septembre 2012, au moment où un record de fonte était enregistré, l’océanographe britannique Peter Wadhams a même envisagé publiquement la fin possible de la banquise estivale dès 2016…
Deux records de minimum saisonnier de la banquise : 2007 et 2012
(cartes de gauche et du centre ; carte de droite : 2013)
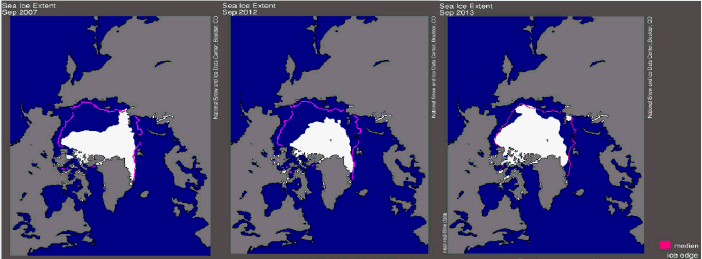
Source : « Les glaces marines arctiques », par Marie-Noëlle Houssais, CNRS-Laboratoire d’océanographie et du climat (LOCEAN-IPSL), Université Pierre et Marie Curie, Paris.
L’évolution de la superficie minimale saisonnière (septembre) de la banquise arctique
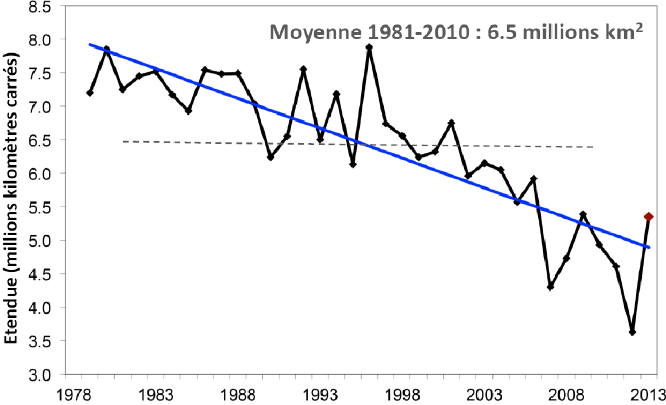
Source : « Les glaces marines arctiques », par Marie-Noëlle Houssais, CNRS-Laboratoire d’océanographie et du climat (LOCEAN-IPSL), Université Pierre et Marie Curie, Paris.
Le recul des superficies englacées concerne aussi la période hivernale, même s’il est là moins marqué : de 1979 à 2014, la superficie maximale annuelle de banquise arctique, constatée généralement en février, est passée de plus de 16 millions de km2 en moyenne à environ 14,5 millions, soit un recul à un rythme de 46 000 km2 par an et de 3 % par décennie.
La fonte de l’inlandsis groenlandais apparaît en très forte accélération : selon le GIEC, dans son rapport précité, « la perte de glace moyenne de la nappe du Groenland a très probablement fortement augmenté, passant [d’environ] 34 milliards de tonnes/an au cours de la période 1992–2001 à [environ] 215 milliards de tonnes/an au cours de la période 2002–2011 ».
Le GIEC évalue pour 1993-2010 à environ 0,33 millimètre par an l’élévation du niveau des océans qui a résulté du recul de l’inlandsis groenlandais : celui-ci serait donc actuellement responsable de plus de 10 % de la hausse mondiale du niveau des mers.
La fonte totale de cet inlandsis entraînerait une hausse de 7 mètres de ce niveau ! L’éventualité de la survenue de cet événement reste marquée d’une extrême incertitude, d’une part parce que les modèles climatiques ne permettent pas de déterminer de manière très sûre le niveau de hausse des températures nécessaire pour enclencher ce cataclysme, d’autre part et surtout parce qu’un tel phénomène prendrait au moins un millénaire, ce qui laisse heureusement quelque délai à l’humanité pour prendre les mesures permettant de l’éviter.
3. Les glaciers de l’Antarctique
Le GIEC, dans son rapport précité, estime que « la perte de glace moyenne de la nappe glaciaire de l’Antarctique a probablement augmenté, passant [d’environ] 30 milliards de tonnes/an au cours de la période 1992–2001 à [environ] 147 milliards au cours de la période 2002–2011 ». Cette fonte aurait été responsable d’une hausse annuelle d’environ 0,27 millimètre par an du niveau des mers pendant la période 1993-2010, soit près de 10 % de la hausse globale de celui-ci.
Le recul glaciaire concerne pour le moment essentiellement l’Antarctique occidentale, notamment les grands glaciers de l’île du Pin, de Thwaites, Haynes, Smith, Pope et Kohler, qui ensemble contiennent assez d’eau pour faire monter le niveau des mers de plus d’un mètre. La presse s’est fait l’écho de plusieurs études scientifiques inquiétantes qui ont récemment montré la rapidité de la fonte de ces glaciers (8). Le glaciologue Éric Rignot a estimé que ce phénomène atteignait d’ores et déjà un point de non-retour (9) et se poursuivrait donc inéluctablement durant les prochaines décennies.
En revanche, la plus grande partie de la calotte glaciaire de l’Antarctique n’est pour le moment pas concernée par cette fonte, tandis que la banquise antarctique qui l’entoure est globalement stable, voire en léger progrès.
4. Les conséquences sur la circulation océanique
Il faut enfin signaler que, selon certaines études scientifiques, la fonte des glaces pourrait avoir une incidence significative sur la circulation océanique – la géographie des courants marins – et par là sur le climat de larges parties du monde (ainsi que sur les ressources halieutiques). Ce serait en particulier le cas pour l’Europe du fait de la fonte des glaces de l’Arctique et du Groenland.
Ce que nous appelons communément Gulf Stream et que les scientifiques préfèrent maintenant nommer « circulation méridienne océanique de retournement » (ou Atlantic Meridional Overturning Circulation, d’où l’acronyme AMOC) désigne un courant d’eaux chaudes et plus salées que la moyenne des mers qui s’écoule à travers l’Atlantique depuis les Caraïbes jusqu’aux côtes de l’Europe occidentale, voire à l’extrême nord jusqu’au Svalbard et à la mer de Barents – qui est en conséquence la partie la moins froide et la moins englacée de l’océan Arctique. Ce courant chaud atteint ensuite des zones, situées au sud et à l’est du Groenland, où ses eaux s’enfoncent dans les profondeurs de l’océan, avant de revenir vers le sud le long des côtes américaines en entraînant en surface des eaux arctiques froides : ceci expliquerait pour partie les très fortes différences climatiques que l’on peut relever, à latitude égale, entre l’Europe et la côte Est américaine. La carte ci-après permet de visualiser les grandes circulations océaniques, dont l’AMOC.
Les grandes circulations maritimes
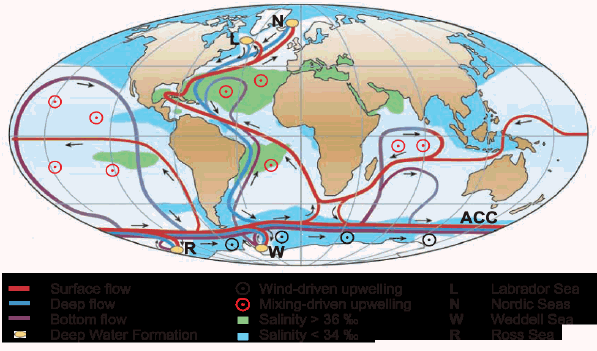
Source : The Encyclopedia of Earth, http://www.eoearth.org/view/article/150290.
Or, la vigueur de l’AMOC et la localisation plus ou moins nordique des zones où cette circulation se « retourne » sont affectées par plusieurs facteurs, dont, potentiellement, le niveau de salinité des eaux, lui-même lié à l’importance de la fonte des glaces d’eau douce. Le réchauffement général des eaux et sans doute, ce point étant plus discuté, une fonte accrue des glaces arctiques pourraient avoir pour conséquence de réduire la force de l’AMOC, avec pour effet un refroidissement climatique, toutes choses égales par ailleurs, dans tout ou partie de l’Europe.
L’incidence du changement climatique sur l’AMOC reste toutefois un point très discuté. La plupart des spécialistes s’accordent au moins sur le peu de vraisemblance d’un changement brutal. Le rapport précité du GIEC synthétise ces positions en énonçant qu’« il reste très probable que la circulation méridienne océanique de retournement de l’Atlantique faiblira au cours du XXIème siècle par rapport aux valeurs 1850–1900 », mais « très improbable que l’AMOC subisse une transition brusque ou un affaiblissement majeur ». De manière générale, les scientifiques considèrent qu’en tout état de cause, le refroidissement relatif en Europe qui pourrait en résulter serait probablement plus faible que l’effet général du réchauffement planétaire dans la zone : en d’autres termes, on aurait tout au plus un ralentissement du réchauffement du climat européen.
De manière plus ponctuelle, des scientifiques établissent un lien entre les épisodes de grands froids que connaissent ponctuellement, depuis quelques hivers, diverses régions boréales tempérées et un dérèglement de la circulation atmosphérique polaire, qui faciliterait le relâchement vers le sud de masses d’air polaire glacial.
C. L’IMPACT ACCRU DE L’ACIDIFICATION
Enfin, le phénomène d’acidification des océans qui accompagne le changement climatique est particulièrement marqué dans les régions polaires, car les eaux froides sont naturellement plus riches en dioxyde de carbone et du fait de la fonte de glace dans ces eaux. La carte ci-après montre les prévisions de concentration en aragonite en 2100 dans l’hypothèse où les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère se poursuivraient selon le scénario pessimiste du GIEC. L’aragonite est une forme du carbonate de calcium, lequel donne aussi le calcaire et est l’un des éléments essentiels du squelette ou de l’exosquelette (coquille) des animaux marins (et de certaines micro-algues comme les coccolithophores). Les régions en bleu sont celles où la concentration en aragonite resterait suffisante pour que coraux et coquillages continuent à croître. En revanche, dans les régions en rouge, qui correspondent, comme on le voit, aux eaux proches des deux pôles, la situation pourrait être telle que des coquilles ou squelettes calcaires non seulement seraient impossibles à construire, mais seraient même corrodés…
Prévisions de concentration en aragonite dans les océans en 2100
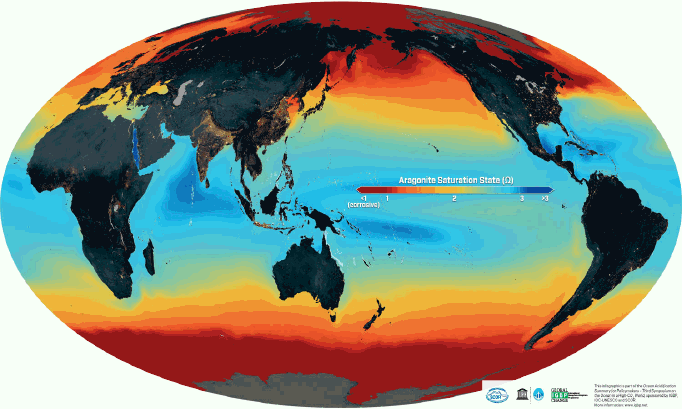
Source : Ocean Acidification, Summary for Policymakers, http://ocean-acidification.net/2014/03/20/creating-a-portal-to-ocean-acidification.
II. UNE FRAGILITÉ ÉCOLOGIQUE PLUS GRANDE DANS LES RÉGIONS POLAIRES
Non seulement le changement climatique est plus visible et plus violent dans les régions polaires, en particulier arctiques, que dans la plupart des autres zones climatiques de la planète, mais la gravité de ses conséquences est accrue par la fragilité des milieux en cause.
A. DES ÉCOSYSTÈMES STRUCTURELLEMENT FRAGILES
La richesse et la spécificité des écosystèmes des régions polaires sont communément illustrées par un grand nombre d’animaux emblématiques qui y habitent exclusivement ou principalement ou y séjournent saisonnièrement : phoques et baleines de différentes espèces, belugas, narvals, morses, rorquals, ours polaires, bœufs musqués, rennes, renards arctiques… Il faut aussi bien sûr citer les oiseaux de toutes sortes : en Arctique, mergules nains, sternes, guillemots de Brünnich, cormorans, mouettes tridactyles, eiders, etc. ; en Antarctique, manchots, sternes, skuas, pétrels…
Les écosystèmes polaires présentent pourtant plusieurs fragilités spécifiques :
● Tout d’abord, dans un contexte général de réchauffement, les formes de vie des régions polaires n’ont pas, à la différence de celles d’autres zones climatiques, tropicales ou tempérées, la possibilité de migrer vers des régions plus septentrionales (ou plus méridionales dans l’hémisphère sud) pour y retrouver des conditions auxquelles elles sont habituées. Face au réchauffement, il n’y a pas de repli possible vers des zones plus fraîches quand on est déjà adapté aux climats les plus froids qui existent.
De plus, les espèces polaires sont confrontées, du fait du réchauffement, à l’arrivée d’espèces en provenance de latitudes plus tempérées, qui leur font désormais concurrence, ainsi qu’à l’expansion de zoonoses ou de parasites qui n’étaient pas endémiques dans les régions polaires jusqu’à présent. On assiste de plus en plus à une « banalisation de la biodiversité » de l’Arctique.
La situation actuelle des ours polaires, dont la population mondiale serait de 20 000 à 25 000 individus, illustre ce drame : on constate d’ores et déjà des phénomènes de malnutrition de ces animaux, car le recul de la banquise arctique estivale écourte leur période de chasse au phoque, qui leur est nécessaire pour emmagasiner des réserves de graisse pour l’hiver et pour se reproduire. Une étude très récente de chercheurs canadiens sur l’avenir des ours polaires de l’archipel arctique canadien (10) observe que d’ici 2100, l’ensemble de ces populations pourraient être confrontées à une période annuelle de 2 à 5 mois sans glace de mer, de sorte qu’elles seraient à cette échéance menacées de famine et d’impossibilité de se reproduire. Ce constat est d’autant plus inquiétant que le grand nord canadien est la zone de l’Arctique où la banquise devrait le mieux résister au réchauffement et apparaissait donc jusqu’à présent comme un sanctuaire possible pour la survie des ours polaires.
Auditionné par la mission, l’ornithologue David Grémillet a de même évoqué la concurrence subie par les oiseaux arctiques du fait de l’expansion vers le nord d’espèces des régions tempérées, comme par exemple l’oie du Canada au Groenland.
Un oiseau tel que la mouette ivoire, ou mouette blanche, dont le mode de vie est intrinsèquement lié à celui des ours blancs et à la glace de mer (il se nourrit des carcasses de phoques abandonnées par les ours), est directement menacé de disparition.
Certes, d’autres études conduisent à des conclusions à court terme moins pessimistes. Par exemple, le même David Grémillet, étudiant les mergules nains, qui sont les oiseaux marins les plus abondants de l’Arctique, a observé (11) qu’ils parviennent, au moins pour le moment, à adapter leur comportement de pêche au réchauffement actuel des eaux de surface en mer du Groenland et peuvent vivre dans des milieux assez diversifiés en termes de températures : leurs taux de reproduction et de survie ne sont pour l’instant pas affectés, même s’il n’en sera peut-être pas de même dans l’avenir face à un réchauffement plus important.
● Ensuite, la vie dans les régions froides est plus lente, s’adapte moins vite aux changements.
● La vie y est également moins diversifiée. On sait que le nombre d’espèces différentes est beaucoup plus important dans les régions tropicales que dans les régions tempérées et a fortiori que dans les régions polaires. On dit souvent que les forêts tropicales abritent plus de la moitié des espèces végétales et animales terrestres, bien qu’elles ne couvrent que 7 % des surfaces. Diverses explications sont données de ce phénomène : le caractère plus ancien et donc plus diversifié des écosystèmes des régions à l’abri des glaciations ; la stabilité du climat tropical, du moins dans les régions humides, qui favoriserait des spécialisations alimentaires plus poussées, en raison de la constance des ressources alimentaires, et donc permettrait l’existence d’un plus grand nombre de niches écologiques...
Or, plus la vie est diversifiée dans un écosystème, moins l’éventuelle disparition d’une espèce, quelle qu’en soit la raison, est grave pour l’équilibre global, car la niche écologique qu’elle occupait est plus facilement reprise par une autre espèce. En revanche, dans les écosystèmes polaires, le nombre plus limité d’espèces vivantes signifie que la disparition de certaines, dont la niche écologique serait difficilement reprise par d’autres, pourrait rapidement mettre en cause l’équilibre global, donc l’existence de nombreuses autres espèces.
Le risque de mise en cause de l’équilibre global des milieux est particulièrement prononcé dans les périodes de changement climatique, comme celle que nous connaissons, du fait des effets de décalage temporel : telle espèce nouvelle, venue du sud, se répand et ravage un milieu parce que son prédateur le plus habituel est plus lent à migrer et ne l’a pas encore rejointe ; telle autre disparaît qui était essentielle dans une chaîne alimentaire…
B. DES ÉCOSYSTÈMES PARTICULIÈREMENT SENSIBLES AUX POLLUTIONS
On constate de plus que les écosystèmes polaires ont tendance à concentrer les pollutions. Des polluants déversés dans le monde entier sont concentrés en Arctique du fait du jeu des courants marins et des vents dominants. Ils s’y ajoutent à ceux qui y sont immergés délibérément, comme par exemple les substances radioactives répandues dans l’Arctique russe du fait des pratiques locales pour se débarrasser à peu de frais des anciens navires et sous-marins, y compris à propulsion nucléaire.
Le réchauffement actuel a pour effet de libérer des polluants qui étaient bloqués dans des glaces, au fur et à mesure qu’elles fondent, et de modifier leur circulation, du fait des changements de la circulation marine. De nouvelles zones sont donc contaminées.
En outre, les températures basses ont pour effet de ralentir la dégradation naturelle de certains polluants et/ou de réduire leur capacité à s’évaporer ou se disperser. C’est le cas notamment pour les « polluants organiques persistants » et pour les hydrocarbures. La faible luminosité et le froid ralentissent ainsi la fragmentation des nappes de pétrole.
Le froid a aussi pour effet d’aggraver les conséquences d’un contact avec une nappe de pétrole pour les animaux : ceux-ci ont besoin d’un plumage ou d’une fourrure (si l’on pense par exemple aux bébés phoques) en bon état pour résister au froid. Les hydrocarbures détruisent les propriétés isolantes des plumages et des fourrures.
Enfin, il faut bien voir que, vu la pauvreté des écosystèmes terrestres polaires, la plupart des animaux terrestres des régions polaires, tels que les ours polaires ou les oiseaux pêcheurs, dépendent de la mer pour se nourrir. Cela signifie que les pollutions du milieu maritime y ont des répercussions plus massives sur la vie terrestre que dans les autres écosystèmes.
De même, le fait que nombre d’oiseaux polaires soient des migrateurs, qui fréquentent de très nombreuses mers ou plans d’eau au cours de leur vie, accroît leur exposition aux diverses pollutions du monde et la diffusion de celles-ci vers les zones polaires.
La catastrophe de l’Exxon Valdez, qui n’est pourtant pas survenue vraiment en milieu polaire, mais seulement dans les eaux froides du Pacifique- Nord, a démontré la fragilité des écosystèmes marins « froids » : plus de deux décennies après, les effets de cette marée noire se font encore sentir, en mer comme sur le littoral. Des poches de pétroles sont toujours enfouies sous les sédiments et les plages de galets. Les populations de loutres de mer, qui avaient diminué de moitié, ne sont pas encore pleinement reconstituées, et des populations locales de mammifères marins, telles que les orques épaulards, sont au bord de l’extinction, des substances toxiques s’étant infiltrées dans leurs sous-couches graisseuses.
C. L’IMPOSSIBILITÉ DE TRAITER UN ACCIDENT ÉCOLOGIQUE MAJEUR DANS LES RÉGIONS POLAIRES
Pour les raisons indiquées supra, les conséquences d’une « marée noire » – qu’elle résulte d’un pétrolier ou d’une plateforme off-shore – en Arctique seraient d’une particulière gravité.
Mais ces conséquences seraient encore aggravées par l’impossibilité dans laquelle on se trouverait de traiter efficacement cet accident : éloignement des moyens de secours, difficulté à intervenir dans des eaux froides et un climat très difficile, voire, au cas où des zones englacées seraient touchées, absence de techniques adaptées. Il est notamment clair que toute opération de dépollution serait impossible pendant l’hiver : le pétrole continuerait éventuellement à se déverser (dans le cas d’une fuite sur un puits) et resterait inévitablement coincé sous la glace pendant des mois. Et il n’est même pas sûr que la courte période estivale serait suffisante pour mener les longues opérations nécessaires, par exemple, pour forer un puits de dérivation, ce qui est souvent la seule solution pour mettre fin à une fuite.
En 2010, la naufrage de la plate-forme Deep Water Horizon dans le golfe du Mexique a entraîné le déversement de près de vingt fois plus de pétrole que les quelques 40 000 tonnes de l’Exxon Valdez, du fait d’une fuite qui s’est prolongée pendant cinq mois avant d’être totalement maîtrisée ! L’intervention de pas moins de 6 500 bateaux a permis de récupérer une petite partie (peut-être le sixième) de ce pétrole. On peut imaginer ce que seraient les conséquences d’un accident de même nature dans les eaux arctiques, au regard à la fois de la fragilité spécifique de leur écosystème et de l’impossibilité dans laquelle on serait de lutter contre ce désastre – on n’y trouverait évidemment pas quelques milliers de navires disponibles et, même si c’était le cas, l’hiver interromprait nécessairement les opérations.
Or, le risque d’un accident grave est sans doute plus élevé dans les régions polaires qu’ailleurs, notamment en ce qui concerne les plateformes off-shore, du fait des glaces flottantes qui dérivent, dont le réchauffement climatique accroît la fréquence. C’est ainsi que le glacier de Petermann, situé dans le nord du Groenland, après avoir « vêlé » en 2010 un iceberg géant de 260 km2, en a encore relâché un de 120 km2 en 2012 ; pour comparaison, la superficie de la ville de Paris est de 105 km2…
III. LA MISE EN CAUSE DES MODES DE VIE TRADITIONNELS DES PEUPLES DE L’ARCTIQUE
Il faut aussi rappeler que les régions arctiques (situées au nord du cercle polaire) sont peuplées d’environ 4 millions de personnes, dont sans doute environ 0,5 million sont issues de peuples autochtones parfois présents depuis plusieurs milliers d’années. Parmi ces groupes, dont l’effectif est très variable, les plus nombreux sont les Inuits, qui seraient environ 150 000 et occupent un vaste espace allant du Groenland à la Sibérie orientale en passant par le Canada et l’Alaska, et les Saamis (anciennement et improprement nommés Lapons) de Scandinavie, qui seraient près de 100 000. En Russie, 41 peuples arctiques représentent au total de l’ordre de 250 000 personnes.
La carte ci-après montre la répartition de ces peuples, regroupés par familles ethno-linguistiques.
Les groupes de populations autochtones de l’Arctique
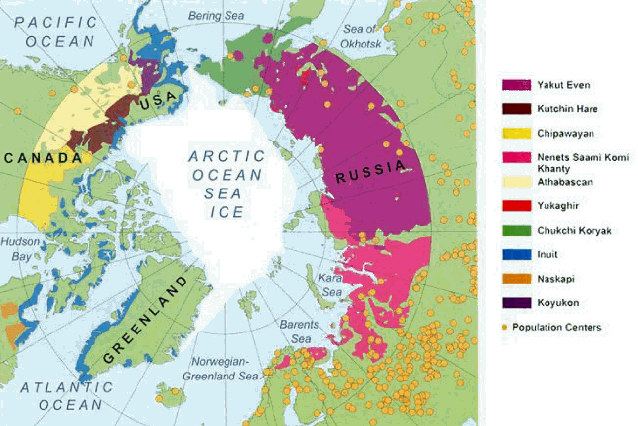
Source : http://www.underthepole.com.
Ces peuples autochtones, souvent nomades à des degrés divers, vivaient traditionnellement, selon les cas, de la chasse (animaux à fourrures, phoques…), de la pêche ou de l’élevage des rennes. Leurs premiers contacts avec le monde européen ont généralement pris la forme de la rencontre de baleiniers, de morutiers ou de trappeurs, parfois de missionnaires ou d’ethnologues. Ils ont pour la plupart connu au XXème siècle une rapide et profonde transformation de leur mode de vie. Cependant, certains ont jusqu’à présent conservé intégralement ou presque leur mode de vie traditionnel, comme les Nenets éleveurs de rennes de la péninsule de Iamal en Sibérie, désormais confrontés au développement de l’extraction gazière. D’autres, notamment de nombreux Inuits, tout en ayant largement adopté un mode de vie « occidental », restent attachés à la poursuite de certaines activités traditionnelles, de chasse au phoque ou de pêche notamment.
Le réchauffement climatique, en mettant en cause l’existence même de la banquise, lieu traditionnel de la chasse au phoque, en provoquant l’extinction de diverses espèces, en favorisant le développement de nouvelles activités économiques, donc l’arrivée de nouvelles populations, risque d’être fatal aux cultures traditionnelles qui subsistent, même si les peuples de l’Arctique revendiquent leurs capacités d’adaptation, prouvées par leur implantation dans des climats très sévères, et ne veulent donc pas être considérés comme des « victimes » climatiques.
Plus généralement, quel que soit l’attrait que des températures moins glaciales puissent éventuellement représenter pour certains habitants de l’Arctique, ce réchauffement présente des risques pour l’ensemble des populations qui y vivent, « traditionnelles » ou non, par certains de ses effets : risque accru d’événements climatiques extrêmes ou simplement inhabituels, fonte du permafrost qui menace la stabilité des infrastructures, des routes et des maison bâties sur lui, précipitations plus abondantes et donc inondations…
IV. CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE : LA CONFÉRENCE PARIS-CLIMAT 2015, SI ELLE RÉUSSIT, SERA PROBABLEMENT POUR L’ARCTIQUE L’ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT DE LA DÉCENNIE
Réchauffement deux ou trois fois plus fort qu’ailleurs ; recul accéléré de la banquise ; infrastructures et habitations fragilisées par la fonte du pergélisol ; effets cumulatifs et plus graves qu’ailleurs de l’acidification des mers et de la pollution ; espèces particulièrement menacées car ne pouvant pas, à la différence de certaines des zones tempérées, se replier plus au nord pour échapper au réchauffement ; écosystèmes très dépendants de la mer et donc sensibles à toutes les pollutions marines ; absence de méthodes et de moyens sur place pour traiter une éventuelle marée noire ; modes de vie traditionnels remis en cause… Tout concourt à faire de l’Arctique l’une des régions les plus menacées par les effets du changement climatique, dont les activités humaines sont responsables.
Dans ces conditions, la priorité n° 1, pour l’Arctique, est que l’humanité parvienne à maîtriser et réduire au plus vite ses émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi il est légitime de penser que la conférence Paris-climat 2015, si elle réussit, pourrait être pour l’Arctique l’événement le plus important de la décennie.
Votre rapporteur estime aussi qu’il est essentiel, vu l’ampleur des risques en cas d’accident, de limiter au maximum l’exploitation et le transport des hydrocarbures dans les eaux arctiques, si possible de les interdire. Mais cela renvoie non pas à la problématique générale du changement climatique, problème mondial, mais à celle de la gouvernance régionale, traitée dans la troisième partie du présent rapport.
DEUXIÈME PARTIE : L’ANTARCTIQUE, UN STATUT À PRÉSERVER
En situation de symétrie inversée avec l’Arctique, comme on l’a vu en introduction du présent rapport, l’Antarctique est la terre des extrêmes et donc la terre qui a été le plus tardivement explorée par l’homme. Elle reste aussi le seul continent quasiment inhabité, hormis par quelques petits milliers de scientifiques.
L’Antarctique est entourée par un immense espace marin qui est également préservé, l’océan Austral qui se prolonge dans les parties méridionales des grands océans mondiaux, formant le domaine « subantarctique ».
La communauté internationale a progressivement doté l’Antarctique d’un statut remarquablement coopératif et protecteur, qui valorise la recherche scientifique et exclut la militarisation et l’exploitation minière.
Cependant, même si, pour le moment, l’Antarctique subit beaucoup plus modérément que l’Arctique les effets du changement climatique, elle ne restera pas forcément toujours à l’abri des bouleversements, non plus que des appétits d’exploitation économique, surtout si son statut international devait être remis en cause.
I. LE DERNIER « BOUT DU MONDE »
A. LE CONTINENT ANTARCTIQUE, TERRE DES EXTRÊMES
1. Des conditions exceptionnellement dures
Le continent Antarctique est un vaste territoire, avec 14 millions de km2, soit, à titre de comparaison, environ la moitié de la superficie de l’Afrique, mais le double de celle de l’Australie. Géologiquement, il se compose principalement de deux zones :
– l’Antarctique orientale est un vaste plateau érodé, issu d’un vieux bouclier continental comme on en trouve au centre de la plupart des grandes masses continentales ;
– l’Antarctique occidentale est traversée par une chaîne montagneuse plus récente, de type alpin, qui se trouve en fait dans le prolongement des Andes sud-américaines. Elle tend dans la direction de celle-ci la péninsule Antarctique, prolongée par un chapelet d’îles (Shetland du Sud, Orcades du Sud, Sandwich du Sud, Géorgie du Sud) qui la séparent de l’Amérique du Sud.
Le continent Antarctique est à 98 % couvert d’une couche de glace de près de deux kilomètres d’épaisseur moyenne, qui s’écoule aux marges du continent dans des zones au-dessous du niveau de la mer, puis se prolonge par une banquise permanente couvrant la plus grande partie des mers côtières. La superficie de la banquise antarctique varie entre 3 millions de km2 durant l’été austral et près de 20 millions durant l’hiver austral. Au moins pour le moment, le changement climatique ne semble pas avoir d’effet significatif sur cette superficie.
L’effet du manque d’insolation, première cause du froid aux pôles, est renforcé en Antarctique par un effet de continentalité que l’on ne trouve évidemment pas en Arctique, et par l’effet de l’altitude, puisque que du fait de l’énorme épaisseur de glace, une grande partie de la surface du continent se retrouve à une altitude de 3 000 mètres ou plus. La température moyenne annuelle s’abaisse à – 49 °C au pôle Sud et à – 54 °C à Vostok dans la zone la plus froide ; on est là dans des secteurs où la température varie au fil de l’année entre – 70 °C et – 30 °C ; à Vostok, le record de froid enregistré est de – 89 °C, tandis que le record historique de « chaleur estivale » est de – 12 °C !
Comme on a pu aussi le voir, cet effet de continentalité protège pour le moment une grande partie de l’Antarctique du réchauffement général, qui est cependant sensible en Antarctique occidentale.
Avec un tel climat, la flore et la faune terrestres sont quasi-inexistantes : quelques lichens, mousses et insectes… La faune est essentiellement marine, la chaîne alimentaire étant notamment fondée sur les concentrations de krill (petites crevettes). Les mammifères marins abondent (phoques, otaries, rorquals bleus, communs et de Rudolphi, baleines à bosse…), de même que les oiseaux marins, dont certains, comme les sternes, migrent d’ailleurs tous les ans entre les deux pôles ; les différentes espèces de manchots, regroupés en colonies gigantesques, constituent sans doute les animaux les plus emblématiques de l’Antarctique.
L’Antarctique est longtemps restée une zone mystérieuse sur les cartes marines. La banquise antarctique semble avoir pour la première fois été atteinte par James Cook en 1773-1774, que les glaces empêchèrent cependant de s’approcher du continent à proprement parler.
C’est en 1820 que ce continent aurait été aperçu pour la première fois, et peut-être en 1821 qu’on y aurait débarqué. La paternité de cette découverte reste incertaine, étant disputée entre l’expédition russe de Fabian von Bellingshausen, le baleinier américain Nathaniel Palmer et le navire britannique d’Edward Bransfield.
Pour la France, Jules Dumont d’Urville a débarqué en 1840 en terre Adélie.
L’exploration de cet espace aux conditions si extrêmes a cependant été lente et ce n’est qu’au début du XXème siècle qu’il est devenu un lieu de concurrence entre les explorateurs, soutenus par leurs nations respectives : après l’échec d’Ernest Shackleton, Roald Amundsen est le premier à atteindre le pôle Sud fin 1911, suivi par Robert Scott qui y laisse la vie. Enfin, le premier survol du pôle est effectué en 1929 par Richard Evelyn Byrd.
B. OCÉAN AUSTRAL ET ÎLES SUBANTARCTIQUES, UN ESPACE MARITIME LARGEMENT PRÉSERVÉ
Le continent Antarctique, prolongé par la banquise, est entouré d’un immense anneau maritime, formé par les parties méridionales des grands océans mondiaux, d’où ne dépassent qu’un nombre limité d’îles, généralement de petite taille bien que le plus souvent montagneuses : beaucoup sont des îlots, les plus grands archipels, comme ceux des Malouines (12 000 km2) ou des Kerguelen (7 000 km2), ayant des superficies du même ordre de grandeur que la Corse.
L’Antarctique et son environnement océanique
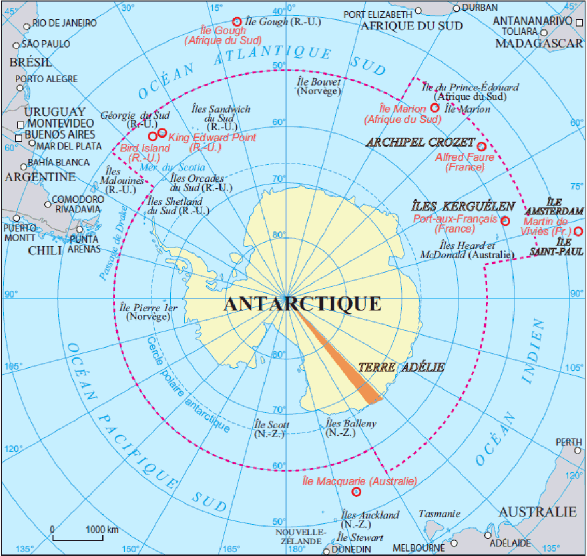
Source : ministère des affaires étrangères.
En rouge, les stations permanentes insulaires ; en pointillé, la ligne « officielle » de la convergence antarctique.
Cet espace maritime est traversé par une ligne géographique continue qui constitue un phénomène géo-climatique remarquable, la « convergence antarctique » (ou « front polaire ») : c’est une étroite zone, de quelques dizaines de kilomètres de large, où les eaux froides et peu salines de l’Antarctique et les eaux plus douces et plus salées de l’« océan mondial » se rencontrent dans un courant d’ouest régulier. Sur une distance qui se compte donc seulement en dizaines de kilomètres, la température de l’eau varie souvent de 5 °C à 6 °C et l’on retrouve les mêmes écarts pour les températures terrestres moyennes relevées sur les îles proches de cette ligne. Le tracé de celle-ci sinue entre les 48eme et 61eme parallèles selon les zones, mais, ce qui est particulièrement notable, c’est la constance de ce tracé : au fil des saisons et des ans, il ne connaît que des variations minimes.
Les eaux situées au sud de la convergence sont communément appelées « océan Austral ».
Les îles situées au sud de la ligne de convergence antarctique ont un climat polaire : températures moyennes annuelles souvent négatives, couverture glaciaire prédominante…
Celles situées au nord de la convergence présentent des conditions climatiques variables selon leur latitude, mais ont généralement en commun leur climat océanique accentué : précipitations abondantes et surtout très fréquentes, vents violents, reliefs souvent voire systématiquement pris dans les nuages, hivers doux (avec des températures moyennes positives), mais étés très frais… Ce climat est généralement incompatible avec la présence de véritables arbres : toundra et végétation rampante dominent.
À titre d’exemple, l’archipel des Kerguelen, localisé dans la zone de la convergence antarctique, présente un climat qui rappelle celui de l’Islande bien que sa latitude, 49°, corresponde dans l’hémisphère nord à celle de Paris. La température moyenne annuelle y est de près de 8 °C inférieure à celle de la capitale.
Les îles antarctiques et subantarctiques ont été découvertes en ordre dispersé à partir du XVIème siècle par les navigateurs européens : les Malouines dès le début de ce siècle, la Géorgie du Sud en 1675, l’île Bouvet en 1739, les îles Kerguelen et Crozet en 1772, les Sandwich du Sud en 1775, etc. À de rares exceptions près comme les Malouines, elles ne furent pas colonisées vu leurs conditions climatiques.
La spécificité de ces conditions et l’isolement des îles antarctiques et subantarctiques y a conduit au développement d’écosystèmes très particuliers, avec la présence d’espèces endémiques spécifiques comme le chou de Kerguelen. L’absence de présence humaine – autre que scientifique ou de souveraineté – sur la plupart d’entre elles y a préservé ces écosystèmes, qui constituent donc une richesse biologique remarquable.
Même si elles ont été précocement visitées par les chasseurs de phoques et de baleines, les eaux antarctiques et subantarctiques, hostiles et éloignées de tout, ont de même longtemps échappé à l’appétit des grandes flottes modernes de pêche. Cependant, comme on y reviendra infra, plusieurs ressources suscitent aujourd’hui un engouement parfois préoccupant :
– le krill, c’est-à-dire ces bancs de petites crevettes qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire ;
– à l’autre bout de la chaîne alimentaire, la légine, gros poisson prédateur qui est victime depuis quelques années d’un engouement gastronomique ;
– dans les eaux plus douces du nord de la zone, la langouste, et, quand on s’approche des zones tropicales, le thon.
II. UNE REMARQUABLE COOPÉRATION INTERNATIONALE, TANT INSTITUTIONNELLE QUE PRATIQUE
Ce que l’on appelle le système ou le statut de l’Antarctique repose sur un ensemble d’instruments internationaux successifs, interconnectés et complémentaires, qui ont mis en place une véritable gouvernance internationale tournée vers la recherche scientifique et la protection de l’environnement, mais excluant tout usage militaire ou économique de l’Antarctique.
A. UN ENSEMBLE COORDONNÉ D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
L’Antarctique est sans doute la région du monde où le plus grand degré d’internationalisation institutionnelle a été obtenu. Un ensemble d’instruments internationaux y organisent la coopération internationale :
– le Traité sur l’Antarctique, signé à Washington le 1er décembre 1959 et entré en vigueur en 1961 ;
– la Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique, souvent désignée par l’acronyme CCAS (pour Convention for the Conservation of Antarctic Seals), qui a été signée à Londres le 1er juin 1972 et est entrée en vigueur en 1978 ;
– la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, dite CCAMLR (pour Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), signée à Canberra le 20 mai 1980 et entrée en vigueur en 1982 ;
– le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, dit « Protocole de Madrid », en date du 4 octobre 1991 et entré en vigueur en 1998.
Ces différents instruments sont à des degrés divers juridiquement liés : la CCAMLR contient des dispositions qui engagent ses parties à respecter des stipulations essentielles du Traité sur l’Antarctique, notamment celles concernant la démilitarisation, la dénucléarisation et le gel des revendications territoriales. Quant au Protocole de Madrid, il constitue par construction un complément du Traité sur l’Antarctique réservé aux seuls États ayant adhéré à celui-ci.
Ils forment donc un système complet de gouvernance internationale de l’Antarctique.
B. LE POINT DE DÉPART : INTERNATIONALISATION ET DÉMILITARISATION
1. Les revendications territoriales du début du XXème siècle
Dès le début du XXème siècle, alors que s’intensifiait l’exploration de l’Antarctique, plusieurs États ont commencé à revendiquer la possession de terres antarctiques, parfois pour des raisons économiques liées à la chasse à la baleine – l’apparition dans les années 1920 des premiers bateaux-usines permettant de l’envisager dans les eaux antarctiques –, mais surtout pour des raisons de prestige et de souveraineté.
Ces affirmations de souveraineté ont généralement été fondées sur deux types d’arguments : soit l’antériorité de la découverte, soit la continuité géographique qui existerait, par-delà plusieurs milliers de kilomètres de mers, avec les territoires des États austraux tels que le Chili, l’Argentine, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cette théorie de la continuité géographique a également conduit à délimiter les zones revendiquées par des méridiens, conduisant à un découpage de l’Antarctique en secteurs, en « parts de fromage ».
Ces revendications ont aussi en commun d’avoir pratiquement toutes pris la forme d’actes administratifs unilatéraux, généralement des textes réglementaires par lesquels les différents gouvernements prétendaient organiser l’administration de territoires que par la même occasion ils délimitaient.
● Il semble que la première revendication exprimée dans la zone ait été celle de l’Argentine, qui a en 1904 officiellement pris possession des îles Orcades du Sud et y a établi une station permanente. Sur le continent lui-même, l’Argentine a délimité unilatéralement les secteurs dont elle revendique la souveraineté par des décrets de 1940 et 1957.
● Le Chili en a fait de même en 1940.
● C’est en réaction aux prétentions argentines que le Royaume-Uni a posé une première revendication territoriale dans l’Antarctique en instituant en 1908 un territoire des Falkland Island Dependencies, revendication qui a ensuite été réitérée et précisée en 1917.
● Les très larges revendications territoriales de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie dans l’Antarctique sont également fondées sur des actes unilatéraux du Royaume-Uni, respectivement datés de 1923 et 1933, dont ces nations étaient encore des dominions.
● C’est par des décrets successifs de 1924 et 1938 qui en organisaient l’administration que la France a confirmé sa souveraineté sur la terre Adélie, fondée sur la prise de possession par Jules Dumont d’Urville en 1840.
● Enfin, après avoir annexé unilatéralement en 1929 l’île Bouvet et en 1931 l’île Pierre Ier, la Norvège a délimité son propre secteur du continent Antarctique en 1939, en se fondant sur les découvertes de ses explorateurs et pour protéger ses intérêts baleiniers.
Sept États dits « possessionnés » avaient donc affirmé, au milieu du XXème siècle, une souveraineté territoriale sur une fraction du continent Antarctique : Argentine, Australie, Chili, France, Norvège, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni.
Comme on peut le voir sur la carte-ci-après, ces revendications ne couvrent pas la totalité du continent, dont toute la partie située entre les 90° et 150° degrés ouest, au sud de l’océan Pacifique, est restée non revendiquée.
En revanche, ces revendications apparaissent contradictoires en Antarctique occidentale, où se trouve la péninsule Antarctique et où les prétentions argentines, britanniques et chiliennes se chevauchent et sont donc incompatibles. Ce litige rend compte de l’affrontement entre deux logiques de revendication, l’une fondée sur la continuité géographique, l’autre sur la primauté des découvreurs ; il est également lié à d’autres litiges situés plus au nord, que ce soit entre le Chili et l’Argentine sur les îles du canal de Beagle au sud de la Terre de feu ou entre l’Argentine et le Royaume-Uni sur les îles Malouines ou Falkland. Après la Seconde guerre mondiale, le litige entre les États sud-américains et le Royaume-Uni a été proche de tourner à l’affrontement ouvert, le Chili et l’Argentine ayant décidé en 1948 de geler leur conflit réciproque pour faire front commun contre le Royaume-Uni : plusieurs incidents nécessitèrent la conclusion en 1949 d’une trêve navale entre les protagonistes, par laquelle ils s’engagèrent à ne plus envoyer de navires de guerre dans les eaux antarctiques, et diverses tentatives de règlement par la médiation ou la justice internationales échouèrent.
Plus généralement, le degré de reconnaissance internationale des différentes revendications de souveraineté est resté faible : seuls la France, le Royaume-Uni et ses anciennes colonies, Australie et Nouvelle-Zélande, se sont concertés avant d’exprimer leurs revendications propres et ont reconnu mutuellement celles-ci (l’Australie a notamment ainsi accepté l’insertion de l’enclave de terre Adélie dans son vaste secteur).
En revanche, les États-Unis, sans formuler eux-mêmes de revendications territoriales en Antarctique, ont précocement (dès 1924 dans une note verbale) dénié toute validité aux revendications des autres puissances dès lors qu’elles ne s’accompagnaient pas d’une occupation effective des territoires en cause. L’URSS a également pris cette position, tout en rappelant le droit d’antériorité que lui donnaient en principe les découvertes de l’expédition russe de 1819-1821, notamment sur l’île Pierre Ier ultérieurement annexée par la Norvège.
Les revendications de souveraineté sur le continent Antarctique
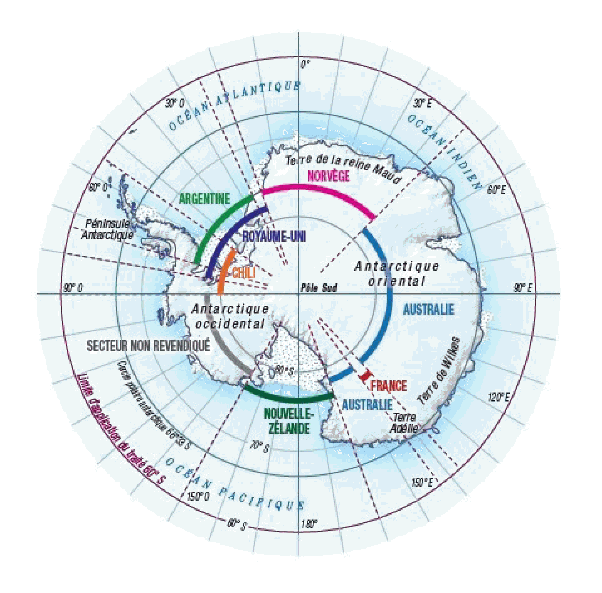
Source : http://www.neo-planete.com.
2. L’élaboration du Traité sur l’Antarctique
C’est dans ce contexte d’affirmation de plus en plus conflictuelle des souverainetés nationales en Antarctique qu’un événement scientifique international permit de changer la donne.
Même si l’exploration des pôles fut largement le fait d’expéditions nationales qui ne manquaient pas de planter leur drapeau, une première « Année polaire internationale » avait été organisée dès 1882-1883, suivie d’une seconde en 1932-1933, et il était proposé de reproduire l’exercice en 1956-1957. Mais, finalement, il fut décidé de donner une portée plus globale à l’exercice scientifique envisagé, sous le nom d’« Année géophysique internationale », pour y rattacher les premières explorations de l’espace qui étaient en cours – dont le lancement du Spoutnik – et ouvraient de nouvelles perspectives pour la connaissance du globe terrestre.
Cette mobilisation mondiale à des fins scientifiques fut cependant aussi l’occasion d’une amplification sans précédent de l’effort de recherche dans l’Antarctique, où plusieurs pays (États-Unis et Union soviétique bien sûr, mais aussi France, Royaume-Uni, Japon…) installèrent des bases de recherche.
Cet exercice, promu par l’ONU, avait aussi des fins politiques, en particulier la promotion d’un statut international démilitarisé de l’Antarctique. La conjoncture y était favorable pour plusieurs raisons évoquées supra :
– les États-Unis souhaitaient apaiser les rivalités territoriales en Antarctique occidentale du Royaume-Uni, du Chili et de l’Argentine, ces trois pays étant leurs alliés dans le camp occidental ;
– les États-Unis et les différents États « possessionnés » en Arctique, tous membres du camp occidental, voyaient avec inquiétude se déployer en Antarctique une activité croissante, motivée par des fins officiellement scientifiques, d’une URSS alors triomphante, qui dans le même temps lançait le Spoutnik ;
– l’heure était à la déstalinisation et à la « détente », dont le Traité sur l’Antarctique est effectivement la deuxième grande réussite institutionnelle, après le Traité d’État qui avait en 1955 permis la fin de la division de l’Autriche en zones d’occupation en contrepartie de sa neutralisation.
Le Traité sur l’Antarctique fut donc négocié et signé entre 12 États qui avaient des prétentions territoriales en Antarctique (soit qu’ils aient affirmé leur souveraineté sur un secteur, soit qu’ils se soient réservé le droit de le faire) et/ou avaient contribué à l’Année géophysique internationale : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Chili, États-Unis, France, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et URSS.
Du fait des adhésions ultérieures, le nombre des États qui sont parties au Traité s’élève maintenant à 50, parmi lesquels on distingue ceux qui ont le statut de « partie consultative », au nombre de 29, et les autres. En effet, le paragraphe 2 de l’article IX du Traité, qui institue des réunions périodiques, les réserve aux parties qui démontrent l’intérêt qu’elles portent à l’Antarctique en « y menant des activités substantielles de recherche scientifique », dites « parties consultatives » : les 21 autres membres du Traité peuvent assister aux réunions, mais sans voix consultative.
Parmi les « parties consultatives » qui se sont ajoutées aux signataires d’origine, on trouve de nombreux États européens, notamment scandinaves (Allemagne, Bulgarie, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Suède et Ukraine), mais aussi les principaux pays émergents (Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde…), lesquels ont obtenu ce statut dans les années 1980.
Le Traité s’applique aux zones situées au sud du 60ème parallèle (article VI).
3. Le cœur du Traité sur l’Antarctique : coopération scientifique, démilitarisation et gel des revendications territoriales
Les considérants qui forment le préambule du Traité méritent d’être cités, car ils en expriment très clairement la portée. Les signataires y affirment solennellement :
– « qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux » ;
– « qu’il est conforme aux intérêts de la science et au progrès de l’humanité d’établir une construction solide permettant de poursuivre et de développer [la] coopération [scientifique] ».
La priorité donnée à la démilitarisation par les signataires du Traité sur l’Antarctique apparaît dans la rédaction de celui-ci : la question est traitée à l’article Ier, qui stipule que « seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique » et y proscrit « toutes mesures de caractère militaire », notamment l’établissement de bases ou l’essai d’armements. Il autorise cependant l’emploi éventuel de personnels ou matériels militaires, mais à des fins pacifiques. L’article V interdit de plus toute explosion nucléaire ou élimination de déchets nucléaires.
L’article IV traite de la question des revendications territoriales. Il sauvegarde les différentes positions des États en mettant de côté les questions de souveraineté : « aucune disposition du présent Traité ne peut être interprétée (…) comme constituant, de la part d’aucune des parties contractantes, une renonciation à ses droits de souveraineté territoriale, ou aux revendications territoriales, précédemment affirmés par elle dans l’Antarctique », ni « comme un abandon total ou partiel (…) d’une base de revendication de souveraineté territoriale » ; cette dernière formule vise la situation des États-Unis et de l’URSS, qui, sans affirmer de souveraineté en Antarctique, avaient réservé leurs droits. Pour l’avenir, le Traité dispose qu’« aucun acte ou activité intervenant pendant la durée du présent Traité ne constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté territoriale dans l’Antarctique, ni ne créera des droits de souveraineté dans cette région. Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension d’une revendication de souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra être présentée pendant la durée du présent Traité ».
L’article VII met en place un régime rigoureux de contrôle, qui écarte de fait toute prétention à exercer des droits de souveraineté : chacune des « parties consultatives » au Traité a le droit de désigner des inspecteurs, qui peuvent accéder à tout moment aux installations, stations et moyens de transport situés dans l’ensemble de l’Antarctique. Les stations et les expéditions des parties doivent être l’objet de notifications mutuelles.
Il est enfin à noter que, si l’exercice des souverainetés territoriales est de fait écarté, en Antarctique, par le Traité, son article VIII institue une sorte de régime de souveraineté personnelle en disposant que les personnels envoyés par les États relèvent exclusivement de la juridiction de leur État de nationalité pour leurs actes commis en Antarctique.
C. UNE PRIORITÉ À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE QUI A PLEINEMENT PORTÉ SES FRUITS
L’article II du Traité stipule que « la liberté de la recherche scientifique dans l’Antarctique et la coopération à cette fin, telles qu’elles ont été pratiquées durant l’Année géophysique internationale, se poursuivront (…) ». À cette fin, l’article III invite les États à développer les échanges scientifiques et prévoit que les résultats scientifiques obtenus « seront rendus librement disponibles ». On peut considérer que ces prescriptions ont été respectées.
1. Les opportunités uniques offertes par l’Antarctique à la science
L’Antarctique offre aux scientifiques des opportunités dans de multiples champs : l’écologie ; l’astronomie, avec des ciels noirs la moitié de l’année et exceptionnellement purs (pas de pollution lumineuse et peu de nuages) ; le géomagnétisme, à proximité du pôle Sud magnétique ; l’atmosphère, avec l’étude du « trou dans la couche d’ozone »…
L’Antarctique est aussi le lieu de l’exploration des frontières ultimes de la vie. En 2012, le forage ultra-profond (3 769 mètres !) des scientifiques russes à Vostok a atteint le lac souterrain présent sous la calotte glaciaire, inviolé depuis des centaines de milliers d’années. Des bactéries thermophiles ont été découvertes dans la couche de regel à la surface du lac.
Il y a également les frontières extrêmes de la vie humaine. Par exemple, la base franco-italienne de Concordia, située à 1 100 kilomètres de la base côtière Dumont d’Urville, à 3 200 mètres d’altitude, offre des conditions de vie particulièrement sévères : température moyenne de – 51 °C, vent, air raréfié par l’altitude et fortement ionisé, nuit polaire, ravitaillement très difficile… La conception d’une telle base de vie, totalement isolée, peut apparaître comme anticipant d’éventuelles futures bases sur d’autres planètes. Dans le même esprit, cette base permet aussi d’étudier les conséquences pour ses personnels des conditions extrêmes, de l’isolement, de l’enfermement. La mise en place de son ravitaillement régulier, assuré par des convois terrestres, a aussi exigé l’élaboration de nouvelles techniques.
L’Antarctique apporte enfin énormément à la connaissance des climats passés de la Terre, car on y trouve les glaces les plus anciennes : sa calotte extrêmement épaisse évolue très lentement compte tenu du froid extrême (pas de fonte) et de la faiblesse des précipitations (l’accumulation des chutes de neige génère par pesanteur un écoulement des calottes glaciaires vers leur bord ; mais dans les parties centrales de l’Antarctique, il ne tombe pratiquement rien – l’équivalent de 25 millimètres d’eau par an à la station Concordia). Des forages de la calotte menés sur des sites tels que Concordia, Vostok ou Kohnen, qui permettent de remonter des carottes sur près de 3 000 mètres d’épaisseur, parfois même plus (à Vostok ou encore à Concordia, où l’on a atteint 3 270 mètres de profondeur), conduisent donc à l’extraction de glaces vieilles de plusieurs centaines de milliers d’années. Ces glaces sont analysées : on peut ainsi connaître la teneur en différents gaz, notamment à effet de serre, des bulles d’air qui y sont emprisonnées ; l’analyse isotopique (12) des molécules d’eau les composant donne quant à elle la température qui régnait alors.
La corrélation entre températures et gaz à effet de serre dans les climats du passé, telle que montrée par les glaces antarctiques
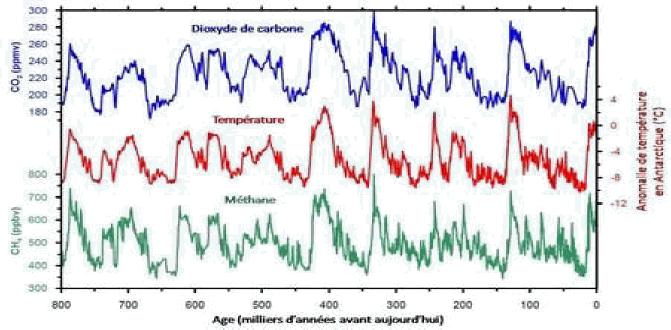
Source : Université de Berne/Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement, http://www.futura-sciences.com.
Ces travaux, menés notamment en France par Mme Valérie Masson-Delmotte, ont permis de remonter jusqu’à présent sur 800 000 ans – l’objectif étant désormais d’atteindre le million d’années. Ils sont très importants, car ils établissent une corrélation très nette entre les températures du passé et les concentrations qu’on y relève en différents gaz à effet de serre, ainsi que le montre le graphique ci-dessus. Il s’agit donc d’une démonstration expérimentale de la réalité de l’effet de serre.
2. De multiples coopérations internationales
Par ailleurs, il faut souligner que ces développements scientifiques sont, comme le traité de 1959 y incitait, effectués le plus souvent dans un cadre de coopération internationale, notamment du fait des difficultés extrêmes du milieu et des coûts qu’elles entraînent, ainsi que de l’ambition de certaines opérations : un carottage glaciaire comme ceux mentionnés supra dure des années, voire des décennies, et coûte plusieurs dizaines de millions d’euros.
Une tradition de coopération internationale, qui dépassait les blocs politiques au temps de la Guerre froide, est apparue dès les débuts de la recherche en Antarctique. Dans les années 1970, le projet IAGP (International Antarctic Glaciological Project), visant à étudier la zone comprise entre les bases de Dumont d'Urville, Mc Murdo (États-Unis) et Vostok (URSS), a impliqué des scientifiques de plusieurs nationalités. Dans les années 1980, le programme IAGO (Interaction atmosphère-glace-océan), portant en particulier sur les vents catabatiques, a été mené conjointement par la France et les États-Unis.
Aujourd’hui, Concordia est une base commune à l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) et au Programma Nazionale di Ricerche in Antartide italien, tandis qu’à Vostok s’est développée une coopération franco-russe. Quant aux forages profonds mentionnés supra à Concordia et à Kohnen, ils ont été réalisés par le consortium EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), qui regroupe dix nations européennes (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse), avec le soutien de l’Union européenne.
D. UNE DIMENSION ENVIRONNEMENTALE PROGRESSIVEMENT RENFORCÉE
Le traité initial de 1959 ne comprend pas de stipulation visant la protection de l’environnement ou concernant spécifiquement la possibilité d’exploiter les ressources économiques de l’Antarctique.
Mais il a institué un mécanisme de réunions périodiques des représentants des parties, la « réunion consultative du Traité sur l’Antarctique » (RCTA), ouverte à différentes organisations observatrices et experts. De 1961 à 1994, la RCTA s’est réunie en général une fois tous les deux ans mais, depuis 1994, elle se tient tous les ans. Elle adopte des mesures par consensus.
Dès 1964, la RCTA a adopté des mesures pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, qui ont jeté les fondements de toute une réglementation.
Des instruments internationaux complémentaires ont par ailleurs été mis en place.
1. La Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique
La Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique, ou CCAS, remonte à 1972. Elle fixe une liste d’espèces de phoques et otaries dont la capture est interdite ou contingentée (pour les ressortissants des signataires et bateaux battant leur pavillon) au sud du 60ème parallèle et met en place des mécanismes de gestion. Elle a été signée par les douze signataires initiaux du Traité de l’Antarctique (toutefois, la Nouvelle-Zélande ne l’a pas ratifiée), ensuite rejoints par l’Allemagne, le Brésil, le Canada, l’Italie et la Pologne.
2. La Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique
La Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, ou CCAMLR, a été signée à l’occasion d’une conférence internationale tenue en 1980 à Canberra.
Partant d’une préoccupation née du développement de la pêche au krill, susceptible de menacer toute la chaîne alimentaire, la CCAMLR établit de fait une organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP). Il ne s’agit pas d’interdire toute exploitation des ressources marines de l’Antarctique : le texte précise bien qu’« aux fins de la convention, le terme "conservation" comprend la notion d’utilisation rationnelle ». Cependant, ce texte a aussi le mérite de promouvoir une approche écosystémique : il ne se donne pas seulement pour objectif de préserver les stocks halieutiques, mais aussi de « maintenir les rapports écologiques entre les populations » marines et de « prévenir les modifications ou minimiser les risques de modifications de l’écosystème marin qui ne seraient pas potentiellement réversibles en deux ou trois décennies » (article II).
La CCAMLR a institué une commission qui s’appuie sur un secrétariat et un comité scientifique. La commission se réunit tous les ans. Ces institutions siègent à Hobart, en Tasmanie.
Le cœur des missions de la commission est identique à celui des organes comparables dans les autres ORGP : recueil de données sur les stocks halieutiques et les captures, élaboration de mesures de gestion, contrôle…
La CCAMLR couvre une zone qui va au-delà de celle visée par le Traité sur l’Antarctique : elle s’étend, au nord du 60ème parallèle, jusqu’à une ligne représentative de la convergence antarctique (voir supra).
Il est à noter qu’une « déclaration » de la présidence annexée au texte de la CCAMLR elle-même traite d’une question sensible, celle de la coordination entre les règles édictées dans son cadre et celles des États ayant des zones économiques exclusives (ZEE) dans la région. Cette déclaration a manifestement été négociée avec le gouvernement français car elle mentionne nommément la situation des îles Kerguelen et Crozet. Elle s’efforce d’organiser une sorte d’articulation entre les mesures de gestion prises dans le cadre de la CCAMLR et les mesures nationales applicables dans les ZEE, tout en prenant acte du droit de la France d’édicter et appliquer les règles qu’elle veut dans ses ZEE.
35 États sont parties à la CCAMLR, dont 24 membres de sa commission, ainsi que l’Union européenne. Comme pour le Traité sur l’Antarctique, on y trouve de nombreux pays occidentaux et européens, mais aussi les principaux pays pêcheurs, Corée du Sud, Japon, et émergents, notamment les membres du club des « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).
Depuis sa création, la commission de la CCAMLR a édicté de nombreuses mesures de gestion de la pêche, afin de préserve les ressources. Elle a également pris des mesures qui ont permis de limiter drastiquement la mortalité aviaire à l’occasion des opérations de pêche. Elle revendique aussi avoir obtenu des résultats significatifs dans la lutte contre la pêche illégale, dont les prises annuelles dans les eaux antarctiques seraient passées de 40 000 tonnes par an dans les années 1990 à moins de 2 000 tonnes en 2010/2011. Elle s’efforce également, avec plus ou moins de succès, de promouvoir des aires marines protégées (voir infra).
3. Le Protocole de Madrid : l’Antarctique dédiée à la science et mise à l’abri de toute exploitation minière
Une nouvelle étape a été franchie avec la signature en 1991, à Madrid, du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, qui complète le traité de 1959 pour lui donner une très forte dimension environnementale.
Ce texte avait été précédé par un autre accord international, qu’il a fait avorter, la « Convention de Wellington » (formellement Convention sur la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l’Antarctique) de 1988, qui admettait la prospection minière en Antarctique tout en l’encadrant strictement.
Le Protocole de Madrid, obtenu notamment grâce à l’action déterminée du Premier ministre d’alors Michel Rocard et de son homologue australien Bob Hawke, a stoppé cette dérive. Son article 7, très clair, interdit en Antarctique « toute activité relative aux ressources minérales, autre que la recherche scientifique ».
Plus généralement, le Protocole impose un haut niveau d’exigence en matière de préservation de l’environnement antarctique. Son préambule met en avant la « nécessité de renforcer le système du Traité sur l’Antarctique » et le fait que « le développement d’un régime global de protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés est de l’intérêt de l’humanité tout entière ». Son article 3 reconnaît la « valeur intrinsèque de l’Antarctique, qui tient notamment à ses qualités esthétiques, à son état naturel et à son intérêt en tant que zone consacrée à la recherche scientifique (…) ». Son article 2 définit l’Antarctique comme « réserve naturelle, consacrée à la paix et à la science ».
La vision globale et exigeante portée par ce texte apparaît bien à son article 3, selon lequel toutes les activités en Antarctique doivent être menées, non seulement « de façon à limiter leurs incidences négatives sur l’environnement (…) et les écosystèmes », mais aussi, les « effets négatifs sur le climat ou les systèmes météorologiques » et « sur la qualité de l’air ou de l’eau », les « modifications significatives de l’environnement atmosphérique, terrestre (y compris aquatique), glaciaire ou marin », les « changements préjudiciables à la répartition, à la quantité ou à la capacité de reproduction d’espèces ou de populations d’espèces animales ou végétales », ou encore « la dégradation, ou le risque sérieux d’une telle dégradation, de zones ayant une importance biologique, scientifique, historique, esthétique ou naturelle ».
Pour mettre en œuvre ces obligations, le Protocole impose un monitoring permanent de l’environnement (article 3) et l’évaluation préliminaire de l’impact environnemental de toute activité (article 8 et annexe I), évaluation qui peut déboucher sur une procédure de débat public et une réunion de la RCTA avant toute mise en œuvre d’une décision ayant un impact « plus que mineur ou transitoire » sur l’environnement. Le système d’inspection prévu par le Traité de l’Antarctique est étendu aux questions environnementales (article 14) et des plans d’urgence environnementale doivent être élaborés (article 15). Enfin, la gestion des déchets (annexe III) et la prévention des pollutions marines (annexe IV) sont strictement réglementées.
Le Protocole, s’inscrivant dans le « système » du Traité sur l’Antarctique, est suivi et mis en œuvre, comme celui-ci, par les réunions périodiques de la RCTA. Il a également créé un comité pour la protection de l’environnement.
Il a été ratifié par 37 des 50 États qui sont parties au Traité sur l’Antarctique (dont toutes les « parties consultatives », donc tous les États ayant une activité réelle en Antarctique, ce qui était d’ailleurs la condition de son entrée en vigueur).
La préoccupation autour du changement climatique est prise en compte dans les travaux récents de la RCTA, bien que certains États membres soient plus ou moins « climato-sceptiques ». Ainsi, la déclaration ministérielle adoptée en 2009 à l’occasion du 50ème anniversaire du Traité sur l’Antarctique comporte-t-elle l’engagement de principe d’« œuvrer ensemble pour mieux comprendre les changements dont fait l’objet le climat de la planète Terre et de chercher activement les moyens de combattre les effets des changements climatiques et écologiques sur l’environnement en Antarctique ».
Ces dernières années, la RCTA a également pris position sur la question sensible de la propriété des résultats de la recherche biologique. En effet, les conditions environnementales très rigoureuses qui règnent dans l’Antarctique ont amené de nombreuses espèces de faune et de flore et des micro-organismes à se doter de caractéristiques et capacités uniques qui peuvent être utilisées pour les avancées biotechnologiques. En 2005, lors de la XXVIIIème session de la RCTA, une résolution a été adoptée pour inviter les États à rappeler à leurs chercheurs se livrant à des activités de prospection biologique dans l’Antarctique les dispositions du Traité sur l’Antarctique qui promeuvent les échanges scientifiques et surtout prévoient la libre disponibilité des résultats des recherches.
Même si le « système » du Traité sur l’Antarctique paraît remarquablement protecteur et solide, il existe plusieurs motifs de s’inquiéter pour l’avenir.
A. LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME
Le tourisme est mentionné dans le texte du Protocole de Madrid et fait donc partie des activités autorisées en Antarctique.
Depuis les premières expéditions commerciales dans les années 1950, il a connu une croissance constante. La grande majorité des touristes se rendent à bord de navires dans la péninsule Antarctique, une région qu’il est possible d’atteindre en quelques jours depuis l’Amérique du Sud. C’est en 1977 qu’ont commencé les vols réguliers transportant des touristes depuis l’Australie. Ce tourisme reste certes limité, mais significatif pour un espace préservé de ma présence humaine et fragile comme l’Antarctique : il y aurait eu 46 000 touristes en 2007-2008 – alors que même en été, l’effectif total sur les bases scientifiques de l’Antarctique, chercheurs et personnels chargés de la logistique, ne dépasse pas 5 000.
La RCTA s’est préoccupée de cette évolution et a adopté à plusieurs occasions, à partir de 1994, des recommandations ou lignes directrices pour encadrer l’activité touristique.
Les voyagistes opérant dans l’Antarctique sont pour la plupart regroupés dans l’Association internationale des organisateurs de voyages dans l’Antarctique (IAATO), qui prend part à la RCTA en qualité d’expert invité. Cette forme d’autorégulation suscite chez les observateurs des réactions mitigées : elle a le mérite d’exister, mais n’est peut-être pas aussi rigoureuse qu’une régulation externe le serait.
Outre la question des atteintes à l’environnement – qu’il s’agisse de celles résultant de la seule présence de nombreux humains, même respectant les consignes les plus strictes, des rares cas de vandalisme ou des éventuels accidents –, le développement du tourisme antarctique pose la question de la sécurité et des secours en cas de problème dans un milieu extrême et avec des moyens nécessairement limités et souvent très lointains. Ce point a clairement été illustré lorsqu’en décembre 2013 les passagers du navire russe Akademik-Chokalskiy se sont retrouvés bloqués par les glaces : l’envoi de navires de secours, ne pouvant reposer que sur le déroutement des navires assurant le ravitaillement des bases scientifiques des différents pays, a désorganisé celui-ci, alors même que ce ravitaillement est complexe à gérer car il doit être opéré durant la courte période d’été austral. Quant au coût du déroutement de plusieurs de ces navires, dont la plupart n’ont finalement pas participé aux secours, il est resté à la charge des instituts de recherche nationaux concernés.
B. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE
La dureté des conditions et les distances à parcourir ont longtemps protégé les eaux antarctiques de la surpêche. L’exploitation massive de certaines ressources halieutiques est cependant devenue un problème depuis les années 1970. Dans ce contexte, la création d’aires marines protégées devient une nécessité, mais est difficile à imposer face aux intérêts économiques.
1. Les principales ressources halieutiques des eaux antarctiques
Les ressources marines vivantes de l’océan Austral sont exploitées depuis 1790, date à laquelle les chasseurs ont commencé à capturer les otaries pour leur fourrure, puis les éléphants de mer, voir certaines espèces de manchots. La chasse au phoque est très fortement encadrée depuis 1978 par la CCAS.
C’est en 1904 qu’a débuté la chasse à la baleine, aujourd’hui prohibée au niveau mondial.
Compte tenu des difficultés du terrain et des coûts, la pêche industrielle moderne dans les eaux antarctiques s’est concentrée sur quelques ressources spécifiques et particulièrement intéressantes.
● Le « poisson des glaces » a été intensément exploité dans les années 1970 et 1980. Depuis les années 1990, sa pêche est interdite ou, selon les zones et les années, autorisée en faible quantité et les prises sont donc faibles.
● Le calmar et le crabe ont également été pêchés.
● Le krill antarctique, formé par les essaims compacts de la crevette Euphausia superba, est la nourriture de base de nombreuses baleines et joue un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire des eaux antarctiques.
Sa pêche, assurée par une poignée de bateaux-usines venus de quelques grands pays pécheurs du monde entier (Norvège, Pologne, Russie, Chine, Corée du Sud et Japon), est en augmentation depuis quelques années, ce qui préoccupe des organisations de défense de l’environnement. Il faut toutefois observer que les niveaux actuels de prises restent très en deçà de certains records du passé et surtout des plafonds fixés par la CCAMLR. D’après les statistiques de cette dernière, le tonnage de krill antarctique remonté annuellement avoisinait régulièrement les 400 000 tonnes, voire parfois 500 000, au début des années 1980, puis dans les années 1986-1991, avant de connaître un effondrement à moins de 100 000 tonnes, puis une lente remontée qui a conduit au niveau actuel de l’ordre de 200 000 tonnes par an. Dans le même temps, le quota annuel maximal alloué est de plus de 3 millions de tonnes (sachant que la biomasse de l’ensemble du stock est parfois estimée à 500 millions de tonnes).
● La légine, avec ses deux espèces « australe » et « antarctique », est un poisson prédateur de grande taille (jusqu’à deux mètres) dont la chair est très appréciée en Asie orientale, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, de sorte qu’elle se négocie plusieurs dizaines d’euros le kilo. C’est un poisson des grands fonds (1 200 à 1 800 mètres de profondeur, parfois plus). Sa pêche a commencé à se développer dans les années 1980. Dans les années 1990, la pêche illégale pesait peut-être cinq ou six fois plus lourd que la pêche déclarée.
Depuis le début des années 2000, le niveau des prises déclarées s’est stabilisé, dans les eaux couvertes par la CCAMLR, à un niveau proche du maximum autorisé dans ce cadre (de l’ordre de 18 000 tonnes par an). Cette pêche, visant l’un des principaux prédateurs des mers australes, risque de déséquilibrer des milieux marins qui restaient, jusqu’à présent, parmi les mieux préservés de la Terre, même si la commission de la CCAMLR revendique par ailleurs une très forte diminution de la pêche illégale.
2. Les aires marines protégées, une réponse nécessaire mais qui a du mal à s’imposer
La spécificité, la richesse et le degré de préservation des écosystèmes marins antarctiques justifient qu’ils soient protégés contre tout risque de surpêche, voire que certaines zones soient mises à l’abri de toute exploitation.
En 2008, la commission de la CCAMLR s’est engagée à créer un système d’aires marines protégées (AMP). En 2009, effectivement, une première AMP a été désignée, autour des îles Orcades du Sud, sur une superficie de 94 000 km2.
En 2012, à l’occasion de la réunion de la commission à Hobart, deux nouveaux projets d’AMP ont été proposés :
– par la France et l’Australie, un système de sept AMP qui couvriraient 1,6 million de km2 au large de l’Antarctique orientale ;
– par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, une AMP de 1,3 million de km2 en mer de Ross.
Bien que le projet franco-australien ait été revu à la baisse (réduction de la superficie à un million de km2, concessions sur la pêche), ces deux projets, qui devaient être adoptés à l’unanimité de la commission, n’ont fait consensus ni à la réunion de 2013, ni à celle d’octobre 2014. Ils se sont notamment heurtés à l’opposition de la Russie et de l’Ukraine, qui ont invoqué diverses raisons plus ou moins fondées : le bilan de l’AMP existante près des îles Orcades du Sud ne serait pas probant, en l’absence de tout rapport de suivi ; les frontières des AMP proposées, rectangulaires, ne tiendraient pas compte des réalités des écosystèmes, voire dissimuleraient des intentions de contrôle géopolitique ; la création de telles aires serait susceptible de porter atteinte à la liberté de la navigation et à celle de la recherche océanographique et dépasserait donc la compétence de la commission CCAMLR (elle devrait être négociée avec l’Organisation maritime internationale et la RCTA du Traité sur l’Antarctique)…
C. LES VELLÉITÉS D’EXPLOITATION DES RESSOURCES DU SOUS-SOL
Comme on l’a dit, après les tentatives des années 1980 d’autoriser la prospection minière en Antarctique, concrétisées en 1988 par la signature de la Convention de Wellington, le Protocole de Madrid a stoppé net ces velléités en 1991.
Pourtant, les richesses potentielles de l’Antarctique continuent à faire rêver, même si elles ont très peu été expertisées. Le continent Antarctique n’est-il pas issu du super-continent du Gondwana, où il avoisinait des terres aussi riches en métaux rares et pierres précieuses que l’Afrique australe ou l’Australie ? En 2013, la presse s’est faite l’écho de la découverte, en Antarctique orientale, par des scientifiques australiens, de kimberlite, roche généralement associée aux gisements de diamants…
Certains États n’ont manifestement pas renoncé à la perspective de cette exploitation, notamment la Russie, laquelle a récemment lancé un ballon d’essai qui a suscité peu de réactions : dans un document présenté à la session de 2011 de la RCTA (13), il était mentionné que l’un des objectifs du plan de développement en Antarctique de ce pays à l’horizon 2020 était de « renforcer la capacité économique de la Russie grâce à l’utilisation de ressources biologiques marines disponibles dans l’océan Austral et aux investigations complexes portant sur les ressources minérales, en hydrocarbures et autres ressources naturelles de l’Antarctique ».
Il a donc clairement été écrit que les ressources du sous-sol de l’Antarctique sont susceptibles d’être mises au service de l’économie russe. La vigilance est de rigueur.
D. LES LIMITES DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL ACTUEL
Les dernières préoccupations portent sur la solidité même du cadre juridique constitué par les instruments internationaux qui forment le « système de l’Antarctique ».
Deux observations sont souvent faites.
● La première pointe une faiblesse inhérente à tous les engagements internationaux : ils ne s’imposent qu’aux États qui les ont signés et ratifiés. Or, comme on l’a vu, les différents textes formant le système de l’Antarctique ne l’ont été que par une minorité des États de la planète : au maximum 50 (pour le Traité sur l’Antarctique) sur près de 200. Donc les autres États et leurs ressortissants ne sont pas tenus de respecter les prescriptions de ces textes.
Cela dit, en pratique, la portée de cette faille reste, au moins pour le moment, limitée, car, comme on l’a vu, à peu près tous les États ayant une population importante et/ou une puissance économique significative ont adhéré au système. Ces États regroupent l’essentiel de la population et plus encore du potentiel économique du monde, probablement la quasi-totalité du potentiel d’accès à l’Antarctique, compte tenu des moyens financiers et techniques que cela demande. Au fil des ans, c’est plutôt à une course à la création de « bases antarctiques » plus ou moins actives que l’on a assisté de la part d’États désireux de justifier du minimum d’activités sur place qui donne accès au statut de « partie consultative » du Traité sur l’Antarctique.
Jusqu’à présent, les nouvelles puissances entrant dans la course à l’Antarctique ont joué le jeu en inscrivant leur action dans le système du Traité, même si cette action n’est jamais dépourvue de préoccupations de prestige national. Par exemple, lorsque la Chine a voulu créer sa station antarctique Kunlun, inaugurée en 2009, elle a conduit les démarches d’études préalables et de consultations de la RCTA prévues par les traités, même si certaines caractéristiques de cette base ont suscité quelques interrogations : le choix d’un site situé plus haut en altitude (plus de 4 000 mètres !) que toutes les autres stations ; un nom « patriotique » qui fait référence à l’une des principales chaînes de montagne de Chine ; voire, selon certains témoignages rapportés dans la presse, la présence sur place d’une inscription souhaitant « Bienvenue en Chine » qui serait bien peu conforme à la lettre et à l’esprit du Traité sur l’Antarctique…
Pour autant, la question des États « hors système » se pose au moins dans un cas (qui n’est pas propre à l’Antarctique), celui des navires (de pêche en l’espèce) sous pavillon de complaisance qui prétendent ainsi échapper aux règles communes.
● La seconde observation concerne le risque de remise en cause du système, en particulier de l’interdiction des activités minières, en 2048.
Cette crainte provient de la rédaction de l’article 25 du Protocole de Madrid, lequel stipule que cinquante ans après son entrée en vigueur, donc effectivement en 2048, une conférence internationale devra être organisée pour réviser le texte initial si l’un (au moins) des États ayant le statut de « partie consultative » le demande.
Cependant, on constate à la lecture de cet article 25 que de solides verrous sont mis :
– un amendement au Protocole décidé lors de ladite conférence ne pourrait entrer en vigueur qu’avec l’approbation des trois-quarts des « parties consultatives », dont la totalité des États qui avaient ce statut au moment de la signature du Protocole en 1991, lesquels (dont bien sûr la France) auront donc un droit de veto ;
– si cet amendement concernait l’interdiction des activités minières (article 7 du Protocole), il ne pourrait être accepté que s’il était mis en place un régime alternatif d’encadrement de celles-ci.
Plus que la question de l’échéance de 2048, c’est peut-être celle de la faiblesse inhérente à tout accord international dépourvu d’un système suffisant d’intégration et de sanctions qui se pose : même si le Traité de 1959 ou le Protocole de Madrid ne prévoient pas formellement la possibilité de retrait d’un signataire, on ne voit pas ce qui empêcherait un grand État désireux de faire « cavalier seul » de sortir du système. Mais, on l’a dit, rien ne laisse présager pour le moment un tel comportement, hormis peut-être les petits « coups de canif » parfois tentés par certains.
*
Au regard des résultats remarquables obtenus pas le système du Traité sur l’Antarctique, votre rapporteur ne peut que souhaiter qu’il perdure. Cependant, le développement des activités économiques à la périphérie de l’Antarctique – pêche et tourisme – entraîne des dégradations. De plus, le risque de remise en cause future du dispositif par certains des grands acteurs mondiaux qui y adhèrent aujourd’hui apparaît réel, lorsque l’on voit des « ballons d’essai » tels que le document russe précité envisageant plus ou moins une exploitation minière future. Il est donc important de conforter le statut de l’Antarctique par une mobilisation continue de l’opinion publique.
TROISIÈME PARTIE : L’ARCTIQUE, UN STATUT À CONSTRUIRE
Le recul rapide des glaces, consécutif au réchauffement climatique, réveille logiquement des appétits d’exploitation des potentialités des régions et des eaux arctiques : navigation, mines, hydrocarbures, pêche… La réalité de ces opportunités demande certes souvent à être vérifiée.
Quoi qu’il en soit, il est cependant clair que la mise en place d’une gouvernance internationale de l’Arctique n’en est que rendue plus urgente. Cette gouvernance existe déjà d’une certaine manière, d’une part à travers la mise en œuvre du droit international de la mer, d’autre part à travers une institution régionale, le Conseil arctique, qui a été créé dans les années 1990 avec un programme louable de protection de l’environnement et de prise en compte des droits des peuples autochtones. Mais les résultats obtenus jusqu’à présent par cette instance sont limités par sa nature même, car il s’agit d’un forum intergouvernemental dont le fonctionnement est fondé sur le consensus, tandis que les questions les plus déterminantes restent de la seule compétence des États arctiques.
I. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES : UNE NOUVELLE « RUÉE VERS L’OR » ?
L’épuisement progressif des ressources naturelles plus faciles à exploiter (car localisées sous des climats plus cléments) et les perspectives offertes par le réchauffement climatique, avec le recul des glaces et le progrès des eaux libres qui l’accompagne, suscitent depuis quelques années une sorte d’emballement médiatique pour les richesses de l’Arctique.
La réalité est cependant beaucoup plus nuancée, comme le démontre l’abandon régulier (ou la mise en sommeil) de tel ou tel grand projet d’exploitation minière ou pétrolière en Arctique qui avait été annoncé comme devant répondre pour des années à la demande mondiale.
En fait, l’histoire se répète, car celle des régions arctiques est tissée de l’alternance d’emballements pour des richesses inexploitées suivis de périodes de repli et d’abandon, soit que la ressource visée ait été épuisée, soit qu’elle soit apparue trop difficile à exploiter dans les conditions extrêmes du grand nord, soit encore qu’elle ait perdu son caractère stratégique… C’est ainsi que successivement les fourrures précieuses – que ce soit en Amérique du Nord ou en Russie –, les défenses de narval prises pour des cornes de licorne, l’huile de baleine, les fourrures de phoque, la morue, l’or du Klondike ou encore le charbon du Svalbard ont suscité passions, « ruées vers l’or », puis désintérêt.
A. LES PERSPECTIVES DE LA PÊCHE : À LA POURSUITE DES STOCKS HALIEUTIQUES
La pêche dans les eaux arctiques ou proches de l’Arctique est ancienne, puisque les pêcheurs européens s’aventurent dans la mer de Barents depuis le XVIIIème siècle.
Toutefois, comme on peut le voir sur la carte qui suit, qui montre la situation dans les années 2000, cette pêche reste relativement modeste, puisque le tonnage des prises est tout au plus de l’ordre de 7 millions de tonnes, sur un total mondial qui avoisine les 100 millions de tonnes. De plus, cette pêche est essentiellement réalisée dans un nombre limité de zones, en périphérie de l’Arctique : la mer de Béring, qui appartient à l’océan Pacifique et non à l’océan Arctique ; les eaux situées à la jonction des océans Atlantique et Arctique, du Groenland à la mer de Barents.
Les principales espèces exploitées sont le colin d’Alaska en mer de Béring, le capelan, le hareng et la morue dans les eaux aux confins de l’Atlantique et de l’Arctique, enfin la crevette nordique dans la baie de Baffin, à l’ouest du Groenland.
Dans le cœur de l’océan Arctique et dans ses parties riveraines de la Sibérie et de l’Amérique du Nord (mers de Beaufort, des Tchouktches, de Laptev, de Kara…), l’activité de pêche est pour le moment insignifiante, ce qui n’a rien de surprenant, puisqu’il s’agit encore, aujourd’hui, d’eaux couvertes par les glaces de manière continue ou quasi-continue. De plus, des moratoires nationaux sont en place dans certaines zones, notamment à l’initiative des États-Unis et du Canada.
Cependant, la progression des activités de pêche dans l’Arctique est une réalité. Dans une publication récente (14), des chercheurs canadiens observent ainsi que, dans les eaux arctiques sous juridiction de leur pays, les passages de navires de pêche ont augmenté de 30 passages en 2005 à 275 en 2011.
Au-delà, les auteurs de cet article s’interrogent sur la probabilité d’une forte croissance des activités de pêche dans les zones jusqu’à présent épargnées, telles que la mer de Beaufort et la partie centrale de l’océan Arctique, croissance qui accompagnerait le recul des glaces. La réponse est pour le moment incertaine, notamment parce que les stocks halieutiques présents semblent mal documentés ; de même, on ne sait pas trop si le réchauffement climatique serait de nature à les favoriser, ce que certaines sources anticipent. Si on constate, aujourd’hui, dans l’Atlantique-Nord, le déplacement de certaines espèces très recherchées vers des eaux plus septentrionales du même océan, il n’est pas certain que ce phénomène continue et conduise à terme à un accroissement des ressources de l’océan Arctique lui-même. Par ailleurs, même si la banquise recule, la présence dans les eaux de morceaux de glace de mer, qui peuvent détruire les filets, restera encore plus difficile à gérer pour une activité de pêche que pour la navigation en général.
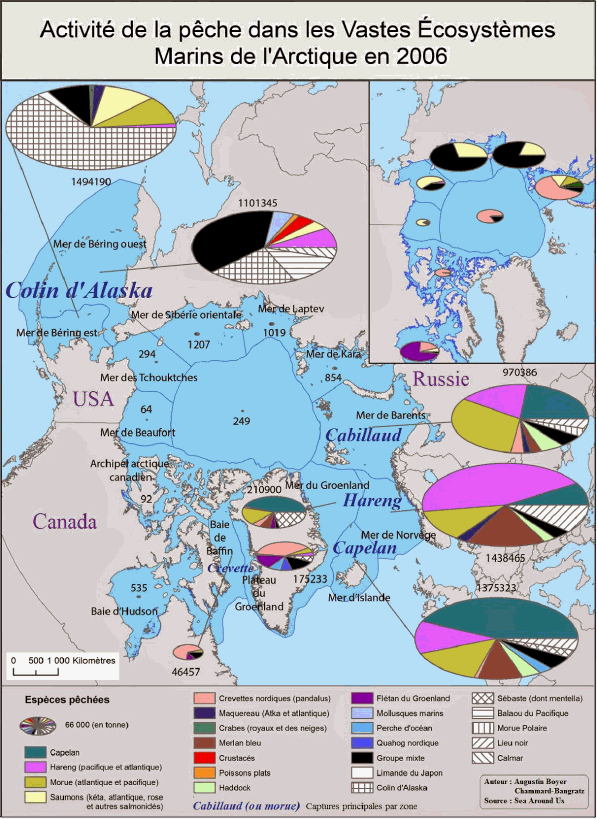
Source : « Quel cadre réglementaire pour la pêche dans l’océan Arctique ? », 31 janvier 2014, par Augustin Boyer et Frédéric Lasserre, Université Laval, publié par CIRRICQ.
S’agissant du cœur de l’océan Arctique, les auteurs de l’étude citent une source du ministère norvégien des pêches selon laquelle le développement de la pêche y serait improbable, car il s’agit d’eaux profondes où l’on pourrait principalement capturer des morues polaires et des requins du Groenland, espèces dont la valeur économique est faible (et effectivement peu recherchées aujourd’hui).
D’autres ressources halieutiques pourraient cependant s’avérer plus intéressantes pour les pêcheurs, notamment le krill qui est actuellement pêché surtout dans les eaux de l’Antarctique. Or, observent les auteurs, la distance entre les ports d’attache asiatiques des pêcheurs de krill et les eaux arctiques est de l’ordre de 8 000 kilomètres « seulement », contre 12 000 pour les eaux antarctiques ; cette distance serait encore plus faible depuis la Norvège ou la Russie, autres pays actifs dans cette pêche… Bref, l’incertitude reste grande quant aux perspectives potentielles de la pêche dans l’Arctique.
B. LES HYDROCARBURES : UN POTENTIEL THÉORIQUE ÉNORME, MAIS UNE EXPLOITATION ENCORE LIMITÉE
Depuis quelques années, les medias présentent communément l’Arctique comme un futur eldorado pétrolier et plus encore gazier. Il y a une sorte d’effet de mode en la matière, qui est né principalement du retentissement d’une publication d’une agence gouvernementale américaine, l’US Geological Survey (USGS), dont en 2008 une étude (15) a positionné l’Arctique comme une région stratégique sur le plan énergétique. D’après ce document, l’Arctique (les terres et les eaux situées au-delà du cercle polaire arctique) renfermerait jusqu’à 650 milliards de barils équivalents pétrole (BEP) d’hydrocarbures « conventionnels », dont 235 milliards de BEP de réserves connues (10 % du total mondial) et environ 412 milliards de BEP de ressources non découvertes (13 % du pétrole et 30 % du gaz qui resteraient à découvrir sur la planète). Pour entrer plus dans le détail, selon cette étude :
– plus de la moitié du gaz naturel encore à découvrir en Arctique serait concentré dans l’est de la mer de Barents et le bassin de Sibérie occidentale, la troisième zone potentiellement très riche étant l’Alaska et ses eaux côtières (mer de Beaufort) ;
– l’Alaska et ses eaux concentreraient également le tiers des réserves de pétrole encore à découvrir dans l’Arctique, les autres régions potentiellement prometteuses étant le bassin « amérasien » (au nord du Canada), les côtes ouest et est du Groenland, la mer de Barents et la Sibérie. Le gaz serait donc plutôt dans l’Arctique russe et le pétrole dans l’Arctique nord-américain (Groenland compris, celui-ci étant géographiquement nord-américain) ;
– 84 % de ces ressources arctiques à découvrir seraient en off-shore.
Il est cependant nécessaire de relativiser la portée de cette étude pour deux raisons : d’une part, parce qu’elle ne fait qu’évaluer sommairement, dans le cadre d’une analyse géologique à grande échelle, des ressources potentielles, qui restent donc à explorer, trouver et confirmer avant une éventuelle exploitation ; d’autre part, parce que l’on n’a pas attendu les années 2000 pour rechercher des hydrocarbures dans le grand nord, mais qu’heureusement l’exploitation en reste difficile et donc limitée.
En fait, la recherche d’hydrocarbures dans les régions arctiques s’est développée assez naturellement dans la continuité des gisements exploités plus au sud :
– l’URSS a commencé à exploiter ses gisements de Sibérie occidentale, qui restent à ce jour les plus productifs de Russie, dans les années 1960, et l’exploration a progressé pas à pas vers le nord, vers la péninsule de Iamal et les eaux de la mer de Kara qui la bordent ;
– les gisements de gaz et de pétrole de Prudhoe Bay, au nord de l’Alaska, étaient connus dès les années 1920 et ont été mis en exploitation dès les années 1970, après la construction d’un oléoduc permettant l’enlèvement du pétrole depuis le port de Valdez, au sud de l’état ;
– en mer du Nord, l’exploitation off-shore a débuté en 1971. Elle a ensuite gagné la mer de Norvège, avec notamment le champ de gaz norvégien d’Ormen Lange, exploité depuis 2007, puis la mer de Barents.
Aujourd’hui, l’exploitation off-shore des hydrocarbures au-delà du cercle polaire reste toutefois limitée, seule une poignée de gisements ayant été mis en production :
– le champ pétrolier de Prudhoe Bay en Alaska, exploité par British Petroleum ;
– le champ gazier de Snøhvit, en mer de Barents, à 140 kilomètres des côtes norvégiennes, exploité depuis 2007 sous la responsabilité de Statoil ;
– le champ pétrolier de Prirazlomnoïe, découvert en 1989 au sud-est de la mer de Barents, qui a livré au printemps 2014 sa première production.
Certains gisements ont été exploités puis abandonnés, comme le champ pétrolier de Bent Horn, dans l’Arctique canadien.
Il faut noter que, dans la période la plus récente, plusieurs projets pourtant annoncés comme majeurs, car il s’agissait d’exploiter des ressources réputées fabuleuses, ont été, sinon définitivement abandonnés, du moins stoppés. Il en est ainsi du projet d’exploitation du champ gazier de Chtokman, situé dans la partie russe de la mer de Barents et présenté comme un gisement géant qui concentrerait 2 % des réserves mondiales de gaz, qu’un consortium international mené par Gazprom et comprenant aussi Total et Statoil envisageait de mettre prochainement en exploitation : ce projet est mis en sommeil depuis 2012 au regard des difficultés et des coûts afférents à l’exploitation d’un gisement localisé à 600 kilomètres des côtes sibériennes, au cœur de l’océan Arctique.
La même année 2012, s’agissant de l’exploitation pétrolière, le PDG d’alors de Total, M. Christophe de Margerie, annonçait que son entreprise y renonçait dans l’Arctique, compte tenu des dégâts qu’y ferait une éventuelle marée noire et des répercussions qu’elle aurait sur l’image de l’entreprise.
De même, en 2013, plusieurs compagnies pétrolières (successivement Shell, Statoil et ConocoPhillips) qui avaient commencé ou programmé des forages d’exploration en mer des Tchouktches, au nord-ouest de l’Alaska, y ont renoncé suite à des problèmes techniques ou en invoquant l’incertitude sur les réglementations applicables. C’est également en Alaska que l’action des organisations de défense de l’environnement et de certaines communautés autochtones a, jusqu’à présent, protégé la région côtière de l’Arctic National Wildlife Refuge, vaste réserve située dans le nord-est de l’état, de la prospection pétrolière, malgré des réserves présentées comme considérables et des tentatives réitérées de remettre en cause cette protection qui existe depuis un demi-siècle. Enfin, en décembre 2014-janvier 2015, plusieurs décisions ou annonces du président Barack Obama ont élargi les zones protégées en Alaska et dans les eaux avoisinantes.
Ces décisions d’élargissement des zones protégées, de retrait ou de suspension de projets s’inscrivent dans un contexte de faiblesse récurrente du prix de gros du gaz en Amérique du Nord depuis 2009, à cause de la montée rapide en puissance de la production de gaz non conventionnel (dit souvent « de schiste »). En 2014, après plusieurs années de déphasage entre les marchés (du fait notamment des conséquences de la catastrophe de Fukushima), cette tendance baissière s’est propagée à l’Europe et à l’Asie. Elle concerne aussi, désormais, les marchés pétroliers, où les cours se sont effondrés pendant le second semestre de 2014. À court terme au moins, cette situation devrait limiter les projets de prospection dans l’Arctique.
Aléas économiques, concurrence des hydrocarbures non conventionnels, difficultés techniques, prise en compte des coûts et pression indirecte (faisant augmenter le coût économique d’une éventuelle marée noire pour les compagnies) des organisations de défense de l’environnement et de l’opinion publique concourent donc, dans le contexte actuel, pour décourager l’exploitation massive des hydrocarbures dans l’Arctique.
Mais bien sûr, à moyen terme, cette exploitation massive, qui serait catastrophique pour l’Arctique, reste une possibilité. Il faut être conscient que les dommages liés à l’exploitation économique – qu’il s’agisse de la surpêche ou des marées noires qui surviennent inéluctablement dans les zones pétrolières – sont peut-être moins systémiques, mais beaucoup plus certains et à plus court terme que ceux qui résulteront du réchauffement climatique.
Ressources minières et énergétiques de l’Arctique
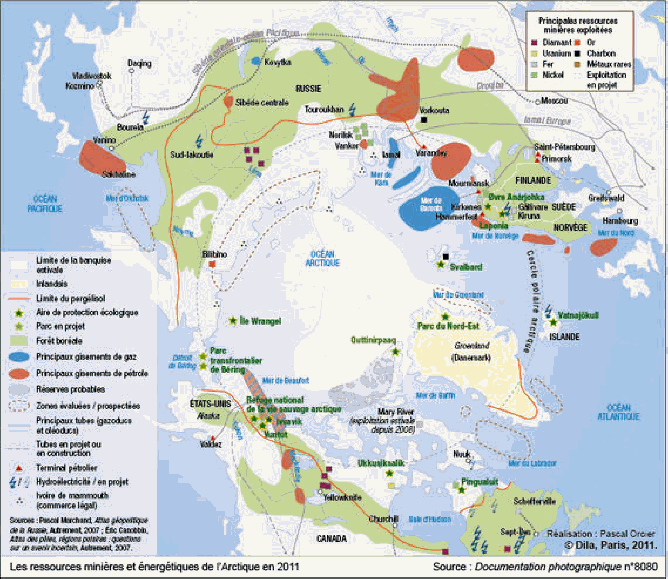
Source : La documentation française.
C. LES AUTRES RESSOURCES MINIÈRES : UNE EXPLOITATION ANCIENNE MAIS EN DENTS DE SCIE
Depuis la ruée vers l’or du Klondike de 1896, les ressources minérales des régions arctiques ont été largement exploitées, mais rarement de manière constante : de nombreuses mines ont été ouvertes puis fermées. De nos jours, l’exploitation minière reste cependant active, tandis que de grands projets sont lancés.
● Dans le nord-ouest de l’Alaska, la mine de Red Dog est l’une des plus grandes mines de zinc et de plomb du monde, exploitée depuis 1989.
● Le Canada valorise aussi les ressources de ses régions nordiques. Il est ainsi devenu en quelques années un producteur majeur de diamants (au 4ème rang mondial en 2012) grâce à l’exploitation de gisements situés dans les Territoires du Nord-Ouest, tels que ceux d’Ekati et Diavik depuis 1998. Il est de même le 5ème producteur mondial de nickel du fait, notamment, de la mine de nickel de Voisey’s Bay, exploitée depuis 2002 sur la côte nord du Labrador. D’autres projets d’exploitation de dépôts riches en nickel et en cuivre sont en cours de mise en œuvre, comme celui de Darnley Bay.
Comme on le voit sur la carte ci-après, la prospection se poursuit toujours plus au nord. Sur l’île de Baffin, par exemple, des gisements de fer, d’or, de saphirs ont été mis à jour. La mine de fer de Mary River a débuté ses opérations en septembre 2014 et devrait expédier du minerai à partir de 2015, avec un objectif d’extraction de 18 millions de tonnes de minerai par an.
Cela dit, les difficultés de l’exploitation dans les conditions polaires et l’épuisement des gisements ont aussi conduit à l’abandon de certaines mines. Ainsi, en 2002, les deux mines canadiennes qui se trouvaient alors au nord du cercle polaire ont-elles été fermées (16).
Les ressources minières du nord canadien
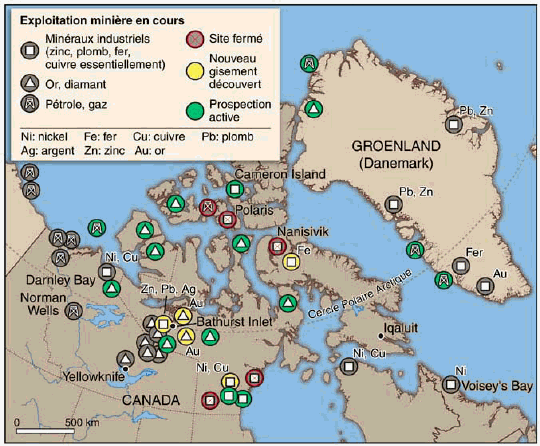
Source : « L’exploitation des ressources naturelles du sous-sol dans l’Arctique : vers une rapide expansion ? », par Frédéric Lasserre et Caroline Rivard, de l’Université Laval, 2007.
● Le Groenland a connu l’exploitation minière dès le XIXème siècle, avec l’extraction de la cryolite – minerai utilisé en particulier dans le processus de traitement du minerai d’aluminium – à Ivittuut. Cependant cette mine a été fermée en 1987. Par ailleurs, une mine de plomb et zinc a été exploitée à Mestersvig de 1953 à 1959 et une mine de plomb, zinc et argent à Maarmorilik de 1973 à 1990. De nombreuses autres minerais sont également présents (fer, or, molybdène, charbon, platine…).
Aujourd’hui, l’attention se porte surtout sur l’uranium et les « terres rares », famille de métaux qui lui sont souvent associés dans les gisements et qui sont stratégiques pour un certain nombre d’industries de haute technologie souvent liées à la transition énergétique (éoliennes, véhicules électriques et potentiellement à hydrogène, écrans, lasers…) : le Groenland disposerait de réserves considérables, alors même que la production des terres rares est actuellement excessivement concentrée en Chine, ce qui a permis à ce pays de mener une sorte de guerre commerciale contre les pays occidentaux en limitant ses exportations. En octobre 2013, le parlement groenlandais a mis fin à la prohibition de l’extraction de l’uranium sur son sol, ouvrant la voie non seulement à l’exploitation de ce métal, mais aussi des terres rares que l’on peut trouver avec lui. Un très important dépôt a en particulier été identifié à Kvanefjeld près de Narsaq : il pourrait s’agir du plus grand gisement mondial de terres rares et également d’un des plus grands d’uranium. Une compagnie minière australienne (Greenland Minerals and Energy Limited) en prépare la mise en production : une licence va être demandée en 2015 en vue de commencer la construction des installations en 2016.
Même si, aujourd’hui, les partisans de l’exploitation minière semblent l’emporter, la société groenlandaise reste toutefois divisée quant à l’intérêt de celle-ci, car la fermeture dans le passé d’un certain nombre de mines en a démontré l’absence de pérennité, tout en laissant des pollutions locales qui, elles, perdurent.
● Le nord de la Scandinavie est riche en fer, avec notamment les mines de Kiruna en Suède.
● La Russie, enfin, n’est pas en reste. Du nickel, du charbon, du cuivre et du fer sont extraits des mines de la péninsule de Kola. En Sibérie, le très important gisement de nickel, cuivre et palladium de Norilsk a été mis en valeur dès les années 1930 en utilisant la main d’œuvre du Goulag ; avec 200 000 habitants environ, Norilsk reste l’une des plus grandes villes côtières de l’océan Arctique. Les diamants proviennent de la vallée de la Lena. L’or et l’étain sont exploités dans le nord-est sibérien.
D. DE NOUVELLES VOIES MARITIMES ?
Dès le XVIème siècle, peu après la découverte de l’Amérique, les navigateurs européens, engagés dans la recherche de la route la plus rapide vers les richesses de l’Asie orientale, ont cherché à contourner par le nord, soit le continent américain, soit l’Eurasie. Leurs noms – Barents, Frobisher, Béring… – sont d’ailleurs devenus des toponymes qui désignent mers, détroits ou îles des régions arctiques qu’ils ont découvertes. Mais les difficultés rencontrées, du fait de la présence permanente ou presque de glace sur une partie de ces routes, ont retardé la réalisation de ces circumnavigations : ce n’est qu’en 1879 qu’Adolf Erik Nordenskjöld a pu passer de l’Atlantique au Pacifique en longeant les côtes de la Sibérie, ouvrant ainsi le « passage du Nord-Est » (ou « route du Nord »), et en 1906 que Roald Amundsen est parvenu au terme de sa navigation au nord du Canada et de l’Alaska, ouvrant le « passage du Nord-Ouest ».
Ces exploits n’ont pas été suivis du développement d’une navigation courante sur ces nouvelles routes maritimes, tant elles sont alors apparues comme difficiles et incertaines, même si, progressivement, le déploiement de brise-glaces de plus en plus puissants, notamment ceux à propulsion nucléaire qui faisaient la fierté de l’URSS, a permis de viabiliser, au moins à certaines périodes, des bouts de ces itinéraires.
Le réchauffement climatique a réveillé le vieux rêve de routes maritimes arctiques qui permettraient de commercer à moindres frais entre l’Atlantique-Nord et le Pacifique-Nord. De fait, le recul de la banquise arctique estivale permet de rendre de plus en plus souvent navigables les deux routes, même si ce n’est pour le moment que pendant quelques semaines en fin d’été tout au plus. Des images satellites prises fin août 2011 montraient ainsi, de manière inédite, que les deux passages étaient alors libres de glaces au même moment.
Et, comme on peut le voir sur le tableau ci-après, le passage du Nord-Est est effectivement plus court pour les liaisons entre l’Europe du nord (Rotterdam) et la plupart des ports du Pacifique, que ce soit du côté asiatique ou du côté nord-américain. Pour la Chine (Shanghai), le gain est de l’ordre de 4 000 kilomètres, soit 20 %, par rapport à la route classique par Suez et Singapour. Le passage du Nord-Ouest est également susceptible de réduire d’environ 3 000 kilomètres, soit 15 %, la route entre le nord-est des États-Unis (New-York) et la Chine.
Exemples de distances entre les ports de l’hémisphère nord selon la route choisie
Par le canal de Panama |
Par le passage du Nord-Ouest |
Par le passage du Nord-Est |
Par le canal de Suez et le détroit de Malacca | |
Rotterdam-Singapour |
28 994 |
19 900 |
19 641 |
15 950 |
Rotterdam-Shanghai |
25 588 |
16 100 |
15 793 |
19 550 |
Rotterdam-Vancouver |
16 350 |
14 330 |
13 200 |
28 400 |
Rotterdam-Los Angeles |
14 490 |
15 120 |
15 552 |
29 750 |
New York-Shanghai |
20 880 |
17 030 |
19 893 |
22 930 |
New York-Hongkong |
21 260 |
18 140 |
20 985 |
21 570 |
New York-Singapour |
23 580 |
19 540 |
23 121 |
19 320 |
Source : données extraites de « Géopolitiques arctiques : pétrole et routes maritimes au cœur des rivalités régionales ? », par Frédéric Lasserre, in Critique internationale, 2010/4 (n° 49).
À ces gains de distance, donc de temps et de carburant, s’ajouterait l’économie des péages exigés actuellement à Suez ou Panama. La carte ci-après permet de visualiser ces deux nouvelles routes potentielles.
Le passage du Nord-Ouest (en rouge) et le passage du Nord-Est (en vert)
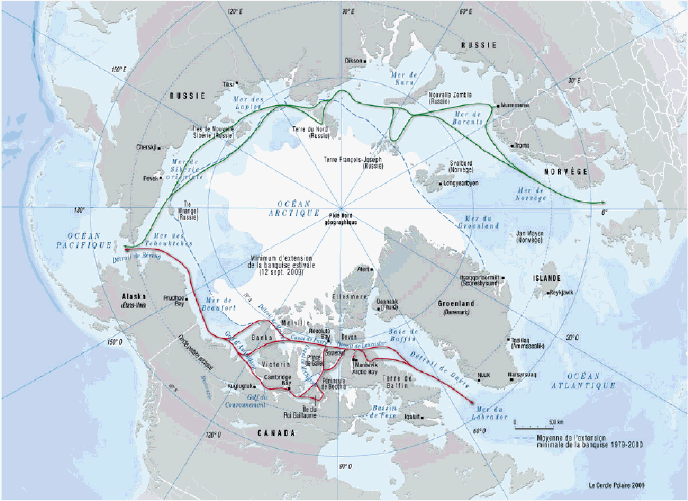
Source : Fondation de la recherche stratégique, recherches & documents, n° 03/2013, novembre 2013 : « Arctique : perspectives stratégiques et militaires », par Alexandre Taithe, Isabelle Facon, Patrick Hébrard et Bruno Tertrais.
On évoque même aujourd’hui la possibilité d’une route plus directe encore, passant au cœur de l’Arctique par le pôle Nord ou à peu près, ce qui serait envisageable si d’ici quelques décennies la banquise disparaît complétement en été (ou devient suffisamment mince pour être traversée par un brise-glace).
Mais s’il est difficile d’anticiper la situation dans quelques décennies, au moins à plus court terme les perspectives des nouvelles routes maritimes du nord doivent être relativisées pour un certain nombre de raisons cumulatives :
– pendant encore quelques années au moins, les périodes où l’un ou l’autre passages seront ouverts (y compris avec l’aide éventuelle de brise-glaces) resteront limitées et incertaines, ce qui est incompatible avec l’établissement de liaisons régulières et la garantie de délais d’acheminement, qui est au cœur du métier des compagnies maritimes ;
– la fonte accélérée des glaces ayant pour effet d’accroître la circulation des icebergs, il faudra prévoir des risques élevés et les coûts associés (assurances, coques renforcées, personnels spécialement formés, recours à l’aide de brise-glaces…) ;
– les espaces arctiques sont largement dépourvus d’infrastructures portuaires et plus généralement de concentrations humaines, de centres économiques, ce qui rend plus difficile les secours en cas de problème et réduit corrélativement les possibilités de cabotage – or, le cabotage le long des routes maritimes est une source significative de revenus pour les compagnies maritimes.
Pour le moment, la navigation sur le passage du Nord-Ouest reste essentiellement limitée à des navires de croisière, même si, en 2013, un gros cargo (225 mètres) transportant du charbon, le Nordic Orion, a été le premier gros navire marchand à emprunter cette route.
Sur le passage du Nord-Est, l’activité est déjà un peu plus importante et croît fortement, cette route étant pour plusieurs raisons plus favorable que le passage du Nord-Ouest : il y a plus de ports et d’infrastructures, notamment des brise-glaces, dans l’Arctique russe que dans l’Arctique canadien (17) ; de plus, cette route est de manière générale moins tortueuse, en eaux plus profondes et moins encombrée de glaces (en raison de la circulation générale des eaux dans l’océan Arctique et grâce à l’apport d’eau un peu moins froide des grands fleuves sibériens). On est donc passé de 34 à 71 passages de 2011 à 2013. Cela dit, ce chiffre est retombé à 28 en 2014 et, surtout, il faut le rapprocher d’autres pour en en apprécier la portée : pour prendre un exemple, ce sont 17 000 à 18 000 bateaux qui empruntent tous les ans le canal de Suez, soit 50 par jour ; l’activité annuelle du passage du Nord-Est représente donc aujourd’hui tout au plus un jour de trafic à Suez ! Quant au détroit de Malacca, 127 000 navires y seraient passés en 2012, pour un fret total de l’ordre de 7 milliards de tonnes, quand le fret actuel passant par la route du Nord-Est ne dépasse pas 5 millions de tonnes par an et que, même à l’échéance 2030, les prévisions russes n’envisagent qu’un fret annuel de 80 millions de tonnes…
On le voit, les potentialités sont énormes, mais les routes maritimes du nord restent pour l’heure très peu exploitées et les conditions de leur rentabilité économique ne sont, pour le moment, pas réunies. Il est en outre difficile de pronostiquer leur développement dans les années et décennies qui viennent, car il dépendra non seulement de l’évolution incertaine de la banquise arctique, mais d’autres facteurs encore plus incertains, notamment l’essor d’activités économiques locales susceptibles de nourrir une plus grande activité de cabotage.
Par ailleurs, il faut être conscient que le réchauffement climatique a aussi pour effet de fermer ou rendre moins utilisables certaines routes, cette fois-ci terrestres : la fonte du pergélisol menace les fondements des infrastructures routières, tandis que la réduction de l’englacement des fleuves limite leur usage comme routes terrestres hivernales.
E. LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
En Arctique, le nombre de touristes est passé d’environ un million au début des années 1990 à plus de 1,5 million dans les années 2000. Des offres touristiques de plus en plus étonnantes sont proposées, par exemple la possibilité d’atteindre le pôle Nord à bord d’un brise-glace russe, pour 25 000 euros…
Comme en Antarctique, ce développement touristique représente des opportunités économiques, mais signifie aussi risques environnementaux, transformation accélérée des modes de vie traditionnels et enjeux de sécurité en cas d’accident.
II. UNE GOUVERNANCE EN DEVENIR
A. DES ENJEUX MILITAIRES QUI PARAISSENT APPARTENIR PLUTÔT AU PASSÉ
L’histoire géopolitique de l’Arctique a d’abord été largement militaire.
La Seconde guerre mondiale y a été à l’origine d’un développement massif de la présence humaine et des infrastructures, avec quelques batailles à sa périphérie, comme celle de Narvik, mais surtout l’utilisation des routes maritimes du nord pour contourner les forces de l’Axe : le ravitaillement de l’allié soviétique par les occidentaux a été effectué par ses ports arctiques tels que Mourmansk et Arkhangelsk. Dans le même temps, la menace japonaise conduisait les États-Unis à renforcer leur présence en Alaska et à construire la « route de l’Alaska » à travers le nord-ouest canadien.
Durant la Guerre froide, l’Arctique a accueilli des équipements de défense très importants, tels que, par exemple, la Distant Early Warning Line, système de 63 stations radars construit à partir de 1954 qui s’étendait sur plus de 10 000 kilomètres des îles Aléoutiennes à l’Islande. Les confins septentrionaux de l’URSS et ses îles arctiques n’étaient pas en reste, formant une vaste zone militaire inaccessible à tout étranger. Quant à l’océan Arctique lui-même, il était devenu l’un des lieux de patrouille préférés des sous-marins nucléaires des deux superpuissances. Il faut aussi savoir que les trajectoires des missiles balistiques que les deux superpuissances envisageaient d’échanger en cas de conflit nucléaire auraient généralement été polaires.
Cet enjeu sécuritaire ne paraît plus central aujourd’hui, l’Arctique étant entouré de pays qui ont entre eux des relations « normales », sinon toujours cordiales, et qui ont su développer une forme de coopération régionale. La Russie renforce certes actuellement sa présence militaire en Arctique (voir infra le développement consacré à ce pays), mais cette politique correspond surtout à un réinvestissement dans une zone délaissée, faute de moyens, après la fin de l’URSS et qui est effectivement essentielle, du point de vue économique, pour le pays. De même, le maintien d’une présence active des États-Unis constitue notamment une réponse légitime à de nouvelles menaces : une éventuelle tentative de frappe balistique de la Corée du Nord contre l’Amérique aurait aussi une trajectoire polaire… Quant à l’OTAN en tant que telle, sa présence en Arctique reste limitée (conduite d’exercices, protection de l’Islande qui n’a pas de forces armées propres…).
Certes, au regard du caractère stratégique des enjeux économiques de l’Arctique – routes maritimes, matières premières… –, les tensions militaires réapparaitraient probablement si les relations entre les pays de la zone se dégradaient gravement. Mais, pour le moment, la coopération qu’ils ont établie entre eux, qu’il est peut-être excessif de qualifier de « gouvernance », repose principalement sur la mise en œuvre d’instruments juridiques relevant du droit international de la mer et sur des forums régionaux intergouvernementaux, dont le Conseil arctique est le principal.
B. UN ESPACE MARITIME, DONC AVANT TOUT RÉGI PAR LE DROIT DE LA MER
Espace essentiellement maritime, l’Arctique est donc régi par le droit international de la mer.
1. La convention des Nations-Unies sur le droit de la mer de 1982 et ses limites
Le droit de la mer est l’une des plus anciennes branches du droit international. Longtemps coutumier, ce droit a ensuite été codifié, d’abord par des textes adoptés en 1958 suite à une conférence internationale tenue à Genève, puis en 1982 avec la signature à Montego Bay de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer (CNUDM, ou UNCLOS pour United Nations Convention on the Law of the Sea).
a. Les principales dispositions de la convention de Montego Bay
La convention de Montego Bay a notamment permis de clarifier les différents statuts des eaux maritimes en termes de souveraineté, des eaux intérieures à la haute mer. On rappelle que l’on distingue ainsi :
– les « eaux intérieures » sur lesquelles les souverainetés nationales s’exercent pleinement, qui sont celles en deçà de ce que l’on appelle la « ligne de base », qui correspond généralement à la « laisse de basse mer le long de la côte », mais inclut aussi les baies, sous certaines conditions, les estuaires, les ports, etc. ;
– les « eaux territoriales », bande de 12 milles marins (18) au plus à partir de la ligne de base, où l’État côtier exerce de nombreux droits souverains, mais est tenu d’accorder un « droit de passage inoffensif » aux navires ;
– la « zone contiguë » aux eaux territoriales, autre bande de 12 milles au plus où l’État côtier est habilité à exercer certaines prérogatives de police ;
– les détroits internationaux, dont le statut ressemble à celui des eaux territoriales avec quelques garanties supplémentaires quant à la liberté de transit (celle-ci ne peut en aucun cas être suspendue par l’État côtier, alors que le droit de passage dans les eaux territoriales peut l’être temporairement et de manière non discriminatoire, pour des raisons de sécurité ; les sous-marins ne sont pas tenus de passer en surface) ;
– la « zone économique exclusive » (ZEE), large au plus de 200 milles marins à partir de la ligne de base, où l’État côtier a des droits économiques souverains ;
– le « plateau continental », lequel, comme l’on y reviendra, peut parfois s’étendre au-delà de la ZEE et où l’État côtier a des droits économiques souverains sur les fonds marins et le sous-sol, mais pas la colonne d’eau, donc pas les ressources halieutiques ;
– enfin, la « haute mer », qui continue à n’appartenir à personne, mais dont les fonds sont proclamés « patrimoine commun de l’humanité » – une Autorité internationale des fonds marins a été fondée en 1994 pour les gérer.
Appliquée au cas de l’océan Arctique, la convention de Montego Bay présente, de manière exacerbée, les mêmes limites et les mêmes insuffisances que dans d’autres espaces marins : problèmes d’interprétation, part belle laissée aux souverainetés nationales et aux appétits économiques, faiblesse de l’affirmation du patrimoine marin comme bien commun de l’humanité avec ce qui devrait s’ensuivre en termes d’exercice d’une autorité internationale…
b. Un cadre imparfait qui laisse place à l’affrontement des souverainetés et des appétits économiques
Le cadre créé par la convention de 1982 favorise l’expression de revendications de souveraineté qui sont considérables et, de plus, intrinsèquement tournées en priorité vers les intérêts économiques – puisqu’en principe, au-delà des eaux territoriales, ce sont seulement des droits économiques exclusifs qui peuvent être affirmés, non une souveraineté nationale pleine.
Ce cadre est en outre complexe et sujet à interprétation, ce qui facilite la multiplication des revendications et des différends.
i. Le différend sur le statut des passages du Nord-Ouest et du Nord-Est
Un premier type de litiges liés à l’interprétation du cadre de Montego Bay oppose le Canada et la Russie à la plupart des autres pays, notamment les États-Unis et la France, qui invoquent la liberté de navigation. Ils portent sur le statut des eaux qui forment les routes maritimes des passages du Nord-Ouest et du Nord-Est.
Ces litiges trouvent leur source dans les ambiguïtés de la notion de « ligne de base » qui sépare eaux intérieures et eaux territoriales et ne suit pas toujours la côte. Selon l’article 7 de la convention de Montego Bay, « là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base ». On peut donc s’écarter de la côte lorsqu’il y a des îles côtières, comme c’est le cas au nord du Canada et de la Russie, et tracer alors une ligne fondée sur des « points appropriés » (sic).
Le Canada soutient que le passage du Nord-Ouest est formé d’eaux intérieures, assimilées juridiquement à ses espaces terrestres. Il revendique ainsi le droit de contrôler (et éventuellement refuser) le passage de tout navire étranger. De la même façon, la « ligne de base » russe inclut plusieurs détroits entre la Sibérie et des îles russes de l’océan Arctique (Nouvelle-Zemble, Terre du Nord et Nouvelle-Sibérie).
De plus, les deux pays revendiquent aussi le droit de réglementer la navigation dans leurs zones économiques exclusives, pour des motifs de protection de l’environnement, en invoquant l’article 234 de la convention de Montego Bay, lequel prévoit cette possibilité spécifiquement pour les eaux englacées (voir infra le développement particulier sur cet article).
Pour la plupart des autres pays, au contraire, les passages du Nord-Ouest et du Nord-Est devraient être soumis au statut des détroits internationaux, avec droit de passage en transit sans aucune entrave.
Ce litige a donné lieu à plusieurs moments de tension entre les États-Unis et le Canada. En 1988, ils ont toutefois signé un accord par lequel les États-Unis se sont engagés à demander la permission avant chaque traversée du passage – permission qui n’est jamais refusée –, sans pour autant reconnaître les positions juridiques du Canada.
ii. Les problèmes de délimitation des eaux territoriales et zones économiques exclusives
Les différends de délimitation des eaux territoriales ou des zones économiques exclusives sont un autre classique entre États adjacents ou qui se font face (avec une distance inférieure à deux fois 200 milles, soit 400 milles). S’agissant de la délimitation des ZEE, l’article 74 de la convention de Montego Bay n’est pas très explicite, appelant simplement à rechercher par la négociation une « solution équitable ». L’article 83 concernant les plateaux continentaux est similaire.
Les États riverains de l’océan Arctique ont résolu par la négociation plusieurs litiges qui les opposaient, tandis que d’autres n’ont fait l’objet que d’arrangements partiels :
– en 1990, les États-Unis et ce qui était encore l’URSS ont formellement délimité leurs espaces maritimes dans le détroit de Béring et les mers avoisinantes, mettant fin à de vieux litiges ;
– en 2010, la Norvège et la Russie se sont partagés la souveraineté d’environ 175 000 km2 de la mer de Barents qu’ils se disputaient ;
– le Canada et les États-Unis affirment tous deux leur juridiction sur un triangle maritime de 21 400 km² en mer de Beaufort. Ce différend trouve son origine dans une divergence d’interprétation du traité de 1825 qui a fixé la frontière entre le Canada et l’Alaska et son applicabilité à la délimitation des eaux. En avril 2009, le Canada a émis des protestations formelles suite au lancement par l’Alaska d’un appel d’offre pour l’exploration gazière dans la zone contestée. Cependant, en mai 2010, le ministre canadien des affaires étrangères a lancé une invitation à rouvrir des négociations, et, en août, une campagne conjointe de délimitation du plateau continental a été lancée ;
– le Canada et le Danemark ont signé en 1973 un accord sur leur frontière maritime, mais trois petits différends subsistent. D’abord, la souveraineté sur l’île Hans ; en 2004, un drapeau danois a été érigé sur cet îlot sans intérêt stratégique, ce qui a suscité en 2005 une visite du ministre canadien de la défense et l’érection d’un drapeau canadien en lieu et place… Cela dit, en 2008, une coopération canado-danoise y a permis l’installation d’une station météo automatique. Il existe par ailleurs des divergences d’interprétation sur deux petits secteurs en mer de Lincoln (au nord du Groenland) ; un accord de principe sur le tracé de cette frontière maritime a cependant été trouvé par les deux États en novembre 2012.
iii. La complexité de la définition du plateau continental et la « course au pôle Nord » qui en résulte
Les problèmes de délimitation qui se posent pour les eaux territoriales et les zones économiques exclusives sont aggravés, dans le cas des plateaux continentaux, par deux éléments :
– le fait que le plateau continental puisse s’étendre jusqu’à 350 milles des côtes, voire au-delà (voir infra), donc bien plus loin que la zone économique exclusive ;
– l’excessive complexité de sa définition.
L’encadré ci-après reproduit les six premiers paragraphes de la définition du plateau continental formulée à l’article 76 de la convention de Montego Bay.
Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer – Article 76
« Définition du plateau continental
« 1. Le plateau continental d’un État côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de sa mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure.
« 2. Le plateau continental ne s’étend pas au-delà des limites prévues aux paragraphes 4 à 6.
« 3. La marge continentale est le prolongement immergé de la masse terrestre de l’État côtier ; elle est constituée par les fonds marins correspondant au plateau, au talus et au glacis ainsi que leur sous-sol. Elle ne comprend ni les grands fonds des océans, avec leurs dorsales océaniques, ni leur sous-sol.
« 4. a) Aux fins de la Convention, l’État côtier définit le rebord externe de la marge continentale, lorsque celle-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, par :
« i) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence aux points fixes extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus continental ;
ou
« ii) Une ligne tracée conformément au paragraphe 7 par référence à des points fixes situés à 60 milles marins au plus du pied du talus continental.
« b) Sauf preuve du contraire, le pied du talus continental coïncide avec la rupture de pente la plus marquée à la base du talus.
« 5. Les points fixes qui définissent la ligne marquant, sur les fonds marins, la limite extérieure du plateau continental, tracée conformément au paragraphe 4, lettre a), i) et ii), sont situés soit à une distance n’excédant pas 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, soit à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 mètres, qui est la ligne reliant les points de 2 500 mètres de profondeur.
« 6. Nonobstant le paragraphe 5, sur une dorsale sous-marine, la limite extérieure du plateau continental ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux hauts-fonds qui constituent des éléments naturels de la marge continentale, tels que les plateaux, seuils, crêtes, bancs ou éperons qu’elle comporte.
« 7. (…) »
Sans en faire l’exégèse, on voit qu’il s’agit d’un texte compliqué, où abondent conditions alternatives ou cumulatives, selon les cas, et formulations sujettes à interprétation.
Cette définition se distingue aussi de celle des eaux territoriales ou de la ZEE en ce qu’elle ne se réfère pas seulement à la distance des côtes, mais aussi à la géographie des fonds marins. Pour cette raison, elle pose déjà problème, car sa mise en œuvre suppose préalablement des relevés fiables des fonds marins, puisqu’il faut par exemple connaître l’épaisseur des roches sédimentaires ou identifier « la rupture de pente la plus marquée à la base du talus » continental : or, l’océan Arctique n’est évidemment pas la région des mers la mieux cartographiée…
Les paragraphes 5 et 6 de l’article 76 sont à la fois particulièrement importants et particulièrement sujets à litiges. Ils sont essentiels car ils visent à fixer une limite à l’extension du plateau continental revendiqué par un État côtier, laquelle pourrait, sinon, être indéfinie dès lors que les caractéristiques géographiques des fonds marins le permettraient : le plateau continental ne peut s’étendre soit au-delà de 350 milles marins depuis la « ligne de base », soit au-delà de 100 milles marins de la ligne de courbe de profondeur (isobathe) correspondant à 2 500 mètres. Et il est précisé que dans le cas d’une extension justifiée par une « dorsale sous-marine », la limite des 350 milles s’applique impérativement. Cette notion de « dorsale sous-marine » est déterminante dans l’océan Arctique, car elle y fonde les revendications les plus ambitieuses.
En effet, les zones économiques exclusives revendiquées dans la limite des 200 milles marins par les États riverains de l’océan Arctique laissent au cœur de celui-ci, comme on le voit ci-après, une zone centrale d’environ 3 millions de km2 de « haute mer » (si l’on peut dire s’agissant d’une zone qui est – pour le moment encore – perpétuellement couverte de banquise). Or, cette zone, où par ailleurs la mer est généralement profonde de plusieurs milliers de mètres, est traversée par une chaîne sous-marine, dite « dorsale de Lomonossov », qui relie en quelque sorte la Sibérie à une zone située aux confins de l’archipel arctique canadien et du Groenland sous souveraineté danoise.
C’est principalement en se fondant sur l’existence de cette dorsale de Lomonossov – qui se trouve passer sous le pôle Nord – (et dans une moindre mesure d’autres chaînes sous-marines comme celle de Mendeleïev) que plusieurs des États riverains de l’océan Arctique se sont engagés dans une course à la revendication du pôle Nord. Comme on peut le voir sur la carte ci-après, ce relief peut opportunément servir aussi bien les intérêts russes que canadiens ou dano-groenlandais.
L’Arctique central et la dorsale de Lomonossov
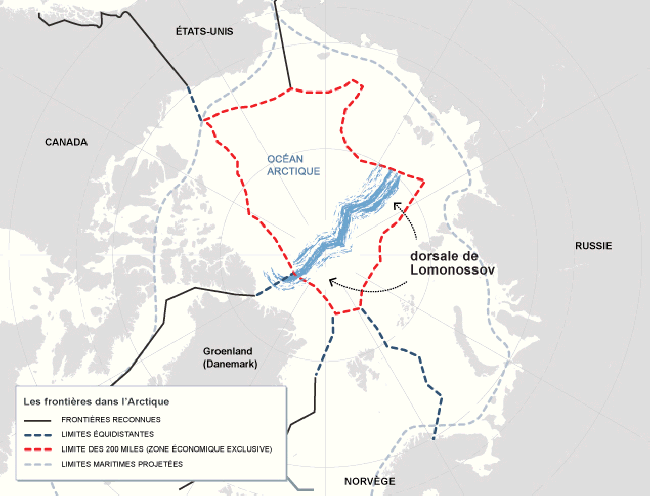
Source : Radio-Canada.
La dimension symbolique de l’affaire conduit à la présenter aux opinions publiques comme une revendication de souveraineté, une affaire de prestige national, alors que formellement, il ne peut s’agir que de revendiquer des droits économiques sur les ressources du sous-sol et des fonds marins. Mais le caractère symbolique l’emporte évidemment, d’autant plus que les perspectives d’exploitation économique de cette zone centrale de l’océan Arctique restent inexistantes pour le moment (banquise permanente) et faibles à termes (grandes profondeurs, éloignement, fait que les ressources en hydrocarbures semblent plutôt sur les marges continentales qui font partie des ZEE dans la limite des 200 milles…). Le dépôt en 2007, à plus de 4 000 mètres de profondeur, d’un drapeau russe à l’aplomb du pôle Nord illustre bien cette petite guerre larvée de prestige que semblent se mener les États arctiques, où les prouesses techniques peuvent être mises au service d’affirmations de souveraineté quelque peu désuètes…
Les États ont également été poussés à affirmer leurs revendications par des règles procédurales : ils ont en principe dix ans à compter de leur ratification de la convention de Montego Bay pour exprimer leurs revendications de plateau continental, pour valider lesquelles (par le biais de « recommandations ») une Commission des limites du plateau continental (CLPC) a été instituée au plan international.
● La Russie a formellement présenté en 2001 sa revendication à la CLPC, laquelle, en 2002, a considéré qu’elle n’était pas assez fondée et demandé des recherches supplémentaires.
Comme on le voit sur la carte ci-après, la revendication russe s’étend jusqu’au pôle Nord.
La revendication russe d’extension de son plateau continental arctique
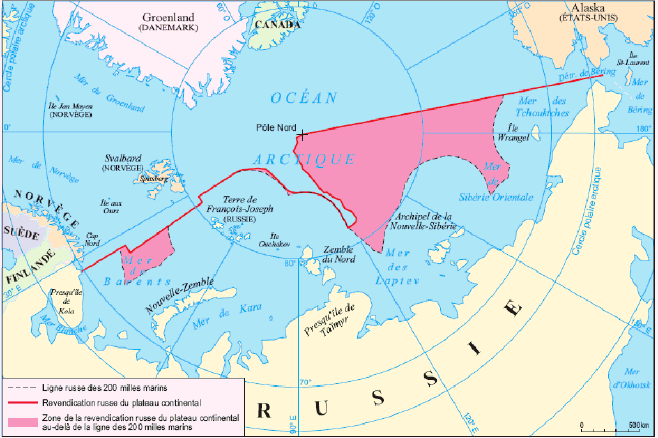
Source : « L’emprise des États côtiers sur l’Arctique », par Hélène De Potter.
● Le Canada, pressé par le délai susmentionné, a pris date en décembre 2013 : il n’a en fait déposé à ce moment de dossier que pour sa revendication de plateau continental au large de ses côtes atlantiques, mais a annoncé une future revendication formelle dans l’océan Arctique et transmis des données préliminaires qui devront être complétées par des études ultérieures pour justifier une demande d’extension jusqu’au pôle Nord. Les revendications canadiennes concerneraient 1,7 million de km2.
● Également contraint par le délai de dix ans, le Danemark a, à son tour, déposé en décembre 2014 une demande formelle d’extension du plateau continental du Groenland qui est très ambitieuse car elle porte sur près de 900 000 km2, va bien au-delà du pôle Nord et couvrirait une grande part de la partie centrale de l’océan Arctique, comme on le voit sur la carte ci-après.
La revendication danoise d’extension du plateau continental du Groenland
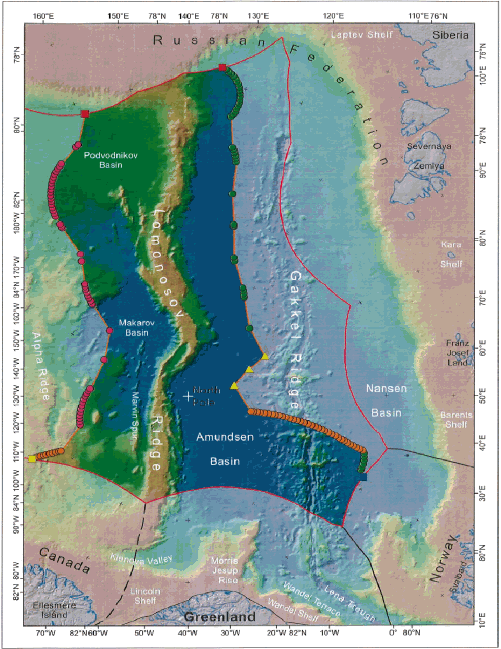
Source : Commission des limites du plateau continental, « Executive summary » de la « Partial Submission of the Government of the Kingdom of Denmark together with the Government of Greenland to the Commission on the Limits of the Continental Shelf – The Northern Continental Shelf of Greenland », décembre 2014.
● En principe, la Norvège aurait aussi pu, en raison de sa souveraineté sur l’archipel du Svalbard, même si celle-ci est encadrée (voir infra le développement ad hoc), revendiquer un plateau continental allant jusqu’au pôle Nord. Le pays a seulement présenté, en 2006, des demandes qui se situaient dans la limite de sa ZEE de 200 milles et ont d’ailleurs été approuvées en 2009 par la CLPC.
● Les États-Unis, enfin, sont dans une situation particulière car ils ont signé mais pas ratifié la convention de Montego Bay (malgré ce qui semble être un large consensus des personnalités politiques majeures expertes de la question, le Sénat n’a pour le moment pas voulu voter le texte, s’inscrivant dans une position classique de méfiance vis-à-vis des instruments internationaux suspectés d’entraver la souveraineté des États-Unis). Ils ne semblent donc pas en position d’en utiliser les outils et notamment de déposer une revendication à la CLPC.
Cette position de retrait relatif n’empêche pas les États-Unis de défendre leurs intérêts. Ils ont notamment critiqué la demande russe d’extension du plateau continental de 2001 en arguant que les dorsales de Lomonosov et de Mendeleïev seraient des dorsales « océaniques » séparées des continents et non des dorsales « sous-marines » susceptibles de fonder une revendication de plateau continental. Ce raisonnement vaut aussi naturellement pour les revendications canadiennes et danoises qui ont le même genre de justification.
c. Une prise en compte limitée des spécificités de l’Arctique
En corollaire du champ qu’il laisse aux appétits des États côtiers, en particulier en matière économique, on peut reprocher au droit de la mer onusien de ne pas défendre suffisamment l’idée que la mer est un bien commun de l’humanité, même si celle-ci est introduite dans la convention de Montego Bay.
Non seulement on ne promeut pas vraiment une « police » internationale des mers, notamment pour protéger l’environnement, mais, en ne reconnaissant guère que des droits économiques aux États côtiers au-delà de leurs eaux territoriales, on ne donne que partiellement les moyens d’assurer cette police écologique à ceux qui le voudraient.
L’enjeu est très net dans l’Arctique, puisque la menace écologique y est extrêmement grave.
La convention de Montego Bay comprend à cet égard une disposition spécifique aux mers très froides et en particulier polaires : dans les seules « zones recouvertes par les glaces », son article 234 autorise les États côtiers à avoir une action de police (édiction et application de réglementation) contre la pollution au-delà de leurs eaux territoriales, mais dans la limite de leur zone économique exclusive, « lorsque des conditions climatiques particulièrement rigoureuses et le fait que ces zones sont recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l’année font obstacle à la navigation ou la rendent exceptionnellement dangereuse, et que la pollution du milieu marin risque de porter gravement atteinte à l’équilibre écologique ou de le perturber de façon irréversible ». Il est précisé que « ces lois et règlements tiennent dûment compte de la navigation, ainsi que de la protection et de la préservation du milieu marin sur la base des données scientifiques les plus sûres dont on puisse disposer ».
La présence de cet article est importante, car elle prend en compte la dangerosité spécifique et la sensibilité écologique des mers polaires. Mais on en voit aussi les limites :
– tout repose sur le bon vouloir des États côtiers, qui peuvent aussi faire un usage détourné de cet article pour affirmer leur souveraineté dans les eaux concernées. C’est ainsi que quand la loi canadienne oblige tous les navires passant dans la ZEE du pays à se signaler, on peut y voir une mesure de prévention, mais aussi une forme de revendication de souveraineté. De même, la Russie utilise le droit de la mer, en particulier l’article 26 de la convention de Montego Bay, lequel pose le principe de la gratuité du passage dans les eaux territoriales mais autorise la perception de redevances pour services rendus, pour exiger des droits de passage sur le passage du Nord-Est ;
– ne sont concernées que les zones « recouvertes par les glaces pendant la majeure partie de l’année », donc une partie seulement – et une partie en recul constant – des eaux polaires ;
– des restrictions visent à décourager les États de trop utiliser ces pouvoirs pour limiter la navigation et peuvent entraîner des problèmes d’interprétation (il faut justifier d’une navigation « exceptionnellement dangereuse », d’atteintes « graves » à l’équilibre écologique…). Ces restrictions sont sans doute utiles pour éviter des utilisations abusives de cette disposition, mais limitent aussi la marge de manœuvre des États côtiers. Il semble clair que si les routes maritimes arctiques deviennent un jour rentables, ce qui suppose aussi que le recul de la banquise se soit poursuivi, ces États ne pourront faire qu’un usage modéré de cet article s’ils veulent éviter des difficultés avec les armateurs.
2. Le développement d’instruments spécifiques de gestion des espaces marins
a. Les organisations régionales de gestion de la pêche
Les organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) sont des organisations intergouvernementales ayant pour objet de réglementer la pêche afin de préserver les ressources halieutiques. À cette fin, elles peuvent édicter des quotas de captures (généralement sous forme de « recommandations », faute d’un pouvoir de contrainte propre), des limitations du nombre de navires autorisés à pêcher, des interdictions pour certaines espèces et des règles relatives aux techniques de pêche. Pour mener à bien leur mission, les ORGP établissent des statistiques, coordonnent des recherches, procèdent à des publications. Elles s’appuient généralement sur un conseil scientifique et peuvent faire une place aux ONG en tant qu’observateurs.
La plus grande partie des espaces marins du monde sont couverts par une ORGP. Plusieurs de ces organisations couvrent des parties de l’océan Arctique, en particulier dans le prolongement de l’océan Atlantique – c’est là que l’on trouve le plus d’eaux libres de glace et qu’une activité significative de pêche est développée –, comme le montre la carte ci-après.
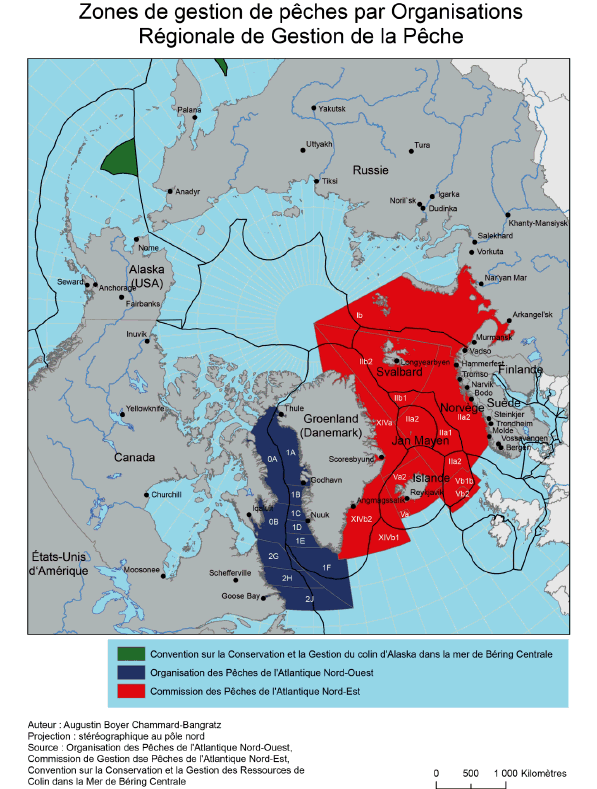
Source : « Quel cadre réglementaire pour la pêche dans l’océan Arctique ? », 31 janvier 2014, par Augustin Boyer et Frédéric Lasserre, Université Laval, publié par CIRRICQ.
Ces ORGP concernant les eaux arctiques et subarctiques sont :
– la Commission des pêches de l’Atlantique du nord-est (North East Atlantic Fisheries Commission), qui existe depuis 1982 ;
– l’Organisation des pêches de l’Atlantique du nord-ouest (Northwest Atlantic Fisheries Organization), qui a pris en 1978 la suite de la Commission internationale des pêches de l’Atlantique nord-ouest créée en 1950 ;
– l’Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique-Nord (North Atlantic Salmon Conservation Organization), établie en 1984 ;
– pour les thons et les espèces voisines, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, établie en 1969.
Dans le Pacifique-Nord, la pêche au colin est également encadrée par la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring.
Il faut toutefois observer que l’impact de l’action des ORGP dans l’océan Arctique est limité du fait que souvent leur compétence ne concerne que les eaux internationales au-delà des zones économiques exclusives, lesquelles sont du ressort des seuls États (même si les ORGP, en tant qu’organisations interétatiques, peuvent aussi émettre des recommandations concernant les ZEE, voire les eaux territoriales, si leurs États membres sont d’accord).
C’est le cas de la Commission des pêches de l’Atlantique du nord-est (CPANE). Or l’on constate que la plus grande part des eaux situées à la jonction de l’océan Atlantique et de l’océan Arctique, en principe couverte par cette organisation, appartiennent en fait à des ZEE ou des zones assimilées (voir infra le cas du Svalbard). La carte ci-après montre ainsi qu’en dehors des abords du pôle Nord, couverts par la banquise permanente, la compétence de la CPANE concerne principalement les eaux tempérées et ne concerne dans les eaux arctiques ou proches que deux petits secteurs, dits « Banana Hole » et « Loophole ». Encore, dans ce dernier, situé en mer de Barents, l’organisation n’exerce-t-elle de fait pas ses compétences, abandonnées pour l’essentiel aux arrangements bilatéraux de la Russie et de la Norvège. En 1999, ces deux pays ont signé un accord, dit « Loophole Agreement », avec l’Islande, dont les pêcheurs revendiquaient le droit de pêcher dans les eaux internationales du « Loophole » : des droits de pêche dans les ZEE russes et norvégiennes ont été concédés aux Islandais en contrepartie de l’abandon de cette revendication.
Les zones de compétences de la Commission des pêches de l’Atlantique nord-est (eaux internationales hors ZEE)
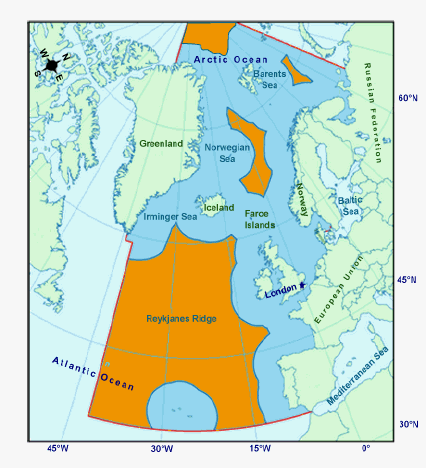
Source : http://www.neafc.org.
Par ailleurs, une grande partie de l’océan Arctique n’est toujours pas couverte par une ORGP, y compris sa partie centrale qui ne relève pas non plus de la responsabilité des États riverains au titre de leurs zones économiques exclusives.
Certes, comme on l’a vu supra, la pêche est encore très peu développée dans les zones concernées et les potentialités, même compte tenu du recul des glaces, y restent très incertaines.
Mais de fait, rien n’interdit juridiquement la pêche dans les eaux de « haute mer » de l’Arctique central, exercée selon les règles nationales de l’État de pavillon. Et si l’article 117 de la convention de Montego Bay impose en principe aux États d’encadrer l’activité de leurs pécheurs en haute mer (19), peu nombreux sont ceux qui le font effectivement, même si cela semble être le cas de deux États arctiques au moins, la Norvège et les États-Unis (20).
La question de l’opportunité de l’établissement d’une ORGP consacrée spécifiquement à l’océan Arctique, en particulier à sa zone centrale, est donc posée. Elle a été évoquée lors d’une réunion organisée en mai 2013 à Washington entre les cinq États riverains de l’océan Arctique (États-Unis, Canada, Danemark, Norvège et Russie). Selon le communiqué publié au nom de la présidence de cette réunion (21), les participants se seraient accordés pour estimer :
– que pour le moment il n’était pas nécessaire d’établir une ORGP pour l’Arctique central ;
– mais que cela pourrait devenir nécessaire ;
– et qu’en attendant, des mesures intérimaires devraient être prises, qui pourraient consister à imposer que toute pêche dans la zone soit effectuée selon les règles des ORGP ou « arrangements » établis ou à établir (ce qui, en l’absence d’ORGP, semble revenir à un moratoire).
La Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du nord-est, dite « OSPAR » (pour « OSlo-PARis »), définit les modalités de la coopération internationale pour la protection du milieu marin dans la zone qu’elle couvre, laquelle comprend une partie de l’océan Arctique.
Elle tire son appellation de deux conventions antérieures, l’une signée à Oslo en 1972, l’autre à Paris en 1974, qui avaient un champ sectoriel plus restreint : elle les remplace avec une portée plus large.
La convention OSPAR a été ouverte à la signature en 1992 et est rentrée en vigueur en 1998. Elle engage l’Union européenne en tant que telle et quinze pays riverains du nord-est de l’océan Atlantique ou de fleuves qui s’y jettent : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Le champ géographique à laquelle elle s’applique, que l’on voit sur la carte ci-après, correspond effectivement au nord-est de l’océan Atlantique en s’étendant, dans la continuité de celui-ci, jusque dans l’océan Arctique : la zone OSPAR s’étend jusqu’au pôle Nord et couvre notamment la mer de Norvège, celle de Barents et même une part de l’Arctique central couvert en permanence (pour quelques années encore) par la banquise.
La zone couverte par la convention OSPAR
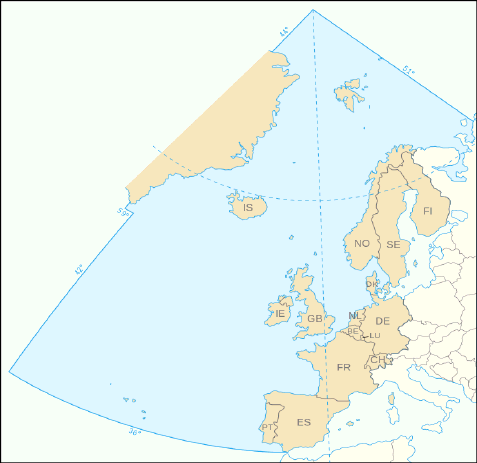
Source : commission OSPAR.
Le dispositif OSPAR est intéressant car non seulement il a pour objet exclusif l’environnement, mais il s’inscrit dans une approche globale, « écosystémique ». Celle-ci repose sur la définition de cinq stratégies concernant les principales problématiques ou menaces pour les eaux concernées : biodiversité et écosystèmes, eutrophisation, substances dangereuses, industrie du pétrole et du gaz off-shore et substances radioactives, le tout étant coordonné par un programme conjoint d’évaluation et de surveillance, lequel établit notamment un bilan de santé de l’environnement marin. La question du changement climatique est également prise en compte dans les travaux effectués.
L’approche globale écosystémique apparaît bien dans l’article 2 de la convention, selon lequel ses parties doivent prendre « toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l’homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, à rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables » : l’ambition n’est pas seulement de lutter contre la pollution, mais aussi contre tous les effets préjudiciables des activités humaines, ce pour préserver ou réparer les écosystèmes.
La convention OSPAR oblige, sur le principe, les parties contractantes à prendre des mesures pour mettre en œuvre le principe de précaution et le principe pollueur-payeur, ce en recourant aux « meilleures techniques disponibles » et à la « meilleure pratique environnementale » : on se place dans une logique de progrès graduel en fonction des possibilités techniques.
Le fonctionnement du système repose sur l’adoption de « décisions » et de « recommandations », concernant par exemple les rejets maximaux de telle ou telle substance chimique par tel ou tel type d’installation, assorties de calendriers de mise en œuvre. Ces directives sont adoptées dans le cadre de la « commission OSPAR » constituée par les représentants des pays ; si l’unanimité ne se dégage pas, elles peuvent l’être à la majorité des trois quarts, mais les pays mécontents du texte adopté peuvent notifier à la commission qu’ils ne l’appliqueront pas.
Par ailleurs, les pays qui sont parties à la convention doivent régulièrement rendre compte des mesures qu’ils prennent pour la respecter et de leur efficacité, ceci conduisant à une évaluation par la commission OSPAR.
On est donc dans un mécanisme qui n’est pas véritablement contraignant (puisqu’une norme peut être refusée par un pays), mais repose plutôt sur une logique d’adhésion entretenue par la « pression des pairs » et éventuellement des ONG, pression qui résulte de la publication régulière de rapports d’évaluation pointant les pays, voire les installations (off-shore notamment), qui ne respectent pas telle ou telle norme technique. Par ailleurs, les compétences du dispositif OSPAR ne couvrent pas directement la réglementation de certaines activités économiques, comme la pêche.
De plus, et c’est le principal handicap du dispositif OSPAR, dans la mesure où il ne s’inscrit pas dans le droit de la mer internationalement reconnu – le système de la convention de Montego Bay –, il ne s’impose en fait qu’aux États (européens) qui en sont signataires. Des États tiers en contestent notamment la prétention à régenter la « haute mer », au mépris de la liberté qui doit y régner selon la convention de Montego Bay.
Malgré ces limites, c’est dans le cadre de la convention OSPAR que, pour la première fois, en 2012, des aires marines protégées ont été désignées dans les eaux de « haute mer » (au-delà des zones économiques exclusives). Actuellement, il est débattu dans ce cadre d’un projet d’aire marine qui concernerait l’extrême nord des eaux couvertes par la convention : les eaux arctiques, actuellement couvertes par la banquise permanente, qui sont situées au-delà des juridictions nationales, jusqu’au pôle Nord, dans la limite des 44ème méridiens ouest et 51ème est, lesquels délimitent le champ d’OSPAR. Mais ce projet se heurte à la volonté des États arctiques qui sont parties à la convention de privilégier le Conseil arctique comme outil de gouvernance de l’Arctique.
Le projet de création d’une aire marine protégée au nord de la juridiction OSPAR
(cette zone correspondrait à la partie hachurée en haut de la carte)
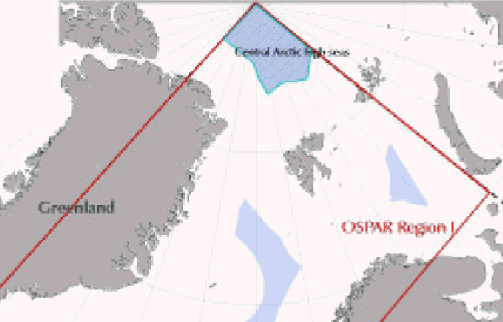
Le « Code polaire » est un instrument juridique en cours de finalisation dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) : sa partie relative à la sécurité dans les eaux polaires a été adoptée en novembre 2014 et sa partie concernant l’environnement devrait l’être prochainement. Il pourrait entrer en vigueur début 2017.
Cet instrument juridique a été précédé par l’adoption de mesures non contraignantes dans le cadre de l’OMI : en 2002, des « lignes directrices » pour la navigation dans les zones englacées de l’Arctique, suivies en 2009 de lignes directrices pour la navigation polaire applicables également en Antarctique.
Le Code se composera d’une partie traitant de la sécurité des navires et d’une partie consacrée à la prévention des pollutions. Chaque partie contiendra des dispositions obligatoires et des recommandations additionnelles n’ayant pas force d’obligation. Ces dispositions viennent s’ajouter ou compléter les dispositions déjà applicables au titres des conventions existantes SOLAS et MARPOL qui posent des règles générales mondiales en matière de sécurité et de pollution maritimes.
Le Code couvre tous les domaines de la conception et de l’exploitation des navires : structure, propulsion, stabilité, engins de sauvetage, moyens de communication, procédures de navigation, qualification des équipages, prévention de différentes formes d’atteintes à l’environnement, etc. Il dispose notamment qu’un certificat sera nécessaire pour pouvoir naviguer dans les eaux polaires et que les navires seront classés en trois catégories en fonction de leurs capacités à évoluer dans différentes épaisseurs de glace. Tous les bateaux voulant se rendre dans ces zones devront également disposer d’un manuel de procédures spécifiques.
Un des avantages de cet instrument est son caractère universel : il a été élaboré dans le cadre d’une organisation internationale qui a 170 membres et est donc plus à l’abri d’éventuels contournements par le jeu de « pavillons de complaisance » que les instruments juridiques régionaux. Il devrait également permettre l’élaboration de normes dérivées (d’application) qui auront l’avantage d’une entrée en vigueur plus facile (car non soumises à la ratification formelle des États).
Le Code présente enfin la caractéristique intéressante de s’appliquer aussi bien aux eaux arctiques qu’aux eaux antarctiques.
Toutefois, pour le moment, il ne s’appliquera qu’aux navires certifiés au titre des conventions SOLAS et MARPOL, bref aux navires de commerce essentiellement. Son application aux autres navires et notamment ceux de pêche et ceux effectuant une navigation domestique devrait être débattue à partir de 2016.
Par ailleurs, certains observateurs estiment que les obligations posées ne vont en pratique guère au-delà des réglementations actuellement imposées par les États arctiques aux navires qui passent dans leurs eaux et des pratiques en vigueur.
C. LA MISE EN PLACE RÉCENTE D’UNE FORME DE GOUVERNANCE RÉGIONALE
Le Canada, le Danemark (en raison du Groenland), les États-Unis, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Russie et la Suède sont considérés comme les huit « États arctiques », car le cercle polaire passe sur leur territoire. Parmi eux, cinq partagent en outre la qualité d’États riverains de l’océan Arctique : le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Norvège et la Russie. Ce n’est le cas ni de la Suède et de la Finlande, bordées par la mer Baltique (et la mer du Nord pour la Suède), ni de l’Islande, qui est généralement considérée comme encore située dans l’Atlantique-Nord (c’est du moins la position du « club » des cinq États côtiers susmentionnés, position que l’Islande conteste vivement).
Ces États sont à l’origine de plusieurs forums internationaux qui constituent une forme de gouvernance internationale – limitée – de la zone arctique.
L’une des prémices de la coopération régionale dans l’Arctique est sans doute la signature à Oslo, le 15 novembre 1973, d’un accord sur la conservation des ours blancs entre les cinq États riverains de l’océan Arctique : le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Norvège et ce qui était encore l’Union soviétique. Cet accord a fortement limité la chasse aux ours polaires, en posant une prohibition de principe avec des exceptions, notamment pour les chasses « traditionnelles » des populations locales, et en limitant en cohérence le commerce des ours et de leurs sous-produits tels que les peaux (22).
Cette coopération s’est également incarnée dans des organisations scientifiques ou techniques, comme le Comité international des sciences arctiques, créé en 1990 et qui comprend maintenant 18 pays membres, et l’Union internationale pour la santé circumpolaire, qui remonte à 1981.
Dans le climat coopératif de l’après Guerre froide et en réponse à l’émergence des préoccupations environnementales concernant l’Arctique, une forme d’organisation des États arctiques, essentiellement intergouvernementale, a ensuite été mise en place avec le Conseil arctique.
Cette institution trouve sa source dans l’adoption par les huit États arctiques, en 1991 de la « déclaration de Rovaniemi », qui établissait une Stratégie de protection de l’environnement arctique (SPEA) et affichait la volonté de respecter les intérêts et les modes de vie des peuples autochtones.
Pour ce faire quatre programmes ont été mis en œuvre :
– celui de Surveillance et d’évaluation de l’Arctique, centré sur les effets des polluants anthropiques ;
– celui de Protection de l’environnement marin de l’Arctique, visant à prendre des mesures préventives contre les pollutions marines ;
– celui de Préparation aux situations d’urgence, de prévention et d’intervention dans l’Arctique, destiné à fournir un cadre pour la coopération concernant la réaction aux urgences environnementales ;
– celui de Conservation de la faune et de la flore arctique.
C’est dans la continuité de la SPEA que le Conseil arctique a été créé en 1996, à Ottawa.
Outre les huit États arctiques membres de plein droit, le Conseil accueille des États observateurs, aujourd’hui au nombre de douze : dans l’ordre alphabétique, l’Allemagne, la Chine, la Corée du Sud, l’Espagne, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni et Singapour. Il faut noter que six de ces États, à savoir l’Italie mais surtout les cinq pays asiatiques (Chine, Corée du Sud, Inde, Japon et Singapour), n’ont obtenu le statut d’observateur qu’en 2013. On constate donc un « entrisme » tout récent de l’Asie, qui est tout à fait significatif et certainement lié à la perspective de l’ouverture de nouvelles routes maritimes en Arctique – à cet égard, l’implication de Singapour, superpuissance portuaire et commerciale bien que petit État par ailleurs, est très caractéristique. Les observateurs doivent justifier leur statut par leurs contributions aux activités du Conseil, notamment à ses programmes scientifiques et groupes de travail. Toutefois, ils ne sont pas habilités à exprimer leurs vues lors des réunions officielles du Conseil. Depuis 2010, à l’initiative de la Pologne, ils ont pris l’habitude d’organiser tous les deux ans des rencontres entre eux.
Un certain nombre d’ONG caritatives ou environnementales, par exemple la Croix-Rouge internationale et le WWF, sont également observatrices.
Par ailleurs, le Conseil fait également une place aux organisations représentatives des peuples autochtones :
– l’Association internationale des Aléoutes ;
– le Conseil arctique de l’Athabaska ;
– le Conseil international des Gwich’in ;
– le Conseil circumpolaire inuit ;
– le Conseil saami ;
– l’Association russe des populations autochtones du nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient.
La carte ci-après montre les zones (approximatives) d’habitat des peuples selon les organisations qui les représentent, peuples dont l’effectif est très inégal : si le Conseil circumpolaire inuit revendique (23) la représentation de 150 000 membres des peuples inuit et l’Association russe des populations autochtones du nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient environ 250 000 membres des 41 peuples qu’elle unit, d’autres groupes dont beaucoup moins nombreux : les communautés athabaskanes d’Alaska et du Canada représenteraient environ 32 000 personnes ; les Gwich’in du Canada et d’Alaska seraient 9 000 ; les Aléoutes quelques 2 000.
Le Conseil est avant tout un organe de coopération au niveau intergouvernemental. Tenant une assemblée ministérielle tous les deux ans, il a également un rôle tribunicien. La présidence est assurée alternativement par les États membres pour une durée de deux ans. Les décisions sont prises par consensus, comme il se doit dans les structures de coopération intergouvernementale. Pendant longtemps, le Conseil n’était pas doté d’un secrétariat permanent (l’État assurant la présidence se chargeait du secrétariat général). Cependant, depuis 2012, un tel secrétariat est installé dans la ville norvégienne de Tromsø.
La couverture géographique des organisations des peuples autochtones représentées au Conseil arctique
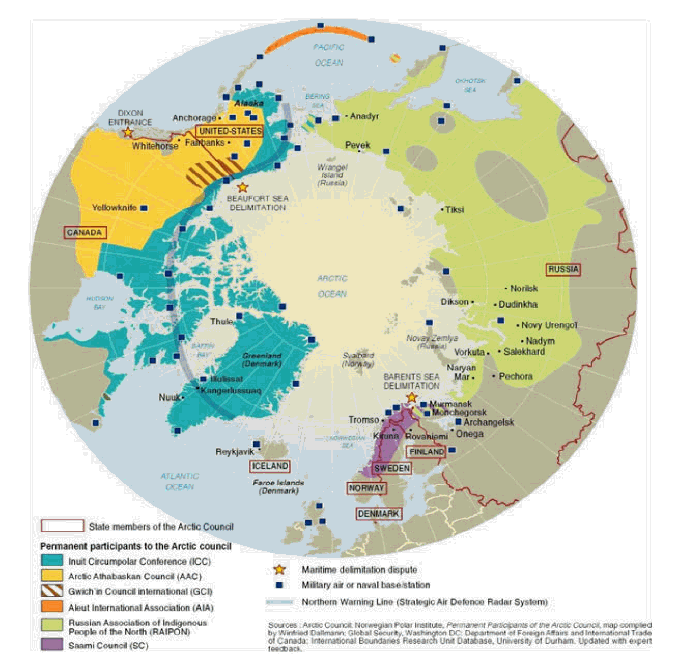
Aux côtés du Conseil, structure intergouvernementale, il existe une Conférence des parlementaires de la région arctique, composée de membres des parlements nationaux des États arctiques et du Parlement européen, qui se réunit tous les deux ans et s’appuie sur un Comité permanent des parlementaires de la région arctique.
Parallèlement, le Forum nordique est composé de responsables politiques des régions arctiques.
Le Conseil arctique a été établi en partie pour assurer la mise en œuvre et la coordination des programmes établis dans le cadre de la SPEA qui l’avait précédé. Ces programmes ont été conservés sous l’appellation de « groupes de travail ». Deux groupes de travail nouveaux y ont été ajoutés :
– l’un chargé du développement durable, au bénéfice des habitants de l’Arctique ;
– l’autre chargé d’un programme d’action et de surveillance des polluants dans l’Arctique.
2. Les instances ne concernant qu’une partie de l’Arctique
Plusieurs institutions intergouvernementales ou interparlementaires ne couvrent qu’une partie de l’Arctique : elles ont été établies, soit dans un cadre « scandinave », soit, plus récemment, dans un cadre européen et dans une optique de coopération avec les nations issues du bloc soviétique et de l’URSS.
Le Conseil nordique des ministres a été institué en 1971 par les gouvernements du Danemark, de l’Islande, de la Suède, de la Norvège et de la Finlande. Il associe aussi les territoires autonomes de ces États : Åland, Groenland et îles Féroé.
Un Conseil parlementaire nordique réunit depuis 1952 des membres des parlements nationaux des pays nordiques et de leurs territoires autonomes. Il se réunit en séance plénière avec les ministres des pays nordiques lors de leur assemblée annuelle du Conseil.
Institué en 1987, le Conseil nordique de l’ouest est une association regroupant les parlements du Danemark, des îles Féroé, du Groenland et de l’Islande.
b. Le Conseil des États de la mer Baltique
Le Conseil des États de la mer Baltique a été créé en 1992. Il réunit les pays scandinaves (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), les États Baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), la Russie, la Pologne et l’Allemagne, ainsi que la Commission européenne. La plupart des autres grands pays européens, dont la France, ainsi que les États-Unis sont observateurs.
Le Conseil fonctionne sur le modèle classique des organisations intergouvernementales : réunions ministérielles, parfois sommets des chefs d’État ou de gouvernement, présidence tournante, secrétariat permanent (à Stockholm).
c. La Région euro-arctique de Barents
La Région euro-arctique de Barents résulte d’une initiative norvégienne de 1993. Cette organisation vise à promouvoir une coopération pour un développement économique et social durable dans les régions riveraines ou proches de la mer de Barents. Elle regroupe les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), la Russie et la Commission européenne. Les principaux pays européens, dont la France, ainsi que les États-Unis et le Canada sont observateurs.
Elle repose sur deux instances :
– le Conseil euro-arctique de Barents, qui se réunit au niveau des ministres des affaires étrangères, avec une présidence tournante entre Finlande, Norvège, Russie et Suède ;
– le Conseil régional de Barents, qui accueille des représentants des collectivités territoriales et des peuples autochtones de la zone couverte par la Région.
La Région de Barents sert de cadre à des projets concrets dans de nombreux domaines : infrastructures, environnement, santé (semble-t-il le domaine le plus actif), etc.
d. Les réunions à cinq des États côtiers de l’océan Arctique
Il faut enfin signaler un forum informel qui s’est développé à l’intérieur du Conseil arctique : à plusieurs occasions, les cinq membres de celui-ci qui se considèrent comme les États côtiers de l’océan Arctique ont tenu des réunions qui leur sont propres. Ce format suscite évidemment un certain mécontentement des autres membres du Conseil arctique et ne fait pas l’unanimité parmi ses cinq membres.
3. Les résultats et les limites des institutions arctiques mises en place
Les analyses universitaires conduites dans les États riverains de l’Arctique (24) – qui sont naturellement plus nombreuses que celles menées ailleurs – considèrent généralement que les institutions internationales arctiques en place ont un bilan plutôt positif et relèvent, a contrario, la difficulté à mettre en place un autre dispositif.
En effet, la mise en place d’un régime global intégré et contraignant de l’Arctique supposerait préalablement d’identifier les acteurs concernés : certains problèmes de l’Arctique concernent le monde entier, ou du moins tous les pays ayant une certaine puissance économique – il en est ainsi de la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ou encore de la navigation sur les routes maritimes nouvelles ouvertes en Arctique du fait du recul des glaces –, tandis que d’autres ne peuvent relever que des États riverains au regard des règles internationales qui reconnaissent leur souveraineté.
De plus, au regard de leurs traditions, il est peu probable que certains des États arctiques – tels que la Russie et le Canada avec son gouvernement actuel – acceptent une évolution vers une gouvernance commune plus intégrée. Quant à accepter une gouvernance véritablement internationale (ouverte aux États non-arctiques), aucun des États arctiques n’y semble prêt.
L’analyse des résultats obtenus par les institutions arctiques en place, en particulier le Conseil arctique, conduit pourtant à un bilan mitigé.
Il faut certes reconnaître au Conseil arctique plusieurs mérites : comme on l’a vu, il a été créé avec la double volonté de préserver l’environnement et de prendre en compte les droits des peuples autochtones ; il s’est appuyé dès ses débuts sur des programmes scientifiques et, encore aujourd’hui, il veille à asseoir ses productions politiques sur une expertise scientifique qui est réelle. Les défenseurs de l’action du Conseil considèrent qu’aucune autre institution internationale n’assoit aussi solidement ses positions sur les résultats de la science.
Cependant, les résultats de cette action ne sont pas toujours convaincants.
• L’accord de 2011 sur les secours
Tout d’abord, le Conseil arctique n’a produit qu’un seul accord juridiquement contraignant, l’« Accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes dans l’Arctique », signé à Nuuk en 2011. Encore cet accord, certes très utile dans son champ particulier, n’établit-il pas vraiment une nouvelle organisation internationale : il s’agit principalement de délimiter les zones de responsabilité des différents États et de prévoir une coordination des secours.
Pour le reste, comme on l’a vu, c’est dans d’autres cadres, qui se sont révélés plus efficaces pour « créer du droit », tels que par exemple l’Organisation maritime internationale, avec le Code polaire, ou la convention OSPAR, que les progrès récents ont été effectués.
• Un forum utile pour la mobilisation des peuples autochtones et la défense de leurs intérêts
Des résultats ont cependant aussi été obtenus au Conseil arctique en ce qui concerne la prise en compte et la mobilisation politique des peuples autochtones (25), en particulier du fait du rôle reconnu à leurs organisations dans le cadre du Conseil. Certaines de ces organisations représentées au Conseil, notamment le Conseil arctique de l’Athabaska, le Conseil international des Gwich’in et l’Association internationale des Aléoutes, semblent s’être constituées principalement en raison de l’offre de représentation que leur proposait le Conseil arctique. Dans le cadre de ce Conseil, les organisations autochtones les plus anciennes et structurées, comme le Conseil Saami, créé dès 1956, ou le Conseil circumpolaire Inuit, établi en 1977, ont également aidé les autres à s’affirmer, en particulier l’Association russe des populations autochtones du nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient. Le développement de ces organisations, dont plusieurs sont transnationales – le Conseil circumpolaire inuit fédère ainsi des organisations d’Inuits du Groenland, du Canada, de l’Alaska et de la Russie –, a également contribué à l’émergence d’une conscience commune des peuples de l’Arctique.
De plus, ces organisations des autochtones ont pu faire émerger certaines problématiques environnementales, comme celle des polluants organiques persistants, perçue comme particulièrement graves pour les peuples autochtones. Plus généralement sur les questions environnementales, le soutien du Conseil arctique à des programmes de recherche et l’écho qu’il a donné à leurs résultats aurait facilité la meilleure prise en compte de ces questions dans l’agenda du Conseil comme dans les agendas nationaux.
Pour autant, la prise en compte des intérêts des peuples autochtones dans le cadre du Conseil arctique a trouvé ses limites dans celles des prérogatives de ce Conseil : l’enjeu primordial, pour ces peuples, est souvent d’obtenir la reconnaissance de leurs droits sur les terres qu’ils habitent et leurs ressources. Or, de telles questions restent strictement du ressort des souverainetés nationales, et pas du Conseil arctique.
• Un impact limité sur l’encadrement de l’exploitation des hydrocarbures
Dans des domaines essentiels pour l’environnement tels que l’exploitation et le transport des hydrocarbures (26), le Conseil arctique a seulement édité des « lignes directrices » (guidelines) non contraignantes, qui, de surcroît, ne font généralement que reprendre des standards élaborés dans d’autres cadres internationaux plus techniques, en particulier les règlements mis en œuvre dans le cadre de l’Organisation maritime internationale et de la convention OSPAR, qui couvre une partie de l’Arctique (voir supra).
L’apport du Conseil arctique dans le domaine de l’impact sur l’environnement des activités liées aux hydrocarbures paraît donc se limiter à une certaine capacité à générer et diffuser de l’information et de la sensibilisation sur la question. La participation, en tant qu’observatrices, d’organisations environnementales au Conseil leur permet d’y promouvoir ce genre de thématiques et d’y accéder plus facilement à l’information et aux décideurs.
• L’absence d’impact visible sur les émissions de gaz à effet de serre
Le bilan n’est pas très différent pour ce qui est de la problématique du changement climatique (27), sur laquelle une mobilisation particulière des États arctiques serait pourtant doublement nécessaire, d’une part vu la rapidité du réchauffement en Arctique et les conséquences très graves qu’il y a, d’autre part du fait de leur poids dans les émissions de gaz à effet de serre. En effet, compte tenu de la présence parmi eux des États-Unis, du Canada et de la Russie, les États arctiques sont au niveau mondial responsables de près de la moitié de ces émissions.
Or, que constate-t-on ? Certes, c’est dans le cadre du Conseil arctique qu’a été lancé en 2000 un programme d’Évaluation de l’impact climatique en Arctique qui a débouché en 2004-2005 sur un rapport de synthèse, un rapport scientifique de plus de mille pages et un document politique de recommandations. Tout ceci a représenté un travail important, impliquant plus de 300 scientifiques de 15 pays différents. D’autres acteurs ont été impliqués et mobilisés, notamment des représentants des peuples autochtones et des intérêts économiques.
Il faut également souligner que le pays « leader », chargé de coordonner le programme, était les États-Unis, dont on connaît par ailleurs le refus de s’engager dans le processus de Kyoto et la sensibilité au climato-scepticisme. L’existence de ce programme sur l’Arctique aurait donc été un moyen efficace de parvenir à un certain niveau de sensibilisation et mobilisation des décideurs américains sur la thématique climatique. Selon l’étude universitaire reprise par votre Rapporteur, la déclaration politique adoptée en 2004 par le Conseil arctique constituerait le document politique signé par l’exécutif américain qui irait le plus loin dans la reconnaissance de la gravité du problème du changement climatique et dans les mesures envisagées.
Pour autant, un résultat factuel rapporté par la même étude montre les limites de cette mobilisation dans le cadre du Conseil arctique : si l’on prend les huit États arctiques membres du Conseil en tant que groupe, on constate qu’au moins sur la période 1990-2003, leurs émissions de CO2 responsable de l’effet de serre ont globalement augmenté de 19 %, alors que sur le même temps la moyenne d’évolution dans les économies développées était une baisse de 5,9 % !
• Dans le cadre du groupe des cinq États riverains, la perspective d’une réglementation de la pêche en Arctique central ?
Il faut enfin rappeler une avancée en cours non dans le cadre du Conseil arctique à proprement parler, mais entre les cinq États côtiers de l’océan Arctique : comme on l’a dit, un communiqué consécutif à leur réunion de mai 2013 à Washington laisse entrevoir la perspective d’une future organisation de gestion de la pêche (ORGP) pour l’Arctique central, qui serait précédée par la mise en place de mesures intérimaires.
*
Il faut certes se féliciter que les États arctiques aient adopté une attitude coopérative pour mettre en place une forme de collaboration et s’efforcent de fonder celle-ci sur les constats rationnels de la science. Mais le forum « semi-ouvert » (avec la place faite aux représentations des peuples autochtones et aux observateurs) qu’ils ont établi a pu être comparé à « un syndic de propriété complice des copropriétaires pour empêcher toute nouvelle arrivée » (28). Surtout, il semble que le choix d’une gouvernance régionale non contraignante, car fondée sur le consensus, sur les « bonnes pratiques » plutôt que sur les règlements et sur le respect des domaines de souveraineté (défense, mais aussi ressources minérales…) conduise nécessairement à des résultats assez limités. D’autres instruments, notamment ceux développés dans le cadre du droit international de la mer, qui débouchent sur l’adoption de textes contraignants, se révèlent finalement plus efficaces pour réaliser des progrès dans la protection de l’Arctique.
III. LES POSITIONS DE NOS PARTENAIRES
Les réflexions autour de l’évolution possible de la « gouvernance arctique » impliquent préalablement l’analyse des positions des différents partenaires.
A. LES MEMBRES DU CONSEIL ARCTIQUE
Votre président et votre rapporteur ont eu la chance de pouvoir se rendre en Norvège, à Oslo, où ils ont eu des entretiens politiques très intéressants – notamment avec le directeur de l’Institut Fridtjof Nansen, think tank de référence sur l’Arctique, M. Leiv Lunde, et l’ambassadrice norvégienne pour les pôles, Mme Else Berit Eikeland –, ainsi qu’à Ny-Ålesund, dans l’archipel du Svalbard (29), où se trouve un remarquable village scientifique international qui accueille entre autres une station de recherche franco-allemande.
À 79° de latitude nord, Ny-Ålesund est le lieu habité situé le plus au nord du monde, distant de « seulement » 1 200 kilomètres du pôle Nord. C’est un lieu où les activités de recherche se sont développées dans un cadre de coopération internationale grâce à la rencontre de plusieurs facteurs : les initiatives de chercheurs avant tout, bien sûr, avec un rôle pionnier des chercheurs français ; mais aussi l’ouverture des autorités norvégiennes à la coopération internationale ; enfin, le statut particulier du Svalbard en droit international.
a. L’Arctique, « priorité n° 1 » d’une diplomatie norvégienne pour laquelle une protection efficace doit reposer sur l’articulation de juridictions nationales solides et de la coopération internationale
i. L’Arctique, élément primordial de l’identité norvégienne
L’Arctique et l’Antarctique tiennent une place toute particulière dans l’identité norvégienne. Il faut en effet se souvenir que la Norvège n’a retrouvé son indépendance que depuis un siècle, en 1905, après plusieurs siècles de tutelle danoise puis suédoise (l’union avec le Danemark remontait à 1380). C’était alors un pays peu peuplé, pauvre, dont l’affirmation internationale n’allait pas de soi. Cette affirmation s’est faite, à la même époque, à travers deux personnalités dont la célébrité mondiale est liée à l’exploration des pôles :
– Roald Amundsen, premier homme à avoir atteint le pôle Sud en 1911 et à avoir survolé, en dirigeable, le pôle Nord en 1926 (30) ;
– Fridtjof Nansen, connu pour ses expéditions polaire, telles que la première traversée à ski du Groenland, mais aussi homme politique éminent (à l’origine en particulier du « passeport Nansen », qui a aidé après la Première guerre mondiale des millions de réfugiés « apatrides » à passer les frontières et donc trouver une nouvelle patrie).
Aujourd’hui encore, la Norvège reste l’un des grands pays de la recherche scientifique sur l’Arctique : selon les données collectées pour la préparation de notre Feuille de route nationale pour l’Arctique (voir supra), elle est le cinquième pays au monde pour le nombre de publications scientifiques sur l’Arctique (sur la période 2007-2012), pratiquement au même niveau que le Royaume-Uni et loin devant les autres pays d’Europe occidentale comme l’Allemagne et la France (31). Si l’on rapportait ce nombre de publications à la population des différents pays, ou à leurs effectifs globaux de chercheurs, la Norvège apparaîtrait probablement comme le pays ayant au monde la plus forte intensité de recherche sur l’Arctique.
Ayant joué un rôle déterminant dans l’exploration des deux pôles, la Norvège partage avec la France la caractéristique rare d’être un pays de l’hémisphère nord qui est également très présent en Antarctique. La Norvège, la France et le Royaume-Uni sont les seuls pays de l’hémisphère nord à être possessionnés en Antarctique (ou du moins à y revendiquer une souveraineté, puisque ces revendications ne sont pas unanimement reconnues).
Aujourd’hui encore, l’Arctique est la « priorité n° 1 » de la diplomatie norvégienne – c’est du moins ce que votre président et votre rapporteur ont entendu à Oslo.
ii. L’Arctique perçu comme un espace de développement économique
Le grand nord semble rester perçu en Norvège avant tout comme une sorte de frontière à coloniser : un espace riche de potentialités économiques qui est déterminant pour l’avenir du pays. Si le dixième seulement de la population norvégienne vit au-delà du cercle polaire, la région arctique du pays est la plus dynamique ; la mer de Barents est devenue la première zone de pêche pour la Norvège et, comme on l’a vu, l’exploitation des hydrocarbures off-shore se déplace progressivement vers le nord, au fur et à mesure que les gisements de la mer du Nord (qui pour la Norvège serait plutôt la « mer du Sud ») s’épuisent. Mais, dans le même temps, la Norvège est aussi le pays d’origine d’ONG très actives pour la protection de l’environnement telles que Bellona ; la sensibilité écologique y est très développée.
Dans ce contexte, les personnalités norvégiennes rencontrées à Oslo tiennent sur les régions arctiques un discours qui veut concilier volonté de développement économique et protection de l’environnement (et plus généralement sécurité dans un espace au climat extrême) :
– il conviendrait de bien distinguer « deux Arctiques » : d’une part, l’Arctique profond, englacé, où, par exemple, l’exploitation pétrolière n’est pas envisageable en l’absence de toute technologie qui permettrait d’endiguer une marée noire ; d’autre part, l’Arctique proche, représenté par la mer de Barents, où les courants marins (extrême pointe du Gulf Stream) font régner des conditions relativement tempérées proches de celles de la mer du Nord et de la mer de Norvège, ce qui justifierait dans son principe une exploitation similaire des ressources halieutiques et minérales ;
– les compétences particulières développées en Norvège dans le cadre d’une réglementation environnementale stricte permettraient aux entreprises norvégiennes de développer des activités, notamment pétrolières, dans des conditions plus propres et plus sûres que leurs concurrentes. On entend dire : « mieux vaut que les hydrocarbures soient exploités par des entreprises norvégiennes que russes, voire chinoises… ». De même, l’impact du développement du tourisme ne devrait pas être surestimé selon les interlocuteurs norvégiens, car il est ralenti par son coût très élevé, que l’adoption de nouvelles réglementations écologiques, comme récemment l’interdiction du fioul lourd pour les bateaux, accroît encore. Le sentiment général est que le développement des régions et mers arctiques sera de toute façon lent et progressif et soumis à une forte vigilance sur le respect de la sécurité des hommes et de l’environnement. Le développement économique doit être soutenable et précédé des expertises scientifiques nécessaires.
En janvier 2015, le gouvernement a demandé que soit établie une nouvelle cartographie de la banquise en mer de Barents pour tenir compte du recul des glaces. Selon des observateurs, il s’agirait de permettre l’ouverture de nouvelles zones à l’exploration pétrolière. Cependant, l’ambassadeur de Norvège, auditionné par votre rapporteur, a insisté sur le sérieux et la transparence des procédures qui conduisent dans son pays à l’ouverture de nouveaux secteurs à l’exploitation des hydrocarbures : compte tenu notamment de l’importance de la pêche dans l’identité et l’économie de la Norvège, les décisions de ce type sont au cœur du débat politique et ne sont pas prises à la légère. Pour autant, il est peu probable que la Norvège soit prête à renoncer par principe aux perspectives d’exploitation des hydrocarbures qui seraient susceptibles d’apparaître dans telle ou telle zone.
iii. Une position d’ouverture à la coopération internationale, pourvu qu’elle soit pragmatique
Sur les questions de gouvernance, la Norvège recherche un équilibre entre une forte affirmation de souveraineté dans une zone essentielle, on l’a vu, pour son identité comme pour son avenir, et une tradition « scandinave » de confiance dans la coopération internationale. L’affirmation des souverainetés nationales est présentée comme devant être mise au service de la protection de l’Arctique, car elle permet d’édicter et d’appliquer des réglementations solides et clarifie les responsabilités : le droit de la mer ne donne pas seulement aux États côtiers des droits, notamment économiques, mais aussi des obligations. À cet égard, cette affirmation est parfaitement conciliable avec des formes de coopération internationale pour autant que celles-ci permettent de conforter réglementations et mesures de protection.
S’agissant des mécanismes de coopération internationale, les autorités norvégiennes paraissent assez satisfaites du dispositif en place dans lequel, on l’a vu :
– les souverainetés nationales restent entières sur des domaines essentiels tels que l’exploitation des hydrocarbures ;
– la « gouvernance » internationale en place, avec le Conseil arctique, reconnaît la prééminence des États arctiques, mais admet, au second plan, la participation des autres États et organisations qui le veulent, un certain nombre de problèmes, à commencer par celui du changement climatique, impliquant clairement le monde entier ;
– dans une optique pragmatique, des résultats concrets peuvent être obtenus sur des questions telles que la représentation des peuples indigènes, le secours en mer, la réglementation de la navigation et celle de la pêche. Du point de vue de l’ambassadrice norvégienne pour les pôles, Mme Eikeland, l’Arctique constitue déjà un espace fortement réglementé.
L’ambassadeur de Norvège à Paris, M. Rolf Einar Fife, a de même mis en avant le souci de la Norvège de promouvoir des démarches pragmatiques et ouvertes, dès lors qu’elles débouchent sur des résultats opérationnels et permettent d’obtenir des règles qui évitent les contournements. Il a cité en exemple les résultats obtenus en matière de gestion de la pêche, où l’on va vers une convergence des différentes réglementations – norvégienne, européenne et même russe – vers un haut niveau de standards.
Autre élément de satisfaction du point de vue norvégien, les coopérations régionales mises en place conduisent progressivement vers un plus grand partage des résultats scientifiques, une plus grande transparence, alors que l’on partait d’un niveau dramatiquement bas au temps de la Guerre froide et de l’URSS.
Parmi les États riverains de l’océan Arctique, la Norvège ressort donc comme l’un des plus ouverts à l’implication des autres États et organisations, sous réserve qu’elle ne remette pas en cause l’équilibre actuel du dispositif. Elle soutient par exemple que le conseil économique qui vient d’être créé dans le cadre du Conseil arctique doit être ouvert à toutes les entreprises présentes dans l’Arctique, quelle que soit leur nationalité, alors que d’autres États riverains privilégient une approche exclusive. La Norvège se distancie également des revendications excessives de souveraineté, notamment celles du Canada et de la Russie sur le pôle Nord, dont elle considère de toute façon qu’elles ne seront pas reconnues car elles excèdent le droit international. Elle est de manière générale favorable à une plus grande implication des observateurs du Conseil arctique, même si la présence accrue des grands pays asiatiques, en particulier la Chine et la Corée du Sud, suscite quelques interrogations…
La Norvège est également très favorable à la démarche de réglementation du Code polaire, qui est présentée comme efficace et pragmatique.
iv. Un souci constant de conserver sur les sujets arctiques de bonnes relations avec la Russie
Enfin, la Norvège a un souci spécifique, c’est celui de ses relations avec la Russie, relations qui sont pleinement « arctiques » puisque c’est au-delà du cercle polaire que les deux pays partagent une courte frontière terrestre, puis une longue frontière maritime dans la mer de Barents.
Reprenant une formule appliquée traditionnellement aux relations entre le Canada et les États-Unis, Mme Eikeland a évoqué devant votre Président et votre Rapporteur la difficulté qu’il y a pour un petit pays à « partager son lit avec un éléphant »…
Dès l’époque soviétique et malgré la Guerre froide, la Norvège a cherché à trouver des arrangements avec son grand voisin en mer de Barents. C’est ainsi qu’en 1957 a été signé un traité de délimitation des eaux territoriales dans le Varangerfjorden. Des négociations sur la délimitation des plateaux continentaux ont ensuite été engagées, dès 1970, et un premier accord partiel portant sur la gestion de la pêche dans les zones disputées passé en 1978. Un traité global a finalement été conclu en 2010, qui fixe la même frontière aussi bien pour les zones économiques exclusives (ZEE) que pour le plateau continental (32).
Outre le Conseil arctique et celui des États de la mer Baltique, les deux pays sont également impliqués, avec la Suède et la Finlande, dans le projet de Région euro-arctique de Barents, lancé en 1993 à l’initiative de la Norvège pour favoriser des projets concrets de coopération et de développement couvrant les régions nord des pays scandinaves et le nord-ouest de la Russie. Une analyse de ces projets présentée dans un article universitaire montre que la grande majorité sont en fait financés par la Norvège et orientés principalement vers la Russie : selon cette étude, en 2002-2003, 43 projets ont été financés par la Norvège contre 9 par la Finlande et 3 par la Suède ; sur ces projets, 24 étaient orientés vers la Russie, notamment la promotion de ses peuples autochtones arctiques (33).
Plus spécifiquement, le gouvernement norvégien et l’industrie pétrolière financent depuis 2007 le projet « Barents 2020 », qui vise à développer des standards communs à la Russie et la Norvège pour l’exploitation et le transport des hydrocarbures en mer de Barents. L’objectif serait d’y obtenir le même degré de sécurité qu’en mer du Nord, ceci impliquant des standards plus exigeants compte tenu d’un environnement plus sévère et de risques plus élevés.
À l’heure où votre président et votre rapporteur étaient à Oslo, l’inquiétude manifeste de leurs interlocuteurs norvégiens était que la crise ukrainienne finisse par mettre en cause leur coopération avec la Russie en mer de Barents, volontiers présentée comme exemplaire. Un désengagement de la Russie des organisations régionales à commencer par le Conseil arctique serait dramatique pour ces institutions.
b. Le statut particulier du Svalbard
Le Svalbard s’étend entre 74° et 81° de latitude nord, dans l’océan Arctique, au nord de la Norvège continentale. C’est un archipel montagneux (avec un point culminant à 1 713 mètres) de 62 000 km2, environ 60 % de cette surface étant couverte par des glaciers.
Il a été découvert – ou redécouvert car il était peut-être connu des Vikings du Moyen-Âge – par le navigateur hollandais Willem Barents en 1596. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, le Svalbard a surtout été fréquenté par les baleiniers qui pêchaient dans ses eaux. Il a également connu durant la première moitié du XXème siècle une période d’exploitation houillère intense, conduite par des entreprises de diverses origines (anglo-saxonnes, russes, norvégiennes…). Il a aussi servi de base de départ pour de nombreuses expéditions arctiques. C’est d’ailleurs de Ny-Ålesund précisément qu’est parti pour le premier survol du pôle Nord le dirigeable Norge en 1926, avec à son bord Roald Amundsen et Umberto Nobile ; c’est également de Ny-Ålesund que ce dernier est parti en 1928 pour le voyage dramatique du dirigeable Italia.
Aujourd’hui, l’archipel compte environ 2 600 habitants, principalement installés dans sa capitale, Longyearbyen, mais aussi dans diverses implantation comme Ny-Ålesund ou les villes russes de Barentsburg et Pyramiden. L’activité minière est désormais résiduelle, mais, outre les activités de recherche et celles liées à la pêche, il convient de signaler que, depuis 2008, l’isolement du Svalbard lui vaut d’accueillir dans un abri souterrain un dépôt mondial de semences, le Svalbard Global Seed Vault, destiné à assurer la conservation de la biodiversité à travers les pires catastrophes éventuelles (naturelles, technologiques ou militaires) et, plus simplement, la standardisation des cultures et le changement climatique.
Fréquenté par des baleiniers, puis des compagnies minières, en provenance de divers pays, le Svalbard est longtemps resté l’une des rares terres répertoriées à ne relever d’aucune souveraineté établie, malgré diverses revendications et tentatives de trouver un arrangement (au XVIIème siècle entre Royaume-Uni, Pays-Bas et Danemark ; avant la Première guerre mondiale, entre Russie, Suède et Norvège) (34).
Ce n’est qu’après la Première guerre mondiale, alors que la Russie en révolution était hors du jeu diplomatique et en compensation des pertes subies par sa flotte marchande, que la Norvège se vit attribuer, mais sous conditions, le Svalbard.
i. Le traité de Paris : un régime de souveraineté encadrée
Le « traité concernant le Spitsberg » a été signé à Paris le 9 février 1920 par une dizaine de pays qui faisaient partie des vainqueurs de la guerre ou avaient été neutres : États-Unis, Royaume-Uni, Danemark, France, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas et Suède. Il a depuis lors été ratifié par une quarantaine de pays, dont toutes les grandes puissances et tous les pays arctiques (notamment, outre les signataires initiaux, la Russie, la Chine, l’Inde, les principaux pays européens…).
Ce traité confie le Svalbard à la Norvège, mais avec un régime de souveraineté conditionnelle. En effet, son article 1er reconnaît certes une « pleine et entière souveraineté de la Norvège », mais les articles suivants limitent de fait cette souveraineté, principalement en imposant des règles d’accès égal, non- discriminatoire, pour les ressortissants de toutes les parties contractantes au territoire et à ses richesses.
Il est ainsi de l’article 2 relatif aux droits de chasse et de pêche dans les eaux territoriales, qui reconnaît le droit des autorités norvégiennes de réglementer ces activités, sous réserve que ce soit de manière non discriminatoire. L’article 3 garantit de même le droit de tous ressortissants des pays signataires à se livrer « à toutes opérations maritimes, industrielles, minières et commerciales sur un pied de parfaite égalité ». L’article 8, plus précisément, stipule que les autorités norvégiennes auront la charge d’édicter un régime minier non discriminatoire et ne comportant pas de privilèges d’État (au bénéfice de la Norvège) ; de plus, il est prévu que le projet de règlement minier devra être soumis à une consultation des autres parties contractantes – effectivement, les autorités norvégiennes ont édicté un règlement minier libéral et non discriminatoire (attribution de permis d’exploration puis de concessions aux découvreurs des gisements).
Par ailleurs, il est prévu une démilitarisation du Svalbard (article 9). Enfin, selon l’article 8, les impôts, taxes et droits levés au Svalbard doivent être exclusivement utilisés sur place. L’archipel reste donc, aujourd’hui, une zone franche fiscale et ne fait pas partie du territoire douanier norvégien.
ii. Un régime juridique jusqu’à présent factuellement protecteur, bien que fragile
Le Svalbard est resté depuis le traité de Paris dans cette situation ambiguë de souveraineté norvégienne encadrée par les stipulations de ce traité. La question de la souveraineté reste également incertaine quant aux eaux entourant l’archipel. Comme on le sait, l’évolution du droit de la mer permet désormais aux États côtiers de revendiquer le contrôle des ressources halieutiques d’une zone économique exclusive (ZEE) large de 200 milles marins et celui des ressources minérales de leur plateau continental, qui s’étend au moins jusqu’à cette limite et peut l’excéder dans certains cas.
Tenant compte de cette évolution tout en prenant le soin de procéder à des consultations diplomatiques, la Norvège a établi en 1977 un régime de protection des ressources halieutiques dans l’aire des 200 milles marins autour du Svalbard. L’applicabilité ou non des provisions du traité de Paris encadrant la souveraineté norvégienne à ces eaux extra-territoriales reste discutée, puisque, par construction, ledit traité n’a pas abordé des questions qui ne se posaient pas en son temps. Cependant, la position norvégienne a consisté à affirmer une souveraineté pleine sur la « zone de pêche » du Svalbard, assimilée à une ZEE, justement au motif qu’elle n’était pas comprise dans le champ visé par le traité de Paris. À partir de 1993, les garde-côtes norvégiens se sont mis à contrôler effectivement les bateaux pêchant dans cette zone de pêche du Svalbard, les arraisonnant le cas échéant, mais semble-t-il en évitant de s’attaquer aux navires russes pour éviter des incidents… Ceci a naturellement suscité des protestations d’autres États concernés, en particulier de l’Islande. Par ailleurs, à plusieurs occasions, des pêcheurs arraisonnés et verbalisés par les garde-côtes norvégiens ont invoqué le traité de Paris devant les tribunaux norvégiens en arguant qu’il devait s’appliquer à la zone de pêche du Svalbard et que la réglementation de la pêche édictée par la Norvège ne respectait pas l’obligation de non-discrimination posée par ce traité (du fait de l’établissement d’un régime de quotas de pêche selon le pavillon des bateaux et de l’absence de contrôle des bateaux russes). Mais les tribunaux saisis ont toujours écarté cette argumentation, soit en estimant que peu importait l’applicabilité ou non du traité de Paris, la réglementation des pêches en cause étant selon eux non-discriminatoire, soit en considérant qu’en l’absence d’un recours formel par un État devant la Cour de justice internationale de La Haye, la souveraineté pleine de la Norvège sur la zone de pêche du Svalbard était incontestée.
S’agissant des éventuelles ressources en hydrocarbures du plateau continental, la Norvège s’était exposée dans les années 1980 à de vives protestations internationales en ouvrant à l’exploration pétrolière des secteurs situés au nord de ses côtes qui « mordaient » un peu sur le plateau continental du Svalbard. Mais finalement ces zones limitrophes n’ont alors pas fait l’objet de concessions pour l’exploitation et le conflit s’est apaisé.
Des informations rapportées récemment dans la presse sont venues ranimer les inquiétudes : la compagnie norvégienne Statoil aurait en 2014 foré des puits d’exploration dans le nord de la mer de Barents à environ 300 kilomètres seulement au sud-est du Svalbard. Des secteurs situés dans le périmètre des 200 milles marins autour de l’archipel auraient donc été ouverts à l’exploration pétrolière. La mission n’est toutefois pas en mesure de confirmer ou d’infirmer ces faits.
Le traité de Paris n’a pas été établi dans un but de protection de l’environnement qui n’était pas à l’ordre du jour en son temps. Bien au contraire, s’il avait le mérite de prévoir la démilitarisation du Svalbard, il visait aussi à garantir son ouverture à l’exploitation économique, notamment minière, de tous, pourvu qu’elle fût non-discriminatoire. Mais, de fait, le régime juridique institué par ce traité a contribué à protéger le Svalbard et ses eaux jusqu’à présent : les incertitudes concernant la souveraineté norvégienne ont sans doute longtemps aidé à ce que les autorités de ce pays n’y ouvrent pas l’exploitation des hydrocarbures off-shore et adoptent un régime de pêche prudent, guère contestable dans son principe même si son application suscite des incidents.
De plus, l’ouverture internationale imposée par le traité – accès non-discriminatoire des ressortissants des pays signataires –, si elle visait d’abord l’exploitation économique, a aussi favorisé le développement d’une présence scientifique internationale et coopérative. À l’origine du village scientifique actuel de Ny-Ålesund, il y a les expéditions polaires des années 1920, puis l’installation en 1963 d’un chercheur français, Jean Corbel, qui profitait de la possibilité pour tout un chacun, vu le statut international, d’aller poser ses instruments et construire sa cabane au Svalbard…
Mais s’il était confirmé que les autorités norvégiennes ont autorisé des forages d’exploration dans la zone de pêche du Svalbard, il est clair que les parties au traité de Paris seraient légitimes à demander à la Norvège de préciser son interprétation de celui-ci et notamment sa position quant à l’application du traité dans la zone économique maritime du Svalbard. Un certain nombre de questions complexes et potentiellement conflictuelles se poseraient quant aux autorités habilitées à gérer les ressources naturelles de ces eaux et de leurs fonds et quant à l’affectation des éventuelles royalties résultant de cette exploitation (étant rappelé que, selon le traité de Paris, les éventuels prélèvements fiscaux opérés au Svalbard doivent être utilisés sur place).
c. Ny-Ålesund, village scientifique international
Ny-Ålesund a d’abord été un village de mineurs : une mine de charbon y a été exploitée de 1916 à 1962, jusqu’à ce qu’un grave accident provoque le décès de 21 mineurs.
Pendant cette période minière, une certaine vocation scientifique et touristique était déjà présente, avec, on l’a dit, le passage de plusieurs expéditions polaires et l’ouverture d’un hôtel, le Nordpolhotellet, lequel existe toujours.
Mais la vocation scientifique s’est surtout affirmée après la fermeture de la mine, et d’entrée en jeu dans une optique de coopération internationale grâce à la position d’ouverture des autorités norvégiennes. En 1964, ces dernières ont en effet signé un accord avec le Conseil européen de recherches spatiales pour la création d’une station de télémétrie par satellite. C’est en 1968 que l’Institut polaire norvégien (Norsk Polarinstittut) s’est implanté dans la station.
Les scientifiques norvégiens avaient toutefois été précédés par le géologue français Jean Corbel, qui avait installé en 1963 une première station à quelques kilomètres de Ny-Ålesund. Cette station française existe toujours et porte désormais son nom. Par droit d’antériorité et bien que, par ailleurs, l’ensemble des terrains et bâtiments de la zone appartiennent en principe à la compagnie Kingsbay, elle continue d’appartenir à la France.
La compagnie Kingsbay est une entreprise publique constituée par les autorités norvégiennes pour assurer toute la gestion logistique du site de Ny-Ålesund : construction et entretien des bâtiments ; gestion de la centrale électrique, du restaurant commun à tous les personnels et scientifiques, de la boutique, de l’hôtel, de la salle de sport et même de certains équipements scientifiques communs, notamment un laboratoire marin ; gestion de l’aérodrome et des rotations aériennes avec Longyearbyen, capitale du Svalbard. Pour ce faire, elle emploie 25 personnes et gère un budget équivalent à environ 9 millions d’euros, abondé principalement par les redevances versées par les pays pour leurs stations scientifiques en contrepartie de ces services et par les touristes qui débarquent régulièrement dans le petit port, mais également complété par une subvention d’investissement du gouvernement norvégien.
Cette gestion commune de la logistique n’a pas seulement un intérêt en termes de coûts. Les échanges qui ont lieu dans la cantine commune ou le fait de partager le laboratoire marin favorisent aussi le développement de coopérations entre les équipes scientifiques.
Les stations scientifiques des différents pays sont installées pour l’essentiel dans d’anciennes maisons du village minier, que les autorités locales préservent soigneusement. Dix pays sont aujourd’hui représentés (d’autres l’ayant été dans le passé, mais s’étant retirés) : six pays européens, soit la Norvège, bien sûr, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ; mais aussi, depuis les années 2000, quatre pays asiatiques, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde et le Japon. Cette présence des Asiatiques et en particulier des Chinois, qui se mêlent peu aux autres résidents, suscite beaucoup d’interrogations quant à la nature de leurs activités…
Globalement, la population du village est généralement d’environ 150 personnes en été, principale période de venue des scientifiques, et peut atteindre 190. Il faut aussi compter avec les nombreux touristes qui ne séjournent jamais mais débarquent de bateaux de croisière pour une escale de quelques heures : 25 000 à 40 000 par an ces dernières années ! En revanche, en hiver, il reste au mieux une trentaine de permanents qui assurent la continuité logistique.
La France et l’Allemagne ont fait depuis une vingtaine d’années le choix de mettre en commun leurs moyens à Ny-Ålesund : leurs installations sont regroupées sous l’acronyme AWIPEV, issu de la fusion des acronymes de l’Alfred Wegener Institut (AWI) et de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV). L’AWIPEV fonctionne avec une équipe de trois permanents, qui gèrent les bâtiments et les équipements communs et accueillent les équipes scientifiques. La répartition des charges a fait l’objet de compromis pragmatiques entre l’AWI et l’IPEV : le premier recrute et paye deux des permanents, le second a en charge le troisième ; les motoneiges et les équipements de plongée sont l’affaire des Allemands ; les bateaux sont celle des Français… L’AWIPEV peut recevoir jusqu’à une petite vingtaine de scientifiques en même temps et ses locaux sont généralement bien remplis. Pour le nombre de journées de recherche effectuées, il vient en tête de toutes les stations, devant même le Norsk Polarinstitutt (qui pourtant reçoit aussi des équipes non-norvégiennes). C’est donc un bel exemple de mutualisation franco-allemande, qu’il est au demeurant envisagé d’étendre aux Néerlandais (qui actuellement ont une petite station autonome).
Les recherches conduites à Ny-Ålesund concernent de nombreux domaines, dont (la liste n’est pas exhaustive) :
– la météorologie et les changements de l’atmosphère, avec l’envoi de ballons-sondes pour mesurer l’ozone ou la vapeur d’eau dans la haute atmosphère et l’utilisation de diverses techniques (spectrométrie, réflexion d’un rayon laser, analyse isotopique…) pour analyser la présence des différents gaz ou aérosols. Un lieu aussi isolé, « loin de tout », que Ny-Ålesund permet en particulier de mesurer la transformation globale de notre atmosphère et la pollution diffuse qui est présente partout même très loin de toute activité humaine ;
– la biologie marine, avec des thèmes de recherche liés là-aussi à l’impact anthropique sur l’environnement (pollution diffuse, effets de l’acidification de l’océan qui résulte de la teneur accrue en CO2, adaptation au changement climatique…), mais aussi simplement à l’environnement du grand nord (adaptation des êtres vivants au froid et à la congélation, ou à l’alternance entre le jour permanent de l’été et la nuit sans fin de l’hiver…) ;
– la glaciologie. Il faut saluer dans ce domaine l’engagement dans la durée des équipes françaises qui se rendent tous les étés dans la station Corbel pour quantifier très précisément, à l’aide de multiples méthodes de mesure, le recul inéluctable d’un petit glacier qui en est voisin ;
– des thèmes plus inattendus tels que la « Mars-analogie » : il s’agit notamment, par l’analyse morphologique de reliefs terrestres façonnés par l’eau et la glace, de se doter d’instruments pour détecter, sur les photographies de la planète Mars, des reliefs qui rendraient compte d’une présence passée des mêmes éléments (35) !
Votre président et votre rapporteur remercient les personnels de la station AWIPEV, du Norsk Polarinstitutt, de la station arctique italienne Dirigible Italia et de la compagnie Kingsbay, ainsi que les chercheurs français présents sur place, pour leur accueil à Ny-Ålesund et le temps qu’ils ont bien voulu leur consacrer.
Pour ce qui concerne le positionnement arctique, la Finlande et la Suède ont plusieurs points communs :
– leur absence de débouché sur l’océan Arctique, bien qu’elles appartiennent au Conseil arctique du fait qu’une partie de leur territoire est au-delà du cercle polaire ;
– leur appartenance à l’Union européenne, qui les conduit à soutenir une implication accrue de l’Union en tant que telle en Arctique ;
– la priorité donnée aux questions environnementales – le développement économique devant être soutenable et appuyé sur des évaluations d’impact environnemental – et à la prise en considération des intérêts des peuples autochtones, en particulier en Finlande où la minorité saami dispose d’une reconnaissance constitutionnelle.
a. Un « porte-avions » pour les intérêts asiatiques dans l’Arctique ?
Comme l’observe le politologue Damien Degeorges, l’Islande a connu depuis quelques années une situation géopolitique glissante (36) : longtemps perçue comme un « porte-avions » américain au milieu de l’Atlantique-Nord, compte tenu des liens privilégiés qui avaient été tissés avec les États-Unis, elle semble en passe de jouer le même rôle pour la Chine, ce après un bref épisode « européen » où l’adhésion à l’Union européenne a été envisagée.
Ces récentes tentations européenne, puis chinoise (sans oublier un intermède russe), sont bien sûr liées aux suites de la dramatique crise des banques islandaises en 2008, laquelle a sur le coup provoqué un effondrement monétaire et économique qui a amené le pays à chercher tous les partenaires économiques possibles.
L’auteur précité met en avant plusieurs signes de l’intérêt soudain et manifeste de la Chine pour le petit État insulaire (320 000 habitants) : la signature de plusieurs accords à partir de 2012, dont un traité de libre-échange en 2013 ; la construction à Reykjavik d’une ambassade chinoise et d’un bâtiment du service économique d’une taille impressionnante pour cette ville ; l’annonce en 2013 du rachat possible de la banque Íslandsbanki par des investisseurs chinois ; la tentative en 2012 d’un hommes d’affaires chinois d’acheter un immense terrain dans le nord-est du pays…
Il signale parallèlement l’intérêt de Singapour, autre pays asiatique, pour l’Islande, avec notamment la désignation récente, pour la première fois, d’un ambassadeur singapourien (non-résident) pour l’Islande, choisi parmi les diplomates les plus éminents.
Comme au Groenland (voir infra), il est manifeste que les intérêts asiatiques, utilisant opportunément les difficultés de l’Islande, cherchent à se placer dans la perspective d’un futur développement des routes maritimes passant par l’Arctique et de l’exploitation de ses ressources naturelles.
b. Une revendication non satisfaite : se voir reconnaître le statut d’État côtier de l’océan Arctique
L’Islande s’est dotée d’une stratégie politique concernant l’Arctique avec l’adoption, en mars 2011, d’une résolution par son parlement, l’Althing.
Ce document comprend un ensemble d’observations générales que l’on retrouve peu ou prou dans les textes officiels de tous les pays concernant l’Arctique : soutien aux droits des peuples autochtones, nécessité de prévenir le changement climatique et ses effets, souhait d’un développement du commerce et des connaissances scientifiques… On peut cependant noter dans le document islandais une tonalité particulièrement pacifiste et environnementale, avec le souci d’éviter toute militarisation de l’Arctique et la priorité clairement donnée à l’environnement sur le développement économique (ce dernier doit être mis au service d’une utilisation soutenable des ressources naturelles).
Surtout, cette résolution parlementaire est significative car elle met nettement en avant un certain nombre de priorités géopolitiques du pays.
Les Islandais sont mécontents du développement de formes spécifiques de coopération entre les cinq États côtiers de l’océan Arctique que sont la Russie, les États-Unis, le Canada, le Danemark et la Norvège, car ils sont exclus de ce cercle. Pour cette raison, les premiers items de la résolution de 2011 sont consacrés à :
– la promotion du Conseil arctique (dans sa formation à huit États, dont l’Islande) et du droit onusien de la mer comme références ;
– la revendication d’un statut d’État côtier de l’Arctique par l’Islande (au motif que la zone économique exclusive du pays jouxterait l’océan Arctique) et la promotion concomitante du principe selon lequel l’« Arctique » comprendrait aussi les régions adjacentes de l’Atlantique-Nord (où se trouve l’Islande) ;
– l’affirmation d’une volonté de coopération accrue avec les îles Féroé et le Groenland (les deux restant des dépendances danoises, comme le fut l’Islande dans le passé).
Il faut également signaler que les relations de l’Islande avec la Norvège sont compliquées par deux points : le fait que Tromsø ait été choisi plutôt que Reykjavik comme siège du secrétariat permanent du Conseil arctique ; les difficultés récurrentes sur la question du Svalbard, notamment du fait de la mise en place unilatérale et de l’application d’une réglementation de la pêche dans la zone des 200 milles marins.
c. En conséquence, la promotion d’une coopération « ouverte » : The Arctic Circle
C’est dans le contexte général de révolution citoyenne connue par l’Islande après la crise bancaire, d’ouverture aux intérêts asiatiques et de défiance vis-à-vis de la prétention de certains pays arctiques à promouvoir un format à cinq États côtiers sans l’Islande que le président islandais Ólafur Ragnar Grímsson a été à l’origine en 2013 d’une nouvelle organisation, « The Arctic Circle ». Il ne s’agit pas d’une institution intergouvernementale, mais d’une ONG qui se présente comme un forum ouvert destiné à faciliter le dialogue en vue de faire face aux changements rapides en Arctique. Son large bureau comprend, outre des personnalités emblématiques comme le prince de Monaco, un panel d’universitaires et de représentants de divers organismes de recherche arctique, des peuples autochtones, d’ONG, mais aussi d’entreprises privées, notamment d’armateurs, etc. Même si la majorité des membres sont issus des pays arctiques ou européens, une place est faite aux grands pays asiatiques.
Le Danemark est un État arctique du fait de la souveraineté qu’il exerce sur le Groenland.
a. Les interrogations sur l’avenir politique et économique du Groenland
Immense territoire (2,2 millions de km2, soit quatre fois la France) peuplé de seulement 57 000 habitants qui sont en grande majorité des Inuits, couvert à 80 % par l’inlandsis, le Groenland a, comme le relève le politologue Damien Degeorges, « tout pour attirer les grandes puissances, tant sur l’aspect énergétique, avec un potentiel considérable en ressources naturelles (hydrocarbures, minerais, eau), que sur la dimension arctique, de par sa localisation au cœur de cette nouvelle frontière des relations internationales ».
Pour le moment, toutefois, l’économie locale repose essentiellement sur la pêche et dépend toujours lourdement de l’aide financière danoise. Mais les ressources pétrolières off-shore pourraient être considérables, même si une première campagne de délivrance de licences d’exploration en 1978 n’avait pas débouché sur des résultats probants ; depuis 2006, de nombreuses licences nouvelles ont été attribuées et des forages sont en cours de test. Par ailleurs, le Groenland pourrait représenter une alternative au quasi-monopole chinois actuel sur la production des « terres rares », famille de métaux stratégiques pour un certain nombre d’industries d’avenir (batteries des véhicules électriques, éoliennes, écrans, etc.) et pour les industries d’armement : comme on l’a dit, un gisement d’importance mondiale a été découvert près de Narsaq. Divers autres minerais sont également présents.
Sur le plan stratégique, le Groenland abrite toujours la base américaine de Thulé, qui joue un rôle déterminant dans la défense anti-missile des États-Unis. Un accord tripartite (États-Unis, Danemark et Groenland) a été signé à Igaliku en 2004 pour moderniser l’accord de défense américano-danois de 1951.
Anciennement colonie danoise, le Groenland a acquis un régime d’autonomie interne en 1979. Dans ce cadre, il a fait le choix de se retirer de la Communauté européenne, à laquelle le Danemark avait adhéré, en 1985. Depuis 2009, suite à un referendum, l’autonomie a été élargie ; ne restent de la compétence danoise que la politique étrangère, la défense nationale, la citoyenneté et la politique monétaire ; le Groenland a donc obtenu, notamment, la maîtrise de ses ressources naturelles.
Le Groenland suscite un intérêt marqué de la part de certains pays asiatiques. En 2012, il a reçu la visite du président sud-coréen Lee Myung-bak, venu sans même une escale au Danemark ou la présence du Premier ministre danois… Des délégations groenlandaises se sont rendues la même année en Corée du Sud et en Chine.
Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la perspective d’une éventuelle accession à l’indépendance du territoire : selon Damien Degeorges, « l’élite politique du Groenland n’est (...) constituée que de 44 personnes (9 ministres, 31 parlementaires et 4 maires) : ainsi, un lobbying auprès d’environ 25 personnes suffit pour avoir accès aux atouts stratégiques du Groenland. Autant dire peu de monde pour de grandes entreprises ou des États habitués à bien plus et qui pourront être aidés dans leur démarche par le fait qu’une partie de ces 25 personnes n’auront pas nécessairement une connaissance approfondie des enjeux internationaux entourant ce développement » (37).
Le Groenland souffre en outre d’autres faiblesses structurelles, notamment en matière d’infrastructures : ce pays immense mais très peu peuplé n’a quasiment pas de routes et un seul aéroport permettant d’accueillir des vols civils internationaux, à Kangerlussuaq, comme le note le sénateur André Gattolin dans son récent rapport d’information sur le pays (38).
Le même rapport souligne à juste titre à quel point la société groenlandaise traditionnelle est « malmenée par la mondialisation » qu’elle subit très rapidement, avec notamment un taux de suicides qui est dramatique. Il est clair qu’un développement massif d’activités minières n’aurait pas seulement des impacts environnementaux, mais aussi des impacts sociaux très lourds, car, dans ce pays quasiment vide, il impliquerait la venue de milliers de travailleurs étrangers qui constitueraient instantanément une part très importante de la petite population groenlandaise.
C’est pourquoi il faut certainement souhaiter aux Groenlandais de choisir des modes de développement « doux » et durable, privilégiant des activités telles que le tourisme et la pêche. Les enjeux de formation, en particulier des nouvelles élites, et plus généralement de consolidation de l’économie groenlandaise dans une logique de développement durable sont essentiels.
Il faut relever, point positif, la signature d’une lettre d’intention visant à une coopération dans le domaine des matières premières entre l’Union européenne et le Groenland lors de la visite du vice-président d’alors de la Commission européenne, M. Antonio Tajani, au Groenland en 2012. Selon M. Damien Degeorges, « l’Union européenne a un rôle à jouer [dans le contexte d’une évolution vers l’indépendance] : proposer au Groenland d’être le "filet de protection" économique dont l’éventuel État groenlandais aura besoin, en l’absence de la subvention annuelle de l’État danois ». En 2012, la communication de la Commission européenne sur la politique arctique de l’Union a rappelé l’importance d’une relation renforcée avec le Groenland. Certains estiment que le chemin le plus court vers l’indépendance du Groenland serait une ré-adhésion à un ensemble partiellement supranational comme l’Union européenne. D’autres ne croient pas en cette perspective, privilégiant un partenariat renforcé.
b. Une revendication audacieuse sur le pôle Nord
Le Danemark a présenté sa « stratégie pour l’Arctique 2011-2020 » en août 2011. On y retrouve le même type d’équilibre entre préoccupations environnementales et économiques que dans les documents de même nature des autres nations : ce texte promeut un développement économique respectueux de l’environnement, avec une exploitation des ressources minérales conduite selon les standards internationaux les plus stricts, une pêche gérée en fonction des connaissances scientifiques, un usage accru des énergies renouvelables… Il insiste par ailleurs sur la coopération nécessaire, en l’absence de traité sur l’Arctique, dans le cadre du droit international de la mer, avec les partenaires internationaux, en particulier les autres États riverains de l’océan Arctique, avec un focus sur les États-Unis et le Canada, avec lesquels des coopérations bilatérales ont été établies.
Comme on l’a vu supra, le Danemark a officiellement déposé, le 15 décembre 2014, une très large demande d’extension de son plateau continental dans l’océan Arctique, bien au-delà du pôle Nord, devant la commission compétente en application de la convention de Montego Bay.
Par la longueur de ses côtes donnant sur l’océan Arctique et donc des parties de cet océan qu’il peut revendiquer comme zone économique exclusive et comme plateau continental, le Canada est le deuxième pays arctique après la Russie.
De fait, l’Arctique est au cœur de la politique étrangère canadienne depuis les années 1950 et connaît depuis quelques années un regain d’intérêt marqué avec la publication, en 2007, d’une « Stratégie pour le Nord » comprenant un volet de politique étrangère. L’affirmation de la souveraineté dans les régions du nord est devenue un marqueur de la politique intérieure canadienne avec l’arrivée au pouvoir en 2006 du Premier ministre conservateur Stephen Harper. Cependant, on ne peut manquer d’observer un décalage entre un discours qui fait de l’Arctique une affaire de fierté nationale et la réalité des intérêts et de la présence du Canada dans l’Arctique, qu’il ne faut pas surestimer.
a. L’Arctique canadien : une population peu nombreuse, des intérêts économiques qu’il ne faut pas surestimer
Les régions arctiques du Canada sont peu peuplées par rapport à leurs homologues russes ou norvégiennes : ainsi l’immense – 2 millions de km2 – territoire fédéral du Nunavut, créé en 1999 pour reconnaître l’autonomie des Inuits canadiens et qui couvre une grande portion de l’Arctique canadien, n’a-t-il que 35 000 habitants (à plus de 83 % Inuits).
Le réchauffement climatique réveille aujourd’hui les appétits de développement économique, mais les potentialités en la matière apparaissent plus limitées que dans d’autres zones de l’Arctique.
• Le passage du Nord-Ouest
Le recul des glaces rend aujourd’hui moins difficile la navigation dans le « passage du Nord-Ouest », terme qui désigne plusieurs routes maritimes possibles reliant les océans Atlantique et Pacifique à travers l’archipel arctique canadien. 7 bateaux ont emprunté le passage en 2005, 12 en 2007, 13 en 2008, 23 en 2009, 34 en 2011…
Cela dit, il s’agit encore essentiellement de bateaux de tourisme. En pratique, comme on l’a indiqué supra, l’avenir du passage du Nord-Ouest est hypothéqué par deux faits :
– les infrastructures (ports, équipements de sécurité) canadiennes le long du passage sont quasi-inexistantes ;
– les autres routes polaires possibles – le passage du Nord-Est et la route transpolaire – ont plus de potentiel. En particulier, le passage du Nord-Est le long de la Sibérie est plus court, moins sinueux, plus profond, moins encombré d’icebergs et beaucoup mieux équipé (ports, brise-glaces…).
• Les richesses minérales
L’Arctique canadien recèle potentiellement des gisements d’hydrocarbures significatifs, mais moindres que d’autres zones de l’Arctique. Ces ressources semblent marginales en comparaison des sables bitumineux de l’Alberta. L’exemple historique de l’échec des forages de prospection des années 1970 et 1980 dans les Territoires du Nord-Ouest conduit également à douter d’une future « ruée vers l’or noir » dans l’Arctique canadien (39).
De même, le potentiel minier de l’archipel arctique canadien est réel, mais ne doit pas être exagéré, surtout au regard des conditions difficiles de production. Comme on a eu l’occasion de le développer supra, nombre de gisements repérés restent inexploités et des mines qui avaient été ouvertes ont parfois été fermées au bout de quelques années.
b. Le contraste entre un volontarisme politique affirmé et des moyens modestes
Depuis 2006, l’identité arctique été mise au service de la politique étrangère du gouvernement conservateur, avec une insistance particulière sue les menaces extérieures contre la souveraineté canadienne. La communication gouvernementale valorise les démonstrations de défense de cette souveraineté. La stratégie de défense « Le Canada d’abord », publiée en 2008, pose la protection de la souveraineté arctique comme première des six missions de l’armée. L’exercice de cette souveraineté apparaît également en tête des piliers de la doctrine arctique du pays (40), devant le développement économique et social, la protection de l’environnement et le contrôle de leur destinée par les populations locales de l’Arctique, notamment les peuples autochtones.
La défense du droit des populations arctiques à décider de leur destin est en effet l’autre axe original de la position canadienne : cette priorité est concrétisée à travers des mesures telles que la création du territoire du Nunavut et sert de justification aux positions canadiennes de refus de prohiber les chasses traditionnelles de l’ours blanc ou du phoque et/ou le commerce des produits qui en sont issus.
Des grands projets ont été annoncés dans le domaine militaire, mais aussi les domaines civils :
– un centre d’entraînement de l’armée a été ouvert à Resolute en août 2013. Des exercices militaires sont organisés annuellement en Arctique. La compagnie de Yellowknife, première unité réserviste de l’armée régulière basée au nord du 60ème parallèle (mais au sud du cercle polaire), a été créée en 2009 ;
– pour ce qui est de la recherche, il est notamment prévu de construire à Cambridge Bay une station de recherche sur « l’extrême-Arctique » (142 millions de dollars canadiens y seraient consacrés sur 2012-2017) ;
– dans le domaine du transport maritime, le Canada a révisé à la baisse ses prétentions d’établir un port arctique en eau profonde à Nanisivik, jugé trop coûteux. De fait, il est prévu la construction, d’ici 2016, d’une station de ravitaillement en carburant pour les navires qui serait utilisable seulement en été ;
– une Agence canadienne de développement économique du nord a été instituée en 2009.
Les réalisations restent en fait modestes, notamment dans le domaine militaire, les moyens ne suivant pas toujours les annonces. De fait, plusieurs projets de renouvellement de matériels faibles et vieillissants ont été retardés. L’espace aérien arctique n’est véritablement couvert que par quatre Twin Otters, des petits avions de transport à hélices basés à Yellowknife, au sud du cercle polaire, et remontant à 1971. De même, la présence militaire canadienne se limite encore à quelques dizaines de réservistes basés dans la même ville et à des rangers sans entraînement militaire. En guise de comparaison, de l’autre côté de la frontière, les États-Unis maintiennent plus de 20 000 soldats, 65 avions de chasse et un site anti-missiles balistiques en Alaska… La flotte canadienne de brise-glaces reste également faible en comparaison de son homologue russe.
Il faut toutefois relever un investissement réel en matière de recherche : d’après les données collectées pour la préparation de notre « Feuille de route arctique » nationale, le Canada arrive en deuxième position mondiale pour le nombre de publications scientifiques sur l’Arctique (avec près de 6 000 publications sur un total de 30 000 recensées dans le monde sur la période 2007-2012) (41). Et, s’agissant du thème de ces publications, il est significatif que les chercheurs canadiens viennent au premier rang mondial quant aux écrits portant sur la « gouvernance et la géopolitique », avec le tiers des publications mondiales sur ce thème, ce qui n’est sans doute pas sans rapport avec la priorité politique accordée à l’Arctique.
c. Des revendications de souveraineté ambitieuses
Dans ce contexte général d’affirmation de sa souveraineté, le Canada gère plusieurs petits litiges territoriaux avec ses voisins et surtout présente des revendications élevées.
Comme on l’a vu, le pays a des différends avec :
– les États-Unis sur la délimitation des eaux en mer de Beaufort ;
– le Danemark sur l’île Hans et des secteurs de la mer de Lincoln ;
– la communauté internationale et en particulier les États-Unis sur le statut des eaux du passage du Nord-Ouest, que le Canada voudrait contrôler intégralement en les qualifiant d’« eaux intérieures » et non de détroit international.
Ces litiges font certes l’objet de négociations et d’arrangements partiels, mais l’attachement du Canada à sa souveraineté semble rendre difficile leur règlement définitif.
Par ailleurs, le Canada a annoncé en décembre 2013 le dépôt prochain devant la commission ad hoc de l’ONU d’une demande de délimitation de son plateau continental arctique qui pourrait représenter environ 1,7 million de km², mais devrait être incompatible avec les demandes russes et danoises.
d. Une position défavorable à toute ingérence des États tiers dans la gestion des problèmes de l’Arctique
Le Canada a été à l’initiative de la création du Conseil arctique et a donc dans le passé œuvré pour l’élaboration d’une forme de gouvernance internationale de l’Arctique, sous réserve qu’elle ne soit pas contraignante et soit l’exclusivité des États arctiques ou du moins reconnaisse leur rôle prééminent. Il est hostile à tout ce qui pourrait permettre une ingérence des États tiers dans la gouvernance de l’Arctique. Dans le cadre du Conseil arctique, il se montre souvent méfiant vis-à-vis des États observateurs et partisan de la restriction de leurs prérogatives : ces observateurs ne sont légitimes que tant qu’ils contribuent positivement aux travaux du Conseil.
Du fait du conflit qui opposait le Canada et la Norvège à l’Union européenne sur la commercialisation des produits issus du phoque, le Canada a aussi été l’un des principaux opposants à l’accession de l’Union à ce statut d’observatrice. Cependant, lors du sommet Union-Canada du 26 septembre 2014, M. Harper a indiqué que son gouvernement avait décidé de lever son objection : après que l’Organisation mondiale du commerce a validé le principe de l’embargo décidé par l’Union sur ces produits, un arrangement euro-canadien a apparemment été trouvé sur la question (voir infra le développement sur la position de l’Union européenne pour plus de détails).
Parallèlement, le Canada reste fondamentalement réticent à une implication de l’OTAN dans la problématique sécuritaire de l’Arctique, contrairement à des pays comme la Norvège ou l’Islande.
Les États-Unis sont un État arctique en raison de leur possession de l’Alaska. Ils sont membres du Conseil arctique, qu’ils président en 2015. Cependant, l’Arctique ne paraît pas constituer pour eux une véritable priorité politique ou économique, ce qui les amène à adopter une posture plutôt coopérative et favorable à l’environnement.
a. Des intérêts significatifs en Arctique
Au XXème siècle, l’intérêt des États-Unis pour l’Arctique a d’abord été stratégique. On l’a vu, la menace japonaise a conduit les États-Unis à renforcer leur présence en Alaska durant la Seconde guerre mondiale et à construire la « route de l’Alaska » à travers le nord-ouest canadien. Durant la Guerre froide, l’Arctique a accueilli des équipements de défense très importants, notamment en matière d’écoute. Quant à l’océan Arctique, il était devenu l’un des lieux de patrouille préférés des sous-marins nucléaires des deux superpuissances. Cet enjeu sécuritaire reste présent, du fait notamment de la prolifération nucléaire de pays tels que la Corée du Nord et récemment encore les États-Unis ont déployé des missiles anti-missile supplémentaires sur leur base de Fort Greely en Alaska.
C’est également dans le cadre d’une conception générale de leur sécurité que les États-Unis sont attachés à la liberté de navigation dans l’Arctique. S’agissant du statut des passages du Nord-est et du Nord-ouest, ils soutiennent, à l’encontre respectivement de la Russie et du Canada, le principe de l’application des règles applicables aux détroits internationaux, qui comprennent la pleine liberté de navigation. Cette position est cohérente avec le souci général des États-Unis, superpuissance maritime, de consolider la liberté de navigation, étant rappelé que certains détroits internationaux présentent un caractère autrement plus stratégique et sont bordés d’États « sensibles », par exemple le détroit d’Ormuz…
Comme pour les autres pays arctiques, les hydrocarbures constituent un autre intérêt majeur des États-Unis. L’Alaska est depuis longtemps une grande zone de production pétrolière (un cinquième de la production américaine en 2012) et la fameuse étude de l’US Geological Survey de 2008 attribuait à l’Alaska un tiers des ressources pétrolières non encore découvertes localisées dans la zone arctique, ainsi qu’un huitième des ressources gazières.
L’Alaska dispose aussi de ressources en minerais, exploitées en particulier à la mine de Red Dog, qui fournit le dixième du zinc mondial.
b. Mais aussi une politique active de préservation de l’environnement
Cela dit, la pression pour l’exploitation plus massive des ressources minérales est contenue par plusieurs facteurs : les incertitudes sur leur réalité ; les coûts d’exploitation dans un milieu difficile et les risques écologiques ; la mobilisation des organisations écologistes et des populations autochtones ; enfin et surtout, la nouvelle – et provisoire – abondance énergétique dont bénéficient les États-Unis en exploitant massivement les hydrocarbures non conventionnels (« de schiste »).
En 2012, l’administration a autorisé de nouveaux forages au nord de l’Alaska, en mer de Beaufort et en mer des Tchouktches. De nombreux projets sont cependant au point mort. Après une série d’incidents en 2012 l’amenant à suspendre ses forages d’exploration en mer de Beaufort, la compagnie Shell a finalement renoncé à forer en Alaska en 2014. En 2013, par ailleurs, l’administration a rejeté une demande du gouverneur d’Alaska de lancer une nouvelle campagne de cartographie des ressources dans l’Arctic National Wildlife Refuge, ou « zone 1002 », qui est depuis trente ans l’objet de combats politiques et juridiques sur la possibilité d’y exploiter le pétrole.
Tout récemment (décembre 2014-janvier 2015), plusieurs décisions ou déclarations du président Barack Obama font pencher la balance vers la protection stricte de l’environnement :
– l’interdiction des forages pétroliers et gaziers dans la baie de Bristol, au sud-ouest de l’Alaska, qui est l’une des grandes zones de pêche des États-Unis ;
– l’exclusion de même de ces forages sur environ 40 000 km2 des mers de Beaufort et des Tchouktches ;
– l’annonce d’une proposition qui sera faite au Congrès de classer une grande partie – plus de 48 000 km2 – de l’Arctic National Wildlife Refuge, dont la plaine côtière, en « zone sauvage » (Wilderness), ce qui exclurait définitivement toute construction et tout forage dans cette région depuis longtemps convoitée par les compagnies pétrolières.
c. Une présence militaire et scientifique traditionnellement forte
Les systèmes de défense anti-missile et d’alerte avancée en Arctique et plus généralement du continent nord-américain (NORAD) sont des éléments essentiels du système militaire des États-Unis. Ce dispositif s’appuie sur trois bases de l’US Air Force en Alaska (Fort Greely, rouverte en 2004 après avoir été fermée en 1995, et Fort Clear) et au Groenland (Thulé) et a été modernisé ces dernières années dans le cadre de la priorité générale donnée à la défense anti-missile. Au total, ce sont plus de 22 000 militaires et 65 avions de chasse qui sont déployés en Alaska. L’US Coast Guard est également très présente avec 5 000 personnels.
Les États-Unis jouent de même un rôle de premier plan dans les recherches concernant l’Arctique, à travers de nombreux organismes : la National Science Fundation, l’US Arctic Research Commission, l’US Geological Survey, l’Interagency Arctic research Policy Committee, la National Oceanic and Atmospheric Administration, le National Snow and Ice Data Center… D’après les données précitées collectées pour la préparation de notre « Feuille de route arctique » nationale, ils arrivent de loin en tête pour le nombre de publications scientifiques sur l’Arctique, comme il est vrai sans doute dans la plupart des domaines de recherche, avec près de 11 000 publications sur l’Arctique sur un total de 30 000 recensées dans le monde sur la période 2007-2012.
d. Cependant, une priorisation limitée de l’Arctique
La « Stratégie des États-Unis en Arctique », publiée le 10 mai 2013 – et complétée par des documents connexes de l’US Coast Guard et du Pentagone et un plan d’action publié par l’exécutif le 30 janvier 2014 –, remplace une directive présidentielle de janvier 2009. Elle identifie trois axes prioritaires, tout en inscrivant en toile de fond la lutte contre le changement climatique :
– les intérêts américains en matière de sécurité, comprenant la libre circulation aérienne et maritime dans les zones internationales ;
– la gestion responsable de la région (protection de l’environnement, exploitation des ressources d’une façon compatible avec la préservation de l’environnement, instauration d’un cadre de gestion intégré pour l’Arctique) ;
– le renforcement de la coopération internationale.
La publication relativement tardive de ce document durant le déroulement de la présidence de M. Obama et l’absence de renforcement des moyens dévolus à l’Arctique font apparaître que ce dernier n’est pas une priorité majeure de la politique des États-Unis, ce qui les distingue de plusieurs autres des États arctiques. Un débat a lieu actuellement sur le renouvellement et l’augmentation de la flotte américaine de brise-glaces, qui est modeste et vétuste. L’Arctique n’est manifestement pas une priorité budgétaire.
La position des États-Unis dans le champ diplomatique arctique est également un peu affaiblie par leur refus de s’engager dans plusieurs instruments internationaux, en particulier le Protocole de Kyoto sur les enjeux climatiques et la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, qui est déterminante pour l’avenir de l’Arctique puisque c’est elle qui fonde les revendications de zones économiques exclusives et de plateau continental. N’ayant pas ratifié cette convention bien qu’ils lui reconnaissent une valeur coutumière, les États-Unis ne peuvent ni déposer de requête de délimitation de leur plateau continental, ni siéger au sein de la commission chargée d’examiner les demandes des autres États.
e. Une approche coopérative des problèmes de l’Arctique
Donnant une priorité limitée à l’Arctique et ne cherchant pas à en faire un enjeu essentiel de souveraineté, voire d’identité, les États-Unis y privilégient les actions de coopération tant au niveau multilatéral que bilatéral. Les discours des responsables américains soulignent leur approche collaborative et équilibrée, qui laisse une large place aux forums multilatéraux.
• Une conception assez ouverte de la gouvernance de l’Arctique, cependant centrée sur le Conseil arctique
Les États-Unis accordent une place prépondérante au Conseil arctique, dont ils assurent la présidence en 2015 après le Canada. Les priorités affichées par les États-Unis pour leur présidence montrent un souci de développement de la coopération régionale et de consensus, avec une orientation environnementale marquée : réalisation de simulations d’accident écologique pour échanger des bonnes pratiques, promotion d’un réseau des différentes aires marines protégées des États arctiques…
Des responsables américains ont publiquement critiqué la tentative de certains pays, Canada en tête, de privilégier un format de gouvernance plus réduit, limité aux cinq États côtiers de l’océan Arctique – les trois autres États arctiques étant exclus, de même que les organisations autochtones et a fortiori les États observateurs – , qui s’étaient réunis en 2008 à Illulissat.
Pour autant, les États-Unis refusent que les sujets ayant trait à la sécurité soient traités dans le cadre du Conseil arctique. Plus généralement, ils sont hostiles à l’établissement d’un instrument juridique sur le modèle du Traité sur l’Antarctique. L’ouverture américaine à une gouvernance internationale de l’Arctique n’est donc que partielle.
• La recherche d’arrangements sur les litiges bilatéraux
Sur le plan bilatéral, bien qu’ils connaissent des contentieux avec le Canada (statut du passage du Nord-Ouest et délimitation des zones économiques en mer de Beaufort) et avec la Russie (statut du passage du Nord-Est et frontière maritime en mer de Béring (42)), les États-Unis cherchent également à développer une approche constructive.
Avec le Canada, on l’a vu, un statu-quo a été trouvé en 1988 sur le passage du Nord-Ouest. La coopération se concrétise également s’agissant du recueil des données pour le dépôt de la demande canadienne sur le plateau continental, avec une campagne océanographique commune en mer de Beaufort en 2010. Par ailleurs, les deux pays continuent à coopérer sur le plan militaire, avec notamment l’organisation d’exercices conjoints.
La coopération avec la Russie en Arctique est également jugée comme importante par les États-Unis. La sécurité maritime dans le détroit de Béring figurait ainsi dans la lettre d’avril 2013 du président Barack Obama à l’attention du président Vladimir Poutine afin de tenter de relancer des relations bilatérales globalement compliquées.
a. Des enjeux économiques vitaux
Historiquement, la Russie a été le premier État à chercher à développer sa façade arctique : le port d’Arkhangelsk a été fondé dès 1584 pour pouvoir commercer directement avec l’Europe occidentale alors que la Russie ne disposait encore d’aucun autre accès à la mer (il lui a fallu attendre les victoires sur la Suède du début du XVIIIème siècle pour posséder un débouché sur la mer Baltique, celles sur la Turquie à la fin du même siècle pour contrôler la côte nord de la mer Noire).
Aujourd’hui encore, la Russie contrôle près de la moitié de l’arc arctique.
Les régions arctiques, où l’exploitation des ressources minérales a été développée à partir du début du XXème siècle, sont devenues essentielles pour l’économie de la Russie contemporaine. En effet, aucun autre État arctique n’est aussi dépendant de la production d’hydrocarbures (43) : les hydrocarbures représentent les deux tiers des exportations russes et assurent environ la moitié des revenus de l’État. Or, cette production présente une double caractéristique :
– elle a désormais une certaine difficulté à augmenter, après une forte croissance au début des années 2000, comme on peut le voir sur le graphique ci-après. Or, le maintien ou si possible la croissance de cette production sont vitales pour la Russie actuelle, dans le contexte présent d’effondrement des cours du pétrole, de crise économique dans le pays, de crise politique avec les pays occidentaux et de dépendance croissante, au fil des ans, du budget russe aux ressources provenant des hydrocarbures ;
Évolution de la production pétrolière et gazière de la Russie
(en millions de tonnes, millions de tonnes équivalent pétrole pour le gaz)
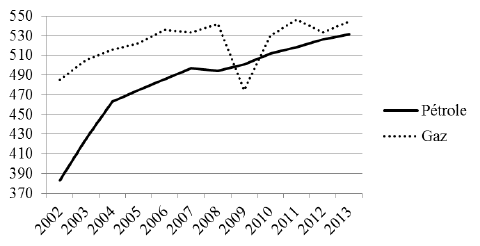
Source : graphique élaboré à partir de données extraite de la BP Statistical Review of World Energy de juin 2014.
– l’avenir de cette production d’hydrocarbures dépend de plus en plus des régions arctiques du pays. L’essentiel de la production pétrolière et plus encore gazière provient désormais de Sibérie occidentale (« Bakou III » et Tioumen), dans des régions proches du cercle polaire. Quant aux réserves inexploitées, elles sont pour l’essentiel off-shore et arctiques. L’étude de 2008 de l’US Geological Survey attribue à la Russie et aux eaux qu’elle contrôle les deux tiers environ des réserves de gaz non encore découvertes dans l’Arctique (principalement en Sibérie occidentale : Iamal et régions et eaux avoisinantes ; dans une moindre mesure en mer de Barents orientale) et un quart de ces réserves pétrolières.
Les autres ressources minérales de l’Arctique russe sont également importantes. Il faut citer en particulier le gisement de nickel, de palladium et d’autres métaux de Norilsk, à l’origine notamment de près de la moitié de la production mondiale de palladium, du cinquième de celle de nickel et du dixième de celle de cobalt.
Enfin, il faut rappeler que les autorités russes placent beaucoup d’espoirs dans le développement de la route maritime du Nord-Est, même si, comme on l’a vu, ses potentialités, du moins à court terme, ne doivent pas être surestimées : le trafic a certes fortement augmenté au début des années 2010, mais reste marginal dans le trafic maritime mondial, et les perspectives demeurent incertaines pour l’avenir.
Dans ce contexte, il n’y a rien d’étonnant à ce que la présence humaine, matérielle, scientifique, militaire, etc. de la Russie dans ses régions arctiques soit souvent beaucoup plus massive que celle de la plupart des autres États.
L’Arctique russe
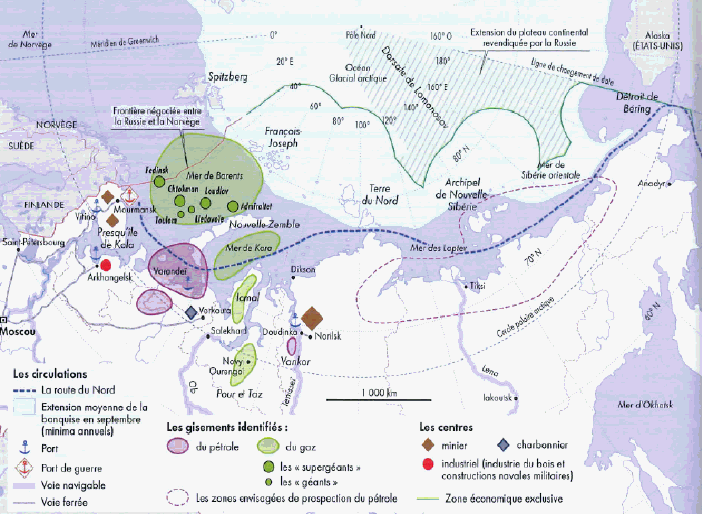
Source : Atlas géopolitique de la Russie, par Pascal Marchand, éditions Autrement.
– la Russie est aujourd’hui le seul pays à disposer de plusieurs grands centres urbains sur les bords de l’océan Arctique ou à proximité immédiate : Arkhangelsk et Mourmansk ont chacune plus de 300 000 habitants ; Norilsk et Severo-Dvinsk environ 200 000 ;
– la Russie possède presque la moitié de la flotte mondiale de grands brise-glaces, qu’ils soient civils ou militaires (36 sur 76, dont 7 nucléaires (44)) ;
– l’une des principales flottes militaires russes, celle du Nord, a son commandement à Severomorsk, près de Mourmansk, et s’appuie sur onze bases ;
– dans le domaine de la recherche, les scientifiques russes occupent le troisième rang mondial pour le nombre de publications sur la période 2007-2012 d’après les données précitées du Chantier arctique français, avec notamment une prédilection assez notable pour la thématique « géodynamique et ressources naturelles » (deuxième rang mondial pour les publications).
c. Une priorité affichée à l’Arctique
La crise économique et budgétaire connue par la Russie dans les années 1990, après la fin de l’URSS, avait entraîné un large retrait de la présence étatique – militaire et civile – dans l’Arctique russe.
La croissance économique des années 2000, fondée sur les hydrocarbures, et la politique de puissance voulue par le régime actuel ont conduit à un mouvement de réinvestissement de la région.
Le gouvernement russe a présenté en 2009 une stratégie arctique pour la période jusqu’à 2020 et au-delà, laquelle met l’accent sur l’importance économique de l’Arctique pour la Russie.
Après le dépôt, en 2007, d’un drapeau russe sur le fond océanique au pôle Nord, une seconde mission océanographique a été lancée en 2012 en vue de recueillir des données validant les revendications russes de plateau continental.
Dans le domaine civil, l’ouverture de dix nouveaux centres de secours dans l’Arctique a été annoncée en 2012 pour l’échéance 2015. Globalement, il a été proposé en 2012 un plan d’investissement de 44 milliards de dollars dans les infrastructures arctiques.
En matière militaire, l’Arctique est manifestement une priorité, même s’il faut sans doute faire la part des annonces et celle des réalisations. La Russie a repris en 2007 ses tests de missiles en Arctique et en 2008 ses patrouilles maritimes et aériennes. La création d’unités militaires spécialement équipées et entraînées pour la guerre en Arctique, voire d’une force interarmées dédiée à la zone, a été annoncée à plusieurs reprises depuis 2011. Des opérations à forte portée symbolique, comme la réouverture en 2014 d’un aéroport militaire dans l’île de Nouvelle-Zemble, au cœur de l’océan Arctique, ont été mise en avant. D’après des annonces de janvier 2015, le plan 2016-2020 de défense et de réarmement de la Russie privilégierait trois zones : la Crimée récemment annexée aux dépens de l’Ukraine, l’enclave de Kaliningrad (entre Pologne et Lituanie), dans une optique manifeste de confrontation avec les pays de l’OTAN, et l’Arctique. Dix aérodromes militaires supplémentaires seraient notamment construits dans cette zone.
d. Mais une politique entravée par plusieurs contradictions
Cependant, la position de la Russie sur les questions arctiques est marquée par un certain nombre de contradictions, voire d’ « incompatibilités », comme le relève un travail universitaire de 2012 (45).
• Entre souci affiché de l’environnement et priorité au développement des hydrocarbures
Le président Vladimir Poutine se présente volontiers comme un défenseur de l’environnement arctique.
Effectivement, il a en 2009 institué le parc national de l’Arctique russe dans les archipels de Nouvelle-Zemble et François-Joseph, qui s’ajoute à la réserve naturelle du Grand Arctique, créée en 1993 et couvrant plus de 40 000 km2 sur la côte nord de la Sibérie et dans les îles de la mer de Kara.
Les observateurs reconnaissent plus généralement qu’un effort réel de nettoyage a été engagé pour traiter les quantités phénoménales de déchets, souvent très dangereux, abandonnées durant la période soviétique.
Mais, dans le même temps, la priorité donnée au développement des hydrocarbures apparaît comme largement contradictoire avec cette priorité environnementale, contradiction qui a été vigoureusement et courageusement dénoncée par Greenpeace. Indépendamment des risques d’accident écologique, l’exploitation pétrolière est en effet conduite en Russie dans des conditions souvent inacceptables pour l’environnement ; selon Greenpeace, « l’industrie pétrolière russe déverse 30 millions de barils sur les terres chaque année — sept fois la quantité qui s’est échappée lors de la catastrophe de Deepwater Horizon — le tout souvent sous le voile du secret et de la corruption. Et tous les 18 mois, l’équivalent de quatre millions de barils se répand dans l’océan Arctique » (46) ; il ne s’agit même pas de marées noires suite à des accidents, mais de « fuites » de toutes sortes sur des équipements souvent vétustes et mal entretenus.
• Une puissance militaire qui ne fournit pas les avantages escomptés ?
La Russie conserve probablement en Arctique une réelle supériorité militaire et s’est de plus engagée dans un processus ambitieux de modernisation de ses forces, censé renforcer son influence. Par ailleurs, la forte densité d’unités navales et d’entreprises du secteur militaro-industriel dans les régions de Mourmansk et d’Arkhangelsk est supposée apporter une base de soutien solide au régime en place.
Mais, dans les faits, selon M. Pavel Baev, « la militarisation russe éveille la suspicion des pays arctiques voisins, qui appellent l’OTAN à accorder plus d’attention à son ancien "flanc Nord" ». De plus « les risques techniques liés aux programmes nucléaires ramènent la Russie de nombreuses années en arrière » : encore en 2011, un incendie n’a été que difficilement maîtrisé à bord d’un sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE).
Par ailleurs, la réforme militaire est difficile à mettre en œuvre et donc le régime n’est pas nécessairement populaire dans les régions arctiques, malgré la forte présence des militaires : on relève un « mécontentement dans les rangs des forces armées et en tout premier lieu parmi les officiers, tandis que les problèmes de financement du programme de construction navale entraînent des tensions sociales », d’autant que, dans le même temps, certains grands projets dans les hydrocarbures sont au point mort.
Bref, la politique de présence et de réarmement menée ne produit peut-être ni les effets extérieurs, ni les effets intérieurs escomptés.
• Entre volonté de coopération et rhétorique de puissance
La grande ambition de la Russie en Arctique est sans doute d’étendre une forme au moins symbolique de souveraineté jusqu’au pôle Nord, au titre de son plateau continental et en application du droit international de la mer, ce qui a entre autres motivé l’opération du drapeau au pôle Nord en 2007.
Mais réaliser effectivement cette ambition impliquerait de trouver un compromis avec les autres États arctiques, en particulier le Canada et le Danemark. La Russie joue donc plutôt le jeu de la coopération dans le cadre du Conseil arctique et des autres institutions arctiques, ainsi qu’au plan bilatéral. Les observateurs considèrent que, jusqu’à présent, la crise ukrainienne n’a pas remis en cause la coopération internationale avec la Russie sur les questions arctiques. Au plan bilatéral, le pays a en particulier manifesté son ouverture en signant en 2010 le traité de délimitation des eaux en mer de Barents avec la Norvège, qui est venu couronner plusieurs décennies de gestion plutôt collaborative de la zone. Mais il faut noter que cet arrangement a été vivement critiqué en Russie.
Dans un pays où l’appel aux sentiments patriotiques reste un outil politique très efficace et alors même que la Russie paraît aujourd’hui s’engager, avec la crise ukrainienne, dans la voie d’une politique de puissance nationaliste, la préservation d’une bonne coopération de la Russie avec ses voisins dans le champ arctique pourrait ne pas être évidente. D’autant que les revendications affichées quant au pôle Nord – que ce soit par la Russie ou par d’autres États arctiques – sont elles-mêmes très contradictoires quant au positionnement par rapport à l’idée de gouvernance internationale : d’un côté, elles apparaissent comme des revendications de souveraineté « de prestige » quelque peu anachroniques et antithétiques de l’idée de gouvernance internationale ; de l’autre, leur reconnaissance impose aux requérants de les formuler dans un cadre de droit international, celui du droit de la mer, en déposant un dossier devant une commission internationale ad hoc, tout cela pour n’obtenir en fait que des droits économiques, pas une véritable souveraineté.
En ce début d’année 2015, le contexte de la crise ukrainienne et des relations difficiles entre la Russie et les pays occidentaux fait craindre à beaucoup d’observateurs un relatif blocage de la coopération arctique, notamment dans le cadre du Conseil arctique, sur des questions aussi diverses que la préparation de la Conférence Paris-climat ou les demandes d’ouverture du Conseil à de nouveaux observateurs, notamment à l’Union européenne.
B. LES AUTRES ÉTATS ET ORGANISATIONS
L’affirmation d’une politique arctique de l’Union européenne en tant que telle est assez récente. C’est en 1999 qu’a été lancée, sous présidence finlandaise de l’Union, l’initiative de la « dimension nordique », destinée à développer des coopérations avec la Norvège, la Russie et l’Islande. Ensuite, à partir de 2002, l’Union a commencé à revendiquer sa dimension spécifiquement arctique, sous l’impulsion de la présidence danoise de l’Union, en introduisant le concept de « fenêtre arctique » dans la « dimension nordique ».
L’idée d’une politique européenne sur l’Arctique a fait son apparition dans le contexte du développement d’une politique maritime intégrée, qui fut une priorité de la Commission pendant la première présidence de José Manuel Barroso. Le Livre vert sur une politique maritime (2006) souligne que « l’Arctique pourrait devenir une priorité majeure » de la politique maritime communautaire. La politique arctique de l’Union s’inscrit donc dans sa politique maritime.
a. Une légitimité incontestable à avoir une politique arctique
L’Union a plusieurs motifs évidents de revendiquer un rôle dans la gouvernance de l’Arctique et d’y assumer des responsabilités :
– trois des huit États arctiques sont membre de l’Union (Danemark, Finlande et Suède) et deux autres de l’Espace économique européen, où s’appliquent de nombreuses politiques européennes (Islande et Norvège). De fait, les réglementations et les politiques européennes s’appliquent donc dans une grande partie de l’Arctique ;
– les choix collectifs européens ont aussi un impact massif en Arctique, que l’on pense à la politique énergétique commune, l’Union étant l’un des grands émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre et ayant donc sa part de responsabilité dans le changement climatique, ou encore à la politique de la pêche, les eaux des confins des océans Atlantique et Arctique fournissant le tiers du poisson consommé en Europe.
Pour le moment, l’implication de l’Union dans l’Arctique est surtout financière : elle est considérée comme le premier bailleur de fonds dans la zone, ce qui contribuerait à justifier un rôle actif dans sa gouvernance. La contribution de l’Union à la recherche arctique est évaluée à 200 millions d’euros sur les dix dernières années. Par ailleurs, les crédits (fonds structurels) consacrés sur la période budgétaire 2007-2013 aux régions arctiques de l’Union et régions voisines se sont élevés à 1,14 milliard d’euros, auxquels on peut ajouter une centaine de millions d’euros au titre de la politique de la « dimension nordique » depuis sa création.
Le politologue Damien Degeorges résume bien cet ensemble d’éléments : « l’Union européenne, ensemble considéré par certains comme étant un acteur extérieur à la région, est géographiquement arctique (…). Premier bailleur de fonds de la recherche polaire dans l’Arctique, l’Union européenne est également en charge, de par le transfert de compétences des États membres, de domaines en lien direct avec l’Arctique. En outre, l’Union européenne légifère sur des sujets qui affectent directement d’autres États arctiques, l’Islande et la Norvège, membres de l’Espace économique européen (EEE) » (47).
Le même auteur regrette pourtant « un manque de confiance et d’affirmation sur ce sujet [qui] est régulièrement perceptible dans les interventions de représentants d’institutions européennes ».
b. Mais des prises de position qui ont handicapé l’insertion de l’Union dans la gouvernance arctique
Il est vrai qu’une institution européenne, le Parlement européen, a fait preuve de beaucoup plus d’audace à une occasion, à l’initiative notamment de M. Michel Rocard : dans sa résolution du 9 octobre 2008 sur la gouvernance arctique, il allait jusqu’à suggérer que la Commission européenne œuvre « en faveur de l’ouverture de négociations internationales visant à parvenir à l’adoption d’un traité international pour la protection de l’Arctique, s’inspirant du traité sur l’Antarctique, complété par le protocole de Madrid en 1991 », donc que l’Union européenne promeuve un statut international de l’Arctique inspiré de celui de l’Antarctique, le plus protecteur possible de l’environnement. Tout au plus le Parlement européen concédait-il qu’il fallait respecter « la différence fondamentale résidant dans le fait que l’Arctique est peuplé et dans les droits et les besoins des populations et des nations de la région arctique qui en découlent ». Il estimait en conséquence que l’on pourrait, « dans un tout premier temps, couvrir au moins les zones non peuplées et non revendiquées du centre de l’océan Arctique ».
Mais les réactions soulevées par ce texte dans les pays arctiques, malgré les concessions et restrictions qu’il comportait, ont rapidement découragé cette démarche, empoisonnant les relations de l’Union avec ces pays et la ramenant ensuite à plus de modestie.
Un second litige a nui aux relations entre l’Union et certains États arctiques : comme l’Union, invoquant le caractère inhumain et cruel des méthodes d’abattage, avait interdit à partir de 2010 la commercialisation des produits dérivés du phoque (avec des exceptions notamment pour les produits venant de communautés autochtones et des captures opérées au nom de la gestion des ressources marines), le Canada et la Norvège ont porté le conflit devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En novembre 2013 puis, à nouveau, en mai 2014 en appel, l’organe de règlement des différends de celle-ci a globalement débouté les requêtes canadienne et norvégienne, en reconnaissant explicitement que des restrictions commerciales pouvaient être justifiées par « l’objectif consistant à répondre aux préoccupations morales du public de l’UE concernant le bien-être des phoques ».
Il est à noter que ces mesures d’embargo prises par l’Union européenne et d’autres pays, dont les États-Unis et la Russie, ont atteint leur objectif : au Canada, on serait passé de plus de 350 000 phoques tués par an au milieu des années 2000 à 40 000 en 2011. Mais ce conflit a naturellement rendu plus difficile l’affirmation de l’Union dans la gouvernance arctique : il a notamment motivé la longue résistance du Canada à lui reconnaître le statut d’observatrice au Conseil arctique.
Dans le cadre des négociations pour un accord commercial et économique global entre l’Union européenne et le Canada, qui se sont conclues favorablement en septembre 2014, un compromis semble avoir été trouvé pour garantir aux communautés autochtones canadiennes le droit de commercialiser les produits de leur chasse sur le marché européen : dans une déclaration commune, les deux parties se sont engagées à travailler de concert pour élaborer un système permettant l’entrée effective des produits issu du phoque dans l’Union, sous réserve de moyens de contrôle de leur origine autochtone. Début février 2015, la Commission européenne a engagé le processus interne de révision des textes européens relatifs aux produits issus du phoque. L’ambassadeur du Canada en France, M. Lawrence Cannon, a indiqué devant votre mission que son gouvernement restait dans une position d’attente : l’Union doit démontrer sa capacité à prendre en compte les enjeux des chasses traditionnelles pour les populations de l’Arctique.
De toute façon, il est loin d’être certain que la levée de l’opposition canadienne conduise enfin à l’attribution prochaine du statut d’observatrice au Conseil arctique à l’Union : celle-ci risque fort de se heurter à un veto russe motivé par des considérations ayant beaucoup plus à voir avec l’Ukraine qu’avec l’Arctique…
De manière plus générale, au-delà des difficultés suscitées par les prises de position courageuses de l’Union pour un statut international de l’Arctique et contre l’abattage des phoques, les observateurs notent une certaine incapacité, dans les années 2000, à formuler une politique européenne de l’Arctique alors que, dans le même temps, des politiques étaient conceptualisées pour d’autres périphéries européennes : la politique euro-méditerranéenne, le Partenariat oriental…
c. Aujourd’hui, une volonté de rattraper le temps perdu
Il y a manifestement aujourd’hui une volonté de changer cet état de fait dans les instances européennes.
Dès le 8 décembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté des conclusions sur les questions arctiques qui visaient notamment à prendre une très grande distance par rapport à la résolution parlementaire précitée du 9 octobre 2008. Le 20 janvier 2011, le Parlement européen adoptait à son tour une résolution sur une politique européenne durable dans le grand nord, dans laquelle il prenait « acte des institutions et du vaste encadrement d’accords internationaux et de droit international régissant des domaines d'importance pour l’Arctique » et reconnaissait « que le Conseil de l’Arctique joue un rôle important en tant que principal forum de coopération régionale pour l’ensemble de la région arctique ». Le changement d’optique par rapport à la résolution de 2008 appelant à un statut international de l’Arctique est clair.
La Commission européenne et la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont présenté le 26 juin 2012 une communication conjointe sur la politique arctique de l’Union. Ce document, au contenu assez prévisible, insiste sur le changement climatique, mais aussi les perspectives économiques qui en découlent en Arctique. Il plaide pour une approche prudente et durable du développement de nouvelles activités en Arctique. C’est pourquoi, indique-t-il, l’action de l’Union européenne dans la zone, qui passe principalement par l’attribution de fonds, privilégie la recherche et le développement de technologies respectueuses de l’environnement dans les transports maritimes et l’exploitation minière.
Le 12 mars 2014, le Parlement européen a adopté à son tour une résolution sur la stratégie de l’Union pour l’Arctique. Ce document étoffé comprend un certain nombre des « passages obligés » habituels : appel à une politique arctique unie de l’Union, accent mis sur les opportunités économiques, conciliation nécessaire entre l’exploitation des ressources naturelles et le respect des populations locales et de l’environnement… Mais il comporte également des considérants plus précis et/ou plus opérationnels, qui peuvent servir de fondement à une politique arctique ayant sa spécificité :
– la résolution prend acte du fait que « seuls 20 % des réserves mondiales de combustibles fossiles peuvent être exploitées d’ici à 2050 afin de maintenir l’augmentation de la température moyenne en dessous de deux degrés Celsius » et considère que « la transformation de l’Arctique représente l’un des effets majeurs du changement climatique sur la sécurité de l’Union européenne » ;
– elle « souligne la nécessité de systèmes fiables de suivi et d’observation pour enregistrer l’évolution de l’Arctique » (monitoring), demande donc la création rapide d’un « centre européen d’information sur l’Arctique » et la présentation de « propositions sur la manière de développer le projet Galileo, ou des projets [comparables], de façon à rendre plus sûre et plus rapide la navigation dans les eaux de l’Arctique, en investissant notamment dans la sécurité et l’accessibilité du passage du Nord-Est », ainsi que la cartographie des fonds marins ;
– elle soutient la démarche d’identification d’aires marines à protéger ;
– elle met enfin l’accent sur les questions de sécurité et de sauvetage et les risques d’accidents écologiques, en demandant notamment à ce que la capacité financière des exploitants d’hydrocarbures à assumer les dommages d’éventuels accidents soit dûment vérifiée.
Enfin, le 12 mai 2014, le Conseil européen a rendu publiques des conclusions sur le développement d’une politique arctique de l’Union. L’apport le plus significatif de ce document est la reconnaissance formelle du Conseil arctique comme la principale institution pour la coopération régionale circumpolaire, l’Union confirmant ainsi très explicitement sa rupture avec l’approche de la résolution parlementaire de 2008. Par ailleurs, ces conclusions demandent à la Commission et à la Haute représentante de proposer d’ici décembre 2015 une politique arctique intégrée et cohérente. À cette fin, une consultation publique a été menée sur les financements européens en Arctique.
2. Les principaux partenaires européens
Comme les pays scandinaves, plusieurs de nos grands partenaires européens, tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, ont publié des « stratégies arctiques ». Ces documents abordent généralement les mêmes problématiques :
– le thème de la protection de l’environnement, auquel la priorité est généralement donnée, mais qui est toujours équilibré par un appel au développement économique responsable ;
– les questions de régulation (faut-il de nouvelles règles, par exemple le Code polaire ?) ;
– les enjeux de sécurité et de protection de l’environnement liés à la circulation maritime et à l’exploitation des hydrocarbures ;
– les questions de gouvernance.
Le Royaume-Uni, qui aime à se présenter comme le pays non-arctique le plus proche de l’Arctique, a une longue tradition dans l’exploration et la recherche polaires. Durant plusieurs siècles, les marins et explorateurs britanniques, comme Frobisher, Hudson, Cook, Ernest Shackleton ou Robert Scott ont souvent été les premiers à explorer les rivages de l’océan Arctique, puis les mers australes et enfin le continent Antarctique.
Le Royaume-Uni partage avec la France la spécificité d’avoir une forte présence en Antarctique, avec des possessions insulaires dans l’océan Austral et des revendications de souveraineté sur une large part du continent.
Un bureau arctique existe depuis 2009 dans le cadre du Natural Environment Research Council (NERC), qui attribue les dotations de recherche ; plus de 50 millions de livres ont été allouées à la recherche en Arctique en 2012. Un Arctic Research Programme a de plus été lancé en 2010, centré sur les questions de changement climatique. Il existe également depuis 1991 une station britannique à Ny-Ålesund. La recherche britannique en Arctique dispose aussi de moyens logistiques (navires et avions) mis à disposition par le British Antarctic Survey. Enfin, dans le domaine des sciences humaines, le Scott Polar Research Institute (rattaché à l’université de Cambridge) joue un rôle important.
Le Royaume-Uni apparaît comme le pays ouest-européen dont les chercheurs publient le plus d’articles sur l’Arctique, du moins sur la période 2007-2012 selon les statistiques précitées de notre Chantier arctique : avec plus de 3 300 publications (4ème rang mondial), il devance de peu la Norvège et de plus loin l’Allemagne.
Le gouvernement britannique a publié en octobre 2013 un document de politique étrangère consacré à l’Arctique, intitulé « Adapting to Change – UK policy towards the Arctic ». L’objectif principal de cette publication est d’affirmer que le Royaume-Uni a en Arctique des intérêts légitimes, d’une part en tant qu’État non-arctique le plus proche géographiquement, d’autre part en tant qu’acteur global. Il s’agit donc avant tout de dresser le tableau des intérêts et des actions britanniques en Arctique, mais sans irriter les États arctiques. Le document est donc consensuel :
– il met en avant l’équilibre à trouver entre trois dimensions : humaine (comprenant la défense) ; environnementale ; commerciale. Il ne s’agit donc pas de proscrire les activités économiques dans l’Arctique, mais de plaider qu’elles sont conciliables avec la protection de l’environnement ;
– le Royaume-Uni ne revendique de rôle actif que dans les domaines les plus « coopératifs », ceux de la recherche et de la protection de l’environnement.
L’Allemagne a une solide tradition d’exploration et de recherche dans l’Arctique. Dans le baromètre des publications scientifiques sur 2007-2012 établi par le Chantier arctique, elle apparaît comme la 6ème nation, avec près de 2 400 textes recensés (contre 1 400 pour la France, 9ème).
La recherche polaire allemande s’appuie en particulier sur l’Institut Alfred Wegener (AWI), qui emploie environ 900 personnes et a un budget de plus de 100 million d’euros. L’Allemagne possède un navire de recherche polaire très bien équipé, le Polarstern, qui fait campagne alternativement en Arctique et en Antarctique, et dispose de cinq stations de recherche polaire : trois en Antarctique et deux en Arctique, la station AWIPEV de Ny-Ålesund au Svalbard, partagée avec la France, et celle de Samoylov dans le nord-est de la Sibérie, partagée avec la Russie.
Le gouvernement allemand a publié en 2013 des « lignes directrices » de sa politique arctique, dans lesquelles on retrouve l’équilibre classique entre les opportunités économiques et la nécessité de protéger l’environnement. Ce texte prend parti pour la création d’aires protégées. D’un point de vue plus politique, il met en avant :
– la liberté de la navigation et de la recherche en Arctique ;
– le cadre juridique formé notamment par les différents textes internationaux qui forment le droit de la mer, que l’Allemagne semble donc considérer comme satisfaisant. Il est à noter que le traité de Paris sur le Svalbard est nommément mentionné ;
– le rôle du Conseil arctique, présenté comme le seul forum régional pan-arctique et organe de décision intergouvernemental de haut niveau. L’Allemagne souhaite donc renforcer son statut d’observatrice ;
– le souhait d’une politique arctique européenne.
La politique arctique des grands pays asiatiques est marquée par plusieurs grandes caractéristiques :
– une volonté générale de présence en Arctique comme partout ailleurs (géographiquement et sectoriellement), qui va avec le sentiment nouveau de puissance ;
– une approche plutôt coopérative et surtout très opportuniste ;
– un intérêt particulier, d’une part pour les nouvelles routes maritimes entre l’Asie orientale et l’Atlantique-Nord que le recul des glaces va ouvrir et pourrait rendre, même si cela reste plus incertain, économiquement viables, d’autre part pour les ressources minérales.
La dimension scientifique est également présente : le Japon et la Chine occupent respectivement les 10ème et 11ème places, juste derrière la France, pour le nombre de publications scientifiques sur l’Arctique pour la période 2007-2012.
La volonté chinoise de présence en Arctique se manifeste notamment par l’ouverture en 2004, on l’a vu, d’une station de recherche dans le village scientifique de Ny-Ålesund au Svalbard et par l’obtention du statut d’observateur au Conseil arctique.
L’opportunisme apparaît clairement dans la manière dont la diplomatie chinoise sait tirer parti de la volonté de reconnaissance internationale du Groenland nouvellement autonome et des difficultés de l’Islande confrontée à la crise financière :
– en 2012, lors d’une visite du premier ministre chinois à Reykjavik, six accords de coopération ont été signés entre la Chine et l’Islande, dont un accord-cadre sur l’Arctique. En 2013, c’est la visite de la première ministre islandaise à Pékin qui a été l’occasion de la signature d’un accord de libre-échange ;
– en 2012 aussi, le président chinois s’est rendu au Danemark où plusieurs accords ont également été signés.
Les préoccupations économiques sont naturellement très présentes. En Arctique comme dans le reste du monde, la Chine est à la recherche de matières premières et de combustibles ; les cibles privilégiées sont le Groenland autonome, désormais maître de ses ressources, l’Islande, après sa crise bancaire, et la Russie, en froid avec le monde occidental.
Plusieurs grandes entreprises pétrolières chinoises, telles que China National Offshore Oil Corporation et China National Petroleum Corporation, ont annoncé en 2013 la signature de partenariats avec des entreprises locales pour l’exploration de champs pétroliers près de l’Islande et dans la partie russe de la mer de Barents. Plus généralement, la Chine est en train de développer massivement ses approvisionnements en hydrocarbures de Russie (lesquels viennent désormais principalement des zones proches de l’Arctique) : fin 2012, le deuxième tronçon de l’oléoduc Sibérie-Pacifique, avec une capacité de transport de 30 millions de tonnes par an, a été mis en service ; un contrat signé au printemps 2013 prévoit la livraison annuelle à la Chine d’environ 15 millions de tonnes de pétrole russe (en plus des livraisons déjà existantes) pendant 25 ans, pour un montant total estimé à 270 milliards de dollars, par la société Rosneft ; China National Petroleum Corporation a acquis 20 % de la future usine de liquéfaction de gaz de Iamal de l’entreprise Novatek…
Au Groenland, les capitaux chinois se sont investis dans la future mine de fer d’Isua et dans le développement des infrastructures à Nuuk.
Les autres grands pays asiatiques ont une politique très comparable à celle de la Chine, ce qui s’explique aisément dans un contexte de compétition entre puissances montantes, cette situation impliquant une présence partout où les concurrents vont.
On constate donc que, comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud se sont dotés de stations de recherche à Ny-Ålesund et sont devenus observateurs au Conseil arctique.
Ce dernier accueille encore un autre observateur asiatique, Singapour. Cet État de taille modeste mais très riche doit historiquement sa prospérité à sa situation de port de transit entre l’Asie orientale et l’océan Indien, donc l’Asie du sud, le Moyen-Orient pétrolier, l’Europe et l’Afrique. Il est naturel que la perspective du développement éventuel de nouvelles routes maritimes arctiques qui ne passeraient plus par Singapour y soit suivie de près… De plus, l’industrie navale de Singapour est extrêmement puissante en matière de construction de plateformes pétrolières off-shore, de sorte que le développement de nouveaux marchés potentiels dans l’océan Arctique ne peut être négligé.
La politique de présence des pays asiatiques passe par les institutions mais aussi, comme pour la Chine, la pénétration économique en recherchant les points faibles possibles. La Corée du Sud joue aussi la carte du Groenland, comme on a pu le voir en 2012 avec la visite du président sud-coréen Lee Myung-bak, venu sans même faire escale au Danemark.
QUATRIÈME PARTIE : LA PRÉSENCE FORTE DE LA FRANCE PRÈS DES DEUX PÔLES JUSTIFIE UN ENGAGEMENT PARTICULIER DE NOTRE PAYS POUR PROTÉGER L’ARCTIQUE
La France partage avec le Royaume-Uni et la Norvège une spécificité : ce sont les trois États de l’hémisphère nord qui sont possessionnés sur le continent Antarctique, ainsi que dans les îles de l’océan Austral qui l’entoure. Même si maintenant la plupart des grands États qui en ont les moyens et ont une tradition de recherche polaire – outre les trois susmentionnés, les États-Unis, la Russie, l’Allemagne, l’Italie, désormais la Chine, etc. – sont présents près des deux pôles, cette spécificité est indéniablement un atout.
I. UNE INFLUENCE FONDÉE SUR DES POSITIONS FORTES
A. UNE TRADITION ANCIENNE DANS L’EXPLORATION ET LA RECHERCHE POLAIRES
Depuis Jules Dumont d’Urville, découvreur de la terre Adélie en 1840, la France a constamment pris sa part de l’exploration des régions polaires. Quelques noms célèbres symbolisent cette contribution :
– Jean-Baptiste Charcot, dont les expéditions successives en Antarctique entre 1903 et 1910, puis dans l’Arctique, ont permis de relever plusieurs milliers de kilomètres de côtes et de réaliser de nombreuses observations scientifiques avant son décès en mer à bord de son navire le Pourquoi pas ? en 1936 ;
– Paul-Émile Victor, compagnon du commandant Charcot, qui traversa en 1936 le Groenland en traîneau à chien et séjourna quatorze mois dans une famille d’Inuits, avant de créer les Expéditions polaires françaises, qu’il dirigea de 1947 à 1976 ;
– Jean Malaurie, qui a notamment dirigé en 1950 la première mission géographique et ethnographique française dans le nord du Groenland et dont le célèbre ouvrage Les derniers rois de Thulé incarne dans la tradition scientifique française une certaine manière de faire se rencontrer regard scientifique, qualités littéraires et engagement.
Plus récemment, des personnalités comme Jean-Louis Étienne, premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986, ou Isabelle Autissier s’inscrivent dans la continuité de cette grande tradition d’exploration humaine et scientifique.
B. UN POSITIONNEMENT EXCEPTIONNEL DANS L’ANTARCTIQUE ET LE SUBANTARCTIQUE
1. Les Terres australes et antarctiques françaises, un atout exceptionnel
Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), qui forment depuis la loi du 6 août 1955 l’une des collectivités territoriales de l’outre-mer français, réunissent un ensemble de territoires très éloignés les uns des autres, qui ont surtout en commun leur isolement, l’absence de population permanente (autre que de chercheurs ou de militaires), mais aussi des enjeux écologiques et économiques majeurs.
Cet ensemble a été constitué à partir de territoires acquis au fur et à mesure de la constitution de l’empire colonial français, parfois mais pas toujours par droit de première découverte.
Les Terres australes et antarctiques françaises

Source : administration des TAAF.
a. Les districts des Terres australes et antarctiques françaises
Les TAAF sont formées de cinq districts :
– la terre Adélie ;
– l’archipel des Kerguelen ;
– l’archipel de Crozet ;
– les îles Saint-Paul et Amsterdam ;
– les îles Éparses (rattachées aux TAAF depuis la loi du 21 février 2007). Ces dernières rassemblent les îles de l’archipel des Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, situées dans le canal du Mozambique, et Tromelin, située au nord de La Réunion.
• La terre Adélie
La côte de la terre Adélie a été touchée pour la première fois en 1840 par Jules Dumont d’Urville, qui en a pris possession pour la France, puis a été l’objet d’actes d’administration en 1924 et 1938. Comme la plupart des autres États possessionnés en Antarctique, la France a alors affirmé sa souveraineté sur un secteur du continent en forme de « part de fromage » et allant jusqu’au pôle Sud. Comme on l’a développé supra dans la partie du présent rapport consacrée à l’Antarctique, les revendications territoriales y ont été gelées par le Traité sur l’Antarctique de 1959.
Ce territoire est délimité par les 136ème et le 142ème méridiens de longitude est ; il couvre environ 432 000 km2, soit l’équivalent des quatre cinquièmes de la superficie de la France métropolitaine, avec environ 350 kilomètres de côtes. Mais évidemment c’est un désert de glace…
• Les îles Kerguelen
Les îles Kerguelen ont été découvertes en 1772 par le navigateur français Yves Joseph Kerguelen de Trémarec. La France y a officiellement planté son pavillon en 1893.
L’archipel est très isolé dans le sud de l’océan Indien, à 1 400 kilomètres des autres îles françaises que sont Saint-Paul, Amsterdam et Crozet, à 2 000 kilomètres des côtes de l’Antarctique, 3 400 kilomètres de celles de La Réunion, 4 800 kilomètres de l’Australie…
D’une superficie de 7 215 km2, il est constitué d’une île principale, la Grande terre, montagneuse (point culminant à 1 850 mètres) et entourée de plus de 300 îles et îlots. Même si sa latitude, 49°, correspond à celle de Paris dans l’hémisphère nord, sa proximité de la zone de convergence antarctique lui vaut un climat qui est plutôt celui de l’Islande. Le vent d’ouest souffle quasi continuellement à une moyenne de 35 km/h ; les précipitations sont fréquentes et, dans les zones exposées, abondantes. Le sol est couvert d’une sorte de toundra et la partie montagneuse abrite une belle calotte glaciaire.
• Les îles Crozet
Les cinq îles Crozet ont été découvertes par l’explorateur français Marc-Joseph Marion-Dufresne qui fit débarquer son second Julien Crozet sur l’île de la Possession en 1772.
Elles sont volcaniques et montagneuses et totalisent 340 km2. Leur climat est comparable à celui des îles Kerguelen.
• Les îles Saint-Paul et Amsterdam
Distantes de 85 kilomètres l’une de l’autre, Saint-Paul et Amsterdam sont deux îles montagneuses de petite taille (respectivement 8 km2 et 58 km2). Situées à une latitude un peu plus basse que les Kerguelen et les Crozet, vers 37°-38° de latitude sud, elles bénéficient donc d’un climat plus doux mais toujours très océanique, avec des vents d’ouest constants, des hivers sans gelées mais des étés très frais. La France en a pris possession en 1892.
• Les îles Éparses
Les îles Éparses sont un ensemble de petites îles, voire d’îlots (l’addition de leurs superficies respectives donne 43 km2), situés dans l’ouest de l’océan Indien. Les îles Europa, Bassas de India, Juan de Nova et l’archipel des Glorieuses se trouvent dans le canal du Mozambique, entre l’Afrique et Madagascar, tandis que l’île Tromelin est au nord de La Réunion et à l’est de Madagascar.
Le climat de ces îles est celui de la zone tropicale où elles se trouvent. Elles sont soumises au régime des alizés.
Tromelin a été découverte en 1722 par un navire français de la Compagnie des Indes. La France a officiellement pris possession des Glorieuses en 1892 et d’Europa, Juan de Nova et Bassas de India en 1897. En 1960, peu avant l’indépendance de Madagascar à l’administration de laquelle la plupart étaient rattachées, les îles Éparses ont été placées sous l’autorité directe du ministère de l’outre-mer, qui en a confié l’administration au préfet de La Réunion, avant de la transférer en 2005 aux TAAF, transfert confirmé en 2007 par la loi.
b. Un point commun : l’absence de population permanente
Le point commun le plus caractéristique entre les différentes composantes des TAAF, par ailleurs très éloignées géographiquement, est leur absence de population permanente au sens classique du terme, c’est-à-dire d’une population de familles installées sur place et vivant d’activités économiques diverses.
L’éloignement, la dureté des conditions climatiques, ou, s’agissant des îles Éparses, leur petite taille et l’insuffisance des ressources en eau douce expliquent cette situation.
Il est cependant à noter qu’il n’en a pas toujours été ainsi : plusieurs des îles Éparses ont connu à la fin du XIXème siècle ou dans la première moitié du XXème des tentatives de colonisation et d’exploitation de leurs ressources, notamment en guano. Plus tôt encore, Tromelin avait été l’objet d’une forme de colonisation involontaire : L’Utile, frégate de la Compagnie française des Indes orientales, ayant fait naufrage aux abords de l’île en 1761, des hommes d’équipage et des esclaves enlevés à Madagascar qui se trouvaient sur ce navire ont survécu plusieurs années, avec diverses péripéties et tentatives de sauvetage, avant que les derniers survivants abandonnés sur l’île ne soient recueillis en 1776 par le navire commandé par le chevalier de Tromelin, lequel a donné son nom à l’île.
Mais aujourd’hui, les différentes TAAF n’abritent plus que des scientifiques ou des militaires. Globalement, l’effectif total qui y est présent est en moyenne d’environ 165 personnes durant l’hiver (austral) et 350 personnes durant l’été.
Il s’agit d’abord de scientifiques, surtout dans les districts antarctiques ou subantarctiques :
– la terre Adélie abrite depuis 1956 la base Dumont d’Urville, située sur l’île des Pétrels, à 5 kilomètres du continent, qui peut accueillir jusqu’à cent personnes et où une trentaine restent pendant l’hiver austral. Elle a succédé à la base de Port-Martin, qui avait été créée en 1950. La base comprend une cinquantaine d’installations, lieux de vie, locaux techniques et laboratoires, avec une surface construite globale d’environ 5 000 m2 ;
– dans les îles Kerguelen, les bâtiments de la base de Port-aux-Français, qui existe depuis 1951, représentent plus de 9 000 m2 et peuvent accueillir jusqu’à 120 personnes en été ;
– depuis 1963, la base Alfred Faure est établie à Crozet ; une vingtaine de personnes y séjournent l’hiver, jusqu’à 45 durant l’été ;
– une station météorologique existe depuis 1950 sur Amsterdam, où elle est devenue la base Martin de Viviès ; une vingtaine de personnes y séjournent l’hiver, le double l’été ;
– en revanche, il n’y a pas de présence humaine autre qu’occasionnelle à Saint-Paul.
Dans les îles Éparses, des stations météorologiques, aujourd’hui à peu près toutes automatisées, ont été établies à partir de 1949.
Depuis 1973, des détachements des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) sont installés sur les îles de la Grande Glorieuse, Juan de Nova et Europa. Il s’agit chaque fois d’une quinzaine d’hommes, relevés généralement toutes les six semaines. Un gendarme est aussi présent sur chacun de ces sites. Cette présence s’inscrit dans un contexte de contestation de la souveraineté française (voir infra), mais vise surtout à décourager toute colonisation « sauvage » de ces îles jusqu’à présent préservées par des pêcheurs ou des paysans venus des pays riverains du canal du Mozambique.
c. Des enjeux écologiques et scientifiques majeurs
Relativement préservées des hommes et très isolées, les différentes TAAF représentent en effet un enjeu écologique majeur. Des écosystèmes très spécifiques s’y sont développés, avec souvent des espèces endémiques propres à telle ou telle île ou à un ensemble d’îles. Certes ces écosystèmes ont malgré tout été fragilisés par le débarquement des hommes, avec leurs compagnons habituels, qu’ils soient là délibérément (les animaux domestiques) ou soient des hôtes indésirables (les rats…), mais des efforts conséquents ont été faits pour réparer ces dommages, avec par exemple, à Saint-Paul, une vigoureuse campagne de dératisation en 1999.
La situation des îles subantarctiques françaises au cœur d’un espace maritime gigantesque en font aussi, pour les espèces marines se reproduisant à terre, des sites d’importance vitale. Elles accueillent ainsi les reproducteurs de trente-quatre espèces d’oiseaux marins et deux espèces endémiques d’oiseaux terrestres. Parmi ces trente-quatre espèces, onze sont classées menacées d’extinction à des degrés divers, dont une en danger critique d’extinction (l’albatros d’Amsterdam, dont l’unique population actuelle est estimée à 180 individus). L’archipel Crozet héberge la plus vaste colonie mondiale de manchots. Globalement, avec plus de 25 millions d’oiseaux, la réserve naturelle des îles australes françaises est la plus grande réserve mondiale d’avifaune. Les plages de Kerguelen accueillent la seconde population mondiale d’éléphants de mer du sud et les eaux côtières de l’archipel abritent la seule population d’une sous-espèce du dauphin de Commerson. D’importantes colonies d’otaries de Kerguelen et d’otaries d’Amsterdam se reproduisent sur les plages de ces îles.
La végétation des îles subantarctiques est également très particulière, avec des plantes endémiques comme le chou de Kerguelen ou le phylica, seul arbre (ou plutôt arbuste) de ces îles, à Amsterdam. Du fait de l’introduction d’animaux domestiques qui broutaient la végétation, cette espèce était fortement menacée dans les années 1980, mais, depuis lors, un programme de restauration a permis la plantation de 7 000 arbres.
Les îles Éparses ne sont pas en reste, avec notamment treize espèces d’oiseaux marins. Juan de Nova héberge la plus grande colonie de sternes fuligineuses de l’océan Indien. Les plages de ces îles sont des lieux de pontes importants pour les tortues marines et leurs récifs coralliens sont en très bon état, ce qui malheureusement devient rare dans le monde.
Il faut également souligner que la souveraineté économique qui s’étend sur les eaux des zones économiques exclusives des différentes TAAF s’accompagne d’une obligation de gestion responsable des ressources halieutiques et de protection de l’environnement.
Des mesures significatives de préservation ont été mises en place :
– l’ensemble des îles subantarctiques françaises (Amsterdam, Saint-Paul, Crozet et Kerguelen) et une part importante de leurs eaux côtières constituent la plus grande réserve naturelle de France, qui couvre 7 000 km2 à terre et 15 700 km2 en mer ;
– créé tout récemment (2012), le parc naturel marin des Glorieuses s’étend jusqu’à la limite de la zone économique exclusive. Couvrant plus de 43 000 km², il comprend en particulier un récif de 17 kilomètres de long et d’une superficie de 165 km², qui sert de refuge à de nombreuses espèces menacées.
Outre l’intérêt suscité par toute cette biodiversité chez les chercheurs, il faut également souligner que l’isolement géographique des différentes îles en fait aussi des lieux quasiment obligés pour l’établissement de stations météorologiques si l’on veut disposer d’un bon maillage du monde entier (c’est d’ailleurs à la demande de l’Organisation météorologique mondiale que des stations ont été installées dans presque toutes les îles). Cet isolement en fait également des lieux privilégiés pour la mesure de la pollution de fond de l’atmosphère de notre planète – la station d’Amsterdam est l’une des deux bases mondiales choisies à cette fin – et plus généralement pour de nombreux travaux de géophysique.
Les TAAF accueillent en moyenne plus de 200 chercheurs par an et la France ressort comme le pays à l’origine du plus grand nombre de publications scientifiques sur l’aire subantarctique.
d. Les enjeux de souveraineté et économiques
Si on laisse de côté la terre Adélie, où dans le régime du Traité sur l’Antarctique l’exercice de la souveraineté territoriale reste virtuel, les TAAF sont formées d’îles qui, à l’exception de la Grande terre de Kerguelen, sont de taille modeste, voire minime. Au total, toutes ces îles couvrent un peu plus de 7 800 km2, soit moins que la superficie de la Corse.
Mais il faut aussi tenir compte des droits qu’en application du droit de la mer, ces territoires donnent sur les eaux environnantes : les TAAF valent à la France 2,35 millions de km2 de zone économique exclusive (ZEE), soit près du quart du total mondial de sa ZEE. De plus, la France a déposé devant la Commission des limites du plateau continental (CLPC) trois demandes d’extension de ses droits sur les fonds marins au-delà de la ZEE, au titre du plateau continental, concernant les îles Kerguelen, Crozet et Saint Paul et Amsterdam. Ces demandes visent plus d’un million de km2.
Il est à noter que, pour le moment du moins, la ZEE délimitée par la France ne semble pas en tant que telle contestée par d’autres États : dans la région du canal du Mozambique (îles Éparses), en particulier, les diverses demandes d’extension du plateau continental déposées entre 2008 et 2011 par Maurice, les Seychelles, le Mozambique et Madagascar ne chevauchent pas la ZEE française.
Mais il existe en revanche des différends plus fondamentaux portant sur la souveraineté de certaines des TAAF (et en conséquence sur les droits concernant la ZEE qui les entoure). Ces différends concernent les îles Éparses, qui ne représentent que 43 km2 de terres, mais sont entourées de 636 000 km2 de ZEE.
i. Le différend avec Maurice sur Tromelin
Comme on l’a indiqué supra, l’île Tromelin a été découverte en 1722 par un navire français et, depuis 1954, date à laquelle y a été installée une station météorologique, a été occupée effectivement et continûment par l’administration française.
Toutefois, la souveraineté française y est contestée en raison de l’ambiguïté d’une clause du traité de Paris du 30 mai 1814, qui a sanctionné la fin des guerres napoléoniennes : stipulant la cession par la France au Royaume-Uni de l’île Maurice et de « ses dépendances », ce texte peut donner lieu à plusieurs interprétations quant au statut de Tromelin, qui n’y est pas nommé, car ses versions anglaise et française ne semblent pas exactement équivalentes. Toujours est-il que les autorités mauriciennes – Maurice, à son indépendance, ayant hérité des droits de la couronne britannique – revendiquent la souveraineté sur Tromelin et le contrôle de la ZEE qui l’entoure, où elles ont parfois prétendu délivrer des licences de pêche, bien sûr non reconnues par la France, ce qui a suscité quelques rares incidents, en particulier l’arraisonnement par la Marine nationale, en 2004, de deux navires japonais titulaires d’une licence mauricienne, mais pas d’une licence française.
Pour mettre fin à cette situation et compte tenu de relations économiques et politiques bilatérales par ailleurs excellentes, la France et Maurice ont signé le 7 juin 2010 un Accord-cadre sur la cogestion économique, scientifique et environnementale relative à l’île de Tromelin et à ses espaces maritimes environnants, accompagné de conventions d’application. À la manière du Traité sur l’Antarctique, ces textes laissent explicitement de côté la question de la souveraineté, qu’ils se refusent à trancher, et prévoient une cogestion, notamment en matière de protection de l’environnement et de pêche (avec un régime où chaque pays serait habilité à délivrer des licences à ses nationaux, mais où les navires de pays tiers devraient demander à la fois une licence française et une licence mauricienne).
Le projet de loi autorisant la ratification de ces textes a été adopté par la commission des affaires étrangères en mars 2013, mais n’a toujours pas été examiné en séance publique par l’Assemblée nationale.
ii. Le différend avec Madagascar sur les îles du canal du Mozambique
Un autre différend oppose la France et Madagascar, cette fois sur les îles du canal du Mozambique – Europa, Bassas de India, Juan de Nova et les Glorieuses –, car celles-ci étaient administrativement rattachées à Madagascar quand la grande île était une colonie française : c’est seulement par un décret du 1er avril 1960, quelques mois avant l’indépendance de Madagascar, que l’administration de ces îles a été directement confiée au ministère de l’outre-mer, avant d’être transférée au préfet de La Réunion.
Les autorités malgaches, invoquant le principe de l’intégrité territoriale des entités décolonisées, ont contesté à plusieurs occasions cette opération et revendiqué la souveraineté sur les îles Éparses. La question a été portée devant l’Organisation de l’unité africaine et l’ONU. L’Assemblée générale des Nations-Unies a adopté le 12 décembre 1979 une résolution (48) qui, partant du principe d’intégrité territoriale mentionné supra, invitait le gouvernement français à négocier avec Madagascar la rétrocession de ces îles. La question réapparaît régulièrement dans la vie politique malgache, en particulier lors des campagnes électorales. Les revendications des dirigeants malgaches ont cependant toujours été exprimées avec modération, avec des appels à la négociation plutôt que des déclarations comminatoires.
La position de la diplomatie française semble être calquée sur celle adoptée quant au litige sur Tromelin : rechercher une solution négociée de cogestion, mais sous réserve de ne rien concéder quant à la souveraineté. L’exposé des motifs du projet de loi de ratification de l’accord avec Maurice sur Tromelin (49) présenté supra est assez clair à cet égard : « cet accord [sur Tromelin] pourrait contribuer à la solution d’autres contentieux dans la même zone en servant de référence sur le fond ou sur la méthode employée. Quatre des cinq États membres de la Commission de l’océan Indien (COI), Madagascar, Maurice, Comores et France (Réunion) n’ont pas pu trouver de consensus concernant la souveraineté sur certaines îles de l’océan Indien ainsi que sur la délimitation et le contrôle de leurs zones économiques exclusives (ZEE). Cela concerne les îles du canal du Mozambique (Europa, Bassas da India, Juan de Nova, Glorieuses) et une île au nord-ouest de La Réunion : Tromelin (…). Le présent accord pourrait inspirer d’autres accords susceptibles d’aplanir les difficultés tout en contournant l’obstacle du différend sur la souveraineté du territoire concerné ».
Les différends de souveraineté évoqués supra ont pour arrière-fond des enjeux économiques significatifs, qui ne sont pas liés aux terres émergées qui constituent les TAAF, mais aux eaux qui les entourent et sur lesquelles la France a des droits économiques exclusifs.
Actuellement, l’exploitation de ces eaux se limite aux activités de pêche : thonidés autour des îles Éparses, langouste autour de Saint-Paul et Amsterdam, avec près de 400 tonnes de prises autorisées par an, et surtout légine autour des îles Crozet et Kerguelen, avec près de 6 000 tonnes de captures autorisées. Ces produits de la mer transitent par La Réunion, où ils doivent être débarqués et où leur conditionnement génère une activité importante : 400 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects ; un chiffre d’affaires proche de 100 millions d’euros ; la seconde ressource d’exportation de l’île. La pêche en haute mer dans les eaux des TAAF est actuellement pratiquée par un petit nombre de navires autorisés, appartenant à des armements français (sauf pour les thonidés, où opèrent également des Espagnols et des Seychellois).
À terme, la question de l’exploitation des hydrocarbures pourrait être posée dans les eaux des îles du canal du Mozambique, puisque cette aire géographique est parfois présentée dans la presse comme un « nouveau Qatar », après la découverte récente de gigantesques réserves de gaz sous les eaux dépendant du Mozambique. S’agissant de la ZEE française afférente aux îles Éparses, des permis de recherche ont été attribués en 2008 à des entreprises spécialisées dans la zone de Juan de Nova et des campagnes de prospection engagées. Mais si des gisements intéressants étaient découverts, leur exploitation serait-elle compatible avec la préservation de l’environnement des îles Éparses, jusqu’à présent prioritaire, ce dont votre rapporteur se félicite ? C’est une question pour l’avenir et un point de préoccupation.
Les îles Éparses et leurs zones économiques exclusives
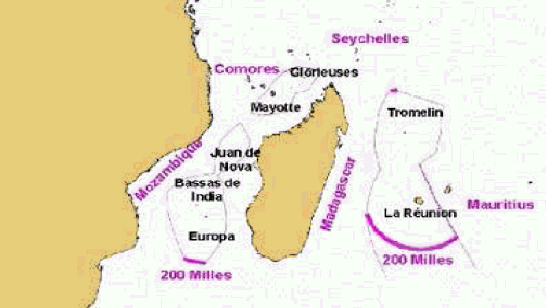
2. L’administration des Terres australes et antarctiques françaises
Le statut des Terres australes et antarctiques françaises a été clarifié par la loi du 21 février 2007, qui les qualifie de « territoire d’outre-mer doté de la personnalité morale et possédant l’autonomie administrative et financière ».
Cette collectivité, dirigée par un préfet, reste toutefois très originale dans le paysage administratif français, puisque, ne comptant pas d’habitants permanents, elle ne comporte pas d’assemblée élue. Le préfet cumule donc les fonctions de représentant de l’État et d’exécutif de la collectivité. Il s’appuie sur un conseil consultatif composé de personnalités (scientifiques et hauts fonctionnaires) nommées.
a. Les moyens de la collectivité des TAAF
Bien que dépourvue d’« habitants », la collectivité des TAAF dispose d’un budget significatif (près de 30 millions d’euros), qui repose à 80 % sur des ressources propres, le reste provenant de subventions budgétaires. Ces ressources propres sont principalement constituées par des droits de pêche et les prestations remboursées pour les services du Marion-Dufresne II (voir infra) au bénéfice des instituts de recherche, auxquels s’ajoutent les revenus plus anecdotiques des émissions philatéliques ou de la prise en charge de quelques dizaines de touristes par an.
Les TAAF bénéficient aussi de fonds communautaires, en tant que PTOM (pays et territoires d’outre-mer) associé à l’Union européenne.
Le siège des TAAF, situé depuis 2000 à Saint-Pierre de La Réunion, fait travailler une cinquantaine d’agents, auxquels s’ajoute une petite équipe (six personnes) à Paris. Par ailleurs, 55 militaires sont mis à disposition des TAAF, qui bénéficient aussi de volontaires du service civique et de contrôleurs des pêches à bord des navires. Au total, l’effectif global des TAAF est de 167 postes en équivalents temps plein.
Les TAAF ne sont toutefois pas le seul organisme public à avoir (et financer) des missions de gestion dans leur ressort territorial : l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV), sur lequel on reviendra infra, a également un rôle, selon la clef de partage des compétences suivante :
– dans les bases des îles Kerguelen, Crozet et Amsterdam, l’administration des TAAF est responsable de la gestion fonctionnelle, mais l’IPEV a en charge la maintenance des laboratoires scientifiques, l’installation des nouveaux équipements de recherche, le ravitaillement et la remise en état des refuges éloignés servant aux différents programmes ;
– la gestion fonctionnelle de la base Dumont d’Urville et la conduite des programmes de recherche sont assurées par l’IPEV, mais les TAAF y exercent les missions de souveraineté et de service public.
Par ailleurs, les deux institutions cofinancent un certain nombre de moyens de transport, car c’est une lourde charge. Il faut à cet égard également mentionner le rôle de la Marine nationale. Le partage des missions et des moyens entre les différents opérateurs, qui peut apparaître un peu complexe, semble pourtant se passer dans des conditions assez claires et dans l’esprit coopératif qu’impose la nécessité de mutualiser des moyens soumis à la contrainte budgétaire.
b. Une problématique majeure pour les TAAF : les moyens permettant d’assurer le ravitaillement des districts et les missions de souveraineté
En effet, plus de la moitié du budget de la collectivité des TAAF est consacré aux moyens de transports, maritimes et aériens, qui sont nécessaires pour assurer le ravitaillement de bases très dispersées, l’activité scientifique en mer et la surveillance maritime. Et cet apport des TAAF ne représente qu’une part du coût de ces moyens, également supporté par l’IPEV et le ministère de la défense.
Le ravitaillement des bases et la relève de leurs personnels sont assurés par différents moyens :
– les îles Crozet, Kerguelen et Amsterdam sont ravitaillées depuis La Réunion par le Marion-Dufresne II, qui fait en général quatre rotations par an. Le Marion-Dufresne appartient à la collectivité des TAAF et est opéré par la CMA-CGM. C’est un cargo et un pétrolier, mais aussi un porte-hélicoptères et surtout un navire de recherche océanographique équipé de 650 m² de laboratoires et doté de plusieurs systèmes de treuillage et portiques pour la manipulation d’engins et matériels lourds, d’un sondeur multifaisceaux et d’un carottier sédimentaire géant ;
– la base Dumont d’Urville est ravitaillée depuis Hobart, en Tasmanie, qui est le port le plus proche, par L’Astrolabe, le ravitaillement de la base Concordia (plus de 500 tonnes de fret et de carburant par an) étant ensuite assuré par des convois terrestres (trois par an) et des avions légers. L’Astrolabe, qui fait jusqu’à cinq rotations par an, est un navire adapté aux conditions polaires (glaces) et embarque aussi deux hélicoptères. Affrété par les TAAF et l’IPEV, il est possédé et opéré par P&O Maritime Services ;
– la relève et le ravitaillement des militaires positionnés dans plusieurs des îles Éparses sont principalement effectués par voie aérienne (par avion Transall).
Le ravitaillement maritime des bases des TAAF
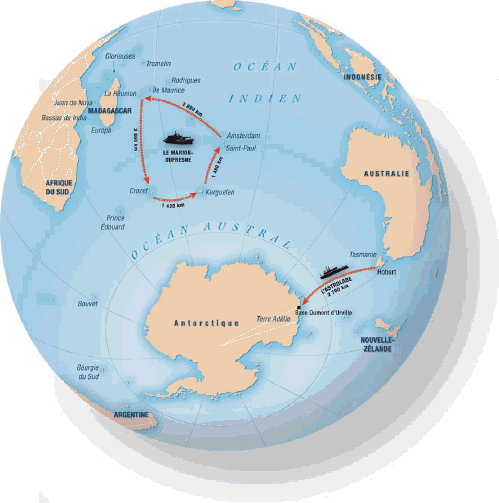
Source : TAAF.
Il y a par ailleurs des missions de souveraineté à assurer. La lutte contre la pêche illicite dans la ZEE française repose largement sur les moyens mis en œuvre par le commandement des forces armées de la zone sud de l’océan Indien (COMSUP-FASZOI). Depuis la base réunionnaise de Port-des-galets, la Marine nationale aligne plusieurs bâtiments : deux frégates de surveillance dotées chacune d’un hélicoptère Panther, deux patrouilleurs, un bâtiment de transport léger, une vedette côtière de la gendarmerie maritime. Certains de ces navires sont affectés à des missions de patrouille. Par ailleurs, dans le cadre du plan régional de surveillance des pêches établi en partenariat entre la Commission de l’océan Indien et l’Union européenne, l’administration des affaires maritimes met en œuvre un patrouilleur hauturier, l’Osiris, qui est propriété des TAAF.
La difficulté est qu’une grande partie des navires et avions sur lesquels repose le fonctionnement des TAAF est aujourd’hui vétuste.
Une solution a pu être trouvée pour le Marion-Dufresne, qui, après vingt ans de service, va connaître une opération de « jouvence » durant ce printemps 2015, cofinancée par la collectivité des TAAF, qui a emprunté à cette fin 10 millions d’euros à l’Agence française de développement, et le ministère de la recherche via l’IPEV, qui met à disposition 13 millions d’euros destinés aux équipements scientifiques.
Mais la question reste posée pour L’Astrolabe, dont le remplacement s’impose avant la fin de la décennie.
De même, plusieurs des bâtiments militaires ou civils de surveillance maritime présents dans la zone devraient être désarmés en 2015 ou 2016. Le patrouilleur L’Albatros est dans ce cas, de même que le bâtiment de transport léger La Grandière et le patrouilleur L’Osiris.
Certains de ces navires devraient être remplacés, mais pas tous, et les remplacements envisagés sont encore à l’étude. L’une des idées est de développer un bâtiment polyvalent qui pourrait répondre aux différents besoins, un « navire polyvalent de souveraineté » destiné à la fois à ravitailler la terre Adélie (en remplacement de L’Astrolabe) et à patrouiller pour la Marine nationale, mais il reste à en trouver le financement…
S’agissant des moyens aériens, le Transall en fin de vie va être remplacé par des CASA, mais, ceux-ci ayant moins de capacité d’emport, il faudra aussi développer un ravitaillement par mer des îles Éparses. En raison de la diminution des moyens de la Marine nationale, le Marion-Dufresne devrait être sollicité : il a déjà effectué des rotations dans les îles Éparses en 2009, 2011 et 2014 et l’objectif est d’organiser une rotation annuelle à partir de 2016.
3. Le rôle de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor
Comme on l’a déjà vu, l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) a également une présence très forte dans l’Antarctique et le Subantarctique.
L’IPEV a été créé en 1992 suite à la fusion de la Mission de recherche des Terres australes et antarctiques Françaises et des Expéditions polaires françaises. Il s’agit d’un groupement d’intérêt public (GIP) constitué par neuf organismes publics ou parapublics (ministères de la recherche et des affaires étrangères, CNRS, IFREMER, CEA, TAAF, Météo-France, CNES et Expéditions polaires Françaises). Il a été prorogé, chaque fois pour douze années supplémentaires, en 2002, puis 2014.
L’IPEV se présente avant tout comme une agence de moyens et de compétences au service des organismes de recherche et des chercheurs. Environ 80 projets sont sélectionnés annuellement sur les recommandations de son Conseil des programmes scientifiques et technologiques, constitué d’experts français et étrangers. L’IPEV organise et finance les expéditions et leur met à disposition ses moyens – navires, bases, équipements scientifiques.
Il dispose de cinquante personnels permanents (15 agents contractuels et 35 agents du CNRS mis à disposition) et recrute annuellement à durée déterminée plus d’une centaine de contractuels pour les missions de terrain (campagnes d’été et hivernages). Son budget est un peu inférieur à trente millions d’euros (27,57 millions en 2013) et provient essentiellement du ministère de la recherche.
Un tiers de ce budget est consacré au fonctionnement du Marion-Dufresne, sur lequel sont menées des campagnes océanographiques. Une autre part très importante est absorbée par les six bases permanentes, qui ont déjà été présentées, et leur ravitaillement : les trois bases des îles Crozet, Kerguelen et Amsterdam ; les bases Dumont d’Urville et Concordia en Antarctique ; la base AWIPEV au Svalbard.
C. L’ARCTIQUE : UNE PRÉSENCE PLUS MODESTE ET UNE ORGANISATION ADMINISTRATIVE INCERTAINE
N’étant pas possessionnée dans les régions arctiques, la France y a nécessairement une présence plus modeste qu’en Antarctique. Cette présence est principalement scientifique et dans une certaine mesure économique. Elle justifie notre statut d’observateur au Conseil arctique, qui nous permet une action diplomatique.
1. La recherche arctique française : de beaux résultats, malgré une structuration et des moyens faibles
D’après un décompte (50) fait récemment sur le nombre de publications scientifiques – indicateur sans doute grossier mais communément utilisé pour mesurer le poids scientifique des nations –, la France arrive, sur la période 2007-2012, au 9ème rang des pays en matière de recherche arctique. Nos chercheurs ont été à l’origine de 4,7 % des articles scientifiques concernant l’Arctique sur cette période, de sorte :
– qu’ils sont devancés par ceux de six des membres du Conseil arctique (dans l’ordre, États-Unis, Canada, Russie, Norvège, Danemark et Suède) ;
– qu’ils ne sont devancés que par ceux de deux autres observateurs au Conseil arctique, le Royaume-Uni et l’Allemagne ;
– mais qu’ils restent légèrement devant les deux premières nations asiatiques du palmarès, le Japon et la Chine.
On peut considérer qu’il s’agit d’une performance honorable, car il n’est évidemment pas surprenant que la recherche arctique des pays arctiques arrive en tête, a fortiori quand il s’agit de « poids lourds » de la science mondiale comme les États-Unis et la Russie.
a. Une présence plus modeste de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor
Comme il a été dit, l’IPEV met à disposition de nos chercheurs une seule base en Arctique, la base AWIPEV à Ny-Ålesund au Svalbard (avec sa dépendance la station Corbel), contre cinq dans l’Antarctique et le Subantarctique.
Dans le document qu’il a produit en vue de la présentation de la « Feuille de route nationale » arctique du gouvernement français (51), l’IPEV a évalué, sur les années 2010-2012, les moyens qu’il consacre à la recherche en Arctique, d’une part à travers le financement de la base AWIPEV et de la station Corbel, d’autre part dans le cadre de son soutien aux programmes scientifiques des chercheurs et organismes de recherche français (prise en charge des déplacements et manipulations sur le terrain arctique). Le coût annuel moyen, sur la période précitée, des activités arctiques financées par l’IPEV est évalué à 1,3 million d’euros (soit environ 0,4 million en soutien direct aux programmes, environ 0,7 million en coûts indirects, dont le fonctionnement de la base AWIPEV pour 0,3 million, et 0,15 million d’investissements pour la base AWIPEV). Sur un budget global d’un peu moins de 30 millions d’euros pour l’Institut, l’Arctique ne représente donc qu’une petite part, ce budget étant lourdement grevé par le financement des bases de l’hémisphère sud et des navires L’Astrolabe et Marion-Dufresne : l’Arctique absorbe environ 7 % du budget « polaire » (hors siège) de l’Institut, ceci signifiant que le reste est consacré à l’Antarctique et au Subantarctique.
En termes de programmes, sur la période 2009-2013, 44 ont été mis en œuvre en Arctique, permettant chaque année à une petite centaine de scientifiques, en moyenne, de se rendre sur le terrain, avec une forte prédominance du Svalbard compte tenu de la présence de la station AWIPEV (40 % des journées-terrain en Arctique). Globalement, les trois quarts de l’activité scientifique de l’IPEV se déploient en Antarctique, contre un quart en Arctique.
b. Le Chantier arctique : une volonté fédératrice en manque de moyens
Une démarche en vue d’une meilleure coordination de la recherche française en Arctique a été lancée en 2013, le « Chantier arctique ».
Cette démarche paraît particulièrement nécessaire si l’on en croit le document préparé en vue de la présentation de la « feuille de route » arctique du gouvernement (52) au nom du Chantier arctique, qui mérite une large citation : « la valorisation de la recherche française arctique repose sur deux conditions, à savoir un soutien fort et une coordination reconnue et acceptée de tous. La complexité de la structuration de la recherche française est telle qu’il est actuellement difficile de concrétiser ces conditions (…).
« Depuis quelque temps, il existe de nombreuses initiatives françaises en Arctique. Il est heureux de constater un tel regain d’intérêt sur cette région, même s’il entraîne une perte de lisibilité et de visibilité face à nos interlocuteurs internationaux qu’il est urgent de corriger. L’IPEV soutient des activités scientifiques en Arctique principalement et stratégiquement via des projets bénéficiant des infrastructures mises à disposition par la base AWIPEV à Ny-Ålesund. L’ANR de son côté participe aux activités du Belmont-Forum dont elle est membre mais aussi au JPI Climate européen. Or le Belmont-Forum a lancé en 2014 un appel à propositions pour un CRA (Cooperative Research Action) sur l’Arctique piloté par l’US NSF et ouvert aux chercheurs de tous les pays. L’ANR et le CNRS sont partenaires de cet appel à propositions, financièrement pour la première et en "in-kind” pour le second. Un groupe miroir français au JPI Climate a été constitué par AIIEnvi mais sans financement. Par ailleurs le JPI Climate avait lancé un appel à propositions sur deux thèmes dont un sur le permafrost et la forêt boréale sibérienne, l’occasion de développer les coopérations existantes avec la Russie. Ce second thème n’a pas été retenu par le conseil d’administration de l’ANR alors qu’il constitue une des priorités du Chantier arctique. L’INSU est membre d’un consortium d’établissements universitaires et de recherche européens, ECRA, développant des collaborations sur le thème de la recherche climatique. Ce consortium a un sous-thème dédié à la recherche sur le climat arctique qui a proposé un plan scientifique ayant débouché sur la soumission d’un projet COST. L’INSU et l’INEE soutiennent également sur leurs fonds des groupes de recherche et laboratoires internationaux avec la Russie, ainsi qu’une unité mixte de recherche et un observatoire hommes-milieux en partenariat avec l’Université Laval à Québec. L’INSU est partenaire de l’US NSF et d’autres agences de financement américaines, dans le programme ArcSEES de la direction de la recherche arctique de la NSF. Enfin, le CNRS et l’IPEV sont membres de l’European Polar Board (EPB), qui regroupe les acteurs majeurs de la recherche et de la logistique polaire et par conséquent arctique. L’IPEV soutient des actions en Arctique mais d'autres programmes comme LEFE à l’INSU-CNRS ou TOSCA au CNES soutiennent également quelques actions (…).
« Des universités et laboratoires se sont également positionnés sur l’Arctique soit d’une manière officielle comme ce fut le cas de l’UVSQ et de l’UPMC ou bien selon des démarches individuelles. Par ailleurs les représentations diplomatiques françaises dans les pays péri-arctiques organisaient jusqu’ici des actions de collaborations non coordonnées avec les initiatives internes (…) ».
Effectivement, la recherche arctique française apparaît foisonnante, avec de nombreuses coopérations internationales, mais il est pour le moins difficile d’en déterminer les axes structurants ! Cela nuit certainement, comme le document précité le souligne, à sa visibilité, en particulier au plan international.
La notion de Chantier arctique français est donc intéressante. Cependant les réalisations restent pour l’heure limitées.
En juin 2013, un colloque national de prospective a été organisé dans ce cadre au Collège de France, qui a constitué la première réunion de l’ensemble de la communauté scientifique française, toutes disciplines confondues, intéressée par l’Arctique. Il a débouché sur la définition de dix champs prioritaires pour la recherche arctique, dont la formulation est destinée à mieux fédérer cette recherche.
Mais, pour le reste, le Chantier arctique demeure un objet au statut incertain : ce n’est pas un établissement autonome, ni le département d’un établissement de recherche ou de financement de la recherche, mais seulement une sorte de secrétariat chargé de conduire une démarche fédératrice sans disposer de moyens propres. Il semble qu’en 2015 il devrait y avoir des appels à projets de recherche au titre du Chantier arctique, mais qu’en pratique cela ne soit pas le cas, ou pas encore.
c. Le sentiment général : un manque de structuration et de moyens qui perdure pour notre recherche arctique
Par ailleurs, l’articulation entre les organismes de recherche, par exemple le CNRS, ou de financement de la recherche, comme l’Agence nationale de la recherche (ANR), et l’IPEV est critiquée par des scientifiques, car le partage des tâches conduit à multiplier les démarches administratives : un projet de recherche comprenant un travail de terrain en Arctique ou en Antarctique doit faire l’objet d’au moins deux dossiers, puisqu’après son approbation par l’organisme d’origine, il faut obtenir celle de l’IPEV afin que sa partie « sur le terrain » soit organisée et prise en charge par l’Institut. L’IPEV est de fait plus qu’une agence de moyens puisqu’il choisit aussi, sur la base de ses propres critères scientifiques, les projets qu’il prend en charge.
Dans une contribution adressée à la mission, l’ONG WWF porte un jugement assez sévère sur le dispositif français : « il manque une administration en charge des Pôles qui pourrait rassembler, ou a minima piloter, les administrations et les scientifiques concernés, et assurer que la France ait une approche globale des questions polaires et une cohérence dans ses programmations, positions et actions. L’IPEV est une agence de moyens (opérationnels) mais qui n’a pas de mandat pour effectuer de suivi sur le fond ; elle élabore ses propres programmes de recherche mais sans articulation avec les agendas des institutions internationales. La structure administrative française est parmi les plus faibles des États ayant une diplomatie polaire (…) : elle ne fait pas le poids par exemple face aux Britanniques qui, pour l’Antarctique, ont créé le "British Antarctic Survey" (…) ».
Cela dit, des chercheurs français considèrent aussi que le modèle en place chez beaucoup de nos partenaires, qui disposent d’instituts de recherche polaire qui s’occupent à la fois du fond (la recherche) et de la logistique, a certes ses avantages, mais aussi ses inconvénients : il conduit à avoir des chercheurs spécialisés sur les pôles et assez isolés de leurs collègues des mêmes disciplines mais qui ne travaillent pas sur les régions polaires. Or, la Terre est une et les interactions entre les milieux naturels, les écosystèmes, les populations humaines, etc., des différentes aires géographiques sont évidemment massives et essentielles à étudier.
L’un des scientifiques entendus par la mission a considéré que l’IPEV devrait surtout investir sur le monitoring de l’Arctique, c’est-à-dire le suivi scientifique de ses données, qui doit s’inscrire dans le temps le plus long possible et couvrir aussi finement que possible l’espace pour être intéressant.
D’autres critiques entendues renvoient aux problèmes de structuration et de moyens :
– faute de moyens, les chercheurs français ne seraient pas assez actifs dans les groupes de travails et programmes scientifiques du Conseil arctique (alors que c’est la contribution apportée dans ce cadre qui constitue la première justification du statut des observateurs au Conseil) ;
– bien que la France ait beaucoup à faire valoir en matière de recherche en sciences humaines en Arctique (du fait de son passé prestigieux dans ce domaine, de la compétence actuelle de ses chercheurs et de l’absence de passif colonial nous concernant dans la zone), elle apparaît particulièrement peu visible dans ce domaine, car notre présence est très dispersée et peu coordonnée ;
– plus généralement, l’absence de grands projets pluriannuels, structurants, est regrettée pour ce qui est de la recherche arctique française. Ce devrait être le rôle du Chantier arctique, mais il ne semble pas avoir les moyens de le remplir. Les chercheurs se tournent donc vers des appels à projets internationaux auxquels il est souvent très compliqué de répondre du fait de multiples exigences.
2. Des moyens également limités pour notre diplomatie arctique
Des diplomates rencontrés par la mission ont observé que le développement d’une « diplomatie arctique » de la France n’était pas seulement légitimé par les enjeux propres à l’Arctique, mais pouvait aussi avoir l’intérêt de faciliter les relations avec les pays arctiques. Si l’on prend l’exemple de la Norvège, dont l’Arctique est de loin la priorité n° 1 en politique étrangère, il est clair que l’implication de la France sur la question crée du « liant » ; l’Arctique est l’un des thèmes majeurs des relations bilatérales avec ce pays.
La diplomatie française a des cartes à jouer en Arctique, du fait :
– du haut niveau de la recherche polaire française ;
– du choix en 2009 d’une personnalité ayant une très grande autorité comme ambassadeur chargé de la négociation internationale pour les pôles, l’ancien Premier ministre Michel Rocard ;
– d’un réseau diplomatique qui, en Arctique comme ailleurs, reste l’un des plus vastes, avec notamment une présence consulaire au Groenland.
Cette année, la Conférence Paris-climat est un élément de plus.
Mais notre action diplomatique dans la zone reste limitée par la faiblesse de ses moyens. Le nombre de rédacteurs travaillant en administration centrale sur les problématiques à proprement parler arctiques est quasi-nul. Quant à nos postes diplomatiques, ils ont du mal à assurer une présence régulière de la France à toutes les réunions des instances du Conseil arctique, qui ont lieu dans différents endroits dont le point commun est généralement d’être très loin au nord et plus ou moins faciles d’accès…
3. Une présence économique significative
Si des pays « arctiques » comme les États-Unis, le Canada ou la Russie sont des partenaires économiques majeurs de la France, il est clair que l’essentiel des échanges que nous avons avec eux ne concernent pas leurs régions arctiques, peu peuplées.
Les enjeux économiques de l’Arctique ou des régions subarctiques se situent, pour les entreprises françaises, dans les domaines du tourisme – avec notamment les croisières de la compagnie Ponant –, de la pêche, potentiellement du transport maritime – mais, on l’a vu, pour le moment, les routes du nord restent peu empruntées – et surtout des hydrocarbures.
La Norvège et la Russie sont parmi les pays les plus importants pour le groupe Total : en 2013, elles ont été respectivement les troisième et quatrième pays de production (pétrole et gaz combinés) pour le groupe, juste derrière le Nigeria et les Émirats-Arabes-Unis. La Norvège et la Russie ont apporté durant cet exercice respectivement 11 % et 9 % de la production mondiale d’hydrocarbures du groupe (53).
En Norvège, Total détient un portefeuille de 104 licences et en exploite 30 ; elle est accompagnée par d’autres entreprises comme Technip. Il faut cependant rappeler que, même si la limite est incertaine, ces gisements se situent plutôt dans l’Atlantique-Nord que dans l’océan Arctique lui-même, avec une tendance au glissement progressif vers le nord. En mer de Barents, Total est partenaire dans l’exploitation du champ gazier de Snøhvit, de même d’ailleurs que GDF-Suez.
Dans l’Arctique russe, Total détient 20 % des parts du projet de Iamal, qui devrait à partir de 2018 exporter du gaz naturel liquéfié (à partir d’une usine que Technip devrait construire), et est également impliqué dans le projet d’exploitation du gisement de Chtokman. Si ce dernier est suspendu, le projet de Iamal continue à être mis en œuvre malgré les difficultés liés aux sanctions économiques occidentales vis-à-vis de la Russie.
En 2013, la Russie et la Norvège ont été les troisième et quatrième fournisseurs de la France en pétrole brut, représentant respectivement 12,1 % et 9 % de nos importations. S’agissant du gaz, la Norvège a été notre premier fournisseur, avec 36,2 % de nos importations, et la Russie le deuxième, avec 17,9 % de ces importations (54).
L’Arctique présente pour notre pays un certain nombre d’enjeux stratégiques :
– comme on vient de l’indiquer, c’est déjà une source majeure de nos approvisionnements énergétiques et ce pourrait devenir, si l’on pense par exemple aux gisements exceptionnels d’uranium et de « terres rares » découverts au Groenland, un élément important pour la diversification, donc la sécurité de nos approvisionnements dans des matières premières stratégiques ;
– stratégiquement, la France est engagée en Arctique par le seul fait de son appartenance aux mêmes alliances que certains des États arctiques : Alliance atlantique et Union européenne ;
– de manière générale, en tant que puissance maritime (et accessoirement en tant que pays d’origine de nombreux touristes aventureux), la France se doit de rappeler son attachement à plusieurs principes dans tout espace maritime, en particulier quand s’y ouvrent de nouvelles routes, comme c’est le cas en Arctique : il s’agit notamment de la liberté de navigation, aussi bien commerciale que militaire, et de la nécessité d’y imposer les règles de sécurité adéquates assorties de secours organisés en cas de besoin.
II. LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION
1. Mobiliser les opinions publiques pour préserver l’Antarctique de l’exploitation économique
Au regard des résultats remarquables obtenus pas le système du Traité sur l’Antarctique, il faut évidemment souhaiter qu’il perdure. Cependant, le développement des activités économiques à la périphérie de l’Antarctique – pêche et tourisme – entraîne des dégradations et, surtout, le risque de remise en cause future du dispositif par certains des grands acteurs mondiaux qui y adhèrent aujourd’hui apparaît réel, lorsque l’on voit des « ballons d’essai » tels qu’un document russe officiel envisageant plus ou moins une exploitation minière future. Il est donc important de conforter le statut de l’Antarctique par une mobilisation continue de l’opinion publique.
La consécration de l’Antarctique comme bien public mondial ou patrimoine commun de l’humanité pourrait être l’occasion parfaite pour une telle mobilisation.
Par ailleurs, la démarche pragmatique de création d’aires marines protégées vise à éviter la surpêche à des écosystèmes encore très peu exploités et donc préservés. Elle doit être mise en avant car elle bénéficie de solides soutiens – outre la France, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande… – mais rencontre aussi une opposition sérieuse.
Proposition n° 1 : face aux velléités de certains États de remettre en cause le statut de l’Antarctique, en particulier la prohibition des activités minières, mobiliser l’opinion publique. La consécration de l’Antarctique comme bien public mondial ou patrimoine commun de l’humanité serait l’occasion d’une telle mobilisation.
*
Proposition n° 2 : soutenir activement la démarche de création d’aires marines protégées dans l’océan Austral.
2. Préserver les nécessaires outils de souveraineté dans les mers australes
La présence effective de la France dans les immenses espaces marins des Terres australes et antarctiques et françaises répond à de multiples enjeux :
– de souveraineté puisque certains pays contestent celle de la France sur les îles Éparses ;
– écologiques et scientifiques, puisqu’on a là des écosystèmes très préservés, très originaux vu leur isolement et vitaux pour de nombreux oiseaux et mammifères marins qui vont parfois à terre (généralement pour se reproduire) et n’ont pas d’autres choix vu le peu de terres émergées dans la zone ;
– économiques, au regard des ressources halieutiques (thon, langouste, légine selon les lieux…) et éventuellement en hydrocarbures de ces eaux.
Cette présence demande un minimum de moyens, notamment en navires et en avions. Or, on l’a vu, plusieurs des bâtiments présents sur place arrivent en fin de vie. Une solution a pu être trouvée pour prolonger celle du Marion-Dufresne, mais elle est loin de régler toutes les difficultés. Il faut donc expertiser rapidement les options possibles, comme celle du « navire polyvalent de souveraineté ».
Proposition n° 3 : préserver les nécessaires outils de présence et de souveraineté de la France dans les mers australes, en assurant au mieux le remplacement des quatre navires de ravitaillement ou de patrouille qui vont devoir être désarmés très prochainement.
3. Maintenir une priorité absolue à la préservation de la biodiversité exceptionnelle des îles australes françaises
La découverte de gisements d’hydrocarbures off-shore dans le canal du Mozambique conduit à penser que la zone économique exclusive attenante à certaines des îles Éparses que nous y possédons pourrait aussi en contenir. Des permis d’exploration ont d’ailleurs été délivrés.
Mais si des gisements intéressants étaient découverts, leur exploitation serait-elle compatible avec la préservation d’un environnement jusqu’à présent largement à l’abri des activités humaines ? Sans même évoquer le risque de marée noire, cette exploitation impliquerait des infrastructures considérables dont l’impact sur l’environnement serait très lourd, quelles que soient les précautions. Comment, notamment, éviterait-on le développement d’infrastructures sur ces petites îles jusqu’à présent inhabitées ?
Il serait certainement plus sage que la France donne l’exemple en renonçant à cette éventuelle exploitation, ce qui s’inscrirait dans l’engagement global qu’il faut prendre, de toute façon, de non-exploitation de la plus grande part des combustibles fossiles encore présents dans le sol si l’on veut parvenir à une limitation efficace des émissions de gaz à effet de serre.
Proposition n° 4 : prendre une position de principe de renoncement à l’exploitation des hydrocarbures dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive des îles Éparses du canal du Mozambique.
1. Clarifier nos positions en les rendant publiques et en affirmant une priorité claire à l’environnement
La France est peut-être le dernier pays membre ou observateur du Conseil arctique à ne pas avoir rendu public un « papier » politique exposant les priorités de sa politique arctique. D’une certaine façon, cela peut apparaître comme une chance alors que l’année en cours est :
– celle de la Conférence Paris-climat 2015 ;
– celle où l’Union européenne doit en principe formaliser aussi cet exercice de stratégie arctique. À cet égard, l’exercice national de Feuille de route devra non seulement avoir une dimension européenne, mais une dimension européenne qui s’articulera pleinement avec le texte que produira l’Union.
Maintenant il est temps que le Gouvernement finalise et publie ce document. Dans la perspective de la Conférence Paris-climat, il doit naturellement lui donner un contenu ambitieux et y affirmer la priorité absolue de la protection de l’environnement naturel arctique sur l’exploitation économique. L’exercice de la Feuille de route, dont la préparation a permis une sensibilisation des différentes administrations aux enjeux arctiques, devra aussi garantir qu’à l’avenir la dimension arctique restera présente dans les délibérations et les décisions gouvernementales.
Proposition n° 5 : rendre rapidement publique notre Feuille de route nationale pour l’Arctique et y inscrire une priorité absolue à la protection de l’environnement naturel arctique sur l’exploitation économique.
2. Renforcer et mieux structurer notre présence dans la recherche arctique et notre présence humaine institutionnelle en Arctique
Ainsi qu’on l’a vu, la recherche française en Arctique a des moyens modestes, compte tenu de la priorité inévitablement donnée aux TAAF, avec le coût structurel de nos bases et de leur ravitaillement : 7 % seulement du budget « pôles » de l’IPEV va à l’Arctique. Cette recherche souffre également d’un certain manque de structuration, le Chantier arctique, créé justement pour la fédérer, ne disposant pas, pour le moment du moins, de moyens propres.
Par ailleurs, le statut d’observateur au Conseil arctique n’est justifié, selon les règles internes à cette organisation, que par les contributions, principalement scientifiques, qu’apportent les observateurs à ses travaux. Il est en outre clair que, le Conseil étant la principale instance de « gouvernance » de l’Arctique, il est essentiel, pour jouer un rôle dans la zone, d’être effectivement présent, tant au niveau scientifique dans les activités de ses programmes et groupes de travail qu’au niveau politique et diplomatique lors des réunions qui sont tenues : cela implique un minimum d’investissement de nos chercheurs et diplomates, donc un minimum de moyens humains.
S’agissant de la recherche, des moyens pourraient utilement être attribués au Chantier arctique, de sorte qu’il puisse effectivement lancer ses propres appels à projets : des projets à moyen terme, ciblés sur des thématiques prioritaires, permettraient de mieux structurer et de rendre plus visible une recherche arctique française aujourd’hui assez dispersée. Naturellement, il ne s’agit pas de remettre en cause les multiples coopérations européennes et internationales existantes, ni la participation aux appels à projets internationaux, mais de trouver un équilibre.
L’effort pourrait sans doute être particulièrement marqué en ce qui concerne les sciences humaines, domaine où la recherche arctique française, malgré un passé brillant, manque aujourd’hui de visibilité.
Parmi les autres pistes suggérées par des scientifiques rencontrés par la mission, on peut aussi signaler :
– la réflexion à mener sur l’articulation des différents acteurs, notamment l’IPEV, agence de moyens, le Chantier arctique et les instituts et organismes de financement de la recherche, afin que les chercheurs n’aient pas à remplir des dossiers différents, d’une part pour que leur projet soit validé dans son principe, d’autre part pour obtenir l’appui de l’IPEV pour mener à bien sa mise en œuvre sur le terrain ;
– l’accent à mettre sur la coopération internationale permettant d’assurer au mieux le monitoring de l’Arctique ;
– le lancement éventuel d’une « zone-atelier » sur l’Arctique, comme il en existe pour l’Antarctique et le Subantarctique, en vue de fédérer les projets de recherche.
La « zone atelier Antarctique et Subantarctique »
Les « zones ateliers » forment un réseau inter-organismes de recherches interdisciplinaires sur l’environnement et les anthroposystèmes en relation avec les questions sociétales d’intérêt national. Elles sont à la fois le lieu pour des actions de recherche et pour des actions de communication des résultats.
La zone atelier Antarctique et Subantarctique, créée en 2000, fédère des recherches à moyen et long termes sur les modifications de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes antarctiques et subantarctiques sous la double influence des activités de l’homme (introductions d’espèces, pêcheries...) et des changements actuels du climat, ces deux facteurs se trouvant souvent en interaction.
Dans une contribution écrite adressée à la mission, le WWF met en avant un outil scientifique qu’il a développé sous l’acronyme RACER, pour Rapid Assessment of Circum-Arctic Resilience. Cet outil vise à identifier et cartographier les zones importantes de conservation en prenant en compte leur capacité de résilience face au changement climatique – par exemple, on prévoit que c’est dans l’Arctique canadien et les zones au nord-ouest du Groenland que la banquise devrait se maintenir le plus longtemps face au réchauffement, donc que les espèces dont la survie dépend de son existence, comme l’ours blanc, ont le plus de chances de se maintenir. Cette méthode cherche donc à anticiper les capacités des écosystèmes à s’adapter dans l’avenir au changement climatique plutôt que d’uniquement se concentrer sur ce qui est actuellement vulnérable.
L’ONG recommande d’utiliser cet outil pour créer un réseau pan-arctique d’aires protégées prioritaires conçu de manière à ce qu’il permette de répondre au changement en cours : il s’agirait de choisir ces aires non en raison de leur vulnérabilité actuelle, mais de ce que l’on peut anticiper pour protéger les éléments qui sont essentiels pour la résilience de la biodiversité de l’Arctique et pour celle des peuples de l’Arctique.
Enfin, la dimension de présence institutionnelle est importante. Il faut sans doute, au ministère des affaires étrangères, parvenir à dégager une poignée d’emplois pour notre « diplomatie arctique », en cohérence avec la priorité qui doit lui être donnée. Le même type de recommandations vaut dans le champ stratégico-militaire : il faut se donner les moyens de participer aux exercices organisés dans l’Arctique et aux réunions des forums régionaux concernant les questions sécuritaires. Plus globalement, il faut peut-être se poser la question de la cohérence de notre « politique arctique » dispersée entre divers administrations et organismes.
Proposition n° 6 : remettre à niveau notre présence scientifique en Arctique à l’aide de moyens supplémentaires (modestes) et grâce à une meilleure structuration, comprenant notamment :
– le lancement d’appels à projets par le Chantier arctique, qui doit disposer de moyens propres si son rôle est bien de structurer à moyen terme la recherche arctique française (sans évidemment remettre en cause les collaborations internationales et européennes, particulièrement développées et utiles) ;
– le lancement éventuel d’une « zone-atelier » sur l’Arctique, comme il en existe sur l’Antarctique et le Subantarctique, pour fédérer les projets de recherche ;
– une réflexion sur l’articulation des différents acteurs, notamment l’IPEV, agence de moyens, le Chantier arctique et les instituts et organismes de financement de la recherche ;
– un accent sur la dimension « sciences humaines » de cette recherche, un peu délaissée (ou peu visible car très dispersée) dans la période la plus récente ;
– un accent sur la coopération internationale permettant d’assurer au mieux le monitoring de l’Arctique.
Proposition n° 7 : utiliser des outils tels que le dispositif RACER pour anticiper l’évolution prévisible de l’Arctique et identifier les zones de résilience où l’environnement sera mieux conservé, de sorte de développer un réseau d’aires protégées non seulement en fonction des vulnérabilités actuelles, mais surtout de ces prévisions.
*
Proposition n° 8 : disposer des moyens permettant une représentation systématique de la France dans les réunions des divers instances et forums arctiques, ainsi qu’une présence navale militaire.
3. Inscrire la question du changement climatique en Arctique au cœur de la Conférence Paris-climat 2015
Dans la mesure où le réchauffement climatique apparaît dans l’ensemble de l’Arctique et une partie de l’Antarctique deux, voire trois fois plus fort qu’en moyenne mondiale, on imagine ce qu’y sera la situation si se réalisait le scénario pessimiste du GIEC : un réchauffement planétaire moyen de 5 ou 6 °C d’ici la fin du siècle en cours si nous ne parvenons pas globalement à maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre. Les milieux polaires seraient complétement bouleversés et il est probable que la plupart des espèces vivantes spécialement adaptées à ces milieux disparaîtraient au profit d’espèces venues des régions tempérées actuelles. Pour les régions polaires, l’impératif premier est bien la maîtrise du changement climatique global et c’est pourquoi il est juste de dire qu’une réussite de la Conférence Paris-climat 2015 serait un événement absolument majeur pour les régions polaires, en particulier arctiques.
Même si cette insertion d’un sujet régional est délicate, l’Arctique doit être au cœur des travaux de la Conférence Paris-climat 2015, car c’est un thème très mobilisateur. On pourrait en faire un programme de travail transversal de la Conférence.
Proposition n° 9 : faire de l’Arctique un thème majeur de mobilisation pour la Conférence Paris-climat 2015, par exemple en en faisant un programme de travail transversal de celle-ci.
4. Trouver les moyens d’une meilleure protection de l’Arctique
Au-delà de l’enjeu climatique global, l’Arctique doit être protégé des appétits économiques que le réchauffement déjà acquis, quel que soit l’avenir, réveille : nouvelles routes maritimes, pêcheries, hydrocarbures… Or, on peut douter, on l’a vu, que la coopération intergouvernementale établie dans le cadre du Conseil arctique et l’application du droit international de la mer suffisent à répondre à ce défi.
a. Le Traité sur l’Antarctique, modèle impossible à transposer ?
Dans sa résolution du 9 octobre 2008, le Parlement européen avait appelé à transposer à l’Arctique le modèle de l’Antarctique, lequel repose sur des instruments juridiques internationaux qui engagent tous les grands pays et a un contenu très exigeant : démilitarisation, interdiction des activités minières, priorité à la science, obligations générales de concertation entre les nations, de transparence des activités et de partage des résultats de recherche…
Pour des raisons politiques, tenant à la géographie de l’Arctique, dont les côtes appartiennent à des États solides, parfois très puissants et en tout état de cause attachés à l’exercice de leur souveraineté, une option de ce type apparaît malheureusement impossible. Il faut donc proposer une alternative.
b. Soutenir la démarche pragmatique de l’Union européenne : la reconnaissance du rôle primordial du Conseil arctique doit s’accompagner d’un haut niveau d’exigence sur le contenu des politiques
Après les réactions suscitées dans les États arctiques par la résolution de 2008 du Parlement européen, l’Union européenne s’est engagée dans un ajustement de son positionnement, dont la publication prochaine d’une stratégie arctique européenne devrait marquer l’achèvement.
Deux textes récents rendent compte de ce nouveau positionnement :
– les conclusions adoptées le 12 mai 2014 par le Conseil européen sur le développement d’une politique arctique de l’Union reconnaissent formellement le Conseil arctique comme la principale institution pour la coopération régionale circumpolaire, ce qui représente un abandon de fait de l’idée d’un traité international ouvert à tous ;
– la nouvelle résolution du Parlement européen sur l’Arctique, en date du 12 mars 2014, évite de revenir sur la question conflictuelle de la gouvernance. Mais elle pose en détail les fondements d’une politique protectrice et exigeante pour l’Arctique. Par exemple, elle met l’accent sur les risques d’accidents écologiques, en demandant notamment à ce que la capacité financière des exploitants d’hydrocarbures à assumer les dommages éventuels soit dûment vérifiée. Elle prend également acte du fait que « seuls 20 % des réserves mondiales de combustibles fossiles peuvent être exploitées d’ici à 2050 afin de maintenir l’augmentation de la température moyenne en dessous de deux degrés Celsius ».
Votre rapporteur considère que l’on a là les bases d’une démarche à la fois réaliste et exigeante qu’il faut soutenir et amplifier. La France s’honorerait en inscrivant dans sa Feuille de route nationale pour l’Arctique (et en s’efforçant d’inscrire dans la future stratégie européenne) :
– la nécessité de renoncer à l’exploitation de la plus grande part des réserves restantes de combustibles fossiles pour maîtriser les émissions des gaz à effet de serre ;
– la proposition en conséquence, vu les risques particuliers de cette exploitation, de renoncer définitivement à l’exploitation pétrolière et gazière dans l’océan Arctique ;
– à défaut, l’exigence d’une responsabilité environnementale totale des exploitants, qui devraient être contraints préalablement à tout projet de donner toutes garanties quant à leur capacité de traiter techniquement un éventuel accident et quant à leur capacité financière d’en compenser les dommages.
Proposition n° 10 : inscrire explicitement dans les stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne :
– la nécessité de renoncer à l’exploitation de la plus grande part des réserves restantes de combustibles fossiles pour maîtriser les émissions des gaz à effet de serre ;
– la proposition en conséquence, vu les risques particuliers de cette exploitation, de renoncer définitivement à l’exploitation pétrolière et gazière dans l’océan Arctique ;
– à défaut, l’exigence d’une responsabilité environnementale totale des exploitants, qui devraient être contraints préalablement à tout projet de donner toutes garanties quant à leur capacité de traiter techniquement un éventuel accident et quant à leur capacité financière d’en compenser les dommages.
c. Encourager les États arctiques à cogérer et protéger de l’exploitation économique la partie centrale de l’océan Arctique
Si l’idée de gouvernance internationale doit être abandonnée, il convient aussi de mettre les États côtiers de l’océan Arctique devant leurs responsabilités, puisqu’ils les revendiquent de manière exclusive.
Certains de ces États manifestent, au moins aujourd’hui, outre un engagement plus net pour l’environnement, une plus grande ouverture aux démarches coopératives, par exemple la Norvège et les États-Unis. Quelques initiatives communes très intéressantes ont été prises, comme l’annonce, suite à la réunion à Washington en 2013 des cinq États côtiers de l’océan Arctique, de possibles mesures de restriction de la pêche dans la partie centrale de cet océan (au-delà des zones économiques exclusives). Les démarches de ce type méritent d’être mises en valeur et encouragées, dans le respect naturellement des prérogatives des États concernés – mais en rappelant aussi que de telles démarches n’ont ensuite d’avenir que si l’ensemble des États potentiellement intéressés à la zone concernée (qu’il s’agisse de la protéger ou d’en exploiter les ressources) peuvent y prendre part (et sont donc engagés).
De la même façon, s’agissant des ressources du sous-sol, on observe que plusieurs des États côtiers ont déposé ou annoncé des demandes d’extension de leurs droits économiques, au titre du plateau continental, sur de larges fractions de la partie centrale de l’océan Arctique. Ces demandes se chevauchent et sont donc contradictoires. Pour cette raison, il est peu probable que la commission compétente des Nations-Unies rende rapidement des recommandations sur le partage du plateau continental dans la zone. De plus, les experts considèrent que les enjeux économiques réels de ces revendications sont faibles : la plupart des réserves probables d’hydrocarbures de l’Arctique sont concentrées dans les eaux plus proches des côtes (zones économiques exclusives des 200 milles marins) ; les profondeurs sont généralement très importantes dans la zone centrale (plusieurs milliers de mètres) ; enfin, on est dans une zone qui, pour un certain temps encore, reste couverte en permanence par la banquise. Dans ces conditions, est-il exclu d’imaginer l’établissement pour la région centrale de l’océan Arctique d’un régime de cogestion par les États côtiers, qui accepteraient un gel de fait de leurs revendications assorti d’un moratoire sur l’exploitation des ressources du sous-sol ?
Proposition n° 11 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, encourager les États arctiques à cogérer et protéger de l’exploitation économique la partie centrale de l’océan Arctique en :
– soutenant leur démarche engagée pour établir une réglementation – et si possible un moratoire – concernant la pêche dans la zone centrale au-delà des zones économiques exclusives, tout en rappelant que l’ensemble des États intéressés devraient ensuite pouvoir y être associés ;
– les invitant à rechercher une solution négociée à leurs revendications contradictoires de plateau continental dans cette zone centrale, qui pourrait reposer sur un régime de cogestion par consensus avec un moratoire sur l’exploitation des ressources minérales (dont la faisabilité technique et économique est de toute façon peu vraisemblable).
d. Mettre le droit international, notamment celui de la mer, au service de la protection de l’Arctique et expertiser la possibilité de lui conférer la qualité de patrimoine naturel mondial ou de bien public mondial
Un dernier champ à investiguer quant aux possibilités de faire progresser la protection de l’Arctique est celui des instruments juridiques internationaux, qu’il s’agisse du droit de la mer, d’autres instruments, voire de concepts innovants à mettre en place. Toutes les pistes méritent d’être explorées et, si elles s’avèrent prometteuses, soutenues : les différentes suggestions faites infra ne sont pas nécessairement toutes compatibles entre elles mais doivent être vues comme un ensemble de possibilités d’avancer qui s’offrent à nous.
i. La possibilité d’étendre en Arctique la juridiction des organisations régionales existantes ?
On l’a dit, l’Arctique, espace marin, est principalement régi par le droit international de la mer. Ce dernier a de nombreuses limites que le présent rapport rappelle, mais il faut aussi reconnaître que c’est dans ce cadre qu’un certain nombre de mesures utiles ont déjà été prises ou sont en train de l’être, si l’on pense au Code polaire en cours d’adoption pour la navigation dans les eaux polaires. Le droit de la mer, qu’il s’agisse des instruments à vocation mondiale ou à vocation régionale, peut et doit donc être mobilisé au bénéfice de la protection de l’Arctique.
Au niveau régional, on a vu que des accords portant sur des éléments de la gestion des espaces maritimes couvrent une partie, mais une partie seulement, des eaux arctiques : il s’agit notamment de la convention OSPAR – dont le champ d’application va jusqu’au pôle Nord, mais ne couvre qu’une partie de l’océan Arctique, États-Unis, Canada et Russie n’en étant pas membres – ou encore des organisations régionales de pêche telles que la Commission des pêches de l’Atlantique du nord-est et l’Organisation des pêches de l’Atlantique du nord-ouest.
Une première piste, finalement assez simple, qui pourrait être explorée serait celle des possibilités d’obtenir l’adhésion à ce type d’instruments régionaux de ceux des États arctiques qui n’en sont pas encore membres : si tous ces États faisaient cette démarche, l’océan Arctique pourrait ainsi bénéficier globalement de règles de gestion et de protection.
En tout état de cause, il faut naturellement soutenir la démarche en cours de discussion dans le cadre du dispositif OSPAR qui vise à instituer une aire marine protégée dans les eaux de haute mer situées à l’extrême nord du champ couvert par cette convention, c’est-à-dire un secteur de la banquise atteignant le pôle Nord.
Proposition n° 12 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, soutenir l’établissement d’une aire marine protégée dans les eaux internationales proches du pôle Nord qui appartiennent au champ géographique de la convention OSPAR.
*
Proposition n° 13 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, encourager les États arctiques qui n’en sont pas encore membres à rallier les organisations régionales de protection de l’environnement ou de gestion de la pêche : convention OSPAR, Commission des pêches de l’Atlantique du nord-est et Organisation des pêches de l’Atlantique du nord-ouest.
ii. La perspective de la négociation sur le statut de la haute mer dans le cadre de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer
Un autre événement récent ouvre des perspectives nouvelles : il vient d’être décidé, dans le cadre onusien, le lancement de négociations pour faire évoluer le statut de la « haute mer » (au-delà des zones économiques exclusives), actuellement peu réglementé, alors que l’on constate à la fois le développement constant des appétits économiques (pêche hauturière et velléités d’exploiter les ressources des fonds marins au-delà des régions côtières) et l’apparition de nouveaux enjeux, comme celui du partage des bénéfices tirés de l’échantillonnage et potentiellement de l’exploitation économique de la biodiversité marine. Des mesures aussi nécessaires que l’établissement d’aires marines protégées manquent donc, en haute mer, d’une base juridique solide permettant d’en imposer le respect à tous.
Cette nouvelle négociation n’a pas encore commencé et le caractère laborieux de la négociation préalable sur le principe même de la négociation (voir l’encadré ci-après) fait douter de son débouché. Mais il est toutefois important de la soutenir, car, si elle réussissait, le statut plus protecteur qu’elle instituerait pour la haute mer s’appliquerait de facto à la partie centrale de l’océan Arctique, avec l’avantage d’une portée universelle.
La relance laborieuse des négociations sur le statut de la haute mer
Depuis l’adoption de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer (CNUDM), dite de Montego Bay, en 1982, les activités humaines dans les zones situées au-delà des juridictions nationales se sont considérablement développées : essor du transport maritime, augmentation des capacités de pêche hauturière, début d’exploration des ressources minérales des grands fonds marins, développement des biotechnologies et des activités de bio-prospection, etc.
Ces pressions anthropiques croissantes affectent des milieux marins. Or, le système de gouvernance de la haute mer tel que prévu notamment dans la convention de Montego Bay est lacunaire. En particulier, il ne permet pas de créer en haute mer des aires marines protégées (ce qui implique des moyens de surveillance et une base juridique universellement opposable pour sanctionner les contrevenants). Il ne traite pas non plus du statut juridique des ressources génétiques marines que la bio-prospection commence à rechercher (sont-elles la propriété intellectuelle du prospecteur qui les a identifiées ? ou de la communauté des hommes, puisqu’elles ont été trouvées dans des eaux internationales ?). Enfin, dans l’hypothèse d’une exploitation minière des fonds marins, il n’existe pas de procédures internationales destinées à protéger l’environnement (étude d’impact préalable, éventuel régime d’autorisation…).
Dans sa résolution 59/24 du 17 novembre 2004, l’Assemblée générale des Nations-Unies a décidé de créer un groupe de travail spécial chargé « d’étudier les questions relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale ». Ce groupe a commencé ses travaux en 2006. En 2011, l’Union européenne, la Chine et le « Groupe des 77 » (réunissant les pays en développement) se sont accordés pour promouvoir une négociation globale qui traiterait notamment des aires marines protégées, de l’évaluation de l’impact des activités sur l’environnement, du partage des bénéfices des ressources génétiques marines et du renforcement des capacités des pays en développement grâce à des transferts technologiques. Cette initiative s’est toutefois heurtée à une coalition de pays soucieux de leurs intérêts dans la pêche hauturière et/ou de la valorisation économique des découvertes scientifiques en matière de biodiversité marine : plusieurs États asiatiques et, il faut bien le dire, la majorité des membres du Conseil arctique (États-Unis, Russie, Canada, Islande, Norvège…). Mais la pression a été mise au niveau international lors de la Conférence des Nations-Unies sur le développement durable de 2012 (Rio+20), où, faute de consensus sur le fond, un accord été trouvé sur une date butoir (août 2015) à laquelle l’Assemblée générale des Nations-Unies devrait prendre une décision sur l’élaboration d’un instrument d’application de la CNUDM concernant la conservation et de l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les zones qui ne relèvent pas des juridictions nationales.
Finalement, en janvier 2015, l’opposition frontale des quelques grands pays qui continuaient à refuser l’idée de négocier sur le statut de la haute mer a été levée. Le groupe de travail ad hoc a donc décidé, après quand même près de neuf ans de négociations onusiennes sur le principe même de cette négociation, de la lancer ; on peut supposer que l’Assemblée générale confirmera cette décision. On l’a compris, ce n’est qu’une première phase : il reste à négocier le fond et à aboutir éventuellement à un accord ; aucune échéance n’est fixée…
*
Proposition n° 14 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, soutenir activement les futures négociations à l’ONU pour soumettre la haute mer à un statut de responsabilité internationale commune plutôt qu’à la situation actuelle de quasi-liberté d’exploitation (adoption d’un nouveau protocole d’application de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer).
iii. Les opportunités offertes par la Convention sur la diversité biologique
La Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio-Janeiro en 1992 est un autre texte qui a l’avantage d’une portée quasi-universelle vu le nombre de ses signataires.
Bien que ce texte n’ait pas vocation à l’origine à s’appliquer hors des juridictions nationales, donc notamment à la « haute mer », la 10ème Conférence des parties, réunie à Nagoya en octobre 2010, a adopté un protocole qui comprend notamment un plan stratégique dont l’un des objectifs, à l’horizon 2020, est de développer un réseau d’aires marines protégées couvrant au moins 10 % de la superficie des océans, sans distinguer les eaux sous juridiction nationale des autres.
De fait, il s’agit donc d’un instrument que la communauté internationale semble prête à appliquer à des espaces extranationaux, même si, il faut le reconnaître, on ne constate jusqu’à présent aucune mise en œuvre pratique.
iv. La possibilité de mobiliser le dispositif du « patrimoine mondial » de l’Unesco
Un autre texte international peut-être plus opérationnel, puisque depuis longtemps en vigueur et mis en œuvre, est la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée le 16 novembre 1972.
Cet accord bien connu, qui est à l’origine du fameux « classement Unesco », a pour caractéristique la plus originale de réunir dans un même instrument les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels. Il apparaît potentiellement parfaitement applicable aux régions polaires. En effet, son article 2 prévoit notamment la protection des « formations géologiques et physiographiques (…) constituant l’habitat d’espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation » ou encore des « sites naturels ou (…) zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle », toutes définitions susceptibles de s’appliquer en Arctique ou en Antarctique.
De fait, si l’on pense à l’Arctique, espace maritime, il faut savoir que le patrimoine marin est, de par le monde, déjà largement protégé à travers le dispositif Unesco, avec 46 sites marins concernés dans 35 pays, qui représenteraient 20 % du total des aires marines protégées dans le cadre des différents dispositifs existants.
Il existe toutefois une difficulté à la mise en œuvre de ce dispositif pour les espaces polaires, en particulier arctiques, dont la plupart ne relèvent pas des souverainetés nationales : c’est aux États qu’il appartient, selon l’article 3 de la convention, de délimiter et proposer à la protection les sites susceptibles d’être inscrits au patrimoine mondial. Corrélativement, la convention exige, à son article 5, la mise en place par les États de dispositifs de gestion et de protection des sites localisés sur leur territoire. L’extension du dispositif Unesco à des espaces extranationaux, notamment de « haute mer », impliquerait donc de développer les moyens institutionnels d’identifier, proposer et ensuite gérer et protéger les sites du patrimoine mondial qui y seraient reconnus – cette tache pourrait par exemple revenir à des organisations régionales.
Une réflexion interne à l’Unesco a été engagée suite à l’adoption, dans le cadre de l’« Évaluation de la stratégie globale de la liste du patrimoine mondial » de 2011, d’une recommandation visant à « réfléchir aux moyens appropriés pour préserver les sites ne relevant pas de la souveraineté des États parties qui répondent aux conditions de valeur universelle exceptionnelle ». En principe les résultats de ce travail devraient être publiés d’ici mi-2016.
Proposition n° 15 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, mobiliser si possible des instruments internationaux tels que la Convention sur la diversité biologique et la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de l’Unesco pour protéger des espaces marins au-delà des juridictions nationales, notamment en Arctique.
v. La notion de « bien public mondial »
Enfin, plus généralement, le débat sur le statut de la haute mer peut en rejoindre un autre, celui sur le concept de « bien public mondial ». C’est ce qui ressort notamment des travaux effectués en France dans le cadre du « Grenelle de la mer ». Un rapport (55) produit à ce titre invite la France à se fixer « pour objectif d’assurer en haute mer la prise en compte renforcée des problématiques liées à la sécurité maritime et une meilleure protection de la biodiversité » et même « promouvoir l’idée de faire de la haute mer un bien public mondial ».
Même si le caractère opératoire de la notion de bien public mondial est largement discuté, ce concept, qui pourrait être appliqué à la haute mer en général ou plus particulièrement à l’Arctique, n’a pas seulement pour objet de mobiliser la communauté internationale et les opinions : de même que le concept de « bien public » dans la sphère classique des États-nations, il sert à fonder en légitimité – donc peut-être demain en droit – le principe d’une gouvernance contraignante (fondée sur des réglementations opposables à tous et l’obligation de contributions).
La notion de bien public mondial
Un « bien public », pour les économistes, est un bien (ou service) dont l’utilisation est non-rivale et non-exclusive : la non-rivalité signifie que la consommation par un agent économique de ce bien ou service ne se fait pas en rivalité avec les autres agents, car elle n’en réduit pas la quantité disponible pour les autres ; la non-exclusivité signifie simplement que tout le monde peut accéder à ce bien ou service.
Les fonctions régaliennes classiques des États sont des exemples de biens publics : le fait que l’État assure par sa diplomatie, son armée, sa police, etc., la sécurité extérieure et intérieure constitue une prestation qui ne peut être quantifiée au niveau de chaque citoyen (à la différence par exemple d’une prestation sociale, pour laquelle le critère de non-rivalité n’est pas assuré, car son coût est identifiable par bénéficiaire et il y a des contraintes budgétaires qui font que l’attribution de prestations à certains oblige de fait à priver d’autres catégories de ces prestations) et qui en principe profite sans exclusivité à tous les résidents ou nationaux de cet État.
On voit bien que, par nature, les biens publics ne peuvent pas être vendus individuellement aux consommateurs, puisqu’ils doivent profiter à tous, même ceux qui n’auraient pas les moyens de payer, et qu’il est plus difficile, même si ce n’est pas impossible, de faire fonctionner le « marché » susceptible de fixer le prix de biens sur lesquels il n’y a pas de rivalité entre acheteurs. Les biens publics sont donc produits gratuitement par la puissance publique, qui a le privilège de se financer autrement que par la vente de biens ou de services : par l’impôt.
Un bien public peut être qualifié de « mondial » ou « global » s’il concerne de la même façon, non-exclusive et non-rivale, tous les hommes et tous les peuples. Sa reconnaissance implique que la communauté internationale parvienne à trouver globalement des moyens de le « produire » grâce aux outils classiques de la puissance publique : règles contraignantes s’appliquant à tous et financement par des contributions qui ne sont pas directement liées à la mise à disposition de ce bien. Ce qui justifie la mobilisation de tous pour un bien public mondial, c’est bien sûr le fait que c’est au niveau global qu’il peut être le mieux assuré et que son caractère universel implique que les contraintes et les contributions qui permettent de le produire soient partagées entre tous.
La préservation d’un environnement planétaire évitant un cataclysme climatique général, grâce à la maîtrise du réchauffement climatique, est sans doute le type même du bien public mondial, mais on peut aussi en imaginer dans d’autres domaines, par exemple le maintien international de la paix, ou, si l’on adhère globalement à l’idée de marché mondialisé, le maintien d’un système commercial mondial ouvert…
*
Proposition n° 16 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, expertiser la possibilité de conférer soit à la haute mer en général, soit à l’Arctique en particulier, la qualité de bien public mondial.
Proposition n° 1 : face aux velléités de certains États de remettre en cause le statut de l’Antarctique, en particulier la prohibition des activités minières, mobiliser l’opinion publique. La consécration de l’Antarctique comme bien public mondial ou patrimoine commun de l’humanité serait l’occasion d’une telle mobilisation.
*
Proposition n° 2 : soutenir activement la démarche de création d’aires marines protégées dans l’océan Austral.
*
Proposition n° 3 : préserver les nécessaires outils de présence et de souveraineté de la France dans les mers australes, en assurant au mieux le remplacement des quatre navires de ravitaillement ou de patrouille qui vont devoir être désarmés très prochainement.
*
Proposition n° 4 : prendre une position de principe de renoncement à l’exploitation des hydrocarbures dans les eaux territoriales et la zone économique exclusive des îles Éparses du canal du Mozambique.
*
Proposition n° 5 : rendre rapidement publique notre Feuille de route nationale pour l’Arctique et y inscrire une priorité absolue à la protection de l’environnement naturel arctique sur l’exploitation économique.
*
Proposition n° 6 : remettre à niveau notre présence scientifique en Arctique à l’aide de moyens supplémentaires (modestes) et grâce à une meilleure structuration, comprenant notamment :
– le lancement d’appels à projets par le Chantier arctique, qui doit disposer de moyens propres si son rôle est bien de structurer à moyen terme la recherche arctique française (sans évidemment remettre en cause les collaborations internationales et européennes, particulièrement développées et utiles) ;
– le lancement éventuel d’une « zone-atelier » sur l’Arctique, comme il en existe sur l’Antarctique et le Subantarctique, pour fédérer les projets de recherche ;
– une réflexion sur l’articulation des différents acteurs, notamment l’IPEV, agence de moyens, le Chantier arctique et les instituts et organismes de financement de la recherche ;
– un accent sur la dimension « sciences humaines » de cette recherche, un peu délaissée (ou peu visible car très dispersée) dans la période la plus récente ;
– un accent sur la coopération internationale permettant d’assurer au mieux le monitoring de l’Arctique.
*
Proposition n° 7 : utiliser des outils tels que le dispositif RACER pour anticiper l’évolution prévisible de l’Arctique et identifier les zones de résilience où l’environnement sera mieux conservé, de sorte de développer un réseau d’aires protégées non seulement en fonction des vulnérabilités actuelles, mais surtout de ces prévisions.
*
Proposition n° 8 : disposer des moyens permettant une représentation systématique de la France dans les réunions des divers instances et forums arctiques, ainsi qu’une présence navale militaire.
*
Proposition n° 9 : faire de l’Arctique un thème majeur de mobilisation pour la Conférence Paris-climat 2015, par exemple en en faisant un programme de travail transversal de celle-ci.
*
Proposition n° 10 : inscrire explicitement dans les stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne :
– la nécessité de renoncer à l’exploitation de la plus grande part des réserves restantes de combustibles fossiles pour maîtriser les émissions des gaz à effet de serre ;
– la proposition en conséquence, vu les risques particuliers de cette exploitation, de renoncer définitivement à l’exploitation pétrolière et gazière dans l’océan Arctique ;
– à défaut, l’exigence d’une responsabilité environnementale totale des exploitants, qui devraient être contraints préalablement à tout projet de donner toutes garanties quant à leur capacité de traiter techniquement un éventuel accident et quant à leur capacité financière d’en compenser les dommages.
*
Proposition n° 11 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, encourager les États arctiques à cogérer et protéger de l’exploitation économique la partie centrale de l’océan Arctique en :
– soutenant leur démarche engagée pour établir une réglementation – et si possible un moratoire – concernant la pêche dans la zone centrale au-delà des zones économiques exclusives, tout en rappelant que l’ensemble des États intéressés devraient ensuite pouvoir y être associés ;
– les invitant à rechercher une solution négociée à leurs revendications contradictoires de plateau continental dans cette zone centrale, qui pourrait reposer sur un régime de cogestion par consensus avec un moratoire sur l’exploitation des ressources minérales (dont la faisabilité technique et économique est de toute façon peu vraisemblable).
*
Proposition n° 12 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, soutenir l’établissement d’une aire marine protégée dans les eaux internationales proches du pôle Nord qui appartiennent au champ géographique de la convention OSPAR.
*
Proposition n° 13 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, encourager les États arctiques qui n’en sont pas encore membres à rallier les organisations régionales de protection de l’environnement ou de gestion de la pêche : convention OSPAR, Commission des pêches de l’Atlantique du nord-est et Organisation des pêches de l’Atlantique du nord-ouest.
*
Proposition n° 14 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, soutenir activement les futures négociations à l’ONU pour soumettre la haute mer à un statut de responsabilité internationale commune plutôt qu’à la situation actuelle de quasi-liberté d’exploitation (adoption d’un nouveau protocole d’application de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer).
*
Proposition n° 15 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, mobiliser si possible des instruments internationaux tels que la Convention sur la diversité biologique et la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de l’Unesco pour protéger des espaces marins au-delà des juridictions nationales, notamment en Arctique.
*
Proposition n° 16 : dans le cadre des stratégies arctiques à venir de la France et de l’Union européenne, expertiser la possibilité de conférer soit à la haute mer en général, soit à l’Arctique en particulier, la qualité de bien public mondial.
La commission des affaires étrangères a examiné le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 8 avril 2015.
M. Michel Vauzelle, vice-président. Mme Élisabeth Guigou m’a prié d’excuser son absence à cette réunion. Elle participe en ce moment même à un entretien entre le Président de l’Assemblée nationale et le Président de la République tunisienne, M. Essebsi. Elle m’a donc demandé de la suppléer, pensant sans doute qu’un méditerranéen était le mieux à même de se pencher sur les pôles.
Par ailleurs, nous accueillons des magistrats de la Cour des comptes qui ont souhaité assister à une réunion de notre commission dans le cadre d’un stage qu’ils effectuent à l’Assemblée nationale. Je profite de cette occasion pour vous indiquer que je viens d’écrire au Premier président de cette institution à propos de la coopération décentralisée, car les régions sont à cet égard dans une situation contradictoire. D’un côté, alors que les crédits nationaux de coopération baissent, on voudrait qu’elles fassent plus. De l’autre, leurs propres moyens sont également réduits et elles se heurtent souvent aux observations des chambres régionales des comptes, pour qui il semble que la Corrèze doive passer avant le Zambèze.
M. Hervé Gaymard, président de la mission d’information. Notre mission avait pour objectif de faire le point sur les deux pôles, qui sont en quelque sorte les miroirs réfléchissants de notre monde. Nous nous sommes centrés sur trois problématiques.
D’abord, l’évolution du climat. Ce qui se passe en Arctique est très symptomatique de l’évolution du monde depuis un demi-siècle, tandis qu’en Antarctique, nous n’en sommes encore qu’aux prodromes du réchauffement. L’importance de cet enjeu climatique fait que la conférence qui se tiendra en décembre prochain à Paris sera stratégique ; parmi toutes les conférences qui se sont tenues, ce sera sans doute l’évènement le plus important pour l’avenir de l’Arctique.
Ensuite, ce qu’on peut appeler les nouvelles frontières. Les hommes ont toujours besoin d’un Far West et l’Arctique, surtout, fait fantasmer, avec ses ressources naturelles, en particulier les hydrocarbures, et la question des passages : nous connaissions depuis longtemps le passage du Nord-Ouest et maintenant celui du Nord-Est suscite l’engouement, même s’il faut relativiser celui-ci.
Enfin, les aspects géostratégiques. L’Arctique était une région exposée pendant la Guerre froide ; les prologues de plusieurs films de James Bond nous montrent des occidentaux affrontant en Arctique des membres du KGB. Aujourd’hui encore, l’Arctique n’a pas de statut international. Au sud, la situation est différente, avec le Traité sur l’Antarctique de 1959, mais ce texte est structurellement fragile. De nouvelles puissances, comme la Chine, pourraient être tentées de s’affranchir des règles internationales.
La France a des intérêts historiques et majeurs dans les régions polaires. En Arctique, nous avons toujours eu une recherche très active, avec des personnalités comme Charcot, Paul-Émile Victor et Jean Malaurie. Nous devons aussi à l’histoire de posséder encore au Svalbard, dans le Kongsfjord, une station scientifique qui est une sorte d’enclave française dans ce territoire au statut international très particulier. Dans la zone subantarctique, nous sommes une puissance riveraine, avec nos possessions insulaires des Kerguelen, de Crozet, de Saint-Paul et d’Amsterdam, qui appartiennent à la France depuis le XVIIIème ou le XIXème siècles selon les cas. Pour cette raison, la France est le premier pays pour le nombre de publications scientifiques concernant le Subantarctique. Dans l’Antarctique enfin, la situation est différente, car il y a le statut international dont la France est partie prenante. Nous entretenons des équipes de chercheurs dans notre base Dumont d’Urville, en terre Adélie, et, en partenariat avec l’Italie, à la station Concordia, située dans le secteur australien.
M. Noël Mamère, rapporteur. Il y a effectivement de grandes différences entre l’Arctique et l’Antarctique.
Elles sont d’abord géographiques, l’un étant une mer glacée, l’autre un continent. Les conséquences du réchauffement climatique n’y sont donc pas les mêmes.
Les différences sont aussi politiques. L’Antarctique est pour le moment sanctuarisé, grâce au traité de 1959 complété par d’autres textes, notamment le Protocole de Madrid de 1991, lequel dédie l’Antarctique à la science et interdit l’exploitation minière. Cela dit, ce dispositif va arriver à échéance en 2048 et il y a déjà des craintes qu’il ne soit remis en cause par des pays. La Chine a été citée, mais on doit aussi évoquer la Russie, qui a indiqué en 2011 qu’elle envisageait une exploitation minière. Il y a aussi la menace représentée par le développement du tourisme, avec aujourd’hui 50 000 visiteurs par an – le même constat vaut d’ailleurs pour l’Arctique, où le tourisme est encore beaucoup plus développé. Bref, bien des revendications pourraient s’exprimer en 2048 et remettre en cause l’avenir du continent.
La France est très présente en Antarctique, avec en particulier la station Concordia que nous partageons avec l’Italie. Cette station est située à plus de 3 000 mètres d’altitude, ce qui ajoute encore à la dureté des conditions. Il s’agit d’endroits où l’on peut avoir 90 degrés au-dessous de zéro !
L’une de nos recommandations, concernant le Subantarctique, est de veiller à maintenir les outils que nous avons sur place, malgré les restrictions budgétaires. Il y a notamment plusieurs navires qui doivent être renouvelés pour assurer la continuité de notre présence. Nous n’avons qu’un navire adapté à la navigation dans les eaux englacées, alors que d’autres pays sont très bien dotés en brise-glaces, je pense notamment à la Russie.
Le caractère océanique de l’Arctique fait que les conséquences du réchauffement climatique n’y sont pas les mêmes. Cette année, nous avons atteint la plus petite limite de banquise. La fonte de la banquise est très rapide et elle pourrait disparaître, en été, d’ici vingt ou trente ans. Tout cela attire des prédateurs, à la recherche d’hydrocarbures, de minerais rares ou de nouvelles routes maritimes faisant économiser plusieurs milliers de kilomètres, lesquelles suscitent beaucoup d’intérêt en Chine. L’Arctique est le meilleur témoin du réchauffement climatique, qui y est beaucoup plus fort. Le risque pour les décennies à venir, c’est de prendre dix degrés en plus, soit la différence de température moyenne entre Naples et Stockholm. Vous imaginez les changements que cela peut induire !
Étant plus proche des grands pays industriels, l’Arctique est également plus touché par la pollution.
Face aux fortes pressions pour exploiter l’Arctique, la meilleure protection serait un statut équivalent à celui de l’Antarctique. Mais l’Arctique est une mer entourée par des terres qui appartiennent aux États-Unis, au Canada, au Danemark, à la Norvège et à la Russie. Le droit de la mer s’y applique, c’est-à-dire la convention de Montego Bay, donc la liberté de naviguer et même, souvent, de pêcher ce que l’on veut. Il y a aujourd’hui une forte extension de la pêche qui menace de nombreuses espèces.
Quant aux pays riverains, ils n’ont mis en place qu’une gouvernance assez faible : les pays arctiques forment le Conseil arctique, qui comprend aussi douze États observateurs, dont la Chine, ainsi que des représentants d’ONG et des peuples locaux. Car c’est un autre point à souligner : alors que l’Antarctique est inhabité, l’Arctique est peuplé, avec 4 millions d’habitants. Du moins l’est-il pour partie, car il n’y a pas « un » Arctique, mais « des » Arctiques, comme l’ambassadrice norvégienne chargée des pôles nous l’a expliqué à Oslo. On ne peut pas comparer l’archipel du Svalbard, où se trouve le village scientifique le plus septentrional, avec le Groenland, qui a une population traditionnelle.
Ces pays riverains ont des prétentions de souveraineté et se disputent notamment le plateau continental dans l’océan Arctique. Tout cela a été avivé par une étude de l’institut géologique des États-Unis, d’où il ressort que peut-être 30 % du gaz et 13 % du pétrole encore à découvrir sur terre pourraient être au-delà du cercle polaire, ce qui attire évidemment les grandes compagnies pétrolières.
Les risques écologiques sont pourtant énormes. Je rappelle que pour récupérer une petite partie de la fuite de la plateforme Deep Water Horizon dans le golfe du Mexique en 2010, il a fallu plus de 6 000 bateaux. Quant à ce qui pourrait arriver en cas de marée noire dans des eaux froides, notre référence est la catastrophe de l’Exxon Valdez : un quart de siècle après, il y a toujours des conséquences de cet accident sur l’écosystème, qui est très fragile ; pourtant, c’était dans le nord du Pacifique, pas dans l’Arctique, où ce serait pire.
Plus généralement, la biodiversité est gravement menacée dans l’Arctique. L’ours polaire ou la mouette ivoire sont en danger, car ils ont besoin de l’existence d’une banquise pour se nourrir. Pour ces animaux, à la différence d’autres, il n’y aura pas de possibilité de se réfugier plus au nord pour suivre l’évolution climatique. Ils risquent donc de disparaître, d’autant qu’ils subissent la concurrence des animaux, notamment des oiseaux, qui, du fait du réchauffement, envahissent les régions arctiques depuis les zones tempérées.
Pour ce qui est des perspectives de gouvernance de l’Arctique, on peut être relativement pessimiste, avec des pays riverains qui ont des attitudes différentes.
Pour les États-Unis, l’Arctique n’est pas une priorité, ce qui fait qu’ils sont assez ouverts à la coopération internationale et soutiennent des mesures de protection, comme les aires marines protégées, où la pêche et l’exploitation des hydrocarbures sont interdites.
Mais pour le Canada du Premier ministre Stephen Harper, l’Arctique permet surtout d’exalter la souveraineté nationale.
La Norvège, quant à elle, joue sur l’ambiguïté. C’est un pays soucieux de protéger l’environnement et ouvert aux discussions internationales. Mais c’est aussi un pays qui n’est pas prêt à accepter une gouvernance commune sur l’Arctique, en particulier sur la mer de Barents et ses réserves d’hydrocarbures.
Le Danemark est présent en Arctique du fait du Groenland. C’est là que les risques sont les plus grands, car le Groenland est très riche en minerais, notamment les terres rares, qui suscitent bien des appétits. Ce n’est pas pour rien que le Président sud-coréen s’y est rendu. Les intérêts chinois s’implantent aussi.
Enfin, la Russie est très dépendante de l’Arctique pour sa production d’hydrocarbures. Vous vous souvenez de l’opération montée par Greenpeace contre une plateforme russe, au demeurant très ancienne et très dangereuse. La Russie renforce sa présence et remilitarise l’Arctique. Nous avons aussi vu cette présence au Svalbard, où il existe des implantations russes comme Barentsburg : même si le Svalbard bénéficie, en application du traité de Paris de 1920, d’un statut d’ouverture internationale et de démilitarisation, on est en droit de s’interroger.
Les perspectives de développement de l’exploitation économique dans l’Arctique restent limitées par certains facteurs : les nouvelles lignes maritimes seront peut-être un jour exploitées, mais pour le moment demeurent chères, car il faut l’aide de brise-glaces, et aléatoires, car l’extension de la banquise est différente chaque année, de sorte que le trafic se limite encore à quelques dizaines de bateaux. Quant aux compagnies pétrolières, elles sont retenues par la crainte des conséquences exceptionnellement graves qu’aurait une marée noire : on ne pourrait pas la traiter et ce serait l’accident de Deep Water Horizon multiplié par dix ou cent !
Mais on ne peut pas trop compter sur le Conseil arctique pour réguler cela, car cette instance, que Michel Rocard avait à juste titre qualifiée de syndicat de copropriétaires, n’a pas été capable de produire des décisions protectrices. Il s’oppose aussi toujours à ce que l’Union européenne y devienne observatrice, en raison de son conflit avec le Canada sur la chasse aux phoques, même si celui-ci est en cours de règlement.
La France ne peut pas non plus jouer un rôle trop important, car elle n’est pas possessionnée dans l’Arctique et y a seulement une base, la station AWIPEV, que l’Institut polaire français Paul-Émile Victor partage avec l’Institut allemand Alfred Wegener ; ce sont les cinq pays riverains de l’Arctique qui mènent la danse.
De plus, il reste des travaux à finir en interne : pour mieux structurer notre recherche, il y a une démarche du CNRS qui s’appelle le Chantier arctique, mais celui-ci est encore en cours de mise en place. De même, on attend toujours la publication d’une Feuille de route nationale sur l’Arctique, alors que dans un premier temps nous espérions pouvoir présenter notre rapport en même temps que cette publication. Enfin, l’Arctique ne sera pas au programme de la COP21, ou, s’il l’est, c’est qu’il sera entré par la fenêtre. Notre ambassadrice chargée de préparer cet évènement, Laurence Tubiana, nous a expliqué les efforts qu’elle faisait pour y introduire la dimension arctique, mais ce n’est pas facile.
L’idéal serait bien sûr de considérer l’Arctique comme un patrimoine commun de l’humanité et de le sanctuariser comme l’est l’Antarctique, mais ce sera difficile, voire impossible. C’est pourquoi nous recommandons d’encourager le Conseil arctique à se renforcer, en lien avec l’Organisation des Nations-Unies. Comme pour l’Union européenne, il s’agit de dépasser le fonctionnement purement intergouvernemental de façon à surmonter les souverainismes.
Pour conclure, l’Arctique est une région déterminante aussi bien pour ce qui concerne le réchauffement climatique, où elle nous annonce ce qui va arriver, que du point de vue géopolitique. De ce point de vue, c’est une région sensible entre l’Ouest et l’Est, à laquelle il faut prêter attention quand on voit la politique actuelle du président Poutine. Nous n’avons pas fini de parler de l’Arctique.
M. Jean-Paul Dupré. Je voudrais évoquer la circulation maritime, notamment dans l’Arctique. À moyen terme, des évolutions économiques peuvent toucher certaines régions du monde et contribuer à modifier les intérêts des uns et des autres. Mais ma question porte sur un sujet qui n’a pas été évoqué : l’évolution du niveau des océans et ses incidences. Quelles sont les prévisions pour la France, tant en métropole qu’en outre-mer ?
M. Pierre Lellouche. Je voudrais d’abord féliciter nos deux collègues pour leur très bon travail. Cet intérêt pour les pôles peut sembler un peu pittoresque, mais il n’en est rien pour ceux qui suivent les questions d’économie mondiale, l’évolution du monde et la géopolitique.
Quand j’étais aux affaires européennes, j’ai moi-même siégé au Conseil arctique, en compagnie de l’ancien Premier ministre Michel Rocard, qui est notre ambassadeur pour les pôles. C’était la première fois qu’il y avait une telle représentation au niveau ministériel. Michel Rocard réalise un excellent travail, avec une toute petite équipe. La première suggestion que je vous demanderai d’ajouter à vos propositions, si vous en êtes d’accord, est d’ailleurs de transformer cette fonction d’ambassadeur en représentant spécial de la France sur les pôles. Cela permettrait d’avoir une vision interministérielle de ces sujets, et non pas seulement diplomatique. J’ai eu à exercer ces fonctions de représentant spécial, notamment en Afghanistan, et je sais à quel point c’est utile pour mobiliser les autres ministères. Les pôles ne représentent pas seulement des intérêts diplomatiques, mais aussi écologiques, économiques et stratégiques. On a besoin de regrouper ceux qui connaissent ces sujets en France.
Ce qui a été dit sur le Conseil arctique est absolument exact. Les pays riverains n’ont tout simplement pas envie de partager et de voir arriver d’autres acteurs. Il a été très compliqué pour la France d’obtenir un siège d’observateur et il n’en est pas question pour l’Union européenne. Il faut donc arriver à modifier la convention de Montego Bay pour doter cet océan glacé d’un statut qui le prémunisse contre tous les risques soulignés par Noël Mamère et Hervé Gaymard. Des intérêts mondiaux sont en jeu, en particulier le climat mais aussi la stabilité. Comment y arriver ? Il me semble qu’il faudrait passer par l’ONU et la réécriture d’une convention internationale sur le droit de la mer, en profitant de la neutralité américaine. Mais les Russes et les Canadiens ne nous aideront pas.
En ce qui concerne l’Antarctique, il est important de renforcer le statut de 1959, mais je crois que cela figure dans votre rapport, pour éviter des tentations de dérive qui se manifestent déjà.
Un mot aussi sur le Groenland, que je connais un peu. L’exploitation a déjà commencé. Il faut bien voir que les liens entre le Groenland et le Danemark ne sont pas si simples. La souveraineté danoise n’est pas absolue. Le Danemark offre une porte d’entrée pour l’Union européenne…
M. Hervé Gaymard, président de la mission d’information. Mais le Groenland n’est pas dans l’Union européenne.
M. Pierre Lellouche. Le statut du Groenland est plutôt proche de celui de la Polynésie française. Il y a une politique économique locale et un gouvernement local qui est d’ailleurs bien déterminé à tirer le plus grand parti possible de ses ressources. Il y a là aussi un problème. Au total, la stabilisation de la région arctique représente un immense défi pour la France.
M. Jean-Pierre Dufau. La situation semble relativement claire et bien établie en ce qui concerne l’Antarctique, mais tout devient compliqué pour l’Arctique, dont le statut est celui d’un océan, dès qu’il s’agit de protection. Comment trouver une solution pour son classement éventuel au patrimoine mondial de l’humanité ? Faut-il s’en remettre à un certain nombre de conventions, comme vous le suggérez dans votre proposition 15 ? Ou, plus classiquement, est-ce à un État de demander le classement ? En l’espèce, les Etats sont multiples. Peut-on alors imaginer une demande dans le cadre de l’ONU, par la voie d’une résolution ? Après tout, l’UNESCO est une émanation de l’ONU.
M. Jacques Myard. J’ai suivi avec grand intérêt vos propos. Salut aux chercheurs d’aventure ! Vos propositions sont ambitieuses, mais ne seront jamais inscrite dans le droit. Il faut continuer ce combat, mais il manque le côté opérationnel. Il faut être conscient de ce hiatus entre les objectifs légitimes que vous poursuivez et la réalité géostratégique du monde imparfait.
Autre question : que viennent faire les îles Éparses du Mozambique dans votre proposition n° 4 ?
M. Philippe Cochet. Le débat de ce matin nous fait voyager. La Russie joue évidemment un rôle majeur dans la zone, mais quid de celui des États-Unis, que vous n’avez pas abordé ? Ces deux acteurs ont-ils des positions antagonistes sur la question des pôles ?
M. Jean-Paul Bacquet. Lors de la précédente législature, un groupe d’étude avait été créé sur les pôles, présidé par notre regrettée collègue Françoise Olivier-Coupeau. Nous avions reçu Jean Malaurie. Je suis surpris des propos optimistes de notre collègue Noël Mamère, quand je me souviens de ceux de Jean Malaurie sur l’urgence d’intervenir dans les terres australes, sur l’urgence écologique.
Deuxième point que j’aurais aimé aborder, le Groenland, qui n’a pas obtenu son indépendance et où vivent seulement quelques dizaines de milliers d’habitants : les jeunes partent sans revenir et la tendance ne semble pas vouloir s’inverser.
Enfin, pourriez-vous détailler un peu plus la question du tourisme et de ses conséquences écologiques ?
M. Didier Quentin. Vous avez évoqué des chiffres impressionnants sur la hausse des températures. Quelles sont exactement les conséquences pour l’Arctique du réchauffement climatique ?
Par ailleurs, Paul-Émile Victor avait le projet, dans les années 1960, de faire venir des blocs de glace de l’Antarctique, pour réduire les problèmes de sécheresse de la Corne de l’Afrique ou des Émirats. L’idée – peut-être farfelue – a-t-elle été abandonnée ?
M. Noël Mamère, rapporteur. Pour répondre à la question de Didier Quentin, je pense que le glaçon a fondu !
Pour répondre à la question portant sur la montée des océans, la véritable menace pour l’Arctique n’est pas tant cela que l’acidification des océans, laquelle met en péril la biodiversité, en s’attaquant notamment aux espèces marines à exosquelette comme le corail. Cela dit, quand vous avez l’équivalent d’une région de France qui se détache de l’Antarctique, effectivement, cela peut avoir un impact majeur sur le niveau des eaux. Mais la montée des eaux n’est pas liée uniquement au réchauffement des pôles, elle est également liée à d’autres facteurs, comme les divers courants marins, ce qui la rend inéluctable.
Sur le statut de patrimoine commun, la proposition de Pierre Lellouche me semble la plus réaliste. En effet, il nous faut réviser de la convention de Montego Bay de 1982, à laquelle il faudrait ajouter l’extension et l’utilisation plus intense de la convention OSPAR, ce sont d’ailleurs des propositions que nous formulons. Voilà la solution. Mais je ne suis pas convaincu que les conditions soient réunies pour y arriver.
Je crois que M. Bacquet a confondu les terres australes et l’Arctique, qui faisait l’objet des cris d’alarmes de Jean Malaurie. Mais on peut être également inquiet pour l’Antarctique. Le système du Traité sur l’Antarctique pourra être révisé en 2048 ; or ce continent possède des terres extrêmement riches en minerais, on peut donc s’inquiéter de son avenir.
Sur l’Arctique, je suis d’accord avec Jacques Myard : il sera difficile de faire accepter aux pays riverains une réglementation commune protectrice ; je ne suis pas convaincu que nous y parviendrons.
La Russie de Poutine, comme le Canada de Harper, font beaucoup d’esbroufe sur ce sujet. Mais vous le savez, comme le disait Clausewitz, la politique extérieure est guidée par des motifs de politique intérieure et la Russie n’a aucun intérêt à provoquer un conflit dans cette zone. Ce sont plutôt des effets de manche. L’Arctique ne figure pas non plus parmi les priorités des États-Unis et je ne pense pas que cela change.
L’un des vrais enjeux c’est le Groenland, car s’y trouvent d’énormes ressources. Il faut réussir à l’intégrer, via le Danemark, dans une convention internationale protectrice. La population locales, qui est constituée d’Inuits, est divisée entre ceux qui voient un eldorado dans la recherche des hydrocarbures et ceux qui souhaitent conserver leur mode de vie.
M. Hervé Gaymard, président de la mission d’information. Avant la période de glaciation du XVème siècle, le Groenland était habité par des Scandinaves qui l’avaient baptisé « Greenland », le pays vert. En effet, à l’époque, ce n’était pas une zone glacée. Les archéologues et historiens estiment d’ailleurs que les premières populations ayant migré sur le continent nord-américain étaient passées par ce Greenland. Il y a eu ensuite une période de glaciation pendant laquelle toutes les populations ont été éliminées, mis à part les ancêtres des Inuits actuels. Puis, à partir du XVIème et du XVIIème siècles, le Groenland est devenu une terre danoise, avec des relations compliquées avec la couronne. En effet, après l’adhésion du Danemark à l’Union européenne en 1973, le Groenland en a fait partie intégrante. Mais ensuite, une négociation spécifique a été entamée pour que le Groenland sorte de l’UE. Actuellement, la situation est compliquée. Jean-Paul Bacquet parlait du cri d’alarme de Jean Malaurie. Jean Malaurie a lui-même reconnu que sa position était contradictoire : il a milité pour l’autonomie puis l’indépendance des autochtones du Groenland, mais il en reconnaît aussi les risques. Mentalement, le Danemark a cessé de penser à une souveraineté territoriale ailleurs que sur son « pré carré » – le pays a renoncé à ses colonies (îles Vierges, Islande) avant et pendant la Première guerre mondiale – et une grande partie de l’opinion publique danoise souhaite un retrait du Groenland. C’est une question disputée au sein des autorités danoises. Il s’agit d’un sujet compliqué, car le Groenland, grand pays avec peu de population, a une élite susceptible d’être influençable.
Je voudrais faire une dernière remarque pour rebondir sur ce qu’a dit Jacques Myard. Pompidou a déclaré, lors de son discours sur la crise du monde moderne à Nice en 1967, que l’action devait être la sœur du rêve. Il disait qu’il faut élever la ligne d’horizon et ne pas se contenter des pesanteurs de la souveraineté. Je pense que sur les pôles Nord et Sud, il faut résolument une action internationale, même si cela peut paraitre à court terme vain, naïf ou idéaliste. Il est important de garder cette part d’idéalisme.
M. Noël Mamère, rapporteur. Alors que les explorateurs y ont débarqué en 1821, le Traité sur l’Antarctique a été signé en 1959. Cela montre donc qu’il faut du temps. Je ne dis pas qu’on aura besoin d’autant de temps pour l’Arctique, mais je veux dire qu’il ne faut pas désespérer.
M. Jacques Myard. Une question sur les nodules au fond de la haute mer. Il était prévu dans la convention de Montego Bay que ce soit une autorité internationale qui organise leur exploitation. Cela n’a jamais été mis en application.
M. Noël Mamère, rapporteur. Pour l’instant, il n’y a pas d’exploitation des nodules.
M. Jean-Paul Bacquet. Pouvez-vous répondre à ma question sur le tourisme ?
M. Noël Mamère, rapporteur. Le tourisme arctique est en développement. Il est réservé à un public doté de moyens. Il y a d’ailleurs une société française, la société Ponant, qui organise beaucoup de ces voyages. Quand nous étions au Svalbard, nous avons vu des touristes débarquer. À Ny-Ålesund, il y aurait plus de 20 000 touristes d’avril à septembre. Le tourisme est effectivement une menace. Il existe une forme de régulation qui lie les agences de voyage.
Mme Cécile Duflot. Vous avez parlé de la particularité de cette région et notamment de son extrême vulnérabilité climatique. J’ai lu que vous vouliez faire de l’Arctique un sujet pour la COP21. Mais étant donné l’organisation actuelle de la conférence, je n’ai pas l’impression que cette question ait été mise à l’agenda. Au-delà de votre proposition, que je trouve pertinente, comment envisagez-vous que cette question soit prise en considération dans les mois à venir ?
M. Noël Mamère, rapporteur. Vous avez raison. En effet, il nous semble que l’Arctique devrait faire partie intégrante des travaux de la COP21. Nous avons auditionné Laurence Tubiana qui nous a expliqué qu’il y avait peu de chance d’y parvenir, ce que nous regrettons.
M. Hervé Gaymard, président de la mission d’information. Je voudrais finir par quelques brèves remarques. Noël Mamère l’a dit mais je veux insister : nous avons une remarquable recherche française sur l’Arctique et l’Antarctique, qui de plus ne coûte pas cher, quelques dizaines de millions d’euros. Cette recherche joue un effet de levier considérable pour l’influence française.
Ma deuxième remarque concerne la très bonne synergie que nous avons avec nos partenaires européens. Il existe une relation qu’on peut qualifier de fusionnelle entre la France et l’Allemagne avec la station commune AWIPEV au Svalbard. Avec les Italiens, il y a une coopération exemplaire, tant du point de vue des équipes que des financements, en Antarctique sur la base Concordia.
Enfin, je vous conseille de lire la bande dessinée d’Emmanuel Lepage, aux éditions Futuropolis, dont les deux tomes sont intitulés « Voyages aux îles de la Désolation » et « La lune est blanche » et sont illustrés d’aquarelles magnifiques.
M. Noël Mamère, rapporteur. En complément je vous conseille aussi, aux éditions Gallmeister, « Rêves arctiques » de Barry Lopez.
À propos de la tradition française de recherche arctique, lors de notre voyage au Svalbard, nous avons visité la station Corbel. Cette station porte le nom d’un chercheur français qui est arrivé sur l’archipel en 1963 et depuis se sont succédé là-bas de grands scientifiques français – je pense par exemple à Mme Masson-Delmotte, parmi bien d’autres – en collaboration avec l’Institut allemand Wegener. J’insiste sur ce que disait Hervé Gaymard : il faut sanctuariser les moyens de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor, faute de quoi les chercheurs du CNRS n’auront plus la possibilité matérielle de continuer leurs travaux dans les régions polaires.
Pour finir, je vous conseille un livre culte aux États-Unis, « Le gang de la clef à molette », qui vous fera découvrir une écologie bien plus radicale que celle que l’on présente comme telle en France.
La commission autorise la publication du rapport d’information à l’unanimité.
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES PAR LA MISSION
En Norvège :
(du 24 au 29 août 2014)
● À Ny-Ålesund (archipel du Svalbard) :
– L’équipe de la base franco-allemande AWIPEV : Mme Verena Mohaupt, chef de station, et ses collaborateurs Mme Kerstin Binder et M. Thomas Dupeyron
– Les scientifiques français présents : MM. Pascal Morin, directeur scientifique de l’IPEV, Dominique Fleury (IPEV) et Jérôme Fournier (CNRS, station marine de Dinard)
– L’équipe de la station Corbel : M. Florian Tolle, glaciologue (laboratoire ThéMA du CNRS et Université de Franche-Comté), et ses collaborateurs
– L’équipe de la compagnie Kingsbay : MM. Ole Øiseth, directeur, et Sébastien Barrault, conseiller scientifique et responsable du laboratoire marin
– M. Fabio Giardi, responsable de la base italienne Dirigible Italia
– Mme Marta Karoline Jansen, de la base norvégienne dépendant du Norsk Polarinstitutt
● À Oslo :
– M. Leiv Lunde, directeur de l’Institut Fridtjof Nansen
– Mme Else Berit Eikeland, ambassadrice de la Norvège pour l’Arctique et l’Antarctique
– M. Kristian Nordheim, député, vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense
– M. Bjørn Arne Næsgaard, directeur des affaires externes de Total-Norvège
– Les collaborateurs de l’ambassade de France, notamment MM. Jean-Marc Pommeray, Christian Fatras et François-Xavier Lannuzel
À Paris :
(par ordre chronologique)
– M. Michel Rocard, ancien Premier ministre, ambassadeur chargé de la négociation internationale pour les pôles Arctique et Antarctique
– M. Hervé Le Treut, climatologue, directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace
– M. Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
– M. Laurent Mayet, conseiller auprès de M. Michel Rocard, président du think tank « le Cercle Polaire »
– M. Yves Frénot, directeur de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV)
– MM. Jean-Louis Etienne, explorateur polaire, et Christian de Marliave, responsable éditorial des éditions Paulsen, accompagnés de Mmes Séverine Alvain (CNRS) et Elsa Peny-Etienne (Océan polaire) et de M. Philippe Sentein (Océan polaire)
– MM. Hubert Loiseleur des Longchamps, directeur des affaires publiques de Total-SA, et Jean-François Minster, directeur scientifique
– M. Pascal Bolot, administrateur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
– M. Damien Degeorges, docteur en sciences politiques, consultant spécialiste du Groenland et de l’Islande
– Mmes Isabelle Autissier, navigatrice, présidente de WWF-France, et Isabelle Laudon, responsable des politiques publiques de WWF-France (cette organisation a de plus adressé une contribution écrite à la mission)
– M. Denis-Didier Rousseau, délégué scientifique en charge des affaires polaires pour le CNRS, responsable du « Chantier arctique »
– M. André Gattolin, sénateur, auteur des rapports d’information « Arctique : préoccupations européennes pour un enjeu global » et « Le Groenland, un carrefour entre l’Europe et l’Arctique »
– M. Olivier Guyonvarch, sous-directeur du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles au ministère des affaires étrangères et du développement international, Mme Fabienne Runyo et M. Jonathan Cholet, rédacteurs
– M. David Grémillet, ornithologue, chercheur au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE)
– Mme Sylvie Joussaume, climatologue, directrice de recherche au CNRS, vice-présidente du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises
– Mme Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, chercheuse au Laboratoire du climat et des sciences de l’environnement
– Mmes Aurélie Bonal, sous-directrice de l’Europe occidentale et nordique au ministère des affaires étrangères et du développement international, et Sandra Debu, rédactrice
– Mmes Kirsten Schulz, conseillère chargée des affaires environnementales et scientifiques à l’ambassade des États-Unis, et Roberta Burns, deuxième secrétaire chargée de l’environnement, de la science, de la technologie et de la santé
– Son Exc. Rolf Einar Fife, ambassadeur de Norvège, et Mmes Inga M. Nyhamar, ministre conseiller, et Line Aune, conseiller
– Son Exc. Lawrence Cannon, ambassadeur du Canada, M. Marc Berthiaume, responsable des relations politiques et parlementaires, et Mme Hélène Halatcheff, responsable de la promotion des intérêts
– Mme Laurence Tubiana, ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique
– Mme Stéphanie Belna, chargée de mission « milieu marin-environnement polaire » à la direction des affaires européennes et internationales du ministère de l’environnement, du développement durable et de l’énergie
– M. Nicolas Régaud, conseiller du directeur général des relations internationales et de la stratégie au ministère de la défense, et les capitaines de frégate Gaël Lacroix, chargé de mission Amérique du Nord, et Loïc Guyot, de l’État-major de la marine
1 () Le Point, 27 novembre 2014.
2 () Voir notamment la publication de la Fondation de la recherche stratégique, dans « Recherches & documents », n° 03/2013, novembre 2013 : « Arctique : perspectives stratégiques et militaires », par Alexandre Taithe, Isabelle Facon, Patrick Hébrard et Bruno Tertrais.
3 () « Arctique : préoccupations européennes pour un enjeu global », Sénat 2013-2014, n° 684, et « Le Groenland, un carrefour entre l’Europe et l’Arctique ? », Sénat 2014-2015, n° 152.
4 () « Changements climatiques 2013 – Les éléments scientifique – Résumé à l’intention des décideurs, Résumé technique et Foire aux questions – Contribution du groupe de travail I au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ».
5 () « Global Estimates 2014 – People displaced by disasters », par le Norwegian Refugee Council.
6 () « Central West Antarctica among the most rapidly warming regions on Earth », par David H. Bromwich, Julien P. Nicolas, Andrew J. Monaghan, Matthew A. Lazzara, Linda M. Keller, George A. Weidner et Aaron B. Wilson.
7 () Le « potentiel de réchauffement global » est un indicateur qui mesure la capacité des gaz à contribuer à l’effet de serre en fonction d’une part de leur absorption de l’énergie radiative, d’autre part de leur rémanence dans l’atmosphère une fois qu’ils ont été libérés – c’est pourquoi il est calculé à une échéance déterminée. Cet indicateur est déterminé par rapport au potentiel du dioxyde de carbone, dont le potentiel est donc par construction de 1.
8 () Voir par ex. Le Monde.fr des 13 janvier et 13 mai 2014.
9 () Voir : « Widespread, rapid grounding line retreat of Pine Island, Thwaites, Smith, and Kohler glaciers, West Antarctica, from 1992 to 2011 », par E. Rignot, J. Mouginot, M. Morlighem, H. Seroussi et B. Scheuchl, Geophysical Research Letters, volume 41, issue 10, pages 3502–3509, 28 mai 2014.
10 () « Projected Polar Bear Sea Ice Habitat in the Canadian Arctic Archipelago », par Stephen G. Hamilton, Laura Castro de la Guardia, Andrew E. Derocher, Vicki Sahanatien, Bruno Tremblay et David Huard, in Plos/One, 26 novembre 2014.
11 () « Little auks buffer the impact of current Arctic climate change », par D. Grémillet, J. Welcker, N.J. Karnovsky, W. Walkusz, M.E. Hall, J. Fort, Z.W. Brown, J.R. Speakman & A.M.A. Harding, Marine Ecology Progress Series. 21 mai 2012.
12 () Les atomes d’oxygène et d’hydrogène composant les molécules d’eau prennent parfois des formes isotopiques atypiques plus lourdes : oxygène 18 et deutérium. Ces molécules plus lourdes ont tendance à aller préférentiellement vers la phase condensée de l’eau (pluie ou neige) plutôt que vers la vapeur. Ainsi, à chaque changement de phase de l’eau, la phase condensée est plus riche en isotopes lourds que la phase vapeur qui lui donne naissance. Il y a donc un appauvrissement progressif en isotopes lourds de la vapeur et en conséquence des précipitations à mesure qu’une masse d’air se refroidit (ceci provoquant une condensation accrue). Les scientifiques ont établi, pour les régions polaires, une relation linéaire entre la composition isotopique des glaces et la température qui régnait lors de leur formation.
13 () Publié par le secrétariat de la RCTA sous le titre : « À propos de la stratégie pour le développement des activités de la Fédération de Russie dans l’Antarctique pour l’horizon 2020 et a plus long terme ».
14 () « Quel cadre réglementaire pour la pêche dans l’océan Arctique ? », 31 janvier 2014, par Augustin Boyer et Frédéric Lasserre, Université Laval, publié par CIRRICQ.
15 () « Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle ».
16 () Nanisivik (zinc et plomb) et Polaris (zinc).
17 () La Russie disposerait de 36 grands brise-glaces, contre seulement 4 à 6 pour chacun des autres grands États détenteurs de cet équipement : Canada, États-Unis, Finlande et Suède.
18 () Étant rappelé qu’un mille marin égale 1 852 mètres.
19 () Cet article dispose que « tous les États ont l’obligation de prendre les mesures, applicables à leurs ressortissants, qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, ou de coopérer avec d’autres États à la prise de telles mesures ».
20 () Selon l’article précité : « Quel cadre réglementaire pour la pêche dans l’océan Arctique ? », 31 janvier 2014, par Augustin Boyer et Frédéric Lasserre, Université Laval, publié par CIRRICQ.
21 () US Department of State, « Chairman's Statement at Meeting on Future Arctic Fisheries, Press Statement, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs », 1er mai 2013.
22 () L’ours polaire est désormais par ailleurs protégé au niveau international dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces menacées (CITES). Cependant, une tentative de le faire inscrire sur l’« annexe I » de cette convention, ce qui aurait eu pour effet d’en interdire tout commerce, a échoué en 2013, bien qu’elle provînt conjointement des États-Unis et de la Russie, face notamment à l’opposition du Canada.
23 () Source de ces données : Arctic Council Indigenous Peoples Secretariat.
24 () Voir notamment « International Cooperation and Arctic Governance – Regime effectiveness and northern region building », édité Olav Schramm Stokke et Geir Hønneland, et « If an Arctic Ocean treaty is not the solution, what is the alternative ? », par Oran R. Young, repris dans « The Politics of the Arctic », édité par Geir Hønneland.
25 () Les observations qui suivent sont tirées de : « Indigenous Issues », par Elana Wilson et Indra Øverland, in « International Cooperation and Arctic Governance – Regime effectiveness and northern region building », édité Olav Schramm Stokke et Geir Hønneland.
26 () Voir sur ce point : « Oil, gas and the environment », par Kristine Offerdal, in « International Cooperation and Arctic Governance – Regime effectiveness and northern region building », édité Olav Schramm Stokke et Geir Hønneland.
27 () Les observations qui suivent sont tirées de : « Climate change », par Alf Håkon Hoel, in « International Cooperation and Arctic Governance – Regime effectiveness and northern region building », édité Olav Schramm Stokke et Geir Hønneland.
28 () Interview de M. Michel Rocard par Libération, 3 février 2013.
29 () Dont le Spitzberg est l’île principale, d’où la confusion parfois faite en France, où ce vocable est appliqué à tout l’archipel.
30 () Voire premier homme à avoir atteint de manière certaine le pôle Nord, le fait que les expéditions Cook et Peary de 1908-1909 l’aient réellement touché étant discuté.
31 () « Contribution à la Feuille de route du MAE pour l'Arctique : La recherche scientifique, la coopération universitaire et l'expertise françaises en Arctique », Chantier arctique français, 2014.
32 () Voir sur cette question : « Maritime Delimitation in the Arctic : the Barents Sea Treaty », par Tore Henriksen et Geir Ulfstein, repris dans « The Politics of the Arctic », édité par Geir Hønneland.
33 () « Indigenous Issues », par Elana Wilson et Indra Øverland, in « International Cooperation and Arctic Governance – Regime effectiveness and northern region building », édité Olav Schramm Stokke et Geir Hønneland.
34 () Les éléments présentés dans le présent développement sur le statut du Svalbard sont notamment tirés de l’article « The Svalbard Continental Shelf Controversy : Legal Disputes and Political Rivalries », par Torbjørn Pedersen, repris dans « The Politics of the Arctic », édité par Geir Hønneland.
35 () D’autres travaux dans le même domaine consistent dans la construction de stations censées reproduire les conditions de vie d’une mission humaine sur Mars : ce type d’expériences n’est pas mené à Ny-Ålesund, mais l’Arctique, vu ses conditions extrêmes, en a accueilli certaines.
36 () Voir : « Greenland and Iceland : meeting place of global powers in the Arctic », 4 septembre 2014, Éditoriaux – Actuelles de l’IFRI.
37 () « L’Arctique : une région d’avenir pour l’Union européenne et l’économie mondiale », in Question d’Europe n° 263, 7 janvier 2013, Fondation Robert Schuman.
38 () « Le Groenland, un carrefour entre l’Europe et l’Arctique ? », Sénat, commission des affaires européennes, n° 152, 2014-2015.
39 () Les hydrocarbures découverts étaient si peu rentables qu’aucune exploitation n’a été possible. Les 176 puits ont tous été rebouchés sans produire une goutte. Les Territoires du Nord-Ouest produisent tout de même des hydrocarbures, mais leurs gisements sont situés au sud du cercle polaire.
40 () Voir l’« Énoncé de la politique étrangère du Canada pour l’Arctique » publié par le gouvernement.
41 () « Contribution à la Feuille de route du MAE pour l'Arctique : La recherche scientifique, la coopération universitaire et l'expertise françaises en Arctique », Chantier arctique français, 2014.
42 () L’accord bilatéral russo-américain sur la frontière maritime, signé en 1990, a été ratifié par le Congrès américain mais toujours pas par la Douma.
43 () Certes les hydrocarbures ont aussi représenté 58 % des exportations norvégiennes en 2013. Mais, avec un PIB par habitant excédant 100 000 dollars, un fonds souverain doté de plus de 600 milliards d’euros fin 2013 et un excédent courant proche de 12 % du PIB (en 2013), la Norvège a de la marge avant qu’une éventuelle baisse de la production ou des cours des hydrocarbures ne mettent en danger son économie…
44 () Selon les données présentées dans le rapport « Naval challenges in the arctic region », Wise Pens International, par les vice-amiraux Fernando del Pozo, Anthony Dymock, Lutz Feldt, Patrick Hébrard, et Ferdinando Sanfelice di Monteforte, 9 septembre 2013.
45 () « La politique russe dans l’Arctique et la modernisation de la Flotte du Nord », par Pavel Baev, in Russie.Nei.Visions n° 65, août 2012.
46 () http://www.greenpeace.org/france/fr/campagnes/energie-et-climat/Glace-Noire.
47 () « L'Arctique : une région d’avenir pour l’Union européenne et l’économie mondiale », in Question d’Europe n° 263, 7 janvier 2013, Fondation Robert Schuman.
48 () N° 34-91.
49 () Sénat, N° 299, session ordinaire de 2011-2012.
50 () Voir : Chantier arctique français, « Contribution à la Feuille de route du MAE pour l’Arctique : la recherche scientifique, la coopération universitaire et l’expertise françaises en Arctique ».
51 () Source : « Contribution de l’Institut polaire français Paul-Emile Victor à l’élaboration d’une Feuille de route nationale pour l’Arctique », février 2014.
52 () Chantier arctique français, « Contribution à la Feuille de route du MAE pour l’Arctique : la recherche scientifique, la coopération universitaire et l’expertise françaises en Arctique ».
53 () Source : Total Factbook 2013.
54 () Source : Bilan énergétique de la France pour 2013, Commissariat général au développement durable, juillet 2014.
55 () Le Grenelle de la mer, « Planète mer : inventer de nouvelles régulations », rapport du groupe 4.
© Assemblée nationale