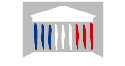______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
en conclusion des travaux d’une mission d’information (1)
sur la présence et l’emploi des forces armées sur le territoire national
ET PRÉSENTÉ PAR
MM. Olivier AUDIBERT TROIN et Christophe LÉONARD,
Députés.
——
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur la présence et l’emploi des forces armées sur le territoire national est composée de :
– MM. Olivier Audibert Troin et Christophe Léonard, rapporteurs ;
– M. Jean-Jacques Candelier, Mmes Nathalie Chabanne et Geneviève Fioraso, MM. Charles de la Verpillière, et Philippe Meunier, membres.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 9
PREMIÈRE PARTIE : L’OPÉRATION SENTINELLE, ENTRE CONTINUITÉ ET RUPTURE 15
I. LES ARMÉES CONSTITUENT DEPUIS LONGTEMPS UN « RÉSERVOIR DE FORCES » POUR LA GESTION DES CRISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 15
A. S’IL EST PLUS VISIBLE DEPUIS 2015, LE RECOURS AUX ARMÉES POUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE NATIONAL N’EST PAS NOUVEAU EN SOI 15
1. Dans les milieux maritime et aérien, les armées assurent déjà « en première ligne » la protection du territoire 16
a. La posture permanente de sûreté aérienne 16
i. L’espace aérien, un milieu dans lequel les armées sont les forces « primo-intervenantes » 17
ii. Une mission permanente, qui mobilise une part substantielle des moyens de l’armée de l’air 19
b. La posture permanente de sauvegarde maritime 20
i. Une mission interministérielle confiée à la marine nationale 20
ii. Un dispositif de protection du territoire national gradué « dans la profondeur » du milieu marin 23
2. Dans le milieu terrestre, les armées ont depuis longtemps pour mission de renforcer les forces de sécurité intérieure en cas de crise 28
a. Un cadre juridique et une organisation déjà anciens 28
i. Un cadre juridique traditionnel, organisé autour du principe de subordination de la force armée à l’autorité civile et de la « règle des quatre “i” » 28
ii. Une chaîne de commandement spécifique : l’organisation territoriale interarmées de défense (OTIAD) 32
b. Une place importante dans le contrat opérationnel des armées 34
i. La protection du territoire national, y compris en milieu terrestre, a continuellement fait partie des missions assignées aux armées par leur contrat opérationnel 35
ii. Ce contrat opérationnel a déjà été mis en œuvre pour des missions de protection 36
B. LES ARMÉES CONSTITUENT SOUVENT LE PRINCIPAL « RÉSERVOIR DE FORCES » À LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT POUR GÉRER LES CRISES TELLES QUE LES ATTENTATS DE 2015 41
1. Les armées ont montré leur capacité à remplir leur fonction de « réservoir de forces » lors de la crise résultant des attentats de 2015 42
a. Un « réservoir de forces », ultima ratio de l’État 42
b. Le déploiement des armées sur le territoire national en janvier 2015 a bien montré la réactivité des forces et leur capacité à s’adapter au contexte de l’opération 47
i. Un déploiement massif et remarquablement rapide 47
ii. Une adaptation rapide au contexte de la mission 50
2. Le recours aux armées pour assurer des missions de protection dans les situations de crise devient d’ailleurs fréquent dans de nombreuses démocraties occidentales 58
a. Le cas du Royaume-Uni : de l’opération Banner à l’opération Temperer 59
i. Le cadre général du recours aux forces armées 60
ii. Les enseignements de l’opération Banner en Irlande du Nord 63
iii. L’opération Temperer de protection de la population contre le terrorisme 69
iv. La place de l’opération Temperer dans une stratégie globale de protection du territoire britannique 75
b. Le cas de la Belgique 77
i. Le cadre légal et doctrinal de l’engagement des armées belges sur leur territoire national 77
ii. Le déploiement des armées belges depuis 2015 sur leur territoire 79
iii. Structures et procédures de gestion de crise 80
iv. L’impact de l’engagement des armées dans la vie politique et dans l’opinion publique 85
c. Le cas particulier d’Israël 86
i. Une stratégie de protection du territoire national fondée sur un contrôle strict des frontières et des flux 87
ii. Une intense activité de renseignement intérieur, qui donne de la profondeur stratégique au dispositif de protection du territoire 89
iii. La place des armées dans le dispositif de protection du territoire israélien 93
iv. L’encadrement juridique de l’action des armées et des forces de sécurité sur le territoire israélien 98
II. LE CHANGEMENT DE PARADIGME DE 2015 : L’ENGAGEMENT DURABLE ET MASSIF DES ARMÉES SUR LE SOL NATIONAL, JUSTIFIÉ PAR LA PERMANENCE ET L’INTENSITÉ EXCEPTIONNELLES DE LA MENACE 101
A. LA MENACE ACTUELLE, AUSSI INTENSE QUE DURABLE, APPELLE DES MESURES DE PROTECTION QUI DÉPASSENT LES HYPOTHÈSES INITIALES DES CONTRATS OPÉRATIONNELS 102
1. La menace terroriste actuelle sur le sol national se caractérise par sa haute intensité et son inscription dans la durée 102
a. Une menace d’une intensité nouvelle : le terrorisme « militarisé » 103
b. Une menace durable 108
2. Les mesures de protection qu’appelle cette menace dépassent ce que prévoyaient les contrats opérationnels 110
a. La difficulté ne résidait pas tant dans le volume des forces déployées que dans leur « capacité à durer » 110
i. L’installation « dans la durée » de l’opération Sentinelle crée des tensions dans la gestion des effectifs de l’armée de terre 110
ii. Les tensions liées à la mise en œuvre du plan Cuirasse 112
b. La tension dans la gestion des effectifs s’est traduite par des « renoncements » maîtrisés 115
i. Des « renoncements » à certaines activités 116
ii. Des renoncements toutefois maîtrisés 118
B. DES MESURES D’ADAPTATION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA DOCTRINE MILITAIRES 121
1. L’actualisation de la loi de programmation militaire traduit l’inscription dans la durée de l’opération Sentinelle 121
a. Une refonte du contrat opérationnel de protection du territoire 121
i. Un haut volume d’engagement : jusqu’à 10 000 hommes en cas de crise 122
ii. Une inscription des mesures de protection dans la durée : jusqu’à 7 000 hommes en permanence 122
b. Des moyens revus à la hausse 122
i. Une manœuvre des ressources humaines complètement réorientée 122
ii. Des moyens budgétaires supplémentaires 124
2. Une adaptation du cadre juridique, conceptuel et doctrinal de l’engagement des armées sur le territoire national : le rapport au Parlement 125
a. Un cadre juridique ajusté à la marge : l’adaptation des règles d’emploi de la force à la tactique des « cavales meurtrières » des terroristes 126
i. L’état du droit lors de la publication du rapport au Parlement 126
ii. Le cadre légal de l’emploi de la force a déjà été adapté au nouveau mode d’action des terroristes que constituent les « cavales meurtrières » 130
iii. Un vif débat sur l’opportunité d’assouplir davantage le cadre légal de l’emploi de la force pour l’adapter aux menaces 132
iv. Un cadre juridique à stabiliser 139
b. Une fonction stratégique de protection « à repenser » 140
i. Notre stratégie de défense et de sécurité nationale plaçait le risque terroriste au premier plan 140
ii. Une refonte annoncée de la fonction stratégique de protection 140
c. De nouvelles « postures » des armées, au premier rang desquelles une « posture de protection terrestre » (PPT) 143
d. Une nouvelle posture de cyberdéfense et des « capacités permanentes » de soutien sanitaire et pétrolier 146
e. Des principes d’engagement des armées sur le territoire national visant à exploiter au mieux leurs savoir-faire spécifiques, plutôt qu’à les employer en « supplétifs » des forces de sécurité intérieure 147
i. Les spécificités des armées depuis leur professionnalisation 147
ii. Les principes d’engagement des armées sur le territoire national 148
iii. Une rupture par rapport à la « logique Vigipirate » 150
f. Un périmètre de missions large mais clairement défini 150
i. Aller au-delà des missions actuelles de Sentinelle 150
ii. Des missions exclues : les opérations judiciaires et le maintien de l’ordre 151
SECONDE PARTIE : PROPOSITIONS POUR PASSER DE SENTINELLE À UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE PROTECTION TERRESTRE DU TERRITOIRE NATIONAL AVEC LE CONCOURS DES ARMÉES 153
I. LA MISE EN œUVRE DE LA NOUVELLE DOCTRINE D’EMPLOI DES ARMÉES EN MILIEU TERRESTRE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL CONSTITUE ENCORE UN DÉFI 153
A. LA DOCTRINE N’A QUE PEU ÉVOLUÉ SUR DEUX SUJETS POURTANT MAJEURS : LA GOUVERNANCE INTERMINISTÉRIELLE DU DISPOSITIF ET L’EXPLOITATION DE L’INFORMATION OPÉRATIONNELLE 154
1. Le recueil, le traitement, le partage et l’utilisation de l’information opérationnelle 154
a. L’utilisation d’informations opérationnelles pertinentes, dans les limites fixées par le cadre légal, constitue une condition d’efficacité des armées sur le territoire national 154
i. Le cloisonnement des informations, parfois au-delà de ce que prévoit la loi, constitue aujourd’hui un facteur limitatif de l’efficacité de l’opération Sentinelle 155
ii. Pourtant, la gestion de l’information d’intérêt opérationnel est au cœur des savoir-faire militaires, particulièrement dans un contexte de prévention d’actes terroristes 157
b. Une clarification des conditions d’utilisation de l’information opérationnelle serait cohérente avec la volonté d’exploiter mieux les savoir-faire des armées qui sous-tend la nouvelle doctrine 158
i. La nouvelle doctrine ne comprend pas de développements ambitieux s’agissant de la gestion de l’information opérationnelle dans l’emploi des armées sur le territoire national 158
ii. Une clarification des règles de gestion de l’information est souhaitable, dans le cadre général fixé par la loi et dans le souci d’optimiser l’action des armées 159
2. L’articulation des armées avec les forces de sécurité intérieure 159
a. Aux niveaux opératif et tactique, la coordination sur le terrain de forces complémentaires constitue un enjeu majeur pour l’efficacité du dispositif national de protection 160
i. La coordination des armées et des forces de sécurité intérieure sur le terrain est encore peu structurée 160
ii. L’accent doit être mis sur la complémentarité des différentes catégories de forces déployées sur le terrain 162
b. Au niveau stratégique, une politique plus ambitieuse de coordination de la planification et de la conduite des opérations de sécurité intérieure est nécessaire 166
i. Les dispositifs actuels de planification et de conduite des opérations restent cloisonnés 167
ii. Un dispositif permanent interministériel de planification « à froid » et de conduite des opérations pour la gestion des crises serait utile 173
B. LA MANœUVRE EN COURS PRÉSENTE PLUSIEURS DÉFIS 175
1. Deux principaux défis techniques : réussir la manœuvre du recrutement et privilégier les modes d’action véritablement militaires 175
a. Réussir la manœuvre des ressources humaines 176
i. La « remontée en puissance » des forces pour la protection du territoire national constitue une manœuvre d’une ambition inédite 176
ii. Les premiers résultats sont globalement conformes aux prévisions 187
b. Privilégier les modes d’action véritablement militaires 190
i. Un dispositif initialement très majoritairement statique 190
ii. Des facteurs d’inertie 190
iii. Les inconvénients de la posture statique 194
iv. Des expérimentations prometteuses de modes d’action plus dynamiques de la force Sentinelle 198
2. Un défi politique : prendre la responsabilité d’une gestion souple du volume des forces engagées 200
a. Un effet de cliquet affectant les effectifs engagés 201
b. Un effet de cliquet affectant les niveaux d’alerte 201
II. APRÈS L’HEURE DE LA RÉACTION AUX CRISES, CELLE DES CHOIX STRATÉGIQUES ET POLITIQUES DE LONG TERME 204
A. VERS UNE REFONTE PLUS COMPLÈTE DE LA PROGRAMMATION MILITAIRE EN COURS 204
1. Pour prendre en compte les nouvelles mesures d’effectifs annoncées après le 13 novembre 205
2. Pour prendre en compte l’ensemble des implications de la posture de protection terrestre, y compris sur les ressources financières, les infrastructures, les équipements et le soutien des forces 205
a. L’armement de la force sur le territoire national 206
i. Des besoins très limités en matière d’armement 206
ii. Des besoins en matière de mobilité de la force 207
b. L’impact de la posture de protection terrestre sur les besoins d’infrastructures du ministère de la Défense 209
c. La question du financement des opérations intérieures 211
i. Un financement satisfaisant pour l’exercice 2015 211
ii. Un parallèle avec les OPEX qui gagnerait à être établi par les textes 213
B. LA QUESTION DE LA JUSTE PLACE DES ARMÉES DANS LA PROTECTION DU SOL NATIONAL À LONG TERME 214
1. Quels champs de compétence respectifs pour les armées et les forces de sécurité intérieure ? 214
a. « Les armées ont-elles leur place sur le territoire national ? » 214
i. La question récurrente de l’état de guerre 214
ii. Une question sans véritable pertinence 216
b. Où les armées ont-elles leur place sur le territoire national ? 219
2. Quelles places respectives pour les militaires d’active et les réservistes ? 220
a. Des réserves engagées dans une profonde transformation 220
b. Un engagement prioritaire des réservistes de l’armée de terre sur le territoire national 222
TRAVAUX DE LA COMMISSION 225
ANNEXE : AUDITIONS ET DÉPLACEMENTS DE LA MISSION D’INFORMATION 251
La doctrine d’emploi de nos armées sur le sol national fait l’objet d’une réflexion intense depuis le lancement de l’opération Sentinelle en janvier 2015, et son évolution est encore en cours au moment où est publié ce rapport.
Non que le recours aux armées sur le territoire national constitue en soi une nouveauté : notre pays a en la matière une longue tradition et, dans les milieux maritime et aérien, les armées sont même en première ligne pour assurer la protection du territoire national. Mais avec l’opération Sentinelle, l’engagement des armées ‒ pour l’essentiel, l’armée de terre ‒ sur le sol national a pris une tout autre dimension : la menace terroriste est plus intense que jamais, et les effectifs engagés sont plus que décuplés par rapport au dispositif ‒ d’ailleurs devenu assez routinier ‒ du plan Vigipirate.
Nos armées ont contribué au plan Vigipirate pendant vingt ans ; l’opération Sentinelle doit-elle durer, elle aussi, telle quelle, plusieurs décennies ? Pour les rapporteurs, c’est impossible. Avec l’opération Sentinelle, l’engagement militaire sur le territoire national a changé d’échelle ; il ne saurait durer qu’en changeant aussi de modèle.
Tel est l’enjeu de la réflexion doctrinale en cours. Bien entendu, les rapporteurs ne prétendent pas refonder eux-mêmes cette doctrine ; mais leurs travaux ont pour objet d’y apporter une contribution, en l’état actuel de leurs réflexions. Ce rapport a ainsi pour vocation de marquer une étape dans le mouvement de refondation doctrinale de l’engagement des armées au service de la protection du sol national, dans la lignée des précédents travaux parlementaires. En effet, l’actualisation de la loi de programmation militaire, le 28 juillet 2015, avait déjà marqué une étape de ce mouvement ; la discussion en séance publique le 16 mars 2016 d’un rapport au Parlement remis par le Gouvernement sur ce sujet en a constitué une autre. Les bases d’une « posture de protection terrestre » des armées ont ainsi été posées ; la définition de son contenu reste en cours. Mais ce mouvement ne pourra être vu comme abouti qu’avec l’adoption d’une programmation militaire renouvelée ‒ que ce soit par « réactualisation » de l’actuelle loi de programmation militaire ou par le vote d’une nouvelle loi.
C’est dans ce cadre que les rapporteurs veulent montrer comment, s’il est décidé que nos armées participent durablement à la protection du sol national, il convient de leur donner les moyens de le faire en tirant au mieux parti de leurs savoir-faire militaires. Les militaires n’ont pas à servir de supplétifs aux policiers ou aux gendarmes : leur plus-value professionnelle est ailleurs, ils ont d’autres savoir-faire à apporter à la protection du territoire national. Cela suppose d’aller plus loin qu’il n’est envisagé à ce jour en diverses matières : l’exploitation de l’information d’intérêt opérationnel, la mise en place de structures de planification et de commandement des opérations, des missions aux effectifs cohérents avec des contrats opérationnels équilibrés, et une posture cohérente avec les compétences des militaires, complémentaires de celles des forces de sécurité intérieure.
Cela suppose également que la société s’adapte, elle aussi, à la menace terroriste qui pèse sur elle. Et pour ce faire, il importe avant tout d’étayer les travaux de doctrine en cours par un investissement politique largement partagé, notamment avec le vote d’une programmation militaire tirant toutes les conséquences de l’engagement des armées sur le sol national. Plus largement, c’est aussi la résilience de la société dans son ensemble qu’il convient de développer.
PRINCIPALES PROPOSITIONS DES RAPPORTEURS
1. Le « statique » doit être l’exception.
Les gardes dynamiques (fût-ce dans un périmètre restreint de « garde dynamique à vue ») sont tactiquement plus efficaces que les gardes statiques, « consomment » moins d’effectifs, et permettent de tirer un meilleur profit des techniques de contrôle de zone que maîtrisent les armées. Le rapport entre les effectifs déployés en mode dynamique et en position statique pourrait donc utilement tendre vers un ratio de 80 % / 20 %. Renoncer à une posture pour l’essentiel statique doit permettre de libérer des effectifs, qui seront utiles pour des missions de contrôle de zone sur tout le territoire national, c’est-à-dire aussi hors des centres urbains ‒ notamment aux frontières et dans les zones rurales.
2./ Respecter le contrat opérationnel de protection (7 000 hommes).
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L’actualisation de la loi de programmation militaire a établi un équilibre entre les effectifs de la force opérationnelle terrestre et le nombre maximal d’hommes déployés sur le territoire national : 7 000 dans la durée, 10 000 pour une durée d’un mois au maximum. Or cet effectif maximal est maintenu depuis déjà sept mois et demi, au lieu d’un. Aussi l’équilibre qui sous-tend le contrat opérationnel est-il de nouveau rompu. Il convient donc soit d’augmenter en conséquence les effectifs de la force en les portant à 86 000 au lieu de 77 000, soit de ramener l’effectif de Sentinelle au niveau prévu par le contrat opérationnel.
3./ Mieux exploiter l’« information d’intérêt opérationnel »
L’exploitation de l’« information d’intérêt opérationnel » (pour ne pas dire : du « renseignement » au sens large) est une des conditions de succès et de sécurité de tout engagement militaire ; d’ailleurs, les forces de sécurité intérieure auraient elles aussi un grand profit à tirer de tout ce qu’observent les militaires. Or, aujourd’hui, aucune procédure formelle n’organise l’échange d’informations entre les armées et les forces de sécurité intérieure sur le sol national. Pour faciliter cet échange, il convient donc d’établir un cadre doctrinal clair et partagé, dans le respect de la légalité.
4./ Créer un centre interministériel d’opérations sur le territoire national
La gestion des crises sur le territoire national relève du Premier ministre, et, par délégation, du ministre de l’Intérieur. Mais ces crises appellent une réponse interministérielle, associant étroitement la défense et l’intérieur au moins, ainsi que la santé, les transports, voire l’énergie, etc. Aujourd’hui, une structure interministérielle existe au niveau politique : la cellule interministérielle de crise. Mais il n’existe aucune structure interministérielle de planification et de conduite des opérations sur le territoire national, à l’image de ce que fait le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) pour les opérations extérieures des armées. D’ailleurs, l’opération Sentinelle aurait-elle eu sa forme actuelle si elle avait fait préalablement l’objet d’une planification interministérielle approfondie ?
Un centre interministériel d’opérations pourrait a minima planifier « à froid » la réaction à différents scénarios de crise (répartition des rôles entre les forces ; modalités d’échange d’informations ; interconnexion des systèmes de communication, entraînements conjoints ; création de centres interservices d’entraînement à l’image du dispositif ACIER (1) dans les Ardennes, etc.). A maxima, un tel centre pourrait assurer la conduite des opérations sur le territoire national, de façon plus organisée que le dispositif improvisé en 2015 dans le fumoir du ministre de l’Intérieur.
5./ Rendre l’opération Sentinelle plus attractive pour les personnels.
La condition des personnels est un facteur déterminant de leur moral et de leur « fidélisation ». L’amélioration des conditions d’hébergement, qui est en cours, en participe ; reste à ce que la suractivité qu’entraîne Sentinelle trouve une juste compensation financière « nette », c’est-à-dire tenant compte des règles fiscales applicables aux opérations intérieures, mais pas aux OPEX.
6./ Accentuer l’effort sur la cyberdéfense et le renseignement.
La stratégie de protection du territoire national doit être globale. Les armées y contribuent, notamment avec Sentinelle ou toute autre forme que pourra prendre la posture de protection terrestre. Leurs missions intérieures constituent un volet majeur de cette stratégie, sans pour autant la résumer. L’effort doit être poursuivi également en matière de cyberdéfense ‒ érigée en « posture permanente des armées » dont le contenu reste lui aussi à préciser ‒ et de renseignement, l’accent devant être mis sur son partage entre services. Cyberdéfense et renseignement permettent en quelque sorte de donner de la profondeur stratégique à notre dispositif de protection du territoire.
7./ Développer la résilience de la société française.
Les gestes de premier secours et les comportements à tenir en cas d’attaque s’apprennent, et l’apprentissage passe aussi par des exercices réguliers. C’est ainsi la résilience de la société française qu’il faut affermir. L’engagement de citoyens dans les réserves militaires y contribue ; il doit continuer à être favorisé, et la fonction publique doit donner l’exemple en la matière.
Pour aller plus loin, les rapporteurs proposent que soit constitué un groupe de travail étudiant l’idée de rendre obligatoire une journée universelle de réserve par an, pendant laquelle les Françaises et les Français apprendraient et mettraient à jour ces compétences. Un tel dispositif pourrait remédier aux limites souvent soulignées de la journée « défense et de citoyenneté », qui n’a guère de suites.
8./ Éviter le piège de l’« effet de cliquet »
Doit-on maintenir indéfiniment 7 000 ou 10 000 militaires sur le sol national ? Vigipirate a été marqué par une sorte d’« effet de cliquet » ‒ une fois prises des mesures de protection, il s’est avéré très difficile d’en « réduire la voilure ». Cet effet commence à jouer pour Sentinelle, avec un effectif maintenu à 10 000 hommes au lieu de 7 000. Or il recèle un piège : une part croissante de nos armées est accaparée par des missions qui relèvent en temps normal des forces de sécurité intérieure et ce, au détriment de leur potentiel opérationnel.
Certes, le niveau de la menace le justifie aujourd’hui. Mais c’est dès à présent qu’il convient de préparer le « retour à la normale » à long terme, quitte à renforcer progressivement les unités mobiles de la police et de la gendarmerie. Pour ce faire, il faut étudier sérieusement l’idée que les textes ou la doctrine établissent un lien entre l’effectif militaire engagé sur le sol national et le niveau de la menace, défini par référence aux degrés d’alerte du plan Vigipirate ou à l’état d’exception en vigueur.
PREMIÈRE PARTIE :
L’OPÉRATION SENTINELLE, ENTRE CONTINUITÉ ET RUPTURE
Le lancement de l’opération Sentinelle, en réponse aux attentats survenus à Paris en janvier 2015, a été perçu et décrit par une large part des observateurs comme marquant un « retour » des armées sur le territoire national, après une vingtaine d’années riches en opérations extérieures pour des armées devenues exclusivement professionnelles.
Il est indéniable que, tant par son volume ‒ 10 000 hommes ‒ que par son déploiement dans des zones urbaines densément habitées, l’opération Sentinelle a donné une visibilité très accrue à la présence des armées sur le territoire national, et qu’à cet égard, l’année 2015 marque bien un tournant.
Peut-on pour autant parler d’une « rupture », ou du moins d’une nouveauté radicale ? N’y aurait-il pas là un risque qu’en quelque sorte, l’opération Sentinelle n’éclipse l’engagement des armées sur le territoire national dans d’autres milieux d’opération ‒ maritime, aérien, mais aussi cybernétique ? Et même dans le milieu terrestre, l’opération Sentinelle doit-elle être perçue comme marquant une rupture stratégique complète ? L’année 2015 en général marque-t-elle une véritable « rupture stratégique » ?
Les rapporteurs se sont attachés à analyser toutes les formes d’emploi des forces armées sur le territoire national et leur évolution dans le temps long.
I. LES ARMÉES CONSTITUENT DEPUIS LONGTEMPS UN « RÉSERVOIR DE FORCES » POUR LA GESTION DES CRISES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
Les armées sont régulièrement engagées en renfort des administrations civiles, sur le territoire national, notamment en cas de catastrophe naturelle ‒ comme, par exemple, lors des inondations dans le Var en 2014 ‒ ou en vue de la prévention des feux de forêt l’été ‒ comme, tous les ans, avec la mission Hephaïstos. Si ces missions ont une forte visibilité auprès de la population, les armées sont chargées aussi, et depuis longtemps, d’autres missions de nature plus militaire, concourant à la protection du territoire national.
A. S’IL EST PLUS VISIBLE DEPUIS 2015, LE RECOURS AUX ARMÉES POUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE NATIONAL N’EST PAS NOUVEAU EN SOI
Avant même les attentats de 2015 et le lancement de l’opération Sentinelle, les armées étaient d’ores et déjà engagées pour la protection du territoire national, d’une façon variable selon les milieux d’opération :
‒ dans les milieux maritime et aérien, elles sont investies de missions permanentes de protection du territoire, pour lesquelles elles agissent en « primo-intervenantes », c’est-à-dire qu’elles constituent la principale force d’action à la disposition de l’État et qu’elles sont les premières forces à intervenir ;
‒ dans le milieu terrestre, elles ont depuis longtemps pour mission d’apporter leur renfort aux forces de sécurité intérieure en situation de crise.
En effet, au titre de la fonction stratégique de protection identifiée par les Livres blancs successifs sur la défense et la sécurité nationale, les armées peuvent être chargées de « missions intérieures » au titre de ce que le concept d’emploi des forces définit comme la « sauvegarde générale ». Celle-ci constitue, comme la contribution à la stabilité internationale et la participation à un conflit majeur, l’un des trois grands ensembles de missions définis par le concept d’emploi des forces. La doctrine (2) la définit comme visant à « contribuer de façon permanente à la protection de la population, au maintien du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la vie normale du pays ainsi qu’à défendre les intérêts de sécurité de la Nation ». Elle précise que la sauvegarde générale « recouvre donc l’ensemble des actions pouvant être conduites par les armées dans un cadre interministériel, voire multinational et contribuant plus particulièrement à la fonction stratégique “protection” », c’est-à-dire « l’ensemble des missions conduites dans le cadre des contributions militaires à l’action de l’État », que ce soit dans le milieu maritime, aérien ou terrestre.
1. Dans les milieux maritime et aérien, les armées assurent déjà « en première ligne » la protection du territoire
Par nature, la protection du territoire national dans les milieux aériens et maritimes relève respectivement de l’armée de l’air et de la marine nationale. Ce dispositif de protection a pour spécificité de faire intervenir les armées « en première ligne », et non en renfort d’administrations civiles.
a. La posture permanente de sûreté aérienne
Lors de son audition par les rapporteurs, le général André Lanata, chef d’état-major de l’armée de l’air, a déclaré que l’armée de l’air est très attachée à sa mission de protection sur le territoire national, mission qu’elle « n’a pas découvert en 2015 ». En effet, la protection de l’espace aérien du territoire national constitue une mission permanente de l’armée de l’air, à laquelle sont attachés une structure de commandement, des moyens et des procédures spécifiques ; l’ensemble est appelé « posture permanente de sûreté aérienne » (PPSA). Le chef d’état-major de l’armée de l’air a souligné que la doctrine déclinant le contrat opérationnel de protection identifie la chaîne de commandement de la PPSA comme le premier échelon de conduite des opérations dans l’espace aérien national.
De surcroît, l’armée de l’air assurait déjà la protection du site de Balard (avec 32 aviateurs), et elle a apporté une contribution permanente de 110 hommes à l’opération Sentinelle ‒ ce qui correspond à son contrat opérationnel ‒ avec des « pics » supérieurs à ce niveau.
i. L’espace aérien, un milieu dans lequel les armées sont les forces « primo-intervenantes »
La posture permanente de sûreté aérienne (PPSA) fait partie, avec la composante aéroportée de la dissuasion, des deux missions permanentes de l’armée de l’air. Dans le cadre de la protection du territoire, la PPSA comprend deux types de dispositifs, permanents et temporaires.
• La composante permanente de la PPSA
La composante permanente du dispositif de PPSA vise à assurer la protection du territoire national contre les menaces aériennes. Parmi les missions du dispositif permanent de la PPSA figure aussi l’assistance en vol à des aéronefs égarés ou en détresse.
Cette composante permanente est pilotée par le centre national des opérations aériennes (CNOA) situé sur la base aérienne 942 de Lyon-Mont Verdun, qui en est le centre de commandement. Les moyens dont elle dispose sont variés : quatre « plots » de chasse (à Orange, Saint-Dizier, Lorient et Mont-de-Marsan) ; quatre « plots » d’hélicoptères (à Orange, Saint-Dizier, Villacoublay, Bordeaux) ; un avion radar AWACS (3) en alerte à six heures (à Avord) ; et un ravitailleur en vol C135 en alerte à 24 heures (à Istres). L’activité de ces appareils est coordonnée avec les pays voisins par des accords bilatéraux et par le biais de l’OTAN.
La PPSA est caractérisée par une « capacité de réactivité considérable », selon les termes du général André Lanata. En effet, dans le cadre de la protection du territoire, des aviateurs entraînés sont mobilisés 24 heures sur 24 et doivent pouvoir décoller en moins de sept minutes le jour, 15 minutes la nuit, et deux minutes en cas d’alerte renforcée pour l’aviation de chasse.
En 2015, ce dispositif a donné lieu à 73 décollages d’avions de chasse. Il a ainsi permis d’intercepter deux bombardiers russes Tupolev Tu 160 au-dessus de la Manche le 17 février 2016. La mission d’assistance en vol à des aéronefs égarés ou en détresse mobilise quant à elle près de 414 personnels 24 heures sur 24, dont 210 en poste et les autres placés en alerte, et représente un volume de 120 opérations en moyenne par an, principalement au profit d’avions civils.
• Les dispositifs temporaires mis en place au titre de la PPSA
La posture permanente de sûreté aérienne comprend également des composantes temporaires appelées « dispositifs particuliers de sûreté aérienne » (DPSA). Ces dispositifs sont mis en œuvre afin de renforcer la protection d’événements particuliers et mobilisent des moyens supplémentaires tels que des systèmes sol-air, des avions de chasse et des hélicoptères.
En 2015, les DPSA ont été mis en œuvre à quatre reprises pour sécuriser notamment le salon du Bourget et la COP 21, mobilisant 650 personnels dont 500 aviateurs et mettant également en œuvre des moyens de lutte contre les mini drones. Les DPSA sont de plus en plus fréquents : ils étaient au nombre de deux en 2013, trois en 2014 et quatre en 2015 ; six sont prévus en 2016.
• Les autres domaines d’intervention de l’armée de l’air sur le territoire national
Le général André Lanata a également cité d’autres domaines d’intervention de l’armée de l’air sur le territoire national, moins visibles que la PPSA. Ainsi, dans le cadre de sa mission de protection du territoire national, l’armée de l’air est engagée dans les missions menées au titre de la « sauvegarde générale », dans le volet terrestre de la protection du territoire national et dans la protection des emprises aériennes.
Au titre de la « sauvegarde générale », l’armée de l’air contribue au dispositif Hephaïstos de prévention des incendies, ainsi qu’à la mission de recherche et sauvetage en mer (Search and Rescue). Elle contribue également au plan Neptune de gestion d’une crue de la Seine. De même, l’armée de l’air effectue des « missions d’alerte transports », c’est-à-dire de missions de transport ou de protection des transports prioritaires comme des déplacements aériens des hautes autorités de l’État. Par exemple, après les attentats du 13 novembre, ce sont les avions de l’armée de l’air qui ont assuré le transport de Pau à Paris des renforts de l’opération Sentinelle. De plus, les aviateurs sont souvent les premiers à accéder à certaines zones de catastrophes naturelles et à apporter les premiers secours. Tel a été le cas des deux CASA CN-235 stationnés en Nouvelle-Calédonie qui ont apporté en février 2016 les premiers secours aux habitants de certaines îles fidjiennes après le passage du cyclone Winston, et ont fourni à ces îles une station de purification d’eau ainsi que du matériel de reconstruction. Enfin, les aviateurs mettent leur expertise en matière d’opérations en milieu nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) : les groupes d’intervention NRBC des bases aériennes sont prêts à intervenir en cas de besoin.
Au titre du volet terrestre de la protection du territoire national, en plus de la protection du site de Balard, l’armée de l’air mobilise 110 personnels en permanence, principalement dans les aéroports de Nice, de Bordeaux et d’Orly.
Enfin, la protection des emprises aériennes fait partie intégrante de ses missions sur le territoire national. En effet, selon le général André Lanata, « les bases aériennes constituent de véritables systèmes de combat de l’armée de l’air » car c’est en leur sein que les aviateurs s’entraînent et opèrent partout dans le monde ; leur protection revêt donc une importance particulière. 2 400 personnels sont en permanence engagés dans la protection de ces emprises.
ii. Une mission permanente, qui mobilise une part substantielle des moyens de l’armée de l’air
L’armée de l’air engage des niveaux d’effectifs et de moyens matériels très élevés sur le théâtre national, aussi bien dans le cadre de missions qui lui sont assignées à titre principal qu’en appui des autres armées en cas de crise. Le niveau d’engagement actuel est d’ailleurs tel qu’il risque de créer des tensions dans l’emploi des capacités de l’armée de l’air.
• L’armée de l’air mobilise des moyens importants au service de la protection du territoire national
Le rapport fait par notre collègue Christophe Guilloteau sur les crédits de l’armée de l’air pour 2016 (4) relève qu’en moyenne, 3 515 aviateurs et 25 aéronefs sont engagés tous les ans dans la protection du territoire national. À titre d’exemple, les missions Harpie de lutte contre les sites d’orpaillage clandestins en Guyane et Titan de protection du centre spatial guyanais mobilisent à elles seules 613 personnels de l’armée de l’air. Le rapport souligne également que la protection du territoire national a donné lieu à une activité intense de l’armée de l’air en 2014 et en 2015, avec 108 décollages d’avions de chasse d’alerte en 2014 et 54 au 30 septembre 2015.
Par comparaison, le personnel de l’armée de l’air affecté aux OPEX est moindre, avec 1 060 militaires engagés, même si le nombre d’aéronefs mobilisés, 71, est plus important.
• Cette sollicitation de plus en plus intense risque d’ailleurs de créer des tensions dans l’emploi des forces aériennes
S’agissant des équipements, le général Lanata a fait état de difficultés de financement du maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels. En effet, le niveau d’engagement de l’armée de l’air dépassant ce qui est prévu par son contrat opérationnel, sa suractivité appelle un surcroît de dépenses de MCO que l’abondement prévu par l’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) ne compense selon lui que partiellement.
Le général Lanata a également présenté comme un véritable défi le renouvellement des équipements de l’armée de l’air. Entre autres difficultés, il a signalé que les drones Reaper commandés ne seront pas immédiatement employables sur le territoire national, ce qui pourrait conduire à devoir prolonger la durée de service des drones Harfang, laquelle prolongation supposerait « un surcroît de crédits de MCO » ; sans une telle prolongation, toutefois, il y a un « vrai risque de rupture capacitaire ».
Les tensions sont également vives en ce qui concerne les ressources humaines. Les effectifs engagés sur le théâtre national sont élevés et l’allégement des déflations ne suffit pas à dissiper ces tensions. En effet, le chef d’état-major de l’armée de l’air a indiqué aux rapporteurs que la déflation des effectifs de l’armée de l’air depuis plusieurs années rendait aujourd’hui la montée en puissance compliquée. Selon lui, « déflater est relativement facile, remonter en puissance ne l’est pas », et l’application des objectifs quantitatifs de déflation des effectifs dans les années passées a pu déséquilibrer la « cohérence organique » de l’armée de l’air. Il a aussi fait valoir que l’augmentation des effectifs programmée en 2015 ne pourra pas produire d’effets immédiats du fait de la durée de formation des personnels, particulièrement longue dans le domaine aéronautique ‒ par exemple, il faut deux à trois ans pour former un mécanicien compétent pour un Rafale. Le chef d’état-major de l’armée de l’air a conclu que pour ces raisons, sa principale préoccupation porte sur la manœuvre des ressources humaines.
b. La posture permanente de sauvegarde maritime
La marine nationale participe à la protection du territoire national dans le cadre de la posture permanente de sauvegarde maritime. À ce titre, elle assure la défense de l’espace maritime national contre toute menace en milieu maritime ; l’ensemble des capacités et des procédures qu’elle y consacre constitue la « posture permanente de sauvegarde maritime » (PPSM). Un déplacement à Toulon a permis aux rapporteurs d’étudier ce dispositif de façon approfondie.
i. Une mission interministérielle confiée à la marine nationale
La PPSM correspond par nature à une mission interministérielle, pour laquelle l’organisation administrative a été mutualisée.
• Une mission interministérielle
La protection maritime du territoire national comprend un ensemble de missions relevant de trois fonctions distinctes :
1°/ La préfecture maritime : à l’image des préfets de département et de région, le préfet maritime est « délégué du gouvernement » (5) pour un territoire maritime précis, représentant direct du Premier ministre. Investi d’un pouvoir de police administrative générale en mer, il a autorité dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’État en mer, comme par exemple la défense des droits et intérêts de la France dans ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive ; le maintien de l’ordre public ; le secours et la sécurité maritimes ; la protection de l’environnement ; la lutte contre les activités illicites en mer (pêche illégale, trafic de stupéfiants, migrations clandestines, etc.). À ce titre, le préfet maritime coordonne l’action en mer des administrations et la mise en œuvre de leurs moyens (marine nationale, affaires maritimes, douanes, gendarmerie, etc.).
2°/ Le commandement d’arrondissement maritime. En application du décret n° 2015-211 du 25 février 2015 relatif à l’organisation du soutien de la défense et portant réforme du commandement organique territorial, le commandant d’arrondissement maritime exerce les responsabilités suivantes :
‒ le commandement militaire du port de Toulon, grand port de projection stratégique avec ses quais, ses infrastructures industrialo-portuaires, ses deux pyrotechnies dont une en ville, etc.
‒ l’autorité organique de formations multiples ne relevant pas des quatre « autorités organiques fonctionnelles » (6) de la marine ;
‒ la coordination de l’action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes, en particulier les deux services de soutien spécifiques : le service de soutien de la flotte (SSF) et le service logistique de la marine (SLM) ;
‒ la protection la défense des installations de la marine sises dans sa zone de responsabilité ;
‒ la sécurité nucléaire du port, ainsi que la sécurité environnementale (l’arrondissement comprenant plusieurs sites SEVESO III) et la mise en œuvre de la réglementation en matière d’environnement et de développement durable ;
‒ l’expression des besoins et le suivi de l’exécution de la programmation financière en matière d’opérations d’infrastructure opérationnelle et de stationnement des unités, avec deux chantiers majeurs qui arrivent à maturité en 2017 : l’accueil du premier sous-marin nucléaire d’attaque de classe Barracuda (le Suffren), et celui des frégates multi-missions (FREMM) ;
‒ les relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions, les fonctions « ressources humaines » et le « rayonnement ».
3°/ Le commandement de zone maritime : le commandant de zone maritime exerce une autorité opérationnelle sur les forces navales déployées dans sa zone de compétence ‒ c’est-à-dire qu’il est chargé de la conduite de toutes les opérations navales et aéronavales ‒, sauf si une autre autorité a été désignée à cet effet. Exerçant un commandement interarmées, il est placé sous l’autorité directe du chef d’état-major des armées et exerce, pour le compte de celui-ci, le contrôle opérationnel des forces maritimes qui opèrent dans sa zone de responsabilité. Le commandant de zone maritime est, en métropole, chargé de la défense maritime du territoire ; outre-mer, il assiste le commandant supérieur interarmées pour lui permettre d’assurer leurs responsabilités dans ce domaine.
• Une organisation administrative mutualisée
Les rapporteurs ont pu constater lors de leur déplacement à Toulon que pour la Méditerranée ‒ comme pour l’ensemble du territoire métropolitain (7) ‒ le choix a été fait de mutualiser ces compétences. Cette mutualisation se traduit à deux égards :
‒ en confiant à un seul et même officier général les trois fonctions de préfet maritime de la Méditerranée, de commandement de l’arrondissement maritime Méditerranée et de commandant de la zone maritime Méditerranée – on parle communément de « triple casquette » de l’amiral ;
‒ en dotant cet officier général, pour l’exercice de ses trois fonctions distinctes, d’un seul et même état-major. Comme l’ont expliqué aux rapporteurs l’adjoint « opérations » et l’adjoint chargé de l’action de l’État en mer de l’amiral Yves Joly, commandant en chef de la Méditerranée (CECMED), cet état-major commun permet non seulement d’économiser des moyens, mais aussi de donner « une certaine transversalité » dans l’exercice des trois fonctions de l’amiral.
Au sein de cet état-major commun, un centre des opérations joue à la fois les rôles de « centre des opérations » au profit de l’autorité militaire et de « centre des opérations maritimes » au titre de la préfecture maritime ‒ le COM.
Aux yeux des adjoints précités de l’amiral Joly, l’efficacité de cette organisation résulte de sa simplicité, qui tient :
‒ à la « coïncidence des chaînes de commandement préfectorale et militaire » : ils soulignent que « contrairement à la force Sentinelle, les militaires chargés de la protection des approches maritimes du territoire national ne sont pas employés sur réquisition au service d’un autre ministère » ;
‒ à l’étendue des prérogatives du préfet maritime, commandant en chef de la Méditerranée, qui « a le pouvoir d’ordonner l’emploi de la force sur tous les moyens présents dans l’ensemble de la Méditerranée », ce qui permet de dépasser les eaux territoriales et la zone économique exclusive, pour aller jusqu’aux limites de la souveraineté des autres États côtiers de la Méditerranée.
La « triple casquette » de l’amiral a ainsi pour avantage de faciliter la dimension interministérielle de l’exercice de ses missions. Cette organisation interministérielle se lit aussi à des échelons de commandement inférieurs : ainsi, les officiers de marine commandants de bâtiments ont des prérogatives juridiques leur permettant de constater certaines infractions, par exemple en matière de stupéfiants ou de terrorisme.
ii. Un dispositif de protection du territoire national gradué « dans la profondeur » du milieu marin
La posture permanente de sauvegarde maritime (PPSM) recouvre plusieurs types de missions, comme le montre le tableau ci-après.
LES MISSIONS ASSURÉES AU TITRE DE LA POSTURE PERMANENTE
DE SAUVEGARDE MARITIME (PPSM)
● Missions spécifiquement militaires : | |
‒ surveillance des approches maritimes | |
‒ mise en œuvre du volet maritime du plan Vigipirate | |
● Missions relevant de l’action de l’État en mer : | |
‒ recherche et sauvetage en mer | |
‒ police des pêches | |
‒ lutte contre les pollutions en mer | |
‒ lutte contre les trafics illicites | |
Comme l’a expliqué aux rapporteurs l’amiral Yves Joly, commandant en chef de la Méditerranée et préfet maritime de la Méditerranée, la dynamique des menaces et des opérations maritimes nécessite le déploiement d’un dispositif de protection gradué « dans la profondeur ». Cette stratégie est liée aux contraintes particulières du milieu marin est cohérente avec la mutualisation des trois fonctions de l’action de l’État en mer évoquée précédemment.
• Ce dispositif répond aux contraintes spécifiques du milieu marin
Deux types de contraintes expliquent le dispositif de protection du territoire national gradué « dans la profondeur » du milieu marin :
‒ les contraintes opérationnelles liées au milieu marin : l’amiral a en effet fait valoir aux rapporteurs que les distances et les modes de transports propres au milieu maritime constituent une contrainte dans la gestion des crises. Il en résulte que si, dans un scénario d’attaque tel que celui du Bataclan, les forces publiques peuvent intervenir à terre dans un délai compris entre vingt minutes pour les primo-intervenants et une heure pour les forces spécialisées, en mer, une intervention du GIGN ou des commandos de marine n’est envisageable que dans un délai de trois ou quatre heures au moins ;
‒ les contraintes administratives liées au droit de la mer : le capitaine de vaisseau Gilles Boidevezi, adjoint « opérations » de l’amiral, et le commissaire général Hervé Parlange, son adjoint chargé de l’action de l’État en mer, ont ainsi indiqué aux rapporteurs que pour contrôler, en dehors des eaux territoriales, un navire battant pavillon étranger suspecté de trafic de drogue, les autorités françaises chargées de l’action de l’État en mer doivent saisir le ministère des Affaires étrangères pour que celui-ci saisisse à son tour notre poste diplomatique auprès de l’État dont relève le pavillon en cause, afin d’obtenir des autorités de cet État un accord écrit aux mesures de contrôle envisagées. La préfecture maritime doit alors réunir les moyens interministériels nécessaires (notamment les moyens de la marine nationale et des douanes), pour enfin pouvoir conduire le contrôle envisagé. Cette procédure est longue au regard des temps de parcours en Méditerranée : à vitesse modérée, il ne faut pas plus de 48 heures pour passer de Gibraltar au sud de la Sardaigne. Il faut donc anticiper au mieux les interventions.
• Une gradation des compétences
La réunion des trois fonctions de préfet maritime, commandant d’arrondissement maritime et commandant de zone maritime est cohérente avec ce choix d’un dispositif de protection gradué « dans la profondeur » du milieu marin. En effet, les compétences qui sont ainsi agrégées s’étendent sur des zones qui s’échelonnent depuis les côtes françaises :
‒ sur la côte, la sécurité des ports militaires et des installations nucléaires de la Défense, qui relève du commandement de l’arrondissement maritime ;
‒ dans les eaux territoriales, la police générale, qui relève de la préfecture maritime ;
‒ sur l’ensemble de Méditerranée (du territoire national aux zones de crises telles que la Syrie ou la Libye), la défense maritime.
Ainsi s’établit un continuum dans l’action de l’État en mer, qui correspond à la géographie des menaces et des trafics qui la sous-tendent (stupéfiants, armes, etc.). Ainsi, comme le dit l’amiral Yves Joly, « Toulon pilote différentes fonctions qui se renforcent mutuellement : ordre public en mer et défense maritime du territoire ». Le schéma ci-après illustre comment cette organisation permet à la même autorité, utilisant les mêmes moyens, de mettre en œuvre successivement différentes prérogatives pour traiter un même cas (par exemple une embarcation suspecte) de façon évolutive en fonction des situations et du niveau de crise.
ARTICULATION DES PRÉROGATIVES
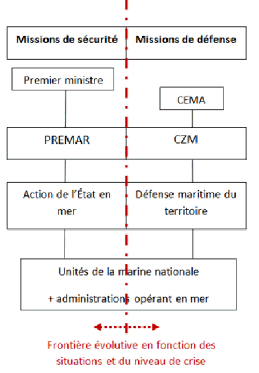
Source : état-major du commandant en chef de la Méditerranée, préfet maritime de la Méditerranée.
• Une part importante des moyens de la marine nationale
La protection maritime du territoire national mobilise 3 780 marins, dont 3 280 en métropole, sur 38 874 personnels au 1er janvier 2015. Le tableau ci-après détaille leurs affectations.
EFFECTIFS DE LA MARINE NATIONALE
CONCOURANT À LA PROTECTION MARITIME DU TERRITOIRE NATIONAL
métropole |
outre-mer |
total | |
gendarmerie maritime |
900 |
110 |
700 |
moyens aéronavals |
220 |
120 |
340 |
sémaphores et CROSS |
800 |
40 |
840 |
alertes CTM et NEDEX |
70 |
20 |
90 |
centres des opérations maritimes |
40 |
10 |
50 |
fusiliers marins |
1 250 |
200 |
1 450 |
total |
3 280 |
500 |
3 780 |
CROSS : centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage ; CTM : centre de transmissions de la marine ; NEDEX : neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs.
Source : formation opérationnelle de surveillance et d’information territoriale de Toulon.
Le dispositif mis en place pour assurer la posture permanente de sauvegarde maritime comprend un réseau d’information et une capacité d’action continue avec des avions de patrouille maritime ou des hélicoptères de la marine ; un bâtiment de la flotte affecté à la posture permanente de sauvegarde maritime ; la gendarmerie maritime ; la chaîne des sémaphores (aussi appelés « vigies » à l’entrée des ports) ; les moyens des autres administrations intervenant en mer (notamment les douanes et l’administration des affaires maritimes). Lors de leur déplacement à Toulon, les rapporteurs se sont attachés à dresser un bilan précis de ces équipements, que présente l’encadré ci-après.
Les moyens consacrés à la posture permanente de sauvegarde maritime
● La marine nationale dispose en théorie de 22 avions de patrouille maritime Atlantique 2 concentrés à Lann Bihoué (près de Lorient) depuis 2009 ; l’âge avancé de cet appareil (en service depuis 25 ans) et le programme de rénovation de quinze appareils de cette flotte, lancé en 2013, font cependant que la marine n’en compte que douze « en ligne », c’est-à-dire opérationnels. L’appareil est relativement lent (il met 1 h 40 pour rallier Toulon depuis Lorient) mais très autonome : il peut voler 18 heures de suite. Pour le commandement à Toulon, « c’est un avion extraordinaire, et c’est d’ailleurs pour cela qu’il et très employé en opérations extérieures », sauf dans les situations appelant une intervention rapide : dans ce cas, la vitesse du Falcon 50 (un biréacteur) constitue un atout décisif.
Sur la base aéronavale d’Hyères, a été présenté aux rapporteurs un des Falcon 50 utilisés pour les missions de surveillance des approches maritimes, de recherche et de sauvetage en mer. Les appareils de ce type aujourd’hui en service sont regroupés au sein de la flottille 24F, sur la base de Lann-Bihoué près de Lorient, et détachés à Toulon, à une heure de vol, ce qui en limite l’emploi en cas d’urgence.
Au titre de la surveillance des approches, selon les précisions fournies aux rapporteurs par le capitaine de vaisseau Ludovic Segond, commandant de la base aéronavale d’Hyères, ces appareils sont censés effectuer un vol par jour, mais du fait du manque de moyens, ils n’en effectuent que la moitié.
Au titre de la recherche et du sauvetage en mer, d’après les explications de l’équipage, la moitié seulement des Falcon 50 en service est dotée de la trappe permettant le lancement de la « chaine SAR » (pour Search and Rescue, recherche et sauvetage en mer), c’est-à-dire l’équipement de sauvetage lancé aux personnes en détresse en mer. La miniaturisation de cet équipement, encore en cours, facilitera son déploiement sur l’ensemble de la flotte. Le Falcon 50 effectue ainsi cinq sauvetages par an en moyenne.
Sur la même base, la marine opère également des hélicoptères, parmi lesquels les 16 Panther français, dont l’un a embarqué les rapporteurs pour une mission de surveillance maritime et de transport d’autorité.
● Les quatre avisos basés à Toulon (parmi lesquels l’Enseigne de vaisseau Jacoubet sur lequel ont embarqué les rapporteurs) assurent 160 jours de mer par an. La permanence n’est donc pas complète, mais complétée par une alerte à 24 heures. Pour le commandement, « c’est le mieux que la marine puisse faire compte tenu des contraintes pesant sur les personnels et ses moyens ».
Comme l’a expliqué au rapporteur le capitaine de corvette Guillaume Soubirant, commandant de l’aviso Jacoubet, la protection des approches dans la profondeur justifie l’emploi de « moyens relativement lourds, tel l’aviso » (dit aussi « patrouilleur de haute mer ») qui « intervient, schématiquement, entre 12 miles nautiques et l’infini : dans les eaux territoriales, les moyens de la gendarmerie maritime sont le plus souvent suffisants ».
● La gendarmerie maritime dispose d’un patrouilleur et de vedettes couvrant les eaux territoriales : il s’agit essentiellement de moyens de surveillance et de contrôle, qui ne sont guère adaptés pour arrêter un bateau récalcitrant s’il est de taille significative.
● Une chaîne de sémaphores (12 sur la côte continentale et sept en Corse) équipés de radars, de récepteurs AIS, coordonnée par la formation opérationnelle de surveillance et d’information territoriale (FOSIT) de Toulon, surveille en permanence la côte. Les sémaphores sont reliés au COM par un système de partage de l’information qui permet de mettre en commun l’information de tous les sémaphores et du COM.
Les rapporteurs ont pu se déplacer sur un des points d’observation, la vigie de Cépet à Saint-Mandrier-sur-mer. Comme l’a expliqué aux rapporteurs le capitaine de corvette Patrick Evanno, commandant de la FOSIT de Toulon, chaque sémaphore, armé par une dizaine de personnels, collecte et traite l’information maritime dans son volume de détection ‒ leur portée efficace atteint 24 miles nautiques ‒, et la diffuse vers le centre opérationnel de la marine (COM), les douanes, la gendarmerie maritime et tous autres acteurs intéressés ; les sémaphores contribuent ainsi au recueil du renseignement d’intérêt maritime. Le FOSIT, quant à lui, compte une centaine de personnels ; selon un récent rapport d’audit, cet effectif constituerait un très strict minimum, permis par la mutualisation très poussée des moyens relevant de l’amiral CECMED, préfet maritime de la Méditerranée.
Les sémaphores servent également au sauvetage en mer : ils transmettent leurs informations au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), et selon le FOSIT, 90 % des 500 opérations que conduit le CROSS chaque année en moyenne ‒ secourant ainsi 350 personnes ‒ résultent d’alertes données par les sémaphores.
Selon les précisions fournies par les personnels de la vigie de Cépet, les radars détectent tout bâtiment qui possède un réflecteur, mais pas toujours les petits navires de pêche ; cela explique qu’il faille encore croiser les informations par une veille visuelle.
En outre, la portée des sémaphores est telle que dès lors qu’une embarcation est détectée, les moyens d’intervention n’ont que deux heures pour réagir. C’est pourquoi une vedette rapide de la gendarmerie maritime se tient en permanence en alerte à 30 minutes, ce qui mobilise une part conséquente des 350 personnels que compte le groupement de gendarmerie maritime de Toulon.
Le dispositif de protection maritime du territoire national a connu certaines inflexions depuis les attentats de 2015 :
‒ l’amiral Yves Joly, CECMED et préfet maritime, a indiqué aux rapporteurs que « la surveillance des approches est devenue une priorité, tant pour l’allocation des moyens que parmi les sujets de préoccupation ». Ainsi, « on a resserré les mailles du filet, et l’on admet moins d’impasses qu’avant – par exemple en cas d’indisponibilité d’un avion » ;
‒ la coopération permettant d’optimiser des moyens comptés, un accord sur les modalités de contrôle en mer a été conclu avec les principales compagnies maritimes, et devrait produire ses effets sous peu ;
‒ selon l’amiral, les liens « ont été resserrés » en matière de renseignement entre le centre des opérations de Toulon et la gendarmerie maritime ;
‒ ses adjoints chargés des opérations et de l’action de l’État en mer ont aussi indiqué aux rapporteurs que le secrétariat général de la mer « étudie la possibilité de mettre en place des personnels armés dans les bateaux de transport de personnel » (c’est-à-dire les navires de croisière) afin que ceux-ci puissent, en cas d’attaque terroriste, « riposter comme primo-intervenants » ; d’ailleurs, selon eux, « les armateurs demandent l’extension aux bâtiments de passagers de la loi sur les équipes de protection embarquées », soulignant que les entreprises fournissant ces équipes, leurs dirigeants et leurs employés font l’objet d’homologation par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) : « c’est donc sécurisé ».
2. Dans le milieu terrestre, les armées ont depuis longtemps pour mission de renforcer les forces de sécurité intérieure en cas de crise
Si, contrairement à ce qui est prévu dans les milieux maritime et aérien, les armées ne sont pas « primo-intervenantes » dans le milieu terrestre sur le territoire national, il n’en reste pas moins qu’il est prévu depuis longtemps qu’elles puissent y être déployées, en renfort des autorités civiles et sous l’autorité de celles-ci.
a. Un cadre juridique et une organisation déjà anciens
L’engagement des armées sur le territoire national, notamment dans le milieu terrestre, fait l’objet d’un encadrement juridique déjà ancien. Celui-ci est organisé de façon à garantir le caractère subsidiaire du recours aux armées : elles n’ont pas vocation à se substituer durablement aux administrations civiles, et demeurent en tout temps ‒ hors état de siège ‒ subordonnées aux autorités civiles tant au niveau national ‒ auquel le ministre de l’Intérieur assure la direction de l’ensemble des forces ‒ qu’au niveau territorial, où une chaîne de commandement militaire spécifique est placée sous l’autorité des préfets.
i. Un cadre juridique traditionnel, organisé autour du principe de subordination de la force armée à l’autorité civile et de la « règle des quatre “i” »
• Le primat des autorités civiles
Comme le rappelle la directive interarmées du 23 novembre 2010 sur l’emploi de la force dans le cadre des missions intérieures en milieu terrestre (8), « la capacité des armées à maîtriser la force à tous les niveaux, leur vocation à être l’ultima ratio regum (9), leur aptitude à intervenir à la fois sur et hors du territoire national, leur autonomie dans un environnement rude, font de celles-ci un outil opérationnel aux capacités duales » que le Gouvernement peut employer sur le territoire national. Cet engagement est cependant « encadré par le droit, qui exprime la prééminence du pouvoir politique légitime ».
Ainsi, les missions confiées aux armées sont définies par le Premier ministre et, comme le souligne la doctrine, « sur le territoire national, les missions de sécurité sont placées sous la responsabilité du ministre de l’Intérieur, qui définit l’état final recherché » (c’est-à-dire l’objectif assigné aux armées). Le Livre blanc de 2008 sur la défense et la sécurité nationale a d’ailleurs consacré le rôle prédominant du ministère de l’Intérieur dans la gestion des crises survenant sur le territoire national, en prévoyant que « le ministre de l’intérieur, chargé de la sécurité intérieure, ainsi que de la sécurité et de la protection civiles, dans l’acception élargie que recevront ces termes dans les codes de la défense et de la sécurité intérieure, assurera, au niveau opérationnel, la conduite interministérielle de la crise sur le territoire ». C’est ainsi le ministre de l’Intérieur qui est chargé de la conduite opérationnelle de la gestion des crises sur le territoire national ; il s’appuie pour ce faire sur le centre de gestion interministérielle de crise situé au sein de son ministère, place Beauvau, où est activée la cellule interministérielle de crise (CIC). Cette orientation a été confirmée par le Livre blanc de 2013.
En sa qualité de conseiller militaire du Gouvernement, le chef d’état-major des armées est responsable de l’emploi des forces et assure le commandement des opérations militaires sous le contrôle du Gouvernement. La doctrine précise que c’est avec l’accord du ministre de la Défense qu’il détermine en détail la mission confiée aux armées sur le territoire national, les moyens humains et matériels engagés et la durée de l’engagement.
• Une condition de réquisition légale
La procédure suivant laquelle des missions intérieures peuvent être confiées aux armées est elle aussi organisée de façon à marquer ce primat des autorités civiles, dans un cadre interministériel. En effet, les armées peuvent être engagées sur le territoire national en milieu terrestre suivant deux procédures :
‒ la « demande de concours » : comme l’explique la doctrine (10), certains départements ministériels ou les services déconcentrés de l’État peuvent être amenés à solliciter à titre occasionnel un renforcement ou un complément de la part des armées. La demande est transmise par le préfet de zone de défense et de sécurité (PZDS) à l’officier général de la zone (OGZDS) ;
‒ la réquisition par une autorité administrative ou judiciaire, qui trouve son fondement notamment à l’article L. 1321-1 du code de la défense, selon lequel « aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale ».
Le régime de la réquisition est précisé par les articles R. 1321-1 et D. 1321-2 à D. 1321-10 du code précité ainsi que par l’instruction interministérielle n° 10100/SGDSN/PSE/PPS/CD du 3 mai 2010 relative à l’engagement des armées sur le territoire national. Il en ressort que les réquisitions administratives pour la défense et la sécurité civiles sont délivrées dans le cadre :
‒ du maintien de l’ordre public ;
‒ d’une atteinte à la sécurité publique en situation d’urgence ;
‒ de la lutte contre le terrorisme ;
‒ d’une crise majeure sur le territoire national.
Les réquisitions administratives sont adressées par le préfet de zone de défense et de sécurité (voire par le préfet de département) à l’officier général de la zone. En cas d’urgence, les réquisitions peuvent être délivrées directement au commandant de la formation ou de l’organisme requis, qui en informe alors l’OGZDS. La doctrine précise que « leur rédaction doit faire l’objet d’une concertation étroite entre l’officier général de zone de défense et de sécurité (ou son représentant, le délégué militaire départemental ‒ DMD), le préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de département ou le représentant de l’État ». L’officier général de zone de défense et de sécurité ainsi saisi transmet immédiatement la réquisition au centre de planification et de conduite des opérations de l’état-major des armées.
Des réquisitions peuvent également être formées par une autorité judiciaire dans le cadre de la constatation d’une ou plusieurs infractions et la recherche du ou de ses auteurs. Il peut s’agir, par exemple, de requérir l’engagement des maîtres-chiens spécialisés dans la recherche d’explosifs, ou d’utiliser dans le même cadre des matériels spécifiques, comme des appareils de détection.
• Un large spectre de missions
Comme le montre l’encadré ci-après, le périmètre de ces missions, qui correspond à la notion de « sauvegarde générale » du concept d’emploi des forces, est très large. La « sauvegarde générale » constitue, comme la contribution à la stabilité internationale et la participation à un conflit majeur, l’un des trois grands ensembles de missions définis par le concept d’emploi des forces.
Périmètre des missions intérieures qui peuvent être confiées aux armées
en milieu terrestre sur le territoire national
Les missions sur le territoire national se rattachent aux principaux domaines ci-après, sans ordre de priorité ni exclusivité :
a. Lutte contre le terrorisme, notamment international ;
b. Lutte contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;
c. Lutte contre le trafic d’êtres humains et l’immigration illicite organisée ;
d. Lutte contre le trafic d’armes, de constituants d’armes et la prolifération ;
e. Lutte contre la piraterie, concernant notamment des intérêts nationaux ;
f. Lutte contre les atteintes à l’environnement ;
g. Sûreté du territoire et de ses approches ;
h. Protection des secteurs d’activités d’importance vitale ;
i. Protection des grands événements sur le territoire national ;
j. Protection des ressources matérielles et immatérielles nationales ou d’intérêt national (par exemple pour des missions de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane) ;
k. Aide et secours d’urgence aux populations en situation grave ;
l. Soutien à la liberté d’action gouvernementale ;
m. Soutien au maintien de la cohésion nationale.
Source : État-major des armées, directive interarmées sur l’emploi de la force dans le cadre des missions intérieures, hors états d’exception (milieu terrestre) n° D-10-00-002077/DEF/EMA/EMP.1/NP du 23 novembre 2010.
• Une place subsidiaire sur le territoire national en milieu terrestre
Lorsqu’elles interviennent sur le territoire national en milieu terrestre, les armées ne sont pas, par principe, « primo-intervenantes » et, s’agissant de missions de sécurité, ne sont pas employées en première ligne. Plusieurs éléments du droit applicable attestent du caractère subsidiaire de la place des armées sur le sol national par rapport aux forces et aux moyens civils.
D’une part, de façon générale, le concours des armées ne peut être requis pour des missions de sécurité intérieure et de sécurité civile que lorsque les autres moyens des administrations ‒ y compris ceux de la gendarmerie nationale ‒ s’avèrent inexistants, insuffisants, inadaptés ou indisponibles. Ce principe est communément appelé « règle des quatre “i” ».
D’autre part, le code de la défense prévoit expressément que même si les armées devaient être réquisitionnées pour être employées au maintien de l’ordre, elles prennent rang en troisième position dans la classification graduée des forces établie par l’article D. 1321-6 du même code, qui distingue :
‒ les forces de première catégorie, c’est-à-dire les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine, qui assurent « quotidiennement et d’initiative » le maintien de l’ordre public ;
‒ les forces de deuxième catégorie, constituées par les formations de la gendarmerie mobile, qui forment « une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l’ordre » selon l’article D. 1321-8 de ce code ;
‒ les forces de troisième catégorie, c’est-à-dire les armées, dont l’article D. 1321-9 du même code dispose qu’elles sont destinées : « à des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police » et « à des missions de protection », et que ce n’est qu’« en dernier ressort » qu’elles « peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles ».
Il en ressort que le droit prévoit de longue date la possibilité d’employer les armées sur le territoire national en tout milieu, mais qu’à la différence des dispositions concernant la protection des approches maritimes du territoire national par la marine nationale et la protection de l’espace aérien national par l’armée de l’air, celles relatives à l’emploi des armées sur le territoire national en milieu terrestre placent clairement les armées dans une position subsidiaire par rapport aux moyens civils des administrations.
ii. Une chaîne de commandement spécifique : l’organisation territoriale interarmées de défense (OTIAD)
• Un zonage ad hoc
Pour les missions de sécurité intérieure, de sécurité civile ou de service public confiées aux armées en milieu terrestre sur le territoire national, une chaîne de commandement spécifique a été instituée par le décret no 50-1189 du 29 septembre 1950 relatif à l’organisation de la défense en surface du territoire métropolitain et réformée à plusieurs reprises depuis : l’organisation territoriale interarmées de défense (OTIAD), qui repose sur un découpage du territoire national en sept zones de défense et de sécurité (ZDS) en métropole et cinq dans les outre-mer, comme l’illustre la carte ci-après.
CARTE DES ZONES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
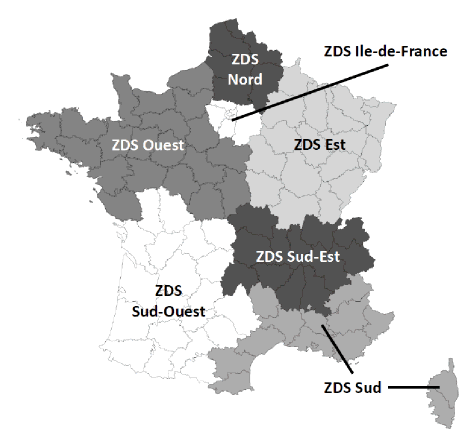
• La chaîne de commandement de l’OTIAD
Cette chaîne de commandement est, comme le souligne la doctrine, « structurée en miroir de la chaîne décisionnelle préfectorale », comme le montre le schéma ci-après. Elle comprend ainsi trois niveaux :
‒ au niveau national, elle est placée sous l’autorité du chef d’état-major des armées, qui dispose pour la piloter de l’état-major des armées, et notamment du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) ;
‒ au niveau régional, chaque zone est placée sous l’autorité d’un préfet de zone de défense et de sécurité qui a pour conseiller militaire un officier général de zone de défense et de sécurité, placé sous l’autorité directe du chef d’état-major des armées, dont il est le représentant dans la zone. Le préfet de zone fixe à l’OGZDS des objectifs en matière de sécurité nationale, dans le respect des prérogatives du chef d’état-major des armées ;
‒ au niveau départemental, elle est représentée par un délégué militaire départemental, représentant de l’OGZDS dans le département et conseiller militaire du préfet.
CHAÎNE DE COMMANDEMENT
DE L’ORGANISATION TERRITORIALE INTERARMÉES DE DÉFENSE (OTIAD)
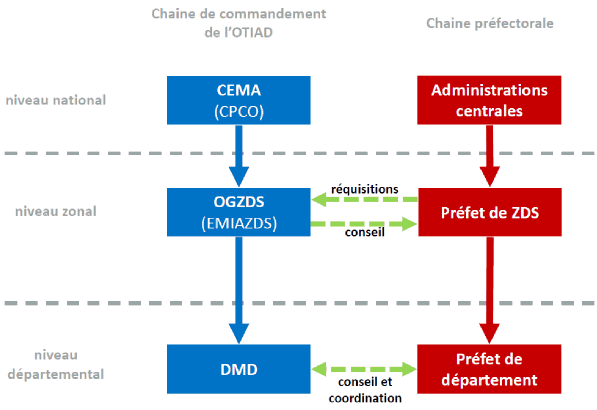
Cette organisation vise, selon la doctrine, à « entretenir le dialogue civilo-militaire », « conseiller les autorités civiles sur l’emploi des armées » et, « surtout », disposer d’une « structure permanente de commandement interarmées au niveau zonal et départemental ».
• Le rôle des états-majors interarmées de zone de défense
Dans chaque zone de défense et de sécurité métropolitaine, les structures de l’OTIAD sont regroupées au sein d’un organisme interarmées, comprenant notamment un état-major interarmées de zone de défense et de sécurité (EMIAZDS). Cet état-major permet à l’officier général de zone de défense et de sécurité d’assurer une veille opérationnelle, de planifier les engagements et d’assurer le contrôle opérationnel des forces engagées. Constitué en temps normal d’un effectif restreint, il doit pouvoir agréger des renforts. Le chef d’état-major de l’armée de l’air a ainsi indiqué, à titre d’exemple, que 27 aviateurs avaient renforcé l’état-major interarmées de zone de défense et de sécurité « Sud » d’avril à juillet 2015.
Les rapporteurs ont pu étudier l’activité de l’état-major de la zone de défense et de sécurité d’Île-de-France ‒ le plus sollicité par l’opération Sentinelle ‒ situé à Saint-Germain-en-Laye, en entendant le gouverneur militaire de Paris, qui est l’officier général de cette zone. Le général Bruno Le Ray a souligné que le lancement de l’opération Sentinelle avait donné à l’activité de cet état-major une « couleur différente », en accentuant fortement l’aspect opérationnel de son rôle. Ce changement tient non seulement à l’effectif des personnels engagés – le 7 janvier 2015, le plan Vigipirate ne comptait que 450 soldats déployés à Paris, leur nombre étant passé à 6 500 en quelques jours – mais aussi au « contexte d’emploi très particulier » de la mission, car Paris est « un sujet à l’intérieur du sujet », les armées ayant davantage l’habitude d’être engagées dans des espaces plus ouverts que la capitale. Le général a souligné l’importance d’une bonne coordination entre son état-major et les services la préfecture de police ‒ le préfet de police de Paris étant par ailleurs préfet de la zone de défense et de sécurité ‒, indiquant que même dans l’urgence, « le dialogue avec la préfecture de police a permis, en quelques heures, d’identifier les nouveaux sites à protéger ».
b. Une place importante dans le contrat opérationnel des armées
En plus d’un cadre juridique et doctrinal propre, la possibilité d’un engagement des armées sur le territoire national, pour des missions de protection en milieu terrestre, est inscrite de longue date dans les contrats opérationnels des armées, notamment dans celui de l’armée de terre.
i. La protection du territoire national, y compris en milieu terrestre, a continuellement fait partie des missions assignées aux armées par leur contrat opérationnel
• Une mission expressément prévue par les contrats opérationnels
L’engagement des armées sur le territoire national pour des missions de protection fait partie des ambitions énoncées par les Livres blancs sur la défense successifs depuis la fin de la guerre froide, au-delà des hypothèses d’engagement liées à une invasion du territoire national, que le Livre blanc sur la défense de 1994 qualifie d’« éventualité peu probable » avec l’écroulement du bloc soviétique. Ainsi, ce Livre blanc rappelle que « la protection du territoire national et de ses approches est une mission permanente des forces armées et un objectif constant de notre politique » et que « la défense civile assure, à titre principal, la protection des populations, le maintien de l’ordre public et la préservation de la continuité d’action du gouvernement ». Parmi les missions qu’il assigne aux armées, il cite la mise en œuvre de « la défense du territoire national, de ses espaces aériens et maritimes, face à des menaces diversifiées, incluant le terrorisme ».
Le Livre blanc de 2008 sur la défense et la sécurité nationale a été quant à lui marqué par l’extension de notre stratégie de défense à la sécurité nationale et par l’identification de cinq grandes fonctions stratégiques, parmi lesquelles la fonction stratégique de protection de la population et du territoire national, non seulement contre les catastrophes naturelles ou technologiques, mais aussi contre le terrorisme. À cette fin, le Livre blanc de 2008 a expressément prévu la fixation d’un « contrat opérationnel de protection » aux armées sur le territoire national, précisant que ce contrat « s’ajoute aux missions de soutien général qu’y assurent l’ensemble des armées ». Il était précisé expressément que ce contrat devait comporter « une capacité de déploiement de forces terrestres pouvant si nécessaire monter jusqu’à 10 000 hommes en quelques jours », permettant de « contribuer, au bénéfice de l’autorité civile, en priorité à la sécurité des points d’importance vitale, à celle des flux terrestres essentiels pour la vie du pays, ainsi qu’au contrôle de l’accès au territoire ».
Selon les explications de l’état-major de l’armée de terre, l’effectif de 10 000 hommes avait été choisi par référence au plan Neptune, qui organise l’action de l’État en cas de crue majeure de la Seine. En effet, parmi les plans alors élaborés, c’est celui-ci qui prévoyait le plus ample déploiement de militaires.
• Une mission maintenue en 2009 et 2013 en dépit des tensions pesant sur le format des armées
Selon plusieurs observateurs avertis, le maintien d’un contrat opérationnel de protection dans les missions des armées n’avait rien d’évident en 2008-2009 et en 2012-2013. En effet, à ces deux moments, lors de la préparation des lois de programmation militaire de 2009 et de 2013, les armées avaient pour tâche de remodeler leurs missions et leurs formats avec pour objectif de réduire leurs moyens, y compris leurs effectifs. La tentation aurait alors été grande de « gager » une part substantielle des déflations d’effectifs à programmer par un transfert à d’autres autorités des missions intérieures relevant du contrat opérationnel de protection.
Pour les rapporteurs, il convient de se féliciter de ce que les autorités ont finalement refusé de renoncer complètement à cette mission et aux moyens afférents.
ii. Ce contrat opérationnel a déjà été mis en œuvre pour des missions de protection
Non seulement le contrat opérationnel de protection figure depuis longtemps dans les missions des armées, y compris en milieu terrestre, mais il a été effectivement mis en œuvre, y compris pour des missions de sécurité.
Le général Didier Brousse, sous-chef d’état-major de l’armée de terre en charge des opérations aéroterrestres, a d’ailleurs fait valoir que l’action de l’armée de terre sur le territoire national revêt aujourd’hui des formes variées :
‒ l’armée de terre concourt à de multiples actions liées aux plans gouvernementaux d’aide aux populations, notamment pour faire face aux catastrophes naturelles (Plan Héphaïstos contre les incendies, plan Neptune en cas de crue de la Seine, etc.) ;
‒ en matière de sécurité du territoire national, elle contribue depuis longtemps au plan Vigipirate ;
‒ 3 000 de ses hommes sont déployés outre-mer au sein de nos forces de souveraineté ;
‒ constituant une cible éventuelle pour les terroristes, l’armée de terre « réinvestit le champ de sa propre protection » ;
‒ elle essaie également de « territorialiser » l’action de ses réservistes.
C’est ainsi que, selon le mot du général Brousse, l’armée de terre compte en permanence 12 000 hommes qui « assurent une posture de protection terrestre comme M. Jourdain fait de la prose ».
Deux missions intérieures en sont particulièrement emblématiques de l’engagement des armées dans le milieu terrestre :
‒ une mission de longue durée : la contribution des armées à la mise en œuvre du plan Vigipirate depuis 1995 ;
‒ une mission de haute intensité : l’opération Harpie de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane.
• Une expérience de plus de vingt ans : la contribution des armées au plan Vigipirate
Dès 1981, la France a élaboré un « plan Pirate » visant à planifier la mise en œuvre de différentes capacités dans la lutte contre le terrorisme. L’évolution de ce dispositif a conduit à l’élaboration en 1991 du « plan Vigipirate » (plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection face aux menaces d’actions terroristes). Comme le souligne le rapport remis en mars 2016 au Parlement sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population, « dans les années 1990, la France a fait figure d’exception dans la définition et la mise en œuvre d’un plan Gouvernemental permanent de prévention et de protection contre la menace terroriste impliquant les armées sur le territoire national ». Les dispositions de ce plan sont mises en œuvre en 1995, à la suite d’une campagne d’attentats conduite par des groupes islamistes.
1./ Une contribution des armées au dispositif gouvernemental de protection contre les actes de terrorisme
Comme l’a souligné M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), le plan Vigipirate comprend deux séries de mesures : d’une part, des mesures juridiques et, d’autre part, des « mesures d’effectifs » déployés sur le territoire national. C’est dans la mise en œuvre de cette seconde série de mesures que s’inscrit le déploiement de 1 000 militaires des armées en moyenne depuis 1995. À chaque posture définie par le plan Vigipirate correspondent ainsi des mesures juridiques et des mesures d’effectifs prédéfinies :
‒ la « posture de base » du plan Vigipirate prévoit le déploiement de 3 000 hommes, dont en moyenne un millier fourni par les armées ;
‒ la « posture de vigilance renforcée » prévoit la mise en œuvre du « contrat opérationnel de protection » des armées, avec un plafond fixé en 2015 à 7 000 hommes dans la durée ;
‒ la « posture d’alerte attentat » permet de porter cet effectif temporairement à 10 000 hommes.
Le SGDSN a souligné qu’« il n’y a pas d’automaticité dans les mesures d’effectifs : les effectifs cités ne constituent que des plafonds d’effectifs déployés ». Ainsi, ils s’imposent aux armées ‒ qui doivent intégrer dans leur planification l’hypothèse d’un déploiement maximal ‒ mais ne préjugent pas du nombre d’hommes qui seront effectivement mobilisés sur réquisition de l’autorité civile.
Si la contribution des armées au plan Vigipirate s’établissait en moyenne à 1 000 hommes environ jusqu’aux attentats de janvier 2015, cet effectif a été porté à 10 000 militaires au lendemain de ces attentats. Ce n’est que lors du Conseil de défense du 29 avril 2015 que le président de la République a décidé de pérenniser ce déploiement et de lui conférer l’appellation d’« opération Sentinelle » : jusqu’à cette date, le seul cadre de l’engagement est le plan Vigipirate.
2./ Un dispositif « entré dans les mœurs »
Comme l’a dit le général Jean-François Parlanti, directeur du centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations (CICDE), « Vigipirate était assez routinier et limité en termes d’effectifs », tant d’ailleurs pour le ministère de l’Intérieur que pour celui de la Défense.
Il ressort en effet des travaux des rapporteurs que le dispositif du plan Vigipirate était en quelque sorte « entré dans les mœurs » : ni réellement évalué ni sérieusement contesté, il faisait partie du quotidien des forces et de la population. Ainsi, M. François Heisbourg, président de l’International Institute for Strategic Studies (IISS) et du Centre de politique de sécurité de Genève (GCSP), ainsi que conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), a constaté devant les rapporteurs que l’efficacité du plan Vigipirate n’a jamais été clairement démontrée, mais que ce plan n’en a pas pour autant été remis en question depuis 1995. Pour lui, ce paradoxe trouve simplement son explication dans le fait que Vigipirate donnait satisfaction à l’ensemble de ses acteurs ‒ tant la population que les militaires et les forces de sécurité intérieure.
En effet, « même si les chefs militaires n’y étaient pas tous favorables dès le départ », Vigipirate offrait aux soldats qui ne partaient pas en opération extérieure l’occasion de « se sentir plus utiles qu’en caserne », et la formule des patrouilles mixtes armées / forces de sécurité intérieure a donné satisfaction. Par ailleurs, on peut estimer que les Français s’en sont sentis rassurés, et ce d’autant qu’aucun incident ne s’est produit entre policiers, militaires et population entre 1995 et 2015. En outre, la mise en place du plan Vigipirate ne donnait pas lieu à des dépenses élevées. Vigipirate a pu jouer un rôle utile pour dissuader les malfaisants de s’en prendre à la Tour Eiffel ou au Louvre : on protège ainsi certains types de cibles, et d’autant mieux que les chargeurs sont engagés. « Quoique non mesurable, un certain effet de dissuasion est possible ». C’est ainsi du fait de l’absence de « mécontents », selon M. Heisbourg, que le plan Vigipirate n’a jamais été sérieusement remis en cause, bien que son efficacité n’ait pas été établie avec certitude. Néanmoins, pour M. Heisbourg, « si l’on partait de zéro, on ne ferait pas Vigipirate : c’est une réponse militaire à un problème qui n’était pas militaire ».
Autre signe de ce que le plan Vigipirate était devenu une sorte de routine, il a été marqué par ce que M. Louis Gautier a appelé « des effets de cliquet ». En effet, comme l’explique notre collègue François Lamy dans un récent rapport (11), « le plan Vigipirate est marqué par une sorte d’hystérèse ». M. Lamy observe en effet que même après son actualisation en 2014, qui a vu les quatre niveaux de vigilance (identifiés chacun par une couleur : jaune, orange, rouge et écarlate) remplacés par deux niveaux d’alerte (« vigilance » et « alerte attentat »), « il est en effet très difficile aux autorités d’ajuster à la baisse le niveau de protection sans donner l’impression de “baisser la garde” inconsidérément », car « baisser le niveau d’alerte, c’est un message politique fort ».
Notre collègue montre comment il en découle, pour l’emploi des forces armées, « une certaine rigidité : le niveau “alerte attentat” correspond désormais, dans l’esprit de la population, à un engagement massif de l’armée de terre sur le territoire national ». En effet, « de même qu’il est difficile, dans la pratique, de réduire le niveau de vigilance, il peut être difficile, dans les faits, de moduler l’effectif de militaires » engagés pour la mise en œuvre du plan Vigipirate, « voire d’en moduler la portion la plus visible : celle qui effectue des gardes statiques ou des patrouilles de quartier ».
• Une mission intérieure de haute intensité : l’opération Harpie
Des contraintes d’emploi du temps n’ont pas permis aux rapporteurs de se rendre en Guyane afin d’y étudier la mission de lutte contre l’orpaillage illégal que conduit l’armée de terre. Toutefois, ils ont systématiquement interrogé les personnes qu’ils ont entendues sur les enseignements que l’on peut tirer de la mission Harpie pour la réflexion en cours sur l’emploi des armées dans la stratégie de protection du territoire national.
Par ailleurs, le rapport au Parlement précité sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population comprend une longue insertion sur l’opération Harpie, dont l’encadré ci-après résume les principales conclusions.
La mission Harpie
● Contexte et lancement de la mission Harpie
L’orpaillage illégal s’est progressivement développé en Guyane dans les années 2000, avec des conséquences écologiques, économiques et sociales telles que le rapport le qualifie de « fléau ».
À partir de 2008, dans le cadre « classique » d’emploi des armées sur le territoire national ‒ cf. la règle dite des « quatre “i” » ‒, l’armée de terre a fait l’objet d’une réquisition du préfet de la Guyane pour des appuis ponctuels à la gendarmerie nationale. La mission a été pérennisée en 2010.
En 2014, les armées ont engagé en moyenne 362 hommes dans l’opération Harpie.
● Cadre d’engagement des armées
La mission Harpie est encadrée par une réquisition générale du préfet de la Guyane, ainsi qu’une réquisition particulière pour chaque régiment engagé. Les objectifs de la mission Harpie sont les suivants :
‒ faire respecter notre souveraineté en Guyane, et poursuivre à cette fin les orpailleurs illégaux ;
‒ permettre la mise en place des activités d’orpaillage légales dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Les règles d’emploi de la force sont limitées au principe de légitime défense.
La mission est dirigée depuis un état-major conjoint aux armées et à la gendarmerie, qui associe également la police de l’air et des frontières, l’office national des forêts, les douanes et le parc amazonien guyanais. Elle est ainsi conduite dans un cadre interministériel intégré.
Les actions menées revêtent différentes formes :
‒ mise en place de postes opérationnels avancés (POA) de circonstance, servant de base à des opérations de patrouilles et de destruction des sites d’orpaillage illégal ;
‒ opérations ponctuelles sur des cibles à haute valeur ajoutée : plots logistiques, sites de production importants, campements, etc. ;
‒ opérations de contrôle des flux, y compris au moyen de barrages fluviaux.
● Bilan et perspectives
Selon la préfecture de la Guyane, entre l’été 2014 et la fin de l’année 2016, le nombre de sites d’orpaillage illégal a baissé de 60 %, de 500 à 200.
Pour éviter que les orpailleurs illégaux n’adaptent leurs modes opératoires et ne contournent ainsi le dispositif Harpie, celui-ci fait l’objet d’adaptations régulières. Mais comme l’indique le rapport au Parlement sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population, « le haut niveau d’engagement des armées dans l’opération Sentinelle obère néanmoins durablement toute perspective de renforcement du dispositif actuel ».
Source : rapport au Parlement sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population, 2016.
Aux yeux des rapporteurs, on peut tirer de la mission Harpie plusieurs enseignements utiles à la réflexion concernant la place des armées sur le territoire métropolitain :
‒ la coordination des efforts des différents départements ministériels est mieux assurée lorsqu’est mis en place une structure interministérielle intégrée et robuste, à l’image de l’état-major commun de l’opération Harpie ;
‒ si l’opération a vocation à donner suite à des procédures administratives ou judiciaires, chaque détachement de l’armée de terre gagne à être accompagné d’un officier ou d’un agent de police judiciaire (12) (OPJ ou APJ).
Ainsi, le général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, a considéré que la mission Harpie comportait des aspects utilement transposables en métropole. Il a évoqué notamment des missions conjointes entre armées et forces de sécurité intérieure de contrôle de zone ou de « durcissement » du dispositif de contrôle aux frontières. L’encadré ci-après donne un aperçu concret des missions qui peuvent être conduites grâce à la conjonction des armées et des forces de sécurité intérieure en Guyane.
Les opérations menées dans le cadre de la mission Harpie
En 18 mois, les Forces armées en Guyane (FAG), en appui aux différents services de l’État, ont, dans le cadre de la mission Harpie, détruit 250 chantiers exploités par les garimpeiros (orpailleurs clandestins venus du Brésil) et réduit ainsi les activités liées à l’orpaillage illégal de 60 %.
Pour arriver à ce résultat, plusieurs opérations importantes ont été menées, dont l’opération Yawasisi, qui a mobilisé deux compagnies du 3e régiment étranger d’infanterie (REI) et des sapeurs du 2e régiment étranger de génie. Mais la section des commandos de recherche et d’action en jungle (CRAJ) du 9e régiment d’infanterie de marine (RIMa) a également été sollicitée pour de la collecte de renseignements et des interventions aéroterrestres, au cours desquelles ont été détruits 14 moteurs, 13 quads, quatre pirogues et plusieurs tonnes de vivres.
Dans le même temps, la 2e compagnie du 9e RIMa, armée par la 3e compagnie du 7e bataillon de chasseurs alpins (BCA), a également été engagée dans le sud-est de la Guyane contre les orpailleurs clandestins. Ne pouvant bénéficier de l’effet de surprise sur le site visé – une arrivée en hélicoptère n’est jamais discrète –, ils ont alors relancé leur action vers un second. Au bout de quelques heures de marche pour franchir, à travers la jungle, 20 kilomètres et 1 100 mètres de dénivelés, ils ont pris à revers des orpailleurs « médusés » et saisi du matériel d’exploitation ainsi que des équipements de communication. En outre, deux commandos de chasseurs alpins ont fait leur jonction sur le site d’Eau Claire, connu pour être un haut lieu de l’orpaillage illégal en Guyane. « En s’infiltrant depuis le nord et le sud, ils ont semé la panique parmi les orpailleurs illégaux qui ne s’attendaient pas à ce qu’une troupe franchisse autant de kilomètres à pied en si peu de temps » à travers la jungle, écrit le communiqué du 7e BCA.
Source : éléments de presse rassemblés par les rapporteurs.
B. LES ARMÉES CONSTITUENT SOUVENT LE PRINCIPAL « RÉSERVOIR DE FORCES » À LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT POUR GÉRER LES CRISES TELLES QUE LES ATTENTATS DE 2015
Si le recours aux armées pour renforcer les moyens de l’État affectés à diverses missions, y compris en matière de sécurité nationale, est expressément prévu par les contrats opérationnels et effectivement mis en œuvre depuis longtemps, c’est que les armées constituent par nature un « réservoir de forces » et de compétences disponibles en cas de crise. Les armées ont d’ailleurs montré leur efficacité dans cette fonction à l’occasion des crises résultant des attentats de janvier et novembre 2015.
Dans une large mesure, cette fonction de « réservoir de forces » explique également que la France ne soit pas le seul pays à recourir à ses armées dans la gestion de ce type de crise : sous une forme ou une autre, suivant les spécificités stratégiques ou culturelles nationales, la même logique est à l’œuvre dans nombre de démocraties occidentales.
1. Les armées ont montré leur capacité à remplir leur fonction de « réservoir de forces » lors de la crise résultant des attentats de 2015
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a fait valoir que l’engagement des armées sur le territoire national se justifiait cependant par le fait que « ni la police ni la gendarmerie ne sont capables de générer en un temps rapide une force de 7 000 hommes, car en leur sein, les personnels sont affectés dans un poste précis, auquel sont attachées des missions permanentes ». Il y a d’ailleurs là, à ses yeux, « une constante historique : les armées ont toujours été vues comme un réservoir de forces, dotées d’équipements spécifiques (par exemple en matière de génie, de lutte NRBC (13), etc.) ». Ainsi, « les armées ont toujours été le dernier recours de l’État en situation de crise » et l’ont encore montré à la suite des attentats de 2015.
a. Un « réservoir de forces », ultima ratio de l’État
M. Louis Gautier a réfuté devant les rapporteurs l’idée que la sécurité du territoire national pourrait être assurée en milieu terrestre par les seules forces de sécurité intérieures, même à terme et même moyennant un renforcement de leurs effectifs, voire un assouplissement de leur statut. En effet, pour lui, « tout État a toujours besoin d’un “dernier recours”, et ce dernier recours, c’est toujours les armées », et ce pour deux raisons :
‒ les armées possèdent des capacités matérielles spécifiques, que les autres forces étatiques n’ont pas ;
‒ les armées constituent également des « “réservoirs d’effectifs” qui n’ont rien à voir avec ceux de la gendarmerie mobile ou des compagnies républicaines de sécurité ». On peut par ailleurs s’interroger sur le point de savoir « pourquoi la gendarmerie, qui dispose d’un vivier de 93 000 hommes ‒ soit bien davantage que la force opérationnelle terrestre ‒ n’est pas capable de générer une force de 3 000 hommes pour armer la mission Vigipirate « alerte attentat » ». En tout état de cause, selon M. Louis Gautier, la pyramide des grades des armées est plus adaptée à la mission Vigipirate que ne le sont celles des policiers et des gendarmes.
De plus, les règles de gestion des carrières au sein des forces de sécurité intérieure ne permettent pas, selon le SGDSN, de se passer des armées pour mettre en œuvre le plan Vigipirate, et ce pour plusieurs raisons.
D’abord, les membres des forces de sécurité intérieure « s’engagent pour une carrière complète », à la différence des soldats, majoritairement contractuels. Or « on ne peut pas imaginer une carrière entière passée en gardes statiques » : il y aurait là « un problème de gestion des ressources humaines ». Quant à l’idée de recruter des policiers et des gendarmes sous contrat pour pallier cette difficulté, le SGDSN a fait valoir que certains gendarmes sont d’ores et déjà contractuels, mais qu’il s’agit précisément d’agents dépourvus des pouvoirs d’OPJ ou d’APJ de leurs collègues. Dès lors, l’intérêt de recruter de tels personnels plutôt que des militaires est des plus limités.
Ensuite, le SGDSN a souligné que se pose en la matière la question de l’intérêt de la mission pour ceux qui l’effectuent ; or, si « tous les militaires n’apprécient peut-être pas Sentinelle, au moins ont-ils pour perspective d’être “projetés” dans d’autres opérations » plus attractives à leurs yeux. À l’inverse, le SGDSN a fait observer que « les policiers et les gendarmes ne se précipitent pas pour assurer des gardes statiques... ».
En outre, quand bien même leurs effectifs seraient renforcés, « les forces de sécurité intérieure ne seraient plus capables, dans cinq ou six ans, de reconstituer une force du volume de Sentinelle : leur mode de gestion des ressources humaines ne le permet pas ». Il tend en effet à « territorialiser » rapidement les personnels.
Enfin, « il y a aussi une raison de coût : recruter un policier ou un gendarme, c’est recruter un fonctionnaire pour une carrière complète ». De surcroît, en ne modifiant pas substantiellement l’équipement des militaires engagés sur le territoire national, « on fait avec ce qu’on a » et le surcoût est limité. Certes, il faudra bien entendu renouveler les effectifs de Sentinelle, et assumer ainsi plusieurs fois le coût de la formation. Mais il n’en demeure pas moins que compte tenu du statut des militaires et de leur durée moyenne de service, l’ancienneté pèse très peu dans la structure des coûts, et que la ressource humaine reste jeune et pleinement employable. M. Louis Gautier a indiqué que pour l’instant, le comparatif des coûts entre la police, la gendarmerie et l’armée de terre n’était pas fait ; « mais assurément, la solution retenue est la plus économe » ce que le tableau ci-après et l’encadré qui en précise le mode de calcul tendent à confirmer, laissant entrevoir un écart de coûts de l’ordre de 900 millions d’euros par an pour ce qui concerne les dépenses de personnels.
COMPARAISON APPROXIMATIVE DE COÛTS
ENTRE LE RECOURS AUX MILITAIRES ET LE RECOURS AUX POLICIERS
POUR ASSURER DES MISSIONS DE GARDES STATIQUES OU DYNAMIQUES
police nationale |
armée de terre | |
actions 176-01 |
action 202-55 | |
nombre estimé d’heures de service |
1 517,25 |
2 374,00 |
par agent par an | ||
effectif nécessaire pour une garde |
5,77 |
3,69 |
« H24 J365 », soit 8 760 heures par an | ||
crédits de titre 2 de référence |
4 151,22 |
6 105,92 |
en millions d’euros | ||
plafond d’emplois de référence |
68 795 |
102 746 |
en ETPT | ||
dépense théorique par agent et par an |
60 342 |
59 427,33 |
en euros | ||
coût théorique d’une garde permanente |
348 390 |
219 285,33 |
« H24 J365 », en euros par an | ||
coût théorique total |
2 438,73 |
1 535 |
pour 7 000 gardes, en millions d’euros
|
Sources : Cour des comptes, « Police et gendarmerie nationales : dépenses de rémunération et temps de travail », rapport public thématique, mars 2013 ; projets annuels de performance relatifs aux missions « Sécurités » et « Défense » annexés au projet de loi de finances pour 2016 ; observations de terrain des rapporteurs ; calculs des rapporteurs.
Éléments de comparaison de coûts entre le recours aux militaires et le recours aux policiers pour assurer des missions de gardes statiques ou dynamiques
Pour les rapporteurs, la question du coût du dispositif de protection du territoire national et de sa population contre le risque terroriste ne saurait être considérée comme non-pertinente, dans un contexte budgétaire marqué par des tensions persistantes.
Les rapporteurs ‒ et c’est regrettable ‒ n’ont pas obtenu d’étude détaillée de comparaison du coût d’un dispositif de protection du territoire selon qu’il est assuré par des policiers, des gendarmes ou des militaires des armées ‒ essentiellement, ceux de l’armée de terre. En attendant que le Gouvernement conduise une telle étude dans des conditions d’approfondissement, de détail, d’exhaustivité et de méthodologie partagée que seul l’exécutif peut réunir, les rapporteurs ont tenté d’estimer, même de façon très approximative, l’ordre de grandeur de ces écarts de coûts. L’estimation faite par les rapporteurs a été réalisée, par nécessité, sur la base de la masse salariale globale des forces concernées, et n’est donc pas parfaitement représentative du coût analytique réel d’une prestation de garde statique.
● Dépense de personnel moyenne par équivalent temps plein
Concernant la police, le projet annuel de performance relatif à la mission « Sécurités » annexé au projet de loi de finances pour 2016 indique, à l’action 01 « Ordre public et protection de la souveraineté » du programme 176 « Police nationale », que 1,15 milliard d’euros de dépenses de personnel (dites « de titre 2 » dans la nomenclature budgétaire) financent les 18 945 équivalents temps pleins travaillés concernés, soit une moyenne de 60 832 euros par an et par fonctionnaire de police. Pour l’action 02 « Sécurité et paix publiques », les dépenses de titre 2 s’élèvent à près de trois milliards d’euros, pour un plafond d’emploi fixé à 49 850 équivalents temps plein travaillés (ETPT), soit une moyenne de 60 155 euros par an et par agent. Si l’on retient ces deux actions comme référence pour évaluer approximativement la masse salariale afférente à l’emploi d’un policier à des fonctions de protection et d’ordre public, la moyenne s’établit à 60 342 euros par an.
Concernant la force opérationnelle terrestre, l’action 55 « Préparation des forces terrestres ‒ Personnel travaillant pour le programme “Préparation et emploi des forces” » du programme 212 « Soutien de la politique de la défense » prévoit 6,1 milliards d’euros de crédits de titre 2 pour 102 746 personnels, soit 59 427,33 euros par homme et par an.
● Temps de travail annuel moyen par personnel
Dans un récent rapport public thématique (14), la Cour des comptes a étudié le temps de travail des fonctionnaires de police. Le temps de travail théorique varie suivant le régime horaire applicable au fonctionnaire :
‒ ceux qui sont soumis au régime dit « hebdomadaire », c’est-à-dire basé sur les jours ouvrés, assurent en théorie 1 655 heures et 30 minutes de service par an ;
‒ ceux qui sont soumis à des régimes dits « cycliques », c’est-à-dire alternant des jours de travail (souvent quatre) et deux jours de repos. Leur temps de travail moyen représente 1 536 heures et 38 minutes par an pour ceux qui servent de jour, et 1 416 heures et 38 minutes pour ceux qui servent de nuit ;
‒ les unités de service général des compagnies républicaines de sécurité ont un régime dit « mixte » : ils accomplissent leurs obligations de service soit selon un rythme hebdomadaire (lors du travail à résidence), soit selon un rythme cyclique (en déplacement).
En première approximation, et sans prétention d’exactitude, on peut retenir comme durée théorique de travail la moyenne de ces durées, soit 1 536 heures et 15 minutes. La Cour des comptes indique toutefois qu’avec le jeu des services supplémentaires et des récupérations, la durée effective du travail est inférieure à cette durée théorique, d’environ 19 heures par an et par agent. On peut donc retenir une durée moyenne de services de 1 517 heures et 15 minutes dans la police.
Concernant les armées, le temps de travail des personnels de la force opérationnelle terrestre n’est pas réglementé ; au contraire, l’obligation de disponibilité au service en tout temps et en tout lieu est une règle fondamentale du statut général des militaires. Le temps de travail est donc difficile à évaluer, et particulièrement en heures ‒ son évaluation est davantage exprimée en jours qu’en heures. Néanmoins, selon les constatations que les rapporteurs ont faites et les informations qu’ils se sont procurées, aujourd’hui, un militaire de l’armée de terre passe en moyenne, en un an :
‒ 156 jours hors de sa garnison, que ce soit en OPEX, en opération intérieure, en mission de courte durée outre-mer ou à l’étranger, en formation ou en préparation opérationnelle. Dans le cadre de l’opération Sentinelle, le rythme de travail est très soutenu : sur la base des observations qu’ils ont faites à l’état-major du groupement Paris-centre, où le rythme d’activité est organisé en cycles de six jours (quatre jours de déploiement, puis un jour d’entraînement et de formation, et enfin un jour de repos), les rapporteurs proposent de l’évaluer à une douzaine d’heures par jour, quatre jours sur six, et à sept heures environ pendant un jour sur six. Le cycle de travail de l’opération Sentinelle semble le plus pertinent à retenir pour évaluer le rythme d’activité de l’armée de terre dans une mission de sécurité. Rapporté à 156 jours, il représente donc 1 430 heures de travail ;
‒ 118 jours « au quartier », avec des durées de travail classiques cinq jours sur sept, mais des tours de garde de 24 heures (on retiendra donc huit heures de travail moyen par jour, en ce inclus les tours de garde, ce qui représente 944 heures par an) ;
‒ 91 jours au repos, que ce soit en week-end ou en permission.
Ainsi, dans l’attente de données plus précises ‒ que la direction des ressources humaines de l’armée de terre ne manquera pas de calculer prochainement, dans le cadre de la définition des conditions d’application aux militaires de la directive européenne sur le temps de travail ‒, on peut évaluer le temps moyen d’activité d’un militaire de la force opérationnelle terrestre en 2015 à 2 374 heures par an et par militaire.
● Effectif nécessaire pour assurer une garde 24 heures sur 24, 365 jours par an
Si l’on prend l’hypothèse d’un déploiement de 7 000 hommes dans la durée, sept jours sur sept et 24 heures sur 24, la charge de travail s’élève à 8 760 heures de travail par an et par poste de garde (statique ou dynamique).
Aussi, pour assurer une garde permanente (« H24‒J365 ») avec des fonctionnaires de police effectuant en moyenne 1 517 heures et 15 minutes de service par an, faudrait-il 5,77 policiers. Pour pourvoir à la même garde avec des personnels de l’armée de terre qui effectuent en moyenne 2 374 heures de service par an, il suffit en revanche de 3,69 militaires de l’armée de terre.
● Écarts de coûts théoriques
Comme le montre le tableau ci-avant, compte tenu des durées moyennes de service et du coût par agent dans chacune des deux catégories considérées, assurer une garde permanente « H24‒J365 » supposerait 348 390 euros par an pour la police, et 219 285 euros par an pour l’armée de terre. Aussi, pour un effectif de 7 000 personnels déployés en permanence, les dépenses de titre 2 s’élèveraient à 2,44 milliards d’euros pour la police, et à 1,53 milliard d’euros pour l’armée de terre.
Les calculs qui précèdent ne doivent naturellement pas être pris comme ayant pour conséquence de remettre en cause le régime statutaire de telle ou telle catégorie d’agents publics ; ces questions ne relèvent d’ailleurs pas du champ d’investigation de la mission d’information confiée aux rapporteurs. En outre, ils n’ont pas d’autre vocation que de donner un ordre de grandeur approximatif des différences de coûts. Une appréciation plus précise de ces écarts supposerait une étude comptable plus approfondie, sur la base de données dont ne disposent pas les rapporteurs et qui ne semblent pas toutes disponibles à ce jour. Enfin, seules sont prises en compte les dépenses de personnels : une appréciation exhaustive des coûts devrait prendre en compte les crédits de titre 5 ‒ c’est-à-dire les dépenses d’équipement des forces : matériels de transmission dont se dotent les armées, armement supplémentaire dont se dote la police, etc. ‒ ainsi que les dépenses de fonctionnement, dites « de titre 3 » dans la nomenclature budgétaire, qui recouvrent des dépenses parfois importantes : hébergement, restauration, etc.
Surtout, esquisser une telle comparaison ne doit en aucun cas être vu comme présupposant que l’armée de terre et la police nationale seraient deux forces parfaitement substituables. Au contraire, comme l’a bien souligné le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, « les militaires des armées ne sont ni des supplétifs, ni des doublons ». M. Louis Gautier a reconnu que « naturellement, il y a des recouvrements de missions » entre les armées et les forces de sécurité intérieure, notamment pour les gardes statiques, qui « permettent de libérer des effectifs des forces de sécurité intérieure pour les consacrer à leur cœur de mission dans la lutte antiterroriste », mais il a bien souligné qu’à ses yeux, armées et forces de sécurité intérieure ne sont qu’« en partie substituables », les armées n’assurant en aucun cas des missions de maintien de l’ordre. En effet, « personne ne veut que les armées voient leurs modes d’action et leur cadre juridique profondément transformés, afin d’éviter que les armées deviennent une sorte de troisième force de sécurité intérieure ». Elles n’interviennent qu’« en relais et en appui », c’est-à-dire soit pour laisser les forces de sécurité intérieure se concentrer sur le cœur de métier dans la lutte antiterroriste, soit pour apporter aux forces de sécurité intérieure des capacités que seules les armées possèdent.
Néanmoins, comme le souligne le Haut comité pour l’évaluation de la condition militaire dans son dixième rapport annuel, publié en mai 2016, la coopération quotidienne entre les forces de sécurité intérieure et les armées, aux niveaux central, zonal et local, ainsi que la complémentarité de leurs missions « amènent inévitablement leurs membres à effectuer des comparaisons sur tel ou tel point particulier : les modalités d’hébergement, l’indemnisation de l’activité, les temps de service et de repos, etc. ». Si le Haut comité ne manque pas d’avertir que « les comparaisons n’ont de sens que globalement et dans le respect de statuts par nature différents », il n’en conclut pas moins clairement qu’« il peut en découler des motifs d’insatisfaction qui diminueraient l’attractivité des forces armées ».
a. Le déploiement des armées sur le territoire national en janvier 2015 a bien montré la réactivité des forces et leur capacité à s’adapter au contexte de l’opération
Sans revenir en détail sur les modalités détaillées et le calendrier de déploiement de l’opération Sentinelle, présenté de façon précise par le rapport précité de notre collègue François Lamy, les rapporteurs tiennent à mettre en exergue certains points montrant avec quelle efficacité les armées ‒ et particulièrement l’armée de terre ‒ ont joué leur rôle de « réservoir de forces » au lendemain des attentats de 2015.
i. Un déploiement massif et remarquablement rapide
• Avec plus de 10 000 hommes déployés en six jours, les forces ont montré leur réactivité
Le général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre, a présenté le lancement de l’opération Sentinelle comme un test de réactivité réussi pour notre outil de défense, particulièrement pour l’armée de terre. Il a fait observer que si le contrat opérationnel prévoyait le déploiement de 10 000 hommes en dix jours, l’armée de terre l’a accompli plus rapidement que prévu, « à tel point d’ailleurs que nous avons dû freiner l’arrivée de certaines unités de façon à ce que leurs missions soient bien établies en amont, en liaison avec le ministère de l’Intérieur ».
Le général Didier Brousse, sous-chef d’état-major de l’armée de terre en charge des opérations aéroterrestres, a souligné qu’à deux reprises en 2015, « les armées, et plus particulièrement l’armée de terre, ont répondu présentes à l’appel lancé par le gouvernement et la Nation ». Pour lui, le succès de la mobilisation de plus de 10 000 soldats en six jours en janvier et en trois jours en novembre 2015 tient à :
‒ « la culture de projection capitalisée au cours des nombreuses opérations récentes » par les soldats ;
‒ « leur volonté de se mettre au service de leurs concitoyens », dont témoignent « nombre de retours spontanés aux quartiers et de retours anticipés de permissions » dès janvier 2015, et qui ne s’est pas démentie en novembre 2015.
Le général Brousse a estimé que l’adaptation d’emblée des soldats à leur mission « a été grandement facilitée par la connaissance que nos soldats, présents sur le territoire national depuis vingt ans dans le cadre du plan Vigipirate, ont de ce type d’engagement ».
• La chaîne des soutiens a été efficace
Le général Bosser a estimé que la chaîne des soutiens « a également fait preuve d’une grande réactivité », en soulignant que cette réactivité tenait en bonne partie à sa culture militaire, elle-même liée à la proportion des personnels militaires dans ses effectifs ‒ proportion encore importante malgré sa baisse tendancielle depuis une dizaine d’années.
Mais aux yeux du chef d’état-major de l’armée de terre, cette chaîne « est cependant confrontée à un problème de dimensionnement ». Elle est en effet conçue « pour soutenir au quotidien nos opérations extérieures et la vie des armées en métropole », davantage que pour assurer le soutien dans le long terme d’une opération majeure sur le territoire national. Le général Bosser a toutefois souligné qu’en dépit de toutes ces difficultés, cette chaîne contribue elle-même directement à l’opération Sentinelle en armant une voire deux unités.
• Les militaires ont d’emblée montré leurs hautes qualités professionnelles
Certains observateurs avaient craint que le déploiement massif de l’armée de terre sur le territoire national n’accroisse dangereusement le risque d’incidents, qu’il s’agisse de prises à parti plus ou moins violentes de la part d’une partie de la population, ou d’accidents dans le maniement des armes.
Le chef d’état-major de l’armée de terre a ainsi rappelé que « beaucoup doutaient de la capacité de soldats de 18 à 25 ans à opérer sur le territoire national avec armes et munitions de guerre ». Mme Claire Landais, directrice des affaires juridiques du ministère de la Défense, a d’ailleurs estimé que les mises en cause de la responsabilité de militaires en cas d’incident peuvent être nettement plus fréquentes pour des actes « quotidiens » que pour des opérations de haute intensité : « il ne faut pas se leurrer, l’agressivité peut monter ». Elle a d’ailleurs reconnu que le risque judiciaire pesant sur les soldats était d’autant moins négligeable que des militaires revenus d’opérations extérieures peuvent rencontrer des difficultés à passer d’un régime où ils ont davantage pour consigne d’employer la force létale à un régime d’emploi de la force moins permissif. Parallèlement, provocations et agressions verbales ou physiques à l’encontre des militaires sont quasiment inévitables.
En attestent les deux agressions physiques majeures subies par les militaires de l’opération Sentinelle, l’une à Nice avec l’attaque au couteau de trois militaires en février 2015, l’autre à Valence le 1er janvier 2016 avec la charge d’une voiture contre un groupe de soldats. Atteste également du risque de mise en cause du ministère devant les tribunaux le fait qu’une victime de dégât collatéral lors de l’incident de Valence ‒ une personne touchée par une balle perdue tirée par les soldats de Sentinelle ‒ ait tenu à porter plainte, alors même que d’autres procédures, d’ordre civil ou administratif, lui auraient permis d’obtenir une indemnisation assurément plus rapide, et probablement pas moins généreuse. La directrice des affaires juridiques du ministère de la Défense a d’ailleurs émis des doutes sur la recevabilité de cette plainte, soulignant qu’au contraire, une demande d’indemnisation aurait été « facilement acceptée ».
Cependant, les observateurs sont unanimes à constater que les hommes de la force Sentinelle font preuve d’une grande maîtrise de la force, qui témoigne de leurs hautes qualités professionnelles. Même le Défenseur des droits, qui porte pourtant un regard assez critique sur l’opération Sentinelle en elle-même, a reconnu que pour l’heure, la stabilité psychologique et l’entraînement des hommes ont permis qu’il n’y ait à déplorer aucune victime grave, notamment collatérale.
C’est ainsi à juste titre que le général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre, a pu estimer que le comportement des soldats a été « irréprochable », et qu’« hormis quelques incidents de tir, rien de grave n’a été enregistré ». Il convient en effet de rappeler que l’instruction des soldats au maniement des armes telle qu’elle est organisée par l’instruction sur le tir au combat fait que, comme l’a souligné le général Didier Brousse, les militaires « ont une bonne maîtrise de leur arme de référence, le FAMAS, et sont formés pour être attentifs à ne pas produire de dommages collatéraux autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national ».
• La force a été bien accueillie par la population
Comme l’a expliqué le général Arnaud Sainte-Claire Deville, l’acceptation de la mission par la population fait partie des indicateurs suivis de près par le commandement, à deux titres principaux :
‒ la préparation des soldats au contact avec la population fait partie de leur préparation opérationnelle, qui doit être adaptée en conséquence ;
‒ l’accueil fait aux soldats par la population a un impact sur leur moral.
L’impression générale des personnes interrogées par les rapporteurs, ainsi que leur propre sentiment, est que la force Sentinelle est, dans l’ensemble, très bien accueillie par la population. Ainsi, le lieutenant-colonel Anne-Henry de Russé, chef de corps du 1er régiment d’infanterie et commandant le groupement Sentinelle Paris-centre, a estimé que l’acceptation de la mission par la population est « globalement très bonne » ; dans quelques cas très marginaux, des réactions d’incompréhension ont été notées. Le commandement note aussi que dans les quartiers les plus aisés de Paris, à l’ouest, l’acceptation est moindre. Il juge également qu’« il faut cependant surveiller avec beaucoup d’attention l’évolution de cette donnée ».
Dans son rapport précité, notre collègue François Lamy relevait déjà en octobre 2015 1 300 incidents de tout type en région parisienne ; il précisait que « pour 70 % d’entre eux, ces incidents constituaient des actions contre la force, allant d’activités suspectes de renseignement à des comportements inquiétants ou des menaces, ces dernières émanant le plus souvent de personnes alcoolisées ». Il notait toutefois une tendance à la baisse de la fréquence des incidents, qui était déjà ramenée de huit à dix par jour au début de l’opération à deux ou trois dès l’automne 2015. Le commandant des forces terrestres a même estimé que l’« on observe un vrai resserrement du lien des Français avec leur armée de terre, ce qui est ressenti très positivement par les soldats ».
ii. Une adaptation rapide au contexte de la mission
L’une des marques de la réactivité des armées dans l’opération Sentinelle tient aussi à la rapidité avec laquelle elles ont mis en place des structures de commandement opérationnel et de soutien de la force adaptées à une mission sans précédent dans son histoire récente.
• Une structure de commandement ad hoc
Le général Jean-Pierre Bosser a expliqué aux rapporteurs que dès le mois d’octobre 2015, en Île-de-France en particulier, le commandement tactique a été réorganisé autour de trois états-majors tactiques aux ordres du centre des opérations de la zone de défense et de sécurité concernée.
1./ L’organisation du commandement tactique de l’opération Sentinelle
Cette refonte du commandement poursuit selon lui un triple objectif :
‒ « améliorer l’emploi des unités » ;
‒ « donner aux chefs de corps des prérogatives de coordination avec les autorités locales », en alignant le zonage de la force Sentinelle sur celui des forces de sécurité intérieure ;
‒ permettre, en cas d’événements majeurs comme à Paris le 13 novembre 2015 ou à Saint-Denis le 18 novembre suivant, « de commander au plus près les moyens et unités déployés ».
Les rapporteurs ont tenu à se déplacer auprès d’un état-major tactique : celui du groupement Sentinelle Paris-centre, installé au fort de Vincennes. Depuis sa réorganisation mise en œuvre à l’automne 2015, le commandement de l’opération Sentinelle en région parisienne est organisé suivant un modèle inspiré de celui des groupements tactiques inter-armes (GTIA) en opérations extérieures. Le colonel Anne-Henry de Russé, commandant le groupement Paris-centre, a insisté sur le parallèle à faire, dans l’organisation de ce commandement, entre l’opération Sentinelle et les opérations extérieures.
2./ Activité d’un état-major tactique à Paris
La région parisienne est divisée en trois zones tactiques (Paris-centre, Paris-ouest, Paris-est), au sein desquelles un chef de corps (appelé, de façon plus appropriée, « chef de groupement ») commande une force et dispose pour ce faire d’un état-major tactique (EMT) et d’un centre d’opérations (CO). La carte ci-après présente le zonage retenu.
ORGANISATION DE LA ZONE « PARIS-CENTRE » DE L’OPÉRATION SENTINELLE
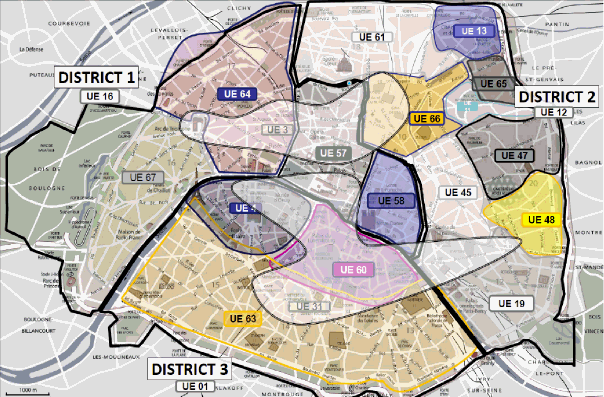
Source : état-major du groupement « Paris-centre ».
Pour la zone Paris-centre, la force est constituée suivant un panachage d’unités. À la date du déplacement des rapporteurs, le 1er mars 2015, elle était armée par 19 régiments de plusieurs brigades ‒ parmi lesquels le 3e régiment du génie de Charleville-Mézières fournissait une part substantielle des effectifs ‒, et si « l’armée de terre est de loin la principale contributrice » à ce dispositif, on note que dix aviateurs employés dans le Sud-Ouest par le service du commissariat des armées (SCA) le complètent. En tout, la force comprend 21 unités élémentaires, soit 2 200 à 2 500 hommes. Le rythme des engagements est soutenu : en permanence, les deux tiers des effectifs sont engagés ; le rythme de travail des hommes s’organise en cycles de six jours, comptant quatre jours d’activité, un jour de repos, et un jour d’entraînement et de formation.
Pour la planification et la conduite de l’opération, la zone Paris-centre a été divisée en trois districts correspondant au zonage de la police nationale. Chaque district est lui-même divisé en zones affectées à une unité élémentaire, commandée par un capitaine. Selon les explications du lieutenant-colonel de Russé, si le nord-est de Paris est plus « morcelé » que le reste de la zone, c’est en raison de la concentration de sites cultuels et culturels à protéger, qui y est particulièrement forte.
En plus des unités déployées sur le terrain dans chacune de ces trois zones, l’état-major tactique dispose d’une force de réaction rapide (Quick Reaction Force, QRF) du volume d’une unité élémentaire, prête à être déployée en tout lieu de la zone dans un délai compris entre 30 et 90 minutes. Par ailleurs, une « brigade des réseaux ferrés » est chargée de la protection des installations ferroviaires.
Cette organisation vise à « responsabiliser » les capitaines et, plus généralement, à exploiter mieux qu’auparavant les compétences et les savoir-faire du commandement tactique. Selon les explications du lieutenant-colonel de Russé, « l’état-major tactique n’impose pas un schéma tactique préétabli aux capitaines ». Ceux-ci conservent la même zone d’action pendant six semaines, et sont compétents pour « adapter leur dispositif à leur terrain ». C’est donc suivant un « principe de subsidiarité », qu’« un effort de décentralisation est consenti », ce qui n’exclut pas le contrôle par le chef de groupement et « suppose que les capitaines partagent l’esprit de la mission ».
Suivant la même logique d’exploitation des savoir-faire propres aux militaires, le commandement vise à « adapter les missions aux savoir-faire métier » de chaque unité, ce qui consiste, par exemple, à confier les patrouilles de préférence aux unités de mêlée, ou les transports aux unités du génie. Si cette orientation n’est pas encore systématique, compte tenu des contraintes pesant sur les effectifs, des progrès ont été accomplis en ce sens.
Les rapporteurs ont aussi consacré une large part de leur déplacement au fort de Vincennes à étudier le fonctionnement du centre d’opérations de la force Sentinelle Paris-centre, appelé « CO Picardie ». Celui-ci fonctionne avec 28 personnels, répartis en plusieurs cellules, dont l’encadré ci-après présente l’organisation. Celle-ci est directement inspirée de celle des postes de commandement des groupements tactiques interarmes (GTIA).
Le centre d’opérations de la force Sentinelle Paris-centre
L’organisation de ce centre d’opérations est inspirée du dispositif appliqué en opération extérieure, à ceci près que « travaillant sur réquisition, la force n’a pas une grande marge de manœuvre ». Parmi celles-ci, la cellule S35 élabore des études prévisionnelles pour l’évolution du dispositif : il s’agit d’un exercice de « planification froide » visant à anticiper des scénarios d’incident ou de crise (e.g. : une paralysie de la RATP).
La cellule S2 assure la « collecte de l’information » ‒ « on ne dit pas “renseignement” sur le territoire national » – par diverses voies : les sources ouvertes d’internet, les informations fournies par la police, les remontées du terrain. Deux personnels suffisent pour cette activité, limitée « compte tenu des limites légales ». En effet, sur le territoire national, les armées ne peuvent pas élaborer de documents de renseignement (des « fiches ») comme elles le font en opération extérieure.
La cellule S6 assure les liaisons radio, y compris sur le système ACROPOL (15) de la police nationale ; l’articulation avec les forces de sécurité intérieure passe aussi par le détachement de deux officiers de liaison à la préfecture de police de Paris. Le système de transmission radio actuel est appelé à être remplacé par le système DIPAD, dispositif militaire d’agrégation de fréquences qui sera livré aux alentours du mois de mai 2016. Selon les explications du commandement, il s’agit d’un dispositif téléphonique qui repose en partie sur les réseaux GSM et permet le géoréférencement. Le système DIPAD permettra au centre d’opérations de rester en contact avec les hommes sur le terrain. Par ailleurs, sera testé à partir du mois de juin le dispositif Auxylium, une interface légère de communication multi-usages pour le combattant débarqué et les forces de secours élaborée par un jeune officier de l’armée de terre, titulaire pour cela du Prix de l’audace 2014 du ministère de la Défense.
• Une amélioration rapide de la condition du personnel
L’amélioration progressive de la condition du personnel engagé dans l’opération Sentinelle constitue elle aussi une marque de la réactivité des armées.
1./ Une tendance à l’amélioration de la condition du personnel sur l’ensemble du territoire national
Le dixième rapport annuel du Haut comité pour l’évaluation de la condition militaire (HCECM) est consacré à la condition des personnels engagés dans les opérations intérieures. Il dresse ainsi un bilan détaillé de l’évolution du soutien de la force Sentinelle, dont il relève quatre aspects majeurs que détaille l’encadré ci-après :
‒ lors du lancement de l’opération, par nature urgente et imprévue, les conditions d’hébergement et d’alimentation étaient « difficiles », mais « la rusticité est, d’expérience, une face incontournable des opérations conduites par nos armées » et contribue d’ailleurs à leur capacité opérationnelle. Néanmoins, la rusticité est de moins en moins admissible au fur et à mesure que dure une opération : une amélioration progressive est donc indispensable ;
‒ le fait religieux peut aussi bien déséquilibrer ou raffermir le lien social en général et la cohésion des armées en particulier, d’autant qu’il est l’un des motifs prétextés par les terroristes : il prend donc une importance particulière dans le cadre de la mission Sentinelle. Si les aumôniers religieux jouent un rôle très positif dans sa prise en compte par le commandement, une formation des cadres de contact au fait religieux serait utile ;
‒ la compensation de la suractivité liée à l’opération Sentinelle a progressé, avec l’octroi de l’indemnité pour services en campagne (ISC) et de l’indemnité pour sujétion spéciale d’alerte opérationnelle (AOPER), mais les conditions de vie restent très hétérogènes ;
‒ des progrès restent à faire, concernant notamment l’hébergement de la troupe, diverses facilités matérielles (Internet, la restauration, etc.), la compensation financière « nette » de la suractivité des personnels (c’est-à-dire tenant compte des règles fiscales applicables aux opérations intérieures, mais pas aux OPEX) et, surtout, l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.
Les conclusions du Haut comité pour l’évaluation de la condition militaire sur la condition des personnels engagés dans l’opération Sentinelle
a) La mission ordonnée en réponse à une crise de sécurité nationale a conduit à une mobilisation dans l’urgence absolue de capacités importantes. Les délais très courts dans lesquels cette mobilisation a été réalisée, grâce à la réactivité des armées, ont naturellement conduit les militaires, dans les premiers temps, à remplir leur mission dans des conditions d’hébergement et d’alimentation difficiles. La rigueur des conditions de vie du soldat en opération dépend, il est vrai, des circonstances de l’engagement des forces, c’est-à-dire du moment, du terrain et de l’adversaire. C’est donc une notion essentiellement relative, très dépendante du contexte opérationnel. Si elle ne doit pas être recherchée pour elle-même, la rusticité est, d’expérience, une face incontournable des opérations conduites par nos armées. La capacité à y faire face et à vivre dans des conditions difficiles constitue, par suite, une aptitude opérationnelle qu’il faut savoir préserver et entretenir. Comme telle, elle est inhérente à la mission et à la condition militaire et elle ne saurait valablement être récusée au nom de normes de confort en vigueur dans le monde civil, voire dans certaines armées étrangères.
Toutefois, le HCECM estime qu’un engagement, dans la durée et sur le territoire national, au milieu de la population, doit, sauf urgence ou nécessité opérationnelle, s’accompagner des standards de vie et de soutien plus à même de faciliter l’exécution de la mission et la récupération des forces engagées (hébergement, hygiène, alimentation, repos, détente). En effet, la notion de rusticité est relative et le contexte de temps et de lieu n’est pas indifférent.
b) Le HCECM a eu l’occasion de rappeler dans son 9e rapport l’importance du rôle des forces armées, pour le lien social. Ce qui est vrai de la diversité sociale l’est aussi pour la diversité des croyances ou des non-croyances. Dans les armées comme dans la gendarmerie, la mission fait sens et offre un cadre fédérateur – la défense de la patrie et la fraternité d’armes – qui permet, aux militaires, à leurs chefs et à l’institution, d’assumer sereinement le fait religieux et la diversité des convictions de tous, croyants, athées ou agnostiques. Ce point est capital et il est absolument essentiel de préserver les armées et la gendarmerie de tout risque de fissure dans un contexte où des extrémismes tentent, en France comme ailleurs, d’instrumentaliser les religions et de dresser les citoyens les uns contre les autres.
Il relève à cet égard le rôle des aumôniers militaires, chargés d’apporter un soutien moral, spirituel et cultuel aux militaires de leur confession, également conseillers du commandement et, bien évidemment, toujours ouverts et à l’écoute des autres militaires, croyants ou non-croyants. L’action positive des aumôniers auprès des établissements et institutions religieuses protégés et de la société civile doit être saluée, de même que doit être soulignée l’importance du commandement dans ce domaine comme dans l’ensemble de sa sphère de responsabilité. La neutralité, l’exemplarité, la fermeté et l’humanité sont, en cette matière des plus sensibles, les points de repère qui doivent être communs à toute la hiérarchie. Il serait bon, à cet effet, de délivrer une information sur le fait religieux aux cadres de contact, dès leur formation initiale.
c) La mission a été prorogée et pourrait être appelée à durer. Il est donc indispensable de porter la plus grande attention, d’une part, aux conditions de récupération physique et morale des militaires, d’autre part, aux mesures destinées à compenser l’intensité particulière des sujétions et des activités liées à cette opération, c’est-à-dire la suractivité et non l’activité elle-même.
À cet égard, les conditions de vie et de service des militaires de l’opération Sentinelle sont apparues très diversifiées, allant du bon au très médiocre, selon le lieu et le moment de l’engagement. Le HCECM a pu constater, depuis le début de ses visites et auditions, soit depuis l’automne 2015, de réels progrès et des améliorations en matière d’hébergement, d’alimentation et d’équipements, même si la situation se caractérise encore par une certaine hétérogénéité.
Le HCECM observe que dans le même temps, des mesures structurelles ont été initiées et ont heureusement abouti :
‒ le bénéfice de l’ISC et de l’AOPER permet d’indemniser les militaires de façon satisfaisante, hors le cas de certaines exclusions ;
‒ une procédure d’octroi en urgence de la protection fonctionnelle est en place ;
‒ la médaille de la protection militaire du territoire avec l’agrafe « Sentinelle » est désormais gratuite pour les militaires qui la reçoivent.
Elles répondent à nombre des attentes formulées par les militaires eux-mêmes ou rejoignent des constats que le HCECM avait pu faire.
d) D’autres chantiers sont encore ouverts, dont il est nécessaire qu’ils puissent être menés à bien :
‒ l’hébergement des militaires dans des conditions de confort convenables ;
‒ l’amélioration des prestations servies par le soutien de proximité (habillement, Internet, transports) ;
‒ la recherche d’un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux, avec la possibilité de prendre 2 à 3 jours de permissions à l’occasion de chaque déploiement.
Source : dixième rapport annuel du Haut comité pour l’évaluation de la condition militaire, mai 2016.
Les rapporteurs se sont eux aussi attachés à étudier le rôle des aumôniers militaires. Ainsi, M. Mohamed Arbi, aumônier en chef du culte musulman aux armées, a constaté un net accroissement des sollicitations des aumôniers musulmans « pour des raisons de compréhension de la religion musulmane (et non des attentats) ». Il a précisé qu’il ne s’agit pas « de justification de ce qui relève d’un fourvoiement mais d’un désir d’explication des principes de l’islam à travers ses préceptes, sa morale et son culte ». L’encadré ci-après présente les grandes lignes du rôle de l’aumônerie musulmane.
Le rôle de l’aumônerie du culte musulman aux armées
S’agissant du rôle des musulmans dans la prévention de la radicalisation de militaires, M. Arbi a rappelé que la mission d’un aumônier militaire, conformément aux textes réglementaires et quel que soit le culte, n’implique pas de procéder à des mesures particulières de prévention de la radicalisation quelle qu’en soit la nature, soulignant que cette question « ne saurait donc encore moins être adressée à des militaires d’une confession particulière ». La vocation du métier d’aumônier militaire se cantonne donc, selon les statuts, au conseil au commandement et au soutien moral et spirituel aux militaires.
Néanmoins, M. Arbi a précisé que si des militaires de confession musulmanes étaient amenés à « se radicaliser de manière irrécupérable et menaçant le respect du bon fonctionnement des unités », l’aumônerie militaire du culte musulman ne manquerait pas d’exercer son devoir de signalement dans le cadre de son rôle de conseil au commandement.
Ainsi, début décembre 2015, un militaire de confession musulmane du bataillon de protection de la base d’Istres s’était laissé pousser la barbe, était en arrêt de maladie depuis trois mois et se promenait sur la base en habit « traditionnel ». Le commandant de la base a donc sollicité l’aumônier en chef du culte musulman pour un entretien d’abord en groupe, puis avec le militaire en question – qui, d’ailleurs, était un converti. Mais « l’aumônerie n’est ni un syndicat, ni un faire-valoir : elle est tenue au secret professionnel ». L’intéressé doit accepter de rencontrer l’aumônier, et celui-ci conseille le commandement sur l’opportunité pour l’institution de se séparer de l’individu. Dans le cas de l’espèce, l’intéressé souhaitait quitter l’armée depuis quelque temps et c’est un déséquilibre familial qui explique son changement.
L’aumônier militaire peut, par ses éventuels diplômes non confessionnels lui permettant de se décentrer de sa propre croyance, remplir une mission de formation sécularisée sur le fait religieux, auprès des autorités de commandement.
2./ L’exemple de la condition des personnels engagés à Paris
Lors de leur déplacement au fort de Vincennes, les rapporteurs se sont attachés à étudier les conditions de vie des personnels et à discuter avec eux de la façon dont ils les perçoivent.
Les rapporteurs ont pu visiter les lieux d’hébergement des soldats au fort de Vincennes, et faire le point sur les conditions d’hébergement de l’ensemble de la force. Actuellement, l’effectif engagé dans la force Sentinelle de Paris-centre est hébergé de façon disséminée, l’état-major faisant un effort de concentration. Pour le commandant du groupement Paris-centre, « ce sujet, touchant à la condition du personnel, est sensible ».
Comme le montre la carte ci-après, les principaux sites d’hébergement sont : Vincennes, pour cinq unités élémentaires ; l’îlot Saint-Germain, pour cinq unités élémentaires, logées dans d’anciens bureaux : « le résultat est tout à fait correct, mais un peu étrange » ; le Val-de-Grâce, pour trois unités élémentaires pour l’heure, et davantage après la fermeture de l’hôpital au mois de juillet ; les conditions y sont « très bonnes » ; le Fort de Nogent, pour trois unités élémentaires, dont le logement est « plutôt insatisfaisant » : les militaires occupent entre autres un ancien refuge de SDF, ce qui est symboliquement mal perçu. L’objectif du commandement est de pouvoir se passer de cette infrastructure ; Satory, pour deux unités élémentaires ; des locaux municipaux mis à disposition de la BSPP (à la mairie du 11e arrondissement et à Ivry), pour deux unités élémentaires. De surcroît, 73 « vigies » (lieux de logement pour la nuit destinés à un groupe ou une demi-section) complètent ce dispositif, dans des locaux municipaux ou des sites confessionnels.
L’état-major vise à rééquilibrer ce dispositif, en réduisant le nombre de vigies et en améliorant leur sécurisation et leur équipement – le tout étant parfois « un peu moyen, même si la rusticité des hommes ne se dément pas ». L’objectif est de concentrer le dispositif, tout en gardant quelques vigies utiles. Le lieutenant-colonel Anne-Henry de Russé estime que pour 80 % des hommes, « les conditions d’hébergement sont correctes », mais pour le reste, « notamment pour les sites épars dans Paris, des efforts restent à faire », au prix notamment d’un effort de regroupement des sites. Le remplacement des lits picots par des lits classiques est en cours, mais certains sites sont encore équipés de lits de toile, notamment dans les vigies disposées dans les sites confessionnels parisiens. Par ailleurs, certains sites sont équipés de wifi, ce qui est très apprécié, mais tous n’en ont pas.
La situation dépend également du sort de l’îlot Saint-Germain et du Val-de-Grâce : si le ministère les vendait, « il serait matériellement impossible de rapatrier à Vincennes les effectifs hébergés dans ces deux sites ».
HÉBERGEMENT DE LA FORCE
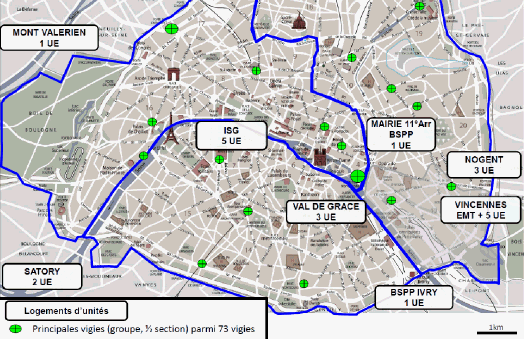
Source : état-major du groupement « Paris-centre ».
Les rapporteurs ont également pu faire le point, avec les militaires, des autres aspects de leur condition lorsqu’ils sont engagés à Paris. La condition du personnel a fait l’objet de grandes attentions du ministère, que le chef de groupement juge « remarquables ». Ainsi, les hommes perçoivent des tickets de cinéma, un « pass navigo », et des entrées à l’Aquaboulevard. Beaucoup s’intéressant au salon de l’agriculture, le chef de groupement leur a trouvé des entrées gratuites. En outre, si le lavage de linge coûtait d’abord cinq euros aux soldats, et le wifi 20 euros, ces services sont désormais gratuits. Enfin, une « carte sentinelle » ouvre droit à des réductions dans divers magasins.
En matière de condition du personnel, la question soulevée avec le plus d’énergie devant les rapporteurs est celle des primes. En effet, celles-ci sont soumises à l’impôt sur le revenu, que ce soit l’AOPER, dont le montant n’est pas très élevé (cinq euros par jour), ou pour l’ISC, dont le montant varie suivant le grade et la situation familiale : « pour un caporal marié, cela représente 50 euros par jour au moins ». Pour une année, 160 jours d’ISC représentent 8 000 ou 9 000 euros, soit une augmentation de 50 ou 60 % de la rémunération d’un soldat.
Selon les explications des officiers, « les jeunes soldats perçoivent des sommes considérables au regard de leur train de vie habituel, et n’ont pas tous l’habitude d’épargner en vue des impôts supplémentaires à payer l’année suivante, ou d’anticiper un saut de tranche fiscale ». Le commandement a mis en avant des « effets de second tour » pour montrer que l’avantage financier procuré par ces primes est en réalité très limité au regard des sujétions qu’elles sont censées compenser : la disponibilité du mari étant plus faible, les conjoints ont recours davantage aux gardes d’enfants. Parallèlement, ils sont touchés par les effets de seuil : tarifs de crèche, allocations diverses dont les aides au logement, etc. Aussi, deux populations sont « très fragiles » : les caporaux chefs avec enfants, et les sergents-chefs avec enfants. Selon les officiers, « dans un scénario négatif, pour ces cadres de contact, on peut évaluer le gain financier réel final à 500 euros sur les 8 000 ou 9 000 euros apparents, ce qui est peu pour justifier 160 jours d’absence par an ».
2. Le recours aux armées pour assurer des missions de protection dans les situations de crise devient d’ailleurs fréquent dans de nombreuses démocraties occidentales
Les rapporteurs se sont attachés à compléter leur étude de l’opération Sentinelle aux pratiques d’autres démocraties occidentales confrontées au risque terroriste ; tous les États ont un territoire national à protéger. Si la démarche comparative présente nécessairement des limites, du fait de la diversité des traditions, des cultures et des contextes stratégiques et politiques, les échos ou, le cas échéant, les différences de pratiques leur ont paru apporter un éclairage enrichissant dans la réflexion en cours sur la redéfinition de notre doctrine d’emploi des armées sur le territoire national.
Le rapport précité au Parlement sur les conditions d’emploi des forces armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population procède lui aussi à des comparaisons internationales, faisant apparaître qu’en matière d’emploi des armées sur le territoire national, les démocraties occidentales ont adopté des systèmes différents, largement déterminés par leur histoire, suivant la typologie suivante :
‒ certains États n’ont prévu d’employer leurs armées sur leur territoire qu’en cas de danger extrême ; tel est, pour d’évidentes raisons historiques, le cas de l’Allemagne, où cette possibilité n’a d’ailleurs jamais été mise en œuvre pour des missions de protection du territoire. On note néanmoins que les Allemands ont mis en place en 2013 un commandement des missions territoriales de la Bundeswehr (16) ;
‒ la majorité des États déploient leurs armées en cas de troubles importants, y compris pour la lutte contre le terrorisme : le Royaume-Uni (avec l’opération Banner en Irlande du nord et avec le plan Temperer), les États-Unis (avec les 54 gardes nationales en premier lieu, et l’US Army le cas échéant), l’Espagne (cf. l’opération Romeo-Mike déployée après les attentats du 11 mars 2004). Mais l’engagement des armées dans la lutte antiterroriste sur le territoire national n’est que ponctuel ;
‒ une minorité d’États dans lesquels les armées appuient régulièrement les forces de sécurité intérieure : la France, et l’Italie où les militaires peuvent être investis des pouvoirs de police étendus (arrestations, contrôles d’identité, fouilles de personnes et de véhicules, etc.), par exemple dans le cadre de l’opération Strade Sicure.
En tout état de cause, le rapport met en avant deux traits communs à toutes les démocraties occidentales étudiées :
‒ leurs armées n’interviennent sur leur territoire que subordonnées au pouvoir civil ;
‒ les armées y sont déployées sous l’autorité de leur chaîne de commandement propre, et non sous celle des ministères de l’Intérieur.
a. Le cas du Royaume-Uni : de l’opération Banner à l’opération Temperer
Les rapporteurs ont tenu à étudier la place des armées dans la stratégie britannique de protection du territoire et de la population. En effet, non seulement parce que le Royaume-Uni constitue un point de comparaison souvent pertinent avec notre pays dans la mesure où nos forces armées ont des formats à peu près semblables, mais surtout parce que le Royaume-Uni est confronté à une menace terroriste avec le terrorisme d’inspiration djihadiste, et que les armées britanniques ont été engagées pendant une quarantaine d’années en Irlande du Nord contre une menace qualifiée de terroriste par Londres, et de lutte armée par les groupes nord-irlandais concernés.
i. Le cadre général du recours aux forces armées
La réunion tenue au ministère britannique de la défense (Ministry of Defence ‒ MoD), en présence de Mme Penelope Mordaunt, ministre déléguée aux Forces armées (Minister of State for the Armed Forces) en présence d’un représentant de la direction de la sécurité et du contre-terrorisme du ministère de l’intérieur (Home Office), a permis aux rapporteurs de constater qu’au Royaume-Uni comme en France, le recours aux armées est possible pour renforcer les autorités civiles dans tous types de crises, principalement en cas de crises sanitaires, de catastrophes naturelles, ou de risque pour les approvisionnements stratégiques. Suivant la même logique de « réservoir de forces » que celle suivie en France, le Royaume-Uni a ainsi mis en œuvre une politique et un cadre légal dit de Military Aid to Civil Authorities (MACA).
• Le cadre légal de Military Aid to Civil Authorities
Selon les explications fournies aux rapporteurs par les responsables des ministères britanniques de l’Intérieur et de la Défense, les actions confiées aux armées dans le cadre appelé MACA, qu’elles soient de nature civile ou militaire, sont soumises à deux conditions légales générales :
‒ d’une part, la mission confiée doit être conforme à la législation en vigueur et les militaires doivent avoir les prérogatives juridiques pour les accomplir ;
‒ d’autre part, le déploiement des forces doit reposer sur une base légale, qu’il s’agisse de « prérogatives de la Couronne » ou d’« ordre donné en conseil de défense » (Defence Council Order).
Au titre des « prérogatives de la Couronne », les armées peuvent recevoir toute mission de nature militaire, les interlocuteurs des rapporteurs soulignant qu’il n’y a pas de définition précise du caractère « militaire » ou non d’une mission. Au titre des Defence Council Orders, sur le fondement soit d’une loi de 1964 (Emergency Powers Act) soit d’une autre loi de 2004 (Civil Contingencies Act), les militaires peuvent être chargés de missions de nature civile à titre temporaire et sous deux conditions cumulatives : l’urgence de la tâche et son « importance nationale ».
Parallèlement, comme l’a fait valoir un adjoint du sous-chef « opérations » de l’état-major des armées britannique, il ressort du droit commun (Common Law) que tout commandant militaire peut prendre les initiatives qui lui semblent appropriées, face à une situation d’urgence, pour aider les autorités et la population ‒ par exemple en cas d’inondation. Dans les faits, le chef militaire en informe ses autorités, et passe le relais aux autorités civiles, sous la responsabilité du Home office, si la situation d’urgence dure plus d’une quinzaine d’heures.
Les interlocuteurs des rapporteurs ont insisté sur le fait qu’en tout autre cas, les armées ne peuvent apporter leur concours aux autorités civiles que sur la base d’un « ordre ministériel », ce qui est très comparable aux procédures de réquisition et de demande de concours prévues par le droit français.
• La politique de Military Aid to Civil Authorities
Comme l’ont expliqué aux rapporteurs leurs interlocuteurs au ministère britannique de la Défense, il ressort des textes et des pratiques que les armées britanniques peuvent apporter leur concours aux autorités civiles (MACA policy) lorsque sont réunies trois conditions :
‒ les armées doivent constituer la dernière ressource disponible à l’État pour gérer la crise en question ;
‒ il doit être impossible ou démesurément coûteux de développer les capacités civiles nécessaires pour traiter ladite crise ;
‒ la situation doit présenter un caractère d’urgence.
On notera que ces conditions sont comparables par leur teneur à la « règle des quatre “i” » du droit français
Cette politique est mise en œuvre pour un large éventail de crises : intempéries plus graves qu’à l’accoutumée, grève du personnel pénitentiaire, émeutes urbaines, sécurisation des Jeux olympiques, inondations, incendies, risques de rupture d’approvisionnement en hydrocarbures, etc. À cet égard, les pratiques britanniques et françaises sont comparables.
Le chef d’état-major du London District ‒ échelon territorial de commandement de l’armée de terre britannique (British Army) compétent pour le grand Londres ‒ a indiqué aux rapporteurs que le recours des autorités civiles aux capacités des armées s’est fait de plus en plus fréquent ces dernières années, au point que « le recours aux armées est parfaitement habituel » (« military support is now routine »). La frise chronologique suivante montre la fréquence des engagements au titre du « MACA » et la variété des situations concernées.
MESURES DE MILITARY AID TO CIVIL AUTHORITIES DEPUIS 2010 À LONDRES
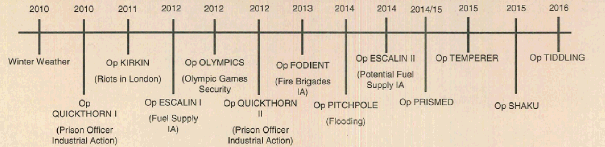
Prison Officer Industrial Action : grève du personnel pénitentiaire; Fuel Supply IA (pour industrial action) : grève dans le secteur de la distribution de carburants ; Flooding : inondation.
Source : British Army, London District.
Toutefois, les autorités militaires rencontrées par les rapporteurs ont insisté sur le fait qu’il n’était pas dans la tradition britannique d’avoir recours aux armées pour des tâches de maintien de l’ordre, à l’exception d’une contribution à la sécurisation des Jeux olympiques en 2012.
• « COBRA » et la dimension interministérielle de la politique de Military Aid to Civil Authorities
Comme l’a souligné le représentant la direction de la sécurité et du contre-terrorisme (Office for Security and Counter-Terrorism) du ministère de l’Intérieur rencontré par les rapporteurs, le Royaume-Uni n’a pas de force de sécurité intérieure à caractère militaire ‒ telle que, par exemple, la gendarmerie nationale en France ‒, « il n’y a rien entre la police et les armées ». Aussi, les forces de sécurité intérieure britanniques peuvent avoir besoin de recourir aux armées pour diverses tâches nécessitant des moyens et des compétences que les autorités civiles ne possèdent pas. La coutume veut alors que le ministre de l’Intérieur (Home Secretary) en fasse la réquisition auprès du ministre de la Défense (Minister of Defence). Cela concerne, principalement des compétences « de niche » ; tel est le cas, par exemple, pour l’intervention d’unités spécialisées des armées ‒ comme les forces spéciales ou les tireurs d’élite ‒ qui remplissent au Royaume-Uni les missions qui, en France, sont dévolues par exemple au GIGN.
Le représentant la direction de la sécurité et du contre-terrorisme a expliqué que dans la plupart des crises, qu’elles résultent ou non d’actes de terrorisme, le Gouvernement privilégie un cadre interministériel de gestion de crise. Concrètement, cela consiste à activer une cellule interministérielle de crise placée auprès des services du Premier ministre (le Cabinet Office), située dans une salle de réunion (identifiée par la lettre A) de ces services, d’où son appellation de « COBRA » (Cabinet Office Briefing Room A) ou « COBR » (Cabinet Office Briefing Room). Y sont rassemblés les représentants de l’ensemble des départements ministériels concernés ‒ le cas échéant, par exemple, les ministères chargés des transports, des affaires étrangères, etc. ‒ pour coordonner la gestion de la crise en question. Dans ce cadre, la gestion des crises est assurée par un membre du Gouvernement, et en cas d’attaque terroriste, c’est le Premier ministre lui-même qui dirigerait les opérations depuis la cellule COBRA. Ainsi, « les lignes de compétence entre départements ministériels s’effacent en situation de crise ». La cellule COBRA demeure activée jusqu’à ce que la crise concernée soit résolue, ce après quoi les systèmes ministériels concernés retrouvent leurs prérogatives habituelles.
Selon les explications fournies aux rapporteurs, le dispositif COBRA peut être activé en cas de crise, ou en amont d’une crise pour prévenir cette dernière.
• Les perspectives d’évolution de la politique de Military Aid to Civil Authorities
Les responsables britanniques rencontrés par les rapporteurs ont indiqué que la politique de MACA fait l’objet d’adaptations constantes en fonction du contexte (événements climatiques, menaces, etc.), et que récemment, le gouvernement a demandé un « réexamen » (review) de cette politique. La réflexion était encore en cours à la date du déplacement des rapporteurs. Un des axes de ce travail consiste à rechercher les moyens d’un examen plus précoce des réquisitions ministérielles, notamment en matière de contre-terroriste.
ii. Les enseignements de l’opération Banner en Irlande du Nord
Les discussions avec les responsables civils et militaires de la protection des populations au Royaume-Uni ont permis aux rapporteurs de recenser les enseignements de l’opération Banner, conduite de 1969 à 2007 en Irlande du Nord par les armées britanniques.
1./ Un glissement d’une mission de maintien de l’ordre à une mission de contre-insurrection
En Irlande du Nord, la mission des armées dans le cadre de l’opération Banner a rapidement évolué, passant d’une « mission de réassurance » ‒ c’est-à-dire d’appui éventuel au maintien de l’ordre ‒ à une « mission d’antiterrorisme de haute intensité ». Les forces déployées se répartissaient en trois catégories :
‒ des régiments locaux (c’est-à-dire basés et employés uniquement en Irlande du Nord), souvent composés de réservistes et employés de façon privilégiée dans la lutte antiterroriste ;
‒ des régiments de l’armée de terre britannique (Army), ayant leur garnison en Irlande du Nord, soumis au même rythme des missions et opérations de tous les autres régiments de l’Army notamment sur d’autres théâtres et n’étant donc pas engagés exclusivement dans la lutte antiterroriste ;
‒ des bataillons d’infanterie, de toute l’Army déployés en missions de courte durée en Irlande du Nord par roulement pour des périodes de six mois.
L’emploi de régiments forts d’un ancrage territorial en Irlande du Nord ainsi que la durée des déploiements des unités tournantes, ont permis une certaine continuité dans l’action des forces, renforcée par le nombre de rotations qu’ont pu faire les régiments en Irlande du Nord permettant de capitaliser « de la connaissance accumulée ». Toutes les troupes engagées avaient ainsi une bonne connaissance du terrain.
Le dispositif reposait notamment sur des patrouilles mixtes, constituées de militaires et de policiers de la Royal Ulster Constabulary (RUC). Plus largement, un adjoint du sous-chef « opérations » de l’état-major des armées britannique a souligné qu’en Irlande du Nord, l’articulation des militaires avec la police avait été « parfaite », en ce que les prérogatives des chefs militaires et celles de la police se complétaient efficacement. Les larges prérogatives confiées aux militaires ont ainsi permis de suivre ce qu’il a appelé « une approche complète » de la gestion de crise, articulant les efforts d’antiterrorisme et de maintien de l’ordre.
2./ Un succès opérationnel
L’opération Banner est vue comme une opération réussie : pour l’officier général adjoint du sous-chef « opérations » de l’état-major des armées britannique rencontré par les rapporteurs, « elle a forcé l’adversaire à abandonner le terrorisme au profit de négociations et à renoncer à l’indépendance ».
Le général a expliqué que « la clé absolue de ce succès, c’est la bataille du renseignement », dans laquelle l’armée a été partie prenante. Cela tient notamment à ce que les militaires vivaient et combattaient au milieu des populations, et à ce que la « campagne du renseignement » a fait l’objet d’une « organisation très fine, très complexe », reposant sur une bonne coordination entre les services concernés : la police, les armées, et le MI5 (Military Intelligence / section 5, service britannique de renseignement intérieur).
Cela n’implique pas pour autant que les militaires britanniques aient été chargés de mission de renseignement à proprement parler. Le général a précisé que le recueil formel de renseignement ne relevait pas en soi de la compétence des militaires sur le sol britannique ‒ à la différence des théâtres extérieurs ‒, mais qu’en tissant des liens avec les populations, les militaires ont recueilli un ensemble d’informations utiles. Il a d’ailleurs fait valoir que si les soldats avaient eu explicitement une mission de renseignement, et avaient employé à cette fin les capacités dont disposent les armées britanniques, il leur aurait été plus difficile de nouer des liens avec les populations. L’intérêt pour le succès de l’opération Banner du recueil par les militaires de renseignement d’ambiance ‒ ou, selon une terminologie moins marquée, d’« informations générales » ‒ peut nourrir utilement les réflexions sur le rôle des armées françaises sur le territoire national dans le cadre de l’opération Sentinelle ou de la nouvelle « posture de protection terrestre » pour le cas où la situation de sécurité intérieure se dégraderait significativement.
L’encadré ci-après résume les documents de retour d’expérience sur l’opération Banner fournis aux rapporteurs lors de leur déplacement à Londres.
L’armée britannique en Irlande du Nord (1969-2007)
L’opération Banner est une intervention de l’armée britannique en Irlande du Nord de 1969 à 2007 ayant pour objectif de mettre fin au conflit entre, d’une part, les républicains (majoritairement catholiques et indépendantistes) et, d’autre part, les unionistes majoritairement protestants et attachés à l’union avec le Royaume-Uni.
Les républicains ou nationalistes nord-irlandais ont pour organisation armée l’Irish Republican Army (IRA) créée en 1919 et disposant d’une structure politique : le Sinn Fein. Du côté unioniste, dit aussi « loyaliste », il existe également des organisations paramilitaires, comme l’Ulster Defence Association (UDA) et les Ulster Volunteer Forces (UVF).
Parmi les autres forces en présence, figurent :
‒ la RUC (Royal Ulster Constabulary), créée en 1922, qui, avec sa réserve appelée B-specials, est chargée de la police de l’Irlande du Nord. Il lui est souvent reproché de favoriser les positions de la communauté unioniste ;
‒ les forces armées britanniques, engagées dans le conflit en 1969, mais dont les effectifs diminuent à mesure qu’un régiment de recrutement local, l’Ulster Defence Regiment (UDR), a été en mesure de prendre le relais.
1./ L’escalade de la violence : de revendications politiques à une situation insurrectionnelle
a) La situation sécuritaire
● Au milieu des années 1960, la communauté catholique organise des marches de protestation contre les discriminations dont elle s’estime victime. D’abord pacifiques, ces marches deviennent de plus en plus violentes et la situation dégénère en guérilla urbaine.
● Les revendications catholiques se traduisent dans un premier temps par une « campagne pour les droits civiques » au milieu des années 1960. En 1963, la situation semble s’apaiser avec les réformes libérales que tente de mettre en place le chef du gouvernement de Stormont (17) Terence O’Neil. Celui-ci est finalement contraint de faire marche arrière compte tenu de l’opposition de certains unionistes. La méthode utilisée par les catholiques change par conséquent et ceux-ci, notamment la Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA), organisent à partir de 1968 des marches, à l’instar des manifestations pour les droits civiques ayant lieu au même moment aux États-Unis. Des marches et des contremarches organisées par les loyalistes se succèdent donc et marquent une escalade de la violence marquée par des affrontements entre les deux communautés. La NICRA est par ailleurs de plus en plus présentée par les loyalistes comme la composante extrême des républicains et la RUC est perçue par la communauté catholique comme le défenseur des loyalistes.
La « bataille du Bogside » illustre cette escalade de la violence. Le 12 août 1969, les loyalistes de l’Ordre d’Orange organisent leur défilé traditionnel dans les rues de Derry/Londonderry pour célébrer la « bataille de la Boyne » (18). Une manifestation nationaliste provoque des affrontements avec des jets de pierres et de briques, et les moyens de la RUC sont débordés face à une telle violence. Le conflit se propage pendant plusieurs jours dans d’autres villes, notamment dans le quartier catholique de Belfast, the Falls, faisant une dizaine de morts.
La RUC se trouve désemparée face à cette montée de la violence et une partie de la population n’a plus confiance en cette police compte tenu de sa proximité de la cause loyaliste. Par ailleurs, la réserve de la RUC, les B-specials, était destinée et formée à la surveillance de la frontière avec l’Irlande mais n’était pas préparée au maintien de l’ordre en zone urbaine.
● À partir de 1970, l’IRA se scinde en deux parties : l’Official Irish Republican Army (OIRA) et la Provisional Irish Republican Army (PIRA). À partir du cessez-le-feu déclaré par l’OIRA en 1972, la PIRA devient progressivement l’organisation paramilitaire la plus visible du mouvement républicain. En 1974, le gouvernement britannique considère officiellement la PIRA comme une organisation terroriste. La PIRA élabore une stratégie caractérisée par différentes phases : l’insurrection de 1969 à 1972 ; le passage à des pratiques terroristes à partir de 1972 mêlant le contrôle de la population, le harcèlement de l’armée ainsi que la propagation de terreur ; et l’action politique avec notamment les grèves de la faim de prisonniers républicains en 1980 et 1981.
b) La réponse à l’escalade de la violence
Le 14 août 1969, le chef de la RUC demande alors le concours de l’armée, conformément aux dispositions législatives relatives au Military Aid to the Civil Power, compte tenu de l’absence d’échelon intermédiaire dans le système de maintien de l’ordre britannique. Au Royaume-Uni, le système des forces de sécurité se fonde en effet sur une stricte séparation du civil et du militaire ; il n’existe donc pas de troisième force intermédiaire formée au maintien de l’ordre public, telle que les compagnies républicaines de sécurité ou les forces de gendarmerie mobile en France.
● Le Ministry of Defence (MOD) assigne alors en 1969 trois missions à l’armée :
‒ arrêter et remettre à la police tout individu détenant des armes ou des explosifs ;
‒ organiser des patrouilles pour gêner les actions de mouvements paramilitaires ;
‒ par leur présence, favoriser le retour d’un climat de confiance.
c) L’armée britannique chargée de missions de maintien de l’ordre
● Les militaires se trouvent cependant rapidement confrontés à des difficultés du fait du manque de préparation à la mission de maintien de l’ordre. Ils ne sont pas formés aux procédures de police, notamment en matière d’arrestations, ce qui limite leur efficacité, de nombreux suspects étant remis en liberté faute de preuves recevables.
En outre, les difficultés de l’armée sont aussi liées à l’ambiguïté de la ligne politique provenant des gouvernements de Stormont et de Westminster. Le Ministry of Defence et le Home Office n’ont par exemple pas le même avis sur la légalité de certains groupes tels que l’Ulster Defence Association (19) (UDA), considéré comme étant légal par le gouvernement de Stormont, et illégal par le gouvernement de Westminster. Par conséquent, de 1969 à 1972, la mise en place d’une stratégie militaire est perturbée par le double contrôle de l’armée par les gouvernements nord-irlandais et britannique.
● Le 1er avril 1970, l’Ulster Defence Regiment (UDR), unité militaire sous contrôle de l’armée britannique, est créé en remplacement des B-specials, dans les rangs desquels des comportements illégaux avaient été constatés à plusieurs reprises. Les 9 000 militaires de l’UDR, étant pour la plupart des réservistes à mi-temps, sont engagés dans des missions de gardes et de contrôles de personnes, mais jamais dans des missions de maintien de l’ordre. L’objectif de la création de ce régiment est également de recruter parmi les deux communautés d’Irlande du Nord. La place de l’UDR dans le conflit nord-irlandais s’accroît tout au long de l’opération Banner. L’un des atouts de l’UDR est son ancrage territorial, qui lui permet d’être très performant en matière de recueil de renseignements.
Malgré ces atouts, l’UDR présente un problème de légitimité du fait de la composition de son personnel, dont la part des catholiques est largement inférieure aux objectifs annoncés lors de la création de l’UDR. Celle-ci est de 2 % contre 18 % prévus.
De plus, l’opération Demetrius, opération d’arrestation et de détention sans jugement de plusieurs centaines de chefs républicains à partir du 9 août 1971, est préjudiciable pour l’image de l’armée, même si elle lui permet d’obtenir de nombreux renseignements précieux. L’opération Demetrius est aujourd’hui considérée comme un échec pour plusieurs raisons :
‒ les émeutes faisant suite aux arrestations donnent lieu à la mort de plusieurs civils, ternissant ainsi l’image de l’armée en Irlande du nord ainsi qu’à l’étranger ;
‒ l’opération, au lieu d’affaiblir l’IRA en emprisonnant ses leaders, l’a consolidée en favorisant le recrutement de catholiques auparavant modérés mais désormais révoltés par des détentions jugées injustes ;
‒ sur l’opération Demetrius retombe une part de la réprobation suscitée par le Bloody Sunday. Le 30 janvier 1972, la NICRA organise une manifestation contre la politique de détention sans jugement, mais la marche dégénère : l’IRA tire sur les forces de sécurité et l’armée britannique riposte, tuant 13 manifestants.
● L’armée britannique devient peu à peu une cible privilégiée pour les membres de la PIRA. Face à la vague de violence provoquée par la politique de détention sans jugement, le gouvernement britannique décide d’instaurer la Direct Rule en 1972, supprimant de fait le gouvernement de Stormont et assurant la gestion de la crise directement depuis Westminster. Les forces armées doivent de plus en plus s’impliquer dans des opérations de maintien de l’ordre. Les Britanniques sont donc de plus en plus mal perçus par les républicains et l’IRA est à l’origine d’une série d’attentats à partir de mars 1972.
Cette entrée dans la Long War place l’armée de terre britannique sous tension au début des années 1970 ; une partie des effectifs étant accaparée par les forces d’occupation en Allemagne, les bataillons stationnés au Royaume-Uni sont très sollicités et la décision est prise d’augmenter le nombre de bataillons permanents de trois à six. De plus, la durée de séjour des unités passe de quatre à six mois. Ces mesures désorganisent néanmoins parfois les unités, car au sein des bataillons, les séjours des cellules de renseignement ne coïncident pas avec les séjours des unités de combat. Par ailleurs, compte tenu de l’intensité de l’engagement, le niveau d’entraînement des hommes sert de variable d’ajustement et leurs compétences tactiques en pâtissent. Parallèlement, le recrutement chute.
2./ L’armée doit mettre en place des stratégies nouvelles de contre-insurrection afin de lutter contre l’adversaire opérant en milieu urbain au sein des populations
a) Le passage d’une stratégie de maintien de l’ordre et de contre-subversion à une stratégie de contre-insurrection
● Au début de l’opération Banner, l’armée met en application une stratégie de contre-subversion associant infiltration et arrestations de nationalistes. Cependant, la contre-subversion a engendré de nombreuses victimes au sein de la population civile, et a ravivé les dissensions entre les représentants de l’État en Irlande du Nord et la communauté catholique.
● Afin de répondre au recours par la PIRA à des moyens de lutte armée, qualifiés de terroristes par les autorités britanniques, l’armée britannique revoit sa stratégie initiale. L’opération Motorman marque à cet égard un tournant. Ayant jusqu’alors été réticentes à intervenir dans les zones de non-droit qui se sont développées dans les quartiers de Belfast et de Derry/Londonderry, les forces armées y lancent l’opération avec pour objectif de gêner la préparation des actions de l’IRA dans ses bases arrières. Afin d’atténuer le nombre de pertes civiles, une annonce officielle du début de l’opération a lieu quelques jours avant celle-ci. L’opération Motorman en 1972 est un succès pour l’armée britannique. Elle marque le passage d’une mission de maintien de l’ordre à une mission de contre-insurrection. Dans la stratégie britannique de contre-insurrection, le renseignement occupe une place centrale. Cette stratégie est fondée sur deux composantes :
‒ une stratégie de « renseignement de bas niveau » (low grade intelligence) consistant à faire de tout soldat un acteur du renseignement : celui-ci, en patrouilles à pied, doit interagir avec la population et écouter les conversations afin d’obtenir un « renseignement d’ambiance », la logique étant que l’insurrection se trouvant au cœur même de la population, il faut garder un contact avec elle ;
‒ des opérations spéciales : des fouilles de véhicules, d’individus, de maisons ; et des opérations clandestines telles que l’infiltration au sein des groupes d’insurgés dans le but d’obtenir du renseignement opérationnel.
b) Le processus d’« Ulstérisation » redonne à la police sa place centrale dans la mission de sécurité intérieure après une phase de « reconstruction » de la RUC
En 1975, la politique de détention sans jugement ainsi que la Direct Rule sont abandonnées. En 1976, un processus dit d’« Ulstérisation » redonne à la police sa place centrale dans la mission de sécurité intérieure, dans le but notamment d’impliquer les acteurs locaux. Le transfert d’autorité des forces armées à la RUC et à l’UDR ne s’effectue cependant pas sans difficultés, la confiance entre l’armée britannique et la police nord-irlandaise n’étant pas totale. Le retour de la RUC au premier plan de la gestion de la sécurité intérieure permet à l’armée de se détourner peu à peu de la mission de maintien de l’ordre et de réduire ses effectifs en Irlande du Nord.
Des lois spéciales sont adoptées afin de garantir aux forces de sécurité d’agir dans la légalité. En 1970, les Firearms Acts forment un cadre légal relatif aux armes à feu et à la détention d’explosifs. De même, d’autres lois spéciales interdisent les sit-ins.
Cette remise en question multiple de la stratégie de la lutte contre la PIRA permet à l’armée d’avoir l’avantage tactique sur la PIRA dans les années 1976-1977.
c) Les tactiques de l’armée de terre britannique pour lutter contre la PIRA
● Les tactiques employées par l’armée de terre britannique pour lutter contre les méthodes de la PIRA ‒ utilisation d’engins explosifs improvisés (EEI), snipers ‒ évoluent au cours du conflit pour s’adapter au milieu urbain. Ainsi, l’armée met-elle en place des tours d’observation dans les villes, des check points et des patrouilles.
Des « opérations cadre » (framework operations) comprenant des patrouilles de routine, des check points et des fouilles de maisons sont mises en place dès le milieu des années 1970. Les check points fixes s’avèrent des cibles pour les terroristes de la PIRA. Bien qu’il en existe en Irlande du Nord, ce sont les check points mobiles qui démontrent une efficacité particulière. En effet, stationnés seulement quelques heures à un emplacement, ils sont ensuite déplacés pour éviter une attaque terroriste. Les check points mobiles prouvent en Irlande du Nord qu’ils permettent d’arrêter davantage d’hommes et de saisir davantage de matériel suspect que les check points fixes.
Les patrouilles de routine ont elles aussi beaucoup évolué au cours du conflit. L’option de la patrouille en une ou deux colonnes est rapidement abandonnée, car elle peut représenter une cible pour la PIRA. Le parallel patrolling semble plus pertinent à l’armée britannique : il consiste à placer deux groupes de soldats dans deux rues parallèles, dans le but de déstabiliser le tireur potentiel qui ne sait pas où se trouve le deuxième groupe de soldats. La technique de hit and run (20) des membres de la PIRA s’en trouve donc compliquée. L’armée britannique doit cependant évoluer vers un nouveau type de patrouilles, le multiple patrolling puisque la PIRA s’adapte au parallel patrolling en menant des opérations de reconnaissance appelées dicking. Le multiple patrolling correspond à un déploiement aléatoire des forces divisées en équipes se déplaçant dans des rues différentes. Le dicking est donc rendu difficile par le positionnement aléatoire des forces. Malgré l’efficacité de la technique de multiple patrolling, des erreurs se sont produites sur le théâtre nord-irlandais : certaines patrouilles empruntent parfois le même trajet plusieurs jours de suite, se rendant de fait plus vulnérables à des attaques. Par conséquent, l’un des points centraux de la tactique de l’armée britannique sur le théâtre nord-irlandais réside dans la position aléatoire des patrouilles. En effet, la PIRA surveillant les habitudes de l’armée britannique, le caractère aléatoire des déplacements militaires a un effet dissuasif.
Les fouilles sont aussi un élément important de la tactique de l’armée britannique lors de l’opération Banner. Elles permettent de réduire le trafic d’armes et d’explosifs et ainsi de perturber la capacité opérationnelle de la PIRA. De plus, l’armée britannique développe des techniques pour faire face au piégeage des maisons inoccupées dans lesquelles des fouilles sont réalisées. Ainsi, chaque compagnie se dote-elle d’un conseiller en recherche technique formé pour démanteler les engins explosifs improvisés (EEI).
Des postes d’observation placés en hauteur sont par ailleurs mis en place. Ils permettent la surveillance d’une zone étendue ainsi que la transmission d’informations aux hélicoptères et patrouilles opérant sur la zone en question.
● Les opérations maritimes et aériennes font aussi partie de la stratégie de l’armée britannique sur le théâtre nord-irlandais. La Royal Navy a par exemple joué un rôle important dans le succès de l’opération Motorman, en permettant le transport d’une grande partie des troupes sur le terrain. En ce qui concerne les opérations aériennes, elles confèrent à l’armée un avantage tactique car elles leur offrent une mobilité importante et leur permettent ainsi de mettre en œuvre de nouvelles tactiques. À titre d’exemple, les operation boxes consistent à déployer rapidement des troupes au sol grâce à des hélicoptères afin de saturer une zone et de déstabiliser l’ennemi ; cette tactique d’occupation rapide de l’espace est difficile à anticiper et à contrer par la PIRA. Le contrôle de l’espace aérien s’est donc avéré décisif lors de l’opération Banner.
iii. L’opération Temperer de protection de la population contre le terrorisme
Le déplacement à Londres a permis aux rapporteurs d’étudier l’opération Temperer, tant à l’échelon stratégique (au ministère de la Défense) qu’au niveau opératif, à l’état-major du London District. Cette opération a été planifiée par les Britanniques pour le cas où les armées devraient apporter leur concours aux autorités civiles afin de répondre à des attaques terroristes.
• Le contexte de la planification de l’opération Temperer
Comme l’ont expliqué les responsables britanniques, l’opération Temperer a été planifiée à la suite des attentats de Paris, « en s’inspirant de l’opération Sentinelle ». Les Britanniques ont d’ailleurs reconnu avoir tiré un grand bénéfice de l’aide de leurs homologues français pour la conception et la planification de l’opération Temperer.
Elle vise à renforcer les mesures de protection de la population, mais ne concerne pas les missions d’antiterrorisme « de pointe » ou l’activité des unités spécialisées et des forces spéciales. Elle consiste en effet à apporter à la police des « moyens » qu’elle n’a qu’en volume limité ‒ à cet égard, on notera que l’état-major du London District a souligné qu’il employait le terme de capacities, c’est-à-dire de « moyens » ou de « volume de forces », et non le terme de capability, qui correspond davantage au terme français de « capacités » au sens militaire du terme, dont la connotation est moins quantitative, renvoyant à un ensemble de systèmes d’armes et de savoir-faire. En effet, la police britannique est très peu armée : selon l’état-major du London District, la police de Londres (Metropolitan Police) compte 35 000 personnels, dont 1 500 seulement sont armés : 600 sont autorisés à porter une arme pour effectuer des gardes statiques, 600 sont autorisés à être armés tout en manœuvrant dans la ville, et 300 officiers spécialisés dans le contre-terrorisme sont armés (le Premier ministre a décidé, lors d’une réunion en format « COBRA », de doubler leur effectif). Si cette dernière unité possède de réelles capacités d’intervention ‒ elle doit pouvoir intervenir en sept minutes en tout lieu du grand Londres ‒, il n’en demeure pas moins qu’aux yeux des militaires, en cas d’attaque terroriste massive ou d’attaques simultanées, les capacités de la police risquent d’être dépassées, ce qui justifie le recours aux armées.
L’opération Temperer a vocation à être déclenchée soit (cas le plus probable) immédiatement après une attaque terroriste, lorsque les terroristes sont encore en fuite ou retranchés, soit (suivant une hypothèse que les militaires britanniques jugent toutefois moins probable) préventivement, dans le cas où les services de renseignement signaleraient que des réseaux terroristes se préparent à une attaque.
Surtout, l’ensemble des interlocuteurs des rapporteurs a souligné le changement culturel que constitue l’opération Temperer.
Ainsi, le président de la commission de la Défense de la Chambre des Communes, M. Julian Lewis, a estimé que si le Royaume-Uni a déjà déployé de nombreux personnels armés « dans les rues », avec l’opération Banner en Irlande du Nord, cela doit être vu comme tout à fait exceptionnel dans les pratiques britanniques, cet engagement inhabituel sur le territoire national étant déterminé par l’ampleur de l’insurrection. Il a souligné qu’au contraire, la tradition politique britannique « veut que l’on maintienne les forces armées dans un rôle subordonné » : les Britanniques « ont une préférence pour l’engagement de la police, tant que celle-ci n’est pas débordée ». Pour lui, cette tradition est aussi illustrée par la procédure ‒ certes purement formelle ‒ par laquelle le Premier ministre doit solliciter tous les ans du Parlement l’autorisation d’entretenir des forces armées en temps de paix. Autre marque de cette tradition, il a indiqué que lorsque le Parlement britannique a été convoqué en session extraordinaire trois jours après les attentats du 11 septembre 2001, « c’était un choc pour nombre de parlementaires que de voir des hommes en armes garder le palais du Parlement ». Pour lui, cette position traditionnelle quant à l’emploi des forces armées dans le cadre très strict dit des MACA fait l’objet d’un large et permanent consensus politique.
Comprendre cette coutume permet de mesurer l’évolution politique que constitue la planification de l’opération Temperer. Le responsable de la direction de la sécurité et du contre-terrorisme du Home Office rencontré par les rapporteurs a souligné ce « fait politique saillant », estimant que « Temperer est passée dans le champ politique, car si les Britanniques font preuve depuis Cromwell d’une certaine « nervosité » à l’idée de déployer sur leur territoire de larges effectifs armés, le Premier ministre a jugé qu’aujourd’hui, les militaires rassureraient la population ».
Plus encore, les responsables du London District de l’armée de terre britannique ont indiqué aux rapporteurs que le Royaume-Uni avait beaucoup évolué en quelques mois dans son approche de l’emploi des armées sur le territoire national. Pour eux, avant les attentats de Paris, « les militaires sont les derniers personnels auxquels la police aurait fait appel en cas de crise ».
• Les objectifs de l’opération Temperer
L’opération Temperer est fondamentalement conçue comme une réponse à une attaque : s’il n’est pas exclu de la déclencher à titre préventif, elle a été présentée aux rapporteurs par ses concepteurs du Ministry of Defence comme un engagement « post-attaque », pendant deux à quatre semaines en principe. L’intérêt est de rassurer la population, de « montrer la résilience du Gouvernement », et de renforcer les capacités antiterroristes de l’État par des personnels militaires.
Cette opération est conçue de façon à ce que l’engagement soit toujours placé, en dernier ressort, sous l’autorité et la responsabilité des pouvoirs civils, et donc de la police : « les armées ne sauraient être déployées qu’en soutien de la police ». L’architecture retenue vise ainsi à concilier deux objectifs :
‒ préserver la cohérence des forces, orientation qui est clairement affirmée en France aussi par le rapport remis au Parlement sur l’évolution de la doctrine en la matière. Pour ce faire, « à tous les échelons de commandement, les militaires seront commandés par des militaires » ;
‒ garantir le primat de l’autorité civile, et pour ce faire, « au niveau national, c’est la police qui commande » et, comme il a été précisé au London District, des opérations ne seront engagées que sur demande formelle du ministre de l’Intérieur (Home Secretary) formellement acceptée par le ministre de la Défense ou l’un de ses ministres délégués et secrétaires d’État, et resteront des « police-led operations ».
De même, en matière de renseignement, « les autorités civiles restent maîtresses », c’est pourquoi « le MI5 domine ». Ce n’est qu’en cas de besoin de soutien « très pointu » que des militaires pourraient y contribuer. Les responsables du Ministry of Defence ont d’ailleurs souligné que la nature du renseignement utile à la conduite des opérations n’est pas la même dans le cas de l’opération Banner ‒ qui reposait sur des actions antiterroristes, et sur une logique de contrôle de zone ‒ et dans celui de l’opération Temperer : en l’espèce, la menace est plus strictement terroriste et possède des ramifications internationales, ce qui correspond au cœur de métier des services de renseignement que sont le MI5 et le MI6 (21), compétents pour le renseignement extérieur.
L’opération Temperer est un plan d’envergure nationale, et pas seulement centré sur Londres. Néanmoins, les capacités policières ‒ particulièrement en matière de contre-terrorisme ‒ étant plus développées dans le grand Londres que dans le reste du royaume, la place que prend l’armée de terre britannique pourrait être plus importante en province que dans la capitale.
L’opération Temperer, comme l’opération Sentinelle en France, est une opération interarmées, possédant toutefois une nette dominante terrestre. En effet, selon les plans présentés aux rapporteurs par les autorités du London District, sur les 5 100 premiers militaires déployés, 4 472 appartiendraient à l’armée de terre, 282 à la marine et 176 à l’armée de l’air.
• Les modalités du déploiement des armées dans le cadre de l’opération Temperer
Le plan Temperer prévoit la montée en puissance en trois phases :
1. Une phase d’urgence, mobilisant 3 500 personnels spécialement préparés pour des tâches prédéterminées d’état-major ou de renfort de la police (police backfill) et placés en régime d’alerte rapide :
– un échelon d’urgence doit pouvoir être opérationnel en moins de six heures (« extreme high readiness ») pour renforcer le quartier général du London District, désigné à l’avance pour la direction de la conduite de l’opération Temperer, c’est-à-dire organiser rapidement la génération de la force nécessaire au renfort de la police, la génération de la force intervenant dans les phases ultérieures de l’opération, ainsi que le soutien de ces forces ;
– les personnels restants doivent pourvoir être engagés (notice to engage) sous 12 heures pour renforcer les effectifs de la police afin d’assurer la protection de sites sensibles : sites nucléaires, sites du ministère de la Défense, centres opérationnels régionaux de la police (police hubs), unités de police (police locations), divers sites et zones que le ministère de l’Intérieur désignerait comme prioritaires, quatre palais royaux (22), Parlement et ambassades, etc.
Le schéma d’engagement des militaires illustre le principe même d’une opération restant dirigée par la police : les policiers travaillant en binômes, un militaire devra remplacer un policier dans les binômes concernés afin de le libérer de ses tâches quotidiennes pour d’autres missions rendues prioritaires par la situation. Ainsi, à la différence des militaires de l’opération Sentinelle, les personnels britanniques seront systématiquement engagés dans des groupes statiques ou des patrouilles mixtes armées / police.
2. 1 500 hommes supplémentaires sont organisés en trois bataillons régionaux de réserve (Regional Reserve) et formés à travailler avec la police tant en zone urbaine que rurale. À la différence des 3 500 hommes engagés dans la première phase de l’opération, ces personnels n’ont pas de tâches prédéfinies ; ils ont vocation à répondre aux demandes supplémentaires de renfort que pourrait formuler la police. Leur degré d’alerte est variable :
– un état-major tactique et un échelon d’urgence (lead company) doivent être prêts à être acheminés vers leur zone de déploiement en 12 heures ;
– le reste de la force doit être prêt à être acheminé vers ses zones d’engagement en 24 heures.
La formation dispensée à ces hommes pour le cadre de l’opération Temperer se limite globalement à ce qui est nécessaire à la coopération avec la police : communications, techniques d’immobilisation d’individus, règles d’engagement, secourisme, etc.
3. 5 000 personnels supplémentaires constituent une « réserve stratégique » (Strategic Reserve) et peuvent être déployés sur ordre du Gouvernement dans le cadre du système « COBRA ». Ils n’ont d’entraînement spécifique que réduit au minimum, et n’ont pas de tâches ou d’affectation prédéfinie dans le cadre de l’opération Temperer.
Une chaîne de commandement a été prévue pour la conduite de l’opération Temperer. Selon les explications fournies aux rapporteurs à l’état-major du London District, cette chaîne a été organisée de façon à permettre « une intégration des militaires dans la chaîne de commandement de la police », et à plusieurs égards :
‒ l’organisation territoriale du commandement de la force Temperer est calquée sur celle de la police, divisée en plusieurs échelons territoriaux : outre l’échelon national, il s’agit d’un niveau régional (dit « niveau or »), du niveau des « secteurs » de la police (dit « niveau argent ») correspondant au ressort des centres régionaux de contrôle la police (Police Force Control Centers) eux-mêmes divisés en sous-secteurs dirigés par des Police Hubs, et de l’échelon de terrain, ou « niveau bronze ») ;
‒ des officiers de liaison sont placés auprès des états-majors de la police à tous les niveaux territoriaux de commandement et de contrôle ;
‒ enfin, on rappellera que la direction nationale de l’opération s’appuie sur une robuste structure interministérielle : COBRA.
• Les questions restant à traiter dans la mise en œuvre du plan
Les discussions, tant au Parlement qu’au ministère de la Défense et au London District, ont permis aux rapporteurs de passer en revue certains éléments identifiés par les responsables britanniques comme pouvant constituer des points d’attention dans le dispositif Temperer.
Cette mission nouvelle pour les armées britanniques ne mobilise certes pas « en temps normal » des effectifs nombreux, mais si l’opération Temperer devait être déclenchée, les armées britanniques devraient l’effectuer en ne pouvant compter que sur leurs effectifs actuels. Pour l’armée de terre, il s’agit de 82 000 militaires d’active et 30 000 réservistes, parmi lesquels 10 000 hommes sont stationnés à l’étranger et 17 000 affectés à des postes « statiques », c’est-à-dire difficilement mobilisables pour une opération.
L’adjoint du sous-chef « opérations » de l’état-major des armées britannique a ainsi estimé devant les rapporteurs que la gestion des ressources des armées constituait un des défis majeurs de l’opération Temperer :
‒ en cas de déclenchement de l’opération, les gestionnaires des ressources humaines devront procéder à des annulations générales de permissions, d’entraînements et de préparations opérationnelles, ainsi que de toutes activités « non essentielles » ;
‒ en cas d’inscription de l’opération Temperer dans la durée, à l’image de l’opération Sentinelle en France, « il faudra alors « travailler la capacité à durer », notamment envisager un recours massif aux réservistes », et ce « d’autant que les perspectives d’engagement en opérations extérieures ne sont pas au plus bas ».
Les responsables britanniques se sont aussi dits conscients d’un risque d’hystérèse dans l’opération Temperer, c’est-à-dire d’une certaine difficulté qu’aurait le Gouvernement, une fois l’opération engagée, à y mettre un terme ou, à tout le moins, réduire les effectifs mobilisés. Ce risque peut trouver un écho concernant l’opération Sentinelle.
L’opération Temperer a fait l’objet de trois exercices depuis mi-2015 ‒ un exercice de grande ampleur mené conjointement avec la police, et deux exercices internes aux armées. Selon l’état-major du London District, il en ressort que :
‒ l’emploi des capacités dites d’ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, c’est-à-dire : renseignement, surveillance et reconnaissance), par exemple la mise à disposition de la police d’hélicoptères de surveillance, peut être amélioré ;
‒ l’appui d’autres départements ministériels dans la gestion de la crise doit être recherché, notamment pour améliorer la logistique de l’opération, qui nécessite des infrastructures immobilières importantes et suppose des transports efficaces alors que le grand Londres présente des risques d’engorgement en cas de crise ;
‒ la soutenabilité dans le temps de l’opération repose sur l’emploi de réservistes, tant pour participer directement à l’opération Temperer que pour relever « en base arrière » les militaires d’active qui y sont déployés. Si l’opération est prévue pour durer deux à quatre semaines, voire davantage, le recours aux réserves est très souhaitable dès la deuxième semaine.
Enfin, concernant la qualité de la coopération entre la police et les armées, certains responsables militaires ont indiqué aux rapporteurs qu’au niveau local, la coordination s’effectue au jour le jour sans difficulté.
iv. La place de l’opération Temperer dans une stratégie globale de protection du territoire britannique
Les entretiens des rapporteurs, notamment avec le président de la commission de la Défense de la Chambre des Communes, M. Julian Lewis, ont permis de replacer l’opération Temperer (et, plus largement, le recours aux armées pour la protection du territoire national britannique) dans la politique d’ensemble de protection du territoire et des populations contre le risque terroriste d’inspiration djihadiste.
• La réalité et l’ampleur de la menace djihadiste
S’exprimant à titre personnel, le président Julian Lewis a souligné l’importance de la menace terroriste d’inspiration djihadiste au Royaume-Uni. Il a estimé que sans amalgamer islam et terrorisme, il fallait distinguer entre les musulmans trois catégories de personnes :
‒ ceux qui sont éloignés de tout extrémisme ;
‒ les extrémistes, « volontiers violents », qui sont aujourd’hui « la cible de tous les efforts de prévention et de surveillance » ;
‒ « une catégorie intermédiaire, la plus difficile à discerner » : ceux qui adhèrent à une vision radicale de l’islam, mais prétendent réprouver la violence.
M. Julian Lewis a d’ailleurs indiqué que la ministre de l’Intérieur (Mme Theresa May, Home Secretary) admettait elle-même que la menace actuelle ne tient pas à l’extrémisme violent, mais à l’extrémisme « tout court ». Pour lui aussi, « même si des radicaux, des extrémistes, « donnent des tuyaux » pour s’assurer des bonnes grâces du Gouvernement et donner du crédit à leur posture non violente, l’extrémisme est en tout état de cause néfaste ».
C’est pourquoi, comparant la lutte contre la menace djihadiste non à une troisième guerre mondiale mais à une deuxième guerre froide, le président de la commission de la Défense de la Chambre des Communes a jugé qu’il y avait encore beaucoup à faire pour « élaborer une doctrine anti-islamiste aussi efficace que la doctrine anticommuniste de la guerre froide ». Pour lui, la menace des extrémistes violents et les risques que font peser ceux qui jouent à ses yeux un double jeu est de nature comparable à l’intérieur des frontières et à l’extérieur.
• Protection et prévention
Interrogés sur l’équilibre à trouver entre prévention du terrorisme (notamment par un effort accru de renseignement) et déploiement de forces de protection, les interlocuteurs des rapporteurs, tant au ministère de la Défense qu’au Parlement, ont loué l’efficacité des services de renseignement, et présenté l’action de ceux-ci comme complémentaire des missions de protection de la police et, le cas échéant, des armées.
Les militaires se sont dits satisfaits de la coordination des différentes agences de renseignement, et particulièrement de la circulation de l’information entre le MI5 ‒ chargé du renseignement intérieur et, à ce titre, responsable principal de la lutte antiterroriste ‒ et les autres services. Ils ont expliqué que cette articulation efficace des différents services tient notamment à la création, en 2003, d’un centre interagences d’analyse du terrorisme ‒ Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC) ‒ placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. M. Julian Lewis a précisé que pour avoir été membre pendant cinq ans de la commission parlementaire du renseignement et de la sécurité ‒ Intelligence and Security Committee of Parliament ‒, il n’a jamais eu l’impression que les rivalités étaient marquées entre services ; au contraire, il est d’après lui fréquent qu’en matière de lutte contre le terrorisme, des équipes mixtes soient constituées.
M. Julian Lewis a insisté sur l’importance du programme de prévention de la radicalisation islamiste mis en œuvre par le Gouvernement (Prevent Program). Pour lui, à long terme, une telle politique de prévention est indispensable pour éviter que les jeunes de la communauté musulmane « ne se radicalisent encore plus vite, trop vite pour les services de renseignement ». Il a indiqué que cette politique de prévention était au cœur des discussions parlementaires et du débat public, en raison des empiétements sur les libertés individuelles qu’elle peut permettre.
Il repose sur un dispositif de repérage des jeunes en voie de radicalisation, qui passe par exemple par l’obligation faite aux universités de signaler à la police les cas concernés. Les individus ainsi repérés suivent ensuite un programme de déradicalisation, dont M. Julian Lewis a estimé qu’il fonctionnerait d’autant mieux que l’on essaierait de trouver des relais dans la communauté musulmane pour le mettre en œuvre.
Signe de la continuité entre les actions de prévention et de protection, ainsi qu’entre les domaines de responsabilité des ministères de l’Intérieur et de la Défense en la matière, la stratégie de sécurité nationale ‒ National Security Strategy (NSS) ‒ et la revue stratégique de défense et de sécurité ‒ Strategic Defence and Security Review (SDSR) (23) ‒ ont prévu la mise en place d’un fond spécial (Joint Security Fund) pour financer des projets concourant à la lutte contre le terrorisme djihadiste. Ce mécanisme de financement interministériel des surcoûts servira à abonder les budgets du ministère des Affaires étrangères, du Ministry of Defence, du ministère du Développement international et des agences de renseignement. Son montant devrait atteindre 1,5 milliard de livres d’ici 2020, et qui profitera en partie à la défense (on évoque une part de 50 % à 66 %).
Les rapporteurs se sont rendus à Bruxelles au surlendemain des attentats qui ont frappé la ville le 22 mars 2016, pour y étudier la stratégie belge de protection du territoire national contre le terrorisme d’inspiration djihadiste et la place des armées en son sein.
i. Le cadre légal et doctrinal de l’engagement des armées belges sur leur territoire national
• Le cadre légal
La Belgique a plusieurs cadres possibles d’emploi des forces armées :
‒ la réquisition, cadre juridique très précis dont l’emploi est très rare, mais auquel le Gouvernement a eu recours pour employer les forces spéciales lors des attentats du 22 mars 2016 ;
‒ un protocole d’accord entre le ministère de la Défense et le service public fédéral de l’Intérieur règle les conditions dans lesquelles les forces militaires peuvent être mises à la disposition de la police. Ce protocole est bref : cinq pages.
Au ministère belge de la Défense, le colonel Pierre Gérard, directeur des opérations et de l’entraînement, et le capitaine de frégate Pierre-Yves Rosoux, secrétariat administratif et technique au cabinet du vice-premier ministre et du ministre de la Défense, ont indiqué aux rapporteurs que, dans l’ensemble, le cadre légal de l’emploi de la force par les armées belges sur leur territoire national est le même que celui des Français : la légitime défense.
Sans violer ce principe, il ne serait envisageable d’élargir les possibilités d’usage légal de la force que suivant deux pistes :
‒ « travailler la notion d’intention hostile » dans les règles d’engagement, notion qui est parfois utilisée (mais pas toujours) en OPEX, et dont l’invocation sur le territoire national revient mais aux yeux du colonel Gérard à s’engager sur « un terrain glissant » ;
‒ déclarer une zone « zone militaire », ce qui « change complètement le cadre légal » applicable, mais que les Belges n’ont pas fait pour l’heure.
Concernant les autres compétences juridiques des soldats, les prérogatives des militaires sont les mêmes que celles des Français : la loi ne permet pas de faire des fouilles. Néanmoins, la législation permet de déroger à cette interdiction en cas de circonstances exceptionnelles et à la date du déplacement des rapporteurs, moins de 48 heures après les attentats du 22 mars, les militaires étaient autorisés à pratiquer des fouilles sur décision du Gouvernement, au motif de la situation d’urgence et d’imminence de la menace. Le colonel Gérard et le capitaine de frégate Rosoux leur ont expliqué que cette extension des prérogatives des militaires n’était pas appelée à durer, d’autant que le niveau de menace devait rapidement « redescendre de 4 à 3, le niveau 3, en théorie, n’appelant pas la conduite de patrouilles ».
Par ailleurs, les armées n’ont pas d’activité de renseignement. Le service de renseignement militaire est intégré aux instances politiques et militaires de direction des opérations, mais il n’est pas habilité à effectuer des missions sur le territoire national ; aussi, les « capteurs » du service ne sont pas utilisés sur le territoire national. C’est la compétence du service de Sûreté de l’État, avec lequel, selon le colonel Gérard, « la collaboration est excellente ».
Aux yeux du colonel Gérard et du capitaine de frégate Rosoux, « le fédéralisme complique considérablement les choses : même la région de Bruxelles-Capitale dispose d’un conseil de sécurité... » De façon générale, « il y a un recouvrement de compétences en matière de sécurité, et des hiatus de compétences ». Par exemple, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), autorité administrative fédérale chargée d’évaluer de façon indépendante la sécurité du territoire national, peut porter au niveau 4 l’évaluation de la menace pesant sur la sécurité du territoire et de la population belges (c’est le plus haut niveau existant dans l’échelle belge de mesure des menaces), mais n’a pas compétence pour suspendre l’activité des transports publics, décision qui appartient à la région seule. La mise en œuvre des mesures de protection de « niveau 4 » en décembre 2015 a révélé un manque de concertation entre les institutions, mais selon les responsables du ministère de la Défense, « des progrès ont été faits, dont atteste la gestion de la crise de mars 2016 ».
• Le cadre conceptuel et doctrinal
Les responsables du ministère de la Défense belge rencontrés par les rapporteurs ont souligné l’importance d’une utilisation avisée de la gradation des niveaux de menaces et des mesures de protection qui y sont associées. Pour le colonel Gérard et le capitaine de frégate Rosoux, en décembre 2015, « le niveau 4 [d’évaluation de la menace] a été proclamé pour des raisons que beaucoup voient comme politiques », entraînant « des mesures draconiennes, comme la fermeture des écoles » ‒ d’ailleurs, même après les attentats du 22 mars 2016, la Belgique n’a pas pris les mêmes mesures. Aux yeux des militaires belges, « on a mis le doigt dans l’engrenage » en décembre, le but étant d’éviter de tomber dans les mêmes travers en mars.
S’agissant des modes d’action des militaires déployés sur le territoire national, les responsables du ministère de la Défense ont souligné que « les retours d’expérience d’Irak et d’Afghanistan montrent l’importance de l’aléatoire, donc du dynamique ».
De surcroît, une pression opérationnelle intense pèse sur l’armée de terre belge : sur 10 000 hommes, 950 sont déployés sur le territoire national. Aussi, pour « tenir dans la durée », il faut « élargir le vivier » de mobilisation de soldats ‒ ce qui, à la date du déplacement des rapporteurs, était d’ores et déjà fait pour l’armée de l’air et était envisagé pour les personnels affectés aux soutiens et à l’environnement des forces : « on n’a pas le choix, on va devoir le faire, sous réserve bien sûr de l’aptitude professionnelle (notamment physique) des hommes ». Surtout, le colonel Gérard et le capitaine de frégate Rosoux ont estimé que la pression opérationnelle ne pourrait être maîtrisée qu’en adaptant les modes opératoires de la force, faisant valoir que « les modes opératoires les plus créatifs sont aussi les plus économes en effectifs ». Ils ont cité en exemple une initiative prise le jour même de la visite des rapporteurs à Anvers : la surveillance du port (« qui demanderait un régiment ou une brigade si l’on se limitait aux moyens terrestres »), a été renforcée par des moyens de l’armée de l’air.
L’idée d’un continuum entre sécurité intérieure et sécurité extérieure semble convaincre les autorités du ministère de la Défense, qui élabore un nouveau plan stratégique insistant sur ce concept, mais selon le colonel Gérard, « on a du mal à le vendre ». Néanmoins, les ministres de la Défense et de l’Intérieur sont membres du même parti et personnellement amis, « ce qui facilite grandement les relations ». En outre, leur parti (la Nieuw-Vlaamse Alliantie, N-VA) « a une approche sécuritaire très anglo-saxonne : ils sont donc très ouverts au déploiement d’unités militaires ».
ii. Le déploiement des armées belges depuis 2015 sur leur territoire
Il y a des précédents de déploiement des militaires sur le territoire national dans les années 1980, contre les cellules communistes combattantes (CCC). Les armées belges ont également une mission traditionnelle d’aide à la Nation, y compris pour des missions d’appui à la police fédérale en cas de manifestations – si les militaires ne sont pas habilités à effectuer des missions de maintien de l’ordre, ils y sont entraînés pour les opérations extérieures mais restent en deuxième ligne derrière la police.
Depuis 2015, les forces armées belges ont été chargées d’une mission de protection du territoire national, appelée opération Vigilant Guardian, dont l’encadré ci-après présente les modalités.
L’opération Vigilant Guardian
Après qu’une cellule terroriste a été démantelée à Vervier quelques jours après les attentats de janvier 2015 à Paris, les autorités ont décidé de renforcer les mesures de protection de certains sites sensibles. Or, comme l’a fait remarquer aux rapporteurs M. Alain Lefèvre, directeur du centre de crise du service public fédéral de l’Intérieur, « si la Belgique est un petit pays, elle n’en possède pas moins un grand nombre d’infrastructures sensibles », à tel point que la police a fait savoir que le nombre d’hommes nécessaires pour assurer les gardes supplémentaires ainsi demandées mettait en péril l’exercice de sa mission de base, par une trop grande ponction sur les effectifs. C’est pour pallier cette difficulté qu’il a été décidé de recourir aux militaires.
Les principales zones d’engagement des armées sont Bruxelles, Anvers, Charleroi et Liège ‒ 50 % des effectifs étant cependant concentrés à Bruxelles. Selon les explications fournies à Bruxelles par les rapporteurs, Anvers est à la fois le principal bastion de la NV-A et le centre historique de la communauté juive, dont les lieux de rassemblement (synagogues, écoles, etc.) constituent les principaux sites d’engagement des armées ‒ ce qui conduit les responsables du ministère de la Défense à craindre « un risque de stigmatisation de cette communauté ». En outre, dans les principales gares, des militaires ont été chargés de missions de canalisation des flux et de fouille de personnes. Les armées ne sont pas concernées par la protection des frontières, et ne veulent pas l’être : pour les militaires rencontrés par les rapporteurs, « cela relève de la police ».
L’effectif engagé a fluctué : il a connu un pic en novembre, après les attentats de Paris, avant d’être progressivement réduit. Il avait fait l’objet d’un nouveau renforcement, en urgence, après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles.
Le centre de crise a conduit une évaluation de cette opération. Il en ressort plusieurs points positifs : le bon accueil général fait par la population aux militaires ; une « bonne intégration » entre forces armées et forces de police ; le fait que les militaires aient constitué « un maillon essentiel de la sécurisation » du territoire national.
Il en ressort également certains points d’attention : une perception « parfois erronée » du rôle des militaires par la population ; une communication « perfectible » ; un estompement de la vigilance générale avec l’installation du dispositif de protection dans la durée.
Le centre de crise, à la suite de cette évaluation, a été conduit à formuler des propositions d’ajustement du dispositif :
‒ adapter certains cadres légaux, y compris pour le partage des informations entre la police et les armées, ou pour les fouilles ;
‒ développer un cadre commun d’action entre la police et les armées ;
‒ développer les modes d’action aléatoires et dynamiques, en travaillant « en cluster » plutôt qu’en postes statiques.
iii. Structures et procédures de gestion de crise
• Les procédures de gestion de crise
À la différence des procédures françaises, le niveau de la menace est évalué non par le Gouvernement directement, mais par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), autorité administrative fédérale placée sous l’autorité conjointe des ministres de l’Intérieur et de la Justice, dont l’encadré ci-après décrit le rôle.
L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace
Selon les explications fournies aux rapporteurs, cet organe a été créé à la suite d’une recommandation de l’Union européenne et d’un processus d’évaluation par les pairs (peer evaluation) sur le fonctionnement des services, suivant le modèle dit de fusion center. Il centralise ainsi des informations fournies par divers services : le service de sûreté de l’État, le service général du renseignement et de la sécurité, les polices fédérales et locales, l’administration des douanes et accises du service public fédéral des Finances, l’Office des étrangers du service public fédéral de l’Intérieur, le service public fédéral de la Mobilité et des Transports et le service public fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement. Le directeur du centre de crise a précisé aux rapporteurs que pour garantir la bonne transmission des informations nécessaires à l’analyse et la menace, un système de sanction a été prévu par la législation en cas de défaut de coopération d’un service.
L’organe est placé sous la responsabilité d’un directeur qui, comme son adjoint, est un magistrat choisi conjointement, au sein d’un collège, par les ministres de la Justice et de l’Intérieur. C’est au directeur qu’il revient de prendre la décision finale d’évaluation du niveau de menace, sur une échelle de 1 à 4.
Les entretiens des rapporteurs au ministère de la Défense leur ont permis d’étudier les structures et les procédures de planification et de conduite des opérations sur le territoire national. Selon le colonel Gérard et le capitaine de frégate Rosoux, « une structure de planification existait, mais elle était en cours de réforme » à la date des attentats de mars 2016.
Pour ce qui est de la conduite des opérations militaires sur le territoire national en réaction aux attentats du 22 mars, le colonel Gérard et le capitaine de frégate Rosoux ont indiqué aux rapporteurs qu’elle avait été dirigée par deux cellules mises en place pour l’occasion, suivant une organisation de circonstance que le retour d’expérience de l’opération devait permettre en consolider :
‒ une cellule « politique » (ou « stratégique »), chargée d’arrêter des orientations stratégiques, qui réunit les ministres ou leurs représentants au centre de crise permanent du service public fédéral de l’Intérieur (cf. infra) ;
‒ une cellule « opérationnelle », dont les membres se réunissent sous la présidence d’un représentant du service public fédéral de l’Intérieur, chargée des aspects opérationnels de tous les moyens, y compris ceux de la défense.
La cellule « politique » se réunit dans la salle de crise permanente du service public fédéral de l’intérieur. La cellule opérationnelle, elle, est déployable ; comparable à un poste de commandement militaire classique, elle n’est par nature pas permanente.
Les modalités suivant lesquelles les armées peuvent prêter leur concours aux autorités civiles sur le territoire national belge ont été réglées par un protocole d’accord conclu en janvier 2016 entre le ministère de la Défense et le service public fédéral de l’Intérieur. Selon les précisions fournies aux rapporteurs, ce protocole prévoit la fourniture par les armées de moyens humains ainsi que de moyens spécialisés ; il exclut cependant toute forme de substitution des militaires aux policiers, le maintien de l’ordre par les militaires et le transfert de compétences judiciaires aux soldats. L’encadré ci-après précise ces conditions.
Stipulations du protocole d’accord défense / intérieur de janvier 2016
L’intérieur ne peut recourir à cette procédure de demande de concours qu’en cas de menace de niveau au moins 3 (suivant l’échelle d’évaluation de la menace qui va de 1 à 4), sur tout le territoire national ou sur certains sites en particulier.
L’engagement des militaires est limité à une durée d’un mois, qui ne peut être renouvelé que par le Conseil des ministres. Aussi, tous les mois, le directeur du centre de crise, compétent pour définir les mesures de protection, doit défendre ces mesures devant le « comité stratégique » interministériel compétent en matière de renseignement et de sécurité (rassemblant des responsables des services et des cabinets ministériels), puis devant le conseil national de sécurité (rassemblant, sous la présidence du Premier ministre, les vice-premiers ministres et les ministres de l’Intérieur, de la Défense et de la Justice). Concrètement, les chefs de services présentent les informations dont ils disposent, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace en présente une synthèse et évalue sur une échelle allant de 1 à 4, et le directeur du centre de crise propose des mesures.
Le Gouvernement fixe en Conseil des ministres un plafond d’effectifs pour les militaires susceptibles d’être engagés sur le territoire national.
Parallèlement, les bourgmestres et les chefs de corps de la police locale peuvent adresser au Conseil des ministres des demandes de concours des armées, demandes qui sont instruites par le centre de crise.
La planification de l’engagement des armées privilégie systématiquement les équipes mixtes, constituées de policiers et de militaires, au sein desquelles « c’est la police qui dirige et assure le briefing des militaires ». La direction opérationnelle relève de la police, mais chaque ministère reste responsable de la mise en œuvre de son personnel.
Lorsqu’elle bénéficie du concours des armées, la police leur en apporte un dédommagement financier, via un fonds spécifique.
• Les structures sous-tendant la gestion de crise : le centre de crise du service public fédéral de l’Intérieur
Le déplacement des rapporteurs à Bruxelles les a conduits à se rendre au centre de crise du service public fédéral de l’Intérieur et à s’entretenir avec M. Alain Lefèvre, directeur de ce centre.
Ce centre de crise a été créé dans les années 1980, car les crises d’alors avaient montré un défaut de coordination interministérielle (au niveau fédéral au moins) « et que les infrastructures ne suivaient pas ». Il s’agit d’un ensemble de salles de crise permanent, servi par un personnel également permanent, servant de « centre névralgique de la gestion de crises ». Selon M. Lefèvre, le rattachement de ce centre interministériel de crise au service public fédéral de l’Intérieur s’explique par le fait que « dans tous types de crise, on a besoin des services de police et de sécurité » ‒ même pour des cas de peste bovine, il faut établir des périmètres de sécurité ‒ et que « cela confère un pouvoir d’injonction sur les services de police et de sécurité ».
Comme le directeur l’a indiqué aux rapporteurs, ce centre a cinq missions :
‒ assurer une permanence « H 24 et J 365 », pour collecter et diffuser des informations non seulement au service public fédéral de l’Intérieur (auquel est rattaché le centre), mais à l’ensemble des départements ministériels, en cas de crise survenant sur le territoire national belge ou affectant les intérêts belges à l’étranger (prise d’otage à bord d’un bateau, accident aérien avec des victimes belges, etc.) ;
‒ organiser la gestion des crises et des grands événements et assurant l’articulation de trois niveaux d’administration publique : fédéral, provincial et communal. Le centre est donc utilisé pour tous types de crises : incident dans un centre de recherche nucléaire, grands incendies, train qui déraille avec des substances chimiques, etc. le directeur a souligné que la gestion des grands événements prend de plus en plus d’ampleur dans l’activité du centre, tant parce que d’importantes institutions internationales ont leur siège en Belgique ‒ ce qui y amène notamment des manifestations de grande ampleur : agriculteurs, éleveurs, dockers, etc. ‒ que parce que d’importants événements internationaux s’y tiennent, comme des sommets de l’UE, de l’OTAN, etc. L’expertise belge en la matière est reconnue au niveau international, et selon M. Lefèvre, c’est la raison pour laquelle lorsque le G8 est redevenu le G7, son premier sommet a été organisé en deux mois à Bruxelles, alors même que le G7 évite généralement de se réunir dans une capitale ;
‒ assurer la protection des personnes et des biens. Au titre de la protection des personnes (comme des chefs d’État en visite, des hommes politiques ou des magistrats menacés), le centre décide des moyens de protection sur la base d’évaluations de la menace fournies par les services compétents. Au titre de la protection des biens, le centre organise la protection d’une série d’installations comprenant les infrastructures critiques dont le droit de l’Union européenne établit une liste, complétée par un recensement national plus large ; il y travaille en lien avec les autorités compétentes pour la protection des infrastructures (centrales de production d’électricité, réseaux ferroviaires, etc.) ;
‒ tenir à la disposition du Gouvernement une infrastructure complète de gestion de crise : téléphonie, systèmes de visualisation (hélicoptères, cartes, etc.) ;
‒ établir des plans d’urgence « à froid » impliquant les trois niveaux territoriaux d’administration (fédéral, provincial, communal) et l’ensemble de l’éventail interministériel de compétences, réparties en cinq « disciplines ». Ainsi, pour chaque « discipline » et pour chaque niveau territorial, le centre élabore des plans d’urgence spécifiques : plan nucléaire, plan SEVESO, réponse à une pandémie humaine, épizooties, inondations, crise des transports aériens, terrorisme, rupture d’approvisionnement pour les besoins vitaux (pétrole, gaz, électricité, etc.).
L’encadré ci-après précise les modalités de fonctionnement de ce centre.
Le centre de gestion de crise
Le centre reçoit des informations de toutes les autorités concernées ; ses personnels sont tous habilités à connaître d’informations classifiées. Selon le directeur du centre, depuis les années 1980, les processus de transmission des informations ont été rodés, si bien que même s’il n’existe pas de dispositif légal de sanction pour contraindre les services à transmettre au centre de crise tout renseignement pertinent ‒ à la différence de ce qui est prévu pour l’OCAM ‒, la circulation de l’information ne semble pas poser de difficulté. Il faut préciser toutefois que les agents du centre de crise ne sont pas qualifiés pour assurer eux-mêmes l’évaluation des informations : ils ne se substituent pas aux analystes des services compétents, qui peuvent être sollicités par le centre si une information provenant d’une autre source ‒ que ce soit un ministère ou les médias et les réseaux sociaux, « riche source d’information » aux yeux du directeur du centre ‒ mérite une analyse approfondie.
Sur la base de ces informations :
‒ soit la situation paraît « claire et sans enjeu politique majeur », auquel cas le centre donne directement des ordres aux services de police, fédérale comme locale, envers lesquelles le centre dispose d’un pouvoir d’injonction ;
‒ soit elle appelle une discussion interministérielle, pour laquelle le centre convoque une réunion à bref délai : ainsi, le 22 mars 2016, ce délai n’a pas excédé 50 minutes.
C’est le directeur du centre qui arrête les décisions relatives à la gestion des crises, et les communique au directeur de cabinet du Premier ministre.
● Les moyens humains du centre de crise sont relativement limités : 90 personnels (officiers de liaison et personnels détachés compris), dont l’effectif est appelé à être renforcé.
Quant aux moyens techniques du centre, ils consistent pour l’essentiel en des salles de réunion permettant d’accueillir, avec les infrastructures de réseaux adaptées, les responsables des autorités politiques de différents départements ministériels, les autorités « stratégiques », une cellule d’évaluation de la situation, une cellule de communication, et une cellule de gestion « socio-économique » de la crise (dont la mission consiste à organiser le « retour à la normale » dans les meilleurs délais). Aussi, le centre doit disposer en permanence d’au moins quatre salles de gestion de crise, et de salles supplémentaires en cas de besoin.
Il organise également une permanence 24 heures sur 24, chargée de suivre les médias, de prendre connaissance des messages destinés au centre, et de consulter régulièrement les moyens de communication cryptés. Cette équipe permanente compte 35 personnels, dont la direction est assurée par trois « lignes » de « chefs de permanence » : une première est chargée d’apporter une réaction immédiate aux crises, de l’ordre du « réflexe », sur la base de procédures préétablies ; une deuxième est chargée d’un examen plus approfondi des dossiers qui le nécessitent, ce qui permet de ne pas « engorger » la permanence ; la troisième est constituée d’experts spécialisés dans certains domaines (sécurité nucléaire, sécurité aéroportuaire, etc.). Les « chefs de permanence » sont assistés par des officiers de liaison et par des spécialistes de différentes matières (communication, infrastructures critiques, rédaction de plans, informatique, etc.).
● Les rapporteurs ont pu évaluer sur place le degré de protection du site du centre de crise, et le trouver étonnamment discret au regard des hautes responsabilités des agents qui y sont affectés. Pour le directeur du centre, cette discrétion est souhaitable ‒ « il faut rester humble, pour passer inaperçu » ‒, mais la même logique supposerait qu’en cas d’indisponibiltié des infrastructures du centre, il existe « un back-up », c’est-à-dire des infrastructures redondantes par sécurité ; faute de moyens, cela n’est pas possible à Bruxelles, mais pour pallier cette difficulté, le centre développe des moyens déconcentrés dans les provinces, sur les infrastructures desquelles il pourrait s’appuyer en cas de difficulté dans la capitale.
iv. L’impact de l’engagement des armées dans la vie politique et dans l’opinion publique
Les rapporteurs se sont rendus à la Chambre des députés, tant en séance lors du débat sur les attentats du 22 mars 2016, que pour des entretiens avec MM. Brecht Vermeulen, président de la commission de l’Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, et avec M. Georges Dallemagne, député de Bruxelles et membre de la commission spéciale sur la lutte contre le terrorisme.
M. Brecht Vermeulen a résumé en deux termes le sentiment de ses collègues au surlendemain des attentats :
‒ « colère », car les terroristes étaient nés et éduqués en Belgique, et que selon lui, ils ont bénéficié de complicités (ou du moins de « l’omerta ») au sein de certaines communautés ;
‒ « honte », car il a souligné que les auteurs des attentats étaient connus des services de la police et de la Justice.
Il a indiqué que lorsque le Gouvernement belge a proposé, à la suite des attentats du 13 novembre à Paris, de renforcer significativement les mesures de protection du territoire national belge prises à la suite des attentats de janvier 2015, le Parlement avait institué une commission spéciale sur la lutte contre le terrorisme, composée de membres des commissions chargées de l’Intérieur, de la Justice, de la Défense ainsi que de l’immigration et de l’asile.
Pour lui, le point d’équilibre s’est déplacé dans la perception par les responsables politiques des mesures de protection du territoire national. En effet, si le programme de la majorité élue en 2014 prévoyait déjà des mesures de lutte contre le djihadisme et la radicalisation islamiste, certaines d’entre elles étaient vues comme difficilement conciliables avec les libertés individuelles ‒ y compris la création d’un fichier national recensant les noms des passagers des transports aériens (Passenger Name Record, PNR), « mais les événements ont modifié l’état d’esprit général », rendant ces propositions acceptables « moyennant la création d’un Secrétariat d’État à la protection de la vie privée ». Il a toutefois regretté que ce changement d’état d’esprit ne soit pas général en Europe, citant en exemple les retards pris par les institutions européennes dans la création d’un PNR européen et dans la gestion de la crise migratoire.
S’agissant de la manière dont le déploiement des militaires est ressenti par la population, M. Brecht Vermeulen a indiqué que des responsables politiques comme une large part de la population pouvaient s’interroger sur la « légitimité » de la présence des militaires sur le territoire national belge, surtout si ce déploiement devait devenir plus ou moins permanent, tout en faisant observer que les Belges « voient bien des militaires dans les rues de Lille, de Paris, de Rome, etc. », et que l’engagement des soldats apporte un réel « sentiment de sécurité ». M. Georges Dallemagne a constaté lui aussi que le déploiement de militaires avait pu rassurer la population, avec toutefois deux réserves : d’une part, il s’est interrogé sur l’efficacité du dispositif et, d’autre part, il a précisé que lorsque les armées avaient employé des véhicules blindés, l’effet obtenu a été plus anxiogène que rassurant pour une large part de la population.
En général, tant les responsables politiques que militaires rencontrés par les rapporteurs ont souligné que les Belges n’avaient pas le même rapport à la présence sur le territoire national de leurs militaires que les Français, qui y seraient plus accoutumés, et donc plus favorables.
M. Vermeulen a également indiqué que la Belgique avait défini une trajectoire pluriannuelle de redressement du budget de la défense, mais en voit la cause davantage dans la volonté des Belges d’atteindre les objectifs fixés en la matière par l’OTAN que dans le déploiement des militaires sur le territoire national.
c. Le cas particulier d’Israël
Les rapporteurs ont souhaité compléter leur analyse comparative par une étude de la stratégie de protection du territoire national d’un État particulièrement concerné par le terrorisme, depuis plusieurs décennies : Israël.
Si le rapport précité présenté au Parlement sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population comprend des éléments de comparaison internationale, il ne présente pas d’analyse du cas d’Israël. Pourtant, non seulement Israël est un partenaire de la France, comme le Premier ministre l’a encore rappelé à Tel-Aviv quelques jours avant le déplacement des rapporteurs, mais il peut aussi être vu comme celle des démocraties occidentales qui est confrontée au plus haut niveau de menace terroriste. Bien entendu, une étude comparative des stratégies française et israélienne de protection du territoire national ne signifie pas que les rapporteurs considèrent que la situation d’Israël soit identique à celle de la France : pousser trop loin le parallèle serait absurde. Faut-il pour autant s’interdire a priori d’étudier la façon dont une démocratie s’est adaptée à une menace terroriste de long terme ‒ indépendamment de la lecture politique que l’on peut faire des causes et des motivations du recours à la lutte armée ? Les rapporteurs ne le croient pas, et les développements suivants présentent le résultat de leurs observations lors de leur déplacement.
Il ressort des entretiens et des observations des rapporteurs en Israël que, schématiquement, la stratégie de sécurité du territoire national israélien repose principalement sur un effort de sécurisation des frontières et de renseignement intérieur. Si la place des armées dans ce dispositif de protection est plus limitée sur le territoire national à proprement parler que dans les territoires occupés et dans les zones frontalières, la protection du territoire repose cependant sur des unités de police très « militarisées », et s’inscrit dans un cadre légal et doctrinal conciliant les impératifs d’efficacité et les principes démocratiques de l’État de droit.
i. Une stratégie de protection du territoire national fondée sur un contrôle strict des frontières et des flux
Lors de leur arrivée à Tel-Aviv, les rapporteurs ont été frappés par la rareté des personnels de sécurité (militaires ou policiers) en uniforme dans l’espace public, alors même que ce grand centre urbain constitue une cible « de premier choix » pour les groupes terroristes, comme l’a montré l’attentat perpétré dans le quartier de Sarena pendant leur séjour sur place.
Ce paradoxe est levé si l’on comprend que la stratégie de défense du territoire d’Israël repose à titre principal sur le contrôle des frontières et des flux qui les empruntent. Ainsi, selon le député Omer Barlev, militaire de carrière ayant commandé l’unité d’élite des forces spéciales israélienne Sayeret Matkal spécialisée dans la lutte antiterroriste, le principe sous-tendant cette stratégie consiste à « neutraliser les terroristes le plus loin possible des centres urbains qui sont ses cibles : c’est pourquoi les forces sont concentrées aux frontières et non dans les centres urbains, tandis que le renseignement permet de traiter les difficultés restantes dans la profondeur géographique du territoire urbain ».
• La sécurisation des frontières et des points d’accès au territoire israélien
Le colonel Benoît de la Ruelle, attaché de défense de l’ambassade de France en Israël a confirmé aux rapporteurs que l’effort de sécurisation du territoire national israélien porte en premier lieu sur la sécurité des frontières.
L’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv constitue l’une des principales « portes d’entrée » sur le territoire israélien, et sa sécurité fait l’objet de mesures plus strictes encore que ne le prévoient les standards internationaux, avec des voies d’accès et un périmètre de sécurité grillagés sur plusieurs kilomètres, plusieurs lignes de contrôle des accès tenues par des gardes armés, et des contrôles approfondis des voyageurs et de leurs biens.
Les rapporteurs se sont également déplacés auprès de la « barrière de sécurité » dont les Israéliens ont entamé la construction autour d’un périmètre correspondant au territoire de l’État d’Israël à proprement parler ‒ modulo certains tracés contestés par la communauté internationale et, devant les juridictions israéliennes, par des justiciables israéliens ou palestiniens. Autour de Jérusalem annexée, la « barrière de sécurité » doit se dérouler sur 145 kilomètres de long, dont 127 kilomètres sont déjà construits et huit kilomètres dont le tracé fait encore l’objet de recours en justice. Ce dispositif vise à créer entre la ville de Jérusalem et la zone placée sous la responsabilité de l’Autorité palestinienne une « enveloppe de sécurité ». Le tracé du mur ne recoupe pas tout à fait les frontières de l’État d’Israël, même en tenant compte des annexions non reconnues par la communauté internationale : certains villages palestiniens sont inclus dans le périmètre du mur, et certaines zones peuplées de ressortissants israéliens demeurent extra muros.
Cette barrière prend, sur la plupart de sa longueur, la forme d’un haut mur bétonné équipé de caméras de surveillance et de capteurs de mouvements ainsi que de tours de contrôle et bordé d’une route de patrouille, précédée par endroits d’une première ligne de barrières et, parfois, d’une zone laissée vide et formant un glacis ; ailleurs, elle prend la forme de barrières frontalières classiques. Selon les précisions fournies aux rapporteurs lors de leur visite de l’état-major de la police aux frontières (le Magav, acronyme de Mishmar HaGvul) pour la zone de Jérusalem, la configuration dépend du terrain : dans les zones densément peuplées, « mieux vaut un mur ».
Seize points de passage sont aménagés : ils se présentent comme des postes frontières permettant le filtrage et le contrôle des véhicules et des piétons, adossés à des infrastructures de rétention, de contrôle approfondi, de regroupement, de transfert de véhicules et d’hébergement de divers services administratifs. Le dispositif vise à entraver la circulation de terroristes, mais aussi tous types de criminalité et de trafics. Lors de leur déplacement à un check point placé entre Jérusalem et le camp palestinien de Kalandia, les rapporteurs ont ainsi pu étudier les modalités pratiques de ce dispositif de contrôle de flux, et des divers trafics que les forces de se sécurité y constatent (passagers clandestins, armes, denrées alimentaires, tabacs de contrebande, etc.) car, comme l’ont indiqué aux rapporteurs les responsables du Magav de Jérusalem, « l’entente et la coopération sont parfaites entre délinquants israéliens et palestiniens… ». En tout, les seize points de passage aménagés autour de Jérusalem enregistrent 33 millions de franchissements par an, et celui de Kalandia, où les rapporteurs se sont rendus, 7,2 millions. Il s’agit très majoritairement de mouvements pendulaires de travailleurs palestiniens.
Le système de sécurité organisé autour de la « barrière » repose sur l’effet combiné de trois systèmes :
‒ l’infrastructure elle-même, c’est-à-dire le mur et ses capteurs d’alerte, d’atteinte et de franchissement ;
‒ l’activité opérationnelle du Magav, qui assure des contrôles aux points de passage et des patrouilles le long du mur. Passant en revue une partie du parc de matériels roulants protégés utilisés pour ces patrouilles, les rapporteurs ont pu constater qu’elles font régulièrement l’objet d’atteintes diverses : jets de pierres, tirs, explosifs artisanaux, jet de pots de peinture sur les pare-brises afin de désorienter les conducteurs, etc. Selon les précisions du Magav, les incidents sont quotidiens ;
‒ diverses sources de renseignement, comprenant notamment une surveillance vidéo permanente, qui permettent de lancer des alertes et de déclencher l’intervention des forces du Magav ou de celles de Tsahal. Les rapporteurs se sont rendus au centre de contrôle des dispositifs de surveillance vidéo, où la surveillance est organisée de telle sorte que tout point de la « barrière de sécurité » fait l’objet d’un contrôle visuel au moins toutes les dix minutes.
L’« enveloppe de sécurité » ainsi organisée autour de Jérusalem est gardée par 1 700 hommes environ, dont 736 policiers du Magav affectés principalement au contrôle des points de passage, 565 hommes de la police militaire, 114 agents chargés du recueil du renseignement ‒ notamment par la surveillance vidéo des abords de la barrière ‒, 33 agents de liaison et de coordination avec l’Autorité palestinienne, 41 policiers n’appartenant pas au Magav, et 204 gardes de sociétés privées de sécurité.
• Un dispositif de sécurité relativement léger à l’intérieur du territoire
Selon les informations fournies aux rapporteurs, les écoles israéliennes sont certes gardées, mais leur sécurité est confiée à des sociétés privées. En outre, bien qu’Israël ait subi des attentats dans les lieux de culte, ceux-ci ne font pas systématiquement l’objet d’un dispositif physique de surveillance.
Plus largement, la présence policière et militaire est très peu visible à l’intérieur du territoire israélien. Le député Élie Elalouf, président du groupe d’amitié France-Israël de la Knesset, a d’ailleurs remarqué devant les rapporteurs que la densité d’agents en uniforme est plus élevée à Paris qu’à Tel-Aviv.
• Une attention particulière portée aux mouvements migratoires
Certains députés israéliens rencontrés par les rapporteurs ‒ notamment M. Michael Oren, ancien ambassadeur d’Israël après des États-Unis ‒ ont indiqué aux rapporteurs que les flux migratoires entrant en Israël constituaient à leurs yeux un facteur déstabilisant pour la sécurité de l’État. Selon eux, la « porosité » de la frontière israélo-égyptienne a permis à des réseaux de passeurs qu’ils ont décrits comme particulièrement cruels d’organiser l’immigration illégale de plusieurs dizaines de milliers de personnes via le Sinaï. Selon leurs estimations, près de 50 000 personnes seraient entrées illégalement en Israël, plusieurs dizaines de milliers d’autres y seraient entrées avec un visa de tourisme et y demeureraient illégalement à l’expiration de celui-ci.
Faisant observer que ces immigrants proviennent pour 40 % d’entre eux d’États avec lesquels il n’est pas possible aux autorités israéliennes d’organiser un rapatriement, faute d’entretenir des relations diplomatiques, ils ont souligné la difficulté qu’il y a à résoudre ce problème et exprimé des craintes concernant les conséquences de cette immigration illégale sur la sécurité d’Israël.
ii. Une intense activité de renseignement intérieur, qui donne de la profondeur stratégique au dispositif de protection du territoire
Lors de leur déplacement en Israël, les rapporteurs ont été reçus au Service de sécurité intérieure israélien (Shérūt ha-Bītāhōn ha-Klālī, ou : Shabak, également connu sous son ancienne appellation de Shin Bet) pour un entretien qui leur a permis d’étudier l’organisation des services de renseignement israéliens et la place du renseignement dans la stratégie israélienne de protection du territoire.
• Les contraintes liées à la géographie et à la situation stratégique générale d’Israël
Les responsables du Shabak ont fait valoir aux rapporteurs que le renseignement intérieur est particulièrement nécessaire pour la protection du territoire d’un État disposant d’une profondeur stratégique limitée. En effet, la géographie d’Israël rend relativement aisée la conduite d’une attaque terroriste depuis l’extérieur des frontières par la conjugaison de deux effets :
‒ le voisinage d’Israël est marqué par une hostilité très répandue à l’État hébreu, soit de la part des gouvernements des États en question, soit, à tout le moins, d’une part très significative de leur opinion publique. Les terroristes peuvent donc trouver des appuis dans le voisinage d’Israël ;
‒ la géographie du territoire israélien est telle que les villes, y compris la capitale, sont peu éloignées des frontières et que les infrastructures de transport permettent de parcourir très rapidement ces faibles distances.
Comme l’a fait valoir aux rapporteurs le député Michael Oren, Jérusalem se trouve « à deux heures des avant-postes de Daech, et à une heure et demie du foyer du Hamas ». Aussi, tout renseignement concernant une attaque doit être recueilli et traité dans des délais particulièrement brefs pour qu’une intervention puisse être planifiée et conduite en temps utile.
• L’organisation des services de renseignement
La communauté israélienne du renseignement comprend plusieurs services spécialisés :
‒ la direction du renseignement militaire (Agaf Ha-Modi’in, généralement désigné par l’acronyme Aman) de l’armée de défense d’Israël (Tsva Hagana LeIsrael, connu sous son acronyme : Tsahal). Si l’Aman n’a pas compétence pour opérer sur le territoire national, elle n’en est pas moins déployée soit très près des frontières (par exemple lorsqu’elle traite des tunnels de franchissement de la frontière à partir de leur débouché en territoire étranger), ou en Cisjordanie ;
‒ le Mossad (Ha-Mosad le-Modi’in u-le-Tafkidim Meyuhadim, Institut pour les renseignements et les affaires spéciales), service de renseignement extérieur chargé de prévenir les menaces pesant sur « les intérêts israéliens ou les intérêts juifs » ;
‒ le Shabak, chargé d’assurer « la sûreté de l’État et des institutions démocratiques », et ce « y compris par des méthodes offensives », contre le terrorisme, l’espionnage, la subversion et le sabotage, ainsi que d’assurer la protection des informations classifiées. De surcroît, le Shabak peut être chargé de traiter en lieu et place de la police tout problème jugé vital pour la sécurité nationale à la discrétion du Gouvernement, lorsque les capacités, les moyens et les modes d’action de la police ne suffisent pas à traiter la menace en question. Il pourrait s’agir, par exemple, de lutter contre la criminalité organisée si celle-ci prenait à l’avenir une ampleur plus considérable qu’aujourd’hui.
Les responsables du Shabak rencontrés par les rapporteurs ont également souligné l’importance de la police, qui, dans le cadre de son activité pénale et de sa mission de maintien de l’ordre public, est conduite à recueillir des informations utiles à l’activité des services.
Les missions du Shabak
Le renseignement intérieur relève en premier lieu de la compétence du Shabak, dont les responsables, devant les rapporteurs, ont énuméré les fonctions de la façon suivante :
‒ assurer la sécurité d’Israël contre les activités illégales ;
‒ assurer la protection des hautes personnalités et des bâtiments figurant sur une liste de « symboles gouvernementaux » établie par le Gouvernement. Si cette liste, traditionnellement assez restreinte, a été élargie après l’assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995, elle n’en demeure pas moins assez réduite ; en témoigne par exemple le fait que, selon les précisions fournies aux rapporteurs, le Shabak n’assure pas de protection rapprochée 24 heures sur 24 de tous les membres du Gouvernement ;
‒ gérer les listes d’habilitation à connaître des informations classifiées et procéder aux enquêtes de sécurité nécessaires à l’établissement de ces listes ;
‒ veiller à la protection des informations classifiées contre l’espionnage ;
‒ définir des procédures de sécurité pour les administrations et les bâtiments publics, et contrôler leur application. À titre d’exemple, c’est le Shabak qui définit les règles de sécurité de l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv, dont les rapporteurs ont pu constater qu’elles sont particulièrement strictes ;
‒ collecter et traiter tout renseignement intéressant la sécurité d’Israël ;
‒ fournir au Gouvernement des analyses sur la base des renseignements acquis par le service. Les responsables du Shabak ont souligné que ce champ de compétence recouvre un très large spectre de rapports, allant d’études de type académique à des évaluations précises du niveau de violence de tel ou tel groupe au jour le jour ;
‒ exécuter toute autre directive du Gouvernement concernant la protection d’un intérêt vital d’Israël.
Source : informations recueillies par les rapporteurs.
• Les moyens du Shabak
Pour remplir sa mission, le Shabak s’est doté d’une organisation territoriale et administrative spécifique, suivant un modèle « matriciel » qui articule des directions spécialisées ‒ compétentes respectivement pour les opérations spéciales, la protection et la sécurité, la contre-insurrection et la contre-subversion, les interrogations, les ressources technologiques, le cyber et le renseignement d’origine électromagnétique, les systèmes de traitement de l’information ‒ et trois directions territoriales, compétentes respectivement pour :
‒ le « centre », c’est-à-dire la région de Jérusalem et celle de « Judée-Samarie », plus habituellement appelée Cisjordanie en France ;
‒ le « sud », y compris la bande de Gaza et le désert du Neguev ;
‒ le « nord », qui s’étend du port d’Ashdod à la frontière libanaise, incluant Tel-Aviv.
Selon les explications des responsables du Shabak, chaque direction territoriale est dotée d’un niveau de ressources lui permettant d’être autonome : sauf exception, elles disposent de suffisamment de personnels et de matériels pour recueillir des renseignements, les analyser, et conduire des interventions sans attendre de renforts du niveau central. Le même souci d’autonomie préside également à l’organisation infrarégionale des moyens du Shabak. Ainsi, à l’échelle de chaque agglomération, une unité antiterroriste complète est constituée, sous la direction d’un chef de division, et dotée de moyens complets d’interrogation, d’exploration de données (data mining), de renseignement d’origines humaine et électromagnétique, de gestion des ressources humaines et de conseil juridique.
S’agissant des directions spécialisées du Shabak, l’originalité de l’architecture retenue tient à ce que l’organigramme repose moins sur une distinction classique entre services chargés du contre-terrorisme et services chargés du contre-espionnage que sur une distinction géographique entre les menaces provenant du monde arabo-musulman et celles qui proviennent du reste du monde. Selon les interlocuteurs des rapporteurs, cette spécificité s’explique par le contexte stratégique général : à leurs yeux, les activités d’espionnage de certaines puissances de la région sont couplées à un soutien actif à des groupes terroristes, ce qui rend inopérante la distinction classique entre contre-espionnage et contre-terrorisme.
Le Shabak est réputé pour la qualité de ses ressources humaines, dont l’effectif est d’ailleurs considérable : il compterait environ 7 000 agents. Même si la comparaison présente d’évidentes limites méthodologiques, on peut rapporter cet effectif à la population d’Israël (8,4 millions d’habitants) pour estimer que le même ordre de grandeur appliqué à la France correspondrait à une direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) forte de 55 600 agents, au lieu d’un effectif-cible de 4 400 personnels fin 2017.
L’appréciation généralement portée sur l’efficacité du Shabak est très positive. Selon les observateurs avertis interrogés par les rapporteurs, on peut penser que les services israéliens connaissent individuellement chaque famille voire chaque individu dans les zones considérées comme sensibles. Le suivi de la population est ainsi très poussé, et repose notamment sur des dispositifs très efficaces de renseignement d’origine humaine : certains agents sont placés « en immersion » pendant trente ans.
• La coopération entre les services de renseignement
Il ressort des entretiens des rapporteurs que tant la géographie d’Israël, avec sa faible profondeur stratégique, que la nature transfrontalière de la menace sur les intérêts israéliens rendent particulièrement nécessaire une coopération étroite des services de renseignement d’Israël.
En effet, comme l’ont fait observer les responsables du Shabak, les mêmes groupes terroristes cherchent régulièrement à frapper les intérêts d’Israël tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières, et l’existence de foyers terroristes dans la zone de compétence du Shabak rend indispensable une coordination de ce service avec le Mossad. Par exemple, si un groupe terroriste a des projets d’attentat à l’étranger (en Libye, en Syrie, etc.), son suivi relève du Mossad, mais s’il transfère des armes au Hamas dans la bande de Gaza, c’est au Shabak qu’il appartient de le savoir. De même, les responsables du Shabak ont indiqué aux rapporteurs que les capacités d’intervention de leur service étaient relativement limitées, ce qui les conduit à s’en remettre fréquemment à Tsahal pour conduire les phases d’intervention des opérations de contre-terrorisme. Et en tout état de cause, le Shabak conduit en permanence une étude fine des développements politiques, économiques, sociaux ou sécuritaires dans les pays de la région afin d’analyser leurs conséquences sur la situation et l’activité des groupes palestiniens. Certains de leurs analystes ont d’ailleurs présenté aux rapporteurs une synthèse de leurs études de l’impact des évolutions récentes du contexte régional sur les mouvements palestiniens.
La coopération inter-services semble très efficace en Israël. Si celle-ci ne prend pas une forme particulièrement institutionnalisée, à la différence de ce qui existe en France autour du coordinateur national du renseignement, les Israéliens ont mis en place un dispositif technique de partage des renseignements mis en place depuis la fin de la deuxième intifada, dans les années 2000. Ce « pool » paraît donner toute satisfaction : il permet aux services d’échanger automatiquement les informations qu’ils recueillent, tout en comportant un dispositif propre à protéger les sources d’information en cas de besoin.
Selon les observateurs avertis avec lesquels se sont entretenus les rapporteurs, les phénomènes de concurrence entre services de renseignement sont d’autant plus faibles en Israël que les services du ministère de la Défense ont en la matière une prépondérance très nette. Quand la communauté du renseignement doit s’exprimer d’une seule voix, c’est généralement celle des militaires.
iii. La place des armées dans le dispositif de protection du territoire israélien
Si la place des armées dans le dispositif de protection du territoire israélien est limitée à la défense des frontières et à l’administration des territoires occupés, c’est, par une sorte de contrepartie, au prix d’un haut degré de « militarisation » de certaines forces de police et d’une large diffusion des armes à feu parmi les civils.
• Sauf crise sécuritaire majeure, Tsahal se concentre sur la défense des frontières et l’administration des territoires occupés
Comme l’a expliqué aux rapporteurs le député Omer Barlev, même avant la guerre des Six-Jours et le contrôle de la Cisjordanie, l’État d’Israël a toujours cherché à faire intervenir le moins possible Tsahal sur son territoire national. Pour lui, « Israël a fait le maximum afin que Tsahal ne soit pas engagée à l’intérieur des frontières, sauf exception due à un niveau exceptionnellement élevé de violence ».
En effet, Tsahal n’est directement chargée de la sécurité intérieure que dans les territoires occupés de Cisjordanie (désignée en Israël sous l’appellation de « Judée-Samarie ») et sur le plateau du Golan, annexé par Israël et placé sous un statut de « territoire militaire ». Même en Cisjordanie, l’armée n’administre directement que l’une des trois zones du territoire (la zone C) ; la zone A, qui regroupe 40 % de la population, est placée sous le contrôle direct et complet de l’Autorité palestinienne, tandis que la zone B est co-administrée par Tsahal et l’Autorité palestinienne.
Ainsi, en principe, la sécurité du territoire national relève des forces de sécurité intérieure et non des armées. Toutefois, les rapporteurs ont pu constater que Tsahal peut être conduite à intervenir sur le territoire israélien de deux manières : soit dans le cadre de la mobilisation de réservistes pour prêter leur concours aux autorités civiles, soit pour la gestion de crises sécuritaires majeures.
S’agissant en premier lieu du concours de Tsahal à des opérations que l’on pourrait qualifier « de service public », les rapporteurs ont en effet pu observer un exercice conduit par le commandement du territoire national de Tsahal ‒ Pikoud HaOref, aussi appelé en anglais Home Front Command. Cet exercice consistait à mobiliser des réservistes « au pied levé » pour une opération de secourisme dans un bâtiment détruit par un missile lancé depuis le Liban.
Ce commandement, créé en 1992 à la suite de la guerre du Golfe, conduit principalement des opérations relevant du concours des armées aux services publics, reposant pour l’essentiel sur l’emploi de réservistes. Il faut en effet rappeler qu’à l’exception des Arabes israéliens et des Juifs orthodoxes ‒ deux groupes qui représentent chacun environ 20 % d’une classe d’âge ‒, l’ensemble des Israéliens, hommes et femmes, sont soumis à l’obligation d’effectuer un long service militaire (28 mois pour les hommes et 24 mois pour les jeunes femmes) et peuvent être rappelés à tout moment. Ainsi, Tsahal dispose de vingt divisions de réservistes, représentant plusieurs centaines de milliers d’hommes et de femmes susceptibles d’être appelés. Selon les précisions du chef du bataillon auprès duquel les rapporteurs se sont rendus, si la loi rend obligatoire les périodes de réserve, elle ne prévoit pas de sanction pour les récalcitrants : ainsi, de facto, la mobilisation des réservistes se fait sur la base du volontariat. Le cadre légal comporte en outre des protections pour les employés en période de réserve, et une indemnité calculée en fonction de leurs revenus civils : il semble ainsi attractif. Hormis les officiers, les réservistes ne sont appelés que le matin même de l’exercice ; néanmoins, selon le commandement, le taux de réponse à l’appel atteint 91 % en moyenne pour les exercices, et tend vers 100 % lors des mobilisations en cas de crise.
Depuis les opérations de 2006 au sud du Liban, la doctrine d’emploi de Tsahal pour la protection du territoire national en situation de crise s’inscrit dans un cadre interministériel. Ainsi, les exercices sont toujours conduits de façon conjointe entre Tsahal et d’autres autorités publiques : la police ‒ un officier de police est systématiquement placé comme adjoint aux chefs de bataillons du Home Front Command ‒, les services du ministère des Affaires sociales, ceux du ministère des Transports, et ceux des municipalités, qui sont les mieux placées pour fournir au Home Front Command tous renseignements utiles concernant la population, la structure urbaine, les réseaux de gaz et d’eau, etc. Selon les explications fournies aux rapporteurs par le commandant du bataillon conduisant l’exercice auxquels ils ont assisté, en situation de crise, les unités de Tsahal rempliraient alors leurs missions sous l’autorité du ministère concerné, en fonction de la nature de la crise.
Les vingt bataillons mobilisables par le Home Front Command sont organisés suivant une logique de « territorialisation » des réserves. Le commandement est lui-même subdivisé en cinq secteurs géographiques. Pour le chef du bataillon rencontré par les rapporteurs, cette logique territoriale contribue à ce que les troupes déployées aient une bonne connaissance du terrain.
S’agissant en second lieu de la gestion des crises sécuritaires d’intensité exceptionnelle, le modèle d’intervention élaboré par les Israéliens en cas de crise permet au Premier ministre de confier la direction des opérations de gestion de crise soit à la police, soit à un commandement interarmées de Tsahal qui travaille régulièrement avec les services de sécurité, le Joint Operation Command (JOC). En tout état de cause, les états-majors de gestion de crise sont conjoints, associant la police et les armées, comme le montre le schéma ci-après. Le choix de confier la direction des opérations à la police ou aux armées dépend du seul Premier ministre ; toutefois, le colonel Benoît de la Ruelle, attaché de défense de l’ambassade de France en Israël a indiqué aux rapporteurs que l’on considère généralement que le Premier ministre confierait aux militaires la gestion des crises les plus graves, notamment en cas d’attaques terroristes simultanées.
![]()
DIRECTION DES OPÉRATIONS DE GESTION DE CRISE SÉCURITAIRE
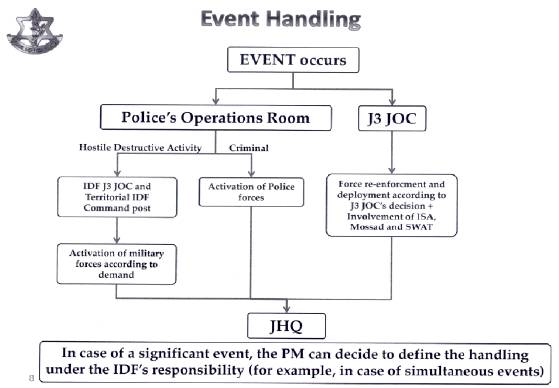
Source : Joint Operation Command (JOC) de Tsahal.
• En contrepoint de la place limitée des militaires sur le territoire national d’Israël, des unités de police très « militarisées »
Le déplacement des rapporteurs en Israël leur a permis d’étudier l’organisation et le rôle du Magav, corps d’élite rattaché à la police et chargé d’une mission de maintien de l’ordre dans les zones les plus sensibles du territoire israélien. Le Magav est chargé notamment de la protection des lieux saints, de la garde des frontières, d’opérations en zone urbaine comme en zone rurale, de missions de maintien de l’ordre en Cisjordanie, et de la protection des abords de la ville de Jérusalem.
Selon les explications fournies aux rapporteurs par ses responsables, ce corps « multifonctions » est constitué de quatre principaux types d’unités :
‒ des unités chargées du contre-terrorisme, en uniforme ou non ;
‒ des unités chargées de missions courantes de sécurité, en uniforme militaire gris et armées de fusils d’assaut M16 ;
‒ des unités de patrouille spéciale antiterrorisme ;
‒ des unités d’intervention, remplissant les mêmes fonctions que nos forces spécialisées comme le GIGN ou le RAID.
L’objectif et la vocation de ces unités consistent à constituer une force disposant d’un large spectre de capacités. Aussi, tous les combattants du Magav sont formés aussi bien pour lutter contre le terrorisme que pour traiter les troubles à l’ordre public. Pour ses responsables, « la polyvalence est vue comme un mode de bonne gestion des effectifs de la police ». Cela suppose de maîtriser un savoir-faire adapté aux pics de violence, et donc d’entretenir les capacités opérationnelles des personnels, tout en disposant des compétences requises des policiers. Selon les observateurs avertis, le Magav est d’ailleurs très entraîné, et les rapporteurs ont pu constater que ses personnels présentent tous les aspects de militaires. Si le Magav est bien une unité de police, investie de toutes les prérogatives de la police, il peut donc apparaître au premier abord comme une unité militaire plutôt que comme une force de sécurité intérieure. Comme l’ont indiqué ses cadres rencontrés par les rapporteurs, « être d’abord policier, et disposer de plus d’une formation militaire, permettent de travailler plus facilement à la fois avec la police « classique » et avec les armées, dans les zones où le Magav est déployé ». D’ailleurs, régulièrement, les unités de Tsahal et du Magav s’entraînent et opèrent conjointement.
Les personnels du Magav sont des conscrits pour 51 % d’entre eux ; leur formation de base est donc militaire avant tout, la formation au métier de la police n’étant dispensée qu’ensuite. La formation militaire des officiers est d’ailleurs organisée de façon conjointe avec les armées. Il est à noter que les jeunes conscrits sont nombreux à se porter volontaires pour servir le Magav : il arrive en deuxième position dans les choix d’affectation des appelés, après la très prestigieuse brigade Golani. Les effectifs du Magav s’élèvent à 8 800 hommes, plus 1 600 réservistes.
À la différence des unités de Tsahal, celles du Magav sont attachées à une circonscription territoriale. Pour leurs responsables rencontrés par les rapporteurs, il en ressort une bonne connaissance de la population, qui permet de « mieux capter des signaux faibles », ce qui constitue « la valeur ajoutée du Magav ».
En outre, selon que le Magav opère dans les zones de responsabilité de la police (le territoire national) ou dans celles des armées (les territoires occupés et le Golan), il est ou non chargé de la direction des opérations de sécurité. Pour ses cadres, « c’est d’ailleurs une spécificité du Magav que de pouvoir s’insérer dans un contexte territorial qui n’est pas le sien ». S’agissant de la conduite des opérations, les unités du Magav et de Tsahal peuvent être employées conjointement, chacune en fonction de sa valeur ajoutée dans l’opération ; par exemple, effectuer des arrestations de vive force peut être confié aux militaires avec le Magav en soutien pour éviter tout trouble à l’ordre public autour du lieu d’intervention.
• De surcroît, une large diffusion des armes dans la population, tant parmi les agents de sécurité privés que les citoyens
Les rapporteurs ont pu constater que les agents de sociétés privées de sécurité sont généralement armés. Leur maîtrise du feu est d’ailleurs d’autant plus sûre que ces agents ont tous effectué un long service militaire.
Par ailleurs, ils ont pu constater qu’en plus des personnels des sociétés de sécurité, une part importante des civils est autorisée à porter des armes, et que la diffusion de l’armement est vue souvent comme une sorte de contrepartie à la faible densité de policiers et de militaires à l’intérieur du pays. Il ressort en effet de leurs entretiens avec leurs homologues israéliens que l’armement des civils est vu comme une réponse valable au terrorisme, et ce d’autant qu’une part importante d’entre eux est constituée de retraités ou de réservistes des armées ou des services de sécurité. Ainsi, M. Élie Elalouf leur a fait valoir que nombre d’attentats ont été déjoués par des civils armés, et que l’éducation à la sécurité commence très tôt en Israël : abris dans toutes les écoles, alertes aux tirs de roquettes, etc. De plus, il a indiqué que l’État avait le projet de mettre en place un système d’alerte géolocalisée sur téléphone portable à destination de tous les titulaires d’un permis de port d’arme en cas d’attaque terroriste à leur proximité. Son collègue Omer Barlev a précisé que l’armement des civils devient une réponse pertinente au terrorisme avec l’évolution des modes opératoires de celui-ci : à ses yeux, jusqu’à l’« intifada des couteaux » commencée en octobre 2015, « aucun civil n’était jamais sérieusement intervenu dans un attentat terroriste », mais l’évolution du modus operandi des terroristes depuis octobre 2015, faisant une large part aux initiatives d’individus isolés difficilement repérables par les services de renseignement, limite la capacité d’anticipation de ces services. Dès lors, pour M. Omer Barlev, 20 à 30 % de ces terroristes ont été maîtrisés par les civils ‒ il s’agissait parfois d’ailleurs de soldats en permission portant leur arme.
En effet, les personnels des armées et des forces de sécurité sont autorisés à porter leur arme de dotation en dehors de leur temps de service. Telle était la règle, traditionnellement, en Israël ; cette règle a toutefois été modifiée dans les années 2000 en réaction à des cas d’utilisation de ces armes à mauvais escient, mais le droit pour les militaires et les policiers de porter leur arme en dehors du service a été restauré en octobre 2015, en réaction à la nouvelle vague d’attentats.
Le député Michael Oren a indiqué aux apporteurs que 3 % des Israéliens étaient ainsi autorisés à porter une arme dans l’espace public ; certains observateurs avertis jugent cette proportion sous-évaluée. Quoi qu’il en soit, même si le taux de 3 % devait être compris comme une hypothèse basse, il n’en est pas moins considérable : rapporté à la population française, il correspondrait à deux millions de porteurs d’armes.
iv. L’encadrement juridique de l’action des armées et des forces de sécurité sur le territoire israélien
Comme l’a indiqué aux rapporteurs le colonel Benoît de la Ruelle, attaché de défense de l’ambassade de France, dans les opérations de sécurité qu’elles conduisent sur leur territoire, « les autorités israéliennes sont toujours « blindées » juridiquement : il est très difficile de les prendre en défaut ». Qu’elles soient conduites par les armées ou par des unités de police présentant des standards d’équipement comparables, ces opérations s’inscrivent en effet dans un cadre légal respectant les principes démocratiques de l’État de droit.
• Des règles d’ouverture du feu précises et contrôlées
En Israël, les règles d’ouverture du feu s’imposant aux forces armées et aux forces de sécurité intérieure sont classifiées.
Comme l’a indiqué aux rapporteurs le député Omer Barlev, elles ont fait l’objet de profonds débats ces derniers mois dans les milieux autorisés à en connaître, et ont été clarifiées par le chef d’état-major de Tsahal. Le député a d’ailleurs indiqué aux rapporteurs que le chef d’état-major a récemment frappé les esprits en déclarant, à l’adresse d’une assemblée de jeunes recrues, que « si une fille de quatorze ans se jette sur un officier avec des ciseaux à la main, il n’y a pas forcément une menace directe et immédiate sur la vie de celui-ci : interdit, donc, d’ouvrir le feu ». Certains observateurs ont d’ailleurs indiqué aux rapporteurs que « les Israéliens ont la gâchette moins facile qu’on ne le dit ».
Il ressort d’ailleurs des entretiens des rapporteurs que les règles d’engagement des forces varient en fonction de la sensibilité de leur zone d’action. Notamment, elles sont moins restrictives en Cisjordanie que sur le territoire national israélien à proprement parler.
• Un dispositif militaire de juridiction et de conseil qui garantit la prise en compte du droit dans les opérations de sécurité
Les rapporteurs ont pu s’entretenir longuement avec le colonel Doron Ben Barak, adjoint au Military Advocate General (MAG) de Tsahal et conseiller juridique pour la Cisjordanie. Ils ont ainsi pu étudier le rôle du Military Advocate General, qui, comme le précise l’encadré ci-après, est à la fois :
‒ une juridiction compétente pour les militaires mis en cause dans l’exercice de leurs fonctions et pour les personnes suspectées d’actes de terrorisme ;
‒ un organe de conseil juridique aux armées.
Le Military Advocate General (MAG)
Le Military Advocate General est un officier général nommé directement par le ministre de la Défense, à la différence des autres officiers généraux, qui sont nommés par l’état-major ; selon les explications fournies aux rapporteurs, cette procédure vise à assurer son indépendance vis-à-vis des autres militaires.
Le MAG est à la tête d’une administration comportant plusieurs départements spécialisés, parmi lesquels :
‒ une école de formation au droit militaire, qui forme les officiers nommés au sein des tribunaux militaires ;
‒ un département de droit international, chargé de conduire des études et d’animer, dans son champ de compétence, les relations extérieures de Tsahal ;
‒ le conseiller juridique pour la Judée-Samarie, à la tête d’une équipe d’une trentaine d’officiers chargés de donner aux cadres de Tsahal qui administrent la Cisjordanie ou y opèrent les règles de droit applicables, dans tous les domaines de compétence d’une armée d’occupation : règles d’engagement, mais aussi recensement et administration générale des populations (2,8 millions de Palestiniens et 400 000 Israéliens), affaires civiles et économiques, cadastre et droit foncier (domaine particulièrement épineux en Cisjordanie), urbanisme et construction, affaires de sécurité ;
‒ des équipes de supervision de la police militaire et des lieux de détention ;
‒ le parquet militaire, composé d’une centaine d’officiers ;
‒ l’administration des tribunaux militaires dans les zones placées sous la responsabilité de Tsahal : le Golan et la Cisjordanie.
Le Military Advocate General est, selon son adjoint, « en rapport quasi-quotidien » avec le conseiller juridique du Gouvernement.
Le colonel Doron Ben Barak a exposé aux rapporteurs ce que fait le Military Advocate General en matière de conseil juridique aux militaires, soulignant que « même quand tonnent les canons, les muses ne sauraient se taire… » et que « parfois, des mesures qui sembleraient très efficaces du point de vue militaire ne sont pas légales, et doivent donc être exclues ». Il a cité en exemple l’idée, un temps étudiée par Tsahal, d’exiler les Palestiniens condamnés pour des actes de terrorisme ; c’est le MAG, avec l’appui du conseiller juridique du Gouvernement, qui a démontré l’illégalité de cette mesure, et les procédures d’exil n’ont pas été mises en œuvre. Selon le colonel, le MAG a été très sollicité dans les opérations récentes. Cette activité de conseil juridique est intense, particulièrement en Cisjordanie, où Tsahal est chargée de l’administration d’une large part du territoire et de sa population et doit se conformer à un cadre juridique complexe découlant du droit international, que détaille l’encadré ci-après et au respect duquel le MAG est chargé de veiller.
Le droit applicable en Cisjordanie
L’adjoint du Military Advocate General s’est attaché à exposer aux rapporteurs les règles de droit international qui s’appliquent à Tsahal en Cisjordanie et la lecture qu’en fait le MAG. Soulignant que « l’occupation militaire n’est pas interdite en tant que telle par la loi internationale, sinon les conventions de La Haye et de Genève ne les auraient pas réglementées », il a indiqué que l’article 43 de la convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre fait obligation aux armées d’occupation de respecter les lois en vigueur.
La législation applicable avant l’occupation de la Cisjordanie en 1967 était constituée de lois ottomanes, notamment en matière foncière, de normes jordaniennes, notamment en matière de construction, et de la législation britannique de la période mandataire. Le colonel Doron Ben Barak a fait valoir que ce sont ces textes, et non une législation israélienne, qui donnent de grandes marges de manœuvre aux forces de sécurité, permettant par exemple de détruire les habitations de terroristes.
Reconnaissant que ces sources légales pouvaient paraître datées dans un contexte aujourd’hui marqué par l’émergence des droits de l’Homme dans la législation internationale, il a rappelé qu’« en théorie, ces règles internationales s’appliquent seulement sur territoires souverains des États », mais indiqué que « tout le monde attendant d’Israël qu’il les applique sur des territoires qu’il occupe depuis près de cinquante ans, le MAG œuvre à prévenir toute atteinte possible aux droits de l’Homme, malgré un contexte sécuritaire complexe ».
Enfin, il faut rappeler que Tsahal opère aussi sous le contrôle de la Haute Cour de Justice d’Israël, devant laquelle les Palestiniens peuvent former des recours depuis 1967. La Haute Cour traite ainsi 60 recours de Palestiniens par an, ce nombre ayant pu s’élever jusqu’à 900 et représentant un tiers de son volume d’affaires. La Haute Cour a ainsi élaboré une jurisprudence qui s’impose à Tsahal, et ne reconnaît la légalité des mesures prises par les militaires que si elles répondent à un double principe de nécessité militaire et de proportionnalité. Le colonel Doron Ben Barak a souligné devant les rapporteurs que cette double exigence « peut rendre la vie très difficile pour le commandement sur le terrain », mais qu’elle s’impose en tout état de cause.
Interrogé par les rapporteurs sur le point de savoir si Israël pouvait se considérer comme étant en guerre, le colonel Doron Ben Barak a fait valoir que même lors des moments les plus violents de la deuxième intifada, Israël s’est refusé à appliquer purement et simplement le droit de la guerre. Si les règles d’engagement ont été ajustées au contexte, au point que certains ont pu y voir un cadre juridique proche du droit militaire en temps de guerre au point de parler de « conflit armé au seuil de la guerre » (« armed conflict short of war »), le Gouvernement, sous le contrôle de la Haute Cour de Justice, a préféré établir un régime juridique qui conserve davantage de garanties. Pour le colonel, même cette législation d’exception restait inspirée par une claire volonté de maintenir la situation « en deçà de l’état de guerre ».
II. LE CHANGEMENT DE PARADIGME DE 2015 : L’ENGAGEMENT DURABLE ET MASSIF DES ARMÉES SUR LE SOL NATIONAL, JUSTIFIÉ PAR LA PERMANENCE ET L’INTENSITÉ EXCEPTIONNELLES DE LA MENACE
Les armées françaises interviennent depuis longtemps déjà sur le territoire national ‒ y compris pour des missions de protection en milieu terrestre ‒ et, en ce sens, l’opération Sentinelle possède bien une « généalogie » qui l’inscrit dans une continuité historique et doctrinale. Cependant, l’année 2015 n’en marque pas moins une rupture, en raison de deux facteurs :
‒ l’intensité de la menace s’est accrue pour atteindre un niveau d’intensité sans précédent sur le territoire national métropolitain. Que l’on y voie ou non une « rupture stratégique », force est de constater que le terrorisme militarisé constitue une nouveauté ;
‒ le volume des forces engagées pour protéger le territoire national contre cette menace est lui aussi sans précédent. Les tensions qu’aurait fait peser ce déploiement dans l’activité des forces auraient été insolubles si le format et les contrats opérationnels des armées n’avaient pas été adaptés en conséquence, et dans l’urgence.
A. LA MENACE ACTUELLE, AUSSI INTENSE QUE DURABLE, APPELLE DES MESURES DE PROTECTION QUI DÉPASSENT LES HYPOTHÈSES INITIALES DES CONTRATS OPÉRATIONNELS
Les responsables et les observateurs entendus par les rapporteurs se sont montrés partagés sur un point : celui de savoir si la situation actuelle constituait ou non une « rupture stratégique ». Ainsi, lors de son audition du 15 octobre 2015 devant la commission (24), le chef d’état-major des armées a déclaré que c’est à « une rupture stratégique » que répond Sentinelle ‒ qui est « loin d’être une sorte de Vigipirate bis », car « nous considérons que la situation n’est plus la même qu’il y a un an et que le niveau de menace est tel en France que les forces de sécurité intérieure ont besoin du renfort substantiel et durable des forces armées ». À l’inverse, devant les rapporteurs, le général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, a estimé que si elle est « exceptionnelle par son intensité, la menace ne l’est pas encore par sa nature » et qu’en conséquence, « il est prématuré de qualifier de rupture stratégique l’action de ces terroristes sur le territoire français ». Pour le général Denis Favier, ce seuil serait atteint si des groupes terroristes parvenaient à prendre durablement le contrôle de certains espaces ou d’une partie de la population. La création de telles enclaves serait à l’évidence de nature à mettre en cause l’intégrité du territoire et l’équilibre de notre pays et, dans ce cas, un engagement des armées visant à reprendre, y compris de vive force, le contrôle de ces zones, pourrait être envisagé. Il a toutefois jugé ce scénario « prématuré ».
La portée de la question n’est pas seulement intellectuelle : si la France se trouve en situation de « rupture stratégique », des évolutions profondes de notre stratégie actuelle de protection du territoire national sont envisageables, par exemple en ce que cette stratégie exclut pour l’heure que les armées soient « primo-intervenantes » en milieu terrestre. À l’inverse, si l’on considère que la situation sécuritaire actuelle, bien qu’aggravée, ne constitue pas une véritable « rupture stratégique », il est naturel d’admettre des ajustements au dispositif de protection du territoire national, mais rien ne nécessite a priori d’en modifier profondément les équilibres.
1. La menace terroriste actuelle sur le sol national se caractérise par sa haute intensité et son inscription dans la durée
M. Philippe Errera, directeur général des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère de la Défense, a déclaré aux rapporteurs que « l’État islamique fait peser une menace plus dangereuse encore qu’Al-Qaïda ». La nouveauté de cette menace tient en effet à son intensité ‒ si élevée que l’on parle de « terrorisme militarisé » ‒ ainsi qu’à son inscription dans la durée, avec l’importante assise dont dispose Daech dans le « proto-État » qu’elle a conquis.
a. Une menace d’une intensité nouvelle : le terrorisme « militarisé »
Les attentats de 2015 présentent pour nouveauté l’utilisation de techniques et de matériels inspirés des actes de guerre. C’est en ce sens que l’on parle d’une « militarisation » de la menace, qui appelle logiquement une militarisation des moyens engagés pour y répondre.
• Des modes d’action de type militaire et une stratégie de tueries de masse
Le général Didier Brousse, sous-chef d’état-major de l’armée de terre en charge des opérations aéroterrestres, a d’ailleurs estimé que « jusqu’alors, les différentes études identifiaient un adversaire générique djihadiste poursuivant un but de guerre, mais non encore dévoilé », mais que les attentats du 13 novembre ont « montré un ennemi déterminé, organisé et militarisé, à la puissance de feu comparable à celle que nous connaissons sur les théâtres d’OPEX ». Le rapport précité au Parlement sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population souligne ainsi que les modes d’action des terroristes sont « de plus en plus militarisés et professionnalisés, de type “coup de main” ou “opération commando” ». Il établit ainsi une typologie des actes terroristes actuels :
‒ actes isolés « avec un degré de préparation et d’équipement minimal » ;
‒ actions conduites par des combattants, arrivant ou revenant sur le territoire national, qui utilisent « un armement, un entraînement et des modes d’actions de type militaire » ;
‒ actions « de grande ampleur dans le cadre d’une campagne ».
Ce rapport souligne aussi que la menace « d’inspiration djihadiste » procède d’un continuum entre l’ordre interne et l’ordre externe. Son « idéologie totalitaire », le takfirisme, possède une « visée universelle » et se trouve servie par une propagande attractive, y compris en France. Cette menace vise à « fragiliser le contrat social démocratique », accréditant l’idée d’un « choc des civilisations ». Il précise que l’État islamique commandite de préférence des « frappes obliques », exécutées par des ressortissants d’un autre État que le pays touché, donc « moins susceptibles d’être connus des services spécialisés ». En outre, le volume de la menace est inédit, étant donné que pour le général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), « les actions terroristes peuvent frapper simultanément en plusieurs points », et pas seulement en région parisienne : « toute l’étendue du territoire est menacée ».
Cette militarisation de la menace a modifié les scénarios des attentats, qui tendent désormais à débuter par des tueries de masse. Le général Favier a d’ailleurs indiqué que les études menées de janvier à novembre 2015 avaient bien mis en évidence le risque de massacres de masses ; une circulaire du directeur général de la police nationale en date du 21 décembre 2015 constate que « les attentats du 13 novembre 2015 ont confirmé la tuerie de masse comme mode d’action terroriste en France ». S’appuyant sur ces études, le rapport précité de notre collègue François Lamy explique cette « nouvelle cinétique des attentats », que présente l’encadré ci-après.
La nouvelle cinétique des attentats
La gendarmerie nationale observe que, dans la période récente, les attaques terroristes peuvent être analysées comme se déroulant en trois temps :
‒ dans un premier temps, les terroristes attaquent une cible avec pour but de tuer autant de personnes que possible ;
‒ dans un deuxième temps, ils se retranchent et font durer la confrontation avec les forces de l’ordre afin d’obtenir notamment le plus large écho médiatique possible ;
‒ dans un dernier temps, ils opèrent un assaut suicide et meurent sous les balles tout en cherchant à causer auparavant le maximum de pertes possibles dans les rangs des forces de l’ordre.
Pour le général Michel Pattin, ce schéma, qui s’observe dans plusieurs pays, est aujourd’hui le modus operandi de Daech et d’autres groupes djihadistes.
Source : avis n° 3115, tome IV, « Préparation et emploi des forces : forces terrestres », fait par M. François Lamy sur les crédits de l’armée de terre pour 2016, octobre 2015.
La menace terroriste est particulièrement visible en milieu terrestre. Au cours de leurs travaux, les rapporteurs se sont aussi attachés à étudier l’évolution de cette menace dans les autres milieux.
S’agissant du milieu maritime, l’amiral Yves Joly, commandant en chef de la Méditerranée, a souligné que « sur la mer, le terrorisme est aujourd’hui une préoccupation ». Au sein de son état-major, le terrorisme marin a été décrit aux rapporteurs comme « une vraie menace », dont on « parle peu, pour éviter des effets de suggestion ou des effets de frayeur néfastes pour l’industrie des croisières ». Néanmoins, Toulon a conduit des exercices, en lien avec la préfecture des Bouches-du-Rhône et les forces de sécurité intérieure. Le commandant de l’EV Jacoubet a exposé aux rapporteurs différents scénarios envisageables d’attaque terroriste : une attaque comparable à celle de l’USS Cole en 2000, des attentats suicides, ou une « bombe cinétique », c’est-à-dire un bateau lancé à plein régime vers une infrastructure côtière sensible, comme les installations industrielles de Fos-sur-mer. Si dans les deux premiers cas, le traitement de la menace « nécessite une certaine logistique, mais n’est pas si compliqué », en revanche, face à une « bombe cinétique », « nos moyens d’action sont limités, d’autant que le tempo des opérations maritimes suppose de l’anticipation et donc de la profondeur ».
Avec les attentats de 2015, cette menace s’est accrue. Pour les adjoints de l’amiral CECMD et préfet maritime, « par le passé les actes terroristes avaient le plus souvent des buts politiques, c’est-à-dire qu’ils visaient à négocier ou à obtenir une caisse de résonance : dans ce schéma, il y avait un temps de négociation et l’assaut était rarement donné avant 24 heures, alors qu’aujourd’hui, les tueries de masse appellent des réactions beaucoup plus rapides ». Selon leurs indications, le but est désormais de donner l’assaut en mer « dans les trois heures suivant l’attaque ». Il s’agit d’un véritable « changement de paradigme », car trois heures constituent un délai « déjà très court » pour, dans un premier temps, se procurer les plans du navire concerné ‒ les services de la marine basés à Brest commencent à collecter, à titre préventif, les plans de tous les navires susceptibles de passer par nos eaux ‒ puis, dans un second temps, planifier une opération et projeter des forces. L’adjoint « opérations » de l’amiral Joly a rappelé à cet égard que 100 miles nautiques à parcourir, « c’est déjà une heure d’hélicoptère ». Un exercice, nommé Estérel, a d’ailleurs été conduit deux semaines avant le déplacement des rapporteurs afin de tester cette nouvelle cinétique de la riposte antiterroriste en mer.
Par ailleurs, les rapporteurs ont accordé une attention particulière aux activités de la marine nationale visant à traiter l’afflux de migrants, que présente l’encadré ci-après.
La gestion des flux de migrants par la marine nationale
L’afflux de migrants a été décrit aux rapporteurs comme « un classique » de la défense maritime du territoire et de l’action de l’État en mer. Si, à la date de leur déplacement à Toulon, le flux de migrants est plutôt constant en volume apparent, cette stabilité recouvre des réalités complexes : on compte aujourd’hui, entre la Libye et l’Italie, moins de Syriens, davantage d’Africains, le flux de Syriens s’étant reporté vers la mer Égée.
Le cadre administratif applicable est celui du sauvetage en mer, pour lequel la mer est organisée en zones de responsabilité. Les motifs susceptibles de justifier le contrôle des embarcations concernées, même hors des eaux territoriales, ne manquent pas : « la plupart des bateaux de migrants sont à l’évidence mal équipés ».
Toutefois, le capitaine de vaisseau Gilles Boidevezi, adjoint « opérations » de l’amiral CECMED et préfet maritime de la Méditerranée, a fait valoir que face à une embarcation de migrants, « l’intervention doit être prudente : il faut éviter, par exemple, que les passeurs ne jettent à l’eau certains migrants pour gagner du temps ». Dans trois cas déjà, les passeurs ont lancé un millier de migrants vers les côtes après avoir abandonné un cargo assez gros et hors d’âge. Cela n’a d’ailleurs pas attendu la crise syrienne : en 2001, des migrants ont massivement débarqué sur les côtes varoises, et il semble qu’une partie de cette population, pourtant accueillie par la France, contribue désormais à nourrir la criminalité locale : racket, meurtres de ceux qui refusent l’« impôt révolutionnaire », etc.
Pour l’heure, néanmoins, les côtes françaises ne sont pas les plus menacées. En effet, l’Italie forme « un obstacle naturel, surtout pour des passeurs soucieux d’économiser le gazole ». C’est pourquoi les passeurs préfèrent aujourd’hui emmener les migrants au large des côtes italiennes, où le sauvetage en mer les prend en charge. Et ce, d’autant qu’il est juridiquement impossible de reconduire les migrants vers la Libye : « il n’y aurait là aucune autorité publique crédible avec laquelle négocier cela », et la pratique ‒ fondée sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ‒ interdit que les autorités chargées du sauvetage en mer reconduisent les migrants à leur point de départ, et l’une des règles du Search and Rescue consiste à ramener les personnes secourues vers un lieu où elles sont en sécurité : or « à l’évidence, elles ne peuvent pas l’être en Libye ».
Le droit pénal applicable à la criminalité transnationale organisée est fondé sur la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 ‒ dite convention de Palerme ‒, dont les stipulations complètent celles de la convention de Montego Bay. Cette dernière faisait du ministère des Affaires étrangères le point de contact de référence en matière d’application du droit de la mer, mais la convention de Palerme y implique le ministère de la Justice, qui s’avère « moins familier des procédures découlant du droit de la mer », bien que le secrétariat général de la mer ait « contribué à la fluidification des procédures ».
S’agissant du milieu aérien, les rapporteurs ont particulièrement étudié les risques qui s’attachent au développement des drones sur le territoire national et la façon dont l’armée de l’air y adapte la protection aérienne du territoire national.
Pour le général André Lanata, il convient de bien distinguer dans cette réflexion les différentes catégories de drones. À titre d’exemple, la menace liée à des drones de trois mètres d’envergure qui se trouveraient incontrôlés ‒ comme tel avait été le cas la semaine précédant son audition, lorsqu’un drone belge avait passé la frontière en échappant au contrôle de son pilote ‒ ne peut pas être traitée de la même manière que l’activité de mini-drones. Certes, les mini-drones ont une charge utile assez faible, mais rien n’interdit d’imaginer qu’ils puissent être utilisés pour transporter un explosif au plus près d’une cible.
Comme l’a expliqué le général Jean-Christophe Zimmermann, commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, ces mini-drones ne font l’objet d’aucun encadrement juridique précis et constituent un domaine nouveau pour la sécurité aérienne. Leur encadrement juridique constitue le premier versant de la réponse à cette potentielle menace ; le SGDSN a travaillé à l’élaboration de règles d’engagement, de normes d’équipement de ces appareils (afin, notamment, qu’ils portent tous une puce électronique), à la formation des utilisateurs, etc. Second versant de la réponse à cette menace, l’armée de l’air s’est organisée en vue d’assurer la détection et, le cas échéant, la neutralisation de ces appareils, suivant des modalités que présente l’encadré ci-après.
Les risques liés à la circulation de mini-drones
Pour le chef d’état-major de l’armée de l’air, la principale préoccupation entourant pour l’heure l’activité des drones réside avant tout dans l’absence de cadre juridique clair, notamment pour ce qui concerne les règles d’engagement face à de tels engins.
En effet, si ces règles sont claires pour les cas d’intrusion dans l’espace aérien, la difficulté, avec les mini-drones, tient à ce que les contrôleurs aériens ne sont pas en mesure de déceler une intention hostile, car à la différence de ce qui est prévu pour les mesures actives de sûreté aérienne, il est impossible d’échanger des informations avec le vecteur. Dès lors, il faut faire le nécessaire pour empêcher le vecteur d’entrer dans la zone par exemple en provoquant le brouillage, plutôt que d’avoir à neutraliser le mini-drone.
● Pour parer toute attaque par mini-drone, l’armée de l’air a disposé des tireurs d’élite dès le salon du Bourget et pendant la COP 21. De plus, des moyens nouveaux, encore en cours d’expérimentation, viennent d’être acquis pour détecter les mini-drones et compléter ainsi les moyens de guet à vue.
La neutralisation des appareils suspects repose sur des moyens de brouillage par l’intermédiaire de GPS ou de télécommandes – avec des contraintes liées à l’environnement, par exemple dans le cas de la proximité d’un aéroport – et sur des moyens cinétiques pour empêcher les mini-drones de s’approcher d’une cible. La réflexion se poursuit sur l’amélioration des dispositifs et sur l’utilisation de radars passifs, perturbant les mini-drones sur le champ électromagnétique. En outre, l’élaboration de la stratégie à adopter face au développement des mini-drones peut s’appuyer sur les travaux de recherche et de développement des industriels, très actifs en ce domaine, mais aussi sur les travaux du centre de guerre aérienne (Air Warfare Center) de Mont-de-Marsan et sur ceux du centre d’excellence « drones » (CED) a été créé à Salon-de-Provence.
C’est grâce à la complémentarité de ces dispositifs que le maillage territorial de surveillance des drones pourra être plus dense, maillage qui est aujourd’hui ciblé sur des lieux et des événements précis. Une couverture à 100 % du territoire national paraît en tout état de cause compliquée.
● Dans la réflexion sur la prévention des menaces potentiellement liées aux mini-drones, le général Zimmermann a expliqué qu’avant de définir les moyens nécessaires à l’armée de l’air, encore fallait-il que sa mission soit clairement établie ; quels sites doivent faire l’objet d’une protection ? En tout état de cause, pour lui, le système de surveillance des mini-drones soit être relié à la chaîne de commandement de l’armée de l’air : « c’est un seul et même espace aérien, qui appelle une unicité du commandement ».
• La militarisation de la menace appelle une certaine militarisation de la réponse
Compte tenu de la militarisation de la menace et des risques de tueries de masse, l’objectif des forces de sécurité, comme l’a souligné le général Didier Brousse, « consiste essentiellement à essayer de contrer une tuerie de masse » : il n’y a plus de négociation possible, et les délais d’acheminement des forces d’intervention spécialisées pourraient être trop longs.
Le rapport précité de notre collègue François Lamy détaille les implications de la nouvelle cinétique des attentats pour l’organisation du dispositif d’intervention antiterroriste, comme l’encadré suivant le montre.
Les implications de la nouvelle cinétique des attentats
pour l’organisation du dispositif d’intervention
Les forces de sécurité intérieure « primo-intervenantes » cherchaient à « fixer » l’adversaire sur les lieux de l’attaque et à faire intervenir des forces spécialisées qui entamaient un processus de négociation visant à réduire le niveau de tension ; la reddition de l’adversaire était possible, notamment dans le cas d’un déséquilibré qui pouvait revenir à la raison. Aujourd’hui, la reddition n’est pas le but, et plus les attaques durent, plus le nombre de victimes est élevé dans la première phase de la nouvelle cinétique des actes terroristes ; en outre, les chances de survie des otages sont d’autant plus faibles que l’attaque dure.
Cette nouvelle cinétique des attentats a appelé une nouvelle organisation de la réponse des forces de sécurité, suivant laquelle il faut que les forces « primo-engagées » aient une réaction adaptée, ce qui a plusieurs implications utiles dans les réflexions doctrinales actuelles :
‒ ces forces « primo-intervenantes » doivent se porter au plus vite au contact des terroristes et engager la confrontation avec eux afin, en quelque sorte, de les « détourner » des victimes civiles : il s’agit de réduire autant que possible la première phase de la cinétique décrite précédemment ;
‒ elles doivent disposer de matériels suffisamment efficaces pour faire face à des attaques perpétrées avec des armes longues, souvent de type AK 47. À cet égard, le directeur des opérations et de l’emploi de la gendarmerie nationale a indiqué au rapporteur que le plan de renforcement du dispositif de lutte contre le terrorisme annoncé le 21 janvier 2015 avait permis de commencer à renforcer l’équipement des personnels, notamment en casques lourds et en armes ayant une portée au moins aussi grande que celle de l’AK 47 ;
‒ la nouvelle cinétique des actions terroristes ne permet plus de considérer que le recours aux unités spécialisées de « haut du spectre » (comme le RAID ou le GIGN) constitue toujours la bonne réponse. Les délais nécessaires à leur acheminement sont en effet trop longs au regard du nombre de victimes que peuvent faire les terroristes dans la première phase de l’attaque. Il faut donc que les gendarmes, dès la deuxième phase de l’opération, soient en mesure de faire cesser l’attaque ;
‒ pour disposer de forces « primo-intervenantes » capables d’intervenir rapidement, il faut un bon maillage territorial. On notera d’ailleurs que c’est un gendarme d’unité territoriale qui a blessé l’un des frères Kouachi à Dammartin-en-Goële, obligeant les deux terroristes à se retrancher dans une imprimerie.
Source : avis n° 3115, tome IV, précité.
Pour le général Brousse, la militarisation de notre dispositif de protection se justifie aussi par le « continuum extérieur‒intérieur » de la menace, qui « nous impose un continuum de la réponse ». Cela justifie que contribue au dispositif de sécurité « le même soldat, ayant capitalisé une expérience opérationnelle en OPEX et la restituant, en l’adaptant, sur le territoire national ». Aussi le général n’est-il pas favorable à la constitution d’une force nouvelle, intermédiaire entre les armées et les forces de sécurité intérieure. Une telle option conduirait à créer une « armée à deux vitesses », où coexisteraient une armée expéditionnaire et une armée territoriale, alors que « les Français n’accepteraient pas d’être protégés par des militaires “de seconde zone” ».
Le général a ajouté que dans ce contexte, les interrogations sur la « légitimité » de l’intervention des armées « semblent à présent derrière nous », selon. Il a fait valoir aux rapporteurs que selon le baromètre IPSOS de l’été 2015, 87 % des personnes interrogées déclarent que l’armée de terre a toute sa place sur le territoire national, et 66 % d’entre eux jugent l’opération Sentinelle efficace.
Le rapport précité au Parlement souligne que le « djihadisme transnational » est à la fois « structuré et polymorphe », mais n’en finit pas moins par constituer « une armée djihadiste » dont l’État islamique est le fer de lance. On observe aujourd’hui une dangereuse concurrence entre :
‒ Al-Qaïda, qui continue à préparer des attentats en Europe via ses filiales Jabhat al Nosra en Syrie, Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA), al Shebab en Afrique de l’est et Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) ;
‒ Daech, vu comme « un « proto-État » incomplet » (certes, il bat monnaie, mais ses effectifs combattants étant limités et ses alliances « aléatoires », il s’apparente à un État « faible »), qui compense ses faiblesses par « la violence extrême et désinhibée ».
L’État islamique, notamment, tente d’inscrire son action dans la durée, par la création d’une structure étatique et par la diversification de ses sources de financement comme de ses modes d’action.
• Mu par l’ambition de s’ériger en État, Daech dispose aujourd’hui de moyens importants pour pérenniser son action
Devant les rapporteurs, M. Philippe Errera, directeur général des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère de la Défense, a décrit l’État islamique comme « un objet politique non identifié », qui aurait vocation à s’ériger en une sorte d’État nouveau.
Selon lui, ce « state building djihadiste » s’exprime non seulement dans le domaine politique et militaire, mais aussi dans le domaine social et fiscal. Son ancrage territorial sur une région étendue et sur une population importante lui confère des moyens militaires, financiers et humains notables. L’organisation tente ainsi d’inscrire son action dans la durée en s’enracinant dans tous les domaines de la vie locale. Cette maîtrise d’un territoire est un premier élément du caractère durable de la menace que fait peser l’organisation terroriste.
Un autre élément suggérant que la menace est durable réside, selon M. Philippe Errera, dans la forte puissance d’attraction qu’exerce « une utopie qui se concrétise », permettant à Daech de mettre en œuvre une propagande mondiale et de recruter des dizaines de milliers d’individus dans le monde entier.
• L’État islamique tente de diversifier ses ressources et ses modes d’action afin de contrecarrer la stratégie de ses ennemis
Les ressources de Daech ont certes été affaiblies par les mesures prises par la coalition formée contre elle, qui visaient le cœur économique de l’organisation. Ainsi, les revenus pétroliers de l’organisation ont été divisés par deux depuis la fin de l’automne 2015, avec les actions conduites sur les capacités de production et de transport du pétrole de l’État islamique. Mais malgré l’affaiblissement économique relatif de Daech, il est difficile d’identifier les acheteurs de son pétrole : même le régime de Bachar el-Assad en ferait partie, au moins indirectement. De plus, l’État islamique cherche à diversifier ses trafics, qu’il s’agisse d’œuvres d’art ou d’êtres humains (migrants ou esclaves).
Daech tente aussi de varier ses modes d’action, dans le domaine NRBC et cyber notamment. Eu égard à la disponibilité de matières radioactives, la menace NRBC constitue selon M. Philippe Errera « une préoccupation sérieuse », car il suffit de mélanger à des explosifs certaines matières assez aisément disponibles pour constituer une « bombe sale », dont l’usage aurait un impact psychologique certainement important sur les populations touchées. S’agissant de la menace chimique, le risque pourrait survenir si l’État islamique parvenait à s’emparer de stocks préexistants, notamment en Syrie. L’organisation serait déjà capable de fabriquer de l’ypérite (aussi connue sous le nom de « gaz moutarde »). Elle rencontrerait cependant des difficultés pour transporter ce gaz ; aussi cette menace pèse-t-elle davantage sur le Levant que sur notre territoire national à court terme.
En matière de menace cyber, on observe chez les membres de Daech « un grand professionnalisme dans la maîtrise de l’espace numérique ». Cependant, l’organisation est davantage spécialisée dans le cryptage et la propagande par l’intermédiaire des réseaux sociaux que dans la cyberguerre offensive.
Pour toutes ces raisons, M. Philippe Errera a considéré qu’il faudrait « au moins une décennie » pour éradiquer les réseaux terroristes sur le territoire européen. Par ailleurs, il ne faut pas écarter l’hypothèse d’un recul de l’État islamique au Levant qui n’induirait pas nécessairement une diminution de la menace à due proportion. En effet, d’autres territoires peuvent servir de refuge aux terroristes, comme la Libye ou le Yémen par exemple ; et les « combattants étrangers » pourraient revenir à titre individuel en Europe.
2. Les mesures de protection qu’appelle cette menace dépassent ce que prévoyaient les contrats opérationnels
La contribution des armées à la protection du territoire national revêt depuis 2015 deux formes principales :
‒ l’opération Sentinelle, première opération conduite au titre de la posture de protection terrestre, assurée pour l’essentiel par l’armée de terre ;
‒ le « plan Cuirasse », en application duquel le ministère de la Défense a renforcé les dispositifs de protection de ses emprises.
a. La difficulté ne résidait pas tant dans le volume des forces déployées que dans leur « capacité à durer »
i. L’installation « dans la durée » de l’opération Sentinelle crée des tensions dans la gestion des effectifs de l’armée de terre
• La pérennisation d’un haut niveau d’engagement dans le cadre de l’opération Sentinelle
Le contrat opérationnel de protection assigné aux armées prévoyait bien le déploiement de 10 000 hommes en cas de crise majeure ; c’est d’ailleurs l’effectif qui a été engagé après les attentats de janvier 2015, et de nouveau après ceux du 13 novembre 2015. Comme le dit notre collègue François Lamy dans son rapport précité, pour l’armée de terre, ce déploiement « s’inscrivait dans les hypothèses maximales de son contrat opérationnel » et « si l’armée de terre n’avait pas été conduite à le faire depuis plusieurs décennies, du moins était-il dans ses prérogatives de le faire, suivant une logique de renfort militaire massif mais ponctuel aux autres services de l’État ».
Toutefois, aucun texte ne fixait expressément la durée d’un tel déploiement. Selon les informations recueillies par les rapporteurs, cette durée était généralement estimée à un mois environ, notamment par référence au plan Neptune de gestion d’une crue de la Seine.
La pérennisation de l’opération Sentinelle et la poursuite d’un niveau d’engagement aussi élevé constituent donc un basculement. Comme le dit M. Lamy, « en décidant de maintenir l’opération Sentinelle dans la durée, on a changé de paradigme » car « il ne s’agit plus de renforcer ponctuellement les forces de sécurité intérieure ; il s’agit de maintenir pour une durée indéterminée, mais assurément longue, un dispositif de sécurisation du territoire ».
Or, comme l’expliquent nos collègues Alain Marleix et Geneviève Gosselin-Fleury dans un récent rapport d’information (25) « le taux de rotation de la force opérationnelle terrestre fait que l’on a besoin de trois fois plus d’effectifs qu’il n’en faut pour assurer, à un moment donné, une mission ». Si, pour un mois, les tensions créées dans la gestion des ressources humaines des armées ne sont pas considérables, il en va autrement lorsque la suractivité doit se prolonger : dans un contexte où elles devaient de surcroît réduire leurs effectifs, les armées ne disposaient tout simplement pas des effectifs nécessaires pour déployer 10 000 hommes sur le territoire national pour une longue durée sans réduire leur présence sur d’autres zones d’engagement.
• Des tensions tant que les augmentations d’effectifs programmées ne sont pas réalisées
Si l’actualisation de la programmation militaire votée en juillet 2015 a prévu une hausse des effectifs de nature à permettre un rythme de relèves plus équilibré pour l’opération Sentinelle, les délais de recrutement et de formation des nouveaux personnels sont tels que les effectifs-cible ne seront pas atteints avant l’été 2017. C’est donc en sous-effectif que les armées doivent assurer l’opération Sentinelle d’ici cette date. Durant cette phase de transition, la « suractivité » constitue un point de vigilance.
D’après le général Arnaud Sainte-Claire Deville, commandant des forces terrestres, certaines unités ont effectué jusqu’à six rotations Sentinelle en 2015, la majorité en ayant assuré entre deux et trois : « le poids de Sentinelle est donc très lourd ». Selon les précisions fournies par le commandement des forces terrestres, au total, 52 344 personnels de l’armée de terre avaient été engagés entre le 7 janvier et le 13 novembre, et 44 180 entre le 13 novembre et le 16 février 2016.
Le « poids » de l’opération Sentinelle a été supporté par certaines unités davantage que d’autres. Non que certaines unités aient été choisies de façon privilégiée pour effectuer cette mission, mais, comme l’a expliqué le général Arnaud Sainte-Claire Deville, les différences d’intensité de mobilisation pour Sentinelle dépendent du cycle opérationnel de chaque brigade et de chaque régiment. Selon que les brigades étaient ou non en phase de projection au moment du lancement de l’opération, leur nombre de déploiements sur le territoire national varie. Le commandant des forces terrestres a aussi indiqué que c’est moyennant un plan d’amélioration des conditions d’hébergement qu’il est possible de passer de six à huit semaines, à partir de juin 2016, la durée de ces engagements.
L’installation dans la durée d’une mission exigeante n’est pas sans risques, notamment sur le moral des militaires. Le général Sainte-Claire Deville a indiqué que, pour l’heure, « il n’y a pas d’indicateur objectif de « rupture morale », mais c’est un risque indéniable avec des durées d’absence de 220 jours ». Le moral appelle donc une attention particulière, car « le jour où les indicateurs seront négatifs, il sera trop tard ! » Parmi ces indicateurs, le CFT suit notamment : l’absentéisme médical, les problèmes sociaux tels que les divorces (parfois plus difficiles à observer), etc.
ii. Les tensions liées à la mise en œuvre du plan Cuirasse
Parallèlement à l’opération Sentinelle, les armées doivent consacrer des moyens accrus à la protection de leurs propres emprises sur le territoire national. Tel est le cas, bien entendu, pour l’armée de terre ‒ qui compte les emprises les plus nombreuses ‒, mais aussi pour les deux autres armées.
Ainsi, le chef d’état-major de l’armée de l’air a fait valoir aux rapporteurs que la menace actuelle impose de mettre un terme à la politique de réduction des budgets d’infrastructures, notamment pour ce qui concerne la protection des emprises aériennes, qui « doivent désormais être consolidées ». Le général André Lanata a précisé que ces travaux sont conduits suivant une « approche globale de la protection », dans le cadre d’une concertation avec les armées, directions et services compétents du ministère de la Défense comme avec d’autres ministères ; la gendarmerie de l’air participe d’ailleurs activement à cette réflexion. Le processus de renforcement des emprises aériennes s’appuie sur un travail de doctrine relatif à la protection des bases aériennes, débuté en novembre 2014 et dans le cadre duquel a été établi un « comité air sécurité protection » (CASP).
Ce renversement de tendance a des conséquences sur la gestion du personnel de l’armée de l’air. En effet, durant les dernières décennies, le personnel assurant la protection des emprises a été réduit et dans certaines bases, cette fonction a été externalisée ‒ notamment en ce qui concerne le filtrage des accès. Il existe actuellement « une demi-douzaine de bases aériennes laissées sans dispositif militaire de protection ». L’impératif actuel de renforcement de la protection des emprises conduit parfois à attribuer à des aviateurs des missions de renfort de la protection de leurs bases aériennes ‒ par exemple par des rondes ou des dispositifs de filtrage ‒, alors même que « ces missions ne font pas partie de leur cœur de métier ».
Les mesures supplémentaires de protection prises en 2015 visent à être « très visibles », pour avoir un effet dissuasif. Selon le général André Lanata, elles ont d’abord été organisées « suivant le système D », et prennent aujourd’hui des formes plus élaborées : tireurs sur les toits, caméras, obstacles, postes de contrôle automatisés de la surveillance, etc. L’effort de protection s’est concentré sur les bases « les plus précieuses ou les plus vulnérables ».
Ces mesures ont permis une baisse du nombre d’incidents sur les sites de l’armée de l’air au cours des six derniers mois ‒ un seul a été recensé. En règle générale, les tentatives d’intrusion s’effectuent à des fins de vol de matériels.
Lors de leur déplacement à Toulon, les rapporteurs ont tenu à étudier la protection de la base navale, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un projet d’attaque (heureusement déjoué) le 29 octobre 2015. L’encadré ci-après présente leurs observations.
La protection de la base navale de Toulon
● La concentration des installations militaires à Toulon fait de la base une cible de choix. Avec près de 10 % des effectifs du ministère de la Défense, la base est en outre le premier site industriel du Var, et premier employeur du département. Comme l’amiral Yves Joly, commandant de l’arrondissement maritime de la Méditerranée, l’a expliqué aux rapporteurs, la logique de concentration des forces à Toulon, suivie depuis Vauban, a conduit à masser 28 290 militaires ‒ soit 10 % des effectifs de la Défense ‒ sur les 250 hectares de la base de Toulon, au cœur de la ville ; en outre, il décrit comme un « écosystème » l’ensemble des 197 unités ou formations autonomes placées sous son autorité de commandant d’arrondissement, de la base navale de Toulon à la base aéronavale d’Hyères, en passant par exemple par le centre opérationnel de force aéronavale nucléaire. En outre, la présence du porte-avions, « appât de premier choix pour la menace » d’autant plus symbolique qu’il a été déployé dans les opérations contre Daech après le 13 novembre y contribue ; c’est de plus sur la base que sont stockés jusqu’à huit réacteurs nucléaires ‒ la marine nationale étant le deuxième opérateur nucléaire d’Europe après EdF. Cela explique que la base ait mis en œuvre le plan Cuirasse de protection des emprises militaires au niveau 3. De surcroît, l’évolution de la menace fait des jeunes recrues des cibles de choix : les écoles regroupées à Saint-Mandrier-sur-mer ont donc dû voir leur protection renforcée, avec une garde armée.
C’est donc de façon autonome que la base navale assure sa fonction de « protection-défense » (PRODEF), ce qui, selon le contre-amiral Bernard Velly, adjoint territorial de l’amiral CECMED et préfet maritime de la Méditerranée, a pour vertu de « responsabiliser les acteurs », notamment ceux qui ont la charge d’un « opérateur d’importance vitale » (OIV) au sens de la classification des sites sensibles par le SGDSN. De surcroît, la base navale assure la protection des sites de services dépourvus de capacités de défense, comme le Service interarmées des munitions (SIMu) ou le Service des essences des armées (SEA). Dépôts de munitions et dépôts de carburants sont donc protégés par la marine, ce qui est parfois complexe : « si certains dépôts de carburant classés SEVESO 3 sont bien enfouis dans les montagnes, d’autres sont situés en zone portuaire ». Au total, onze sites ayant la qualification de point d’importance vitale (PIV) sont placés sous la responsabilité de l’amiral, dont deux qui ont le statut d’installation prioritaire de défense (IPD) : la base navale de Toulon et le poste de commandement de la force aéronavale nucléaire.
La proximité entre le port civil et le port militaire est également à prendre en compte. Un arrêté érigera prochainement la petite rade en port militaire, en confortant le statut particulier d’une zone interdite à la navigation civile.
● Le dispositif de protection a été renforcé au cours de l’année 2015, en réaction aux attentats de Paris. Comme l’a bien dit l’amiral Bernard Velly pour illustrer la gradation des mesures de protection-défense en fonction d’une menace croissante, « le « surge » de janvier 2015 est devenu le socle de novembre 2015, et l’on tient en réserve de nouveaux moyens pour préparer le cas échéant le prochain « surge » ». Ce dispositif s’avère utile pour prévenir les « événements de nature sécuritaires (faux badge, fiche S, tentative d’intrusion, etc.) ».
Ce dispositif de protection est organisé de façon à traiter les menaces « dans la profondeur », avec :
‒ aux entrées de la base, des réservistes chargés d’orienter véhicules et passants dans 12 files de contrôle qui permettent de traiter environ 25 000 entrées par jour ;
‒ un contrôle des badges d’accès par vigiles privés ;
‒ depuis le 14 novembre 2015 au matin, un deuxième contrôle d’identité ;
‒ le déploiement, encore en cours, d’un système intégré de protection et de sécurité (SIPS) reposant notamment sur des cartes à puce.
Afin de permettre une réponse immédiate aux menaces, un groupement de fusiliers marins est mobilisé en permanence. La protection-défense repose aussi sur différents viviers de personnels, parmi lesquels les gendarmes maritimes, qu’ils soient d’active (affectés de façon privilégiée à des tâches de garde dynamique) ou de réserve, neuf des cent réservistes de la gendarmerie maritime à Toulon étant déployés en permanence pour assurer des filtrages et concourir à la préparation de l’arrêt technique majeur du porte-avions. Dans leurs fonctions de filtrage, les gendarmes réservistes traitent aussi les cas non-conformes en aval d’un premier filtrage par les vigiles privés.
● Une garde armée est organisée. Le capitaine de frégate Marc Tisseyre, commandant le groupement de fusiliers marins chargé de la protection des bases de Toulon et d’Hyères, a souligné que la formation de base des militaires est ainsi faite qu’en théorie, cette garde peut être assurée par tout militaire, « quelle que soit sa spécialité ». L’amiral Yves Joly, quant à lui, a précisé que l’inscription de ce dispositif de garde dans la durée rendait nécessaire un effort accru d’entraînement, afin de s’assurer que les compétences de tir des militaires soient à jour. Il a également insisté sur la complémentarité entre une garde statique et des gardes dynamiques, qui permettent de renforcer ponctuellement certains postes. Son adjoint chargé des opérations a précisé qu’un effort de « montée en gamme des fusiliers marins » était consenti, afin qu’ils ne soient plus cantonnés en majorité à des missions de surveillance statiques, mais « qu’ils acquièrent le niveau nécessaire pour devenir primo-intervenants, sans prétendre en faire des commandos », ce qui devrait être fait d’ici la fin de l’année 2016.
Le capitaine de frégate Marc Tisseyre a également rappelé que l’ouverture du feu est légalement permise dans certains cas dépassant la légitime défense, même d’autrui :
‒ une spécificité juridique du statut des gendarmes leur autorise le tir sur sommation en cas d’absolue nécessité ;
‒ dans les zones de défense de haute sécurité, le régime juridique est plus strict qu’en simple terrain militaire : il autorise le tir sur sommation.
● Le groupement des fusiliers marins de Toulon compte 430 personnels de différentes qualifications ; dix d’entre eux participent à la mission Sentinelle à Paris. Il est doté de vingt embarcations de drome opérationnelle de protection et de cinquante chiens.
Les hommes étaient armés de FAMAS au jour du déplacement des rapporteurs, mais devaient être rapidement dotés de surcroît d’armes de poing. Cette nouvelle dotation est motivée par le fait que la longue portée du 5,56 n’est pas toujours adaptée à terrain.
● Les forces de gendarmerie maritime de Toulon comptent 80 personnels, répartis en trois unités, l’une étant chargée de la surveillance du port militaire. Conjointement avec les fusiliers marins, ils assurent la sécurité de la base navale et effectuent à cette fin des patrouilles 24 heures sur 24, sur mer et sur terre, avec une vedette et un Zodiac à fond rigide. Ils sont dotés d’un armement varié : bâtons télescopiques, gaz lacrymogènes, armes de poing, pistolet-mitrailleur HK, FAMAS, fusil mitrailleur de calibre 7,62, etc. Selon les explications fournies par les gendarmes, le choix d’un pistolet-mitrailleur HK a été motivé par les conditions potentielles d’emploi de l’arme : ce calibre 9 mm possède en effet une portée moins longue et un effet aussi fort que le FAMAS ; pour des distances de 25 à 50 mètres, il représenterait l’arme la plus adaptée.
Pour la sécurité des activités d’importance vitale, la gendarmerie maritime utilise un véhicule équipé de caméras et d’un système informatique qui scanne les plaques des autres véhicules, transmet l’information à Paris, et reçoit en retour des renseignements sur les véhicules en question. Cela permet, d’une part, de repérer des véhicules recherchés et, d’autre part, de suivre les mouvements de certains véhicules : ainsi, l’historique de certains mouvements peut faire naître une suspicion et justifier un surcroît de vigilance. Le jour du déplacement des rapporteurs, à 11 heures du matin, ce dispositif avait déjà permis de scanner 1 200 véhicules.
Les rapporteurs ont également passé en revue un détachement des pompiers, qui contribuent à la protection du site contre les risques de feu, les risques technologiques et les risques d’accidents communs sur les 30 km de réseau routier de la base.
● Les activités de protection-défense sont coordonnées par un centre opérationnel de protection (COP), sur la base navale.
Celui-ci centralise les images des caméras de la base, et a bénéficié d’investissements supplémentaires à la suite des attentats du 13 novembre 2015 sous le régime des programmes d’urgence opérationnelle. Une fois la livraison de ce programme achevée, le réseau de caméras de la base pourra visualiser les plaques d’immatriculation.
C’est au sein de ce centre que peut être activée à bref délai une cellule de crise qui rassemble, outre l’équipe armant habituellement le COP, les gendarmes maritimes, l’officier de garde, et les fusiliers marins. Il coordonne les actions entreprises immédiatement après l’alerte. Ce centre est configuré de telle façon qu’en cas d’incident, l’officier de sécurité dispose de trois leviers parfaitement coordonnés : les fusiliers marins pour les actions militaires ; la gendarmerie maritime (incontournable dès lors que des prérogatives judiciaires doivent être mises en œuvre) ; les pompiers en cas d’implication sanitaire.
Selon le personnel du COP, en cas d’alerte, la base navale peut demander le concours de la police nationale et de la police municipale, notamment pour renforcer le contrôle des axes de communication extérieurs à la base navale.
b. La tension dans la gestion des effectifs s’est traduite par des « renoncements » maîtrisés
Depuis janvier 2015, l’armée de terre ont dû libérer des effectifs conséquents afin de les engager dans l’opération Sentinelle, en « renonçant » à certaines activités ‒ qu’elles soient reportées ou annulées.
i. Des « renoncements » à certaines activités
L’effort consenti par les armées en vue de libérer des effectifs disponibles pour l’opération Sentinelle ou pour le renforcement de la protection des emprises de la Défense dans le cadre du plan Cuirasse s’est traduit par des ajustements portant soit sur la condition du personnel ‒ notamment sur les permissions ‒, soit sur les activités professionnelles ‒ notamment la préparation opérationnelle.
• Des « renoncements » affectant la condition du personnel
En matière de condition du personnel, les renoncements portent principalement sur deux aspects de la vie des militaires :
‒ le nombre de leurs permissions a été réduit ;
‒ le nombre de jours d’engagement loin de leurs quartiers, et donc loin de leurs familles, couramment appelé « absentéisme », a considérablement augmenté.
S’agissant des permissions, le rapport précité du HCECM indique que « l’opération Sentinelle et le bouleversement de la planification opérationnelle qui l’a accompagnée n’ont, dans l’ensemble, pas empêché la plupart des militaires de prendre autant de permissions que par le passé », soit quarante jours en moyenne. Ce constat ne rejoint toutefois pas tout à fait celui qui ressort des entretiens des rapporteurs avec les militaires à la rencontre desquels ils sont allés. Un suivi statistique plus approfondi de cette question serait donc utile. Néanmoins, le HCECM reconnaît que « les créneaux pendant lesquels ils ont été en permissions leur ont été souvent imposés et ne coïncidaient pas nécessairement avec les périodes pendant lesquelles leurs conjoints et leurs enfants étaient en congés ».
S’agissant de l’« absentéisme » ‒ terme qui, de façon contre-intuitive et propre aux armées, désigne non pas le fait pour un personnel de ne pas se rendre à son travail, mais au contraire d’être davantage sollicité ‒, le nombre de jours passés par les militaires hors de leurs quartiers a manifestement augmenté dans des proportions importantes. Ce phénomène a été souligné par le chef d’état-major de l’armée de terre, indiquant qu’il aurait pour conséquence une « accumulation de fatigue », dont le rapport du HCECM précise qu’elle est autant d’ordre physique que d’ordre moral. Nombre de militaires rencontrés par les rapporteurs comptaient entre 160 et 200 jours d’absence de leur domicile en 2015.
Le rapport précité du HCECM souligne d’ailleurs l’impact de l’« absentéisme » non seulement sur les personnels, mais aussi sur leurs familles. Il souligne que « sans pouvoir aussi fréquemment que dans le cas des opérations extérieures s’organiser longtemps à l’avance, le conjoint du militaire déployé dans l’opération Sentinelle doit, en plus de ses propres obligations professionnelles, assurer seul plus longtemps l’éducation des enfants et faire face aux difficultés matérielles et administratives de la vie quotidienne ». Il relève que « certains conjoints ont, selon les témoignages de militaires, atteint les limites de ce qu’ils pouvaient supporter et plusieurs cas de burn-out ont été rapportés ».
Pour les rapporteurs, cette situation mérite une attention particulière, d’autant qu’elle est appelée à durer. En effet, le général Arnaud Sainte-Claire Deville a souligné que l’engagement de l’armée de terre dans la durée sur le territoire national est « une rupture parce qu’il inverse le paradigme qui structurait l’armée de terre » dans la mesure où, « avant le 7 janvier, un soldat passait 15 % de son temps en opérations extérieures et 5 % en missions intérieures » alors que « depuis le 7 janvier, le soldat passe toujours 15 % de son temps en projection hors métropole mais 40 à 50 % en opération intérieure (Sentinelle, Harpie, Cuirasse) ». Il a ajouté que cette inversion est durable : « lorsque nous aurons recruté, instruit, formé et entraîné nos 11 000 recrues, le soldat sera toujours 15 % de son temps en OPEX mais passera 20 % à 25 % de son temps en mission de protection de ses concitoyens sur le sol national ». Or il ressort clairement des discussions avec les soldats comme avec leurs cadres que l’absentéisme pèse non seulement sur le moral des personnels directement, mais aussi indirectement, via les difficultés conjugales ou familiales qu’il peut engendrer.
• Des « renoncements » susceptibles d’affecter à long terme le potentiel opérationnel des armées
La préparation opérationnelle des forces constitue un gage de leur niveau de compétence professionnelle. L’encadré ci-après présente le système de préparation opérationnelle de l’armée de terre.
Le système de préparation opérationnelle de l’armée de terre
Le commandement des forces terrestres (CFT) est chargé d’entraîner et de préparer les militaires de la force opérationnelle terrestre (FOT) à toutes les missions dans lesquelles l’armée de terre peut être engagée. Cette préparation s’articule en trois ensembles.
Le premier porte sur l’acquisition et le maintien des savoir-faire liés aux différentes spécialités, du niveau individuel jusqu’à celui de la section. Cette « préparation opérationnelle métier » (PO-M) est réalisée par les régiments.
La « préparation opérationnelle interarmes » (PO-IA) vise ensuite à entraîner au combat interarmes les unités à partir du niveau de la compagnie. Elle est assurée dans des centres spécialisés, à Mailly et à Sissone.
La « mise en condition avant projection » (MCP) est une préparation spécifique, adaptée aux conditions particulières du théâtre sur lequel un groupement tactique va être déployé. Elle est, comme la « préparation opérationnelle interarmes », conduite de manière centralisée, compte tenu de l’importance des moyens qu’elle nécessite.
Source : dixième rapport annuel du HCECM, mai 2016.
Avec l’opération Sentinelle, le nombre de jours de préparation opérationnelle par personnel a chuté en 2015 ; l’objectif fixé s’établissait à 83 jours ‒ ce qui est déjà en deçà de la norme de référence, qui s’élève à 90 jours ‒, mais le nombre de jours effectifs s’est établi, selon les unités, entre 51 et 64. Dans son rapport précité, notre collègue François Lamy présente le détail des renoncements opérés depuis 2015 :
‒ la formation initiale a été réduite. Selon les précisions fournies par l’état-major de l’armée de terre, 50 % des activités de partenariat entre les régiments et les écoles ont été annulées en 2015, particulièrement au premier semestre. M. Lamy rapporte que selon le ministère, « l’atteinte d’un niveau d’aptitude opérationnelle satisfaisant pour les jeunes cadres arrivant en unités sera par conséquent différée » ;
‒ la préparation opérationnelle dite « métier » (PO-M) « connaît elle aussi un ralentissement, faute de temps disponible et faute de certains moyens ‒ les matériels de transmissions et certains véhicules tactiques étant utilisés pour l’opération Sentinelle ». Pour le ministère, « la dégradation du socle de fondamentaux qui en découle aura in fine un impact sur la performance des activités opérationnelles » ;
‒ la « préparation opérationnelle interarmes » (PO-IA) « a dû être restreinte aux “mises en condition avant projection” (MCP) des personnels envoyés en OPEX, au détriment de l’entraînement dit “générique” ». Il en résulte un « phénomène d’usure du socle général de compétences interarmes », dont la rapidité est proportionnelle à celle du renouvellement des personnels des unités. L’état-major de l’armée de terre a indiqué aux rapporteurs qu’il estime à 30 % le taux de perte annuelle du « socle de fondamentaux du combat interarmes ». Le commandant des forces terrestres s’est dit « préoccupé » par « la baisse du niveau d’entraînement » des forces : « nos unités vivent pour l’instant sur leurs acquis ».
De plus, le rapport précité du HCECM indique que nombre de personnels ont dû renoncer à des activités de formation et de préparation des examens et concours. Or écourter voire supprimer des stages a parfois pour effet de ralentir leur progression professionnelle.
En outre, le général Jean-Pierre Bosser a précisé que ces renoncements ont porté aussi sur les exercices internationaux : la partie française a dû renoncer à participer à certains exercices, et a dû réduire l’importance des forces participant à d’autres exercices, comme l’exercice bilatéral franco-britannique Griffin Rise 2015 ou l’exercice Citadel Kleber 2015 conduit dans le cadre de l’OTAN.
ii. Des renoncements toutefois maîtrisés
Si ces renoncements sont par principe regrettables, les rapporteurs soulignent qu’ils ont été consentis et organisés par les armées de façon à affecter le moins possible la capacité opérationnelle des forces.
Des mesures palliatives ont également été prises. Ainsi, à titre d’exemple, les rapporteurs ont constaté que le rythme d’activité des soldats engagés dans le groupement Paris-centre de la force Sentinelle était organisé par cycles de six jours où se succèdent : quatre jours d’activité propre à la mission Sentinelle ; un jour de formation et d’entraînement ; un jour de repos. De telles mesures palliatives conjuguées à une répartition avisée des reports et annulations d’activité permettent ainsi de maîtriser les renoncements à l’entraînement des soldats, particulièrement dans deux domaines-clés pour le maintien du niveau professionnel des militaires : leur formation initiale et leur préparation aux engagements les plus exigeants et les plus risqués.
• Un effort maintenu de formation initiale des recrues
Compte tenu de l’augmentation des cibles de recrutement permise par la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire, les besoins sont accrus en matière de formation initiale des recrues. Le chef d’état-major de l’armée de terre a ainsi fait valoir que les moyens consacrés à la formation initiale avaient augmenté de 50 % depuis l’été 2015.
Le schéma suivant illustre le fait que les renoncements ne concernent plus la formation initiale, qui fait au contraire l’objet d’un effort.
LA PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE – 2015-2017
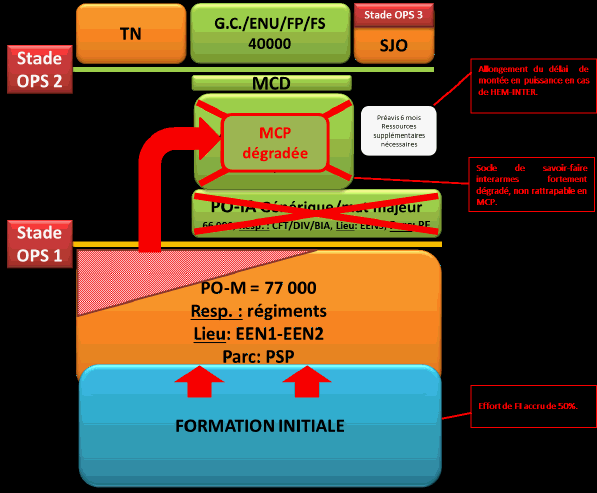
Source : avis n° 3115, tome IV, précité.
• Des conditions préservées de préparation aux opérations extérieures
Le général Arnaud Sainte-Claire Deville a souligné devant les rapporteurs que l’armée de terre « on ne fait d’impasse ni sur la préparation opérationnelle métier (la formation de base), ni sur les mises en condition avant projection », à la différence de la préparation au combat interarmes, qui est clairement « une variable d’ajustement ».
À titre d’exemple, les schémas suivants montrent l’impact de ces renoncements sur l’activité d’un régiment, le 1er régiment de tirailleurs.
PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE ET ENGAGEMENTS DANS SENTINELLE EN 2015
DES UNITÉS FORMANT LE GROUPEMENT TACTIQUE INTERARMES ENGAGÉ
DANS L’OPÉRATION DAMAN AU LIBAN EN 2016
au second semestre 2015
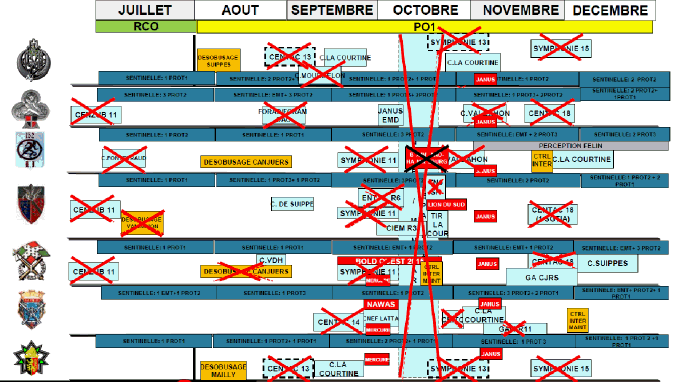
Source : 1er régiment de tirailleurs.
ÉTAT OPÉRATIONNEL ET ENGAGEMENTS DANS SENTINELLE EN 2015
DES UNITÉS FORMANT LE GROUPEMENT TACTIQUE INTERARMES ENGAGÉ
DANS L’OPÉRATION DAMAN AU LIBAN EN 2016
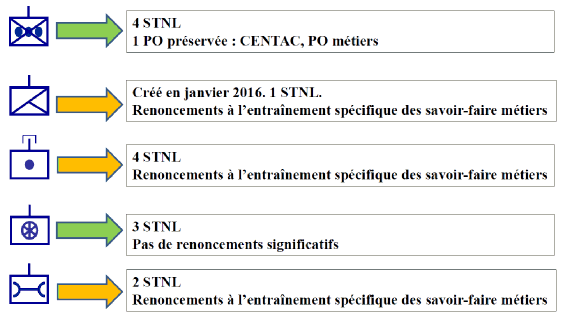
Source : 1er régiment de tirailleurs.
B. DES MESURES D’ADAPTATION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA DOCTRINE MILITAIRES
L’opération Sentinelle étant appelée à se prolonger au-delà d’un mois, elle n’aurait pas été soutenable si la manœuvre des ressources humaines prévue par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 avait été conduite suivant ses modalités initiales. De plus, au-delà de ces obstacles d’ordre matériel ‒ dirimants à eux seuls ‒, la pérennisation de l’opération Sentinelle suppose également un travail de refonte des contrats opérationnels et de la doctrine militaire, que le Gouvernement a engagé dès 2015.
1. L’actualisation de la loi de programmation militaire traduit l’inscription dans la durée de l’opération Sentinelle
La loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 a procédé aux premières adaptations du cadre de référence pour l’organisation et l’emploi de notre outil de défense, afin de prendre en compte la pérennisation de l’opération Sentinelle décidée en conseil de défense le 29 avril 2015. Ainsi ont été ajustés les missions confiées aux armées, de même que les moyens qui leur sont alloués.
a. Une refonte du contrat opérationnel de protection du territoire
L’actualisation de la loi de programmation militaire consécutive à l’activation à plein régime du contrat opérationnel de protection assigné aux armées a notamment précisé les effectifs maximaux que les armées doivent pouvoir être appelées à consacrer à la protection du territoire national.
i. Un haut volume d’engagement : jusqu’à 10 000 hommes en cas de crise
La loi d’actualisation de la programmation militaire a modifié le contrat opérationnel de protection, sans modifier pour autant l’effectif maximal susceptible d’être engagé en cas de crise : 10 000 hommes.
Elle a toutefois précisé qu’un tel engagement n’est envisagé que pour une durée d’un mois, conformément à ce qui était compris par les armées auparavant, sans toutefois être explicite dans aucun texte public.
ii. Une inscription des mesures de protection dans la durée : jusqu’à 7 000 hommes en permanence
La loi du 28 juillet 2015 a également prévu qu’au titre de leur contrat opérationnel de protection, les armées soient susceptibles de « déployer dans la durée, dans le cadre d’une opération militaire terrestre, 7 000 hommes sur le territoire national », précisant que s’y ajoutent « les moyens adaptés des forces navales et aériennes ».
Ainsi, l’actualisation de la programmation militaire a distingué entre, d’une part, un effectif maximal mobilisable sans condition de durée (7 000 hommes) et, d’autre part, un effectif plus élevé, mais dont l’engagement ne peut être que ponctuel (10 000 hommes pour un mois), en cas de crise. Cette mesure peut être vue comme visant à éviter les « effets de cliquet » qui ont marqué, pour ce qui est des effectifs déployés, la mise en œuvre du plan Vigipirate. Comme M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, l’a souligné, ces effectifs ne constituent que des plafonds : « on veut en effet éviter des postures rigides : le Gouvernement doit pouvoir moduler l’effectif déployé en fonction des circonstances ».
b. Des moyens revus à la hausse
i. Une manœuvre des ressources humaines complètement réorientée
L’actualisation de la programmation militaire a prévu de renoncer à près de 18 750 des 33 675 suppressions de postes prévues au sein du ministère de la Défense par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 dans sa version initiale issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, dont 10 175 au titre du reliquat de la loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014. De surcroît, le président de la République a annoncé devant le Congrès le 16 novembre 2015 « qu’il n’y aurait aucune diminution d’effectifs dans la défense jusqu’en 2019 ».
Ainsi, comme le montrent en détail le et le schéma tableau ci-après, les effectifs du ministère de la Défense auront augmenté de 2 300 postes entre 2015 et 2019, au lieu de baisser de près de 25 800 postes comme le prévoyait la version initiale de la programmation militaire.
Évolution des effectifs du ministère de la Défense entre 2013 et 2019
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Total |
Total | |
LPM 2009-2014 (1) |
|||||||||
Évolution annuelle des effectifs |
– 7 881 |
– 2 500 |
– 10 175 |
‒ 2 294 | |||||
dont suppressions de postes : |
– 7 881 |
– 2 500 |
– 10 381 |
‒ 2 500 | |||||
dont créations de postes : |
+ 103 |
+ 103 |
+ 206 |
+ 206 | |||||
Effectif total du ministère |
275 954 |
268 073 |
265 573 |
265 676 |
265 779 |
265 779 |
265 779 |
||
LPM 2014-2019 « version 2013 » (2) |
|||||||||
Évolution annuelle des effectifs |
– 7 881 |
– 7 500 |
– 7 397 |
– 7 397 |
– 3 500 |
0 |
–33 675 |
‒ 25 794 | |
dont reliquat des réformes précédentes (3) |
– 7 881 |
– 2 500 |
+ 103 |
+ 103 |
– 10 175 |
‒ 2 294 | |||
dont déflations supplémentaires |
– 5 000 |
– 7 500 |
– 7 500 |
– 3 500 |
0 |
–23 500 |
–23 500 | ||
Effectif total du ministère |
275 954 |
268 073 |
260 573 |
253 176 |
245 779 |
242 279 |
242 279 |
||
LPM actualisée « version 2015 » (4) |
|||||||||
Évolution annuelle des effectifs |
– 8 007 |
0 |
+ 2 300 |
– 2 600 |
– 2 800 |
– 3 818 |
– 14 925 |
‒ 6 918 | |
dont résultats de la gestion 2014 |
– 8 007 |
||||||||
dont suppression de postes |
– 8 007 |
– 7 500 |
– 4 500 |
– 3 419 |
– 3 018 |
– 3 880 |
– 30 324 |
‒ 22 317 | |
dont créations de postes des réformes précédentes (5) |
+ 103 |
+ 103 |
+ 206 | ||||||
dont créations de postes décidées en janvier 2015 dans le domaine du renseignement |
|
+ 100 |
+ 85 |
+ 65 |
|
|
+ 250 |
+ 250 | |
dont autres créations de postes (FOT, etc.) |
+ 7 400 |
+ 6 612 |
+ 651 |
+ 218 |
+ 62 |
+ 14 943 |
+ 14 943 | ||
Effectif total du ministère |
276 086 (6) |
268 079 |
268 079 |
270 379 |
267 779 |
264 979 |
261 161 |
||
Déclarations du président de la République devant le Congrès le 16 novembre 2015 (7) |
|||||||||
Nouvelle évolution annuelle des effectifs |
– 8 007 |
0 |
+ 2 300 |
0 |
0 |
0 |
‒ 5 707 |
+ 2 300 | |
Effectif total du ministère |
276 086 |
268 079 |
268 079 |
270 379 |
270 379 |
270 379 |
270 379 |
(1) Source : Assemblée nationale, rapport n° 1551 fait par Mmes Patricia Adam et Geneviève Gosselin-Fleury sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, tome I, 2013. (2) Source : article 5 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019. (3) Suppressions et créations de postes prévues au titre de la LPM 2009-2014, et confirmé par la LPM 2014-2019 « version 2013 ». (4) Source : article 4 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019. (5) Créations décidées par la LPM 2009-2014, confirmé par la LPM 2014-2019 « version 2013 » et par son actualisation. (6) L’effectif du ministère de la Défense pour 2013 était évalué à 275 954 postes fin 2013, lors de l’adoption de la LPM 2014-2019 « version initiale », mais une fois l’exercice 2013 clos, cet effectif a été mesuré avec précision et l’on a constaté un écart de 132 postes par rapport aux estimations retenues fin 2013. Cette rectification a été intégrée à la construction de l’actualisation de la LPM, en 2015. (7) François Hollande dixit : « Quant à nos armées qui sont de plus en plus sollicitées par les opérations extérieures que nous allons poursuivre, par la sécurité de nos compatriotes qui est demandée, j’ai donc là encore décidé qu’il n’y aurait aucune diminution d’effectifs dans la Défense jusqu’en 2019 ».
Évolution annuelle des effectifs du ministère de la Défense :
modifications successives des objectifs
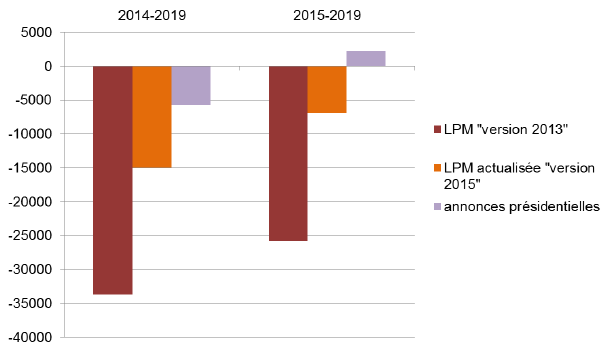
Source : données du tableau précédent mises en forme par les rapporteurs.
Cette augmentation doit permettre de renforcer de 11 000 hommes les effectifs de la force opérationnelle terrestre (FOT) par rapport à l’objectif prévu en 2013, en les portant de 66 000 à 77 000 militaires. En effet, comme le montre le rapport précité de nos collègues Alain Marleix et Geneviève Gosselin-Fleury, compte tenu du rythme de relèves, il faut disposer d’un vivier de 21 000 militaires pour pouvoir en engager 7 000 en permanence. Or l’armée de terre n’en disposait que de 10 000. Aussi, pour que la FOT puisse remplir son nouveau contrat opérationnel ‒ déployer dans la durée jusqu’à 7 000 hommes pour une opération comme Sentinelle, fallait-il donc accroître son effectif de 11 000 soldats.
Au demeurant, comme le souligne notre collègue François Lamy dans son rapport susmentionné, « l’augmentation des effectifs de la FOT est juste suffisante pour permettre à l’armée de terre d’assurer la mission Sentinelle à son format actuel, soit 7 000 hommes déployés en permanence ».
ii. Des moyens budgétaires supplémentaires
Comme le montre le rapport précité de notre collègue François Lamy, l’actualisation de la programmation militaire a prévu une hausse des crédits alloués à la mission « Défense » en vue de financer plusieurs priorités, en tête desquelles la protection du territoire national, et « le budget de l’armée de terre pour 2016 est cohérent avec l’ajustement à la hausse du format de cette armée ».
En effet, les crédits inscrits au budget opérationnel de programme (BOP) Terre (BOP 178-0011) ont augmenté de près de 2 % en autorisation d’engagement et de 1,43 % en crédit de paiement par rapport à 2015.
2. Une adaptation du cadre juridique, conceptuel et doctrinal de l’engagement des armées sur le territoire national : le rapport au Parlement
L’article 7 de la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 prévoit que « le Gouvernement remet, avant le 31 janvier 2016, un rapport au Parlement sur les conditions d’emploi des forces armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population », précisant que « ce rapport fait l’objet d’un débat ». Ce rapport a été remis le 4 mars et a fait l’objet d’un débat en séance publique à l’Assemblée nationale le 16 mars.
Ce rapport suit un raisonnement militaire classique : il prend pour base une analyse de la menace, pour en déduire quelle « posture » de protection peut y parer, puis examine les savoir-faire militaires qui permettent de constituer cette « posture », et en déduit enfin quels moyens doivent être employés ou acquis. Il est ainsi composé en cinq parties, développant respectivement :
‒ une mise en perspective historique et internationale du rôle des armées sur le territoire national, que présente l’encadré ci-après ;
‒ un panorama de l’évolution des menaces ;
‒ le cadre juridique, stratégique, opérationnel et doctrinal de l’intervention des armées sur le territoire national, pour conclure à l’établissement d’une nouvelle « posture » de protection ;
‒ le détail des missions confiées aux armées dans ce cadre, missions dont le rapport prévoit qu’elles doivent être liées aux spécificités des armées et conduire à un « dépassement de la logique Vigipirate » ;
‒ les moyens afférents à ces nouvelles missions en termes financiers, humains, juridiques et capacitaires, esquissant ainsi une éventuelle « réactualisation » de la loi de programmation militaire.
Mise en perspective historique de l’engagement des armées sur le territoire national
Les armées ont longtemps été employées à des tâches de maintien de l’ordre public, mais que cette activité a été progressivement « démilitarisée » sous le double effet, d’une part, de la professionnalisation du maintien de l’ordre par les forces de sécurité intérieure et, d’autre part, de nouveaux « équilibres démocratiques ».
Les armées ont toujours eu une mission de protection du territoire, initialement conçue contre une invasion étrangère dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire (DOT). Si la fin de la guerre froide a « fait tomber en désuétude » la DOT, le continuum entre sécurité extérieure et sécurité intérieure a justifié l’identification, par les Livres blancs de 2008 et de 2013, d’une « fonction stratégique de protection » assignée aux armées.
Le rapport affirme que « l’offensive terroriste que nous connaissons aujourd’hui actualise ce rôle que d’aucuns avaient jugé un peu théorique », tout en notant que la « virulence inédite » de la menace conduit à remettre en question « les catégories de pensée qui prévalaient jusque-là : il ne s’agit ni d’invasion du territoire, ni de simple concours supplémentaire épisodique aux forces de sécurité intérieure ».
a. Un cadre juridique ajusté à la marge : l’adaptation des règles d’emploi de la force à la tactique des « cavales meurtrières » des terroristes
La partie 3 du rapport présente le cadre d’engagement des armées sur le territoire national en partant de son cadre juridique (constitutionnel et légal), puis en examinant sa place dans la stratégie de défense et de sécurité nationale élaborée dans ce cadre, pour ensuite étudier les modifications à apporter en conséquence aux contrats opérationnels des armées et, partant, dans la « posture » des armées ‒ c’est-à-dire « l’ensemble des dispositions permanentes » prises par les armées pour protéger le territoire national.
Le rapport au Parlement présente dans un premier temps les différents régimes d’exception existants : l’article 16 de la Constitution, l’état de siège et l’état d’urgence tel que l’article 1er du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation (en cours d’examen au moment de la publication du rapport) tendait à le définir. La discussion de ce projet de loi constitutionnelle n’étant plus à l’ordre du jour, il conviendrait que le Gouvernement précise si l’absence de refonte du régime de l’état d’urgence appelle ou non une modification de ce que prévoit le rapport au Parlement.
Outre ces développements descriptifs, le rapport semble ouvrir la voie à « une réflexion » sur « une actualisation des dispositions législatives relatives à l’état de siège » (non modifiées depuis un siècle) afin « d’améliorer la cohérence » entre état d’urgence et état de siège. Le rapport envisage explicitement que soit précisé « que l’état de siège ne peut être déclaré, sur tout ou partie du territoire, qu’en cas de péril imminent résultant d’une situation de conflit armé ou d’insurrection armée ».
Surtout, le rapport au Parlement traite aussi des règles d’emploi de la force, indiquant que l’engagement accru des armées sur le territoire national « doit également conduire à [les] préciser ».
i. L’état du droit lors de la publication du rapport au Parlement
On peut définir la notion d’« emploi de la force » comme toute action d’autorité à l’égard des personnes tendant à interférer dans leurs droits et leur liberté. En la matière, le rapport au Parlement évoque l’état du droit et exclut des ajustements majeurs, au-delà de ce que prévoyait le projet de loi ‒ entre-temps promulgué ‒ réformant la procédure pénale.
• Les textes
Le régime de l’emploi de la force par les membres des trois principales catégories de forces déployées depuis janvier 2015 pour la protection du territoire national ‒ les armées, la gendarmerie nationale et la police nationale ‒ est fondé sur le droit commun, c’est-à-dire sur le droit reconnu à tout citoyen d’arrêter l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, la légitime défense (y compris d’autrui), et l’état de nécessité.
Ils voient en outre l’emploi de leurs armes par leurs membres encadrés par des textes différents :
‒ pour les militaires des armées, le droit commun de la légitime défense fondé sur l’article 122-5 du code pénal ;
‒ pour les policiers, le droit commun de la légitime défense. Toutefois, le 12 novembre, le ministre de l’Intérieur a annoncé son intention de réformer les conditions d’engagement de la force par la police, évoquant une « présomption de légitime défense » pour les policiers, sans qu’il y ait été donné de suite depuis ;
‒ pour les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, un régime plus large, fondé non seulement sur le droit commun de la légitime défense mais aussi sur des dispositions spéciales prévues à l’article L. 2338-3 du code de la défense.
Article 122-5 du code pénal
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »
Article L. 2338-3 du code de la défense
« Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
« 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
« 3° Lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de " Halte gendarmerie " faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;
« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt. »
Accessoirement, certaines dispositions législatives spéciales aménagent le régime de l’emploi de la force dans des cas déterminés. On citera notamment :
‒ l’article L. 4123-12 du code de la défense, qui exonère les militaires de leur responsabilité pénale s’ils font un usage de la force armée absolument nécessaire, après sommations, pour empêcher une intrusion dans une zone militaire hautement sensible ;
‒ l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, qui autorise en situation de maintien de l’ordre : 1°) l’usage d’armes de catégorie B (grenades de différents types) et de lanceurs de grenades et de balles de défense après deux sommations demeurées sans effet ; 2°) l’usage de ces mêmes armes ou d’armes de catégorie C (fusil à répétition) en l’absence de sommation si des voies de fait sont exercées contre eux ou si le terrain qu’ils occupent ne peut être autrement défendu.
• La portée des textes
1./ La portée du régime spécifique prévu pour les gendarmes est très limitée par la jurisprudence
S’agissant du régime spécifique applicable aux gendarmes, que le procureur de Paris a présenté aux rapporteurs comme « une survivance du décret organique sur la gendarmerie de 1903 », il a été largement vidé de sa substance par l’application de la jurisprudence européenne, qui, selon M. François Molins, « enserre le droit français dans des conditions très restrictives en la matière » ; le procureur de Paris a d’ailleurs rappelé qu’un fameux arrêt de 2014 a condamné la France pour la mort d’une personne appartenant à la communauté des gens du voyage, abattu par un gendarme alors qu’il s’enfuyait d’une gendarmerie, alors qu’il avait sauté menotté du deuxième étage.
En effet, de quelque statut que relève un membre des forces de l’ordre, ses actions doivent être compatibles avec l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui définit le « droit de toute personne à la vie » et dont le paragraphe 2 restreint l’emploi des armes par les membres des forces de l’ordre à une condition d’absolue nécessité et à des situations particulières.
Article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
« La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
« a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
« b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
« c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Or la jurisprudence qui a découlé à partir de 2003 (26) a pu être vue comme rendant faisant tomber en désuétude les dispositions de l’article L. 2338-3 précité du code de la défense, dès lors que la chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué l’article 2 de la CEDH sans jamais reconnaître remplie la dite condition d’absolue nécessité avant 2013 dans aucune affaire soumise devant elle. Ainsi, jusqu’en 2013 au moins, la jurisprudence était telle que le régime de droit applicable aux gendarmes était le même que celui des policiers, le seul cas légal d’ouverture du feu étant la légitime défense. Me Laurent-Franck Liénard, avocat spécialisé dans la défense de membres des forces de l’ordre, a précisé qu’en 2013 (27) est intervenu ce qui peut être vu comme un revirement de jurisprudence : la Cour de cassation a reconnu la légalité de tirs sur le fondement de l’article L. 2338-3 précité du code de la défense. Néanmoins, selon lui, dans la pratique, « la différence de régime entre les gendarmes et les policiers ou les militaires des armées est ténue, et c’est toujours la légitime défense que l’on plaide » dans les procès mettant en cause des membres des forces de l’ordre. S’agissant du concept d’absolue nécessité en général, le procureur de Paris a estimé qu’il « paraît difficile à manier », précisant : « voilà longtemps que l’on ne l’utilise plus du tout ; il n’était d’ailleurs que très peu invoqué ».
2./ Le droit de la légitime défense ménage une marge d’appréciation importante au juge en fonction des circonstances de l’espèce
S’agissant de la légitime défense, elle n’est reconnue qu’en cas d’agression réelle, actuelle, injuste, et préalable à la riposte, et seulement si l’acte de défense remplit trois conditions :
‒ une condition de nécessité : la personne attaquée ne peut éviter le danger et l’emploi de la force est la seule défense possible ;
‒ une condition d’immédiateté : l’acte de légitime défense doit se dérouler de façon concomitante à l’agression et ne doit pas se poursuivre après la cessation de l’agression, par exemple en cas de fuite des agresseurs : comme l’a fait valoir aux rapporteurs Me Laurent-Franck Liénard, « légitimer un tir pratiqué sur un individu au motif qu’il a tué reviendrait à appliquer la peine de mort » ;
‒ une condition de proportionnalité : l’intensité de l’emploi de la force en riposte doit être proportionnée à la gravité de l’attaque.
C’est donc au juge qu’il revient d’apprécier si les conditions de la légitime défense sont réunies dans chaque cas d’espèce qui lui est soumis. Or, selon Me Liénard, « un certain nombre de juges ont des sortes d’élégances : ils répugnent à reconnaître la légitime défense ». Son confrère Me Thibault de Montbrial, avocat mais aussi ancien officier et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure (CRSI), observe lui aussi que si, en soi, le texte du code pénal sur la légitime défense est « très bon » quoique concis, mais que le problème du droit actuel tient moins à sa rédaction qu’à son interprétation par les juges, « interprétation très restrictive, qui a depuis des décennies un effet castrateur sur les forces de sécurité intérieure ». Il a cité en exemple la situation du gendarme qui, à Dammartin-en-Goële le 9 janvier 2015, a touché un des frères Kouachi par un tir, mais ne l’a pas achevé au sol alors même que l’on connaissait sa dangerosité, sa détermination et son armement. Pour Me de Montbrial, on peut voir là à la fois « une hérésie opérationnelle » résultant d’une « application restrictive du droit de la légitime défense ».
Toutefois, Me de Montbrial a aussi évoqué « une évolution heureuse dans les pratiques des parquets : on partait certes de loin, mais depuis un an, les parquets ont une position plus responsable dans l’appréciation de la légalité de l’emploi de la force ». Pour lui, le cas des soldats qui ont riposté à une agression à Valence le 1er janvier 2016 le montre : le procureur a évalué les circonstances et « sereinement considéré que malgré un nombre important de coups de feu (une quarantaine), la légitime défense était constituée », ce qui « n’aurait probablement pas été le cas aussi rapidement il y a dix-huit mois ».
De même, selon lui, après que six policiers ont successivement tiré sur les frères Kouachi le 7 janvier 2015 ‒ sans qu’aucun n’atteigne sa cible ‒, un chef de service a pensé saisir l’inspection générale de la police nationale (IGPN), « par un réflexe mécanique de couverture » ; c’est alors le parquet qui l’a « ramené à la raison ». La même tendance s’observerait en outre dans le choix des procédures. En effet, pour entendre le fonctionnaire auteur d’un acte d’usage de la force, le parquet a plusieurs cadres : soit la garde à vue, si le parquet a des raisons de penser que le cadre de la légitime défense n’est pas respecté, soit l’audition libre, moins stigmatisante. Les parquets utilisaient quasi systématiquement la garde à vue, mais depuis 2015, « ils prennent davantage leurs responsabilités » et recourent plus fréquemment à la simple audition libre.
ii. Le cadre légal de l’emploi de la force a déjà été adapté au nouveau mode d’action des terroristes que constituent les « cavales meurtrières »
1./ Des facteurs d’insécurité juridique face à la menace actuelle
Plusieurs observateurs ont pu douter que la légitime défense soit constituée au bénéfice des personnes qui emploieraient la force contre un terroriste engagé dans une « cavale meurtrière », c’est-à-dire un enchaînement de plusieurs meurtres en divers endroits, à l’image de ce qu’a entrepris le commando terroriste des 10e et 11e arrondissements de Paris le soir du 13 novembre 2015.
Me Liénard a estimé devant les rapporteurs que si le régime de la légitime défense permet de tirer sur un meurtrier en train de tuer, elle interdit de le faire dès lors qu’il n’est pas précisément en train de braquer son arme. Il y a là, à ses yeux, un « vide juridique » déjà connu pour le cas des tueurs fous ‒ les « amoks » ‒ : si la police en surprend un après un premier meurtre, elle ne peut appliquer de tir que lorsque le tueur commence à tuer de nouveau, sous peine de ne pas pleinement remplir la condition d’immédiateté. Ce vide se serait vérifié dans la période récente : selon Me Liénard, lorsque les terroristes ayant attaqué Charlie Hebdo ont été pris pour cible par un gendarme lors de leur cavale entre Montagny-Sainte-Félicité (Oise) et Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), et que celui-ci n’a pu tirer qu’une cartouche. En outre, cet état du droit pose aussi une difficulté pour les tireurs d’élite : ceux-ci ne peuvent pas justifier leurs tirs par l’ordre qui leur est donné ‒ une jurisprudence constante défendant d’exécuter un ordre manifestement illégal ‒, de telle sorte que bien souvent, « le sniper ne sert à rien ».
Le procureur de Paris a estimé quant à lui que neutraliser un terroriste qui, engagé dans une démarche criminelle sérielle de tuerie, recharge son arme, fuit ou se déplace est justifié et que selon lui, il n’y a dans la pratique « aucun problème de légitime défense puisqu’on est dans la légitime défense d’autrui ». En tout état de cause, l’état du droit laisse ainsi une large marge d’interprétation aux juges, ce qui peut être vu par les militaires et les membres des forces de l’ordre comme un facteur d’insécurité juridique, à tort ou à raison.
Par ailleurs, les rapporteurs ont pu constater lors de leur déplacement sur le terrain auprès des hommes de la force Sentinelle que les militaires engagés dans l’opération sont sensibles à l’encadrement juridique de l’opération.
Le commandement fait valoir que « déterminer en quelques secondes et sous pression si l’on se trouve ou non en situation de légitime défense n’est pas évident ». Faut-il davantage de formation, ou une garantie juridique supplémentaire ? Le problème ne tient pas aux textes ‒ la lettre de la loi, sur la légitime défense, est assez simple ‒, mais à l’appréciation de leur portée, qui est « très complexe » ; aussi, les officiers jugent-ils « difficile de dire si un autre texte serait meilleur » que le droit en vigueur. Pour eux, « en tout état de cause, le soldat tire si, d’instinct, il trouve cela juste », et la principale préoccupation des hommes est de savoir « s’ils seront couverts ou soutenus en cas de tir contesté ». Or « le problème est réel, et particulièrement sensible à Paris ». D’ailleurs, selon le lieutenant-colonel de Russé, « il y a un risque réel d’inhiber les soldats par un rappel trop stressant des limites juridiques ».
Le général Jean-François Parlanti, directeur du centre interarmées de concepts, de doctrine et d’emploi, a confirmé aux rapporteurs que le cadre juridique actuel « pose des problèmes concrets pour les forces de sécurité intérieure comme pour une éventuelle action militaire : dans quel cas frapper un tireur armé d’une AK 47 ? S’il est en train de tirer, le droit d’ouvrir le feu est acquis mais qu’en est-il lorsque celui-ci est en train de recharger son arme, s’il se déplace ou fuit sans tirer alors ‒ même que l’on sait qu’il est en mesure de commettre une nouvelle tuerie quelques minutes plus tard ? ». C’est ainsi que, pour le général Parlanti, « le droit actuel est potentiellement inhibant pour les militaires » : dès qu’il y a tir, il y a mise en œuvre du dispositif juridique pour vérification des conditions juridiques du tir avec saisie de l’arme (garde à vue), etc.
Le chef des opérations de l’état-major tactique du groupement Paris-centre s’est dit très favorable à un élargissement des cas d’ouverture du feu en raison de la nouveauté de la menace. À ses yeux, « pour un terroriste « classique », la légitime défense suffit, mais elle n’est pas adaptée au scénario, nouveau, du suicide bomber ». Selon lui, cette menace est nouvelle et le cadre légal n’y répond pas ; habituellement, même face à un terroriste armé, les soldats essaient avant tout de le neutraliser ; avec le risque de suicide bomber, « la seule solution consiste à tirer dans la tête ». Une extension aux soldats des dispositions applicables à la gendarmerie serait, pour lui, utile.
2./ Une nouvelle excuse pénale
Afin de lever cette difficulté, l’article 51 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a institué une nouvelle excuse pénale évitant la condamnation des membres des forces de l’ordre qui emploient la force pour mettre fin à une « cavale meurtrière ».
Cette excuse est instituée au bénéfice des policiers, des gendarmes, des douaniers et des militaires déployés sur le territoire national sur réquisition préfectorale qui font un usage « absolument nécessaire » et « strictement proportionné » de leur arme « dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis », dans le cas où les membres de ces forces ont « des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable » au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leur arme.
Me Thibault de Montbrial a déclaré que cette disposition « constitue une bonne surprise », et qu’elle est « de nature à guider les juges » dans leur application du droit de l’usage de la force.
Les rapporteurs relèvent qu’avec l’instauration de cette excuse pénale, les militaires des armées bénéficient des mêmes garanties que les agents des forces de sécurité intérieure. Cela répond ainsi à une préoccupation du ministère de la Défense, qui, comme l’a expliqué sa directrice des affaires juridiques, s’était fixé comme principe, en matière d’aménagements du régime d’emploi de la force sur le territoire national, de ne pas obtenir pour les soldats moins que le ministère de l’Intérieur pour les policiers et les gendarmes. Il s’agit, selon le général Didier Brousse, de ne pas rompre la « cohérence » qui existe entre le régime juridique de l’action des soldats, des policiers et des gendarmes. Tout en soulignant que « cohérence » ne signifiait pas « similitude » ‒ ce qui s’inscrit pleinement dans la logique de complémentarité et non de substitution des armées aux forces de sécurité intérieure ‒ et que l’armée de terre n’a pas pris l’initiative de demander quelque modification juridique que ce soit, il a fait valoir qu’elle « ne peut pas être reléguée dans des actions de seconde zone, derrière des forces de sécurité intérieures très renforcées ».
iii. Un vif débat sur l’opportunité d’assouplir davantage le cadre légal de l’emploi de la force pour l’adapter aux menaces
Certains interlocuteurs des rapporteurs ont estimé que les règles d’emploi de la force, même complétées par la réforme susmentionnée de la procédure pénale, ne sont pas adaptées à l’intensité de la menace actuelle ou aux nouveaux modi operandi des terroristes. D’autres jugent ce cadre légal adéquat et équilibré. Aussi, tout au long de leurs travaux, les rapporteurs ont-ils pu discuter de différentes propositions visant à assouplir encore davantage le cadre légal d’emploi de la force avec les responsables civils et militaires ainsi que les observateurs qu’ils ont entendus, comme avec les personnels rencontrés sur le terrain.
1./ Des prérogatives juridiques supplémentaires pour les militaires ?
Certains interlocuteurs des rapporteurs, comme le général Didier Brousse, ont jugé qu’il demeurait un entre-deux juridique à combler entre le droit applicable en temps de paix et celui qui s’applique sous l’empire des régimes d’exception. Il a ainsi estimé qu’il y a « une zone grise, un champ inexploité situé entre le cadre juridique général du temps de paix et celui des états d’exception, notamment l’état d’urgence et l’état de siège ». C’est dans cet espace juridique médian que seraient envisageables des ajustements ad hoc, visant à adapter le droit à la menace terroriste, à l’image de ce qui a été fait en 1955, avec le développement dans la doctrine de la notion d’état de crise, pour combler un espace alors interstitiel entre le droit de l’état de paix et l’état de guerre.
Plus précisément, plusieurs idées ont pu être versées au débat public : confier à certains militaires ‒ par exemple les cadres de contact et les officiers ‒ des prérogatives de police judiciaire ; autoriser les soldats à pratiquer des palpations de sécurité, à l’image de ce qui est permis aux stadiers ; permettre aux personnels des armées de pratiquer des contrôles d’identité ; investir les militaires d’un pouvoir de très brève rétention sur des personnes dont il apparaît nécessaire de vérifier l’identité ; autoriser les soldats à pratiquer des fouilles de bagages et de véhicules ; etc.
M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, a indiqué que sur la question particulière d’une éventuelle extension des prérogatives juridiques des militaires, les points de vue des différents acteurs de la réflexion interministérielle en cours avaient varié au cours des derniers mois :
‒ à partir du mois de janvier 2015, « la poussée en ce sens était très forte, y compris au sein des armées » ;
‒ ensuite, dans le courant de l’année 2015, « on a assisté à un repli », bon nombre d’acteurs estimant nécessaire de « maintenir un “contraste” entre les armées d’une part, et les forces de sécurité intérieure d’autre part » ;
‒ puis, après les événements du 13 novembre 2015, « le balancier a tendance à rebasculer de l’autre côté ».
Le SGDSN a ajouté qu’au seuil de sa réflexion, il avait estimé en première approximation qu’une adaptation des pouvoirs de certains militaires était nécessaire, ne serait-ce que pour permettre des fouilles ou des contrôles d’identité. Cela supposait à son sens d’investir ces militaires de pouvoirs de police judiciaire. Mais, chemin faisant dans les réflexions, le SGDSN en est venu à considérer que lorsque l’on veut contraindre quelqu’un à justifier de son identité, rien n’interdit à un militaire de demander aux personnes de présenter leurs papiers ‒ comme le font les agents de sécurité des transports ‒ ; pour les (rares) cas où l’intéressé refuserait de justifier de son identité devant un militaire, il suffirait alors à ce dernier de l’orienter vers un autre point de contrôle où se trouve un agent de police judiciaire.
Il a toutefois fait valoir que « si l’on confie à des militaires des pouvoirs de police, on aggrave la confusion des rôles entre les armées et les forces de sécurité intérieure : dès lors, on perd dans la double logique de complément de mission et de relais qui préside à la participation des armées à Vigipirate ». Selon le SGDSN, « c’est aussi pour éviter de se poser en nouvelle force de sécurité intérieure que les armées elles-mêmes sont attentives à conserver la spécificité de leur métier ». De plus, « les militaires des armées ne veulent pas être accaparés par des missions de type Sentinelle au détriment d’autres missions ». À trop approfondir les compétences juridiques des militaires, on en viendrait donc à spécialiser une partie d’entre eux dans ces activités et, de ce fait, « on perdrait en polyvalence et en réversibilité ».
Le SGDSN a aussi exclu, même sous le régime de l’état d’urgence, « certaines choses comme la perquisition : il ne faut pas que les militaires interviennent dans les enquêtes » ; en somme, « on laisse de côté les enquêtes judiciaires ». Selon lui, ces questions « concernent plutôt la Justice et l’Intérieur, sous l’égide du secrétariat général du Gouvernement ».
En tout état de cause, s’il fallait « déplacer le curseur » par une initiative législative, il paraîtrait judicieux au SGDSN de « conserver un contraste fort entre les armées et les forces de sécurité intérieure ».
En revanche, autoriser les palpations et autres contrôles, y compris d’identité, à titre exceptionnel sous le régime de l’état d’urgence « n’est pas exclu du tout » : le SGDSN s’est déclaré tout à fait ouvert à une adaptation des règles juridiques pour un temps et un lieu dérogatoires, moyennant un contrôle. Le rapport relatif à l’engagement des armées sur le territoire national qu’il a remis au Premier ministre le 17 février 2016, et qui n’a été déclassifié et transmis qu’en mai suivant, comprend une recommandation en ce sens, formulée avec une certaine prudence. Il propose en effet d’« étudier la possibilité de confier de nouvelles prérogatives administratives aux militaires des armées engagés dans le cadre de la sécurité intérieure », précisant qu’il pourrait s’agir de « palpations de sécurité » et d’« inspections visuelles de bagages ». Il reconnaît cependant deux inconvénients à une telle mesure :
‒ « l’exercice de prérogatives de police administrative supposerait […] une évolution significative de la formation délivrée aux cadres des armées » ;
‒ « le risque de limiter le rôle des armées à l’exécution de tâches réalisées ordinairement par des agents de sécurité privée ne doit pas être sous-estimé ».
En outre, il ne propose de ne confier de telles prérogatives aux militaires que « dans des conditions de lieux et de temps très précisément définies », et ce uniquement « dans le cadre de l’état d’urgence (voire de l’“alerte attentat”) ».
Selon les explications fournies aux rapporteurs, dans les discussions interministérielles préalables à la rédaction du rapport du SGDSN, les armées n’ont pas formellement demandé de tels pouvoirs, afin de ne pas accroître le risque de se voir employées en « substituts » voire en « supplétifs » des forces de sécurité intérieure. Elles ne reconnaissent l’utilité de cette mesure que pour la mise en œuvre de certains savoir-faire militaires, comme le contrôle de zone, pour le cas où les militaires ne seraient pas accompagnés de policiers ou de gendarmes. Une telle mesure peut être établie soit de façon générale par la loi, soit « en tant que de besoin », c’est-à-dire par des réquisitions préfectorales.
Pour les rapporteurs, les inconvénients de cette mesure ‒ bien mis en exergue par le rapport du SGDSN ‒ justifient une approche très prudente de cette question. Si cette mesure devait être prise, il serait donc préférable, en tout état de cause, que ce soit sur la base de réquisitions préfectorales spéciales, pour un temps et un lieu définis à l’avance.
2./ Une présomption de légitime défense pour les militaires ?
Peu avant les attentats du 13 novembre 2015, le ministre de l’Intérieur a fait connaître son intention d’établir une présomption de légitime défense au bénéfice des policiers faisant usage de leur arme. Rien n’interdisait alors d’envisager la même disposition au bénéfice des militaires.
Les rapporteurs ont soumis cette idée à leurs interlocuteurs les plus familiers des contentieux de la légitime défense, qui se sont montrés réservés. Me Thibault de Montbrial a ainsi présenté cette initiative comme « l’archétype de la fausse bonne idée », établissant un parallèle avec « deux exemples de présomptions annihilées par la jurisprudence » :
‒ le dispositif issu d’un décret de 1903 sur la gendarmerie, « vidé de quasiment toute substance par la jurisprudence, notamment celle de la CEDH » ;
‒ celle prévue à l’article L. 122-6 du code pénal au bénéfice de toute personne qui utilise la force pour repousser une intrusion de nuit dans un lieu habité : « dans la pratique lorsqu’il est invoqué, le bénéfice de cet article est le plus souvent écarté par les juges ».
De même, le procureur de Paris a jugé « curieuse » l’idée d’établir une telle présomption, au motif que toute présomption légale étant « toujours vue avec prudence par le Conseil constitutionnel », celui-ci « ne tolère que des présomptions simples et réfragables ». Une présomption irréfragable de légitime défense serait ainsi inconventionnelle, voire inconstitutionnelle, tandis qu’une présomption réfragable serait en pratique de nul effet. Les victimes ou leurs proches continueraient à déposer des plaintes et le parquet ‒ voire le juge d’instruction si la famille d’un terroriste se constitue partie civile ‒ apprécierait in concreto la légitimité de l’emploi de la force, comme il le fait déjà sous l’empire du droit existant. Aussi, selon Me Liénard, une telle présomption « ne servira pas à grand-chose » : susceptible d’être combattue et renversée par l’autorité de poursuite, elle ne met en rien les membres des forces à l’abri de poursuites.
Au contraire, selon Me Liénard, une présomption de légitime défense pourrait aussi être contre-productive, dans la mesure où elle donnerait aux policiers une « fausse impression de sécurité juridique » de nature à les conduire à « user de la force plus facilement, avec moins d’attention qu’ils ne le font aujourd’hui ». Ils risqueraient ainsi d’être davantage poursuivis qu’ils ne le sont actuellement, sans pour autant être davantage protégés.
3./ Étendre au territoire national le champ de l’excuse pénale prévue pour les militaires en OPEX ?
L’une des idées parfois avancées en vue de raffermir la sécurité juridique des militaires engagés en opération sur le territoire national consiste à étendre au territoire national le champ d’application de l’excuse pénale instituée aux articles L. 4123-11 et L. 4123-12 du code de la défense au bénéfice des soldats engagés sur un théâtre d’opération extérieure.
Le rapport au Parlement précité étudie cette idée, mais l’exclut au motif qu’elle supposerait de démontrer que la situation du territoire national est assimilable à un conflit armé au sens du droit international, seule exception au « droit à la vie » admise par la CEDH. Mme Claire Landais, directrice des affaires juridiques du ministère de la Défense s’est dite défavorable à cette solution maximale, expliquant que d’autres aménagements seraient plus efficaces :
‒ pour garantir que les soldats comprennent bien le cadre légal applicable sur le territoire national, la direction des affaires juridiques du ministère de la Défense a été associée à un travail d’élaboration de supports de formation « renouvelés, spécifiques à l’opération Sentinelle ». Dans le même ordre d’idées, M. François Molins a estimé que « la sensibilisation peut jouer son rôle », surtout si elle passe aussi par une présentation plus objective des risques : « il y a peut-être des décisions que l’on peut juger inappropriées contre des policiers ou des gendarmes, mais vraiment pas tant que cela » ;
‒ le ministère a aussi amélioré la protection fonctionnelle des militaires, présentée par l’encadré ci-après et dont la directrice des affaires juridiques du ministère de la Défense a regretté qu’elle ait longtemps été administrée de façon « moins réactive » que celle des membres des forces de sécurité intérieure. Ainsi, en janvier 2016, une procédure d’octroi en urgence de la protection fonctionnelle a été mise en place ; elle a été utilisée pour la première fois à la suite de l’attaque contre les militaires en faction devant la grande mosquée de Valence, le 1er janvier 2016. De surcroît, la directrice des affaires juridiques du ministère de la Défense a indiqué que le ministère entend « transposer aux militaires les évolutions de la protection fonctionnelle des fonctionnaires » prévues par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en particulier l’extension du champ de la protection aux « atteintes volontaires à l’intégrité de la personne » subies par les militaires, ainsi que son octroi « aux agents entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale dans des cas où les faits conduisant à de tels actes de procédure pénale n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».
La protection fonctionnelle des militaires
La protection fonctionnelle – ou protection juridique – traduit la volonté de l’État de défendre un agent public attaqué du fait de ses fonctions. La protection fonctionnelle des militaires est prévue par l’article L. 4123-10 du code de la défense.
Elle peut être octroyée dans trois cas :
‒ lorsqu’un militaire est victime, en sa qualité d’agent de l’État, de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages ;
‒ lorsqu’il fait l’objet de poursuites civiles ou pénales, dans la mesure où les faits ont un lien avec le service mais ne relèvent pas d’une faute personnelle de sa part ;
‒ lorsque son conjoint, ses enfants et ses ascendants directs sont victimes d’une infraction pénale volontaire du fait de son état militaire.
Elle peut prendre trois formes :
‒ des conseils juridiques ;
‒ une intervention judiciaire directe de l’État en vue de réparer le préjudice ;
‒ la prise en charge des dépenses engagées pour la procédure (honoraires d’avocats, frais d’expertise, etc.).
La participation renforcée des militaires aux missions de sécurité intérieure tend naturellement à accroître la probabilité qu’eux-mêmes, ou leurs proches, soient exposés à l’une des situations ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. La gendarmerie gère elle-même depuis 2013 les demandes de protection fonctionnelle, de façon efficace et réactive. Les armées recourent aux services locaux du contentieux du service du commissariat des armées (SCA) et à la direction des affaires juridiques (DAJ). Si le ministère de la défense indique ne pas rencontrer de difficultés pour mettre en œuvre la protection fonctionnelle, il considère néanmoins que le dispositif mis en place par la gendarmerie peut servir de modèle.
Le rapport au Parlement précité de mars 2016 identifie deux écueils à éviter :
‒ le premier consisterait à accorder la protection fonctionnelle dans des situations où le militaire n’aurait fait l’objet d’aucune attaque volontaire, par exemple à l’occasion des accidents de la circulation ;
‒ le second correspondrait au cas où même les incidents minimes seraient suivis d’un dépôt de plainte, ce qui conduirait à la « judiciarisation » des activités militaires.
Source : HCECM, 10e rapport annuel précité.
Me de Montbrial a ajouté qu’un effort de sensibilisation des procureurs aux contraintes opérationnelles des forces de sécurité intérieure et des armées serait utile. Il recommande, par exemple, que tous les procureurs de France (ce qui représente seulement une centaine de chefs de parquets) effectuent un stage de l’ordre de deux ou trois jours auprès de la brigade de recherche et d’intervention (BRI), du RAID ou du GIGN : « ils verraient ce que représentent trois secondes lorsqu’il s’agit d’ouvrir le feu... ». L’académie du FBI, à Quantico (Virginie) propose des stages de ce type. En France, les magistrats peuvent demander ce type de stage au cours de leur formation, mais ces démarches ne reposent que sur le volontariat et peu de places sont proposées.
4./ Instituer un régime d’exception en cas d’urgence absolue ?
Me Thibault de Montbrial, a soumis aux rapporteurs une proposition tendant à établir un régime juridique spécial pour les situations dites « d’urgence absolue ». Ce régime permettrait d’étendre davantage les bornes temporelles d’application du droit de la légitime défense ‒ et donc d’assouplir la condition d’immédiateté que comporte le droit de la légitime défense ‒, ce que ne permet pas la réforme susmentionnée de la procédure pénale. Selon Me de Montbrial, cette proposition correspond aux réflexes et aux compétences tactiques des militaires français, habitués par les OPEX récentes à des scénarios d’ouverture du feu très fréquente, celle-ci devenant même souvent indispensable à la manœuvre des forces ‒ d’où les tirs de fixation, etc. Me de Montbrial reconnaît que sa proposition a toutefois un inconvénient : sa mise en œuvre « suppose qu’une autorité prenne une décision, ce qui nécessite un certain courage ».
Le SGDSN a reconnu que « l’on peut considérer que les règles doivent être adaptées au contexte », par exemple dans une situation comparable à celle de l’assaut de Saint-Denis le 18 novembre 2015. Ainsi, « en situation de crise », « pour un lieu et un temps donnés », il serait envisageable d’élargir les règles d’engagement de la force de façon à dépasser le cadre strict de la légitime défense. Mais pour lui, « reste à savoir comment écrire une telle exception... »
Le procureur de Paris a toutefois fait observer que même si le législateur français prenait une telle mesure, les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure n’en demeureraient pas moins soumis à la jurisprudence de la CEDH.
5./ Faire reposer la légitimité d’un tir sur un motif de prévention ?
Me Laurent-Franck Liénard a soumis aux rapporteurs l’idée de faire reposer la légitimité d’un tir sur un motif de prévention, soutenant qu’une disposition visant à « prendre en compte le fait que si quelqu’un s’apprête à tuer, il n’y a pas d’autre choix que d’appliquer un tir » pourrait être rédigée de sorte à exploiter au mieux les possibilités laissées par le texte de la CEDH. À ses yeux, en effet, une situation d’absolue nécessité est constituée quel que soit le mode opératoire du terroriste ‒ arme à feu ou ceinture d’explosif. Comme c’est d’ores et déjà le cas des textes fondant la légitime défense ‒ y compris la légitime défense d’autrui ‒, cette extension de ce régime mériterait d’être applicable à toute personne, qu’elle soit ou non membre des forces de sécurité intérieure ou militaire. Cela mettrait dans une position légale, par exemple, aussi bien un membre des forces de l’ordre qui neutralise avec son arme un terroriste en train de recharger la sienne, que toute personne qui percuterait ledit terroriste avec sa voiture.
M. François Molins a toutefois estimé que dans un tel cas, il n’y a dans la pratique « aucun problème de légitime défense puisqu’on est dans la légitime défense d’autrui ». De plus, le texte proposé n’éviterait pas ‒ « même si le non-lieu est évident » ‒ une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction, fût-ce après un classement sans suite.
iv. Un cadre juridique à stabiliser
Le rapport au Parlement précité ne prévoit pas d’autre modification au cadre juridique de l’emploi de la force que celles opérées récemment par la réforme de la procédure pénale. Ainsi, l’idée de permettre aux militaires de pratiquer des fouilles (de véhicules et de bagages) ou des contrôles d’identité est écartée. Comme M. Jean-Claude Mallet, conseiller spécial du ministre de la Défense, l’a expliqué aux rapporteurs, cette décision s’explique par la volonté que « les armées soient utilisées pour ce pour quoi elles sont faites ».
Par ailleurs, nombre de responsables estiment, avec la directrice des affaires juridiques du ministère de la Défense, qu’« en cas d’incident, les soldats disposent d’une couverture juridique suffisante ». Aussi, selon le SGDSN, « personne ne veut que les armées voient leurs modes d’action et leur cadre juridique profondément transformés, afin d’éviter que les armées deviennent une sorte de troisième force de sécurité intérieure ». M. Louis Gautier a d’ailleurs remarqué qu’« il y a eu beaucoup de littérature sur la légitime défense et l’emploi du FAMAS ces derniers mois » et, prévenant que les réflexions sur ce thème sont encore en cours, que le travail de « décantation » des sujets « a conduit à considérer la légitime défense comme le cadre adéquat, d’autant que c’est le régime applicable aux policiers, et bien que ce ne soit pas exactement le régime applicable aux gendarmes ».
En outre, comme le fait valoir le SGDSN, il y a toujours un risque à édicter des règles qui seraient « très générales, au point d’empiéter sur ce qui relève de l’appréciation des commandants sur le terrain ».
Mme Claire Landais a ajouté qu’il était d’autant moins nécessaire de faire évoluer les règles juridiques d’emploi de la force par les militaires sur le territoire national que, observe-t-elle, « les magistrats judiciaires font, depuis quelques années, une application du droit de la légitime défense qui est de plus en plus compréhensive des spécificités des forces de l’ordre » : la jurisprudence « a tendance à faire une interprétation spécifique de l’excuse pénale de légitime défense pour ces forces ».
Faut-il pour autant s’en remettre sur la jurisprudence, par nature fluctuante ? Pour la directrice des affaires juridiques du ministère, légiférer alors que la jurisprudence s’adapte pourrait être contre-productif : cela pourrait susciter certaines rigidités. En outre, cet infléchissement dans un sens plus ouvert aux nécessités de l’action des forces de l’ordre a débuté avant même les attentats de janvier 2015 : on ne peut donc pas voir le résultat d’une émotion collective appelée à se dissiper. Elle a d’ailleurs fait valoir que légiférer ne suffit pas toujours, citant en exemple le régime d’emploi de la force applicable aux gendarmes. Si l’on s’en tient à la lettre de la loi, ce régime est plus permissif que celui applicable aux policiers et aux militaires des armées ; mais en réalité, l’interprétation constante de ces dispositions par la Cour de cassation est très restrictive, et ce n’est que sur le fondement de cette interprétation restrictive que la Cour européenne des droits de l’Homme a admis leur conformité à la convention de Rome.
Pour les rapporteurs, il serait prudent d’observer les conditions de mise en œuvre par le commandement des dispositions nouvelles issues de la réforme de la procédure pénale avant de modifier encore les équilibres législatifs en la matière.
b. Une fonction stratégique de protection « à repenser »
Le rapport au Parlement examine les implications des attentats de 2015 et du déploiement de l’opération Sentinelle pour nos documents stratégiques, qu’il s’agisse de la stratégie nationale de défense et de sécurité nationale formulée par le Livre blanc de 2013, ou des fonctions stratégiques assignées aux armées.
i. Notre stratégie de défense et de sécurité nationale plaçait le risque terroriste au premier plan
Examinant la place du territoire national dans la stratégie de défense et de sécurité nationale, le rapport n’annonce aucune inflexion stratégique ; au contraire, il constate que cette stratégie prenait d’ores et déjà en compte les menaces terroristes et visait à garantir la « résilience » de la Nation suivant une « démarche globale », dans laquelle il souligne le caractère « prioritaire » des efforts dont font l’objet le renseignement et la cyberdéfense.
Il indique aussi que « la France doit être en mesure de penser et conduire son action en relation avec plusieurs acteurs et à des niveaux différents », citant notamment « l’ensemble des ministères, des services publics, des armées, des forces de sécurité, des collectivités territoriales et des opérateurs d’infrastructures et de réseaux vitaux ».
M. Philippe Errera, directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense, a cependant suggéré qu’il serait utile de mettre à jour, dans les années qui viennent, le Livre blanc de 2013 sur la défense et la sécurité nationale pour mieux y faire apparaître le caractère militarisé de la menace terroriste actuelle et en tirer les conséquences. Il a toutefois estimé qu’une telle mise à jour pouvait attendre un ou deux ans.
ii. Une refonte annoncée de la fonction stratégique de protection
Le rapport au Parlement rappelle que le Livre blanc de 2013 a reconnu la fonction stratégique de protection comme fondamental dans un « tryptique “dissuasion ‒ intervention ‒ protection” » qui « structure l’action des armées » et « confère à la sécurité de la France la profondeur stratégique qui lui est indispensable ». Il rappelle aussi que le contrat opérationnel des armées fait déjà une place importante à la protection du territoire, tant au titre de leurs missions permanentes (c’est-à-dire la « situation opérationnelle de référence ») que de leurs « engagements circonstanciels », comme le montre le schéma ci-après.
Le rapport précise cependant que « l’affirmation de la menace terroriste dans toutes ses dimensions ‒ y compris le cyberespace » conduit à des changements majeurs dans la fonction stratégique de protection (« à repenser ») et dans le contrat opérationnel de protection (« à actualiser »), et ce à plusieurs égards :
‒ s’agissant des effectifs, il rappelle que la loi actualisant la LPM a déjà modifié le dispositif, qui est passé d’un déploiement ponctuel de 10 000 hommes au déploiement « dans la durée » d’un effectif de 7 000 hommes, porté à 10 000 hommes pour un mois. Il y a là un « rééquilibrage » des missions des armées au profit du territoire national ;
‒ s’agissant de la logique générale du dispositif, le rapport annonce un profond changement de paradigme par rapport au dispositif Vigipirate : « il ne s’agit donc plus d’apporter un complément d’effectifs relativement modeste aux forces de sécurité intérieure sur le modèle du plan gouvernemental Vigipirate », mais de « garantir, dans tous les milieux, la capacité de conduire le volet militaire des opérations de sécurité intérieure » impliquant plusieurs milliers d’hommes. Le rapport insiste ainsi sur le caractère militaire de ces missions et donc de leur commandement, qui « relève directement du chef des armées, au terme d’un Conseil de défense et de sécurité nationale, à l’identique des interventions extérieures » ;
‒ s’agissant de l’articulation des forces, le rapport reconnaît bien sûr aux forces de sécurité intérieure qu’elles « conduisent la manœuvre globale de sécurité intérieure », tout en décrivant leurs rapports avec les armées en termes de « coordination et complémentarité », plutôt qu’en termes de suppléance, de subordination ou de mise à disposition.
LA PROTECTION DU TERRITOIRE DANS LE CONTRAT OPÉRATIONNEL
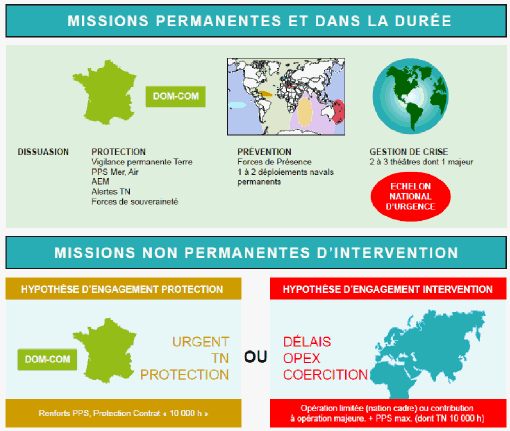
Source : rapport au Parlement sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population, 2016.
L’objectif est ainsi décrit : « mettre à la disposition permanente de la Nation une réserve générale d’intervention militaire permettant d’agir sur le territoire national de façon rapide, le cas échéant massive et, lorsque nécessaire, dans la durée ». Comme le conseiller spécial du ministre de la Défense l’a expliqué aux rapporteurs, la défense du territoire constituait une mission « un peu perdue de vue depuis 1996 », lors de la professionnalisation des armées et douze ans après le transfert à la gendarmerie nationale de la mission de « défense opérationnelle du territoire » (DOT), tombée en déshérence. Selon M. Mallet, si la fonction de protection était affirmée par les Livres blancs successifs, « la façon de décliner cet objectif n’était pas entrée dans les mœurs ; on se disait en quelque sorte : “on se débrouillera le moment venu” ».
Enfin, le rapport cite, au titre de la « fonction “protection” rénovée » de nouvelles mesures de sécurité prises pour protéger les emprises militaires ‒ notamment le plan Cuirasse ‒ ou les secteurs dits « d’importance vitale » au titre des activités militaires ou industrielles.
L’enjeu consiste donc à établir un corpus doctrinal pour approfondir la notion de « fonction stratégique de protection » et à définir mieux qu’avant les missions assignées aux armées à ce titre par leurs contrats opérationnels. L’adoption en janvier 2015, en urgence, de modes d’action statiques et la difficulté qu’il y a depuis à faire évoluer ce dispositif peuvent être vues comme le résultat de ce peu d’approfondissement dans la réflexion sur cette fonction stratégique.
c. De nouvelles « postures » des armées, au premier rang desquelles une « posture de protection terrestre » (PPT)
La « posture » des armées se définit comme « l’ensemble des dispositions permanentes » prises par les armées dans tous les milieux pour protéger le pays, et ne concerne aujourd’hui que les milieux maritime et aérien, dans lesquels les armées sont « primo-intervenantes ». Après une présentation des deux postures permanentes existantes et analysées plus haut, le rapport au Parlement annonce la création de deux nouvelles postures, concernant pour l’une ‒ la principale ‒ le milieu terrestre.
• Caractéristiques de la « posture de protection terrestre »
Le rapport au Parlement pose les bases d’une nouvelle « posture » des armées : la « posture de protection terrestre » (PPT) et en définit les plusieurs caractéristiques :
1./ Cette posture n’est pas qualifiée de « permanente » (à la différence de ce qui existe dans les milieux aérien et maritime), mais le rapport précise qu’elle sera « adaptable », c’est-à-dire « continue dans le temps, mais discontinue en volume et dans l’espace ».
2./ Le rapport insiste sur le fait que si cette posture se traduit par des engagements « au service de l’autorité civile en charge de la sécurité intérieure », la chaîne de commandement sera militaire à tous les niveaux ‒ stratégique (EMA/CPCO), opératif (zone de défense) et tactique (états-majors tactiques) ‒, ceci « garantissant la cohérence et l’efficacité de l’engagement militaire ».
3./ Le rapport met aussi l’accent sur la « militarité » des missions conduites au titre de cette posture. Il évoque ainsi les « spécificités des armées », et met en avant une sorte de continuum « de savoir-faire et de compétences » détenus par l’armée de terre et « utilisés pour les opérations extérieures comme pour les opérations intérieures ». Il présente en effet cette posture comme répondant à des réquisitions préfectorales exprimées en « effets à obtenir », ce qui traduit le souhait des armées de voir l’autorité civile leur laisser davantage de marge de manœuvre dans la planification et la conduite de leurs missions, là où, dans le cadre actuel de l’opération Sentinelle, l’énoncé des réquisitions porte souvent sur les moyens à employer.
Aux yeux des rapporteurs, identifier une nouvelle « posture » ‒ la « posture de protection terrestre » ‒ marque un parallèle avec les dispositifs existants pour les milieux maritime et aérien (PPSM et PPSA), à la différence que l’armée de terre ne serait pas primo-intervenante dans son milieu. Avec l’élaboration de ces éléments de doctrine, la contribution des armées à la protection du territoire national en milieu terrestre ne se résume plus à l’opération Sentinelle ou au plan Vigipirate, tant pour ce qui concerne les zones de déploiement que les modes d’action.
En ce sens, M. Jean-Claude Mallet a souligné que cette posture constitue le cadre dans lequel les armées (principalement, mais pas exclusivement, l’armée de terre) « seront en permanence en capacité de répondre au “contrat 7 000 / 10 000” ». Ainsi, le déploiement d’un effectif pouvant atteindre 7 000 hommes dans la durée (et 10 000 pour un mois) s’intègre désormais dans la « situation opérationnelle de référence », c’est-à-dire les missions permanentes des armées.
M. Mallet a ajouté que les activités menées au titre de la « posture de protection terrestre » se présenteront « sous la forme de Sentinelle ou sous une autre forme : on ne doit pas “se fixer” sur Sentinelle ». Les rapporteurs relèvent d’ailleurs que l’accent est mis sur la flexibilité de la PPT, ce qui fait écho au souhait des armées (en particulier l’armée de terre) de ne pas rester « figée » dans un dispositif encore très statique, comme l’est celui de l’opération Sentinelle a plusieurs égards (cf. les rigidités constatées dans l’évolution des effectifs déployés et des modes d’action).
Le texte du rapport au Parlement traduit aussi une sorte de volonté de « montée en gamme militaire » par rapport à l’opération Sentinelle : il met l’accent sur l’utilisation de savoir-faire proprement militaires dans une optique d’« optimisation » de l’emploi des forces, faisant le parallèle avec les OPEX, et ouvre (prudemment) la voie à une meilleure exploitation des capacités des armées en matière de renseignement, sans citer le mot. En tout état de cause, si le rapport au Parlement ne manque jamais de rappeler le primat de l’autorité civile et la place des forces de sécurité intérieure, néanmoins, il peut être vu comme inspiré par la recherche d’une certaine autonomie de l’outil militaire dans la protection du territoire national, qui s’éloigne de l’emploi supplétif des forces de sécurité intérieure qui a pu marquer le plan Vigipirate. L’accent est ainsi mis sur le caractère militaire de la chaîne de commandement et des savoir-faire employés.
• Contenu de la « posture de protection terrestre »
Le rapport précise que la posture de protection terrestre comprendra deux types d’activités :
‒ des « missions de sécurité », conduites « en autonomie ou conjointement avec les forces de sécurité intérieure », portant notamment sur : la surveillance ou le contrôle de zone ; la protection de sites « en privilégiant au maximum une approche zonale » (c’est-à-dire dynamique) ; l’escorte de convois ; la contribution « à la surveillance des objectifs ou activités susceptibles de constituer une menace » ; la collecte « d’informations d’ambiance sur le terrain » (ces deux derniers points ouvrant la voie à une exploitation du renseignement moins bridée qu’aujourd’hui) ; et l’intervention en cas d’attaque terroriste « en appui des forces de sécurité intérieure » ;
‒ des activités de préparation opérationnelle « réorientées » sur le territoire national (on parle aussi de « prépa-ops dérivée »). L’objectif de cette mesure est double : d’une part, « renforcer la présence territoriale » de l’État et, d’autre part, « se préparer aux éventuels engagements futurs » ; le rapport mentionne aussi « l’acquisition d’informations d’environnement ». Ces activités prendront la forme de manœuvres, qui pourront être menées conjointement avec les forces de sécurité intérieure. Comme terrain envisageable pour ces activités, le texte évoque « des zones peu fréquentées ou difficiles d’accès ».
Ainsi que l’a expliqué le sous-chef d’état-major de l’armée de terre chargé des opérations aéroterrestres, dans la mise en place de la nouvelle posture de protection terrestre il est « important de ne pas “désoptimiser” ce qui fonctionne déjà ». Aussi, l’armée de terre propose d’élaborer cette posture sur la base de :
‒ la mise en synergie et en cohérence de l’ensemble des mesures de protection déjà prises par l’armée de terre ;
‒ la réorientation d’une partie de ses activités opérationnelles au service de la sécurité du territoire national.
Concernant la « préparation opérationnelle dérivée », le général Brousse a évoqué l’idée d’« une présence planifiée, continue dans le temps, mais discontinue en volume et dans l’espace ». Selon ses explications, il s’agirait de réorienter certaines activités de préparation opérationnelle (sous l’appellation de « préparation opérationnelle dérivée ») de façon à ce que la force s’entraîne non seulement « coupée du reste au sein des camps d’entraînement », mais aussi au sein de la population, en zone rurale ou périurbaine. Cette nouvelle forme
préparation opérationnelle aurait, aux yeux du général Brousse, un double caractère « gagnant-gagnant » :
‒ elle permettrait non seulement de mieux préparer la force à des engagements sur le territoire national mais aussi, ce faisant, d’assurer une présence accrue de l’État dans certaines zones du territoire : « l’État pourrait en profiter pour reprendre pied dans certaines zones ». Le général a fait valoir que de tels déploiements pourraient ainsi avoir un intérêt en matière de prévention, voire de recueil d’informations, notamment « là où la gendarmerie est peu présente » ; il a aussi cité en exemple le cas de l’Ariège : on y a arrêté un prédicateur, et une présence plus dense des forces armées dans ce contexte serait de nature à rassurer la population. Le général a aussi rappelé que certaines unités s’entraînent déjà en milieu ouvert : à titre d’exemple, le 8e RPIMa « a toujours mené des exercices de combat de rue en zone peuplée », et « tout existe pour qu’on le fasse » à une plus large échelle.
‒ elle permettrait de développer des compétences utiles non seulement pour les opérations sur le territoire national, mais aussi en OPEX.
Ainsi, le champ des activités relevant de cette posture est large : le rapport indiquant que la PPT « s’appuie sur l’ensemble des dispositions prises dans le milieu terrestre », elle pourrait être vue comme intégrant la « protection défense » (PRODEF) (28) et les moyens afférents.
d. Une nouvelle posture de cyberdéfense et des « capacités permanentes » de soutien sanitaire et pétrolier
En plus de la posture de protection terrestre, le rapport au Parlement annonce la création :
‒ d’une autre posture nouvelle : la « posture cyber » ;
‒ ainsi que de deux dispositifs du même ordre qui, appelés non pas « postures » mais « capacités permanentes », concernent le soutien sanitaire et le soutien pétrolier.
• La « posture cyber »
Le rapport au Parlement institue ainsi une « posture cyber », dont il précise qu’elle est « très majoritairement tournée vers la protection interne du ministère de la Défense ». Ses objectifs sont l’anticipation, la détection et le traitement des menaces. Le rapport évoque deux de ses outils :
‒ un « centre d’opération cyber » placé au sein du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) ;
‒ un « centre d’analyse de lutte informatique défensive ».
• Les capacités permanentes de soutien sanitaire et pétrolier
Le rapport met, selon les termes de M. Jean-Claude Mallet, « un coup de projecteur » sur deux capacités permanentes qui, sans être qualifiées de « postures » spécifiques, font partie des mesures permanentes de protection du territoire national prises par les armées.
1./ La « capacité permanente de réponse sanitaire » du Service de santé des armées (SSA)
Le rapport met en avant les moyens et les savoir-faire du SSA, ainsi que ses compétences spécifiques, par exemple en matière de gestion du risque nucléaire, radiologique, biologique, chimique ou épidémiologique, ou encore en matière de traitement des blessures de guerre.
Il est ainsi prévu que le SSA puisse mettre ses capacités et ses compétences au service de la protection du territoire, et ce « au-delà de sa participation au service public hospitalier » ‒ c’est-à-dire dans des situations de crise ‒, mais « sous réserve de la priorité qu’il doit accorder à la satisfaction des besoins des armées ». M. Jean-Claude Mallet a d’ailleurs souligné aux rapporteurs que « le risque chimique est réel et avéré avec Daech en Irak et Syrie ».
2./ La « capacité permanente de soutien pétrolier des forces armées et des forces de sécurité intérieure » du Service des essences des armées (SEA)
Trois types de contributions du SEA sont ainsi évoqués :
‒ la mise à la disposition permanente d’experts détachés de la direction générale de l’énergie et du climat et de sociétés en charge de missions d’utilité publique, afin de contribuer à la « mission régalienne de sécurisation de la logistique pétrolière aval » ;
‒ assurer le stockage et la distribution de carburants « garants de la mobilité des forces armées et des forces de sécurité intérieure » ;
‒ contribuer à des missions de service public, sous deux réserves : d’une part, que ce soit « sous commandement opérationnel » (c’est-à-dire militaire) ; d’autre part, que la priorité soit accordée à la satisfaction des besoins des armées.
e. Des principes d’engagement des armées sur le territoire national visant à exploiter au mieux leurs savoir-faire spécifiques, plutôt qu’à les employer en « supplétifs » des forces de sécurité intérieure
Dans sa quatrième partie, le rapport au Parlement passe de la doctrine sous-tendant la fonction stratégique de protection au concret des missions des armées dans ce cadre. Pour ce faire, comme l’a expliqué M. Jean-Claude Mallet, le raisonnement suivi prend pour base les spécificités des armées ‒ le rapport souligne toujours qu’elles sont « professionnelles » ‒, pour en déduire les principes généraux de leur emploi et, enfin, le détail de leurs missions.
i. Les spécificités des armées depuis leur professionnalisation
Des spécificités des armées, le rapport fait un tableau général assez bref, ordonné en trois ordres de spécificités :
1./ Le rapport montre une convergence entre, d’une part, la nature des menaces, avec l’action de « groupes terroristes d’inspiration djihadiste, aussi puissants et militarisés que certains États » et, d’autre part, les modes d’action des armées. Avec la multiplication des opérations de gestion de crise et de maintien de la paix, ceux-ci se sont en effet diversifiés dans le sens d’« une très grande maîtrise dans l’usage de la force », ce qui contribue « de facto à atténuer les distinctions de posture entre-temps de paix et temps de guerre ».
2./ La deuxième spécificité des armées relevée par le rapport tient à « l’effet dissuasif » de la forte visibilité des militaires.
3./ La troisième de ces spécificités réside dans six « qualités intrinsèques » (ou « spécificités génériques ») des armées énumérées par le rapport :
‒ leur capacité de planification, c’est-à-dire d’intégration et de mise en synergie d’un large spectre d’aptitudes et d’équipements ;
‒ leur autonomie (elles ne dépendent pas des moyens des forces de sécurité intérieure pour agir sur le territoire national) et leur mobilité territoriale : à la différence de l’essentiel des effectifs et des moyens des forces de sécurité intérieure, ceux des armées ne sont pas « consommés par le maillage territorial » ;
‒ leur réactivité : les armées constituent un réservoir de forces disponible, organisé de façon à être déployé et manœuvrer dans de brefs délais, grâce notamment à leur « chaîne de décision verticale » ;
‒ leur capacité à employer la force armée dans toutes ses composantes ;
‒ leur « capacité de cyberdéfense intégrée » et des moyens spécialisés « rares » (équipements NRBC, moyens aériens, etc.) « qui peuvent compléter ou, selon le cas, suppléer ceux des « primo-intervenants » ».
ii. Les principes d’engagement des armées sur le territoire national
Le rapport commence par réaffirmer le caractère « extraordinaire » de l’engagement des armées sur le territoire national ‒ extraordinaire en soi, par sa durée et par ses modes opératoires ‒, puis en énumère neuf principes généraux qui doivent encadrer cet engagement :
‒ encadrement de l’engagement militaire par une demande de l’autorité civile (suivant les deux régimes existants : réquisition ou demande de concours) ;
‒ compétence du ministre de la Défense pour prendre les dispositions nécessaires afin de répondre à ces demandes ;
‒ expression des réquisitions ou demandes de concours en termes « d’effets à obtenir » et « non en désignation de moyens spécifiques, sauf exception », et « autant que possible » bornée dans l’espace et dans le temps ;
‒ association préalable des autorités militaires dans le processus d’établissement des réquisitions, ce qui tend à formaliser les pratiques en cours : en effet, selon M. Jean-Claude Mallet, la chaîne OTIAD « est très décentralisée, ce qui permet aux officiers généraux de zone de défense et de sécurité de discuter efficacement avec les préfets de zone pour la définition des réquisitions » ;
‒ maintien d’une « marge d’initiative et de manœuvre » pour les armées dans leurs modes d’action, « pour réduire la prévisibilité des déploiements, diversifier la tactique, et assurer le caractère dissuasif du déploiement » ;
‒ information régulière de l’autorité civile et contrôle civil de la mission ;
‒ emploi des armées visant « la plus grande cohérence possible avec leurs spécificités propres », notamment l’« action collective et coordonnée sous commandement central », le parallèle étant fait avec l’organisation en OPEX.
Aux yeux des rapporteurs, la logique sous-tendant ces principes d’action est claire : c’est une logique d’opération militaire ‒ du point de vue des savoir-faire employés, de l’organisation et du commandement ‒, avec autant d’autonomie que possible par rapport aux forces de sécurité intérieure, à l’opposé d’une logique « de supplétifs ».
L’accent est mis sur la présentation des armées comme un « réservoir de forces unique » à la disposition de l’État pour la gestion des crises extérieures comme intérieures. Ce concept de « réservoir de forces unique », largement développé par le SGDSN, justifie à plusieurs égards le recours aux armées plutôt que le recrutement de policiers ou de gendarmes supplémentaires pour la protection du territoire national :
‒ l’organisation militaire et la chaîne de commandement constituent une garantie de réactivité, ce qui est précieux en cas de crise ;
‒ d’autres forces que les armées seraient moins polyvalentes (capables d’être engagées dans une crise extérieure aussi bien qu’intérieure) ;
‒ le niveau de violence de la menace actuelle impose d’apporter une réponse dans le haut du spectre de la force.
Ce passage du rapport semble très inspiré par le retour d’expérience de l’opération Sentinelle. En effet, ces principes reflètent clairement ce que la majorité des observateurs comprend comme étant le point de vue des autorités militaires sur l’opération Sentinelle, qui serait trop « figée » dans des postures statiques et trop « bornée » par des réquisitions préfectorales exprimées en termes de moyens pour permettre aux armées d’exploiter leurs savoir-faire.
Certes, M. Jean-Claude Mallet a réfuté devant les rapporteurs l’idée que le ministère de l’Intérieur ait sur cette question des vues radicalement différentes de la défense. Néanmoins, les informations recueillies sur le terrain et les déclarations du général Denis Favier devant la mission d’information permettent d’émettre l’hypothèse qu’au moins pour l’opération Sentinelle, l’Intérieur préfère confier les gardes statiques à la force Sentinelle qu’aux forces de sécurité intérieure. Or c’est l’opération Sentinelle qui « sature » aujourd’hui le contrat opérationnel de protection ; et même si cette opération est appelée à évoluer, rien ne permet d’exclure que les sites protégés doivent l’être dans la durée, ce qui continuera à nécessiter d’importants effectifs. Aussi, concernant les divergences de vues entre la défense et l’intérieur, ce qui vaut aujourd’hui pour l’opération Sentinelle risque de valoir demain pour une part substantielle des missions menées au titre de la posture de protection terrestre (PPT).
iii. Une rupture par rapport à la « logique Vigipirate »
La quatrième partie du rapport se conclut sur un développement visant à montrer en quoi l’opération Sentinelle marque une rupture par rapport à la « logique Vigipirate ». Outre que le nombre de militaires engagés traduit un changement d’échelle ‒ de 1 010 au maximum pour Vigipirate à 10 000 pour Sentinelle ‒, l’opération Sentinelle est présentée comme illustrant les avantages qu’il y a à mettre en œuvre le « contrat de protection » prévu par le Livre blanc de 2008 : « capacité de réaction immédiate », « souplesse d’emploi » et « modularité » du « réservoir de forces » que constituent les armées.
Le rapport énumère ainsi les éléments de « cohérence et continuité » entre l’opération Sentinelle et les opérations extérieures : mêmes soldats, décision d’engagement relevant du chef de l’État, Sentinelle « conçue comme une véritable opération tournée vers l’intérieur ». Il est précisé que l’opération Sentinelle n’est pas liée à l’état d’urgence. L’évolution des modes d’action de la force Sentinelle vers des postures moins statiques est présentée comme une adaptation à l’évolution de la menace (attaques coordonnées, bombes humaines, tueries de masse en zones publiques).
f. Un périmètre de missions large mais clairement défini
De l’analyse des spécificités des armées et de l’énoncé de leurs principes d’engagement, le rapport déduit le « périmètre » des missions des armées sur le territoire national ‒ c’est-à-dire qu’il distingue ce qu’elles peuvent être appelées à faire et ce qu’il est exclu de leur confier.
i. Aller au-delà des missions actuelles de Sentinelle
Six types de mission sont inclus dans ce périmètre :
1./ Les missions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, parmi lesquelles le rapport cite : la présence dissuasive (et rassurante pour la population) ; le contrôle et la surveillance de zones et d’axes de communication ; la protection de grands événements ; la protection des structures essentielles de l’État et de points d’importance vitale. Il cite aussi :
‒ en cas d’attentats majeurs ou de prises d’otages massives, une « capacité à rétablir un rapport de forces favorable pour sauver des vies humaines », en complément des forces de sécurité intérieure spécialisées (le RAID, la BRI ou le GIGN) ;
‒ des missions de surveillance et de protection, avec des capacités « en mesure de déclencher des interventions spécialisées » en complément des unités d’intervention des forces de sécurité intérieure.
2./ La contribution à la lutte contre le crime organisé, dans deux secteurs : les opérations antidrogue en mer et la lutte contre l’orpaillage illégal (opération Harpie), qui correspondent aux milieux où les armées agissent déjà en primo-intervenantes.
3./ La défense des intérêts économiques et des accès aux ressources stratégiques, ceci incluant la protection de ressources, des infrastructures d’approvisionnement, ainsi que de l’environnement.
4./ La sauvegarde maritime.
5./ La sûreté aérienne.
6./ La sécurité civile en cas de sinistres et de catastrophe.
ii. Des missions exclues : les opérations judiciaires et le maintien de l’ordre
En contrepoint, le rapport exclut explicitement du périmètre des missions des armées deux ordres de missions : les actions relevant du domaine judiciaire (sauf réquisition spéciale), et les opérations de maintien ou de rétablissement de l’ordre (sauf états d’exception, comme l’état de siège).
SECONDE PARTIE :
PROPOSITIONS POUR PASSER DE SENTINELLE À UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE PROTECTION TERRESTRE DU TERRITOIRE NATIONAL AVEC LE CONCOURS DES ARMÉES
Globalement, il ressort des travaux des rapporteurs que l’opération Sentinelle a été marquée en tout point par l’urgence : cette opération n’ayant pas de précédent, il a fallu, dans un seul et même temps ‒ qui plus est un temps de crise ‒, « inventer » à la fois un concept d’opération, une chaîne de soutien à l’engagement et à la vie des unités, un plan de déploiement, un schéma de commandement, une doctrine d’emploi, etc. Les armées ‒ particulièrement l’armée de terre ‒ ont relevé certes ce défi avec succès, et la réflexion doctrinale engagée en parallèle de la conduite de l’opération a été intense.
Mais, s’agissant de la protection du territoire national en milieu terrestre, les rapporteurs ont le sentiment ‒ partagé par beaucoup d’observateurs ‒ que les armées se situent toujours dans une phase de transition entre, d’une part, un modèle ancien et devenu assez « routinier » qu’était Vigipirate et, d’autre part, un nouveau modèle dont les contours sont esquissés, mais dont la teneur exacte reste à définir de façon suffisamment précise et consensuelle ‒ notamment entre la défense et l’intérieur ‒ pour que le nouveau modèle soit mis en place dans les conditions prévues, avec les effectifs prévus, et « entre dans les mœurs ». Cet exercice constitue en lui-même un défi pour les armées, mais aussi pour les forces de sécurité intérieure.
En effet, aux yeux des rapporteurs, la réflexion doctrinale qui est en train d’aboutir n’imprégnera pleinement les pratiques que lorsqu’elle aura fait l’objet d’un investissement politique complet, assis sur des choix politiques clairs et largement partagés ‒ comme il est de coutume dans les affaires de défense ‒, et « gravé dans le marbre » de la programmation militaire.
I. LA MISE EN œUVRE DE LA NOUVELLE DOCTRINE D’EMPLOI DES ARMÉES EN MILIEU TERRESTRE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL CONSTITUE ENCORE UN DÉFI
On pourrait dire de l’exercice de refonte doctrinale présenté par le rapport au Parlement qu’il pose à nos armées et à nos forces de sécurité intérieure un double défi, au moins autant pour ce qui n’y apparaît qu’« en creux » ‒ la gestion de l’information opérationnelle et la dimension interministérielle du dispositif de protection du territoire national ‒ que pour ce qui y apparaît « en relief » : un changement majeur de format et de mission pour nos armées, qui se traduit par la création d’une « posture de protection terrestre ».
A. LA DOCTRINE N’A QUE PEU ÉVOLUÉ SUR DEUX SUJETS POURTANT MAJEURS : LA GOUVERNANCE INTERMINISTÉRIELLE DU DISPOSITIF ET L’EXPLOITATION DE L’INFORMATION OPÉRATIONNELLE
Au cours de leurs travaux, les rapporteurs ont eu à plusieurs reprises le sentiment que les points de vue respectifs des ministères de la Défense et de l’Intérieur ne se conciliaient pas aisément notamment au début de l’exercice de refonte doctrinale de notre dispositif de protection du territoire national et, particulièrement, sur le contenu à donner à la posture de protection terrestre. Outre qu’ils ne facilitent pas la recherche des moyens d’une coopération ‒ voire d’une intégration ‒ interministérielle poussée, ces décalages de vues ont porté notamment sur le renseignement ‒ au sens large du terme, qui désigne en réalité la collecte et le traitement de toute information, y compris publique, ayant un intérêt pour la bonne marche des opérations.
1. Le recueil, le traitement, le partage et l’utilisation de l’information opérationnelle
Il ressort des travaux des rapporteurs que le renseignement doit encore faire l’objet d’un encadrement adapté aux impératifs d’efficacité opérationnelle des armées dans le cadre de la posture de protection terrestre, tout en restant compatible avec les exigences de protection de la vie privée des personnes résidant sur le territoire national. Le rapport au Parlement évoque peu ce domaine et évite même l’emploi du terme.
Cette réticence peut s’expliquer par le fait que le mot « renseignement » est souvent compris comme renvoyant seulement aux informations les plus sensibles. Or, dans la doctrine militaire, il désigne habituellement un ensemble d’informations, pour beaucoup publiques, dont une part importante constitue ce que l’on appelle :
‒ le « renseignement d’ambiance », c’est-à-dire un certain nombre d’informations très générales sur le contexte d’une mission ou d’une opération ;
‒ le « renseignement d’opportunité », c’est-à-dire des informations relatives à un événement particulier intéressant une unité pour l’accomplissement de sa mission.
a. L’utilisation d’informations opérationnelles pertinentes, dans les limites fixées par le cadre légal, constitue une condition d’efficacité des armées sur le territoire national
Pris dans un sens large, le renseignement est une composante aujourd’hui incontournable dans la planification et la conduite d’une opération militaire.
Le traitement de l’information utile aux opérations a d’ailleurs pour propre de fonctionner « à double sens » : les armées en opération ont besoin de renseignements fournis par des services spécialisés ou tout type de source ‒ au moins d’ambiance ou d’opportunité ‒ pour opérer, mais lorsqu’elles sont présentes sur un terrain, leurs hommes ‒ et, le cas échéant, leurs moyens techniques ‒ sont également en bonne position pour collecter des informations utiles.
Aussi, dans le cadre de la posture de protection terrestre, l’accès des militaires aux informations d’intérêt opérationnel constitue-t-il un enjeu majeur.
i. Le cloisonnement des informations, parfois au-delà de ce que prévoit la loi, constitue aujourd’hui un facteur limitatif de l’efficacité de l’opération Sentinelle
• L’accès des armées aux informations d’intérêt opérationnel apparaît freiné par des cloisonnements administratifs
Le général Jean-François Parlanti, directeur du centre interarmées d’études, de concepts et de doctrine a d’ailleurs souligné devant les rapporteurs, au titre de l’importance qu’il y a à « parler le même langage », que les échanges entre ministères de la Défense et de l’Intérieur sont parfois compliqués par des différences d’interprétation de certaines notions, telle celle de « renseignement ». En effet, le ministère de l’Intérieur ne conçoit cette notion que comme des informations recueillies à des fins judiciaires, et encline donc à refuser donc tout partage avec qui n’a pas droit à en connaître, alors que le ministère de la Défense demande simplement du « renseignement d’ambiance » ‒ qui vit dans la zone de déploiement des militaires ? Où se situent les éléments perturbateurs de tel ou tel quartier ?
Le gouverneur militaire de Paris a précisé que les difficultés liées au partage du renseignement entre les armées et les forces de sécurité intérieure ne se traduisent pas partout de la même manière. En effet, « dans les grands espaces, le renseignement est plus facile d’accès et ressemble à des cas de figure trouvés en OPEX, tandis que dans une ville comme Paris, il s’agit souvent d’informations relevant du renseignement judiciaire ». À titre d’exemple, le gouverneur militaire de Paris a considéré qu’il serait anormal qu’un capitaine soit tenu dans l’ignorance d’une manifestation se déroulant dans le quartier dans lequel opère sa compagnie.
Lors de leur déplacement au fort de Vincennes, il a été indiqué aux rapporteurs que la police ne transmet pas au centre d’opérations de Sentinelle à Paris-centre ses informations sur la menace antiterroriste à Paris. Or les contacts de terrain ne permettent pas toujours de pallier ce manque ; en effet, l’organisation de la police nationale est telle que les commissaires d’arrondissement ne sont compétents que pour l’ordre public, le terrorisme relevant d’un autre « tuyau d’orgue » dans l’organigramme de la préfecture de police de Paris. Les militaires ont donc exprimé aux rapporteurs leur besoin de synthèses faites par les services compétents, notamment la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).
D’ailleurs, Mme Claire Landais, directrice des affaires juridiques du ministère de la Défense, a dit ne pas voir d’obstacle juridique au partage de l’information (c’est-à-dire, au sens large, du renseignement) entre les ministères de l’Intérieur et de la Défense, dans la mesure où la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement a établi à l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure une « base légale satisfaisante pour l’échange d’information » permettant à tous les services compétents, qu’ils relèvent de l’intérieur ou de la défense, d’« échanger toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions ». En conséquence, si l’échange d’information ne se faisait pas, il ne faudrait pas l’imputer à un obstacle juridique.
• Le recueil d’informations sur le terrain par les personnels de la force Sentinelle est lui aussi compliqué
Il ressort des travaux des rapporteurs que les militaires sont nombreux à relever au ministère de l’Intérieur une grande réticence à l’idée que les militaires puissent recueillir du renseignement.
Pourtant, selon le général Jean-François Parlanti, les préfets ne semblent pas mécontents des informations que peuvent parfois leur fournir les officiers généraux de zone de défense et de sécurité grâce au déploiement de la force Sentinelle. D’ailleurs, le général Didier Brousse a fait valoir aux rapporteurs que « dans les faits, les policiers sont bien contents que les hommes de Sentinelle les renseignent. ». Le général Hervé Wattecamps, directeur des ressources humaines de l’armée de terre, a ajouté qu’« a minima, la transmission de renseignements d’opportunité au ministère de l’Intérieur est indispensable ».
Lors de leur déplacement auprès de l’état-major du groupement Paris-centre de la force Sentinelle, les rapporteurs ont pu constater que l’activité de collecte, de traitement et d’exploitation d’informations d’intérêt opérationnel était très limitée. Ainsi, au sein de cet état-major ‒ pourtant présenté comme constitué sur le modèle des postes de commandements des groupements tactiques interarmes déployés en OPEX ‒, une cellule, intitulée S2, assure la « collecte de l’information » ‒ ses personnels ont expliqué aux rapporteurs que l’« on ne dit pas “renseignement” sur le territoire national » ‒ par diverses voies : divers sites internet, les informations parfois fournies par la police ou les remontées du terrain. Deux personnels suffisent pour cette activité, qui est restreinte « du fait des limites légales ». En effet, sur le territoire national, les armées ne peuvent pas élaborer de documents de renseignement (des « fiches ») comme elles le font en OPEX.
La collecte d’informations d’intérêt opérationnel par les hommes de l’opération Sentinelle se heurterait aussi à des obstacles tant pratiques que juridiques. En effet, ils ne sont engagés que pour six semaines (bientôt huit), ce qui crée des ruptures fréquentes dans la connaissance du terrain par les hommes. Or aucun système de compilation, de classement, de traitement et d’exploitation de l’information ne permet de compenser les pertes d’information liées à ces relèves, car « tout relevé d’information qui n’a pas directement trait à la mission, à savoir la protection des sites, est interdit ». Aussi, « le soldat ne peut relever aucun nom, prendre aucune photographie, noter aucun numéro de plaque d’immatriculation, même si quelqu’un passe devant un site sensible à une fréquence suspecte ». Le général Hervé Wattecamps a cependant précisé que « depuis la réorganisation des états-majors à Paris, la force Sentinelle perd moins d’information, car il y a de véritables commandements et donc des passations formalisées de consignes ». Il n’en reste pas moins une perte considérable d’informations, qui nourrit un sentiment de frustration.
Chose difficilement explicable : selon les zones de déploiement, les pratiques varient d’un terrain à un autre. En effet, les rapporteurs ont pu s’entretenir à Vincennes avec des militaires qui avaient été engagés auparavant pour l’opération Sentinelle à Lyon, où il leur était interdit même de prendre une photographie ; à Paris, cela leur est permis, pour transmission à la police nationale. En tout état de cause, toute information doit être transmise à la police, puis son support doit être détruit. Le commandement du groupement Paris-centre de la force Sentinelle a souligné que ces règles, d’ailleurs variables d’un terrain à un autre, se fondent sur la pratique, mais pas sur des textes.
ii. Pourtant, la gestion de l’information d’intérêt opérationnel est au cœur des savoir-faire militaires, particulièrement dans un contexte de prévention d’actes terroristes
Le chef d’état-major de l’armée de terre a indiqué que le ministère de la Défense souhaite disposer de renseignement général, de nature opérationnelle, pour donner du sens à l’action (c’est-à-dire expliquer aux soldats le pourquoi de la mission), et d’intérêt local, tant pour garantir l’efficacité des missions conduites au titre de la posture de protection terrestre que pour assurer la Force Protection de nos soldats.
Comme l’a fait valoir le lieutenant-colonel Anne-Henry de Russé, commandant du groupement Sentinelle Paris-centre, opérer sans renseignement est très étranger aux pratiques habituelles des armées. En effet, « les armées travaillent d’habitude sur la base d’une analyse de la menace, or aujourd’hui, le partage de l’information est très décevant : c’est le “niveau zéro du renseignement”, ce qui est frustrant ».
Pourtant, comme l’a expliqué le général Arnaud Sainte-Claire Deville, les retours d’expérience de l’opération Banner en Irlande du Nord montrent que le partage de l’information entre la Défense et l’Intérieur a fait partie des principaux facteurs de succès de cette opération.
Notre commission, à l’occasion de nombreux rapports, a déjà mis en exergue le rôle du renseignement ‒ ou, en d’autres termes, d’informations d’intérêt opérationnel ‒ dans le succès d’une opération de nos armées. Aussi y a-t-il presque une forme de contradiction entre, d’une part, la volonté d’exploiter mieux les savoir-faire des militaires et leurs compétences spécifiques ‒ volonté affirmée par le rapport au Parlement précité sur les conditions d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population ‒ et, d’autre part, les pratiques actuelles de cloisonnement des informations entre les services du ministère de l’Intérieur et les armées.
Soulignons toutefois que comme l’a rappelé le général Didier Brousse, « l’armée de terre n’a jamais eu l’ambition de mettre en place une chaîne de renseignement sur le territoire national », car « c’est le travail du ministère de l’Intérieur ». Les armées font simplement valoir qu’« il faut que l’information circule, et ce dans les deux sens », notamment en cas de menace sur les soldats. Si le terme même de « renseignement » peut susciter des réserves, le général s’est dit tout à fait ouvert à ce que l’on lui préfère celui d’« information ».
b. Une clarification des conditions d’utilisation de l’information opérationnelle serait cohérente avec la volonté d’exploiter mieux les savoir-faire des armées qui sous-tend la nouvelle doctrine
Pour les rapporteurs, on peut estimer, sur le fond, que la collecte, le traitement et l’exploitation d’informations d’intérêt opérationnel sans lien avec des procédures judiciaires constitue une des conditions d’efficacité de l’engagement des armées sur le territoire national et, parfois aussi, une condition de sécurité pour les militaires déployés. Mais plus encore, la variété des pratiques d’une zone de déploiement à une autre traduit une certaine incertitude juridique qui mérite d’être dissipée. Assurément, les activités des armées en matière de renseignement doivent être régulées, mais ce doit être par des règles claires, explicites, et compréhensibles par les soldats. Le rapport au Parlement ne clarifie pourtant pas ces règles.
i. La nouvelle doctrine ne comprend pas de développements ambitieux s’agissant de la gestion de l’information opérationnelle dans l’emploi des armées sur le territoire national
Globalement, l’approche du rapport au Parlement est très prudente concernant l’exploitation d’informations d’intérêt opérationnel. Ainsi, le rapport indique que la posture de protection terrestre comprendra des missions de sécurité dont il précise qu’elles conduiront notamment les armées à « contribuer à la surveillance des objectifs ou activités susceptibles de constituer une menace » et à collecter des « informations d’ambiance sur le terrain ». Ces précisions peuvent être vues comme suggérant une exploitation d’informations d’intérêt opérationnel moins bridée qu’aujourd’hui, et ouvrant la voie à un partage plus efficace des « informations à fins opérationnelles » avec les forces de sécurité intérieure, voire à l’emploi de certaines capacités de renseignement des armées.
Mais dans le même temps, le terme même de « renseignement » est évité par les rédacteurs du rapport, et le sujet est assez peu approfondi.
ii. Une clarification des règles de gestion de l’information est souhaitable, dans le cadre général fixé par la loi et dans le souci d’optimiser l’action des armées
De l’avis des rapporteurs, si l’on doit engager les armées sur le territoire national, il faut le faire en leur donnant les moyens de leur mission, et particulièrement en leur laissant dans la mesure du possible utiliser ces moyens dans les conditions pour lesquelles ils ont été formés et entraînés. D’ailleurs, les armées pourraient mettre à la disposition des autorités civiles des moyens de renseignement précieux :
‒ avec 7 000 à 10 000 personnels sur le terrain, en garde statique ou en patrouille, la force Sentinelle constitue un « capteur » d’informations de grande ampleur. Un système permettant le recueil et l’exploitation de ce qu’observent les soldats ne pourrait être qu’utile ;
‒ les équipements des armées en matière de renseignement sont pour beaucoup plus sophistiqués, et pour l’essentiel disponibles en nombre plus grand, que ceux des forces de sécurité intérieure. On peut citer en exemple les drones, les jumelles de vision nocturne, etc. Aussi, les réquisitions préfectorales qui assignent aux armées des missions sur le territoire national pourraient-elles utilement, lorsque cela est nécessaire, prévoir d’employer ces matériels sur le territoire national. Le rapport précité du SGDSN recommande d’ailleurs d’« étudier dans un cadre interministériel les conditions d’emploi sous réquisition de capteurs de renseignement des armées sur le territoire national ».
Le chef d’état-major de l’armée de terre a estimé qu’en clarifiant ce qui relève du « renseignement judiciaire » et du « renseignement d’ambiance », les difficultés constatées pourraient être aplanies.
En tout état de cause, il n’est pas inimaginable que le silence relatif des textes de doctrine concernant le renseignement sur le territoire national ait conduit le commandement militaire, en tout ou partie du territoire, à adopter en la matière une position de prudence qui conduit à limiter au-delà de ce qu’impose la légalité les activités de renseignement des armées. Dans ce cas, une clarification des règles aurait comme avantages, en plus de celui de la clarté pour les soldats et leurs cadres, celui d’une plus grande marge de manœuvre même à législation constante.
2. L’articulation des armées avec les forces de sécurité intérieure
La question de la collecte, du traitement, du partage et de l’utilisation d’informations d’intérêt opérationnel n’est pas le seul sujet pour lequel les vues du ministère de l’Intérieur ne recoupent pas d’emblée complètement celles de celui de la Défense. En effet, aux yeux de la plupart des observateurs, les cultures respectives de la police et des armées sont fort éloignées, et cet éloignement est particulièrement visible pour ce qui concerne la planification et la conduite des opérations.
Or, dans un souci d’efficacité du dispositif de protection du territoire national en milieu terrestre, l’emploi des armées et des forces de sécurité intérieure sur le territoire national doit être cohérent et exploiter au mieux la complémentarité de ces deux catégories de forces. Pour cela, un certain degré de coordination, de coopération, voire d’intégration du pilotage de ces forces est nécessaire, au-delà de ce qu’évoque brièvement le rapport au Parlement, et ce à tous les niveaux :
‒ aux niveaux tactique et opératif, où la coordination entre les forces paraît reposer pour beaucoup sur des relations interpersonnelles ;
‒ au niveau stratégique, où les structures de coordination interministérielle sont encore peu développées.
a. Aux niveaux opératif et tactique, la coordination sur le terrain de forces complémentaires constitue un enjeu majeur pour l’efficacité du dispositif national de protection
i. La coordination des armées et des forces de sécurité intérieure sur le terrain est encore peu structurée
Le gouverneur militaire de Paris a d’ailleurs estimé que dans son ressort de compétence, qui concentre la majeure partie de la force Sentinelle, la coordination de la force Sentinelle avec la police « est bonne, même si c’est mal connu ». Cependant, cette coordination repose encore largement sur les relations entre les personnes davantage que sur des procédures précises et des équipements adaptés ; pour les rapporteurs, cela constitue une base fragile.
• La coordination des actions ne saurait dépendre trop largement des relations interpersonnelles
La coordination s’opère non seulement au niveau national, entre les ministères de la Défense et de l’Intérieur, mais aussi :
‒ au niveau régional (ou « opératif »), entre les préfets de zone de défense et de sécurité et les officiers généraux de zone de défense et de sécurité ;
‒ au niveau local (ou « tactique »), entre les capitaines commandant les unités élémentaires et les commissariats d’arrondissement ou de district.
Le commandant des forces terrestres a fait valoir que l’une des clés du succès de l’opération Banner en Irlande du nord tenait à « la colocalisation et la coopération des différents systèmes de commandement ». Dans cette optique, il serait souhaitable qu’une coopération étroite soit assurée entre les états-majors de la force Sentinelle et les commandements des forces de sécurité intérieure aux niveaux opératif et tactique et qu’à tout le moins, les deux chaînes de commandement disposent de moyens de communication adaptés. Or il apparaît que sur les deux plans, de nets progrès sont possibles.
• Les forces ont besoin de moyens techniques de communication et de commandement partagés
1./ Des progrès à faire dans l’interopérabilité des systèmes d’information et de communication des armées et des forces de sécurité intérieure
La fluidité des communications entre la police et les armées est d’autant plus importante dans le cadre de l’opération Sentinelle qu’à la différence du dispositif classique du plan Vigipirate, militaires et policiers ne sont plus constitués en patrouilles mixtes ; lorsqu’ils ont besoin d’un officier de police judiciaire, les militaires doivent donc pouvoir contacter aisément la police.
Or, selon le commandant des forces terrestres, les difficultés rencontrées dans l’interopérabilité des systèmes d’information et de communications (SIC) du ministère de la Défense avec ceux du ministère de l’Intérieur constituent « un point saillant de RETEX ». Le gouverneur militaire de Paris a précisé que les systèmes de télécommunication militaires ne sont pas utilisables à Paris pour diverses raisons techniques et que, pour les réseaux de la police, les fréquences radio ne sont pas les mêmes selon les arrondissements et départements, de sorte que « les moyens de communication des forces de sécurité intérieure sont rivés à des périmètres territoriaux fixes ».
Ce constat a été confirmé sur le terrain, au fort de Vincennes, où le lieutenant-colonel de Russé a estimé que « le gros point noir, ce sont les transmissions ». En effet, au début de l’opération Sentinelle, la police a mis à la disposition de l’armée de terre des postes ACROPOL, mais en nombre jugé insuffisant. De plus, selon l’état-major du groupement Paris-centre de la force Sentinelle, « ACROPOL sert à obtenir des informations de la police, pas à commander ». D’ailleurs, le centre d’opérations du groupement n’est pas relié directement et physiquement au système ACROPOL : un capitaine doit systématiquement assurer l’interface. Si le centre d’opérations dispose bien d’un « poste de commandement tactique » (PCTAC) déplaçable, celui-ci « n’a aucun moyen en matière de systèmes d’information et de communication ». Aussi, pour l’employer, « il faudrait utiliser les postes radios de l’armée de terre, ce qui est en test, mais encore faut-il disposer de fréquences adaptées ».
Cette organisation est appelée à évoluer avec le déploiement du système de transmission appelé DIPAD, dispositif militaire d’agrégation de fréquences dont 2 000 exemplaires ont été livrés au premier semestre 2016. Selon les explications de l’état-major du groupement Paris-centre de la force Sentinelle, il s’agit d’un dispositif téléphonique qui repose en partie sur les réseaux GSM, peut être connecté au réseau ACROPOL en basculant d’un réseau d’arrondissement à un autre, tout en étant compatible avec les réseaux militaires et doté d’une fonction de géoréférencement.
L’interopérabilité des systèmes d’information et de communication pourrait être accrue avec le développement d’un dispositif nouveau, testé à partir de l’été 2016, appelé Auxylium, interface légère de communication multi-usages pour le combattant débarqué et les forces de secours.
2./ Une meilleure articulation du commandement des différentes catégories de forces est possible (et souhaitable)
Dès lors que deux catégories de forces sont déployées sur le même territoire ‒ les armées et les forces de sécurité intérieure ‒, l’efficacité du dispositif de protection du territoire national suppose que leurs chaînes de commandement définissent ensemble les sites et le rythme des patrouilles de sorte qu’il n’y ait pas de « doublon » entre policiers et militaires.
Le général Bruno Le Ray a précisé que c’est justement « afin de faciliter au maximum la recherche d’interlocuteurs » que la force Sentinelle a calqué son zonage parisien sur celui de la police, qui repose sur la carte des arrondissements, regroupés en trois districts. En somme, aux yeux du gouverneur militaire de Paris, « la coordination physique des moyens se fait plutôt bien, modulo d’inévitables questions d’ego, la bénévolence des interlocuteurs étant variable ».
Le gouverneur militaire de Paris n’en observe pas moins que sur le terrain la coordination des forces, comme la transmission des informations d’intérêt opérationnel, ne tient aujourd’hui en grande partie qu’aux relations interpersonnelles : « tous les commissaires de bonne volonté devraient avoir le réflexe d’avertir leurs homologues militaires de la tenue d’une manifestation », d’autant plus que lors de manifestations, les militaires se doivent de se mettre en retrait pour éviter d’être mis en situation d’opérer le maintien de l’ordre.
Ce constat a été confirmé lors du déplacement des rapporteurs auprès du groupement Paris-centre de la force Sentinelle, à Vincennes. Les personnels de l’état-major de ce groupement leur ont en effet confirmé qu’« il n’y a aucune coordination au niveau de l’état-major tactique avec les forces de sécurité intérieure ». Ils ont souligné qu’à cet égard, l’articulation avec la police nationale, en l’état, ne peut pas donner pleine satisfaction. D’ailleurs, le chef de groupement Paris-centre de la force Sentinelle a indiqué qu’aucune procédure d’établissement de contact auprès des autorités de la police nationale n’est formalisée : « le chef de groupement n’a que les contacts qu’il réussit à se faire ».
Aux yeux des rapporteurs, les relations entre les personnes constituent une base bien fragile pour la coopération entre les forces, et ce d’autant que les contacts doivent être renouvelés à chaque relève de la force Sentinelle, toutes les six semaines jusqu’à présent et toutes les huit semaines à partir de l’été 2016.
ii. L’accent doit être mis sur la complémentarité des différentes catégories de forces déployées sur le terrain
Une meilleure coordination des forces, que pourraient permettre tant une meilleure coopération des chaînes de commandement que des systèmes d’information et de communication plus interopérables, peut permettre d’exploiter au mieux la complémentarité des armées et des forces de sécurité intérieure.
1./ Compétences complémentaires et non personnels supplétifs
L’ensemble des interlocuteurs des rapporteurs s’est prononcé en faveur d’un emploi des armées suivant une logique de complémentarité plutôt qu’en position de « supplétifs » des forces de sécurité intérieure. Ainsi, le général Hervé Wattecamps a constaté « une vraie fracture entre les armées et le monde de la sécurité intérieure », soulignant que pour lui, « il ne devrait pas y avoir de concurrence : toutes les forces sont avant tout au service des Français ». Le commandant des forces terrestres a souligné que l’objectif de l’armée de terre n’est assurément pas de remplacer les forces de sécurité intérieure : « le mot-clé, c’est “complémentarité” des forces ». Il a d’ailleurs précisé que « pour l’heure, le commandement des forces terrestres n’a pas de remontées du terrain qui indiqueraient que les soldats ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas les mêmes prérogatives que les policiers ».
Le général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale, a lui aussi soutenu que l’engagement des armées « ne peut être que complémentaire aux forces de sécurité intérieures » :
‒ complémentaire au regard des volumes engagés : rappelant qu’il s’agit de « 7 000 hommes portés éventuellement à 10 000, à mettre en perspective des 270 000 hommes des forces de sécurité intérieures », il s’est interrogé sur le point suivant : « faut-il dès lors modifier en profondeur le cadre juridique et l’organisation de gestion de crise de l’État ? » ;
‒ subsidiaire en matière de pouvoirs de police, car les militaires des armées n’ont pas les prérogatives administratives et judiciaires « indispensables pour exercer, dans la durée, une action efficace sur le terrain qui ne soit pas seulement défensive ».
Le DGGN a souligné que les termes de « complémentarité » et « subsidiarité » ne devaient pas être perçus comme péjoratifs ‒ subsidiaire ne renvoyant pas à « supplétif » ‒, mais plutôt que « chacun doit être centré sur sa mission dans une logique de coordination ».
2./ Une complémentarité des forces qui peut prendre des formes diverses
Le principe d’un emploi des armées exploitant la complémentarité de leurs savoir-faire avec ceux des forces de sécurité intérieure peut se traduire par plusieurs configurations tactiques très différentes sur le terrain. En effet, dans la mise en œuvre « classique » du plan Vigipirate, les deux forces constituaient des patrouilles mixtes, dans lesquelles les personnels avaient chacun des spécificités complémentaires :
‒ les membres des forces de sécurité intérieure avaient l’avantage de connaître le terrain et d’être investis de pouvoirs de police, et donc des prérogatives requises pour pratiquer des contrôles et des fouilles ;
‒ la présence de militaires en armes (même non chargées) avait certainement un aspect rassurant pour la population et dissuasif pour les fauteurs de troubles.
À l’inverse, c’est également au nom de la complémentarité des différentes catégories de forces que le système des patrouilles mixtes n’a pas été repris pour l’opération Sentinelle. Ainsi, le gouverneur militaire de Paris a expliqué avoir œuvré au récent renoncement au système de patrouilles mixtes aux motifs que :
‒ « leur format place vraiment les militaires en position de supplétifs » ;
‒ les militaires sont équipés de moyens ACROPOL permettant de faire appel si nécessaire rapidement à un OPJ ;
‒ « les militaires disposent déjà de plusieurs niveaux d’intervention lorsqu’ils sont autonomes », suivant une gradation qu’ils maîtrisent bien : avant tout, leur présence et leur posture ont en elles-mêmes un effet dissuasif. Si une personne est vue en train de commettre un acte délictueux, ne répond pas aux injonctions (notamment lorsqu’il semble s’agir de repérages), ou s’en prend aux soldats, ceux-ci savent assurer un « gel de situation » avec des techniques de combat au « corps à corps » ; tel a été le cas, par exemple, le 8 mars 2016, quand les hommes de la force Sentinelle ont neutralisé un véhicule dont le conducteur était passé plusieurs fois devant eux avec une attitude menaçante. En cas de contact, les soldats maîtrisent l’usage du bâton télescopique ou de la bombe lacrymogène ; et en dernier recours, ils sont dotés de leur FAMAS.
Le directeur du CICDE a expliqué aux rapporteurs que pour mettre en œuvre leurs savoir-faire, complémentaires de ceux de la police et de la gendarmerie, « les armées ont besoin d’autonomie d’action, ce qui ne signifie pas l’autonomie tout court » car les armées n’interviennent qu’en appui des forces de sécurité intérieure, primo-intervenantes. Cette coordination suppose un conséquent effort de planification, qui pose moins de difficultés aux militaires ‒ pour le général Jean-François Parlanti, « pour eux, c’est rôdé » ‒ que pour les policiers et les gendarmes.
Le directeur général de la gendarmerie nationale a lui aussi admis que les patrouilles mixtes ne constituaient pas le seul mode d’action susceptible d’exploiter au mieux la complémentarité des armées et des forces de sécurité intérieure. Il a cité pour les armées trois types de missions :
‒ des « missions autonomes », qui devraient consister à ses yeux en des « missions de protection ou d’escorte » pour l’essentiel, à l’image de ce que font les gendarmes au Palais de justice ou devant certaines ambassades. Pour le général Denis Favier, ces missions n’exigent pas de savoir-faire spécifique que les armées ne maîtriseraient déjà, et « n’ont rien de dévalorisant ». Leur attribution aux armées permettrait de redéployer des unités de force mobile « vers des zones où elles sont utiles au regard de leurs compétences propres », alors qu’« aujourd’hui, des escadrons de gendarmerie mobile sont immobilisés par des gardes statiques et ne peuvent pas intervenir : tel était déjà le cas le soir de l’attaque du Bataclan, alors même que des compagnies d’infanterie étaient stationnées à Paris » ;
‒ des « missions conjointes », à l’image de ce qui est fait en Guyane. De tels modes d’action seraient appropriés pour des missions de contrôle de zone ou de contrôle des flux (autoroutiers ou ferroviaires). En tout état de cause, pour le général Denis Favier, ces missions dites dynamiques ne sont réellement efficaces dans la durée que si les patrouilles comprennent au moins un OPJ ou un APJ. Il pourrait être envisagé, dans certains milieux spécifiques (par exemple en zone de montagne) de travailler sur le même schéma de mission conjointe afin de renforcer un contrôle de zone, et de « durcir » le dispositif de protection aux frontières ;
‒ des missions « à exclure » pour les armées : le maintien de l’ordre et la police judiciaire. Le DGGN a évoqué l’assaut de Saint-Denis où des unités de l’armée de terre ont été engagées en réalité « dans une mission de maintien de l’ordre », dont il fait valoir que « c’est le travail des gendarmes mobiles ».
Pour nombre de militaires interrogés par les rapporteurs, les armées disposent de savoir-faire leur permettant d’assurer seules des missions de plus haute intensité que les « missions de protection ou d’escorte » évoquées. D’ailleurs, les rapporteurs observent que leurs interlocuteurs ont davantage évoqué devant eux les missions de protection et de dissuasion que les opérations de réponse à la menace ‒ c’est-à-dire, le cas échéant, d’intervention. Or, comme l’a souligné le commandant des forces terrestres, l’articulation entre l’armée de terre et les forces de sécurité intérieure devait être analysée sur plusieurs plans : la protection, la dissuasion, mais aussi la réaction face à la menace. Le général Arnaud Sainte-Claire Deville a ajouté que le commandement des forces terrestres « a fait un peu de benchmark international » en la matière, ce qui lui a permis de « militariser » différents éléments de concepts et de doctrine, notamment sur la notion de « primo-intervenant ». Il en ressort que l’on pourrait exploiter mieux certaines capacités de l’armée de terre, telles que :
‒ l’assaut urbain : « toutes les unités de l’armée de terre n’y sont pas prêtes, mais nos unités d’infanterie le sont » ;
‒ la cavalerie, qui a de nombreux véhicules et des réseaux de transmissions performants, « est bien adaptée au contrôle de zone ».
Revenant plus précisément sur l’articulation de la force Sentinelle avec les forces de sécurité intérieure la nuit du 13 novembre 2015, le général a indiqué qu’au Bataclan, une équipe était en place à 22 heures, soit quelques minutes après le début de l’attaque mais que « pourtant, l’assaut a attendu plus de deux heures ». Pour lui, « on se demande donc si la nature de l’ennemi appelle encore l’usage de la palette de techniques habituelles (négociation, etc.) », ce qui revient à se poser la question de savoir « qui doit être le primo-intervenant ». Au Bataclan, la coopération de Sentinelle avec les forces de sécurité intérieure a été « limitée » : le primo intervenant a été un commissaire de la BAC, l’équipe Sentinelle s’est mise en position, et a coopéré avec le RAID une fois celui-ci déployé. Les rapporteurs notent toutefois que l’appréciation du rôle de la force Sentinelle dans le 13 novembre au soir n’est pas négligeable. En effet, dans un article pourtant critique sur l’opération Sentinelle publié par l’Institut français des relations internationales (IFRI) (29), M. Élie Tenenbaum reconnaît que ce groupe de soldats en faction devant un site à proximité de la rue de Charonne, dès qu’il a entendu la fusillade, s’est rendu sur les lieux « sans être réquisitionné par l’autorité civile » et, « en coordination avec les policiers, a pu contribuer à établir un périmètre de sécurité » ce qui « a eu une forte impression sur la population et a rassuré les sauveteurs, sensibilisés au risque de sur-attentat, qui se seraient écriés : “C’est bon, l’armée nous protège, on peut faire notre travail !” ».
Mais pour le commandant des forces terrestres, « il ressort de l’expérience israélienne que le “principe de l’incendie” doit guider : compte tenu de la menace, que le premier sur place intervienne, même s’il n’est pas le plus spécialisé pour cela » ‒ dans certaines limites toutefois : « on ne demandera pas à une unité de transmissions d’entrer au Bataclan pour faire du combat urbain ». Pour les rapporteurs, si les forces armées ne sont pas mentionnées dans le nouveau « schéma national d’intervention » publié en avril 2016 par le ministère de l’Intérieur pour répartir les rôles des différentes forces via un commandement des opérations d’intervention spécialisée, on ne saurait exclure, en cas d’urgence absolue et d’indisponibilité dans des délais appropriés de moyens disponibles des forces de sécurité intérieure, l’intervention d’unités de la force opérationnelle terrestre, voire des forces spéciales. Tel serait par exemple le cas si une attaque terroriste survenait à proximité du quartier du 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine de Bayonne, spécialement formé aux missions de contre-terrorisme et de libération d’otages, alors que les forces du ministère de l’Intérieur les plus proches sont implantées à Bordeaux.
En tout état de cause, les rapporteurs constatent un certain consensus des responsables civils et militaires pour considérer que les armées ont des compétences complémentaires de celles des forces de sécurité intérieure, et qu’à ce titre, elles peuvent être chargées de missions conduites de façon autonome.
b. Au niveau stratégique, une politique plus ambitieuse de coordination de la planification et de la conduite des opérations de sécurité intérieure est nécessaire
Si la coordination des forces est nécessaire au niveau tactique et à l’échelon opératif ‒ au sein des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité ‒, elle l’est aussi au niveau central. Au terme de leurs travaux, les rapporteurs ont le sentiment que la gestion des crises survenant sur le sol national gagnerait à s’appuyer sur un dispositif interministériel de conduite des opérations plus robuste qu’aujourd’hui, et sur des plans établis à l’avance pour tout type de crise, y compris sécuritaire. Établir une forme de centre interministériel de planification et de conduite des opérations de gestion de crise parachèverait un mouvement de renforcement du pilotage interministériel des crises entamé dans les années 2000, mais encore inabouti à ce jour.
i. Les dispositifs actuels de planification et de conduite des opérations restent cloisonnés
Si, depuis le Livre blanc de 2008 sur la défense et la sécurité nationale, la dimension interministérielle de la gestion des crises a progressé, l’expérience des attentats de 2015 montre que toutes les conséquences n’en avaient pas été tirées en matière de planification de l’action de l’État, et que l’organisation de celle-ci présente encore des cloisonnements.
• Un mouvement de structuration d’instances interministérielles de gestion des crises initié par le Livre blanc de 2008
Le Livre blanc de 2008 sur la défense et la sécurité nationale avait déjà souligné le besoin d’une coordination interministérielle des opérations de gestion de crise au niveau central. Il indiquait ainsi que « le dispositif de sécurité intérieure et de sécurité civile doit se préparer aux formes d’agression ou de crise qui peuvent toucher gravement le territoire national » et qu’« en conséquence, les moyens civils et les moyens militaires développeront de nouvelles formes de coopération ». La stratégie de sécurité nationale que définissait ce Livre blanc établissait ainsi « les fondements d’une doctrine, s’appliquant à toutes ses composantes, organisant la coopération avant, pendant et après l’événement ».
Outre les mesures d’organisation que cela impliquait, cette stratégie devait conduire « à la mise en place de procédures connues et appliquées à tous les niveaux, testées par des exercices interministériels ». L’objectif était expressément « une progression qualitative majeure » de la « planification de crise » et de « l’organisation des pouvoirs publics en temps de crise ».
Le Livre blanc de 2013 a réaffirmé cette ambition. Il constate que « sous l’impulsion du précédent Livre blanc, la capacité de l’État à répondre efficacement aux situations de crise majeure a progressé de façon substantielle », citant notamment le dispositif de cellule interministérielle de crise (CIC) qui « permet au Premier ministre, en liaison avec le Président de la République, d’assurer la direction politique et stratégique de l’action gouvernementale » dont la conduite opérationnelle est placée sous la responsabilité d’un ministre désigné à cet effet ‒ en principe, pour une crise sur le territoire national, il s’agit du ministre de l’Intérieur. À ce titre, c’est au ministère de l’Intérieur, place Beauvau, qu’est installée la cellule interministérielle de crise.
• Un mouvement de structuration d’instances interministérielles de gestion des crises encore inabouti à l’échelon opérationnel
L’intérêt d’une coopération interministérielle plus poussée et plus structurée pour la gestion des crises majeures est identifié depuis longtemps déjà. Toutefois, il n’a abouti à la mise en place de structures interministérielles robustes, au niveau national que dans le champ de la direction politique et stratégique des crises ‒ mais pas dans celui de la conduite des opérations.
Le lancement de l’opération Sentinelle en témoigne : faute de planification interministérielle « à froid » d’un tel déploiement, pourtant prévu par les contrats opérationnels depuis 2008, l’opération a été mise en œuvre dans l’urgence, sans guère d’autre préparation que l’expérience du plan Vigipirate, et demeure pilotée d’une façon peu coordonnée. Pour les rapporteurs, une large partie des insatisfactions que fait naître Sentinelle ‒ excès de gardes statiques, réquisitions préfectorales exprimées en effectifs plutôt qu’en termes d’effets à obtenir, etc. ‒peut être vue comme trouvant sa source dans ce défaut de planification interministérielle « à froid ».
1./ Des structures interministérielles de gestion des crises majeures existent pour la direction politique et stratégique des opérations
En application des orientations fixées par le Livre blanc de 2008, une circulaire du Premier ministre en date du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures a fixé les principes de gestion de telles crises, et précisé les modalités de fonctionnement de la cellule interministérielle de crise (CIC).
Comme l’indique cette circulaire, « la direction politique et stratégique des crises majeures est assurée par le Premier ministre en liaison avec le Président de la République ». La CIC est activée en cas de crise ‒ aussi « en amont » que possible ‒ sur la décision du Premier ministre ; elle réunit alors « l’ensemble des ministres concernés », et le Premier ministre peut choisir de « confier la conduite opérationnelle de la crise » à un ministre en particulier, la circulaire rappelant qu’il s’agit « en principe » du ministre de l’Intérieur pour les crises survenant sur le territoire national, et du ministre des Affaires étrangères pour les crises extérieures.
L’encadré ci-après présente les principes de fonctionnement de la cellule interministérielle de crise, dont on retiendra notamment les traits suivants :
‒ quoiqu’installée place Beauvau, la CIC est un organe véritablement interministériel, dont la direction revient de droit au Premier ministre et dont le secrétariat est assuré par le SGDSN ;
‒ la cellule interministérielle de crise a pour champ de compétence la direction politique et stratégique de la crise, et non la mise en œuvre opérationnelle des décisions stratégiques que prennent les ministres en son sein ;
‒ la CIC est activée en tant que de besoin, mais n’est pas permanente.
Organisation et fonctionnement de la cellule interministérielle de crise
L’organisation du Gouvernement pour faire face à une crise majeure repose sur la capacité de l’État à mettre en commun ses ressources en matière de recherche et d’analyse de l’information, d’anticipation, de décision et de communication, afin de permettre au Premier ministre, en liaison avec le président de la République, d’exercer pleinement sa responsabilité de direction de crise.
Le présent chapitre fixe les principes de cette organisation et décrit le cadre dans lequel les ministères doivent se placer pour assurer le fonctionnement de la CIC.
1/ La répartition des rôles dévolus aux différentes autorités gouvernementales au sein de la CIC
Le Premier ministre, en liaison avec le président de la République, fixe la stratégie générale de réponse de l’État en définissant :
– l’objectif à atteindre en sortie de crise ;
– les impératifs politiques, les priorités et les contraintes majeures ;
– la stratégie de relations internationales ;
– la stratégie de communication gouvernementale.
Dans ce cadre, le ministre chargé de la conduite opérationnelle, en s’appuyant sur l’ensemble des ministères représentés en CIC, assure pour le compte du Premier ministre :
– la centralisation de toutes les informations en relation avec la crise ;
– l’analyse de ces informations ;
– la conception des scénarios d’anticipation ;
– la préparation des décisions ;
– la coordination interministérielle dans la mise en œuvre des décisions gouvernementales.
À ce titre, il organise les travaux de la CIC pour apporter au Premier ministre :
– des points de situation (événements, bilan humain et matériel, moyens engagés, couverture médiatique, état de l’opinion, etc.) ;
– des évaluations (menace immédiate, évolution des risques, bilan à terme, sur le territoire national et concernant les ressortissants français à l’étranger).
Il lui propose des décisions (activation des plans gouvernementaux, décision de mise en œuvre de capacités spécifiques, prise d’actes juridiques particuliers, etc.) et fournit des éléments d’anticipation et des propositions de choix stratégiques.
Tous les ministres concernés par la crise participent à la CIC afin d’y apporter les compétences de leur département ministériel, de contribuer au recueil et à l’analyse de l’information, ainsi qu’à l’élaboration des propositions de décision qui seront soumises au Premier ministre. Leur participation à la CIC garantit une réponse coordonnée de l’État dans chacun des champs de compétences ministériels concernés. Le CEMA assiste à la CIC ou se fait représenter, au sein de la représentation du ministère de la Défense.
Le ministre chargé du secteur principalement affecté par la crise a un rôle essentiel au sein de la CIC. Il la fait bénéficier de sa connaissance du secteur, de ses liaisons avec les principaux acteurs relevant de son domaine de compétence et de son expertise.
2/ La direction de crise et la CIC
La CIC permet au Premier ministre de définir des axes de conduite de crise par la mise en commun des ressources des différents ministères. Elle s’appuie sur les différents centres opérationnels ministériels et interministériels qu’elle met en réseau et qui l’alimentent en information.
Le ministre désigné pour assurer la conduite opérationnelle de la crise et la direction de la CIC est garant du respect des règles d’organisation et de fonctionnement fixées par la présente circulaire.
2.1. La direction de crise
La direction de crise, dans sa dimension politique et stratégique, est assurée par le Premier ministre qui s’appuie sur le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, sur le service d’information du gouvernement, sur le secrétariat général des affaires européennes et sur le secrétariat général de la mer.
Le Premier ministre détermine les grandes lignes d’action du travail de la CIC pour la préparation des choix politiques et stratégiques de direction de crise et de communication de l’État. Il est en contact avec les structures homologues des États étrangers concernés pour préparer les décisions de nature stratégique ou politique. Il définit la stratégie de sortie de crise.
Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale assure le secrétariat des réunions de crise, formalise les décisions qui y sont prises et les notifie à la CIC. Dès la mise en œuvre de la CIC, le SGDSN met en place une fonction de retour d’expérience, permettant d’améliorer la qualité de la réponse gouvernementale.
2.2. La CIC
La CIC est dirigée par le ministre désigné par le Premier ministre pour assurer la conduite opérationnelle de la crise.
Le principe de fonctionnement de la CIC repose sur la collégialité interministérielle, fondée sur la participation active de tous les ministères concernés par la crise et, en tant que de besoin, de certains experts ou opérateurs, aux trois fonctions qui la structurent :
– la fonction « situation » ;
– la fonction « communication » ;
– la fonction « décision ».
Source : circulaire du Premier ministre en date du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures.
On notera qu’en application des mêmes orientations du Livre blanc de 2008, la loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014 a modifié l’intitulé du Conseil de défense, qui est désormais appelé à l’article L. 1122-1 du code de la défense « Conseil de défense et de sécurité nationale ». Le décret n° 2009-1657 du 24 décembre 2009 en a précisé les attributions à l’article R. 1122-1 du même code, pour les élargir à la définition des orientations en matière de « planification des réponses aux crises majeures, de renseignement, de sécurité économique et énergétique, [et] de programmation de sécurité intérieure concourant à la sécurité nationale et de lutte contre le terrorisme ». Plus encore que pour le cas de la cellule interministérielle de crise, il s’agit là d’une instance par nature interministérielle, mais agissant uniquement dans le champ de la direction politique et stratégique de la gestion des crises, et non dans la direction opérationnelle.
2./ Les événements de 2015 ont montré que la planification et la conduite des opérations de gestion de crise restent largement cloisonnées entre ministères
En premier lieu, l’expérience de 2015 a montré des lacunes en matière de capacités interministérielles de conduite des opérations : il n’existe pas de centre d’opérations interministériel.
Dans les instances de planification et de conduite des opérations interministérielles de gestion de crise, on observe une sorte de curieux hiatus entre les différents niveaux territoriaux de commandement :
‒ au niveau opératif, les zones de défense et de sécurité ont à leur tête un préfet, dont la compétence s’étend sur l’ensemble des services de l’État dans son ressort, et les états-majors de zone de défense et de sécurité ont officiellement un caractère interministériel ;
‒ au niveau stratégique, en revanche, il n’existe pas de structure interministérielle robuste de direction des opérations de gestion de crise.
En effet, les moyens du ministère de la Défense engagés dans une opération sont pilotés directement par le centre de planification et de conduite des opérations (CPCO) de l’état-major des armées, qui n’a pas pour vocation de planifier et de conduire les opérations d’autres forces. Pour les opérations conduites sur le territoire national, il a autorité sur une chaîne de commandement spécifique : l’OTIAD.
S’agissant en revanche du ministère de l’Intérieur, il ne semble pas qu’il existe une structure de planification et de conduite des opérations aussi robuste. En témoigne notamment le fait que le 7 janvier 2015, lors des premiers attentats de Paris, le ministre de l’Intérieur a dû improviser un succédané de centre d’opérations dans le « salon du fumoir » de l’hôtel Beauvau. Ainsi, il a réuni autour de lui pour la durée des opérations les responsables des forces de sécurité intérieure, des services de renseignement, ainsi que des magistrats, des personnels de liaison d’autres ministères et d’autres personnes qualifiées.
Depuis les attentats de 2015, des instances de dialogue entre les ministères de l’Intérieur et de la Défense ont été mises sur pied. Outre les réunions de cadrage tenues entre les cabinets des deux ministres et diverses réunions bilatérales entre états-majors et directions concernées, il s’agit principalement d’une « cellule de coordination Intérieur-Défense » (C2ID). Cette cellule a été créée à la suite des attentats du 13 novembre pour, selon explications du ministère de la Défense, « disposer d’une instance de pilotage stratégique et garantir l’anticipation et la cohérence globale de l’engagement des forces de sécurité intérieure et des armées » ; elle est fonctionnelle depuis janvier 2016. Le fait qu’il ait fallu un an après le lancement de l’opération Sentinelle pour qu’une telle structure soit mise en place atteste du retard pris par les administrations centrales pour donner des structures ‒ en l’espèce très légères ‒ à la gestion interministérielle des crises.
En second lieu, le déploiement de l’opération Sentinelle a montré les limites de la planification interministérielle de crise telle qu’elle a été organisée jusqu’à présent.
En effet, alors que l’opération Sentinelle correspondait, lors de son lancement, à une hypothèse d’engagement expressément prévue par le Livre blanc de 2008 ‒ qui soulignait en outre les risques d’attaques terroristes ‒ ainsi que par le contrat opérationnel des armées, une telle opération ne semble pas avoir fait l’objet d’une planification très poussée.
C’est ce que le chef d’état-major de l’armée de terre a d’ailleurs confirmé aux rapporteurs : à la question de savoir si des travaux de planification « à froid » avaient été entrepris, et si les modalités de déploiement d’une force de 10 000 hommes avaient été discutées en amont avec les préfets, le général Jean-Pierre Bosser a répondu qu’« en janvier 2015, non, ou peu ».
À ses yeux, « c’est assurément cela qui explique le dispositif qui a été adopté dans l’urgence et qu’il a fallu l’adapter ensuite », par exemple avec la structuration du dispositif de commandement de la force à Paris autour de trois états-majors tactiques, « sans lequel nous n’aurions pas pu avoir la réactivité que nous avons eue » la nuit du 13 novembre 2015. Selon les précisions du gouverneur militaire de Paris, c’est d’ailleurs l’ampleur de l’engagement décidé par le président de la République qui a conduit le chef d’état-major des armées à ordonner l’engagement d’unités placées en alerte au titre de l’échelon national d’urgence (ex-dispositif Guépard), même si le territoire national n’est pas leur terrain d’engagement de référence.
De plus, le général Bruno Le Ray a expliqué que, dans ce contexte, le « positionnement physique de la force n’avait pas été anticipé ». C’est pourquoi des travaux ont été conduits en urgence avec la préfecture de police pour arrêter les zones de déploiement des forces. C’est le plan Vigipirate qui a servi de base : les effectifs ont été renforcés pour les sites déjà protégés, tels les gares – puis « le dialogue avec la préfecture de police a permis, en quelques heures, d’identifier les nouveaux sites, concernant notamment la communauté juive ». La préfecture de police avait d’ailleurs identifié les sites à protéger en lien avec les responsables de cette communauté. Ainsi, 305 sites israélites ont notamment été identifiés, en sus des 20 sites correspondant au déploiement « historique » du plan Vigipirate (sites touristiques, gares…). À la suite des attentats du 13 novembre, la même procédure a été suivie.
ii. Un dispositif permanent interministériel de planification « à froid » et de conduite des opérations pour la gestion des crises serait utile
La refonte de la doctrine d’emploi des armées sur le territoire national, dont le rapport au Parlement précité a présenté les conclusions, constituait une occasion de parachever le mouvement de constitutions de structures interministérielles de gestion de crise, en mettant sur pied un centre d’opérations interministériel.
M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, a fait observer aux rapporteurs que fixer le détail des réquisitions adressées par les préfets aux armées suppose d’opérer une synthèse des besoins exprimés et des moyens disponibles, sachant qu’« il y a un risque que deux logiques parallèles ne se rencontrent jamais » :
‒ celle des militaires, « qui sont soucieux de conserver les leviers de planification des moyens » ;
‒ celle des autorités civiles, notamment préfectorales, « qui définissent la mission dans la réquisition ».
Pour le SGDSN, un organe de synthèse et d’arbitrage est donc indispensable. Le Conseil de défense n’a pas à tenir ce rôle au quotidien, ne serait-ce que parce qu’« il ne se réunit pas tous les jours » : le dispositif manque donc « d’instances d’arbitrage qui réconcilient les positions, sur la base d’appréciations et d’audits de sécurité qui tiennent compte aussi de facteurs “politiques”, comme les demandes des élus locaux ou l’impression de telle ou telle communauté d’être particulièrement menacée ».
Les rapporteurs notent aussi que le besoin d’intégration interministérielle dans la conduite des opérations est relevé par plusieurs observateurs avertis. Ainsi, la publication précitée de l’IFRI a recommandé, pour « repenser en profondeur les équilibres du continuum sécurité-défense », de créer « un nouveau commandement intégré » des armées et des forces de sécurité intérieure pour leurs opérations sur le territoire national, à l’image de ce qui est fait pour l’opération Harpie.
Or le rapport au Parlement ne présente pas de mesures nouvelles en ce sens, à même de faciliter coopération interministérielle et l’interopérabilité des forces dans les opérations de protection du territoire national. Aux yeux de certains observateurs indépendants, si l’intérieur et la défense ont pu s’accorder sur le texte du rapport, c’est peut-être au prix d’une insuffisance concernant la coordination de la planification et de la conduite des missions entre les armées et les forces de sécurité intérieure. Pourtant, les retours d’expérience des attentats du 13 novembre et de l’assaut de Saint-Denis pourraient indiquer des marges de progrès, et la coordination est nettement moins poussée en métropole que par exemple en Guyane, où les centres d’opération communs mis en place entre la gendarmerie et la force Harpie donnent pleine satisfaction à l’ensemble des responsables interrogés par les rapporteurs.
On pourrait nettement aller plus loin dans la coordination et l’interopérabilité entre les armées et les forces de sécurité intérieure, en complétant les structures interministérielles actuelles de gestion de crise, qui n’interviennent qu’au niveau de la direction politique et stratégique de la crise, par un centre d’opérations interministériel, structure de planification et de conduite des opérations interministérielle de gestion de crise, dont le cœur pourrait être constitué, dans un premier temps, entre les ministères de la Défense et de l’Intérieur.
Un tel centre d’opérations pourrait utilement :
‒ a minima, travailler à la répartition des rôles entre les armées et les forces de sécurité intérieure pour différents scénarios de crise, c’est-à-dire mener des travaux de planification « à froid » des opérations intérieures ;
‒ a maxima, un tel centre d’opérations pourrait assurer la planification « à chaud » voire la conduite d’opérations, en y associant d’autres acteurs, comme le ministère de la Santé, voire celui des Transports, et devenir ainsi un véritable centre de crise interministérielle pour le territoire national, à l’image du centre de gestion de crise belge.
Un tel centre ne constituerait pas un doublon du CPCO de l’état-major des armées, dès lors qu’il n’aurait pas vocation à intervenir dans les OPEX ou dans les plans de défense strictement militaires. Il gagnerait en outre à disposer de moyens de transmission et d’interconnexion avec le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), implanté à Asnières, qui dispose des capacités nécessaires pour conduire des opérations de sécurité civile.
Sa vocation interministérielle justifierait sa direction par un membre du corps préfectoral, et un rattachement soit aux services du Premier ministre (par exemple au SGDSN), soit aux services du ministère de l’Intérieur serait cohérent avec son champ de compétence, orienté prioritairement sur le territoire national.
Si ce centre était placé au ministère de l’Intérieur, sa création permettrait aussi de combler les lacunes de ce ministère en matière de capacités de conduite des opérations. D’ailleurs, tirant les leçons du pilotage de la recherche des frères Kouachi au « salon du fumoir » de la place Beauvau, le directeur général de la gendarmerie nationale a souligné que le ministère de l’Intérieur devait tirer bénéfice du savoir-faire du ministère de la Défense en la matière, notamment pour « développer ses capacités de planification et de conduite des opérations ». Selon le général Denis Favier, « le ministère de l’Intérieur a besoin de développer ses outils de gestion de crise ; en parallèle de la CIC, l’étude d’une salle de crise, d’une “war room”, qui intègre toutes les forces de sécurité intérieures est nécessaire ». Pour lui, « c’est, de manière empirique, ce qui avait été mis en œuvre à l’occasion des événements récents, et qu’il reste cependant à formaliser » ; il précise que « bien entendu, dans la situation actuelle, les armées y auraient leur place ».
Placé au sein des services du ministère de l’Intérieur, comme l’est la cellule interministérielle de crise, un centre d’opérations interministériel viendrait compléter harmonieusement le dispositif de gestion des crises majeures au niveau stratégique, qui serait ainsi constitué par :
‒ un organe politique : la cellule interministérielle de crise, activée en tant que de besoin ;
‒ un organe opérationnel : le centre d’opérations interministériel, qui serait permanent dès lors qu’il serait chargé non seulement de la conduite des opérations, mais aussi de leur planification en amont.
B. LA MANœUVRE EN COURS PRÉSENTE PLUSIEURS DÉFIS
Le rapport au Parlement précité pose les fondements d’une doctrine d’emploi des armées sur le territoire national en milieu terrestre visant à dépasser la « logique Vigipirate » et pour la mise en œuvre de laquelle l’actualisation de la loi de programmation militaire a déjà pourvu à de renforts d’effectifs substantiels ‒ on parle couramment à ce propos de « remontée en puissance ». Il s’agit ainsi d’une double manœuvre qui n’a rien d’évident : l’accroissement rapide et substantiel des effectifs sans perte de qualité professionnelle suppose un complet retournement de la politique de déflation des effectifs qui présidait depuis 2009, tandis que le changement de posture de la force suppose de rompre avec des habitudes désormais bien ancrées. Il y a donc là un double défi technique ; le suivi de cette double manœuvre dans les mois à venir permettra de vérifier si la tendance encourageante qu’indiquent les premiers résultats est confirmée.
Les rapporteurs ont également le sentiment que le dispositif de protection du territoire national proposé par le rapport au Parlement pose un défi d’un autre ordre, plus politique : que la doctrine insiste sur une gestion souple du format du dispositif de protection du territoire national est une chose ; que les autorités politiques prennent la responsabilité d’utiliser ces marges de souplesse non seulement à la hausse ‒ pour accroître le format des forces déployées ‒, mais également à la baisse en est une autre.
1. Deux principaux défis techniques : réussir la manœuvre du recrutement et privilégier les modes d’action véritablement militaires
Réussir, d’une part, à mettre en œuvre l’ambitieux plan de « remontée en puissance » dans les délais prévus et sans compromis avec la qualité des recrues ‒ ou, à tout le moins, leur fiabilité ‒ et, d’autre part, à faire accepter à l’ensemble des acteurs de la protection du territoire national un changement de posture aussi clair que ce que prévoit le rapport au Parlement constitue un doublé défi sérieux.
a. Réussir la manœuvre des ressources humaines
Le général Hervé Wattecamps, directeur des ressources humaines de l’armée de terre (DRHAT), a souligné le défi que représentent l’organisation et la conduite de la « remontée en puissance » de la force opérationnelle terrestre, dont la loi actualisant la programmation militaire a prévu que ses effectifs soient portés de 66 000 à 77 000 hommes d’ici la fin de l’année 2016, soit mois de 18 mois après la promulgation de cette loi. En effet, ce « surge » est indispensable pour « redonner, au plus vite, à l’armée de terre l’oxygène nécessaire à la préparation et à la conduite de ses missions ».
i. La « remontée en puissance » des forces pour la protection du territoire national constitue une manœuvre d’une ambition inédite
Ambitieuse, la manœuvre l’est autant du point de vue quantitatif, du fait de l’importance des effectifs à recruter, mais aussi du point de vue qualitatif : les armées professionnelles ne peuvent pas « recruter pour recruter », il leur appartient de veiller à la qualité des recrues et, dans un contexte de contre-terrorisme, à une fiabilité sans faille.
• Une manœuvre ambitieuse du point de vue quantitatif
Le graphique ci-après montre l’évolution des effectifs totaux du ministère de la Défense tels qu’elle était prévue par la loi de programmation militaire 2009-2014, par la loi de programmation militaire 2014-2019 dans sa version initiale, puis dans sa version actualisée, et enfin en tenant compte des annonces faites le 16 novembre 2015 par le président de la République.
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS TOTAUX DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
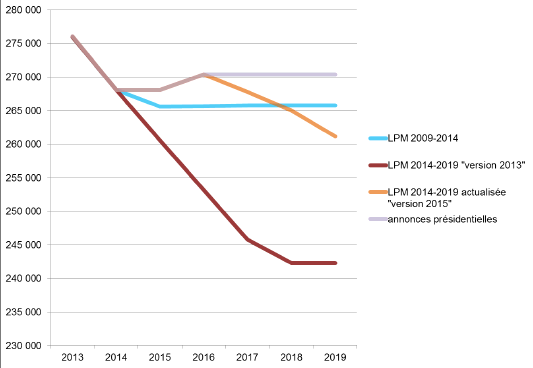
Source : Assemblée nationale.
L’opération Sentinelle concernant très majoritairement l’armée de terre, les rapporteurs se sont attachés à étudier en détail les plans de gestion des ressources humaines de celle-ci.
La manœuvre des effectifs destinée à pourvoir notamment à la « remontée en puissance » de la force opérationnelle terrestre est d’une ampleur sans précédent, tant par le volume des recrutements, que la sollicitation des chaînes de recrutement et de formation des recrues, et, d’une certaine façon, par la complexité qu’il y a à recruter massivement pour certaines unités tout en poursuivant une manœuvre d’optimisation d’autres unités, directions ou services.
1./ Une manœuvre d’effectifs particulièrement ample
Pour le général Hervé Wattecamps, « le défi est d’abord quantitatif : après de nombreuses années de déflation, s’inverse l’évolution nette des effectifs », c’est-à-dire le solde des recrutements et des départs de l’institution.
L’effectif total des personnels de l’armée de terre ‒ incluant les personnels gérés par la DRHAT, y compris les 20 000 d’entre eux qui servent dans des structures interarmées ou des organisations internationales ‒ n’a cependant augmenté que de 1 000 hommes seulement en 2015, car le départ de 4 000 hommes était déjà programmé en janvier 2015, mais l’augmentation nette atteint 4 000 personnels en 2016.
Dès 2015, pourtant, l’effort de recrutement est considérable. Pour illustrer ce « changement de paradigme », le général Hervé Wattecamps a mis en avant quelques chiffres : le plan de recrutement, qui portait sur 10 000 personnels en 2014, 15 000 en 2015 et 20 000 en 2016, cet effectif agrégeant recrutements externes et recrutements internes, c’est-à-dire « dans les rangs ». S’agissant des seuls recrutements externes, leur volume « aura presque doublé entre 2014 et 2016 : il passera de 9 088 à 17 400 ». Ainsi, en 2015, selon les précisions fournies par la DRHAT, l’armée de terre a recruté 652 officiers au lieu des 522 prévus, 2 581 sous-officiers, et 12 150 militaires du rang contre 7 078 initialement programmés.
Les plans de recrutement pour l’année 2016 sont encore plus ambitieux, notamment pour les catégories des sous-officiers et des militaires du rang. Il est ainsi prévu de recruter :
‒ 15 700 militaires du rang, soit 19 % de plus qu’en 2015 ;
‒ 3 632 sous-officiers, soit 40 % de plus qu’en 2015 ;
‒ 770 officiers, soit 15 % de plus qu’en 2015.
L’armée de terre a dû prendre des mesures particulières pour permettre l’atteinte de ces ambitieux objectifs de recrutement dans un contexte où, en dépit d’un regain d’intérêt pour les armées suivant les attentats des 7 janvier et 13 novembre, la « conquête de la ressource » s’avère « très concurrentielle » car les forces de sécurité intérieures et les sociétés de sécurité privées recrutent en partie dans le même vivier. Ainsi, l’armée de terre a :
‒ porté le recrutement direct de sous-officiers au maximum des capacités d’accueil de l’École nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) ;
‒ assoupli les conditions d’éligibilité des militaires du rang au recrutement interne des sous-officiers en élargissant les conditions d’ancienneté : en 2016, y seront éligibles les soldats ayant entre 12 et 17 ans de service ;
‒ adapté divers leviers de gestion pour faciliter le recrutement : âge maximum des candidats repoussé de 29 à 30 ans pour les militaires du rang et de 25 à 29 ans pour les engagés volontaires sous-officiers, durée des contrats modulée, etc.
Parallèlement au recrutement de militaires, l’armée de terre doit aussi recruter des civils. En effet, selon le DRHAT, elle emploie 8 000 civils (dont elle est l’employeur, mais plus encore le gestionnaire). Cette population est « vieillissante » ‒ 47 ans en moyenne ‒, et les départs seront nombreux dans les cinq prochaines années : ils porteront sur 40 à 50 % des effectifs. Un plan de recrutement est lancé, pour 343 recrutements en 2015. Le recrutement se fait par Pôle emploi et par le dispositif de l’article L. 4139-3 du code de la défense, qui permet de reclasser des militaires dans les corps civils, « ce qui contribue toutefois au vieillissement de la population des civils ». Mais les postes concernés, concentrés sur les activités de maintenance, sont « peu attractifs, notamment du point de vue indiciaire ». La direction des ressources humaines du ministère de la Défense (DRHMD) travaille d’ailleurs sur ce sujet.
2./ Une pression sur le système de recrutement et le dispositif de formation
Cette inversion de tendance et la croissance considérable des plans de recrutement qui la sous-tend ont pour conséquence de placer la chaîne de recrutement et de formation sous tensions. En effet, comme le directeur des ressources humaines de l’armée de terre l’a fait observer, « pourtant, l’organisation n’a pas fondamentalement changé ». Il a souligné que pour sa direction, « il a fallu en très peu de temps réapprendre à recruter et à former en masse », car remplir les contrats opérationnels suppose aujourd’hui de recruter, de former et d’administrer différemment ; « il n’y avait là rien d’évident à cela, mais le succès est indéniable ». Pour lui, avec la « remontée en puissance » programmée, « en peu de temps, on change la physionomie de l’armée de terre ».
Ainsi, la chaîne de recrutement de l’armée de terre a été fortement sollicitée, et le général Wattecamps a jugé qu’elle a été « hyperréactive en 2015 ». Elle est articulée autour de ses cinq groupements de recrutement et de sélection (GRS) et de ses 104 centres d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA), « points de contact bien répartis sur le territoire », qui ont été « renforcés ». Le général a précisé que l’afflux de gens aux CIRFA ne concernait pas seulement de potentielles recrues : beaucoup venaient simplement demander ce qu’ils pourraient faire pour aider ; « il s’agit parfois plutôt de vocations de réservistes ». La performance de la chaîne de recrutement constitue un enjeu crucial, tant pour l’attractivité de l’armée de terre sur le marché du travail que pour recruter en temps utile pour atteindre les objectifs fixés pour 2015 et 2016. À cet égard, le directeur des ressources humaines de l’armée de terre a indiqué que le délai entre le premier contact au CIRFA et la signature du contrat s’établit à trois mois : « ce n’est pas considérable ». Mais compte tenu de ces délais, l’essentiel des recrutements pour 2015 s’est concentré sur la fin de l’année.
La performance de la chaîne de recrutement est toutefois dépendante de celle de la chaîne de formation, et le général Hervé Wattecamps a souligné que « les capacités des écoles créent un plafond de recrutement ». Ainsi, l’ENSOA de Saint-Maixent accueillera en 2016 1 200 personnels à former, « et c’est là le maximum » ; dès lors, « recruter davantage ne se ferait qu’au prix de pertes indésirables dans la qualité de la formation ».
Le général a aussi fait le point des campagnes de publicité que programme l’armée de terre afin de susciter la constitution d’un vivier de recrutement suffisant. Il a précisé que « la DRHAT n’a pas de partenariat avec Pôle emploi, et c’est très bien comme cela », car « Pôle emploi n’est pas capable de relayer les spécificités du métier des armes ».
3./ La neutralisation des déflations ne résout pas toutes les tensions
Il faut souligner que la croissance des effectifs de la force opérationnelle terrestre et le renoncement aux déflations initialement programmées sont loin de lever toute pression dans la gestion des ressources humaines des armées. Comme nos collègues Alain Marleix et Geneviève Gosselin-Fleury l’ont souligné dans leur rapport précité sur la manœuvre des ressources humaines de l’armée de terre, avec les orientations prises en 2015, c’est une nouvelle « manœuvre RH » qui se superpose à une autre, plutôt qu’elle ne s’y substitue.
Le directeur des ressources humaines de l’armée de terre a ainsi souligné que certaines unités, directions ou services doivent voir leurs effectifs continuer à décroître, comme il était prévu dans les plans d’optimisation établis à partir de 2013. Il a fait valoir que malgré la stabilisation globale des effectifs, la force opérationnelle terrestre et « certaines composantes montant en puissance (le renseignement, la fonction cyber) », d’autres verront nécessairement leur effectif diminuer ou s’accroître dans une moindre mesure. Pour les armées, « les chiffres sont en cours de consolidation », mais « l’armée de terre devrait bénéficier d’une atténuation des déflations à hauteur de 3 000 postes » sur les 10 000 emplois ainsi sauvegardés au sein du ministère de la Défense.
Le commandant des forces terrestres a d’ailleurs observé qu’il reste à savoir si la « remontée en puissance » des effectifs telle qu’elle est planifiée est suffisante compte tenu de l’engagement opérationnel actuel. En effet, le général Arnaud Sainte-Claire Deville a expliqué que le niveau d’équilibre de Sentinelle pour l’armée de terre correspond à l’hypothèse de déploiement dans la durée prévue par le contrat opérationnel de protection, c’est-à-dire 7 000 hommes. Or ce sont 10 000 hommes qui sont déployés depuis le 13 novembre : « on ne retrouve donc pas l’équilibre ». Pour pouvoir déployer 10 000 hommes dans la durée, il faudrait (en première approximation statistique) 86 000 hommes dans la force opérationnelle terrestre, et non 77 000. Aussi, « il faudra choisir : on ne peut pas maintenir 10 000 hommes sur le territoire national tout en menant une expédition en Libye ». Il faudra pour cela ramener à 7 000 hommes l’effectif déployé sur le territoire national, et avoir achevé les recrutements planifiés.
4./ Un calendrier très contraint par les tensions pesant sur les forces en attendant l’atteinte des nouvelles cibles d’effectifs
Il faut souligner l’ambition qui marque la manœuvre des ressources humaines décidée par la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire et rectifiée encore par les annonces présidentielles du 16 novembre : en moins de dix-huit mois, les effectifs de la force opérationnelle terrestre auront augmenté de 11 000 hommes, soit plus de 15 %.
Le général Didier Brousse a tenu à souligner que cette « remontée en puissance » s’opère « à marche forcée », ce qui est d’autant plus difficile qu’elle constitue un revirement complet des politiques de ressources humaines jusqu’alors mises en œuvre : ainsi, « l’armée de terre doit rendre ses recrutements attractifs alors qu’on lui demandait d’employer ses leviers RH à faciliter la déflation des effectifs » (avec un dispositif complet d’aide au départ), et l’outil de formation était calibré pour un flux de recrutements en baisse. Il existe ainsi un « seuil » de remontée en puissance dans un temps donné, mécanisme dû aux limites des capacités de recrutement, de formation, d’hébergement, d’équipement et de soutien des forces.
Pourtant, compte tenu des tensions pesant sur les forces actuellement disponibles, que l’opération Sentinelle a placées en position de suractivité, un retard aurait de graves conséquences.
• Une manœuvre ambitieuse du point de vue qualitatif
Comme l’a bien dit le directeur des ressources humaines de l’armée de terre, la question des effectifs ne règle pas tout : encore faut-il que le niveau de compétence professionnelle des forces reste excellent ; « le défi est aussi qualitatif ». À cet égard, deux facteurs de risque majeurs constituent autant de défis pour la gestion des ressources humaines : s’assurer de la qualité des recrues, et reprendre rapidement les activités de préparation opérationnelle auxquelles il a dû être renoncé, tout en s’assurant de la bonne formation des personnels aux missions de protection du territoire national qui sont appelées à constituer une part substantielle de leur activité.
1./ Un enjeu immédiat : la qualité des recrues
Selon le général Hervé Wattecamps, les cibles en recrutement définies pour 2015 et 2016 « tiennent compte de la volonté de préserver une sélectivité acceptable », gage de la qualité du recrutement ‒ « on ne doit pas transiger avec cela ».
Le général a rappelé à cet égard que le taux de sélection des soldats s’élève à deux candidats pour un poste, ce qui « est à mettre en perspective avec le taux que nous avons connu au début de la professionnalisation des armées, à savoir 1,5 candidat pour un poste » et, selon lui, « demeure compatible avec l’exigence des engagements actuels ». Plus précisément, s’agissant des militaires du rang, le taux de sélection s’est maintenu à deux candidats par poste, car « l’augmentation de nos besoins s’est accompagnée de l’augmentation de l’attrait de la jeunesse pour nos métiers ».
Le DRHAT s’est néanmoins déclaré « très vigilant quant à l’évolution de ces taux », une baisse appelant des « mesures correctives » concernant notamment les programmes de formation. La sélectivité resterait également satisfaisante s’agissant des sous-officiers. Pour le général, « les recrutements sont pour l’instant satisfaisants ».
2./ Un enjeu corollaire : la fiabilité des recrues et des personnels déjà en service dans un contexte d’intense propagande djihadiste
L’audition du général Jean-François Hogard, directeur de la protection et de la sécurité de la Défense (DPSD), a permis aux rapporteurs de faire le point sur le contrôle de la fiabilité des recrues et la surveillance de celle des personnels déjà dans les rangs.
S’agissant du contrôle des recrues, la DPSD procède pour tous les candidats au recrutement à ce qu’elle appelle un « contrôle élémentaire », qui vise à évaluer le degré de confiance qui peut être accordé à l’individu. Il est conduit par les 87 personnels du centre national des habilitations défense (CNHD), et consiste en une consultation (directe ou par saisie de services partenaires) de fichiers informatiques dits « de souveraineté ». L’objectif est d’écarter du métier des armes les profils présentant une dangerosité pour la défense. Selon le général Jean-François Hogard, 92 % des candidats à l’engagement bénéficient d’un avis « sans objection » de la DPSD, les 8 % restant se voyant attribuer d’un avis « restrictif » ou « défavorable » lié à une vulnérabilité ou à un antécédent constitué. Pour le général, ces statistiques montrent « que l’immense majorité des recrues ont un profil sûr ».
Le « surrecrutement » décidé par l’actualisation de la loi de programmation militaire a mécaniquement eu pour conséquence un surcroît de travail pour le CNHD. Ainsi, 200 000 dossiers ont été étudiés en 2015 contre 130 000 en 2014 (30). Selon le général, « des mesures ponctuelles découlant directement des attentats de janvier 2015 ont également entraîné une charge de travail additionnelle significative ».
La procédure de contrôle élémentaire s’est avérée jusqu’à présent efficace. En ce sens, comme l’a souligné le général Hogard, « le CNHD de la DPSD constitue la première brique de la lutte antiterroriste ».
S’agissant de la surveillance des personnels appartenant déjà aux armées, le général Jean-François Hogard a indiqué que la DPSD suit en priorité « une cinquantaine de dossiers de radicalisation ». Ce nombre évolue en permanence, car la DPSD reçoit des signalements qu’elle traite par des opérations de renseignement de durée variable, les investigations se menant systématiquement à charge et à décharge. Le général a souligné que « le traitement des signalements doit être prudent, car il faut éviter de stigmatiser certaines personnes, faute de quoi on risque de les pousser dans les bras de l’ennemi ». Il a expliqué en effet que pour les mêmes signes extérieurs ‒ port de la barbe, refus de parler à une femme, etc. ‒, il faut savoir distinguer des cas de réelle radicalisation de ce qui peut n’être que l’expression d’un refus de la discipline ou d’un simple mal-être, et veiller à limiter les effets de stigmatisation, qui nuisent à la cohésion dont ont besoin les armées. Le général a souligné que la plupart du temps, quelle que soit l’origine du soldat, « l’engagement n’est pas un acte neutre : c’est un “engagement” au sens plein du terme, au service de son pays et de son drapeau ».
Pour faire face au surcroît d’activité qui résulte pour la DPSD à la fois de l’intensité de la menace et de l’augmentation du nombre de candidats au recrutement, les effectifs de la DPSD ont été renforcés en 2015 :
‒ après les attentats de janvier 2015, la DPSD a obtenu 65 personnels supplémentaires en renfort. Mais l’effet de ces renforcements n’est pas immédiat car les recrutements sont longs (les premiers agents recrutés n’ont rejoint la direction qu’en août 2015), puis il faut former ces agents (les premiers recrutés ne sont opérationnels que depuis janvier 2016), après quoi il leur faut huit ou neuf mois pour s’insérer pleinement dans les structures de la DPSD et le réseau du renseignement ;
‒ l’actualisation de la loi de programmation militaire a ouvert 150 postes supplémentaires, pour lesquels les recrutements s’échelonneront jusqu’en 2018.
Ainsi, l’effectif de la DPSD est passé de 1 500 agents en 2008 à 1 050 à la fin de l’année 2013, puis sera porté à 1 310 à la fin de l’année 2018. Plus qu’un renforcement des effectifs, il s’agit donc en réalité d’une « moindre déflation ». Le général a précisé que le schéma de renforcement des effectifs adopté « se situe entre une hypothèse haute et une hypothèse basse proposées par la DPSD », l’hypothèse haute s’élevant à 178 personnels supplémentaires ‒ soit 28 de plus que ce qui a été accordé ‒ correspondant à des créations de postes précises.
La DPSD a formulé une nouvelle demande portant sur 275 personnels, justifiée notamment par la surcharge actuelle de contrôles et par la nécessité de « traiter vite les signaux faibles ». Cet effectif demandé inclut 50 personnels supplémentaires pour le CNHD, 25 personnels supplémentaires pour les inspections, 38 pour la recherche technique, et 47 pour la recherche humaine. Cette hausse des effectifs a vocation à s’inclure « dans une future “actualisation de l’actualisation”, c’est-à-dire à horizon de 2017 ».
L’encadré ci-après présente les missions pour lesquelles la DPSD a exprimé un besoin d’effectifs supplémentaires.
Les priorités de la DPSD justifiant des effectifs supplémentaires
Les moyens obtenus ont d’ores et déjà permis :
‒ d’activer en permanence (7 j / 7 24 h / 24) le centre de situation et des opérations (CSO). Ainsi, un signalement reçu par la DPSD à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit peut être traité très rapidement, même en l’absence du personnel normalement dévolu à cette tâche ;
‒ de doubler les effectifs de la section antiterrorisme, dont les moyens étaient « trop faibles pour traiter la menace avec le sérieux nécessaire » ;
‒ de renforcer les capacités de « recherche cyber », y compris en matière de surveillance des réseaux sociaux.
Pour les mois à venir, la DPSD prévoit de :
‒ renforcer les moyens affectés à la fonction « habilitation » ;
‒ renforcer les moyens affectés à la fonction inspection, notamment celles des points d’importance vitale (PIV) ;
‒ renforcer la présence d’officiers de liaison auprès des autres services de renseignement en vue d’améliorer la coopération entre la DPSD et ces services. Aujourd’hui, la DPSD ne dispose d’officiers de liaison qu’au sein de la cellule inter-services de lutte antiterroriste pilotée par la DGSI et de la cellule Hermès pilotée par la DRM, qui suit les opérations en Irak et en Syrie ;
‒ améliorer les moyens techniques, aujourd’hui insuffisants dans les directions zonales de la DPSD. En effet, le directeur veut que ses échelons déconcentrés en province « acquièrent des capacités qui leur permettent de travailler avec la même souplesse que les échelons parisiens ». Ainsi, les directeurs zonaux disposeront d’« une petite capacité technique à leur main pour mener des investigations sans dépendre de la centrale ». En effet, « aujourd’hui, projeter les moyens de l’échelon central est parfois long, donc potentiellement préjudiciable en cas d’urgence » ;
‒ renforcer la protection du siège de la DPSD au fort de Vanves, en adaptant l’infrastructure et en renforçant le personnel affecté à cette fonction.
En effet, malgré les renforts consentis en 2015, « la DPSD ne peut pas tout faire ». Ainsi, en matière d’habilitations, elle fera appel aux réservistes et a pris à cette fin des contacts avec le délégué aux réserves. Une difficulté dans l’utilisation des réservistes tient à la durée de leur formation préalable et au fait qu’« il faut une durée d’emploi de l’ordre de six mois pour “amortir” la formation ». L’armée de terre a également été sollicitée pour fournir des renforts temporaires afin d’aider à absorber le surrecrutement. Pour donner un ordre d’idée, la réalisation de 6 000 contrôles élémentaires nécessite l’emploi d’une dizaine d’équivalents temps plein. En dépit de ces renforts ponctuels, il y a un certain effet d’éviction entre l’antiterrorisme et les autres missions : la DPSD a dû hiérarchiser ses efforts dans ce domaine, et donc faire des choix. Ainsi, la lutte contre la subversion, contre l’espionnage, ou la protection du potentiel scientifique et technique pâtissent, dans une certaine mesure, de la concentration des moyens de la DPSD sur la lutte antiterroriste. « C’est naturel : pour armer, par exemple, un centre d’alerte opérationnelle 24 h / 24, il a fallu, dans un premier temps, dégarnir d’autres fonctions ». Le général Jean-François Hogard a toutefois précisé que, pour autant, « la DPSD n’a abandonné aucun champ : l’espionnage reste un risque, et un certain nombre de cas sont détectés chaque année ».
Après les attentats de janvier 2015, la DPSD a aussi obtenu 2,54 millions d’euros supplémentaires en crédits d’investissement ‒ pour un budget de 10 millions d’euros hors titre 2 ‒, afin de financer notamment les priorités suivantes : le renforcement des moyens de recherche sur sources ouvertes ; la sécurité informatique ; le stockage et la traçabilité des données conformément à la loi sur le renseignement (« il faut un système automatisé pour s’assurer la confiance du régulateur ») ; divers matériels techniques.
3./ Une attention particulière doit être portée au maintien du niveau de compétence professionnelle des forces
Interrogé l’évolution à court et moyen terme de la qualité professionnelle de l’armée de terre, le général Arnaud Sainte-Claire Deville a expliqué que le niveau de cette qualité dépend de cinq déterminants principaux : les OPEX, les opérations intérieures, l’instruction et la formation des nouvelles recrues, la préparation opérationnelle, la remise en condition. Le général Sainte-Claire Deville a souligné que les trois premiers domaines sont « très prioritaires », ce qui a pour corollaire « un risque d’écrasement, très réel, dans les deux derniers domaines ». En témoigne par exemple le fait que l’armée de terre « aura peiné à garantir 15 jours de permissions en été, et une permission pour l’une des deux fêtes de fin d’année ». En somme, « deux risques de ruptures sont réels : rupture morale, et rupture professionnelle : l’armée de terre risquant de passer de l’armée de terre de Serval à celle de Sentinelle ».
En effet, selon le général Arnaud Sainte-Claire Deville, les premiers effets bénéfiques de l’augmentation des effectifs de la force opérationnelle terrestre « sont attendus pour l’automne 2016 » et permettront de :
‒ « commencer à réarmer notre échelon national d’urgence » (ENU, ex-Guépard), qui est réduit depuis 2015 à son seul élément de réaction rapide ;
‒ « relancer la préparation opérationnelle interarmes » (PO-IA) : un nouveau cycle de préparation sera lancé en octobre 2016, et devrait être stabilisé au cours du deuxième semestre de l’année 2017. Cette relance est cependant d’autant plus compliquée que l’ampleur des recrutements en cours nécessite d’importants efforts de formation initiale, qui accaparent les cadres.
Le général Didier Brousse, lui aussi, a alerté les rapporteurs sur les risques qui pèsent sur le niveau de compétence opérationnelle des armées :
‒ dans l’attente d’une reprise de la préparation opérationnelle, le capital de compétences des forces s’érode, or le recrutement et la formation des effectifs supplémentaires ne seront achevés qu’en 2017 : d’ici là, le flux de recrutement permet de « gagner en capacité opérationnelle mois après mois » après plusieurs mois où « l’armée de terre n’a fait que Sentinelle » ;
‒ même une fois les recrutements opérés et les recrues formées, il faudra du temps pour retrouver le niveau de compétence professionnelle d’avant 2015 : « même après l’intégration des 11 000 hommes supplémentaires, ce ne sera pas tout à fait comme avant » car il faudra davantage de temps pour pouvoir remplir l’ensemble des missions de l’armée de terre, notamment dans les hypothèses d’engagement de haute intensité : « refaire Serval sera de nouveau possible, heureusement, mais mener une opération de haute intensité ne le sera pas aussi rapidement ». Cela s’explique non seulement par le volume des engagements correspondant aux hypothèses de haute intensité (24 000 hommes et plusieurs postes de commandement de corps d’armée ou de division, au sein d’une coalition), mais aussi par le niveau de préparation opérationnelle qui s’y attache.
Le général Arnaud Sainte-Claire Deville a précisé que si l’augmentation prévue des effectifs permettra de retrouver un niveau d’entraînement « acceptable », celui-ci restera « inférieur à celui que nous avions auparavant », s’établissant à 60 % du niveau antérieur.
4./ Un enjeu supplémentaire pour le niveau de compétence de nos armées : assurer leur bonne formation aux missions de protection du territoire national
La préparation opérationnelle devra aussi être réorganisée : le commandant des forces terrestres travaillait, à la date de son audition, à une « profonde rénovation » du cycle de préparation et des « parcours normés » de préparation, « en tenant compte des exigences opérationnelles “OPEX” et “territoire national” ».
L’engagement sur le territoire national, qui est appelé à tenir désormais une part substantielle dans l’activité des armées, présente en effet des spécificités, que le général Arnaud Sainte-Claire Deville a énumérées ainsi :
‒ des règles d’engagement « contraignantes » : les soldats n’étant pas investis de pouvoirs de police judiciaire ou administrative, cela suppose « de grandes capacités d’adaptation aux situations diverses : insultes, découverte de délits, détection de colis ou comportements suspects, appui ponctuel aux forces de sécurité intérieure, etc. » ;
‒ une mission centrée sur la lutte antiterroriste et une menace « diffuse et omnidirectionnelle », au milieu de la population, ce qui fait que « la maîtrise de la force reste le facteur clé de la réussite de la mission » et que « la notion de “caporal stratégique” prend ici toute sa valeur » ;
‒ si l’organisation territoriale interarmées de défense (OTIAD) assure l’interface avec les préfets, le contact de terrain avec les commissariats, les îlotiers, les autorités municipales, les représentants des communautés confessionnelles, la population elle-même, etc. « est aussi important qu’en OPEX ». « Dans ce patchwork, le chef militaire doit donc intégrer de nombreux paramètres et surtout évoluer avec finesse et détermination afin de garantir la réussite de la mission », et « l’improvisation n’est pas de mise ».
De plus, selon le général, même si le soldat qui patrouille à Paris est le même que celui qui est à Gao, après quatre mois passés dans les sables de la bande sahélo-saharienne, son déploiement sur le territoire national « présente un décalage certain en termes de contexte d’engagement ». Il suppose ainsi une « mise dans l’ambiance » et une mise en condition opérationnelle spécifiques.
Ces conditions justifient selon le général Arnaud Sainte-Claire Deville un « principe de différenciation » de la préparation opérationnelle, qui consiste « à cibler spécifiquement la préparation de la phase d’engagement considérée et à y appliquer la juste suffisance ».
Le général a en effet expliqué qu’en matière de préparation opérationnelle, « on avait depuis l’Afghanistan un système très normé », et que le chef d’état-major de l’armée de terre a souhaité « que l’on prenne mieux en compte la maturité de nos soldats ». Il n’est en effet pas indispensable de dispenser la même instruction à toutes les unités : selon que certaines ont bénéficié ou non d’un entraînement ou d’un déploiement particulier, ou selon que leur encadrement et leurs hommes ont été renouvelés récemment ou non, on peut prévoir pour elles une préparation opérationnelle adaptée. « C’est une logique de subsidiarité contrôlée, moins normative » ; davantage qu’un pis-aller, c’est une préparation « plus individualisée... » Elle vise à retrouver le plus vite possible un niveau professionnel satisfaisant.
Le commandant des forces terrestres a indiqué qu’en avril 2015, une première directive de préparation opérationnelle spécifique à Sentinelle a été mise en œuvre, puis aménagée en janvier 2016. Début mars 2016, un séminaire de retour d’expérience est organisé à Lille, avec notamment les neuf chefs de corps qui auront été déployés à Paris. Comme l’a fait observer le général, « l’ajustement permanent de la préparation opérationnelle est la culture de l’armée de terre ». Il en ressort que la mise en condition avant Sentinelle doit durer entre une et deux semaines, selon le niveau des unités : « une petite mise en condition est systématique, mais elle peut être accrue pour les (très rares) unités qui n’ont pas été engagées dans l’opération Sentinelle depuis plusieurs mois ».
Si le général fait valoir que la plupart des savoir-faire requis « font partie du “fond de sac” de tout soldat de l’armée de terre, ils supposent une révision avant tout déploiement sur le territoire national, ainsi que des « séances dédiées » de formation concernant notamment :
‒ le tir avec l’arme de dotation « afin d’insister sur la parfaite maîtrise individuelle de l’arme » ;
‒ les rappels d’utilisation des armes à létalité réduite (ALR) qui équipent nos soldats, à savoir : « point de tasers ni de gomme cogne, mais des matraques télescopiques et des diffuseurs lacrymogènes », dont la simplicité d’emploi peut n’être qu’apparente ;
‒ les techniques d’intervention opérationnelle renforcées, combinant l’entraînement sportif et une « gestuelle » adaptée aux matériels de dotation. « Il s’agit pour nos soldats d’être graduellement capables d’adapter leur comportement et leur intervention face à une situation difficile afin de maintenir la violence au plus bas niveau et d’éviter l’usage de leurs armes ». Le général a jugé que le comportement du trinôme agressé à Nice en janvier 2015 et la réaction « parfaitement adaptée » à l’attaque par voiture bélier à Valence le 1er janvier 2016 « en sont la parfaite illustration » ;
‒ des « rappels sur les règles d’emploi de la force et de comportement », ce que le général a présenté comme « fondamental compte tenu du cadre légal spécifique de l’engagement » ;
‒ une « mise dans l’ambiance » de la zone de déploiement : caractérisation de l’aire de responsabilité de l’unité, points particuliers, sensibilisation sur les us et coutumes de certaines confessions religieuses en fonction des sites et zones à protéger ou à surveiller ;
‒ la révision d’un certain nombre d’actes élémentaires et réflexes individuels et collectifs destinés à replacer les unités dans un contexte urbain : prise en compte de la menace verticale, progression dans une cage d’escalier, pénétration dans un parking souterrain, etc.
ii. Les premiers résultats sont globalement conformes aux prévisions
• Le net succès de la manœuvre de recrutement
Selon les informations fournies par le directeur des ressources humaines de l’armée de terre, les résultats de l’exercice 2015 sont très encourageants : l’armée de terre atteint à 99,6 % son effectif-cible au 31 décembre 2015.
L’écart s’explique par la sous-réalisation légère des objectifs concernant la catégorie des sous-officiers, qui sont tout de même atteints à 98 %, et un sous-recrutement de volontaires de l’armée de terre : 810 ont été recrutés au lieu des 922 prévus. Selon les informations des rapporteurs, les ouvertures de postes non-réalisées en 2015 ont été intégralement reportées sur l’exercice 2016.
Le général Hervé Wattecamps a aussi indiqué que « la manœuvre de recrutement pour 2016 est actuellement “sur trajectoire” ».
Les rapporteurs relèvent toutefois un point d’attention : l’évolution du « taux d’attrition » des recrues, notamment des militaires du rang. Cet indicateur mesure la part des personnels qui s’engagent, mais ensuite, soit renoncent soit ne sont pas jugés faits pour le métier des armes. En effet, pendant les six premiers mois de contrat ‒ trois mois en centre de formation initiale militaire (CFIM) puis trois mois en régiment ‒ les intéressés peuvent quitter librement l’institution ou celle-ci se séparer d’eux tout aussi librement.
Le général Hervé Wattecamps a indiqué que ce taux d’attrition constitue « une question qui suscite des inquiétudes au sein de la DRHAT ». En effet, il s’est élevé en 2015 à 25 %, contre 23 % auparavant. Or, d’après les explications du général, ramener ce taux à 23 % est une condition nécessaire à ce que l’armée de terre atteigne ses effectifs-cible en fin d’année 2016. Le directeur des ressources humaines de l’armée de terre a toutefois souligné que pour ce faire, les leviers d’action sont limités : « il s’agit essentiellement de jouer sur la qualité de l’accompagnement humain, ce qui est particulièrement difficile dans une période de sollicitation accrue des cadres ».
• Le succès moins complet des efforts de fidélisation des personnels
Le général Jean-Pierre Bosser avait expliqué à la commission que pour accroître les effectifs, il misait à 80 % sur les nouveaux recrutements, et à 20 % sur un effort de fidélisation accrue des personnels ‒ c’est-à-dire de renouvellement de contrats. On rappellera que la part des contractuels est importante dans l’armée de terre : 100 % dans les militaires du rang servent en vertu d’un contrat, ainsi que l’ensemble des sous-officiers tant qu’ils ne possèdent pas le brevet supérieur ; c’est aussi le cas d’un nombre significatif d’officiers.
Comme l’a expliqué le chef d’état-major de l’armée de terre, pour atteindre ses objectifs de remontée en puissance « et ne pas s’épuiser à recruter », l’armée de terre « a néanmoins encore besoin d’être attractive et de fidéliser ses militaires du rang ». Devant les rapporteurs, il a précisé quelles mesures il a prises pour inciter les personnels à prolonger ou renouveler leur engagement, que présente l’encadré ci-après.
Les mesures de « fidélisation » et de « surfidélisation »
De mesures dites de « surfidélisation » ont été prises en 2015 en faveur de la fidélisation des personnels :
‒ réengagement de militaires ayant quitté l’institution depuis moins de quatre ans ;
‒ renouvellement de contrat des militaires même si ceux-ci étaient déjà engagés dans un processus de reconversion ;
‒ engagement dans l’active des militaires réservistes ;
‒ possibilité offerte aux soldats de 1re classe de servir au-delà de cinq ans de service (jusqu’à la limite de 11 ans) ;
‒ modularité accrue des contrats, qui peuvent être conclus pour des durées variables, notamment entre cinq et 11 ans de service ;
‒ adaptation et l’assouplissement des règles pour les renouvellements de contrats au-delà de 11 ans ;
‒ autorisation de proroger jusqu’à 21 ans de service les contrats des militaires du rang ayant atteint le seuil de la retraite à jouissance immédiate (19 ans et demi).
À la question de savoir s’il ne serait pas judicieux, pour améliorer la « fidélisation » des personnels, de leur proposer plutôt des contrats plus longs, le DRHAT a fait valoir que l’âge moyen des militaires du rang s’élève à 28 ans : « c’est la « génération Y », assez volatile, qui « zappe » constamment ; ils ne sont donc pas intéressés par des contrats longs : cinq ans, c’est déjà le maximum ». Selon ses précisions, l’armée de terre aurait déjà « testé des contrats plus longs, mais cela n’a jamais fonctionné ». Aussi, au contraire, pour remplir les objectifs quantitatifs de recrutement, propose-t-elle désormais des contrats plus courts (trois ans ou quatre ans) que le contrat « classique » de cinq ans. Pour autant, il ne faudrait pas, selon le général Wattecamps, « en venir à une sorte de service militaire rémunéré : dix mois, c’était ridicule » car il faut au moins six mois de formation initiale et six mois de formation « un peu plus spécialisée » pour qu’un militaire soit opérationnel.
Si, selon le directeur des ressources humaines de l’armée de terre, ces mesures ont permis de porter le taux de renouvellement des contrats de 29,2 % en 2014 à 30,1 % en 2015, ce progrès n’est pas suffisant. Le général Hervé Wattecamps y voit le « seul bémol » dans la « remontée en puissance » de l’armée de terre : du fait de la sous-réalisation des objectifs de fidélisation, il restait 400 postes à pourvoir fin 2015, lesquels, « par chance », ont été reportés intégralement à 2016.
Pour expliquer ce résultat en demi-teinte, le général Hervé Wattecamps a fait valoir que parmi les facteurs de fidélisation, « les conditions d’exercice du métier jouent », et que la suractivité résultant de l’opération Sentinelle a tendance à les détériorer. Il a en effet précisé qu’une part importante des soldats de l’armée de terre a passé plus de 200 jours hors de sa garnison en 2015. À cet égard, il a fait valoir l’importance du plan d’amélioration de la condition militaire annoncé, lors de ses vœux à Coëtquidan, par le président de la République, qui a confirmé la création d’une prime de suractivité ou d’activité cumulée pour compenser un absentéisme et une « usure opérationnelle » qui vont croissant.
Est-ce le signe d’un manque d’attractivité du métier des armes ? Pour le général Wattecamps, « l’attractivité est loin d’être nulle : il suffit pour s’en convaincre de relever que l’on réussit à remplir des objectifs ambitieux de recrutement avec un taux de sélection qui reste exigeant ». Mais pour le reste, « l’armée est le reflet d’une société... les jeunes sont aujourd’hui versatiles ».
b. Privilégier les modes d’action véritablement militaires
L’une des questions les plus souvent évoquées devant les rapporteurs concerne les modes d’action de la force Sentinelle. Ceux-ci, hérités du plan Vigipirate faute de travaux de planification plus poussés de la mise en œuvre des hypothèses maximales du contrat opérationnel de protection assigné aux armées, se sont d’abord résumés pour l’essentiel à des gardes statiques.
Le rapport au Parlement précité insiste sur l’intérêt d’une diversification des postures des armées sur le territoire national, en vue d’exploiter mieux qu’aujourd’hui la « plus-value » d’armées professionnelles. Les auditions conduites par les rapporteurs font apparaître que cette évolution, pour justifiée qu’elle soit, se heurte toutefois à des réticences telles qu’elle représente un véritable défi.
i. Un dispositif initialement très majoritairement statique
Lors de leur déplacement auprès du groupement Paris-centre de la force Sentinelle au fort de Vincennes, les rapporteurs se sont attachés à dresser un bilan quantifié des modes d’action de la force. Il en ressort qu’au 1er mars 2016, ce groupement ‒ représentatif de l’ensemble de la force ‒ a quatre modes d’action :
‒ la garde statique 24 heures sur 24, pour deux sites ;
‒ la garde statique en journée pour 50 lieux de culte, quatre gares et un site touristique majeur : la Tour Eiffel ;
‒ la garde dynamique pour 88 sites cultuels (avec garde fixe pendant les offices), 22 ambassades, 10 gares (y compris de RER), cinq sites touristiques et cinq sièges de médias ;
‒ le contrôle de zone dans les trois districts, confiés à une unité élémentaire. Comme l’a indiqué aux rapporteurs le chef du groupement Paris-centre, « c’est le mode d’action que les armées aimeraient privilégier », à l’image de ce qu’elles font depuis trente ans sur les théâtres extérieurs dans le cadre d’opérations de stabilisation.
Néanmoins, les gardes statiques occupaient encore 75 % des hommes ce qui fait dire au chef du groupement que « globalement, la force est fixée sur ses emprises ». Il est cependant à noter que « cette proportion a un peu évolué : il y a encore trois mois, la quasi-totalité des hommes était déployée en garde statique ». Selon le chef du groupement Paris-centre de la force Sentinelle, « un bon ratio dynamique / statique serait de 80 % / 20 % ».
Les rapporteurs ont pu constater que l’évolution de la posture de la force se heurtait à des résistances de différente nature.
• Des facteurs historiques : la permanence des habitudes héritées de Vigipirate
Les rapporteurs ont indiqué que la mise en œuvre des hypothèses maximales d’engagement au titre du contrat opérationnel de protection du territoire national n’avait pas fait l’objet d’une planification « à froid » approfondie, et que de ce fait, lors de son lancement, l’opération Sentinelle a largement fait fonds sur le dispositif Vigipirate. Comme l’a constaté le général Arnaud Sainte-Claire Deville, « il y a une forme de tétanisation : le dispositif est encore largement figé dans sa forme mise en place en urgence en janvier 2015 ».
Surtout, le principal facteur d’inertie dans le dispositif de protection du territoire national tenant à cette « généalogie » de Sentinelle réside dans les pratiques de rédaction des réquisitions préfectorales.
En effet, comme l’a expliqué le directeur du CICDE, il y a une « différence d’approche » entre autorités civiles et militaires dans la formulation de ces réquisitions, en ce que :
‒ les autorités préfectorales raisonnent « en termes d’effectifs déployés », suivant une logique d’obligation de moyens appliqués à une liste de sites à protéger, ce qui induit ipso facto une préférence pour les gardes statiques ;
‒ les autorités militaires sont formées à un raisonnement « en termes d’“effets à obtenir” » suivant une logique d’obligation de résultat qui leur laisse une marge de manœuvre pour prendre des « initiatives tactiques » et jouer sur « l’imprévisibilité » de la manœuvre de la force, toutes choses que permettent les gardes « dynamiques » (c’est-à-dire les patrouilles), mais pas les grades statiques.
Le général Arnaud Sainte-Claire Deville, commandant des forces terrestres, a ainsi estimé que « c’est d’ailleurs là une difficulté des discussions avec le ministère de l’Intérieur, qui a tendance à exprimer les réquisitions en termes de moyens » alors que « la culture de l’armée de terre, c’est plutôt une culture du résultat ». Résultat sur le terrain : « travaillant sur réquisition, la force n’a pas grand marge de manœuvre », comme l’a regretté devant les rapporteurs le chef du groupement Paris-centre de la force Sentinelle.
• Des facteurs politiques : la réticence de certains gestionnaires de sites à protéger
Les rapporteurs se sont attachés à entendre les représentants des gestionnaires de principaux sites protégés par la force Sentinelle, au premier rang desquels les représentants de la communauté israélite. Il apparaît que s’ils ne sont pas tout à fait unanimes, une large part d’entre eux exprime de fortes réticences à voir leurs établissements cultuels ou culturels protégés d’une autre façon que par des gardes statiques.
L’expression de cette réticence peut expliquer que les autorités préfectorales n’aient pas pris l’initiative de faire évoluer plus rapidement la posture de la force. En effet, selon le général Bruno Le Ray, « le préfet de police de Paris estime qu’une évolution profonde du mode de garde des sites juifs est politiquement aujourd’hui inacceptable ». Pourtant, d’après les chefs de groupements Sentinelle rencontrés par les rapporteurs, « les capitaines n’ont pas le sentiment que les commissaires d’arrondissement verraient d’un mauvais œil des gardes plus dynamiques ; la résistance tient surtout de certains gestionnaires de sites confessionnels ». Elle tient aussi parfois à des facteurs symboliques, et « le symbolique contredit parfois le tactique : qui accepterait de retirer la garde de l’Hypercacher ? » Ainsi, le gouverneur militaire de Paris observe que « l’évolution d’un mode de protection (statique) à un autre (dynamique) se passe bien en province, mais moins à Paris, du fait notamment de réticences vives de la communauté israélite ». Certes, d’après lui, le Grand Rabbin de France « est très conscient de l’intérêt d’une telle évolution, ainsi que du risque de stigmatisation de la communauté juive et de décrochage de l’adhésion de la population à la mission » ; mais « à Paris, celui qui décide, ce n’est pas le Grand Rabbin : c’est le président du Consistoire et le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) », lesquels « refusent l’abandon de la réquisition statique et font prévaloir leur point de vue auprès du préfet, qui le traduit dans ses réquisitions ».
M. Roger Cukierman, président du CRIF, a déclaré aux rapporteurs que le préfet de police de Paris et le gouverneur militaire de Paris « souhaitent passer du statique au mobile », et ‒ avec le ministère de l’Intérieur ‒ en discutent avec le CRIF et les autres représentants de la communauté israélite. Il a fermement rappelé que « tous les représentants de la communauté juive sont d’accord pour dire leur attachement à un mode d’action statique », au motif que celui-ci « a un impact psychologique irremplaçable » et rassure la communauté israélite. Il a d’ailleurs fait valoir que « jusqu’à présent, les autorités publiques ont accepté ce fait ». Pour lui, il est difficile de voir les gardes dynamiques non comme une mesure d’économie, mais comme une valeur ajoutée dans la protection des sites sensibles et de leur environnement, et ce :
‒ non seulement sur le plan du sentiment de sécurité des israélites : « même le CRIF aurait dû mal à convaincre les mères de famille que des policiers ou des militaires à 500 ou 800 mètres les protègent mieux que des policiers ou des militaires devant la porte de l’école... » ;
‒ mais aussi dans l’absolu, les représentants du CRIF émettant des doutes sur l’idée, souvent avancée, selon laquelle les gardes dynamiques seraient plus efficaces que les gardes statiques. Pour eux, « l’exemple du dispositif de protection des locaux de Charlie Hebdo le démontre : une garde statique était en place et a été remplacée par une garde mobile : l’attaque du 7 janvier 2015 a été perpétrée lorsque le dispositif de sécurité devant les locaux du journal était devenu dynamique… ». Ils font valoir que « l’on est observé par les terroristes : affaiblir la garde et renoncer à la garde à vue des bâtiments, c’est ouvrir une brèche dans leur protection ».
Ainsi, aux yeux du CRIF, une garde dynamique à l’échelle d’un quartier « accroît vraiment le risque, et ne permet pas de répondre au besoin de sécurité des Juifs – de la maman qui emmène son enfant à l’école, par exemple – même au prix du sentiment d’être une population à part ». Sur ces prémisses, ils font valoir qu’il y aurait une incohérence à ce que la menace s’aggravant, on relâche le dispositif de protection. Pour le CRIF, il y aurait d’ailleurs comme un « effet de cliquet » dans la protection des sites : dès lors que des gardes statiques ont été mises en place, elles doivent être conservées autant que possible, tant que dure la menace. Et s’il est vrai que les gardes statiques ont révélé l’emplacement de certains lieux, par un effet pervers, « justement, renoncer à la garde statique de ces lieux désormais connus revient à les exposer particulièrement ».
Pourrait-on, à tout le moins, limiter la présence statique des militaires aux heures d’entrée et de sortie des lieux protégés ? Les représentants du CRIF ont déclaré en avoir « discuté avec le préfet de police et le gouverneur militaire de Paris », et ont estimé qu’« il ne faut pas sous-estimer le danger » : à leurs yeux, « certains peuvent certes se demander si ce n’est pas beaucoup investir pour 1 % de la population seulement ; mais c’est oublier que précisément, 1 % de la population cristallise 40 à 50 % des attaques racistes ».
Les représentants du CRIF ont reconnu que la protection des lieux cultuels et culturels israélites est, en elle-même, en quelque sorte ambivalente :
‒ d’une part, la protection elle-même « peut être anxiogène », et si « les Juifs sont reconnaissants de la protection de l’État, mais se disent qu’ils ne peuvent pas vivre durablement comme cela » ;
‒ mais d’autre part, compte tenu de la menace, dans l’immédiat, « toutes choses bien entendues, les gens préfèrent être protégés ».
Cette position n’est pas celle de tous les gestionnaires de lieux de culte ; M. Roger Cukierman s’en est entretenu après le projet d’attentat contre une église de Villejuif avec Mgr André Vingt-Trois, cardinal-archevêque de Paris, soutenant que les églises elles aussi sont en danger ; « mais S.E. le cardinal-archevêque de Paris ne veut fondamentalement pas de protection particulière ».
Les rapporteurs ont pu vérifier auprès de Mgr Luc Ravel, évêque du diocèse aux armées, et Mgr Michel Dubost, évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes, représentants de la Conférence des évêques de France, que malgré l’attentat déjoué à Villejuif et la « stricte observation des directives de l’État » en matière de sécurité, globalement, le curseur entre le fonctionnement « normal » et l’hyperprotection est mis « le plus proche possible de la normalité ». Pour eux, « les paroissiens ne demandent pas davantage de sécurité », et à Évry au moins, « les diocésains ne souhaitent pas du tout le même degré de protection que les juifs et les musulmans ». De plus, aux yeux des représentants de la conférence des évêques de France, les gardes statiques devant les sites confessionnels israélites ou musulmans « les désignent comme cible autant que cela les protège » et, de façon générale, risque de risque de « nourrir une psychose collective ». La préférence des responsables catholiques va clairement à une surveillance dynamique.
Aussi, la sécurité n’a-t-elle pas été considérablement renforcée dans les lieux de culte et les autres institutions catholiques ‒ églises, monastères, écoles, établissements du mouvement scout, etc. À Évry, il y a désormais quelques vigiles devant la cathédrale ‒ concrètement, du personnel d’accueil féminin a été remplacé par du personnel masculin pondichérien recruté parmi les paroissiens ‒, « mais pas de fouille systématique des sacs ». Au niveau national, 200 établissements environ seraient protégés ; dans le cas du diocèse d’Évry, cinq sites seulement bénéficient d’une surveillance particulière, et le diocèse s’est toujours opposé à la mise en place de moyens de vidéosurveillance au nom de la liberté de culte : « chacun a le droit d’entrer dans une église sans être observé » ‒ le diocèse ne l’a acceptée que pour une église qui a été la cible d’une série de pillages, et encore, uniquement aux heures de fermeture.
iii. Les inconvénients de la posture statique
Si la posture statique concerne encore une majorité des hommes engagés dans l’opération Sentinelle, ses limites n’en sont pas moins connues. Elles tiennent autant à l’efficience du dispositif ‒ c’est-à-dire le rapport entre le degré de protection produit et les moyens engagés ‒ qu’à son efficacité elle-même : non seulement les gardes statiques supposent des effectifs très importants, mais encore, elles ne sont pas d’une grande efficacité tactique.
• Un dispositif très « consommateur » d’effectifs ‒ d’ailleurs formés à d’autres missions
La « fixation » d’un effectif très conséquent de soldats à des postes de garde fixe est d’autant plus regrettable, que ces soldats possèdent des compétences professionnelles qui permettraient de les employer mieux à d’autres missions.
1./ La posture statique est très « consommatrice » d’effectifs militaires
Le gouverneur militaire de Paris a mis en exergue un paradoxe : schématiquement, dans la posture de la force Sentinelle au printemps 2016, 25 % des sites gardés accaparent 75 % de l’effectif de la force. Cette concentration de l’effectif s’explique par la garde « quasi exclusivement statique » d’une partie des sites. En effet, selon les explications fournies aux rapporteurs, il faut huit à neuf militaires pour maintenir devant un site un poste fixe de deux ou trois soldats en permanence.
En outre, la concentration d’effectifs que nécessite la garde statique de certains sites constitue un frein à l’extension du nombre de sites protégés. Le chef d’état-major de l’armée de terre a d’ailleurs souligné qu’un recours accru à des postures dynamiques était indispensable du fait de « l’accroissement du cahier des charges », c’est-à-dire de l’augmentation du nombre de sites à protéger. Sur le terrain, le lieutenant-colonel de Russé a fait valoir qu’un recours plus large aux gardes dynamiques permettrait de mieux protéger les sites aujourd’hui les moins bien couverts : par exemple, il y a 1 000 crèches dans Paris, et seul un « désoclage » de la force (c’est-à-dire des gardes plus dynamiques) permettrait de dégager les ressources nécessaires pour mieux les protéger.
Le gouverneur militaire de Paris a d’ailleurs fait valoir qu’à la suite des attentats du 13 novembre, l’extension des réquisitions a conduit à « une explosion du nombre de sites protégés » ‒ incluant alors des sièges de médias, des écoles laïques, des sites touristiques, des lieux culturels, des sites commerciaux etc. Désormais, 1 800 sites sont protégés en Île-de-France. Dans ces conditions, le recours à des gardes plus dynamiques est indispensable pour assurer leur protection avec 10 000 hommes.
2./ L’emploi de soldats professionnels en posture statique ne permet pas de tirer le meilleur parti de leurs aptitudes militaires
Conformément aux orientations présentées par le rapport au Parlement, le général Didier Brousse a estimé qu’« employer un soldat pour garder une porte » n’est « pas le meilleur moyen d’exploiter au mieux la formation exigeante et la capitalisation d’expérience opérationnelle » des militaires, ni de tirer le meilleur parti de leur puissance de feu et des « capacités de manœuvrabilité d’un détachement militaire dont l’engagement rapide pourrait permettre de geler ou de limiter les effets d’un massacre de masse ».
Il a indiqué qu’en conséquence, un « recentrage » de l’action des armées « sur les spécificités militaires est constamment recherché », pour les employer là où elles « peuvent apporter de plus ou de mieux par rapport à ce que font déjà les forces de sécurité intérieure », suivant une logique de complémentarité et non de substitution. Selon le général, « c’est au travers de ce prisme qu’apparaissent les notions de résilience, d’unicité de commandement, de capacité de planification et de bien d’autres caractéristiques propres à l’état militaire ». Il a insisté sur le fait que l’action militaire ne doit être « ni galvaudée ni banalisée, même si elle s’inscrit maintenant dans la durée » : elle doit conserver « un caractère “extraordinaire” ». Pour le général Brousse, exploiter mieux les compétences des militaires dans leurs missions de protection du territoire national suppose de :
‒ « rester dans une logique militaire de mission confiée et d’effet recherché, plutôt que de moyens imposés » ;
‒ laisser à la force « une certaine marge d’initiative pour conserver sa liberté d’action » ;
‒ privilégier un emploi de la force « préservant la plus-value d’une action collective et coordonnée sous commandement central », utilisant « le panel capacitaire qui lui est nécessaire, y compris le recueil d’information ».
En outre, comme le note bien le général (2S) Vincent Desportes dans une contribution au récent dossier du Cercle de réflexion de l’Association des officiers généraux en seconde section (31), « à utiliser les armées comme des forces de police ‒ ou, pire comme des sentinelles ou des vigiles de sociétés de gardiennage ‒ on utilise à faux un remarquable instrument, sans en retirer de plus-value sécuritaire mais, en se privant dans l’instant et pour l’avenir d’un moyen qui fait déjà défaut sur les théâtres d’opération et dont se dégradent à vive allure les capacités ».
Soulignant lui aussi que les armées ne doivent pas devenir une sorte de « nouvelle force de sécurité intérieure » ‒ « elles doivent en rester au très haut du spectre », c’est-à-dire aux situations de violence ou de chaos ‒, le général Jean-François Parlanti a estimé qu’elles « ne doivent pas s’user dans des fonctions qui gâchent leur plus-value opérationnelle », comme les gardes statiques. D’après lui, les travaux du CICDE ont permis d’établir dans la réflexion interministérielle préparatoire au rapport au Parlement une « ligne rouge », selon laquelle l’emploi des armées sur le territoire national doit permettre de « retrouver de la profondeur stratégique », c’est-à-dire :
‒ de la « profondeur fonctionnelle » : il faut différencier les missions des forces tant que les forces de sécurité intérieure ne sont pas débordées ;
‒ de la profondeur géographique : il faut conserver les moyens d’assurer la « défense de l’avant » par des OPEX contre la source de la menace et garder les approches maritimes et aériennes du territoire national ;
‒ de la « profondeur conceptuelle », c’est-à-dire « élaborer une stratégie de long terme stable globale sur notre pourtour sécuritaire » (Moyen Orient, Libye, etc.), y compris par une réflexion sur la prise en charge de la jeunesse française, car « on paie toujours le manque de perspective et de stratégie à long terme de nos interventions ou de notre histoire, comme l’ont montré l’intervention américaine en Irak en 2003 ou la nôtre en Libye en 2011 ».
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a ajouté que lors des travaux interministériels de refonte de la doctrine d’emploi des armées sur le territoire national, les armées avaient tenu à éviter toute mesure qui les aurait conduites à dégrader le niveau de compétence de tout ou partie de la force opérationnelle terrestre. Selon lui, « les armées, notamment le chef d’état-major de l’armée de terre, ont tenu à ne pas improviser un dispositif nouveau, et ont pris comme base de leur réflexion l’état des choses ». Ainsi, « on est parti des compétences du soldat et de son équipement », en privilégiant « l’unicité de la formation ». Aussi, les armées se sont prononcées :
‒ contre la constitution d’unités spécialisées dans les opérations de protection sur le territoire national, que de telles unités soient constituées en régiments à part entière ou en compagnies spécifiques au sein des régiments ;
‒ contre une modification de l’équipement « tout temps ‒ tout lieu ‒ toute heure ‒ toute opération » du soldat français : le FAMAS, « avec lequel, d’ailleurs, on peut choisir de tirer au coup par coup ou en rafale ».
• Une efficacité tactique limitée
Si, encore, les gardes statiques avaient l’avantage d’offrir une meilleure protection que d’autres postures, peut-être faudrait-il mesurer à cette aune le poids de ses inconvénients ‒ mobilisation d’effectifs nombreux et emploi de soldats professionnels « surqualifiés » pour ces tâches. Mais, de surcroît, il ressort de l’avis de tous les connaisseurs de la tactique militaire que l’efficacité pratique des gardes statiques et plus limitée que celle des gardes dynamiques. Comme l’a bien dit le commandant des forces terrestres, « nul besoin d’être un expert en tactique pour comprendre que le mode statique rencontre rapidement des limites ».
Les rapporteurs retiennent deux ordres de limites à l’efficacité de la posture statique :
‒ comme le chef d’état-major de l’armée de terre l’a reconnu dans une récente livraison de la Revue Défense nationale (32), « la ligne Maginot de l’après-7 janvier [a été] soigneusement contournée » au soir du 13 novembre 2015. Reprenant la même comparaison, le général Bruno Le Ray a expliqué que l’opération Sentinelle figée dans des postures statiques constitue « une sorte de ligne Maginot qu’il suffit de contourner » car, selon les mots du général Parlanti, « la protection se limite aux lieux symboliques, mais peu ou pas au-delà, 30 mètres plus loin, à la bouche de métro » ;
‒ elle place aussi la force en position de vulnérabilité. Comme l’a dit le général Didier Brousse, il faut éviter le « syndrome de la guérite » : les militaires statiques constituent des cibles visibles et vulnérables ;
‒ elle a pu avoir pour effet de révéler l’implantation de sites israélites qui étaient inconnus du public, par un effet de « désignation de cible ».
De surcroît, un dispositif statique peut aussi s’avérer contre-productif, dans la mesure où il a des effets « stigmatisants ». À cet égard, l’attention des rapporteurs a été appelée, sur un risque grave : il ne faudrait pas que les militaires aient l’impression d’être employés à la seule protection des sites israélites. Le commandant des forces terrestres a regretté à ce propos que « l’image donnée par le dispositif statique devant les écoles israélites soit parfois difficile à assumer par certains soldats », qui sont « interpellés sur le point de savoir pourquoi ils protègent ainsi une école juive et pas une “école de la République” ».
D’ailleurs, le grand Rabbin de France a constaté que si le lancement de l’opération Sentinelle a marqué le début d’un « grand amour entre l’armée et la communauté juive », en revanche, « à partir de Yom Kippour et du Nouvel an, ce lien s’est dissipé ». La raison en réside dans plusieurs facteurs :
‒ un « décalage » entre l’activité d’un militaire au travail et l’état d’esprit d’un pratiquant se rendant à la synagogue peut « créer des frictions » ;
‒ les gestionnaires des sites protégés ont dans un premier temps mis à la disposition des militaires des lieux d’accueil, « mais les ont récupérés car ils en avaient besoin » et le manque d’équipements adéquats de ces lieux, notamment concernant les douches, a exacerbé les tensions nées de la promiscuité ;
‒ la tension peut aussi provenir du fait que certaines synagogues sont déjà protégées par des sas, des vigiles et des blindages, toutes choses qui ne donnent pas aux soldats le sentiment que leur présence est indispensable.
Aussi, pour le grand Rabbin, le dispositif actuel de gardes statiques présente-t-il le risque de « donner l’impression qu’une seule partie de la population est protégée », Pour lui, « une approche plus dynamique irait dans le sens d’une meilleure acceptation par la population de la présence de soldats » ; par exemple, « en protégeant deux écoles voisines, l’une juive et l’autre catholique, une garde dynamique sécuriserait tout un quartier et légitimerait l’action des militaires ».
iv. Des expérimentations prometteuses de modes d’action plus dynamiques de la force Sentinelle
Tout au long de leurs travaux, les rapporteurs ont pu suivre les efforts faits par les armées, en lien avec les autorités du ministère de l’Intérieur comme avec les gestionnaires des sites protégés, pour diversifier les modes d’action de la force Sentinelle. Selon le président du CRIF, le président du Consistoire israélite de Paris (M. Joël Mergui), le président du Fonds social juif unifié (M. Ariel Goldmann) et lui-même rencontrent une fois par mois le préfet de police et le gouverneur militaire de Paris pour discuter des opérations de protection.
Le Grand Rabbin de France a d’ailleurs souligné que c’est dans le cadre d’un dialogue entre toutes les parties que le dispositif avait pu être adapté peu à peu. Il a cité en exemple d’« adaptation intelligente des mesures de sécurisation » qui peut en ressortir le cas d’une synagogue à de Cagnes-sur-Mer, où le préfet et le gestionnaire du lieu ont jugé qu’une protection permanente de ce lieu de culte perdait son sens dès lors que celui-ci n’était pas tout le temps ouvert et qu’un stationnement militaire permanent gênerait les riverains.
Les rapporteurs soulignent aussi l’intérêt de l’expérimentation d’adaptations plus profonde de la posture des armées sur le territoire national, comme les « gardes dynamiques à vue » ou les manœuvres de contrôle de zone, par exemple dans des territoires d’accès malaisé où la plus-value de l’armée de terre est évidente.
• Des exercices de contrôle de zone en tout type de contexte
Pour les rapporteurs, la sécurisation des zones urbaines ne doit pas faire oublier que la menace peut aussi peser sur les zones rurales, montagneuses ou difficiles d’accès pour d’autres raisons. En effet, quel ne serait pas l’impact d’une attaque de Daech suivant un scénario de type « Oradour-sur-Glane » ? D’ailleurs, si la plupart des attentats de 2015 ont été commis dans de grands centres urbains, ce n’est pas le cas de celui de Saint-Quentin Fallavier en juin 2015.
Interrogé sur le point de savoir si le commandement des forces terrestres travaillait sur des scénarios de crise en zone rurale, le général Arnaud Sainte-Claire Deville a admis que « cibler les zones de sensibilité permet d’améliorer la préparation des opérations », tout en faisant observer que « cette logique se heurte à l’imprévisibilité de la menace, qui conduit à adopter une posture plus souple, réactive à des menaces touchant à toute zone du territoire ». Ainsi, « le spectre des possibles est trop vaste pour pousser plus loin la préparation de déploiements en quelque lieu du territoire que ce soit ». Les processus actuels, « que le commandement des forces terrestres maîtrise bien », permettent aujourd’hui de déployer des forces en tout lieu du territoire national.
Pour les rapporteurs, dans des zones peu densément peuplées et difficiles d’accès, la plus-value des armées serait évidente, compte tenu de leurs moyens de mobilité terrestres, aéroterrestres et aériens. Ils relèvent d’ailleurs qu’un exercice conjoint entre une compagnie du 7e bataillon de chasseurs alpins (BCA) de Varces et des unités de la gendarmerie, appelé Minerve, a été conduit en avril 2016, lors de la traditionnelle foire d’avril de Beaucroissant, en Isère ‒ département où se trouve Saint-Quentin Fallavier et où une centaine d’individus font l’objet d’une étroite surveillance. Cet exercice visait à tester les capacités de manœuvre conjointes de l’armée de terre et de la gendarmerie, ainsi que les techniques de contrôle des flux et des axes.
Les rapporteurs relèvent par ailleurs qu’en dépit des faibles marges de manœuvre que lui laissent les réquisitions préfectorales, le commandement du groupement Paris-centre de la force Sentinelle a organisé un dispositif très dynamique de « contrôle de zone », confié à une compagnie. Comme l’a indiqué le commandant du groupement, « c’est le mode d’action que les armées aimeraient privilégier ».
• Des gardes « dynamiques à vue »
Le général Jean-Pierre Bosser a ainsi souligné que l’armée de terre a pu « apporter des innovations » au dispositif de protection. Il a cité notamment l’expérimentation à Sarcelles d’un « dispositif “zonal” » qui se présente comme un système de garde dynamique « à vue », dans les 500 mètres des sites à protéger, en remplacement de gardes statiques.
Selon les précisions du gouverneur militaire de Paris, cette expérimentation est conduite dans le quartier dit de la Petite Jérusalem, dense en sites israélites mais aussi en autres sites qu’il est utile d’intégrer dans un dispositif de protection. Concrètement, les militaires ne sont plus présents en permanence devant les sites pendant les offices : ils ne protègent en mode statique que l’entrée et la sortie des fidèles, et patrouillent pendant la durée des offices dans un périmètre très réduit, de 800 mètres par 800 mètres.
Selon le gouverneur militaire de Paris, cette expérimentation résulte d’une initiative soutenue par le préfet du Val-d’Oise et couverte par une réquisition supplétive du préfet de police. Deux facteurs ont contribué à sa mise en œuvre :
‒ « la préfecture de police de Paris n’a pas les mêmes compétences dans le Val-d’Oise et en petite couronne » ;
‒ « le préfet du Val-d’Oise n’a pas voulu faire des réticences de certains responsables de la communauté un point absolument bloquant ». En effet, selon lui, les représentants du service de protection de la communauté juive (SPCJ) n’y étaient pas d’emblée favorables, et certains auraient même fait savoir aux autorités préfectorales parisiennes que la responsabilité de tout incident devrait être assumée par les autorités publiques.
Le chef d’état-major de l’armée de terre a indiqué que ce modèle « a montré sa pertinence et son efficacité auprès des acteurs locaux », et que l’armée de terre proposait d’en étendre la mise en œuvre à d’autres zones. Le Grand Rabbin de France a d’ailleurs suggéré qu’il serait pertinent, par exemple, rue de Montevideo (Paris 16e) où, à seulement quelques mètres d’intervalle, cohabitent deux synagogues, dans le voisinage d’un centre communautaire et de l’ambassade de Mauritanie ; pour lui, une garde mutualisée, dans un périmètre aussi restreint, aurait toute sa pertinence.
2. Un défi politique : prendre la responsabilité d’une gestion souple du volume des forces engagées
Il ressort des travaux des rapporteurs que dans la manœuvre engagée de refonte de notre dispositif de protection du territoire national, aux défis techniques s’ajoute un défi politique particulièrement complexe : prendre la responsabilité de moduler non seulement à la hausse, mais également à la baisse, le niveau de protection du territoire.
L’expérience du plan Vigipirate n’est guère rassurante à cet égard : voilà plus de vingt ans que le plan est activé, et nombre des interlocuteurs rencontrés ont le sentiment que l’on a pu préférer réformer l’échelle des seuils d’alerte que prendre la responsabilité d’une baisse significative du niveau de menace, par souci de ne pas donner l’impression de « baisser la garde ». À cet « effet de cliquet » affectant le choix des niveaux d’alerte s’ajoute un autre effet d’hystérèse concernant les effectifs déployés : élément-clé de la communication gouvernementale destiné à rassurer lorsqu’il est ajusté à la hausse, l’effectif des forces engagées n’en est que d’autant plus difficile à réduire.
a. Un effet de cliquet affectant les effectifs engagés
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a fait valoir que sous l’empire d’un même seuil d’alerte du plan Vigipirate, la posture des forces déployées peut varier de façon significative. Ainsi, « la “posture COP21” n’est pas la même que la posture “achats de Noël”, etc. » ; ainsi, « Vigipirate a connu entre quinze et vingt ajustements de postures en 2015 ». De plus, non seulement le dispositif n’est pas le même en tout temps, mais il ne l’est pas non plus en tout lieu du territoire : l’Île-de-France ou les Alpes maritimes ont pu voir leur statut évoluer différemment des autres lieux.
Néanmoins, les effectifs engagés ‒ point central dans la communication destinée à rassurer la population ‒ restent peu ou prou les mêmes. Certes, comme l’a souligné le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les effectifs de forces déployées cités par le plan Vigipirate ne doivent pas être lus comme automatiques, mais comme des plafonds. Mais à cet égard, la baisse des effectifs de l’opération Sentinelle de plus de 10 000 à 7 000 personnels entre la fin du mois de février et le 13 novembre 2015 apparaît comme une exception. Les rapporteurs soulignent d’ailleurs que si, conformément au nouveau contrat opérationnel des armées, un déploiement de 10 000 hommes pour une opération telle que Sentinelle est possible pour une durée limitée à un mois au plus, ce niveau a été atteint au lendemain des attentats du 13 novembre et n’a pas été réduit depuis sept mois. Ce dépassement dans la durée du contrat opérationnel de protection atteste d’un puissant effet de cliquet.
b. Un effet de cliquet affectant les niveaux d’alerte
Les rapporteurs observent également qu’il s’avère difficile aux autorités publiques de prendre la responsabilité de réduire le niveau d’alerte sans donner un signal de baisse de vigilance. Ce second « effet de cliquet » risque d’ailleurs de jouer de la même manière concernant l’application des états d’exception. Ainsi, l’état d’urgence proclamé au paroxysme de la crise terroriste, le 13 novembre au soir, est encore en vigueur à l’heure de la rédaction du présent rapport.
Pour plusieurs interlocuteurs des rapporteurs, comme M. François Heisbourg, établir l’état d’urgence pendant trois mois en cas d’attaque terroriste est tout à fait pertinent, mais le prolonger dans la durée l’est moins, pour deux ordres de raisons :
‒ « l’état d’exception permanent » a des impacts sur la population qui, pour l’essentiel, n’a pas à en subir les effets. Or l’état d’urgence et les mesures d’exception « pèsent toujours sur la même part de la population, qui a toujours la même couleur » : ils peuvent se justifier pour quelques mois, « mais ce n’est pas un grand moment d’état de droit... » Le Défenseur des droits a d’ailleurs déclaré aux rapporteurs qu’il a été saisi de réelles atteintes aux libertés publiques dans le contexte de l’état d’urgence. Aux yeux de M. Heisbourg, « c’est une façon de contourner la magistrature, pas davantage, dès que l’on dépasse les trois premiers mois » ;
‒ à l’inverse, les terroristes s’adaptent avec le temps aux règles de l’état d’urgence. Il suffit en effet pour s’en convaincre d’observer la façon dont des groupes terroristes réussissent à se constituer et à opérer dans des États autoritaires, dans lesquels les forces armées et les forces de sécurité intérieure ont en tout temps des prérogatives bien plus larges que celles de nos forces, même en état d’urgence : « même sous le président Vladimir Poutine, le terrorisme a été fort » ; ainsi, « si les états d’exception suffisaient, cela se saurait ».
Les rapporteurs ne remettent nullement en cause le bien-fondé de l’état d’urgence ‒ ou, par principe, d’un régime d’exception ‒ en cas de crise. D’ailleurs, le procureur de Paris leur a déclaré que lui-même n’avait été choqué par son établissement, « ni comme magistrat ni comme citoyen ». Conférer aux préfets divers leviers de contournement du droit commun, comme le prévoit la loi de 1955 relative à l’état d’urgence par exemple en matière d’assignations à résidence ou de perquisitions, peut être parfaitement justifié.
D’ailleurs, M. François Molins a souligné qu’état d’urgence et droit commun relèvent, notamment en matière de perquisitions, de deux logiques politiques différentes : par nature, les perquisitions administratives sont faites pour des situations dans lesquelles la justice ne pouvait pas autoriser une perquisition, faute d’indices suffisants. Ainsi, les perquisitions administratives « servent souvent aux fins de levées de doutes nés de comportements suspects » ; il convient donc de distinguer clairement deux cheminements différents : dans un cas, des charges précises à la suite de la commission d’une infraction sont suffisantes pour justifier une violation de domicile tandis que, dans un autre, c’est dans un cadre dérogatoire que l’on pratique des levées de doutes. Le procureur de Paris a d’ailleurs indiqué qu’il y a des procureurs qui coopèrent bien avec la police, pour « “recaser” en perquisition administrative ce qui n’aurait pas pu se faire dans un cadre judiciaire ». Mais chaque fois, les procureurs sont avisés des projets de perquisitions administratives et peuvent s’y opposer si elles interfèrent avec des enquêtes judiciaires en cours.
En revanche, pour le procureur de Paris, « il ne faut pas s’installer dans l’état d’urgence : s’y installer durablement serait critiquable ». À ses yeux, « il faudra en sortir en se donnant les moyens légaux adéquats pour lutter contre le terrorisme », par exemple en aménageant les procédures applicables aux enquêtes antiterroristes, que présente l’encadré ci-après.
Les procédures applicables aux enquêtes antiterroristes
● M. Molins a rappelé l’organisation de la justice en matière antiterroriste en lien avec les autorités administratives chargées des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, soulignant notamment qu’il y a un double niveau de compétence à Paris :
‒ celui du ressort du tribunal de grande instance (TGI) de Paris : à ce titre, les autorités administratives et judiciaires ont mis en place un double système de concertation : la préfecture de police de police envoie au procureur tous les jours à 17 heures un tableau récapitulant les perquisitions prévues la nuit suivante : en cas d’interférence avec une procédure judiciaire, le procureur demande au préfet de surseoir ou de renoncer ; tous les matins, le préfet de police adresse au procureur un bilan des perquisitions effectuées ;
‒ la compétence nationale du parquet de Paris au titre du terrorisme. Les services de renseignement sont avisés des projets de perquisition administrative et font éventuellement le lien avec la section terroriste car aucune mesure administrative ne peut intervenir dans une procédure judiciaire. La section antiterroriste est ensuite avisée en cas de découverte dans la perquisition administrative d’éléments pouvant fonder l’ouverture d’une enquête judiciaire.
● « Véritable paradoxe, les services de renseignement peuvent faire davantage que la justice » : le parquet antiterroriste a aujourd’hui moins de pouvoirs que les services de renseignement, sous le seul contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et du juge administratif, depuis la loi du 25 juillet 2015 pour les « sonorisations » et les IMSI catchers. Il faut donner les mêmes pouvoirs dans le cadre des enquêtes conduites par le parquet.
En effet, la justice voit son activité enserrée dans des règles parfois inadaptées. Le procureur de Paris a cité le cas des captations informatiques, pour lesquelles les procédures sont calquées sur le régime des perquisitions : elles exigent la présence de la personne concernée, ou des témoins, etc. « Mieux vaudrait, en bonne orthodoxie juridique, calquer ce régime sur les interceptions de sécurité ». Pour M. Molins, on pourrait aussi « approfondir l’utilisation de la flagrance, notamment pour mener des perquisitions de nuit ». Tout cela se faisant sous les contrôles du juge des libertés et de la détention, « il n’y a franchement aucun risque pour les libertés publiques ».
Ainsi, pour les rapporteurs, moduler les seuils d’alerte et les effectifs déployés dans le cadre des régimes d’exception ou du plan Vigipirate constitue un défi que le souci du fonctionnement normal de l’état de droit impose de relever. Les rapporteurs soulignent d’ailleurs qu’il n’y a pas là de contradiction fondamentale entre les exigences de l’État de droit et les nécessités de la défense du territoire, dans la mesure où l’effet de cliquet affectant les dispositifs de protection a aussi pour conséquence de priver le Gouvernement d’une marge de manœuvre en cas d’aggravation de la crise. C’est en ce sens que le grand rabbin de France, M. Haïm Korsia, a lui aussi souligné que si la mobilisation de plus de 10 000 militaires constitue un « signal fort », il est « déjà l’ultime recours » face à une menace d’une telle ampleur ; dès lors, « reste-t-il une gradation possible dans la réponse à de nouvelles menaces ? »
Pour éviter ces « effets de cliquet », il faut préparer dès à présent le « retour à la normale » à long terme, quitte à renforcer progressivement les unités mobiles de la police et de la gendarmerie. Pour ce faire, les rapporteurs considèrent qu’il convient d’étudier l’idée que les textes ou la doctrine établissent un lien entre l’effectif militaire engagé sur le sol national et le niveau de la menace, défini par référence aux degrés d’alerte du plan Vigipirate ou à l’état d’exception en vigueur.
II. APRÈS L’HEURE DE LA RÉACTION AUX CRISES, CELLE DES CHOIX STRATÉGIQUES ET POLITIQUES DE LONG TERME
Pour les rapporteurs, les défis techniques que représentent la réussite d’une ambitieuse manœuvre des ressources humaines et le changement de posture des armées sur le territoire national dans le cadre de la posture de protection terrestre (PPT), ainsi que le défi politique que constitue la modulation assumée des niveaux de protection ne pourront être relevés que si la refonte de notre stratégie de protection du territoire national fait l’objet d’un investissement politique clair, assis sur des principes largement partagés.
Or, en l’espèce, beaucoup reste à faire, et l’échéance approche. En effet, l’article 5 de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 prévoit que le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport d’évaluation de l’application des dispositions de la loi de programmation militaire concernant les ressources et les effectifs du ministère de la Défense et ce, « en vue, le cas échéant, d’une nouvelle actualisation » de la programmation militaire. Une telle « réactualisation » permettrait de compléter les mesures déjà prévues par la loi précitée de 2015 concernant le dispositif de protection du territoire national, ne serait-ce que pour y intégrer le renoncement aux déflations annoncé le 16 novembre 2015 par le président de la République et le soutien des forces.
Plus encore, une possible « réactualisation » de la programmation militaire peut constituer l’aboutissement de l’entreprise de refondation juridique, conceptuelle et doctrinale de la contribution de nos armées à la protection du territoire national.
A. VERS UNE REFONTE PLUS COMPLÈTE DE LA PROGRAMMATION MILITAIRE EN COURS
L’actualisation de la loi de programmation militaire opérée avec la loi précitée du 28 juillet 2015 a permis de rectifier la version initiale de la loi de programmation militaire pour tenir compte des premiers besoins liés au déploiement de l’opération Sentinelle. L’actualisation de 2015 a-t-elle cependant « épuisé le sujet » ? Vraisemblablement pas.
En témoigne, d’une part, le fait que c’est la loi de 2015 qui a chargé le Gouvernement de faire rapport au Parlement sur l’évolution de la doctrine d’emploi des armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour des missions de protection. L’atteste, d’autre part, le fait qu’un certain nombre de mesures liées à l’opération Sentinelle n’ont pas encore été « gravées dans le marbre » de la programmation militaire. À tout le moins, une « réactualisation » de la programmation doit permettre de les y intégrer.
1. Pour prendre en compte les nouvelles mesures d’effectifs annoncées après le 13 novembre
Devant le Congrès, le 16 novembre 2015, le président de la République a annoncé qu’il renonçait aux déflations nettes d’effectifs prévues par la loi de programmation militaire actualisée depuis le 28 juillet précédent.
Comme l’ont montré les tableaux et graphiques précédents, cette décision modifie profondément la trajectoire d’effectifs du ministère, définie à l’article 5 de la loi de programmation militaire de 2013 tels que modifié par l’article 4 de la loi du 28 juillet 2015. En outre, les effectifs étant appelés à dépasser ce qui était programmé, la masse salariale doit être ajustée à la hausse, ce qui suppose une révision des éléments de programmation budgétaires définis par l’article 3 de la loi de 2013 et actualisés par l’article 2 de celle de 2015. Ressources humaines et ressources budgétaires constituant des éléments essentiels de toute programmation militaire, c’est l’équilibre général de la programmation militaire en cours qui a été déplacé, et mérite donc d’être réactualisé.
De plus, l’effectif de la force opérationnelle terrestre avait été porté de 66 000 à 77 000 au motif que, très schématiquement, il manquait 11 000 hommes à cette force pour pouvoir assurer son nouveau contrat opérationnel de protection. Ce nouveau contrat prévoyait en effet le déploiement de 7 000 hommes dans la durée, ce qui, compte tenu des besoins de relève, supposait que la force opérationnelle terrestre dispose d’un vivier de 21 000 personnels à ce titre, alors qu’elle n’en comptait que 10 000. Or, comme l’a souligné le général Arnaud Sainte-Claire Deville, ce sont 10 000 hommes qui sont déployés depuis le 13 novembre 2015 : « on ne retrouve donc pas l’équilibre » correspondant à un déploiement de 7 000 soldats seulement. Pour pouvoir déployer 10 000 hommes dans la durée, il faudrait donc (en première approximation statistique) 86 000 hommes dans la force opérationnelle terrestre, et non 77 000.
Aussi, la « réactualisation » éventuelle de la loi de programmation militaire sera l’occasion d’un choix : soit des raisons dirimantes imposeront de maintenir un niveau d’engagement des armées sur le territoire national supérieur à leur contrat opérationnel, auquel cas il faudra accroître en conséquence leurs effectifs ; soit il faudra s’en tenir au modèle défini par l’actualisation de 2015, et renoncer à dépasser les hypothèses d’engagement du contrat opérationnel.
2. Pour prendre en compte l’ensemble des implications de la posture de protection terrestre, y compris sur les ressources financières, les infrastructures, les équipements et le soutien des forces
Les rapporteurs observent que l’actualisation, par la loi du 28 juillet 2015, de la programmation militaire en cours a, en quelque sorte, « paré au plus pressé », renvoyant à des débats ultérieurs plusieurs questions majeures, telles que :
‒ la doctrine d’emploi des armées sur le territoire national, renvoyée au débat du 16 mars 2016 ;
‒ l’adéquation des ressources humaines et financières aux besoins nouveaux, renvoyée à un rapport d’évaluation « en vue, le cas échéant, d’une nouvelle actualisation » de la programmation, lequel devra en tout état de cause prendre en compte le renoncement aux déflations nettes d’effectifs annoncé le 16 novembre 2015 ;
‒ le financement des surcoûts liés aux opérations intérieures, qui n’est pas prévu de façon aussi explicite que celui des surcoûts liés aux OPEX ;
‒ les besoins en équipements divers (armement, véhicules, etc.) et en infrastructures (protection accrue des emprises de la défense et hébergement de la force) nécessaires pour l’entretien dans la durée d’un volume important de forces sur le territoire national.
a. L’armement de la force sur le territoire national
L’actualisation de la loi de programmation militaire a tiré les conséquences de l’accroissement des effectifs de la force opérationnelle terrestre de 11 000 hommes en augmentant à due concurrence le nombre d’armes individuelles futures (AIF) commandés. Elle a aussi prévu, au rapport annexé à la loi, que « l’évolution des capacités protégées d’engagement de personnels sera cohérente avec les effectifs de la force opérationnelle terrestre ». Ce sont là les seules mesures prises, en matière d’équipements, spécifiquement pour tenir compte de l’opération Sentinelle.
Les rapporteurs se sont attachés à recenser les besoins d’équipements exprimés par les armées pour leur intervention sur le territoire national.
i. Des besoins très limités en matière d’armement
Il en ressort notamment que l’armement des soldats n’a pas besoin d’être substantiellement modifié. Ainsi, sur le terrain, le chef du groupement Paris-centre de la force Sentinelle a estimé que le FAMAS ne pose pas de sérieux problèmes de maniabilité. À ses yeux, « le FAMAS est la bonne arme pour cette mission, et il n’y a pas de débat sur ce point dans l’armée de terre ». D’ailleurs, le gouverneur militaire de Paris a fait valoir que loin de s’équiper d’armes plus légères, les forces de sécurité intérieure font marche en sens inverse, en se dotant actuellement de fusils d’assaut HK de calibre 5,56. Il s’est d’ailleurs interrogé sur le point de savoir si leurs membres seront suffisamment formés à l’emploi de ce type d’armes, tant individuellement qu’en manœuvre collective, « ce qui est indispensable compte tenu du fait que les terroristes agissent en groupe ». Certes, une mauvaise manipulation d’une telle arme peut causer des dégâts, mais pour le lieutenant-colonel de Russé, « c’est un risque toléré » ; preuve en est que « le 13 novembre, il y a eu des gens touchés par les balles perdues de la BRI, et l’on en a peu parlé ».
Le général Didier Brousse a ajouté qu’à ses yeux, si « le FAMAS est adapté à la menace actuelle », c’est aussi parce que les djihadistes ont des armes de même type, voire plus puissantes : ainsi, dans le contexte actuel, la puissance de feu constitue « un élément de la plus-value des unités militaires » dans la protection du territoire national. Par ailleurs, pour « le tout-venant » ‒ les soldats pouvant être appelés à prêter main-forte aux forces de sécurité intérieure, au même titre que tout citoyen, pour traiter d’autres formes de délinquance ‒, les soldats de Sentinelle sont équipés de bâtons télescopiques et de bombes lacrymogènes.
Le général a déclaré que l’armée de terre ne demandait pas d’autres armements non létaux ‒ comme des pistolets à impulsion électrique Taser ou des lance-grenades Cougar ‒ car cela met en œuvre des compétences qui ne sont pas celles des armées : « si l’on veut utiliser des armements comme le Cougar, il est plus cohérent de faire appel à quelqu’un d’autre qu’un soldat ». Pour le lieutenant-colonel de Russé, « si l’on “dégrade” l’équipement pour des armes à létalité réduite, ou des munitions à létalité réduite, on risque de perdre les savoir-faire fondamentaux des hommes de l’armée de terre ». En effet, le FAMAS est l’arme de dotation : les soldats y sont donc habitués, même si « beaucoup ne jurent que par le HK, qu’ils ont eu en Afghanistan » mais qui est en tout état de cause d’un gabarit comparable à celui du FAMAS. L’instruction sur le tir au combat a par ailleurs renforcé le lien entre le soldat et son FAMAS : il y aurait donc un véritable danger à doter les hommes d’une arme nouvelle ou de nouvelles munitions qu’ils maîtriseront moins bien.
Le rapport précité du SGDSN, récemment déclassifié, recommande cependant d’« étudier la possibilité d’étendre une double dotation “fusil d’assaut ‒ pistolet automatique” pour les militaires déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle ». Il explique que le pistolet automatique est mieux adapté, « dans certaines circonstances, à une ouverture du feu en environnement urbain », car le calibre de 9 millimètres « et la vélocité de la munition » limitent « les ricochets et les risques de dégâts collatéraux ». En tout état de cause, les rapporteurs soulignent que le pistolet automatique ne ferait que compléter l’armement des militaires, et ne doit en aucun cas se substituer au FAMAS.
En revanche, les rapporteurs ont pu constater au fort de Vincennes que les gilets pare-balles fournis sont souvent prélevés sur des stocks anciens, dont les protections d’épaules gênent les mouvements du soldat et qui pèsent 17 kg ; on ne les utilise d’ailleurs plus en OPEX. Le CIRAS, nouveau modèle utilisé en OPEX, est moins lourd et plus confortable ; les chauffeurs en ont été équipés, mais faute de stocks suffisants, il ne peut pas être fourni à tous les hommes.
ii. Des besoins en matière de mobilité de la force
Dans l’urgence, le ministère de la Défense a passé commande de plusieurs milliers de véhicules légers, indispensables à la manœuvre des personnels de l’opération Sentinelle.
Le commandant des forces terrestres a expliqué que dans le cadre des travaux de variation actualisée du référentiel (33) (VAR), l’armée de terre exprime « un besoin pressant » de véhicules de transport tactique non protégés : les GBC 180 (34) (gros camions) « ne sont pas idéaux » en milieu urbain, et le véhicule tout terrain P4 (35) doit être remplacée.
Un équilibre doit en outre être trouvé avec les moyens protégés ; l’armée de terre possède quelques VBL (36) qu’elle pourrait déployer avec certains avantages :
‒ d’un gabarit adapté à la circulation routière, « discret et maniable », il présente « le meilleur ratio taille / blindage des véhicules de l’armée de terre » ;
‒ « facilement identifiable », il a un effet rassurant et dissuasif ;
‒ il possède une capacité d’appui des forces d’intervention spécialisées du ministère de l’Intérieur qui ne disposent pas de véhicules blindés en nombre important, ce qui peut s’avérer décisif en cas d’attaques multiples à des endroits éloignés les uns des autres ;
‒ il dispose de moyens de protection efficaces, notamment contre les armes légères d’infanterie ;
‒ apte à évoluer en « milieu NBC » (nucléaire, bactériologique, chimique), il « peut apporter une réponse crédible et immédiate en cas d’attentats avec des armes “sales” ».
Le VBL fait d’ailleurs l’objet d’un programme de revalorisation, dit VBL Ultima, dans l’attente du programme VBAE (véhicule blindé d’aide à l’engagement) d’ici 2026-2028. Le PVP (petit véhicule protégé) pourrait également répondre à ce besoin.
Ce besoin de capacités de transport protégé ressort également des observations de terrain des rapporteurs. Ainsi, à titre d’exemple, le groupement Paris-centre dispose de 300 véhicules, essentiellement de la gamme commerciale. Avant 2016, ils étaient fournis sur la base d’un contrat de location de ce type de voitures auprès de la société Europcar, qui offrait des véhicules de type Renault Espace, mais par souci d’économie, le ministère de la Défense a préféré acquérir des véhicules de type Renault Kangoo, qui donnent pleinement satisfaction.
Toutefois, selon le chef de groupement, « il faudrait pouvoir disposer de blindage en cas de coup dur ». Des véhicules blindés auraient par exemple permis de couper la route aux terroristes qui ont sillonné l’est de Paris le 13 novembre 2015 au soir. D’ailleurs, « le CEMAT réfléchirait à une militarisation du matériel roulant », mais rien n’est arrêté. Il ne serait pas nécessaire pour autant de blinder tous les véhicules de la force Sentinelle : pour le lieutenant-colonel de Russé, « un ratio équilibré s’établirait à 70 % de véhicules de la gamme commerciale pour 30 % de véhicules blindés ».
b. L’impact de la posture de protection terrestre sur les besoins d’infrastructures du ministère de la Défense
L’actualisation de la loi de programmation militaire ne comprenait pas de mesure majeure d’adaptation du schéma d’infrastructures du ministère de la Défense. Pourtant, il est évident que l’état de la menace sur le territoire national et l’inscription dans la durée d’opérations intérieures au titre de la posture de protection terrestre supposent des aménagements conséquents des infrastructures du ministère, qu’il conviendra de prendre en compte dans les équilibres financiers de la programmation.
• La protection des emprises
Les rapporteurs se sont attachés à évaluer les mesures de renforcement de la protection des emprises de la Défense, dont l’intrusion subie en juillet 2015 par l’établissement principal « Provence » du service interarmées des munitions a révélé les insuffisances. Cette situation appelant à l’évidence des travaux d’infrastructures, un plan d’urgence a été mis en place, pour 95 millions d’euros.
Les rapporteurs n’ont pas pu se rendre à Miramas, mais ont demandé au général Jean-François Hogard, directeur de la protection et de la sécurité de la défense, son appréciation sur le renforcement de la protection des emprises de la Défense. Il en ressort que la DPSD avait inspecté le site de Miramas en 2007 et avait émis des recommandations, confirmées plusieurs fois par des inspections de l’OGZDS compétent, mais celles-ci n’ont pas été suffisamment prises en compte. Les causes de cette situation proviennent certes dans une certaine mesure de la dilution des responsabilités au sein de la chaîne hiérarchique mais sont aussi et surtout la conséquence de « l’impasse » réalisée sur la fonction « protection » au fil des diminutions successives des moyens accordés à la défense depuis 25 ans.
La direction de la protection des installations, moyens et activités, intéressant la défense (DPID), créée à la suite de l’incident de Miramas, a une fonction de coordonnateur des différents services qui jouent un rôle dans la protection des installations. La DPSD effectue quant à elle une évaluation de la menace et des vulnérabilités au travers d’inspections dont la programmation est établie par le cabinet du ministre de la Défense. La DPID, au vu des menaces, des vulnérabilités et de la sensibilité des sites définit, au nom du ministre, les priorités budgétaires. Dans ce cadre, la DPSD estime que la situation de sécurité des sites est variable, mais globalement insatisfaisante.
• L’hébergement de la force dans ses zones de déploiement
Le contrôleur général des armées Jean-Paul Bodin, secrétaire général pour l’administration (SGA) du ministère de la Défense, a confirmé aux rapporteurs que l’impact de l’actualisation de la loi de programmation militaire sur les besoins d’infrastructures du ministère de la Défense est important, notamment pour l’hébergement des personnels engagés dans l’opération Sentinelle.
En la matière, la difficulté tient à ce que la force est concentrée en région parisienne, où le ministère ne possède plus un nombre de casernes suffisant pour l’ensemble de la force. Il a donc dû renoncer à la cession de la deuxième tranche de la caserne Lourcine, et a décidé d’héberger des hommes « de façon rustique » au Val-de-Grâce et à l’îlot Saint-Germain. Pour l’hébergement des effectifs supplémentaires recrutés afin de pourvoir à l’augmentation des effectifs de la force opérationnelle terrestre, le besoin croissant a motivé la passation d’un marché-cadre de bungalows installés dans leurs régiments d’appartenance.
Il faut distinguer, d’une part, l’hébergement en caserne et, d’autre part, le logement familial. Les casernes ne comptent pas dans le recensement des logements sociaux établi pour apprécier la conformité de la situation d’une commune aux obligations légales en la matière : aux yeux du secrétaire général pour l’administration, « peut-être une telle disposition susciterait-elle un plus vif intérêt des autorités chargées de l’urbanisme pour la construction, la rénovation ou tout simplement le maintien de casernes ». Pareillement, les soldats bénéficiaires de logements familiaux pourraient pour la plupart prétendre à un logement social. D’ailleurs, les baux offerts par la société nationale immobilière (SNI) prévoient des loyers inférieurs de 50 % aux prix du marché. Le secrétaire général pour l’administration a observé que la situation est d’ailleurs surprenante dans certaines villes, où le logement social est encore moins cher que le logement familial. En tout état de cause, un classement des logements militaires en logement social aiderait le ministère de la Défense. Avec la hausse des effectifs, la demande ne fera que croître. De même, bénéficier des subventions de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) serait utile.
Selon la loi de programmation militaire actualisée, les cessions immobilières doivent rapporter 200 millions d’euros par an. Les opérations « Pépinière » et « Bellechasse » ont rapporté davantage en 2015, mais l’emprise de Saint-Thomas-d’Aquin a été cédée à Sciences-Po pour 87 millions d’euros, alors que le secrétaire général pour l’administration avait indiqué aux rapporteurs que le ministère de la Défense estimait pouvoir retirer plus de 100 millions d’euros de cette vente. Le Val-de-Grâce va être vendu : le préfet de région a trois projets en lien avec la santé. L’îlot Saint-Germain constitue « un dossier plus compliqué », la difficulté ayant porté notamment sur le quota de logement social voulu par la Ville de Paris. L’État et la Ville de Paris ont annoncé le 17 juin 2016 avoir trouvé un accord aux termes duquel l’État cèderait à la Ville 14 000 m² des bâtiments de l’îlot en vue de créer des logements sociaux, tout en accélérant la libération de plusieurs casernes dans Paris. Par ailleurs, les discussions ont repris avec la Société de valorisation foncière et immobilière (SOVAFIM) pour la cession de plusieurs bâtiments en province.
Ainsi, le ministère de la Défense fait face à une certaine contradiction : d’une part, la programmation militaire prévoit toujours la cession d’une part de ses emprises, notamment à Paris ; mais, d’autre part, il doit héberger la force Sentinelle au plus près de ses lieux de déploiement, et les rapporteurs ont pu constater que des travaux de reconversion des bureaux désaffectés de l’îlot Saint-Germain en hébergements avaient déjà été entrepris. La « réactualisation » de la loi de programmation militaire devra résoudre cette contradiction.
c. La question du financement des opérations intérieures
i. Un financement satisfaisant pour l’exercice 2015
• Les demandes de la défense ont été satisfaites
Pour couvrir les surcoûts nets ‒ c’est-à-dire agrégeant les dépenses supplémentaires et les dépenses évitées ‒ qu’il estime liés à l’opération Sentinelle, le ministère de la Défense a demandé l’ouverture de crédits au titre de réserve interministérielle de précaution pour, comme le montre le tableau ci-après, 118 millions d’euros hors titre 2 et 55,5 millions d’euros de crédits de titre 2 :
‒ les crédits demandés hors titre 2 concernent des activités de préparation, quelques petits équipements et des crédits de fonctionnement (le détail est présenté dans le tableau de la page suivante).
‒ les crédits de titre 2 demandés concernent principalement les surcoûts d’indemnité de service en campagne (ISC), de solde de réservistes et d’indemnité de sujétion d’alerte opérationnelle (ISAO). S’agissant de l’ISC, la somme demandée résulte de la multiplication du coût moyen de 38,66 euros par jour par l’effectif déployé, et de la prise en compte des moindres dépenses liées à l’annulation d’activités opérationnelles des forces au sein des centres spécialisées de l’armée de terre, à la réduction du format du défilé du 14 juillet à Paris (annulation de 30 % du défilé motorisé) et en province (annulation de 40 % en moyenne des effectifs mobilisés pour le défilé).
SURCOÛTS HORS TITRE 2 LIÉS À L’OPÉRATION SENTINELLE ESTIMÉS PAR LA DÉFENSE
(en millions d’euros)
P178 |
P212 |
Total | |
activité opérationnelle (alimentation, hébergement, carburant, etc.) |
24,8 |
|
24,8 |
entretien programmé du matériel |
4,2 |
|
4,2 |
équipement d’accompagnement et de cohérence (équipements terrestres, de soutien, munitions, etc.) |
35,1 |
6,0 |
41,1 |
fonctionnement et activité spécifique (fonctionnement du service du commissariat des armées des bases de défense) |
22,1 |
|
22,1 |
entretien programmé du personnel (matériels de restauration collective, habillement, etc.) |
24,6 |
|
24,6 |
socle VIGIPIRATE |
-1,2* |
|
-1,2 |
moindres dépenses |
-6,5* |
|
-6,5 |
infrastructure |
|
8,8** |
8,8 |
Total |
103,2 |
14,8 |
117,9 |
* Moindres dépenses : Sentinelle contraint à annuler ou réduire des activités d’entraînements ou d’activité et a donc un impact sur le nombre de journées de préparation opérationnelles réalisées en 2015. Les dépenses engagées au titre de Vigipirate, qui préexistait et qui a été fusionné au sein de Sentinelle, sont à déduire des dépenses Sentinelles. Enfin, il convient de réduire les dépenses d’alimentation des militaires engagées dont l’alimentation n’est, de fait, plus assurée par les services de restauration de leur garnison d’affectation.
** Dépenses d’infrastructure destinées à faire face aux besoins d’une force de 10 000 hommes sur le territoire national.
Source : direction du budget du ministère des Finances.
Le ministère de la Défense a présenté cette somme comme un surcoût net, c’est-à-dire tenant compte de la réduction des activités de préparation opérationnelle, du format du défilé du 14 juillet, etc. Le secrétaire général pour l’administration (SGA) du ministère a précisé que le montant obtenu en 2015 « correspond à la demande faite par la défense ». Le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance ouvre en effet 119 millions d’euros ‒ les dernières prévisions du ministère de la Défense ont conduit à revoir le besoin de crédits de personnels à la baisse, pour trois millions d’euros, et à la hausse les besoins de crédits hors titre 2, pour deux millions d’euros.
• Une méthode de calcul des surcoûts liés aux opérations intérieures a commencé à être élaborée
Selon MM. Vincent Moreau, sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget du ministère des Finances et Dominique Blaes, chef du bureau de la défense et de la mémoire au sein de cette direction, la discussion interministérielle pour l’évaluation de ces « surcoûts OPINT » a reposé sur des bases particulières. En effet, « le ministère du Budget ne dispose pas de la capacité de contre expertiser les évaluations de la Défense ». Par ailleurs, à la différence de l’estimation des surcoûts OPEX, qui fait l’objet d’une « méthodologie commune et partagée, socle d’une relation de confiance », il n’existe pas de référentiel interministériel des « surcoûts OPINT », ni de clause d’assurance, ni de provision dans la LPM actualisée. Le calcul des surcoûts est d’autant plus compliqué pour les opérations intérieures que même si l’opération Sentinelle ne les avait pas mobilisées, les unités déployées sur le territoire national auraient eu d’autres activités génératrices de dépenses.
En effet, Bercy ne peut pas vérifier la programmation homme par homme des activités d’entraînement qui ont été annulées (et qui auraient dû donner lieu au versement d’une ISC). Ainsi, la défense présente des surcoûts nets, mais Bercy ne peut pas vérifier la réalité ou le volume de l’économie résultant de l’annulation d’activités au profit de Sentinelle. En effet, 80 % des personnels de l’armée de terre percevaient déjà l’ISC : « le socle étant distribué sur une assiette très large (80 % de l’armée de terre), et la prime ayant été mensualisée, la comptabilisation des surcoûts est difficile ». Fin novembre 2015, le logiciel Chorus indiquait que la consommation d’ISC était à peine supérieure à celle de l’année passée : moins de cinq millions d’euros d’écart, alors que la défense demandait la prise en charge d’un surcroît d’ISC qu’elle évaluait à 35 millions d’euros. Le ministère de la Défense explique le faible écart de consommation d’ISC affiché par Chorus par un effet de base : la référence à l’exercice 2014 serait trompeuse, car sous-évaluée du fait des retards et dysfonctionnements de l’écosystème Louvois. Les arbitrages ont finalement retenu, à quelques millions près, les chiffres de la défense.
Le renoncement aux déflations prévues en 2015, avec la révision du schéma d’emploi des armées courant 2015 validée par la loi actualisant la programmation militaire, a également créé un surcoût de dépenses de personnel par rapport aux prévisions de la loi de finances pour 2015. ‒ qui, elles, n’ont pas été actualisées. Ce surcoût est évalué à 60 millions d’euros, mais le ministre de la Défense n’avait pas demandé de crédits supplémentaires en fin de gestion pour prendre en compte les non-déflations de 2015 : ces 60 millions d’euros ont été pris en charge par le ministère sur ses crédits. Pour Bercy, « il convient de distinguer, d’une part, l’allégement du schéma d’emploi lié à la révision du contrat protection et, d’autre part, les surcoûts indemnitaires liés au déploiement Sentinelle ».
Ainsi, une méthodologie est en voie de définition pour la mesure de la réalité des surcoûts liés aux opérations intérieures.
ii. Un parallèle avec les OPEX qui gagnerait à être établi par les textes
Les surcoûts liés aux opérations extérieures font l’objet d’une prise en charge au titre de la réserve interministérielle de précaution, et sont évalués suivant une méthode qui, au fil des ans, a fini par ne plus soulever d’observations ni des finances, ni de la défense.
Pour le secrétaire général pour l’administration du ministère de la Défense, « dès lors qu’il y a un précédent pour 2015, il serait logique que le même mécanisme soit mis en place chaque année ». Il n’y a en revanche, pour l’instant, aucune règle écrite.
Dans son rapport le projet de loi de finances pour 2016 (37), notre collègue Charles de La Verpillière consacre des développements approfondis aux incertitudes pesant sur le financement de ces surcoûts et juge « regrettable que la loi actualisant la programmation militaire, pourtant discutée après le lancement de l’opération Sentinelle, n’ait pas prévu expressément de mécanisme de financement interministériel des surcoûts liés aux opérations intérieures ». En effet, « faute de disposition explicite, il n’y a pas de fondement juridique » pour un traitement analogue des deux catégories de surcoûts, et « l’on pourrait avoir l’impression que le législateur n’a pas jugé bon d’établir un parallèle entre le régime des surcoûts liés aux OPEX et celui des surcoûts liés aux opérations intérieures ».
B. LA QUESTION DE LA JUSTE PLACE DES ARMÉES DANS LA PROTECTION DU SOL NATIONAL À LONG TERME
Si la « réactualisation » de programmation militaire ‒ ou le vote d’une nouvelle loi de programmation ‒ doit régler ces dispositions techniques, elle doit également être l’occasion d’un débat politique de fond sur la posture de protection terrestre, de façon à ce que la légitimité de la solution retenue repose sur une assise large dans l’opinion.
1. Quels champs de compétence respectifs pour les armées et les forces de sécurité intérieure ?
La première question qui viendra à se poser dans un débat politique de fond, préalable à une « réactualisation » de la programmation militaire, tient à l’existence même de l’opération Sentinelle et, plus largement, de la posture de protection terrestre, en ce qu’elle a vocation à ne pas être ponctuelle : le territoire national est-il « l’affaire » des armées ? Sentinelle est-elle vraiment « l’affaire » des militaires, ou plutôt des forces de sécurité intérieure ?
a. « Les armées ont-elles leur place sur le territoire national ? »
In fine, la question qui revient le plus souvent est de savoir si la France, depuis les attentats de 2015, est ou non « en guerre », ce qui justifierait le recours aux armées sans qu’il y ait besoin d’examiner plus avant la question. Cette notion apparaît fréquemment dans les discours du Premier ministre.
i. La question récurrente de l’état de guerre
Toutefois, elle mérite un examen approfondi. M. Jacques Toubon a ainsi jugé que « l’emploi, pour la situation actuelle du territoire national, du vocabulaire de la guerre est une erreur » et conduit à une « surenchère sécuritaire », rappelant que « la guerre, c’est essayer de ne pas être tué en tuant ».
En tout état de cause, la France peut difficilement être vue à bon droit comme étant en situation de guerre sur son territoire national. D’ailleurs, devant la commission (38), le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a fait observer aux députés : « c’est l’état d’urgence que vous avez voté, non l’état de siège ! ». Une situation de guerre se reconnaît en effet à deux critères : d’une part, l’intensité de la violence et, d’autre part, la capacité d’organisation de l’adversaire, qui supposerait qu’il contrôle un territoire. S’il est vrai que l’on entend le plus souvent ce terme pour désigner des conflits armés interétatiques, il n’en est pas moins vrai la France participe à un conflit armé au sein d’une coalition, au Levant ; en ce sens, la France est bien en guerre, au Levant. La France se trouve-t-elle pour autant en guerre sur son territoire national ? Répondre par l’affirmative ne paraît pas fondé s’agissant du territoire national, dans la mesure où Daech ne contrôle pas de partie de ce territoire.
Si tel était le cas, des adaptations du droit existant seraient d’ailleurs nécessaires. On peut penser notamment au dispositif de l’excuse pénale, établie par le code de la défense au bénéfice des militaires pour les opérations de guerre. Ce dispositif n’est prévu que pour les OPEX, et il y trouve sa légitimité dans l’existence d’une alternative juridique : le droit des conflits armés. Si le territoire national était le siège d’un conflit armé, la question pourrait alors se poser d’étendre cette excuse pénale au bénéfice des soldats engagés dans la protection du territoire national. Cette hypothèse est cependant écartée pour l’instant. On en reste donc au système classique d’engagement des forces sur réquisition de l’autorité civile prévu par l’article L. 1321-1 du code de la défense.
On pourrait se poser la question de savoir si le volume de l’opération Sentinelle, bien plus important que celui de la contribution des armées au plan Vigipirate, ne traduit pas à un changement de nature même de l’opération Sentinelle par rapport à la situation antérieure. D’ailleurs, le rapport au Parlement parle volontiers d’« opération militaire », mais si l’opération Sentinelle est bien une opération militaire eu égard au volume des forces engagées, comme au fait qu’elle a été engagée par une décision prise en Conseil de défense ‒ organe compétent pour ordonner la réponse aux crises majeures ‒, il n’en demeure pas moins que par nature, elle reste à ce jour une opération de sécurité intérieure.
Pourrait-on considérer que l’ennemi étant, sur le territoire national, le même que celui que combattent les armées au Levant, il devrait y avoir aussi un continuum du cadre juridique de ce conflit ? Si la militarisation de la violence sur le territoire national est un fait indéniable, et crée une rupture, pour autant, il ressort des travaux des rapporteurs que la doctrine française ne conçoit l’application du droit des conflits armés que localisée. Certes, cette doctrine a pu évoluer, récemment, notamment pour prendre en compte les effets de frontières nationales au Sahel, où la menace n’est nullement contenue par des frontières d’ailleurs assez lâches. Mais notre doctrine n’a pas évolué au point que la France envisage à l’inverse d’appliquer le droit des conflits armés en tous lieux, ce qui peut être vu comme ayant été la contribution du président américain George W. Bush à la doctrine. Ainsi, la France n’estime pas qu’un terroriste de Daech « importe » avec lui le droit des conflits armés quand il immigre de Syrie.
ii. Une question sans véritable pertinence
Pour les rapporteurs, non seulement considérer que la France est en état de guerre sur son territoire national est excessif, mais de surcroît, il n’est nul besoin d’être « en guerre » pour que les armées prêtent leur concours aux forces de sécurité intérieure.
• Une sur-réaction lexicale
À cet égard, les rapporteurs observent que l’« effet de cliquet », dont ils ont montré qu’il était à l’œuvre dans l’établissement des niveaux d’alerte et dans la fixation des effectifs engagés dans les missions de protection, est peut-être à l’œuvre dans l’emploi du vocabulaire de « guerre ». Si la situation sécuritaire actuelle doit être qualifiée d’état de guerre, quelle qualification pourrait-on employer si la situation empirait encore ? Si, pour reprendre l’exemple évoqué plus haut, un groupe terroriste d’inspiration djihadiste opérait une sorte d’« Oradour-sur-Glane » dans une zone difficile d’accès dont nos forces ne reprendraient le contrôle que sous un délai ‒ nécessaire à leur acheminement ‒ qui permettrait audit groupe d’infliger des dommages considérables ?
Par ailleurs, il ressort aussi des discussions des rapporteurs sur le terrain que le commandement militaire peut se trouver en situation de soutenir un paradoxe face aux hommes auxquels il demande de subir sans faillir une suractivité éprouvante au nom d’un « état de guerre », et qui ne peuvent que s’interroger sur la réalité de celui-ci en voyant que des troubles majeurs à l’ordre public se produisent tout de même.
M. François Heisbourg a d’ailleurs insisté sur l’importance stratégique du vocabulaire utilisé dans la situation actuelle : « c’est une erreur profonde que de donner aux criminels de Daech la dignité de combattant : rien de mieux pour galvaniser leurs recrues et faciliter leur recrutement ». Les Français, selon lui, sont en outre les seuls à utiliser ce vocabulaire pour qualifier leurs opérations contre Daech. Le terme de « guerre » n’est pas approprié dans le cadre de la lutte antiterroriste contre Daech pour trois raisons :
‒ Daech ne mérite pas qu’on l’assimile à un « État », menant une « guerre » et constituant une « armée ». Employer ces termes est « une erreur stratégique », car « nous parlons exactement de la façon dont ils voudraient que l’on parle d’eux » ;
‒ juridiquement, la France n’est ni plus ni moins « en guerre » que lors d’une opération extérieure classique comme en Afghanistan ou au Mali : « Chammal n’a rien de spécifique à cet égard » ;
‒ le caractère à la fois intérieur et extérieur des opérations pose un problème : la plupart des acteurs étant français et les opérations s’effectuant sur le territoire national, le risque est fort de « glissement vers un vocabulaire de guerre civile », dont l’emploi pourrait d’ailleurs être auto-réalisateur.
Ces arguments rejoignent ceux que notre collègue François Lamy a déjà développés dans son rapport précité, dont l’encadré ci-après reprend un développement-clé.
Réfléchir à la notion même d’« opération intérieure »
Depuis près de vingt ans, le rapporteur a pu observer que la notion même d’« opération intérieure » suscite une certaine réserve chez certains acteurs ou certains commentateurs des affaires militaires. On peut d’ailleurs tirer de l’analyse des Livres blancs de 2008 et de 2013, ainsi que du suivi de leurs travaux d’élaboration, l’impression d’une forme de réticence des hautes autorités civiles et militaires à s’engager trop avant dans l’emploi de ce concept.
À cet égard, il faut remarquer que l’on emploie plus volontiers l’expression de « missions intérieures » pour désigner les engagements des armées ‒ et particulièrement de l’armée de terre ‒ sur le territoire national et sous le commandement opérationnel du chef d’état-major des armées (CEMA), en soutien, en accompagnement ou en complément de l’action civile de l’État. C’est ainsi sous ce vocable que l’on regroupe diverses missions de protection du territoire national. (…)
Mais hormis la participation au plan Vigipirate avant 2015, la plupart des missions conduites en métropole servent des objectifs que l’on pourrait qualifier « de service public » plutôt que de sécurité. Elles mobilisent des capacités certes très spécialisées et parfois en volume important, mais rarement des capacités de combat : prêter main-forte aux services d’incendie et de secours en cas de catastrophe naturelle n’est pas tout à fait de même nature qu’une « opération » au sens strictement sécuritaire ou militaire du terme. Et même pour les missions des armées relevant de la sécurité, leur engagement était conçu dans une logique d’urgence et de réversibilité, et non pour durer. De même, comme le général Jean-François Parlanti, directeur du centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations (CICDE) l’a fait observer au rapporteur, on parle à ce stade de « territoire » et non de « théâtre » national : la nuance est importante.
Cette réticence à développer le concept d’« opération intérieure », que le rapporteur a pu percevoir depuis longtemps, peut tenir ‒ en partie au moins ‒ à ce que le terme d’opération évoque de mobilisation de capacités de combat, de contexte de guerre.
Pour le rapporteur, il convient en effet de bien mesurer les conséquences ‒ politiques mais aussi juridiques ‒ de l’utilisation du concept de guerre. Employé mal à propos au territoire national, il risquerait de conduire certains à une logique de combat contre quelque « ennemi de l’intérieur », ainsi qu’à une escalade rhétorique éloignée de la position que les pouvoirs publics et les autorités politiques ont constamment, et avec raison, affirmée depuis le 11 janvier. Il y a une nuance importante entre la notion d’« ennemi à l’intérieur », que certains observateurs emploient pour caractériser la situation actuelle, et la rhétorique de l’« ennemi de l’intérieur ». Pour le rapporteur, il y a un danger à passer de la première à la seconde sans prendre garde au sens et à la résonance historique de ces expressions.
Bien sûr, le rapporteur ne méconnaît pas la nouveauté de la situation actuelle : l’engagement de l’armée de terre sur le territoire national, qui est massif sans être ponctuel, constitue un changement de conception par rapport aux pratiques antérieures, mais aussi par rapport à une tendance longue de notre histoire militaire. En effet, depuis le Livre blanc de 1994 et au fil des réformes, l’armée de terre a poursuivi une transformation de fond vers un standard nouveau : celui d’une armée professionnelle, dont le format et l’empreinte territoriale sont devenus très réduits au fur et à mesure des restructurations et des dissolutions, et organisée de façon à produire d’excellents effets dans des opérations extérieures, souvent menées en coalition, tandis que le territoire national était vu comme ne faisant pas l’objet de menaces militaires majeures. Or, comme le chef d’état-major de l’armée de terre l’a fait valoir, « la population ne comprendrait pas que l’armée de terre reste dans ses casernes en période d’attaques terroristes ».
Faut-il, pour autant, développer aux côtés de la police et de la gendarmerie une troisième force de sécurité intérieure, qui serait militaire ? Le débat est certainement ouvert, mais le rapporteur relève qu’en l’état des réflexions, l’idée d’aller si loin rencontre plusieurs obstacles qu’il ne faut pas négliger :
‒ le rapporteur n’observe pas (loin s’en faut) au sein de l’armée de terre de consensus pour souhaiter voir cette armée devenir une troisième force de sécurité intérieure, et encore moins se voir confier de façon durable des responsabilités en matière de maintien de l’ordre. D’ailleurs, la nature de ces missions relève plus sûrement de la gendarmerie nationale, force de sécurité intérieure capable de mener des opérations militaires ;
‒ pour plusieurs des acteurs interrogés par le rapporteur, il faut accorder une attention particulière à l’histoire et à la culture françaises en la matière, et se garder d’importer tels quels des concepts issus de pays où le recours aux forces armées pour la sécurité intérieure, voire pour le maintien de l’ordre, est présenté comme habituel, voire banal ;
‒ comme l’a fait valoir au rapporteur M. Pascal Lalle, directeur central de la sécurité publique à la direction générale de la police nationale (DGPN), dans notre droit, une force de sécurité intérieure, même de nature militaire, ne pourrait être investie de pouvoirs de police judiciaire sans être subordonnée à l’autorité fonctionnelle du garde des Sceaux ;
‒ plusieurs responsables ont appelé l’attention du rapporteur sur la précaution avec laquelle on peut donner à la population le sentiment qu’elle vit sous une menace permanente, car les postures d’urgence s’avèrent difficiles à tenir dans la durée. Pour M. Pascal Lalle, confier aux armées des pouvoirs de police étendus ou créer une nouvelle force de sécurité intérieure à caractère militaire, voire placée sous l’autorité du ministre de la Défense, ne peut être entrepris qu’après une analyse du signal ainsi donné à la population. Or préserver les capacités de résilience de la population pour l’avenir suppose de manier avec prudence et mesure les signes d’alerte, pour pouvoir proportionner de manière rationnelle le niveau d’alerte ‒ ainsi que le volume des forces déployées ‒ au fur et à mesure de l’évolution de la menace.
Source : rapport pour avis n° 3115, tome IV, précité.
• Un lien infondé avec l’emploi des armées sur le territoire national
Les rapporteurs considèrent qu’en tout état de cause, même si la France ne peut pas à bon droit se considérer comme étant « en guerre » sur son territoire national ‒ ce qui est certainement le cas, du moins pour l’heure ‒, cela ne constitue absolument pas une raison pour récuser l’engagement de ses armées pour la protection du territoire national.
Comme les rapporteurs l’ont montré, les armées protègent déjà notre territoire, au quotidien et en première ligne ‒ en « primo-intervenantes » ‒ dans les milieux maritime et aérien. Faudrait-il pour cela que la France se déclare « en guerre » dans ses approches maritimes ou son espace aérien ?
Ils ont également montré que, depuis longtemps en France comme dans la plupart des démocraties occidentales, les armées constituent un « réservoir de forces » dont le Gouvernement aurait tort de se priver pour la gestion des crises majeures, telles que les attentats de 2015. Et ce, que ce soit en raison des capacités techniques qu’elles possèdent, de la portée symbolique de leur engagement, de l’économie générale du dispositif ‒ l’état militaire est ainsi réglé qu’en temps de crise sécuritaire, leur statut rend l’engagement des personnels réactif et relativement peu coûteux, tandis qu’en temps normal, leur polyvalence permet de les employer à d’autres missions ; en outre, le statut de contractuels de 70 % d’entre eux permet une gestion des effectifs dans la durée plus souple que dans d’autres corps.
b. Où les armées ont-elles leur place sur le territoire national ?
Pour les rapporteurs, il ne s’agit pas, bien entendu, de « banaliser » l’emploi des armées sur le territoire national. À leurs yeux, dès lors que le Gouvernement choisit d’engager les armées sur le territoire national, il convient qu’elles le soient avec les moyens d’accomplir la mission qui leur est confiée.
À cet égard, on ne saurait se satisfaire d’une posture qui accapare la majorité des personnels pour des gardes statiques dont l’efficacité est inférieure à celle des techniques militaires de contrôle de zone. De même, sans méconnaître les spécificités du théâtre national, on ne peut pas pour autant soutenir qu’il est cohérent avec une ambition affichée d’exploiter la plus-value professionnelle des armées que de demander aux armées d’opérer sans un cadre clair réglant le recueil, le traitement, l’exploitation et le partage de l’information d’intérêt opérationnel.
En revanche, les armées sont-elles les mieux placées pour intervenir essentiellement en milieu urbain ? Les effectifs que permettrait de libérer le développement de modes d’action plus proches de la technique militaire du contrôle de zone ‒ fût-ce sur des zones très restreintes de « garde dynamique à vue » ‒ pourraient utilement être employés à sécuriser des espaces où leurs capacités de mobilité présenteront une plus-value plus évidente, comme les zones rurales ou les espaces frontaliers.
Enfin, faut-il vraiment opposer forces de sécurité intérieure et armées ? Pour les rapporteurs, dès lors que le recours à un « réservoir de forces » s’impose comme un moyen efficace à la disposition de l’État, il y aurait beaucoup à gagner à ce que l’action des armées et des forces de sécurité intérieure soit davantage coordonnée, par un organe interministériel de planification et de conduite des opérations sur le territoire national.
Voilà, sans prétention à l’exhaustivité de la part des rapporteurs, quelques lignes directrices pour une réflexion approfondie sur la juste place et le rôle pertinent des armées sur le territoire national.
2. Quelles places respectives pour les militaires d’active et les réservistes ?
Définir la juste place et le rôle pertinent des armées sur notre territoire national est une chose ; elle ne saurait être détachée d’une autre question : celle de savoir à quelles composantes des armées l’on fait ainsi référence. En effet, s’agissant du territoire national, ce serait une erreur que de négliger ce que la réserve opérationnelle peut apporter.
C’est en ce sens que les rapporteurs entendent des déclarations que le président de la République a faites aux parlementaires réunis en Congrès le 16 novembre 2015, lorsqu’il a appelé à « mieux tirer parti des possibilités des réserves de la Défense » et précisé que celles-ci « peuvent, demain, former une Garde nationale encadrée et disponible ». Comme le souligne M. Élie Tenenbaum dans la publication précitée de l’IFRI, « si le terme de “garde nationale” ne correspond pas nécessairement aux références historiques adéquates (39), la territorialisation du corps réserviste ainsi que la réduction des durées de mobilisation devraient en permettre un usage plus souple et mieux planifié dans les opérations intérieures ».
a. Des réserves engagées dans une profonde transformation
Le général Christian Thiébault, secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire, a expliqué que face à la menace actuelle, la réserve est engagée dans une nouvelle évolution de sa structure avec un renforcement de ses effectifs tournés vers la projection sur le territoire national, et le développement d’une réserve de spécialistes, notamment dans le domaine de la cyberdéfense.
Pour lui, cette refonte de la place et des fonctions de la réserve militaire représente « une évolution profonde des cultures ». En effet, alors que la réserve avait connu depuis une quinzaine d’années une baisse constante de ses effectifs, le général Thiébault présente l’année 2016 comme le début d’une « nouvelle dynamique » pour la réserve militaire à deux égards :
‒ l’augmentation des effectifs et de l’intensité de leur emploi : en 2015, les effectifs augmentent pour atteindre 28 100 réservistes après des années de diminution, et le nombre moyen de jours d’activité des réservistes a également augmenté : il s’élève en 2015 à 27,9 jours, contre 24 jours en 2014 ;
‒ le nombre moyen de jours d’activité des réservistes en projection intérieure augmente en 2015 de 347 % par rapport à 2014. De 102 en 2014, le nombre de réservistes par jour engagés en opérations intérieures est passé à 457 en 2015 avec un pic d’activité de 610 hommes par jour au second semestre 2015, correspondant au déploiement de seize sections de réserve.
Le budget des réserves est en nette hausse : il est passé de 71 millions d’euros en 2014 à 96,3 millions d’euros en 2016 et devrait ainsi permettre d’atteindre l’objectif ‒ déjà ancien ‒ de 30 jours d’activité par réserviste, ainsi que de recruter 3 000 réservistes supplémentaires. L’effort financier est consacré quasi totalement à la fonction stratégique de protection.
Néanmoins, pour atteindre l’effectif de 40 000 réservistes fixé par la loi de programmation militaire, des efforts de recrutement restent à faire. Le général Christian Thiébault a souligné l’importance qu’il y a à exploiter tous les viviers de recrutement dans la montée en puissance actuelle des effectifs des réserves de l’armée de terre, que présente l’encadré ci-après.
Viviers de recrutement prioritaires de la réserve opérationnelle
Parmi les viviers de recrutement à exploiter, le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire a cité notamment :
1./ Les entreprises
Il existe déjà 360 conventions de partenariat entre des entreprises et la réserve. Afin de développer ces conventions, le Conseil supérieur de la réserve militaire anime un réseau de correspondants réserve-entreprises-défense (CRED) chargés de favoriser l’acceptation par les entreprises des contreparties que l’engagement dans la réserve militaire implique. Ce dispositif est appelé à s’étendre puisque l’objectif à l’horizon 2019 est d’atteindre le chiffre de 100 CRED, contre 56 actuellement.
Le général a évoqué une autre piste pour inciter les entreprises à accepter le principe de l’engagement dans la réserve : assimiler les périodes de formation militaire des réservistes comme des périodes de formation professionnelle au sens de la législation sociale et, à terme, faire entrer l’ensemble des activités de réserve dans la formation professionnelle. Cependant, le général Thiébault reste réservé sur l’idée d’un renforcement de la législation pour contraindre les entreprises à consentir à la réserve. À ses yeux, l’exemple de la contrepartie financière mise en place au Royaume-Uni, et n’ayant pas donné de résultats probants, appuie l’idée que des leviers incitatifs sont plus efficaces que la contrainte. D’ailleurs, il a rappelé qu’à la suite des attentats du 13 novembre 2015, plusieurs entreprises ont volontairement accordé des jours supplémentaires à leurs employés réservistes.
2./ La fonction publique
Selon le général Thiébault, « la fonction publique doit donner l’exemple ». Le secrétaire général du CSRM juge nécessaire une révision de la circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve militaire (dite « circulaire Sauvé »). Au sein de la fonction publique, la démarche est en quelque sorte graduée : le ministère de la Défense doit donner l’exemple, puis c’est au tour du reste des administrations de l’État et de la fonction publique territoriale de suivre.
La fonction publique territoriale constitue ainsi un vivier conséquent pour le recrutement de réservistes. Les discussions engagées entre le ministère de la Défense et le secrétaire général de la fonction publique territoriale dans ce domaine sont à ses yeux « constructives ». En la matière, le général Thiébault a pour objectif d’approfondir les possibilités offertes par les dispositifs de gestion du « temps partagé » des agents publics. En effet, les centres de gestion de la fonction publique territoriale ont d’ores et déjà développé des outils permettant à un même employé de partager son temps de travail entre différents employeurs (les collectivités territoriales et leurs établissements) ; l’objectif du général Thiébault consiste à ce que le ministère de la Défense puisse être assimilé à un employeur supplémentaire pour ceux de ses réservistes qui relèvent de la fonction publique territoriale. Une expérimentation à l’échelle d’une région permettrait d’évaluer la viabilité du dispositif.
3./ Les demandeurs d’emploi
Par ailleurs, le secrétaire général du CSRM a indiqué qu’il travaillait avec la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) pour améliorer la coopération entre Pôle emploi et les armées. Il existe cependant quelques obstacles administratifs avec l’inadéquation entre les bulletins de solde et le mode de prise en compte de Pôle emploi : ce dernier exige une déclaration de revenus dans un délai d’un mois alors que les armées ne peuvent la fournir que sous trois mois.
L’exemple des sapeurs-pompiers prouve que les demandeurs d’emploi sont un vivier important de recrutement de réservistes : 21 000 pompiers volontaires sont actuellement demandeurs d’emploi. L’intérêt pour les demandeurs d’emploi est double. Dans le même ordre d’idées, le CSRM est en cours de négociation pour signer une convention avec Adecco (société de placement en intérim), qui pourrait être intéressante.
4./ Les universités et les grandes écoles
De plus, des partenariats avec des universités et grandes écoles permettent de promouvoir l’engagement dans la réserve en accordant des crédits ECTS. Le secrétaire général du CSRM espère étendre ces accords. Le général Thiébault a tenu à noter que les principales cibles de recrutement sont cependant davantage les jeunes en lycée ou en formation professionnelle.
b. Un engagement prioritaire des réservistes de l’armée de terre sur le territoire national
Les réservistes contribuent à la protection du territoire national soit en renfort des unités d’active, soit en unités constituées (section ou groupe), ou encore, le plus souvent, indirectement, en remplacement des militaires d’active engagés eux-mêmes dans l’opération Sentinelle, suivant des modalités présentées par l’encadré ci-après.
Le recours aux réserves dans le cadre de l’opération Sentinelle
Les réservistes sont intervenus de deux manières dans Sentinelle : soit en appuyant directement les unités d’active, soit en facilitant le déploiement de militaires d’active.
Dans le premier cas, les réservistes renforcent les unités d’active et sont pleinement intégrés à leur mission. Même si de petites unités de réserve ont parfois été déployées de façon autonome, le général Thiébault a insisté sur la pertinence de mêler réservistes et militaires d’active dans la composition des patrouilles.
Dans le second cas, les réservistes remplacent des militaires d’active dans leur garnison afin de leur permettre de participer à l’opération Sentinelle. L’opération Sentinelle suppose en effet une préparation au « corps à corps » pour laquelle les compétences de certains réservistes ne sont pas toutes à jour. Ces réservistes peuvent donc être employés dans la surveillance des emprises militaires et points sensibles et ainsi indirectement concourir à la mission Sentinelle.
Actuellement, 205 réservistes sont déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle et plus de 100 en renforcement indirect. Le général Thiébault a tenu à préciser que les réservistes ne doivent pas être considérés comme une composante « supplétive » de l’armée de terre. En effet, le réserviste a, sur une même mission, les mêmes qualifications qu’un militaire d’active. Ainsi, les réservistes déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle ont les mêmes « prérequis » que les militaires d’active. Pour le général Thiébault, « l’engagement de réservistes en effectifs conséquents sur le territoire national est un signe très encourageant. Les réserves permettent aux armées de retrouver leur liberté d’action, avec une grande souplesse d’emploi et à moindre coût ».
Le secrétaire général du CSRM a par ailleurs détaillé le changement d’orientation dans la formation des réservistes. Auparavant, celle-ci visait à rendre un réserviste opérationnel sur des missions « tous lieux tous temps ». La logique actuelle favorise davantage l’acquisition de compétences en lien direct avec la première mission du réserviste. Ainsi, la formation d’un réserviste destiné à être engagé en premier lieu pour l’opération Sentinelle se concentre sur les qualifications essentielles pour cette mission précise. La formation militaire initiale (FMI) du réserviste dure 21 jours la première année et lui permet d’être disponible 20 % du temps pour les besoins de l’armée. Ce pourcentage s’élève à 50 % la deuxième année et à 80 % la troisième année.
Actuellement, sur les 28 100 réservistes, 10 000 ont vocation à participer à la fonction de protection, les autres servant en « compléments individuels de compétences ». L’objectif est de créer 19 unités de réserve dans l’armée de terre d’ici 2019, soit 8 000 hommes, 17 compagnies Roméo dans la marine, soit 1 000 fusiliers marins réservistes et de passer de 15 à 19 sections de réserve d’appui (SRA) dans l’armée de l’air.
Interrogé sur la proposition du président de la République de « déployer mille réservistes en permanence », le général Christian Thiébault a précisé que cet objectif concerne la fonction de protection en général et non pas seulement Sentinelle. Actuellement, avec l’opération Sentinelle et le plan Cuirasse, des réservistes assurent des missions d’aide au service public, à la protection des approches maritimes (au sein des sémaphores, comme le montre l’encadré ci-après) ou aérien. La prise en compte de toutes ces missions conduit à porter l’effectif actuel employé sur le territoire national à 457 réservistes.
Le général Christian Thiébault a indiqué aux rapporteurs que ces nouvelles unités avaient vocation à s’intégrer dans les chaînes d’active telles que des brigades ou des régiments. À terme, chaque formation d’active pourrait disposer d’au moins une compagnie de réserve, sur son site principal mais aussi à d’autres endroits afin de resserrer le maillage territorial de l’armée de terre. Le 6e régiment de génie d’Angers est actuellement le seul exemple d’unité en France à posséder aussi une unité de réserve, délocalisée à Nantes.
L’article 18 de la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire comporte des mesures visant à faciliter le recours à la réserve : la durée du préavis est réduite de 30 à 15 jours et le nombre de jours d’activité minimale est porté de 5 à 10. Selon la note précitée de l’IFRI, la montée en puissance des réserves dans la protection du territoire national se heurte toutefois à certaines difficultés, comme la durée de mobilisation et l’éloignement du lieu de résidence, qui demeurent des obstacles pour les employeurs. À ce titre, l’auteur cite le modèle de la réserve de la gendarmerie nationale, « qui fonctionne sur des durées réduites et sur une base départementale ». Déployer des réservistes à proximité de chez eux apporterait « une meilleure connaissance du terrain » et atténuerait les effets indésirables liés à l’éloignement des familles. Un tel système impliquerait cependant de « repenser le maillage territorial de l’armée de Terre et de réinvestir les déserts militaires », la note relevant que la récente création d’une unité de réservistes à Paris « semble aller dans ce sens ».
Pour les rapporteurs, un recours accru à la réserve pour les missions sur territoire national mérite d’être encouragé. Militaire à part entière, le réserviste doit pouvoir disposer de toutes les compétences nécessaires pour une opération telle que Sentinelle ‒ laquelle ne s’inscrit pas dans le haut du spectre de l’intensité de combat. Et militaire à temps partiel seulement, il peut apporter une contribution puissante au lien entre la Nation et ses armées sur notre territoire national.
La Commission procède à l’examen du rapport de la mission d’information sur la présence et l’emploi des forces armées sur le territoire national, au cours de sa réunion du mercredi 22 juin 2016.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. Notre collègue Christophe Léonard et moi vous présentons aujourd’hui les conclusions de la mission d’information sur la présence et l’emploi des forces armées sur le territoire national, mission dont vous nous avez désignés rapporteurs le 3 novembre dernier.
En fait de conclusions, on pourrait dire qu’il s’agit plutôt de contributions ‒ parfois d’ailleurs dans la forme interrogative ‒, car notre rapport constitue une étape dans un mouvement de réflexion, encore en cours, sur la doctrine d’emploi des armées sur le territoire national. En la matière, en effet, les positions évoluent ; en témoigne le fait que le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) vient tout juste d’entreprendre des actions de communication au sujet du rapport qu’il a soumis en février dernier au Premier ministre, et qui vient d’être déclassifié. Or, sur plusieurs points, sa position a évolué depuis qu’il nous avait présenté le premier état de ses réflexions, devant la commission puis devant nous, rapporteurs, en décembre dernier. La doctrine est donc en cours d’évolution et, après l’étape que constitue la présentation de notre rapport, nous nous proposons de continuer à suivre ces évolutions si la présidente le souhaite.
C’est une mission qui nous a conduits à beaucoup travailler. Nous avons procédé à une trentaine d’auditions, et entendu ainsi 56 personnes d’horizons variés : différentes autorités civiles et militaires chargées tant des opérations que de la doctrine, mais aussi des représentants des cultes ‒ car ils gèrent des sites protégés par nos soldats ‒, des services de renseignement, le procureur de Paris, des avocats spécialisés, des chercheurs, le Défenseur des droits… bref, un panel très varié de points de vue et d’opinions.
M. Christophe Léonard, rapporteur. Nos travaux portent sur une question fondamentale adressée aujourd’hui au pays : Vigipirate, lancé en 1995, a duré vingt ans ; l’opération Sentinelle, lancée en 2015, doit-elle durer vingt ans aussi ?
Nous avons tenu à enrichir notre réflexion par des comparaisons internationales, dont vous trouverez des conclusions très détaillées dans notre rapport. En effet, tous les pays ont un territoire national à protéger, et certains sont confrontés à la menace terroriste depuis fort longtemps. Nous nous sommes bien sûr limités à des pays qui peuvent être comparés au nôtre, c’est-à-dire à des démocraties occidentales. Nous nous sommes ainsi rendus à Londres, pour y étudier à la fois le « retour d’expérience » de l’opération Banner en Irlande du Nord et le plan d’intervention des armées britanniques en soutien de la police en cas d’attaque terroriste, plan inspiré par Sentinelle et ses premiers retours d’expérience. Nous nous sommes aussi rendus à Bruxelles, moins de 48 heures après les attentats du 22 mars 2016, ainsi qu’en Israël où, là encore, notre sujet d’étude s’est tragiquement imposé dans l’actualité, puisque nous étions à Tel-Aviv lors de l’attentat du 8 juin dernier.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. Nous nous sommes aussi rendus, bien entendu, auprès de nos soldats qui assurent la protection du territoire national, non seulement pour étudier avec les états-majors l’organisation des forces sur notre territoire, mais aussi pour discuter avec les hommes et les femmes des armées qui y sont engagés. La protection du territoire national, c’est d’abord, actualité oblige, l’opération Sentinelle. Nous nous sommes donc rendus à l’état-major de la force Sentinelle déployée à Paris, au fort de Vincennes, pour étudier la planification et la conduite de l’opération, et passer un moment ‒ à la fois instructif et convivial ‒ avec nos soldats, notamment ceux du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières qui étaient engagés à Paris lors de notre passage. Mais la protection du territoire national, c’est aussi la protection de ses approches aériennes et maritimes. Nous nous sommes donc rendus à Toulon, d’où est piloté le dispositif dit de « posture permanente de sauvegarde maritime » en Méditerranée, ainsi qu’en mer, à bord d’un aviso en mission de surveillance.
M. Christophe Léonard, rapporteur. En effet, il ne faut pas voir Sentinelle comme « l’alpha et l’oméga » de ce que les armées peuvent faire en matière de protection du territoire national. Sentinelle est, en quelque sorte, la portion émergée de l’iceberg : c’est la plus visible, mais il faut se garder d’y limiter toute réflexion sur la place des armées sur le territoire national. En ce sens ‒ et c’est la première chose que souligne notre rapport ‒, l’opération Sentinelle n’est pas une rupture en soi. En effet, depuis des décennies, ce sont les armées qui assurent la protection du territoire national pour ses approches maritimes et l’on connaît les enjeux de sécurité qui s’y attachent, notamment en Méditerranée. Elles assurent aussi la protection de l’espace aérien, au titre de ce que l’on appelle la « posture permanente de sûreté aérienne ». Dans ces espaces, dans ces deux « milieux » (maritime et aérien), les armées sont même en première ligne : elles n’interviennent pas en appui de forces de sécurité intérieure, elles sont dites « primo-intervenantes ».
Le Gouvernement nous a remis le 4 mars dernier un rapport sur les conditions d’emploi des forces armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national pour protéger la population, et ce rapport propose de créer une « posture de protection terrestre » : ainsi, il fait fond sur ce qui existe déjà pour les milieux aérien et maritime, modulo certaines spécificités du milieu terrestre sur lesquelles nous reviendrons.
Sentinelle a aussi fait fond sur Vigipirate : cela fait plus de vingt ans déjà que nos armées patrouillent dans les rues. Nous avons donc une longue histoire de contribution des armées à la protection du territoire national. Alors, me dira-t-on, Vigipirate, c’était le « bas du spectre » de l’intensité militaire : les FAMAS des hommes en patrouille n’étaient même pas chargés. Certes, mais l’armée de terre a aussi été engagée à un plus haut niveau de ce spectre sur le territoire national, en appui de la gendarmerie, en Guyane. C’est l’opération Harpie, qui dure dans sa forme actuelle depuis huit ans. Nous n’avons pas eu le temps de nous rendre en Guyane pour y étudier la planification et la conduite de cette opération, mais elle mériterait assurément que la commission s’y intéresse, en quelque sorte dans le cadre du suivi de nos travaux. Bref, nos armées sont engagées depuis longtemps sur le territoire national pour des missions de protection, et ce, sans même parler de leurs missions intérieures en cas de catastrophe naturelle, comme on en a connu encore récemment.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. Tout cela forme, comme nous le disons dans notre rapport, la « généalogie » de l’opération Sentinelle.
Nous ne voulons pas dire par là que Sentinelle ne marque en rien une rupture ; mais nous voulons souligner que l’engagement des armées sur le territoire national n’est pas en soi une nouveauté. Avec Sentinelle, on a changé d’échelle, mais pas vraiment changé de modèle.
La nouveauté tient avant tout au volume des forces engagées : schématiquement, c’est dix fois plus qu’avec Vigipirate ; 10 000 au lieu de 1 000. La nouveauté tient aussi au contexte de la mission : le terrorisme « militarisé » à but djihadiste. Nous ne nous étendrons pas maintenant sur la description de cette menace, que chacun ici connaît bien, si ce n’est pour souligner que les modes d’action quasi-militaires appellent un certain degré de « militarité » dans le dispositif de protection. D’ailleurs, la police elle-même s’équipe d’armes de guerre ; face à la kalachnikov, on peut difficilement faire moins que le FAMAS et le gilet pare-balles lourd…
Cet important déploiement militaire semble appelé à durer, et c’est là qu’il y a un changement de paradigme. En effet, si 10 000 hommes ont été engagés en janvier 2015, c’était conforme au contrat opérationnel des armées ‒ le « contrat de protection ». Toutefois, ni le Livre blanc ni aucun document doctrinal ne fixait expressément de durée maximale à un tel engagement. Implicitement, personne n’imaginait qu’il puisse durer plus d’un mois ; mais rien ne l’interdisait explicitement.
Et pourtant, l’opération dure, et le président de la République a décidé de la pérenniser, le 29 avril 2015, en Conseil de défense. De janvier à fin février 2015, l’effectif engagé gravitait autour de 10 000 hommes ; il a été ramené aux alentours de 7 000 de mars à novembre 2015, mais guère en deçà, en dépit de quelques allégements pendant l’été ; et depuis les attentats du 13 novembre, ce sont en permanence 10 000 hommes qui sont engagés.
C’est là que se situe la rupture : lorsque l’on est passé d’une logique d’engagement massif, mais ponctuel, à une logique d’engagement massif et durable. C’est là que les contrats opérationnels des armées ont été dépassés, une première fois au printemps 2015, et une nouvelle fois à la fin de l’année 2015. En effet, l’actualisation de la loi de programmation militaire (LPM) l’été dernier a révisé à la hausse les effectifs du « contrat opérationnel de protection », mais elle a fixé un plafond de 7 000 hommes déployés dans la durée, avec un « surge » possible à 10 000 hommes pour un mois seulement ; or, cela fait maintenant plus de sept mois que l’effectif de la force Sentinelle s’établit à 10 000 hommes.
C’est donc là, dans la « capacité à durer » sur le territoire national, que réside la difficulté. C’est là que l’équation sous-tendant la gestion des armées est devenue intenable, surtout pour l’armée de terre.
M. Christophe Léonard, rapporteur. Nous nous sommes en effet attachés à étudier les dysfonctionnements que l’opération Sentinelle ‒ ou plutôt : son inscription dans la durée ‒ a créés. Ces dysfonctionnements sont de plusieurs ordres.
D’abord, les militaires ont dû consentir un certain nombre de renoncements touchant à la condition du personnel : le nombre de leurs permissions a été réduit, et le nombre de jours d’engagement loin de leurs quartiers, et donc loin de leurs familles, couramment appelé « absentéisme », a considérablement augmenté. Bien sûr, la disponibilité en tout temps et en tout lieu est au cœur du statut des militaires ; mais là encore, la difficulté réside dans la « capacité à durer » : la « suractivité » crée des tensions conjugales, familiales ou morales qui s’aggravent avec le temps, et peuvent finir par peser sur le moral des hommes.
Mais les dysfonctionnements résultant de Sentinelle tiennent aussi à des renoncements à diverses activités de préparation opérationnelle. S’ils sont massifs et répétés, de tels dysfonctionnements peuvent peser sur la capacité opérationnelle de nos armées : c’est donc un véritable danger. Nous avons étudié en détail la portée de ces renoncements, c’est-à-dire, pour l’essentiel, ce sur quoi l’armée de terre a été contrainte de « faire l’impasse ». Il en ressort qu’après quelques perturbations en 2015, elle a veillé à préserver la formation initiale des hommes ‒ ce qui est d’autant plus important qu’elle recrute massivement ‒ et la préparation opérationnelle de ceux qui sont appelés à être engagés en opération extérieure. En revanche, la préparation opérationnelle interarmes a servi de variable d’ajustement : afin de libérer des effectifs pour Sentinelle, on a massivement annulé des grandes manœuvres d’entraînement dans nos camps de Canjuers, de Mailly, de Mourmelon, etc.
Il faut dire ici que ces dysfonctionnements affectent particulièrement l’armée de terre, et ce pour une raison simple : c’est elle qui fournit la quasi-totalité des troupes de l’opération Sentinelle. Mais il faut préciser aussi que les autres armées ne sont pas tout à fait épargnées, et loin s’en faut. En effet, parallèlement à Sentinelle, le ministère a dû mettre en œuvre le « plan Cuirasse », qui organise le renforcement de la protection des bases et autres emprises de la défense. Ce sont en effet des cibles de choix : l’intrusion dans le dépôt de munitions de Miramas l’a bien montré ; une attaque a été déjouée à Toulon en octobre dernier ; et je vous laisse imaginer l’impact qu’aurait une intrusion sur certaines bases aériennes particulièrement sensibles… Notre collègue Gwendal Rouillard, dans son dernier rapport, a bien montré la suractivité qui en résulte pour les fusiliers marins, et notre collègue Christophe Guilloteau nous a exposé quant à lui les tensions qui pèsent sur les forces de l’armée de l’air.
Les recrutements que nous avons votés en actualisant la loi de programmation militaire, en juillet dernier, doivent permettre aux armées, et particulièrement à l’armée de terre, de retrouver un rythme d’activité soutenable. Nous tenons toutefois à faire trois observations à ce sujet, qui concourent toutes les trois à montrer que tous les problèmes ne sont pas pour autant réglés.
Premièrement, avec le temps nécessaire à la formation des recrues, il faudra attendre l’été 2017 pour que les effectifs soient complets. L’armée de terre, en particulier, sera restée deux ans et demi en sous-effectif majeur, et les « renoncements » auront entre-temps entamé son « capital » de savoir-faire. Il faudra donc encore plus de temps pour retrouver le très haut niveau d’excellence professionnelle de l’armée de Serval.
Deuxièmement, même à effectifs complets, les militaires auront moins de temps pour l’entraînement, car selon toute vraisemblance, la menace pour laquelle on les a déployés sur le territoire national n’est pas appelée à s’estomper du jour au lendemain. Ainsi, avant le 7 janvier 2015, un soldat de l’armée de terre passait en moyenne 15 % de son temps de service en OPEX et 5 % en missions intérieures ; aujourd’hui, c’est toujours 15 % de son temps de service en OPEX, mais 40 à 50 % en mission intérieure (Sentinelle, Harpie ou Cuirasse) ; et même après les recrutements supplémentaires, le soldat passera encore 15 % de son temps de service en OPEX, et 20 % à 25 % de son temps en mission de protection sur le sol national.
Troisièmement, les effectifs supplémentaires que nous avons votés correspondent à un contrat opérationnel précis ‒ 7 000 hommes sur le territoire national, avec des pics à 10 000 pendant un mois au maximum ‒ mais ce contrat est dépassé. Or les mêmes causes produisent les mêmes effets : avec 3 000 hommes de plus que prévu engagés dans l’opération Sentinelle, inévitablement, le rythme d’activité de l’armée de terre est de nouveau déséquilibré.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. Ainsi, l’actualisation de la LPM a résolu certaines tensions, mais pas toutes. D’ailleurs, il n’y a pas que la programmation militaire qui a été actualisée : il y a aussi la doctrine.
Le ministre de la Défense est venu devant la commission nous parler du rapport au Parlement que nous lui avions demandé sur les conditions d’emploi des armées sur le territoire national, et ce rapport a fait l’objet d’une discussion en séance publique le 16 mars. Il s’agit là encore de tirer les conclusions de l’opération Sentinelle, cette fois-ci dans le champ doctrinal. Ce rapport vise, d’une certaine façon, à ce que notre dispositif terrestre de protection du territoire national ne change pas seulement de volume, en passant de 1 000 à 7 000 ou 10 000 hommes, mais à ce qu’il change aussi de modèle.
Je ne reviendrai pas en détail sur tout ce que contient ce rapport ; nous en avons discuté en séance publique. Soulignons simplement que sa grande nouveauté tient à la définition d’une nouvelle « posture » des armées : la « posture de protection terrestre ». Il s’agit d’un cadre doctrinal visant à mieux exploiter les compétences des militaires lorsqu’ils agissent sur le territoire national. Ces savoir-faire, nous les connaissons : capacité à agir de façon planifiée et coordonnée, puissance de feu (au moins à titre dissuasif), capacité de manœuvre dans tous types d’espaces, y compris difficilement accessibles, etc. Il s’agit, en quelque sorte, de passer d’une logique de « missions intérieures » de type Vigipirate, où les militaires agissaient en supplétifs de la police, à une logique d’« opérations intérieures », où l’on cherche davantage à exploiter les savoir-faire des armées et leur complémentarité avec ceux des forces de sécurité intérieure.
Cela suppose divers arrangements doctrinaux ; le rapport pourvoit à certains, et un travail est encore nécessaire pour donner du contenu à cette posture de protection terrestre. Cela aurait pu supposer aussi des arrangements juridiques, concernant l’emploi de la force ou les prérogatives des militaires. En la matière, le rapport propose de s’en tenir aux ajustements opérés il y a quelques mois par la réforme de la procédure pénale, et nous pensons que c’est globalement une position avisée. D’ores et déjà, le droit de l’emploi de la force a été adapté au mode opératoire des terroristes que ne prenait pas en compte notre droit : les « cavales meurtrières ». Ainsi, les policiers, les gendarmes et les militaires des armées pourront employer la force non seulement en position de légitime défense ‒ d’eux-mêmes ou d’autrui ‒, mais aussi lorsqu’un terroriste est en train de faire mouvement d’un lieu de meurtre à un autre ; pensons par exemple au circuit des terroristes du 13 novembre dans l’est de Paris.
M. Christophe Léonard, rapporteur. En effet, tout au long de nos travaux, nous avons été conduits à examiner toutes les grandes questions qui se sont posées au sujet du cadre juridique et doctrinal de l’opération Sentinelle, en parallèle des travaux interministériels.
Ainsi, il y avait un vif débat sur l’opportunité d’assouplir le cadre légal de l’emploi de la force pour l’adapter aux menaces, en donnant aux militaires le droit, par exemple, de fouiller des bagages et des véhicules, voire des personnes, et de pratiquer des contrôles d’identité. Le rapport au Parlement exclut toute évolution juridique majeure qui reviendrait à confier des pouvoirs de police judiciaire aux militaires. À nos yeux, cela pourrait peut-être se concevoir dans le régime de l’état de siège ; pas dans celui de l’état d’urgence, ou a fortiori hors état d’exception. D’ailleurs, en pratique, les choses ne sont pas si compliquées : un militaire peut proposer à une personne un contrôle, et si celle-ci refuse ‒ c’est rare ‒, l’orienter vers un agent de police judiciaire.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. Dans le même registre, d’ailleurs, le SGDSN vient de communiquer à la presse des éléments de son rapport récemment déclassifié qui marquent une évolution de son point de vue et laissent entrevoir la possibilité que l’on permette aux militaires de pratiquer des fouilles visuelles de bagages et des palpations de sécurité, sur la base d’une réquisition préfectorale spéciale enserrant ces prérogatives dans des conditions précises d’espace et de temps.
Par ailleurs, lors de nos travaux, a aussi été évoquée l’idée d’établir une présomption de légitime défense pour les militaires, les policiers et les gendarmes. Pour nous, c’est l’archétype de la fausse bonne idée. En effet, il ne peut y avoir en la matière de présomption que réfragable : policiers et militaires ne seraient donc pas plus « couverts » qu’à l’heure actuelle. En revanche, ils pourraient se croire davantage couverts, et être moins attentifs qu’aujourd’hui dans l’emploi de la force. Dès lors, ils prendraient des risques juridiques inconsidérés. Ce serait un cadeau empoisonné à leur faire.
M. Christophe Léonard, rapporteur. D’autres personnes ont avancé l’idée d’étendre au territoire national le champ de l’excuse pénale prévue pour les militaires en OPEX. Là encore, nous avons des réticences fondées sur l’aspect pratique des choses. En effet, quelque initiative législative que nous puissions prendre en la matière, la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’appliquera de toute façon, y compris le « droit à la vie » reconnu par son article 2. Dès lors, on donnerait un faux blanc-seing aux militaires : déjà très contestable dans son principe, il n’aurait pas de portée, puisque tout justiciable pourrait demander au juge de l’écarter au motif de son incompatibilité avec la CEDH. Ce qui vaut pour les OPEX ne pourrait valoir sur le territoire national qu’en cas de situation de conflit armé ; nous n’en sommes heureusement pas là.
La « couverture juridique » de nos soldats nous semble passer de façon plus efficace par une formation poussée aux règles d’emploi de la force et par la mise en œuvre de la protection fonctionnelle que leur apporte l’État. Nous venons de réformer le droit de la protection fonctionnelle, pour améliorer notamment la protection juridique des agents victimes d’agressions. L’application de ces nouveaux principes au ministère de la Défense nous paraît plus efficace pour protéger les soldats que des régimes légaux d’exception que le juge écartera à coup sûr.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. D’autres idées nous ont également été soumises, tendant toutes, en réalité, à dépasser le droit de la légitime défense ‒ y compris la légitime défense d’autrui ‒ comme fondement des règles d’emploi de la force. Ainsi, par exemple, on citera l’idée d’instituer un régime d’exception en cas d’urgence absolue, ou de fonder le droit d’employer la force sur un motif de prévention. Ces idées méritent certainement d’être discutées et notre rapport les analyse, mais elles se heurtent là encore à la jurisprudence de la CEDH. Le régime de la légitime défense d’autrui mérite d’être mieux connu ; avec la nouvelle excuse pénale prévue par la réforme récente de la procédure pénale, il offre un cadre déjà large pour établir des règles d’emploi de la force. Mieux vaut, à nos yeux, laisser à la police et aux forces armées le temps de s’approprier ce cadre légal, d’en exploiter vraiment toutes les possibilités, plutôt que légiférer à nouveau dès à présent.
M. Christophe Léonard, rapporteur. Notre rapport souligne en effet que la mise en œuvre de notre doctrine renouvelée de protection du sol national avec le concours des armées représente déjà un ambitieux défi.
Nous nous sommes attachés à étudier en détail la façon dont pourront être mises en œuvre les orientations qui ressortent de cette refonte doctrinale, et nous en arrivons à la conclusion, si j’ose dire, que les défis tiennent autant à ce que le rapport au Parlement ne mentionne qu’« en creux » qu’à ce qu’il présente « en relief ».
« En creux », c’est-à-dire évoqué de façon un peu elliptique à nos yeux, voire parfois insuffisante. C’est le cas pour deux sujets dont l’importance ressort tant de nos travaux à Paris que de nos comparaisons internationales. Il s’agit, d’une part, du « renseignement » entendu au sens militaire du terme, c’est-à-dire au sens large ; on pourra parler, de façon à la fois plus précise et moins clivante, d’« information d’intérêt opérationnel ». Il s’agit, d’autre part, de la coordination des forces de sécurité intérieure (c’est-à-dire du ministère de l’Intérieur) et des armées (c’est-à-dire du ministère de la Défense), qui nous semble très peu évoquée dans le rapport au Parlement.
J’en viens aux questions d’« information d’intérêt opérationnel ». Le vocabulaire est très important : dans le langage du ministère de l’Intérieur, le mot « renseignement » renvoie au « renseignement à des fins judiciaires ». Dans le langage des militaires des armées, il désigne autre chose pour l’opération Sentinelle : le « renseignement d’ambiance », c’est-à-dire un certain nombre d’informations très générales sur le contexte d’une mission ou d’une opération, et le « renseignement d’opportunité », c’est-à-dire des informations relatives à un événement particulier intéressant une unité pour l’accomplissement de sa mission.
Or, pour travailler ensemble, il faut parler la même langue… Ce n’est manifestement pas le cas aujourd’hui. Nous avons pu le constater sur le terrain : la communication entre la police et les armées repose aujourd’hui, pour l’essentiel, sur la bonne volonté et les bonnes relations des uns et des autres. Or, non seulement ce n’est pas toujours la chose la mieux partagée au monde, mais c’est aussi une base fragile pour une force qui, comme Sentinelle, était renouvelée toutes les six semaines, et qui le sera désormais toutes les huit semaines. Sans procédures formelles d’information par la police, sans dispositif organisant le traitement de l’« information d’intérêt opérationnel » dans la continuité, la force Sentinelle est sinon aveugle, du moins myope.
En outre, faute de cadre clair, on s’aperçoit que les pratiques locales varient : telle ou telle chose se pratique à Paris mais pas à Lyon, ou inversement. En la matière, le « système D » a vraiment ses limites.
À notre sens, le rapport au Parlement aurait utilement pu clarifier les choses en définissant des concepts partagés par toutes les forces et en fixant des règles claires, doublement inspirées par un strict respect de la légalité et par un souci d’efficacité.
Nous concluons de nos travaux que l’« information d’intérêt opérationnel » est indispensable à la planification et à la conduite des opérations militaires. Ainsi, il serait incohérent de vouloir, comme le fait le rapport au Parlement, utiliser mieux les savoir-faire militaires sur le territoire national, tout en refusant d’établir un cadre clair pour la collecte, le partage, le traitement et l’exploitation de l’« information d’intérêt opérationnel ». Tout le monde a à y gagner : les armées, bien sûr, afin que Sentinelle ‒ ou toute autre forme que pourra prendre la posture de protection terrestre ‒ opère dans un environnement mieux connu et soit donc susceptible d’être plus efficace ; mais également les forces de sécurité intérieure, car elles ont beaucoup à y gagner : Sentinelle, ce sont 10 000 hommes sur le terrain, qui entendent et voient des choses intéressant aussi la police et la gendarmerie.
J’insiste sur un point : il ne s’agit nullement de laisser les militaires employer sur le territoire national les mêmes moyens qu’en OPEX. Loin s’en faut. Nous ne plaidons pas pour un déploiement de tous les moyens de la direction du renseignement militaire (DRM) sur le territoire national. Il s’agit, selon nous, d’établir une doctrine claire en matière d’« information d’intérêt opérationnel », de façon à ce que la police et la force Sentinelle coopèrent, dans le respect de la légalité. Sans cadre juridique et doctrinal clair, les pratiques varient, le commandement peut être conduit à ne pas utiliser toutes les possibilités que donne la loi, officiers et commissaires ne se parlent pas beaucoup et, accessoirement, il nous est plus difficile de contrôler et d’évaluer les pratiques. Tout cela plaide, à nos yeux, pour l’élaboration d’un cadre doctrinal clair et partagé en matière de collecte, de partage, de traitement et d’exploitation de l’« information d’intérêt opérationnel », dans le respect des lois en vigueur.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. Sur ce point encore, la position du SGDSN semble avoir évolué : il propose en effet de faciliter le recueil d’informations de terrain par les militaires.
Tout au long de nos travaux, nous avons pu avoir le sentiment que les positions respectives des ministères de l’Intérieur et de la Défense ont pu être parfois éloignées, et que c’est au prix d’une formulation très elliptique sur certains points que le rapport au Parlement a pu reposer sur un consensus trouvé dans les travaux interministériels. Ceci vaut l’« information d’intérêt opérationnel », mais aussi pour un autre sujet : la coordination des forces de sécurité intérieure et des armées dans la planification et la conduite des opérations sur le territoire national.
On le dit souvent : la culture de la planification est « dans l’ADN » des militaires, et nos états-majors y excellent. C’est bien entendu exact. Il n’en demeure pas moins que s’agissant du territoire national, on a le droit de penser qu’une planification mieux coordonnée entre les armées et les forces de sécurité intérieure aurait des avantages.
D’ailleurs, au fur et à mesure que nous avancions dans nos travaux, nous avons eu le sentiment que l’opération Sentinelle n’aurait pas pris la même forme en 2015 si elle avait pu faire l’objet d’une planification mieux coordonnée au préalable. Si tel avait été le cas, la majeure partie des effectifs seraient-ils accaparés depuis janvier 2015 par des gardes statiques, que les militaires ont beaucoup de mal à remplacer par des gardes plus dynamiques ? La gestion de l’« information d’intérêt opérationnel » ne serait-elle pas mieux encadrée ? Les interventions des différentes forces n’auraient-elles pas pu être mieux coordonnées, par exemple lors de l’assaut donné le 18 novembre à Saint-Denis ? Les problèmes d’interconnexion des systèmes d’information et de communication entre la police et les armées n’auraient-ils pas été traités davantage en amont ?
Voilà, à la lumière de l’opération Sentinelle, certaines des questions qu’une planification « à froid » permet de trancher avant que ne se posent des problèmes sur le terrain.
Or force est de constater que si le ministère de la Défense dispose d’un CPCO dont l’efficacité est reconnue, tel n’est pas le cas à l’échelle interministérielle. Certes, la cellule interministérielle de crise (CIC) se réunit place Beauvau. Mais il s’agit d’un organisme de niveau ministériel ; c’est donc un organe de pilotage politique des opérations, qui n’est ni permanent, ni doté des moyens d’un véritable centre d’opérations. Le ministère de l’Intérieur ne dispose pas d’un tel centre : le fameux fumoir du ministre en a été un succédané, mais sa mise en place peu anticipée fait surtout apparaître le besoin d’une structure plus robuste.
Par nature, les opérations de sécurité sur le territoire national ont un caractère interministériel. La création de la CIC en témoigne. Intérieur, défense, mais aussi santé, transports, énergie, etc. : la coopération interministérielle ‒ on pourrait même dire : l’intégration interministérielle ‒ est cruciale dans la gestion des crises actuelles. Aussi la planification et la conduite des opérations de sécurité sur le territoire national doit-elle reposer sur une structure interministérielle, un véritable centre d’opérations interministériel.
Une telle structure pourrait, a minima, travailler à la planification « à froid » des opérations, c’est-à-dire définir les rôles respectifs des forces de sécurité intérieure et des armées, leurs modes de communication, etc. A maxima, elle pourrait assurer la conduite coordonnée des opérations des différentes forces, notamment dans un scénario de crise ou d’assaut, comme les 13 et 18 novembre derniers.
C’est pourquoi nous plaidons en faveur de la constitution d’un centre interministériel de planification et de conduite des opérations de gestion des crises sur le territoire national. La spécificité du territoire national le désigne naturellement pour être placé au ministère de l’Intérieur, par exemple sous la direction d’un préfet. Il devrait pouvoir être interconnecté avec les moyens existants, comme le CPCO.
M. Christophe Léonard, rapporteur. Notre rapport ne souligne pas que ce qui est « en creux » dans la nouvelle doctrine d’emploi des armées sur le territoire national, mais aussi les défis que représente déjà ce qu’il prévoit « en clair ».
Le premier de ces défis tient à l’ambition de la manœuvre des ressources humaines qui est prévue. C’est une claire inversion de tendance : le ministère de la Défense était engagé depuis plusieurs décennies dans une réduction du format des armées et, aujourd’hui, les armées recrutent de nouveau. Le défi est d’abord quantitatif : retenons schématiquement que le plan de recrutement de l’armée de terre portait sur 10 000 personnels en 2014, 15 000 en 2015 et 20 000 en 2016. C’est un défi. Pour l’heure, il semble que ce défi soit relevé, à une nuance près : les efforts que les armées font pour améliorer la « fidélisation » des personnels ne semblent pas porter les fruits escomptés. C’est une question qu’il nous appartiendra de suivre avec attention.
Le défi est aussi qualitatif : recruter, c’est bien, mais encore faut-il recruter des personnels motivés, et estimés fiables par la direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD). En la matière, le nombre de candidats a augmenté en 2015 dans des proportions comparables à celui des postes offerts : le taux de sélection reste donc satisfaisant. Reste à savoir si, l’effet post-attentats s’estompant, les candidatures resteront aussi nombreuses.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. La mise en œuvre de notre doctrine rénovée comporte un autre défi : réussir à passer de « Vigipirate fois 10 », pour faire simple, à des modes d’action véritablement militaires.
En la matière, tout le monde reconnaît que les modes de garde statiques sont peu efficaces : c’est une ligne Maginot qu’il suffit de contourner, et nous ne pouvons pas déployer des soldats devant chaque école, chaque lieu de culte, chaque supermarché, etc. Pourtant, certains gestionnaires de sites protégés y sont très attachés. Lors de nos auditions, nous avons pu constater que tel est le cas par exemple du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF).
Il en résulte que les réquisitions préfectorales mettent beaucoup de temps à évoluer concernant la protection de certains lieux de culte et établissements culturels. Nous plaidons, avec l’ensemble des autorités militaires, pour des modes d’action plus dynamiques, avec lesquels les soldats sont moins prévisibles, moins vulnérables aussi, ce qui renvoie l’incertitude dans le camp de l’adversaire et permet d’exploiter les techniques de « contrôle de zone » inculquées à nos militaires. Accessoirement, cela mobilise moins d’hommes par site à protéger, ce qui permet donc de protéger davantage de sites ; rappelons par exemple qu’il y a 1 000 crèches et plusieurs milliers d’écoles à Paris. Des expérimentations de « garde dynamique à vue », c’est-à-dire sur un périmètre resserré, ont été conduites, notamment dans le quartier de la Petite Jérusalem à Sarcelles ; selon nos observations, elles sont concluantes.
Il faut aller plus loin dans la logique du contrôle de zone, tant en zone urbaine qu’en zone rurale, ou en zone de montagne. Un récent exercice conduit conjointement entre l’armée de terre et la gendarmerie dans l’Isère a montré l’intérêt que peut avoir un déploiement des soldats dans des zones frontalières ou difficiles d’accès.
Ainsi, les gardes statiques doivent devenir l’exception.
M. Christophe Léonard, rapporteur. Enfin, les défis ne sont pas seulement d’ordre technique : ils sont aussi d’ordre politique.
En effet, l’expérience de Vigipirate montre qu’il y a une sorte d’« effet de cliquet » ou d’hystérèse dans les dispositifs de protection. On décide aisément d’en augmenter le niveau, c’est-à-dire de passer à un niveau d’alerte supérieur et de mettre davantage d’hommes sur le terrain, mais il est très difficile, à l’inverse, de prendre la décision politique de « réduire la voilure ». Certes, cela permettrait de disposer d’une marge de manœuvre en cas d’aggravation de la situation ; mais à court terme, c’est surtout prendre le risque de donner l’impression que l’on baisse la garde.
Aussi, quel que soit le contenu que l’on donnera à la posture de protection terrestre, il faudra surtout savoir moduler les seuils d’alerte et les effectifs engagés sur le terrain. C’est là un défi politique, et ce n’est pas le moindre des défis à l’ordre du jour.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. Ce défi politique serait plus aisé à relever si la doctrine nouvelle faisait l’objet d’un véritable investissement politique, aussi partagé que possible sur tous nos bancs.
Cela nous renvoie à la question d’une éventuelle « réactualisation » de la LPM. Le texte que nous avons voté il y a un an prévoit la possibilité de le faire d’ici le 31 mars 2017. 2017 est donc un horizon pertinent. Et une telle « réactualisation » permettrait de traiter plusieurs problèmes aujourd’hui en suspens.
En effet, il y a un an, nous avons paré au plus pressé, en renforçant les effectifs de la force opérationnelle terrestre et en renonçant à 18 750 suppressions de postes au total. Mais la question des soutiens d’une force davantage engagée sur le territoire national n’a guère été traitée : une force plus nombreuse et engagée sur le territoire national, ce sont des besoins d’infrastructure et de soutien général en plus.
D’ailleurs, la question des effectifs est elle aussi en suspens : certes, nous avons renoncé à 18 750 suppressions de postes, mais devant nous, réunis en Congrès le 16 novembre, le président de la République a annoncé renoncer à toute suppression d’effectifs. Reste à en tirer toutes les conclusions dans la programmation militaire, c’est-à-dire non seulement dans les tableaux d’effectifs qu’elle comporte, mais aussi dans la trajectoire financière qu’elle fixe.
Enfin, la doctrine nouvelle ne gagnerait-elle pas à être intégrée au rapport annexé à la LPM, de façon à ce qu’elle soit formellement adoptée par la Représentation nationale ?
Voilà qui plaide en faveur d’une « réactualisation » de la LPM cette année ou en 2017.
M. Christophe Léonard, rapporteur. Pour conclure, mes chers collègues, la question qui nous était posée peut in fine se résumer ainsi : quelles places respectives pour les armées et les forces de sécurité intérieure sur le territoire national ?
La question conduit certains à se demander si nous pouvons à bon droit nous dire « en guerre » ou non. Les uns emploient volontiers ce vocabulaire, qui suffirait à justifier le recours aux armées ; d’autres y voient une surréaction lexicale. Pour les rapporteurs, en tout état de cause, il n’y a pas de lien de nécessité entre l’état de guerre et le recours aux armées. Ou alors, il faudrait renoncer à recourir aux armées en Guyane, comme dans le cadre de l’action de l’État en mer, ou pour la surveillance de l’espace aérien, ainsi qu’en cas de catastrophe naturelle.
Nous avons donc abordé la question de la place des armées sur le territoire national de façon pragmatique. Les armées, dans toutes les démocraties occidentales, constituent des « réservoirs de forces » à la disposition du Gouvernement en cas de crise. En France, leur statut rend leur emploi plus souple et moins coûteux que celui de la police ou de la gendarmerie, et la formation des militaires garantit une polyvalence qui rend ces personnels utiles à d’autres missions lorsqu’ils ne sont pas engagés au titre de la posture de protection terrestre.
Pour autant, faut-il employer les soldats en supplétifs des forces de sécurité intérieure ? Nous pensons que non. Nos militaires ont beaucoup plus à apporter sur le territoire national, et pas seulement dans les zones urbaines : la ruralité est également une cible, et les zones de frontières sont également des zones d’intérêt ; d’ailleurs, dans ces espaces, les capacités de manœuvre des armées constituent une indéniable plus-value.
Enfin, si employer nos soldats sur le territoire national se justifie, il faut préciser quels soldats. À nos yeux, les réservistes ont vocation à être employés prioritairement sur le territoire national : ils connaissent le terrain, ont à cœur de le défendre, et possèdent toutes les aptitudes militaires requises pour le faire. On doit saluer leur engagement et leur rôle. C’est eux, la « garde nationale » parfois évoquée.
À mes yeux, notre rapport marque ainsi une étape dans une réflexion collective, et je résumerai les grandes lignes de ma réflexion de la façon suivante.
D’abord, les gardes statiques doivent être l’exception, alors qu’aujourd’hui, la répartition des effectifs montre qu’elles sont la règle. Ensuite, l’actualisation de la LPM telle que nous l’avons votée fixe un plafond de 7 000 hommes, qui ne peut être porté à 10 000 hommes que pendant un mois, pour l’effectif des forces engagées en milieu terrestre pour la protection de notre territoire national. À mes yeux comme à celui de mon collègue Olivier Audibert Troin, il faut revenir au contrat opérationnel et, sous les plafonds fixés, ménager des marges de manœuvre pour organiser des déploiements dans les zones rurales et les zones de frontière, dans le cadre d’opérations planifiées « à froid » avec les forces de sécurité intérieure. Par exemple, dans les Ardennes, la frontière franco-belge présente une certaine porosité, et un déploiement de l’opération Sentinelle permettrait d’améliorer le contrôle de cette zone de passage.
Par ailleurs, nos études sur le terrain font ressortir d’importantes difficultés dans l’interconnexion des systèmes de communication entre les forces de sécurité intérieure et les armées. En la matière, il faut aller plus loin que le « système D ».
Il me paraît aussi souhaitable que deviennent systématiques les entraînements conjoints des armées et des forces de sécurité intérieure, le cas échéant, d’ailleurs, avec les « soldats du feu ». D’ailleurs, une structure d’entraînement interservices appelée ACIER est mise en place dans les Ardennes pour former conjointement les militaires du 3e régiment du génie et les pompiers des Ardennes, voire, à terme, d’autres unités, ainsi que la police et la gendarmerie.
M. Olivier Audibert Troin. Nous ne sommes pas entrés dans tous les détails de notre rapport, et certains de ces détails sont d’importance. Mon collègue Christophe Léonard en a évoqué quelques-uns, et je tiens à évoquer d’autres pistes, pour lesquelles nous aurions certainement besoin de conduire des travaux supplémentaires. Ainsi, affermir la résilience de la société française face au terrorisme me semble de première importance. Comment le faire ? Une idée mériterait certainement d’être étudiée : celle de rendre obligatoire une journée par an de réserve pour chacun de nos concitoyens. Cela permettrait à toutes les Françaises et à tous les Français d’acquérir et de mettre à jour les réflexes nécessaires pour renforcer la résilience de notre pays, ainsi que les gestes de premier secours, dans le cadre d’exercices encadrés par les armées et les forces de sécurité intérieure. Cela contribuerait aussi à resserrer le lien de la Nation avec ses armées et ses forces de police et de gendarmerie. Des dispositifs comparables fonctionnent bien à l’étranger.
Notre rapport détaille aussi les aspects budgétaires de l’engagement des armées sur le territoire national. Nous avons essayé d’établir une comparaison du coût d’une garde selon qu’elle est effectuée par l’armée de terre ou confiée à la police. Cette estimation est à lire avec toutes les limites d’une évaluation conduite par nos propres moyens et à prendre avec toutes les réserves d’usage concernant les exercices comparatifs ; certainement faudra-t-il l’affiner. Nous constatons cependant un différentiel de coût de l’ordre d’un milliard d’euros par an pour un dispositif de 7 000 gardes, ce qui peut contribuer à expliquer certains des choix qui ont été faits.
Nous abordons aussi la question de l’attractivité financière de l’opération Sentinelle pour nos soldats, ainsi que la problématique de leur armement. Mon collègue et moi nous étions rangés à l’avis des autorités militaires, qui privilégient le fusil d’assaut, après nous être interrogés au début de nos travaux sur la pertinence de ce choix. Le FAMAS est une arme relativement lourde, de longue portée, dont on peut se demander si elle est la plus appropriée pour les missions de sécurité en milieu densément peuplé. Les autorités militaires mettent en avant le fait que les soldats sont habitués au FAMAS, leur arme de dotation, et jugent qu’un changement d’arme poserait des difficultés. Mais là encore, nous sommes un peu pris de court par les déclarations du SGDSN, qui ouvre la voie à un système de double dotation d’armes de poing et de fusils d’assaut. Ainsi, sur ce point encore, la doctrine est en train d’évoluer, ce qui, Madame la présidente, justifierait que nous continuions à suivre cette évolution dans les semaines et les mois à venir.
Mme la présidente Patricia Adam. Je crois que l’ensemble des commissaires présents ont été très attentifs à votre exposé et très intéressés par votre rapport. Nous pouvons vous remercier pour le travail nécessaire que vous avez accompli. Il s’agira d’un sujet de débat dans les mois qui viennent et, certainement, pour le gouvernement issu des prochaines élections puisque, comme vous l’avez justement souligné, ce débat est appelé à durer. Des questions persistent, des progrès restent à accomplir – vous en avez cité un certain nombre. J’ai notamment retenu – tout comme Philippe Nauche – vos observations concernant le renseignement, que vous appelez « information d’intérêt opérationnel », ce qui permet d’éviter les confusions et les incompréhensions en la matière.
M. Alain Marty. Je tiens tout d’abord à remercier nos deux rapporteurs. Je crois que nous sommes tous ici favorables à ce que nos militaires jouent un rôle important non seulement en opérations extérieures (OPEX) – c’est le fond de leur métier –, mais également sur le territoire national. À cet égard, Sentinelle constitue une opération importante. Un certain nombre de questions se posent toutefois, que vous avez abordées.
La première concerne les gardes statiques, qui font que nos militaires peuvent devenir des cibles. Vous plaidez pour qu’elles deviennent l’exception, mais, à ce stade, elles restent la règle de fonctionnement normal. J’ai comme vous eu l’occasion de voir comment fonctionne Sentinelle à Paris intra-muros : ce que l’on demande à nos militaires, c’est de surveiller un certain nombre de sites en statique. Et lorsqu’ils veulent mettre en place une surveillance plus dynamique comme ils en ont l’habitude en OPEX, ils se heurtent parfois aux réticences des responsables des lieux de culte ou des écoles qui veulent voir les militaires postés devant ces sites à l’heure où ils ouvrent leurs portes. Il est assez difficile d’expliquer que la sécurité sera mieux assurée avec une garde dynamique qu’avec une garde statique. Nous ne sommes pas encore passés à cette étape ; à l’heure actuelle on reste sur le schéma « garde statique », qui pose un réel problème pour la sécurité de nos militaires.
Vous n’avez en revanche pas évoqué la façon dont les militaires considèrent Sentinelle. Il faut relever un élément important : au fil de l’engagement, on a considérablement amélioré les conditions d’hébergement, qui étaient assez insatisfaisantes au début de l’opération. Aujourd’hui, les militaires s’accommodent de ce qui est mis à leur disposition. Par ailleurs, l’existence d’une prime spécifique est un autre élément positif qui constitue une amélioration non négligeable de la solde.
Mais quand on leur demande s’ils préféreraient être en OPEX ou participer à Sentinelle, la réponse est unanime : tous souhaiteraient être en OPEX, car c’est pour cela qu’ils se sont engagés. J’ai rencontré des militaires du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières postés devant l’Hyper Casher. Lorsque je leur posé la question, ils m’ont répondu qu’ils étaient sensibles au bon accueil de la population, mais qu’ils préféraient de loin l’engagement en OPEX. La question de la motivation est essentielle, il ne faut pas l’oublier ; les militaires assurent naturellement la mission Sentinelle, mais ils aimeraient aussi faire autre chose.
Par ailleurs, et les rapporteurs l’ont bien souligné, Sentinelle a des effets considérables sur la préparation opérationnelle de nos forces. Il est clair qu’aujourd’hui, les unités ne sont pas préparées comme elles l’étaient au moment de notre engagement en Afghanistan. L’Afghanistan a joué un rôle essentiel dans la professionnalisation de nos armées, qui ont été remarquablement préparées pour participer à cette mission. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, ce qui pose un réel problème.
Après ces observations, je souhaiterais poser une question aux rapporteurs : avez-vous pu obtenir des éléments sur l’impact de Sentinelle sur la fidélisation des engagés volontaires ? C’est un vrai sujet. Au bout de six mois, un certain nombre d’engagés dénoncent leur contrat ; au bout de cinq ans ils sont encore plus nombreux. Est-ce que la participation à Sentinelle entraîne un taux de renoncement plus important ?
M. Malek Boutih. Je tiens à remercier nos rapporteurs pour leur rapport très précis qui donne une vision extrêmement détaillée de la situation. Ce qui m’a marqué, c’est cette phrase, qui à mon sens résume le rapport : jour après jour, la doctrine évolue. Autant je pense qu’il existe un consensus sur l’utilité d’une réponse à court terme après les attentats pour sécuriser psychologiquement et politiquement la population, autant nous sommes entrés dans des phénomènes de long terme, ainsi que le soulignent tous les analystes. Or sur le long terme, l’improvisation permanente est un danger, dont l’ampleur dépasse les éléments « internes » que vous avez soulignés – problèmes matériels, d’organisation. Je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes en guerre, mais que celle-ci a changé. Et c’est un danger car le fait de mener une guerre sans stratégie expose, un jour, à de graves problèmes. On ne peut pas en permanence adapter notre dispositif de sécurité intérieure en fonction des événements qui touchent notre pays. Autant la réponse de court terme qui a été apportée était nécessaire, autant on voit bien dans votre exposé la contradiction majeure entre la nature de ce que sont nos forces armées aujourd’hui et les besoins nouveaux que crée ce nouveau type de guerre.
Ce n’était pas l’objet de votre rapport, mais on voit bien aussi que la réponse ne peut pas non plus être apportée par les forces de sécurité intérieure traditionnelles. Est-ce que tous ces constats ne plaident pas pour l’ouverture d’un débat sur l’émergence d’un nouveau type de force, adaptée aux nouveaux types de conflit et d’intervention et qui réponde, sur le long terme, aux enjeux de sécurisation du territoire ?
Le grand danger en termes stratégiques est que nous ne connaissons pas tous les objectifs de nos ennemis. Mais on sait que l’un d’entre eux est d’amener petit à petit à ce que les réponses sécuritaires apportées – face à des actes de guerre, il ne s’agit plus seulement d’opérations de police – entraînent notre pays dans des logiques qu’il ne maîtrise pas. Il s’agit de trouver un bon équilibre permettant de répondre à long terme à ce type de menaces, tout en préservant notre modèle démocratique et notre État de droit.
Votre rapport formule un certain nombre d’observations et de réponses absolument justes afin d’adapter notre réponse. Mais fondamentalement, ne faut-il pas envisager la constitution d’un nouveau type de force de sécurité dont le champ ne recouvrirait ni les opérations de police traditionnelles – la lutte contre la délinquance par exemple – ni les missions menées en OPEX, mais qui serait chargée de la protection de notre territoire ? En somme, comment sanctuarise-t-on notre territoire face à ces nouveaux dangers ?
M. Jean-Jacques Candelier. Je souhaite féliciter nos deux rapporteurs pour ce travail très clair et très approfondi. Avec l’opération Sentinelle qui, je l’espère, ne durera pas 20 ans ou plus, nous sommes déjà tombés dans l’engrenage constituant à devoir rassurer la population française en employant notre armée pour protéger des sites dits sensibles. Je rappelle les conséquences de la révision générale des politiques publiques avec la dissolution de l’équivalent de 14 escadrons de gendarmerie et la réduction des effectifs de plusieurs compagnies républicaines de sécurité, qui ont constitué une grave erreur stratégique pour la sécurité des Français. L’emploi des armées dans une fonction purement policière démontre qu’il faut réaffecter d’urgence des moyens pour développer l’investigation, les enquêtes de terrain et les filatures.
M. Alain Moyne-Bressand. Merci pour ce rapport très complet et qui va loin dans l’analyse. Nos rapporteurs ont ouvert un vaste chantier qui trace des nombreuses perspectives mais qui suscite aussi beaucoup d’interrogations. Vous avez souligné l’importance de la formation, de l’organisation des relations avec la police et la gendarmerie. Qu’en est-il de la formation des militaires avant leur premier engagement sur le terrain ?
Par ailleurs, je me pose la question de l’équipement porté par nos militaires, qui sont lourdement chargés, par rapport aux gendarmes par exemple. Ont-ils besoin d’un tel « harnachement » ou est-ce que la « peur du militaire » – à l’image de la « peur du gendarme », qui n’a pas tous ces équipements – ne suffirait pas à faire comprendre qu’ils sont là pour défendre nos intérêts, à les faire respecter ?
M. Christophe Léonard, rapporteur. La préparation des forces a été évoquée et c’est là l’essentiel. La principale problématique tient en effet à cette question : Sentinelle a-t-elle pour conséquence l’impréparation de nos forces et, finalement, leur incapacité à défendre notre pays ? Aujourd’hui, le contrat opérationnel prévoit 7 000 hommes, et nous plaidons pour en rester à ce niveau, qui permet à l’armée de terre de se préparer à toutes ses autres missions. Cela suppose d’être absolument ferme sur la question des gardes statiques. Tout le monde en parle, il s’agit maintenant de donner des directives en ce sens aux préfets, qui établissent les réquisitions et sont ainsi, si j’ose dire, des sentinelles de l’État. De mon point de vue, il est donc nécessaire de faire en sorte que les gardes statiques deviennent l’exception afin d’alléger le dispositif, sans pour autant perdre en termes de sécurité. C’est même l’inverse puisque les gardes dynamiques réduisent la vulnérabilité des soldats.
Cela permet de répondre au problème de fidélisation. Car pour un jeune soldat – les personnels ont au plus 28 ans –, passer l’essentiel de son temps en poste fixe en ayant le sentiment que cela n’est pas toujours utile n’offre pas beaucoup de motivation pour renouveler son contrat d’engagement.
S’agissant de l’hébergement de la force Sentinelle, il est assuré ‒ notamment en région parisienne ‒ sur des sites du ministère de la Défense qui avaient vocation à être vendus. La question de leur cession va se poser très concrètement : s’ils sont vendus, la question de l’hébergement de la force à Paris se reposera, avec un fort impact sur la condition du personnel et, de ce fait, sur la fidélisation.
Pour répondre à notre collègue Malek Boutih, les sujets qu’il évoque constituent la question centrale. Ces chantiers n’ont pas été ouverts à notre initiative, mais par les actes terroristes qui ont frappé notre pays. Je me pose plusieurs questions : quelle est l’efficacité de Sentinelle ? Est-ce que l’engagement de 7 000 hommes sur le terrain a évité des attentats ou pas ? L’actualité montre qu’on ne peut pas tout éviter. J’ignore s’il faut constituer une « troisième force ». Mais il faut déjà réfléchir à la question du renseignement. Nos déplacements au Royaume-Uni et en Israël nous ont démontré que la culture du partage du renseignement entre les différentes forces et les différents services n’est pas la même que dans notre pays. Par ailleurs se pose la question de l’entraînement interservices des forces ; pour être plus efficace il faut se connaître, tant au niveau des pratiques que de la communication.
Nous avons également évoqué la question de l’armement et du port d’arme en dehors des heures de service pour les personnels des différentes forces, qui renvoie à la question de la primo-intervention. Nous ne pouvons en effet pas demeurer dans l’improvisation continue. Vigipirate a duré 20 ans, quid de Sentinelle qui mobilise 7 000 hommes ? Durera-t-elle aussi 20 ans voire plus ? À l’heure actuelle et sans avoir les éléments de réponse définitifs, cela me paraît improbable. Il faut donc apporter une réponse différente en matière de renseignement, d’entraînement, de port d’arme. Olivier Audibert Troin évoquait également la question de l’amélioration de la « culture générale » du citoyen français afin de renforcer notre résilience et notre capacité à nous protéger d’actes terroristes. Tel serait l’objet de cette journée universelle de réserve obligatoire par an, dont il faudrait établir les modalités. Mais, au final, en 2017 ou après 2017, il faudra de nouveau actualiser la loi de programmation militaire…
M. Yves Fromion. Il y aura bien une LPM !
M. Christophe Léonard, rapporteur. Cela permettra de traiter les questions que nous avons évoquées, notamment en matière de renseignement et de cyberdéfense qui sont des éléments fondamentaux. Ce que j’ai retenu de notre déplacement au Royaume-Uni, c’est que les Britanniques sont réticents à un déploiement précoce de soldats dans les rues car ils redoutent « l’effet cliquet » pouvant rendre compliqué le retour à la normale. Il s’agit, pour eux, de la dernière extrémité. Aussi, afin d’anticiper au mieux, ont-ils fait le choix de miser sur le renseignement. Même si nous avons fait des efforts sensibles et notables en la matière, notamment avec la LPM et son actualisation, je crois que nous devons continuer dans cette voie.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. Sur les gardes statiques, l’objectif est de renverser la logique en arrivant à 80 % de patrouilles dynamiques et 20 % de gardes statiques. Tous les éléments tendent à prouver qu’une telle évolution est acceptée par l’ensemble des acteurs, notamment les forces de sécurité intérieure. Chacun a bien compris que le rôle des armées n’était pas de constituer une cible devant un lieu de culte ou une école, mais que sa valeur ajoutée résidait dans les techniques de patrouilles.
Quelques mots sur la fidélisation, qui est un sujet essentiel. Sentinelle a entraîné une suractivité et un absentéisme chez nos militaires. Entendons-nous bien : en l’espèce, la notion d’absentéisme renvoie à l’absence du militaire de son foyer. En moyenne, l’absentéisme atteint 160 jours par an environ, quelques cas nous ont même été rapportés à 220 jours. Or lorsque l’on voit la modicité des soldes versées à ces jeunes soldats, on comprend le niveau du taux de rupture anticipée ou de non-renouvellement des contrats. Nous avons donc une vraie réflexion à mener à ce sujet. Par ailleurs, ces jeunes militaires nous ont indiqué à plusieurs reprises que, lorsqu’ils sont en OPEX, les primes versées sont défiscalisées, ce qui n’est pas le cas des primes versées en opérations intérieures. Nous avons fait le calcul : avec Sentinelle, les primes s’élèvent en moyenne à 8 000 euros par an, ce qui n’est pas neutre. Mais une fois retranchés les impôts, les frais de garde d’enfant, etc., le « bénéfice net » peut n’atteindre que de 500 euros environ. Il y a sans doute là un travail à mener pour rendre plus attractif le métier de militaire.
Notre collègue Alain Marty évoquait la préparation opérationnelle qui fait les frais de Sentinelle. C’est vrai, notamment dans le domaine de la préparation opérationnelle interarmes : les autorités militaires estiment que, selon toute vraisemblance, la force opérationnelle terrestre ne retrouvera que 60 % de son niveau d’entraînement de 2014.
Notre collègue Malek Boutih a posé la question de fond : pouvons-nous continuer ainsi ? À titre personnel je ne suis absolument pas défavorable à l’évolution de la doctrine. Simplement il ne faut pas qu’elle évolue d’heure en heure. Les modalités d’intervention des terroristes changent et nous devons être capables d’être extrêmement réactifs, y compris concernant la doctrine. La vraie question est celle de la capacité à durer : doit-on limiter Sentinelle à l’état d’urgence et laisser la main aux seules forces de sécurité intérieure hors état d’urgence, sachant que celles-ci doivent remonter en puissance ? Aujourd’hui, les forces de sécurité intérieure ne peuvent pas assurer seules la protection du territoire national. Nous sommes bien dans une situation correspondant la règle dite des « quatre “i” », qui veut que les armées puissent être employées sur le territoire national quand les autres moyens de l’État sont indisponibles, inexistants, insuffisants ou inadaptés. Il est donc légitime que l’armée contribue à la protection du territoire national ; cela fait partie de sa mission. Mais la vraie question est : « comment et jusqu’à quand ? ».
Pour répondre à notre collège Alain Moyne-Bressand, il existe une petite formation, notamment juridique, sur l’usage de la force et l’ouverture du feu sur le territoire national, dont les modalités sont différentes de celles qui existent en OPEX. L’excuse pénale prévue pour les OPEX n’a pas d’équivalent sur le territoire national : on y est essentiellement soumis au régime de la légitime défense. C’est un véritable sujet car nos soldats n’ont que quelques secondes à peine pour décider l’usage de leurs armes.
M. Daniel Boisserie. Si je m’associe aux compliments de mes collègues quant à la qualité du rapport présenté, je serais plus critique quant à son exhaustivité car il a fallu attendre, si j’ose dire, la conclusion de la conclusion pour entendre le mot « ruralité ».
M. Olivier Audibert Troin. Nous sommes des élus de la ruralité !
M. Daniel Boisserie. Vous n’en donniez guère l’impression. Je voudrais savoir combien de villes bénéficient de l’opération Sentinelle et quelle proportion du territoire et de la population est concernée. Ne pensez-vous pas qu’un déséquilibre naît du fait que les forces de gendarmerie, et notamment les forces mobiles, se trouvent aujourd’hui employées dans les villes, à Paris ou à Calais, au lieu des territoires ruraux ?
L’armée se plaint des difficultés de circulation dans Paris, serait-il possible d’équiper les véhicules de gyrophares ?
M. Gilbert Le Bris. Qu’il s’agisse des menaces ou de l’opération Sentinelle, il semble bien que nous allons nous installer dans la durée. Il convient donc d’adapter notre armée à ce nouveau théâtre d’opérations qu’est le territoire national. Vous avez fait des propositions très intéressantes auxquelles je souscris, en matière d’évolution doctrinale et juridique ainsi que concernant la mise en place d’un centre d’opérations interministériel. Je suis plus réservé sur votre idée de rendre obligatoire pour tous une journée de réserve par an, dont je crains qu’elle ne soit un gadget. La durée optimale d’une telle période de formation et de réserve serait à mon sens d’une semaine, mais il s’agit là d’un autre débat.
Vous avez abordé le volet quantitatif des questions qui découlent de l’inscription dans la durée de l’opération Sentinelle en évoquant les effectifs et la loi de programmation militaire. Il faut aussi prendre en compte leur volet qualitatif. Avez-vous réfléchi à une éventuelle spécialisation des militaires qui sont engagés sur ce théâtre intérieur ou pensez-vous que nos militaires doivent pouvoir être engagés indifféremment sur le sol national et en OPEX ?
M. Nicolas Dhuicq. Je félicite également nos collègues pour cet excellent rapport. J’ai toutefois quelques questions car j’ai l’impression que nous sommes toujours, si j’ose dire, dans le coup d’après. Concernant l’entraînement, la question cruciale du calibre des armes et du passage du 9 mm au 5,6 mm se pose, et renvoie d’ailleurs à celle de la filière munitions et de la production nationale de nos cartouches. Ainsi, un gendarme tire en moyenne 90 cartouches par an à peine, et ce sur cible statique, alors qu’au moins 300 cartouches seraient nécessaires à l’entraînement au tir dans le contexte d’une foule en mouvement. Se pose également la question de la protection des forces de sécurité intérieure au sens large, dans lesquels j’inclus les surveillants pénitentiaires qui ne disposent pour transférer un prisonnier dangereux que d’un gilet pare-balles ‒ lequel n’est d’ailleurs pas une dotation personnelle et se limite souvent à une vieille flak-jacket ‒ et qui n’ont pour accompagner ce même détenu à l’hôpital ni arme ni flak-jacket. Deux surveillants ont failli mourir il y a deux ans parce que le civil qui conduisait le véhicule ne pouvait intervenir. L’équipement doit évoluer.
Nous devrions savoir dans cette commission que les cibles ne sont pas seulement statiques ; il y a aussi des scenarii d’attaque sur des cibles humaines spécifiques. Il y a quelques mois, un officier a failli le payer de sa vie. Le risque, c’est une politique de la terreur avec enlèvement, égorgement filmé et diffusion de la scène sur toutes les chaînes de télévision de France. Je m’interroge aussi quant aux cibles rurales ; j’ai reçu dans ma commune de 3 000 habitants un dénommé Farouk Ben Abbes, assigné à résidence, et je n’ai à ce jour aucune réponse du ministre de l’Intérieur concernant les moyens de notre brigade de gendarmerie, qui n’est pas équipée et n’a reçu aucun moyen supplémentaire pour surveiller un individu qui, de six heures à vingt heures, peut déambuler librement. Au sein de la ruralité, un des risques est la prise d’un village et l’appel à tous les musulmans islamistes de France à rejoindre le drapeau de l’État islamique flottant sur la mairie. Ce scénario est envisageable. Devons-nous constituer une force de frappe spécifique au lieu de répartir des soldats sur l’ensemble du territoire ? Notre collègue Malek Boutih évoquait une nouvelle force, mais je pense que cette force est la gendarmerie nationale, de statut militaire, qui peut constituer des unités de ce type. Je crois en effet qu’à terme, l’armée de terre ne pourra pas maintenir son effort actuel, qui aura des effets psychologiques non mesurés aujourd’hui.
Le commandement interministériel dont vous préconisez la création me semble une bonne chose mais vous évoquez sa direction par un préfet et non par un militaire, alors que l’équipement de nos forces de sécurité intérieure se rapproche de plus en plus de celui de l’armée de terre. Vous parliez du FAMAS, mais Thales a présenté à Eurosatory un fusil de trois kilos et demi très maniable dont la version 5,6 mm semble intéresser les gendarmes. Le calibre des armes est un élément important du débat sur les cibles : devons-nous tirer pour mettre hors d’état de nuire ou stopper et tuer ? Je suis favorable à ce que l’on revienne à une force de gendarmerie développée, avec des unités mobiles, que le ministre de l’Intérieur a commencé à mettre en place, et je plaide pour une force d’intervention rapide pour le type de scenarii que j’évoquais.
M. Philippe Vitel. Bravo mes chers collègues pour ce rapport sur l’emploi des forces armées sur le territoire national. Vous l’avez évoqué, me dit-on, avant mon arrivée mais comme j’entends parler de la seule opération Sentinelle, je ne voudrais pas que l’on oublie les 1 500 marins qui assurent la défense des approches maritimes et les 1 000 aviateurs qui assurent la sécurité permanente de l’espace aérien français.
Mme la présidente Patricia Adam. Cela a été largement dit.
M. Philippe Vitel. Mon collègue Gilbert Le Bris évoquait l’inscription de menaces dans la durée comme une nouveauté, mais nous sommes dans la même situation depuis 38 ans déjà ! C’est en 1978 qu’a été mise en place la première structure adaptée au contexte de terrorisme, suivie par le plan Pirate en 1981, puis Vigipirate en 1991 et aujourd’hui l’opération Sentinelle, qui est un renforcement de Vigipirate depuis janvier 2015. Ceci devrait nous conduire à une réflexion, que nous n’avons pas menée, sur le point de savoir quelle force est légitime pour conduire ces actions. C’est pour moi la gendarmerie, et non une quelconque garde nationale. À ce propos, lorsque nous avions un temps évoqué avec Mme la présidente l’idée de créer un corps de garde-côte, nous nous étions rendus à l’évidence que cela n’avait aucun sens au regard de l’exigence d’interopérabilité de nos forces. Une garde nationale n’en aurait selon moi pas davantage. Depuis plus de deux siècles la gendarmerie remplit ces missions. Ce sont des « gens d’armes » chargés d’assurer la sécurité sur le territoire national et dotés de grandes capacités d’adaptation. C’est en outre une arme de prestige, à telle enseigne que les premiers du classement de sortie à Saint-Cyr s’engagent dans la gendarmerie. Je leur fais pleinement confiance, à condition qu’on leur en donne les moyens, pour s’adapter à ces nouvelles missions, ce dont je ferai mon credo personnel en matière de doctrine.
Je souhaite avoir des précisions sur le coût du dispositif de protection. J’entends parler d’un surcoût d’un million d’euros par jour depuis plus de 500 jours par rapport au plan Vigipirate, hors les primes versées aux soldats. Disposez-vous d’un calcul de l’enveloppe globale du coût de l’opération Sentinelle depuis janvier 2015, qui pourrait éclairer une réflexion portant sur l’attribution de ces sommes et l’éventuelle création d’une arme dédiée à la protection du territoire national ?
M. Yves Fromion. Je m’associe aux félicitations adressées aux rapporteurs ainsi qu’aux réflexions formulées par nos collègues. Pour ce qui concerne l’absence de doctrine que les rapporteurs ont bien soulignée, j’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une absence de prise de responsabilité du secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale (SGDSN). En effet, les deux dernières lois de programmation militaire ont prévu l’engagement de 10 000 militaires pour la sécurité du territoire sans que personne ne réfléchisse au corps de doctrine devant nécessairement accompagner cette disposition. Il s’agit là d’une défaillance extraordinaire, toutes tendances politiques confondues. Je trouve que le PC de crise que vous avez évoqué est une excellente idée mais qu’il convient de le placer non pas auprès du ministre de l’Intérieur mais bien auprès du SGDSN, c’est-à-dire du Premier ministre, en raison même du caractère interministériel de la situation ; le SGDSN devrait disposer d’une salle de crise vers laquelle faire converger l’ensemble des informations et des leviers de gestion de crise relevant de la police, de la gendarmerie, de la défense, mais également des autres ministères.
Ma question porte sur la déflation des effectifs. J’ai pour ma part compris que son annulation était totale et concernait les 24 000 postes dont la suppression était envisagée dans la loi de programmation militaire. L’annonce a été faite en deux fois, une première fois en avril 2015 et une seconde fois en novembre suivant, le président de la République ayant annoncé l’arrêt de toute déflation. Je ne comprends donc pas pourquoi il est question d’un quelconque « résidu de postes à supprimer » et la « rallonge » de 3,8 milliards d’euros, dont 2,8 milliards consacrés à la protection, devait théoriquement couvrir l’annulation totale de la déflation des effectifs.
La gendarmerie est, je ne cesse de le répéter, notre garde nationale. Il s’agit de sa vocation naturelle et l’ancienne majorité, dont je suis, a commis une lourde erreur en réduisant ses moyens. Nous devrions en tirer les conséquences et lui donner des moyens supplémentaires, notamment en escadrons mobiles, de façon à donner de la consistance à cette « garde nationale ».
Vous avez relevé qu’il est moins cher de recourir à l’armée de terre qu’à la police ou à la gendarmerie. Mais, si cela est effectivement le cas, je ne l’écrirais à votre place qu’en filigrane car les militaires n’apprécient guère d’être considérés comme une force de sécurité « low cost ».
M. David Comet. Félicitations pour ce rapport. La manœuvre globale de sécurité intérieure dans le cadre de la lutte antiterroriste est placée sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et des préfets, mais Sentinelle s’inscrit en cohérence avec les opérations extérieures. Si, dans les premiers temps, elle a permis une protection statique des sites les plus sensibles, cette opération allie désormais gardes statiques et patrouilles aléatoires. Le ministre de la Défense a informé la commission d’enquête relative aux moyens mis œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015 que les parts respectives des postures dynamiques et statiques dans le nombre de sites protégés s’établissent désormais dans un rapport de 80 % / 20 %, augmentant le sentiment de sécurisation.
Lors de l’attentat du Bataclan, les militaires étaient présents mais n’ont pas reçu d’ordre d’intervention du ministère de la Défense ou de la préfecture de police de Paris. La commission d’enquête précitée s’interroge donc sur l’usage qui pourrait être fait de la force Sentinelle, armée de FAMAS, en dehors de la sécurisation de zone.
Un profilage de sécurité est effectué à l’aéroport de Tel-Aviv par les personnels compétents. Serait-il possible de prévoir pour nos militaires une formation de quinze jours à cette méthode, qui représenterait une plus-value pour leur action et contribuerait à l’amélioration de la sécurisation de nos aéroports ? En Israël, les militaires agissent en dehors du territoire national et la police à l’intérieur ; notre grille de lecture est différente et nous estimons que, la menace étant ce qu’elle est, sécurité intérieure et sécurité extérieure s’interpénètrent et que la situation nécessite donc l’intervention des militaires. Je souhaite avoir votre sentiment sur cette philosophie des espaces d’intervention.
M. Olivier Audibert Troin, rapporteur. S’agissant de la répartition des effectifs de l’opération Sentinelle entre zones urbaines et zones rurales, nous ne disposons pas de données chiffrées définitives, mais d’ordres de grandeurs significatifs. Ainsi, entre 70 et 75 % des militaires qui ont participé à cette opération ont été déployés en région d’Île-de-France, où il est vrai que sont concentrés bien des centres de décision et des objectifs potentiels. Comment être le plus efficace en zone rurale ? Élu de la ruralité moi-même, je pense que ces espaces peuvent être très vulnérables. Des réponses ont déjà été en partie apportées à cette question, avec la réorganisation sur une base régionale des diverses forces d’interventions, telles que le RAID, les BRI ou le GIGN. Par ailleurs, une tendance à conduire davantage d’exercices militaires au sein des populations, hors des camps militaires, est à l’œuvre. Enfin, il faudra probablement augmenter les effectifs de la gendarmerie de manière à garantir sa meilleure présence sur le territoire. Pour ce qui est de la qualité professionnelle des personnels militaires déployés, les évènements de Valence et de Nice ont démontré leur extrême professionnalisme et leur capacité à réagir de manière adaptée.
En ce qui concerne le surcoût de l’opération Sentinelle, il s’établit en 2015 à 118 millions d’euros hors titre 2 – c’est-à-dire hors dépenses de personnel – et à 55,5 millions d’euros pour le titre 2.
Pour répondre à notre collègue Yves Fromion, il n’est bien entendu pas question de considérer nos armées comme des forces de sécurité « low cost », mais simplement de relever que nos calculs montrent – en première approximation et sous toute réserve – que, pour assurer une même mission de garde statique permanente, il faut 5,77 policiers là où il faut 3,69 militaires. Cela s’explique bien entendu par des différences statutaires et de temps de travail.
Pour ce qui est du profilage à l’aéroport de Tel Aviv, ma propre expérience lors de notre déplacement est significative. En effet, lors de l’interrogatoire de sécurité, j’avais oublié le nom de l’hôtel dans lequel nous avions séjourné ; cela m’a valu de patienter le temps que soient opérées des vérifications complémentaires des plus efficaces… Est-ce à dire que c’est à nos armées qu’il revient de développer de tels moyens de suivi et de profilage ? Je ne le pense pas ; cela ressort plutôt des compétences des forces de sécurité intérieure et des services de sécurité aéroportuaire.
Pour répondre à la question portant sur le rôle des militaires de Sentinelle aux abords du Bataclan, je rappellerai que le ministre de la Défense a répondu ici même en relevant qu’il s’agissait d’une question opérationnelle et qu’en l’espèce, nos militaires avaient obéi aux ordres qui leur avaient été donnés de sécuriser le périmètre afin de faciliter le travail des unités d’intervention. Tout ceci plaide d’ailleurs à mon sens pour l’organisation d’une structure interministérielle de planification et de commandement.
M. Christophe Léonard, rapporteur. Pour revenir à la question du déploiement de Sentinelle en milieu rural, je pense qu’il est important de ramener les effectifs déployés à 7 000, conformément au contrat opérationnel. Nos amis britanniques ont d’ailleurs prévu, dans le cadre des plans de l’opération Temperer, un déploiement en deux étapes portant les effectifs employés à 3 500 puis à 5 000, ce qui permet de conserver une force en réserve de 5 000 militaires. Nous devrions en faire de même, en utilisant une partie des 7 000 militaires déployés pour mener des opérations de contrôle de zone hors des grandes villes ou les régions frontalières.
D’aucuns nous reprochent d’être trop timides en ne proposant qu’une seule journée de réserve par an pour former les citoyens à la résilience face au terrorisme…
M. Yves Fromion. Pour un barbecue festif, c’est bien suffisant !
M. Christophe Léonard, rapporteur. Disons plutôt que nous souhaitons démarrer modestement, au vu de l’ampleur des problèmes d’infrastructures que pourraient poser plusieurs journées en continu, afin de lancer la réflexion. Nous proposons la mise en place d’un groupe de travail sur ce sujet.
Tous les officiers généraux que nous avons entendus ont jugé nécessaire de ne pas faire de distinction entre militaires, tous devant être aptes à effectuer des opérations extérieures aussi bien que des opérations intérieures. Le rythme très soutenu des rotations peut avoir des effets sur la fidélisation des personnels, ce qui constitue également une des raisons pour lesquelles il faut s’orienter vers un déploiement ramené à 7 000 personnels, conforme au contrat opérationnel.
À l’occasion de notre déplacement en Israël, nous avons pu constater la présence très légère des forces de police visibles et l’absence de gardes statiques devant des lieux sensibles, notamment à Tel-Aviv, ce qui offre un contraste saisissant avec la situation prévalant à Paris, y compris avant janvier 2015. Une autre manière d’envisager la sécurité est donc possible, en mettant davantage l’accent sur le renseignement et sur un contrôle strict aux frontières, plutôt que de se cantonner à des gardes statiques de lieux de cultes censément protectrices. Nous pourrions donc utilement nous en inspirer en réorientant le dispositif vers 80 % de gardes dynamiques. Pour cela, il faut mettre en avant les objectifs de sécurisation plutôt que de s’en tenir à des obligations de moyens.
Mme la présidente Patricia Adam. Merci pour cet intéressant rapport, qui mérite une large diffusion et donc que vous organisiez une conférence de presse à cet effet.
La commission autorise à l’unanimité le dépôt du rapport d’information sur la présence et l’emploi des forces armées sur le territoire national en vue de sa publication.
ANNEXE
AUDITIONS ET DÉPLACEMENTS DE LA MISSION D’INFORMATION
(Par ordre chronologique)
1. Auditions :
Ø M. le général Didier Brousse, sous-chef d’état-major « opérations aéroterrestres » de l’état-major de l’armée de terre, M. le colonel Hervé Fouilland et M. le lieutenant-colonel Pierre Chareyron ;
Ø M. le général Jean-François Parlanti, commandant le centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations (CICDE) ;
Ø Mgr Luc Ravel, aumônier en chef du culte catholique aux armées et Mgr Michel Dubost, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes, représentants de la Conférence des évêques de France ;
Ø M. Vincent Moreau, sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget du ministère des Finances et des comptes publics et M. Dominique Blaes, chef du bureau de la défense et de la mémoire ;
Ø M. le général Jean-François Hogard, directeur de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD) ;
Ø M. le général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie, M. le colonel Jean-Pierre Aussenac et M. le colonel Laurent Phelip ;
Ø M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, M. le colonel Hervé de Courrèges et M. Gwénaël Jézéquel ;
Ø M. le contrôleur général des armées Jean-Paul Bodin, secrétaire général pour l’administration et M. le colonel Frank Barrera, chef de cabinet ;
Ø M. Abdelkader Arbi, aumônier en chef du culte musulman aux armées ;
Ø Me Laurent-Franck Liénard, avocat au barreau de Paris ;
Ø M. François Molins, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris ;
Ø M. Jean-Claude Mallet, conseiller spécial du ministre de la Défense ;
Ø M. le rabbin Haïm Korsia, Grand rabbin de France et Mlle Yaël Hirschhorn, chargée des relations institutionnelles ;
Ø M. François Heisbourg, président de l’International Institute for Strategic Studies (IISS) et du Centre de politique de sécurité (GCSP), conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) ;
Ø Me Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris ;
Ø M. le général Arnaud Sainte-Claire Deville, commandant des forces terrestres (CFT), M. le colonel Armel Dirou, chargé d’études et M. le capitaine Gilles Dufeutrelle ;
Ø M. Roger Cukierman, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) et MM. Francis Kalifat et Yonathan Arfi, vice-présidents du CRIF ;
Ø M. le général Christian Thiébault, secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM) et Mme le capitaine Solène Darras ;
Ø M. le général Hervé Wattecamps, directeur des ressources humaines de l’armée de terre, M. le colonel Pierre Chareyron, et M. le lieutenant-colonel Boris Vallaud ;
Ø M. Jacques Toubon, Défenseur des droits, M. Richard Senghor, secrétaire général et Mme France de Saint-Martin ;
Ø M. le général Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris et M. le colonel Marc Boileau, chef de cabinet ;
Ø Mme Claire Landais, directrice des affaires juridiques du ministère de la Défense ;
Ø M. le général Philippe Boutinaud, commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris et M. le colonel Jean-Pierre Tourtier, médecin en chef de la brigade ;
Ø M. le général Grégoire de Saint-Quentin, général commandant les opérations spéciales et M. le capitaine Etienne Devic, chef de cabinet ;
Ø M. le général André Lanata, chef d’état-major de l’armée de l’air, M. le général Jean-Christophe Zimmermann, commandant en second de la défense aérienne et des opérations aériennes et adjoint « territoire national » au commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et M. le colonel Olivier Kaladjian, assistant militaire ;
Ø M. le général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre, M. le colonel Hervé Fouilland, M. le colonel Pierre Chareyron et M. le lieutenant-colonel Olivier Pinard Legry ;
Ø M. Philippe Errera, directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la Défense, M. le colonel Randal Zbienen et M. Etienne de Durand ;
2. Déplacements :
Ø Var (état-major du commandant en chef de la Méditerranée et préfet maritime, base aéronavale de Hyères, aviso Enseigne de vaisseau Jacoubet) :
– M. le vice-amiral d’escadre Yves Joly, commandant en chef de la Méditerranée et préfet maritime de la Méditerranée ainsi que ses subordonnés, notamment M. le contre-amiral Bernard Velly, adjoint territorial, M. le commissaire général Hervé Parlange, adjoint chargé de l’action de l’État en mer et M. le capitaine de vaisseau Gilles Boidevezi, adjoint « opérations » ;
– M. le capitaine de corvette Guillaume Soubirant, commandant de l’aviso Enseigne de vaisseau Jacoubet, et l’équipage du bâtiment ;
– le commandement de la base aéronavale de Hyères et les personnels de la flottille d’hélicoptères 36F et des flottilles 21F et 23F de Lann-Bihoué ;
– le commandement et les personnels du groupement de fusiliers marins chargé de la protection des bases de Toulon et d’Hyères;
– le commandement et les personnels de la gendarmerie maritime ;
– le commandement et les personnels du centre de coordination des opérations de protection de la base navale ;
– le commandement et les personnels du sémaphore de la vigie Cépet.
Ø Fort de Vincennes (groupement Paris-centre de la force Sentinelle) :
– M. le lieutenant-colonel Anne-Henry Budan de Russé, commandant le groupement Paris-centre de la force Sentinelle, et son état-major ;
– personnels issus de différentes unités et engagés à Paris dans l’opération Sentinelle.
Ø Belgique (Bruxelles) :
– M. Brecht Vermeulen, président de la commission de l’Intérieur, des affaires générales et de la fonction publique de la Chambre des représentants ;
– M. Georges Dallemagne, député de Bruxelles et membre de la commission spéciale sur la lutte contre le terrorisme ;
– ministère de la Défense : M. le colonel Pierre Gérard, directeur des opérations et de l’entraînement et M. le capitaine de frégate Pierre-Yves Rosoux, secrétaire administratif et technique au cabinet du vice-premier ministre et du ministre de la Défense ;
– centre de crise du service public fédéral de l’Intérieur : M. Alain Lefèvre, directeur ;
– ambassade de France : Mme Claude-France Arnould, ministre plénipotentiaire.
Ø Royaume-Uni (Londres) :
– Mme Penelope Mordaunt, ministre déléguée aux forces armées ;
– M. Julian Lewis, président de la commission de la Défense de la Chambre des Communes ;
– état-major des armées : l’adjoint du sous-chef « opérations » de l’état-major des armées et ses subordonnés ;
– ministère de l’Intérieur : un représentant de la direction de la sécurité et du contre-terrorisme ;
– London District : le chef d’état-major et ses subordonnés ;
– ambassade de France : M. l’amiral Patrick Chevallereau, attaché de défense et M. le colonel Antoine de Loustal, attaché militaire adjoint.
Ø Israël (Tel-Aviv, Atarot et Jérusalem) :
– Knesset : M. Élie Elalouf, député, président du groupe d’amitié France-Israël, M. Omer Barlev, député, ancien commandant d’une unité de forces spéciales spécialisée dans la lutte antiterroriste, M. Michael Oren, député, ancien ambassadeur de la République d’Israël auprès des États-Unis ;
– Military Advocate General : M. le colonel Doron Ben Barak, adjoint au Military Advocate General, et ses subordonnés ;
– Home Front Command : le commandement de Tel-Aviv et des personnels d’active et de réserve ;
– Shabak : un directeur de département et ses analystes ;
– Magav : le commandement de Jérusalem ;
– ambassade de France : M. Gilles Pécassou, chargé d’affaires, M. le colonel Benoît de La Ruelle, attaché militaire et M. Pascal Augrain, attaché de sécurité intérieure.
1 () Acronyme de Ardennes complexe interservices d’entraînement à la réalité.
2 () État-major des armées, « Organisation territoriale interarmées de défense », publication interarmées n° D-12-002694/DEF/EMA/EMP.3/NP du 20 avril 2012.
3 () Airborne Warning and Control System, pour système de détection et de commandement aéroporté.
4 () Avis n° 3096, tome VI, « Préparation et emploi des forces : air » présenté par notre collègue Christophe Guilloteau, octobre 2015.
5 () Aux termes du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer.
6 () Il s’agit de l’amiral commandant la force d’action navale (ALFAN), l’amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique (ALFOST), l’amiral commandant la force de l’aéronautique navale (ALAVIA) et l’amiral commandant la force maritime des fusiliers marins et commandos (ALFUSCO).
7 () Outre-mer, la fonction de préfet maritime est exercée par le préfet du département ou le Haut-Commissaire (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) qui prennent le nom de « délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer ».
8 () État-major des armées, directive interarmées sur l’emploi de la force dans le cadre des missions intérieures, hors états d’exception (milieu terrestre) n° D-10-00-002077/DEF/EMA/EMP.1/NP du 23 novembre 2010.
9 () Littéralement : « le dernier argument des souverains ».
10 () État-major des armées, « Organisation territoriale interarmées de défense », publication interarmées n° D-12-002694/DEF/EMA/EMP.3/NP du 20 avril 2012.
11 () Avis n° 3115, tome IV, « Préparation et emploi des forces : forces terrestres », fait par M. François Lamy sur les crédits de l’armée de terre pour 2016, octobre 2015.
12 () Selon l’article 12 du code de procédure pénale, « la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers et agents » ; l’article 14 du même code dispose que la police judiciaire « est chargée […] de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ». Parmi le personnel concerné, on distingue les officiers de police judiciaire (OPJ) régis par l’article 16 du même code, les agents de police judiciaire (APJ) régis par l’article 20, les agents de police judiciaire adjoints (APJA) régis par l’article 21 et les officiers de douane judiciaire (ODJ) régis par l’article 28-1. Les officiers de police judiciaire disposent d’une compétence générale de police judiciaire et ont ‒ à la différence des APJ et APJA ‒ l’exclusivité des mesures les plus importantes telles que le placement en garde à vue, la perquisition ou les réquisitions à personne.
13 () Lutte contre les menaces nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques (NRBC).
14 () Cour des comptes, « Police et gendarmerie nationales : dépenses de rémunération et temps de travail », rapport public thématique, mars 2013.
15 () Pour « automatisation des communications radioélectriques opérationnelles de la police nationale ».
16 () Kommando territoriale Aufgaben des Bundeswehr.
17 () Gouvernement nord-irlandais, du nom du siège du gouvernement, le palais de Stormont à Belfast.
18 () La bataille de la Boyne oppose en 1660 le catholique Jacques II d’Angleterre et le protestant Guillaume III également appelé Guillaume d’Orange, tous deux rivaux aux trônes d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande. La victoire de Guillaume d’Orange sur son adversaire lors de cette bataille fait de celle-ci un symbole de l’hégémonie des protestants.
19 () Organisation paramilitaire loyaliste.
20 () Technique consistant à agir et fuir rapidement.
21 () Military Intelligence, section 6, dont l’appellation officielle est Secret Intelligence Service (SIS).
22 () S’agissant des palais royaux et autres sites institutionnels, les responsables du London District ont indiqué aux rapporteurs que les militaires déjà présents à des fins d’apparat « auront juste à changer d’uniforme pour une tenue de combat ».
23 () Strategic Defence and Security Review, équivalent britannique du Livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale.
24 () Commission de la défense nationale et des forces armées, 15 octobre 2015, compte rendu n° 11.
25 () Rapport d’information n° 2745 fait par Mme Geneviève Gosselin-Fleury et M. Alain Marleix sur l’état d’avancement de la manœuvre ressources humaines et les conséquences des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 octobre 2014, mai 2015.
26 () Cour de Cassation, chambre criminelle, Arrêt Consorts X n° 755 du 18 février 2003.
27 () Voir par exemple Cour de cassation, chambre criminelle, Arrêt du 12 mars 2013, pourvoi n° 12-82683.
28 () La notion de « protection défense » (PRODEF) est définie comme l’ensemble des dispositifs techniques, humains et organisationnels mis en place pour protéger les installations, les matériels, les informations, le personnel et activités abritées par une installation militaire contre une atteinte physique liée à une agression armée, au terrorisme, au sabotage ou à tout acte de malveillance.
29 () Élie Tenenbaum, « La Sentinelle égarée ? L’armée de Terre face au terrorisme », Focus stratégique, n° 68, juin 2016.
30 () Cette croissance s’explique cependant aussi par d’autres facteurs, comme par exemple la mise en place des ZRR (zones à régime restrictif) au sein d’entreprises détenant des savoir-faire stratégique susceptibles de faire l’objet d’espionnage industriel. Ce régime spécifique impose en effet la réalisation d’un contrôle élémentaire, réalisé par la DPSD lorsque les sociétés concernées sont en lien avec la défense.
31 () Général (2S) Vincent Desportes, « Armées et lutte contre le terrorisme » in Cercle de réflexion G2S, « Pour un rôle clair et réaliste des armées dans la lutte contre les terroristes “militarisés”… » n° 17, avril 2016.
32 () Général Jean-Pierre Bosser, « L’Armée de terre, le territoire national et l’année 2015 », Revue Défense Nationale, n° 791, janvier 2016.
33 () Exercice annuel de mise à jour de différents aspects de la programmation militaire.
34 () Le Renault GBC 180 est un véhicule cargo tous terrains militaire français à trois essieux moteurs (6×6) en tout-terrain et pouvant transporter 4 tonnes de charge utile.
35 () Le Peugeot P4 est un véhicule léger à quatre roues motrices produit par Peugeot, présenté en mars 1981 à Satory et utilisé par l’armée française sous la désignation de « véhicule léger tout-terrain ».
36 () Le Panhard Véhicule blindé léger (VBL) est un véhicule blindé léger permettant d’effectuer des reconnaissances ou des liaisons sous blindage, tout en étant protégé contre les attaques NBC.
37 () Avis n° 3115, tome III, « Soutien et logistique interarmées », fait par M. Charles de la Verpillière sur le projet de loi de finances pour 2016, octobre 2015.
38 () Assemblée nationale, commission de la Défense nationale et des forces armées, audition de M. Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, 2 décembre 2015, compte rendu n° 23.
39 () En France, il a désigné pendant la majeure partie du XIXe siècle une milice urbaine, souvent présentée comme une milice « bourgeoise », dissoute dans les premiers mois de la IIIe République.
© Assemblée nationale