

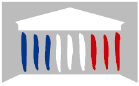
N° 4062
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 septembre 2016.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145–7 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
en conclusion des travaux de la mission sur
l’application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche,
ET PRÉSENTÉ PAR
Mme Sandrine DOUCET,
M. Benoist APPARU
Co-rapporteurs.
——
La mission d’information sur l’application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est composée des deux co-rapporteurs : Mme Sandrine Doucet et M. Benoist Apparu.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I. UN PREMIER BILAN DE L’APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUILLET 2013 7
A. LES GRANDS OBJECTIFS D’UNE LOI D’ORIENTATION 7
B. LES TEXTES D’APPLICATION 12
C. LES RAPPORTS AU PARLEMENT 12
D. LES STRATÉGIES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 20
1. Des stratégies s’inscrivant dans une concertation longue 20
a. La Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (StraNES) 20
b. La stratégie nationale de recherche (S.N.R.) 22
2. Des stratégies en quête d’une programmation 23
II. LES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU REGARD DE DEUX THÈMES MAJEURS DE LA LOI : LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE ET LA GOUVERNANCE 25
A. L’ENJEU DE LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE 25
1. L’articulation entre enseignements secondaire et supérieur 25
2. Réussir dans l’enseignement supérieur technologique et professionnel 30
a. Les instituts universitaires de technologie (IUT) 31
b. Les sections de techniciens supérieurs (STS) 34
3. Réussir à l’université 37
a. Faire coïncider élitisme et ouverture à tous les étudiants 37
i. La sélection en licence ou une réorientation en cours de L1 ? 38
ii. La sélection en master 40
b. L3, licence ou bachelor, processus européen et marché mondial 41
4. Réussir dans l’enseignement supérieur privé associatif 45
B. LA RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 47
1. Des regroupements territoriaux et des coopérations aux aspects multiples 47
a. Les communautés d’universités et établissements (ComUE) 47
i. Les PRES et le premier programme des investissements d’avenir (PIA 1) 47
ii. Les ComUE 49
iii. Les grands organismes de recherche dans les ComUE 57
iv. Les ComUE et les PIA 57
b. La place des grandes écoles et des grands établissements dans les ComUE 63
2. Les universités et l’autonomie 66
a. Les nouvelles structures de gouvernance 66
b. Les fusions 69
c. L’autonomie financière et les droits d’inscription 70
d. Une approche transversale étudiante sur la loi ESR et les questions de gouvernance 73
TRAVAUX DE LA COMMISSION 77
ANNEXES 97
1. Liste des personnes auditionnées 97
2. Décrets d’application 102
3. Liste des préconisations sur les carrières d’enseignants-chercheurs (Rapport IGAENR n° 2015-073 - décembre 2015) 104
4. Liste des thèmes de la loi classés par titre, chapitre et article (hors coordinations diverses) 107
5. Regroupement d’établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche 113
6. Rapport d’autoévaluation du HCERES : forces et faiblesses 114
La commission des Affaires culturelles et de l’éducation a décidé, le 20 janvier 2016, de constituer une mission d’information sur l’application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (1), en application de l’article 145-7, alinéa 3, du Règlement de l’Assemblée nationale qui dispose que, « à l’issue d’un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur d’une loi, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, présentent à la commission compétente un rapport d’évaluation sur l’impact de cette loi. »
La loi du 22 juillet 2013 succédait à deux textes qui avaient substantiellement modifié l’organisation, d’une part, de la recherche : la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche et, d’autre part, de l’enseignement supérieur : la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (2). Première de ce genre, la loi du 22 juillet 2013 visait, quant à elle, à réunir dans un cadre législatif commun l’ensemble des politiques publiques en matière de recherche et d’enseignement supérieur.
Son élaboration a reposé sur un travail préparatoire important qu’il convient de rappeler, depuis les assises de l’enseignement supérieur et de la recherche jusqu’au travail mené, tant en commission qu’en séance publique, par les deux assemblées.
Un certain nombre de points, qui avaient suscité de larges débats lors de l’examen du projet de loi, avaient conduit le Parlement à demander des rapports d’évaluation. On pourra constater que ces sujets, s’ils restent d’actualité, ont perdu une partie de leur caractère polémique.
Loi d’orientation et non de programmation, la loi ESR prévoyait l’élaboration de deux stratégies, la stratégie de l’enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche, publiées toutes les deux en 2015 et qu’il convient de présenter. Le livre blanc qui devait les réunir et en définir la base budgétaire sera proposé cet automne.
Les dispositions contenues dans les 129 articles de la loi sont très diverses. Mais les quatre objectifs majeurs présentés par le Gouvernement à l’appui du projet de loi visaient à offrir de meilleures chances de réussite à tous les étudiants, à donner un nouvel élan et une meilleure visibilité à la recherche, à renforcer la coopération entre tous les acteurs et, enfin, à amplifier la présence de la recherche française dans les programmes européens et le rayonnement international des universités, écoles et laboratoires en encourageant la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
Lors de la réunion préparatoire aux travaux de la mission, les rapporteurs ont décidé de travailler plus particulièrement sur deux de ces objectifs, qui sont le sujet de la deuxième partie de ce rapport : la réussite étudiante et la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur, et plus particulièrement celle des universités. Ils ont déterminé les auditions des nombreux responsables et acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche que les rapporteurs ont rencontré.
La loi, soit directement en introduisant des quotas de bacheliers professionnels et technologiques ou en systématisant les conventions entre les lycées et les universités, soit indirectement par le cadre qu’elle établit, les mesures réglementaires ou contractuelles, les initiatives ministérielles et interministérielles, a en effet produit des résultats en matière de réussite étudiante qu’il convient de présenter.
Qu’il s’agisse des conditions de l’articulation entre les enseignements secondaire et supérieur, de l’orientation et de la sélection post-baccalauréat puis tout au long des études supérieures, de l’apparition de nouveaux diplômes comme le bachelor, ou encore du renforcement de la mobilité et de l’insertion des étudiants, son impact doit être précisé.
La loi a également sensiblement modifié l’organisation de la gouvernance de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle a mis en place de nouveaux modes de regroupement territoriaux et de coopération entre les établissements, dont les communautés d’universités et établissements. Elle a réformé le mode d’élection des présidents et des conseils et influé assez notablement sur la pratique, par les universités, de leur autonomie. Il convient d’examiner ces nouvelles structures et leur fonctionnement.
Trois ans est certes un délai assez court pour évaluer une loi portant sur des sujets qui ne peuvent s’apprécier pleinement que sur le temps long. En effet, la troisième année universitaire suivant sa promulgation vient de s’achever et les derniers éléments statistiques stabilisés disponibles datent de 2015. Cependant, les rapporteurs ont pu mesurer, au cours des auditions, combien l’ensemble de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche s’était d’ores et déjà emparée d’un texte qui, s’il ne se définissait pas comme fondateur, n’en emportait pas moins de nombreuses réorganisations. Que ces témoins passionnés soient ici remerciés.
I. UN PREMIER BILAN DE L’APPLICATION DE LA LOI DU 22 JUILLET 2013
A. LES GRANDS OBJECTIFS D’UNE LOI D’ORIENTATION
1. Les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche
La préparation du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche s’est appuyée sur les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui se sont déroulées durant le deuxième semestre de 2012.
Lancées à l’initiative du Président de la République nouvellement élu, les assises étaient animées par un comité de pilotage, nommé par Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, et présidé par Mme Françoise Barré-Sinoussi. Après avoir procédé à une centaine d’auditions d’organisations nationales, le comité a proposé une synthèse intermédiaire de ses travaux qui a contribué à lancer les débats des assises territoriales, tenues dans toutes les régions de France. Se fondant sur les rapports de ces assises, complétés par ceux d’ateliers thématiques, le comité a formulé un premier ensemble de propositions débattues lors des assises nationales qui se sont tenues au Collège de France, les 26 et 27 novembre 2013. Les propositions issues de ces concertations multiples ont fait l’objet d’un rapport au Président de la République confié à M. Vincent Berger et remis le 17 décembre 2012.
Les thématiques initiales proposées par la ministre étaient triples : la réussite des étudiants, l’ambition pour la recherche et l’organisation de l’enseignement supérieur.
Elles ont cadré les propositions du rapport, complétées par deux thématiques supplémentaires, l’une à caractère social – mieux reconnaître l’activité des femmes et des hommes –, l’autre plus budgétaire – affirmer l’engagement de la France dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Synthèse des principales propositions issues
des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche
Assurer une continuité entre le lycée et l’enseignement supérieur (propositions 1 à 7)
Réformer la licence dans le sens d’une spécialisation disciplinaire progressive et augmenter le taux d’encadrement en premier cycle (propositions 9, 14)
Renforcer dans la loi la priorité d’accueil des bacheliers professionnels en STS et des bacheliers technologiques en IUT (proposition 13)
Encourager les formations en alternance et tout au long de la vie (propositions 16 à 20)
Rattacher par partenariat chaque classe préparatoire aux grandes écoles à une université (propositions 21 et 22)
Faire reconnaître le doctorat dans la haute fonction publique et dans les conventions collectives (proposition 34)
Mettre en place une initiative nationale de l’enseignement en ligne (propositions 36 à 39)
Mettre en place une nouvelle allocation d’études versée sur critères sociaux et d’assiduité (proposition 44)
Construire un agenda stratégique sur les grands enjeux de société (54 et 55)
Développer les coopérations entre la recherche publique et la recherche privée (propositions 56 à 58, 102 et 103)
Augmenter le soutien de base des laboratoires (proposition 59)
Améliorer la sincérité budgétaire de l’enseignement supérieur et de la recherche (propositions 65 à 69)
Mieux faire participer l’ensemble de la société aux choix scientifiques (propositions 73 et 74)
Mettre en cohérence et développer l’action internationale de la France dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche (propositions 26, 29, 49 à 52, 70 et 71, 76 à 80)
Retirer la personnalité morale aux « idex » et supprimer les « périmètres d’excellence » (propositions 82 et 83)
Remplacer toutes les structures ayant pour objectif de faire coopérer des équipes de recherche par une seule structure-type, légère et sans personnalité morale (proposition 86)
Réviser la gouvernance des universités vers davantage de collégialité et de démocratie (propositions 87 à 94)
Transformer les pôles de recherche et d’enseignement supérieur en grandes universités à l’échelle régionale (propositions 95 à 99)
Élaborer des schémas régionaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (propositions 100 à 103)
Consolider les ressources humaines des opérateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche et revaloriser les carrières (propositions 104 à 108)
Résorber la précarité de l’emploi dans l’enseignement supérieur et la recherche (propositions 108 à 113)
Mieux former les enseignants-chercheurs à la pédagogie (propositions 114 et 115)
Prendre en compte toutes les activités des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des ingénieurs dans leur carrière (propositions 116 à 119)
Faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes (proposition 124)
Redéfinir le système d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche et supprimer les notations (proposition 131 et 132)
Dépasser 0,85 % du PIB pour les dépenses publiques de recherche hors militaire et grands programmes technologiques. Atteindre ainsi 1,15 % du PIB pour le total des dépenses publiques de recherche et de développement (proposition 134)
Augmenter les budgets des universités progressivement pour atteindre une dépense de 9 000 € par étudiant, hors dépenses de recherche (proposition 135)
(Source : assises de l’enseignement supérieur la recherche - rapport de M Vincent Berger au Président de la république).
Au rapport des assises s’est ajouté celui de notre collègue M. Jean-Yves Le Déaut, président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) : « Refonder l’université, dynamiser la recherche, mieux coopérer pour réussir » proposant des transcriptions législatives et réglementaires des conclusions des assises, remis au Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, le 14 janvier 2013.
Les quatre parties de ce rapport portaient sur la gouvernance et l’autonomie des établissements, l’enseignement supérieur et la recherche et les territoires, la réussite des étudiants et une nouvelle ambition pour l’enseignement supérieur et la recherche, ses acteurs, son financement et son évaluation.
Dans sa conclusion, M. Jean-Yves Le Déaut soulignait que son « rapport s’est inscrit dans une démarche d’adaptation législative tout à fait inédite, consistant à associer le Parlement en amont de l’élaboration du texte gouvernemental, contrairement à la pratique courante l’impliquant seulement à partir du dépôt du projet de loi sur le bureau de l’une ou l’autre des deux chambres. »
Il proposait « le repositionnement de l’université au cœur du système d’enseignement supérieur et de recherche, rendu nécessaire par l’essoufflement du processus de rattrapage, qui a donné durant des décennies tout son sens au fort développement des écoles d’ingénieurs et des organismes de recherche appliquée », précisant qu’à côté de l’apprentissage rapide des savoirs, la formation par la recherche à l’université devient un atout stratégique pour le pays et que les nouvelles modalités de regroupement des établissements doivent leur en donner l’occasion.
Il suggérait « un plus large éclectisme du parcours des étudiants qu’il s’agisse de l’amélioration de l’orientation combinée à une spécialisation plus tardive, de la multiplication des passerelles facilitant les rebonds, ou de la pluralité des voies d’accès préservant toute la valeur des cheminements indirects, souvent enrichissants. »
Rappelant l’importance de la coopération pour atteindre la performance, il remarquait que cela correspondait à une démarche d’adaptation raisonnée au contexte mondial, l’importation d’un modèle de concurrence généralisée ne lui paraissant pas pertinente dans un pays de taille moyenne comme la France, où les ressources sont comptées. Cette coopération entre établissements et organismes devait comporter un ancrage régional solide puisque « dans ce domaine, comme maints exemples étrangers l’ont montré, les projets qui réussissent sont ceux qui se construisent en étroit partenariat avec les collectivités locales et les entreprises ; les premières fournissent les infrastructures, les secondes les emplois, et toutes profitent des retombées liées au rayonnement scientifique et technologique qui attire les meilleurs professeurs et les meilleurs chercheurs. » (…) « C’est à travers un maillage de puissants pôles régionaux acquérant une véritable visibilité internationale que l’enseignement supérieur et la recherche insuffleront leur vitalité retrouvée à l’économie française. »
Enfin, le rôle de l’État, garant de la cohésion nationale serait, dans ce cadre refondé, de continuer à garantir le niveau des diplômes et le statut des personnels tout en renforçant son action de pilotage stratégique. À cet égard, la programmation prospective de la recherche ainsi que les perspectives quinquennales tracées par un Livre blanc pour l’enseignement supérieur et la recherche devraient permettre à tous les acteurs de mieux se situer dans la durée nécessaire à leur épanouissement.
2. La loi du 22 juillet 2013
S’inscrivant dans la poursuite de cet important travail d’élaboration collective et concertée, le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche (n° 835) a été déposé à l’Assemblée nationale le 20 mars 2013 et présenté au nom du Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, par Mme Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 21 mars 2013.
Le texte a été examiné en première lecture par l’Assemblée nationale en séance publique du 22 au 28 mai 2013, sur le rapport (n° 1042) de M. Vincent Feltesse, au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, saisie au fond, et les avis de MM. Christophe Borgel (n° 969) et Olivier Véran (n° 983), au nom respectivement des commissions des affaires économiques et des affaires sociales. Le texte a été adopté par l’Assemblée nationale le 28 mai 2013 (texte adopté n° 142).
Le texte (n° 614 (2012-2013)) a ensuite été examiné en première lecture par le Sénat les 19, 20 et 21 juin 2013 sur le rapport (n° 659 (2012-2013)) de Mme Dominique Gillot, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, saisie au fond, et l’avis (n° 663 (2012-2013)) de Mme Valérie Létard, au nom de la commission des affaires économiques, et adopté avec modifications par le Sénat (texte adopté n° 170 (2012-2013)).
Les délégations aux droits des femmes des deux assemblées ont publié chacune un rapport d’information, de M. Sébastien Denaja à l’Assemblée nationale (n° 1007) et de Mme Françoise Laborde au Sénat (n° 655 (2012-2013)).
Une commission mixte paritaire réunie au Sénat le 26 juin 2013 a abouti à un texte commun, sur le rapport de M. Vincent Feltesse et de Mme Dominique Gillot (n° 1208 Assemblée nationale et n° 694 (2012-2013) au Sénat).
Le texte de la commission mixte paritaire a été adopté par le Sénat le 3 juillet 2013 et par l’Assemblée nationale le 9 juillet 2013.
La loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a été promulguée sous le n° 2013-660 le 22 juillet 2013 ; elle est parue au Journal officiel n° 169 du 23 juillet 2013.
La loi redéfinit les missions du service public de l’enseignement supérieur (chapitre Ier du titre Ier) et de la recherche et la politique de la recherche et du développement technologique (chapitre II du titre Ier) et réforme le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (titre II).
Le titre III précise les responsabilités des établissements d’enseignement supérieur en matière de formation et le titre IV les dispositions applicables aux stages en milieu professionnel.
Le titre V porte sur : les établissements d’enseignement supérieur publics (chapitre Ier) à travers la gouvernance des universités (section 1), les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur (section 2) et la composition des conseils des établissements publics (section 3) ; la coopération et les regroupements des établissements (chapitre II) ; les établissements d’enseignement supérieur privés (chapitre III).
Le titre VI concerne les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche et le titre VII est consacré à la recherche : son organisation générale (chapitre Ier) et l’exercice des activités de transfert (chapitre II).
Enfin, le titre VIII comprend des dispositions diverses (chapitre Ier) et les dispositions transitoires et finales (chapitre II) rendues nécessaires par les mesures précédentes.
Les dispositions contenues dans les 129 articles de la loi sont foisonnantes et diverses. Mais les quatre objectifs majeurs exposés par le Gouvernement dans la présentation du projet de loi visaient à offrir de meilleures chances de réussite à tous les étudiants, à donner un nouvel élan et une meilleure visibilité à la recherche, à renforcer la coopération entre tous les acteurs et enfin à amplifier la présence de la recherche française dans les programmes européens et le rayonnement international des universités, écoles et laboratoires en encourageant la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs. La loi devait être complétée par des mesures réglementaires, contractuelles ainsi que par des initiatives ministérielles et interministérielles.
Des thèmes sont communs aux deux grands volets du projet : les missions complémentaires fixées à l’enseignement supérieur et à la recherche à travers leurs stratégies nationales respectives, complétées par la réforme du système d’évaluation externe de l’enseignement supérieur et de la recherche. La place de la langue française dans l’enseignement supérieur et la recherche, à travers la possibilité de prévoir des exceptions au principe de l’enseignement en langue française, comme celle de l’enseignement numérique, bien qu’introduits comme mesures spécifiques à l’enseignement supérieur, concernent également le domaine de la recherche. Il en est de même du respect de la parité entre femmes et hommes.
Le volet « enseignement supérieur », de loin le plus volumineux, s’articule autour de l’objectif prioritaire consistant à permettre la réussite du plus grand nombre d’étudiants et d’une refonte de la gouvernance des universités et des regroupements d’établissements. L’objectif de la réussite étudiante s’appuie sur l’affirmation de la continuité entre l’enseignement du second degré et l’enseignement supérieur, la mise en place de dispositifs rénovés en matière d’alternance et de stages pour améliorer l’insertion professionnelle des étudiants et des doctorants, les rapprochements entre l’université et les filières sélectives, l’étude d’un dispositif particulier pour les étudiants en médecine et, enfin, une procédure d’accréditation se substituant à l’habilitation des établissements à délivrer des diplômes nationaux.
La réforme de la gouvernance des universités comprend la mise en place d’un conseil académique, la révision des règles pour les élections au conseil d’administration, une application précisée du principe de subsidiarité. Elle établit également de nouvelles modalités de coopération de site et de regroupement universitaires, par la fusion d’établissements, la participation à une communauté d’universités et établissements ou l’association à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Des mesures concernent plus directement les personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche, tant en matière de statut que de déroulement de carrière, et réforment le Conseil national de l’enseignement et de la recherche (CNESER).
Le volet « recherche » s’appuie sur deux dispositifs principaux : une réorganisation du cadre institutionnel, avec un rôle renforcé pour l’OPECST, et un renforcement de la valorisation et de la diffusion de la recherche.
La présentation des thèmes par article figure dans l’annexe n° 4 au présent rapport.
Les décrets d’application figurent dans l’annexe n° 2 au présent rapport.
a. Les enseignements non francophones
L’article 3 de la loi prévoyait la remise d’un rapport aux commissions permanentes du Parlement sur le bilan des enseignements non francophones dans l’enseignement supérieur en examinant, en particulier, les effets produits sur leur développement, afin d’apaiser les inquiétudes alors suscitées par l’article 2. Le rapport confié à une mission de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale (IGAENR) n° 2015-050 de juin 2015 répond à cet objectif.
Il convient en effet de rappeler que l’article 2 de la loi modifiant l’article L. 121-3 du code de l’éducation prévoyait des exceptions au principe de l’utilisation du français comme langue de l’enseignement, des examens et des concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement, liées à « des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 123‐7 ou dans le cadre d’un programme européen » ainsi que : « le développement de cursus et diplômes transfrontaliers et multilingues ».
La mission de l’inspection générale constate que ces nouvelles exceptions laissent, par leur étendue, une grande marge de manœuvre aux établissements qui veulent dispenser des enseignements non francophones. Elle souligne que toutes les personnes rencontrées ont exprimé la conviction que les enseignements non francophones sont un moyen au service de l’internationalisation nécessaire de l’enseignement supérieur français, le renforcement de la stature internationale des universités et des écoles requérant une attractivité plus grande reposant sur la qualité des enseignements dispensés et des recherches menées mais également sur un usage plus large de langues étrangères.
Elle rappelle que les étudiants français ont un intérêt objectif à rehausser leur niveau en anglais et dans d’autres langues dès l’enseignement scolaire et à poursuivre cet apprentissage dans l’enseignement supérieur en passant de la langue générale à la langue de spécialité.
L’objectif pour les universités, malgré les contraintes que font peser sur elles à la fois le nombre élevé d’étudiants et des ressources limitées, est de réduire l’écart qui subsiste encore avec les écoles de commerce et d’ingénieurs, du point de vue de la maîtrise de l’anglais et d’autres langues par leurs étudiants et donc, à terme, de développer suffisamment l’aisance linguistique des étudiants français pour favoriser leur insertion professionnelle dans un processus continu depuis l’enseignement secondaire.
La mission faisait en conclusion les recommandations suivantes :
1 – Mettre en œuvre une application souple de l’article 2 de la loi de juillet 2013 en considérant que les « formations d’enseignement supérieur visées » s’entendent comme les mentions de licence et de master et que la « proportion d’enseignements en français » doit être fixée au cas par cas par les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 2 – Préciser le contenu des dossiers de demande d’accréditation pour la vague A en demandant de recenser les mentions de licence et de master relevant d’une des exceptions prévues par l’article 2 de la loi et d’indiquer, lorsque le système d’information le permet, le nombre d’unités d’enseignement dispensées en français dans chaque mention de licence ou de master et le nombre total d’unités d’enseignement ; 3 – Compléter les indicateurs du contrat d’établissement par des indicateurs relatifs à l’internationalisation de l’établissement et notamment : le nombre d’enseignants étrangers permanents ou temporaires, exprimé en mois de présence ; le nombre d’étudiants inscrits dans les cursus faisant partie des exceptions mentionnées à l’article 2 de la loi du 22 juillet 2013 et leur pourcentage par rapport au total des étudiants inscrits ; 4 – Développer et rendre obligatoires conformément à la loi des enseignements en français langue étrangère à destination des étudiants non francophones, en fonction des exigences posées par le diplôme recherché : contrôler le niveau initial de connaissance du français de l’étudiant étranger en fonction du classement européen de C1 à A2, préciser l’exigence de niveau final de l’étudiant en fonction de ce même classement et indiquer si ce niveau conditionne l’obtention du diplôme. 5 – Suggérer à toutes les universités d’offrir des enseignements non francophones dès le premier cycle afin de maintenir une continuité d’apprentissage linguistique du lycée au doctorat ; 6 – Mettre en place dans tous les établissements ou regroupements d’établissements d’enseignement supérieur un centre d’évaluation ou d’accompagnement linguistique et didactique à l’intention des personnels administratifs et des enseignants-chercheurs ; 7 – Promouvoir la diversité linguistique et culturelle européenne en proposant des enseignements en des langues autres que le français et l’anglais et en privilégiant des cursus à doubles diplômes. |
b. La sélection et la formation des médecins
Le rapport prévu par l’article 41 de la loi, formulant des propositions en vue d’améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins, n’a pas été publié (3).
Des projets expérimentaux ont été mis en place par les universités à la rentrée 2015 : dix universités proposent de nouveaux dispositifs pour intégrer les cursus de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Elles testent différents dispositifs en proposant une voie alternative pour intégrer une 2e année de licence (L2) dans l’une des quatre filières médicales : médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique.
M. Jean-Loup Salzmann (4), constatant l’échec insupportable en première année de médecine gâchant des parcours scolaires jusque-là réussis, souhaitait vivement que les expériences engagées soient menées jusqu’au bout.
c. Le recrutement, le déroulement de carrière et la formation des enseignants-chercheurs
L’article 74 de la loi prévoyait la remise au Parlement d’un rapport relatif au recrutement, au déroulement de carrière et à la formation des enseignants-chercheurs. Confié à l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale (IGAENR), il a été publié sous le n° 2015-073 en décembre 2015. Sa conclusion fait apparaître plusieurs constats.
En moins de dix années, le recrutement, le déroulement de carrière et la formation des enseignants-chercheurs ont connu des évolutions importantes qui demandent à être poursuivies.
La loi LRU et la loi ESR ainsi que les modifications du décret statutaire du 6 juin 1984 ont fait évoluer notablement les dispositifs relatifs au recrutement (modification de la procédure suivie par les établissements en la matière), au déroulement de la carrière (assouplissement des obligations de service, création de nouvelles voies de promotion, mesures favorisant la mobilité) et à la formation (réorganisation de la formation initiale, reconnaissance du droit à la formation continue) des enseignants-chercheurs.
Ces modifications ont été portées par les évolutions de l’environnement universitaire national et international, marquées par la mondialisation de l’enseignement supérieur et, davantage encore, de la recherche, et le renforcement de l’autonomie des établissements, qui amène ceux-ci à intervenir davantage dans la gestion des enseignants-chercheurs.
Par ailleurs, l’arrivée de nouveaux publics et de nouvelles méthodes d’enseignement notamment fondées sur l’utilisation du numérique, le développement de nouvelles modalités de financement de la recherche et les besoins accrus de gouvernance, ont fait évoluer les missions des enseignants-chercheurs.
Pour autant, les réformes ne leur apparaissant pas complètement abouties, les auteurs formulent 20 recommandations, annexées au présent rapport (5).
d. Prise en compte du doctorat pour le recrutement des fonctionnaires
L’article 79 prévoyait un rapport sur la prise en compte du doctorat pour les recrutements des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique.
Le Gouvernement a rendu public, le 8 octobre 2014, l’avis du Conseil d’État relatif à la reconnaissance de l’expérience professionnelle acquise au cours de leur formation par les titulaires d’un doctorat.
Selon cet avis, trois voies sont ouvertes au pouvoir règlementaire pour lui permettre de satisfaire l’objectif d’ouverture poursuivi par le législateur, compte tenu des besoins du service et des exigences de gestion des corps et cadres d’emplois concernés :
– la modification des concours existants en vue d’adapter les conditions de candidature ou la nature des épreuves ;
– l’intervention directe dans les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois concernés, pour en compléter les dispositions relatives au recrutement et créer des concours externes spéciaux ouverts aux titulaires d’un doctorat, venant s’ajouter aux concours actuels ;
– l’intervention sur les concours d’entrée dans les écoles qui conduisent aux corps ou cadres d’emplois de catégorie A, pourvu que l’expérience professionnelle acquise par les docteurs soit pertinente par rapport aux besoins de ceux-ci ; dans ce cas aussi, la solution peut consister soit à instaurer un concours d’entrée spécial pour les titulaires d’un doctorat, soit à apporter aux actuels concours externes des aménagements répondant à l’objectif poursuivi par le législateur à l’article L. 412-1 du code de la recherche.
En revanche, le Conseil d’État a estimé que les adaptations voulues par le législateur ne pouvaient concerner les procédures de recrutement dans les corps ou cadres d’emplois par la voie de la promotion interne, sauf à porter atteinte au principe d’égalité. La voie du tour extérieur doit également être écartée, les critères de recrutement par cette voie déterminés par la loi étant d’une autre nature que la détention d’un diplôme.
e. Le statut des ATER
L’article 83 de la loi prévoyait la remise d’un rapport sur l’évolution du statut d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) afin d’étudier la possibilité de créer deux types d’attaché : l’un destiné aux doctorants, l’autre aux docteurs en attente de poste.
L’analyse qui a été conduite par la mission de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) en 2014 montre que le statut d’ATER, qui a été créé en 1988, ne répond plus aujourd’hui à ses objectifs : les obligations de service d’enseignement imposées aux ATER doctorants sont souvent inconciliables avec l’achèvement de la thèse ; les fonctions d’ATER ne débouchent plus que marginalement sur un recrutement de maître de conférences.
Elle précise que le statut d’ATER recouvre en effet deux catégories bien différentes : celle des doctorants en fin de thèse, qui est largement majoritaire, et celle des docteurs qui aspirent à devenir enseignant-chercheur. S’y ajoute également celle des enseignants du second degré, doctorants ou docteurs, presque aussi nombreuse que celle des docteurs. À cette simplicité apparente correspond cependant une très grande diversité de situations en fonction des disciplines et des établissements.
Les investigations conduites par l’IGAENR montrent que, quelle que soit la catégorie concernée, le statut d’ATER ne répond plus aujourd’hui que très imparfaitement aux attentes de ceux qui en bénéficient comme aux besoins des établissements et qu’il se trouve désormais en décalage par rapport, d’une part, au niveau de rémunération et aux modalités d’exercice qu’offrent le contrat doctoral et les contrats de post-doctorant et, d’autre part, aux possibilités d’insertion professionnelle ouvertes aux docteurs.
Elle relève qu’une expérience d’enseignement étant prise en compte par les sections du conseil national des universités au moment de la qualification aux fonctions de maître de conférences, son acquisition devrait pouvoir intervenir pendant la préparation de la thèse ou juste après et s’inscrire dans le processus de formation et de suivi du jeune chercheur, doctorant ou docteur, mis en œuvre par les écoles doctorales.
Enfin, la mission souligne que le dispositif de soutien aux jeunes chercheurs devrait être l’une des composantes de la politique des établissements ou des communautés d’établissements en voie de constitution, qui, en fonction de leurs objectifs et de leurs possibilités, utiliseraient les types de contrats existants au mieux de leurs besoins et de l’intérêt des bénéficiaires.
f. Les conditions d’alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d’art sur celui des écoles nationales
L’article 85 de la loi prévoyait la remise d’un rapport sur les conditions d’alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d’art sur celui des écoles nationales d’art et comprenant une analyse de leurs activités de recherche ; il a été remis aux commissions compétentes des assemblées en avril 2015.
Une question écrite n° 22365 de Mme Dominique Gillot, sénatrice du Val-d’Oise (6) relative aux suites données à ce rapport, en particulier l’échéance et les modalités selon lesquelles le statut de professeur des écoles d’art sera modifié conformément à ses recommandations est en attente de réponse du ministère de la fonction publique.
g. Le bilan du fonctionnement du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)
L’article 91 de la loi demandait que soit transmis au Parlement le bilan du fonctionnement du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) qui succédait à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), créée par la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
Le Haut conseil a adopté un rapport (7) d’autoévaluation le 7 mars 2016.
Il y précise que cette démarche d’autoévaluation est un acte majeur pour l’institution et se situe à un tournant de son évolution et de son organisation. En effet, après deux ans de transition, le HCERES dispose depuis octobre 2015 d’un nouveau conseil et d’un nouveau président. Dès lors, les résultats de l’évaluation interne et externe devraient, selon lui, constituer un socle fondateur pour le développement de ses orientations stratégiques 2016-2020.
Cette démarche constitue un enjeu essentiel pour la continuité de la reconnaissance européenne et internationale du Haut conseil. Comme l’AERES, le HCERES est régulièrement sollicité par des institutions et agences étrangères pour faire part de l’expérience acquise ou pour conduire des évaluations qui renforcent leur légitimité.
Le Haut conseil précise avoir souhaité, à travers le rapport d’autoévaluation, montrer les évolutions intervenues depuis 2010 et analyser sa meilleure prise en compte des standards européens en la matière, les ESG (European Standards and Guidelines), tout en décrivant préalablement son contexte d’intervention, son fonctionnement et son système de qualité, interne et externe.
L’analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunites, Threats) réalisée dans le cadre de l’autoévaluation, c’est-à-dire des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques, conformément aux règles de l’évaluation classique du Haut conseil appliquées à lui-même, figure en annexe (8) au présent rapport.
Lors de son audition, M. Michel Cosnard (9) rappelait que le plan stratégique du Haut conseil s’inscrivait pleinement en réponse à la loi et aux débats qui l’avaient précédée. Les axes qu’il définit visent à renforcer l’engagement du Haut conseil au service des évalués ; à promouvoir une évaluation éthique, de qualité et à consolider l’évaluation par les pairs ; à garantir l’indépendance du Haut conseil et son positionnement parmi les autres acteurs de l’évaluation ; à conduire une évaluation intégrée au niveau des politiques de site ; à mettre en œuvre la validation des procédures d’évaluation ; à simplifier les processus d’évaluation ; à accroître la visibilité européenne et internationale ; à bénéficier pleinement des compétences de l’Observatoire des sciences et techniques (OST) ; et à mettre en place une organisation interne adaptée à l’évaluation intégrée.
Parallèlement le Haut conseil travaille sur une exigence majeure de la loi, la validation des procédures, les entités évaluées pouvant faire appel à une autre instance que le HCERES pour assurer leur évaluation externe, à charge, pour ce dernier, de valider les procédures de cette autre instance.
Le plan stratégique s’accompagne d’un volet simplification visant à rendre du temps à la communauté scientifique et pédagogique pour exercer son cœur de métier, répondant ainsi à une demande ancienne.
h. Les inégalités sociales repérées
L’article 105 de la loi dispose qu’un rapport annuel est remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées en matière de vie étudiante.
Cette mention complète l’article L. 811-3 du code de l’éducation qui prévoit que les associations d’étudiants représentatives qu’il définit sont associées au fonctionnement d’un observatoire de la vie étudiante (OVE) qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants et des stagiaires.
L’observatoire vient de publier (10) le 30 juin 2016, « Le rapport à l’avenir des étudiants français », note fondée sur la dernière enquête triennale sur les conditions de vie des étudiants (2013) qui permet d’étudier différents aspects de la vie étudiante et des conditions d’études. Parallèlement, le rapport « Les vies étudiantes / Tendances et inégalités », paru à La Documentation française en juin 2016, est la réponse la plus récemment développée à cette préoccupation.
M. Jean-François Balaudé soulignait lors de son audition (11) que la responsabilité sociale des universités est un élément important, défendu lors Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche et repris en pratique dans la loi. Elle regroupe toute une série d’actions qui créent des externalités positives autour des universités, par la diffusion du savoir, l’implication dans des associations favorisant l’égalité, dans les quartiers environnants, les maisons d’arrêt, l’accompagnement d’associations étudiantes sur le terrain, le soutien scolaire, la protection judiciaire de la jeunesse par l’insertion de jeunes délinquants sur le campus même où ils peuvent rencontrer étudiants et enseignants. De plus, ces actions se mènent parallèlement aux travaux de recherche menés sur et à travers ces sujets. Il rappelait que cet aspect n’est pas marginal, mais un trait de différenciation pour la ComUE Paris-Lumières.
D. LES STRATÉGIES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
1. Des stratégies s’inscrivant dans une concertation longue
a. La Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (StraNES)
Instaurée par l’article 4 de la loi, la Stratégie nationale de l’enseignement supérieur prévoyait que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche élabore, au niveau national, une stratégie dédiée à l’enseignement supérieur devant constituer avec la stratégie nationale de recherche, élaborée parallèlement, un Livre blanc.
Les auditions d’experts et de personnalités représentant les acteurs concernés par les enjeux de l’enseignement supérieur français ont abouti à un rapport d’étape en juillet 2014, puis au rapport définitif. Le comité d’expertise a été installé le 12 février 2014, présidé par Mme Sophie Béjean avec M. Bertrand Monthubert comme rapporteur général. À l’issue d’une large consultation, le rapport final a été remis à la rentrée 2015 (12).
Les 40 propositions du rapport s’articulent autour de 5 axes stratégiques :
1. Construire une société apprenante et soutenir notre économie, afin de favoriser l’innovation, la citoyenneté et la créativité et sécuriser les parcours professionnels grâce au développement des qualifications ;
2. Développer la dimension européenne et l’internationalisation de notre enseignement supérieur afin de promouvoir un modèle humaniste d’accueil et d’attractivité des talents et former nos étudiants pour un monde multiculturel et globalisé ;
3. Favoriser une réelle accession sociale et agir pour l’inclusion afin de favoriser la mobilité sociale et contribuer aux besoins de la société apprenante en donnant à chacun la chance ou les chances de réussir ;
4. Inventer l’éducation supérieure du XXIe siècle en soutenant la transformation pédagogique pour mieux faire réussir les étudiants et les préparer à la société apprenante et au numérique ;
5. Répondre aux aspirations de la jeunesse en promouvant l’autonomie des étudiants et la mobilité sociale, tout en faisant de la vie de campus un facteur de la réussite ;
et 3 leviers :
1. Dessiner un nouveau paysage pour l’enseignement supérieur en assurant une coordination renforcée et en encourageant la coopération pour dessiner un paysage équilibré de l’enseignement supérieur ;
2. Écouter et soutenir les femmes et les hommes de l’enseignement supérieur en valorisant les nouvelles formes et les nouveaux métiers de l’enseignement supérieur, en reconnaissant l’investissement dans la recherche et en construisant des équipes pédagogiques pluri-métiers ;
3. Investir pour la société apprenante et adapter les financements aux besoins en construisant un budget de transition pour mettre en œuvre les réformes nécessaires, en adaptant le modèle économique de l’enseignement supérieur et en s’assurant de la cohérence des financements avec les objectifs fixés.
Les 40 propositions déclinent précisément ce plan d’action.
Lors de son audition, Mme Sophie Béjean (13), présidente du comité mais également mandatée par lui pour assurer le suivi de la stratégie, rappelait que s’il existait une stratégie pour la recherche et des politiques de l’enseignement supérieur, l’élaboration d’une stratégie spécifique pour l’enseignement supérieur est une décision nouvelle. Cela suppose, d’une part, d’élaborer une vision prospective de la place que l’on veut donner à l’enseignement supérieur en France, et, dans ce cadre, d’élaborer des orientations stratégiques et un plan d’action pour les réaliser, mais, d’autre part, d’avoir également une vision globale, car interministérielle, de l’enseignement supérieur en ne se limitant pas, par exemple, aux seules universités. Dans les faits, elle a constaté une appropriation par tous les acteurs de la concertation préalable à l’élaboration de la stratégie, ouverte et libre : les ministères et les opérateurs, les organisations syndicales et étudiantes, les partenaires économiques. Les propositions ont été avancées de façon constructive sur la base d’un diagnostic partagé, fondé sur un dialogue social salué par tous et appuyé par les chercheurs et les scientifiques.
Plus précisément, elle a souligné, en cohérence avec les orientations de la loi, la prise en compte du « –3 / +3 », l’attention portée aux transitions sensibles
– terminale/post-bac ; collège/lycée – afin de transformer le droit formel d’accès à l’enseignement supérieur que constitue le baccalauréat, en droit réel de réussir, face à la démocratisation de cet enseignement.
Mme Sophie Béjean a plus particulièrement relevé la proposition n° 8 qui vise à renforcer la mobilité sortante des étudiants, en particulier ceux d’origine modeste. Elle constatait que si les collectivités territoriales ont des dispositifs adaptés, il conviendrait de mieux les cibler sur des milieux donnés. Les jeunes ont souligné leurs insuffisances en connaissance des langues étrangères ; aussi un complément en langue étrangère de 2 ou 3 mois pourrait compléter le dispositif Erasmus, par exemple, et préparer la mobilité.
Elle relevait l’importance de la proposition n° 31 visant à anticiper et à accompagner les métiers de l’enseignement supérieur, face aux nouveaux programmes et aux nouvelles approches pédagogiques liées au numérique.
En conclusion, elle insistait sur la nécessité d’assurer un suivi vigilant de la stratégie, en mettant en place pour l’évaluer des indicateurs établis ou à déterminer. Il conviendra en particulier d’être attentif à l’inégalité en matière d’accès aux diplômes. L’interministérialité est également à renforcer, car malgré la cotutelle prévue par la loi ESR sur les établissements d’enseignement supérieur, les décisions prises par certains ministères restent encore trop souvent non anticipées ou coordonnées. Enfin, la cohérence des financements budgétaires et extrabudgétaires pour accompagner les orientations définies est essentielle.
b. La stratégie nationale de recherche (S.N.R.)
La stratégie nationale de recherche définie à l’article 15, qui modifie l’article L. 111-6 du code de la recherche, a la double ambition de maintenir la France parmi les premiers acteurs de la recherche mondiale et de permettre à la recherche française de répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux du XXIe siècle.
Elle a fait l’objet d’un rapport (14) publié au mois de mars 2015. S’inscrivant dans une démarche globale associant la communauté scientifique, elle devait identifier les verrous et les ruptures scientifiques et créer les conditions favorables au développement de nouveaux concepts, dans l’objectif d’y répondre en promouvant « une approche inter et pluridisciplinaire et en tenant compte des spécificités de la recherche fondamentale dont les résultats et les applications ne sont pas programmables. »
Cette nouvelle stratégie nationale de recherche doit associer « toujours plus étroitement recherche fondamentale, recherche technologique et recherche finalisée », afin d’assurer « le renouvellement du socle de connaissances permettant aux politiques publiques de redressement économique et industriel de la France (…) de jouer pleinement leur rôle. » En effet, il est constaté que « les innovations de rupture, les plus “différenciantes”, naissent en grande partie de la recherche. Le ressourcement en amont par la recherche, essentiel à la réussite de ces politiques publiques, nécessite donc que l’on fluidifie davantage encore le passage de l’invention de laboratoire à l’innovation appropriée par les entreprises. »
Sur ces bases, la stratégie nationale de recherche vise à s’appuyer « sur une analyse détaillée des atouts de notre recherche et de son impact potentiel en matière de développement économique et social pour notre pays afin de définir un nombre limité de programmes d’actions prioritaires et mobilisateurs, destinés à accroître les connaissances et stimuler l’écosystème d’innovation. »
Parallèlement, les enjeux de la stratégie couvrent aussi « le renforcement de la capacité d’expertise des chercheurs en appui aux politiques publiques, aux associations et fondations, le développement de l’innovation et du transfert de savoirs et de technologies (…) tout comme l’amélioration de la position et de la visibilité de la recherche française au sein des programmes de coopération. »
Dix principaux défis ont été retenus, auxquels doit répondre la stratégie nationale de recherche :
– la gestion sobre des ressources et l’adaptation au changement climatique ;
– l’énergie propre, sûre et efficace ;
– le renouveau industriel ;
– la santé et le bien-être ;
– la sécurité alimentaire et le défi démographique ;
– la mobilité et les systèmes urbains durables ;
– la société de l’information et de la communication ;
– les sociétés innovantes, intégratives et adaptatives ;
– une ambition spatiale pour l’Europe ;
– la liberté et la sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses résidents.
La stratégie nationale de recherche succède à la stratégie nationale de recherche et d’innovation établie en juillet 2009 (15), qui était la première du genre et dont les trois axes prioritaires étaient la santé, le bien‐être, l’alimentation et les biotechnologies ; l’urgence environnementale et les écotechnologies ; l’information, la communication et les nanotechnologies.
2. Des stratégies en quête d’une programmation
Le Livre blanc défini à l’article 17 de la loi comme réunissant les stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de recherche était le substitut d’une programmation qui ne figurait pas dans la loi. Elle ne déterminait en effet qu’une orientation, comme le remarquait Mme Geneviève Fioraso (16) lors de son audition. M. Thierry Mandon (17) faisait d’ailleurs remarquer que la croissance démographique non anticipée des effectifs étudiants depuis 2014 aurait rendu inadaptée une programmation dès 2013.
Le 13 juin 2016, Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et M. Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, ont installé le comité du Livre blanc de l’enseignement supérieur et de la recherche. Présidé par M. Bertrand Monthubert, il devra présenter un bilan des premières mesures de mise en œuvre de la S.N.R. et de la StraNES, identifier les enjeux à venir, prioriser les actions au sein de ces stratégies à 10 ans et établir une programmation budgétaire sur le court et le moyen terme, pour l’application de ces deux stratégies.
Le Livre blanc devrait être présenté au mois de novembre prochain.
II. LES ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU REGARD DE DEUX THÈMES MAJEURS DE LA LOI : LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE ET LA GOUVERNANCE
A. L’ENJEU DE LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE
Si les dernières données statistiques disponibles montrent que le taux de réussite des étudiants en France est supérieur à la moyenne observée dans les pays de l’OCDE, (20 % d’échec contre 30 %), la durée d’un cycle d’études ne permet pas, à ce stade, de disposer du recul suffisant pour étudier de façon incontestable l’impact d’une loi promulguée en juillet 2013 et de ses textes d’application. D’autant que, comme le relevait M. Thierry Mandon (18), la démographie étudiante a connu un accroissement très important, lié non seulement à la démographie lycéenne mais surtout à la conviction d’une partie de la jeunesse que les diplômes universitaires faciliteront leur accès au marché du travail dans une période de crise. Les auditions ont cependant permis de disposer d’éléments très vivants sur les orientations que la loi a définies, accompagnées ou renforcées et sur ses premiers résultats dans un domaine qui était l’un de ses objectifs majeurs.
1. L’articulation entre enseignements secondaire et supérieur
Les politiques menées en matière d’éducation depuis plus de 25 ans visent toutes à renforcer le niveau de formation, initiale mais aussi continue, en se conformant aux décisions prises au niveau européen mais aussi aux recommandations des grandes organisations internationales comme l’OCDE ou l’Unesco. Il convient à cet égard de remarquer que 80 % des étudiants sortent diplômés en France, ce qui est au-dessus de la moyenne observée dans l’OCDE.
Outre la définition de la stratégie de l’enseignement supérieur, la loi a posé, dans son article 6, l’objectif de la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants, en prévoyant l’élaboration de divers outils statistiques permettant de la mesurer (article 21 et 30).
Comme l’a rappelé avec force M. Vincent Berger (19), cette réussite repose avant tout sur l’orientation. La loi est intervenue sur les questions d’orientation dans deux domaines de formations supérieures particulièrement tendus : les études médicales et de santé (article 41), les études techniques et en classes préparatoires (article 33).
Elle a, parallèlement, induit une série de mesures complétant ou systématisant des dispositifs antérieurs.
La particularité d’un baccalauréat qui, à la fois, sanctionne la fin des études secondaires et ouvre l’accès à l’enseignement supérieur, se reflète tant dans les trois voies d’études au lycée qu’il sanctionne que dans les perspectives d’enseignement supérieur qu’il laisse envisager.
Le baccalauréat général et le baccalauréat technologique ont été chacun conçus comme ouvrant la voie à des études supérieures plus ou moins longues et professionnalisantes, mais le baccalauréat professionnel, dont on vient de célébrer les 30 ans, avait été initialement conçu comme sanctionnant la fin d’un cycle d’études secondaires qui devait ouvrir directement à l’emploi.
Or, les dernières statistiques disponibles (20) montrent que la croissance du taux de bacheliers dans une génération repose essentiellement sur celle des bacheliers professionnels – même si une reprise de la croissance du nombre de bacheliers généraux s’observe depuis 3 ans –, alors que, parallèlement, les entreprises recrutent de moins en moins à ce niveau d’études et préfèrent les diplômes de l’enseignement supérieur (sanctionnant, selon les cas, deux ou trois ans d’études, spécificité française diversement appréciée). Cette croissance, depuis 2010, accompagne l’arrivée des bacheliers professionnels ayant suivi un cursus réduit de quatre à trois ans.
En effet, les statistiques définitives pour la session 2015 du baccalauréat montrent que, si l’effectif de candidats a baissé de près de 50 000 dans la voie technologique depuis 2004 – dont 4 500 depuis 2014 –, la voie professionnelle a augmenté de 96 000 candidats sur la même période et la voie générale de 29 000, dont 10 000 en 2015. Dans le même temps, la proportion de bacheliers dans une génération a gagné plus de 16 points et atteint 77,2 % en 2015. Les résultats provisoires pour 2016 semblent montrer la poursuite de ces inflexions.
Si 60 % des bacheliers professionnels entraient directement sur le marché du travail en 2015, la question de leur orientation et, plus généralement, celle de l’ensemble des lycéens se pose avec une acuité accrue.
M. Thierry Mandon (21) faisait remarquer qu’en France, le choix de l’orientation intervient très jeune, à 16 ou 17 ans. Il lui semble donc nécessaire d’imaginer des moyens de différer le choix définitif par des expérimentations de tronc commun ou par une année de pré-césure dans le parcours individuel, qui pourrait être prise dès après le baccalauréat, par exemple. Les études sont impuissantes à préciser le moment et les circonstances où le choix précis de son orientation se s’opère chez un jeune.
La meilleure compréhension du cadre d’accueil suppose de s’emparer de la structuration de l’enseignement entre les trois années du second cycle du secondaire et les trois premières années de l’enseignement supérieur. Cette approche « bac –3 / bac +3 » (22) qui se développe dans l’enseignement secondaire mais dont l’enseignement supérieur n’a peut-être pas tiré tous les avantages, relevait M. Jean-Richard Cytermann (23).
Pour M. Philippe Tournier (24), l’approche « bac –3 / bac +3 » est aux confins de tout le monde mais au centre de personne, aux confins de l’enseignement scolaire et de la classe au nom significatif de « terminale » et de la première année d’enseignement supérieur, L1, mais pas au centre des réflexions des universités. Il rappelait également que les réorientations en cours d’études et les passerelles ont connu au départ un développement bourgeonnant, depuis plus de 15 ans, accéléré après 2007 avec le décret permettant la délivrance des crédits ECTS (European Credit Transfer System) établissant des équivalences entre les universités et les classes préparatoires.
Admission post-bac (APB)
Si M. Pierre-André Jouvet (25) remarquait que le baccalauréat remplit pourtant encore son office puisque les meilleurs bacheliers se dirigent vers les classes préparatoires aux grandes écoles, les universités développent parallèlement une stratégie de doubles diplômes pour attirer elles-aussi ces bons étudiants. Il rappelait également que le reste de la population étudiante doit être accompagné le mieux possible. Ayant étudié plusieurs fois l’algorithme, publié ce printemps, du dispositif d’admission post-bac (APB), il a constaté que la présélection ne se fait pas sur la base des vœux individuels mais sur l’ensemble, créant ainsi un critère « rawlsien », tendant à avantager le plus défavorisé, ce qui conduit à un retour des stratégies complexes qui ont naguère prévalu et que l’on souhaitait précisément éviter, comme le soulignait M. Jean Bastianelli (26).
À cet égard, M. Philippe Tournier rappelait qu’APB était à l’origine un outil partenarial, prévoyant, pour les classes préparatoires aux grandes écoles, une adéquation entre les classes et les choix des élèves. Or il remarquait que le produit actuel s’était dénaturé, sa logique interne consensuelle ayant été abandonnée au profit de choix politiques rendant périmés les prospectus distribués chaque année aux lycéens avant même leur utilisation. Comme l’ont relevé plusieurs représentants des enseignants des classes préparatoires, s’ajoute à cette procédure le paradoxe d’une affectation connue dans l’enseignement supérieur avant même d’avoir passé l’examen qui la conditionne, lui-même pouvant être passablement terni par une affectation qui ne serait pas celle que souhaitait le futur étudiant.
Il leur apparaît dès lors nécessaire de renforcer l’édifice inabouti de l’orientation parce que, selon eux, non piloté.
M. Thierry Mandon (27) précisait qu’il fallait améliorer l’outil APB, qui doit davantage informer sur les taux de réussite potentiels des étudiants selon leur parcours et sur les débouchés professionnels des filières choisies. Les professeurs principaux ont connaissance du choix du lycéen, l’orientation en première et terminale devrait être élaborée plus collectivement et non renvoyée à la solitude du lycéen et de sa famille. Cet équilibre entre famille et enseignants en la matière est à optimiser.
C’est à cette fin que Mme Sophie Béjean a souligné l’importance de la proposition n° 13 de la Stratégie nationale de l’enseignement supérieur, visant à réformer l’orientation lycée-supérieur. Il y est en effet demandé :
– de repenser l’orientation en préparant dès le lycée les projets de poursuite d’études : modules d’immersion dans les établissements d’enseignement supérieur, tutorat des lycéens par les étudiants, etc.
– d’expérimenter une réforme de l’accès au supérieur avec conseil personnalisé, alerte en cas de risque d’échec et proposition alternative pour garantir la réussite, la sélection n’étant pas une solution ; adapter APB à ces nouvelles dispositions ;
– d’expérimenter et évaluer un conseil d’orientation post-secondaire en donnant aux recteurs la responsabilité de garantir une place dans le supérieur, en proposant si nécessaire le passage par une passerelle ou un parcours adapté, et de vérifier les indicateurs d’accès social ;
– et, enfin, de créer un guide virtuel et interactif d’information et d’aide à l’orientation pour les étudiants et futurs étudiants, présentant toutes les formations supérieures et leurs débouchés, dans le cadre d’une démarche « open data » (données ouvertes) et avec le concours de l’Onisep.
À cet égard, Mme Béjean soulignait l’intérêt de l’expérimentation de conseils d’orientation post-baccalauréat mise en place dans cinq académies
– Dijon, Amiens, Nancy Toulouse et Nantes – qui pourrait se généraliser si les résultats en sont fructueux. Cette pratique compléterait le dispositif APB, qui n’est, selon elle, qu’un simple système de gestion des flux, une expression des choix et des vœux, par un dispositif réunissant tous les acteurs des formations post-baccalauréats, sélectives ou pas, pour traiter des situations particulières que ne prend pas en compte APB. On peut penser, par exemple aux jeunes bacheliers professionnels n’ayant pas obtenu de places en STS, afin de leur proposer une formation où ils puissent réussir, ou bien aux jeunes orientés vers les classes préparatoires alors qu’ils ont l’ambition de faire de la recherche dans des secteurs scientifiques, sans doute mieux portés à l’université, ou encore le choix des études de médecine.
M. Vincent Berger (28) relevait ainsi qu’il faudrait continuer d’expliquer aux élèves de lycées que certaines filières universitaires sont très sélectives, le L1 santé étant ainsi une année de bachotage avec 95 % d’échec. Il soulignait qu’un domaine où tout le monde échoue et redouble laisse des traces psychologiques durables et est doublement coûteux. M. Fabrice Melleray (29) s’étonnait à cet égard que la loi se contente de traiter de la sélection, qui relève de son véritable domaine, et sujet sensible s’il en est, dans le seul domaine de la médecine.
Plus largement, M. Jean-Loup Salzmann (30) proposait une réforme du baccalauréat mettant fin à cet examen couperet. Il pourrait être remplacé par un contrôle continu en première et terminale permettant de définir, sur deux ans, les compétences des lycéens et leurs projets professionnels en s’appuyant sur un contrat pédagogique qui leur assure la place qui leur convient en STS, en IUT, en classe préparatoire ou à l’université. Cette orientation prescriptive, élaborée dans un contexte non malthusien, permettrait de retrouver une adéquation entre les choix et les capacités de chacun et éviterait que se multiplient les contournements des licences par les diplômes de l’enseignement supérieur technique ou professionnel, par exemple.
Relevée par plusieurs auditionnés, l’origine géographique des lycéens joue également un rôle important dans les choix opérés. France Stratégie, dans une note d’analyse (31) de novembre 2015 portant sur la géographie de l’ascension sociale, constatait que « les chances d’ascension sociale des individus d’origine populaire (soit les enfants d’ouvriers et d’employés) varient du simple au double selon leur département de naissance1. L’ascenseur social fonctionne bien dans certaines régions – Île-de-France, Bretagne, Midi-Pyrénées – et mal dans d’autres
– Poitou-Charentes, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Pour les individus d’origine populaire, la mobilité ascendante apparaît faiblement liée au dynamisme économique des territoires. Elle est en revanche fortement liée à l’éducation – en particulier à l’obtention d’un diplôme du supérieur.
« La massification de l’enseignement secondaire puis supérieur a certes favorisé globalement la mobilité sociale ascendante qui a augmenté au cours des dernières décennies, mais sans faire disparaître les “trous noirs” de l’éducation et de la promotion sociale. L’analyse économétrique tend à montrer qu’il ne s’agit pas d’un problème de rendement de l’éducation mais plutôt d’accès à l’éducation. Or les inégalités territoriales d’accès au supérieur sont restées inchangées jusqu’à aujourd’hui.
« Augmenter les chances de mobilité ascendante dans les territoires défavorisés suppose donc une démocratisation réelle de l’accès à l’enseignement supérieur là où celui-ci est le plus difficile. Au-delà des politiques visant une meilleure égalité des chances face à l’éducation en amont de l’université, cela peut passer par une aide à la mobilité étudiante, une offre universitaire élargie, le décloisonnement des académies ou une coopération renforcée entre les académies d’Île-de-France et celles des régions environnantes. Une telle politique implique de développer les outils de suivi longitudinal des élèves selon l’origine sociale au niveau national. »
2. Réussir dans l’enseignement supérieur technologique et professionnel
L’article 33 de la loi du 22 juillet 2013 modifie l’article L. 612-3 du code de l’éducation qui ouvre le premier cycle de l’enseignement supérieur à tous les titulaires du baccalauréat, en y introduisant une disposition qui, tout en tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription, charge le recteur d’académie, « pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie » de mettre en place « respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. » Ces pourcentages doivent être fixés « en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs. » En effet, alors que ces formations professionnalisantes avaient été conçues pour les bacheliers titulaires des baccalauréats leur correspondant, les bacheliers généraux sont devenus majoritaires dans les IUT et les bacheliers technologiques dans les STS.
M. Thierry Mandon soulignait cependant que l’attrait pour les brevets de technicien supérieur (BTS) et les diplômes d’enseignement technologique (DUT) ne tenait pas seulement à leur caractère professionnalisant mais aussi à l’attirance que des formations en alternance ont pour de nombreux jeunes étudiants. Une réorientation des bacheliers généraux vers les filières qui leur sont en principe destinées devra tenir compte de ce facteur.
La mise en place des quotas et le taux retenu ont fait l’objet d’un certain nombre de réflexions lors des auditions, M. Fabrice Melleray (32) faisant remarquer qu’il restait pour le moins paradoxal de légiférer pour prévoir que les recteurs réservent des places en formation courte au public auquel ces formations sont précisément destinées.
Mme Geneviève Fioraso a pour sa part rappelé (33) qu’il lui semblait nécessaire de conserver dans ce domaine une approche pragmatique et réaliste, conforme à l’esprit initial de cette mesure, un quota national devant pouvoir se décliner de façon flexible suivant les filières et les territoires. Cette approche est également celle de M. Jean-François Balaudé (34) qui remarquait qu’il convenait de prendre garde, toutefois, à ne pas chercher à atteindre des objectifs coûte que coûte : passer brutalement à 40 % serait excessif. Il lui semblait nécessaire de conserver une réelle souplesse dans la réalisation des quotas et donc dans la qualité des études, gage de la réussite. Il précisait que l’académie de Versailles était favorable à cette orientation renforcée des baccalauréats technologiques et professionnels vers des filières adaptées afin d’éviter l’échec et les frustrations et de permettre de connaître des étudiants heureux : le taux de réussite de ces bacheliers à l’université de Paris 10 Nanterre était en effet inférieur à 5 % (autour de 2 %) et le passage en L2 de droit y relevait du miracle…
a. Les instituts universitaires de technologie (IUT)
En 2015-2016, 116 200 étudiants préparaient un diplôme universitaire de technologie (DUT), ce nombre restant stable. La part des titulaires d’un baccalauréat technologique parmi les nouveaux entrants était de 29,9 %, en baisse de 0,4 point par rapport à l’année précédente. Elle était de 26,3 % en 2012-2013, avant la promulgation de loi.
Lors de son audition, M. Rodolphe Dalle (35) précisait que les statistiques annuelles sur la réussite étudiante montrent des taux de réussite globaux avoisinant 73 % en première année de DUT. Ces résultats recouvrent une assez forte disparité suivant les filières d’origine des étudiants. La moyenne pour les baccalauréats généraux toutes disciplines et IUT confondus est de 80 % de réussite au premier semestre, contre un peu moins de 60 % pour les bacs technologiques. Or une réussite au premier semestre pour un étudiant le conduit dans près de 100 % des cas au bout de son DUT, avec peu de difficultés. Les taux de réussite sont également assez fortement inégaux sur le territoire national, et entre la métropole et l’outre-mer où ils sont assez sensiblement inférieurs pour certains IUT. Des nuances existent également suivant les spécialités : bien qu’au niveau national, l’écart entre secteur secondaire et tertiaire reste faible, la différence selon les spécialités peut varier significativement d’un établissement à l’autre. Ainsi M. André-Max Boulanger (36) faisait remarquer qu’à Montreuil, le taux de réussite en DUT varie fortement en fonction des spécialités : il est globalement meilleur en tertiaire qu’en secondaire, mais l’impact des baccalauréats d’origine est très net, les bacheliers technologiques ayant une moins bonne réussite.
C’est dans ce cadre, estimait M. Boulanger, que se pose la question pratique des quotas prévus par la loi, devenus des « valeurs chiffrées à construire ensemble ». L’IUT de Montreuil acceptait déjà des bacheliers technologiques à des taux supérieurs à ceux demandés à la suite de la loi comme un élément de sa politique de recrutement. Mais il regrettait que le rectorat semble plus préoccupé par les flux d’entrée que de sortie alors que le taux des réussites des différents baccalauréats est évidemment à prendre en compte.
M. Rodolphe Dalle a rappelé que les responsables des IUT sont attachés à la réussite de leurs étudiants quel que soit leur baccalauréat. Or, la différence sémantique entre quotas et objectifs d’accueil prioritaires a un sens. Les quotas ont une dimension autoritaire qui lui semble contreproductive. Toutes les équipes pédagogiques s’emparent de la réussite étudiante, par l’accompagnement et le soutien, bénévolement et spontanément parce qu’elles se sentent responsables du recrutement. La déresponsabilisation du recrutement conduirait à un retrait de l’engagement des équipes pédagogiques. Or, selon lui, l’accueil des bacheliers technologiques ne progresse pas autant que souhaité pour deux raisons : le manque de vivier et l’inadéquation entre les baccalauréats technologiques et les spécialités des IUT.
M. Steeve Reisberg (37) a fait remarquer que le vivier de baccalauréat technologique ne représente qu’entre 8 et 10 % des candidatures pour son IUT de Paris-Diderot, très spécialisé, alors que le nombre d’étudiants en remédiation, en échec dans le cycle L et qui ne veulent pas continuer dans un cycle universitaire classique, est de 25 à 30 %. Statistiquement, depuis la mise en place de quotas par la loi, le nombre de bacheliers technologiques est passé de 2 à 20 %, dont 30 à 35 % sont en remédiation. La pression est donc forte : 20 à 25 candidatures pour une place dans un DUT. La sélection ne se fait pas sur les notes, mais sur un entretien avec le candidat. L’IUT reçoit entre 1 200 et 1 300 étudiants ; l’orientation est essentielle, car l’échec n’est pas forcément lié au niveau scolaire mais à un défaut d’orientation. En effet, les meilleurs étudiants ne réussissent pas forcément en IUT, mais les plus motivés, ayant un goût pour la technologie, aimant le travail en équipe, ayant un esprit d’initiative, assidus, ponctuels et ayant un esprit de rigueur. Ces différents éléments se remarquent à travers les appréciations des enseignants dans le secondaire et les entretiens. Les études en DUT imposent 35 à 40 heures hebdomadaires, contre 20 à 25 en cursus universitaire classique. Du fait de la faiblesse du vivier de recrutement (200 sur 2 000), l’IUT a été conduit à impulser des initiatives destinées aux bacheliers technologiques, financées sur ressources propres, en direction des lycées technologiques franciliens et en dehors des journées « portes ouvertes ». Elles peuvent prendre par exemple la forme d’« olympiades » qui mettent en concurrence les étudiants de filières de baccalauréat général avec ceux de baccalauréat technologique. Les étudiants des filières technologiques, quand ils sont sur le podium, rompent certaines barrières psychologiques les séparant de ceux des filières générales.
Il précisait également que certains étudiants admettaient, après avoir réussi leur DUT, qu’ils avaient eu peur de candidater, ou qu’ils ont candidaté mais ont rencontré de nombreuses difficultés, dues notamment au fait que les spécialités de DUT et de baccalauréat technologique ne sont plus en adéquation.
La question de l’inadéquation du vivier de bacheliers technologiques avec les formations proposées par les IUT, corroborée par les données statistiques nationales qui montrent la stagnation du taux des baccalauréats technologiques, a également été soulignée par M. Jean-Paul Vidal, pour l’IUT d’Allier.
La réforme des baccalauréats sciences et technologies (ST) en 2010, relevée par les différents responsables d’IUT auditionnés, a modifié les programmes enseignés dans les lycées en renforçant la composante générale au détriment de matières techniques nécessaires pour entreprendre un DUT. M. Jean-Paul Vidal faisait remarquer que cette réforme des baccalauréats ST a été vue comme allant dans le sens de l’essor de « l’économie de la connaissance » mais elle a conduit à rompre l’équilibre entre la pratique et la conceptualisation, qui est particulièrement important dans des sections qui scolarisent des jeunes peu attirés par la conceptualisation. Or, une conceptualisation sans pratique nuit à la conceptualisation elle-même. Il regrettait que les domaines de compétence et de connaissance s’en soient trouvés réduits, comme la poursuite des études par ces étudiants. Il estimait cette rupture d’équilibre était cause d’échecs croissants. En outre, il s’étonnait de ce que l’année de terminale soit focalisée sur le projet de terminale, souvent virtuel, sur ordinateur, avec des images, au risque de négliger l’aspect concret ou la taille de la réalisation et son utilisation pratique, révélés seulement les derniers jours. Il regrettait que les étudiants ne découvrent qu’à leur entrée à l’IUT, pour la première fois, ce qu’est une machine-outil.
M. Rodolphe Dalle a lui aussi relevé l’importance de l’articulation entre conceptualisation et apprentissage par la pratique et l’induction, les IUT faisant du « learning by doing » (apprentissage par la pratique) depuis leur création, il y a 50 ans. L’abstraction est plus grande aujourd’hui, liée aux technologies nouvelles et aux modèles numériques dans les différents enseignements. Dès lors, on peut constater, dans le cadre de la formation en alternance, et tant dans les entreprises que dans les IUT, que la pratique du geste est moins spontanée, puisqu’en perte de vitesse dans l’enseignement secondaire.
L’importance du DUT a été soulignée par les différents responsables d’IUT auditionnés, à la fois comme un élément sécurisant d’un parcours professionnalisant dans l’enseignement supérieur, mais aussi comme une voie d’accès efficace à la poursuite des études.
Licence professionnelle ou non, diplômes d’ingénieurs, doctorats, les perspectives offertes aux titulaires de ce diplôme atypique qui ne cadre pas exactement avec le schéma LMD montrent l’intérêt d’en développer l’accès aux bacheliers pour qui le DUT avait été initialement conçu. Les dimensions d’un IUT lui permettent d’accompagner les jeunes et d’être en mesure de mobiliser les équipes pédagogiques, ce qui rassure les familles, rappelait M. Rodolphe Dalle (38). Il soulignait que la poursuite d’études après l’IUT n’a rien de surprenant puisqu’il existe une demande sociétale réelle, portée par une démarche tant nationale qu’européenne tendant à l’obtention de grades universitaires de plus en plus élevés. Les ingénieurs des grandes écoles se tournent aujourd’hui vers la finance ou le management. Or, les étudiants de DUT qui poursuivent leurs études en écoles d’ingénieurs deviennent de très bons ingénieurs de terrain puisqu’ils en ont le goût, comme celui de la technologie. Il en est de même pour les écoles de commerce, formant des managers de sommet, les IUT pouvant quant à eux fournir les managers de terrain. Ces cadres correspondent aux besoins des entreprises. Les études bac +5 mettent ainsi à profit les compétences professionnelles acquises en IUT. Le DUT apparaît à beaucoup de familles comme une brique intermédiaire sécurisante qui permet d’encourager leurs enfants à poursuivre des études supérieures. Ils ne le feraient pas s’ils se dirigeaient vers un cycle supérieur classique ou d’autres études proposées par les établissements publics. À défaut, ils s’orientent plutôt vers les cursus professionnalisants du secteur privé.
Au-delà de la question des quotas, dont la rigidité tient à une approche selon lui trop ciblée, d’une question réelle comme le taux d’échec des bacheliers professionnels ou technologiques dans l’enseignement supérieur, M. Rodolphe Dalle a insisté sur la nécessité de garder une souplesse et une variété des formations où chacun puisse trouver sa place en fonction de son projet personnel et professionnel, tout en mettant en place ou en renforçant les systèmes de passerelles afin de conduire la majorité des étudiants vers la réussite. Cependant, il soulignait que la lourdeur des horaires des IUT peut dérouter, au même titre que le besoin d’organisation autonome dans les cycles classiques, et que l’adaptation des étudiants à ces particularités n’est pas homogène.
b. Les sections de techniciens supérieurs (STS)
Le baccalauréat professionnel avait été conçu comme ouvrant directement sur l’insertion professionnelle et l’entrée dans la vie active, ce qui est encore le cas pour 60 % de ses titulaires. Or, le contexte économique actuel réduit les chances d’insertion immédiate et les entreprises tendent à recruter au moins à bac + 2 pour des raisons de niveau de formation mais aussi d’âge : formés en 3 ans, les bacheliers professionnels sont plus jeunes que naguère. L’enseignement supérieur n’a pas anticipé suffisamment l’arrivée importante de ces nouveaux bacheliers, tant en termes de capacités d’accueil que de formations proposées. Les difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils souhaitent poursuivre des études se traduisent par de très faibles taux de réussite et ont conduit, suivant une même logique que pour les baccalauréats technologiques et les IUT, à mettre en place des pourcentages minimaux de bacheliers professionnels dans les sections de techniciens supérieurs (STS), qui étaient initialement conçues comme devant constituer la voie principale de la poursuite de leurs études.
En 2015-2016, 256 100 étudiants étaient inscrits en STS.
Or, même si leur part a baissé de plus de 10 points depuis 2009, les bacheliers technologiques restent les plus nombreux à fréquenter les sections de techniciens supérieurs et représentent 34,7 % du nombre total d’entrants.
Certes, la part des bacheliers professionnels augmente depuis dix ans : ils représentaient 12,5 % des nouveaux entrants en 2005 et 28,0 % en 2015. Mais leur part a baissé cette année de 0,8 point. L’impact de la loi sur le taux de bacheliers professionnels, si l’on se réfère à ce qu’il était avant sa promulgation (26,1 % en 2012 et 21,7 % en 2011) reste modeste, les capacités d’accueil en STS étant insuffisantes.
La création annoncée de 2 000 places supplémentaires cette année, dans un effort poursuivi sur cinq ans qui en porterait le nombre total à 10 000, devrait contribuer à redresser les possibilités d’accès à l’enseignement supérieur technique pour les bacheliers professionnels.
Par ailleurs, cinq académies expérimentent actuellement une admission en STS décidée par le conseil de classe de la terminale professionnelle, au lieu de l’actuelle sélection sur dossier.
Lors de son audition, Mme Danièle Roussillon (39) remarquait qu’il convenait particulièrement dans ce domaine d’études supérieures de faciliter « l’encrochage », en s’appuyant sur un accompagnement renforcé, un tutorat, et des enseignants exerçant à la fois dans les classes de baccalauréat professionnel et les STS. Ce nécessaire effort d’accompagnement était également relevé par Mme Claudine Ledoux (40), comme la nécessité que les universités s’intéressent davantage aux étudiants des STS, les licences professionnelles n’étant pas les seules qui leur soient accessibles si une approche plus fine était mise en place.
M. Éric Mansencal (41) relevait également que les problématiques étaient différentes en milieu rural et en milieu urbain : dans ce dernier cas, les lycéens demandent à rester dans leur établissement, qui leur est familier. Un élève scolarisé en milieu rural sera souvent conduit à poursuivre ses études en milieu urbain, faute de STS dans son établissement, ce qui est un facteur bloquant que traduisent les statistiques comme celles évoquées précédemment, publiées par France Stratégie en 2015. M. Philippe Tournier précisait à cet égard que le taux d’accès à l’enseignement supérieur est plus élevé en Seine-Saint-Denis que dans la Seine-et-Marne, montrant clairement que le clivage territorial joue un rôle plus important que le clivage social.
M. Christophe Bonnet (42) soulignait que le niveau bac + 2 restait très apprécié en France et faisait remarquer qu’une meilleure insertion territoriale des STS et des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) qui les portent dans le nouveau dispositif d’enseignement supérieur permettrait de sortir d’une logique fondée uniquement sur des universités de recherche bien placées dans les classements internationaux. Il regrettait ainsi que les conventions passées entre les lycées et les universités restent intra-académiques alors que les nouvelles politiques de site reposent sur une logique territoriale souvent inter-académique.
Mme Claudine Ledoux ajoutait que se mettaient en place au niveau européen des équivalences internationales pour certains BTS reconnaissant ainsi leur valeur malgré leur caractère atypique dans le cadre du cursus LMD. Cette possibilité est ouverte par exemple aux élèves scolarisés dans un lycée ayant signé une charte Erasmus. La poursuite d’études à l’étranger, encore peu utilisée par les élèves des STS, renforce l’intérêt de continuer à y favoriser l’entrée de titulaires de baccalauréats professionnels, dont la mobilité étudiante reste faible.
Deux ans après la promulgation de la loi, M. Christian Lerminiaux constate dans son rapport (43) « Améliorer la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur des bacheliers professionnels » que la part des STS demeure prépondérante pour les bacheliers professionnels qui poursuivent leurs études ; le taux est à peu près constant mais recouvre, comme cela a été souligné, une forte augmentation de la population concernée. Il remarque qu’on « peut résumer la situation actuelle des bacheliers professionnels de la façon suivante : le nombre de ceux qui accèdent à un diplôme de l’enseignement supérieur ou s’insèrent professionnellement augmente moins vite que le nombre de ceux qui échouent en STS, s’engagent dans des formations leur offrant peu de chances de réussite ou viennent directement grossir les rangs des demandeurs d’emploi et des inactifs. C’est le cas notamment d’une partie des bacheliers du secteur tertiaire, qui sont particulièrement exposés au risque d’échec : il leur est difficile en effet d’accéder tant à l’emploi qu’aux STS, où ils sont davantage soumis à la concurrence des bacheliers généraux et technologiques et où leur taux de réussite est sensiblement inférieur à celui constaté dans les formations industrielles. »
Parmi les recommandations qu’il suggère, la 9e vise à remédier aux difficultés soulevées par la poursuite des études des bacheliers professionnels à laquelle la seule introduction par la loi de places réservées dans les STS répond insuffisamment. Elle résume bien les diverses suggestions et préoccupations exposées lors des auditions : « Mieux accompagner les bacheliers professionnels en filière professionnelle du supérieur en renforçant la logique de parcours entre les deux niveaux d’enseignement :
« a) Assurer une meilleure articulation entre le baccalauréat professionnel et le BTS et les nouvelles formations universitaires professionnalisantes ;
« b) Développer une pédagogie différenciée afin de mieux prendre en compte les acquis des différents publics accueillis en filières professionnelles de l’enseignement supérieur ;
« c) Préparer les futurs bacheliers professionnels à la poursuite d’étude en amont de leur entrée dans l’enseignement supérieur ;
« d) Mettre en place des outils de suivi des parcours des bacheliers professionnels et des diplômés de STS (et poursuivre leur mise en place dans les IUT et les autres établissements d’enseignement supérieur) ;
« e) Permettre aux néo bacheliers une période de détermination. »
a. Faire coïncider élitisme et ouverture à tous les étudiants
La place centrale de l’université dans le dispositif de formation supérieure et de recherche français a été nettement rétablie par la loi LRU et réaffirmée par la loi ESR, le choix ayant été fait, comme l’a rappelé M. Jean-Richard Cytermann (44) de ne pas abroger la loi LRU mais de l’adapter.
Les décisions et objectifs européens initiés dans le cadre du processus de Bologne ont conduit à harmoniser les cursus d’enseignement supérieur, le cursus universitaire français s’organisant autour de trois diplômes nationaux : la licence, le master et le doctorat. Cette organisation, « LMD », fondée sur des semestres d’études, doit favoriser la mobilité géographique des étudiants européens mais aussi la mobilité thématique entre les disciplines et les formations.
Parallèlement les objectifs d’une Europe de la connaissance, de la stratégie de Lisbonne à celle d’Europe 2020, visent à améliorer les niveaux d’éducation en réduisant le taux d’abandon scolaire à 10 % et en portant à 40 % la proportion des personnes de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur ou atteint un niveau d’études équivalent. Pour sa part, la France s’était fixé un objectif ambitieux de 50 % de diplômés pour la classe d’âge des 17-33 ans. Enfin, la proposition 1 de la StraNES consiste à porter à 60 % le taux de diplômés de l’enseignement supérieur dans une classe d’âge, 50 % au niveau licence et 25 % au niveau master. Selon le comité de la StraNES il faudrait, pour atteindre ce niveau de qualification, une augmentation de 30 à 35 % du nombre d’étudiants d’ici à 2025.
Jointes à la croissance continue du nombre de bacheliers, mais titulaires d’un diplôme qui ne semble plus correspondre à ce qu’il était, le premier diplôme universitaire – quelles que soit d’ailleurs les études qu’il sanctionne, générales, technologiques ou professionnelles –, ces nouvelles données ont conduit l’université à devoir répondre à des questions auxquelles elle n’était pas initialement préparée : destinée à former des enseignants et des chercheurs et, depuis l’origine, des juristes et des médecins, accueillant des étudiants conscients de poursuivre des études assez longues et élitistes, elle doit aujourd’hui répondre à une demande forte d’intégration professionnelle assez rapide et de formations professionnalisantes la permettant.
Cette révolution culturelle a été diversement commentée lors des auditions des universitaires responsables d’établissements.
i. La sélection en licence ou une réorientation en cours de L1 ?
M. Jean-Richard Cytermann a rappelé que le principe fondamental d’absence de sélection à l’entrée à l’université a été maintenu ; dès lors, l’intervention administrative consiste à réguler les flux, améliorer l’orientation et, hors domaine législatif, renouveler l’approche pédagogique.
M. Jean-Loup Salzmann (45) constatait que l’absence de sélection à l’université n’empêchait pas de réfléchir à des solutions permettant de faire en sorte que des étudiants non équipés pour y réussir puissent trouver une orientation leur correspondant mieux. Le dogme du baccalauréat premier diplôme universitaire et garantissant une entrée libre à l’université ne prépare pas en soi les étudiants à l’exigence de travail qui sera demandée en licence. Lors de la même audition, M. Khaled Bouabdallah rappelait que la question de la sélection ne concernait pas la seule université mais toute la société, et que c’était à l’État de réfléchir plus globalement à la réussite des lycéens dans l’enseignement supérieur.
M. Pierre André Jouvet (46) faisait part de son sentiment que la loi ESR n’avait pas apporté de changements profonds sur la capacité de faire réussir les étudiants en licence ou en master. Il lui semblait en effet que le souci était plus structurel et lié aux étudiants entrant en 1ère année, soit avec un choix par défaut de l’université, soit ne disposant pas du parcours préalable leur permettant de s’engager dans des études universitaires, plutôt abstraites et peu encadrées en termes de cours et de formations. Il remarquait que c’était particulièrement le cas pour les étudiants ayant un baccalauréat professionnel, dont les formations préparent peu aux méthodes de l’université. Il constatait que les universités ont fait leur deuil du baccalauréat. La question bac –3 / bac +3 est pertinente, car il n’a pas l’impression que ce qui s’étudie depuis bac –3 prépare de façon optimale aux études supérieures. Dès lors, certaines universités sont allées jusqu’à mettre en place une année blanche après le baccalauréat pour mettre les étudiants à niveau et leur donner des méthodes de travail et l’accès à l’autonomie.
Il constatait également que les étudiants se concentrent sur quelques disciplines à la mode comme le droit, l’économie, la gestion mais aussi les licences de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). Des difficultés énormes se posent pour ces étudiants, en termes d’encadrement et de suivi. Les initiatives intéressantes, comme par exemple la mise en place de tutorat (ou le monitorat), sont en fait très rapidement utilisées par les meilleurs étudiants et passent donc à côté de la population auxquelles elles étaient destinées prioritairement. Elles sont par ailleurs antérieures à la loi ESR. Les idées déjà présentes comme des jurys semestriels permettant une réorientation en cours d’année sont difficiles à mettre en œuvre pour des populations de 1 000 ou 1 500 étudiants. Du coup beaucoup d’abandons ont lieu. C’est le cas en économie ou en droit à l’université de Paris Ouest Nanterre : 25 à 30 % des étudiants abandonnent au cours de la première année, 30 % s’en sortent et 30 % sont entre deux et demandent une meilleure intégration.
M. Jean-Francois Balaudé (47) rappelait que le niveau des néo-entrants titulaires d’un baccalauréat était très variable. Les responsables des formations sont conscients des lacunes à combler et des niveaux à rattraper. À Paris Ouest Nanterre, des dispositifs de culture générale ont été introduits en première année de licence (L1) (« les grands repères »), mais aussi un atelier de langue française, imparfaitement maîtrisée par certains étudiants : ce qui était sans doute impensable il y a 15 ans est apparu assez naturellement comme une solution. Il lui semble important de ne pas laisser les étudiants s’embarquer dans une formation où ils seront perdus en quelques semaines, plutôt que de tenter de remédier ensuite à un gâchis. L’objectif est d’essayer d’avoir le moins de décrocheurs possible parmi les 34 000 étudiants de Paris 10. Ainsi, les examens sur les « grands repères » rassemblent 8 000 étudiants. Il convient donc de délivrer des fondamentaux et d’adapter les cursus aux situations de fait : un niveau faible.
Cependant, M. Jean-Francois Balaudé constatait que depuis 2013, les moyens mis en œuvre pour permettre la réalisation des objectifs posés par la loi en matière de réussite étudiante ont pris la forme des créations de postes dites « Fioraso » pour les deux universités de Paris Lumières afin de mieux encadrer les étudiants dans l’objectif de la réussite « licence ». Les manques à Nanterre étaient surtout administratifs mais concernaient aussi certaines formations. L’amélioration du taux de réussite en licence, notamment le taux de passage de L1 à L2 (+5 % en 2015), ne procède sans doute pas seulement de ces renforcements, mais ils y ont cependant contribué, comme l’ont aussi fait de nouvelles modalités de contrôle des connaissances. Par exemple, est retenue la meilleure des deux notes obtenue entre deux sessions (dispositif qui, bien sûr, n’était pas prévu par la loi). Tout cela participe de l’objectif d’améliorer le taux de réussite. La loi a délivré des encouragements généraux : une meilleure orientation des futurs étudiants, une orientation active visant à dissuader de postuler pour des filières à l’échec programmé.
La sélection en licence est, selon M. Jean-François Balaudé, un sujet à la fois plus sensible et plus compliqué. Elle peut être tournée par une bonne information sur les formations qui peut avoir un effet dissuasif sur les mauvais choix : les licences simples, doubles, pluridisciplinaires et leurs attendus et charges de travail. La bonne sélection ne se fait pas à l’entrée à l’université mais au cours ou à l’issue de la première année de licence (L1), par exemple avec l’introduction d’une double licence au 2e semestre. Il faisait remarquer qu’il y avait bien sûr un grand écart entre ce double cursus et l’atelier de langue française. Mais la sélection s’opère sur la base des résultats obtenus par l’étudiant à l’université même. C’est une façon non conflictuelle et plus intelligente de s’orienter vers des filières plus sélectives et un accompagnement plus actif de l’étudiant. Certaines universités, parisiennes en particulier, font d’autres choix, non réglementaires, comme une sélection sur dossier dans ou hors APB, plaçant dès lors les autres universités d’Ile-de-France en situation délicate.
L’évaluation des enseignements vient d’être mise en œuvre à Paris Ouest Nanterre, avec diplomatie, sur une série de formations pilotes. Elle sera étendue si l’expérience est concluante, ce qui semble être le cas. Ces évaluations participent de la réussite étudiante puisqu’elles obligent à consulter les étudiants et à réfléchir, à travers leurs réactions et leurs retours, sur les formations délivrées et les cadres proposés afin d’améliorer, en continu, les dispositifs universitaires. M. Jean-François Balaudé constatait que les étudiants restaient très attentifs et volontaires pour participer au travail sur l’évolution de la pédagogie. Il ne s’agit pas de se substituer aux enseignants mais d’aider à réfléchir aux modes de transmission, de lever des freins en intégrant la dimension numérique et la virtualisation, tout ce mouvement d’innovation ayant été mis en route par la loi.
Si M. Laurent Batsch (48) précisait que l’université de recherche Paris Sciences et lettres assume que ses licences sont préparatoires aux masters, sélectives et méritocratiques, mais elles sont accompagnées d’une politique sociale très active. Elles ne sont pas professionnalisantes, pas plus que les classes préparatoires. Ce ne sont que des socles de compétences et de connaissances. Tout le monde semble résigné, mais malgré les livres du type « il n’y pas de crise à l’université », l’échec massif en 1er cycle lui paraît patent. Sur 10 jeunes, 4 terminent la licence en 3 ou 4 ans. Sur les 6 autres, la moitié se réoriente on ne sait où et l’autre moitié disparaît. Il déplore que ce sujet n’intéresse personne, que l’on glose sur le bac -3 / bac +3 mais qu’il est suggéré de ne toucher à rien quand on rédige la Stratégie nationale de l’enseignement supérieur… Il estime que dans ces conditions il est vain d’attendre des résultats en matière de réussite étudiante à l’université.
M. Jean-François Balaudé (49) relevait lors de son audition qu’un impensé, un non-dit, saute cependant aux yeux : la question de la sélection en master, de son maintien, de son déplacement en première année de master (M1) ou de sa stabilisation entre première (M1) et deuxième année (M2)… La loi n’a pas permis d’anticiper ce point, qui se règle dans la douleur avec des résultats assez incertains pour l’année qui vient.
En effet, dans un avis du 10 février 2016, le Conseil d’État (50) a précisé la portée de l’article L. 612-6 du code de l’éducation et rappelé qu’une sélection ne peut être mise en place pour l’accès aux formations de première ou deuxième année de master à l’université que si ces formations figurent sur une liste établie par décret.
M. Jean-François Balaudé a relevé que, le ministère ayant affirmé qu’il sécurisait l’existant, les universités lui transmettent la liste des masters concernés en 2015-2016, soit la quasi-totalité. La réussite étudiante se joue aussi à ce niveau et la possibilité pour un étudiant admis en master d’aller jusqu’au bout de ce cycle n’est pas acquise. Il serait sans doute préférable de placer une sélection, pas trop rigoureuse, à l’entrée du M1 pour permettre à la cohorte d’étudiants d’aller au bout de son cycle, en requalifiant ainsi le master. En réalité, cette sélection qui ne dit pas son nom a déjà lieu hypocritement en M1, ce qui fausse la liste de celle établie entre M1 et M2…
M. Thierry Mandon (51) a précisé qu’au-delà des débats parfois animés sur cette question, la possibilité de mettre en place une sélection dès le M1 pour certains masters est assez généralement admise ; un projet de loi devrait ouvrir cette voie.
b. L3, licence ou bachelor, processus européen et marché mondial
Si les auditions ont donc fait apparaître assez nettement que l’université conservait une vocation à former des étudiants destinés à poursuivre des études supérieures de master et de doctorat, indépendamment de la réflexion sur leurs contenus et leurs voies de sortie, généralistes ou tournées vers la recherche, elle parvenait difficilement à développer une voie professionnalisante dès le niveau licence. Dès lors, se développent des diplômes d’écoles ou d’établissements privés, de niveau L3, du type bachelor, qui drainent les étudiants désireux de trouver une insertion professionnelle rapidement, même si, comme le constatait M. Franck Bournois (52), cette formation qui concurrence les classes préparatoires n’a pas de protection juridique. Elle traduit par ailleurs un paradoxe relevé tant par M. Jean-Loup Salzmann que par M. Khaled Bouabdallah (53) : les mêmes entreprises qui défendent les diplômes de niveau bac + 2 comme le DUT, demandent aujourd’hui des formations professionnalisantes de niveau bac + 3.
Le titre de bachelor est délivré depuis longtemps par certaines écoles de commerce et correspond le plus souvent à une durée de 3 ans d’études après le baccalauréat, sa reconnaissance, variable, étant d’abord liée à la réputation et au carnet d’adresses de l’école qui le remet, et qui propose souvent des stages inaccessibles aux étudiants en DUT ou en BTS. Or ces diplômes se multiplient : l’École polytechnique ouvre ainsi, à la rentrée 2017, un cursus bachelor sélectif dispensé en anglais afin de correspondre aux standards des plus grandes universités mondiales, selon la présentation qu’en fait le site de l’école.
La première difficulté est justement que le même nom couvre des diplômes assez différents : ceux délivrés par les écoles de commerce, mais aussi certains diplômes intermédiaires des écoles d’ingénieurs ou le bachelor de technologie de l’École nationale supérieure des arts et métiers, voire un produit d’appel pour étudiants étrangers, comme cela vient d’être remarqué.
M. Jean Bastianelli (54) faisait remarquer que la mise en place des bachelors, à bac + 3 mais parfois à bac + 4, traduisait un système diversifié correspondant à la diversité des élèves. Les deux voies sont possibles. Ce n’est pas, pour lui, une mise en concurrence puisque les publics concernés sont différents. Les classes préparatoires aux grandes écoles continuent de former aux grands concours, comme celui de l’École polytechnique, délivrant des diplômes d’ingénieur, de niveau bac + 5, ce nouveau bachelor en anglais étant, lui, destiné aux étudiants étrangers.
M. Jacques Bittoun (55) précisait à cet égard qu’il cherchait à éviter le conflit avec les grandes écoles. Quand elles se concentraient sur les applications et l’industrie nationale, elles ne cherchaient pas à atteindre le standard de la recherche internationale que présente un doctorat. Mais, dans une économie mondialisée, les grandes écoles demandent maintenant les privilèges de reconnaissance internationale qui étaient ceux des universités, alors même qu’il est exigé des universités de chercher des financements des entreprises. Dès lors, le partage des rôles antérieur ne tient plus : les universités sont désormais en concurrence avec les grandes écoles pour la moitié de leurs activités. À Paris Saclay, le cluster serait suffisant pour prendre la place des grandes écoles auprès des entreprises sur le site. Jusqu’à présent, la recherche était partagée et les diplômes propres aux écoles leur étaient laissés. La naissance du bachelor, dont les écoles demandent l’exclusivité parallèlement au cursus LMD de Bologne, modifie le paysage. Il devient nécessaire de transformer les licences en bachelor, pour rééquilibrer le choix fait par l’École polytechnique – dans le cas de l’université de Paris-Sud –, mais surtout pour que l’université tienne sa place dans le cadre concurrentiel de la mondialisation.
M. Jean-Richard Cytermann (56) rappelait que le rôle de l’État était de séparer le bon grain de l’ivraie dans les diplômes, le modèle lucratif ayant ses limites : il y a un maximum en matière de frais d’inscription. De même que le master s’est imposé lentement, le bachelor devrait se réguler avec le temps mais il ne faut pas qu’il mette en danger des filières qui marchent bien : une cohérence globale devrait s’imposer à ces formes naissantes d’enseignements et de diplômes.
M. Jean-Paul Vidal (57) soulignait que le premier diplôme reconnu en Europe dans le cadre du cursus LMD est le L, d’où la place prise par des bachelors en 3 ans. Il s’agit, pour les écoles d’ingénieurs, d’attirer une nouvelle population par des classes préparatoires déguisées, mais comme pour les écoles de commerce, les jeunes qui en sortent se référeront à l’école, pas au diplôme. Le risque pour les IUT est que des bacheliers qui auraient pu les choisir préfèrent se diriger vers des écoles délivrant des bachelors, même lorsqu’ils sont issus de populations modestes ou défavorisées, quitte à s’endetter pour ce faire. Dès lors, si l’État doit financer quelque chose, ce serait plutôt un bachelor dans les IUT en faisant évoluer les formations nécessaires sur les bases actuelles.
Lors de la même audition, M. Rodolphe Dalle constatait que le bachelor était tout d’abord une réponse d’opportunité : la réforme de la taxe d’apprentissage favorise le versement aux établissements dont les formations sont plutôt en dessous du niveau 1 et un certain nombre d’écoles de commerce et d’ingénieurs ayant constaté un manque à gagner, la création d’un bachelor est un moyen pour elles de bénéficier à nouveau de la taxe d’apprentissage. Mais, d’autre part, la création d’un bachelor est également l’occasion, pour ces écoles, de se positionner à l’international, dans un grand marché de l’enseignement supérieur libéralisé, comme le montre le cas de l’École polytechnique.
M. Dalle se demandait s’il fallait encore complexifier la lisibilité des scolarités de l’enseignement supérieur en y introduisant un nouveau diplôme. Il lui semblait préférable de plutôt affirmer et optimiser les parcours existants pour répondre aux besoins par une offre de qualité. Il soulignait cependant que le processus de Bologne, le cycle LMD fondé sur bac + 3, + 5 et + 8, rendait les IUT et les DUT qu’ils délivrent moins lisibles. La réglementation devant être un levier pour innover, si le bachelor est en mesure de correspondre à un diplôme technologique qui réponde aux besoins des entreprises, il serait alors possible d’en examiner l’intérêt pour les IUT.
Pourtant, le monopole de l’État en matière de collation des grades et des titres universitaires, prévu par l’article L. 613-1 du code de l’éducation, attribué aux établissements accrédités depuis la loi ESR, paraît à certains un peu dépassé. En effet la loi ESR a mis fin à l’habilitation des formations conduisant aux diplômes nationaux au profit de l’accréditation des établissements. L’État n’entre plus dans le détail des formations proposées en habilitant chaque diplôme, mais accrédite désormais les établissements pour délivrer les diplômes, pour la durée du contrat pluriannuel, en vérifiant qu’ils respectent le cadre national des formations. L’arrêté d’accréditation de l’établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer les diplômes nationaux dont la liste lui est annexée.
Or, comme le constatait Mme Simone Bonnafous (58), tout le monde peut adopter le nom de bachelor qui n’est pas reconnu par l’État français. Les écoles de commerce l’ont développé, les écoles d’ingénieurs peu. Mais il faut que la licence générale apporte des certitudes : le grade de licence ne saurait être conféré à tous les bachelors, dont la création permet d’échapper non seulement au cadre des licences voté au CNESER et imposé par arrêté à tous les établissements, mais aussi aux droits d’inscription nationaux.
M. Laurent Batsch (59) constatait, quant à lui, que, 18 ans après Bologne, près de 450 000 étudiants sont à bac + 2, alors que le standard européen a été fixé à bac + 3. Dès lors ont été créées des licences professionnelles plaquées, d’un intérêt limité, sauf dans l’industrie, (ainsi, dans le secteur tertiaire, la licence « gestion et identité de l’immobilier », c’est-à-dire une formation de comptables pour syndics). Les PME ont besoin de chefs comptables, de techniciens comptables formés de façon cohérente sur ces sujets pendant trois ans. Il faut accepter et assumer des licences qui ne débouchent pas sur des masters et donc, a contrario, des licences et des masters sélectifs. Il faut développer ces licences technologiques qui vont permettre d’ouvrir une voie de réussite. Il faisait remarquer que le marché est en train de se substituer au service public. En effectifs globaux, sur dix ans, les universités ont perdu 5 % de parts de marché de l’enseignement supérieur, captés par des écoles post-baccalauréat vendant des bachelors à 8 000 euros par an. Il faut donc créer dans le service public une voie de réussite. Elle pourrait être cette licence technologique sélective, ce qui recentrerait les licences préparatoires aux masters sur leur vraie fonction. Cette voie nouvelle devrait s’ouvrir en s’appuyant sur ce qui existe, les IUT en particulier, qui seraient ainsi mieux intégrés dans l’université, afin de donner accès à une licence qualifiante dès la fin du baccalauréat, conçue comme telle et programmée réellement sur 3 ans, ayant vocation à déboucher sur des emplois de cadres intermédiaires et non pas sur des masters.
De même, M. Francis Jouanjean (60), constatant que les élèves de classes préparatoires ont 80 % de chances d’atteindre le niveau master, se demandait comment orienter les élèves dans le premier cycle universitaire dans une voie professionnalisante. La Conférence des grandes écoles pense qu’il faut développer des filières professionnalisantes en trois ans, quitte à poursuivre des études ultérieurement en travaillant par modules diplômants courts, soit en cours du soir, soit en alternance, et atteindre ainsi le niveau M1/M2, voire le doctorat. Il lui semblait que continuer à tendre absolument à un niveau bac + 5 revient à le dévaloriser, comme le constate déjà l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), qui montre que, d’ores et déjà, le niveau des embauches proposées à ces diplômés a diminué.
M. Jean-Michel Nicolle (61) faisait remarquer que si le secteur de l’enseignement supérieur privé associatif qu’il représente s’insère aujourd’hui dans le cadre des politiques publiques, l’alternative est un secteur privé bâti sur un modèle lucratif et délivrant des diplômes américains attractifs. La jeunesse ne se place plus du point de vue public ou privé mais raisonne davantage en termes de poursuite des études en France ou à l’étranger. Le bachelor est adapté au grand marché mondial de l’éducation qui se joue aujourd’hui au niveau de la licence. S’il est impossible pour le secteur privé non lucratif de délivrer des diplômes publics, il pourrait se rallier au bachelor auquel, dans ce contexte de concurrence internationale, il est favorable.
4. Réussir dans l’enseignement supérieur privé associatif
Les établissements privés d’enseignement supérieur non lucratifs se sont vu reconnaître leur participation aux missions de service public en 2002, puis leur contractualisation avec l’État en 2010 en contrepartie d’un engagement dans des missions d’intérêt général et, enfin, la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) par la loi ESR. Son article 70, introduit par un amendement porté par le groupe de l’Union des démocrates et indépendants – Union centriste en séance publique en première lecture au Sénat, crée en effet un chapitre dans le code de l’éducation définissant les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur à but non lucratif. Ils participent de la « biodiversité » de l’enseignement supérieur, selon le mot retenu par leurs représentants lors de la table ronde les réunissant (62).
La reconnaissance de ces établissements s’articule autour de trois exigences : un statut d’association, de fondation reconnue d’utilité publique ou de syndicat professionnel, un caractère non lucratif et une gestion désintéressée, la participation aux six missions de service public de l’enseignement supérieur : la formation initiale et continue ; la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ; l’orientation et l’insertion professionnelle ; la diffusion de la culture et l’information scientifique et technique ; la participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et la coopération internationale.
Comme le soulignait M. Michel Boyance (63), il n’y avait pas eu de loi sur ce sujet depuis 1880… Le changement est donc important. La loi s’inscrit cependant dans la même logique que les lois n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés (loi « Debré ») ou n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d’enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l’enseignement public agricole (loi « Rocard »), qui offrent une reconnaissance et un financement par l’État contractualisés en échange d’une participation aux missions de service public. Les mentalités changent mais cette forme d’enseignement supérieur privé n’est pas encore aussi familière que celle des établissements « sous contrat » ou « hors contrat » de l’enseignement du second degré, la reconnaissance par les universités publiques étant plus lente, selon lui, que celle du ministère. Ce que représente la loi ESR en matière de distinction entre le secteur privé associatif et non associatif ne semble pas être encore passé dans l’opinion. Il convient, selon lui, de garantir une forme de liberté d’établissement, défendant un caractère spécifique plutôt qu’un caractère propre, dont la forme associative est à articuler au service public.
M. Jean-Louis Vichot précisait lors de cette audition que les établissements catholiques qu’il représente inscrivent leur mission de service public dans l’objectif de rendre service aux étudiants et à leurs familles, avec ce caractère spécifique de s’intéresser à l’étudiant comme personne et pas seulement comme futur employé. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier d’une meilleure insertion, dans leur formation d’abord, professionnelle ensuite. Les résultats sont meilleurs que dans le secteur public parce que les lieux d’enseignement sont de taille modeste : les amphithéâtres de licence les plus chargés comptent 300 personnes… Dès lors, l’attractivité des formations proposées en licence et master est réelle. La faible taille des établissements les rend plus agiles et plus innovants, car ils ne sont pas soumis aux contraintes plus lourdes qui pèsent sur l’enseignement supérieur public.
Il soulignait que la proximité avec le tissu économique local est très forte et inscrite dans l’origine même des établissements. Ainsi, les établissements catholiques de Lille et de Lyon ont été créés avec l’appui du patronat local. Dès lors, il existe une véritable osmose entre les besoins de la société civile et les réponses apportées, favorable à la réussite des étudiants. Il regrettait cependant que la labellisation d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général n’ouvre pas à leurs étudiants accès aux mêmes aides publiques : aides sociales, accès aux installations sportives ou aux bibliothèques.
M. Philippe Choquet (64) rappelait que 30 ans après la loi de 1984, un tiers des ingénieurs du ministère de l’agriculture avaient reçu leur formation dans le secteur associatif privé. Les écoles de la Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif, créées par des professionnels, ont des comptes à rendre à leurs partenaires, les étudiants mais aussi leurs familles, et les entreprises. Il soulignait que cette obligation de rendre compte garantit l’efficience de la gouvernance. Écoles de management ou d’ingénieurs, mais aussi de sciences humaines et sociales, elles sont bien réparties sur le territoire national, en lien avec les collectivités locales. Il rappelait que le taux de réussite en premier cycle est remarquable, lui aussi (les échecs étant de 10 à 20 %) comme le taux de placement à l’issue de la scolarité, lié aux relations privilégiées avec le secteur privé.
Tout en précisant que la reconnaissance des écoles associatives comme établissement d’enseignement supérieur d’intérêt collectif était une vraie avancée et leur permettait d’assumer pleinement la mission de formation contrepartie de la contribution de l’État, il soulignait que la pérennité du système impliquait la garantie des financements, ce qui n’est pas le cas, bien que les étudiants ne proviennent pas de milieux plus favorisés que ceux du secteur public, les élèves ingénieurs boursiers y étant dans les mêmes proportions. Enfin, les écoles associatives ne bénéficient pas des avantages du secteur privé en matière d’aides ou de fiscalité.
B. LA RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1. Des regroupements territoriaux et des coopérations aux aspects multiples
a. Les communautés d’universités et établissements (ComUE)
L’article 62 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche définit de nouvelles modalités de coopération et de regroupement pour les établissements d’enseignement supérieur.
La volonté d’harmoniser les rôles, de mieux intégrer les différents acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’en simplifier et d’en rendre plus lisible l’organisation, n’est pas nouvelle. Les classements internationaux des universités comme celui de Shanghai ont rappelé que la mondialisation était réelle dans ce domaine aussi.
i. Les PRES et le premier programme des investissements d’avenir (PIA 1)
La loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche avait créé les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). Leur essor a accompagné l’accession des universités françaises à l’autonomie, renforcée par la loi LRU. Dans ces pôles se retrouvaient déjà l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche. En septembre 2012, on comptait 26 PRES qui regroupaient, au total, près de 60 universités et de nombreux établissements d’enseignement supérieurs : écoles d’ingénieurs, instituts d’études politiques, écoles de commerce, instituts nationaux polytechniques, grands établissements (ENSAM, Institut de physique de Grenoble, Institut de physique du globe de Paris, etc.) et centres hospitaliers.
Les PRES étaient conçus comme un instrument de promotion des établissements membres et un moyen de prendre place dans la compétition scientifique internationale. Les membres fondateurs des PRES retenus avaient choisi l’option d’une délégation de compétences sur des champs significatifs, en particulier en matière de recherche, de formations doctorales et d’international.
La coordination des études pouvait donner lieu à la délivrance d’un diplôme sous le sceau du PRES, correspondant à des formations assurées par une ou plusieurs écoles ou universités membres. Les publications scientifiques des sites étaient présentées sous la signature unique du pôle, afin d’améliorer la visibilité à l’international des productions scientifiques de ses membres.
Le choix du statut d’établissement public de coopération scientifique (EPCS) avait constitué un autre critère déterminant pour le ministère. Il était notamment le seul à permettre la délégation au PRES de la délivrance des diplômes. La délégation de compétences au PRES s’était accompagnée d’un transfert de moyens, notamment financiers et humains, des établissements fondateurs. Les PRES étaient le moyen retenu pour organiser le rapprochement entre les établissements d’un même site ou d’un large bassin. Cette structure devait permettre soit la préfiguration d’une fusion entre établissements (PRES pré-fusionnel, débouchant sur la constitution d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel), soit l’exercice en commun d’un nombre plus ou moins grand de compétences (PRES de coopération ou de mutualisation).
Les PRES, conçus comme des structures de coopération, devaient avoir un rôle de réflexion stratégique à long terme, à partir de leurs sites d’implantation, avec leurs membres et partenaires. Ils étaient les porteurs des discussions et des groupes de projets envisagés sur un site, élaborés en réponse aux différents appels à projets, dont ceux de l’Agence nationale de la recherche (ANR) nouvellement créée. Cependant, ce n’était pas une obligation et les périmètres d’établissements portant les projets pouvaient, selon les actions concernées, être différents de ceux appartenant à un PRES.
Or, c’est dans ce paysage universitaire en voie de regroupement, dans le domaine de la recherche et non de la formation, qu’est intervenue la décision du « grand emprunt », devenu le premier programme des investissements d’avenir (PIA 1).
Ce programme, né du rapport « Juppé – Rocard » de 2009, se fixe pour objectif de préparer la France aux défis de demain. Il vise à favoriser l’excellence, l’innovation et la coopération. Les universités, les instituts, les laboratoires, les équipes, les projets entrepreneuriaux et industriels sont choisis en fonction de leur excellence sur la base d’avis de jurys ou d’experts indépendants. L’innovation est nécessaire pour pouvoir bénéficier du PIA. La coopération vise à faire travailler ensemble ceux qui portent les recherche d’avenir.
Les capitaux déployés sont importants :
- en 2010, pour le PIA 1, 35 milliards d’euros, dont 22 pour la recherche et l’enseignement supérieur ;
- en 2014, pour le PIA 2, 12 milliards d’euros dont 5,4 pour la recherche et l’enseignement supérieur ;
- en 2016, pour le PIA 3 annoncé, 10 milliards d’euros dont 5,9 pour la recherche et l’enseignement supérieur.
En pratique, les initiatives d’excellence (IDEX) du PIA 1 se sont donc adressées aux PRES. Elles visaient à réunir, selon une logique de territoire, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche déjà reconnus pour leur excellence scientifique et pédagogique, afin d’obtenir un niveau d’intégration élevé capable d’assurer leur visibilité et leur attractivité à l’échelle internationale. Les IDEX devaient également se structurer autour de projets scientifiques ambitieux, en partenariat étroit avec leur environnement économique.
Les IDEX devaient jouer un rôle moteur dans la transformation et la modernisation du paysage éducatif et scientifique, en ouvrant la voie à des partenariats toujours plus étroits entre les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche. Elles disposaient pour cela d’un fonds initial de 7,7 milliards d’euros. Lors de la phase probatoire de quatre ans, une part des revenus de ce capital pouvait être versée à chaque campus sélectionné pour financer les premières dépenses liées à la mise en œuvre de son projet. Après la période probatoire, et en fonction des résultats, chaque campus labellisé devait recevoir une dotation en capital dont les revenus assureraient leur financement dans la durée. Les enjeux sont donc importants, même si, comme le constatait Mme Geneviève Fioraso (65) les montants annuels rapportés au budget d’une université ne sont pas si élevés, les fonds en capitaux n’étant pas consomptibles.
Les Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche ne remettaient pas en cause la nécessité de renforcer la coopération entre ses acteurs. Ce besoin de synergies, fondées sur un cadre territorial, était d’ailleurs déjà présent dans les réflexions des États généraux de la recherche en 2004. Mais leur traduction dans les PRES était contestée. Le rapport des Assises proposait donc de transformer les PRES en grandes universités démocratiques dotées de conseils élus, en élargissant à l’enseignement supérieur leur caractère initial de cadre partenarial de recherche.
La loi ESR a offert aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche différentes modalités, combinables entre elles, pour organiser les regroupements et coordonner leurs politiques : la fusion, la participation à une communauté d’universités et établissements (ComUE) ou l’association à l’établissement chargé de la coordination du site.
La forme de l’association est utilisée soit pour réunir des écoles autour d’une université fusionnée comme Aix-Marseille Université soit, comme le soulignait M. Michel Brazier (66), parce que les établissements souhaitant coopérer relèvent déjà d’un autre regroupement : ainsi de l’UTC (Université de technologie de Compiègne) liée à la ComUE Sorbonne Universités mais participant à l’association constituée au niveau académique autour de l’Université de Picardie Jules Verne. Il estimait en effet que l’association étant la forme la plus souple des regroupements, elle laissait une place importante au projet. Elle n’oblige pas non plus à définir des structures de gouvernance, toujours compliquées à mettre en œuvre. Les projets existent et priment. Ils peuvent être variés : la politique doctorale, ou internationale, les formations, initiales ou continues, liées aux besoins et préoccupations régionaux – agro-ressources, agroéconomie et développement des bio-raffineries dans la région Picardie.
Par souci de simplification, la loi a par ailleurs mis fin à la catégorie des établissements publics de coopération scientifique porteurs des PRES. Les nouvelles communautés d’universités et établissements sont donc des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au même titre que les universités. Ce choix a des conséquences importantes. Les missions des communautés sont celles des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et n’ont donc pas à être précisées par la loi, sauf celle relative à la coordination et seront, de fait, celles qui auront été transférées par les membres. Les organes d’administration sont rapprochés de ceux des universités, la seule différence étant due à la présence de représentants des membres au conseil d’administration. Cela aboutit à augmenter la part des élus dans le conseil d’administration et à créer un conseil académique, dont les compétences seront en partie fonction des compétences transférées. Le classement comme établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel détermine aussi le régime financier et la nature des ressources, la particularité étant l’apport des membres.
Parmi les 25 regroupements, 20 ont choisi la forme d’une ComUE. Ces regroupements se font à l’échelle académique ou inter-académique. Par dérogation, en Île-de-France et dans ses trois académies de Paris, Versailles et Créteil, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.
Les ComUE ont des compétences qui varient en fonction de celles qui leur sont transférées par les établissements membres de la communauté et que définissent leurs statuts. Certaines ComUE portent l’accréditation du doctorat, voire de certains masters et licences. Beaucoup portent un pôle pour étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (Pepite). Quelques-unes envisagent d’intégrer une école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) à titre de composante propre. La plupart ont une politique commune de signature scientifique. Certaines assurent la répartition de la part de la dotation de fonctionnement que les établissements membres consacrent à leurs structures de recherche, lancent et soutiennent des programmes de recherche ou mettent en place une structure d’appui à la recherche internationale pour permettre de mieux répondre aux appels à projets européens.
Les auditions ont montré que les acteurs s’étaient emparés assez volontiers du nouveau modèle de coopération entre établissements, sans doute dans la mesure où il ne montrait pas une rupture trop marquée avec le précédent. En outre, en pratique, leur mise en place fonctionnelle est très récente, 2015 pour la plupart des ComUE.
M. Jean-Richard Cytermann (67) a souligné que la mise en place d’une coordination territoriale est continue au fil des lois depuis 20 ans. Elles convergent vers les mêmes objectifs. Le ministère souhaite en effet un interlocuteur unique ou principal sur chaque site tout en laissant le choix des formules juridiques. Il constatait que les ComUE n’étaient finalement pas très différentes des PRES qui auraient pu être conservés si l’on en avait démocratisé la gouvernance. Il faisait remarquer que la forme de la ComUE n’était pas forcément la plus adaptée, l’université unique (en Lorraine) ou fusionnée (en Alsace) pouvant davantage convenir.
L’implantation géographique des ComUE reprend d’ailleurs largement celle des PRES qui les ont précédées, comme le montre la carte des regroupements d’établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche jointe en annexe (68) au présent rapport.
Les regroupements reproduisent assez fortement l’ancienne carte administrative régionale de la France. Or l’adoption de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le nouveau découpage régional qu’elle met en place poussent à s’interroger sur la pertinence du maintien de ces cadres territoriaux, au risque, déjà latent, de développer des mastodontes universitaires aux implantations et effectifs ingérables ou, à l’inverse, de séparer des ensembles constitués sur plusieurs nouvelles régions, comme la ComUE Université confédérale Léonard de Vinci (69).
La plupart des personnes auditionnées ont rappelé que les universités les plus prestigieuses – Stanford, Harvard, Yale, Cambridge, etc. – ne comptaient que 10 000 à 20 000 étudiants et, à l’inverse, qu’une ComUE regroupant 160 000 étudiants sur un très vaste territoire comme l’Université Bretagne Loire (70) pouvait présenter un caractère assez artificiel. M. Thierry Mandon (71) remarquait cependant que cette ComUE était en train de développer un remarquable outil numérique et pédagogique donnant accès à l’enseignement supérieur dans des territoires isolés ou à des populations défavorisées.
À cet égard, M. Vincent Berger (72) faisait remarquer que viser une ComUE par région était d’ores et déjà impossible à Paris. S’il faut éviter qu’une ComUE soit à cheval sur plusieurs régions il est possible d’en imaginer deux dans une seule région. Il lui semblait donc qu’on ne peut pas faire coïncider la carte universitaire avec celle des régions. Il suggérait de ne pas tenter de dessiner un jardin à la française idéal mais plutôt d’envisager des territoires de recherche et de formation universitaire qui s’affranchissent des divisions administratives.
Lors de son audition, M. Thierry Mandon rappelait que, de son point de vue, une ComUE doit entrer en cohérence avec de grands bassins de vie afin de permettre une coopération concrète entre les différents acteurs. M. Khaled Bouabdallah (73) soulignait, quant à lui, que la cohérence propre des ComUE n’était pas celle des régions.
Mais, parallèlement, M. Michel Brazier (74) faisait remarquer que la création de la nouvelle région des Hauts de France impliquait pour l’université de Picardie Jules Verne, qu’il préside, des partenariats avec les autres universités du Nord de la France : les universités du Littoral, d’Artois et du Valenciennois et l’Université de Lille en cours de fusion. Mais, chacune ayant ses projets, une forme plus intégrée de coopération resterait à définir.
Mme Sophie Béjean (75) soulignait que la diversité des outils dont peuvent s’emparer les opérateurs en fonction du contexte et de leurs relations est pertinente mais qu’on devait s’interroger sur la nécessité d’aller plus loin en matière de regroupements régionaux. Une ComUE « Grand Est » regroupant les universités de Champagne, de Lorraine et de Strasbourg restructurées ne lui semble pas adaptée. En revanche, il serait intéressant de coordonner la politique de site en lien avec la collectivité régionale nouvelle.
Mme Geneviève Fioraso (76) rappelait que les ComUE n’étaient pas obligatoires, mais un lieu où se retrouver, pouvant tendre à la fusion ou permettre une association. Il ne s’agissait pas d’une énième structure paralysante, mais d’un lieu de rassemblement dans le cadre d’une politique de site. La ComUE doit rester, selon elle, un organisme vivant qui peut évoluer, la réorganisation régionale en cours entraînant des regroupements de ComUE qui paraissent intéressantes. En effet, la ComUE doit pouvoir s’articuler, si elle le souhaite, avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques présents dans ses structures de gouvernance.
Cette politique de site, faisait remarquer M. Fabrice Melleray (77), n’est fondamentale que pour des universités de taille moyenne ou de petite taille, pas pour les grandes universités « en tube » qui ont autant d’étudiants en 2e cycle qu’en 1er. Paris n’a pas besoin d’une politique de site. Saclay en a besoin pour surmonter la division entre universités et grandes écoles. Bordeaux est au-delà de la taille critique et du territoire pour avoir un rayonnement international. Mais on ne peut se tourner vers le tissu économique dans toutes les disciplines par un mode de gouvernance unique. La seule solution était une déconcentration des composantes ; or le système actuel milite pour une centralisation en ComUE.
Mme Anne-Sophie Barthez (78) a relevé, quant à elle, que le remplacement des PRES par les ComUE a coûté deux ans de travail sans apporter grand-chose : il a fallu rédiger de nouveaux statuts et revenir sur des accords difficiles entre établissements. Des regroupements en ont pâti. Des trois formes de regroupement, l’association lui semble inutile, et les deux autres modèles, fédératif ou fusionnel, existaient déjà avant la loi.
M. Francis Jouanjean (79) remarquait également que certaines ComUE se sont arrêtées de travailler pendant deux ans pour mettre au point gouvernance et statuts. Des gouvernances extrêmement lourdes se sont mises en place par compromis successifs. Le lieu du pouvoir n’est pas clair : parfois le conseil des membres, parfois le conseil d’administration.
M. Pierre André Jouvet (80) a précisé que la ComUE Université Paris-Lumières (81) reposait sur une structure confédérale, sans transfert de compétences, n’ayant ni services, ni personnels propres. Les personnels des universités ont simplement des missions en lien avec la ComUE. Dès lors, cette nouvelle structure peut donner l’impression d’avoir ajouté une surcouche à un fonctionnement qui n’était déjà pas simple ; la plus grande souplesse ayant été laissée aux établissements pour définir les statuts communautaires, l’explication de l’organisation du système d’enseignement supérieur français à des universitaires étrangers ne paraît pas avoir gagné en clarté… Les instances de la ComUE se sont mises en place à la rentrée 2015. Un élément ressort cependant comme source de difficulté : l’articulation entre le conseil d’administration et le conseil académique. Le président du conseil d’administration de la ComUE n’est pas le président du conseil académique. Le mode opératoire de cette configuration est en cours d’évaluation mais si les appels à projet ont été définis en conseil d’administration, l’enveloppe correspondante a été remise au conseil académique, qui en fixe la répartition selon ses propres critères.
M. Laurent Diez (82) relevait lui aussi que les universités et les ComUE superposent des structures parallèles ; or le rajout de couches administratives ne se traduit pas par une amélioration du fonctionnement des universités. On pouvait imaginer que la ComUE devienne une entité véritable, mais en fait la ComUE se juxtapose à l’existant. Il constatait lui aussi que la lisibilité à l’étranger n’est pas améliorée : un logo aurait peut-être suffi… Rappelant que les habitants peuvent s’approprier le projet une communauté de communes, M. Jacques Douet soulignait qu’il n’en était pas de même pour une ComUE, même si la présentation du projet de loi faisait référence à ce mode de regroupement. Les distances entre les établissements peuvent être importantes, en province en particulier. Dès lors, la communauté de projet n’est pas perçue. Il faut un périmètre identifiable, une structure claire pour donner un nom à un établissement universitaire.
M. Khaled Bouabdallah (83), se référant lui aussi aux intercommunalités et rappelant qu’il défendait l’autonomie des établissements, regrettait que la loi n’ait pas défini, dans ce cas également, les compétences obligatoires et optionnelles des communautés.
M. Vincent Hoffmann-Martinot (84) a rappelé que la ComUE Aquitaine (85) a succédé au PRES Universités de Bordeaux de 2007 qui n’était pas pré-fusionnel au départ mais l’est devenu puisqu’il a conduit à la fusion de trois des quatre universités bordelaises. L’université, de métropolitaine, est devenue régionale. Constatant le peu d’implantations universitaires dans le sud aquitain, la ComUE lutte contre cette disparité. Parallèlement, l’académie de Bordeaux développe avec l’Espagne une Euro-région avec le Pays basque et la Navarre, liés par conventions avec l’université de Bordeaux. Cette internationalisation est très importante. Une ComUE de six membres comme celle-ci est plus gérable que celles qui ont 15 ou 20 membres, permettant un équilibre entre universités et écoles. Or, beaucoup de partenaires souhaitent entrer dans la ComUE pour développer l’enseignement et la recherche à l’échelle de la région, ce qui suscite des interrogations.
M. Hoffmann-Martinot soulignait que, si la ComUE Aquitaine s’est mise en place tardivement, ses statuts ayant été approuvés en mars 2015, l’année de transition a permis la mise en place de l’université fusionnée de Bordeaux. Il convenait en effet que les deux réformes qui se sont succédées ne se heurtent pas. La nouvelle université avait besoin de se stabiliser avant de se projeter dans l’espace régional. En revanche, il constatait que la création de la nouvelle grande région Aquitaine n’est pas encore intégrée dans le plan de développement de la ComUE, tout en souhaitant un rapprochement entre les ComUE Aquitaine et l’Université fédérale Léonard de Vinci. Afin de ne pas ajouter une couche bureaucratique au système déjà lourd des gouvernances d’établissements, il a été préféré pour la ComUE une structure de coordination légère, de mission plus que de gestion. Il souhaitait, dès lors, que le régime juridique des ComUE et des universités, qui ont la même forme d’établissement public, harmonise les conditions d’appartenance des représentants des personnels à plusieurs conseils.
Pour Paris Sciences et lettres (PSL), M. Thierry Coulhon rappelait que l’impact socio-économique des réformes est durable puisqu’il s’agit de fonder des universités de classe mondiale, mais que chaque projet a ses caractéristiques propres. Ainsi, le paysage de l’enseignement supérieur connaît à la fois une simplification et une diversification. Certaines communautés s’articulent très fortement autour de l’université – c’est le cas de Paris Saclay avec l’université de Paris Sud. Mais PSL est une petite communauté, avec 18 500 étudiants et 3 500 enseignants-chercheurs. Petite structure au niveau français elle est d’un niveau normal au plan international, comparable aux universités américaines comme Harvard, par exemple. Elle suit un schéma classique que l’on retrouve à New York University, Columbia ou Cambridge : « on choisit nos étudiants qui nous choisissent ». Pour recruter des talents, il vaut mieux les choisir, suivant une gamme d’aptitudes. La présence en son sein d’écoles très différentes donne à la ComUE un caractère unique en France. Elle est sous multitutelle (86). La grande diversité des institutions membres permet cependant un modèle dont la pertinence est démontrée par des indicateurs chiffrés : cette configuration se traduit par un accroissement des résultats, comme le nombre des contrats ERC (European Research Council). Une simulation de la place de cet ensemble suivant la méthodologie du classement de Shanghai serait significative, le situant au 25e rang et Saclay au 26e. La croissance de l’ensemble universitaire repose sur des interactions qui n’auraient pas pu intervenir dans la configuration précédente, comme des croisements de recherches entre l’ENS, l’ESPCI, Chimie Paris Tech et l’institut Curie dans le domaine de la physique et de la chimie appliquées au vivant. PSL apporte de la visibilité et la conscience d’appartenir à un même ensemble et permet de faire apparaître des études qui ne seraient pas apparues sans elle, comme une école de la mode à Paris à la demande de l’École des Arts décoratifs, associant l’École des mines, pour les industries du luxe, et Dauphine, pour le management.
M. Gilles Bloch (87) a rappelé que Paris-Saclay (88), ComUE depuis janvier 2015, est un jeune établissement : vouloir construire une université de rang international à partir de 18 établissements relevant de trois catégories – des universités, des grandes écoles dont Polytechnique et HEC, et des organismes de recherche, dont le CNRS – n’était pas le choix initial mais une adaptation aux exigences de la loi. Il faut préparer des décisions et lancer des chantiers à 18. Pour y parvenir, le principe d’un conseil d’administration resserré a été longuement débattu mais en 2 heures et demie, il semble possible de faire ce qui prend une journée ailleurs. Ses 26 membres comprennent 10 représentants des établissements (avec une rotation biannuelle ; le CNRS, le CEA et l’université de Paris-Sud ont un siège permanent), 10 élus et 6 personnalités qualifiées. Cette instance centrale est équilibrée et efficace, puisqu’à sa sixième réunion, elle conserve un bon niveau d’assiduité.
Le conseil des membres, qui réunit les 18 établissements, prépare les décisions importantes et la transition, conformément à l’IDEX, vers une autre forme d’organisation. Son importance est réelle et il importe que le conseil d’administration ne soit pas vécu comme une chambre d’enregistrement des décisions du conseil des membres.
Le conseil académique de Paris-Saclay comprend 220 membres représentant les personnels et les étudiants, dont 24 personnalités extérieures et 40 représentants des établissements. La ComUE développant 15 % de la RD nationale, le conseil académique est sa boussole.
Mais M. Gilles Bloch rappelait qu’une grande université à l’européenne ayant conservé le rôle social d’accueil d’une classe de bacheliers sans sélection à l’entrée en licence ne gagne pas à avoir un patron d’entreprise dans ses conseils, puisqu’il risque d’y perdre beaucoup de temps. À cette préoccupation, Paris Saclay a répondu en créant un conseil stratégique, scientifique et d’innovation afin d’attirer des patrons de haut niveau sur des séances bien préparées avec des questions précises et un agenda maîtrisé.
Dès lors, faut-il aller plus loin et, comme le suggérait certains lors des auditions, séparer la gestion d’une ComUE, qui serait confiée à un manager, de sa direction académique, dévolue à un universitaire ?
M. Franck Bournois (89) faisait à cet égard remarquer qu’une enquête de notoriété sur les ComUE serait décevante auprès des dirigeants d’entreprise. Les entreprises n’ont pas intérêt à s’investir dans l’administration d’une ComUE : leurs échelles de transformation de plus en plus courtes ne leur permettent plus de s’investir sur 10 ou 15 ans et elles ne peuvent déléguer dans les conseils d’administration des ComUE que des passeurs, non des décideurs. Il soulignait que les patrons, issus le plus souvent des grandes écoles, participent aux réseaux d’anciens et ne sont pas liés aux universités ; il faut donc attendre un changement sociologique sur le long terme.
iii. Les grands organismes de recherche dans les ComUE
Mme Anne Peyroche (90) a précisé que le CNRS n’avait pas d’avis à donner sur la gouvernance et l’autonomie des universités, mais qu’avaient été fêtés en janvier 2016 les 60 ans de la création d’un premier laboratoire mixte à l’université de Paris Sud (Orsay), la plupart de ses laboratoires l’étant désormais. Sa politique de site conduit le CNRS à lier ses missions nationales à un ancrage territorial marqué par des partenariats qui dépassent les unités mixtes de recherche, en vue de former de grandes universités de recherche multidisciplinaire ayant un rayonnement international. Le CNRS est membre de 14 ComUE sur 20 et travaille avec les 3 universités fusionnées dans le cadre piloté par une IDEX.
Mme Peyroche a précisé que là où le projet scientifique n’était pas au cœur de la ComUE, le CNRS n’intervient que dans les unités mixtes de recherche. Les organismes nationaux de recherche se sont concertés pour tenir une même stratégie à l’égard des ComUE. Les 10 directeurs d’instituts disciplinaires du CNRS ont nommé un directeur scientifique référent pour les sites universitaires importants pour leurs départements.
M. Vincent Berger a également souligné que les organismes de recherche ont, depuis toujours, une politique différenciée à l’égard des universités, toutes n’ayant pas les mêmes missions ni les mêmes activités. En 2012, on ne s’autorisait pas parler à parler d’université de recherche. Cette spécialisation est désormais acceptée parce qu’elle correspond à la vérité. Le CNRS dépense beaucoup plus à Paris Saclay que dans le dernier décile des universités. Il faut des moyens d’évaluation et des financements différenciés par université. Des logiques de « cluster » s’imposent. Il est de l’intérêt de tous que ces sites soient visibles à l’étranger pour attirer les meilleurs étudiants. Il convient donc d’éviter de multiplier les étiquettes mais plutôt de mettre en place des bannières par région ou par site, comme le plateau de Saclay, qui dispose d’une concentration exceptionnelle d’établissements et de structures de recherche.
C’est dans le cadre des ComUE succédant aux PRES qu’il faut apprécier les recommandations présentées à l’issue de la session tenue du 25 au 29 avril 2016 par le jury international Initiatives d’excellence (IDEX) présidé par M. Jean-Marc Rapp, professeur à l’université de Lausanne. Le jury avait, entre autres, à évaluer les 8 IDEX sélectionnées en 2011-2012 lors du premier programme d’investissements d’avenir (PIA 1) et précisément attribuées à des établissements qui revêtaient alors la forme de PRES.
Pour M. Jean-Richard Cytermann (91) les programmes d’investissements d’avenir ont en effet traversé les projets des nouveaux regroupements et des gouvernances les accompagnant. Il regrette, comme Mme Geneviève Fioraso (92), que le Commissariat général à l’investissement n’articule pas toujours de façon optimale ses orientations avec celles du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Dès lors, la validation de la poursuite des IDEX ou leur renouvellement devient un test de solidité de la construction communautaire, certaines ComUE risquant de se défaire en cas d’échec, chaque acteur préférant retrouver son autonomie.
L’évaluation des IDEX par le jury s’est déroulée à l’issue de la période probatoire qui donnait aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche portant les Initiatives d’excellence le temps et la possibilité de faire la preuve de la crédibilité de leur projet et de l’atteinte de l’objectif : constituer une université de recherche de rayonnement mondial disposant d’une puissance et d’un impact scientifique de tout premier plan dans une palette étendue de champs de la connaissance. C’est sur la base de ces orientations qu’ont été organisés les travaux du jury international et que celui-ci a établi ses propositions, au vu des trois possibilités ouvertes : la confirmation du projet ; la reconduction de la période probatoire ; l’arrêt du projet.
Les IDEX « A*MIDEX » (Aix-Marseille), « IDEX Bordeaux » et « UNISTRA » (Strasbourg) sont confirmées et bénéficieront sans limitation de durée des financements annuels qui leur avaient été accordés lors de la sélection initiale. Le jury a proposé la confirmation définitive des IDEX pour lesquels il a estimé que la dynamique de constitution d’une université de recherche au standard international avait été clairement engagée et avait obtenu des résultats convaincants, et que cette dynamique était irréversible. Cette proposition s’accompagne de recommandations aux acteurs visant à conforter leur dynamique de transformation.
M. Vincent Hoffmann-Martinot (93) rappelait qu’il avait dû arbitrer entre un choix métropolitain et un choix régional, avec des objectifs politiques différents. L’IDEX est métropolitaine, portée par l’université de Bordeaux, ainsi que les investissements d’avenir dans les grands instruments de recherche. Mais les universités et les écoles ont des antennes sur l’ensemble du territoire régional. À Bayonne, deux universités sont présentes. Il faut donc associer les collectivités territoriales, y compris les conseils départementaux, à la politique de site de la ComUE d’Aquitaine qui trouve là son rôle.
Les IDEX « Paris Sciences et Lettres », « Sorbonne Universités » et « Université Paris Saclay » voient leur période probatoire renouvelée par le jury. Sorbonne Universités (94) s’est engagée dans une fusion qui devrait être réalisée en janvier 2018.
Le jury précise que les universités Paris Saclay et Paris Sciences et Lettres ont à concevoir un modèle intégré d’organisation leur permettant notamment d’être pleinement visibles au niveau international et d’apparaître en tant que telles au sein des différents classements existants. Dans les deux cas, des modèles originaux sont à concevoir qui préservent l’excellence d’institutions souvent très fortement marquées par l’histoire tout en se projetant dans une organisation comparable à ce qui fait une université de recherche internationale de premier rang.
À cette fin, le Gouvernement s’est engagé à accompagner les acteurs dans leur réflexion organisationnelle rassemblant universités, grandes écoles et organismes de recherche, en examinant les possibilités d’expérimentation et d’adaptation du cadre juridique qui seraient nécessaires en fonction des propositions des acteurs.
Pour Paris Saclay, M. Gilles Bloch (95) rappelait que la période probatoire de quatre ans avait été marquée par des jalons contractuels et un énorme travail, commencé par son prédécesseur. Un seul doctorat est établi pour tous les étudiants et mille parcours de masters ont été mis en commun. La ComUE est une constellation d’entités indépendantes mais l’espace commun de production de 10 000 articles annuels. Les engagements pris envers l’État en vue de construire une seule université reconnue dans les classements internationaux ont été tenus, mais la ComUE reste insuffisamment intégrée pour apparaître dans ces classements. Il faut prendre des décisions d’évolution qui vont mettre à l’épreuve la gouvernance. Le nouvel objectif de fusion en 2020 devrait garantir le classement. Mais force est de constater que les transformations d’établissements publics se heurtent à de fortes résistances culturelles, contrairement aux fusions d’entreprises. Il devrait être possible de définir d’ici 5 ans un noyau portant la marque de la nouvelle université et prévoir autant de temps pour que des écoles, qui ne sont pas dans cette dynamique et se contentent de bénéficier des avantages du site et de la ComUE, rejoignent ce noyau.
M. Jacques Bittoun (96) craignait quant à lui que 5 à 10 ans ne soient trop courts. Il suggérait de proposer, pour le prochain contrat quinquennal de 2020, un dossier présentant une forme juridique nouvelle unissant une université visible à l’international et des grandes écoles autonomes.
Pour Paris Sciences et Lettres, M. Thierry Coulhon (97) relevait que les IDEX et leur articulation avec la loi ESR posaient trois questions : le périmètre, la gouvernance et le rapport avec l’État par la contractualisation. Le périmètre a été maintenu, les PRES conduisant aux ComUE ; la gouvernance suit une direction depuis la loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche, la loi LRU et la loi ESR. Deux problématiques se rencontrent : le « plan campus » autour des établissements pour PSL, la montagne Sainte Geneviève et le site de Dauphine ; les Laboratoires d’excellence (LABEX) et les financements qui les accompagnent, avec 25 millions d’euros par an, soit 3 % de 880 millions d’euros en budget consolidé. Les établissements qui composent la ComUE ont la conviction qu’ils sont trop petits pour atteindre le niveau de rayonnement international qui correspond à leur capacité réelle, tout en faisant un choix de complémentarité et de coopération qui aurait été possible mais ne se faisait pas. La ComUE est une institution qui crée un cercle de confiance au quotidien.
PSL a bénéficié de la première vague IDEX initialement portée par une fondation de coopération scientifique (FCS) qui ne pouvait pas diplômer. L’outil ComUE semble plus adapté à ses responsables en termes de gouvernance et de périmètre, mais ils jugent que les coûts de transaction ont été importants et souhaitent que les évolutions ultérieures de l’outil soient plus légères. La dualité actuelle leur paraît cependant vivable. Les souplesses d’une fondation de coopération scientifique sont indispensables, car l’instrument ComUE reste peu agile. Si la ComUE évoluait, on pourrait imaginer que la FCS s’occupe uniquement de valorisation de la recherche et de levées de fonds, devenant un instrument de l’établissement public, alors qu’aujourd’hui la ComUE n’est que l’outil diplômant de la FCS. Les missions de chacun sont donc en voie de rééquilibrage et devraient permettre la mise en place d’une gouvernance unique.
L’essentiel repose sur la rencontre entre le processus IDEX et l’évolution nécessaire de la ComUE. Le rapport du jury, au mot près le même pour Saclay et PSL, note les évolutions positives intervenues depuis 2015, mais demande que dans 18 mois soient présentés un modèle institutionnel et l’accord des membres à législation constante ou suggérée. Le charme de la proposition, pour M. Thierry Coulhon, est que tout est à créer en matière d’outils, dans un délai très contraint. Il entend donc proposer avec M. Gilles Bloch un schéma commun le plus simple et clair possible. Une partie de l’effort a déjà été consentie par les établissements membres, suffisamment engagés pour ne pas renoncer face à cette épreuve supplémentaire.
Se dessinent alors trois perspectives : faire évoluer la législation, encourager et renforcer l’engagement des établissements, tout en prenant en compte les difficultés qu’ils vont rencontrer, et faire remarquer qu’en 18 mois, il est impossible d’envisager des changements irréalistes.
En matière d’évolution législative, une plus grande flexibilité a été souhaitée, par exemple dans la définition d’un « grand établissement », voie quasi fermée par l’article 58 (article L. 717-1 du code de l’éducation) de la loi ESR et les conditions qu’il fixe en matière d’ancienneté et de diplômes dispensés. La même souplesse devrait être recherchée en matière de composition des conseils, de recrutement, de sélection et de droits d’inscription, qui devraient être affirmés au niveau de PSL et pas des seuls établissements qui la composent, alors que des doctorats ont déjà été transférés à PSL et que certaines licences lui sont propres. La question sera encore plus aiguë si des voies alternatives aux écoles d’ingénieurs se développent. PSL repose sur l’engagement d’établissements qui ont une stratégie forte, comme l’engagement international permettant de passer des accords entre l’ensemble coopératif PSL et des universités comme Cambridge ou Columbia.
À la différence de Paris Saclay, la ComUE PSL considère qu’il importe de conserver deux niveaux de personnalités morale et juridique : les établissements membres doivent conservent les leurs. Ce n’est pas si différent de Cambridge, par exemple, où le Chancellor a un pouvoir important mais les Schools et Colleges aussi… Le jeu institutionnel est un jeu d’équilibre. Il serait ainsi possible de résoudre la question de la force des composantes des regroupements, impensé du système issu des différentes lois sur l’enseignement supérieur et la recherche.
Les IDEX « UNITI - Université de Toulouse » (98) et « Université Sorbonne Paris Cité » (99) sont arrêtées. Le jury a estimé que l’objectif IDEX était impossible à atteindre sans une dynamique réellement nouvelle et des mesures de rupture. Il a considéré qu’on ne pouvait observer une adhésion des acteurs à une démarche de transformation conduisant à une université de recherche intégrée, visible au plan international et reconnue comme telle.
Cette situation montre la difficulté de réussir, dès la première tentative et dans un bref délai, le processus visant à constituer une université de recherche. La politique de structuration conduite par l’État ne s’achève pas avec l’évaluation des IDEX et s’inscrit dans un temps long. Le troisième programme d’investissements d’avenir devrait notamment créer de nouvelles opportunités pour faire reconnaître l’excellence de la recherche et de la formation sur les sites concernés.
Mme Christine Clerici (100) rappelait que la création même du regroupement « Université Sorbonne Paris Cité », la ComUE succédant au PRES, avait été motivée par une IDEX qui devait le conduire vers une université unifiée par la fusion de ses composantes. Or la loi ESR permettant de bâtir une ComUE sur une structure confédérale et de ne pas fusionner des communautés qui n’étaient pas prêtes à le faire, ce choix a été retenu par ses membres, mais sanctionné par le jury. Pourtant, le temps de la ComUE a permis à ses composantes d’apprendre à constituer des programmes de recherche ou d’enjeux sociétaux et des services partagés de formation pédagogique pour les enseignants-chercheurs, d’offrir des bourses de master avec des mobilités, de créer un collège doctoral intégré. Cette intégration du bas vers le haut a suscité une adhésion qui satisfait et il n’existait paradoxalement plus d’opposition à l’IDEX.
De même, M. Stéphane Leymarie (101) remarquait que les ambitions en matière de politiques de site, visant à contractualiser avec un seul site et à harmoniser l’offre de formation, n’imposaient pas le recours au statut de ComUE. Créant des redondances de statuts universitaires, elles étaient en réalité, selon lui, à comprendre comme pré-fusionnelles. Le jury international du PIA ne se préoccupe pas des questions de gouvernance mais elles semblent pourtant jour un rôle essentiel dans l’attribution ou la confortation des IDEX. La ComUE Université de Toulouse avait une structure fédérale approuvée par le CNESER pour sa qualité scientifique, mais semble avoir été précisément sanctionné pour cette démarche, M. Francis Jouanjean (102) soulignant lui aussi que, du point de vue des écoles, le fonctionnement fédératif de la ComUE Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées était pleinement satisfaisant.
À l’inverse, certains, comme Mme Barthez (103), regrettaient que seul compte l’avis d’un jury international jugeant le potentiel de recherche, celui-ci étant forcément faible dans une ComUE ne comptant qu’une seule université, et qu’il ne soit pas davantage pris en considération d’autres aspects positifs, dus aux rapprochements des établissements la composant.
M. Philippe Tchamitchian (104) présentait le cas atypique de la ComUE Université Paris-Est. Elle a répondu à l’appel à projet des I-SITE du PIA 2, pour les universités qui valorisent des atouts scientifiques thématiques plus concentrés, distinctifs, reconnus sur le plan international, et qui en font un levier d’entraînement et un point d’appui de leur stratégie de développement et de partenariat avec le monde économique.
Mais le projet de la ComUE Université Paris Est n’a pas été retenu. Or les évolutions institutionnelles demandées sont difficiles parce que les établissements qui composent la ComUE dépendent de plusieurs ministères (agriculture, environnement, culture, santé) dont les politiques ne sont pas mises en cohérence. Dès lors, développer une stratégie de recherche internationale suppose une solution fédérale, puisqu’une fusion est inenvisageable alors que la gestion des statuts et des corps académiques relevant de tutelles multiples n’est pas unifiée. Il est en outre impossible de sélectionner les profils scientifiques dont la politique de recherche aurait besoin et donc d’avoir une politique commune de recrutement et d’emploi scientifique.
Le jury de l’appel à projets IDEX - I-SITE a cependant admis les projets présentés par une université qui n’entre pas dans les catégories de la législation française actuelle, donc juridiquement infaisables. Aussi Université Paris-Est a proposé d’unir la ComUE et l’université dans un établissement à imaginer qui garderait un caractère fédéral, exigé par les écoles, et donnerait un pouvoir de décision au conseil académique, ce que ne permet pas la loi. C’est en effet la seule instance qui dispose d’une vision d’ensemble de la politique de recherche à l’échelle du site : le conseil d’administration n’est pas adapté. M. Philippe Tchamitchian remarquait que de telles constructions devraient prolonger la piste ouverte par les ComUE d’une intégration qui ne soit pas une fusion.
M. Khaled Bouabdallah (105) soulignait lui aussi que les modèles proposés depuis dix ans en matière de regroupements avaient été mouvants et qu’il y avait une contradiction entre les prescriptions strictes sur l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche, fixées en contrepartie des moyens attribués dans le cadre des PIA, et la diversité des formes, dont les ComUE, qu’ils pouvaient pourtant, selon la loi, revêtir.
Lors de son audition, M. Thierry Mandon (106) précisait qu’une lettre commune du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et du commissariat général à l’investissement, avant le deuxième appel à projet du PIA 2, cadrerait davantage les aspects et les contraintes institutionnelles et rappellerait qu’il ne faut pas s’enfermer dans la vision erronée d’un modèle unique. Il constatait, par ailleurs, que le cadre des ComUE est volontairement très souple, y compris au plan juridique. Il pourrait être amélioré et tendre par exemple vers des « ComUE plus ». Un rapport de l’IGAENR rendu cet automne devrait faire des propositions législatives dans ce domaine.
b. La place des grandes écoles et des grands établissements dans les ComUE
L’intégration des grandes écoles et des grands établissements dans les ComUE pose un certain nombre de questions, qui ne peuvent se résumer à un choix d’opportunité. Conserver un caractère spécifique, fondé sur une intégration professionnelle forte et un recrutement sélectif, tout en se rapprochant des universités ouvertes à tout bachelier et tendant à proposer un cycle d’études tourné vers la recherche, suppose de lever des obstacles qui ne relèvent pas tous de la législation.
M. Francis Jouanjean (107) remarquait que les relations entre les grandes écoles et les universités ne sont plus si compliquées. Ainsi, depuis 25 ans, un partenariat étroit existe dans le domaine de la recherche, alors que la recherche dans les écoles d’ingénieurs était peu importante jusque dans les années 1990. Parallèlement, les écoles délivrent chaque année 40 % des diplômes de grade master.
La mise en place des PRES a conforté cette activité recherche. La loi ESR devait permettre de franchir une étape, pour homogénéiser les rapprochements. Or, les ComUE, présentées initialement comme devant favoriser l’ouverture et le décloisonnement, la connaissance et l’innovation, forment des ensembles extrêmement divers, dont l’efficacité ne l’est pas moins. L’ensemble donne l’impression d’avoir superposé des réflexions institutionnelles, organisationnelles et de recherche. Rappelant que les ComUE comptent souvent un nombre très élevé d’étudiants au regard des critères des grandes universités de recherche internationales, M. Jouanjean soulignait que les écoles étaient, quant à elles, plus agiles, plus adaptables aux besoins des entreprises et du monde socio-économique.
Il remarquait que l’intégration des écoles dans les ComUE était inversement proportionnelle à la taille de cette dernière. Pour une petite école, les coûts de transaction sont colossaux alors que les avantages, en termes de services communs, de guichets uniques, de cartes d’étudiant pour tous existaient déjà avec les PRES. Cette faible valeur ajoutée peut néanmoins être réelle si le président de la ComUE n’oublie pas sa petite école et la conforte dans ses relations avec les collectivités territoriales. Il importe donc que la ComUE ne se comporte pas comme un magma absorbant toutes ses composantes.
Il rappelait que le modèle des grandes écoles n’était pas spécifique à la France : à la taille près, c’est le modèle le plus courant fondé sur le triptyque, recherche, formation et entreprises, avec l’innovation, l’ouverture à l’international et une gouvernance agile. Dans d’autres pays, une grande école s’appellerait université.
Il s’interrogeait cependant sur la création des écoles universitaires de recherche prévue par le troisième programme des investissements d’avenir (PIA3). Pour ses promoteurs, cette action vise à offrir à chaque site universitaire la possibilité de renforcer l’impact et l’attractivité internationale de sa recherche dans un domaine scientifique, par une école réunissant des formations de master et de doctorat ainsi qu’un ou des laboratoires de recherche de très haut niveau – une version française des graduate schools.
M. Jouanjean (108) se demandait, plus largement, si le foisonnement de concepts qui caractérise les actions du PIA3 est vraiment compatible avec l’agilité de la gouvernance et une meilleure articulation entre universités, grandes écoles et organismes de recherche qui était l’objectif de la loi.
M. Marc Mézard (109), auditionné avec les responsables de la ComUE PSL, soulignait que le modèle international est un enjeu pour tous les directeurs d’établissement. C’est dans ce cadre que réunir universités, arts et ingénierie prend son sens. Le défi reste de disposer d’un cadre qui permette cette réunion dans une gouvernance intégrée de structures différentes par la taille, la pratique ou les tutelles qui peuvent être une régie municipale, les ministères de la culture ou de l’industrie. L’engagement de l’École normale supérieure (ENS) dans la ComUE est entièrement motivé par la question de la reconnaissance internationale : il est exclu de figurer dans les 30 premiers établissements universitaires mondiaux avec 2 400 étudiants. En outre, la coopération entre les membres potentialise ce qu’on fait. En retour, la visibilité renforce l’attractivité internationale : on sait assez bien recruter les meilleurs étudiants en France, mais pas dans le monde entier. L’étudiant très brillant de Princeton ou de Shanghai n’a pas l’ENS comme perspective. L’université de recherche qu’est la ComUE est donc une réponse, malgré ses lourdeurs.
Les ComUE et le recrutement des enseignants-chercheurs
Pour M. Marc Mézard (110), en effet, le recrutement des professeurs repose sur un parcours bureaucratique très contraint aux étapes multiples, qui oblige à constituer des commissions et à réunir des conseils, le processus prenant six mois mais les recrutés passant, au total, 15 minutes avec la commission qui les recrute. À titre de comparaison il a passé une journée entière avec un futur professeur recruté à Stanford. L’un des enjeux de la création d’une université de recherche est de susciter la confiance qui permettra de définir de façon autonome les modalités des recrutements, ce dont les établissements se sentent capables dans toutes leurs disciplines.
Partageant cet avis, M. Khaled Bouabdallah (111) ajoutait que la liberté et la responsabilité de recrutement obligent aussi à assumer l’évaluation des mauvais choix. Mais, lors de la même audition, M. Jean-Loup Salzmann remarquait que l’existence de corps d’emploi nationaux s’opposait à une plus grande déconcentration de la masse salariale et des recrutements, conduisant à des solutions qui ne peuvent qu’être insatisfaisantes.
M. Bruno Mantovani (112) relevait que ce besoin d’une plus grande liberté en matière de recrutements était particulièrement vrai dans le domaine artistique, alors que le cachet d’un concert est supérieur à six mois de salaire dans quelque établissement d’enseignement que ce soit.
M. Christian Lerminiaux faisait remarquer lors de la même audition que le problème se posait également avec les contrats ERC (European Research Council / Conseil européen de la recherche) attribués à des chercheurs européens, qui en disposent comme ils l’entendent. Un chercheur français ou établi en France au moment où il l’obtient reste ou part à l’étranger aussi en fonction de la situation qui lui est faite. À l’inverse, le mode de rémunération ne permet pas d’attirer des chercheurs bénéficiant de contrats ERC. Les chercheurs français ne partent pas fréquemment, mais le bilan global reste négatif. Il a donc été nécessaire de mettre en place un système de tenure track (113) afin de stabiliser les carrières des contractuels internationaux et de les recruter avec un titre de professeur. Pour autant, certains obstacles subsistent, un contractuel ne pouvant pas, par exemple, candidater à l’Institut universitaire de France ou être assimilé aux professeurs pour les élections aux conseils.
2. Les universités et l’autonomie
a. Les nouvelles structures de gouvernance
La loi se fixait comme objectif de simplifier et de démocratiser la gouvernance des universités. L’architecture institutionnelle issue de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, maintenue par la loi LRU, reposait sur un président d’université, un conseil d’administration, un conseil scientifique et un conseil de des études et de la vie universitaire.
La loi ESR simplifiait l’élection du président, désormais confiée au seul conseil d’administration. L’article L. 712-2 du code de l’éducation était modifié en ce sens, disposant désormais que « Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois. » Tous les membres, y compris les personnalités extérieures non élues, mais désignées, participent désormais à son élection.
Le conseil d’administration à la collégialité renforcée devait être recentré sur ses fonctions stratégiques. Sa composition définie par l’article L. 712-3 prévoit qu’il « comprend de vingt-quatre à trente-six membres ainsi répartis : 1° De huit à seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ; 2° Huit personnalités extérieures à l’établissement ; 3° Quatre ou six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ; 4° Quatre ou six représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement. »
Les deux conseils consultatifs – le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire – étaient remplacés par un conseil académique reprenant leurs attributions. Celui-ci regroupe les membres de deux nouvelles commissions, la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire.
La question des personnes qualifiées et de leur participation à l’élection du président du conseil d’administration a été régulièrement évoquée lors des auditions.
M. Jean-Loup Salzmann (114) a rappelé que la Conférence des présidents d’université était opposée à la participation des personnalités extérieures à l’élection du président, qui existait avant la loi LRU et depuis la loi ESR. Il soulignait que cette pratique n’existait nulle part ailleurs. Soit l’État nomme les membres du conseil d’administration, soit ils sont tous élus. Les personnalités qualifiées sont désignées mais électrices. Le mode de blocage a simplement changé, passant des incertitudes liées à la gouvernance par les pairs à celles liées au choix des personnalités extérieures.
M. Jacques Bittoun (115) faisait remarquer que la loi ESR voulait revenir sur les pouvoirs de « super-président » d’université, jugés abusifs. Mais il estimait que l’on était allé trop loin dans l’autre sens.
Mme Christine Clerici (116) rappelait que l’université Paris Diderot était la première à avoir mis en œuvre la loi après sa promulgation en juillet 2013, après la démission de son président en septembre. Elle a, elle-même, été élue en mai 2014 suivant les nouvelles règles électorales. Elle faisait remarquer que l’impact de la loi sur la composition des conseils d’administration portait non sur les personnels enseignants-chercheurs mais sur les personnalités extérieures. La liste majoritaire cherchait auparavant des personnes en lien avec le monde universitaire, venant en appui de sa majorité ; or les contraintes fixées par la loi en matière de choix et l’appel à candidatures officiel ont suscité des candidatures dont le lien avec les majorités et les oppositions dans l’université n’est pas connu. Dès lors, les personnalités qualifiées peuvent faire basculer les votes de façon inattendue. Les personnalités extérieures risquent ainsi d’affaiblir la légitimité de la stratégie des présidents d’université au lieu de la conforter. En outre, les problèmes d’assiduité ont été, eux-aussi, mal anticipés. La forme et l’objet des débats en conseil d’administration ne sont pas toujours en adéquation avec les préoccupations de personnalités disposant d’un temps généralement limité.
Plus largement, Mme Clerici soulignait qu’il importe que les personnalités qualifiées s’impliquent dans la stratégie du président de l’université à l’élection duquel elles participent, comme le font les administrateurs d’une entreprise – si l’on accepte le principe de l’université autonome –, donc qu’elles le stimulent mais ne fassent pas bloc contre lui.
Elle remarquait que les deux commissions du conseil académique
– formation et vie universitaire et recherche – sont calquées sur les sénats des universités américaines. En France, les présidents de conseil d’administration sont devenus président du conseil académique et les réunissent peu pour éviter de les mettre en concurrence avec les conférences académiques. L’article L. 712-4, dans sa rédaction issue de la loi ESR, dispose en effet que « les statuts de l’université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d’administration de l’université », ce qui est le cas général.
Le conseil académique n’a pas d’obligations ou d’objectifs précis, mais il convient de remarquer que les sujets portant sur les enseignements ne s’adressent pas aux mêmes publics que ceux portant sur les programmes de recherche fondamentale.
M. Pierre-André Jouvet (117) a fait observer que ce changement radical de gouvernance était souvent intervenu en cours de mandat pour un certain nombre de présidents d’université. Des difficultés ont surgi, liées au transfert vers le conseil académique des attributions du conseil d’administration restreint qui gérait les carrières et les évaluations des enseignants. Ces changements de compétences ont impliqué l’intervention d’élus dont le mandat n’était pas d’intervenir dans les carrières de leurs collègues, étant soit spécialistes de la recherche soit compétents en matière de pédagogie. Il eût été préférable que la loi s’appliquât à l’issue de l’élection des nouveaux conseils et non en cours de mandat.
M. Jean-Richard Cytermann (118) jugeait lui aussi la composition du conseil académique plus compliquée que ce qui était souhaitable.
M. Jean-François Balaudé précisait cependant que, dans le cadre de son nouveau mandat de président de l’université de Paris Ouest Nanterre, allait être créée une vice-présidence chargée du conseil des directeurs, sur le modèle des vice-présidences statutaires chargées du conseil d’administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire. Il s’agit de mettre en place une cogestion participative avec les directeurs d’unité de formation et de recherche (UFR) afin de permettre une forte implication des directions et des échanges plus intenses. La systématisation des instances par la loi est utile pour atteindre l’objectif d’une gestion commune d’une université autonome.
Comme cela a été remarqué, les ComUE ont pu apparaître comme un cadre pré-fusionnel, en particulier dans le cas où elles accueillaient des IDEX attribuées aux PRES qui les précédaient, même si rien dans la loi ESR ne les conduisait formellement à fusionner. D’ores et déjà ont fusionné les universités de Strasbourg (fusion des Universités Strasbourg-I, II et III), d’Aix-Marseille (fusion des Universités d’Aix-Marseille-I, II et III), de Lorraine sous la forme d’un grand établissement (fusion de l’Institut national polytechnique de Lorraine, de l’Université de Metz et des Universités Nancy-I et II), de Bordeaux (fusion des Université Bordeaux-I, II et IV), Montpellier (fusion des universités Montpellier-I et II), Grenoble (fusion des universités Grenoble-I, II et III). Suivront les universités de Clermont-Ferrand et de Lille.
La fusion entre les universités de Créteil et de Marne-la-Vallée, programmée dans le cadre de la ComUE de Paris-Est, est suspendue. Celle déjà évoquée des universités composant la ComUE Sorbonne-Paris-Cité (Sorbonne Nouvelle, Paris-Descartes, Paris-Diderot et Paris 13) a été relancée par les appréciations du jury de l’IDEX d’avril 2016.
À cet égard, Mme Christine Clerici (119) précisait que sa vision avait évolué depuis qu’elle était présidente de l’université Paris-Diderot : elle est devenue favorable à la fusion, qui ne saurait cependant être un modèle unique, en dépit de la peur d’une perte d’identité des établissements qu’elle suscite. Il n’est pas simple d’expliquer aux enseignants-chercheurs l’intérêt d’une seule université fusionnée. Ceux qui ont participé à l’ouverture de cette université à l’identité très particulière, en 1970, ne l’admettent pas facilement. En revanche, la fusion devrait s’adresser non seulement aux 4 universités de la ComUE mais aussi, comme à Strasbourg, aux 4 établissements associés : l’École des hautes études en santé publique (EHESP), Sciences Po, l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) et l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Elle faisait remarquer que les liens entre les établissements avaient aussi été fondés sur l’IDEX partagée.
Dès lors, la remise en cause de l’IDEX au printemps 2016 peut conduire soit à les distendre – chacun reprenant son autonomie –, soit à les renforcer pour maintenir les financements.
M. Jacques Bittoun (120) a rappelé que la sélection de Paris Orsay par le jury IDEX en juillet 2012 reposait bien sur la création d’un PRES qui, devant aboutir à une vraie université, n’aurait été qu’une étape intermédiaire comme, depuis, la ComUE. Or il lui semble que cet objectif initial s’est estompé et que, dans la loi ESR, les universités ne sont plus au centre du système de recherche. L’abandon, en cours de processus, du modèle anglo-saxon a fait réapparaître les clivages entre enseignement et recherche, y compris au niveau des directions ministérielles.
M. Thierry Mandon (121) a de son côté souligné que l’administration centrale de son ministère continuait de piloter un système reposant sur l’autonomie des établissements avec les outils de la période antérieure. Elle doit s’adapter à la nouvelle organisation. La segmentation entre enseignement et recherche n’est plus fondée.
Enfin, tant les remarques des personnes auditionnées que la réalité de terrain montrent que les universités centrées sur les sciences de l’homme et de la société (SHS) ne se sont pas emparées des questions de fusion au même titre que les autres. M. Fabrice Melleray soulignait (122) que la centralisation et le regroupement sacrifient des disciplines qui n’ont pas de débouchés en dehors de l’enseignement. M. Laurent Diez relevait que les SHS, parents pauvres des financements, sont réticentes à être intégrées, craignant de ne pas trouver leur place dans le nouveau cadre proposé.
c. L’autonomie financière et les droits d’inscription
L’autonomie de gestion des universités instaurée par la loi LRU fonde un projet d’établissement, bâti sur des choix stratégiques, une politique de recrutement, la gestion d’un budget global, la mission d’insertion professionnelle des étudiants. Le passage à l’autonomie a été un véritable tournant, un choc, comme le soulignait M. Vincent Berger (123), car il s’agit d’un transfert sans précédent de responsabilités budgétaires, incluant la gestion des emplois et de la masse salariale, première étape complétée par le transfert du patrimoine.
M. Philippe Adnot, dans son rapport d’information fait au nom de la commission des finances du Sénat (124), constatait qu’après « une période qui a pu se révéler difficile pour les universités lors du passage à l’autonomie, alors que le suivi et le pilotage par l’État se sont notamment révélés tardifs, leur situation financière est désormais globalement satisfaisante, même si d’importantes disparités peuvent encore être constatées entre elles. L’autonomie a, par ailleurs, constitué un indéniable atout pour ces établissements et, en particulier, un facteur de modernisation de leur gestion. » Il lui semblait que, pour autant, l’autonomie des universités devait « se poursuivre, afin d’améliorer encore davantage leur gestion (ressources humaines, patrimoine immobilier) et de leur donner les moyens d’un meilleur pilotage, dans un contexte de regroupement des établissements et de forte contrainte budgétaire qui exige de diversifier leurs ressources. Il s’agit ainsi de permettre aux universités de relever les défis majeurs auxquels elles doivent faire face, au premier rang desquels la réussite des étudiants chaque année plus nombreux et la concurrence internationale toujours plus forte. »
Parmi les pistes retenues pour diversifier les ressources des universités et les rendre moins dépendantes de la subvention pour charges de service public, il suggérait d’envisager l’augmentation des droits d’inscription. Les auditions des rapporteurs ont permis de constater que sur ce point non plus les avis n’étaient pas convergents.
Mme Christine Clerici (125) remarquait que l’université de Paris Diderot comptait 25 % d’étudiants internationaux et se montrait favorable à des droits d’inscriptions libres ou plus élevés pour ces étudiants, assortis de bourses les compensant pour les étudiants venant de pays où ces droits seraient rédhibitoires. Elle faisait remarquer que les étudiants originaires des pays asiatiques émergents ne s’inscrivent pas dans les universités françaises parce que les droits d’inscription trop faibles sont interprétés comme de mauvais signes quant à la qualité des conditions de l’enseignement supérieur. Il convient cependant de préciser que les droits des universités étrangères sont souvent plus élevés mais comprennent un logement sur le campus.
M. Jean-Richard Cytermann (126) rappelait que le budget de l’État et celui des collectivités étaient contraints pour longtemps et que la diversification des ressources n’est pas simple. Si, selon lui, la formation continue peut apporter davantage, un financement accru par les droits d’inscription ne peut pas se substituer à un financement d’État.
M. Thierry Coulhon (127) précisait que la question des droits d’inscription se posait pour les étudiants étrangers. Tout l’équilibre est fragile. L’École des mines de Paris est un exemple : le cycle d’études d’ingénieur civil est déficitaire. Avec les autres écoles d’ingénieurs de PSL, elle propose un master tourné vers l’international. Faut-il introduire des droits d’inscription élevés ou faut-il financer les études de la bourgeoisie internationale ? La question se pose pour les étudiants étrangers dont les familles ne paient pas d’impôts en France. Il faut distinguer ce sujet de la question sociale en France. En poussant cette logique de différentiation, il serait également parfaitement opportun de payer pour attirer des étudiants étrangers aussi doués que désargentés.
Lors de la même réunion, M. Bruno Mantovani relevait que la question était particulièrement pertinente dans le domaine de l’art. Les droits d’inscription au Conservatoire national supérieur de musique et de danse sont fixés par le ministère de tutelle. La scolarité coûte 29 000 euros et le montant des droits est de 500 euros. Au demeurant, les frais d’inscription dans un conservatoire régional peuvent atteindre des montants très supérieurs. De plus, 20 % des étudiants sont étrangers. Le Conservatoire est une école élitiste dans un environnement international concurrentiel, qui attire sans difficulté les meilleurs praticiens. Les frais d’inscription peu élevés jouent en sa défaveur par rapport au public asiatique. La Julliard School à New York demande 50 000 dollars, ce qui apparaît plus sérieux. Alors que les ressources baissent, l’impossibilité d’agir sur les droits d’inscription pose problème.
Mme Simone Bonnafous (128) remarquait à cet égard que la création par l’École polytechnique d’un bachelor destiné aux étrangers et complété par un grade reconnu par l’État permettait d’augmenter les droits d’inscription.
Il conviendrait sans doute de distinguer la situation des familles imposées en France et participant au financement de l’enseignement supérieur et celle des consommateurs de cet enseignement mis en concurrence sur le marché mondial.
Néanmoins, Mme Sophie Béjean (129) relevait que les études menées à l’étranger, en Allemagne – pays proche de la France en termes d’attractivité universitaire – ou dans le Nord de l’Europe ne reposaient pas sur des droits d’inscription élevés, sauf en Suède. Mais celle-ci a perdu près de 90 % de ses étudiants étrangers en une année. Une réflexion de l’ensemble des acteurs parties à l’enseignement supérieur suédois est en cours. L’égalité de traitement entre les étudiants étrangers et les étudiants français – quel que soit le montant des droits – lui semble par conséquent être un bon principe, en cohérence avec les choix européens, système britannique mis à part – mais la place de celui-ci est elle-aussi exceptionnelle, pour des raisons linguistiques.
Mme Geneviève Fioraso rappelait que les échos, discussions et rapports sur les situations à l’étranger montrent que beaucoup de questions qui semblent spécifiquement françaises ne le sont pas, y compris celle des droits d’inscription. Avant de rouvrir ce dossier, il convient d’avoir présent à l’esprit un certain nombre d’éléments. Des droits élevés posent particulièrement problème en période de crise, la bulle financière liée à l’endettement étudiant aux États-Unis semblant être supérieure à celle de l’immobilier qui a entraîné la crise de 2008.
L’histoire de l’enseignement supérieur universitaire en France repose sur le principe de la gratuité de l’enseignement public. Le montant des droits d’inscription universitaires est faible, bien loin des 80 000 dollars exigés pour certaines filières en Chine. Mais Mme Geneviève Fioraso précisait qu’elle défendait ce système dans son double aspect : élitiste sur sélection pour les grandes écoles, ouvert pour les universités.
Mme Geneviève Fioraso rappelait, plus largement, qu’il convenait de ne pas pénaliser les jeunes issus des milieux sociaux les plus défavorisés. À l’université, 23 % sont issus de milieux modestes ou précaires. 14 % en 1ère année, 9 % en master, 3 ou 4 % en doctorat. Beaucoup des échecs ou des succès potentiels se décident avant l’université, mais il est d’autant plus essentiel que les rescapés n’échouent pas. Ce serait s’accommoder d’une société bloquée.
La mise en place de droits différents pour les étudiants étrangers soulève d’autres difficultés. Il existe des accords bilatéraux ou multilatéraux qui rendent impossible une discrimination avec les étudiants français, par exemple pour les ressortissants de l’Union européenne et ceux des pays francophones parties à une convention avec la France.
La situation est plus ouverte s’agissant des étudiants issus de pays émergents non concernés par ces accords ; cependant, il existe effectivement un « benchmarking » international. Un coût peu élevé est aussi un avantage pour les étudiants issus de milieux modestes.
En fait, la question se pose de savoir à quelles catégories d’étudiants étrangers il est souhaitable d’ouvrir l’accès de l’enseignement supérieur français : les meilleurs élèves des classes moyennes ou modestes des pays émergents ou les enfants des classes privilégiées qui optent d’ailleurs, le plus souvent, pour les universités américaines ?
d. Une approche transversale étudiante sur la loi ESR et les questions de gouvernance
Mme Marthe Corpet (130), vice-présidente de l’UNEF, regrettait que la loi, dont elle soutenait l’avant-projet, se soit écartée de ses objectifs initiaux. Elle soutenait la proposition d’un outil de régulation de la concurrence et d’égalité, de réussite par les objectifs partagés de qualification d’une majorité d’une classe d’âge s’appuyant sur des refinancements. Le quinquennat actuel s’était ouvert, selon elle, sur la concurrence entre les universités, entre des pôles d’excellence internationaux et des établissements territoriaux. La dérégulation entraînait la mise en place d’un système à deux vitesses, avec des modes de financement différenciés et une répartition locale arbitraire des ressources. Les PRES n’avaient pas de réalité territoriale. La loi ESR est intervenue sur le cadre national des formations, les règles de regroupement, l’habilitation et l’accréditation du contenu des formations. Or son application montre que ses objectifs ne sont pas atteints. Les regroupements sont inégaux, les territoires des ComUE n’ont pas de cohérence et ces dernières s’intéressent surtout à la recherche et non pas à la vie étudiante, laissée aux dirigeants des établissements. Cet échec n’est pas dû à l’absence de projet mais d’équilibre entre les compétences des établissements et la régulation étatique, en dépit de la mise en place de cadres plus démocratiques, formellement. Les regroupements se font d’abord pour trouver des financements, sans objectif de cohérence territoriale. Les acteurs de la gouvernance ne pèsent pas sur les décisions, les conseils s’apparentant à des chambres d’enregistrement sauf dans les unités de formation et de recherche (UFR). Le contenu des formations, le nombre d’heures et les crédits ECTS (European Credits Transfer System) conditionnant les passerelles sont laissés à la liberté de l’établissement. Dès lors, une même licence n’est pas également traitée sur tout le territoire.
Sur la réussite étudiante, Mme Marthe Corpet jugeait positive l’orientation active tout au long des années universitaires, avec une spécialisation progressive plutôt que tubulaire, permettant la réorientation. Mais un décret a réduit les crédits communs des formations et la majorité des universités n’ont pas changé l’organisation tubulaire de leurs formations. Elle estimait que les crédits restaient insuffisants pour couvrir les charges supplémentaires due à l’autonomie des universités, dont les fondements n’ont pas été modifiés par la loi. Enfin, si l’association démocratique des étudiants à la gestion des établissements a progressé, ils ne peuvent pas influencer l’affectation des crédits dans les conseils d’administration.
M. Edgar Mathet, délégué national de l’UNI, soulignait que la loi ESR avait bouleversé la gouvernance des universités. L’enseignement supérieur se démocratise – parfois trop, selon lui –, ce qui est néfaste à la gouvernance des universités et donc aux étudiants. Les élections aux conseils des UFR, aux conseils centraux d’université, à la ComUE, sont permanentes. La démocratie universitaire a un coût. De plus, on constate une mise en concurrence des filières dans l’élection des présidents. La parité absolue imposée pour les personnalités extérieures oblige à choisir d’abord le sexe des personnalités avant de les désigner individuellement sur leurs compétences. Si les présidents politiques des universités ne sont pas les mieux placés pour les diriger, une coalition sans unité idéologique élit un président sans majorité de gouvernance. Il importe de mesurer les conséquences concrètes de la paralysie due à l’absence de majorité.
En matière de regroupements universitaires, M. Mathet remarquait que les fusions pouvaient avoir un intérêt, comme à Aix-Marseille, sans que ce soit une nécessité. Elles ajoutent des services administratifs à ceux qui existent sans les regrouper, ce qui semble dommageable financièrement comme pour les étudiants. Il regrettait que les ComUE, à la différence des PRES, soient contraignantes pour les établissements qui ne peuvent plus refuser d’adhérer. Cela donne des ComUE aux configurations étranges, peu propices à la réussite, avec des sites parfois très distants les uns des autres. Alors que les établissements devraient être libres de gérer leurs partenariats, ils semblent interchangeables dans des communautés contraignantes.
M. Jens Villumsen, délégué national UNI, estimait que les quotas, qui risquent de tuer les IUT, n’étaient pas une solution pour lutter contre l’échec des bacheliers professionnels et technologiques. Il remarquait que le cadrage national des intitulés des diplômes les prive de visibilité, les spécialisations ayant disparu dans l’uniformisation. Les établissements doivent être libres de sélectionner leurs étudiants et leurs enseignants comme leurs formes d’association. Il soulignait enfin que le mode de gouvernance des universités tend à mettre en concurrence les filières en fléchant les crédits sur celles qui constituent l’électorat du président.
M. Quentin Panissod, président de Promotion et défense des étudiants (PDE), rappelait avoir soutenu la réforme et ses objectifs mais remarquait que les politiques de mise en œuvre ont été inadaptées et les priorités sont à revoir, les coupes budgétaires n’aidant pas à la réussite. La gestion des universités manque de compétence, ce qui traduit un problème de formation des élus et non pas de démocratie. Les regroupements ne sont pas lisibles pour les étudiants. Dès lors, ils ne comprennent pas les élections à leurs instances de direction, jointes à celles des Crous et s’ajoutant aux élections aux conseils des UFR et aux conseils centraux. Il serait souhaitable de regrouper les élections le même jour, ce qui permettrait de mettre en place des campagnes nationales et de mutualiser les formations des exécutifs. Il conviendrait également de mieux assurer la représentation des étudiants des établissements associés à un groupement. Il lui semble en revanche que le cadre national des formations ne perturbe pas la cohérence de celles-ci, grâce aux sous-titres des intitulés, mais permet de cartographier les formations et les flux.
M. Tarek Mahraoui, vice-président chargé des affaires académiques de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE), précisait que son organisation était favorable aux regroupements pour valoriser l’offre de formation et coordonner les milieux universitaires et économiques. Les projets de meilleurs équilibres territoriaux étaient intéressants mais se sont peu traduits dans les faits.
Ainsi, en matière de gouvernance, il regrettait que le conseil des membres d’une ComUE n’inclue pas les représentants étudiants alors que c’est là que se décident les orientations majeures, les conseils d’administration ne faisant qu’enregistrer les orientations des conseils des membres. La démocratie universitaire reste donc limitée. Il soulignait, lui aussi, que les scrutins seraient par ailleurs plus lisibles s’ils étaient regroupés. Il y aurait des débats dont les étudiants pourraient se saisir. Enfin, les fusions ont été précipitées, alors que les établissements ainsi hâtivement regroupés ont gardé leur mode de fonctionnement propre, sans projet commun.
Il rappelait, en matière de réussite étudiante, que son organisation soutenait les quotas de bacheliers technologiques et professionnels en IUT et en STS. Mais les procédures d’accréditations sont, selon lui, une réforme inachevée pour les étudiants, les établissements ayant des politiques coordonnées mais l’accréditation ne concernant que les formations et pas la stratégie de site. Le cadre national des formations lui semble constituer une avancée permettant de comparer les mentions, en amont des nomenclatures. Il soulignait, pour conclure, que la réussite étudiante passait par l’international et devait s’adresser à tous les publics, alors que la diversification des profils sociaux des étudiants reste peu prise en compte par l’université, en particulier dans ce domaine.
La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation examine le rapport d’information sur l’application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche (M. Benoist Apparu et Mme Sandrine Doucet, corapporteurs).
M. le président Patrick Bloche. Mes chers collègues, nous débutons notre matinée par l’examen du rapport d’information sur l’application de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche que notre Commission, conformément au troisième alinéa de l’article 145-7 du Règlement de notre assemblée, a confié à deux rapporteurs, l’une de la majorité, l’autre de l’opposition.
À mes yeux, cette démarche illustre parfaitement ce qu’est notre rôle de législateurs aujourd’hui. Non seulement nous votons des lois, et nous avons toutes et tous été engagés dans l’examen et le vote de la loi du 22 juillet 2013 intervenus au début de la présente législature, mais, sans en attendre le terme, nous évaluons sa mise en œuvre.
Je vais donc donner la parole à nos deux collègues, Sandrine Doucet et Benoist Apparu, qui, au-delà du classique bilan des textes d’application et des rapports, se sont intéressés à la mise en œuvre de deux objectifs majeurs de la loi : la réussite étudiante et la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur.
Ce rapport est intéressant non seulement parce qu’il constitue un travail rétrospectif, mais aussi parce qu’il s’inscrit dans la perspective de ces deux objectifs qui, je le pense, nous rassemblent.
Mme Sandrine Doucet, rapporteur. Depuis 2006, la recherche et l’enseignement supérieur en France ont connu des réformes profondes à un rythme soutenu.
La loi du 22 juillet 2013 relative à la recherche et à l’enseignement supérieur, dite loi « Fioraso », du nom de la ministre qui, à l’époque, l’avait présentée, loi « ESR », dont nous vous présentons l’application, succédait à deux textes qui avaient substantiellement modifié l’organisation de l’enseignement supérieur : la loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche et la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, la loi « LRU ». La loi de 2013 est toutefois la première à réunir, dans un seul projet, des mesures concernant les deux domaines, l’enseignement supérieur et la recherche, devenus de fait indissociables.
À partir de 2010, les programmes successifs des investissements d’avenir (PIA) et leurs grands projets ont eu parallèlement un grand impact par la masse des financements extrabudgétaires qu’ils mobilisent et les réorganisations qu’ils induisent ; ils ont fait l’objet de débats au cours des auditions que nous avons conduites.
La loi a reposé sur un travail préparatoire important qui a associé de nombreux acteurs dans les ateliers des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’automne 2012, mais aussi notre Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et son président.
Force est de constater qu’un certain nombre de points, qui avaient suscité de larges débats lors de l’examen du projet de loi, ont perdu une partie de leur caractère polémique. Vous trouverez, dans notre rapport, le compte rendu des publications que nous avions demandé au Gouvernement sur ces sujets, comme le rapport sur les conséquences du développement des enseignements non francophones, prévu par l’article 2 – sujet qui avait été très discuté et commence à trouver une place équilibrée dans l’ouverture de notre enseignement supérieur à de nouveaux étudiants étrangers issus du monde non francophone – ou encore le rapport d’autoévaluation du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), qui a succédé à la très critiquée Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES).
Loi d’orientation et non de programmation, la loi ESR prévoyait l’élaboration de deux stratégies, la stratégie de l’enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche, qui ont été publiées toutes les deux en 2015. Le livre blanc qui devait les réunir et en définir la base budgétaire sera proposée cet automne et devrait donc en permettre, cette fois, la programmation. On peut regretter ce décalage, mais il permet de prendre en compte la pression démographique des classes d’âge les plus nombreuses qui accéderont à l’enseignement supérieur dès l’an prochain.
Les dispositions contenues dans les 129 articles de la loi sont aussi foisonnantes que diverses. Mais le Gouvernement avait défini quatre objectifs majeurs : offrir de meilleures chances de réussite à tous les étudiants, donner un nouvel élan et une meilleure visibilité à la recherche, renforcer la coopération entre tous les acteurs et amplifier la présence de la recherche française dans les programmes européens et le rayonnement international des universités, des écoles et des laboratoires en encourageant la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs.
Nous avons toutefois préféré centrer nos auditions sur deux objectifs qui illustrent et rassemblent les autres : la réussite étudiante et la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur, et plus particulièrement celle des universités.
Trois années constituent un délai minimum pour évaluer une loi portant sur un temps long, celui des études – c’est la durée d’un premier cycle dans le meilleur des cas – et celui d’une gouvernance.
Au cours des auditions, nous avons toutefois pu mesurer combien l’ensemble de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche s’était d’ores et déjà emparé du texte de la loi et de ses multiples conséquences.
M. Benoist Apparu, rapporteur. La réussite étudiante constituait l’un des deux principaux objectifs poursuivis par la loi. Le constat de départ, connu de tous, est que l’ensemble des premiers cycles de l’enseignement supérieur français connaît un taux de réussite à peu près similaire à celui des grands pays occidentaux, mais qu’il y a un atypisme de l’université, avec un taux d’échec en licence très largement supérieur à celui constaté dans les grands pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
L’une des explications de ce phénomène est l’échec particulièrement grave et douloureux des bacheliers professionnels à l’université puisque seulement 3 % d’entre eux obtiennent leur licence en trois ans. Le principal problème que nous rencontrons est donc celui de la gestion de l’orientation et des flux d’étudiants entrant dans l’enseignement supérieur français.
Globalement, ceux qui réussissent très bien dans la voie générale choisissent plutôt les grandes écoles, leur second choix s’orientant vers les filières courtes, notamment les instituts universitaires de technologie (IUT) ou, éventuellement, vers les licences universitaires. Le résultat est que des étudiants provenant, soit de la voie professionnelle, soit de la voie technologique, ne trouvent pas de place dans leurs débouchés naturels que sont les IUT ou les sections de technicien supérieur (STS), et se retrouvent en premier cycle universitaire général sans posséder le bagage nécessaire pour réussir leur licence.
Sur la base de ce constat pertinent, la loi ESR a proposé une réponse tout aussi pertinente : les fameux quotas applicables aux bacheliers techniques et professionnels en IUT et en STS. À ce stade, nous pensons que ce dispositif a été bien reçu, bien qu’il soit trop tôt pour en apprécier les résultats, et qu’il va dans la bonne direction. L’exercice connaît peut-être une limite, car l’application de la loi a subi le choc d’un afflux nouveau d’étudiants, tant à l’université que dans l’ensemble du système de l’enseignement supérieur. De ce fait, la loi peine à donner sa pleine mesure, le taux d’ouverture de places en IUT et BTS ne compensant pas ce flux d’arrivées dans l’enseignement supérieur.
Le Gouvernement en a pris pour partie la mesure de ce problème en proposant de créer de nouvelles places, notamment en STS. Là encore, la mise en œuvre est longue, mais à la lumière des auditions, nous pensons que les choix retenus par la loi « Fioraso » vont dans la bonne direction.
Les auditions ont ouvert en revanche deux nouvelles problématiques.
La première est celle de la question de la sélection en master. Le système français est en décalage avec le système mondial, principalement organisé autour du parcours licence-master-doctorat (LMD) en « 3-5-8 ». Ce système n’est pas du tout appliqué en France où nous connaissons des sorties « professionnalisantes » à 2, 3, 4, 5 et 8 ans.
Il nous faudra bien un jour nous aligner sur le format en cours dans les autres pays du monde. C’est pourquoi la question de la sélection en master 1 (M1) ou master 2 (M2) trouve toute sa place. Le Gouvernement a récemment adopté un certain nombre de mesures concernant la validation juridique de la sélection à l’entrée du master 2. Beaucoup de questions se sont fait jour à ce sujet à l’occasion des auditions que nous avons tenues. Faut-il rabaisser cette sélection au niveau du master I ? Il semble que le secrétaire d’État à l’enseignement supérieur soit très ouvert sur ce sujet, quand bien même j’ai cru comprendre qu’une légère divergence d’appréciation existait avec sa ministre de tutelle.
Cette question devra bien être tranchée et, à titre personnel, je suis favorable à la sélection dès l’entrée du master 1 afin d’être en cohérence avec le système mondial.
La seconde problématique porte sur l’apparition d’un objet universitaire relativement peu connu jusqu’alors, mais qui semble se développer très rapidement : le bachelor. Ce diplôme est apparu en France il y a maintenant trois ans, il consiste en une formation de niveau bac +3. Il trouve son origine dans la réforme de l’apprentissage, qui a généré une perte d’étudiants dans beaucoup de grandes écoles, que ces dernières ont cherché à compenser à ouvrant des bachelors.
Cet objet, quelque peu particulier, car non reconnu, librement délivré par les grandes écoles dont Polytechniques ou l’École des arts et métiers vient, là encore, heurter le système 3-5-8 en créant un nouveau diplôme. Il nous faudra bien trouver une voie pour généraliser ce type de dispositif, peut-être sous un autre intitulé.
En tout état de cause, il faut revenir à l’idée, déjà exprimée il y a quelques années, d’une licence professionnelle qui devienne de fait l’outil principal d’insertion professionnelle des étudiants. Elle pourrait ainsi utilement compléter, comme c’est déjà le cas, les DUT et BTS en les généralisant et en y agrégeant le bachelor. De l’autre côté, demeurerait une licence plus générale destinée à la poursuite d’études jusqu’à bac +5. Nous devrons probablement, à un moment ou un autre, nous arrêter à ce modèle.
Voilà ce que je souhaitais dire sur la réussite étudiante, notre collègue Sandrine Doucet va maintenant évoquer la gouvernance de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ensuite, comme il se doit pour un député de l’opposition, je réinterviendrai en conclusion pour faire connaître mes désaccords…
Mme Sandrine Doucet, rapporteure. J’en viens au sujet de l’organisation de la gouvernance de l’enseignement supérieur et de la recherche, sujet moins souvent évoqué, alors que la façon dont les universités vont pouvoir offrir des réponses, que je qualifierais de « territoriales », à l’orientation des étudiants, est déterminante.
Cette organisation a été assez sensiblement modifiée par la loi afin de répondre aux incompréhensions que les mesures prises dans ce domaine depuis 2006/2007 avaient pu susciter.
L’autonomie de gestion des universités instaurée par la loi LRU impliquait un projet d’établissement bâti sur des choix stratégiques, une politique de recrutement ainsi que la gestion d’un budget global. C’est la question de la gestion de ce budget qui a suscité le plus de difficultés et de critiques lors des Assises.
Ce transfert sans précédent de responsabilités budgétaires a mis à l’ordre du jour une diversification des ressources, et la question de la latitude des universités à fixer le montant des droits d’inscription, ainsi que leur montant, s’est posée. Entre temps, les ministres successifs ont posé le principe de leur non-augmentation. Toutefois, un débat demeure ouvert au sujet de l’équilibre devant être trouvé entre cette non-augmentation et notre capacité à attirer des étudiants étrangers.
De fait, la visibilité internationale de nos universités se mesure aussi, pour ces étudiants, au montant des droits d’inscription, qu’ils considèrent comme représentatifs de la qualité de l’enseignement. Plus ces montants sont élevés, plus l’université est considérée comme bonne.
Or la question se pose de savoir quelles sont les catégories d’étudiants que nous souhaitons attirer sur notre territoire : les fils de milliardaires chinois ou d’autres pays émergents ou les enfants des classes moyennes de ces pays ou des pays européens ? Les classements internationaux, dont celui du Shanghai, placent les universités françaises à des niveaux que nous souhaiterions plus élevés, mais je vous laisse le soin, mes chers collègues, d’en apprécier les critères d’évaluation. Car nous pouvons être satisfaits de constater que la France est l’un des pays attirant le plus d’étudiants au monde comme de la très bonne circulation des étudiants européens dans le cadre du programme Erasmus, dont beaucoup viennent chez nous.
La loi se fixait comme objectifs de simplifier et de démocratiser la gouvernance des universités. L’élection du président est ainsi confiée au seul conseil d’administration. Tous les membres, y compris les personnalités extérieures non élues, mais désignées, participent désormais à son élection. C’est sur ce dernier point que les présidents d’université ont beaucoup achoppé en estimant qu’ils ne maîtrisaient plus parfaitement leur corps électoral. Au cours des auditions, certains d’entre nous leur ont répondu qu’ils préféreraient, eux aussi, pouvoir choisir leurs électeurs, ce qui leur serait bénéfique pour leurs futurs mandats !
L’articulation du conseil d’administration avec le conseil académique regroupant la commission de la recherche et la commission de la formation et de la vie universitaire constitue le cœur de la loi, en ne scindant plus la vie universitaire et la recherche. C’est là la marque d’une organisation qui se veut stratégique.
Parmi les vingt-cinq regroupements, vingt ont choisi la formule de la communauté d’universités et établissements (ComUE), qui a fait l’objet de bien des commentaires, particulièrement à cause de la place concédée aux écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE). Ces débats sont révélateurs des questions posées au sujet du rôle des écoles et de la façon dont les universités peuvent se regrouper ainsi que de leurs projets respectifs.
Dans le domaine de la gouvernance, la mise en œuvre de la loi ESR a subi l’impact des programmes d’investissements d’avenir (PIA) ainsi que de la réforme territoriale organisée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe ».
S’agissant des PIA, il a été constaté que le jury international attribuait plus volontiers des initiatives d’excellence (IDEX) aux universités ayant opté pour la fusion ; ce qui a donné lieu à des débats portant sur les modalités de regroupement qu’il convenait de retenir.
De son côté, le redécoupage des régions réalisé dans le cadre de la réforme territoriale a considérablement élargi leur périmètre ; ce qui a posé la question de l’adéquation des limites des regroupements universitaires avec celles des régions.
Alors même que la loi – dont je rappelle qu’il ne s’agit pas d’une loi de programmation – n’avait pas pour objet de régler la question des IDEX ni celle de la réforme territoriale, elle n’en apporte pas moins des réponses. S’agissant de l’adéquation entre les ComUE et les régions, l’exemple de l’Aquitaine, qui m’est familier, est caractéristique, puisque le président de la région Nouvelle Aquitaine souhaitait constituer une ComUE unique. Cela n’a pas été possible puisque les universités, invoquant leur autonomie et la loi ESR, ont préféré adapter des périmètres de regroupements correspondant à leurs projets et, surtout, aux bassins de vie. J’ai constaté que le président de région avait finalement accepté l’existence de plusieurs ComUE, accompagnées toutefois d’un organe collégial unique faisant fonction d’interlocuteur de la région.
La gouvernance des ComUE a constitué le sujet le plus épineux, critiquée dans son mode d’élection et soupçonnée de créer une structure supplémentaire. Il faut cependant conserver à l’esprit que les dernières structures n’ont été mises en place que cette année et que nous nous orientons maintenant vers une politique stratégique de sites.
En conclusion, et sans vouloir plagier le titre d’un livre, je dirais qu’il s’agit d’une politique posant deux principes : l’autonomie et le territoire.
M. le président Patrick Bloche. Je remercie les rapporteurs qui ont été très clairs. De façon très synthétique, ils ont su livrer l’essentiel de la teneur de leur rapport.
M. Benoist Apparu, rapporteur. Nous savons tous que l’objet de ces rapports est de contrôler l’application de la loi. Faute d’établir un document consensuel, nous avons recherché les points de convergence susceptibles de nous rassembler.
À mes yeux, la création des ComUE constitue peut-être un outil de plus ou de trop qui ne change pas grand-chose par rapport au passé, notamment aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). Nombre de nos interlocuteurs ont indiqué que la transition entre les PRES et les ComUE a nécessité deux ans de travail administratif pour rédiger les nouveaux statuts, définir les périmètres, etc. Tout cela sans justifier d’une utilité évidente au regard de ce qui existait auparavant.
Par ailleurs, je rappelle que, dans le domaine de l’enseignement supérieur, une loi nous revient tous les cinq ans, alors que d’autres secteurs connaissent une évolution tous les ans. Avec une loi tous les cinq ans, mieux vaut éviter que les rendez-vous soient pour partie ratés ; or il semble qu’en matière de gouvernance, l’acte II de l’autonomie ait été manqué. La loi LRU a posé l’acte I de cette autonomie, il nous semble que la loi ESR a raté son acte II, en ne donnant pas aux universités les réels moyens de gérer leur autonomie, singulièrement dans le domaine crucial de la gestion des ressources humaines, ce que nos interlocuteurs n’ont pas manqué de nous rappeler. Nous devons donc achever cet acte II.
S’agissant de la réussite étudiante, j’approuve la mesure de réservation de places dans les IUT et les STS pour les bacheliers des filières professionnelles et technologiques. Toutefois, en m’appuyant sur le rapport d’information d’Emeric Bréhier sur Les liens entre le lycée et l’enseignement supérieur, je considère qu’il conviendra surtout, à l’avenir, de bien définir qui fait quoi après le baccalauréat.
Le bac professionnel est un diplôme à vocation professionnalisante devant, pour une majorité d’étudiants, les orienter vers le monde professionnel. Ce qui ne signifie évidemment pas qu’il faille leur interdire l’accès à l’enseignement supérieur, mais ceux qui souhaitent poursuivre dans la voie professionnelle doivent trouver leur place, en STS notamment.
La voie naturelle pour les bacheliers de la filière technologique est l’IUT, à la condition que sa vocation professionnalisante lui soit restituée, alors qu’il n’est plus aujourd’hui qu’un détournement de premier cycle universitaire pour poursuivre ensuite des études longues à l’université.
La question du M1 devra être tranchée – et j’espère que le Gouvernement, qui s’y est engagé, le fera dans les prochaines semaines – en instituant une sélection en M1, en cohérence avec la sortie du niveau 3. Enfin, le 3-5-8 ne manquera pas de constituer l’un des débats majeurs portant sur l’avenir de notre enseignement supérieur.
Voici, monsieur le président, les compléments que je souhaitais apporter à la présentation de notre rapport.
M. le président Patrick Bloche. Compléments qui ne sont pas anodins. Ils illustrent parfaitement à quel point, appartenant respectivement à la majorité et à l’opposition, vous ne sauriez être d’accord sur tout. Sur ce sujet éminemment politique, vous avez chacun vos propres analyses, et il ne s’agit pas d’aboutir à un consensus mou.
Mme Sandrine Doucet, rapporteure. Il me paraît excessif d’affirmer que l’acte II de l’autonomie des universités a été raté. De fait, les PRES et la loi LRU avaient instauré une véritable concurrence entre les universités, alors que nous proposons plutôt des modalités de coopération. La dévolution budgétaire organisée par la loi LRU s’était soldée par des difficultés considérables pour les universités.
En 2014, soit sept ans après l’entrée en vigueur de cette loi, 10 % seulement des universités disposaient d’une comptabilité analytique, car les moyens permettant d’assurer une gestion saine, claire et efficace de leur budget ne leur avaient pas été donnés. À titre d’exemple, je mentionnerai les difficultés qu’a connues la faculté de Montpellier avec son antenne de Béziers ; ce type de situation est aujourd’hui partout assaini.
Le rapport d’Emeric Bréhier ainsi que mon rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2015 ont traité la question de l’adéquation entre les divers baccalauréats et les différentes filières. Nous ne saurions avoir une conception binaire de l’orientation, le sujet n’étant pas celui de l’étudiant qui doit choisir ou non, mais de lui donner tous les moyens d’opérer son choix et de l’accompagner.
La loi ESR a créé les passerelles au sein du premier cycle, elle a intégré la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires ; ce qui garantit la formation ainsi que des choix mieux éclairés. Son article 2 a favorisé les cours en langues étrangères, elle a amélioré la connaissance de l’entreprise et développé les MOOCs (Massive Open Online Course) ou cours en ligne ouverts et massifs. Un système global d’accompagnement de l’étudiant a donc été mis en place afin qu’il ne se trouve pas confronté à un non-choix.
Il y aura lieu, par ailleurs, de conduire une réflexion sur l’orientation en master retenue par les universités et leur offre territoriale.
Enfin, je rappelle que cette loi associe l’enseignement et la recherche, ce qui consiste à relever le double défi du rayonnement international et celui de l’aménagement territorial de proximité des études. Ce schéma global appelle une réflexion excédant une simple posture d’opposition se caractérisant par des choix simplement binaires.
M. le président Patrick Bloche. Merci, Sandrine Doucet, vous avez été amenée à évoquer les Écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) ; à ce sujet, je vous rappelle que nous examinerons la semaine prochaine le rapport de la mission d’information sur la formation professionnelle des enseignants, présidée par Frédéric Reiss, et dont le rapporteur est Michel Ménard.
M. Emeric Bréhier. Au début de notre réunion, à la lecture du rapport ainsi qu’à l’écoute des deux rapporteurs, j’ai craint de devoir constater qu’il existait enfin une vision commune et partagée de l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche dans ce pays. Les conclusions présentées par Sandrine Doucet et Benoist Apparu m’ont rassuré en montrant que les clivages persistent.
De même que la loi ESR n’est pas la loi miracle ayant tout résolu, la loi LRU n’a pas été un parangon de vertu comme d’aucuns voudraient le croire ; en son temps, elle a fait l’objet de mouvements de critique et de contestation. Aussi, ne réécrivons pas l’histoire, et ne cédons pas à l’uchronie, mon cher collègue Benoist Apparu.
Dans votre rapport, vous signalez de façon incidente que l’un des traits caractéristiques de l’enseignement supérieur français est qu’il ne lutte pas de manière assez efficiente contre la reproduction des inégalités sociales. Cela se perçoit aisément lorsque l’on considère la caractérisation sociologique des diplômés à mesure que l’on progresse dans l’enseignement supérieur. C’est peut-être là l’une des raisons qui nous avaient conduits à nous battre ensemble afin d’instituer des quotas pour les STS et les IUT.
Cette remarque va de pair avec la citation que vous faites de La note d’analyse de France Stratégie au sujet des inégalités territoriales d’accès à l’éducation. Je m’interroge : sommes-nous allés assez loin dans l’activation des dispositifs d’accompagnement permettant aux étudiants éloignés des centres universitaires, notamment ceux issus des catégories populaires, d’accéder à l’enseignement supérieur ?
Les dispositions de l’article 2 de la loi ESR avaient donné lieu à d’amples débats ; nous avons été bien inspirés de tenir, car, comme le montre votre rapport, une fois le show à l’américaine de l’hémicycle passé, la réalité universitaire a ramené un peu de raison. Aussi aimerais-je connaître votre sentiment à ce sujet.
Enfin, je souhaite vous faire part d’un regret que j’éprouve à la lecture du rapport. Vous y faites référence au devenir des doctorants dans la fonction publique mais vous n’évoquez pas une disposition déjà présente dans la loi LRU – à laquelle notre collègue Apparu se réfère avec enthousiasme –, reprise par la loi ESR, relative à la nécessité, dans les branches professionnelles, de la prise en compte des diplômes de docteur par les conventions collectives salariales passées avec le secteur privé.
Nous savons tous que l’un des enjeux de l’intégration des docteurs est la reconnaissance de leur diplôme dans les conventions collectives, ce qui ne relève pas simplement de l’enseignement supérieur, de la recherche ou des fonctions publiques, mais aussi du secteur privé. Puisque nous sommes ici pour faire le point sur la mise en œuvre de la loi : où en sommes-nous à cet égard ?
M. Frédéric Reiss. Nos collègues nous présentent leur rapport sur l’application de la loi du 22 juillet 2013 alors que le Conseil national de l’évaluation du système scolaire (CNESCO), dont avec d’autres collègues je suis membre, vient de publier un rapport montrant à quel point notre système scolaire est inégalitaire, remettant par là en cause trente ans de politiques éducatives.
Comme l’ont montré les travaux portant sur la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, après la promesse de passer de l’ombre à la lumière, nous sommes aujourd’hui confrontés au principe de réalité.
Sur cette loi ESR, singulièrement bavarde, nos deux rapporteurs ont à juste titre centré leur attention sur les deux principaux thèmes que constituent la gouvernance des universités et la réussite des étudiants.
S’agissant de la gouvernance, sans vraiment revenir sur l’autonomie accordée aux universités par la loi LRU, la majorité a choisi de ne pas aller plus loin, créant par là des difficultés. Aussi, à l’instar de Benoist Apparu, je considère que l’acte II de l’autonomie des universités a été un échec.
Nous avions dénoncé le caractère systématique et purement territorial, dans le contexte d’une vision très administrative, du remplacement des PRES par les ComUE, et les critiques ne manquent d’ailleurs pas dans votre rapport. Certaines ComUE sont des coquilles vides consistant en un empilement de couches administratives ; plus grave, elles ne sont pas reconnues dans les classements internationaux, notamment dans celui de Shanghai. Tout cela fait régresser notre pays.
S’agissant de la réussite des élèves, un sujet nous avait beaucoup occupés en 2013 : celui des quotas de places pour les bacheliers techniques dans le recrutement des IUT et STS. Favoriser les baccalauréats techniques lors du « recrutement des élèves pour le supérieur », pour reprendre l’expression de la ministre, revient à poser le problème de l’orientation précoce des élèves dans le secondaire. La transition seconde/première n’est d’ailleurs pas mentionnée dans la liste des transitions sensibles établie par votre rapport, qui ne mentionne que les transitions terminale/postbac ou collège/lycée. La seconde est ainsi devenue une année d’orientation sans pour autant offrir aux élèves des activités consacrées aux questions d’orientation. Il est regrettable qu’un élève soit pénalisé s’il réalise qu’il souhaite plutôt s’orienter vers des formations techniques relevant des IUT ou des STS après obtention du baccalauréat. Il conviendrait donc, en seconde, de prévoir des activités tournées vers l’orientation.
La question des enseignements non francophones est abordée de façon incomplète. Les étudiants français ont, certes, besoin de s’améliorer dans le domaine des langues étrangères. C’est l’objet des cours de langues obligatoires ou facultatifs proposés dans les divers centres de formation. Mais l’enseignement non francophone crée par ailleurs des incertitudes, la formation interdisciplinaire nécessitant des enseignants sensibilisés à la fois aux autres matières et aux autres langues. La validation d’un module technique doit sanctionner l’acquisition de connaissances techniques et non la maîtrise d’une langue étrangère, et les contenus des curriculums sont moins accessibles aux relecteurs, ce qui rend les évaluations et contrôles parfois difficiles, car ils nécessitent une traduction.
Le rapport aborde succinctement la question des droits d’inscription qui avait été éludée par la loi. À l’heure où nos finances publiques connaissent des difficultés sans précédent, ne faudrait-il pas, à l’instar de la plupart des pays européens, faire payer les étudiants étrangers ? Le sujet mérite d’être étudié, sans même parler de l’augmentation des droits d’inscription.
M. Laurent Degallaix. Je tiens à saluer la qualité du travail accompli par les rapporteurs, car il est toujours valorisant pour le travail parlementaire d’évaluer les lois que nous adoptons.
S’agissant de la loi ESR, le groupe Union des démocrates et indépendants ne nourrissait que peu d’illusions quant aux avancées permises par ce texte. Bien en deçà de ce qu’exige la situation que nous connaissons, cette loi s’est bornée à l’adoption de mesures techniques dont l’objet principal était de défaire ce qui avait été réalisé sous la précédente législature. Pourtant l’enseignement supérieur se trouve à la croisée d’enjeux fondamentaux : conditions de la réussite des étudiants, ambition pour la recherche et l’enseignement supérieur, compétitivité économique, rayonnement international de notre pays.
Trois ans après l’entrée en vigueur de cette loi, votre rapport brosse un panorama à peu près complet des mesures adoptées et présente celles qui restent en suspens. De nombreux rapports étaient prévus par ce texte, vous en dressez d’ailleurs la liste exhaustive. Or, force est de constater que chacun d’entre eux soulève de véritables questions, qui, pour la plupart, devront être à nouveau être tranchées par voie législative. À ce titre, peuvent être cités la sélection et la formation des médecins, le déroulement de carrière et la formation des enseignants-chercheurs ainsi que les inégalités sociales.
S’agissant de la réussite étudiante, à laquelle une partie du rapport est consacrée, on constate que les dérives de l’outil d’admission postbac (APB) n’ont malheureusement pas été corrigées par la loi ESR. Vous considérez qu’il s’agit d’un outil dénaturé, et le ministre lui-même appelle une amélioration permettant une meilleure information sur les taux de réussite potentielle.
L’orientation constitue un défi et l’université de Valencienne, que je connais bien, n’est pas épargnée par l’échec, notamment en première année puisque le taux d’étudiants validant leur licence en trois ans s’élève à peine à 35 %. Préconisez-vous de donner suite à la proposition de la stratégie nationale de l’enseignement supérieur (StraNES) d’expérimenter une nouvelle forme d’orientation dans les années à venir ?
Par ailleurs, le rapport indique qu’un projet de loi devrait ouvrir la voie à la sélection pour l’accès au master, pouvez-vous nous fournir des informations supplémentaires ?
Enfin, alors que les derniers chiffres du chômage font état d’une situation particulièrement dégradée du marché de l’emploi, quelles sont, selon vous, les priorités susceptibles de rapprocher l’enseignement supérieur de l’entrée des jeunes dans la vie active ? Pour mémoire, je rappelle que, d’après l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), à peine 60 % des bac +5 de la promotion 2014 étaient en poste moins d’un an après l’obtention de leur diplôme.
Mme Colette Langlade. Je me réjouis que le rapport qui nous est présenté soit le travail de deux de nos collègues, l’une appartenant à la majorité, l’autre à l’opposition ce qui, je l’espère, ajoutera du crédit au travail effectué ainsi qu’à ses conclusions.
Je m’interroge toutefois sur la gouvernance du paysage universitaire et des établissements d’enseignement supérieur. La loi du 22 juillet 2013 donnait une marge de manœuvre dans la définition de cette gouvernance afin de faciliter l’adaptation aux modifications du paysage institutionnel. Vous avez d’ailleurs insisté, madame la rapporteure, sur l’adaptation du périmètre des regroupements en fonction des projets et des bassins de vie.
Aussi aurais-je souhaité savoir comment vous évaluez la capacité d’adaptation des ComUE instituées par la loi aux frontières des nouvelles régions, et comment se réalise cette nouvelle configuration. Je pense particulièrement aux universités de Poitiers et de Limoges, auparavant regroupées avec celles d’Orléans et de Tours, mais qui font désormais partie de la région Nouvelle Aquitaine.
Mme Dominique Nachury. Cette année encore, nous n’avons pas échappé aux marronniers sur le manque de place à l’université, car la loi ESR n’a pas souhaité s’attaquer à la question. Dans un entretien avec le journal Les Échos, Mme la ministre a laissé entendre qu’un projet de loi serait présenté au mois de novembre prochain, mais j’ai compris qu’elle porterait sur la sélection en master. Qu’en est-il pour la sélection en licence, qui me semble être une question importante ?
Faire d’APB un dispositif d’orientation positive suppose de faire connaître les prérequis, les résultats, la suite de la formation : progresse-t-on dans ce domaine ?
Au-delà se pose la question du statut du baccalauréat, ou des baccalauréats, de son organisation ainsi que de son contenu. Ces questions se trouvaient au cœur de la mission sur le continuum –3/+3 et il me semble qu’elles sont quelque peu renouvelées à l’issue de votre rapport. Vous avez conduit de nombreuses auditions : quelles perspectives se sont dégagées sur l’ensemble de ces sujets ?
Mme Martine Martinel. Ma première question est pour M. Apparu. Vous avez insisté sur le terme de « bachelor », et indiqué que ce diplôme pourrait prendre un autre nom. Je ne saisis pas bien son utilité. Qu’apportera ce diplôme supplémentaire au cursus des étudiants, alors que vous soulignez que l’accumulation de diplômes n’aboutit pas forcément à des résultats concrets, singulièrement sur le marché du travail, pour les étudiants titulaires de bac pro, par exemple ?
Ma seconde question s’adresse à Sandrine Doucet. À juste titre, vous avez considéré que la réforme territoriale était venue percuter la loi ESR, mais vous avez aussi considéré que l’institution de ComUE était propice à la bonne adéquation des regroupements universitaires avec cette nouvelle géographie. Pourriez-vous préciser votre propos ?
M. Paul Salen. L’article 41 de la loi du 22 juillet 2013 prévoyait la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement formulant des propositions destinées à améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins. Or ce document n’a jamais été publié : savez-vous s’il le sera ou s’il a été abandonné ?
La diversification des ressources financières des universités semble constituer une préoccupation partagée par de nombreux acteurs de l’enseignement supérieur afin de rendre les établissements universitaires moins dépendants de la subvention. En revanche, les avis sont partagés quant aux solutions pouvant être apportées, comme on peut le constater au sujet de l’augmentation des droits d’inscription. Vos divers interlocuteurs, entendus au cours des auditions que vous avez conduites, seraient-ils susceptibles d’envisager un partenariat financier avec des entreprises en fonction des filières concernées ?
Mme Valérie Corre. Je constate que les débats que nous avons ne sont pas près de prendre fin, ne serait-ce qu’à entendre les sujets abordés. Or, à mes yeux, la prochaine étape que l’enseignement doit passer excède ces simples questions ponctuelles car il s’agira de réfléchir à l’articulation de la formation tout au long de la vie avec les différentes étapes du cursus universitaire. Nous devrons alors dépasser nos schémas traditionnels mais il ne semble pas que nous y soyons parvenus aujourd’hui.
Notre collègue Dominique Nachury a évoqué l’orientation positive : les auditions que vous avez conduites vous ont-elles permis d’obtenir des informations supplémentaires à ce sujet ? Le dispositif APB est-il vraiment devenu plus lisible et plus utile ? Nos jeunes lycéens et étudiants parviennent-ils à s’orienter en étant mieux informés, autant au sujet du type de filières existantes qu’à celui des débouchés professionnels ?
Dans le cadre de vos auditions, avez-vous observé une plus grande cohérence entre les deux années de master ? Car l’ancien système universitaire s’arrêtait à la maîtrise et, de ce fait, une véritable frontière persiste aujourd’hui entre la fin du M1 et l’entrée en M2. Alors que certains s’interrogent sur l’opportunité de diplômer le bac +4, il est notoire que sur le marché du travail comme dans le système universitaire européen, celui-ci n’est pas reconnu. Est-il envisageable qu’à terme, certains de nos étudiants soient contraints d’arrêter leur cursus à la fin du M1 ?
M. Jean-Pierre Giran. J’ai entendu beaucoup de réflexions intéressantes sur le financement et l’autonomie des universités, sur l’organisation des différents conseils, sur la sélection, l’orientation et la vie des étudiants. Cependant, comme souvent lorsque le sujet des universités est abordé, les universitaires sont rarement évoqués, comme s’il n’était question que de machines et pas de pilotes.
Ceux qui connaissent l’université observent qu’il est toujours plus difficile d’y retenir, éventuellement pour y faire carrière, les meilleurs étudiants, car désormais ils partent. Cela est sans doute dû au fait que le statut des universitaires, en termes de rémunération, de considération et d’évolution de carrière n’est pas ce que l’on pourrait espérer. Lorsqu’une institution ne parvient pas à retenir le meilleur des siens, elle rencontre des difficultés, quelle que soit la qualité de la machine que l’on met en place.
Je souhaiterais donc savoir s’il y a une fatalité, de loi en loi, qui fait que la question des universitaires est absente du débat ?
M. Christophe Premat. Je souhaite saluer le travail qui nous est présenté, qui met en évidence les défis qui sont posés sur le long terme à l’université, par une démarche de démocratisation de l’enseignement supérieur.
L’internationalisation de l’enseignement supérieur ne se limite pas à la question de l’attractivité de nos établissements ou aux modules enseignés en langue anglaise. Par le biais des ComUE, il faut solidifier les coopérations internationales, favoriser la mobilité étudiante ainsi que la co-diplômation dans certaines filières, comme l’audition de M. Hoffmann-Martinot notamment y invite. La pratique et l’enseignement accru des langues étrangères pourraient favoriser ces coopérations.
S’agissant de la question des droits d’inscription, beaucoup de fausses bonnes idées circulent. Il faudrait augmenter ces droits alors même que, dans certains pays européens, on constate la difficulté que cela pose. C’est notamment le cas de la Suède, qui a fait payer aux étudiants étrangers les frais d’inscription à l’université ; cela a occasionné des départs, la fermeture de filières, soit un appauvrissement intellectuel de l’université.
L’un de nos collègues parlait de pilotes, or, cette fois c’est une mesure structurelle qui est imposée à la machine sans pour autant produire le moindre effet. Fort heureusement, dans une sagesse post Brexit, les universités anglaises demeurent libres et, pour l’instant, n’ont pas annoncé l’imposition de frais de scolarité. En effet, cela serait catastrophique pour nos ressortissants étudiants en Angleterre, comme pour les autres étudiants étrangers à ce pays. Dans le cadre de l’examen d’un rapport d’évaluation de l’application d’une loi, nous ne devons pas céder à ces sirènes.
Le rapport analyse avec finesse la question de l’insertion des docteurs. La loi ESR offre la possibilité de multiplier toujours plus les équivalences afin d’éviter que les intéressés ne se trouvent en difficulté à la fin de leur thèse, et soient contraints à multiplier les postes d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), voire de demi ATER. Conduire une réflexion portant sur la condition et le statut des docteurs est donc indispensable. De fait, les docteurs se retrouvent en recherche d’emploi au sortir de leur thèse, alors qu’ils sont susceptibles d’apporter une expérience et une réflexion en occupant diverses fonctions.
La vie étudiante – dont la loi de finances pour 2016 a substantiellement augmenté la dotation – peut apporter une solution à la question des droits d’inscription ; par la création de véritables campus en permettant aux étudiants de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. En prenant exemple sur de nombreux pays européens, nous pourrions trouver des pistes pour la définition d’une stratégie universitaire portant sur le long terme.
Mme Sandrine Doucet, rapporteure. Merci pour ces questions, mes chers collègues, auxquelles je vais répondre par thème.
La question de la sélection s’est posée au cours de nos débats, principalement pour deux niveaux : le baccalauréat et la licence. La problématique de l’adéquation du baccalauréat avec l’entrée à l’université se fait toujours plus prégnante, et un choix judicieux dans les disciplines prépare le mieux à cette entrée. À cet égard, la conférence des présidents d’université (CPU) a marqué sa préférence pour le contrôle continu en première et terminale, plus propre, à ses yeux, à la révélation des compétences.
Considérer le baccalauréat comme le premier diplôme universitaire ne conduit qu’à de fausses espérances ; c’est donc bien sur la question de l’orientation et de l’affinement progressif des choix des élèves qu’il convient de mener la réflexion. Lors de son audition, le ministre Thierry Mandon a souligné que la France est le pays où le choix d’orientation est demandé le plus tôt aux intéressés, dès l’âge de seize ou dix-sept ans.
Le dispositif APB est plus que discuté, ainsi, dans la région Aquitaine, les candidats aux sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) sont si nombreux qu’il a été décidé de recourir au tirage au sort. L’offre étant inférieure à la demande, dans l’espoir d’être retenus, la majorité des élèves placent le STAPS en premier choix. Dès lors, la question n’est pas tant celle de l’outil APB que de l’attractivité de cette filière et des débouchés sur lesquels elle ouvre, qui sont tout de même limités.
La question de l’enseignement supérieur comme lieu de professionnalisation reste ainsi posée, car, qu’il s’agisse d’une école, d’une université, d’un IUT ou d’une STS, il s’agit bien d’aboutir à une activité professionnelle. Dans le cadre d’une orientation judicieuse et éclairée, APB doit être considérée comme un outil, sans que pour autant il faille tout en attendre.
La sélection en master est souvent présentée comme garantie d’un meilleur recrutement, toutefois, une loi sera probablement nécessaire afin d’éviter une orientation brutale et binaire et de pouvoir offrir une réelle gamme de choix. Cela devrait régler le problème de la rupture entre le M1 et le M2 ; il n’en demeure pas moins que des concours sont passés au stade du M1, et que des sorties à bac +4 afin d’intégrer certains métiers existent toujours. Cette situation ne manquera pas, concomitamment, de poser la question du concours de recrutement des enseignants, car une partie de la formation correspondante est délivrée en M1.
La mobilité est l’une des conditions essentielles de la réussite étudiante ; en effet, comment avoir la latitude du choix si celle-ci fait obstacle ? Certains de nos interlocuteurs ont évoqué les espaces de non-choix que constituent certaines zones périurbaines car, pour les jeunes des classes moyennes y résidant, la ville est trop proche pour y prendre un logement, ou ceux-ci sont trop chers ; ce qui entraîne de nombreux et fatigants déplacements.
À cet égard on peut prendre l’exemple de Poitiers, où la réussite au baccalauréat est très honorable, mais où peu de bacheliers poursuivaient des études supérieures. La région a organisé un programme d’accompagnement à la mobilité afin de permettre aux jeunes d’accéder à l’information dès le lycée en affrétant des bus pour visiter l’université et assister à des cours. Par ailleurs, la pratique de la caution locative, qui a débuté en région Aquitaine et s’est étendue à tout le pays, constitue un excellent dispositif d’accompagnement de la vie étudiante.
La question de l’adéquation du périmètre des ComUE avec celui des régions est régulièrement posée ; or il me semble que le sujet doit être pris en amont. En premier lieu, il convient de considérer le territoire, ce qui a clairement été dit par le président de l’université de Picardie où l’accès à l’emploi est difficile, le chômage important, et où pour des raisons en quelque sorte culturelles, les jeunes ne veulent pas, ou pensent qu’ils ne peuvent pas, accéder à l’enseignement supérieur.
Un tel territoire a besoin d’un projet de partenariat impliquant des entreprises, les organismes d’information, etc. C’est le bassin de vie ainsi créé qui va justifier la création de la ComUE ou du regroupement, et, in fine, leur gouvernance ; or, je constate que la gouvernance est souvent prise pour préalable. Ainsi, le regroupement universitaire doit être conçu à partir du projet local ; c’est à partir de là que les compétences peuvent être judicieusement réparties.
Par ailleurs, l’émergence des IDEX à conduit à s’interroger sur les fusions universitaires, qui semblaient constituer la structure la plus propice à l’obtention de ces financements. Aujourd’hui, sur l’ensemble des regroupements, vingt-cinq sont des ComUE ; les auditions ont montré que ces structures étaient perçues comme des paliers de réflexion susceptibles d’évoluer.
La question de l’intégration des docteurs pose le problème presque culturel de leur présence au sein d’entreprises, car ils viennent concurrencer les ingénieurs et les écoles qui les forment. Il s’agit d’un réel tropisme : comment le docteur trouve-t-il sa place dans l’entreprise ? Car il n’est pas pris en compte dans les conventions collectives et l’État lui-même est loin d’être exemplaire à cet égard.
M. Benoist Apparu, rapporteur. Monsieur Emeric Bréhier, vous avez raison d’affirmer que des différences subsistent entre la droite et la gauche en matière universitaire, mais je ne doute pas que vous accomplissiez le chemin qu’il vous reste à parcourir sur l’autonomie et la sélection en M1 pour nous rejoindre complètement !
La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) n’a évidemment pas tout changé et on peut lui adresser des critiques, notamment le fait que l’autonomie donnée aux établissements universitaires ne s’est pas accompagnée d’une réforme de l’ancienne direction générale de l’enseignement supérieur (DGES), ce découplage générant un immense décalage. Il n’en demeure pas moins qu’il existe un avant et un après LRU ; en effet cette loi a amorcé l’autonomie, aujourd’hui acceptée par presque tout le monde. Je regrette que la loi relative à l’enseignement supérieur et la recherche (ESR) n’ait pas engagé la deuxième étape, qui s’avère indispensable.
Des manifestations ont eu lieu contre la loi LRU, ce qui est normal car il ne faut quand même pas s’attendre à ce que les syndicats étudiants acceptent l’ombre d’un début d’une réforme. Ce serait contradictoire avec ce qu’ils sont dans notre pays.
Il y a souvent des points de crispation dans les débats parlementaires, mais ils s’oublient assez vite. Il y en a eu sur l’article 2, et il est bon que ce sujet soit derrière nous.
S’agissant des docteurs, nous ne légiférons pas pour les branches, notre problème principal est d’ordre culturel. Les membres de l’élite mondiale sont à bac +8, alors que ceux de l’élite française, passés par les grandes écoles, sont à bac +5 : cette différence saute aux yeux dans les conseils d’administration des grandes entreprises.
Je reste totalement défavorable à la sélection à l’entrée à l’université, car les taux d’accès et de diplômés de l’enseignement supérieur doivent progresser dans notre pays. Cet objectif correspond à nos engagements pris dans le cadre du processus de Bologne et de la stratégie de Lisbonne. Nous ne devons pas limiter l’accès à l’enseignement supérieur !
La question de l’orientation est différente : comment faire en sorte que le jeune entrant dans l’enseignement supérieur se retrouve dans une formation correspondant à son envie et à ses compétences ? Que l’on qualifie l’orientation de « positive » ou de « sélective », il convient de relever ce défi pour que le jeune soit diplômé de l’enseignement supérieur.
Il existe différentes approches de la sélection en M1 et M2, et certains considèrent que tout le monde doit achever le M2. Le marché du travail français a-t-il besoin de cadres supérieurs à bac +5 aussi nombreux que les étudiants entrant en L1 ? La réponse est non. Nous avons besoin de former des employés de très bon niveau, des ouvriers très qualifiés – telle est la vocation du bac professionnel –, des cadres intermédiaires qui iront jusqu’au niveau L3, et des cadres supérieurs pour notre industrie et nos services, titulaires d’un bac +5. Tant que le nombre de sorties du système universitaire ne répondra pas aux besoins de l’économie française, le décalage s’accentuera.
Le nombre de niveaux de sortie ne correspond ni aux demandes des milieux économiques, ni aux standards internationaux, ni même au processus de Bologne, pourtant initié par un rapport de M. Jacques Attali repris par le ministre de l’époque, M. Claude Allègre ! Le rapport ne s’intitulait pas « LMD », mais « 3-5-8 » ; or nous avons adopté le schéma du LMD, mais nous avons quand même des diplômés à bac +2, +3, +4 et +5. Autour d’une formation à vocation professionnelle – qu’elle se nomme bachelor ou autre et qui regrouperait les sections de technicien supérieur (STS), les instituts universitaires de technologie (IUT) et les formations bachelor existantes –, on créerait un vrai niveau de sortie à bac +3. On aurait également une sortie à bac +5 après une licence et un master sélectifs, l’ensemble gagnant en simplicité et en lisibilité.
Je ne pense pas que le périmètre géographique des régions doive devenir la référence de l’ensemble des politiques publiques françaises, notamment universitaires. Une université doit correspondre à un bassin de vie et de recrutement, indépendamment des limites de la région. La loi offre aux départements la possibilité de quitter une région pour en rejoindre une autre, mais cela ne devrait pas avoir d’impact sur le périmètre de la ComUE. Celle-ci doit être un projet, comme le disait Mme Sandrine Doucet, délié des limites territoriales. L’idée du président de l’Aquitaine de mettre en cohérence les ComUE et les régions ne me paraît donc pas bonne.
Les universités mondiales les plus prestigieuses ne comptent pas plus de 30 000 étudiants, alors que la plus petite ComUE française dépasse ce nombre. On est en train de créer des mastodontes de 120 000 à 150 000 étudiants quand toutes les grandes universités de recherche dans le monde n’en ont pas plus de 30 000 ! Harvard, la plus grande, compte à peine plus de 29 000 étudiants et le MIT 10 000. On doit accepter la différence de vocation entre les universités de notre pays : cinq à huit d’entre elles seraient des pôles de recherche à vocation mondiale et les autres chercheraient avant tout à offrir un accès direct à l’emploi à ses diplômés. Il ne faut pas suivre les standards pour les standards, mais il y a lieu de rechercher l’efficacité ; or le système universitaire français n’est pas le plus efficace au regard des classements internationaux.
Le débat sur les droits d’inscription constitue un serpent de mer français ; ce sujet peut mettre rapidement quelques dizaines de milliers d’étudiants dans la rue, mais les universités font face à une équation budgétaire impossible. La loi LRU peut ne pas être totalement étrangère à cette situation, mais la cause principale tient à l’organisation globale de notre système éducatif. Les rapports du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA en anglais) montrent que les meilleurs systèmes consacrent beaucoup d’argent aux préapprentissages et à l’enseignement supérieur, et beaucoup moins aux collèges et aux lycées ; au lieu de cette répartition en « U », la France dispose d’un schéma en « N » où de faibles ressources sont allouées aux préapprentissages et à l’enseignement supérieur, et où les collèges et les lycées reçoivent beaucoup de crédits. Il nous faudra réorienter nos efforts en redonnant de l’air à notre enseignement supérieur, en insistant sur les préapprentissages et en tirant les conséquences de l’état de nos finances publiques pour le collège et le lycée.
Mme Sandrine Doucet, rapporteure. Nous avons déjà donné de l’air à l’enseignement supérieur en lui allouant 9 milliards d’euros supplémentaires depuis 2012. La taille raisonnable des universités étasuniennes par rapport à celle des françaises ne constitue pas un facteur déterminant ; les universités aux États-Unis sont hors-sol, alors que nous demandons aux nôtres de rayonner internationalement tout en répondant à des questions territoriales basiques.
M. Benoist Apparu, rapporteur. Je crains que l’on échoue à tout attendre d’un même centre universitaire. On ne peut pas demander aux universités d’avoir à la fois un rayonnement international et d’assurer un emploi local à ses diplômés, car lorsque l’on fixe deux priorités, il y en a souvent une de trop.
Le système américain ne représente pas un modèle en soi, mais cinq ou six universités y jouissent d’un prestige et d’un recrutement des étudiants et des chercheurs mondiaux. Nous devons avoir cet équivalent en France si nous voulons que notre pays retrouve de l’attractivité. À côté de ces universités, les autres établissements américains possèdent une niche de recherche à vocation internationale, et l’on pourrait transposer cette répartition en France. La petite université de Reims pourrait, par exemple, se spécialiser dans la recherche à très haut niveau dans les domaines agricole et viticole, mais sa vocation principale consiste à former les futurs cadres dont nous avons besoin. Demander aux 70 établissements universitaires français d’avoir en même temps une vocation de recherche mondiale et une autre de dimension territoriale conduirait à l’échec.
La Commission décide, en application de l’article 145, alinéa 7, du Règlement, à l’unanimité, d’autoriser la publication du rapport d’information.
*
* *
1. Liste des personnes auditionnées
(par ordre chronologique)
Ø Université Paris-Diderot VII – Mme Christine Clerici, présidente
Ø Université Paris-Seine communauté d’universités et d’établissements (ComUE) – Mme Anne-Sophie Barthez, présidente
Ø Table ronde ComUE Université de Paris-Saclay :
– Université Paris-Saclay, communauté d’universités et d’établissements (ComUE) – M. Gilles Bloch, président
– Université Paris-Sud – M. Jacques Bittoun, président
– Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Mme Anne Peyroche, directrice générale déléguée à la science
– École supérieure de commerce de Paris – Europe (ESCP Europe) – M. Franck Bournois, directeur général
– Chambre de commerce et d’industrie région Paris Île-de-France – Mme Véronique Étienne-Martin, directrice de cabinet du président et du directeur général (131)
Ø Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) – M. Vincent Berger, directeur de la recherche fondamentale, ancien rapporteur général des assises nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche (automne 2012) (132)
Ø Communauté d’universités et d’établissements d’Aquitaine (ComUE d’Aquitaine) – M. Vincent Hoffmann-Martinot, président
Ø Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche – M. Jean-Richard Cytermann, inspecteur général, chef du service de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
Ø Communauté d’universités et d’établissements (ComUE) de l’Université Paris-Est (UPE) – M. Philippe Tchamitchian, administrateur provisoire
Ø Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) – M. Olivier Montagne, président
Ø Communauté d’universités et d’établissements d’Aquitaine (ComUE d’Aquitaine) – M. Vincent Hoffmann-Martinot, président
Ø Table ronde Instituts universitaires de technologie (IUT) :
– Institut universitaire de technologie Paris Descartes – M. Guillaume Bordry, directeur
– Institut universitaire de technologie Paris Diderot – M. Steeve Reisberg, directeur
– Institut universitaire de technologie de Montreuil – M. André-Max Boulanger, directeur
– Assemblée des directeurs d’institut universitaire de technologie (ADIUT) – M. Rodolphe Dalle, vice-président
– Union Nationale des présidents d’institut universitaire de technologie (UNPIUT) – M. Jean-Paul Vidal, président, et Mme Sylviane Debail, membre du bureau
Ø Communauté d’universités et d’établissements (ComUE) Paris-Lumière – M. Pierre André Jouvet, président
Ø Université Paris Ouest Nanterre-La Défense – M. Jean-Francois Balaudé, président
Ø Table ronde ComUE Université Paris Sciences & Lettres :
– Université de recherche Paris Sciences & Lettres – PSL Research university, M. Thierry Coulhon, président de la comUE
– École nationale supérieure de chimie de Paris – M. Christian Lerminiaux, directeur
– École normale supérieure (ENS) – M. Marc Mézard, directeur
– Université Paris-Dauphine – M. Laurent Batsch, président
– École nationale supérieure des beaux-arts – M. Jean-Marc Bustamante, directeur
– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris – M. Bruno Mantovani, directeur, et M. François Laurent, directeur adjoint
Ø Université de Picardie Jules Verne – M. Michel Brazier, président (visioconférence)
Ø Mme Sophie Béjean, rectrice de l’Académie de Strasbourg – Chancelière des Universités d’Alsace, et présidente du Comité d’expertise de la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur (StraNES)
Ø Fédération des Établissements d’Enseignement Supérieur d’Intérêt Collectif (FESIC) – M. Philippe Choquet, vice-président, et Mme Delphine Blanc-Le Quilliec, directrice des relations institutionnelles
Ø Fédérations d’établissements susceptibles d’être reconnus établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) :
– Union des nouvelles facultés libres (UNFL) – M. Michel Boyance, président
– Union des établissements supérieurs catholique (UDESCA) – M. Jean-Louis Vichot, délégué général
– Union des grandes écoles indépendantes (UGEI) (133) – M. Jean-Michel Nicolle, président, et Mme Séverine Messier, déléguée générale
Ø Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) – M. Michel Cosnard, président
Ø Table ronde Classes prépas et BTS
- Association des proviseurs des lycées ayant des classes préparatoires aux grandes écoles (APLCPGE) – M. Jean Bastianelli, Jean Bastianelli, président et proviseur du Lycée Louis-le-Grand, et Mme Martine Breyton, secrétaire générale et proviseure du Lycée Lakanal à Sceaux
- Syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges (SNFOLC) – Mme Cécile Kohler, secrétaire nationale
- Syndicat général de l’Éducation nationale – Confédération Française Démocratique du Travail (SGEN-CFDT) – M. Christophe Bonnet, ingénieur d’études à l’université Sorbonne nouvelle-Paris 3, secrétaire fédéral, et Mme Claudine Ledoux, proviseure de l’ENC Bessières adhérente
- Fédération de l’enseignement privé – Confédération Française Démocratique du Travail (FEP-CFDT) – M. Bruno Lamour, secrétaire général, et Mme Marie-Thérèse Debatisse, secrétaire nationale
- Union nationale technique de l’enseignement privé (UNETP) – Mme Danièle Roussillon, vice-présidente, et M. Vincent Fléter, membre du bureau et secrétaire
- Syndicat national unitaire des personnels de direction de l’Éducation nationale-FSU (snU.pden-FSU) – M. Éric Mansencal, secrétaire général adjoint et proviseur du lycée Thibaut de Champagne de Provins
- Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN-UNSA) –M. Philippe Tournier, secrétaire général, et M. Pascal Charpentier, secrétaire national
Ø Table ronde Enseignement supérieur
– Syndicat national de l’enseignement supérieur – Fédération Syndicale Unitaire (SNESUP – FSU) – Mme Heidi Charvin, secrétaire nationale en charge du secteur recherche, M. Hervé Christofol, secrétaire général, et M. Pierre Chantelot, secrétaire national en charge du secteur des formations
- Sup’Recherche – Union nationale des syndicats autonomes (Sup’Recherche-UNSA) – M. Stéphane Leymarie, secrétaire général
- Syndicat national des personnels de la recherche et des établissements de l’enseignement supérieur – Force Ouvrière (SNPREES-FO) – M. Alain Bretto, secrétaire national et professeur des universités
- Sup’Autonome – M. Michel Gay, secrétaire général et professeur des universités
- Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture (FERC sup CGT) – Mme Christel Poher, technicienne en documentation, co-secrétaire, et M. Vincent Martin, enseignant-chercheur, membre du bureau national
Ø M. Fabrice Melleray, professeur des universités à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, spécialiste de la fonction publique universitaire
Ø Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche - Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) – Mme Simone Bonnafous, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, Mme Rachel-Marie Pradeilles-Duval, cheffe de service de la stratégie des formations étudiantes et de la vie étudiante, et M. Éric Piozin, chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l’immobilier
Ø Table ronde étudiants
– Promotion et défense des étudiants (PDE) – M. Quentin Panissod, président, et M. François Gaudré, vice-président
- Fédération des Associations Générales Étudiantes (FAGE) – M. Tarek Mahraoui, vice-président en charge des affaires académiques
- Union nationale des étudiants de France (UNEF) – Mme Marthe Corpet, vice-présidente, et Mme Lara Bakech, responsable des questions universitaires
- Union nationale-interuniversitaire (UNI) – M. Edgar Mathet, délégué national, et M. Jens Villumsen, délégué national
Ø Conférence des grandes écoles (134) – M. Francis Jouanjean, délégué général, Mme Nadia Hilal, chargée des relations institutionnelles
Ø Syndicat national du personnel technique de l’enseignement supérieur et de la recherche (SNPTES) – M. Laurent Diez, secrétaire général, M. Alain Halère, secrétaire général adjoint, M. Alain Favennec, secrétaire général adjoint, et M. Jacques Drouet, chargé de mission
Ø Mme Geneviève Fioraso, députée de l’Isère, ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ø M. Thierry Mandon, Secrétaire d’État de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ø Conférence des présidents d’université (CPU) (135) – M. Jean-Loup Salzmann, président, M. Khaled Bouabdallah, vice-président et président de l’Université de Lyon, et M. Karl Stoeckel, conseiller parlementaire
– Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013 relatif aux conditions d’exercice du droit de suffrage, à la composition des collèges électoraux et aux modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
– Décret n° 2014-297 du 5 mars 2014 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics et au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire
– Décret n° 2014-321 du 10 mars 2014 relatif à la publication par voie électronique des bilans sociaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
– Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
– Décret n° 2014-610 du 11 juin 2014 relatif au pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée
– Décret n° 2014-761 du 2 juillet 2014 portant modification du décret n° 2012-572 du 24 avril 2012 relatif au Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle
– Décret n° 2014-801 du 16 juillet 2014 modifiant le décret n° 85-831 du 2 août 1985 portant organisation et fonctionnement de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique
– Décret n° 2014-921 du 18 août 2014 modifiant diverses dispositions relatives au droit au séjour et au travail des étrangers
– Décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences
– Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014 relatif aux modalités d’inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
– Décret n° 2014-1073 du 22 septembre 2014 relatif aux modalités d’inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles de lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
– Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
– Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
– Décret n° 2014-1421 du 28 novembre 2014 relatif au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
– Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l’article L. 533-1 du code de la recherche
– Décret n° 2014-1678 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de l’Académie nationale de médecine
– Décret n° 2015-668 du 15 juin 2015 relatif à la coopération internationale des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
– Décret n° 2016-1020 du 26 juillet 2016 relatif aux conventions conclues en application de l’article L. 822-1 – 8ème alinéa, du code de l’éducation et fixant les critères d’attribution de certaines catégories de logements destinés aux étudiants
3. Liste des préconisations sur les carrières d’enseignants-chercheurs (Rapport IGAENR n° 2015-073 - décembre 2015)
Préconisation n° 1 : procéder à une évaluation des effectifs d’enseignants-chercheurs recrutés sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, et à une analyse du fonctionnement de ce dispositif dans les établissements.
Préconisation n° 2 : étudier l’hypothèse d’une fusion des corps d’enseignants-chercheurs et de chercheurs ou a minima d’un rapprochement de ces corps, dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur leurs missions et leurs obligations de service.
Préconisation n° 3 : en fonction des résultats de l’évaluation par le HCERES, de l’expérimentation en cours de décontingentement des postes ouverts aux recrutements selon la procédure du 46.1 dans les sections du CNU de sciences économiques (05) et de sciences de gestion (06), étendre éventuellement le dispositif de décontingentement, aux autres disciplines d’agrégation de l’enseignement supérieur.
Préconisation n° 4 : veiller à ce que le projet de modification des textes réglementaires relatifs aux écoles doctorales et au doctorat, actuellement en cours de discussion, intègre des dispositions robustes visant à garantir le niveau des doctorats délivrés, et prévoir une évaluation de l’application du dispositif réglementaire dans les deux ou trois ans suivant sa mise en place.
Préconisation n° 5 : dans le cadre de la réglementation actuelle des comités de sélection :
– encourager l’ouverture des comités de sélection à des représentants de la gouvernance de l’établissement ainsi que de la composante et du laboratoire concernés par le recrutement ;
– faciliter la participation des membres extérieurs, notamment étrangers, en allongeant les calendriers de recrutement des comités de sélection ;
– étudier des solutions de mise en place de comités de sélection dans le cadre de regroupements d’établissements.
Préconisation n° 6 : généraliser dans les établissements la mise en œuvre d’opérations de recrutement correspondant aux pratiques en vigueur au niveau international (visites préalables de candidats potentiels, échanges avec les futures équipes, allongement des temps d’auditions et réalisations de séminaires par les candidats, véritables entretiens d’embauche). Envisager des incitations ministérielles dans le cadre de la politique contractuelle pour favoriser cette évolution des pratiques.
Préconisation n° 7 : encourager les établissements à faire auditer leurs processus internes de recrutement dans le but d’établir des règles internes propres à garantir un fonctionnement impartial des différentes instances. Encourager également la mise en place d’un dispositif de certification de ces processus.
Préconisation n° 8 : instaurer une procédure de titularisation des enseignants-chercheurs plus formalisée et plus rigoureuse.
Préconisation n° 9 : faire un bilan des actions menées au sein du CNU, en réponse à la demande ministérielle en vue d’une harmonisation du fonctionnement des différentes sections.
Mettre en place sous l’égide de la DGRH, un groupe de travail sur l’organisation et le fonctionnement du CNU, auquel participeront la CPCNU et la CPU ainsi que des représentants des EPST et des personnalités universitaires étrangères.
Préconisations n° 10 : dans l’hypothèse du maintien à court ou moyen terme de la qualification comme condition pour se présenter à un concours d’enseignant-chercheur dans les conditions de droit commun :
– étendre le dispositif actuel des dérogations règlementaires aux candidats ayant fait la preuve de leurs qualités en enseignement et en recherche,
– étudier la faisabilité juridique d’un dispositif de dérogation à l’article L. 952-6 du code de l’éducation dans le cadre d’une procédure expérimentale pour une durée de cinq ans.
Préconisation n° 11 : affiner le suivi de l’endo-recrutement et la définition des endo-recrutés pour distinguer les enseignants-chercheurs ayant acquis la totalité de leur expérience antérieure dans l’établissement recruteur, de ceux qui tout en ayant soutenu leur thèse ou eu des fonctions de MCF dans cet établissement, ont réalisé une ou des mobilités dans d’autres établissements, en tant que post doctorant, enseignant-chercheur ou chercheur.
Pour favoriser la diminution de l’endo-recrutement, préférer, sauf exception, les politiques incitatives dans le cadre contractuel à un supplément de réglementation nationale.
Préconisation n° 12 : faire évoluer la règlementation, notamment en matière de reclassement, pour favoriser le recrutement d’enseignants-chercheurs étrangers ou français ayant acquis une expérience professionnelle internationale ou dans d’autres fonctions.
Préconisation n° 13 : (pour le MENESR) : poursuivre les partenariats avec des équipes de recherche pour approfondir la connaissance des carrières des enseignants-chercheurs.
Préconisation n° 14 : renforcer le dispositif statutaire de prise en compte des mobilités géographiques et fonctionnelles dans la progression de carrière des enseignants-chercheurs.
Préconisation n° 15 : promouvoir des recherches sur la définition d’outils d’évaluation de l’activité d’enseignement en s’inspirant des exemples étrangers existant.
Encourager le développement de l’évaluation des enseignements par les étudiants, notamment dans le cadre de la politique contractuelle.
Préconisation n° 16 : procéder à une analyse des référentiels des EPCSCP pour recenser les tâches les plus identifiées aujourd’hui, afin d’améliorer la connaissance de la part relative de chacune des composantes du métier et de mesurer l’intérêt d’une nouvelle définition des obligations de service.
Préconisation n° 17 : inciter les établissements à utiliser les dispositifs règlementaires de modulation des obligations réglementaires de service, dont ils disposent, afin, notamment, de diminuer le volume horaire d’enseignement des nouveaux MCF au profit de leur activité de recherche, et inversement de renforcer celui des enseignants-chercheurs qui opteraient pour une réorientation de leur mission dans le sens d’un plus grand investissement dans l’enseignement que dans la recherche.
Approfondir la réflexion sur une modification des obligations réglementaires de service d’enseignement des enseignants-chercheurs, dans le sens d’un assouplissement et d’une individualisation du dispositif, et engager des expérimentations dans ce sens.
Préconisation n° 18 : généraliser le suivi de carrière à toutes les sections du CNU et confier au HCERES une mission d’étude sur les modalités de mise en œuvre de l’évaluation individuelle des enseignants-chercheurs.
Préconisation n° 19 : réaliser un audit des formations réalisées au sein des écoles doctorales confié au HCERES ainsi qu’un référentiel des compétences à acquérir par les candidats à un concours de recrutement des enseignants-chercheurs.
Préconisation n° 20 : généraliser les dispositifs de formation des nouveaux MCF et les rendre obligatoires dans le cadre de la procédure de titularisation.
4. Liste des thèmes de la loi classés par titre, chapitre et article
(hors coordinations diverses)
TITRE Ier MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
CHAPITRE Ier Les missions du service public de l’enseignement supérieur
Article 1er Égalité du service public sur l’ensemble du territoire
Article 2 (article L. 121-3 du code de l’éducation) Extension des exceptions au principe de l’enseignement en langue française
Article 3 Rapport au Parlement sur l’impact des modifications apportées au principe de l’enseignement en français
Article 4 (article L. 123-1 du code de l’éducation) Instauration d’une stratégie nationale de l’enseignement supérieur et d’une coordination ministérielle du service public de l’enseignement supérieur
Article 6 (article L. 123-2 du code de l’éducation) Actualisation de la rédaction des dispositions relatives aux objectifs de l’enseignement supérieur
Article 7 (article L. 123-3 du code de l’éducation) Consécration de la mission de transfert des résultats de la recherche du service public de l’enseignement supérieur
Article 8 (article L. 123-4 du code de l’éducation) Contribution du service public de l’enseignement supérieur à la réussite des étudiants
Article 9 (article L. 123-4-2 du code de l’éducation [nouveau]) Mise à disposition de ses usagers par le service public de l’enseignement supérieur de services et ressources pédagogiques numériques
Article 10 (article L. 123-5 du code de l’éducation) Mission de transfert des résultats de la recherche vers les secteurs socio-économiques et d’appui aux politiques publiques
Article 11 (article L. 123-6 du code de l’éducation) Promotion des valeurs d’éthique et lutte contre les stéréotypes sexués
Article 12 (article L. 123-7 du code de l’éducation) Encouragement au développement de parcours comprenant des périodes d’études et d’activités à l’étranger
Article 13 (article L. 241-2 du code de l’éducation) Missions de l’inspection générale de l’éducation nationale et de la recherche
CHAPITRE II La politique de la recherche et du développement technologique
Article 14 (article L. 111-1 du code de la recherche) Objectif complémentaire de la politique nationale de la recherche
Article 15 (article L. 111-6 du code de la recherche) Stratégie nationale de la recherche
Article 16 (article L. 112-1 du code de la recherche) Objectif complémentaire de la politique publique de la recherche
Article 17 Livre blanc de l’enseignement supérieur et de la recherche
Article 19 Articulation des stratégies nationales et des schémas régionaux de l’enseignement supérieur et de la recherche
TITRE II LE CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Article 20 (article L. 232-1 du code de l’éducation) Réforme du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
TITRE III LES FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 21 Fourniture par les établissements scolaires disposant d’une formation d’enseignement supérieur de statistiques de réussite de leurs élèves et apprentis
Article 22 (article L. 611-2 du code de l’éducation) Introduction de l’alternance comme modalité à part entière de la formation dans l’enseignement supérieur
Article 23 (article L. 611-3 du code de l’éducation) Projet d’orientation universitaire et professionnelle des étudiants
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
Article 24 (article L. 611-5 du code de l’éducation) Missions des bureaux d’aide à l’insertion professionnelle
Article 26 (article L. 612-8 du code de l’éducation) Définition du stage en milieu professionnel
Article 27 (article L. 612-11 du code de l’éducation) Conditions de la gratification des stages
Article 28 (article L. 612-11 du code de l’éducation) Évaluation par les étudiants de la qualité de leur accueil en stage
Article 29 (article L. 611-8 du code de l’éducation) Obligation de rendre disponibles certains enseignements sous forme numérique
Article 30 Mise à disposition des statistiques produites par les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures
Article 31 Introduction de la formation à l’entreprenariat au sein de chaque cycle de l’enseignement supérieur
Article 32 (article L. 612-2 du code de l’éducation) Finalités du premier cycle de l’enseignement supérieur
Article 33 (article L. 612-3 du code de l’éducation) Orientation des bacheliers technologiques et professionnels et rapprochement entre lycées et établissements d’enseignement supérieur
Article 34 (article L. 612-4 du code de l’éducation) Poursuite d’études des étudiants de l’enseignement supérieur technologique court
Article 35 (article L. 612-7 du code de l’éducation) Poursuite d’insertion professionnelle des doctorants
Article 36 (article L. 612-9 du code de l’éducation) Encadrement des dérogations à la durée maximale de six mois pour les stages
Article 37 (article L. 613-1 du code de l’éducation) Accréditation des établissements
Article 39 (article L. 631-1 du code de l’éducation) Expérimentation de nouvelles modalités d’accès aux études médicales
Article 40 Expérimentation d’une première année commune aux formations paramédicales
Article 41 Rapport sur l’amélioration de la sélection et de la formation des futurs médecins
TITRE V LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
CHAPITRE Ier Les établissements publics d’enseignement supérieur
Article 42 (article L. 711-2 du code de l’éducation) Ajout des communautés d’universités et établissements à la catégorie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 43 Limite d’âge des dirigeants d’EPSCP
Article 44 Obligation de publicité de la liste des diplômes universitaires et de leurs enseignants
Section 1 La gouvernance des universités
Article 45 (article L. 712-1 du code de l’éducation) Administration de l’université
Article 46 (article L. 712-2 du code de l’éducation) Président de l’université
Article 47 (article L. 712-3 du code de l’éducation) Composition et pouvoir du conseil d’administration
Article 49 (articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l’éducation) Création et composition du conseil académique
Article 50 (article L. 712-6-1 du code de l’éducation) Compétences du conseil académique
Article 52 (article L. 713-1 du code de l’éducation) Liberté de créer des composantes
Article 55 (article L. 714-1 du code de l’éducation) Compétences des services communs internes aux universités
Section 2 Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur
Article 56 (articles L. 715-1 du code de l’éducation) Maintien de la structure actuelle des instituts et écoles ne faisant pas partie des universités et possibilité de se doter d’un conseil académique.
Article 58 (article L. 717-1 du code de l’éducation) Définition, fonctionnement des grands établissements et procédures de recrutement pour la nomination de leurs dirigeants
Article 59 (Chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime) Maintien de la compétence du conseil d’administration pour l’exercice du pouvoir disciplinaire dans les établissements de l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public
Section 3 Dispositions communes relatives à la composition des conseils
Article 60 (article L. 719-1 du code de l’éducation) Mode d’élection des membres des conseils
Article 61 Décret relatif à la parité entre les femmes et les hommes dans la désignation des personnalités extérieures
CHAPITRE II Coopération et regroupements des établissements
Article 62 (articles L. 718-2 à L. 718-15 [nouveaux] du code de l’éducation) Coopération de site entre différents établissements.
Article 63 Contrôle de la politique des ressources humaines des établissements par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche
Article 64 Publication des bilans sociaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article 66 (articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 344-1 à L. 344-10 du code de la recherche) Suppression des PRES et des dénominations « RTRA » et « CTRS »
CHAPITRE III Les établissements d’enseignement supérieur privés
Article 68 Formations de santé
Article 69 Mention par les établissements d’enseignement supérieur privés des formations sanctionnées par un diplôme d’État
Article 70 Rapport des établissements d’enseignement supérieur privés avec l’État
Article 71 (article L. 731-14 du code de l’éducation) Sanctions pénales en cas de délivrance de « master » en l’absence d’autorisation de délivrer des diplômes conférant le grade de master
Article 72 Transmission par le recteur aux services de la concurrence des publicités en infraction avec l’article L. 731-14 du code de l’éducation
TITRE VI LES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Article 73 Mobilité des personnels enseignants de l’enseignement supérieur
Article 74 Rapport en vue d’améliorer les carrières des enseignants-chercheurs
Article 75 (article L. 952-6-1 du code de l’éducation) Transfert aux conseils académiques des compétences en matière de recrutement des enseignants-chercheurs
Article 77 (article L. 952-24 du code de l’éducation) Assimilation des chercheurs aux enseignants-chercheurs dans les instances de gestion des ressources humaines des établissements d’enseignement supérieur
Article 78 (article L. 412-1 du code de la recherche) Prise en compte du doctorat pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie A
Article 79 Rapport sur la prise en compte du doctorat dans les recrutements de fonctionnaires de catégorie A
Article 80 (article L. 952-24 du code de l’éducation) Participation des post-doctorants recrutés par l’université aux élections des conseils
Article 81 (article L. 411-3 du code de la recherche) Valorisation de l’expérience acquise par les chercheurs dans le cadre de la participation à la création d’entreprise
Article 82 (article L. 411-4 du code de la recherche) Reconnaissance du doctorat dans le secteur privé
Article 83 Rapport sur l’évolution du statut d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER)
Article 84 (article L. 711-11 du code de l’éducation) Liberté pour les EPSCP de contracter avec des institutions étrangères ou internationales
Article 85 Rapport sur l’alignement des statuts des écoles territoriales et nationales d’art
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE
CHAPITRE Ier L’organisation générale de la recherche
Article 87 (article L. 113-1 du code de la recherche) Contrôle de l’efficacité de la dépense publique en faveur de la recherche privée par l’OPECST
Article 88 (article L. 114-1 du code de la recherche) Prise en compte des actions en faveur de la dimension participative de la culture scientifique dans l’évaluation de la recherche financée par des fonds publics
Article 90 (article L. 114-3-1 du code de la recherche) Création du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
Article 91 Rapport rendu par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sur son fonctionnement
Article 92 (article L. 114-3-3 du code de la recherche) Composition et fonctionnement du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
Article 95 Création du Conseil stratégique de la recherche
Article 96 Procédure de nomination des dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et de l’Agence nationale de la recherche
CHAPITRE II L’exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique
Article 97 (article L. 329-7 du code de la recherche) Valorisation et transfert renforcés de la recherche menée sur fonds publics
Article 98 Fonctionnement en réseau des centres techniques industriels
TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE Ier Dispositions diverses
Article 102 Suivi vaccinal des étudiants
Article 104 (Article L. 135 D du livre des procédures fiscales) Extension du bénéfice de la dérogation au secret professionnel en matière d’accès aux données fiscales en faveur des chercheurs
Article 105 (Article L. 811-3 du code de l’éducation) Rapport au Parlement sur les inégalités sociales dans l’enseignement supérieur
Article 106 (Article L. 822-1 du code de l’éducation) Modalités du transfert aux collectivités territoriales des résidences étudiantes
Article 107 (article L. 821-1 du code de l’éducation) Rôle du réseau des œuvres universitaires
Article 108 Modalités des transferts de compétences aux régions en matière de culture scientifique, technique ou industrielle
Article 109 Modalités du retrait d’un titre de séjour avec la mention scientifique-chercheur
Article 110 Statut de l’Académie nationale de médecine
Article 111 (article L. 328-1 du code de la recherche) Académie des technologies
Article 113 Personnels de l’établissement public « Universcience »
Article 114 Conséquences du transfert éventuel des agents de Supélec
Article 115 Statut des personnels de l’école supérieure d’électricité
CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales
Article 116 Dispositions transitoires permettant aux universités d’installer leurs nouvelles instances
Article 117 Dispositions transitoires applicables aux établissements publics de coopération scientifique existants en vue de leur transformation en communautés scientifiques
Article 118 Délai d’adoption des décrets relatifs aux rattachements d’établissements existants
Article 119 Date de transfert des biens, droits et obligations de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
Article 120 Délai de mise en œuvre du rapprochement des lycées disposant de formations d’enseignement supérieur et des établissements publics d’enseignement supérieur
Article 121 Dispositions concernant la première accréditation d’un établissement public d’enseignement supérieur lorsque la durée du contrat le liant à l’État restant à courir est inférieure à un an
Article 122 Entrée en vigueur des nouvelles procédures de recrutement et d’affectation des personnels enseignants-chercheurs
Article 123 (Article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail) Prolongation de l’expérimentation des contrats à objet défini
Article 124 Modification des codes de la recherche et de l’éducation et modalités d’extension et d’adaptation de la loi à l’outre-mer
Article 125 Application aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de la loi
Article 126 Modalités d’extension et d’adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Article 127 Modalités d’application à Mayotte
Article 128 Adaptation du titre IV à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique
5. Regroupement d’établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche
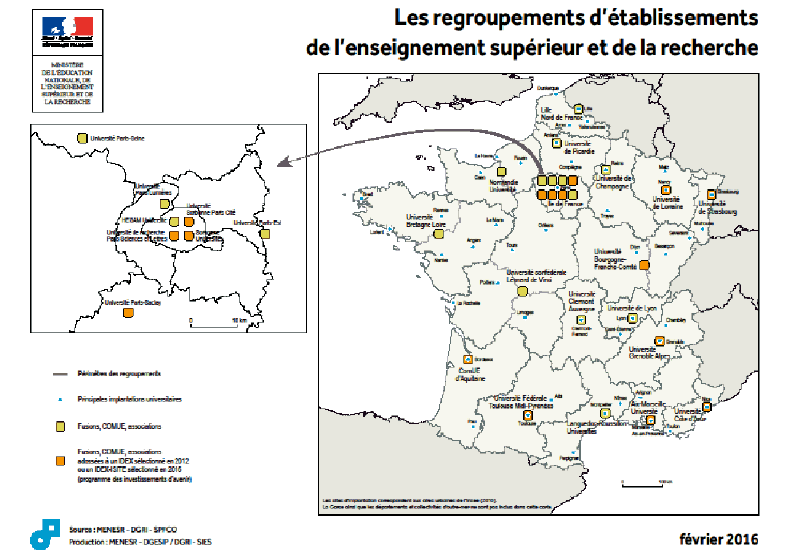
6. Rapport d’autoévaluation du HCERES : forces et faiblesses
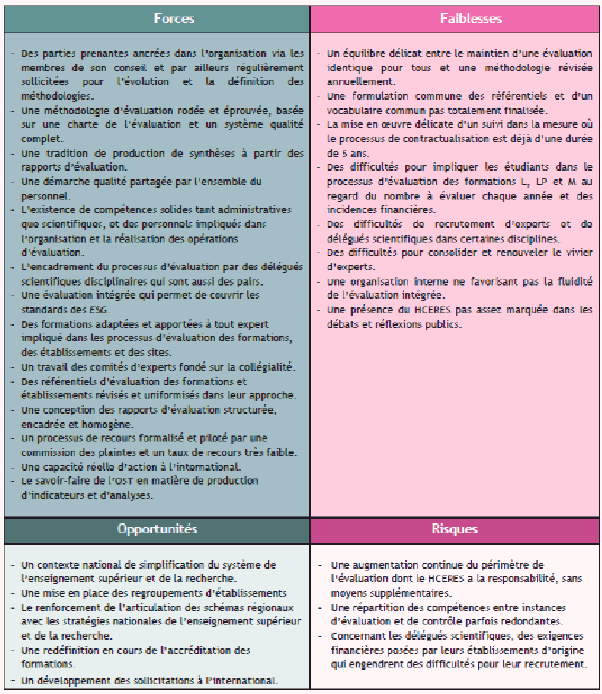
Source : Rapport HCERES 2016.
1 () Loi ESR dans la suite de ce rapport.
2 () Loi LRU dans la suite de ce rapport.
3 () Voir, cependant, la note d’information 15-05 du MESR : Profil et parcours des étudiants en première année commune aux études de santé.
4 () Audition du 22 septembre 2016.
5 () Annexe n° 3.
6 () JO Sénat du 23 juin 2016.
7 () HCERES, Rapport d’autoévaluation, mars 2016.
8 () Annexe n° 6.
9 () Audition du 26 mai 2016.
10 () OVE Infos, n° 32.
11 () Audition du 7 avril 2016.
12 () Pour une société apprenante, propositions pour une stratégie nationale de l’enseignement supérieur, 8 septembre 2015.
13 () Audition du 26 mai 2016.
14 () Stratégie nationale de recherche - Rapport de propositions et avis du Conseil stratégique de la recherche,
6 mars 2015.
15 () Stratégie nationale de recherche et d’innovation – rapport général – 23 juillet 2009.
16 () Audition du 7 juillet 2016.
17 () Audition du 22 septembre 2016.
18 () Audition du 22 septembre 2016.
19 () Audition du 9 mars 2016.
20 () Ministère de l’éducation nationale, Repères et références statistiques 2016, août 2016.
21 () Audition du 22 septembre 2016.
22 () Voir sur ce point le rapport d’information n° 2951 de M. Emeric Bréhier : « Les liens entre le lycée et l’enseignement supérieur » Assemblée nationale, 8 juillet 2015.
23 () Audition du 24 mars 2016.
24 () Audition du 2 juin 2016.
25 () Audition du 7 avril 2016.
26 () Audition du 2 juin 2016.
27 () Audition du 22 septembre 2016.
28 () Audition du 10 mars 2016.
29 () Audition du 2 juin 2016.
30 () Audition du 22 septembre 2016.
31 () France Stratégie, La note d’analyse n° 36, novembre 2015.
32 () Audition du 2 juin 2016.
33 () Audition du 7 juillet 2016.
34 () Audition du 7 avril 2016.
35 () Audition du 7 avril 2016.
36 () Audition du 7 avril 2016.
37 () Audition du 7 avril 2016.
38 () Audition du 7 avril 2016.
39 () Audition du 2 juin 2016.
40 () Audition du 2 juin 2016.
41 () Audition du 2 juin 2016.
42 () Audition du 2 juin 2016.
43 () M. Christian Lerminiau, Rapport à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à M. le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, septembre 2015.
44 () Audition du 24 mars 2016.
45 () Audition du 22 septembre 2016.
46 () Audition du 7 avril 2016.
47 () Audition du 7 avril 2016.
48 () Audition du 12 mai 2016.
49 () Audition du 7 avril 2016.
50 () CE, 10 février 2016, nos 394594 et 394595.
51 () Audition du 22 septembre 2016.
52 () Audition du 10 mars 2016.
53 () Audition du 22 septembre 2016.
54 () Audition du 2 juin 2016.
55 () Audition du 10 mars 1016.
56 () Audition du 24 mars 2016.
57 () Audition du 7 avril 2016.
58 () Audition du 2 juin 2016.
59 () Audition du 12 mai 2016.
60 () Audition du 7 juillet 2016.
61 () Audition du 26 mai 2016.
62 () Audition du 26 mai 2016.
63 () Audition du 26 mai 2016.
64 () Audition du 26 mai 2016.
65 () Audition du 7 juillet 2016.
66 () Audition du 12 mai 2016.
67 () Audition du 24 mars 2016.
68 () Annexe n° 5
69 () La ComUE Université confédérale Léonard de Vinci regroupe les établissements suivants : les universités de La Rochelle, Limoges, Orléans, Poitiers et Tours, l’École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique et l’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire.
70 () En janvier 2016, la ComUE Université de Bretagne Loire regroupait : universités : Université d’Angers ; Université de Brest (UBO) Université de Bretagne-Sud (UBS) ; Université du Mans ; Université de Nantes ; Université de Rennes-I ; Université Rennes-II ; écoles : École centrale de Nantes ; École des hautes études en santé publique (EHESP) ; École nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB) ; École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM) ; École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) ; École nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) ; École nationale supérieure des techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) ; Groupe des écoles nationales d’économie et statistiques (ENSAI : École nationale de la statistique et de l’analyse de l’information) ; École normale supérieure de Rennes (ENS Rennes) ; École supérieure d’agriculture (ESA) ; Institut d’études politiques de Rennes (Sciences Po Rennes) ; Institut mines-télécom (Télécom Bretagne) ; Institut national des sciences appliquées de Rennes (INSA Rennes) ; Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest) ; École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS) ; organismes de recherche et agences d’expertise : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement du travail (ANSES) ; Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ; Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ; Institut de recherche pour le développement (IRD).
71 () Audition du 22 septembre 2016.
72 () Audition du 10 mars 2016.
73 () Audition du 22 septembre 2016.
74 () Audition du 12 mai 2016.
75 () Audition du 26 mai 2016.
76 () Audition du 7 juillet 2016.
77 () Audition du 2 juin 2016.
78 () Audition du 9 mars 2016.
79 () Audition du 7 juillet 2016.
80 () Audition du 7 avril 2016.
81 () La ComUE Université Paris Lumières regroupe deux établissements d’enseignement supérieur : l’Université Paris-VIII Vincennes - Saint-Denis ; l’Université Paris-X Ouest Nanterre La Défense, et un organisme de recherche : le Centre national de la recherche scientifique ; auxquels viennent de s’associer l’École nationale supérieure Louis Lumière et l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (septembre 2016).
82 () Audition du 7 juillet 2016.
83 () Audition du 22 juillet 2016.
84 () Audition du 16 mars 2016.
85 () La ComUE Aquitaine se compose de l’École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine, l’Institut d’études politiques de Bordeaux, l’Institut polytechnique de Bordeaux, l’université de Bordeaux, l’université Bordeaux-III, l’université de Pau et des Pays de l’Adour.
86 () Paris sciences et lettres : ComUE comprenant 25 membres, Chimie ParisTech ; Collège de France ; Conservatoire national supérieur d’Art Dramatique ; Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ; École des Hautes Études en Sciences sociales ; École Française d’Extrême Orient ; École nationale des chartes ; École nationale supérieure des Arts Décoratifs ; École nationale supérieure des beaux-arts ; École normale supérieure ; École pratique des hautes études ; École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris ; Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherche ; IBPC - Fondation Edmond de Rothschild ; Institut Curie ; Institut Louis-Bachelier ; La Fémis ; Lycée Henri-IV ; MINES ParisTech ; Observatoire de Paris ; Université Paris-Dauphine ; CNRS ; INRIA ; INSERM ; Institut Pasteur ; NB. au sein de PSL et de manière autonome, l’association Art et Recherche réunit les cinq écoles d’art qui en sont membres : Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École nationale supérieure des Arts décoratifs, École nationale supérieure des Beaux-Arts, La Fémis.
87 () Audition du 10 mars 2016.
88 () La ComUE Paris Saclay comprend - au titre des établissements d’enseignement supérieur : l’Ecole centrale des arts et manufactures, l’Ecole des hautes études commerciales, l’Ecole normale supérieure de Cachan, l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, l’Ecole polytechnique, l’Ecole supérieure d’électricité, le Groupe des écoles nationales d’économie et statistiques, l’Institut Mines-Télécom, l’Institut d’optique Graduate School, l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech), l’université Paris-XI et l’université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines ; - au titre des organismes de recherche : le Centre national de la recherche scientifique, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, l’Institut des hautes études scientifiques, l’Institut national de la recherche agronomique, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’Institut national de recherche en informatique et automatique, l’Office national d’études et de recherches aérospatiales.
89 () Audition du 10 mars 2016.
90 () Audition du 10 mars 2016.
91 () Audition du 24 mars 2016.
92 () Audition du 7 juillet 2016.
93 () Audition du 16 mars 2016.
94 () Sorbonne Universités comprend les universités Pierre et Marie Curie, et Paris-Sorbonne ; l’Université de technologie de Compiègne, l’Insead (Institut européen d’administration des affaires), le Muséum national d’histoire naturelle, le Centre international d’études pédagogiques, le Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt, et le CNRS, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l’Institut national de recherche en informatique et automatique (Inria) et l’Institut de recherche pour le développement (IRD). L’université de Panthéon Assas lui est associée.
95 () Audition du 10 mars 2016.
96 () Audition du 10 mars 2016.
97 () Audition du 12 mai 2016.
98 () La ComUE « Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées » est composée des membres suivants : - au titre des établissements d’enseignement supérieur : l’Institut polytechnique de Toulouse, l’Institut national des sciences appliquées de Toulouse, l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace, l’Université Toulouse-I, l’Université Toulouse-II et l’Université Toulouse-III ; - au titre des organismes de recherche : le Centre national de la recherche scientifique.
99 () La ComUE « Université Sorbonne Paris Cité » est composée des membres suivants : au titre des établissements d’enseignement supérieur : l’École des hautes études en santé publique, l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), l’Institut national des langues et civilisations orientales, l’Institut de physique du globe de Paris, l’université Paris-III, l’université Paris-V, l’université Paris-VII, l’université Paris-XIII ; - au titre des organismes de recherche : le Centre national de la recherche scientifique, l’Institut national d’études démographiques, l’Institut national de recherche en informatique et automatique, l’Institut national de la recherche médicale, l’Institut de recherche pour le développement.
100 () Audition du 9 mars 2016.
101 () Audition du 2 juin 2016.
102 () Audition du 7 juillet 2016.
103 () Audition du 9 mars 2016.
104 () Audition du 24 mars 2016.
105 () Audition du 22 septembre 2016.
106 () Audition du 22 septembre 2016.
107 () Audition du 7 juillet 2016.
108 () Audition du 7 juillet 2016.
109 () Audition du 12 mai 2016.
110 () Audition du 12 mai 2016.
111 () Auditon du 22 septembre 2016.
112 () Audition du 12 mai 2016.
113 () Poste permanent sans en être titulaire au sens strict.
114 () Audition du 22 septembre 2016.
115 () Audition du 10 mars 2016.
116 () Audition du 9 mars 2016.
117 () Audition du 7 avril 2016.
118 () Audition du 24 mars 2016.
119 () Audition du 9 mars 2016.
120 () Audition du 10 mars 2016.
121 () Audition du 22 septembre 2016.
122 () Audition du 2 juin 2016.
123 () Audition du 10 mars 2016.
124 () « Le bilan de l’autonomie financière des universités »- Rapport n° 715 (2014-2015), 30 septembre 2015.
125 () Audition du 9 mars 2016.
126 () Audition du 24 mars 2016.
127 () Audition du 12 mai 2016.
128 () Audition du 2 juin 2016.
129 () Audition du 26 mai 2016.
130 () Table ronde du 22 juin 2016.
131 () Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
132 () Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
133 () Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
134 () Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
135 () Ce représentant d’intérêts a procédé à son inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
© Assemblée nationale