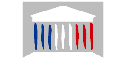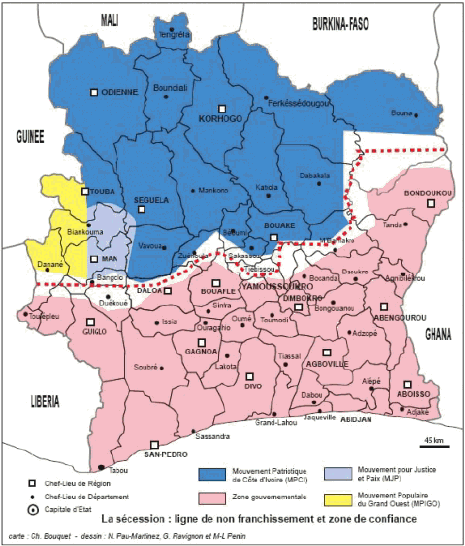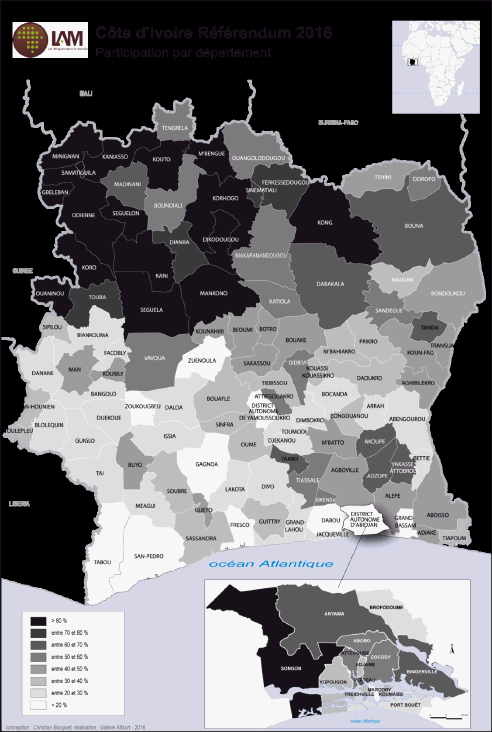______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 février 2017
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 27 avril 2016
sur la Côte d’Ivoire
Président
M. Philippe Cochet
Rapporteure
Mme. Seybah Dagoma
Députés
La mission d’information sur la Côte d’Ivoire est composée de : M. Philippe Cochet, président ; Mme Seybah Dagoma, rapporteure ; M. Jean-Paul Bacquet, M. François Loncle, M. Gérard Charasse, M. Patrick Balkany et M. Michel Terrot.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 7
I. 2011-2017 : VERS UNE RENAISSANCE IVOIRIENNE ? 11
A. UN TERRITOIRE RÉUNIFIÉ ET GLOBALEMENT PACIFIÉ 11
1. La Côte d’Ivoire vient de loin 11
2. Le rétablissement de la sécurité, une entreprise non linéaire 13
3. Une situation encore fragile 17
B. LES RESSORTS DE LA STABILISATION POLITIQUE 23
1. Le succès de l’alliance électorale Bédié-Ouattara 24
2. Une opposition qui a tendance à s’auto-exclure du jeu politique 27
3. La bonne tenue générale des échéances électorales 32
C. L’ÉCONOMIE RELANCÉE 35
1. De nombreux atouts à valoriser 35
2. Un impressionnant redressement depuis 2011 40
3. La confiance retrouvée de la communauté internationale et des bailleurs 46
D. UN NOUVEAU MOTEUR POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ? 50
1. Un relais aux moteurs nigérian et ghanéen 50
2. Vers une relance de l’intégration régionale ? 51
3. « Ghanivoire » : un potentiel à exploiter pour créer une dynamique ouest-africaine 54
4. La bonne santé de la Côte d’Ivoire, un enjeu essentiel pour le Sahel 58
E. UNE REINVENTION CULTURELLE AU SERVICE DU RAYONNEMENT DE LA COTE D’IVOIRE 60
1. Une tradition culturelle parmi les plus riches d’Afrique 60
2. La Côte d’Ivoire au cœur des évolutions artistiques de l’Afrique de l’ouest 62
3. Une volonté politique de structurer et soutenir le secteur culturel 65
II. UNE CROISSANCE AUX PIEDS D’ARGILE : DES DÉFIS CONSIDÉRABLES ET URGENTS À SURMONTER 67
A. L’URGENCE DU DÉVELOPPEMENT 67
1. Des indicateurs sociaux alarmants 67
2. « Approfondir » la croissance 71
3. Le défi de l’éducation 78
B. RASSEMBLER LES IVOIRIENS 82
1. La réconciliation nationale, un processus inachevé 82
2. Réfugiés, apatrides et migrants : trois illustrations des cicatrices persistantes 90
3. Au-delà des divisions héritées de la crise, un malaise social grandissant 93
4. Une priorité : intégrer les jeunes 98
C. RENFORCER L’ASSISE DE LA DÉMOCRATIE 101
1. Susciter un jeu politique plus inclusif 101
2. Renforcer les contre-pouvoirs 106
3. Réduire une corruption devenue systémique 108
4. Conforter l’indépendance et l’efficacité de la justice 111
D. CONSOLIDER LA SÉCURITÉ 114
1. L’armée a encore beaucoup de chemin à parcourir 115
2. Accélérer la réforme du secteur de la sécurité 118
3. Prévenir l’implantation de la menace terroriste en Côte d’Ivoire 119
E. RÉSOUDRE LA QUESTION FONCIÈRE 123
1. Une question ancienne 123
2. Question foncière et identité, un ressort profond de la crise ivoirienne 124
3. Une question brûlante aujourd’hui 125
III. LA FRANCE EN CÔTE D’IVOIRE : UNE RELATION FORTE MAIS SANS EXCLUSIVE 127
A. UNE RELATION BILATÉRALE PARTICULIÈREMENT DENSE 127
1. Des liens historiques, culturels et humains solides 127
2. Un partenariat fort et structurant autour de l’aide au développement 134
3. Une présence économique importante 138
4. Un partenariat de défense autour des forces françaises en Côte d’Ivoire 147
B. UNE POSITION FORTEMENT CONCURRENCÉE 155
1. La stratégie marocaine 155
2. La montée en puissance des pays émergents 162
3. Le rôle ancien de la diaspora libanaise 168
4. Les partenaires africains 169
5. Les Européens 170
6. Une influence anglo-saxonne croissante 171
C. BÂTIR DES PONTS POUR UN PARTENARIAT DURABLE 174
1. La diaspora, un vivier à mobiliser 174
2. Rapprocher les jeunes générations 176
3. Rapprocher les territoires 180
EXAMEN EN COMMISSION 183
SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 201
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 203
« Nous avons besoin de belles histoires », disait à la mission un haut responsable de l’Agence française de développement. La Côte d’Ivoire pourrait entrer dans cette catégorie. Elle apparaît en effet comme un oasis de croissance et de stabilité dans une Afrique de l’ouest rongée par l’insécurité et engluée dans le sous-développement.
Assurément, les performances de la Côte d’Ivoire depuis 2011 ont de quoi impressionner. Après douze années d’une crise profonde qui a coupé le pays en deux et fait des milliers de morts, la Côte d’Ivoire semble renouer avec la stabilité et la prospérité qui en faisaient autrefois le poumon économique de l’Afrique de l’Ouest.
Certes, la réconciliation nationale est loin d’être achevée. Les Ivoiriens sont encore divisés au moins quant au regard que chacun porte sur ces évènements tragiques et sur la manière dont la justice –nationale et internationale – traite les responsables de cette crise. L’ombre de l’ancien Président Laurent Gbagbo plane au-dessus du pays et une large partie de l’opposition a choisi de ne pas participer aux élections.
Cependant, plus de cinq ans après la crise, l’administration a été redéployée sur un territoire réunifié et pacifié. Les institutions se sont remises à fonctionner. Une stabilisation politique a été permise par l’alliance entre l’ancien Président Henri Konan Bédié et le Président de la République Alassane Ouattara. Ce dernier a été réélu à une large majorité, dans des conditions jugées satisfaisantes, en 2015. Les institutions internationales et les bailleurs publics et privés, mis en confiance par l’arrivée au pouvoir de cette équipe, sont revenus en force dans le pays. La croissance économique a repris avec vigueur, atteignant en moyenne les 9% par an depuis 2012.
Une vague d’optimisme a ainsi traversé la communauté internationale et atteint la France. La Côte d’Ivoire est gouvernée et a un cap – très ambitieux : celui de l’émergence à l’horizon 2020.
Cette renaissance suscite de nombreux espoirs. Dans un contexte où le Sahel se trouve particulièrement fragilisé, une Côte d’Ivoire solide et prospère constituerait un pôle de stabilité et de développement à même d’absorber une partie des migrations sahéliennes. Elle pourrait devenir un modèle en Afrique de l’ouest. Ou plutôt, redevenir le modèle qu’elle était dans les années 1960-1970 : un modèle économique fondé sur une agriculture puissante et diversifiée adossée à une agro-industrie performante ; mais aussi, un modèle de partenariat avec la France, la Côte d’Ivoire ayant toujours, sous le règne d’Houphouët-Boigny, entretenu des relations particulièrement intimes et amicales avec notre pays.
Le rapprochement historique doit cependant s’arrêter là. La Côte d’Ivoire se reconstruit aujourd’hui dans un environnement résolument différent des années qui ont suivi son indépendance.
Elle doit s’insérer dans une mondialisation qui lui impose de réussir au plus vite le défi de la transformation de sa croissance économique, vers une croissance qui crée de la valeur localement, qui profite à tous les Ivoiriens, y compris les jeunes, sur l’ensemble du territoire, et qui dure.
Elle doit encore réussir cette gageure qu’est le développement, alors que la pauvreté dans le pays a explosé depuis trente ans et que ses indicateurs sociaux demeurent parmi les plus faibles au monde. Elle doit y parvenir alors que sa population va très fortement s’accroître, faisant peser une pression inédite sur les secteurs sociaux et sur le marché de l’emploi. A cet égard, l’ampleur des flux de l’immigration illégale en provenance de ce pays montre que la tâche ne sera pas aisée. En effet, sur les 180.000 migrants illégaux recensés aux portes de l’Italie en 2016, 12.400 sont des Ivoiriens, ce qui en fait la quatrième nationalité représentée. Est-ce le signe d’un certain malaise social et d’un manque de foi en l’avenir ? Nous pouvons nous poser la question.
En tout état de cause, la Côte d’Ivoire devra relever tous ces défis. Et cela, alors même que plusieurs problèmes de fond – foncier rural, corruption, réforme du secteur de la sécurité – demeurent irrésolus. Les mutineries qui se sont propagées dans le pays au cours des dernières semaines ont rappelé au monde que la stabilité ne peut être considérée comme totalement acquise tant que ces réformes ne sont pas menées à leur terme. Les potentiels effets de contagion ne doivent pas être sous-estimés alors que, depuis un an, les mouvements sociaux se sont multipliés dans le pays. Ainsi, pour reprendre les termes de Serge Michailof (1), la Côte d’Ivoire se trouve « comme un cycliste sur une ligne de crête ». Elle devra garder le cap et réussir plusieurs virages délicats.
Quel peut être le rôle de la France dans cette perspective ? À l’évidence, il n’est pas question d’en revenir aux relations certes très cordiales mais datées de l’époque d’Houphouët-Boigny où les coopérants français investissaient par centaines les administrations ivoiriennes. Quand bien même notre pays en aurait les moyens, ce ne serait pas souhaitable. La France a changé : elle souhaite aujourd’hui nouer des partenariats avec ses anciennes colonies d’Afrique sur une base nouvelle, d’égal à égal. La Côte d’Ivoire aussi a changé : elle est devenue plus ouverte au monde. La référence à notre pays reste forte mais n’y est plus exclusive.
L’enjeu pour la France est aujourd’hui d’accompagner au mieux le développement de la Côte d’Ivoire. L’enjeu est aussi de parvenir à faire fructifier, sur la base d’une réciprocité assumée, les liens anciens et nombreux entre nos deux pays, alors que perdure en Côte d’Ivoire une demande de France que nous devons saisir.
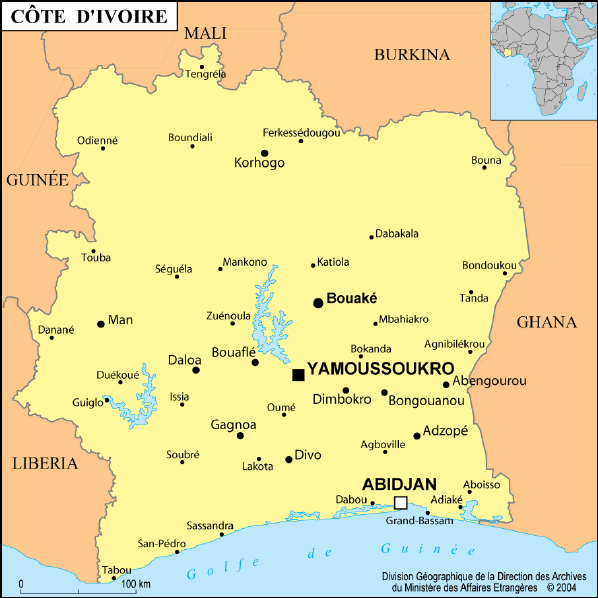
I. 2011-2017 : VERS UNE RENAISSANCE IVOIRIENNE ?
La prestation de serment du Président Alassane Ouattara en mai 2011 a mis un terme à une crise profonde qui avait débuté douze ans plus tôt, en 1999, avec le coup d’État du général Gueï. D’une certaine manière, la crise ivoirienne est plus ancienne encore si l’on remonte au début de la crise économique qui a vu le modèle de croissance ivoirien s’enrayer, dans les années 1980, et aux secousses liées à l’introduction du multipartisme, en 1990, et à la succession de Félix Houphouët-Boigny, en 1993.
En 2011, la Côte d’Ivoire était ainsi exsangue économiquement et moralement. Elle venait de frôler la guerre civile. La tâche qui incombait à la nouvelle équipe dirigeante conduite par le Président Ouattara était immense. De ce point de vue, il est indéniable que le chemin parcouru depuis lors a été considérable. Ces avancées ont été favorisées par un contexte international propice, mais elles sont aussi le fruit d’un leadership politique fort.
A. UN TERRITOIRE RÉUNIFIÉ ET GLOBALEMENT PACIFIÉ
1. La Côte d’Ivoire vient de loin
« Avant, on ne parlait pas / ni de nordistes ni de sudistes / Mais aujourd’hui, tout est gâté / l’armée est divisée / la société est divisée / les étudiants sont divisés / même nos mères au marché sont divisées (…)
Avant, on ne parlait pas / de chrétiens ni de musulmans / Mais aujourd’hui, ils ont tout gâté / l’armée est divisée / la société est divisée / les étudiants sont divisés / même nos mères au marché sont divisées ».
Ces paroles du célèbre chanteur de reggae ivoirien Tiken Jah Fakoly, extraites de « Le pays va mal », une chanson de l’album Françafrique sorti en 2002, nous replongent dans l’atmosphère de la Côte d’Ivoire des années 2000. Elle se trouvait alors dans une situation grave et inédite, que l’on peine parfois à imaginer aujourd’hui tant cette page semble tournée : celle d’une partition du pays autour d’une ligne de fracture nord/sud qui n’avait jamais semblé particulièrement significative par le passé.
• Un territoire durablement coupé en deux
La crise ivoirienne s’est en effet traduite par la division du territoire national en deux parties, le nord occupé par les rebelles des Forces nouvelles, plus ou moins contrôlées par Guillaume Soro (actuel Président de l’Assemblée Nationale), et le sud qui demeurait aux mains des forces gouvernementales tenues par l’ancien Président de la République, Laurent Gbagbo.
Cette fracture a été matérialisée, de 2002 à 2007, par l’existence d’une « ligne de non-franchissement » entourée d’une zone tampon sur laquelle étaient déployés les soldats français de la force Licorne, dans une optique d’interposition. Pendant cette période, les forces rebelles avaient organisé la moitié nord du pays sur un mode féodal, chaque chef de guerre régnant sur un territoire donné.
D’après Christian Bouquet (2), une « géographie régionale parallèle » avait eu le temps de « s’incruster dans la réalité quotidienne » : le territoire occupé par la rébellion avait été divisé en dix grandes zones dirigées par des commandants de zone (com’zones) qui contrôlaient non seulement les hommes mais aussi les ressources. Celles-ci provenaient principalement de la taxation des exportations de cacao mais aussi de la filière coton, ainsi que de la prise de contrôle des richesses minières, essentiellement l’or et le diamant.
La zone tampon a été officiellement démantelée à partir de la conclusion de l’accord politique de Ouagadougou, en mars 2007, mais la division du pays a perduré dans les faits. Si les préfets, juges et magistrats ont effectivement été redéployés dans le nord en 2008 et 2009, la réhabilitation des bâtiments administratifs n’a pas suivi : seuls 519 sur 3778 étaient opérationnels en janvier 2009. Plus profondément, l’emprise des com’zones sur les territoires du nord restait entière et la fusion des corps armés, bien que prévue par l’accord de Ouagadougou et ses compléments, ne s’est jamais concrétisée.
La crise ivoirienne s’est achevée après la conquête du sud par les Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), nouveau nom des Forces nouvelles auxquelles s’étaient ralliés des éléments de Forces de défense et de sécurité (FDS) de Laurent Gbagbo. L’arrestation de Laurent Gbagbo et de ses proches, le 11 avril 2011, et la proclamation d’Alassane Ouattara comme président de la République par le Conseil constitutionnel, le 4 mai 2011, mettaient officiellement un terme à une décennie de divisions. Il restait pourtant fort à faire pour « recoller » le pays.
• La généralisation du non-droit
L’installation de la crise ivoirienne a eu pour effet de saper l’autorité de l’État et de banaliser les comportements déviants. Ainsi, le recours à des supplétifs aux forces de sécurité, la circulation incontrôlée des armes, les exactions en toutes sortes – exécutions extra-judiciaires, viols, pillages, rackets – se sont généralisés, dans un contexte de totale impunité. Indépendamment de la question de la répartition exacte des torts, on peut affirmer que ces dérapages n’ont pas été l’apanage d’un seul camp.
Ces faits ont été abondamment documentés par les rapports successifs du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, notamment le 27ème, rédigé au plus fort de la crise, en mars 2011 (3). Il n’entre nullement dans la vocation de ce rapport de donner un avis sur la répartition des responsabilités des exactions commises pendant la crise. Par ce rappel, votre rapporteure souhaite simplement resituer le contexte d’insécurité généralisée qui prévalait au début de l’année 2011, lorsque la nouvelle équipe dirigeante a pris le pouvoir. On ne peut évaluer le chemin parcouru que lorsque l’on connait le point de départ.
2. Le rétablissement de la sécurité, une entreprise non linéaire
• Une impulsion présidentielle forte
À partir de 2012, le Président Ouattara s’est fortement investi pour rétablir la sécurité et restaurer l’autorité de l’État sur le territoire. À cette fin, le ministre de l’Intérieur, Hamed Bakayoko, a systématiquement été reconduit à ce poste depuis 2010. Il semble d’ailleurs en avoir tiré une certaine crédibilité.
Cet effort répondait à un impératif de stabilisation, dans un contexte où de nombreux combattants irréguliers entretenaient l’insécurité sur le territoire, mais aussi à la pression de la communauté internationale exprimée, notamment, au travers des résolutions successives du Conseil de sécurité de l’ONU.
Devant la mission, Hamed Bakayoko a souligné l’investissement personnel du Président de la République sur les questions de sécurité, notamment au travers du Conseil national de sécurité (CNS). Créé en août 2012 sur le modèle du National security council américain, ce conseil mêle décideurs politiques et hauts responsables civils et militaires sous la direction du Président pour coordonner la politique de sécurité. Depuis 2012, le Président Ouattara a réuni le CNS chaque semaine afin de faire le point sur les évolutions de la situation sécuritaire.
Cette impulsion au plus haut niveau est également mise en avant par la chercheure Aline Lebœuf, qui a travaillé sur la réforme du secteur de la sécurité ivoirienne (RSS) depuis la fin de la crise (4). Selon elle, c’est une spécificité de la RSS ivoirienne que d’avoir été conduite selon une approche très « top-down », dirigée par le Président lui-même, qui avait d’ailleurs initialement les attributions de ministre de la défense.
• Le processus DDR, un modèle du genre ?
La première étape incontournable pour restaurer la sécurité était de désarmer et démobiliser les nombreux combattants qui avaient pris les armes dans les deux camps, souvent en-dehors des cadres réguliers des forces armées et de sécurité : ex-rebelles, miliciens, mercenaires, chasseurs traditionnels Dozos... La fin de la crise n’avait pas pour autant mis un terme aux exactions quotidiennes de ces hommes en armes qui continuaient à évoluer sur le territoire : vols et ventes d’armes illicites, trafics, rackets, attaques armées, etc. Un rapport de l’ONU daté de mars 2012 relevait ainsi que « si la sécurité s’est améliorée à Abidjan, les menaces s’avèrent plus diffuses et la situation semble s’être dégradée dans d’autres régions du pays où la présence de l’État est faible et où les armes prolifèrent » (5).
Un processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) a été conduit entre 2012 et 2015, sous la responsabilité de l’Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des anciens combattants (ADDR), créée en août 2012 et placée sous la tutelle du CNS. L’ADDR a identifié 74.000 anciens combattants à démobiliser dans les deux camps.
Ce processus a été conduit sur une base volontaire : les combattants qui se présentaient devaient rendre leur arme et étaient envoyés dans des camps de resocialisation, avant de se voir proposer une formation devant permettre leur réintégration dans la vie civile. Ils percevaient en outre une petite aide financière. Les premiers combattants à se présenter devant l’ADDR ont bénéficié des possibilités de reclassement offertes par les administrations, en particulier les eaux et forêts, les douanes, la protection civile et l’administration pénitentiaire ; au total, 6500 ex-combattants ont été reclassés dans l’administration. Pour les suivants, il a fallu trouver des pistes de reclassement dans le secteur privé.
Début 2015, le processus de DDR semblait marquer le pas en raison de l’emprise persistante des anciens com’zones sur leurs hommes, qu’ils employaient pour pérenniser leurs trafics tout en leur promettant une improbable réintégration dans l’armée. Cette situation a été mise en lumière par un rapport du groupe d’experts de l’ONU sur la Côte d’Ivoire paru en avril 2015, qui notait la présence de « nombreux éléments militaires irréguliers » et de « vastes quantités d’armes et de munitions dont on a perdu la trace » (6).
Le Général Clément-Bollée, qui conseillait le gouvernement ivoirien dans le cadre de ce processus DDR, estimait ainsi que 17.000 à 18.000 anciens combattants restaient à démobiliser. Les autorités ivoiriennes ont alors lancé une vaste opération visant à libérer les sites occupés par les anciens « associés » des Forces nouvelles, l’« opération Bonheur ». Elle avait été précédée par une campagne de communication de l’ADDR visant à faire prendre conscience à ces combattants qu’ils ne réintégreraient jamais l’armée.
Pour le Général Clément-Bollée, cette opération a finalement été un succès. Ainsi, selon les statistiques de l’ONUCI, 69.000 anciens combattants auraient intégré le programme et 66.000 auraient été réinsérés avant la dissolution de l’ADDR en juin 2015. Il est indéniable que ce processus de DDR a permis d’obtenir des résultats concrets, ce qui n’avait pas été le cas des opérations du même type conduites au cours des années 2000.
Malgré tout, plusieurs réserves peuvent être formulées. En premier lieu, le rapport du groupe d’experts de l’ONU relève que le processus d’identification initiale des hommes à démobiliser a été confié aux commandants de zone qui auraient gonflé leurs effectifs afin de faire bénéficier prioritairement à leurs fidèles des mesures de réinsertion et du petit pécule financier octroyé dans ce cadre. Ainsi, sur les 74.000 combattants initialement identifiés par l’ADDR, les deux tiers faisaient partie du camp des « nordistes » ; « un grand nombre des anciens groupes d’autodéfense affiliés au gouvernement Gbagbo étaient laissés pour compte » (7).
Autre critique adressée à ce processus, le caractère très incomplet du désarmement. Au 30 juin 2015, au moment où l’ADDR mettait fin à ses activités, elle avait récupéré environ 43.500 armements, notamment des kalachnikovs, des obus, des grenades ainsi que 2,5 millions de munitions. De nombreux observateurs ont souligné que ces statistiques paraissaient très insuffisantes au regard du nombre de combattants démobilisés. D’abondantes quantités d’armements demeureraient en circulation, sans qu’il soit possible d’en évaluer précisément le nombre. Cette information a été reprise par l’ONUCI qui a souligné la nécessité d’« assurer la continuité des opérations de désarmement des civils en Côte d’Ivoire » (8).
Dernière réserve : la pérennité de la réinsertion des anciens combattants, dans un pays où l’emploi des jeunes pose des difficultés. Un effort de vigilance était ainsi de mise pour assurer la durabilité de la réintégration sociale des anciens combattants. Le général Clément-Bollée a ainsi souligné que le processus de DDR ne pouvait fonctionner que s’il bénéficiait d’un suivi dans la durée.
• La réforme du secteur de la sécurité (RSS), une tâche d’ampleur
La démobilisation et la réintégration des anciens combattants n’ayant pas vocation à intégrer les corps réguliers n’étaient que le premier volet du rétablissement de l’ordre sécuritaire. Il convenait par ailleurs de profondément restructurer et apurer ces corps réguliers fortement éprouvés par la crise. La réforme du secteur de la sécurité comprend deux principales phases : la restructuration des différents piliers de ces forces (gendarmerie, police, armée, etc…) ; puis l’établissement de complémentarités, d’échanges, de synergies entre ces forces.
Au sein de l’armée, il fallait à présent fusionner les ennemis d’hier : Forces nouvelles pro-Ouattara (FAFN) et Forces de défense et de sécurité (FDS) restées sous le commandement de Laurent Gbagbo. En vertu de l’accord signé à Ouagadougou en 2007, 8400 combattants des Forces nouvelles avaient vocation à intégrer l’armée régulière. C’est sur ce fondement que l’armée a été restructurée à partir de 2011, en conservant l’ossature des FAFN. Le Président Ouattara a lui-même précisé les modalités de cette fusion :
« S'agissant des hauts cadres de l'armée, j'ai eu à négocier avec les officiers des ex-Forces nouvelles, qui voulaient tous les postes. Et j'ai réussi à imposer cet équilibre dans la hiérarchie militaire, jusqu'au niveau de commandant: le n° 1 issu des FN, flanqué d'un n° 2 venu de l'ancienne armée régulière. Tous grades confondus ; il y a 12 % de nordistes dans la police, 15 % dans la gendarmerie et 40 % environ dans l'armée » (9).
S’agissant des forces de sécurité, le ministre de l’Intérieur Hamed Bakayoko a indiqué à la mission avoir fait le choix de conserver la police et la gendarmerie. Cela impliquait un long travail de rétablissement de la confiance, ces forces – la gendarmerie en particulier – étant celles sur lesquelles le Président Laurent Gbagbo s’appuyait à titre principal.
Les contours de la réforme du système de sécurité ont été formalisés dans le cadre d’une « stratégie nationale de RSS » mise au point au septembre 2012, complétée et précisée par une « stratégie nationale de sécurité » élaborée en 2015. Cette dernière a ouvert la voie aux votes des lois de programmation militaire et de programmation des forces de sécurité intérieure en janvier 2016, perçues comme ambitieuses et faisant montre d’un certain courage politique pour aborder les défis de ces corps. Il allait à présent falloir mettre en œuvre ces orientations.
La loi de programmation militaire prévoit notamment de réduire la part des salaires à 60% du budget de la défense en diminuant les effectifs de 25.000 à 20.000 hommes. Cela doit permettre de financer des équipements à hauteur de 800 milliards de francs CFA sur la période 2016-2020, pour un budget total de 2254 milliards.
Votre rapporteure reviendra plus en détail sur les défis que la Côte d’Ivoire doit encore surmonter pour améliorer la cohésion, la fiabilité et l’efficacité de ses forces armées et de sécurité, dont de récentes mutineries ont encore souligné la fragilité (cf. infra). Ce processus est loin d’être achevé. Toutefois, il faut garder en tête le point de départ : ces forces étaient totalement à reconstruire – voire à construire – en raison des effets de la crise ivoirienne, mais aussi parce que la Côte d’Ivoire n’avait jamais, depuis son indépendance, conçu la construction d’une armée solide comme une priorité.
3. Une situation encore fragile
• Une normalisation apparente de la situation sécuritaire
- Un sentiment de « retour à la normale » globalement partagé
D’après les renseignements fournis par la direction du renseignement militaire (DRM), on observe une amélioration globale de la situation sécuritaire dans le pays, qui semble « en voie de normalisation ». La DRM estime cependant que la vigilance demeure de mise en raison de la possible résurgence de conflits communautaires et de la porosité des frontières.
Cette appréciation rejoint celle de nombreux interlocuteurs de la mission et notamment du Général L’Hôte, qui commande la force militaire de l’ONUCI. Elle se retrouve dans les « conseils aux voyageurs » diffusés sur le site du ministère des Affaires étrangères, qui classe l’essentiel du territoire de la Côte d’Ivoire en « vigilance renforcée » (ce qui est le cas de toutes les régions d’Afrique jugées plutôt sûres), à l’exception de la zone frontalière avec le Libéria, « déconseillée sauf raisons impératives ».
Le départ imminent de l’opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), présente dans le pays depuis 2004, témoigne de cette normalisation. Le 29 avril 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l’unanimité la résolution 2283 décrétant la levée immédiate de toutes les sanctions des Nations Unies à l’encontre de la Côte d’Ivoire (embargo sur les armes et sanctions individuelles) ainsi que la résolution 2284 qui prévoit la fermeture définitive de l’ONUCI d’ici au 30 juin 2017, après transfert des responsabilités aux autorités ivoiriennes. Cette double résolution marquait ainsi la confiance du Conseil de sécurité à l’égard de la capacité de la Côte d’Ivoire à relever elle-même les défis auxquels elle était confrontée.
- La frontière avec le Libéria, principale zone de fragilité
La frontière avec le Libéria est, depuis les années 1980, une zone de vulnérabilité particulière en raison de l’existence de conflits fonciers anciens susceptibles de dégénérer (cf. question foncière).
Ce risque a été exacerbé avec la crise ivoirienne durant laquelle le recours à des mercenaires libériens s’est largement répandu. D’après les informations recueillies par la mission, ces mercenaires continueraient aujourd’hui à traverser la frontière pour conduire des attaques armées.
La présence d’anciens combattants « pro-Gbagbo » réfugiés dans des camps au Libéria serait un facteur d’instabilité supplémentaire. D’après le rapport du groupe d’experts de l’ONU précité, ces derniers auraient été liés à des actions de déstabilisation conduites avec l’aide de ces mercenaires libériens dans l’extrême ouest de la Côte d’Ivoire (10).
Le Général Clément-Bollée a expliqué à la mission que le processus DDR avait été perturbé, pour ces combattants réfugiés au Libéria, par la survenue de l’épidémie d’Ébola qui a conduit à la fermeture de la frontière ivoiro-libérienne entre août 2014 et septembre 2016. L’accès au programme de DDR a pourtant été prolongé au-delà de juin 2015 pour les combattants réfugiés dans ce pays, mais les délais induits par la fermeture de la frontière auraient contribué à atténuer l’impact de ce processus pour lesdits combattants.
Ainsi, plusieurs attaques ont été recensées dans la région ouest de la Côte d’Ivoire, à proximité de la frontière. Par exemple, en décembre 2015, une bande de brigands en provenance du Libéria a pris d’assaut le camp des militaires ivoiriens situé à Olodio, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, faisant sept morts parmi les soldats ivoiriens.
En 2016, une opération conjointe des forces armées libériennes et ivoiriennes pour sécuriser la frontière a semblé porter ses fruits, aucun problème majeur n’ayant été recensé depuis le mois de mars dernier.
- Des facteurs de risques à prendre en compte dans le nord
Plus au nord du pays, la situation sécuritaire est, d’après l’ONUCI, globalement calme, mais présente un certain nombre de facteurs de risques qui, par effet cumulé, peuvent représenter un cocktail dangereux pour la Côte d’Ivoire. Dans cette région sévissent traditionnellement coupeurs de route et bandits, mais aussi trafiquants – notamment d’armements – qui tirent parti de l’absence de contrôle réel des régions frontalières avec le Mali et le Burkina Faso.
À ces menaces traditionnelles s’ajoutent désormais des facteurs de risques nouveaux. La porosité des frontières permet aux mouvances djihadistes issues des pays du Sahel de trouver refuge et/ou de circuler sur le territoire ivoirien. Par ailleurs, l’orpaillage clandestin s’est développé à la faveur de la crise ivoirienne, attirant une faune peu recommandable.
Il convient ainsi d’être particulièrement vigilant à ces différentes menaces. Si les intérêts des trafiquants, terroristes, orpailleurs, coupeurs de route et autres bandits viennent à se croiser, elles deviendront d’autant plus difficiles à juguler.
Il est par ailleurs important de mentionner que, dans le nord-est de la Côte d’Ivoire, à proximité de la frontière burkinabè, persiste un vieux conflit portant sur les droits d’usage de la terre entre les agriculteurs de l’ethnie lobi et les pasteurs transhumants d’ethnie peule, dont le bétail détruit parfois les cultures des lobis. D’après les informations recueillies par la mission, les peuls bénéficieraient de la complicité des propriétaires des terres, de l’ethnie koulango, qui joueraient un double jeu en louant leurs terres aux lobis tout en autorisant les peuls à faire passer leurs troupeaux. Un conflit de ce type a gravement dégénéré à Bouna, en mars dernier, faisant des dizaines de morts et de blessés et des milliers de déplacés.
- Les chasseurs Dozos, une menace sous contrôle ?
L’escalade de violence observée à Bouna en mars dernier est liée à l’intervention, dans les deux camps, de chasseurs Dozos. Elle illustre le potentiel de déstabilisation induit par la mobilisation dans la sphère sécuritaire de ces guerriers auparavant cantonnés à la sphère culturelle.
D’après un rapport de l’ONUCI publié en 2013 (11), les Dozos sont un phénomène culturel ancien qui remonterait au XIIIème siècle. Cette confrérie de chasseurs traditionnels était alors principalement localisée au Mali. Les Dozos sont arrivés dans les régions du nord de la Côte d’Ivoire bien avant l’indépendance ; ils s’y sont « organisés en confréries secrètes dotées d’un code moral et de rites initiatiques pour enseigner l’art de la chasse et des connaissances mystiques aux nouveaux adhérents de nationalité ivoirienne ». Les Dozos se distinguent par le port de multiples amulettes ; ils sont en outre autorisés à détenir des armes traditionnelles de chasse de petit calibre.
Initialement cantonnés aux régions du nord, les Dozos se sont progressivement installés dans les régions du sud au cours des années 1980 et 1990, à la faveur des vagues migratoires. À partir de 1995, ils ont commencé à se voir reconnaître des responsabilités en matière de sécurité.
Ce phénomène a pris un tour nouveau avec la crise ivoirienne. Lorsque la patrie est en danger, les Dozos se font les protecteurs de leur clan. Les rebelles des Forces nouvelles leur ont donné un rôle dans le cadre du conflit qui les opposait aux forces du Président Laurent Gbagbo. Dès lors, une double évolution a pu être observée : d’une part, une militarisation des Dozos, qui ont troqué le fusil de chasse contre la kalachnikov, et, d’autre part, une « dozoïfication » des militaires, la distinction entre « vrais » et « faux Dozos » devenant de plus en plus difficile à établir. L’implantation des Dozos s’est élargie dans le sud à la faveur des conquêtes des Forces nouvelles. Au total, on en dénombrait environ 50.000 disséminés dans tout le pays en 2012.
À la fin de la crise post-électorale de 2011, les Dozos ont continué, dans un contexte de carence de l’État, à jouer le rôle de supplétifs aux forces de sécurité, initialement avec le consentement implicite des autorités ivoiriennes. Ainsi le ministre de l’Intérieur Hamed Bakayoko était encore en 2012, d’après le rapport de l’ONUCI, le parrain d’une association nationale de Dozos. Cette situation est rapidement devenue facteur d’instabilité, de nombreux Dozos abusant de la crainte qu’ils inspiraient en raison de leurs supposés pouvoirs mystiques pour perpétrer des exactions bien souvent impunies. Par ailleurs, ils étaient fréquemment sollicités dans le cadre de règlements de compte liés à des conflits fonciers, ce qui se traduisait inévitablement par des escalades de violence, comme à Bouna.
En juin 2012, une circulaire interministérielle a interdit aux Dozos de mener des missions de sécurité sous peine de sanctions ou de poursuites judiciaires. En 2013, l’ONUCI dressait un bilan très critique de l’application de cette circulaire, estimant que les autorités continuaient à tolérer les interventions des Dozos. Il semble néanmoins que la situation se soit améliorée depuis. D’après le ministre de l’Intérieur Hamed Bakayoko, les associations de Dozos ont été désorganisées et ces derniers « ramenés à la sphère culturelle ». De l’avis des différents interlocuteurs de la mission, leur influence dans la sphère sécuritaire a en effet été nettement amoindrie. D’après l’ONG Human Rights Watch, la plupart d’entre eux ont accepté de retourner à la vie civile, mais ils demeurent une « structure latente » : il n’est pas exclu qu’ils reprennent les armes en cas de résurgence de la violence.
- Les coupeurs de route rentrés dans rang ?
Dans la période post-crise, les déplacements à travers le pays étaient fortement perturbés par la présence de multiples « coupeurs de route » qu’il fallait « dédommager » pour obtenir de poursuivre son chemin. Ces coupeurs de route étaient fréquemment d’anciens combattants irréguliers profitant de l’avantage que leur procurait leur arme. Les progrès du processus DDR ont contribué à réduire la prévalence de ces barrages qui demeuraient néanmoins fréquents, en particulier sur la portion de route entre Korhogo et Bouaké, dans le nord du pays.
Plusieurs interlocuteurs relèvent que la situation se serait améliorée au cours de la période récente sans pour autant que le problème soit complètement résolu. La mission a pu emprunter la route qui mène de Korhogo à Bouaké sans être inquiétée ; elle était toutefois escortée par une voiture de police « au cas où ». D’après les informations recueillies sur place, il reste plus prudent de ne pas circuler la nuit. Il n’en demeure pas moins que les déplacements sur les routes du pays s’effectuent globalement dans des conditions sécuritaires correctes.
• L’État déployé sur un territoire réunifié
- Le redéploiement des administrations et forces de sécurité dans la zone centre-nord-ouest (CNO)
Depuis la fin de la crise de 2011, l’administration ivoirienne a tant bien que mal été redéployée dans toutes ses composantes au sein de l’ex-zone centre-nord-ouest (CNO), sous le contrôle de la rébellion pendant la crise. Un mouvement de rétrocession à l’État et de réhabilitation des bâtiments administratifs a été entrepris, avec des avancées plus ou moins rapides. Enseignants, juges, préfets, forces armées et de sécurité, douaniers et autres agents publics ont été redéployés sur l’ensemble du territoire. Ainsi, les tribunaux se sont remis à fonctionner, de même que les écoles et universités, centres de santé, commissariats, etc. Si l’effectivité de ce redéploiement a pu se heurter localement au manque de moyens, sa mise en œuvre relativement rapide a permis à l’État de rétablir une présence visible sur un territoire désormais réunifié, et de progressivement réaffirmer son autorité, même si ce chantier demeure conditionné à l’achèvement de la réforme du secteur de la sécurité.
- La partition oubliée : « un modèle en Afrique » ?
La fin de la crise a aussi marqué la reprise des mouvements de population sur le territoire ivoirien. Ces brassages, qui sont dans l’ADN de la Côte d’Ivoire, avaient été affectés par le phénomène de repli ethnique et les comportements xénophobes qui s’étaient fait jour pendant la crise. De ce point de vue, la division territoriale de la Côte d’Ivoire parait aujourd’hui largement surmontée.
Ceci amène à se questionner sur la réalité de la césure nord/sud dans ce pays. Certes, ces deux moitiés se rattachent à deux grandes zones climatiques aux caractéristiques différentes : le sud à la zone subtropicale humide particulièrement propice à l’agriculture de plantation qui a fait la richesse de la Côte d’Ivoire, quand le nord est une zone de savane, plus sèche et plus pauvre. Certes, le nord était traditionnellement peuplé d’ethnies islamisées quand le sud était à dominante chrétienne et/ou animiste.
Cependant, comme le souligne Christian Bouquet (12), les brassages de populations en Côte d’Ivoire ont été tels que cette opposition n’a plus vraiment lieu d’être. D’après les données du recensement général de 1998, les musulmans étaient majoritaires dans presque toutes les régions de la Côte d’Ivoire, à l’exception de l’est du pays qui comptait davantage de chrétiens et du centre majoritairement animiste. Si la division nord/sud continue à trouver une certaine traduction dans les cartes électorales, il apparaît ainsi que les lignes de fractures se situent aujourd’hui davantage à l’intérieur des villes et des campagnes ivoiriennes.
Votre rapporteure juge remarquable le fait que les Ivoiriens semblent aujourd’hui avoir complètement oublié la division de leur territoire, matérialisée pendant cinq ans par une ligne de non-franchissement. Il est en effet rare en Afrique de voir un pays se remettre de partitions de ce type, que l’on songe à la situation de l’Éthiopie et de l’Érythrée, ou encore du Soudan et du Soudan du sud.
• Les émeutes de janvier 2017, révélateur d’une situation encore fragile
Alors que les problématiques sécuritaires semblaient avoir cédé la place aux questions économiques et sociales parmi les urgences auxquelles les autorités ivoiriennes devaient répondre, les mutineries de janvier 2017 sont venues rappeler la grande fragilité de l’édifice sécuritaire et l’urgence de le consolider pour garantir la stabilité du pays.
Le 6 janvier dernier, un mouvement de contestation s’est déclenché au sein des forces armées ivoiriennes, après plusieurs mois de grogne larvée. La revendication est partie de Bouaké – foyer de la rébellion pendant la crise ivoirienne – pour s’étendre aux agglomérations de Korhogo, Daloa, Daoukro et Odienné, avant de gagner la quasi-totalité des forces armées.
D’après les informations communiquées à la mission, les mutins étaient principalement des anciens rebelles auprès desquels le Président Ouattara aurait contracté des engagements en 2011. Leurs revendications portaient sur les salaires, les modalités d’avancement de grades, des primes supposées non attribuées et les conditions matérielles de la vie de soldat.
Cet évènement n’était pas sans précédent. En novembre 2014, une mutinerie avait éclaté à Bouaké avant de se propager au reste du pays, exactement selon le même scénario. Les militaires réclamaient alors le paiement d’arriérés de soldes datant de la période entre les accords de Ouagadougou et la crise post-électorale. Ces accords prévoyaient l’intégration au 1er janvier 2009 de 8400 combattants des forces nouvelles au sein des forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI). Cette fusion n’avait finalement eu lieu qu’en 2011, mais le Président Ouattara se serait engagé à payer ces 8400 hommes pour leurs services entre 2009 et 2011, considérant qu’ils faisaient déjà partie de l’armée légale de la Côte d’Ivoire.
En janvier dernier, le ministre de la Défense, Alain-Richard Donwahi, s’est rendu à Bouaké pour négocier avec les mutins. Déterminé à étouffer ce mouvement qui mettait à mal l’image internationale de la Côte d’Ivoire, le Président Ouattara a accédé à leurs revendications. D’après les informations recueillies par la mission, les 8400 ex-rebelles réintégrés dans l’armée devraient ainsi percevoir chacun la somme de 12 millions de francs CFA (18.000 euros), dont 5 millions auraient été versés immédiatement. Cet effort budgétaire substantiel – 150 millions d’euros au total – risque de mettre en péril l’équilibre financier de la loi de programmation militaire sur laquelle est assis le pilier militaire de la RSS.
Ces évènements, intervenant six ans après la crise, ont mis en lumière le caractère encore fragile de la stabilité conquise. Le manque de professionnalisme et de loyauté des soldats est apparu problématique.
Par ailleurs, si les « indemnisations » décidées ont permis de rétablir un certain calme, elles ont constitué un signal de faiblesse de la part du gouvernement à l’endroit d’autres unités et corporations – fonctionnaires, corps habillés – bien décidées à tirer leur épingle du jeu. Ainsi, le 7 février, ce sont les militaires des forces spéciales qui se sont mutinés à Adiaké, à proximité de la frontière ghanéenne, réclamant des primes. Le gouvernement aurait néanmoins refusé de céder à leurs revendications, arguant que les forces spéciales ne comptaient pas parmi les 8400 militaires auxquels ces primes avaient été promises.
Au total, ces évènements incitent à relativiser le constat de normalisation de la situation sécuritaire ivoirienne en l’absence de consolidation de la réforme du secteur de sécurité (RSS). Tant que ce processus ne sera pas mené à bien, la Côte d’Ivoire restera vulnérable aux turbulences comme celles qu’elle connaît actuellement, susceptibles de s’emballer en cas d’agrégation des mécontentements. Votre rapporteure reviendra ultérieurement sur les défis de cette RSS.
B. LES RESSORTS DE LA STABILISATION POLITIQUE
Le rétablissement de la sécurité sur le territoire ivoirien n’aurait pas été envisageable sans une stabilisation politique et institutionnelle. Conduite sous la direction du Président Ouattara, cette stabilisation repose sur l’alliance des deux grandes forces politiques que sont le Rassemblement des républicains (RDR) et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Alliance qui, en dépit de quelques fêlures et de nombreux pronostics défaitistes, a tenu bon jusqu’à aujourd’hui.
Ce succès politique doit aussi beaucoup à un phénomène inquiétant : la non-participation d’une large partie de l’opposition aux élections, qui se traduit par une abstention forte dans les zones d’influence traditionnelles du parti de l’ancien Président Gbagbo, le FPI, et par une très faible représentation de ce parti à l’Assemblée nationale ivoirienne.
1. Le succès de l’alliance électorale Bédié-Ouattara
• Genèse de l’alliance RDR-PDCI
De son indépendance à 1990, la Côte d’Ivoire fut dirigée par le Président Houphouët-Boigny, à la tête d’un parti unique, le PDCI, créé en 1946. Celui-ci s’appuyait principalement pour gouverner sur le groupe ethnique akan (centre et est de la Côte d’Ivoire) tout en associant habilement les autres ethnies à la répartition des rentes et des situations.
À partir de 1990, le multipartisme fut introduit en Côte d’Ivoire, dans la foulée du discours prononcé par le Président Mitterrand à La Baule, qui liait la poursuite de l’aide française à la démocratisation des régimes africains.
En Côte d’Ivoire, la vie politique finit par se structurer autour de trois principaux partis davantage attachés à leur leader qu’à une base programmatique précise. Henri Konan Bédié, dauphin constitutionnel d’Houphouët-Boigny, élu Président de la République à partir de 1995, reprit l’héritage du PDCI.
L’opposant historique d’Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo, d’ethnie bété (centre-ouest de la Côte d’Ivoire) prit la tête du Front populaire ivoirien (FPI), parti de l’anti-colonialisme et du nationalisme : il incarnait la voix des populations de l’ouest, traditionnellement en marge du pouvoir.
Initialement membre du PDCI – il fut le Premier ministre d’Houphouët-Boigny de 1990 à 1993 – Alassane Ouattara fit sécession de ce parti en raison de désaccords croissants avec Henri Konan Bédié, qui avait fait voter en 1994 une disposition du code électoral manifestement destinée à le rendre inéligible (13). Alassane Ouattara est d’ethnie dioula (originaire du nord du pays) ; la remise en question de sa nationalité allait, par extension, symboliser l’exclusion des gens du nord, qui se retrouvèrent principalement au sein du nouveau parti créé en 1994 par Djéni Kobina, le Rassemblement des Républicains (RDR).
Un temps opposés, le PDCI et le RDR finirent par se retrouver dans leur opposition à Laurent Gbagbo, devenu Président de la République. C’est ainsi que naquit, en 2005, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Il s’agissait d’un front commun électoral entre le PDCI et le RDR, ainsi que trois autres petits partis, l’UDPCI, le MFA et l’UPCI (14), qui prévoyait le désistement automatique entre les candidats de chacune de ces formations lors du second tour de la prochaine élection présidentielle.
Cette alliance électorale permit à Alassane Ouattara de l’emporter sur Laurent Gbagbo en 2010, bien que ce dernier (15) n’ait jamais accepté ce résultat. Au premier tour, Laurent Gbagbo était arrivé en tête avec 38% des suffrages, contre 32% pour Alassane Ouattara et 25% pour Henri Konan Bédié. Lors du second tour, Bédié appela à voter pour Ouattara qui l’emporta avec 54% des suffrages exprimés.
• L’élection présidentielle de 2015 et l’« appel de Daoukro » : vers un parti politique unique ?
Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara avaient exprimé l’idée que le RHDP avait vocation à dépasser sa nature d’alliance électorale ponctuelle pour devenir un véritable parti politique. Dans cet esprit, Henri Konan Bédié appela, en mars 2015, les membres de son parti à voter pour Alassane Ouattara dès le premier tour de l’élection présidentielle prévue en octobre 2015, annonçant qu’il ne se présenterait pas. Cette décision fut entérinée par le congrès extraordinaire du PDCI organisé en février 2015. Quelques « frondeurs », à l’image de Kouadio Konan Bertin, Jérôme Brou Kablan, Amara Essy ou encore Charles Konan Banny, affichèrent pourtant leur désaccord avec cette décision jugée unilatérale et en contradiction avec le vote du dernier congrès ordinaire du parti, qui avait prévu au contraire que le PDCI présenterait un candidat.
Cette alliance garantit au Président sortant une confortable réélection dès le premier tour de l’élection présidentielle d’octobre 2015, avec 84% des suffrages exprimés, dans un contexte où l’opposition n’était jamais parvenue à se structurer, affaiblie par ses divisions et les appels au boycott d’une partie de ses leaders (cf. infra). Le Président Ouattara devait son élection à la mobilisation de l’électorat des neuf régions du nord, mais aussi de l’électorat traditionnel du PDCI dont l’ethnie baoulé constitue le cœur. Ainsi, les régions du « V baoulé » (centre) avaient largement élu Ouattara avec des taux de participation supérieurs à la moyenne nationale. La stratégie d’alliance du PDCI et du RDR semblait ainsi avoir fait ses preuves.
Cependant, la transformation du RHDP en parti politique unifié – évoquée comme pouvant se tenir dans la foulée de l’élection présidentielle de 2015 – ne se concrétisa pas, signe que cette stratégie continuait à susciter des remous dans les camps du RDR et du PDCI.
• Élections législatives de 2016 : l’alliance tient bon en dépit de quelques fêlures
Dès lors, de nombreux observateurs prédisaient la probable fracture de cette alliance alors que le pays s’acheminait vers le référendum constitutionnel d’octobre 2016 et les élections législatives de décembre 2016.
Henri Konan Bédié appela à voter en faveur du projet de nouvelle Constitution présenté par le Président Ouattara. Votre rapporteure reviendra ultérieurement sur le contenu et les modalités de cette réforme. L’alliance entre le PDCI et le RDR trouvait probablement son point d’équilibre dans la création d’un poste de vice-président. Le premier ministre Daniel Kablan Duncan, membre du PDCI, fut nommé à ce poste le 10 janvier dernier.
L’alliance du RHDP fut ainsi reconduite pour les élections législatives de décembre 2016. Le PDCI et le RDR s’accordèrent sur des candidatures communes dans l’ensemble des circonscriptions. Au total, le RDR investit 135 candidats au nom du RHPD, dont la totalité des candidats dans les circonscriptions du nord, contre 105 pour le PDCI.
Les désistements qu’impliqua ce processus de candidatures uniques suscitèrent néanmoins des mécontentements au sein des deux partis, et plus particulièrement du PDCI qui avait dû faire de nombreuses concessions au RDR.
Au terme de ces élections, l’alliance du RHDP se trouva à nouveau créditée d’une majorité confortable, quoique moins large que dans l’Assemblée issue des élections de 2011 : au total, elle obtint 167 sièges sur un total de 254, contre 204 sièges pour le PDCI et le RDR en 2012. Signe que celle alliance se trouvait fragilisée, le nombre d’élus indépendants connut une forte recrudescence : 75 au total, dont une bonne partie étaient en réalité des membres du RDR et surtout du PDCI n’ayant pas suivi les consignes de leur parti. La stratégie de ces élus indépendants – réintégration du groupe parlementaire de leur parti ou création d’un nouveau groupe – pourrait avoir un effet sur l’avenir de cette alliance.
Quoi qu’il en soit, la fusion ne paraît toujours pas vraiment actée, l’hypothèse d’un groupe parlementaire unique semblant s’éloigner. Ainsi, d’après Maurice Guikahué, le secrétaire exécutif du PDCI, « malgré le fait que nous avons voté RHDP, il y aura un groupe parlementaire PDCI et un groupe parlementaire RDR. Chaque parti politique à l’Assemblée nationale va garder son identité et sur les grandes questions, les deux groupes fusionnent pour aller ensemble d’une même voix » (16).
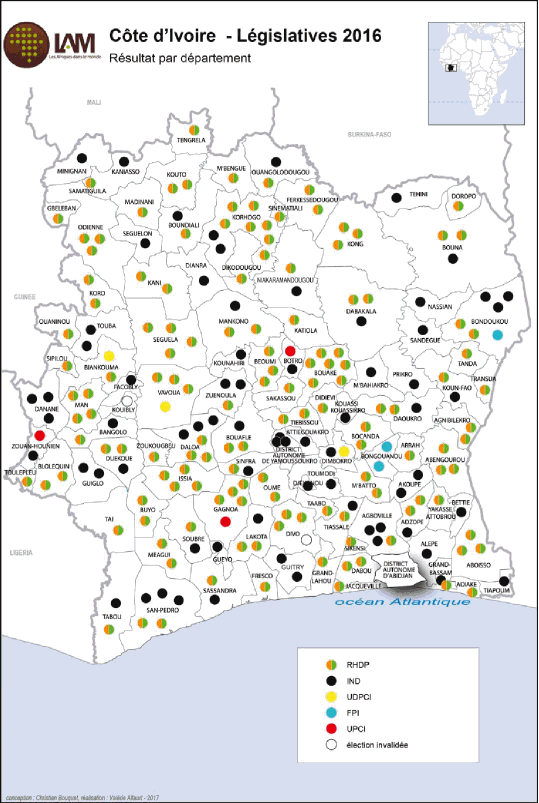
2. Une opposition qui a tendance à s’auto-exclure du jeu politique
La faiblesse de l’opposition est la conséquence directe de l’issue de la crise électorale de 2010 et de la situation actuelle de l’ancien Président Laurent Gbagbo.
Ce dernier, leader historique de l’opposition au régime d’Houphouët-Boigny et président de la Côte d’Ivoire pendant dix ans, est aujourd’hui emprisonné à La Haye mais dispose encore d’une forte influence sur le jeu politique ivoirien. Inculpé devant la Cour pénale internationale (CPI) de crimes contre l’humanité (cf. encadré), il proclame son innocence et compte encore de nombreux partisans, y compris au sein de la diaspora ivoirienne de France. La mission a eu l’occasion d’évoquer dans le détail la situation de l’ancien Président avec son avocat, Maître Emmanuel Altit (cf. encadré).
• Le FPI divisé entre deux tendances aux stratégies opposées
La principale force d’opposition au président Ouattara est le FPI. Cependant, depuis l’arrestation de Laurent Gbagbo, cette opposition pâtit d’un manque évident de structuration qui la rend quasi-inexistante face à la redoutable machine électorale du RHDP.
Elle est tiraillée entre deux stratégies : l’affirmation dans le cadre des mécanismes institutionnels et l’obstruction systématique, la rue apparaissant alors comme le meilleur canal d’expression. Lors des élections législatives de 2012, les militants du FPI, tout juste privés de leur leader et d’une bonne partie de leurs cadres, en exil ou en prison, avaient adopté la stratégie du boycott afin de dénier toute légitimité au Président Ouattara. Le FPI n’était donc pas représenté à l’Assemblée nationale.
En août 2013, Pascal Affi N’Guessan, ancien Premier ministre sous Laurent Gbagbo, emprisonné avec lui en avril 2011, a bénéficié d’une libération provisoire. Devenu président en titre du FPI, il a cherché à reprendre le flambeau en optant pour la participation au jeu politique.
Cependant, une frange importante des militants du parti du Président Gbagbo a refusé de le suivre, s’en tenant à la ligne « Gbagbo ou rien » : l’ancien Président est le seul dirigeant légitime du FPI, seule sa libération permettrait au FPI de participer à nouveau aux mécanismes institutionnels. En France, cette ligne est relayée par de nombreux proches de l’ancien Président, dont Bernard Houdin, son ancien conseiller. En Côte d’Ivoire, elle est portée par Aboudramane Sangaré, un proche de la première heure du Président Gbagbo, du temps où celui-ci militait contre le Président Houphouët-Boigny.
Lors de l’élection présidentielle de 2015, Pascal Affi N’Guessan n’a obtenu que 9% des suffrages exprimés, principalement dans son fief électoral de Moronou et dans sa ville de Boungouanou (centre-est). Plusieurs régions habituellement acquises à Laurent Gbagbo ont été marquées par une forte abstention qui a permis la victoire du Président Ouattara (Gôh, Marahoue, Guémon). Si la consigne de boycott n’est sans doute pas le seul facteur de cette abstention, elle semble néanmoins être suivie par une partie de la population.
RÉSULTATS ET PARTICIPATION À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE SEPTEMBRE 2015 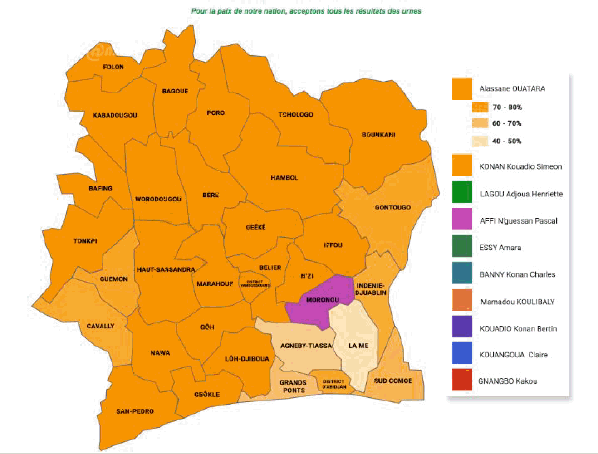
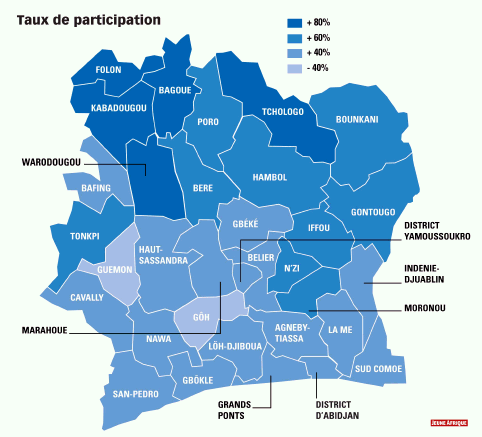
Source : Jeune Afrique
• L’échec des stratégies de rassemblement en l’absence de leader incontesté
La plupart des observateurs doutent que Pascal Affi N’Guessan ne parvienne, à court et moyen terme, à rassembler derrière lui l’ensemble des leaders et militants du FPI.
Dès lors, les stratégies de rassemblement de l’opposition semblent vouées à connaître le destin de l’éphémère « Coalition nationale pour le changement » (CNC) constituée dans la perspective de l’élection présidentielle de 2015. Fondée en mai 2015, cette coalition était en réalité un assemblage hétéroclite de personnalités de l’opposition (Aboudramane Sangaré, Laurent Akoun, Mamadou Koulibaly…) et de dissidents de la majorité (Charles Konan Banny, Essy Amara, Bertin Konan Kouadio…) qui avaient essentiellement en commun de s’opposer au Président Ouattara. L’absence de base programmatique commune, de leader ou même de porte-parole désigné a conduit à l’implosion de cette coalition avant même l’élection présidentielle. La plupart des candidats à la magistrature suprême s’étaient alors repliés sur une stratégie de boycott.
• Les élections législatives de décembre 2016
Les législatives de décembre 2016 revêtaient un enjeu particulier pour l’opposition tenue en marge de la vie politique du pays du fait de son absence de représentation à l’Assemblée nationale. En outre, l’accession au Parlement conditionne le financement des groupes politiques auquel le FPI n’a donc pas eu accès durant ces quatre dernières années. Il convient toutefois de noter que le FPI a bénéficié d’un financement extraordinaire de 600.000 euros accordé par le Président Ouattara pour la campagne présidentielle de 2015.
En 2016, l’opposition était encore partie en ordre dispersé, puisque la tendance Sangaré avait à nouveau appelé au boycott. Conscients de la nécessité de faire entendre leur voix pour assurer leur survie politique, plusieurs militants du FPI s’étaient portés candidats sans étiquette.
Les résultats des législatives de décembre 2016 illustrent à quel point la stratégie de Pascal Affi N’Guessan peine à rassembler l’électorat du FPI. Ce dernier, qui avait présenté 186 candidats pour 255 postes en jeu, n’a pu obtenir que 3 sièges au total. Il ne pourra donc pas constituer de groupe politique.
Le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour Pénale internationale (CPI)
Le 19 novembre 2011, la Cour pénale internationale (CPI) a notifié un mandat d’arrêt international à l’ancien Président Laurent Gbagbo, alors en résidence surveillée à Korhogo depuis son arrestation, en avril 2011. La nuit même, ce dernier a été transféré à la prison de Scheveningen, près de La Haye.
La Côte d’Ivoire, bien que n’étant pas partie au Statut de Rome, avait préalablement accepté la compétence de la Cour. Elle a finalement ratifié ce traité le 25 février 2013.
Les charges portées contre Laurent Gbagbo consistent en quatre chefs d’inculpation de crimes contre l’humanité qui auraient été perpétrés par l’intermédiaire des forces « pro-Gbagbo » sur les populations civiles : meurtre, viol, autres actes inhumains et persécutions. Plus précisément, quatre évènements sont visés, survenus entre décembre 2010 et avril 2011 : la marche de partisans d’Alassane Ouattara au siège de la RTI, la manifestation des femmes d’Abobo, le bombardement au mortier d’un secteur densément peuplé d’Abobo et les massacres de Yopougon.
Suite au transfert de l’ancien Président, s’est déroulée une phase de confirmation des charges. Lors de l’audience de confirmation des charges qui a eu lieu en février 2013, la Chambre préliminaire a estimé que les éléments de preuve apportés par le procureur n’étaient pas suffisants pour aller au procès. Les juges ont donc demandé au procureur de recommencer ses enquêtes. Les nouveaux éléments de preuve soumis ont conduit à la confirmation des charges contre Laurent Gbagbo en juin 2014 ; l’un des trois juges a toutefois émis une opinion dissidente. L’ancien président a ainsi été renvoyé devant la Chambre de première instance.
Le 11 mars 2015, la Chambre de première instance a décidé de joindre les procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, lui aussi transféré devant la CPI. D’après la Cour, il s’agissait « d’assurer l’efficacité et la rapidité de la procédure ». Pour Maître Emmanuel Altit, l’avocat de Laurent Gbagbo, c’était une technique judiciaire destinée à remonter plus facilement jusqu’à Laurent Gbagbo, en l’absence de preuves décisives contre lui.
Le 23 janvier 2016, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé s’est ouvert à La Haye. Celui-ci est conduit selon la procédure anglo-saxonne : la défense et l’accusation disposent de moyens égaux pour conduire leurs enquêtes et présenter leur cas. Le cas de l’accusation doit être présenté en premier ; il s’appuie sur la convocation de 138 témoins, dont seuls 29 ont été entendus au moment de la reprise du procès, en février 2017.
Le procès est retransmis sur le site Internet de la CPI ; toutefois, depuis juillet 2016, cette retransmission a lieu en différé, suite à des fuites relatives à l’identité d’un témoin.
La longueur prévisible de la procédure, alors que le cas de l’accusation est encore à ses débuts, conduit à étudier des solutions pour l’accélérer. Dans cet intervalle, la défense cherche à obtenir la libération conditionnelle de Laurent Gbagbo.
3. La bonne tenue générale des échéances électorales
• Des scrutins jugés dans l’ensemble pacifiques et crédibles
On sait combien les périodes d’élections peuvent être sujettes à de graves tensions dans des pays où, comme en Côte d’Ivoire, l’introduction de la démocratie s’est accompagnée de fortes turbulences. Le souvenir de la crise post-électorale de 2010-2011 est encore très présent. Aussi, l’élection présidentielle d’octobre 2015 a été suivie avec une attention particulière.
Dans l’ensemble, le caractère apaisé, transparent et crédible du scrutin a été relevé par les observateurs dépêchés par les ambassades (France, Royaume-Uni), les organisations de la société civile, l’ONG PEACE, la CEDEAO et l’Union africaine. Quelques incidents techniques ont été signalés, tenant à l’ouverture en retard des bureaux de vote et aux dysfonctionnements des tablettes biométriques, mais ils ne semblent pas avoir remis en question la crédibilité du scrutin. Aucune tentative notable de déstabilisation n’a par ailleurs été relevée.
Le référendum constitutionnel d’octobre 2016 était également suivi de près car il appelait les électeurs à se prononcer sur des sujets très polémiques par le passé, en particulier les conditions d’éligibilité qui constituaient un des germes de la crise ivoirienne. Dans l’ensemble, le scrutin s’est déroulé dans le calme, une cinquantaine d’incidents ayant été répertoriés sur l’ensemble du territoire : urnes incendiées à Yopougon et Gagnoa, intimidations et violences physiques à une échelle jugée faible au regard du nombre de bureaux de vote (20.000).
Quant aux législatives de décembre 2016, elles se sont déroulées dans le calme. L’ONU a qualifié ces élections de « pacifiques et inclusives », appréciation globalement partagée par la Plateforme des organisations de la société civile (POECI) qui recensait tout de même « 254 incidents critiques dont 27 cas d’interdiction aux observateurs de la POECI de rester dans les bureaux de vote tout au long de la journée ».
• Incomplétude de la liste électorale et abstention, deux facteurs de fragilisation
Le bon déroulé global des scrutins de 2015 et 2016 est tempéré par la faible participation globale des Ivoiriens. Celle-ci s’explique par une abstention assez élevée mais aussi par une liste électorale jugée encore incomplète au regard du dynamisme démographique ivoirien.
La liste électorale a été révisée au cours de l’été 2016, après une période pendant laquelle les Ivoiriens ont été appelés à s’inscrire dans les bureaux de vote de leur circonscription. Les remontées du terrain ont fait apparaître que le succès de cette opération avait été mitigé, de nombreux bureaux de vote étant restés vides la majeure partie du temps. En particulier, de nombreux jeunes en âge de voter ne se seraient pas inscrits. La liste électorale publiée comptait ainsi 6,3 millions d’électeurs, en hausse de quelques milliers par rapport à 2015, ce qui semble peu pour une population estimée à 23 millions d’habitants, de surcroît très jeune. À titre de comparaison, le voisin ghanéen, avec une population légèrement supérieure, dispose d’un corps électoral de plus de 9 millions de personnes.
Par ailleurs, la participation aux différents scrutins a eu tendance à s’effriter. Lors de la présidentielle de 2015, la participation a été estimée à 52% des inscrits, contre 84% en 2010. La participation au référendum constitutionnel d’octobre 2016 a été estimée à 42,42% des inscrits, mais ce chiffre a suscité l’incrédulité de plusieurs ONG de la société civile ainsi que de certains observateurs qui l’ont considéré trop élevé par rapport à l’affluence constatée dans les bureaux de vote. La participation a été particulièrement basse pour les élections législatives de 2016, seuls 34% des inscrits étant allés voter.
Il convient de noter que cette faible participation globale recoupe des réalités très différentes selon les régions (cf. carte ci-après). De manière générale, la participation est tombée parfois à des niveaux extrêmement bas dans les régions du sud – en particulier du sud-ouest – et à Abidjan, quand le RDR semblait parvenir à mobiliser davantage ses électeurs dans les régions du nord du pays. À cet égard, la carte électorale ci-après est explicite.
L’abstention importante résulte en partie de la défiance des Ivoiriens à l’égard de la vie politique, phénomène que l’on retrouve dans de nombreux pays. Son niveau particulièrement élevé dans les régions qui soutenaient traditionnellement Laurent Gbagbo suggère néanmoins que la consigne de boycott donnée par une partie des militants de l’opposition trouve un certain écho.
Il n’appartient pas à votre rapporteure d’exposer les raisons qui ont conduit à cette situation qui pèse lourdement sur la vie politique de la Côte d’Ivoire et hypothèque le retour à un fonctionnement démocratique apaisé. Faut-il incriminer l’ancien président et certains leaders du FPI de ne pas accepter l’issue de la crise de 2010 ou bien les dirigeants actuels et la communauté internationale ? Cela conduirait à analyser en détail une longue crise, qui a commencé en réalité avec la disparition du président Houphouët-Boigny et a connu de nombreux et tragiques rebondissements. Il appartient aux Ivoiriens, aux historiens et à la justice de se prononcer sur les responsabilités et les manquements des uns et des autres.
Toutefois, il est clair que cette situation est un indice du chemin qui reste à parcourir avant que les Ivoiriens soient complètement réconciliés et que la démocratie ivoirienne s’enracine durablement. Votre rapporteure analysera plus loin les éléments de cette réconciliation.
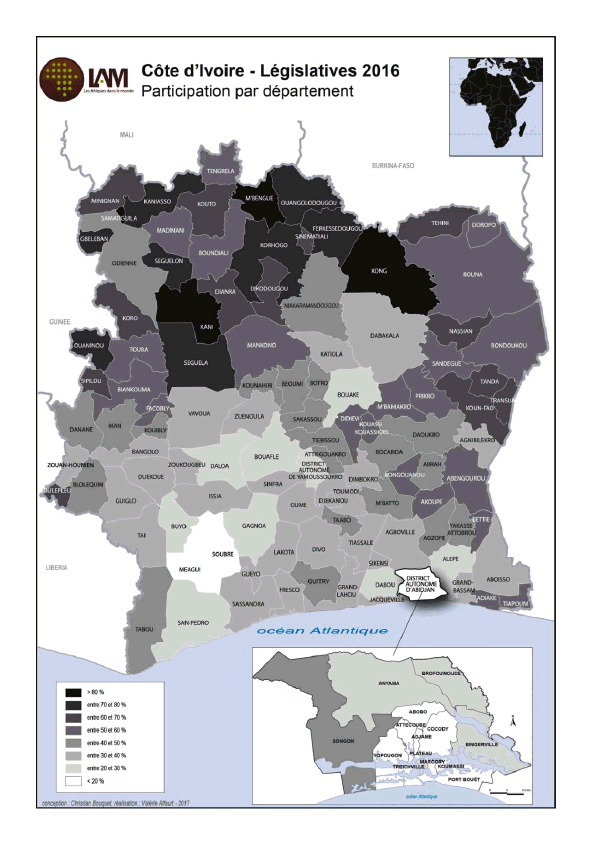
source : LAMencartes
Le Président Ouattara a fait le pari de la réconciliation des Ivoiriens par la croissance. Il avait clairement formulé ce choix dès son arrivée au pouvoir, en 2011 : « la réconciliation ne devient réalité que lorsque les uns et les autres se sentent en paix et en sécurité. Il faut avant tout améliorer les conditions de vie, restaurer les pistes, bâtir des centres de santé ou des écoles (17) ». Relancer la croissance apparaissait ainsi comme un préalable indispensable.
Cet objectif semble atteint : six ans après la crise post-électorale de 2011, la croissance ivoirienne se maintient à 8-9% par an, une exception en Afrique. D’après la Banque mondiale, « efficacité, engagement et providence sont les ingrédients de la réussite ivoirienne » (18).
1. De nombreux atouts à valoriser
La Côte d’Ivoire dispose d’un potentiel économique considérable. Intelligemment valorisé, il avait permis le « miracle ivoirien » des années 1960-1970. Ce potentiel n’est encore, à ce jour, que très partiellement exploité.
• Une agriculture puissante et diversifiée
Le modèle économique ivoirien fondé au cours des années 1960-1970 continue aujourd’hui à prouver sa pertinence. En mettant intelligemment en valeur les atouts de la Côte d’Ivoire, il lui a conféré « une structure économique qui est la plus équilibrée d’Afrique de l’Ouest, où une agriculture d’exportation diversifiée s’appuie sur une agro-industrie moderne » (19).
Le secteur agricole demeure en effet le socle de l’économie ivoirienne et le principal moteur de sa croissance. Il représente 22% du PIB et 70% des recettes d’exportation et emploie près des deux tiers de la population active du pays. Le potentiel du pays est encore supérieur : seules 35% de ses 21 millions d’hectares de terres cultivables étaient exploitées en 2012 (20).
- Les cultures d’exportation
Avec 35% du marché mondial, la Côte d’Ivoire est le premier producteur de cacao (1,8 millions de tonnes produites en 2014-2015), loin devant le Ghana. Cette production est essentiellement aux mains de petits producteurs : la taille moyenne d’une exploitation de cacao est ainsi de 3 à 5 hectares. Depuis 2015, le pays s’est hissé au premier rang mondial, devant les Pays-Bas, pour la transformation de l’or noir, assurée à 35% localement.
Au total, le secteur du cacao emploie directement 800.000 producteurs et fait vivre 6 millions de personnes, soit le quart de la population ivoirienne.
Au cours des dernières années, la filière du cacao équitable a connu un certain succès en Côte d’Ivoire. À l’heure actuelle, 113 coopératives ivoiriennes – représentant plus de 25.000 producteurs – ont reçu le label de l’organisation internationale Fairtrade, contre seulement 18 en 2013. Les producteurs engagés dans cette démarché doivent mettre en œuvre une agriculture plus durable (privilégiant les intrants naturels, respectant les droits des enfants, etc...). En contrepartie, ils reçoivent une « prime de développement » qui doit améliorer leurs revenus et bénéficient d’une meilleure visibilité sur les contrats de vente. Cette filière a aussi pour objet de réduire les « coûts cachés » du commerce du cacao afin d’améliorer les retombées pour les agriculteurs. Néanmoins, son impact serait encore limité en raison des inerties fortes liées à la structuration de la filière.
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a su remarquablement diversifier son agriculture, tirant parti de la richesse de ses terres. Le pays joue ainsi un rôle de leader sur les marchés mondiaux de l’huile de palme (450.000 tonnes produites). Pour cette production, le processus industriel de transformation en produits finis (huile raffinée et produits dérivés) se déroule intégralement sur place, avant exportation vers les pays de la CEDEAO, où la demande est en forte croissance.
La Côte d’Ivoire est également l’un des principaux producteurs de caoutchouc, pour lequel l’offre mondiale est inférieure à la demande, ainsi que de fruits tropicaux (bananes, mangues, ananas). La culture des mangues se développe rapidement dans le nord de la Côte d’Ivoire. Les quantités exportées ont considérablement augmenté, passant de 10.000 tonnes en 2011 à 32.000 tonnes en 2016, pour une production record de 100.000 tonnes. La Côte d’Ivoire est ainsi devenue le premier exportateur de mangues africain et le troisième fournisseur du marché européen. Le pays exporte aussi du coton et du café, bien que la part de cette dernière culture autrefois importante n’ait cessé de diminuer.
Par ailleurs, Jean-Pierre Marcelli, le directeur Afrique de l’Agence française de développement, est revenu devant la mission sur ce qu’il a appelé le « miracle de l’anacarde », devenue un levier important de développement des régions du nord du pays. En 2000, la Côte d’Ivoire ne produisait que 64.000 tonnes de noix de cajou. Cette production est passée à 450.000 tonnes en 2012 et à 700.000 tonnes en 2015, ce qui a permis à la Côte d’Ivoire de ravir à l’Inde le rang de premier producteur mondial, avec 25% du marché. Cette filière emploie désormais 250.000 producteurs et fait vivre près de 2,5 millions d’Ivoiriens.
- Les cultures vivrières
Parmi les productions ivoiriennes les plus importantes en valeur figurent nombre de cultures vivrières. L’examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire réalisé par l’OCDE (21) relève ainsi que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième productions agricoles ivoiriennes en valeur après le cacao sont respectivement l’igname (1,407 milliard de dollars), le riz (846 millions de dollars), les bananes plantains et le manioc. Le maïs figure en huitième position.
D’après l’OCDE, le rendement de toutes ces cultures s’est accru au cours des dernières années, à l’exception de l’igname. La culture du riz en particulier a connu un fort accroissement de sa productivité, faisant quasiment jeu égal avec l’Indonésie et devançant la Malaisie. La production de riz a ainsi progressé de près de moitié entre 2012 et 2016.
- Une agro-industrie performante
Si la production agricole demeure principalement aux mains des petits producteurs – à l’exception de la production d’huile de palme, largement industrialisée – sa commercialisation et sa transformation sont assurées par des grandes entreprises, souvent solidement implantées en Côte d’Ivoire. Celle-ci dispose ainsi d’une agro-industrie performante ; de nombreuses filiales de multinationales de l’agroalimentaire sont ainsi solidement implantées dans le pays. Ce secteur a connu un essor particulier au cours des dernières années, avec l’arrivée de nouveaux grands groupes comme Heineken ou Bel.
Les activités agro-industrielles représentées sont très variées, les principales étant la meunerie, la transformation du cacao (Barry Callebaut, Olam, Cargill, Touton, Nestlé), de l’huile de palme (Palmafrique, Palmci), de l’hévéa et, dans une moindre mesure, du café (Nestlé), ainsi que des fruits (Selectima, Compagnie fruitière) et des volailles, la brasserie (Castel), la production de boissons préparées, de sucre (Castel, Sifca), de lait et de conserves de poissons. La Côte d’Ivoire joue ainsi un rôle leader pour la production de produits industriels thoniers (Thunnus Overseas, Nueva Castelli) : elle en est le premier pays exportateur en Afrique et le deuxième dans le monde, après le Japon.
Cependant, le potentiel de ce secteur est encore très sous-exploité. Ainsi, il ne représente que 3% des exportations ivoiriennes contre 48% pour les exportations agricoles, De nombreux projets ont certes vu le jour dans ce secteur au cours des dernières années. Cependant les nouveaux investissements directs étrangers (IDE) à destination de la Côte d’Ivoire se sont prioritairement portés sur les activités de service, en particulier les télécommunications (28% du total, contre 17% pour la fabrication des produits alimentaires, selon les statistiques de l’OCDE).
• Un important potentiel énergétique et minier
- Potentiel minier et pétrolier
Ce potentiel est actuellement peu exploité en raison des lacunes de la carte géologique de base du pays ainsi que d’une distribution inégale de l’électricité sur le territoire.
S’agissant des ressources minières, le territoire ivoirien recèle notamment des gisements importants d’or (réserves estimées de 600 tonnes), de diamants, de fer, de manganèse mais aussi de bauxite et de cuivre. Pour l’heure, la contribution au PIB de ce secteur reste marginale, de l’ordre de 2%. Elle est néanmoins en forte hausse : le chiffre d’affaires du secteur aurait crû de 24% en 2015, pour atteindre 730 millions d’euros.
Pour l’heure, seuls l’or et le manganèse sont exploités à l’échelle industrielle. Les principaux producteurs d’or sont le britannique Rangold, l’Australien Newcrest Mining et le Canadien Endeavor Mining. La production d’or a cependant déjà augmenté : 18 tonnes en 2014, contre 15 tonnes en 2013. Le rapport du groupe d’experts de l’ONU notait toutefois, en 2015, qu’une partie non négligeable de l’exploitation de l’or et du diamant transitait par des circuits illégaux (22). Étaient notamment mentionnées les activités d’orpaillage illégal à Daloa et Bouna et le trafic de diamants en provenance de Séguéla. Il convient de noter que l’exportation légale de diamants n’a pu reprendre qu’à partir de la mi-2014, après la levée de l’embargo imposé par le Conseil de sécurité de l’ONU.
Le secteur pétrolier a connu un réel essor au cours des dernières années, avec un taux de croissance régulier et des investissements d’envergure. La Côte d’Ivoire exporte du pétrole brut et importe un pétrole plus léger, adapté à ses installations de raffinage, gérées par la Société ivoirienne de raffinage (SIR). D’après les autorités ivoiriennes, la production s’est élevée à près de 30.000 barils par jour en 2015, contre 19.000 barils en 2014 ; cette hausse se serait poursuivie en 2016. Le gouvernement s’est fixé pour objectif d’atteindre, à terme, les 200.000 barils par jour. La montée en puissance de ce secteur a néanmoins été ralentie par la baisse du cours mondial du pétrole. Les ventes de produits pétroliers représentaient ainsi 13% des exportations ivoiriennes en 2015, soit 1,4 milliard d’euros, en baisse de 26% par rapport à 2014.
- Potentiel énergétique
La Côte d’Ivoire ambitionne d’être un hub énergétique régional et dispose pour cela d’un potentiel gazier et hydroélectrique certain. Pour l’heure, elle possède trois centrales thermiques et six barrages hydroélectriques. Si la part de l’hydraulique reste supérieure à la moyenne africaine, les deux tiers de l’électricité ivoirienne sont produits à partir du gaz naturel extrait au large de ses côtes. Celle-ci est en partie exportée vers ses voisins : Mali, Burkina Faso et bientôt Libéria et Guinée. Cependant sa production est encore très insuffisante, en particulier au regard du prévisible accroissement des besoins qui accompagnera la croissance. Des investissements sont ainsi prévus pour doubler la capacité de production d’électricité de 2000 à 4000 mégawatts installés d’ici 2020.
• Un potentiel considérable en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC)
Les TIC ont effectué une réelle percée en Côte d’Ivoire au cours des dernières années et recèlent un vrai potentiel, d’une part parce que les besoins du pays sont immenses, d’autre part parce que les Ivoiriens s’avèrent très friands de ces technologies et plutôt doués pour les manier.
Les télécommunications sont une activité en pleine expansion ; leur contribution au PIB est estimée à 6%. Le taux de pénétration des téléphones mobiles est d’ores et déjà de 110%, avec un parc d’abonnés de 24,7 millions. Ce chiffre est d’autant plus étonnant quand on considère que seuls 60% des Ivoiriens ont accès à l’électricité permettant de recharger ces téléphones ; aussi les points de rechargement mobile se sont multipliés.
La forte pénétration de la téléphonie mobile a entraîné l’essor de services variés, souvent spécifiques au marché africain. Ainsi, les activités de mobile banking – qui permettent d’avoir accès à des services financiers sur son téléphone – ont connu un développement rapide : on recenserait ainsi plus de 2 millions d’utilisateurs (23). Plus largement, le e-commerce a connu une croissance rapide (Jumia, Vendito, Cdiscount, Yatoo, etc...), ainsi que les services de paiement via téléphone (factures pour l’eau, l’électricité mais aussi paiements dans les supermarchés).
Par ailleurs, le pays compterait plus de 8 millions d’internautes pour seulement 110 000 abonnements à une offre ADSL. L’accès à Internet s’effectue ainsi majoritairement par l’offre Internet mobile et par le biais des 400 cybercafés répartis sur le territoire.
Plusieurs interlocuteurs relèvent que les Ivoiriens, en particulier les jeunes, ont de réelles aptitudes dans le domaine numérique. Pour Sophie Clavelier, la directrice régionale de Business France, leur niveau de formation officiel ne rend pas entièrement compte de leurs capacités car ils ont un « potentiel de débrouille » très important. Ce potentiel demeure cependant très insuffisamment valorisé.
À cet égard, l’exemple du phénomène des « brouteurs » est particulièrement révélateur. De plus en plus jeunes ivoiriens, en raison d’une dilution des valeurs et d’un sentiment d’impunité nourri par la crise, mais aussi faute de projets structurants et de perspectives de carrière, s’adonnent à la cybercriminalité. Ces « brouteurs », spécialisés dans les arnaques sur Internet, sont loin d’être un phénomène unique en Afrique. Dans ce domaine, les Nigérians, Ghanéens et Camerounais ont joué un rôle pionnier. Cependant, un article de Jeune Afrique daté de 2013 (24) mentionnait Abidjan comme la capitale de cette nouvelle criminalité. On ne peut que déplorer le gaspillage du potentiel de cette jeunesse qui fait preuve d’une vraie agilité dans le maniement des nouvelles technologies, dont il pourrait être tiré parti pour accélérer le développement du pays.
• Des infrastructures relativement performantes
La Côte d’Ivoire dispose d’un stock d’infrastructures historiquement de très bonne qualité, mais dont l’état s’est dégradé avec le temps et les épisodes de conflit.
Le pays concentre 50% du réseau routier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avec 82.000 km de routes dont 6500 km de tronçons bitumés. Ce réseau est cependant vieillissant ; sa rénovation et son extension figurent parmi les priorités des plans de développement ivoiriens.
La Côte d’Ivoire possède par ailleurs deux ports autonomes qui comptent parmi les plus influents de la sous-région. Celui d’Abidjan est le premier port en eau profonde d’Afrique de l’Ouest. Il permet à la Côte d’Ivoire de jouer un rôle de hub à destination des pays enclavés de l’hinterland (Burkina Faso, Mali, Niger). Quant au port de San Pedro, il s’agit du plus grand port exportateur de cacao au monde.
La Côte d’Ivoire dispose d’un aéroport international parmi les plus dynamiques du continent, l’aéroport Félix-Houphouët-Boigny, ainsi que de six aéroports nationaux qui ont été réhabilités à Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo, San Pedro, Man et Odienné. Enfin, elle possède une ligne ferroviaire de 1260 km la reliant à Ouagadougou, gérée par une filiale de Bolloré, la Sitarail. Elle joue un rôle important dans le transport de détail et de personnes mais doit être rénovée.
2. Un impressionnant redressement depuis 2011
• Une croissance soutenue faisant figure d’exception en Afrique
Fin 2015, le PIB ivoirien s’élevait à environ 32 milliards de dollars. Entre 2012 et 2015, la croissance avait été en moyenne de 9% par an, un taux nettement supérieur au taux d’accroissement naturel de la population, estimé à 2,4% par an. Les données récentes de la Banque mondiale font apparaître un léger repli en 2016, avec une croissance estimée à 7,9% (25).
Ce taux, qui demeure soutenu, ne peut plus être analysé aujourd’hui comme un simple effet de rattrapage de la crise ivoirienne, lequel aurait inévitablement fini par s’estomper.
La croissance ivoirienne contraste avec les difficultés rencontrées par la plupart des pays africains, dans un contexte de baisse des cours des matières premières et, en particulier, du pétrole. Ainsi, le taux de croissance moyen du continent africain n’a été que de 1,5% en 2016. D’après la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire a enregistré le deuxième taux de croissance du continent, derrière l’Éthiopie mais devant le Ghana et le Nigéria, dont les économies avaient été particulièrement dynamiques au cours de la période récente.
En 2014 et en 2015, la Côte d’Ivoire a bénéficié d’un environnement international très porteur, à rebours de ses voisins : le maintien des cours du cacao et de l’anacarde s’est conjugué à la baisse des cours du pétrole, dont la Côte d’Ivoire est importatrice nette. La dépréciation du franc CFA par rapport au dollar, devise dans laquelle sont libellés les principaux produits exportés, a aussi joué favorablement. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a été moins affectée que ses voisins par le ralentissement de la croissance chinoise, la Chine représentant une part relativement modeste des investissements étrangers et des exportations du pays (cf. infra, sur la concurrence étrangère). Ainsi, au cours de cette période, la Côte d’Ivoire a bénéficié d’une amélioration des termes de l’échange de l’ordre de 30%. Son excédent commercial a culminé à 1,9 milliard de dollars en 2015.
En 2016, la situation de la Côte d’Ivoire est devenue un peu moins favorable en raison de mauvaises conditions climatiques au cours de la première partie de l’année (fort harmattan), qui ont nui aux récoltes, mais aussi d’une baisse continue du cours du cacao sur les marchés internationaux : celui-ci a ainsi perdu 25% de sa valeur entre novembre 2015 et novembre 2016. Ainsi, les exportations ivoiriennes, qui avaient crû de 12% en valeur en 2015, ont diminué de 13% sur les huit premiers mois de l’année 2016, par rapport à la même période en 2015.
On peut néanmoins considérer que la croissance ivoirienne a remarquablement résisté au contexte régional morose qui prévaut. Elle a été principalement portée par les services dont la contribution est estimée à 4,1%, notamment grâce à l’expansion rapide des secteurs de l’énergie, des communications, du commerce et du transport. Dans le secteur secondaire, la construction, tirée par les investissements publics, est la principale locomotive, suivie par l’extraction minière.
La plupart des observateurs estiment que les perspectives de l’économie ivoirienne sont positives pour les prochaines années. Le FMI prévoit que la croissance ivoirienne devrait se maintenir à un niveau supérieur à 7% du PIB jusqu’en 2020. Il conviendra toutefois d’être vigilant face à certains risques, sur lesquels votre rapporteure reviendra (cf. partie II.A). Par ailleurs, il faudra suivre l’évolution du cours du cacao, dont la baisse s’est poursuivie au-delà du mois de novembre et qui se trouve actuellement à son plus bas niveau depuis trois ans.
• Une gestion économique de qualité
- Un personnel politique compétent
Les interlocuteurs rencontrés par la mission sont nombreux à reconnaître la bonne qualité de la gestion économique conduite par le Président Ouattara et son équipe. Alassane Ouattara est lui-même économiste de formation ; il a occupé des postes de responsabilité au sein de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et du FMI, dont il est devenu le directeur général adjoint en 1994. Le Président a veillé à s’entourer de personnes de confiance, à l’image de l’ex-Premier ministre et actuel vice-Président Daniel Kablan Duncan, qui avait déjà fait ses preuves à ce poste en 1994-1995, lors de la délicate période qui avait suivi la dévaluation de 1994. Par ailleurs, lors de l’échange avec les membres de la mission, Amadou Gon Coulibaly, l’actuel Premier ministre, s’est singulièrement distingué.
De manière générale, il est indéniable que la mission a eu le sentiment de rencontrer, lors de son séjour en Côte d’Ivoire, des interlocuteurs dotés d’une vision claire des enjeux auxquels le pays est confronté et des solutions à apporter.
Cette appréciation est aussi celle de l’AFD, qui coopère au quotidien avec les responsables ivoiriens pour l’instruction et la mise en œuvre des projets. Selon le directeur Afrique de l’AFD, « nous avons des partenaires de bonne qualité, de la présidence à la maîtrise d’ouvrage. Les ministres sectoriels avec qui l’AFD travaille (éducation, santé, infrastructures économiques, etc...) sont de bon niveau et engagés, avec des responsables ou cadres également compétents (directeurs de cabinet, directeur général de la planification au ministère de l’agriculture, etc.) ».
- Une gestion budgétaire et monétaire jugée prudente
La qualité de la gestion budgétaire et monétaire de la Côte d’Ivoire est décrite par la Banque mondiale comme l’un des facteurs de la croissance prolongée du pays (26). Le rapport souligne que les autorités ont maintenu une gestion prudente en dépit des échéances électorales de 2015 et 2016, lesquelles sont souvent source de dérapages.
Le déficit budgétaire est considéré comme maîtrisé bien qu’il ait crû de 2,8% du PIB en 2015 à 4% en 2016. Si le pays a eu recours, de manière croissante, à l’endettement extérieur, c’est essentiellement pour financer des dépenses en capital, les recettes intérieures suffisant à financer les dépenses courantes. Cette tendance s’est retournée en 2016 en raison d’une inversion du différentiel de coût entre ces différents emprunts.
La dette publique a atteint 48,3% en 2016, un niveau jugé relativement raisonnable par la Banque mondiale qui considère le risque de surendettement « modéré ». Cette appréciation est partagée par les agences de notation internationales qui accordent en général à la Côte d’Ivoire un B+ avec une perspective stable, à l’image de Fitch ratings.
Enfin, l’inflation est restée maîtrisée à moins de 2% du PIB depuis 2013, la stabilité procurée par le cadre institutionnel du franc CFA aidant. Au total, la gestion budgétaire et financière du président Ouattara a été jugée crédible et raisonnable par la communauté internationale. Il faudra pourtant suivre dans la durée la dynamique de l’endettement ivoirien, dont la tendance à la hausse devra être maîtrisée (cf. infra).
• Une réelle ambition réformatrice
Depuis 2012, les autorités ivoiriennes encouragent les investissements, dynamisent l’image du pays et opèrent des réformes pour améliorer le climat des affaires.
- Le développement rapide des infrastructures
Le bâtiment et travaux publics (BTP) a été l’un des moteurs de la croissance ivoirienne depuis 2012. 60% des investissements publics ont été réalisés dans ce secteur.
De nombreux projets ont ainsi été achevés ou sont en cours de réalisation : infrastructures routières (autoroute Abidjan-Grand-Bassam, construction en un temps record du pont Henri Konan Bédié à Abidjan), ouvrages d’art, logements sociaux, etc.
Ce programme de développement des infrastructures routières devrait encore monter en puissance au cours des prochaines années, les autorités ayant affiché des ambitions importantes dans le cadre du « plan national de développement 2016-2020 », avec notamment un plan de développement routier d’un montant de 5,7 milliards de dollars.
Par ailleurs, le pays a lancé la rénovation de la ligne ferroviaire Abidjan-Ouagadougou en 2015. Il est prévu de moderniser les quais du Port autonome d’Abidjan et d’ouvrir un deuxième terminal de conteneurs en 2018. Un môle destiné à l’exportation des produits thoniers y a été inauguré en novembre 2015. Le Port de San Pedro fait, lui aussi, l’objet de projets d’extension et de modernisation.
- L’amélioration de l’environnement des affaires
Les autorités ivoiriennes ont pris acte de la nécessité d’améliorer l’environnement des affaires afin d’attirer les investisseurs privés. Elles ont lancé un vaste programme de rationalisation des procédures administratives auxquelles doivent faire face les opérateurs économiques. Un guichet unique a été mis en place pour les investisseurs étrangers, le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI). Il permet de créer une entreprise en 48 heures et d’obtenir un agrément pour investir en 21 jours.
Les autorités ont également cherché à améliorer l’environnement juridique pour les investisseurs. Le code des investissements a été modifié en 2012, de même que le code minier. Par ailleurs, des codes des télécommunications et de l’électricité ont été adoptés. Un tribunal du commerce a été créé à Abidjan en 2012.
Ces réformes ont permis à la Côte d’Ivoire de progresser de la 177ème à la 139ème place dans le classement Doing Business entre 2013 et 2015. Cependant, le pays a rétrogradé à la 142ème place (sur 190) en 2016 et 2017, signe que cette évolution demeure fragile. Au total, les chefs d’entreprises rencontrés par la mission se sont accordés sur le fait que l’environnement des affaires évoluait lentement mais plutôt favorablement, sauf sur la question de la corruption sur laquelle votre rapporteure aura l’occasion de revenir.
- Le développement de l’agriculture
Le dynamisme de la croissance économique ivoirienne au cours des dernières années a reposé notamment sur le secteur agricole, en raison de la bonne tenue des cours du cacao, du café et de l’anacarde, mais aussi du fait de l’augmentation de la production. La production de cacao est ainsi passée de 1,4 millions de tonnes en 2011 à 1,8 millions de tonnes en 2015. Cette hausse résulte de l’augmentation des surfaces cultivées mais également d’une amélioration de la productivité.
Pour autant, selon la Banque mondiale, les performances de l’agriculture sont restées en-deçà de celles des autres secteurs. Le rapport de l’OCDE montre que la productivité moyenne agricole est faible en Côte d’Ivoire, et qu’elle s’est encore affaiblie à la suite des crises politiques. Ainsi, depuis le début des années 2000, les avantages comparatifs des plantations de cacao et d’hévéa ivoiriennes ont décliné et le désavantage comparatif des plantations de café et de palmier à huile s’est creusé : les rendements des palmiers à huile ivoiriens sont ainsi sept fois inférieurs à ceux de l’Indonésie.
Les causes en sont multiples : vieillissement des vergers, notamment de cacao, diffusion insuffisante ou piètre qualité des engrais, équipements et techniques d’irrigation, état des infrastructures, coûts de transport et d’intermédiation, problèmes fonciers, absence d’économies d’échelle dans un contexte où prévalent de petites structures faiblement mises en réseau…
La Côte d’Ivoire devra donc accroître durablement la productivité de son agriculture si elle veut pérenniser ses bonnes performances, au-delà des fluctuations des cours mondiaux. Il convient de noter que les autorités ont adopté des mesures visant à améliorer les revenus des petits producteurs par l’augmentation du prix du cacao « bord champ », c’est-à-dire payé au producteur, de 750 franc CFA par kilogramme en octobre 2013 à 850 francs CFA en octobre 2014, 1000 francs CFA en octobre 2015 et 1100 francs CFA en octobre 2016. Ces mesures sont importantes car les petits producteurs vivent pour la plupart sous le seuil de pauvreté.
Elles devront être prolongées par des actions visant à moderniser résolument l’agriculture ivoirienne. Il ne s’agira pas de revenir massivement sur le type d’exploitation familial qui prévaut en Côte d’Ivoire. Un expert auditionné par la mission estimait ainsi que si la production agricole ivoirienne basculait aux mains des grands groupes comme en Argentine, où les plantations de soja emploient quatre hommes pour 1000 hectares de superficie, cela susciterait un exode rural massif que les villes ivoiriennes ne seraient aucunement en mesure d’absorber, en l’absence de révolution industrielle. Il s’agit donc de trouver les moyens d’accroître la productivité de ces petites structures en améliorant les plants et les engrais, en généralisant l’irrigation et la culture attelée, en mettant en réseau les producteurs et commerçants, en améliorant les infrastructures, etc.
L’action publique est nécessaire pour y parvenir, ne serait-ce que pour construire des routes et raccorder les campagnes à l’électricité. Les partenariats entre petits producteurs et grands groupes assurant la transformation et la commercialisation peuvent aussi y contribuer. Ces partenariats ont pour objectif d’accroître la productivité des producteurs tout en assurant l’approvisionnement régulier et la qualité de la filière : ils sont donc à somme positive. Ils peuvent apporter aux producteurs intrants et compétences, mais aussi certaines infrastructures comme des magasins de stockage ou des moyens d’irrigation.
Ces partenariats ont déjà commencé à se mettre en place en Côte d’Ivoire. Ainsi, le chocolatier Cémoi, dont la mission a visité l’usine, a lancé, dans le cadre d’une joint-venture avec Blommer et Petra Food, un programme intitulé PACST (processors alliance for cocoa traceability and sustainability) qui associe 22 coopératives et 20.000 planteurs pour obtenir des fèves fraiches fermentées de façon scientifique, afin d’avoir un cacao plus fin. En retour, les planteurs sont payés 20% au-dessus du prix officiel. Ce programme illustre les possibilités de montée en puissance et en gamme d’une agriculture appelée à conserver une place importante dans l’économie du pays.
3. La confiance retrouvée de la communauté internationale et des bailleurs
La stabilisation politique de la Côte d’Ivoire et l’arrivée au pouvoir d’une équipe jugée compétente ont rétabli la confiance de la communauté internationale qui s’est pleinement réinvestie dans le pays. Le retour rapide de la croissance et l’amélioration progressive de l’environnement des affaires ont convaincu les bailleurs publics et, dans une certaine mesure, les partenaires privés, de soutenir le plan de développement porté par le Président Ouattara. Ainsi, en 2015, l’afflux de capitaux étrangers en Côte d’Ivoire a plus que doublé par rapport à 2012, totalisant 600 millions d’euros environ.
• Le solide soutien de la communauté internationale
La crise ivoirienne avait jeté le doute sur la capacité du pays à normaliser sa situation sécuritaire et administrative et fortement écorné son image sur la scène internationale. La rapide « prise en main » de la situation sécuritaire et économique par les autorités à partir de 2012 a eu pour effet de rassurer la communauté internationale, qui a choisi de soutenir résolument le Président Ouattara.
Le symbole de cette confiance retrouvée a été l’installation – ou le retour – de plusieurs institutions internationales dans le pays. La Banque africaine de développement (BAD) est ainsi rentrée à Abidjan en 2014, après onze années d’exil à Tunis, même si le projet de délocalisation d’une partie des effectifs de cette banque a suscité une polémique récente. De même, en septembre 2015, l’Organisation internationale du cacao (ICCO), basée à Londres depuis 1973, a officialisé son déménagement prochain en Côte d’Ivoire. Et en mars 2016, c’est la Banque européenne d’investissement (BEI) qui a annoncé l’ouverture d’un bureau régional à Abidjan.
Plus généralement, la confiance de la communauté internationale a été illustrée par le soutien massif apporté par les bailleurs publics au plan national de développement 2016-2020 présenté par la Côte d’Ivoire. Réalisé avec l’aide de l’OCDE, ce plan de développement requiert des financements de l’ordre de 46 milliards d’euros sur quatre ans, dont 62% sont attendus du secteur privé et 38% du secteur public.
Lors du groupe consultatif organisé à Paris les 17 et 18 mai dernier, au siège de la Banque mondiale, les bailleurs publics ont massivement soutenu ce plan présenté par l’ancien Premier ministre Kablan Duncan. Le Gouvernement recherchait 6,75 milliards d’euros pour compléter ses ressources propres, et s’en est vu promettre 13,6 milliards par les partenaires institutionnels du pays, dont 5 milliards par la Banque mondiale, 2 milliards par la BAD et 1,8 milliard par la Banque islamique de développement.
Par ailleurs, en octobre 2016, les autorités ivoiriennes et le FMI se sont mis d’accord sur un programme de soutien au plan de développement ivoirien. En décembre 2016, le conseil d’administration du FMI a approuvé deux accords au titre de la Facilité élargie de crédit (27) (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (28) (MEC) permettant de mobiliser au total 658 millions de dollars, dont 94,1 millions immédiatement. Cet accord faisait suite à la facilité élargie de crédit de 616 millions de dollars accordée en 2011.
• Le retour rapide mais prudent des investisseurs privés
La Côte d’Ivoire a bénéficié d’un regain d’intérêt des investisseurs privés – notamment français – depuis la fin de la crise. Pour Jean-Pierre Marcelli, directeur Afrique de l’AFD, la rapidité avec laquelle les affaires ont repris montre que le secteur privé avait gardé un ancrage assez important. En réalité, pendant la crise, seuls les grands groupes avaient pu se maintenir dans le pays ; les petites entreprises étaient parties. Ces dernières commenceraient à présent à revenir.
De fait, les investissements privés ont augmenté régulièrement depuis 2011. L’installation de plusieurs grands groupes a été emblématique de cette attractivité renouvelée. Ainsi, Carrefour a ouvert son premier hypermarché en Afrique subsaharienne à Abidjan, en partenariat avec CFAO, en décembre 2015. Au même moment, une usine installée par le groupe Bel démarrait la production de la Vache qui Rit. Le groupe hollandais Heineken, associé à la CFAO, a lancé Brassivoire, nouvelle concurrente pour la Solibra, du groupe Castel. L’Allemand Merck a ouvert en octobre 2016 une filiale ivoirienne qui doit servir de plateforme régionale pour les activités du groupe. Et ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres.
Néanmoins, la marge de progression reste importante. Ainsi, la Côte d’Ivoire demeure une destination de second rang à l’échelle régionale pour les investissements directs étrangers (IDE). D’après les données de la CNUCED, ceux-ci s’élevait à 430 millions de dollars en 2015, contre 3,19 milliards pour le Ghana et 3,06 milliards pour le Nigéria, où ces investissements atteignaient fréquemment les 8 milliards annuels avant la chute du cours du pétrole. Au total, la hausse des IDE enregistrée depuis 2011 reste mesurée : de 302 millions de dollars en 2011, ils sont passés à 439 millions en 2014, avant de redescendre à 430 millions en 2015. Ces chiffres restent ainsi inférieurs au pic historique de 466 millions d’euros enregistré en 2008, avant que ces investissements ne chutent (données de la Banque de France).
D’après la Banque mondiale, le ratio investissement par rapport au PIB s’établissait à 18,4% en Côte d’Ivoire en 2015, en dessous de la moyenne de l’UEMOA évaluée à 22,8% et bien en-dessous du ratio du Sénégal qui est de 26,9%. La Banque mondiale considère ainsi que la Côte d’Ivoire pourrait obtenir un surcroît de croissance considérable si elle parvenait à relever ce ratio, ce qui impliquerait de stimuler l’expansion de son secteur privé.
Or, cette expansion semble encore quelque peu freinée par un climat des affaires jugé encore difficile en dépit des réformes entreprises. Ainsi, lors du groupe consultatif de mai 2016, les autorités ivoiriennes ont certes obtenu deux fois ce qu’elles avaient demandé de la part des bailleurs publics, mais elles ne sont pas parvenues à mobiliser autant que prévu de la part du privé. Ainsi, les engagements se sont élevés à environ 14 milliards d’euros sur la période 2016-2020, alors que le gouvernement ivoirien en attendait 28 milliards.
Il convient cependant de noter qu’à l’heure où ce rapport est publié, les premières estimations font état d’une forte hausse du flux d’investissements directs étrangers (IDE) en Côte d’Ivoire en 2016. D’après la Banque mondiale, les IDE représenteraient près de 3% du PIB ivoirien en 2016, contre 1,3% en 2015. Pour l’institution, cette hausse « traduit l’engouement des investisseurs internationaux dans les secteurs de la transformation agro-alimentaire et des services de consommation, notamment le commerce. Elle reflète aussi un élargissement de la base des investisseurs, qui viennent d’horizons de plus en plus différenciés, y compris d’Asie et d’Afrique du nord, et plus uniquement de France et d’Europe » (29).
• La redynamisation du partenariat avec l’Union européenne
L’Union européenne semble enfin prendre conscience de l’enjeu majeur que constitue la relation avec l’Afrique, en particulier dans les domaines de la sécurité, du développement, de la démographie et de l’immigration. L’engagement de l’Union européenne dans la formation de l’armée malienne, mais aussi l’intervention très remarquée de la Haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l’Union, Federica Mogherini, lors du forum de Dakar en décembre 2016, semblent prometteurs à cet égard.
En Côte d’Ivoire, cette coopération s’articule autour des échanges commerciaux et de l’aide au développement.
- Vers la mise en œuvre d’un « partenariat économique »
Les relations entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne sont inscrites dans le cadre de l’accord de Cotonou initialement signé en 2000, qui a pour objectif de promouvoir une approche stratégique commune pour la réduction de la pauvreté et l’intégration progressive des pays du groupe ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) dans l’économie mondiale. Ces relations ont progressivement évolué d’un régime préférentiel unilatéral à des accords de partenariat économique (APE) établissant un libre échange commercial réciproque entre l’Union européenne et les pays ACP.
Avec la Côte d’Ivoire, l’Union européenne a signé en 2008 un accord de partenariat économique intérimaire qui devait servir de solution d’attente pendant la négociation d’un accord de partenariat régional entre l’Afrique de l’ouest (CEDEAO + Mauritanie) et l’Union européenne. Cet accord intérimaire n’avait cependant pas été ratifié en raison des progrès de l’accord régional, finalement conclu en juillet 2014, après dix ans de négociations. La Côte d’Ivoire avait été, avec le Ghana et le Sénégal, un élément moteur pour convaincre les pays africains des bienfaits de cet accord régional.
La conclusion de l’accord de partenariat régional avait permis à la Côte d’Ivoire d’être maintenue dans le règlement d’accès au marché (RAM) (30) qui octroie un accès sans droits ni quotas au marché européen à tous les produits sauf les armes. Ce régime est en effet octroyé à tous les pays en cours de négociation et de ratification de l’APE.
Cependant, l’entrée en vigueur de cet APE régional s’est heurtée à des réticences marquées de plusieurs pays. Bien que treize États sur les seize concernés aient signé ce texte en décembre 2014, le Nigéria, la Gambie et la Mauritanie s’y sont refusés pour des motifs économiques et politiques.
Devant cette situation de blocage, la Commission européenne a posé un ultimatum à ses partenaires en juillet 2016 – même si certains États membres, dont la France, s’y étaient opposés : elle a adopté plusieurs actes délégués pour retirer du RAM les pays n’ayant pas ratifié leur APE depuis 2014. Or, il était impossible de ratifier l’APE régional tant que tous les États ne l’avaient pas signé. La Côte d’Ivoire risquait ainsi de perdre le droit à ces préférences commerciales le 1er octobre 2016.
Pour contourner cette impasse, le pays a fait le choix de réactiver et ratifier l’accord de partenariat bilatéral intérimaire qui avait été signé en 2008. Ce dernier est entré en application le 3 septembre 2016. Il prévoit un accès libre de droits sur le marché européen pour les produits européens. Des dispositions particulières sont toutefois prévues pour protéger certains secteurs considérés comme sensibles par l’Union (sucre, riz, bananes), notamment en cas d’augmentation importante des importations de Côte d’Ivoire.
Côté ivoirien, il est prévu que les tarifs pour l’importation de produits européens représentant au total 81% des exportations de l’Union vers la Côte d’Ivoire seront progressivement démantelés sur une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. Les 19% de produits qui ne seront pas libéralisés comprennent essentiellement la viande, le café, les huiles et graisses, le cacao et les produits préparés à base de chocolat, les jus de fruit, le tabac, le ciment, les carburants, le coton, les métaux précieux et les automobiles. Des mesures de sauvegarde sont prévues afin, notamment, d’assurer la protection des industries naissantes ivoiriennes.
- La coopération en matière de développement
Celle-ci est principalement financée par le Fond européen de développement (FED). Dans le cadre du 11ème FED, le programme indicatif national (PIN) de la Côte d’Ivoire pour la période 2014-2020 prévoit une enveloppe de 273 millions d’euros répartis entre trois secteurs principaux : le renforcement de l’État et la consolidation de la paix (60 millions d’euros), l’agriculture et la sécurité alimentaire (60 millions d’euros) et l’énergie (139 millions d’euros). Le programme inclut aussi des enveloppes spécifiques pour des mesures d’appui à la société civile de l’ordre de 14 millions d’euros.
En dehors des financements prévus dans le cadre du FED, la Côte d’Ivoire bénéficie de lignes spécifiques dédiées à la protection des droits humains (Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme) et à l’appui aux organisations de société civile et aux autorités locales. Enfin, l’Union européenne entretient encore dans le pays un bureau permanent d’ECHO, l’Office humanitaire et de la protection civile de l’Union européenne. Installé dans le pays lors de la crise post-électorale de 2011, ce bureau a aujourd’hui pour mission d’assurer la transition entre l’urgence et le développement, dans le cadre d’un « partenariat pour la transition » qui prévoit des actions en matière de santé primaire, de sécurité alimentaire, d’appui aux moyens d’existence et d’assistance au retour des populations.
Enfin, il convient de noter que la Côte d’Ivoire est à présent éligible au fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne créé pour venir en aide aux pays d’Afrique les plus fragiles et les plus affectés par la situation migratoire. Le principe de ce fonds avait été acté lors du sommet Union européenne-Afrique organisé à La Valette en novembre 2015. Doté d’un montant initial de 1,8 milliard d’euros répartis entre 23 pays d’Afrique, il vise à lutter contre les causes profondes des migrations « en générant de nouvelles opportunités économiques et en faisant la promotion de la sécurité et du développement ».
D. UN NOUVEAU MOTEUR POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ?
1. Un relais aux moteurs nigérian et ghanéen
« Côte d’Ivoire is back ». Avec le retour de la croissance, la Côte d’Ivoire prétend retrouver le rôle de locomotive de l’Afrique de l’ouest qui était le sien au temps du « miracle ivoirien », dans les années 1960-1970. Le pays s’était alors considérablement développé et modernisé. Devenue pays à revenu intermédiaire, la Côte d’Ivoire était parvenue à réduire considérablement la pauvreté. Elle était considérée comme un modèle sur le continent et constituait un pôle d’attraction régional pour les migrations économiques, notamment en provenance du Sahel, mais aussi pour les « cerveaux », le système éducatif ivoirien étant reconnu pour son excellence.
L’actuelle croissance ivoirienne suscite ainsi des espoirs. Dans un contexte où les moteurs récents de l’Afrique de l’Ouest –Nigéria et Ghana – sont en panne, la Côte d’Ivoire pourrait redevenir le poumon économique de l’Afrique de l’Ouest. En effet, le Nigéria, géant économique de la région, dont le PIB représentait en 2015, avec 445 milliards d’euros, cinq fois celui de l’UEMOA, a été frappé de plein fouet par la baisse des cours du pétrole. En outre, l’insécurité liée à l’ancrage de Boko Haram dans le nord-est du pays et à la montée en puissance des groupes armés dans le sud pourrait durablement gêner les ambitions du pays, dont la croissance devrait être quasiment nulle en 2016.
Quant au Ghana, qui avait connu des taux de croissance exceptionnels entre 2008 et 2013 et enregistré en 2011 le taux record de 14%, il a également pâti de la baisse du cours de l’or noir qui a considérablement dégradé la situation de ses finances publiques, au point que le pays a dû faire appel au FMI en 2014. Le Ghana avait en effet conduit une politique budgétaire expansionniste qui s’est avérée insoutenable avec le retournement des cours. La croissance ghanéenne devrait s’élever à 4% du PIB en 2016 et repartir à la hausse en 2017 et 2018. Si le pays demeure attractif en raison notamment de sa stabilité et de sa démocratie bien ancrée, il est handicapé par la faiblesse du cédi ghanéen dans un contexte où il importe beaucoup, et pâtit d’un problème non résolu d’alimentation électrique qui se traduit par de fréquents délestages particulièrement nuisibles à la vie économique du pays.
Dans ce contexte, la Côte d’Ivoire aspire à devenir un « hub » régional, une porte d’entrée et une plateforme pour les investisseurs en Afrique de l’ouest. L’effort considérable de modernisation des infrastructures s’inscrit dans cette perspective. À l’heure actuelle, la Côte d’Ivoire est indéniablement le poids lourd de l’UEMOA (31), dont elle représente 40% du PIB et 60% des exportations. C’est désormais à l’échelle de la CEDEAO (32) que le pays aspire à peser.
2. Vers une relance de l’intégration régionale ?
• L’intégration régionale ouest-africaine, une œuvre de longue haleine
En dépit des discussions conduites au sein des organisations économiques régionales, l’Afrique reste un continent très peu intégré d’un point de vue formel. L’Afrique de l’ouest n’échappe pas à ce diagnostic. Certes, les pays de l’UEMOA sont liés entre eux par une monnaie commune, ce qui constitue en théorie un degré d’intégration très poussé. Mais même au sein de cette zone monétaire, on n’observe pas le développement d’un tissu régional d’entreprises. Globalement, le commerce intra-régional demeure faible au sein de la CEDEAO, de l’ordre de 9% du total des échanges, quand le commerce intra-européen représente 70% des échanges des Européens. Si l’entrée en vigueur, en janvier 2015, d’un tarif extérieur commun (TEC) aux frontières de la CEDEAO constitue le premier pas vers une union douanière, le chemin vers la création d’un marché commun reste encore long.
Pourtant, l’Afrique de l’Ouest est une région très intégrée du point de vue des peuples. Elle est marquée par une grande fluidité des mouvements de population. C’est évidemment le cas des populations nomades ou semi-nomades du Sahara, Touaregs au Mali, au Niger et en Algérie et Toubous au Niger, au Tchad et en Libye, mais aussi des Peuls, pasteurs nomades traditionnels présents dans de nombreux pays d’Afrique de l’ouest. De manière générale, de nombreuses ethnies se retrouvent dans plusieurs pays de la région, à l’image des malinkés (Sénégal, Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Guinée Bissau), des songhaïs (Mali, Niger, Bénin) ou encore des akans (Côte d’ivoire, Ghana). On assiste également à des migrations, souvent saisonnières, très fréquentes, notamment des pays enclavés du Sahel vers les États côtiers, à l’image de la Côte d’Ivoire.
Il existe donc une intégration de fait très réelle, qui se traduit également par une vitalité importante des économies transfrontalières. Celles-ci se situent cependant essentiellement dans le domaine de l’informel.
Dès lors, comment expliquer que l’intégration régionale, pourtant régulièrement invoquée, patine à ce point ? Les carences des infrastructures de transport constituent une partie de la réponse. Il faudrait ainsi dix-sept jours pour transporter des marchandises du port de Tema, au Ghana, à Ouagadougou, au Burkina Faso, villes pourtant distantes de seulement 1000 kilomètres (33). De même, le commerce du Maroc avec la Côte d’Ivoire transite la plupart du temps par l’Europe.
Au-delà des questions logistiques, plusieurs interlocuteurs de la mission d’information ont insisté sur l’impact des divergences entre pays anglophones et francophones au sein de la CEDEAO. La barrière est ici linguistique. L’enjeu pour les pays d’Afrique de l’ouest est déjà d’alphabétiser l’ensemble de leur population, dans un contexte où les langues locales restent souvent très prégnantes. L’enseignement d’une deuxième langue paraît donc difficile à mettre en œuvre. Mais il existe aussi de réelles différences culturelles et juridiques entre anglophones et francophones, l’héritage des différents systèmes coloniaux étant ici en cause.
De l’avis de tous les observateurs, le renforcement de l’intégration régionale est pourtant un enjeu essentiel pour permettre à l’Afrique de s’intégrer dans les chaines de valeur mondiales. Beaucoup d’opportunités sont perdues en raison du manque de vision régionale des États d’Afrique de l’ouest, cette vision étant paradoxalement principalement portée par les investisseurs étrangers.
• Alassane Ouattara, une influence régionale ?
Depuis son arrivée au pouvoir, le Président Ouattara a fait preuve d’un certain volontarisme au sein des organisations régionales. Il a succédé en février 2012 au président nigérian Goodluck Jonathan à la tête de la CEDEAO, poste auquel il a été reconduit en février 2013, avant de prendre la présidence de l’UEMOA en janvier 2016. Le pays a ainsi marqué sa volonté de jouer un rôle de leader au sein de la région, affichant son intention d’avancer sur les dossiers de l’intégration économique mais aussi de la coopération sécuritaire, dans le contexte de la montée en puissance de la menace terroriste.
Plusieurs interlocuteurs de la mission ont estimé que le président Ouattara bénéficie d’une certaine aura dans la région et, plus largement, sur le continent africain. Reste à savoir si cette bonne réputation pourra permettre de surmonter les réticences et obstacles nombreux qui se dressent sur la voie d’une plus grande intégration régionale. Les déboires des négociations sur l’accord de partenariat économique avec l’Union européenne (cf. supra) montrent que ce chemin est loin d’être linéaire...
• Franc CFA : atout ou handicap ?
Votre rapporteure ne peut traiter de l’intégration régionale sans aborder l’épineuse question du franc CFA. Cette monnaie, commune aux pays de l’Union monétaire ouest-africaine (UEMOA) (34) était à l’origine, à sa création en 1945, la monnaie des « colonies françaises d’Afrique », d’où son acronyme maintenu jusqu’à ce jour avec la signification de franc de la « communauté financière d’Afrique ». Le franc CFA est lié à l’euro par une parité fixe et sa valeur est garantie par le Trésor public français, auprès duquel les pays de la zone franc doivent obligatoirement déposer au minimum 50% de leurs réserves de change.
En raison de ces caractéristiques, le franc CFA est régulièrement stigmatisé comme un instrument de domination néocoloniale au service de l’ancienne métropole. Sans entrer dans ce débat, votre rapporteure a souhaité poser la question de la plus-value de cette monnaie commune pour les économies des pays d’Afrique de l’ouest, en particulier de la Côte d’Ivoire.
Certains, à l’image de Serge Michailof, pensent que la parité inadaptée du franc CFA est le principal obstacle à l’insertion de l’Afrique francophone dans les chaines de valeur de la mondialisation. En effet, en raison de son ancrage à l’euro, le CFA est une monnaie forte, ce qui a pour effet de renchérir les exportations et d’abaisser le coût des importations. Or, ce faible coût des importations décourage l’industrialisation de ces pays, dans la mesure où il est moins cher d’acheter à l’étranger que de produire soi-même.
Ce phénomène est d’autant plus prégnant en Afrique francophone que le coût de la main d’œuvre y est relativement élevé en raison du poids des charges fiscales et sociales sur le travail. La parité inadaptée du franc CFA ne serait donc pas étrangère à l’incapacité de la Côte d’Ivoire à transformer ses succès agricoles et agro-industriels en développement industriel dans les décennies précédant la crise.
La problématique du franc CFA a pourtant rarement été présentée comme un problème pour la Côte d’Ivoire lors des travaux de la mission d’information. Les interlocuteurs de la mission se sont généralement accordés pour considérer qu’une monnaie unique était plutôt un atout dans un contexte de mondialisation. C’est en outre un gage de stabilité.
L’idée d’une sortie du franc CFA a donc été présentée comme peu crédible et s’apparentant davantage à une posture idéologique tournée contre l’ancienne métropole. À l’inverse, plusieurs interlocuteurs ont estimé qu’il pourrait être souhaitable d’élargir l’union monétaire aux anglophones de la CEDEAO. Les responsables politiques ghanéens ont évoqué une réflexion en ce sens, tout en soulignant les difficultés considérables qui rendaient improbable la réalisation de ce projet à moyen terme (respect de critères de convergence, difficultés politiques).
Si le franc CFA doit être maintenu au sein de l’UEMOA, il serait envisageable – sans doute souhaitable – d’en ajuster les paramètres techniques afin d’améliorer sa fonction de soutien à l’économie réelle. Cependant, les débats sur cette question entre dirigeants de la zone franc semblent pour l’heure peu fructueux.
Recommandation n°1 : Instaurer un échange régulier avec le Fonds monétaire international (FMI) lors des réunions des ministres de la zone franc pour renforcer la coordination des politiques économiques régionales.
3. « Ghanivoire » : un potentiel à exploiter pour créer une dynamique ouest-africaine
Pour relancer l’intégration régionale, le président Ouattara pourrait s’appuyer sur le renforcement des liens avec son voisin ghanéen. Plusieurs interlocuteurs voient dans le couple « Ghanivoire » (35) un potentiel de développement et de stabilité considérable pour l’Afrique de l’ouest, susceptible de relancer une dynamique régionale.
• Des points communs nombreux
Le Ghana et la Côte d’Ivoire sont souvent désignés comme des «jumeaux sortis du ventre de la même mère» (36). Il est certain que les deux pays ont beaucoup en commun. De taille et de population similaire, ils partagent les mêmes structures territoriales et climatiques, avec un sud forestier et un nord situé en zone de savane et plus pauvre. L’agriculture de rente a un poids important dans les économies des deux pays, même si cette part a eu tendance à diminuer au Ghana avec la montée en puissance de l’exploitation du pétrole. Le Ghana et la Côte d’Ivoire sont les deux premiers producteurs de cacao au monde. Tous deux sont également des producteurs importants d’huile de palme et de fruits tropicaux.
Par ailleurs, les liens sont très denses entre les populations de part et d’autre de la frontière, en particulier celles du groupe ethnique akan qui se situe à cheval sur les deux pays. Les populations traversent d’ailleurs quotidiennement la frontière qui est une zone de commerce – mais aussi de trafics – très active. Pendant la crise ivoirienne, de nombreux Ivoiriens sont allés se réfugier dans le village voisin au Ghana, chez leurs « frères », signe que cette frontière est une réalité lointaine pour les populations.
• Une relation souvent dominée par les divisions et les rivalités
Et pourtant, ces deux pays ont souvent été divisés par l’histoire. Les leaders nationaux de la décolonisation, Houphouët-Boigny et N’Krumah, s’étaient faits les chantres de modèles radicalement opposés. Alors qu’Houphouët-Boigny, qui n’avait jamais été partisan de l’indépendance, cherchait à pérenniser des relations amicales et denses avec la métropole, N’Krumah était un militant fermement indépendantiste et apôtre du panafricanisme. Il rejoignit le camp socialiste à partir des années 1960. En 1984, le Ghana accusa la Côte d’Ivoire d’encourager l’action de dissidents sur son territoire et d’héberger des agitateurs politiques ghanéens.
En 2000, émergea un contentieux portant sur la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays, dont l’enjeu était le contrôle de gisements pétroliers off-shore. En 2015, une sentence arbitrale rendue par le Tribunal international du droit de la mer (Hambourg) a interdit tout nouveau forage dans l’attente d’un règlement. Une décision devrait permettre de trancher ce contentieux au cours de l’année 2017 ; les audiences à cette fin ont débuté le 6 février dernier.
Dans le contexte de la crise ivoirienne, le New patriotic party (NPP), parti de John Kufuor, président du Ghana de 2001 à 2009, était perçu comme « pro-Ouattara », tandis que le National democratic congress (NDC) de ses successeurs, John Atta Mills (2009-2012) et John Dramani Mahama était considéré comme « pro-Gbagbo ». À cet égard, en 2012, un rapport réalisé par un groupe d’experts mandaté par l’ONU accusa le gouvernement ghanéen d’héberger des mercenaires ivoiriens dans le but de déstabiliser le pouvoir du Président Ouattara.
Au total, en dépit de nombreux points communs, défiance et rivalités ont souvent été de mise entre les deux pays. Si les échanges informels sont nombreux au niveau de la frontière, l’intégration est restée très faible, le Ghana se tournant davantage vers son grand voisin nigérian.
• Une impulsion politique pour relancer des relations bilatérales à fort potentiel
Dans ce contexte, l’ex-président ghanéen John Dramani Mahama et Alassane Ouattara ont affiché leur volonté conjointe d’œuvrer au renforcement des liens bilatéraux et de l’intégration régionale. Ainsi le Président Mahama avait-il pris la suite du Président Ouattara à la tête de la CEDEAO, en février 2014.
La visite officielle du Président Mahama en Côte d’Ivoire, en juin 2016, avait vocation à ouvrir une nouvelle page des relations entre les deux pays. Les présidents ont affiché leur volonté de faire avancer le projet d’autoroute Abidjan-Lagos, qui serait une étape importante dans le processus d’intégration sous-régionale. Ils ont aussi convenu d’accroître leur coopération en matière de renseignement pour lutter contre le terrorisme.
Les deux présidents ont par ailleurs cherché à se montrer constructifs sur les sujets qui constituent des irritants bilatéraux. Ils ont marqué leur ouverture au dialogue pour trouver une solution négociée profitable à toutes les parties pour l’exploration et l’exploitation des gisements pétroliers dans la zone maritime contestée. John Mahama a appelé publiquement les exilés ivoiriens encore présents au Ghana (cf. infra) à retourner en Côte d’Ivoire, estimant que la situation politique était désormais normalisée.
En janvier 2017, le Président Ouattara était l’invité d’honneur de la cérémonie d’investiture du nouveau président ghanéen, Nana Akufo-Addo, issu du parti NPP. Le nouveau souffle donné à la relation bilatérale devrait ainsi se trouver entretenu, si ce n’est amplifié, avec cette alternance politique.
Il est certain qu’une plus grande coopération entre les deux pays serait profitable à toute l’Afrique de l’ouest. En joignant leur forces, les deux pays pourraient constituer une sorte d’OPEP mondiale du cacao, ce qui permettrait d’attirer les investissements des industries de transformation et de créer de nombreux emplois, voire d’inciter les grands leaders mondiaux du chocolat à relocaliser leur production en Afrique. Cela contrasterait avec la situation actuelle, caractérisée par la concurrence, les différentiels dans les prix du cacao se traduisant par un important trafic transfrontalier. Cette situation non-coopérative est ainsi inefficiente pour les deux pays.
Par ailleurs, le Ghana et la Côte d’Ivoire réalisent d’importants investissements dans le domaine énergétique et disposent d’ambitions similaires, notamment pour exporter cette énergie dans la région. En joignant leurs forces, ils pourraient mettre en place un hub énergétique qui assurerait la production, la distribution et la commercialisation d’énergie à destination de toute la sous-région.
La Côte d’Ivoire et le Ghana disposent indéniablement de complémentarités à exploiter. Le Ghana conserve, en dépit de ses difficultés actuelles, une forte attractivité pour les investisseurs étrangers : avec 3,19 milliards de dollars, le pays était la cinquième destination du continent pour les IDE en 2015 (derrière l’Afrique du sud, le Nigéria, le Congo et le Mozambique). Il dispose d’une maturité démocratique et d’une stabilité susceptibles d’exercer un effet d’entraînement sur la Côte d’Ivoire. Le modèle de cohésion nationale des Ghanéens, qui sont très patriotes tout en conservant un fort attachement à leurs communautés respectives, pourrait inspirer la Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, l’armée ghanéenne a une expérience importante des opérations de maintien de la paix. Le pays a une présence historique au Liban où il déploie un bataillon. Des contingents ghanéens sont par ailleurs déployés au sud-Soudan, au Libéria, au Mali et au Sahara occidental. Des militaires ghanéens étaient également présents en Côte d’Ivoire avant la fermeture (en cours) de l’ONUCI. La Côte d’Ivoire affiche sa volonté de déployer des militaires à l’extérieur de ses frontières mais son armée est très peu aguerrie, en raison d’une faible tradition militaire et des effets déstructurants des années de crise (cf. infra). Elle pourrait donc bénéficier d’une coopération plus étroite avec l’armée ghanéenne.
Les deux pays pourraient enfin tirer parti de leur différence linguistique en organisant des échanges au niveau scolaire et universitaire afin de développer le bilinguisme français-anglais, ce qui serait très favorable dans une perspective d’intégration de l’Afrique de l’ouest.
Pour tirer parti de ces complémentarités, il faudra néanmoins surmonter des inerties de taille. Comme le soulignait un interlocuteur ghanéen de la mission, pour l’heure, si l’harmonie est affichée au niveau politique, de nombreux sujets de tensions souterraines persistent. Il y a pourtant indéniablement une fenêtre d’opportunité à exploiter, les difficultés actuelles du Nigéria incitant le Ghana à s’ouvrir davantage à ses voisins francophones. Le pays cherche d’ailleurs à développer l’enseignement du français, ce qui est certainement un premier pas.
Recommandation n°2 : Répondre à la demande ghanéenne en appuyant l’apprentissage du français, susceptible de favoriser l’intégration régionale, d’une part et les échanges avec la Côte d’Ivoire, d’autre part.
4. La bonne santé de la Côte d’Ivoire, un enjeu essentiel pour le Sahel
• Un pôle d’attraction des migrations
La Côte d’Ivoire a toujours eu un rôle d’absorption des migrations en provenance du Sahel. Comme l’a indiqué devant la mission Jean-Christophe Belliard (37), le mouvement naturel des populations du Sahel est d’aller vers le sud plutôt que vers le nord. Selon Serge Michailof (38), 80% des migrations sahéliennes sont ainsi interafricaines. Ces migrations sont en partie saisonnières : pendant les périodes de sécheresse, les hommes vont chercher des emplois dans les États côtiers, puis reviennent au pays.
En Côte d’Ivoire, ces migrations ont accompagné et favorisé le développement économique du pays. Elles répondaient à une politique volontaire de l’administration coloniale puis du président Houphouët-Boigny, visant à mettre en valeur le territoire ivoirien par le développement d’une agriculture de rente. La plupart des planteurs qui ont exploité le front cacaoyer en zone forestière dans le centre-ouest puis dans l’ouest de la Côte d’Ivoire étaient ainsi des migrants, pour partie allochtones (principalement des akans venant du centre et de l’est de la Côte d’Ivoire) et pour partie étrangers, maliens et surtout burkinabés.
On estime actuellement que 25% de la population de la Côte d’Ivoire est étrangère, sur une population de 23,7 millions d’habitants. Cette forte présence étrangère a été l’un des ferments de la crise ivoirienne, dans un contexte de conflits fonciers et de difficultés économiques.
On comprend donc que la bonne santé économique de la Côte d’Ivoire est indispensable pour maintenir les équilibres régionaux, alors que la population des pays du Sahel va fortement s’accroître au cours des prochaines décennies. Pour que le pays maintienne sa capacité d’absorption des migrations, il doit bénéficier d’une croissance durable créatrice de nombreux emplois, dans un contexte où l’accroissement naturel de sa population sera également très dynamique.
• Une charnière entre deux zones de vulnérabilité
La stabilité de la Côte d’Ivoire est aussi un enjeu très important pour limiter la propagation des risques sécuritaires qui tendent à s’aggraver dans cette région du monde. Le colonel Jean-Luc Kuntz, commandant des forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI), soulignait ainsi que la Côte d’Ivoire se situe dans une « zone d’intervalle » entre deux zones de grande vulnérabilité : la bande sahélo-saharienne, frappée par la montée en puissance des groupes armés terroristes, et le Golfe de Guinée, marqué par la recrudescence et l’aggravation des actes de piraterie maritime.
D’ores et déjà, les groupes armés terroristes du Sahel entretiennent des liens étroits avec les trafiquants, notamment de drogues entrées en Afrique par le Golfe de Guinée. Les militaires français redoutent l’éventualité d’une connexion entre les mouvances terroristes sahéliennes et les pirates du Golfe de Guinée, sur le modèle de ce qui s’est produit au large de la Corne de l’Afrique, avec les Shebabs somaliens. Il est donc particulièrement important pour l’Afrique de l’Ouest que la Côte d’Ivoire et, plus généralement, les États côtiers de cette « zone d’intervalle », soient en mesure d’endiguer la propagation de ces menaces.
Côte d’Ivoire et Sahel, des destins en partie liés
Sécuriser le développement ivoirien implique aussi d’œuvrer en faveur de la stabilité régionale. Tous les dirigeants ivoiriens rencontrés par la mission l’ont souligné, la Côte d’Ivoire ne pourra pas prospérer dans la durée si les pays du Sahel ne sont pas stabilisés. Elle a 530 kilomètres de frontière commune avec le Mali et 580 kilomètres avec le Burkina Faso. Les forces armées et de sécurité ivoiriennes devront parcourir beaucoup de chemin avant d’être en mesure d’assurer le contrôle de ces frontières, alors qu’elles doivent maintenant, avec le retrait de l’ONUCI, compter essentiellement sur leurs propres forces, avec l’appui ponctuel de certains partenaires, surtout la France.
L’attentat de Grand Bassam a montré que la Côte d’Ivoire pouvait aussi être la cible de la menace terroriste internationale qui continue de trouver un foyer dans les pays de la bande sahélo-saharienne, en dépit de l’opération Barkhane conduite par l’armée française.
En dehors même du problème du terrorisme, la situation du Sahel a un impact direct sur la Côte d’Ivoire par le canal des migrations. Nous avons vu que la Côte d’Ivoire était une destination naturelle pour les populations du Sahel, dans le cadre de migrations pouvant être permanentes (en particulier sur le front forestier cacaoyer) ou saisonnières. Les migrations sahéliennes sont appelées à s’intensifier considérablement avec la croissance démographique de ces pays et le réchauffement climatique, qui devrait durcir encore leurs conditions écologiques.
Or, si la Côte d’Ivoire s’est construite avec les migrations, la crise a montré les difficultés pouvant accompagner l’absorption des migrants, en particulier dans un contexte de difficultés économiques, comme celles qui ont prévalu au cours des années 1990. Il faut aussi prendre en compte le fait que la Côte d’Ivoire a elle-même un accroissement naturel très important, même s’il reste plus modéré que celui du Niger : 2,4% par an, contre 3,8% pour le Niger, 3% pour le Mali et le Tchad et 0,4% pour la France. Ainsi, comme le montre Serge Michailof (39), la capacité d’absorption de la Côte d’Ivoire ne sera pas illimitée : « la population ivoirienne a été multipliée par 6,5 depuis 1960, et le nombre d’étrangers qui y résident représente près du quart de la population totale. Si l’on appliquait ces ratios à la France, notre population serait aujourd’hui supérieure à celle des Etats-Unis, et les étrangers seraient plus nombreux que la population totale actuelle. On comprend mieux ainsi l’ampleur des problèmes identitaires, ethniques, fonciers et politiques qui ont contribué à déchirer la Côte d’Ivoire. »
Les défis auxquels sont confrontés les pays du Sahel sont tels qu’il est peu probable qu’ils parviennent à les surmonter sans un appui extérieur de grande ampleur, coordonné et constant dans la durée. En l’état actuel des choses, les dépenses de sécurité pèsent lourdement dans les budgets publics de ces États.
Le Mali bénéficie d’une aide extérieure considérable du fait de l’investissement de la communauté internationale depuis 2013 : 11 000 hommes y sont déployés dans le cadre de la mission des Nations Unies (MINUSMA) en plus de la force Barkhane. En revanche, les dépenses de sécurité du Niger et du Tchad, qui font face à de multiples menaces internes et externes (vide sécuritaire libyen, mouvements irrédentistes touareg et Toubou, Boko Haram dans la région du lac Tchad, rebelles de l’ex-Séléka en provenance de République centrafricaine…) tendent à évincer les dépenses en faveur du développement économique et social, ce qui contribue à enfoncer ces pays dans la spirale du sous-développement et de l’insécurité. Ainsi, les dépenses de sécurité du Niger s’élevaient à 3,6% de son PIB en 2015, doit deux fois et demi le montant dépensé en 2009. Et malgré cela, elles sont encore insuffisantes.
Votre rapporteure pense qu’il est donc urgent de remobiliser les moyens de l’aide publique au développement vers les États du Sahel. Elle juge tout à fait incompréhensible que ces derniers ne reçoivent qu’en moyenne 12 millions d’euros par an en dons de l’AFD quand les surcoûts liés à l’opération Barkhane – dont l’utilité n’est pas contestée – se chiffrent en centaines de millions d’euros.
Recommandation n°3 : Remobiliser l’aide au développement et l’expertise françaises en faveur des pays du Sahel, dont la stabilité et le développement sont un enjeu essentiel et commun à nos deux pays.
E. UNE REINVENTION CULTURELLE AU SERVICE DU RAYONNEMENT DE LA COTE D’IVOIRE
La Côte d’Ivoire possède une culture riche et diversifiée, issue d’une longue tradition artistique. Elle a longtemps été au cœur des évolutions artistiques de l’Afrique de l’Ouest francophone.
Si la crise post-électorale a pu nuire à la tenue de certains évènements culturels, le retour de la stabilité et de la croissance économique ont été propices à une renaissance culturelle. Le développement du secteur culturel est aujourd’hui une politique voulue des autorités ivoiriennes, au service de l’émergence du pays et de son rayonnement au-delà des frontières.
1. Une tradition culturelle parmi les plus riches d’Afrique
• Des traditions artistiques étroitement insérées dans des systèmes philosophiques et religieux
Les arts traditionnels ivoiriens comptent parmi les plus foisonnants du continent. Cette situation n’est pas sans lien avec la multiplicité des ethnies représentées en Côte d’Ivoire, chacune apportant sa tradition artistique, étroitement liée à un système de croyances religieuses, mystiques et philosophiques. En effet, la caractéristique de ces arts traditionnels est de ne jamais rechercher la beauté pour elle-même. Les objets culturels ont ainsi toujours une fonction sociale et religieuse.
C’est le cas des nombreux masques et statues que l’on retrouve dans les différentes régions du pays ; chez les guérés, les masques incarnent la brutalité des forces de la nature, quand ils prennent une forme plus apaisée, fine et bienveillante chez les gouros, les yaourés et les dans. Les baoulés sont connus pour leurs statuettes de petite taille, images des ancêtres qui font l’objet d’une vénération et de sacrifices.
Statues et masques jouent un rôle essentiel dans le rituel du Poro qui rythme les étapes de la vie chez les sénoufos. Le Poro désigne un enseignement global qui comporte quatre périodes initiatiques de sept ans chacune. Il s’agit d’une véritable philosophie de vie où se mêlent les aspects métaphysiques, liturgiques, sociaux et politiques. Cet enseignement s’accompagne d’un rituel particulièrement riche où statues, masques et danses revêtent une importance centrale.
La danse joue un rôle religieux et social important chez toutes les ethnies, qui ont chacune élaboré des chorégraphies originales adaptées à diverses circonstances. Ainsi, les jeunes doivent apprendre non seulement les mouvements de danse, mais aussi leur sens sous-jacent. Chez les dans, il existe des danses réservées à des « sociétés secrètes » dont les membres ont dû subir une initiation préalable particulièrement rigoureuse.
• Un artisanat renommé
L’artisanat baoulé connaît une certaine notoriété, notamment les portes de case et les sièges, qui prennent des formes très diverses selon les circonstances et les personnes auxquelles ils sont destinés. Chez les akans, les sièges des rois, précieusement conservés, sont les réceptacles de la tradition.
La poterie est pratiquée presque partout dans le pays : jattes, canaris et vases de toutes tailles et de tous usages sont généralement montés à la main et cuits sous la cendre. Les malinkés sont plus particulièrement réputés dans cet art et la région d’Odienné concentre la plus importante proportion de potiers.
Les baoulés et les sénoufos sont des tisserands réputés dans tout le pays et même au-delà. Lors de son voyage dans le nord du pays, la mission a pu admirer les œuvres des peintres sur toile de Korhogo, dont la renommée dépasse les frontières du pays.
2. La Côte d’Ivoire au cœur des évolutions artistiques de l’Afrique de l’ouest
La Côte d’Ivoire a joué un rôle moteur dans les évolutions qui ont marqué la culture ouest-africaine au cours des dernières décennies.
• La musique, un soft power ivoirien ?
À partir des années 1970, la Côte d’Ivoire s’est imposée comme le carrefour musical du continent africain. De nombreux artistes ivoiriens ont eu une renommée qui dépassait les frontières de la Côte d’Ivoire, à l’image du chanteur de reggae Alpha Blondy dans les années 1980, et, plus tard, du célèbre Tiken Jah Fakoly, cité précédemment, internationalement connu pour ses chansons engagées telles que Françafrique ou Coup de Gueule.
Vers la fin des années 1980, le zouglou est apparu dans le milieu étudiant d’Abidjan puis s’est rapidement répandu dans les quartiers populaires de la capitale économique. Ce genre musical traite des réalités vécues par la jeunesse et contient souvent des messages politiques, fréquemment abordés sur le ton de l’humour. Il est notamment incarné par Magic System dont la chanson Premier Gaou a eu un succès mondial.
À sa suite est né dans les années 2000 le coupé décalé, expression qui renvoyait à la coupure du pays en deux et au décalage qui s’en est suivi. À la fois danse et courant musical, le coupé décalé est une synthèse de la musique ivoirienne et du mdombolo congolais. Initialement incarné par des DJ comme Douk Saga, ce rythme dansé est très apprécié de la jeunesse ivoirienne qui « s’enjaille » (s’amuse en argot des faubourgs d’Abidjan) dans les « maquis » (bars en argot des faubourgs d’Abidjan). Au fil des années, il a volé la vedette au ndombolo dans les discothèques d’Afrique de l’ouest. Aujourd’hui encore, des artistes ivoiriens comme DJ Arafat et Serge Beynaud sont incontournables.
Par ailleurs, une nouvelle génération d’artistes hip-hop émerge avec des groupes comme Kiff no beat et Tour 2 Garde. La scène musicale ivoirienne semble pourtant en relative perte de vitesse face à l’hégémonie conquise par la musique nigériane au cours des dernières années.
• L’essor de l’art contemporain
Depuis la fin de la crise, l’art contemporain a connu un réel essor en Côte d’Ivoire. Réservé à une élite, il s’est avant tout développé à Abidjan, qui s’est imposé comme le cœur de ce marché en Afrique.
Les galeries d’art, telles que les galeries Cecile Fakhoury ou Houkami Guyzagn, y sont en pleine expansion. Elles bénéficient d’une ouverture croissante vers l’extérieur. Certains artistes ivoiriens comme Michel Kodjo, Ouattara Watts, Aboudia et Pascal Konan bénéficient d’une exposition internationale.
Après deux années de fermeture liée à la crise, la Fondation Donwahi pour l’Art contemporain, du nom de Charles Donwahi, premier ministre de la Coopération de la Côte d’Ivoire indépendante, a rouvert en 2013. Elle dispose en son sein d’une résidence d’artistes et permet au public d’accéder librement à ses salles d’exposition, à sa médiathèque et à ses ateliers de création.
• La culture du divertissement
Certaines séries cultes ivoiriennes, comme Ma famille, diffusée entre 2002 et 2007 à la télévision publique ivoirienne, ont connu un grand succès en Afrique francophone. En 2016, celle-ci est revenue sur les écrans sous le nom de Ma grande famille. Sa popularité doit beaucoup à sa capacité d’aborder avec humour des sujets de société. De même, la série TV Taximan Kpakpato, également diffusée sur Youtube et les réseaux sociaux (« Kpakpato » désignant une personne qui aime les commérages) retrace de manière comique les aventures d’un chauffeur de taxi bavard et indiscret.
Par ailleurs, la télévision publique ivoirienne – avec ses deux chaînes RTI 1 et RTI 2 – tente de se moderniser en diffusant des programmes au-delà des frontières du pays, notamment grâce à des émissions de divertissement telles que C’midi.
Le sport est un levier pour renforcer la cohésion nationale. Le football en particulier contribue au rayonnement de la Côte d’Ivoire, avec de nombreux joueurs ivoiriens évoluant dans des équipes européennes à l’image de Didier Drogba, Yaya Touré ou encore Serge Aurier. Les « Éléphants » ivoiriens, vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2015, forment l’une des équipes nationales les plus renommées du continent et comptaient parmi les favoris pour l’édition de 2017, bien que ces espoirs aient été déçus. La Côte d’Ivoire a par ailleurs été désignée pour organiser la CAN 2021 qui promet d’être un grand moment de mobilisation populaire.
Il convient également de noter que la Côte d’Ivoire accueillera en 2017 les Jeux de la francophonie, un ensemble de compétitions sportives et de concours culturels organisés tous les quatre ans au sein de l’espace francophone. 4000 artistes et sportifs, 700 journalistes et 500 000 spectateurs sont attendus pour cette huitième édition qui devrait en outre être suivie par 500 millions de téléspectateurs.
• Le cinéma ivoirien
L’industrie cinématographique ivoirienne a beaucoup souffert de la crise. Certains films ont toutefois bénéficié d’une reconnaissance à l’étranger.
Ainsi, en 2014, pour la première fois depuis vingt-neuf ans, un film ivoirien a fait partie de la sélection officielle du festival de Cannes. Il s’agissait de Run de Philippe Lacôte, qui mettait en scène la violence de la crise que venait de traverser le pays.
Par ailleurs, l’adaptation cinématographique de la bande dessinée Aya de Yopougon (de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie), qui retrace avec humour les aventures d’une jeune fille dans le quartier éponyme à la fin années 1970, a été nominé aux Césars 2014 dans la catégorie « meilleur film d’animation ».
Enfin, après avoir été récompensée par de nombreux prix et distinctions, la Côte d’Ivoire sera mise à l’honneur lors de l’édition du Festival panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO) qui se tiendra du 25 février au 5 mars 2017 dans la capitale burkinabée.
• Quelle place pour la littérature ivoirienne ?
La littérature ivoirienne en langue française s’est d’abord développée à partir du théâtre. Le succès du genre théâtral s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, il se fond très bien dans les réalités africaines, dont le quotidien est empreint de théâtralité, à travers les cérémonies de labours, séances de contes et autres cérémonies dramatiques. Par ailleurs, un théâtre dit « indigène » avait émergé dès les années 1920, en provenance du Ghana.
Ces fondements ont contribué à la naissance du théâtre de Bingerville, sous la bannière de Bernard Dadié, qui se livrait à une critique des mœurs de la société ivoirienne. La littérature ivoirienne s’est ensuite exprimée à travers d’autres genres, notamment celui de la poésie. À la différence du théâtre, assez peu engagé, la poésie a progressivement acquis une dimension très militante en s’engageant résolument dans le mouvement de la négritude. Ce fut, là encore, Bernard Dadié qui ouvrit la voie avec notamment Afrique Debout en 1950. Ce dernier a aussi signé la première œuvre romanesque en langue française, Climbié, en 1956. D’autres auteurs tels que Aké Loba, grand prix littéraire d’Afrique noire, Atta Koffi Raphael, Charles Nokan, Maurice Koné ou encore Oussou-Essui Denis ont fait vivre cette littérature au cours des années 1960.
En 1968, Le soleil des indépendances du romancier Ahmadou Kourouma a marqué un tournant. Cet auteur, récompensé par de nombreux prix littéraires (Prix du livre Inter pour En attendant le vote des bêtes sauvages en 1999, prix Renaudot pour Allah n’est pas obligé en 2000) s’est imposé comme l’une des plus grandes figures de la littérature africaine, dans un genre souvent engagé. Quelques belles plumes se sont distinguées dans les années 1970 et 1980, comme Amadou Koné, Jean-Marie Adiaffi et Bernard Zadi Zaourou, avant que n’émerge une nouvelle génération à partir des années 1990. L’auteur de nouvelles Isaïe Biton Koulibaly en est l’une des figures les plus connues ; sa popularité dépasse largement les frontières de la Côte d’Ivoire.
La scène littéraire ivoirienne s’est ouverte aux femmes à partir des années 1970. Les écrivaines Henriette Diabaté, Simone Kaya, Fatou Bolli ou Regina Yaou se sont engagées les premières dans cette voie. À partir des années 1980, les écrivaines ivoiriennes ont été nombreuses à percer, à l’image de Flore Hazoumé, Gina Dick, Micheline Coulibaly, Assamala Amoi, Fatou Keïta, pour n’en citer que quelques-unes, ou encore de Marguerite Abouet, que nous avons déjà citée pour sa célèbre bande dessinée, Aya de Yopougon.
On note aussi l’émergence de quelques talents venus d’autres horizons, comme l’économiste Mamadou Coulibaly (Le libéralisme, nouveau départ pour l’Afrique noire) ou le journaliste Venance Konan (Les prisonniers de la Haine, 2003).
3. Une volonté politique de structurer et soutenir le secteur culturel
Dans les années qui ont suivi la crise, la culture a été perçue comme un moyen au service de la réconciliation nationale. C’est ainsi qu’a émergé une politique culturelle nationale concrétisée par l’adoption de plusieurs textes : lois du 14 juillet 2014 portant politique culturelle et relative à l'industrie cinématographique et loi du 20 juillet 2014 relative à l’industrie du livre.
Cette volonté de valoriser la culture ivoirienne s’est aussi traduite par l’organisation de festivals nationaux et régionaux comme ceux du Zanzan ou des arts sacrés des Savanes, qui sont autant d’occasions de mettre en lumière la diversité de la Côte d’Ivoire. Ces évènements ont également été perçus comme des moments privilégiés pour fédérer les Ivoiriens.
Après sept années d’interruption, le retour, en 2014, du Marché des Arts du Spectacle Africain (MASA) a participé à la renaissance culturelle du pays. Créé en 1993 avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), il s’agit d’une biennale qui a pour but de promouvoir les professionnels des arts et de la culture et de leur faciliter l’accès au marché international. La 9e édition de 2016 s’est tenue dans le Palais de la Culture de Treichville qui venait d’être réhabilité après avoir subi de fortes dégradations lors de la crise postélectorale de 2010-2011.
Cet effort de rénovation des infrastructures s’est étendu au centre d’actions culturelles d’Abobo et au centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Par ailleurs, un ambitieux projet de construction d’une « Bibliothèque de la Renaissance africaine » à Abidjan a été annoncé fin 2015. Ce site, qui devrait compter parmi les dix plus grandes bibliothèques africaines, doit contribuer à restaurer la grandeur de la culture ivoirienne et à asseoir son influence sur le continent. D’autres constructions sont en projet, notamment une douzaine de centres culturels répartis à travers le pays et composés d’une bibliothèque, d’un musée, d’une salle d’exposition et de salles de spectacles, mais aussi un musée des Arts contemporains, un Opéra, un Hôtel des Artistes ou encore une « Promenade du Poète ».
Par ailleurs, le Bureau ivoirien des droits d’auteur (BURIDA) a été réformé et restructuré. Selon Maurice Kouakou Bandaman, le ministre de la Culture, les droits d’auteurs enregistrés par cette structure sont passés de 136 millions de francs CFA en 2012 à plus d’un milliard aujourd’hui.
Le gouvernement a aussi choisi de mettre à l’honneur les « anciennes gloires de la culture », c’est-à-dire les artistes ivoiriens qui se sont distinguées par leur apport à la culture du pays. Une pension présidentielle de 300 000 francs CFA par mois a été offerte à quarante-cinq personnalités distinguées à ce titre.
Enfin, pour mieux valoriser le patrimoine ivoirien, le gouvernement a mis en place un programme de soumission de biens matériels et immatériels sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville historique de Grand Bassam se trouve ainsi désormais inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et le festival « Balafon Déguélé » sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Le ministre de la Culture et de la francophonie a également annoncé sa volonté de construire des « sites de mémoire » pour valoriser les grands moments de l’histoire du pays, de l’esclavage à la vie du Président Houphouët Boigny.
Recommandation n°4 : Étudier les moyens de donner une meilleure visibilité à la culture ivoirienne en France et favoriser les échanges entre les acteurs culturels de nos deux pays.
II. UNE CROISSANCE AUX PIEDS D’ARGILE : DES DÉFIS CONSIDÉRABLES ET URGENTS À SURMONTER
La mission mesure le chemin parcouru par la Côte d’Ivoire depuis la crise de 2011. Le pays veut avancer, les autorités s’y emploient : ce volontarisme doit être souligné.
Cependant les défis qui attendent la Côte d’Ivoire sont immenses et les Ivoiriens sont impatients. Alors que leurs conditions de vie demeurent, en général, très difficiles, ils ne se satisfont pas des discours sur le retour à l’âge d’or perdu de la prospérité ivoirienne.
La Côte d’Ivoire se trouve ainsi « comme un cycliste sur une ligne de crête » (40) : un engagement politique fort et pérenne, agrégeant les principales forces vives ivoiriennes, sera nécessaire pour espérer tenir la route vers l’émergence.
Daniel Kablan Duncan, alors Premier ministre, l’a clairement formulé devant la mission : « notre premier défi est le développement ». La Côte d’Ivoire n’a pas encore réussi à faire que ses taux de croissance flatteurs profitent à l’ensemble des Ivoiriens. Ces derniers protestent : « vous faites des ponts, vous faites des routes, mais les Ivoiriens ne mangent pas de béton (41) ».
Cette formule traduit l’impatience grandissante de la population qui s’exprime de plus en plus dans la rue. Elle doit être prise au sérieux. Comme l’observait le sociologue Francis Akindes, ces mécontentements, s’ils n’étaient pas endigués, pourraient être récupérés par des populismes ou des organisations extrémistes, au risque de replonger la Côte d’Ivoire dans la tourmente.
1. Des indicateurs sociaux alarmants
• Une pauvreté encore massive
Par les effets cumulés de la crise économique des années 1980-1990 et de la crise politique des années 2000, la Côte d’Ivoire est retombée massivement dans la pauvreté. En 2013, le PIB par habitant se situait autour de 1000 dollars, soit une baisse de 30% par rapport à 1980.
Dans les années 1980, le pays faisait figure d’exception en Afrique avec un taux de pauvreté de 10%. Celui-ci a triplé entre 1985 et 1993, pour atteindre 31%. En 2008, 49% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 737 francs CFA par jour. La Banque mondiale estime que ce taux a culminé à 52% de la population en 2011 avant de redescendre graduellement à environ 46% actuellement.
Ce pourcentage demeure considérable. De nombreux interlocuteurs de la mission ont insisté sur le fait que la pauvreté était massive en Côte d’Ivoire. La mission a pu le constater lors de son déplacement dans les bidonvilles d’Abidjan, dans les campagnes du nord du pays ou à Bouaké. Pour beaucoup d’Ivoiriens, se nourrir demeure un sujet de préoccupation quotidien. L’archevêque de Bouaké, Monseigneur Ahouanan, rapportait ainsi que de nombreuses familles ne prenaient qu’un seul repas par jour, parfois seulement composé de riz. Il est fréquent que des jeunes, parfois même des étudiants, lui demandent à manger. Selon l’Institut national de la statistique ivoirien (INS), près de 70% des familles ivoiriennes rencontraient des difficultés pour se nourrir et se soigner en 2013.
Cet accroissement tendanciel de la pauvreté depuis trente ans a fortement ébranlé les classes moyennes, qui se sentent aujourd’hui très vulnérables et étranglées par la cherté de la vie en raison de la hausse du prix des denrées alimentaires. Elles craignent le déclassement. Selon l’OCDE, plus des deux tiers des Ivoiriens ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie. En 2014, plus de la moitié des chefs de ménage interrogés estimaient que le niveau de vie de leur famille s’est dégradé depuis 2011, selon une étude de la cellule d’analyse des politiques économiques du Centre ivoirien de recherches économiques et sociales (CAPEC).
Certes, le taux de pauvreté a déjà commencé à diminuer depuis 2011. Cependant, comme la population s’est accrue dans le même temps, la Banque mondiale estime qu’il y a aujourd’hui environ 935.000 pauvres de plus qu’en 2008. Globalement, l’institution juge que l’élasticité de la réduction de la pauvreté par rapport à la croissance du PIB est particulièrement faible en Côte d’Ivoire, de l’ordre de 0,28, alors qu’elle est en principe comprise dans une fourchette entre 1 et 5 et qu’elle s’établit en moyenne à 3 pour les pays en développement.
La situation n’est guère meilleure si l’on considère le classement de la Côte d’Ivoire en termes d’indice de développement humain (IDH). Le pays a un IDH de 0,45, considéré comme « faible », et a reculé d’une place au classement en 2015, occupant désormais la 172ème place sur (188 pays). Cet indice synthétique se fonde sur trois principaux facteurs, l’espérance de vie à la naissance, le niveau d’éducation et le niveau de vie.
• Un accès non garanti aux infrastructures de base
En moyenne, les logements qui s’offrent à la vue des visiteurs dans les villages et dans les quartiers populaires des villes ivoiriennes apparaissent très précaires. Ce sont la plupart du temps des cases recouvertes de tôles, dépourvues des commodités de base.
Dans les campagnes que la mission a traversées, l’accès à l’eau potable et à l’électricité était loin d’être acquis. D’après les statistiques de la Banque mondiale, 60,5% des Ivoiriens sont raccordés à l’eau potable et 61,5% à l’électricité.
En outre, l’Organisation mondiale de la Santé relevait qu’en 2015, 52% des ménages ivoiriens ne disposaient pas de toilettes à chasse d’eau ou de latrines couvertes, un taux qui recouvrait en réalité de fortes disparités territoriales, puisque qu’il culminait à 78% en milieu rural contre 24% en milieu urbain.
Ces conditions de logement vétustes combinées à un déficit structurel de l’offre, alors que la demande augmente de 10% par an avec la pression démographique, sont à l’origine d’une véritable crise du logement en Côte d’Ivoire. En 2014, le Gouvernement estimait le déficit structurel de logements à 400.000 dont 200.000 pour la seule ville d’Abidjan. Pour répondre à cette urgence, les autorités avaient annoncé en 2013 un vaste programme de construction de 60.000 logements sociaux, mais ceux-ci peinent à voir le jour, en raison de difficultés de financement et de dysfonctionnements divers. En juillet 2016, seuls 3000 logements avaient été construits.
• Des données sanitaires préoccupantes
Selon les données de la Banque mondiale, l’espérance de vie à la naissance de la population ivoirienne était de 52 ans en 2014, l’une des plus faibles au monde – la moyenne mondiale dépasse les 71 ans. Le pays affiche par ailleurs l’un des plus forts taux de mortalité maternelle : il est passé de 543 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2005 à 720 en 2013.
Le taux de mortalité infantile demeure élevé, avec 108 décès pour 1000 naissances vivantes. Les maladies (paludisme, diarrhées, maladies respiratoires) et la malnutrition, à l’origine de 53% des décès d’enfants de moins de cinq ans, ont sont les principales causes.
Un investissement considérable dans le domaine sanitaire est donc nécessaire. D’après l’Agence française de développement (42), non seulement les dépenses actuelles de santé sont insuffisantes en volume, mais en outre elles reposent excessivement sur les familles. La couverture sanitaire demeure lacunaire et le fonctionnement des structures de santé doit être considérablement amélioré. Enfin, la qualité globale des soins dispensés doit être rehaussée.
• Une réponse qui n’a pas encore permis de faire la différence
Si la plupart des interlocuteurs de la mission ont reconnu les qualités de bon gestionnaire du Président Ouattara, ils sont nombreux à avoir insisté sur les carences de ses politiques de redistribution.
Pourtant, lorsque l’on considère les chiffres, on constate que les dépenses sociales ont occupé une place prépondérante dans le budget de l’État. Le rapport de la Banque mondiale souligne ainsi que « contrairement à la perception quasi-générale, le Gouvernement a privilégié les secteurs sociaux même si la part consacrée aux infrastructures a augmenté au cours du temps ». En 2015, les dépenses en faveur de l’éducation et de la santé ont représenté 27% du total, contre 19% pour les infrastructures, en hausse respectivement de 2 et 5% par rapport à 2012.
RÉPARTITION PAR POSTE DU BUDGET DE L’ÉTAT IVOIRIEN
Postes |
2014 |
2015 | ||
Mia FCFA |
% total |
Mia FCFA |
% total | |
Service de la dette |
1 167,00 |
27,50 |
1 295,00 |
24,90 |
Services généraux des administrations publiques |
573,00 |
13,50 |
504,50 |
9,70 |
Enseignement, Formation et Recherche |
851,00 |
20,00 |
1044,20 |
20,10 |
Santé |
228,00 |
5,40 |
384,70 |
7,40 |
Affaires économiques |
277,00 |
6,50 |
351,40 |
6,80 |
Défense, Ordre, Sécurité |
417,00 |
9,80 |
431,32 |
8,30 |
Administration et développement des infrastructures |
596,00 |
14,00 |
986,10 |
19,00 |
Autres secteurs |
134,00 |
3,20 |
198,80 |
3,80 |
TOTAL |
4 243,00 |
100,00 |
5 196,00 |
100,00 |
Source : Banque Mondiale
D’après l’ancien premier ministre Kablan Duncan, les dépenses de l’État en faveur des pauvres ont ainsi doublé entre 2012 et 2016, passant de 1000 à 2000 milliards de francs CFA. Le mode de calcul de cet agrégat a cependant fait l’objet de critiques relevées par l’OCDE : il inclurait des dépenses de fonctionnement de l’administration centrale des ministères sociaux et des collectivités locales sans impact direct sur la lutte contre la pauvreté.
Il est incontestable que le Gouvernement a adopté plusieurs mesures résolument sociales, comme la création d’une couverture maladie universelle (43), la hausse du salaire minimum garanti (de 36.000 à 60.000 francs CFA), le déblocage des avancements indiciaires des fonctionnaires, l’école gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, ou encore la hausse du prix bord champ du cacao qui augmente directement les revenus des petits producteurs (de 750 francs CFA le kilogramme en 2013 à 1100 francs CFA en 2016).
Cependant, le fait est que ces mesures ont encore un impact limité sur la réduction de la pauvreté. Si l’on prend l’exemple de la hausse du salaire minimum garanti, elle ne bénéficie qu’à la frange des salariés qui ont un contrat de travail. Or, d’après les statistiques de la Banque mondiale, seul un travailleur ivoirien sur cinq est salarié, et seuls 4 salariés sur 10 disposent d’un contrat de travail. L’immense majorité des Ivoiriens demeure en effet confinée dans l’emploi salarié informel, l’auto-emploi ou l’emploi familial, lesquels ne bénéficient d’aucune protection.
Pour l’ex-premier ministre, la pauvreté est en train de se réduire et il faut laisser le temps aux mesures adoptées de produire leur effet. Sans remettre en question cette appréciation, il y a lieu de penser que la politique de redistribution mise en œuvre par les autorités ivoiriennes devra être renforcée afin de répondre sans tarder à l’urgence du développement, dans un contexte où la « grogne sociale » s’accroît considérablement (cf. infra).
Pour la Banque mondiale, trois facteurs expliquent que la croissance économique ait peu influé sur la réduction de la pauvreté depuis 2011. Premièrement, le fait que la croissance a été principalement alimentée par les investissements, qui mettent toujours du temps avant de produire un impact sur les conditions de vie des ménages. Deuxièmement, la Côte d’Ivoire est prise dans un « piège à pauvreté » : le niveau de pauvreté initial des ménages est si important qu’ils ne parviennent pas à améliorer leurs revenus et leur consommation. Troisièmement, les principaux vecteurs sectoriels de la croissance (mines, finances, communication) ne sont pas directement générateurs d’emplois, tandis que la performance de l’agriculture a été en deçà des autres secteurs. Au total, la croissance ne s’est pas encore traduite par la création de suffisamment d’emplois de qualité.
2. « Approfondir » la croissance
Pour relever le défi de l’émergence et réduire la pauvreté à 20% de la population à l’horizon 2020, objectifs que se sont fixés les autorités ivoiriennes dans le cadre du plan national de développement 2016-2020, la Côte d’Ivoire doit impérativement « approfondir » sa croissance économique. En d’autres termes, elle doit parvenir à monter dans les chaines de valeur et diversifier son économie afin de créer des emplois de qualité et de réduire sa dépendance aux chocs extérieurs.
La crise économique des années 1980-1990 avait en effet illustré la vulnérabilité du « modèle ivoirien », fondé sur une agriculture et une agro-industrie puissantes mais très dépendant à l’égard du cours des matières premières, en particulier du cacao. La situation est toujours la même aujourd’hui, alors que le cacao représentait en 2015 près de 50% des recettes d’exportation du pays. La baisse actuelle du cours de l’or noir vient rappeler l’urgence de cette diversification, alors que les prévisions pour 2017 ne sont pas particulièrement optimistes, en raison d’une hausse des stocks mondiaux et d’une incertitude sur la demande.
• Un préalable : maîtriser l’endettement et assainir certaines structures publiques
Si la plupart des observateurs s’accordent pour dire que la croissance ivoirienne repose sur une gestion plutôt saine, tous pointent des risques qui doivent être traités sous peine de fragiliser l’édifice.
Les autorités ivoiriennes devront maîtriser le rythme de l’endettement public. Si son niveau apparaît raisonnable, cet endettement est reparti rapidement à la hausse après les annulations de dette consenties par les bailleurs multilatéraux dans les années 2000, puis par le Club de Paris en 2012 : 43,3% en 2013, 44,8% en 2014, 47,8% en 2015 et 48,3% en 2016.
Si la Banque mondiale estime que cet endettement est globalement maîtrisé, il est néanmoins source de fragilité en raison de la profondeur limitée du marché de la dette au sein de l’UEMOA ainsi que du durcissement des conditions d’accès aux marchés pour certains pays africains. La Côte d’Ivoire doit garder en tête l’exemple du Ghana qui avait fortement accru ses dépenses publiques en période faste et s’est retrouvé dans une situation insoutenable avec le retournement de la conjoncture, qui l’a forcé à faire appel au FMI et à mettre en œuvre des mesures d’ajustement douloureuses.
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire doit également assainir la situation financière de plusieurs entreprises et établissements publics. C’est particulièrement vrai dans le domaine de l’énergie. La Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE) se trouve en situation de déficit structurel en raison de sa dépendance au gaz naturel, d’un recouvrement de recettes chroniquement insuffisant et d’arriérés cumulés pendant la crise. La situation de la Société ivoirienne de raffinerie (SIR) et de la Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire (PETROCI) est encore plus préoccupante. En outre, plusieurs banques publiques et établissements de microfinance doivent être restructurés car ils ne remplissent pas les ratios prudentiels et sont sous-capitalisés.
La Banque mondiale appelle par ailleurs à porter une attention supérieure aux risques associés à la prolifération des partenariats public-privé. Le Gouvernement a identifié près de 100 projets devant être conduits de cette manière sur la période 2016-2020, dont au moins une vingtaine sont déjà bien avancés. Les autorités devront être vigilantes au risque individuel porté par chaque projet, mais aussi au risque systémique induit par le recours massif à cette formule.
• Diversifier l’économie pour monter en gamme et créer des emplois
Les secteurs de l’industrie (25% du PIB) et des services (47% du PIB) représentent une part importante de l’économie ivoirienne mais l’emploi reste concentré dans l’agriculture. Par ailleurs, le secteur secondaire est largement dominé par des activités à faible valeur ajoutée qui ne génèrent qu’une quantité limitée d’emplois formels (par exemple, les mines). Quant aux services, leur potentiel reste peu exploité et ils demeurent beaucoup cantonnés dans le domaine informel.
- Créer des emplois de qualité, un enjeu central pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens
Les autorités ivoiriennes mettent en avant un développement rapide de l’emploi au cours des dernières années. En réalité, les emplois créés sont essentiellement des emplois informels. Selon la Banque mondiale, 93% des Ivoiriens déclarent un emploi, le chômage étant un luxe qu’ils ne peuvent pas se permettre. Cependant, l’immense majorité de ces emplois sont peu productifs et mal payés. 76% des Ivoiriens travaillent dans l’auto-emploi et l’emploi familial, dont les deux tiers dans l’agriculture. La faiblesse de l’emploi salarié formel renvoie à celle du tissu d’entreprises ivoiriennes susceptibles de générer ces emplois.
La création d’emplois de qualité est pourtant la clé pour que la croissance ivoirienne soit redistributive et soutenue. En accédant à un emploi pérenne, les travailleurs voient leurs revenus augmenter et accroissent leur demande de biens de consommation et d’investissement. Ils investissent davantage en capital humain et en équipements, ce qui a pour effet d’accroître leur productivité. En outre, l’accès à un emploi génère un sentiment d’appartenance et de bien-être social qui ne peut qu’accroître la cohésion de la société ivoirienne.
La diversification de l’économie ivoirienne doit donc permettre de répondre à ce défi de la création et de la montée en gamme des emplois. Il faudra pour cela améliorer les performances de l’agriculture et accélérer la transformation des produits agricoles, étendre le tissu industriel et mieux exploiter le potentiel des services.
- Accélérer la transformation des produits agricoles
Comme évoqué précédemment, la Côte d’Ivoire dispose d’une agriculture puissante. Mais elle n’assure encore que peu la transformation des produits agricoles sur son territoire : l’industrie agro-alimentaire ne représentait ainsi en 2015 que 3% des exportations contre 48% pour les produits agricoles non transformés, d’après les statistiques de l’OCDE. Un interlocuteur mentionnait à la mission l’exemple des mangues, produites dans le nord de la Côte d’Ivoire. À l’heure actuelle, un tiers de la production est exportée ; il est fréquent de voir le reste pourrir sur le sol, une fois la population locale approvisionnée. Le spécialiste s’étonnait que, dans ces conditions, des entreprises de transformation locale n’aient pas vu le jour, afin de créer des confitures, pâtes de fruits, jus et autres produits pouvant être plus aisément conservés et exportés.
En effet, la montée en puissance des industries de transformation permettrait à la Côte d’Ivoire d’accroître la valeur de ses exportations, de développer un tissu d’industries sur son territoire, de diffuser les savoir-faire afférents et de créer des emplois locaux. Ce potentiel a été pris en compte par les autorités ivoiriennes qui en ont fait un axe important du plan national de développement 2016-2020.
Au cours des dernières années, le pays a déjà progressé dans la transformation du cacao. La Côte d’Ivoire est progressivement passée au deuxième niveau de transformation (production de masse et de beurre de cacao) pour atteindre le troisième niveau en 2015 (chocolat en tablette et en poudre, pâte à tartiner). L’usine française Cémoi, que la mission a pu visiter lors de son déplacement en Côte d’Ivoire, produit ainsi du chocolat en poudre, de la pâte à tartiner et bientôt des tablettes destinés au marché local et, à terme, régional.
À l’heure actuelle, la transformation du cacao n’est assurée qu’à 33% localement, l’objectif étant de parvenir à 50% d’ici 2020. Pour inciter les entreprises à investir, les autorités ont réduit la fiscalité applicable à l’exportation de cacao transformé, l’abattement consenti dépendant de la nature et du degré de transformation du produit exporté.
Pour autant, le potentiel de montée en valeur de la filière cacao demeure limité. Comme le montre l’OCDE, il est difficile et long de se construire un avantage comparatif dans la filière du chocolat en raison des nombreuses compétences et technologies à acquérir. Les chocolats de grande qualité sont en outre toujours créés à partir d’un savant mélange de fèves d’origines variées : une industrie de transformation visant à produire un chocolat de qualité ne pourrait donc reposer exclusivement sur la production ivoirienne. Enfin, la demande de chocolat demeure très faible en Afrique, ce qui limite l’intérêt de relocaliser la filière en Côte d’Ivoire, les distributeurs internationaux recherchant plutôt la proximité avec les marchés de consommation.
En dehors du cacao, le potentiel de transformation des produits agricoles ivoiriens est considérable. Le pays est devenu le premier producteur d’anacarde au monde mais n’assure que 8% de la transformation de sa production, principalement exportée brute vers l’Inde, le Brésil et le Vietnam. Pour l’heure, parmi les grandes entreprises, seul le singapourien Olam a investi, avec l’ouverture en 2012 de la plus grosse usine de transformation de cajou au monde, à Bouaké.
L’anacarde présente de nombreuses opportunités de transformation : amandes rôties et salées, baume de cajou, huile de cajou, jus, fruits et confitures de pomme de cajou, combustibles, peintures, vernis, élément de friction de frein et d’embrayage… Selon la Banque mondiale, parvenir à transformer 30% de la production, soit 234.000 tonnes, permettrait de créer au moins 46.000 emplois.
La Côte d’Ivoire a par ailleurs cherché à développer la transformation locale du coton, culture rivale de l’anacarde dans le nord du pays. Cette entreprise butte sur l’attractivité supérieure du prix de la graine de coton – très courtisée dans la sous-région – à l’export.
La mission a ainsi rencontré l’entrepreneur français d’origine ivoirienne, Alexandre Keita, qui détient Ohleol, une usine spécialisée dans la trituration de la graine de coton située à Bouaké. Cette dernière produit de l’huile alimentaire, des tourteaux et de la nourriture pour volaille pour les marchés locaux et régionaux. Cependant, elle menace de mettre la clé sous la porte faute de pouvoir acheter suffisamment de matière première, les égreneurs vendant leur production à meilleur prix à l’étranger, en particulier au Burkina Faso et au Mali. En 2016, elle n’a pu obtenir que 13.000 tonnes de graines alors qu’il lui en faudrait 90.000 tonnes pour équilibrer ses comptes et qu’elle a la capacité d’en traiter jusqu’à 220.000 tonnes. En 2015, la production ivoirienne de coton graine s’était élevée à 310.000 tonnes contre 450.000 tonnes l’année précédente, principalement en raison de mauvaises conditions climatiques.
Pourtant, selon l’OCDE, la filière coton-textile-habillement présente un fort potentiel de montée en gamme en Côte d’Ivoire : « la croissance démographique, l’urbanisation, l’émergence de chaines hôtelières régionales, la diaspora et les préférences commerciales régionales, un accès préférentiel aux marchés européens et aux États-Unis offrent aux stylistes et confectionneurs ouest-africains des niches dynamiques dans la coupe-couture haut de gamme, le textile pour la maison et la décoration intérieure ainsi que la broderie traditionnelle et l’artisanat de luxe ». La Côte d’Ivoire serait, avec le Nigéria, le seul pays de la région à avoir une bonne capacité industrielle sur le segment textile qui lui permettrait de développer cette filière, à condition de se concentrer sur un segment moyen-haut de gamme pour ne pas entrer en concurrence avec les pays asiatiques, plus compétitifs sur le bas de gamme.
- Étendre les capacités de l’industrie ivoirienne
La diversification du tissu industriel ivoirien au-delà des industries de transformation est nécessaire pour réduire la dépendance aux aléas de production et créer davantage d’emplois.
Pour cela, la Côte d’Ivoire pourrait se reposer sur des capacités et compétences pas trop éloignées de celles dont elle dispose actuellement. L’examen multidimensionnel de l’OCDE recense plusieurs créneaux potentiels, tels que les produits chimiques, de beauté ou pharmaceutiques, les produits manufacturés basés sur des matières premières (meubles, habillement, maroquinerie, etc.) ou encore l’industrie légère (équipements de transport, équipements médicaux, etc.).
- Mieux exploiter le potentiel des services
Les services sont susceptibles d’avoir un effet d’entraînement important sur les autres secteurs de l’économie ivoirienne. Or, ils sont encore largement cantonnés à la sphère informelle, ce qui réduit leur potentiel de croissance.
L’OCDE suggère que la professionnalisation et la modernisation des services de logistique et de planification, notamment grâce aux technologies de l’information et de la communication (TIC), pourrait libérer un potentiel de croissance. En effet, les services de transport sont souvent informels et les cargaisons sont expédiées sur une base peu planifiée, ce qui suscite de nombreuses inefficiences. Le développement de ces services pourrait avoir un effet d’entraînement sur la fabrication, en abaissant le coût de transport, et sur le développement des technologies d’information et de la communication.
• Lever les freins au développement du secteur privé
Le développement de la Côte d’Ivoire ne pourra se faire sans un renforcement du secteur privé qui devra reposer largement sur les petites et moyennes entreprises (PME), adaptées à la taille du marché et à même de fournir de l’emploi à une population active ivoirienne nombreuse.
Le Gouvernement en a conscience et appelle de ses vœux l’implantation de PME étrangères. Or, dans la situation actuelle, de nombreux obstacles à leur développement persistent. Les PME sont en effet les premières pénalisées par l’environnement des affaires encore compliqué et par les difficultés d’accès aux financements.
Cette situation n’est pas propre à la Côte d’Ivoire. Ancien directeur général de l’AFD, Jean-Michel Severino a créé une banque d’investissement destinée à soutenir les entreprises africaines, Investisseurs et Partenaires. Pour lui, les entrepreneurs africains « sont des héros, et pas simplement en raison des défaillances du système fiscal et institutionnel ou de la corruption. C’est bien d’avoir une usine, mais encore faut-il que la route ne soit pas inondée six mois par an et que l’électricité fonctionne plus de quelques heures par jour… ».
- Améliorer le climat des affaires
Certaines réformes transversales doivent contribuer à améliorer l’environnement global pour les entreprises : modernisation des infrastructures, extension de l’approvisionnement en électricité et en eau potable, développement du capital humain, promotion et la facilitation du commerce régional, notamment au sein de la CEDEAO, etc…
Mais la Côte d’Ivoire doit encore parvenir à accroître la confiance des investisseurs pour libérer le potentiel du secteur privé. Le chantier de la lutte contre la corruption est, de ce point de vue, incontournable ; votre rapporteure aura l’occasion de revenir spécifiquement sur cette question.
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire doit encore réduire l’insécurité juridique et fiscale à laquelle les entreprises sont exposées. Le système fiscal ivoirien s’avère complexe et peu lisible pour les acteurs économiques. Selon l’édition 2014 de la publication Paying Taxes (Banque mondiale et PwC), une entreprise ivoirienne doit s’acquitter de 62 impôts par an contre 36 en moyenne en Afrique, 32 au Ghana et moins de 10 en Afrique du Sud et au Maroc qui ont simplifié leur fiscalité. Les entreprises peuvent en outre se voir appliquer des taxes supplémentaires, y compris à titre rétroactif. Ainsi, l’amélioration de la fiscalité est un passage obligé pour attirer les investisseurs.
Sur le plan de la sécurité juridique, la création du tribunal de commerce d’Abidjan a constitué un premier pas très bienvenu. Il importe désormais d’ouvrir d’autres bureaux dans le reste du pays et de développer les recours contre les décisions rendues.
La Côte d’Ivoire doit aussi faciliter encore la logistique pour les industries. Les procédures douanières ivoiriennes sont globalement jugées peu fluides et coûteuses. Par ailleurs, les transporteurs et autres acteurs du commerce international pâtissent du manque de regroupement géographique des activités dans le port d’Abidjan.
La Banque mondiale mentionne d’autres domaines où la Côte d’Ivoire doit encore considérablement progresser pour créer un environnement des affaires compatible avec son ambition de pays émergent, notamment l’obtention des permis de construction et la suppression des barrières à l’entrée limitant la concurrence dans certains secteurs, en particulier la finance, les transports et les communications. Dans beaucoup de secteurs, les réformes ont été engagées ; elles devront être poursuivies pour établir durablement la confiance.
- Développer les services financiers
Le manque de financements est un frein majeur au développement d’un tissu de petites et moyennes entreprises. Globalement, le secteur financier ivoirien est considéré comme plus performant que dans la majeure partie des pays africains. Ainsi, le Côte d’Ivoire dispose du réseau bancaire le plus développé de l’UEMOA et son marché d’assurances est nettement plus avancé que chez ses voisins. Cependant, pour diverses raisons, ces financements bénéficient assez peu aux petites entreprises qui souhaitent se développer.
Le crédit bancaire a connu une croissance régulière depuis 2011 pour atteindre 27% du PIB en 2013. Cependant, cette hausse a surtout profité aux grandes entreprises. D’après l’OCDE, cela tient à des taux d’intérêt élevés, à l’insécurité juridique qui entoure l’octroi du crédit en Côte d’Ivoire et à la frilosité des banques, confrontées au manque d’informations fiables sur la situation des emprunteurs.
En outre, la réglementation bancaire exige d’adosser les prêts à long terme sur des dépôts de longue durée, lesquels représentaient en 2012 moins de 50% du total des dépôts des particuliers et du secteur privé. Cette règle limite considérablement la disponibilité du crédit à long terme pour les PME. Ainsi, en 2012, le crédit à court terme représentait 78% de l’encours total du crédit.
Par ailleurs, la microfinance et le secteur de l’économie sociale et solidaire sont restreints en Côte d’Ivoire par rapport à d’autres pays en développement. La microfinance comptait moins d’un million de clients en 2012 ; les agences sont souvent concentrées à Abidjan, au détriment des régions nord et ouest. Par ailleurs, l’OCDE relève que nombre d’établissements de microfinance affichent une situation peu brillante en raison d’un manque de compétences techniques, opérationnelles et humaines.
S’agissant des marchés boursiers, les opérateurs privés ne représentent encore qu’une partie infime des volumes échangés à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) dont la Côte d’Ivoire est membre. Celle-ci est avant tout une source de financement pour les gouvernements de la région : la dette publique à court terme représente ainsi 96% du total des émissions.
Enfin, si la Côte d’Ivoire est l’un des marchés les plus dynamiques et concurrentiels au monde pour la banque mobile (mobile banking), avec quatre millions d’utilisateurs, ces services ne profitent pas à la frange la plus pauvre et la plus isolée de la population et les transactions sont soumises à un plafond de 500.000 francs CFA.
Conscientes de la nécessité de développer le financement au secteur privé, les autorités ivoiriennes ont institué un Comité de développement du secteur financier (CODESFI) interministériel qui a conduit une analyse du développement du secteur financier et établi un plan d’action conforme aux préconisations des bailleurs de fonds, lequel doit à présent être mis en œuvre.
• Un système éducatif sinistré
En Côte d’Ivoire, la référence à l’âge d’or d’Houphouët-Boigny est omniprésente lorsque l’on évoque le système éducatif. L’éducation publique avait alors bonne réputation et la Côte d’Ivoire était même un pôle d’enseignement supérieur de haut niveau, reconnu dans toute la région. Plusieurs hauts responsables ivoiriens ont d’ailleurs été formés dans ce système public.
Ce système a pourtant grandement souffert des effets cumulés de l’ajustement structurel conduit dans les années 1990, puis de l’alignement sur les « objectifs du millénaire pour le développement » formulés en l’an 2000 (44), et enfin de la crise ivoirienne. L’ajustement structurel, en comprimant fortement les dépenses publiques, a eu pour effet de détruire les secteurs sociaux qui avaient été bâtis au cours des décennies précédentes. Quant aux objectifs du millénaire, ils sont jugés sévèrement par de nombreux experts, pour qui le programme « éducation pour tous », en se concentrant sur la dimension quantitative, a eu pour effet de donner « une éducation au rabais dispensés par des instituteurs dépourvus de qualifications devant des classes de cent élèves ».
Pour Christian Bouquet, « le système public ivoirien ne vaut plus rien aujourd’hui. Aucun enfant des catégories socio-professionnelles supérieures ne le fréquente. La jeunesse nantie va dans des établissements français, ou encore dans quelques rares établissements publics d’excellence qui ne sont pas du tout à l’image du reste ». Ce diagnostic rejoint celui du sociologue ivoirien Francis Akindes, pour lequel, en Côte d’Ivoire, « il y a les uns, les autres et les et cetera ». Les « uns » envoient leurs enfants étudier à l’étranger, quand les « autres » les envoient dans des établissements privés ou publics d’excellence et les « et cetera » ont une éducation « au rabais ».
Pour Charles Gomis, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, l’éducation publique a aussi beaucoup souffert de sa politisation pendant la crise, qui a nui à son image au sein de la population ivoirienne.
L’éducation est aujourd’hui considérée comme « l’une des plus grandes faiblesses de la Côte d’Ivoire » par l'OCDE qui relève que, si le taux d’inscription à l’école primaire est élevé (94% des enfants en 2012), le taux d’achèvement de ces études primaires est faible, de l’ordre de 45% en 2012 (60% en 2013-2014 selon le Gouvernement ivoirien), ce qui signifie que nombre d’enfants quittent le système scolaire sans avoir les compétences pour rester alphabétisés toute leur vie. Par ailleurs, l’accès au secondaire était restreint à 41% des enfants ivoiriens en 2013, tandis que seuls 25% achevaient le cycle du collège et 15% celui du lycée. Enfin, seuls 4% accédaient à l’enseignement supérieur en 2012 alors qu’ils étaient deux fois plus nombreux en 2007. Enfin, l’OCDE notait une dégradation considérable du niveau des acquisitions des élèves depuis les années 1990, notamment dans le primaire.
• Le travail des enfants, un phénomène encore massif
Cette crise de l’éducation publique ivoirienne combinée à une pauvreté importante entretient un taux élevé de travail des enfants et en particulier des filles. Au total, selon le ministère de l’emploi ivoirien, plus d’un quart des enfants ivoiriens sont considérés comme économiquement actifs. Ce ratio monte à plus de 30% pour les filles et plus encore à Abidjan, où elles sont massivement employées comme aides familiales. Si l’on considère les adolescents de 14 à 17 ans, ils étaient près de 50% à exercer une activité économique en 2014.
• Un capital humain défaillant
- Au niveau de l’éducation de base
La Côte d’Ivoire a, comme tous les pays en développement, un défi portant sur l’alphabétisation et l’éducation de base de sa population. Le taux d’alphabétisation est encore faible, de l’ordre de 57%, et si l’accès des enfants à l’école a été fortement amélioré au cours des dernières années, ils n’y restent souvent que pour une durée très courte. D’après le rapport de l’OCDE (45), « la fréquence des abandons liée à la volonté d’apprendre un travail suggère que le système éducatif n’offre pas les formations adaptées aux élèves en difficulté et indique une demande de formation technique et professionnelle relativement précoce dans le parcours scolaire des élèves ivoiriens ».
D’après l’OCDE, ce défi va devenir d’autant plus aigu au cours des prochaines années que la force de travail sera composée « majoritairement de personnes n’ayant pas de niveau d’éducation formelle suffisant » à l’horizon 2025. Dès lors, il importera d’offrir à ces populations des formations qualifiantes ou des opportunités de validation des acquis accumulés dans le cadre d’activités informelles qui n’existent pas actuellement.
- Au niveau de l’éducation secondaire et supérieure
Les jeunes Ivoiriens qui accomplissent une éducation primaire et secondaire complète – voire accèdent aux études supérieures – ne sont pas forcément mieux lotis. En raison des défaillances du système d’éducation, de formation et d’orientation, les diplômes sont déconnectés des besoins du marché du travail. En effet, la Banque mondiale relève qu’« une vaste majorité d’employeurs reconnaissent ne pas trouver suffisamment de travailleurs qualifiés ». Le taux de chômage des titulaires de diplômes du secondaire et du supérieur s’élève ainsi à 15%.
D’après la Direction générale du Trésor, il existe un « trou » dans le management intermédiaire ivoirien. Ce constat rejoint celui de l’OCDE : « alors que la société ivoirienne dispose de bonnes compétences pour les fonctions supérieures, il existe un manque de compétences adéquates pour les fonctions intermédiaires chargées de l’opérationnel ».
Ce déficit est aussi sectoriel. Ainsi, l’OCDE observe encore que « l’économie nationale est dominée par l’emploi indépendant informel et par le secteur agricole. Or, les enseignements à destination du secteur des services sont surreprésentés, les effectifs de l’enseignement technique et de la formation professionnelle à destination de l’agriculture et de l’industrie sont particulièrement faibles, et la structure de l’offre de formation est essentiellement tournée vers l’emploi salarié sans tenir compte de la prévalence de l’emploi indépendant ».
Ce problème est particulièrement prégnant pour des entreprises avec des problématiques industrielles. Un entrepreneur français rencontré à Abidjan rapportait ainsi qu’il était « plus facile d’avoir un doctorant que de recruter un plombier zingueur ». Une anecdote rapportée à la mission illustre bien cette situation. De jeunes Ivoiriens avaient conçu une tablette numérique. À la question de savoir comment ils comptaient la fabriquer, ces jeunes avaient répondu qu’ils allaient « faire comme les grands », c’est-à-dire la faire produire à l’étranger, faute de personnel avec les qualifications techniques requises pour le faire en Côte d’Ivoire.
• Un chantier à prioriser absolument
De nombreux observateurs s’accordent pour penser qu’en dépit des efforts consentis, la politique de l’éducation, de la formation et de l’orientation mise en œuvre par le gouvernement ivoirien doit être approfondie. Cet enjeu a été souligné dans le dernier rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du pays(46), qui observe que « la Côte d’Ivoire demeure en retrait de la moyenne africaine et surtout très éloignée des résultats atteints par les pays émergents ».
L’éducation est pourtant, avec 1,6 milliard d’euros en 2015, le premier poste budgétaire après le service de la dette. Comme mentionné, la scolarité a été rendue obligatoire et gratuite entre 6 et 16 ans, une réforme des filières techniques a été amorcée, une augmentation du temps scolaire a été décidée afin de faire face à la demande qui est immense. En parallèle, un programme de construction et de réhabilitation de 60 000 salles de classe et 158 collèges et lycées de proximité a été lancé, et divers programmes ont été mis au point pour favoriser l’accès à l’instruction des filles et développer l’alphabétisation des femmes.
Cet effort doit être poursuivi en insistant désormais sur la dimension qualitative de l’enseignement. Les entrepreneurs français rencontrés par la mission à Abidjan insistent sur la nécessité de ne pas plaquer les modèles occidentaux – et en particulier français – en Côte d’Ivoire. Les problématiques y sont radicalement différentes, compte tenu des besoins de développement du pays.
L’OCDE insiste sur la nécessité d’accroître, en coordination avec le privé, l’offre de formations techniques et professionnelles dans les secteurs à fort potentiel de croissance (agriculture, agro-industrie, construction, transports…) et de favoriser l’acquisition de compétences entrepreneuriales (comptabilité, gestion, finance) dès le premier cycle.
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire devra mettre en place des politiques ciblées de compétences pour valoriser la main d’œuvre d’ores et déjà disponible sur le marché du travail, sans attendre que les réformes des curriculums d’éducation ne portent leurs fruits. Les effets de ces dernières ne peuvent être que différés, or il y a urgence à donner sans attendre des perspectives à la population nombreuse en âge de travailler et à répondre aux besoins de l’économie ivoirienne.
La réhabilitation du système d’éducation, de formation et d’orientation est un défi d’autant plus central que la Côte d’Ivoire va devoir absorber une poussée démographique considérable au cours des prochaines années et décennies. Comme l’observait Jean-Pierre Marcelli, le directeur Afrique de l’AFD, si l’on ne restaure pas rapidement la foi dans l’école publique, les Ivoiriens feront le choix de la madrasa ou des travaux des champs pour leurs enfants.
La mission a pu constater combien la « réconciliation nationale » demeurait d’actualité, six ans après la fin de la crise ivoirienne.
Votre rapporteure estime cependant que les lignes de fractures qui traversent la société ivoirienne dépassent le clivage Gbagbo/Ouattara hérité de la crise. Globalement, l’OCDE relève que le « capital social » de la Côte d’Ivoire, compris comme « l’ensemble des réseaux, ainsi que des normes, valeurs et convictions communes qui facilitent la coopération au sein des groupes ou entre eux », est particulièrement faible en Côte d’Ivoire.
Au-delà de la réconciliation, le défi auquel les autorités ivoiriennes sont confrontées est ainsi celui de la cohésion des différentes composantes de la société.
1. La réconciliation nationale, un processus inachevé
« Il ne faut pas confondre le calme et la paix », faisait observer Charles Konan Banny, ancien Premier ministre de la Côte d’Ivoire et président de la Commission vérité, dialogue et réconciliation, lors de son audition devant la mission d’information.
En effet, il est évident, pour qui fréquente un peu les Ivoiriens, que les cicatrices de la crise ne sont pas encore refermées. Ces divisions ne doivent cependant pas être instrumentalisées. Aujourd’hui, une majorité d’Ivoiriens semble vouloir aller de l’avant.
• L’impact forcément limité de la réconciliation « institutionnelle »
La réconciliation nationale a été invoquée en permanence dans les discours politiques depuis 2011. Les actions conduites ont toutefois eu un impact limité sur la classe politique et la population ivoirienne.
D’entrée de jeu, cette réconciliation apparaissait un peu théorique dans la mesure où une grande partie des leaders du FPI, dont Laurent Gbagbo, se trouvait en prison ou en exil. Pour toute une frange de ces militants, en partie libérés depuis 2011, le maintien de Laurent Gbagbo à La Haye constitue un blocage insurmontable à toute tentative de réconciliation.
En raison de ce contexte, il n’y a pas eu de consensus politique autour de la création d’une Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR), mise en place dès la fin de crise, en 2011, pour « œuvrer en toute indépendance à la réconciliation nationale et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d’Ivoire par le biais de mécanismes de justice transitionnelle ». Cette commission était présidée par Charles Konan Banny, un membre du PDCI qui avait appelé à voter pour Alassane Ouattara au second tour de l’élection de 2010. En dépit de son profil plutôt consensuel, ce dernier ne pouvait donc pas être considéré comme neutre.
Les auteurs des violences ne se voyaient pas proposer de contrepartie incitative pour avouer leurs forfaits, comme cela a pu être le cas dans d’autres mécanismes de justice transitionnelle, comme en Afrique du sud, dans les années 1990, où ils pouvaient bénéficier d’une amnistie. Dès le départ, cette donnée limitait la marge d’action de la CDVR. Lors de son audition par la mission d’information, le chercheur Richard Banégas a jugé pour le moins sévèrement les travaux de cette commission. Il dénonce l’opacité globale qui a entouré les travaux de cette commission qui avait pourtant vocation à « guérir par la parole » et à relancer le dialogue. Les audiences publiques n’ont pas été retransmises à la télévision comme c’était initialement prévu. Après plusieurs mois d’attente, le rapport de la CDVR a finalement été rendu public en octobre dernier, sans qu’aucun débat ne soit organisé sur les différentes problématiques évoquées.
En mars 2015, une Commission nationale pour la réconciliation et l’indemnisation des victimes (CONARIV) a été instituée afin de recenser les victimes de la crise et d’effectuer des propositions d’indemnisation à leur endroit. Présidée par l’archevêque de Bouaké, Monseigneur Ahouanan, cette commission a remis son rapport en avril 2016 ; celui-ci recense plus de 150.000 victimes, pour lesquelles un fonds d’indemnisation d’un milliard de francs CFA a été mis en place en août 2015. L’ONG Human Rights Watch note cependant que ces indemnisations tardent parfois à parvenir à leurs destinataires.
Plusieurs observateurs estiment que cette réconciliation « institutionnelle » n’a eu qu’un impact limité auprès de la population ivoirienne. Pour Francis Akindes, le dialogue n’est pas véritablement descendu au niveau des populations et les actions de réconciliation ont essentiellement « donné dans le folklore ».
• La thèse d’une « justice des vainqueurs » cristallise les divisions
La question de la justice tend à maintenir ouvertes les plaies de la crise ivoirienne. De nombreux interlocuteurs ont exprimé à la mission leur sentiment d’une « justice des vainqueurs » : pour eux, seuls les responsables du camp de Laurent Gbagbo ont été arrêtés, tandis que ceux du camp présidentiel ne sont pas inquiétés. Sans reprendre ce terme, la représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en Côte d’Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, a parlé d’une « justice à deux vitesses ».
Les enquêtes relatives aux exactions commises pendant la crise relèvent d’une cellule spéciale d’enquête et d’instruction (CSEI) qui aurait, d’après l’ONG Human rights Watch, commencé à travailler efficacement à partir de la fin 2014. Cette cellule a inculpé des membres de haut niveau des forces du camp « pro-Gbagbo ». S’agissant du camp du Président, deux noms sont revenus à plusieurs reprises lors des auditions, ceux de deux anciens com’zones soupçonnés d’avoir joué un rôle majeur dans des exactions commises lors de la crise, Cherif Ousmane et Losseni Fofana. Ces derniers ont été entendus par la justice ivoirienne durant l’été 2015. Cependant, ces inculpations n’ont débouché sur aucun procès. Certains soupçonnent qu’elles aient eu pour seul objet de leur éviter un transfert devant la Cour pénale internationale (CPI), la justice internationale étant conçue comme complémentaire à la justice nationale.
En 2015, de nombreuses personnalités « pro-Gbagbo », dont l’ancienne Première dame, Simone Gbagbo, ont été condamnés pour crimes contre l’État. Cette dernière a écopé de vingt ans de prison, le double de la peine requise par le ministère public. Elle est à présent jugée, depuis juin 2016, pour crimes contre l’humanité. La Cour pénale internationale avait émis un mandat d’arrêt international contre elle pour ce même chef, mais le Président Ouattara n’a pas consenti à ce transfert.
À l’heure actuelle, plus de deux cent personnes du camp de l’ancien Président Gbagbo restent en détention préventive en lien avec des crimes qui auraient été commis lors de la crise post-électorale ; le Premier ministre Kablan Duncan avait évoqué le chiffre de 242 personnes lorsqu’il avait rencontré la mission au mois de septembre.
La représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU, Aïchatou Mindaoudou, a indiqué à la mission faire pression pour une accélération de la conduite des procès, afin que ceux qui ne sont pas condamnés puissent être libérés. Elle insistait cependant sur le fait que ces prisonniers n’étaient aucunement des prisonniers politiques : des chefs d’inculpation précis et graves figuraient derrière le nom de chaque détenu. La mission n’a cependant pas eu connaissance de cette liste.
Le fait que seuls Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé aient été transférés à La Haye accentue la perception que la justice est partiale. D’après les informations recueillies par la mission, la CPI a prévu de séquencer ses poursuites en commençant par le camp Gbagbo. La procureure Fatou Bensouda a indiqué en avril 2015 que son bureau comptait désormais accélérer les enquêtes sur les crimes commis par les forces affiliées au Président Ouattara. Ce dernier a réaffirmé récemment son soutien au travail de la CPI, mais, d’après l’ONG Human Rights Watch, la coopération apportée aux enquêtes concernant les personnes qui appartenaient à son camp ne serait pas particulièrement zélée.
Pour un interlocuteur, ces lenteurs de la justice ne doivent pas être interprétées comme une absence de justice : « Je pense que la justice a une mémoire ; le procès d’Hissène Habré le montre bien. Dans le court terme, une justice équitable peut mettre à mal la paix sociale encore précaire. Mais c’est bien que la pression demeure sur le Président ; désormais, les dirigeants ivoiriens savent qu’ils ne peuvent plus être des entrepreneurs de la violence ».
• Le facteur ethnique, entre réalité et instrumentalisation
Dans un pays caractérisé par la coexistence d’une mosaïque d’ethnies et la présence d’une proportion importante d’étrangers (estimée à 25%), les questions d’identité et de nationalité ont pris, dans les années 1990, une importance croissante, et ont constitué l’un des nœuds de la crise des années 2000.
En Côte d’Ivoire coexistent en effet quatre grands groupes ethniques (cf. carte ci-après) regroupant eux-mêmes une multiplicité d’ethnies, installées au gré de migrations (47).
Le centre et le sud-est sont occupés par le groupe akan, dont était issu Félix Houphouët-Boigny et auquel appartient son successeur, Bédié. Plusieurs sous-groupes lui sont rattachés : les baoulés, les abrons, les agnis et les peuples dits lagunaires, tels les ébriés, que l’on trouve autour d’Abidjan. On estime que ces groupes chrétiens et animistes représentent environ un tiers de la population ivoirienne.
Le centre-ouest et le sud-ouest sont les fiefs des krous, auxquels se rattachent les bétés comme Laurent Gbagbo, mais aussi les didas et les guérés. Ce groupe est nettement minoritaire.
Le nord et le nord-est sont essentiellement peuplés par le groupe gour – ou voltaïque – islamisé : il comprend notamment les koulangos et les sénoufos.
Le groupe mandé rassemble, au sud, les yacoubas dont était issu le général Gueï et les gouros, et au nord, les malinkés et les dioulas.
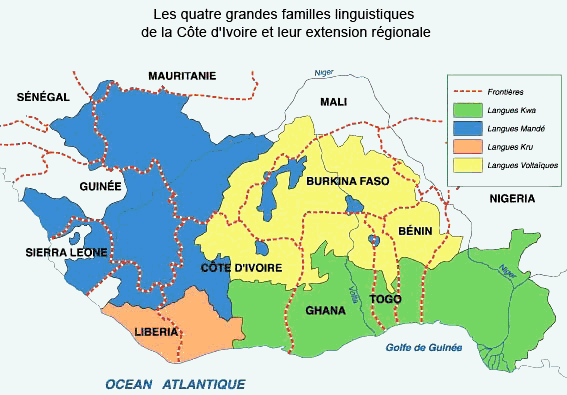
Source : Géoconfluences, Cartes de Ch. Bouquet, dessin : N. Pau-Martinez et G. Ravignon ADES-DyMSET
Globalement, les ethnies venues du nord ont été massivement islamisées. Les populations musulmanes sont ainsi devenues, au fil des vagues migratoires, majoritaires en Côte d’Ivoire. Cependant, le syncrétisme religieux prévaut, les religions chrétiennes et musulmanes étant toutes deux largement teintées d’animisme.
Le chercheur Richard Banégas a rappelé à la mission combien les divisions ethniques entre Ivoiriens avaient d’abord été une création politique, dans le contexte de la mise en valeur de la Côte d’Ivoire. Celle-ci s’est en effet appuyée principalement sur les akans tandis que les populations de l’ouest, moins structurées, demeuraient en marge du pouvoir. Quant aux populations du nord, désignées sous le vocable général de « dioula », elles avaient la réputation de commercer efficacement et étaient considérées comme de bons intermédiaires.
L’un des germes de la crise ivoirienne a été la montée en puissance de la thèse de l’ « ivoirité ». D’abord mise en avant par Henri Konan Bédié, dans les années 1990, l’ivoirité était en réalité centrée sur le groupe akan, voire même, en son sein, sur l’ethnie baoulé, dont étaient issus l’ancien président Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, qui revendiquait son héritage. Le FPI de Laurent Gbagbo a repris la thèse de l’ivoirité à son compte dans un contexte où les populations de l’ouest se sentaient dépossédées de leurs terres en raison de la colonisation agraire. Ce concept a alors été tourné principalement contre les populations du nord considérées comme étrangères ; ce rejet s’est cristallisé sur la personne d’Alassane Ouattara.
Lorsque l’on considère les cartes électorales, le vote des Ivoiriens semble fortement déterminé par des logiques ethno-régionales. Au premier tour de l’élection présidentielle de 2010, il apparaît clairement que les régions du nord ont voté massivement pour Alassane Ouattara, quand le centre et l’est ont voté pour Henri Konan Bédié et l’ouest pour Laurent Gbagbo.
RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2010
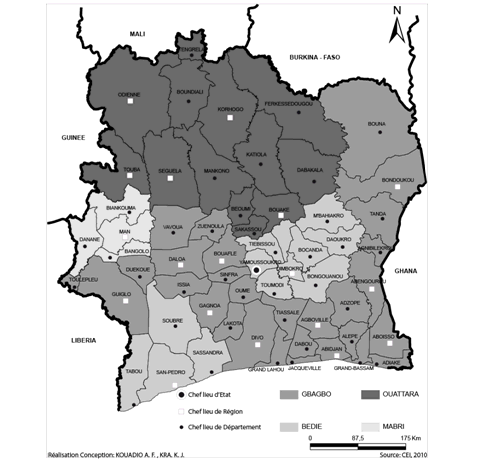
Cette logique semble perdurer aujourd’hui. Lors du référendum constitutionnel d’octobre 2016 (cf. carte ci-après), les régions du nord ont participé massivement et approuvé largement le projet. La participation a été moins importante dans les bastions traditionnels du PDCI. Enfin, la participation a été la plus faible dans les bastions traditionnels du FPI, dans le centre-ouest et l’ouest de la Côte d’Ivoire. Ces différentiels de participation ont été à nouveau observés lors des élections législatives de décembre 2016.
Les questions ethniques semblent ainsi conserver dans la vie politique ivoirienne une importance que l’on ne retrouve paradoxalement pas à l’échelle des territoires et des familles. En réalité, le facteur ethnique continue aujourd’hui à être instrumentalisé dans le débat public. La polémique autour du « rattrapage ethnique » que pratiquerait le Président Ouattara dans ses nominations aux postes de responsabilités le montre bien.
La prise de conscience de cette instrumentalisation doit conduire à ne pas surestimer les divisions réelles entre les Ivoiriens. Comme le souligne Aïchatou Mindaoudou, la Représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU, « les questions ethniques sont prégnantes ici comme partout ailleurs en Afrique ». Les Ivoiriens sont en réalité largement mélangés, et ils se sont plutôt définis historiquement par leur tradition d’ouverture et de vivre ensemble que par leurs divisions.
La plupart des interlocuteurs de la mission ont insisté sur le fait qu’aujourd’hui, les Ivoiriens ne voulaient surtout plus revivre ce qu’ils avaient vécu pendant la crise. Ils souhaitent désormais avancer : « ça va aller », nous disent-ils.
• Comment recréer de la cohésion : le référendum constitutionnel, une occasion manquée ?
Pour plusieurs observateurs, le Président Ouattara aurait manqué, avec le référendum constitutionnel d’octobre 2016, une occasion de rassembler les Ivoiriens pour tourner la page de la crise ivoirienne.
Ce référendum soumettait le texte d’une nouvelle Constitution instituant une troisième République. Elle avait pour objectifs affichés d’asseoir une base solide pour la transition du pouvoir et d’enlever les éléments « confligènes » présents dans la Constitution de 2000. Il s’agissait donc de tourner la page de la crise ivoirienne et de préparer l’avenir.
La création d’un poste de vice-président devait permettre de préparer la transition du pouvoir afin d’éviter les crises de successions comme celle suscitée par la mort du Président Houphouët-Boigny en 1993. Cette vice-présidence était aussi perçue comme un moyen de pérenniser l’alliance entre le RDR et le PDCI en prévoyant une alternance au pouvoir. La nomination du premier ministre Kablan Duncan à ce poste, en janvier 2017, a semblé confirmer cette interprétation.
La création ou la constitutionnalisation de nombreuses institutions – Cour des comptes, Sénat, Haute Cour de justice, médiateur de la République, Chambre des Rois et Chefs traditionnels, Conseil économique, social, environnemental et culturel – participait de cette volonté affichée d’asseoir le pouvoir sur une base solide et aussi large et consensuelle que possible, respectueuse des principes de l’État de droit.
Quant aux éléments « confligènes », il s’agissait de revenir sur l’article 35 de la Constitution de 2000, qui prévoyait que le Président de la République devait être « ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine » et ne « s’être jamais prévalu d’une autre nationalité ». Cette disposition, insérée pour empêcher la candidature d’Alassane Ouattara, avait été l’un des ferments de la crise ivoirienne.
Il est évident que le Président Ouattara n’a pas souhaité faire de ce projet de nouvelle Constitution un grand moment de débat national. Le projet a en effet été rédigé par un comité d’experts, alors que de nombreuses voix réclamaient une constituante. Par ailleurs, il a été présenté au Parlement une semaine avant la date du vote et soumis au référendum deux semaines plus tard : ces délais extrêmement resserrés n’étaient pas favorables à une mobilisation large des Ivoiriens autour de cet enjeu. Ils n’étaient pas non plus propices à une expression constructive de l’opposition. Celle-ci a donc appelé ses militants à manifester contre le projet.
Plusieurs voix se sont élevées pour regretter que l’occasion de cette nouvelle Constitution n’ait pas été saisie pour « recréer de la cohésion » entre les Ivoiriens et pour relancer le dialogue sur certaines questions de fond. On peut toutefois concevoir que les dirigeants n’aient pas voulu prendre le risque de « rouvrir la boîte de Pandore » des questions de nationalité et d’éligibilité qui avaient précipité la Côte d’Ivoire dans la crise vingt ans plus tôt.
2. Réfugiés, apatrides et migrants : trois illustrations des cicatrices persistantes
Les problématiques des réfugiés et des apatrides sont en apparence bien distinctes. La question des réfugiés ivoiriens découle de la crise politique : elle renvoie aux errements de la réconciliation nationale dans un contexte où l’un des deux camps n’a pas complètement réintégré le jeu politique. À l’inverse, la problématique des apatrides, liée à la question des contours de la nationalité ivoirienne, a été l’un des ferments de la crise.
Ces deux sujets ont cependant en commun de constituer des ruptures graves de la cohésion nationale, appelant une prise en compte active par les autorités ivoiriennes.
Votre rapporteure souhaitait par ailleurs souligner le cas des Ivoiriens, de plus en plus nombreux ces dernières années, qui tentent l’aventure de l’immigration illégale en Europe par la voie de la Méditerranée centrale.
• Le non-retour des réfugiés, pierre d’achoppement au processus de réconciliation nationale
La crise ivoirienne a suscité environ un million de déplacés et 300.000 réfugiés dans les pays alentour et en Europe. À l’heure actuelle, environ 40.000 réfugiés demeurent en exil, principalement au Libéria et au Ghana, mais aussi en Guinée et au Togo.
La mission a pu s’entretenir avec les responsables du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) de l’ONU opérant au Ghana, où se trouvent encore environ 11 000 réfugiés ivoiriens principalement répartis sur trois camps. Ces réfugiés sont essentiellement des militants « pro-Gbagbo » qui ont fui la Côte d’Ivoire à la fin de la crise post-électorale de 2011. Ils sont plutôt bien acceptés par les Ghanéens qui leur permettent de circuler librement sur leur territoire. Cependant, dans un contexte de pénurie d’emplois au Ghana et en raison de la barrière de la langue, ces réfugiés ne peuvent pas vraiment exercer une activité économique. Cela limite donc leur intégration.
Les autorités ivoiriennes et ghanéennes se sont entendues sur un retour de ces réfugiés sur une base volontaire. Cependant, dans les faits, ces derniers ne rentrent pas, à quelques exceptions près. Beaucoup de rumeurs circulent dans les camps, instrumentalisées par certains activistes: les réfugiés rentrant au pays seraient emprisonnés ou victimes de violences, voire tués. S’agissant des arrestations, ces rumeurs sont partiellement fondées dans la mesure où certains réfugiés devront, s’ils rentrent, répondre devant la justice ivoirienne de crimes commis pendant la crise. Plusieurs réfugiés disent avoir peur de leur voisin. En outre, nombreux sont ceux ont perdu leurs biens et leurs terres avec la crise.
En tout état de cause, le non-retour de ces réfugiés entretient des divisions et des tensions très nuisibles pour la cohésion nationale. Pour la plupart, ces réfugiés n’ont pas vraiment l’espoir de s’intégrer à court terme dans les pays où ils se trouvent. Ils restent entre eux, entretiennent rumeurs et théories du complot et perpétuent les divisions en Côte d’Ivoire.
Conscientes de l’enjeu, les autorités ivoiriennes ont appelé les réfugiés à rentrer au pays. La ministre de l’Intégration et des Réfugiés, Mariatou Koné, s’est déplacée au Ghana pour les rencontrer dans les camps, mais d’après les informations communiquées à la mission, ce déplacement ne s’est pas avéré concluant. Le HCR dit vouloir organiser de son côté des « go and see », consistant à accompagner certains réfugiés jusqu’à chez eux pour qu’ils puissent y constater la situation et venir en faire état aux autres, ou encore des « come and tell », par lesquels des réfugiés rentrés au pays viendraient témoigner dans les camps. Cependant, la responsable du HCR juge peu probable qu’ils rentrent en Côte d’Ivoire, au moins à court terme.
• L’apatridie, un phénomène massif qui revêt des enjeux singuliers en Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire se distingue par une population apatride particulièrement élevée. Elle est estimée par le Gouvernement ivoirien à 700.000 personnes apatrides ou à risque d’apatridie. En réalité, selon les informations communiquées à la mission, l’ordre de grandeur serait plus proche de deux millions, en prenant en compte les enfants nés ou à naître.
Ce phénomène est donc massif. C’est un réel défi pour la Côte d’Ivoire car l’absence de nationalité prive de nombreux autres droits, tels que les droits à l’éducation, à la santé, à l’emploi et la liberté de circulation. Ce statut se transmet en outre de père en fils. C’est donc un facteur grave d’exclusion.
L’apatridie revêt des enjeux singuliers en Côte d’Ivoire car elle n’est pas liée, comme c’est le cas dans beaucoup d’autres pays, à des pratiques discriminatoires du gouvernement, mais plutôt à des failles dans la législation et la pratique administrative nationales, ainsi qu’au processus de décolonisation et aux schémas migratoires.
En effet, les apatrides en Côte d’Ivoire sont notamment des migrants historiques qui sont arrivés dans le pays avant ou juste après l’indépendance de 1960 et n’ont pas fait établir leur nationalité avant que la loi ne change en 1972. Leurs descendants ont hérité de ce statut. L’apatridie touche également des enfants abandonnés n’ayant pas été déclarés à la naissance (nombreux dans le contexte de la crise ivoirienne) et certains groupes transfrontaliers comme les éleveurs nomades et la communauté lobi dans le nord-est du pays.
En outre, l’apatridie concernerait aussi de très nombreux citoyens ivoiriens nés à partir de 1970, qui n’ont pas été enregistrés car ils ne parviennent pas à apporter la preuve de leur nationalité. Ce phénomène toucherait toutes les régions du pays et toutes les ethnies. C’est en prenant en compte cette population que l’on passerait du chiffre officiel des 700.000 apatrides dénombrés par le gouvernement aux deux millions évoqués précédemment.
Les autorités ivoiriennes ont manifesté leur volonté d’apporter des solutions à ce problème. Outre la ratification de deux conventions internationales sur l’apatridie en 2013 (48), les députés ont adopté en août 2013 une réforme du code de la nationalité destinée à régulariser la situation de certains migrants « historiques ». Au moment de l’indépendance, en 1960, tous les étrangers résidant sur le territoire ivoirien pouvaient accéder à la nationalité ivoirienne. Le premier code de la nationalité adopté en 1961 prévoyait que tout enfant né sur le sol ivoirien de parents étrangers pouvait acquérir la nationalité ivoirienne par simple déclaration. Cependant, ce droit du sol avait été supprimé dans le code de nationalité réformé en 1972.
Le but de la réforme entreprise en 2013 est de permettre aux migrants et aux descendants de migrants n’ayant pas fait valoir leurs droits à l’époque de les faire reconnaître par simple déclaration, dans un délai de deux ans. Sont ainsi concernés les apatrides pouvant prouver qu’ils résidaient en Côte d’Ivoire avant l’indépendance et les enfants nés en Côte d’Ivoire de parents étrangers entre 1961 et 1972, ainsi que leurs descendances. Cette disposition avait été actée dans les accords dits de Linas-Marcoussis conclus entre 2003 mais n’avait jamais été mise en œuvre. La loi prévoit par ailleurs qu’un homme étranger épousant une femme ivoirienne peut acquérir la nationalité ivoirienne, annulant ainsi une inégalité, puisque le contraire était déjà possible.
Par ailleurs, le gouvernement ivoirien a, en lien avec le HCR, cherché à améliorer ses procédures administratives afin de réduire les risques d’apatridie, par exemple en sensibilisant les populations et les chefs coutumiers et communautaires sur la nécessité de déclarer les naissances et en déployant des tribunaux mobiles afin de délivrer des jugements supplétifs, des certificats de nationalité et des cartes d’identité. Il resterait cependant beaucoup à faire pour combattre l’apatridie dans le pays, dans un contexte où la question de la nationalité, en partie à l’origine de la crise ivoirienne, demeure assez sensible.
Recommandation n°5 : Appuyer la prise en compte par les autorités ivoiriennes de la situation des apatrides.
• Les migrants illégaux, expression d’un paradoxe ivoirien
En 2016, 12.400 Ivoiriens ont tenté l’aventure d’une traversée à haut risque, via la Libye et la Méditerranée centrale, pour rejoindre l’Europe occidentale. Cela place les Ivoiriens au quatrième rang parmi les nationalités de migrants arrivés illégalement en Italie en 2016, après le Nigéria (37.600 migrants), l’Érythrée (20.700 migrants) et la Guinée (13.300 migrants). Ces flux de migration illégale se sont fortement accrus au cours des dernières années.
D’après M. Rémi Maréchaux, directeur Afrique et Océan Indien au ministère des Affaires étrangères, cette hausse s’explique notamment par la mise en place d’une filière d’émigration clandestine à Daloa, dans le centre-ouest du pays. Cette filière serait désormais démantelée. D’après les informations données par le ministère de l’Intérieur ivoirien, les migrants transiteraient aussi par San Pedro.
Ces flux croissants d’émigration clandestine illustrent sans doute le manque de perspectives des Ivoiriens et leur aspiration à un mode de vie plus confortable. Néanmoins, ils constituent un paradoxe à l’échelle régionale. Comme nous l’avons évoqué, la Côte d’Ivoire est, en raison de son dynamisme, un pays d’accueil des migrations des pays de la région, en particulier du Sahel.
3. Au-delà des divisions héritées de la crise, un malaise social grandissant
La mission a acquis la conviction que l’enjeu de la cohésion de la société ivoirienne dépasse nettement celui de la réconciliation nationale, laquelle reste finalement assez tributaire de la stratégie des différents acteurs politiques.
En effet, le principal souci de la plupart des Ivoiriens est aujourd’hui d’ordre matériel ; la configuration politique apparaît comme secondaire. Il y a lieu de penser que si la Côte d’Ivoire parvenait à réduire les inégalités et à améliorer les conditions de vie de la majorité de la population, la cohésion s’en trouverait nettement facilitée.
Cependant, cette perspective paraît lointaine alors que l’amplitude des inégalités et la dureté des conditions de vie – à rebours des discours sur le « miracle économique ivoirien » – suscite un malaise social grandissant.
• Des inégalités extrêmes
- Des inégalités de revenus
La persistance d’une pauvreté massive en Côte d’Ivoire s’expliquerait en partie par l’accroissement des inégalités. Pour le sociologue Francis Akindes, les personnes qui étaient riches sous l’ancien Président Gbagbo sont devenues plus riches encore sous le Président Ouattara. La richesse est ainsi captée par une élite souvent liée au milieu politique, à l’image des « grandes familles » qui gravitent autour du pouvoir depuis l’époque d’Houphouët-Boigny.
Pour Francis Akindes, le style de consommation des plus riches a cependant évolué depuis l’époque de Laurent Gbagbo. Il serait aujourd’hui plus « fin » et favoriserait moins la redistribution. Ainsi, la « théorie du ruissellement » – selon laquelle les revenus des plus riches sont in fine réinjectés dans l’économie et profitent à tous – trouverait moins à s’appliquer en Côte d’Ivoire, où « l’argent ne descend pas », pour reprendre les termes du chercheur Richard Banégas.
Il n’existe pas réellement de statistiques fiables permettant de corroborer ce sentiment exprimé par de nombreux interlocuteurs de la mission. Les dernières données disponibles à la Banque mondiale datent de 2008 et rendent compte d’une situation certes inégalitaire, mais pas exceptionnelle au niveau mondial. Ainsi, en 2008, les 10% des Ivoiriens les plus riches détenaient 32,6% des revenus contre 1,8% pour les 10% les plus pauvres. La classe moyenne ivoirienne est estimée à 13% de la population. Le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités de revenus sur une échelle de 0 (égalité parfaite) à 100 (situation totalement inégalitaire) s’élevait à 43,2 en 2008.
À titre de comparaison, ce coefficient était de 42,9 au Nigéria en 2009, de 33,2 en Éthiopie en 2009, de 63,4 en Afrique du Sud en 2011, de 39,5 en Indonésie et 37,9 en Thaïlande en 2013, de 33,1 en France en 2012. Dans les pays émergents, on observe une tendance à la réduction des inégalités. En Thaïlande, le coefficient de Gini était de 47,9 en 1992 et n’a cessé de décroître depuis. Cette tendance est pourtant loin d’être univoque : ainsi les cas de l’Afrique du sud et des pays d’Amérique latine font-ils apparaître le maintien d’inégalités très fortes.
S’agissant de la Côte d’Ivoire, il est difficile d’analyser les évolutions récentes des inégalités avec la reprise de la croissance faute de statistiques actualisées. La faiblesse de la réduction de la pauvreté est néanmoins le signe que les retombées de la croissance ne profitent pas à tous de la même façon.
- Des inégalités territoriales
Les dynamiques spatiales ivoiriennes font apparaître une population rurale en décroissance, estimée à moins de 50% de la population totale en 2014. La Côte d’Ivoire compte ainsi parmi les douze pays les plus urbanisés d’Afrique subsaharienne.
Cette situation est notamment liée à l’urbanisation massive d’Abidjan, qui concentre 20% de la population totale (4,4 millions d’habitants en 2014 contre 2,9 millions en 1998), 80% des emplois formels et 90% des entreprises formelles. Cette urbanisation a aussi reposé sur la croissance des autres villes principales et secondaires dont les principales sont Bouaké (540.000 habitants en 2014 contre 460 000 en 1998), Daloa (270.000 contre 170.000), Korhogo (250.000 contre 140.000) et Yamoussoukro (210.000 contre 160.000) (49).
L’urbanisation ivoirienne a été assez progressive : elle s’était accélérée à partir des années 1960, passant de 20% à 40% dans les années 1980 avec l’éclosion de petites villes dans les zones de production de cultures de rente. La croissance urbaine avait ensuite ralenti de 8% par an à 0,57% par an dans les années 1980 avec le début de la crise économique, pour se stabiliser ensuite à 1,5% par an à partir des années 2000.
La différence de développement est saisissante entre la capitale économique et le reste du pays. En 2012, 91% de la population d’Abidjan se situait ainsi dans les deux premiers quintiles de l’indicateur du bien-être économique créé par l’Institut national de la statistique (INS) ivoirien.
Globalement, les milieux ruraux restent très pauvres. Ils sont désavantagés en général : l’accès aux services publics (écoles, structures sanitaires) et commodités de base (eau potable, électricité) y est plus complexe, et les infrastructures y sont moins développées. En 2008, une enquête du ministère du plan et du développement ivoirien dénombrait 62,1% de pauvres en milieu rural et 29,1% en milieu urbain. La population urbaine dans les bidonvilles est cependant en constante augmentation.
Les disparités régionales sont également importantes : d’après l’OCDE, les régions qui concentrent le plus de pauvres sont l’ouest et le nord-est, alors que les régions du sud semblent plus épargnées.
Par ailleurs, les différences de développement entre les villes sont parfois extrêmes. Globalement, les infrastructures et services sont déficients dans les villes secondaires, s’agissant notamment de l’accès à l’eau potable, de la gestion des déchets, de l’assainissement et de la gestion des eaux usées.
La situation de Bouaké, deuxième ville du pays et cœur de la rébellion pendant la crise ivoirienne, est particulièrement frappante. La mission a eu l’occasion de s’y rendre. Elle a été marquée par l’état de délabrement de la ville. Le consul honoraire de France à Bouaké, Kemal Hélou, a évoqué devant la mission la misère de cette ville et de ses habitants, restés en marge de la reconstruction du pays.
- Des inégalités de genre
Les inégalités sont aussi palpables entre les hommes et les femmes. Plusieurs interlocuteurs ont pourtant exprimé le sentiment que les femmes n’étaient globalement pas brimées en Côte d’Ivoire. De fait, elles jouent un rôle important dans le pays ; les sociétés akan sont d’ailleurs matriarcales. Les femmes occupent une place centrale dans l’activité économique informelle de la Côte d’Ivoire. Des Français rencontrés à Bouaké évoquaient ainsi leur admiration devant le courage de ces mères qui se battent chaque jour pour nourrir leur famille.
Si les femmes ne sont pas opprimées, elles sont proportionnellement plus touchées par les difficultés auxquelles la population ivoirienne est confrontée. L’OCDE relève ainsi que les femmes ont plus de difficultés à accéder à un emploi formel et sont donc souvent confrontées à des emplois vulnérables (79% d’entre elles, selon une étude de 2013) ; qu’elles ont en moyenne plus de difficultés que les hommes pour accéder aux soins, notamment faute d’obtenir la permission de leur conjoint ; qu’elles accusent un retard important en matière d’éducation, surtout en milieu rural où l’accès au secondaire leur est quasiment barré (seules 7% des jeunes Ivoiriennes habitant en zone rurale fréquentaient le secondaire en 2012) ; que, par conséquent, elles sont plus touchées par l’analphabétisme (47% des femmes contre 24% des hommes en milieu urbain ; 79% des femmes contre 55% des hommes en milieu rural en 2012).
En outre, en raison des pratiques culturelles, les femmes ivoiriennes dans les campagnes, ont une autonomie limitée. Bien souvent, elles ne disposent pas de revenus ni de patrimoine en propre. L’ONG Human Rights Watch a indiqué à la mission que les femmes étaient discriminées dans l’accès au foncier, les chefs coutumiers ne reconnaissant généralement pas les droits des femmes sur les terres en l’absence du chef de famille.
En 2012, l’Assemblée nationale ivoirienne a adopté un code de la famille qui compte parmi les plus innovants d’Afrique de l’ouest. Ce texte avait suscité de vifs débats parmi les élus de la majorité. Cependant, un chercheur a rapporté à la mission n’avoir recueilli qu’un faible enthousiasme de la part des femmes des villages à cette perspective. Pour lui, ce texte était prématuré ; il était préférable de progresser d’abord sur certains points fondamentaux comme la scolarisation et l’alphabétisation des femmes. Il s’attend à ce que leur situation juridique évolue graduellement à mesure que le pays se développera.
• Une « grogne sociale » croissante
La conscience aiguisée de ces inégalités nourrit la profonde insatisfaction des Ivoiriens quant à l’évolution de leurs conditions de vie. Elle se traduit par un climat social de plus en plus lourd dans le pays.
Cette « grogne sociale » n’est pas tant le fait des classes populaires enlisées dans la pauvreté que des classes moyennes. Celles-ci ont accès à des emplois formels, en particulier dans l’administration, ainsi qu’aux commodités de base, mais se trouvent étranglées par la hausse tendancielle du coût de la vie et voient certains de leurs acquis remis en cause.
Ainsi, depuis le début de l’année 2016, grèves, manifestations et émeutes se sont multipliées. Des grèves ont d’abord été lancées dans la justice ainsi que dans certaines entreprises publiques, notamment la Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire, la PETROCI. Elles ont ensuite touché l’enseignement, à l’instigation des syndicats d’enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur ainsi que du syndicat étudiant FESCI. En juillet, de violentes émeutes contre la hausse du prix des factures d’électricité ont mis en lumière l’exaspération croissante des Ivoiriens face à la vie chère, alors que les taux de croissance flatteurs de la Côte d’Ivoire étaient partout vantés. Globalement, les Ivoiriens se plaignent de la hausse de leurs dépenses courantes alors que leurs revenus stagnent.
En outre, certains acquis se trouvent remis en cause par les réformes conduites par le Gouvernement. Celui-ci a, par exemple, adopté en 2012 une réforme des retraites de la fonction publique qui en recule le bénéfice de 55 à 60 ans tout en augmentant les cotisations et en baissant le montant des pensions. Les effets de cette réforme, qui ne se sont fait sentir qu’en 2016, se sont traduits par des grèves de fonctionnaires au mois de janvier 2017. Par ailleurs, la rentrée de septembre a été marquée par des grèves d’instituteurs protestant contre la réforme des rythmes scolaires, qui conduit à les faire travailler le mercredi.
Le Gouvernement a tâché de convaincre la population du bien-fondé de ses réformes qui visent à assurer la soutenabilité et accroître la performance du système social pour permettre, à terme, le développement du pays. Ainsi, la réforme des rythmes scolaires avait pour objet d’étendre le temps scolaire afin d’aligner la Côte d’Ivoire sur les standards internationaux de volumes horaires annuels. En effet, les enfants ivoiriens sont souvent scolarisés seulement à la demi-journée, ce qui permet à un même instituteur de conduire deux classes à la fois, alors que le pays manque de professeurs et de salles de classes.
Les efforts de pédagogie du Gouvernement se sont pourtant heurtés à la vive impatience de la population, à la fois des pauvres dont les conditions de vie sont très dures et des classes moyennes qui ont peur du déclassement. L’agrégation de ces mécontentements représente assurément un facteur de déstabilisation pour le pays alors que la réconciliation politique demeure inachevée.
La situation sociale semble en effet avoir franchi un seuil de gravité supplémentaire à l’aube de l’année 2017 en raison de l’effet de contagion de la mutinerie des militaires, qui s’est traduite par l’octroi de primes d’un montant considérable (cf. supra). Ce mouvement de revendication s’est étendu aux autres corps habillés et aux fonctionnaires, faisant peser de lourds risques sur les finances publiques et sur la stabilité du pays, alors que les concessions faites à des personnes jugées plutôt bien loties suscitaient l’exaspération de la grande majorité des Ivoiriens, engluée dans la pauvreté.
Devant cette situation, plusieurs observateurs, à l’image des évêques catholiques ivoiriens, ont tiré la sonnette d’alarme. Ces derniers mettent en garde contre le « malaise social qui persiste au sein de la population » et les « sentiments de frustration et de révolte qui habitent encore le cœur de nombre d’Ivoiriens », estimant que « tout ce climat délétère, si nous n’y prenons garde, risque de compromettre gravement tous les acquis enregistrés, fruits de nos efforts ».
La cohésion de la société ivoirienne apparaît ainsi comme un enjeu primordial pour le pays. La mise en place d’une croissance plus redistributive, la réduction des inégalités et de la pauvreté sont des chantiers d’une importance capitale que votre rapporteure a déjà eu l’occasion d’aborder. La cohésion de la société ivoirienne dépendra aussi largement de sa capacité à donner des perspectives à sa jeunesse nombreuse, laquelle peine aujourd’hui à trouver sa place.
4. Une priorité : intégrer les jeunes
La population ivoirienne est jeune : 60% de ses 23 millions d’habitants ont moins de 25 ans et le pays ne compte que 3% de personnes âgées. Cette jeunesse peut être un réel atout en termes de dynamisme économique pourvu que la Côte d’Ivoire sache améliorer ce capital humain (santé, éducation), créer des emplois de qualité pour tous et réduire son taux de fertilité, de manière à diminuer le nombre de « dépendants » par rapport au nombre d’actifs. Une étude financée par l’AFD (50) analyse ainsi en détail les conditions nécessaires pour que la Côte d’Ivoire profite à plein du « dividende démographique » dont les pays émergents – notamment asiatiques – ont su tirer parti. Pour l’heure, ces conditions sont loin d’être remplies. La jeunesse ivoirienne vit en effet un profond malaise. Son intégration est aujourd’hui une problématique d’autant plus urgente qu’elle pourrait, à défaut, être tentée par le recours à la violence.
• Une rupture générationnelle consommée
De nombreux interlocuteurs de la mission ont souligné la prégnance de cette rupture générationnelle en Côte d’Ivoire. Les générations plus anciennes ont connu l’époque d’Houphouët-Boigny qui demeure pour eux une référence omniprésente, souvent présentée comme un âge d’or où les Ivoiriens étaient prospères et vivaient en harmonie. De leur côté, les jeunes n’ont pas connu Houphouët-Boigny. Ils ont grandi dans un contexte de crise économique, sociale et politique qui s’est étiré au long des années 1990 et 2000. C’est une époque où la pauvreté s’est accrue en Côte d’Ivoire, où l’éducation publique s’est effondrée, où les Ivoiriens se sont déchirés et où la violence a été légitimée comme moyen pour parvenir à ses fins.
La crise et la pauvreté ont notamment aggravé le phénomène des « enfants des rues », auquel la mission a été sensibilisée notamment lors de la visite du Foyer Akwaba, tenu par les Frères des écoles chrétiennes dans le quartier populaire d’Abobo. La mission a pu constater à quel point le développement de ces jeunes avait été affecté par la violence débridée à laquelle ils avaient été confrontés dès le plus jeune âge. Le Foyer ne pouvait pas envisager d’accueillir de petites filles en tant que pensionnaires, le risque de viol étant jugé trop élevé.
Les jeunes du Foyer Akwaba ne sont qu’un exemple parmi d’autres. L’ampleur du phénomène des enfants des rues est difficile à évaluer en l’absence de statistiques précises mais plusieurs observateurs se sont inquiétés de son aggravation.
Cette jeunesse a donc des repères et des références radicalement différents des générations plus anciennes. Les jeunes des quartiers populaires manquent de perspectives : ceux qui poursuivent des études sont souvent mal formés et confrontés à un chômage important, tandis que les autres sont cantonnés dans des petits boulots informels, peu productifs et mal rémunérés (cf. supra). À cet égard, la transformation structurelle de la croissance qui doit permettre la création d’un tissu économique générant des emplois de qualité est un enjeu essentiel que votre rapporteure a déjà eu l’occasion de souligner.
Plusieurs experts estiment que cette jeunesse nombreuse finira par se mobiliser « pour le meilleur ou pour le pire ». Dans le meilleur des cas, elle se mobilisera dans des associations citoyennes comme au Sénégal et au Bénin. Mais elle pourrait aussi être tentée par des formes d’engagement plus radicales.
• Jeunesse et violence politique : le lourd passif ivoirien
La Côte d’Ivoire a en effet une lourde histoire de mobilisation violente de la jeunesse. Le chercheur Richard Banégas a spécifiquement travaillé sur ces questions (51), montrant comment une « jeunesse militante et militarisée » s’était affirmée pendant la crise, entrainée par des meneurs politiques. C’est ce que le chercheur a appelé « la politique du gbonhi » (la bande, le groupe en argot des faubourgs d’Abidjan).
Cette mobilisation de la jeunesse n’a pas été l’apanage du camp « pro-Gbagbo », avec les « Jeunes patriotes » conduits par Charles Blé Goudé. Le chercheur montre qu’une mobilisation similaire a eu lieu dans le camp d’Allassane Ouattara, notamment via les « grins de thé », qui sont des rassemblements traditionnels dans l’espace mandingue, dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire. Ces jeunes auraient joué un rôle important dans les dernières batailles conduites par le camp du Président Ouattara. La plupart de ces jeunes, indépendamment de leur camp, avaient eu le même cursus : ils étaient passés par la FESCI, à l’image de Guillaume Soro.
Richard Banégas a exprimé à la mission son interrogation quant à savoir si le modèle d’affirmation par la violence de rue généralisé pendant la crise était encore d’actualité aujourd’hui. Les deux principales universités publiques sont restées fermées pendant deux ans à la fin de la crise afin de circonscrire l’activisme de la FESCI. On observe pourtant encore une certaine agitation dans les universités et les syndicats continuent à saisir les occasions qui se présentent pour aller à l’affrontement. Encore récemment, lors de la grève de la fonction publique, des manifestants se réclamant de la FESCI se sont, à plusieurs reprises, introduits dans des établissements scolaires pour interrompre les cours et forcer les élèves à se joindre aux manifestations. Ces intrusions parfois violentes ont touché le lycée français Jean Mermoz le 16 janvier dernier.
De nombreux observateurs estiment que plusieurs hommes politiques, à l’image de Guillaume Soro, mais aussi d'Hamed Bakayoko, continuent à disposer de relais dans la rue dont il est difficile d’évaluer l’ampleur.
• Les microbes, un symptôme de cette jeunesse en déshérence
Un phénomène récent illustre cette perte de repères d’une jeunesse dépourvue de perspectives et dont les valeurs ont été brouillées par la crise. Les « microbes » (52) sont des bandes de jeunes âgés de 10 à 25 ans environ qui conduisent des agressions parfois très violentes contre les populations dans les quartiers urbains précaires, notamment à Abidjan. Certains auraient servi d’éclaireurs pour le « commando invisible » qui a pris le contrôle du nord d’Abidjan, contribuant à la chute de Laurent Gbagbo en avril 2011. On compte aussi dans leurs rangs des enfants des rues, des anciens combattants et des jeunes délinquants qui se servent des armes non rendues après la crise.
Le sociologue Francis Akindes, qui a conduit une étude sur ce phénomène (53), relève que les nouveaux gangs sont de plus en plus jeunes et de plus en plus féminisés, et qu’ils « considèrent leurs crimes comme une activité économique légitime et la maîtrise de la violence criminelle comme une compétence ». Certains auraient affirmé être prêts, si on leur en faisait la proposition, à s’engager auprès de mouvements djihadistes.
Pour Hamed Bakayoko, le ministre de l’Intérieur, ces jeunes sont des victimes de la crise : ils ont été très tôt confrontés à une violence extrême qui a perturbé leur développement. Un temps accusé de ne pas réagir, le gouvernement a pris le parti d’interner ces jeunes dans des centres de resocialisation, considérant qu’ils ne relevaient pas de la prison.
C. RENFORCER L’ASSISE DE LA DÉMOCRATIE
Interrogée sur son appréciation générale de l’État de droit en Côte d’Ivoire, l’ONG Human Rights Watch a estimé que les progrès accomplis depuis la crise de 2011 étaient indéniables. La situation sécuritaire s’étant améliorée, les violations massives des droits de l’homme observées pendant la crise ont été enrayées. Les institutions fonctionnent dans tout le pays. Les autorités acceptent les critiques et permettent aux ONG de travailler sur le territoire ivoirien.
Cependant, il persiste une marge importante de progrès. Celle-ci porte plus particulièrement sur le fonctionnement de la justice et la lutte contre l’impunité. Au-delà d’une simple lecture « légaliste », le fonctionnement des institutions ivoiriennes gagnerait sans doute à être plus inclusif et à favoriser davantage une expression démocratique des désaccords.
1. Susciter un jeu politique plus inclusif
L’un des écueils de la cohésion nationale ivoirienne semble être le caractère peu inclusif du système politique tel qu’il est actuellement conçu et décliné. Ce phénomène n’est pas propre à la Côte d’Ivoire. D’après Serge Michailof, « lorsque la démocratie se met en place dans un pays ethniquement hétérogène, des précautions particulières sont souhaitables pour préserver les droits des minorités et éviter des phénomènes d’exclusion créateurs de forts ressentiments et de tensions » (54).
Il convient ainsi de chercher à « construire une architecture démocratique réduisant autant que possible les risques de domination d’un groupe ethnique ou religieux par un autre, définissant dans le détail les règles de partage du pouvoir et de la richesse et l’évolution de cette répartition si celle-ci est gravement inégalitaire ».
• L’alliance PDCI-RDR, un « rouleau compresseur hégémonique » ?
Pour Richard Banégas, l’alliance entre le PDCI et le RDR agit comme un « rouleau compresseur hégémonique ». Le chercheur la perçoit comme une sorte d’« histoire à l’envers » dans la mesure où cette alliance reviendrait à reconstituer l’ancien parti unique d’Houphouët-Boigny.
- Le système ivoirien et le travers du « winner takes all »
Il est certain que le système ivoirien, par sa nature très présidentielle, confère au parti du Président de la République une position dominatrice : c’est le travers du « winner takes all » (« le vainqueur prend tout »).
La Constitution ivoirienne prévoit que le Président de la République est à la fois le « chef de l’État », qui « incarne l’unité nationale », « veille au respect de la Constitution », « assure la continuité de l’État », « est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux » (article 54), mais aussi le « détenteur exclusif du pouvoir exécutif » (article 63) et « le chef de l’Administration » (article 67), qui « nomme aux emplois civils et militaires ». Il nomme le Premier ministre et les autres membres du gouvernement qui ne sont pas responsables devant le Parlement (article 71). Il partage avec le Parlement l’initiative des lois (article 74).
La nouvelle Constitution votée en octobre dernier a renforcé encore le pouvoir exécutif, le dauphin constitutionnel du Président n’étant plus, comme auparavant, le Président de l’Assemblée nationale, mais le vice-président dont le nouveau texte acte l’institution (articles 78 à 80). Le vice-président est choisi par le Président de la République et élu en même temps que lui.
Il convient de noter que l’institution d’une vice-présidence est inspirée des États-Unis, mais que le système ivoirien ne prévoit pas, à la différence du système américain, un mécanisme de « checks and balances » à même de contrebalancer le pouvoir présidentiel. Ainsi, le Parlement n’exerce aucun contrôle sur les nominations faites par le Président. Aucune procédure du type de l’« impeachment » américain ne permet au Parlement de destituer le Président de la République en cas de motifs graves.
- La quasi-absence d’opposition, un facteur de fragilisation du pouvoir
Dans ce contexte institutionnel, l’opposition a d’autant moins les moyens de peser qu’elle se trouve divisée depuis la fin de la crise post-électorale de 2011 (cf. supra).
Dans la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale issue des élections législatives de décembre, l’opposition demeure quasiment inexistante en dépit de la montée en puissance des indépendants. Cette assemblée ne compte que trois élus officiellement labélisés FPI. Comme mentionné précédemment, cette situation résulte, en partie, d’une stratégie volontaire de leaders et militants de ce parti (cf. supra).
De nombreux observateurs s’accordent pour dire que cet anéantissement de l’opposition n’est pas une bonne nouvelle pour la démocratie ivoirienne. Un interlocuteur souligne ainsi que le FPI avait, du temps de Gbagbo, une véritable assise sociale et territoriale qui dépassait largement sa base ethnique bété ou même celle des populations autochtones de l’ouest ivoirien.
Il serait indéniablement dans l’intérêt de la démocratie ivoirienne que le FPI redevienne une force politique. Cela permettrait de mieux préserver les grands équilibres socio-politiques du pays.
- La concentration du pouvoir, source de frustrations croissantes
L’alliance du RHDP a conduit à organiser un partage du pouvoir entre le RDR et le PDCI. Si cette alliance peut s’apparenter à une reconstitution de l’ancien parti du Président Houphouët-Boigny, sa cohésion est autrement plus fragile dans un contexte de multipartisme, où des forces centrifuges peuvent s’exprimer.
Pour l’heure, le pouvoir repose essentiellement entre les mains des présidents Bédié et Ouattara et de leurs proches. Or, cette situation génère des frustrations croissantes au sein du camp majoritaire.
La montée en puissance des candidatures indépendantes aux élections législatives de décembre en a été une manifestation assez claire. Des voix dissonantes se font entendre au sein du PDCI, dont nombre de cadres estiment que l’alliance RHDP tourne à leur désavantage et verraient d’un mauvais œil la création d’un parti unique. Des fractures se dessinent également au sein de la base militante du RDR.
D’après les informations communiquées à la mission, sur les 75 indépendants élus lors des législatives de 2016, seuls une petite trentaine seraient de « vrais indépendants », les autres ayant déjà regagné le PDCI ou le RDR. Ces indépendants ont formé trois groupes parlementaires autour de sensibilités différentes : le groupe « Nouvelle vision » ; un groupe intitulé « Agir pour le peuple » autour du député du PDCI Evariste Méambly, lequel aurait néanmoins marqué sa fidélité au chef du PDCI, Henri Konan Bédié ; enfin le groupe « Vox populi, vox dei ».
La structuration de cette trentaine d’indépendants, de même que le maintien de groupes parlementaires distincts pour le PDCI et le RDR, aura sans doute le mérite de permettre une meilleure expression des différents points de vue au sein du Parlement.
• Le « rattrapage ethnique » : perpétuation ou rupture du consensus houphouëtiste ?
Le « compromis houphouëtiste » qui a permis à l’ancien Président ivoirien de se maintenir au pouvoir pendant plus de trente ans tout en préservant la paix sociale reposait, entre autres, sur une habile répartition des rentes et des situations entre les différents groupes ethniques. À cette époque, l’essentiel du pouvoir était entre les mains des akans, mais l’ancien Président veillait à préserver un équilibre entre les principaux groupes ethniques.
Plusieurs observateurs estiment que ce compromis a été mis à mal avec la disparition d’Houphouët-Boigny, dans un contexte de crise économique – qui voyait la rente se tarir – et de repli identitaire. Ainsi, Henri Konan Bédié aurait, en tant que président, conduit une « baoulisation » de l’État, privilégiant de manière systématique les représentants de son ethnie, ce qui aurait contribué à sa chute en 1999. Une fois au pouvoir, Laurent Gbagbo, conscient de l’étroitesse de sa base ethnique bété, aurait eu l’art de valoriser les groupes qui en avaient jusqu’alors été exclus.
À l’heure actuelle, les détracteurs d’Alassane Ouattara l’accusent d’avoir mis en place un « État dioula ». Cette polémique s’est cristallisée autour de la notion de « rattrapage ethnique ». Cette expression est tirée d’une explication donnée par le Président Ouattara lui-même quand, interrogé en 2012 par la presse française sur la nomination de nombreuses personnalités du nord à des postes de responsabilité, il avait estimé qu’il s’agissait d’un « simple rattrapage » (55), « les communautés du nord, soit 40% de la population » ayant été « exclues des postes de responsabilité » sous Laurent Gbagbo.
Pour Francis Akindes, le fait que le Président Ouattara s’appuie aujourd’hui principalement sur les populations du nord est « dans l’historicité ivoirienne », la logique de confiance en politique s’étant toujours appuyée sur des groupes ethniques.
Cette question est cependant sujette à débat, d’aucuns considérant que l’hégémonie actuelle des nordistes est particulièrement outrée. La mission n’est pas en mesure de se prononcer sur ce point ; elle constate simplement que le nouveau gouvernement constitué autour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly paraît moins représentatif des différentes régions du pays que les précédents.
• Comment élargir la base du pouvoir ?
Comment favoriser un jeu politique plus inclusif, qui permette de rassembler les principales ethnies, régions et forces politiques ivoiriennes autour de la reconstruction et du développement du pays ?
Il importe de trouver des mécanismes permettant de garantir un meilleur partage du pouvoir. Le Président Ouattara a conscience de cet enjeu qui était l’un des axes explicites de la révision constitutionnelle d’octobre dernier.
- De nouvelles institutions destinées à représenter la diversité de la nation ivoirienne
La nouvelle Constitution entérine notamment la création d’un Sénat dont la vocation est de « mieux utiliser le savoir-faire présent dans notre pays afin de faire émerger une approche commune » (Kablan Duncan), en améliorant la représentation des régions et des communes, mais aussi de fournir des positions à certaines personnalités qui ne trouvent pas leur place dans la configuration institutionnelle actuelle.
En effet, l’article 87 de la Constitution prévoit que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire. Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les anciens présidents d’Institution, les anciens Premiers ministres et les personnalités et compétences nationales, y compris des Ivoiriens de l’extérieur et des membres de l’opposition politique. »
Dans le même esprit, la Constitution formalise la création de la « Chambre des rois et chefs traditionnels » mise en place depuis octobre 2015 afin d’officialiser le rôle de ces autorités qui conservent une réelle influence au niveau local.
- Mieux asseoir le rôle du Parlement
L’Assemblée nationale ivoirienne est encore structurellement faible. Le caractère très présidentiel du régime et l’absence actuelle d’une opposition structurée font qu’elle s’apparente à une chambre d’enregistrement des décisions de l’exécutif.
L’examen du projet de nouvelle Constitution était, à cet égard, significatif. La mission se trouvait en Côte d’Ivoire à peine deux semaines avant la date prévue pour le vote de la nouvelle Constitution, et les députés – pourtant membres de la majorité – n’avaient toujours pas eu connaissance du texte. Comme mentionné plus haut, il s’est écoulé une semaine entre la date de dépôt et le vote du texte. Et cela, alors même qu’il s’agissait d’un texte comprenant 184 articles.
Ainsi, la mission n’a eu aucune peine à percevoir la frustration des députés devant la faiblesse des moyens qui leur sont donnés pour remplir leur mission d’information et de contrôle. Il serait probablement utile, sans que cela remette en question la nature du régime, d’améliorer les conditions de travail et les moyens d’expertise du Parlement.
En outre, il convient de noter que l’éligibilité de droit de tous les citoyens ivoiriens est limitée dans les faits par des contraintes socio-économiques. Lorsqu’ils sont investis par leur parti, les candidats à la députation perçoivent un subside de la part de ce dernier, mais doivent pour l’essentiel financer leur campagne eux-mêmes. Cela exclut de fait les candidats des catégories sociales les moins favorisées, parmi lesquelles de nombreuses femmes. Les élections législatives de décembre 2016 ont ainsi vu l’élection de 29 femmes pour 225 hommes.
Par ailleurs, les députés pâtissent d’un problème de perception auprès des populations. Une fois élus, ils sont considérés comme nantis. Dans un contexte de carence ou de manque de moyens des administrations locales, les populations se tournent ainsi spontanément vers eux pour obtenir le financement de projets locaux. Or, ces derniers ne disposent pas d’une réserve parlementaire à cette fin : ils ne peuvent donc que puiser dans leurs ressources propres.
Recommandation n°6 : Renforcer les liens entre les parlements français et ivoirien, notamment dans le cadre des groupes d’amitié, en faisant en sorte de favoriser les échanges entre femmes députées.
- Donner des pouvoirs spécifiques à l’opposition
Le bon fonctionnement de la démocratie ivoirienne suppose la structuration d’une opposition en mesure de peser sur la majorité et de canaliser les mécontentements.
Nous avons vu que cette structuration était largement tributaire des avancées du processus de réconciliation nationale.
Les dirigeants ivoiriens pourraient néanmoins l’appuyer en améliorant les pouvoirs de l’opposition. Cela impliquerait de lui donner un statut et des droits spécifiques, au sein du Parlement et en dehors. Un projet de loi en ce sens avait été présenté au Parlement au printemps dernier, mais l’examen de ce texte avait finalement été ajourné. Il serait sans doute utile que ces mesures puissent être mises en œuvre.
La nouvelle Constitution prévoit, à l’article 100, que « l’opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement ». Il faudra voir comment cette disposition est mise en œuvre concrètement. Cependant, ses effets seront nécessairement limités par la très faible représentation de l’opposition au sein de l’Assemblée élue en décembre.
2. Renforcer les contre-pouvoirs
S’il est important d’élargir la base du pouvoir afin que les différents groupes ethniques et régions se sentent représentés, il convient aussi de renforcer les contre-pouvoirs afin de favoriser ainsi une expression apaisée des désaccords.
Or, en Côte d’Ivoire, ces contre-pouvoirs sont assez faibles. La presse connaît des difficultés prononcées et a fortement pâti des années de crise. Quant à la société civile ivoirienne, elle est peu structurée. Ainsi, un renforcement des contre-pouvoirs serait sans doute dans l’intérêt du pays, dans un souci de stabilité durable.
• L’enjeu d’une presse indépendante et de qualité
La presse écrite ivoirienne est extrêmement foisonnante : des dizaines de quotidiens et hebdomadaires paraissent, exprimant des courants d’opinion extrêmement variés. Cependant, cette presse a beaucoup souffert de la crise ivoirienne, où elle s’est fortement politisée, la « presse bleue » devenant l’instrument de propagande du FPI de Laurent Gbagbo, face à une « presse verte » ou « orange » favorable au PDCI et au RDR.
Dans un contexte de difficultés économiques extrêmes, cette presse peine à se relever. Elle apparaît fortement inféodée aux formations politiques. En effet, la précarité dans laquelle vivent de nombreux journalistes ne favorise par leur indépendance ; les écrits contre rémunération sont ainsi une pratique courante, de même que les perdiems, qui consistent à défrayer les journalistes pour qu’ils assurent la couverture d’un événement particulier.
Les autorités ivoiriennes apportent des soutiens financiers aux journaux, conscientes de l’importance de ce secteur qui symbolise la liberté d’opinion. L’ONG Human Rights Watch critique cependant la promptitude avec laquelle le Conseil national de la presse (CNP), autorité de régulation du secteur, suspend parfois la publication de journaux critiques à l’égard du pouvoir pour des motifs que l’ONG juge insuffisants. À titre d’exemple, le CNP a suspendu le 1er décembre dernier la parution de sept journaux qui avaient, de manière répétée, fait référence à la détention par le pouvoir de « prisonniers politiques » arbitrairement détenus. Le Conseil a jugé, dans sa décision, qu’en employant ce vocable, les journaux s’étaient « adonnés à la publication de fausses informations et à une entreprise de manipulation de l’information » contraire aux règles de déontologie.
En tout état de cause, la presse écrite se trouve aujourd’hui affaiblie, ce qui réduit d’autant sa capacité à agir comme un contre-pouvoir. La télévision n’est pas davantage en mesure de jouer ce rôle : la Côte d’Ivoire ne compte pour le moment que deux chaines nationales, la RTI 1 et la RTI 2, toutes deux détenues par l’État.
D’après l’ONG Human Rights Watch, l’État ne garantit pas un égal accès à ces chaines de télévision nationales pour tous les partis politiques et pour les ONG. L’organisation a notamment dénoncé le traitement inégal des camps favorable et défavorable au projet de Constitution lors de la campagne pour le référendum constitutionnel d’octobre dernier.
• Favoriser la structuration et l’expression de la société civile : l’exemple du Ghana
La société civile est relativement peu active et structurée en Côte d’Ivoire, ce qui l’empêche de peser vraiment dans le débat national. L’organisation de la société civile est pourtant un bon moyen de susciter une expression pacifique des mécontentements. Elle est donc favorable à la démocratie et à la paix sociale.
À cet égard, la Côte d’Ivoire pourrait s’inspirer de son voisin ghanéen. Dans ce pays, la société civile est très active. Elle a joué un rôle très important dans l’avènement et la consolidation de la démocratie ghanéenne.
Le Ghana est en effet considéré comme un modèle en Afrique : il a connu plusieurs alternances pacifiques depuis 1996 et la démocratie y semble désormais bien ancrée. L’élection présidentielle de 2012, organisée après la mort du Président John Atta Mills, avait été emblématique de cet enracinement de la démocratie ghanéenne. Le candidat Nana Akufo-Addo avait en effet rejeté le résultat qui donnait John Dramani Mahama vainqueur avec 50,7% des suffrages exprimés. Il avait contesté ce chiffre devant la Cour suprême, qui avait procédé à de longues audiences des deux parties, retransmises en direct à la télévision nationale. La Cour avait finalement rectifié certaines erreurs qui ne modifiaient pas le résultat initial, et ce verdict avait été accepté par tous.
Nana Akufo-Addo a finalement pu accéder à la magistrature suprême avec l’élection présidentielle de décembre 2016, qui a marqué une nouvelle alternance pacifique dans ce pays.
Le Ghana se singularise par une culture du débat démocratique et une réelle liberté d’expression : même les sujets les plus sensibles, comme la corruption des élites, sont abordés et débattus sans tabous. Cette culture de la confrontation pacifique des idées est notamment portée par quelque 6000 organisations de la société civile – dont seules 1500 sont vraiment actives – et des think tanks de qualité, à l’image de l’institution IMANI.
La Côte d’Ivoire diffère radicalement de son voisin sur ce point. L’OCDE estime « qu’entre désintérêt et absence de contact, les Ivoiriens ne participent pas suffisamment à la vie publique de leur pays », notant qu’« en moyenne, 65% des personnes interrogées se sentent indifférentes à la vie publique, un taux nettement supérieur à la moyenne des pays africains ».
3. Réduire une corruption devenue systémique
La captation de la richesse par une élite, phénomène répandu dans les pays en développement bénéficiant d’une forte croissance, est souvent présentée comme particulièrement problématique en Côte d’Ivoire. Elle résulterait de pratiques de corruption à grande échelle.
Ces dernières sont évidemment un frein au développement du pays : elles détruisent la confiance nécessaire aux investissements et constituent une source majeure d’« évaporation » des ressources publiques. La corruption tend aussi à gangréner la démocratie et révèle les faiblesses de l’État de droit, en ce qu’elle ne peut prospérer que dans un contexte d’impunité. C’est donc bien, à ces différents égards, un chantier prioritaire pour le gouvernement ivoirien.
• Une corruption endémique
La plupart des observateurs considèrent que la corruption est un problème de grande ampleur en Côte d’Ivoire. L’ONG allemande Transparency international, qui calcule l’« indice de perception de la corruption » dans le monde, considère que les deux tiers des États ont un « secteur public perçu comme extrêmement corrompu », avec un score calculé inférieur à 50 sur 100. Si l’on se réfère à cet indice, la Côte d’Ivoire a progressé relativement puisqu’elle occupait la 136ème place en 2013 et la 108ème place (sur 176) en 2016. Son score est par ailleurs passé de 27 en 2013 à 34 en 2016.
Ce progrès enregistré par l’ONG allemande ne rejoint pas le ressenti de plusieurs interlocuteurs de la mission. Pour eux, la corruption est « endémique », « systémique », « semble se débrider », a atteint un « niveau exceptionnel », à tous les étages de la société. De quel type de corruption s’agit-il ?
C’est d’abord ce qu’on appelle la « petite corruption », celle à laquelle les Ivoiriens sont confrontés au quotidien dans leurs relations avec les administrations publiques et les différents « corps habillés ». D’après les avis recueillis sur place, cette « petite corruption » est généralisée. Elle s’explique parfois par la faiblesse des salaires, mais tient aussi aux mauvaises habitudes prises pendant la crise et à l’impunité qui a longtemps prévalu. Au quotidien, cette corruption est nuisible car elle induit une perte de confiance des Ivoiriens dans les institutions publiques et met en cause la fiabilité des agents de l’État, qu’il suffit d’acheter pour parvenir à ses fins.
Si les Ivoiriens se plaignent de cette petite corruption, ils sont plus véhéments encore à l’égard de la « grande corruption », celle de leurs élites soupçonnées de détourner massivement l’argent public pour leur enrichissement personnel. À cet égard, la politique de grands projets conduite depuis 2011 se prête particulièrement à ce genre de détournements.
La Banque mondiale relève ainsi de nombreuses déficiences dans la gestion financière de l’État (56): couverture imparfaite des comptes publics se focalisant principalement sur le gouvernement central, en laissant de côté nombre d’entreprises publiques et d’agences ; carences profondes dans le domaine des contrôles externes ; exécution budgétaire pas toujours transparente et difficile à suivre en raison du maintien de multiples comptes et de procédures de passation de marchés complexes. La Banque mondiale concède cependant que « la part des marchés utilisant des procédures de gré à gré a diminué de manière substantielle entre 2014 et 2015 ».
Le récent scandale provoqué par un rapport du cabinet Deloitte est particulièrement révélateur (57). Ce rapport daté de mai 2016 relève des dysfonctionnements majeurs dans la gestion du Conseil du coton et de l’anacarde : marchés passés de gré à gré, règlements en espèces pour des montants considérables, chèques impayés, retraits en cash injustifiés, transactions bancaires douteuses… Il suggère ainsi des détournements massifs au sein de cette filière.
La grande corruption porte sur des montants qui peuvent être considérables et constitue une source majeure d’« évaporation » de l’argent public, qui pèse sur les performances macroéconomiques du pays.
• Une action publique encore bien timide mais incontournable
La lutte contre la corruption fait partie des objectifs affichés par les autorités ivoiriennes. Cependant, force est de constater qu’au-delà des intentions, l’action publique en la matière est restée embryonnaire. Cela contraste avec le réformisme dont font preuve les autorités sur d’autres sujets.
Une Brigade de lutte contre la corruption a été créée en 2012 pour réduire la « petite corruption » des agents de l’État. Cependant, la manière la plus efficace d’éradiquer cette corruption semble être d’augmenter la dématérialisation des procédures afin de minimiser les interfaces de contact entre l’administration et les usagers. De ce point de vue, le projet « e-gouv » en cours de réalisation pourrait, s’il est mené à son terme, améliorer considérablement la relation des Ivoiriens au service public.
Pour lutter contre la « grande corruption », une Haute autorité pour la bonne gouvernance a été créée fin 2013, dotée d’une autonomie juridique et financière. Cependant, pour la plupart des interlocuteurs de la mission, cette autorité « n’a pas les coudées franches ». Elle a d’abord cherché, sans y parvenir complètement, à relever le patrimoine des responsables politiques. Sa volonté d’enquêter sur les dysfonctionnements de la filière anacarde (cf. supra) s’est finalement retournée contre elle, le secrétaire général de la Haute autorité, Yves Yao Kouamé, se trouvant accusé d’être « en affaires » avec un haut responsable du Conseil du coton et de l’anacarde.
Aussi le diagnostic de plusieurs entrepreneurs français est-il sans appel : « dès que des intérêts de haut niveau entrent en jeu, l’impunité est totale ». Certains pensent que le Président Ouattara a hérité d’un « carcan » dont il ne peut se défaire que progressivement : ceux qui l’ont aidé à accéder au pouvoir estiment à présent que « c’est leur tour de manger » et viennent « tirer les marrons du feu ».
Cette situation rejoint l’éclairage donné par Serge Michailof sur la difficile remise en question d’un système fondé sur la « distribution des rentes », qui était l’un des piliers du « compromis houphouëtiste » (58). Dans un tel système, le contrôle du pouvoir politique permet le contrôle des rentes qui assurent sa perpétuation ; il est donc très difficile de s’en extraire.
Pourtant, Serge Michailof estime que les pays qui parviennent à sortir du sous-développement sont ceux qui ont réussi à éradiquer la grande corruption. Il cite ainsi l’exemple de l’Éthiopie, parvenue à s’insérer avec succès dans les chaines de valeur de la mondialisation. La Côte d’Ivoire devra donc s’atteler à ce chantier sous peine de voir ses performances macroéconomiques s’essouffler.
C’est aussi une urgence pour restaurer la confiance des Ivoiriens dans leurs institutions et la cohésion mise à mal par le spectacle de l’enrichissement de quelques-uns.
4. Conforter l’indépendance et l’efficacité de la justice
La corruption peut prospérer à la faveur de l’impunité qui demeure répandue en Côte d’Ivoire. Cette impunité est d’abord un état d’esprit hérité des années de crise où elle avait été érigée en norme. Elle est entretenue par le manque d’indépendance et de moyens – matériels et humains – du système judiciaire.
• Accroître les moyens de la justice pour renforcer son indépendance
La crise ivoirienne a laissé se développer dans le pays un climat d’impunité qu’il est difficile d’enrayer dans un contexte où l’administration judiciaire a dû être largement reconstruite.
La justice ivoirienne dispose de faibles moyens. Son budget est actuellement de moins de 1% du PIB. D’après le ministre de la Justice, M. Sansan Kambile, que la mission a rencontré, il devrait stagner au cours des prochaines années. Au total, l’administration judiciaire compte 600 agents, retraités inclus. Ils seraient assez mal rémunérés. Au total, ces moyens sont notoirement insuffisants pour faire face à la demande, ce qui induit nécessairement la perception que la justice est lente et inefficace.
Le système judiciaire ivoirien est mixte : les affaires de droit privé et de droit public sont traitées par les mêmes institutions. En effet, au moment de l’indépendance, le pays n’aurait pas eu les moyens de faire fonctionner deux ordres de juridiction distincts. L’inconvénient de ce système est qu’il est très difficile de recruter de bons connaisseurs du droit administratif au Conseil d’État, car aucun juge de premier recours n’est spécialisé dans ce domaine.
Un défi majeur sera de conforter l’indépendance de la justice. L’enjeu est évidemment l’indépendance à l’égard du pouvoir politique, mais aussi celle vis-à-vis des parties au procès, des intérêts locaux et des familles, qui peuvent faire pression sur les juges pour obtenir un verdict à leur convenance.
Le ministre a fait preuve de volontarisme. Il a cherché à renouveler autant que possible le personnel et à promouvoir les jeunes et les femmes. C’était une façon de contourner les solides conservatismes qui bloquent l’institution.
Le chantier est considérable pour ces personnes qui doivent, avec des moyens très limités, restaurer la confiance et convaincre les populations que l’impunité n’est désormais plus la norme. Les magistrats bénéficiaient autrefois du soutien de la coopération française et effectuaient tous un stage à l’école nationale de la magistrature (ENM). Cette époque est désormais révolue mais la demande d’un plus grand soutien de l’administration judiciaire en termes de conseil et de formation reste forte.
Pour l’heure, l’appui de la France dans ce domaine repose essentiellement sur deux projets dans le cadre du contrat de désendettement (C2D), dispositif sur lequel votre rapporteure reviendra (III.A). D’une part, les écoles françaises de la magistrature, des greffes de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse envoient leurs experts former les cadres ivoiriens. D’autre part, les barreaux français soutiennent la modernisation du barreau d’Abidjan. La construction d’une cité judiciaire à Yamoussoukro et d’une école de formation aux métiers de la magistrature, financée en partie sur le C2D, contribuera également à appuyer la modernisation de la justice ivoirienne.
Recommandation n°7 : Amplifier les actions dédiées à la justice dans le cadre du C2D et accroître les échanges entre professionnels de la justice français et ivoiriens de façon à mieux partager les expériences et bonnes pratiques.
• Lutter contre l’impunité : l'exemple des violences sexuelles
Le climat d’impunité qui a longtemps prévalu en Côte d’Ivoire laisse des traces aujourd’hui.
Cette situation d’impunité est particulièrement préoccupante s’agissant des violences sexuelles. De nombreux interlocuteurs de la mission ont souligné à quel point celles-ci étaient répandues et, la plupart du temps, impunies. Ces violences sont fréquemment tournées contre des mineures, souvent même des petites filles, et elles peuvent être le fait de très jeunes garçons. Les agressions sexuelles sont fréquentes en milieu scolaire, les maîtres jouissant d’une large impunité.
L’ONUCI a publié en juillet dernier un rapport sur les violences sexuelles en Côte d’Ivoire (59) qui fait état de l’ampleur du problème. Le rapport documente 1129 cas de viols commis en Côte d’Ivoire entre 2012 et 2015, dont 66% des victimes sont des enfants. Cependant, il ne s’agit que de la partie émergée de l’iceberg car on estime que la plupart des violences sexuelles ne sont pas reportées.
D’après le sociologue Francis Akindes, « des normes sociales et culturelles forcent les communautés à contenir le viol dans la sphère privée, privilégiant les arbitrages coutumiers, aboutissant souvent à des sanctions financières, très légères. Lorsque la justice est saisie, la qualification de viol comme un acte criminel n’est pas systématique car, si la loi ivoirienne, à travers l’article 254 du code pénal, précise les peines, elle ne fournit pas de définition précise du viol, rendant aléatoire l’accès à la justice ».
Ces informations sont corroborées par le rapport de l’ONUCI : alors que 90% des cas de viol documentés ont fait l’objet d’une enquête, moins de 20% ont abouti à un jugement. Le rapport souligne par ailleurs que la totalité des cas ayant abouti à un jugement avait fait l’objet d’une requalification des faits en délit d’agression sexuelle. Il relève le recours très répandu aux règlements à l’amiable, notamment dans les cas de viols d’enfants, qui « contribue sans conteste à la banalisation du viol et au retranchement de la victime dans une position de faiblesse et de vulnérabilité ».
Les auteurs du rapport estiment enfin que la prévalence de ces crimes a sans doute été exacerbée par les années de conflit qu'a connues le pays et qui ont « favorisé une culture de violence en raison du climat général d'insécurité et ont été marquées par une impunité persistante due à l'absence de répression judiciaire systématique ».
L’urgence de restaurer la confiance dans la justice et de mettre fin à la culture de l’impunité est ici évidente. Le manque de moyens complique l’atteinte de cet objectif. Comme l’explique le rapport, les requalifications des viols s’expliquent en partie par l’accès très compliqué aux cours d’assises ; les victimes sont assurées d’avoir un jugement plus rapide si elles acceptent de passer devant un tribunal de première instance, même si la gravité de leur préjudice est alors sous-évaluée.
Le ministre de la Justice a indiqué à la mission prendre très au sérieux ce problème, qui aurait déjà fait l’objet de mesures concrètes.
• Le surpeuplement des prisons
Le système carcéral est un autre goulet d’étranglement de la justice ivoirienne. Chroniquement surpeuplé, il ne permet pas de procurer aux prisonniers des conditions de détention dignes. Au 31 mars 2014, les ONG ACAT Côte d’Ivoire et FIACAT estimaient la population carcérale à 11 000 personnes environ, pour une capacité d’accueil de 4000 places. Environ un tiers de ces 11 0000 prisonniers étaient des prévenus en attente de procès. L’ONG Human Rights Watch dénonce ainsi un recours largement abusif à la détention préventive, qui renvoie aux lenteurs de la justice.
Les conditions de détention sont particulièrement dégradées. La surpopulation entraine une promiscuité favorable au développement de maladies, telles que la tuberculose, qui serait la première cause de mortalité parmi les détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca), la plus grande des prisons du pays. La violence et les phénomènes de bandes semblent être généralisés. À cet égard, le parcours de Yacouba Coulibaly dit « Yacou le chinois » est éloquent. En outre, la corruption est fortement développée dans les établissements pénitentiaires, où « tout se monnaye ». Les trafics au sein de la Maca avaient atteint une telle ampleur en 2012 que le gouvernement a annoncé vouloir remplacer l’ensemble des gardiens par des surveillants venus d’autres prisons. Il faut dire que la profession n’est pas très attractive : les gardiens sont mal payés et en sous-effectif : un ratio d’un gardien pour quarante hommes à la Maca en 2012 était déjà considéré comme « relativement élevé ».
La corruption des gardiens ne serait pas pour rien dans le fort taux d’évasion que connaissent les prisons du pays. La plus spectaculaire avait été celle de la Maca, au plus fort de la crise ivoirienne, en mars 2011. L’ensemble des 5400 détenus en avaient profité pour s’enfuir. Depuis, la population carcérale a de nouveau dépassé les 4000 prisonniers, pour une capacité de 1500 places. Entre janvier et mars 2014, les ONG FIACAT et ACAT dénombraient 32 évasions au total.
Après un mouvement de mutinerie à la Maca qui avait fait plusieurs morts, le Gouvernement ivoirien avait annoncé fin 2014 un plan de construction de 22 prisons pour décongestionner le système pénitentiaire. Dix d’entre elles seraient en cours de construction, notamment à San Pedro.
Si la réforme du secteur de la sécurité a été conduite avec un volontarisme certain à partir de 2012, Aline Lebœuf, chercheur à l’Institut français des relations internationales (IFRI) (60), estime qu’elle a conservé un caractère assez superficiel en n’abordant pas vraiment « les sujets qui fâchent ». Ainsi, le secteur de la sécurité ivoirien resterait encore aujourd’hui « avant tout un enjeu de pouvoir et non un outil au service des populations et de la sécurité humaine ».
Les pics de violence circonscrits mais réguliers que connaît le pays – conflits communautaires, coupeurs de routes, microbes, affrontements avec les forces de l’ordre, mutineries, émeutes – viennent rappeler que la sécurité demeure fragile sur le territoire ivoirien.
Les récentes mutineries doivent absolument inciter les responsables ivoiriens à accélérer le travail de sécurisation qui a été entrepris et qui demeure, à bien des égards, inachevé.
1. L’armée a encore beaucoup de chemin à parcourir
La construction d’une véritable armée nationale dans un pays avec une faible tradition militaire, sortant d’une décennie de crise, est nécessairement un processus de longue haleine. À son arrivée au pouvoir, le président Ouattara a dû composer avec un héritage particulièrement lourd : matériel détruit, formations interrompues, et surtout scissions profondes entre ex-FDS (forces de défense et de sécurité restées sous le contrôle de Gbagbo) et ex-FAFN (Forces Nouvelles pro-Ouattara). Il devait en partie aux dernières son arrivée au pouvoir, si bien que la réforme de l’armée est vite apparue comme une question éminemment sensible.
De ce point de vue, le chemin à parcourir semble encore long. Les militaires français rencontrés par la mission confirment que cette armée ivoirienne n’est « toujours pas dans des standards corrects ». Les évènements de janvier 2017 ont montré que le problème n’était pas simplement celui des compétences, mais qu’il était structurel, et requérait une prise en main rapide, sous peine de menacer la stabilité du pays.
• Une cohésion encore très imparfaite
La fusion entre les forces armées des deux camps s’est opérée selon les termes prévus par l’accord de Ouagadougou conclu en 2007 : 8400 ex-rebelles des Forces nouvelles ont intégré l’armée nationale rebaptisée forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI). Il restait beaucoup à faire pour qu’elle devienne une véritable armée nationale.
Les 8400 ex-rebelles des Forces nouvelles ont été réintégrés dans l’armée avec des grades souvent hors de proportion avec leur niveau réel de compétences. En effet, dans l’ensemble, les combattants des Forces nouvelles étaient très peu formés. Un militaire français faisait observer à la mission que leurs chefs, les com’zones, qui occupent aujourd’hui des positions d’officiers supérieurs, étaient tous initialement des militaires du rang ou des sous-officiers.
Ainsi, de nombreux interlocuteurs ont relevé que les chefs militaires issus des FAFN avaient un niveau de formation faible. Or, la configuration créée par la victoire du camp Ouattara en 2011 a conduit à donner la préséance à ces derniers sur les officiers des FDS, pourtant souvent dotés d’un niveau de formation plus élevé.
Cette situation été outrée par la mutinerie de 2014. Celle-ci s’est traduite par un mouvement massif de promotion d’ex-rebelles comme sous-officiers, alors qu’ils n’en avaient pas le niveau, selon nos standards. Ainsi l’armée ivoirienne, au lieu d’avoir une structure pyramidale, avec beaucoup d’hommes du rang et de moins en moins d’hommes à mesure que l’on avance en grade, a la structure d’une toupie, les sous-officiers étant manifestement excédentaires par rapport aux hommes du rang.
Cette déconnection entre les compétences et les grades est à l’origine de dysfonctionnements dans la chaine de commandement. Elle suscite en outre des rancœurs et une défiance persistantes entre les forces armées issues de chaque camp. Celles-ci sont d’autant plus grandes que les anciens rebelles contrôlent largement les unités les plus opérationnelles sur lesquelles le pouvoir s’appuie en priorité, qui concentrent le gros de l’effort de formation et d’équipement.
• Une armée de com’zones ?
Le manque de cohésion et les loyautés variables des forces armées tiendraient également à l’influence persistante des anciens com’zones dans le dispositif sécuritaire ivoirien.
Dans les années qui ont suivi la crise, ces anciens chefs militaires (61) ont conservé un rôle majeur dans l’armée ; le pouvoir s’est appuyé sur eux pour conduire la sécurisation du territoire. Pour un analyste français (62), ces com’zones sont comme des « sparadraps » sur les mains du Président Ouattara : il doit les ménager car « il leur est redevable ». Ils ont indéniablement constitué une option pour maintenir la paix dans les années qui ont suivi la crise.
À l’heure actuelle, la place de ces com’zones dans le dispositif sécuritaire est débattue. Plusieurs interlocuteurs estiment que le pouvoir serait, dans un premier temps, parvenu à réduire progressivement leur influence sur les forces armées ivoiriennes en les éloignant de leur région d’origine ou en les envoyant à l’étranger.
Pourtant, force est de constater que plusieurs com’zones conservent aujourd’hui dans le dispositif sécuritaire une place centrale, qui semble avoir encore été renforcée par les récentes mutineries. En effet, plusieurs com’zones (Wattao, Vetcho, Cherif Ousmane) étaient présents au sein de la délégation chargée de négocier avec les mutins lors des émeutes de janvier 2017. Et les nominations qui s’en sont suivies leur ont donné la part belle.
Ainsi, les com’zones contrôlent actuellement les unités qui « comptent vraiment », c’est-à-dire celles qui bénéficient de la confiance du Président de la République et sont mieux formées et mieux équipées que les autres. Wattao est devenu commandant de la Garde républicaine après en avoir été le commandant-adjoint. Cherif Ousmane, jusqu’alors commandant en second du Groupement de la sécurité présidentielle, est devenu commandant du premier bataillon de commandos parachutiste (1er BCP). Morou Ouattara a pris la tête du premier bataillon de sécurisation de l’est (BSE). Losséni Fofana commande le bataillon de sécurisation de l’ouest (BSO) et Vetcho le 3ème bataillon de Bouaké. Enfin, Martin Fofié Kouakou commande en second la deuxième région militaire de Daloa.
En outre, plusieurs interlocuteurs ont rapporté à la mission que la création récente des forces spéciales avait été confiée aux com’zones, qui avaient veillé à y placer leurs hommes.
En dépit de ce rôle en apparence central, certains observateurs estiment que plusieurs com’zones sont aujourd’hui décrédibilisés. Cela tiendrait aux fausses promesses qu’ils avaient faites à leurs hommes pour entretenir leur allégeance, mais aussi à l’enrichissement ostentatoire de certains d’entre eux, grâce aux systèmes de préemption des ressources mis en place sur les territoires qu’ils contrôlaient pendant la crise. Un rapport du groupe d’experts de l’ONU (63) paru en 2015 révèle que des trafics – d’or, de diamants et de cacao – sont restés actifs depuis la fin de la crise.
• Des capacités opérationnelles encore réduites
Au total, la capacité opérationnelle des forces armées ivoiriennes reste faible. Cela tient aux dysfonctionnements structurels évoqués (déconnection entre les compétences et les grades, problèmes de loyauté) et à l’état déliquescent des équipements et des infrastructures. En particulier, la mobilité des unités est contrainte (très peu de moyens de combats, déficience criante des véhicules), même si certaines sont mieux équipées que d’autres.
Plusieurs opérations intérieures ont néanmoins été lancées. Elles visent notamment à sécuriser la zone frontalière avec le Libéria (opération Cavally III), à renforcer la surveillance sur la frontière ivoiro-malienne (opération Bordure de protection) et à prévenir la menace terroriste sur l’ensemble du territoire (opération Bouclier d’Ivoire).
En revanche, l’armée ivoirienne n’est pas déployée en dehors de ses frontières. L’idée avait été évoquée d’envoyer un voire plusieurs bataillons au sein de la MINUSMA, l’opération des Nations Unies au Mali, mais cette ambition se heurte à des insuffisances financières et de formation. Cette perspective existe toujours, bien que l’horizon soit incertain.
La marine, quant à elle, commence à être rééquipée et à revenir en mer, mais les équipements actuels (trois patrouilleurs non armés, quelques vedettes et embarcations) sont insuffisants pour répondre aux menaces. En revanche, l’armée de l’air est quasiment inexistante ; seuls les appareils de transport gouvernementaux volent de façon régulière.
• Une image dégradée
Avec la crise, les militaires – indépendamment de leur camp – ont longtemps bénéficié d’une immunité quasi-totale qui les a conduits à développer des pratiques contestables, qui perdureraient en partie aujourd’hui. Ainsi, la corruption serait fortement répandue parmi les forces armées, ce qui réduirait d’autant leur fiabilité pour maintenir la sécurité sur le territoire. De même, les militaires ont été fréquemment accusés de se livrer à des exactions contre la population.
Pour cette raison, l’armée pâtit d’une image peu reluisante auprès des Ivoiriens. Les manifestations spontanées en réponse aux mutineries de janvier 2017 ont illustré ce désamour. Les habitants de Bouaké scandaient : « Libérez Bouaké ! On a faim, on veut travailler ! ».
2. Accélérer la réforme du secteur de la sécurité
La réforme du secteur de la sécurité conditionne la stabilité de la Côte d’Ivoire au même titre que l’amélioration des conditions de vie. Les récentes mutineries ont d’ailleurs laissé entrevoir que les effets cumulatifs de l’indiscipline militaire et de l’agitation sociale pourraient être redoutables.
Au cours de son premier mandat, le Président Ouattara avait fait preuve d’un réel volontarisme pour progresser sur les questions sécuritaires. Ces efforts s’étaient notamment traduits par le vote d’une loi de programmation militaire ambitieuse (cf. première partie).
Il convenait d’assurer le suivi et le financement des réformes envisagées dans la durée. Or, certains observateurs ont perçu un changement de cap des autorités ivoiriennes, en particulier depuis l’élection présidentielle de 2015. L’accent serait désormais mis sur les problématiques économiques au détriment des questions de sécurité ; l’attentat de Grand Bassam, en mars 2016, n’aurait pas réellement remis en question ce relatif désinvestissement.
La prise de conscience du danger que représente l’instabilité des forces armées doit conduire les autorités ivoiriennes à redoubler d’efforts pour donner du contenu aux réformes impulsées.
• Donner un nouvel élan à la réforme de l’armée
S’agissant de l’armée, les autorités doivent ainsi veiller à mettre en œuvre la loi de programmation militaire en assurant un financement suffisant. De ce point de vue, il faudra voir comment combler le « trou » créé par les indemnisations consenties suite à la mutinerie de janvier. Il s’agit de réduire les effectifs, de les payer pour éviter l’instabilité et de les occuper avec des missions claires et limitées de nature militaire (opérations de maintien de la paix, sécurisation des frontières), le maintien de l’ordre revenant exclusivement aux forces de sécurité.
L’accent doit être mis sur l’amélioration de la formation des hommes. À l’heure actuelle, l’éparpillement des formations entre la France, le Maroc, la Chine et les États-Unis ne semble pas propice à la cohésion de l’armée et génère beaucoup d’incohérence. Si l’apport de pays extérieurs peut être bénéfique, la Côte d’Ivoire gagnerait par ailleurs à puiser dans ses propres ressources et investir dans les formations sur son propre territoire : créer davantage d’écoles spécialisées, donner plus de moyens à l’EFA (École des forces armées) et faire avancer l’AMAA (Académie des métiers de l’air d’Abidjan).
• Améliorer la coordination entre les différents « piliers sécuritaires »
La première étape de la réforme du secteur de la sécurité consiste à restructurer chaque pilier des forces armées et de sécurité : réorganisation, rééquipement, relance de la formation. Nous avons vu les obstacles auxquels se heurtait cette restructuration s’agissant du pilier militaire.
Quant aux autres piliers, la police et la gendarmerie, ils ont également fait l’objet d’une restructuration dont les modalités ont varié en fonction de degré de confiance qu’inspiraient ces forces.
Au fil du temps, leurs formations ont repris et les infrastructures ont été réhabilitées, surtout à Abidjan. Mais leur réarmement a été particulièrement lent ; les autorités ivoiriennes ont invoqué l’embargo sur les armes imposé par l’ONU (et levé en 2016) à l’appui de ces délais.
Une forte hétérogénéité persiste néanmoins, au sein des différents piliers sécuritaires, entre les unités qui bénéficient de la confiance des autorités et les autres. Ces disparités entretiennent une atmosphère de défiance entre ces forces et nuisent à la consolidation d’ensemble du dispositif sécuritaire.
• Dépolitiser les forces
À terme, il sera nécessaire de parvenir à dépolitiser les forces de sécurité. À cet égard, sans doute le temps et le renouvellement des hommes seront-ils une partie de la solution au problème. Aline Lebœuf reconnaît d’ailleurs que le temps sera sans doute un facteur important « pour pousser au changement sans brusquer et bloquer un système imparfait qui assure pour l’instant sa mission au profit du pouvoir, à défaut de servir la sécurité des populations, la sécurité humaine, contrairement aux annonces de la RSS ».
Il faudra toutefois une pression internationale constante pour faire avancer le processus de réforme du secteur de la sécurité en appui aux acteurs ivoiriens. À cet égard, l’influence française peut jouer un rôle important. Votre rapporteure aura l’occasion de revenir sur cette question.
3. Prévenir l’implantation de la menace terroriste en Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, la menace terroriste n’a pas l’acuité qu’on lui connaît dans certains pays du Sahel et d’Afrique du nord. Cela ne signifie pas que cette menace n’existe pas : l’attentat perpétré à Grand Bassam en mars dernier est venu le rappeler.
• Une menace terroriste pour le moment extérieure
Pour le ministre de l’Intérieur Hamed Bakayoko comme pour la direction du renseignement militaire (DRM), le terrorisme est, pour le moment, essentiellement une menace d’origine externe en Côte d’Ivoire.
Cette menace provient de la présence importante d’intérêts européens, en particulier français, sur le territoire ivoirien. Ainsi, en mars dernier, la station balnéaire de Grand Bassam a ouvertement été ciblée par les terroristes d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) en raison de sa fréquentation régulière par des expatriés français. Quatre victimes sur les 19 qui y ont laissé la vie sont d’ailleurs de nationalité française. La revendication de l’organisation terroriste était explicite sur ce point : la Côte d’Ivoire était visée parce qu’elle était l’alliée de la France dans le cadre des opérations militaires conduites dans le Sahel, pour lesquelles le camp des forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) constitue une « base opérationnelle avancée ».
D’après les informations recueillies lors de l’enquête, aucun des terroristes impliqués dans cet attentat n’était ivoirien. L’un d’eux était malien et avait déjà été arrêté par les soldats français de Barkhane avant d’être relâché par les autorités maliennes. Deux autres étaient des Peuls. Les autorités ivoiriennes n’auraient pas identifié de cellules dormantes sur le territoire national.
Cette menace externe provient aussi de la frontière nord du pays, fortement poreuse. D’après la DRM, les terroristes qui sévissent au Mali cherchent à desserrer l’étau de Barkhane qui les empêche de se déployer dans le nord du pays. Ils ont ainsi adapté leurs modes d’action et se sont déplacés vers le sud du pays où ils se fondent plus aisément dans les populations et conduisent désormais des attaques ponctuelles. En juin 2015, des actions terroristes ont ainsi été conduites à proximité de la frontière ivoirienne : le 10 juin, la ville malienne de Misséni faisait l’objet d’une attaque armée, et le 28 juin, des terroristes prenaient le contrôle d’une partie de la ville de Fakola pendant quelques heures.
Ces attaques concrétisaient la naissance de la katiba Halid Ibn Walid, dont le chef, Souleymane Keita, a été arrêté. Ce groupe, qui ne comptait qu’une trentaine de membres, aurait été démantelé depuis. Au total, ce genre d’attaques ne représenterait pas une menace majeure pour la Côte d’Ivoire.
• Cependant, des prémices de radicalisation
Dans quelle mesure existe-t-il une menace interne de radicalisation en Côte d’Ivoire ? Cette question est difficile à apprécier en l’absence de statistiques précises sur le poids de l’islam d’influence wahhabite, sur les éventuels départs de « combattants étrangers », etc.
Certaines sources confirment que la Côte d’Ivoire est aussi victime de la radicalisation des sociétés à l’œuvre en Afrique de l’ouest, même si ce n’est pas à la même échelle que le Nigéria ou le Sénégal. De plus en plus d’ONG fleurissent dans le pays, dont personne ne sait vraiment quels sont les donneurs d’ordre. De nombreuses mosquées ont été construites, financées par des pays du Golfe.
Christian Bouquet rend compte (64) d’une étude conduite en 2000 sur les medersas dans le nord de la Côte d’Ivoire, qui montrait qu’elles scolarisaient alors déjà une proportion d’enfants beaucoup plus importante qu’on ne le pensait. Au total, dans la circonscription de Korhogo et dans le département d’Odienné, on recensait 306 écoles coraniques avec des maîtres venus du Mali ou du Nigéria et 109 medersas avec des cours plus structurés et des enseignants originaires d’Égypte, d’Iran ou d’Arabie saoudite. Au total, ces écoles scolarisaient des effectifs équivalents à 20% de ceux de l’enseignement public. Il y a tout lieu de penser que le phénomène s’est accentué aujourd’hui. C’est cependant difficile à apprécier en l’absence de renseignements précis à ce sujet.
Dans l’ensemble, les interlocuteurs ivoiriens considèrent que l’islam traditionnel domine en Côte d’Ivoire. Lors de ses déplacements, la mission n’a pas constaté que les femmes fussent massivement voilées comme elles peuvent l’être au Niger. Plusieurs observateurs disent cependant observer des prémices de radicalisation religieuse.
Il est certain que la situation de la jeunesse – en mal de perspectives et familiarisée avec la violence – est une source de vulnérabilité importante pour la Côte d’Ivoire, dans la mesure où les jeunes en déshérence constituent un vivier potentiel de radicalisation pour le pays. Le pays doit garder en mémoire l’exemple du Niger : les jeunes Nigériens qui se sont engagés dans Boko Haram l’ont fait parce que c’était leur « meilleure option » : on leur proposait une moto, de l’argent et une raison de se battre.
• Prévenir l’implantation de filières locales, une nécessité absolue
Les autorités ivoiriennes considèrent ainsi très sérieusement la nécessité de se prémunir contre l’émergence d’une menace terroriste interne qui se traduirait par l’implantation de filières locales.
La Côte d’Ivoire doit développer son renseignement afin d’avoir une meilleure vision des éventuelles dynamiques de radicalisation sur son territoire. Cependant, le chemin à parcourir est encore long. À l’heure actuelle, les autorités ivoiriennes cherchent déjà à identifier leur population au moyen de fichiers numériques et n’en seraient encore qu’à la moitié de ce chantier. À cet égard, peut-être les crédits dont bénéficiera la Côte d’Ivoire au titre du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pourraient-ils être mobilisés en appui aux efforts du Gouvernement ivoirien.
La France appuie en outre la Côte d’Ivoire dans la structuration d’une chaine de renseignement. D’ores et déjà, une Coordination nationale du renseignement a été mise sur pied afin de centraliser et de partager le renseignement au niveau interministériel.
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a pris conscience, avec l’attentat de Grand Bassam, de la nécessité d’améliorer la coopération avec ses voisins. Les échanges entre services de renseignement de la région ont ainsi été nettement renforcés et la Côte d’Ivoire cherche à améliorer la surveillance de ses frontières. Pour ces différents aspects, la coopération avec la France joue un rôle central sur lequel votre rapporteure reviendra.
En tout état de cause, la première urgence est celle du développement, qui doit permettre de donner des perspectives à la jeunesse et favoriser son intégration. Il convient également de promouvoir un islam tolérant pour contrecarrer l’influence de l’islam du Golfe. Les Ivoiriens l’ont compris. C’est pourquoi, ils misent notamment sur le partenariat qu’ils ont noué avec le Maroc, visant à former 200 imams au sein de l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams, qui promeut un islam traditionnel et tolérant.
Recommandation n°8 : Orienter une partie des crédits du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne en appui aux efforts du gouvernement ivoirien pour sécuriser l’état civil.
E. RÉSOUDRE LA QUESTION FONCIÈRE
La question foncière était en toile de fond de la crise ivoirienne. Elle n’a pas été traitée depuis et demeure une véritable pomme de discorde pour les Ivoiriens et une entrave au développement du pays.
Votre rapporteure se concentrera sur la présentation de la question foncière en zone forestière (ouest – sud-ouest) car c’est celle qui pose les problèmes les plus graves. Cependant, on observe aussi des conflits fonciers dans les autres régions, en particulier dans le nord et le nord-est de la Côte d’Ivoire, où les difficultés portent davantage sur les droits d’usage de la terre, notamment entre agriculteurs et éleveurs.
La problématique du foncier rural ivoirien a, de longue date, été un enjeu politique dans le contexte de la mise en valeur du territoire ivoirien par une économie de plantation.
Pour bien comprendre les ressorts de cette question foncière, il faut se souvenir que la Côte d’Ivoire, comme le reste de l’Afrique, vivait par le passé – et, dans une certaine mesure, encore aujourd’hui – dans le collectivisme agraire : la terre était la propriété collective d’une communauté, et sur cette terre se superposaient plusieurs droits d’usage pour l’élevage et l’agriculture.
En Côte d’Ivoire, les transactions sur la terre se sont fortement développées à partir des années 1920-1930, quand le colonisateur a fait le choix d’approfondir la spécialisation du pays sur l’exportation de café et de cacao. Dès lors a émergé un compromis fondateur qui sera institutionnalisé par le Président Houphouët-Boigny après l’indépendance : l’accès à la terre est facilité pour ceux qui la mettent en valeur. Pour ce faire, l’État va ouvrir les frontières à une abondante main d’œuvre étrangère, malienne et surtout burkinabè, et imposer des transactions sur les terres du front cacaoyer entre les populations autochtones, propriétaires des terres, et les migrants – allochtones (d’une autre région de la Côte d’Ivoire) ou allogènes (d’un autre pays) – chargés de la mettre en valeur.
Ces transactions ont pu s’apparenter à des ventes sans pourtant s’y rattacher complètement. En effet, comme le montrent bien les chercheurs Jean-Pierre Chauveau et Jean-Philippe Colin (65), spécialistes de cette thématique, ces « ventes » aux normes locales comportaient des clauses sociales qui régissaient l’insertion des étrangers dans la communauté et impliquaient en particulier un « devoir de reconnaissance » vis-à-vis du propriétaire et de sa communauté, qui pouvait se matérialiser sous la forme de cadeaux et d’aides financières. Dès lors, la vente n’était jamais complète dans la mesure où elle pouvait toujours être contestée au prétexte que l’étranger n’honorait pas son devoir de reconnaissance.
L’État d’Houphouët-Boigny avait réussi à imposer ce compromis aux populations autochtones de l’ouest ivoirien moyennant une politique de redistribution favorisée par la croissance économique : investissements publics, avantages catégoriels, politiques sociales… Or cet édifice s’est effondré avec le retournement de la conjoncture dans les années 1980-1990, qui a mis un coup d’arrêt à la politique de redistribution et a entraîné une dérive ethno-nationaliste qui allait se cristalliser autour du thème de l’« ivoirité » et du rejet des étrangers.
C’est alors que fut votée la loi de 1998 sur le foncier rural. Celle-ci est à resituer dans le contexte plus général des pressions exercées par la Banque mondiale sur les pays d’Afrique afin qu’ils adoptent des réformes foncières pour sécuriser les terres. Il s’agissait en fait de substituer à la propriété collective la propriété privée de terres, notion qui était totalement étrangère aux pratiques locales, qui impliquaient en fait un partage de la propriété.
La loi foncière de 1998 imposait ainsi le titrage systématique des droits coutumiers en droits de propriété privée. Cependant, à rebours de la tradition ivoirienne, la loi réservait la propriété foncière rurale aux seuls nationaux ivoiriens. Elle prévoyait une période de dix ans pendant laquelle tous ceux qui estimaient avoir des droits fonciers à faire valoir devaient obtenir un certificat foncier. À défaut, il était prévu que les terres basculeraient dans le domaine de l’État. Trois ans après leur établissement, les certificats fonciers devaient être convertis en titres de propriété pour les autochtones, ou, à la rigueur, pour les allochtones (Ivoiriens d’une autre région) à condition que les populations autochtones y consentent, et en baux emphytéotiques pour les étrangers expressément exclus de la propriété.
Dans la mesure où cette loi conduisait à réserver l’exclusivité de la propriété à un seul propriétaire, et a priori pas celui qui l’avait mise en valeur et la « possédait » parfois depuis plusieurs décennies, son application s’est immédiatement révélée très conflictuelle. Cependant, chaque catégorie a voulu y voir la concrétisation de ses attentes : pour les migrants, la reconnaissance de leurs droits acquis sur la terre ; pour les populations autochtones, la confirmation de la primauté de leur droit d’autochtonie. L’établissement des certificats fonciers s’avérait en outre complexe et coûteux, de sorte que seuls 20.000 hectares étaient immatriculés en 2013, soit 0,09% de la totalité des terres à enregistrer évaluée à 23 millions d’hectares.
2. Question foncière et identité, un ressort profond de la crise ivoirienne
En excluant les non-nationaux de la propriété foncière, la loi de 1998 faisait de la reconnaissance de la qualité de citoyen ivoirien un enjeu considérable.
Par le passé, la citoyenneté ivoirienne avait été conçue de manière très ouverte. Le droit du sol était en application avant la réforme du code de la nationalité, en 1972. Les présidents ivoirien Houphouët-Boigny et burkinabè Maurice Yameogo avaient même imaginé de doter leurs citoyens d’une nationalité commune, projet qui avait finalement été rejeté. De nombreux enfants de planteurs étrangers nés en Côte d’Ivoire entre 1961 et 1972 avaient de droit la nationalité ivoirienne mais avaient négligé de la faire reconnaître dans les temps.
On comprend mieux, dans ce contexte, que l’ancien Président Laurent Gbagbo, qui se faisait le défenseur des populations autochtones, ait repris à son compte la thèse de l’ivoirité, qui permettait de contester les droits des migrants sur les plantations qu’ils avaient mises en valeur à l’ouest.
C’est ainsi que la crise ivoirienne s’est traduite, dans les campagnes, par la création de « groupes d’autodéfense rurale » composés de jeunes autochtones qui stigmatisaient les étrangers accusés de s’accaparer les terres et parfois les leur « arrachaient ». Cependant, passée la phase initiale d’affrontement des belligérants, la majorité des migrants sont revenus ou restés sur leurs plantations, et les transactions sur les terres se sont poursuivies en dehors du cadre légal posé par la loi de 1998 (66).
La phase finale de la crise ivoirienne qui a vu la conquête du pays par les Forces nouvelles soutenant Alassane Ouattara a, en revanche, provoqué une brutale inversion du rapport de forces dans l’ouest. D’après Jean-Pierre Chauveau, l’ouest a connu « un afflux de nouveaux migrants étrangers, burkinabés en majorité, vers les zones abandonnées par les autochtones » qui ont fui vers le Libéria. Ils ont « trouvé une offre de terres vacantes auprès de certains autochtones, notamment des jeunes, en grandes difficultés, prêts à céder les terres de villageois ou de parents réfugiés, ou rendus conciliants par la pression menaçante de la présence armée des partisans du nouveau pouvoir », tandis que les migrants étaient « moins enclins à s’assurer de l’authenticité des cédants, se sentant davantage protégés par le nouveau rapport des forces ».
3. Une question brûlante aujourd’hui
La fin de la crise ivoirienne n’a donc en rien réglé la question foncière. Bien que le sujet soit rarement évoqué par les médias, les tensions intercommunautaires suscitées par les enjeux fonciers sont croissantes, en particulier dans l’ouest du pays.
L’application stricte de la loi de 1998 paraît inenvisageable en l’état, car elle conduirait à exclure tous les étrangers de la propriété, alors que ceux-ci représentent, dans la zone forestière, entre 26 et 45% des exploitants selon les régions. Quel droit sur la terre, de l’exploitant ou de l’autochtone, doit prévaloir pour l’immatriculation des terres ? Pour Christian Bouquet, « trancher cette question, c’est remettre la guerre civile à l’ordre du jour ».
Aussi les autorités ivoiriennes ont eu une attitude prudente sur le sujet. Le Président Ouattara a d’abord affirmé son intention de prendre le problème à bras le corps, laissant entendre qu’il pourrait faire évoluer la loi foncière de 1998 :
« Il faut avoir le courage de s’attaquer enfin au problème du foncier rural, ce que personne n’a fait jusqu’alors. Je vais le régler, d’autant que je dispose d’une majorité solide à l’Assemblée (…). Nous devons inventer quelque chose de nouveau sur le droit de propriété. » (67).
Néanmoins, à ce jour, le Président s’est limité à reconduire le délai de dix ans prévu par la loi de 1998 pour faire reconnaître les droits coutumiers sur les terres avant qu’elles ne tombent dans le domaine de l’État. Ce délai court à présent jusqu’en 2023. Il faut toutefois noter que la loi votée en 2013 sur la nationalité, qui permet aux étrangers arrivés en Côte d’Ivoire avant l’indépendance ou nés en Côte d’Ivoire avant 1972 de faire reconnaitre leur nationalité, devait permettre à bon nombre de planteurs – certaines estimations évoquaient le chiffre de 300.000 – d’accéder à la nationalité ivoirienne et donc à la propriété privée.
Cependant, la loi sur la nationalité aura pour effet d’accroître le nombre de prétendants à la propriété foncière rurale. Elle ne peut donc qu’aviver les tensions suscitées par la mise en œuvre de la loi de 1998.
Jean-Pierre Chauveau et Jean-Philippe Colin considèrent ainsi (68) qu’il convient d’imaginer des solutions pour appuyer les demandes locales de sécurisation foncière sans nécessairement respecter la lettre de la loi. Il s’agirait d’inciter les acteurs – migrants et autochtones – à expliciter les clauses qui les lient et d’enregistrer au niveau administratif local ces engagements, en s’en tenant dans un premier temps à cette phase de pré-certification qui aura déjà le mérite de clarifier les situations. Il faudrait pour cela réduire le coût de l’obtention d’un certificat foncier, qui s’avère prohibitif pour la plupart des paysans. Au total, pour les chercheurs, « la Côte d’ivoire s’est dotée d’une loi foncière qui pose le cadre légal et les objectifs à atteindre dans un horizon qui ne peut être que lointain. Investir massivement dans l’atteinte de cet objectif [passage à la propriété privée intégrale des terres] serait totalement irréaliste et « suicidaire » (69).
III. LA FRANCE EN CÔTE D’IVOIRE : UNE RELATION FORTE MAIS SANS EXCLUSIVE
La mission a été marquée, tout au long de ses travaux, par la profondeur des liens entre la France et la Côte d’Ivoire. Ces liens sont d’ordre politique, économique, militaire, mais ce sont aussi – et peut-être avant tout – des affinités particulières entre les populations et les cultures.
Comment adapter et donner un nouveau sens à cette relation dans le contexte de mondialisation que nous connaissons, où la « France-Afrique » chère à Houphouët-Boigny n’a plus sa place ? C’est un défi que la France et la Côte d’Ivoire doivent aujourd’hui conjointement relever.
A. UNE RELATION BILATÉRALE PARTICULIÈREMENT DENSE
1. Des liens historiques, culturels et humains solides
• Une relation d’amitié qui a transcendé le carcan de la colonisation
Le père de l’indépendance ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny – « le Vieux », comme l’appelaient affectueusement les Ivoiriens – n’a jamais promu la rupture avec l’ancienne métropole. Au contraire, il a été l’artisan d’une amitié solide, qui perdure encore aujourd’hui, entre nos deux pays.
Chef traditionnel baoulé, Houphouët-Boigny se forma au sein des écoles établies par la France pour l’élite francophone africaine. Il devint un militant de la première heure en faveur de l’égalité des droits entre planteurs indigènes et colons au sein du Syndicat agricole africain (SAA) fondé en 1944, qui demandait de meilleures conditions de travail, une hausse des salaires et l’abolition du travail forcé.
Élu député de la Côte d’Ivoire au sein de l’Assemblée nationale française, en 1946, il obtint d’ailleurs cette abolition par le vote d’une loi qui porterait son nom. Il milita alors en faveur de l’Union française, ce projet qui prévoyait d’ériger les colonies en départements et territoires français. Son argumentation lors de la discussion générale sur ce projet d’union était particulièrement explicite sur le type de relations qu’il souhaitait mettre en œuvre avec la métropole :
« Quand nous vous demandons de briser l'oppression politique et économique dont nous sommes souvent victimes, nous ne vous demandons pas de nous libérer de la France, mais d'une infime minorité de Français, hélas ! combien puissants, qui oublient trop souvent dans notre territoire qu'ils sont les descendants des révolutionnaires sublimes de 1789 et 1848 (...). La France n'a aucun intérêt à nous laisser attendre encore dans les bras de la misère et de l'ignorance. » En conséquence, « il ne faut pas qu'il y ait deux politiques, une métropolitaine démocratique et une coloniale réactionnaire. »
Ainsi, comme l’explique Frédéric Grah-Mel, professeur à l’école normale d’Abidjan et auteur d’une biographie de Houphouët-Boigny (70), ce dernier « n’a jamais été un adversaire de la colonisation française. À aucun moment, il n’a douté des bienfaits de la rencontre entre l’Afrique et la France. D’ailleurs, si les choses n’avaient tenu qu’à lui seul, la colonisation aurait encore duré longtemps au-delà de 1960, l’année des indépendances. À cette date, c’est d’ailleurs un ministre d’État français et non un simple ressortissant ivoirien qui accède au pouvoir en Côte d’Ivoire. Il n’avait donc ni à manœuvrer ni à gérer une quelconque influence. Il a travaillé avec la France, la main dans la main et en toute confiance, exactement comme si un ressortissant français avait été affecté à Abidjan pour diriger la Côte d’Ivoire. Il estimait en effet que plus longtemps la colonisation durerait, mieux le pays qui serait cédé plus tard aux autochtones serait construit, et mieux ses enfants seraient préparés à assumer la relève » (71).
Ainsi, Houphouët-Boigny estimait que l’indépendance politique ne valait rien sans une indépendance économique. Il appela donc toujours de ses vœux la « France-Afrique », conçue comme le maintien de liens denses et multiformes dans l’intérêt mutuel des deux parties. Au cours des décennies qui suivirent l’indépendance ivoirienne, proclamée en 1960, les militaires et coopérants français furent nombreux à peupler les administrations ivoiriennes, tutelle organisée à la demande du Président ivoirien. Par ailleurs, des générations de fonctionnaires et de militaires ivoiriens furent envoyées se former dans les écoles et universités françaises. Ces échanges tissèrent des liens étroits entre les élites politiques, économiques, administratives et militaires des deux pays.
Les turbulences des années 1990 et 2000 portèrent un coup à ce modèle de partenariat qui paraissait de toute façon condamné à évoluer. Comme l’évoque Serge Michailof, « parmi les sujets d’étonnement de tout visiteur en Côte d’Ivoire à cette époque, la place excessive voire totalement déraisonnable occupée par des assistants techniques français, des petits entrepreneurs français, des ouvriers spécialisés français était finalement source de profond malaise. Participant au début des années 1980 en tant que représentant de l’AFD à la négociation d’un cofinancement avec la Banque mondiale à Washington, je me trouvais face à une délégation ivoirienne exclusivement composée de coopérants français (…) à l’exception d’un chef de délégation qui n’assista qu’à l’ouverture (…) ».
Au contraire, l’anticolonialisme était l’un des chevaux de bataille du FPI de Laurent Gbagbo, arrivé au pouvoir en 2000. Dans le contexte des tragiques évènements de la crise ivoirienne, alors que l’armée française se trouvait prise entre deux feux, cet anticolonialisme se convertit en sentiment anti-français qui culmina en 2004, lorsque des émeutes anti-françaises furent déclenchées, qui conduisirent au rapatriement d’urgence de 8000 de nos compatriotes.
La crise ivoirienne a incontestablement marqué une rupture historique dans les relations entre la France et la Côte d’Ivoire. Antoine Glaser, très critique à l’égard de la politique africaine de la France, estime que « la crise en Côte d'Ivoire est à la présence française en Afrique ce que la prise de la Bastille fut à l'Ancien Régime : le symbole de la fin » (72). Plus que la fin, cette crise a sans doute représenté un tournant qui avait en réalité déjà été amorcé avec le déclin de la coopération, dans les années 1990.
Cependant, une relation très forte perdure encore entre la France et la Côte d’Ivoire. Elle tient aux relations interpersonnelles denses qui se sont tissées entre les élites ivoiriennes et africaines, formées sur les mêmes bancs pendant des décennies. Ainsi, comme le formule très bien le rapport des sénateurs Jeanny Lorgeoux et Jean-Marie Bockel (73), « si la France a réussi, pendant plus de trente ans, à conserver un lien fort avec le continent, ce n’est pas seulement grâce à des alliances politiques et aux réseaux d’individus qui s’étaient établis au plus haut niveau de l’État » et qui ont pu incarner la face sombre de cette « françafrique » souvent décriée. « C’est aussi et surtout par la vertu des relations sociales qui, à tous les niveaux, établissaient des ponts de communication entre Français et Africains ». Ainsi, d’après Richard Banégas, cité par le rapport des sénateurs, « pour le meilleur et pour le pire, ce sont des réseaux d’amitié ou de simple connaissance, tissés sur les bancs de l’université, de l’école de guerre ou du militantisme syndical des années 1960-1970, qui ont nourri la croyance en un destin commun et des valeurs communes ».
• Des diasporas nombreuses
La pérennité des liens entre la France et la Côte d’Ivoire repose sur des échanges humains denses favorisés par l’existence de diasporas importantes.
En réalité, le terme « diaspora » peut ne pas rendre parfaitement compte de la qualité de ces échanges car il est en partie subjectif. En effet, une diaspora s’apprécie en théorie par la conscience d’une identité ethnique ou nationale différente de celle du pays d’accueil, l’appartenance à un groupe plus ou moins structuré et le maintien de contacts avec le pays d’origine. Cette définition est intéressante car elle souligne la diversité potentielle des personnes que l’on considère comme faisant partie d’une diaspora. Pour Serge Michailof, ce qui distingue une diaspora, c’est qu’elle n’est pas assimilée à la culture du pays d’accueil (74).
S’agissant des échanges humains entre la France et la Côte d’Ivoire, les diasporas évoquées renvoient en fait aux résidants ivoiriens détenant la nationalité française et aux résidants français dotés de la nationalité ivoirienne. Le constat qui domine est celui d’un important mixage, la plus grande partie des communautés considérées étant dotée de la double nationalité franco-ivoirienne.
- Les Français de Côte d’Ivoire
Les Français de Côte d’Ivoire sont actuellement environ 25.000 au total. De 30.000 avant la crise, leur nombre avait chuté à 15.000 pendant les années 2000. Un article de Jeune Afrique paru en 2008 (75) soulignait à quel point les Français d’Afrique, et parmi eux, les Français de Côte d’Ivoire, avaient changé. Dans les décennies qui ont suivi l’indépendance, les Français d’Afrique étaient majoritairement des expatriés – notamment des coopérants – qui vivaient entre eux, dans des conditions très confortables.
Or, à l’heure actuelle, si les expatriés du privé et les agents publics des ambassades et de leurs démembrements forment les bataillons les plus visibles de la communauté française, ils sont devenus minoritaires face aux double-nationaux. Une majorité d’entre eux est noire : ce sont des Ivoiriens qui ont obtenu la nationalité française par naturalisation après avoir longtemps séjourné en France ou après un mariage mixte, ou leur descendance. Il convient aussi de noter qu’une partie des double-nationaux français en Côte d’Ivoire est franco-libanaise, les deux communautés ayant fait l’objet d’un mixage assez important.
Cette donnée des double-nationaux est intéressante car elle donne une idée du potentiel que recèle cette population qui partage la nationalité et la culture des deux pays, loin des clichés des diasporas vivant repliées sur elles-mêmes, sans interaction avec la population du pays d’accueil. Pour les journalistes de Jeune Afrique, « à condition que la France officielle sache la saisir, c’est une vraie chance pour refonder sa relation avec le continent ».
- Les Ivoiriens de France
Historiquement, la Côte d’Ivoire n’a pas connu les grandes vagues d’émigration enregistrées par les pays sahéliens ou les autres pays d’Afrique de l’ouest après les indépendances. Le rôle moteur de la Côte d’Ivoire au niveau régional a en effet induit une dynamique migratoire très différente de celle observée dans les pays voisins. Ainsi, jusqu’à la crise économique des années 1990, les immigrés ivoiriens étaient peu nombreux.
D’après l’ambassade de Côte d’Ivoire, on peut distinguer quatre principales vagues de constitution de la diaspora ivoirienne en France. Avant 1960 sont arrivés les premiers étudiants ivoiriens ainsi qu’une première élite politique. Puis, entre 1960 et 1980, les premiers cadres de la fonction publique et des secteurs parapublics y sont venus pour être formés en prévision de l’« ivoirisation » des administrations publiques et privées. À partir des années 1980-1990, en raison des conséquences financières et sociales et de la crise économique ivoirienne, la Côte d’Ivoire a connu ses premières vagues de migrations économiques vers la France. Enfin, de l’avènement du multipartisme jusqu’à la crise post-électorale de 2010-2011, les troubles politico-militaires qu’a connus la Côte d’Ivoire ont suscité un grand nombre de réfugiés et de victimes de guerre qui ont trouvé asile à l’étranger, particulièrement en France.
Actuellement, cette diaspora reste assez mal évaluée et connue. D’après l’ambassadeur de Côte d’Ivoire, elle serait en cours de recensement. Selon l’OCDE (76), environ 150.000 Ivoiriens auraient émigré dans les pays de l’OCDE, auxquels il faut adjoindre 40.000 enfants de nationalité ivoirienne nés dans ces pays. 60% d’entre eux résideraient en France, soit un total d’environ 115.000 Ivoiriens. Cependant, la direction générale des Ivoiriens de l’extérieur (DGIE) estimait la diaspora ivoirienne à 1,2 millions de personnes au total, dont 60% étaient établies en France, soit 700.000 personnes environ. Cette définition inclut en fait les descendants des migrants de première génération qui détiennent uniquement la nationalité française.
D’après les informations fournies par l’OCDE, la diaspora ivoirienne est plutôt qualifiée puisque 30% des émigrants sont diplômés du supérieur. Par ailleurs, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes, contrairement à la situation observée pour la population immigrée de la plupart des autres pays africains.
• La Côte d’Ivoire, un pays très francophone
Le français est la seule langue officielle de Côte d’Ivoire. Le rapport mondial de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) (77) se fonde sur les statistiques des Ivoiriens scolarisés et alphabétisés pour déterminer le pourcentage de francophones dans le pays. Cela la conduit – à son propre aveu – à sous-estimer largement la prévalence de la francophonie en Côte d’Ivoire, évaluée à 34% en 2014, en baisse, en raison des effets de la crise politico-militaire sur l’éducation publique. Ce pourcentage devrait remonter en puissance avec les efforts entrepris au cours des dernières années pour généraliser l’accès à l’éducation et pour alphabétiser les adultes, en particulier les femmes.
L’OIF reconnaît cependant qu’il existe une « exception ivoirienne » en Afrique qui se caractérise par une maîtrise orale de la langue française au-delà du cercle des populations scolarisées et alphabétisées. Au total, selon la direction du renseignement militaire (DRM), on compterait en réalité 70% de locuteurs francophones dans le pays et jusqu’à 99% dans la région d’Abidjan.
Ainsi, le français n’est pas seulement la langue des affaires, de l’enseignement et de l’administration, c’est aussi une langue d’usage. La mission a pu constater qu’à Abidjan, les Ivoiriens parlaient français entre eux. La langue nationale n’a pas toujours ce degré d’appropriation en Afrique. Par exemple, la mission a relevé qu’à Accra, les Ghanéens n’échangeaient pas entre eux en anglais mais en langue locale. De même, les Sénégalais privilégient plutôt l’usage du wolof à Dakar et les Maliens celui du bambara à Bamako.
Le rapport mondial de l’Organisation internationale de la francophonie pour l’année 2014 illustre de manière détaillée comment le français a cessé d’être une langue étrangère et fait l’objet d’une véritable appropriation en Côte d’Ivoire. À côté du français académique enseigné dans les écoles, s’est développé un français informel dont les lieux privilégiés d’apprentissage sont la rue, la famille et les rencontres entre amis. Ce phénomène est particulièrement prégnant en milieu urbain. Il se traduit par l’émergence de variations locales du français, à l’image du « français ivoirien » – fortement influencé par la morphosyntaxe et les modes d’énonciation et de conceptualisation des langues locales ivoiriennes – et, de plus en plus, du « nouchi », le parler des jeunes. Le « nouchi » se caractérise par des emprunts à d’autres langues ivoiriennes, africaines et européennes et par de nombreux néologismes.
Au total, selon l’OIF, « les locuteurs ivoiriens se sont littéralement approprié l’ancienne langue coloniale, en la façonnant selon leurs besoins. Ils en ont fait une langue vivante et dynamique, colorée et adaptée à toutes les situations de communication. À travers les différentes variétés de cette langue, les Ivoiriens donnent forme à leurs pensées, désignent et décrivent désormais leur monde. Par cette langue, ils expriment les réalités culturelles et sociales dans lesquelles ils « baignent » au quotidien.
Cette acculturation du français en Côte d’Ivoire suscite une réelle proximité avec la France, faisant raisonner les paroles du philosophe allemand Fichte, pour qui « ceux qui parlent la même langue forment un tout que la pure nature a lié par avance de mille liens invisibles ». Cette situation procure un large accès aux médias français, à l’image de RFI (Radio France internationale) et des chaines de télévision françaises, en particulier celles du bouquet proposé par Canal + Afrique sur le satellite, assez largement diffusées alors que la Côte d’Ivoire ne dispose que de deux chaines de télévision nationales. Le partage du français entretient ainsi une familiarité réciproque et procure des références culturelles communes.
• Un pays plutôt francophile
Pour la plupart des interlocuteurs de la mission, les sentiments anti-français qui se sont manifestés pendant la crise ivoirienne résultent davantage d’une instrumentalisation politique, plutôt qu’ils ne reflètent une lame de fond de la société ivoirienne. De ce point de vue, la situation en Côte d’Ivoire serait très différente de celle du Cameroun, où le discours anti-français a une forte résonnance.
Pascal Affi N’Guessan, qui dirige la tendance « modérée » du FPI, établit une distinction qui a été reprise par plusieurs interlocuteurs de la mission : « les Ivoiriens n’ont pas de problème avec les Français, mais ils ont un problème avec les hommes politiques français » ; ils ont l’impression que la classe politique française « ne veut pas sortir de la françafrique ».
Charles Konan Banny a estimé, devant la mission, que les dirigeants français, lorsqu’ils se rendent en Côte d’Ivoire, donnent parfois l’impression d’interférer dans le jeu politique ivoirien. En outre, ils apparaissent coupés des réalités de la population ivoirienne, n’interagissant qu’avec une classe dirigeante elle-même suspecte d’avoir un « problème d’affect », entre les destinées de son pays et ses amitiés parisiennes.
Par ailleurs, la France et les Français sont plutôt considérés avec bienveillance. Francis Akindes décrit les Ivoiriens comme « plutôt francophiles », estimant toutefois que « le sentiment anti-blanc demeure mobilisable à tout moment », l’histoire coloniale étant condamnée à refaire surface épisodiquement, surtout si elle est instrumentalisée.
Globalement, ce positionnement plutôt amical des Ivoiriens correspond à ce que la mission a ressenti lors de son déplacement. Elle n’a jamais été le témoin de manifestations de rejet, d’hostilité ou d’agressivité à l’encontre de la France et des Français. Au contraire, elle a plutôt eu le sentiment d’une attente.
Le réseau culturel et éducatif français en Côte d’Ivoire
Le dispositif éducatif et culturel français en Côte d’Ivoire contribue à enrichir les liens entre les deux pays et à diffuser la culture française en Côte d’Ivoire.
L’Institut français de Côte d’Ivoire est un acteur culturel de premier plan dans le paysage ivoirien. Après d’importants travaux de rénovation, il a été inauguré en octobre dernier par le Premier ministre Manuel Valls. Il compte notamment une bibliothèque-médiathèque dont le fonds documentaire est en constante augmentation, très fréquentée par les étudiants et enseignants des universités et grandes écoles d’Abidjan. Il comprend aussi une grande salle de spectacles de 630 places, considérée comme l’une des meilleures d’Abidjan.
L’Institut développe une programmation artistique et culturelle de concerts, spectacles de danse, théâtre et expositions autour de la création contemporaine française et ivoirienne. Des rencontres littéraires, des débats d’idées et des colloques sont régulièrement proposés au public, dont une émission littéraire filmée par la RTI. Des cours de français sont dispensés à des apprenants coréens, turcs, chinois et arabes en poste à Abidjan, ainsi qu’à des personnels de la Banque africaine de développement. L’Institut abrite par ailleurs l’espace Campus France pour la Côte d’Ivoire, qui accueille le public étudiant en recherche d’une mobilité vers la France.
Sur le plan éducatif, le réseau des écoles françaises dispose d’une forte attractivité, dans un contexte où le système éducatif public connaît de fortes difficultés (cf. supra). Le réseau scolaire à programme français est constitué de huit établissements homologués par le ministère français de l’éducation nationale dont six avec l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AELE) et deux avec la Mission laïque. S’y ajoutent cinq établissements conventionnés avec le CNED et la Mission laïque. Au total, ce réseau accueille, de la maternelle à la Terminale, plus de 8000 élèves français, ivoiriens et étrangers, des effectifs en constante hausse face à une demande très dynamique, que le réseau ne peut satisfaire intégralement.
Il convient enfin de noter la présence de plusieurs Alliances françaises en Côte d’Ivoire, à Abengourou, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro, chargées de diffuser la langue et la culture françaises.
2. Un partenariat fort et structurant autour de l’aide au développement
À rebours de la tendance générale dans les autres pays d’Afrique, l’aide au développement est un levier puissant de l’influence française en Côte d’Ivoire. Elle repose sur la mobilisation d’un outil, le contrat de désendettement (C2D), certes non pérenne, mais qui permet de poser les bases d’un nouveau partenariat en faveur du développement ivoirien.
• Des montants considérables en faveur du développement ivoirien grâce au mécanisme du C2D
L’Agence française de développement (AFD) a en Côte d’Ivoire son premier portefeuille de projets au monde, avec des décaissements annuels de l’ordre de 225 millions d’euros sous forme de dons. C’est plus que le montant total de l’enveloppe de dons de l’AFD à destination des seize pays prioritaires de l’aide française, qui s’élève à 160 millions d’euros. La mobilisation de telles sommes en dons pour la Côte d’Ivoire s’explique par la mise en œuvre d’un contrat de désendettement (C2D).
Concrètement, le contrat de désendettement permet de refinancer sous forme de dons en faveur du développement de la Côte d’Ivoire des échéances de dettes remboursées par cette dernière. Ce mécanisme original est une alternative à l’annulation sèche ; il permet de flécher les crédits restitués au pays bénéficiaire vers des actions favorables à son développement. Cet outil a été mobilisé dans dix-huit pays qui se trouvaient endettés auprès de la France, dont quinze en Afrique (78). Les montants impliqués étaient cependant très variables : de 2,3 millions d’euros pour le Nicaragua à 2,9 milliards d’euros pour la Côte d’Ivoire qui mobilise, de loin, le plus gros montant, devant le Cameroun (1,5 milliard d’euros).
- Genèse des C2D ivoiriens
Ce différentiel s’explique par le fait que la Côte d’Ivoire était lourdement endettée auprès de la France. Dans les années 1980 et 1990, la France avait régulièrement prêté à la Côte d’Ivoire qui bénéficiait alors d’une croissance importante et une bonne capacité d’absorption, puis avait continué à le faire alors que les premiers signes de faiblesse étaient apparus, les règles prudentielles n’étant alors pas aussi strictes qu’aujourd’hui. Comme la Côte d’Ivoire était alors un pays à revenu intermédiaire, elle n’avait pas bénéficié de l’annulation de dette consentie par la France en faveur des pays les moins avancés (PMA) de la zone franc, en 1994. Lorsque la Côte d’ivoire s’était trouvée en difficulté, la France avait fait des prêts d’ajustement structurel afin que le pays puisse continuer à bénéficier du soutien des bailleurs multilatéraux.
La Côte d’Ivoire avait donc un stock de dette considérable à l’égard de la France, dont le montant avait cependant été divisé par deux pour tenir compte de la dévaluation du franc CFA en 1994. Dans les années 2000, la Côte d’Ivoire a bénéficié du processus d’annulation multilatérale de la dette en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE). Dans la foulée, le Club de Paris a consenti en 2012 des annulations de dettes bilatérales. Dans ce cadre, la France a décidé de ne pas faire une annulation de dette intégrale, mais d’en échanger une partie (2,9 milliards d’euros sur un total de 3,8 milliards, le reste faisant l’objet d’une annulation sèche) contre des programmes de développement.
- Secteurs d’intervention et montants
Sur ce total de 2,9 milliards d’euros, la France et la Côte d’Ivoire ont d’ores et déjà contracté pour un montant de 1,7 milliard euros. Le premier C2D portait sur un montant de 630 millions d’euros pour la période 2012-2015 ; il est entièrement engagé et décaissé à 84%. Le deuxième C2D prévoit d’engager 1,125 milliard d’euros sur la période 2014-2019 ; ces sommes ont été engagées à 73% et décaissées à hauteur de 11%.
Ces sommes considérables permettent à l’AFD de se positionner de manière significative sur l’ensemble de ses secteurs d’activité. La construction de routes concentre près de 20% des crédits ; viennent ensuite l’éducation, la formation et l’emploi (18%), le développement urbain, la décentralisation, l’eau et l’assainissement (18%), l’agriculture et la biodiversité (12%) ; la santé (9%) et la justice (5%).
- Autres instruments mobilisés
Outre le C2D, l’AFD mobilise toute la palette de ses instruments en Côte d’Ivoire. Jusqu’à récemment, elle ne pouvait pratiquer que des prêts non souverains (au secteur privé ou au secteur public sans garantie étatique). Cependant, l’amélioration du risque souverain, confirmée par les analystes de l’AFD et les principales agences de notation, a conduit la France à reprendre les prêts souverains en décembre 2016. Un prêt souverain d’un montant de 120 millions d’euros permettra ainsi de financer un programme d’investissements dans le secteur de l’énergie : réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Buyo, extension de réseau, électrification rurale dans 350 villages et branchements sociaux. Ce prêt sera complété par 34 millions d’euros de subventions de l’Union européenne.
Parmi les autres instruments mobilisés, l’AFD finance des garanties bancaires en faveur des petites et moyennes entreprises dans le cadre du mécanisme ARIZ.
Enfin, on peut noter qu’Expertise France, l’agence publique de la coopération technique internationale française, est présente en Côte d’Ivoire depuis 2004, où elle dispose d’un bureau de représentation et déploie actuellement une équipe de 36 personnes. Elle conduit des actions visant à renforcer les capacités de la Côte d’Ivoire dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques adaptées aux besoins des populations. Elle intervient ainsi dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la protection sociale, de la lutte contre le changement climatique, de la sécurité, de la gouvernance et, bientôt, de l’énergie. Jusqu’à présent, la France était le premier bailleur d’Expertise France à travers les financements du C2D. Prochainement, l’Union européenne devrait devenir le principal bailleur, le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne devant confier à l’agence la gestion déléguée de deux importants projets dans les domaines de la sécurité civile et de l’électrification rurale et l’efficacité énergétique des bâtiments publics.
• Un partenariat mutuellement bénéfique
Pour Jean-Pierre Marcelli, directeur Afrique de l’AFD, le C2D est « un outil exceptionnel » en ce qu’il instaure un dialogue partenarial pour le développement de la Côte d’Ivoire, dans l’intérêt des deux pays.
- Une aide au développement cogérée avec les Ivoiriens, en fonction de leurs objectifs nationaux
Le C2D épouse bien les intérêts de la Côte d’Ivoire car il est aligné sur les objectifs de développement que se sont fixés les dirigeants, à travers les plans nationaux de développement 2012-2015 et 2016-2020. Il vient donc véritablement en soutien des objectifs politiques nationaux.
Le C2D est fondamentalement dans l’intérêt de la Côte d’Ivoire car il permet de flécher vers le développement les échéances de dettes restituées, ce qui ne serait pas le cas avec une annulation sèche. Il permet ainsi de contourner les risques d’« évaporation » dont nous avons vu qu’ils n’étaient pas négligeables en Côte d’Ivoire. Charles Konan Banny, ancien premier ministre de la Côte d’Ivoire, a lui-même souligné cette « vertu » fondamentale. Les procédures de l’AFD sont très rigoureuses et celle-ci intervient pour donner son avis à tous les stades de la mise en œuvre des projets, qui font en outre l’objet d’un audit ex post. Le risque d’une mauvaise utilisation des fonds est donc minime.
Par ailleurs, la sélection des projets ayant vocation à bénéficier des crédits du C2D s’effectue en partenariat avec les Ivoiriens. L’AFD instruit les projets avec les ministères maîtrises d’ouvrages avec pour objectif de faciliter la mise en œuvre des politiques sectorielles gouvernementales. Le dialogue est contradictoire : l’AFD refuse parfois de financer certains projets (comme le logement social) et la partie ivoirienne décline aussi certaines propositions. D’après Jean-Pierre Marcelli, « le dialogue initial est particulièrement exigeant ». Cependant, les deux parties finissent toujours par se mettre d’accord sur un programme qui satisfait tout le monde. Pour Jean-Pierre Marcelli, ce type de coopération est précisément « ce à quoi aspire l’Afrique ».
- Un levier d’influence et des retours économiques certains pour la France
Les intérêts pour la France sont évidents. Le C2D est un formidable outil d’influence, qui permet à la France, selon Jean-Pierre Marcelli, d’assurer « un copilotage sur la trajectoire de développement du pays ». Les montants d’intervention permettent d’avoir un impact significatif dans les secteurs financés et d’agréger les financements d’autres bailleurs, notamment multilatéraux.
Par exemple, la France consacre plus de 200 millions d’euros à des projets dans le domaine de l’éducation, ce qui lui permet d’intervenir sur tout le « continuum éducatif », depuis l’éducation de base à l’emploi, en passant par les collèges, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.
Au total, la France est le deuxième bailleur bilatéral de la Côte d’Ivoire après la Chine. En effet, ce pays a consenti deux prêts importants de l’ordre de 800 à 900 millions de dollars, qui venaient s’ajouter aux financements déjà octroyés pour la construction de routes, de stades, l’eau potable et l’énergie, entre autres. Pour le reste, les principaux bailleurs sont, par ordre décroissant, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la Corée du sud, le Fonds saoudien, le Fonds koweitien ou encore l’Inde.
Chez les multilatéraux, la France fait pratiquement jeu égal avec la Banque mondiale – ce qui est très rare. La Banque africaine de développement (BAD), l’Union européenne, les agences des Nations Unies, la banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque islamique de développement et la Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique (BADEA) sont aussi présents.
Cette forte empreinte de l’AFD est évidemment favorable aux entreprises françaises, bien que la France ne pratique pas l’aide liée. Pour Jean-Pierre Marcelli, ce ne serait d’ailleurs ni dans l’intérêt de la Côte d’Ivoire, ni dans celui de la France. En effet, pour la Côte d’Ivoire, une aide déliée est la meilleure façon d’avoir la meilleure offre au meilleur prix. Pour la France, ce type d’aides permet de stimuler la compétitivité des entreprises et d’agréger les financements des autres bailleurs, ce qui n’est pas possible lorsque l’aide est liée.
Recommandation n°9 : Préserver le remarquable outil d’intervention qu’est le C2D ivoirien en maintenant une gestion partenariale des projets et en fluidifiant au maximum les procédures.
3. Une présence économique importante
En dépit d’un recul relatif, les entreprises françaises continuent d’occuper une place centrale dans l’économie ivoirienne. La France et la Côte d’Ivoire doivent aujourd’hui trouver les moyens de bâtir un vrai partenariat économique orienté vers le développement ivoirien, mais aussi avec un objectif clair de co-prospérité.
• Une présence encore centrale dans l’économie ivoirienne
- Les entreprises françaises de retour en Côte d’Ivoire
Dans les années 1990, les entreprises françaises avaient une place largement prédominante dans l’économie ivoirienne. Cet état de fait résultait d’une politique voulue du président Houphouët-Boigny, qui avait ouvert ses frontières aux travailleurs migrants et aux capitaux et entreprises étrangers.
La crise ivoirienne a porté un coup à cette présence. Les émeutes anti-françaises de 2004 auraient causé la dégradation ou la destruction de 120 entreprises, essentiellement françaises. Elles se sont traduites par le rapatriement de plus de 8000 ressortissants et la fermeture de 150 entreprises. De manière générale, la crise a fortement impacté les petites et moyennes entreprises (PME), les filiales des grands groupes ayant davantage les moyens de résister aux conditions économiques particulièrement dégradées qui prévalaient. Ainsi la plupart des PME n’ont pas pu surmonter la baisse drastique d’activité et l’accès dégradé voire inexistant aux devises et aux crédits suscités par la crise. D’autres pays se sont engouffrés dans la brèche laissée par le départ des Français, à l’image de la Chine (cf. infra).
Ainsi, la part de marché des entreprises françaises en Côte d’Ivoire a été divisée par deux depuis le début des années 2000 : elles représentaient alors 28% des importations ivoiriennes, contre 14% aujourd’hui. Les importations chinoises, avec 13% de part de marché, font désormais quasiment jeu égal avec celles de la France.
Cependant, d’après les statistiques données par la Direction générale du Trésor, les entreprises françaises continuent aujourd’hui à occuper une place centrale dans l’économie ivoirienne. La France conserve de loin le principal stock d’investissements directs étrangers sur le sol ivoirien, avec 1,6 milliard de dollars pour un stock total de 7,7 milliards en 2014, soit une part de 21%. Le deuxième investisseur en termes de stock était en 2014 les Pays-Bas, avec 12% du total.
Les entreprises françaises jouent un rôle essentiel dans l’économie formelle de la Côte d’Ivoire. Elles représenteraient environ un tiers du PIB ivoirien et entre 40 et 50% des recettes de l’impôt sur les sociétés. Au total, entre 600 et 700 entreprises françaises seraient implantées dans le pays dont 160 filiales de grands groupes qui emploient près de 35 000 personnes. Ces filiales font de plus en plus de la Côte d’Ivoire un « hub » pour leurs activités dans la région, à l’instar d’Orange ou d’Engie. En 2015, les entreprises françaises auraient totalisé 20% du stock et 37% du flux des investissements en Côte d’Ivoire.
Les petites et moyennes entreprises commenceraient tout juste à revenir après l’hémorragie de la crise ivoirienne. On dénombre aujourd’hui environ 400 PME de droit local ivoirien créées par des Français. Il semble pourtant que la « reconquête des PME françaises » soit encore à venir. En témoigne, la délégation importante conduite par Pierre Gattaz, président du Medef à Abidjan en avril dernier. Celle-ci comptait 130 chefs d’entreprise dont 75% de PME.
Pour Jean-Christophe Belliard, ancien directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères, la présence économique française en Côte d’Ivoire ne doit pas être perçue sous l’angle du déclin : « notre part de marché baisse, mais la taille du gâteau augmente. Si notre part baisse, c’est parce que de plus en plus de monde s’intéresse à la Côte d’Ivoire, et c’est bon signe pour nous ».
- Des positions clés dans plusieurs secteurs
Tous les grands groupes français traditionnellement présents en Afrique sont implantés en Côte d’Ivoire. Ces filiales occupent des positions très importantes dans la plupart des secteurs de l’économie ivoirienne.
Dans le transport, Bolloré Africa logistics est un acteur important du trafic maritime. Il est concessionnaire du quai conteneurs sur le port d’Abidjan et adjudicataire du futur second terminal sur ce port qui devrait être opérationnel en 2018. Celui-ci sera réalisé par des entreprises chinoises, sur financement chinois. Bolloré est également positionné dans le transport ferroviaire à travers sa filiale Sitarail, qui exploite la ligne de chemin de fer reliant Abidjan à Ouagadougou. D’autres groupes comme Air France ou la CMA-CGM (transport maritime) sont également implantés. La compagnie Air Côte d’Ivoire a passé commande auprès d’Airbus pour cinq appareils livrables entre 2017 et 2021.
Orange est leader du marché de la téléphonie fixe et mobile en Côte d’Ivoire et s’appuie sur sa filiale ivoirienne pour réaliser une part de son expansion en Afrique de l’ouest. L’entreprise a notamment créé à Abidjan le plus grand centre de traitement des données d’Afrique de l’ouest. Dans le domaine de la télévision par câble et par satellite, Canal + (Vivendi) était jusqu’à présent en situation de monopole, étant le seul opérateur autorisé par la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) ivoirienne. Celle-ci a cependant ouvert ce secteur à la concurrence du chinois Startimes et de deux sociétés ivoiriennes en mars dernier. Actuellement, Canal + compte 300 000 abonnés à son bouquet de 200 chaînes dans le pays.
Dans le secteur bancaire, les entreprises françaises ont perdu du terrain face aux banques marocaines, mais la filiale de la Société générale (SGBCI) reste la première banque du pays. Elle vient d’ailleurs d’ouvrir une salle de marchés régionale à Abidjan chargée de gérer les activités de change de l’ensemble des filiales du groupe dans l’UEMOA et peut-être, à terme, dans toute l’Afrique subsaharienne. La filiale de BNP Paribas (BICICI) est quant à elle la quatrième banque du pays. Au total, les banques françaises sont à égalité avec les banques marocaines pour le montant des crédits accordés. Axa est présente dans le secteur des assurances.
Dans le secteur du BTP, la société Franzetti du groupe Veolia est restée active malgré la crise. Le groupe Bouygues occupe également une place de premier plan ; il a notamment réalisé la construction du troisième pont d’Abidjan (le pont Henri Konan Bédié) et devrait participer à la construction du métro d’Abidjan à travers un consortium franco-coréen. Par ailleurs, la société Matière a décroché un contrat pour la construction de treize ponts métalliques en milieu rural, financée par un prêt du Trésor. Les sociétés Fayat et Vinci sont également présentes.
Dans le domaine agro-alimentaire, Danone, Castel et La Compagnie fruitière sont bien implantées en Côte d’Ivoire. Le groupe antillais Bernard Hayot a relancé la concurrence en investissant dans la culture de bananes. Dans le secteur de la transformation du cacao, à côté des géants américain (Cargill), suisse (Nestlé), singapourien (Olam), les Français Touton et Cémoi sont présents et occupent une place certes proportionnellement modeste. Cependant, Cémoi a ouvert en 2015 la première usine de fabrication de chocolat du pays. Il était ainsi le premier acteur à maîtriser l’ensemble de la filière, de la fève au chocolat. Bel a par ailleurs ouvert en mars 2016 une usine pour produire la Vache qui rit en Côte d’Ivoire.
Dans le secteur de la distribution, Carrefour a ouvert, en partenariat avec CFAO, désormais japonais, son premier hypermarché en Afrique subsaharienne au sein du nouveau centre commercial Playce Marcory. Un deuxième Carrefour devait ouvrir en janvier 2017 à Abidjan. Accor est un acteur prépondérant du secteur de l’hôtellerie ivoirienne, où toute sa gamme d’hôtels est représentée.
Dans le secteur de l’énergie, Total est leader dans la distribution, le trading et l’exploration-production en Côte d’Ivoire. Alstom a conclu un contrat pour la fourniture de quatre turbines dans le cadre de la réalisation du barrage de Soudré qui est assurée par le Chinois SynoHydro. Eranove est un acteur majeur du secteur de l’électricité à la fois pour la production, à travers sa filiale CIPREL, et pour le transport et la distribution, par sa participation dans la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE). Le groupe est par ailleurs actionnaire de la Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire, la SODECI. Enfin, Engie a installé son premier bureau en Afrique de l’ouest à Abidjan en janvier 2016 et aurait des projets d’investissements dans les domaines du gaz naturel liquéfié (GNL) et des centrales à gaz.
Enfin, dans le domaine de la défense, l’entreprise Raidco Marine a livré trois patrouilleurs au ministère de la défense en 2015 et Thalès a été retenu pour fournir un système de suivi, de contrôle et de surveillance maritime pour le ministère de la production animale et des ressources halieutiques. Le groupe est par ailleurs en négociation pour la fourniture d’un système de vidéosurveillance pour Abidjan dans le cadre d’un consortium avec le Chinois Huawei.
- Des échanges commerciaux dominés par l’agroalimentaire et les médicaments
La France occupe une place assez importante et globalement stable dans les échanges commerciaux de la Côte d’Ivoire. Les exportations françaises à destination de la Côte d’Ivoire se sont élevées à 1,1 milliard d’euros et les importations à 772 millions d’euros en 2015, soit un excédent commercial en faveur de la France de 335 millions d’euros. Globalement, les échanges commerciaux ont crû de 10,8% en valeur en 2015.
Cette hausse est principalement due à une augmentation de 22% des importations françaises en provenance de la Côte d’Ivoire, après une baisse de 5% en 2014. Ces importations sont essentiellement constituées de produits agricoles : cacao et ses dérivés (303 millions d’euros en 2015), plantes à boisson (essentiellement café ; 171 millions d’euros), fruits tropicaux (112 millions d’euros), conserves de poisson (73 millions d’euros) et pétrole brut (52 million d’euros). Les postes les plus dynamiques sont le café et le cacao en raison de l’appréciation du cours. Aucune importation de pétrole n’avait eu lieu en 2014, ce qui contribue à expliquer la hausse des importations.
Avec 5,4% du total, la France est le cinquième client des exportations ivoiriennes, derrière les Pays-Bas (10%, cacao, or), les États-Unis (8%, cacao), la Belgique (6%) et l’Allemagne (5,7%). Les principaux clients africains de la Côte d’Ivoire sont l’Angola (4%), le Nigéria (4%) et l’Afrique du sud (3%). Vu de France, la Côte d’Ivoire est, avec une part de marché de 8%, son quatrième fournisseur en Afrique subsaharienne, derrière le Nigéria (30%), l’Angola (15%) et l’Afrique du sud (9%).
Les exportations de la France vers la Côte d’Ivoire ont également crû, à un taux cependant inférieur à la croissance économique : 3,9% contre 8,4%. Les médicaments et les céréales constituent près d’un quart des exportations françaises vers la Côte d’Ivoire. Les autres principaux postes sont les machines (49 millions d’euros), les équipements de communication (40 millions d’euros), l’informatique (29 millions d’euros), les produits et conserves à base de poisson et de produits de pêche (26 millions d’euros), les parfums et produits de toilette (16 millions d’euros) et les vins (15 millions d’euros).
Ces exportations font de la France le second fournisseur de la Côte d’Ivoire après le Nigéria, avec une part de marché de 14% contre 12% en 2014. Le Nigéria est le premier fournisseur, mais sa part de marché a diminué à 16% en 2015 en raison de la baisse du cours du pétrole. Hors pétrole, la France demeure le premier fournisseur de la Côte d’Ivoire. La Chine est le troisième fournisseur avec 13% de part de marché ; ses exportations ont doublé en l’espace de cinq ans.
9% des exportations françaises en Afrique subsaharienne se dirigent vers la Côte d’Ivoire, ce qui en fait le troisième client de la France dans cette région derrière l’Afrique du sud (15%) et le Nigéria (11%). La Côte d’Ivoire devance ainsi le Sénégal, le Congo, le Cameroun, l’Angola et le Togo, tous autour de 5-6% de part de marché.
• Un environnement plutôt favorable
- Un dispositif d’accompagnement très complet pour les entreprises
La présence économique française en Côte d’Ivoire est facilitée par un dispositif d’accompagnement très complet dans le pays, souvent avec une vocation régionale.
Business France, l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française, (issue de la fusion, en janvier 2015, de l’agence française pour le développement international des entreprises (UBIFRANCE) et de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII)), dispose d’un bureau basé à Abidjan dont la zone de compétences s’étend au Ghana, au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Une équipe composée de sept collaborateurs et organisée en quatre pôles de compétences (art de vivre-santé, industries et cleantech, agrotech et tech et services) accompagne les entreprises françaises qui souhaitent exporter en Côte d’Ivoire (accompagnement individuel, opération collective et embauche de volontaires internationaux en entreprise (VIE)) et les projets d’investissements ivoiriens en France. Elle promeut également la France pour faire venir des investisseurs ivoiriens dans notre pays.
BPI France, la banque publique d’investissement au service du développement des entreprises, est également implantée à Abidjan. L’institution a choisi la Côte d’Ivoire comme premier pays d’implantation en Afrique. BPI France accompagne les entreprises françaises « de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit jusqu’aux fonds propres » par des prêts, des garanties de crédits bancaires et des investissements en capital, ainsi que par une gramme de produits financiers complémentaires au marché bancaire traditionnel français. La banque a en outre lancé en mars 2015 le crédit export, qui permet de proposer des solutions de financement aux clients africains des entreprises françaises. Par ailleurs, depuis 2016, BPI France gère le mécanisme de garanties publiques à l’exportation auparavant du ressort de la COFACE.
La COFACE est présente en Côte d’Ivoire depuis 1994 et intervient par l’intermédiaire de son partenaire AXA CI pour accompagner les sociétés françaises par des évaluations sur les risques commerciaux de leurs partenaires, de l’assurance-crédit qui contribue à la croissance de ces sociétés en leur permettant d’optimiser la gestion de leur poste client et par la mise à disposition d’une base de données entreprises et de services annexes.
Les entreprises françaises en Côte d’Ivoire peuvent par ailleurs s’appuyer sur un réseau de chambres de commerces : la chambre de commerce et d’industrie française en Côte d’Ivoire (CCIF-CI), la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) et l’Eurocham CI, la Chambre de commerce européenne. En outre, 31 conseillers du commerce extérieur français (CCEF) sont implantés à Abidjan afin d’appuyer la présence économique française en Côte d’Ivoire.
Enfin, il convient de noter que Proparco, la filiale de l’AFD en charge du secteur privé, intervient depuis Abidjan sur l’ensemble de la CEDEAO à l’exception du Nigéria. En Côte d’Ivoire, Proparco a un portefeuille d’environ 250 millions d’euros principalement investi dans le secteur financier, l’agro-industrie et le financement des infrastructures. Ces appuis peuvent évidemment profiter aux entreprises françaises intervenant dans ces secteurs.
- Des atouts spécifiques à faire valoir
Outre leur positionnement favorable, dans nombre de secteurs dans lesquels les besoins ivoiriens sont importants, les entreprises françaises ont des atouts spécifiques à faire valoir. La « marque France » est auréolée d’un réel prestige dans le pays ; elle est synonyme de qualité et de haute technologie. Les classes moyennes ivoiriennes veulent consommer « comme en Europe » : les entreprises françaises doivent ainsi développer une offre certes adaptée au marché local mais certainement pas composée de produits de « seconde gamme », l’avantage comparatif de la France étant bien cette image de qualité, dans un environnement hautement concurrentiel.
Par ailleurs, en raison des liens denses qui se sont tissés entre la France et la Côte d’Ivoire au cours des dernières décennies, il persiste une certaine familiarité entre les communautés d’affaires françaises et ivoiriennes ainsi qu’entre les élites des deux pays. Ainsi, plusieurs interlocuteurs ont estimé que la France n’était pas considérée comme un partenaire « lambda » et que les Ivoiriens avaient tendance à préférer avoir affaire à des Français, pourvu que ces derniers sachent leur proposer une offre qui leur convienne. Cette demande persistante de France doit être prise en compte, de même que le tempérament que nous y avons apporté : la France doit être en mesure de proposer une réponse aux préoccupations des Ivoiriens, c’est aujourd’hui un enjeu essentiel pour la présence économique française dans ce pays.
- Mais aussi quelques limites
À l’heure actuelle, la Côte d’Ivoire ne saurait être considérée aveuglément comme un eldorado et une chasse gardée pour les entrepreneurs français. Nous avons vu l’intensité de la concurrence et le caractère encore difficile de l’environnement des affaires dans le pays.
La France occupe certes encore une place de premier plan dans l’économie ivoirienne, mais elle peut aussi s’avérer désavantagée à certains égards.
En particulier, les entreprises françaises, qui opèrent dans le cadre formel, pâtissent de l’informalisation croissante de l’économie favorisée par la crise ivoirienne. Elles paient le prix fort de l’étroitesse de l’assiette fiscale qui en résulte. Elles font ainsi l’objet d’un harcèlement de l’administration fiscale ivoirienne, pour laquelle elles représentent une source essentielle de revenus, à hauteur de 50% du total des recettes fiscales. Ce harcèlement prend la forme de contrôles fiscaux à répétition et de redressements adossés à une interprétation tatillonne de la loi fiscale, laquelle demeure peu claire et changeante. Ainsi, la pression fiscale peut être considérable pour les entreprises françaises implantées en Côte d’Ivoire. À titre d’exemple, elle équivaut à 20% du chiffre d’affaires d’Orange.
Les entreprises françaises sont aussi tributaires de l’image négative que renvoient certaines d’entre elles. À cet égard, une interlocutrice de la mission estime qu’il existe une génération d’entrepreneurs qui ne sont pas sortis d’un mode de pensée « à l’ancienne » et viennent en Côte d’Ivoire « comme en terrain conquis », sans se rendre compte que la Côte d’Ivoire a changé. Les Ivoiriens veulent désormais travailler en partenaires.
Il est certain que, dans ces conditions, l’offre des pays émergents, qui prônent une coopération sud-sud, peut rencontrer d’autant plus de succès qu’elle est souvent assortie de conditions de financement attrayantes. C’est là l’une des fragilités majeures de l’offre française en Afrique en général et en Côte d’Ivoire en particulier. Les interlocuteurs ivoiriens de la mission sont nombreux à l’avoir souligné : la France doit pouvoir proposer à la Côte d’Ivoire des solutions de financement susceptibles de rivaliser avec les offres des pays émergents.
• Perspectives : vers des partenariats pérennes en faveur du développement ivoirien
Si les entreprises françaises veulent maintenir leur empreinte économique en Côte d’Ivoire, elles n’ont d’autre choix que de s’engager dans des partenariats pérennes avec les acteurs économiques ivoiriens. Ces partenariats, orientés vers une production locale avec des salariés locaux, doivent permettre un transfert des savoir-faire afin de développer le tissu industriel ivoirien, d’accélérer la diversification et la montée en gamme de l’économie.
Cette approche partenariale est au bénéfice des deux parties. En contribuant au développement du tissu industriel ivoirien, la France génère à terme de nouvelles opportunités.
Par ailleurs, l’insistance des Ivoiriens sur la priorité donnée à l’implantation de PME correspond à un objectif central de la politique économique de la France, qui est que ses PME contribuent davantage à l’internationalisation de l’économie, aujourd’hui portée essentiellement par les grands groupes. Pour cela, la stratégie adaptée est celle de la « chasse en meute », largement mise en pratique, avec succès, par d’autres acteurs comme l’Allemagne. Il s’agit de valoriser une « équipe France » à l’international pour bâtir des projets compétitifs, intelligents, optimisant les synergies entre grandes groupes et PME.
À l’inverse, notre pays doit pouvoir obtenir que des entrepreneurs ivoiriens investissent en France et contribuent ainsi au dynamisme de l’économie française. Cette réciprocité des flux est fondamentale.
Il convient de noter que les rencontres « Africa 2017 » organisées par la Fondation Africa – France, qui vise à « renforcer les relations entre les entreprises françaises et de l’ensemble du continent africain sur une base partenariale pour une croissance durable et inclusive », se tiendront à Abidjan. Elles fourniront une occasion supplémentaire pour avancer dans cette voie.
Coopérer pour un développement durable de la Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire est vulnérable au changement climatique à plusieurs titres. Compte tenu de l’importance du secteur agricole dans le pays, la préservation des sols et la mise en place d’une agriculture durable sont des enjeux de premier ordre. En outre, la colonisation agraire de la Côte d’Ivoire s’est traduite par un mouvement massif de déforestation que le pays cherche aujourd’hui à inverser. En moins de cinquante ans, la Côte d’Ivoire a perdu 75% de sa surface forestière, passée de 16 millions d’hectares dans les années 1960 à 3,4 millions aujourd’hui. La gestion des ressources en eau, les infrastructures énergétiques et l’érosion côtière sont d’autres problématiques importantes pour la Côte d’Ivoire.
Pour l’heure, le pays n’émet que peu de gaz à effet de serre, en raison de sa faible industrialisation. Les émissions progressent plus lentement que la croissance économique, les déchets et l’énergie étant les principaux secteurs émetteurs. Cependant, la Côte d’Ivoire aspire, comme nombre de ses voisins, à développer son tissu industriel. La maîtrise des émissions futures est ainsi d’ores et déjà un enjeu à prendre en compte.
Les autorités ivoiriennes se sont engagées dans cette voie en ratifiant l’Accord de Paris le 25 octobre dernier. La contribution nationale ivoirienne (plan d’action climat) présentée dans ce cadre prévoit, entre autres, une réduction de 28% des émissions de gaz à effet de serre et une augmentation à 42% de la part des renouvelables dans le bouquet énergétique d’ici à 2030.
Ces objectifs ambitieux nécessiteront un soutien extérieur important. L’AFD vient d’adopter un « projet d’appui à l’efficacité énergétique en Côte d’Ivoire », qui sera mis en œuvre conjointement avec l’Union européenne. Il vise à rendre plus performante la distribution d’électricité et à promouvoir les énergies propres et renouvelables pour la production d’électricité.
En particulier, l’AFD s’est positionnée sur les trois projets ivoiriens identifiés dans le cadre de l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables présentée par la ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, établie afin de « nourrir l’accélération concrète du développement des énergies renouvelables en Afrique ». Il s’agit des projets de centrale biomasse, de centrale hydroélectrique de Buyo et de centrale solaire. La coopération de la France dans le domaine climatique porte par ailleurs sur la préservation des écosystèmes et l’agriculture et l’énergie durables.
Recommandation n°10 : Amplifier la coopération pour un développement durable de la Côte d’Ivoire, domaine à fort enjeu dans lequel un appui extérieur est indispensable et où la France a une expertise à faire valoir.
4. Un partenariat de défense autour des forces françaises en Côte d’Ivoire
• Une relation de défense rénovée en 2012
- L’opération Licorne et la nécessité d’un nouveau départ
En 2002, confronté à une tentative de coup d’État et à la prise de contrôle de plusieurs villes du nord et du centre du pays par des rebelles, le Président Gbagbo avait demandé un appui militaire de la France, présente en Côte d’Ivoire depuis 1978 avec le 43ème Bataillon d’infanterie de marine (BIMA), stationné à Port-Bouët. Le Président demandait l’activation de la clause d’assistance militaire prévue par l’accord de défense bilatéral conclu en 1961, dénonçant une agression extérieure.
Dans un premier temps, la France avait refusé de s’engager, faisant valoir qu’il s’agissait d’une crise interne. Cependant, elle s’est finalement résolue à intervenir selon des modalités qui n’étaient pas celles escomptées par le Président Laurent Gbagbo. L’opération Licorne a ainsi été lancée en septembre 2002 avec pour but premier d’assurer la sécurité des ressortissants européens. Elle a rapidement évolué vers une mission d’interposition entre les deux camps : dès le 20 octobre, les soldats français se sont déployés d’ouest en est pour surveiller le cessez-le-feu, gelant ainsi durablement le front au niveau de Bouaké.
Ce positionnement s’est avéré très inconfortable, suscitant l’insatisfaction des deux parties. La France a donc cherché à impliquer ses partenaires africains, puis la communauté internationale. À partir de mars 2003, l’opération Licorne a ainsi évolué vers une mission de soutien et d’appui à la MICECI, mission de la CEDEAO, puis, à partir de mai 2003, de la MINUCI, mission des Nations-Unies. Celle-ci a été convertie en opération de maintien de la paix (ONUCI) à partir de février 2004, Licorne devant intervenir en soutien pour assurer la sécurité générale et protéger les civils.
Après le démantèlement de la zone de confiance, dans la foulée de l’accord signé à Ouagadougou en 2007, l’opération Licorne s’est muée en force de réaction rapide auprès de l’ONUCI.
Dans le contexte de la crise post-électorale, la résolution 1975 du Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé Licorne, en soutien de l’ONUCI, à agir pour protéger les populations civiles, notamment en détruisant les armes lourdes concentrées autour du Palais présidentiel.
Au total, la plupart des observateurs, y compris en Côte d’Ivoire, reconnaissent que l’opération Licorne a permis de stopper l’escalade de la violence, préservant de nombreuses vies. Il n’en demeure pas moins que l’ambiguïté du positionnement de cette force a suscité de fortes controverses. Il était donc nécessaire, à l’issue de la crise, de créer une base nouvelle pour le partenariat de défense entre la France et la Côte d’Ivoire.
- Vers la mise en œuvre d’un partenariat de défense
Avant 2012, la relation de défense entre la France et la Côte d’Ivoire était principalement régie par deux textes conclus en 1961 : un « accord de défense » quadripartite entre les gouvernements de la République française, de la République de Côte d’Ivoire, de la République du Dahomey et de la République du Niger, dont les clauses ne s’appliquaient plus qu’à la seule Côte d’Ivoire après avoir été dénoncé par les deux autres pays ; et un « accord d’assistance militaire technique », bilatéral complété de ses annexes sur « le statut des membres des forces armées françaises sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire » et « l’aide et les facilités mutuelles en matière de défense ». Si le deuxième accord se bornait à prévoir les modalités d’une coopération technique visant à mettre sur pied une armée ivoirienne, l’accord de défense comportait une clause stipulant que les parties pouvaient « demander une aide » à la France « dans les conditions définies par des accords spéciaux ». Ces derniers n’étaient pas publics.
La crise ivoirienne et les débats autour de l’opération Licorne avaient mis en lumière la nécessité de rénover cette relation de défense qui n’avait pas été réévaluée depuis 1961. Ce mouvement s’inscrivait aussi dans le contexte plus large de la révision de la relation de défense entre la France et l’Afrique, annoncée par le Président Sarkozy dans un discours prononcé à Dakar en 2008 : celle-ci devait désormais être fondée sur des partenariats de défense établis sur une base réciproque ; les clauses d’assistance militaire avaient vécu.
La France et la Côte d’Ivoire ont ainsi conclu en janvier 2012 « un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale des deux États », qui prévoit les domaines et modalités d’une coopération dont la vocation ultime est de contribuer au renforcement de l’architecture africaine de paix. Ratifié par la France en novembre 2012 et par la Côte d’Ivoire en juillet 2014, ce nouveau traité ne prévoit pas de clause d’assistance en cas d’agression extérieure, mais de simples « échanges de vues sur les menaces et les moyens d’y faire face ». La coopération a désormais vocation à se développer dans les domaines du renseignement, de l’équipement, de l’entraînement des forces, du soutien logistique et de la formation. Un statut des forces déployées sur le territoire de chaque partie dans le cadre des actions de coopération est donc établi sur une base réciproque.
Par ailleurs, le traité comporte aussi une annexe relative aux facilités accordées aux Forces françaises en Côte d’Ivoire. En effet, dans le nouveau schéma du dispositif prépositionné de la France en Afrique, il est prévu qu’une présence française sera maintenue en Côte d’Ivoire sous forme de « base opérationnelle avancée » (cf. infra). Dans cette optique, le 43ème BIMA, présent dans le pays depuis 1978, a été dissous en 2009 et l’opération Licorne a pris fin le 1er janvier 2015, cédant la place aux Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI). L’annexe au nouveau traité de partenariat prévoit ainsi les modalités de cette présence militaire française, s’agissant notamment des entrées de matériels et de l’approvisionnement, des déplacements sur le territoire et des installations mises à disposition.
Les Forces françaises en Côte d’Ivoire ont une vocation très différente de l’opération Licorne ou même du 43ème BIMA qui préexistait. Le colonel Kuntz, qui commande actuellement les FFCI, l’a encore rappelé récemment, alors que la perspective d’une intervention française était agitée dans le contexte des mutineries qui ont secoué le pays : « c’est très important, nous ne sommes plus l’opération Licorne. Les dispositions du traité de partenariat ont changé et les Forces françaises n’ont aucune vocation à intervenir en Côte d’Ivoire » (79).
• La Côte d’Ivoire, une implantation stratégique pour la France
La présence des FFCI est l’un des enjeux importants de la relation de défense franco-ivoirienne. Pour les militaires français, cette implantation est stratégique à bien des égards.
- Une « zone d’intervalle » à la croisée des enjeux de piraterie et de terrorisme
Les militaires français considèrent la côte nord du Golfe de Guinée comme une « zone d’intervalle » entre deux foyers de menaces majeures dont il convient impérativement de prévenir la jonction.
Au nord, la bande sahélo-saharienne est marquée par une menace terroriste élevée. Initialement plutôt localisées dans les territoires désertiques du nord qui échappaient en partie au contrôle des États du Sahel, les actions des groupes terroristes armés ont eu tendance à s’étendre vers le sud. Dans le même temps, la menace s’est internationalisée, les intérêts occidentaux constituant, de manière croissante, une cible dans toute l’Afrique de l’Ouest.
En tant que haut lieu de trafics notamment de drogues et épicentre de la piraterie maritime, le Golfe de Guinée est « l’une des priorités de la coopération militaire française en Afrique », comme l’a rappelé le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian à l’occasion du Sommet de Lomé sur la sécurité maritime, en octobre 2016. La France apporte un soutien logistique, financier et armé aux pays de la région afin de les aider à faire face aux différences menaces.
L’action française dans le Golfe de Guinée se matérialise aussi par la présence permanente d’un bâtiment de marine nationale dans le cadre de la mission Corymbe. Cette présence militaire française permet de lutter contre la pêche illicite, les attaques et les trafics en tout genre et de se tenir prêt à évacuer les ressortissants français en cas de nécessité.
Le Golfe de Guinée, nouvelle zone de fragilité majeure
Un nombre d’attaques en augmentation. 44 actes de piraterie et de brigandage ont été recensés dans le golfe de Guinée au premier trimestre 2016, soit une augmentation de 17 % par rapport à la même période en 2015. Quatre-vingt-six personnes ont été enlevées et quatre personnes tuées sur cette même période, contre 102 sur l’ensemble de l’année 2015. Si l’épicentre du phénomène de la piraterie se situe toujours dans les eaux territoriales et dans la Zone économique exclusive (ZEE) du Nigéria, la zone maritime à risque s’étend de la Guinée Conakry à l’Angola.
L’attaque à des fins de kidnapping, mode d’action privilégié. La piraterie dans le golfe de Guinée s’étend du larcin au détournement de pétrolier pour soutage (ou bunkering) et au kidnapping. Depuis le début de l’année 2016, les groupes de pirates qui opèrent depuis le Nigéria privilégient les enlèvements plutôt que les opérations de soutage. En effet, la très forte baisse du prix du pétrole et des carburants a rendu les attaques de pétroliers beaucoup moins lucratives. Cette tendance devrait perdurer tant que le prix du brut ne remontera pas.
Des efforts pour apporter une réponse régionale. Depuis juin 2013, les efforts se sont accentués dans le golfe de Guinée pour améliorer la coopération régionale et internationale et assurer la sécurité du domaine maritime africain vis-à-vis de ces menaces. 25 États de la région ont ainsi initié à Yaoundé un processus visant à obtenir une connaissance accrue de la situation maritime africaine, s’appuyant sur une architecture interrégionale de partage de l’information maritime, et à doter les États des outils juridiques leur permettant une action collective efficace contre la piraterie maritime. Trois ans après les engagements pris lors du sommet de Yaoundé, cette organisation régionale commence à se mettre en place.
Lors du sommet organisé à Lomé en octobre 2016, plus de 30 pays africains ont adopté une charte contraignante sur la sûreté et la sécurité maritime qui prévoit de coordonner les actions entre les pays du continent pour lutter contre la piraterie et les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains sur les côtes africaines.
- Une base opérationnelle avancée pour les opérations dans la région et la sécurité des ressortissants
Les Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) ont pris le relai de l’opération Licorne en janvier 2015. Elles constituent, avec le Gabon, l’une des deux « bases opérationnelles avancées » (BOA) françaises sur le continent africain. La vocation première de cette présence est de servir de réservoir de forces et de base de soutien pour les opérations militaires de la France dans la région. L’armée française doit être en mesure de déployer un GTIA (groupement tactique interarmes) en douze heures en cas d’urgence dans la région.
Dans le cadre de l’opération Barkhane, 200 militaires des FFCI sont en permanence déployés dans la bande sahélo-saharienne. Par ailleurs, les FFCI jouent un rôle essentiel pour le soutien logistique de l’opération : acheminement et désengagement des hommes et du matériel, soutien pétrolier en particulier. Tous les deux ou trois mois, un bâtiment au départ de Toulon vient décharger du matériel en Côte d’Ivoire à destination de Barkhane.
Par ailleurs, les FFCI ont aussi pour mission d’assurer la protection des ressortissants et des intérêts français, d’assurer des actions de coopération avec les militaires ivoiriens (cf. infra) et d’effectuer une veille stratégique. Lors de l’été 2016, l’effectif des FFCI a été porté de 580 à 900 hommes. Cette réorganisation a pu apparaître comme consécutive à l’attentat de Grand Bassam ; elle constituait en réalité l’achèvement d’un processus entamé de longue date.
- Le camp de Port-Bouët, une « pépite »
Le camp de Port-Bouët est pour nous « une pépite » : il offre à l’armée française des conditions de travail exceptionnelles.
Ce camp implanté à Abidjan date de 1962. D’une superficie totale de 260 hectares, il est mis à disposition de la France par la Côte d’Ivoire. Celle-ci a aussi octroyé des emprises qui affranchissent les militaires des contingences de la circulation aérienne et par les ponts. Les FFCI jouissent d’une liberté totale de circulation sur le territoire ivoirien.
La localisation du camp de Port-Bouët en fait un lieu éminemment stratégique. Il est pratiquement colocalisé avec le port d’Abidjan, qui constitue le premier port d’Afrique subsaharienne en eau profonde. Il est à proximité immédiate de l’aéroport international. Il est enfin situé sur une presqu’île dont il est aisé de bloquer les accès en cas de nécessité.
Enfin, les militaires français ont aussi accès au camp de Lomo nord, qui appartient à l’armée ivoirienne. Dans ce camp de tir, ils peuvent s’entraîner à tous les systèmes d’armes.
• Un rôle important pour appuyer la reconstruction de l’armée ivoirienne
La France joue un rôle important pour soutenir la reconstruction de l’armée ivoirienne. Cette coopération, coordonnée par l’attaché de défense, est mise en œuvre par les coopérants techniques déployés par la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) pour les aspects structurels et principalement par les FFCI pour les aspects opérationnels.
La coopération structurelle conduite par la DCSD bénéficie en 2017 d’un budget de 3,3 millions d’euros pour la défense et 1,8 millions d’euros pour la sécurité intérieure et la protection civile ; elle s’appuie sur 17 coopérants déployés dans le pays.
- Un conseil de haut niveau dans les sphères politico-militaires
La mission de défense française, constituée de l’attaché de défense et d’une douzaine de coopérants, entretient une coopération très étroite avec la Côte d’Ivoire. La France est le seul pays à être si bien inséré dans les structures institutionnelles ivoiriennes, au plus haut niveau. Des conseillers français sont ainsi placés auprès du chef d’état-major général de l’armée, du ministre de la Défense (Alain-Richard Donwahi), mais aussi du commandant de la marine nationale et d’autres encore.
Ces coopérants ont pour mission de conseiller et d’assurer un suivi des réformes. Ils sont notamment amenés à apporter des conseils sur des chantiers de grande ampleur, comme la réforme des ressources humaines au sein de l’armée ivoirienne, l’un des volets prévu par la loi de programmation militaire. L’objectif est d’aider les Ivoiriens à réaliser une déflation des effectifs de l’armée et à mettre en place de vrais outils de gestion du personnel et une bonne gouvernance. L’appui des coopérants français est essentiel dans ce domaine. Un projet d’appui à la formation des sous-officiers a par ailleurs vu le jour.
De manière générale, les conseillers français s’emploient à aiguiller les principaux acteurs de la réforme du secteur de la sécurité en s’inspirant des modèles qui ont fonctionné pour la France. La loi de programmation militaire (LPM) ivoirienne, dont les coopérants français ont été les principaux artisans, est largement inspirée de la LPM française.
Il convient de noter que le conseil de haut niveau – auprès du Ministre et des directeurs généraux – a été renforcé depuis deux mois dans le domaine de la sécurité intérieure. Les actions entreprises incluent désormais la formation des cadres.
- La coopération anti-terroriste
Depuis les attentats de Grand Bassam, le 13 mars dernier, la coopération en matière de renseignement et de lutte antiterroriste s’est intensifiée entre nos deux pays. Une réorientation des actions de coopération de la France vers cette priorité a ainsi été décidée.
La coopération antiterroriste concerne à la fois les forces de défense et de sécurité. Elle se décline à plusieurs niveaux : entre les forces spéciales françaises et les forces spéciales ivoiriennes ; entre le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale française (GIGN) et l’unité d’intervention de la gendarmerie nationale ivoirienne (UIGN) ; et entre les services de renseignement français et les services de renseignement ivoiriens.
Dans un contexte de recrudescence de la menace terroriste en Afrique de l’ouest, avant même l’attentat de Grand Bassam, le ministre de l’Intérieur Hamed Bakayoko avait sollicité un appui français pour structurer des forces d’intervention rapide sur l’ensemble du territoire ivoirien. Les forces spéciales avaient alors été identifiées comme l’entité la plus à même de répondre à ce besoin. Des actions de formation des forces spéciales ivoiriennes ont ainsi été mises en place avec le concours de plusieurs partenaires, dont la France et le Maroc.
La nouvelle priorité donnée à la lutte contre le terrorisme a conduit à élaborer des actions de coopération visant à développer, au sein des forces armées et de sécurité ivoiriennes, des compétences en matière de renseignement, de police technique et scientifique, de cyberdéfense et de lutte contre la cybercriminalité. La France appuie notamment la structuration d’une chaîne de renseignement ivoirienne qui s’avère être un chantier assez urgent.
- Un soutien opérationnel sur terre et en mer
Le contexte actuel est favorable à une bonne dynamique de coopération entre les forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) et les forces armées ivoiriennes, nouvellement rebaptisées FACI (Forces armées de Côte d’Ivoire).
Cette coopération est centrée autour de la formation pour accompagner la montée en puissance de l’armée ivoirienne. Le contenu des formations est varié : techniques de combat, instruction sur le tir de combat, techniques d’intervention opérationnelle rapprochée, systèmes d’information et de communication, maintenance, communication opérationnelle ou encore sauvetage au combat. Ces actions sont conduites sous forme de détachements d’instruction opérationnelle (DIO).
Les DIO sont prioritairement orientés vers la préparation des unités susceptibles d’être déployées à l’extérieur des frontières ivoiriennes. Ainsi, depuis trois ans, les FFCI contribuent à la formation d’une compagnie (150 hommes) devant être déployée au sein de la MINUSMA, au Mali. Elle devait l’être en janvier 2017. Cet envoi est toutefois sans cesse reporté et les informations à ce sujet semblent désormais peu fiables. En outre, la formation de cette compagnie se heurte à plusieurs obstacles dont, parfois, le manque de professionnalisme de soldats ivoiriens.
D’autres DIO moins ambitieux ont fait leurs preuves. Ainsi, en décembre dernier, les FFCI ont conduit une formation de moniteurs-instructeurs sur le tir au combat. Il existe également un projet de remise à niveau du bataillon parachutiste local, dont le dernier saut tactique remonte à 17 ans.
À l’intérieur du pays, la sécurisation de la frontière ivoiro-malienne, qui reste une zone difficile d’accès pour les FACI, pourrait être l’un des champs d’action d’une nouvelle coopération. Un appui des FFCI pour cette mission aurait le mérite d’être en synergie avec les actions conduites par Barkhane et les armées du G5 Sahel pour renforcer le contrôle des frontières.
L’armée française épaule par ailleurs l’action de l’Etat en mer ivoirienne via la mission Corymbe, qui assure la présence quasi-permanente d’un bâtiment français dans le Golfe de Guinée. Cette présence a deux objectifs majeurs : la protection des intérêts français dans la zone et la diminution de l’insécurité maritime par un soutien aux marines riveraines. Celui-ci vise à accroître leurs capacités dans les domaines de la sécurité et de la surveillance maritime. À cette fin, des exercices de coopération sont fréquemment réalisés.
En mai 2016, par exemple, l’exercice NEMO (Naval Exercice for Maritim Operation) a mis en scène une infraction d’un navire de pêche qui a dû être intercepté par les marines ivoirienne, guinéenne et libérienne. Fin août 2016, lors d’une escale à Abidjan, le bâtiment de projection et de commandement (BPC) Dixmude et le patrouilleur de haute mer Commandant Ducuing ont conduit des périodes d’instruction opérationnelle au profit de la marine ivoirienne.
• Perspectives
Les bienfaits de la coopération de défense franco-ivoirienne sont reconnus par les deux parties ; il existe de grands besoins et une réelle attente du côté ivoirien.
Cependant, les actions de coopération se heurtent à un manque de moyens et parfois, côté ivoirien, à une trop faible impulsion pour donner du contenu aux projets. Le projet de soutien à l’Académie des métiers de l’air d’Abidjan (AMAA) en est un exemple éloquent. Ce projet a pris l’allure d’une usine à gaz alors que l’école pourrait être un pôle d’excellence aéronautique en Afrique de l’ouest. Les formations dispensées par la société française IAS (International aircraft services) ont finalement été interrompues faute de paiement par les ministères de la Défense et de l’Intérieur ivoiriens.
Du côté français, les moyens alloués par la direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) n’ont cessé de décroître au cours des dernières années. En Afrique subsaharienne, le nombre de coopérants est ainsi passé de 245 en 2011 à 226 en 2015. En Côte d’Ivoire, un poste de coopérant à l’aéroport d’Abidjan a été supprimé en août 2016. Les moyens consacrés aux partenaires de la France en Afrique de l’ouest ont néanmoins été priorisés. Le projet ASECMAR (Appui à la réforme du système de sécurité maritime) en atteste : destiné à six pays du Golfe de Guinée dont la Côte d’Ivoire, il s’élève à 1,2 millions d’euros sur la période 2011-2015.
Si la France est de loin le pays le mieux inséré dans les structures institutionnelles de défense ivoirienne, il convient de mentionner l’émergence de nouveaux partenaires. Contrairement à la coopération française qui est permanente et structurelle, les actions conduites par d’autres pays comme le Maroc ou les États-Unis ont un caractère plus ponctuel. Le Maroc a par exemple fait des dons de matériels militaires et forme de nombreux officiers ivoiriens, y compris sur son territoire. Dans le cadre de l’AFRICOM (le commandement militaire américain pour l’Afrique), les Américains financent quant à eux une aide destinée à renforcer la bonne gouvernance et les capacités des forces armées ivoiriennes.
En dépit des limites évoquées, la coopération de défense en Côte d’Ivoire se déroule sous de bons auspices. D’importants progrès ont été réalisés depuis la fin de la crise en termes de capacités de défense. Des projets sont continuellement proposés et les autorités ivoiriennes plébiscitent la pérennisation et l’approfondissement de cette coopération. Celle-ci n’a pourtant pas vocation à se substituer aux actions conduites par les Ivoiriens eux-mêmes, et sa bonne marche dépend de la volonté réelle du partenaire ivoirien de conduire jusqu’au bout la réforme du secteur de la sécurité qui a été engagée.
Néanmoins, les mutineries récentes ont mis en lumière les limites des avancées de la construction d’une armée nationale alors que plusieurs problèmes de fond n’ont pas été réglés (cf. II.D). La coopération française doit s’adapter à cette donnée. Ainsi, d’après Rémi Maréchaux, directeur Afrique et Océan Indien au ministère des affaires étrangères, une réorientation des actions de coopération serait en cours. Il s’agirait de revenir à une coopération « à moins haute valeur ajoutée », portant essentiellement sur l’encadrement des hommes. Les mutineries ont en effet montré qu’il fallait renforcer les fondements de cette armée ivoirienne et que les objectifs ambitieux qui avaient été fixés avec l’appui de la coopération française ne pourraient être atteints qu’à plus long terme.
B. UNE POSITION FORTEMENT CONCURRENCÉE
« Nous ne reconnaissons plus notre Côte d’Ivoire ». Cette expression spontanée d’un entrepreneur français (80) met en lumière un sentiment répandu chez les Français habitués à la Côte d’Ivoire d’Houphouët-Boigny, perpétuée, tant bien que mal, aux cours des années 1990. Celle-ci se trouvait alors dans une sorte de tête à tête quasi-exclusif avec la France.
L’empreinte de notre pays est encore forte en Côte d’Ivoire, mais elle est concurrencée. La Côte d’Ivoire est plus ouverte au monde, elle joue désormais sur différents tableaux en fonction de ses intérêts nationaux.
Traditionnellement premier investisseur étranger en Côte d’Ivoire, la France s’est vue détrônée en 2015 par le Maroc (81). Ce pays, lui-même un partenaire privilégié de la France, tire parti de sa francophonie, de sa relative avance de développement et d’un discours sur la coopération sud-sud qui trouve un réel écho pour étendre son influence en Afrique de l’ouest et centrale.
Si ce développement est encore embryonnaire quand on considère la structure des échanges du Maroc, encore très largement tournés vers l’Union européenne (64% des importations et 69% des exportations marocaines, contre 10% pour l’Afrique), il doit retenir l’attention de la France à plusieurs titres.
Premièrement, il répond à une stratégie clairement énoncée et portée personnellement par le roi Mohammed VI, avec une constance et un engagement sur le long terme qui méritent d’être notés. Deuxièmement, les acteurs marocains font preuve d’une audace et d’une propension à la prise de risques qui contraste parfois avec leurs homologues français. Enfin, le Maroc se fait le chantre du « co-développement », de la coopération d’égal à égal sans rapports de forces, problématiques qui trouvent un écho dans des pays qui ont en commun d’être des anciennes colonies françaises.
La mission d’information s’est rendue au Maroc pour mieux apprécier cette dynamique africaine – et en particulier ivoirienne – du royaume. Elle a été frappée par le fait que les acteurs économiques et la société civile marocaine font bloc derrière cette stratégie impulsée par le roi, dont les premiers résultats suscitent une certaine fierté.
• Les grandes phases de la construction du partenariat maroco-ivoirien
Les Marocains nous rappellent souvent que les liens qui les unissent à l’Afrique de l’ouest sont anciens. Des caravanes de marchands descendaient depuis le Maroc jusqu’aux principales villes de l’Afrique de l’ouest. L’islam a été diffusé dans cette région par les confréries soufies marocaines. La fluidité des mouvements de population dans cette partie de l’Afrique avait ainsi permis de tisser des liens culturels et religieux qui comptent encore aujourd’hui. De nombreux observateurs estiment d’ailleurs que l’identité du Maroc est africaine avant d’être arabe, ce qui le distinguerait des autres pays du Maghreb.
Une relation institutionnelle s’est nouée entre le Maroc et la Côte d’Ivoire au lendemain des indépendances. Elle était très cordiale entre Hassan II et Houphouët-Boigny. Le Maroc cherchait à cette époque, par le développement de ses relations bilatérales avec les pays d’Afrique, des soutiens sur la question du Sahara occidental. Un temps refroidies sous la présidence de Laurent Gbagbo, les relations bilatérales sont redevenues très amicales avec l’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara.
Une relation sociale et culturelle s’est nouée à partir des années 1970. Le Maroc a voulu ouvrir l’accès de ses établissements scolaires et universitaires aux étudiants subsahariens, d’abord aux Sénégalais puis aux Ivoiriens, auxquels des bourses ont été octroyées pour des cursus civils et militaires.
La relation économique s’est nouée à partir des années 2000. Le Maroc s’était construit des champions nationaux qui avaient atteint une certaine maturité sur le marché national. Leur mouvement naturel a donc été de se tourner vers l’Afrique, où les opportunités d’investissement étaient nombreuses. L’Afrique était alors un terrain largement inexploré pour les entreprises marocaines, toutes entières tournées vers le commerce avec l’Europe. L’opportunité d’un rééquilibrage est progressivement apparue. Les premières opérations ont été conduites dans le secteur bancaire, puis la présence des banques a créé un appel d’air pour d’autres secteurs, en particulier l’immobilier et les assurances. Pour l’essentiel, les entreprises marocaines ont procédé par rachat de filiales locales.
Des tournées royales ont été organisées en 2013, 2014 et 2015 afin de prolonger et d’amplifier ce mouvement ; elles se sont soldées par la signature de plusieurs dizaines d’accords. Des groupes d’impulsion économiques ont par ailleurs été créés afin d’identifier de nouveaux axes de coopération porteurs.
• La stratégie africaine du Maroc
La stratégie du Maroc en Afrique repose d’abord sur une impulsion politique donnée au plus haut niveau, par le roi Mohammed VI. Elle est assise sur des relations personnelles privilégiées avec certains présidents africains : à cet égard, l’entente entre Mohammed VI et Alassane Ouattara est réputée particulièrement cordiale. Le roi a pris le temps d’impulser une dynamique : les tournées royales en Côte d’Ivoire ont duré plusieurs jours, quand les responsables français ne restent que quelques heures. D’après Karim el Aynaoui, directeur général du think tank marocain OCP Policy center, cet investissement royal « donne de l’espace au business ». Cette impulsion politique s’avère nécessaire en l’absence d’aides publiques à l’internationalisation des entreprises, hors de portée des moyens de l’État marocain.
La stratégie africaine du Maroc repose par ailleurs sur un discours bien rodé. Le royaume se fait le promoteur de la coopération sud-sud, d’égal à égal, sans rapports de forces. Il insiste sur son identité africaine qui lui permet de partager les réalités des pays d’Afrique subsaharienne et de les comprendre. Le royaume met aussi en avant son statut de pays à revenu intermédiaire, qui connaît les défis et urgences du développement ; il propose de partager son expérience avec les pays d’Afrique qui souhaitent monter dans la chaine de valeur et s’intégrer au commerce international. Le Maroc insiste aussi sur la primauté du pragmatisme dans les relations économiques. Comme le souligne Karim El Aynaoui, entre les pays africains et le Maroc, « on parle tout de suite affaires, on a le bon niveau de dialogue ». Enfin, le royaume met en avant la dimension mutuellement bénéfique du partenariat qu’il propose, le visage humain du développement qu’il souhaite promouvoir.
Ces différents messages ressortent très clairement des discours prononcés par le roi Mohammed VI (82): « auparavant la diplomatie était au service de la consolidation des relations politiques. Aujourd’hui, c’est la dimension économique qui prime et constitue l’un des fondamentaux des relations diplomatiques. La coopération, hier basée sur la relation de confiance et les liens historiques, est, aujourd’hui, de plus en plus fondée sur l’efficacité, la performance et la crédibilité. (…) L’Afrique est un grand continent, par ses forces vives, ses ressources et ses potentialités. Elle doit se prendre en charge, ce n’est plus un Continent colonisé. C’est pourquoi l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique. Elle a moins besoin d’assistance, et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques ».
Ce message trouve un certain écho dans les pays d’Afrique subsaharienne, en particulier en Côte d’Ivoire. Cependant, comme tout discours, il comporte une part d’embellissement dont les Ivoiriens sont bien conscients. Ainsi, selon une interlocutrice « le discours sud-sud des Marocains agace un peu car ils se sont longtemps détournés de l’Afrique ». Par ailleurs, le côté mutuellement bénéfique du partenariat maroco-ivoirien comporterait une part de mythe. Des entrepreneurs français signalaient ainsi que le chantier pharaonique de la réhabilitation de la Baie de Cocody, dont ont hérité les Marocains, semblait employer peu d’entreprises locales.
Enfin, la stratégie marocaine en Afrique est ordonnée autour d’une ambition : celle de devenir un hub régional – voire continental – au même titre que l’Afrique du sud. Si les deux pays se trouvent ainsi en situation de rivalité, leurs pays cibles ne sont pas vraiment les mêmes. L’Afrique du Sud constitue davantage un hub à destination de l’Afrique de l’est et australe. Le Maroc aurait donc toute sa place pour jouer ce rôle en Afrique de l’ouest et centrale, qui correspond à sa « zone de confort ».
À cette fin, le royaume dispose de plusieurs outils dont certains demandent encore à monter en puissance. Le plus élaboré est sans doute pour le moment la compagnie aérienne Royal Air Maroc, qui ouvre sans cesse de nouvelles lignes directes à destinations de l’Afrique subsaharienne, y compris à présent vers l’Afrique de l’est (Nairobi, Kigali, Addis Abeba) qui était auparavant la chasse gardée d’Ethiopian Airlines. Le Maroc a aussi créé une place financière, la Casablanca finance city. Enfin, il cherche à développer ses capacités logistiques pour échanger avec l’Afrique subsaharienne, dans un contexte où les infrastructures de transport intra-africaines restent largement défaillantes. Il a ainsi créé le port en eaux profondes Tanger Med afin d’accroître ses capacités de transport de fret. Le Maroc construit par ailleurs une route en Mauritanie afin d’alimenter les marchés subsahariens, et doit mettre en place une plateforme logistique pour l’exportation des fruits et légumes dans le port d’Abidjan. Enfin, le Maroc est lié par des accords de libre-échange aux deux grandes zones économiques que sont les États-Unis (83) et l’Union européenne (84).
Il convient enfin de noter que les Marocains ont, à l’appui de leur ambition, une certaine audace et une aversion au risque qui paraît nettement moins prononcée que celle de leurs homologues français. C’est particulièrement vrai pour les banques. Ainsi, pour la directrice régionale de Business France, « les Marocains sont puissants parce que leurs banques les soutiennent ». En revanche, le Maroc ne dispose pas vraiment d’une image de marque dont il peut se prévaloir. La qualité de ses produits est décrite par des interlocuteurs de la mission comme « acceptable, bien adaptée au marché africain ».
• La présence économique marocaine aujourd’hui
Les entreprises marocaines ont considérablement développé leur implantation en Côte d’Ivoire, marché qui concentre le quart des investissements direct à l’étranger (IDE) marocains. Le Maroc a même décroché le titre de premier investisseur étranger en Côte d’Ivoire en 2015, avec au total 22% des agréments délivrés par le Centre de promotion des investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI), contre 16% pour la France.
L’expansion marocaine s’est appuyée sur une montée en puissance très offensive des banques. Trois grandes banques marocaines, Attijariwafa Bank, BMCE-Bank of Africa et Banque populaire, ont ainsi conquis une position très forte sur un marché historiquement acquis aux banques françaises, en procédant par rachat de banques panafricaines ou de filiales locales. Elles ont ainsi largement détrôné les banques françaises en nombre d’agences et sont au coude à coude avec ces dernières en valeur d’actifs bancaires. Les banques marocaines ont pu profiter d’un mouvement de retrait des banques françaises, à l’image d’Attijariwafa bank qui a racheté la SIB, filiale du Crédit agricole, en 2009.
Les banques marocaines ont la caractéristique d’être peu averses à la prise de risques, ce qui les distingue des françaises, jugées frileuses. Ces dernières continuent d’accompagner les grands groupes français en Côte d’Ivoire mais refusent d’investir dans des projets qui ne comportent pas de garantie des bailleurs de fonds internationaux. Les banques marocaines se montrent beaucoup plus disposées à financer l’économie ivoirienne ; la Banque centrale populaire a, par exemple, financé la société du réseau routier ivoirien FER et la société d’opérations pétrolières PETROCI. Les banques marocaines auraient toutefois été appelées à plus de prudence dans leurs opérations d’acquisition et de refinancement par la Banque centrale de leur pays, ce qui expliquerait le recul des investissements marocains constaté au premier semestre 2016.
Les banques ont accompagné l’expansion d’entreprises marocaines dans d’autres secteurs. Le Maroc est ainsi présent dans les télécoms via Moov, l’opérateur local de Maroc télécoms, qui était en septembre 2015 le troisième opérateur derrière Orange et MTN (Afrique du sud), avec 20% du marché. Il est présent dans l’immobilier où il revendique une expertise dans le logement social, avec le groupe Addoha et sa filiale Ciments d’Afrique, ainsi que dans les assurances (groupe Saham). Le Maroc a décroché le contrat emblématique de la réhabilitation de la baie de Cocody, chiffré à 137 millions d’euros et financé par les banques marocaines.
Cette expansion rapide, alors que les entreprises marocaines étaient quasiment absentes il y a dix ans, est indéniablement impressionnante. Cependant, le royaume a encore du chemin à parcourir pour consolider sa position. Pour l’heure, son expansion s’est principalement effectuée dans le secteur des services ; l’assise industrielle du Maroc reste ainsi très faible en Côte d’Ivoire par rapport à celle de la France. Par ailleurs, les flux commerciaux entre le Maroc et la Côte d’Ivoire ont certes augmenté mais restent assez modestes : 200 millions de dollars en 2015 contre 80 millions en 2010, ce qui fait de la Côte d’Ivoire le sixième client et le douzième fournisseur du Maroc.
• Le « soft power » marocain
La stratégie africaine marocaine est une stratégie d’influence générale qui n’est pas uniquement cantonnée à l’économie : « le Maroc va en Afrique avec un modèle ».
Le premier pilier de l’influence marocaine est sans doute le champ du religieux, en raison du statut de « Commandeur des croyants » reconnu au roi du Maroc. À ce titre, celui-ci dispose d’une réelle aura parmi les populations musulmanes d’Afrique de l’ouest, dont l’islam est historiquement issu des confréries marocaines.
Ce statut donne une légitimité au Maroc pour présenter son islam « du juste milieu » comme un modèle pour l’Afrique, dans un contexte de montée des extrémismes et de forte concurrence du wahhabisme importé des pays du Golfe. Le Maroc a d’ailleurs mis en place un « Institut Mohammed VI pour la formation des imams » qui dispense une formation à cet islam du juste milieu, largement accessible aux imams subsahariens mais aussi européens. Une centaine de jeunes imams et prédicateurs ivoiriens se trouvent actuellement dans cet institut pour une formation de deux ans.
Par ailleurs, d’après Karim El Aynaoui, le Maroc peut partager avec les autres pays africains son expertise dans la structuration du champ religieux : l’État a en effet repris la main sur les lieux de culte via la direction des mosquées du ministère des Habous, et les imams marocains sont désormais des fonctionnaires de l’État.
Le soft power marocain trouve également à s’exercer dans le champ de l’éducation et de la formation. Le Maroc a largement ouvert les portes de ses universités aux étudiants d’Afrique subsaharienne : plus de 10.000 étudiants étrangers dont 7400 boursiers ont été accueillis en 2014 ; 70% d’entre eux étaient originaires d’Afrique subsaharienne. Avec la Côte d’Ivoire, cette coopération en matière de formation est à la fois civile et militaire. Ainsi le Maroc contribue-t-il, entre autres, à former les forces spéciales ivoiriennes aux côtés de la France. Cet accueil des étudiants d’Afrique subsaharienne s’accompagne d’une attitude ouverte à l’immigration : le pays est ainsi fier, après avoir longtemps été une terre d’émigration, d’être devenu un pays d’immigration. Le royaume a procédé à des régularisations massives d’immigrés subsahariens illégaux : 20 000 migrants ont été concernés en 2014 et une nouvelle vague de régularisations a été annoncée en 2016.
Enfin, la francophonie est, à l’évidence, un levier important de l’influence marocaine en Afrique de l’ouest et centrale, et, singulièrement, en Côte d’Ivoire. Le Maroc a d’ailleurs ouvert récemment une antenne de radio en modulation de fréquence, Hit Radio. De ce point de vue, il se trouve ouvertement en concurrence avec la France. Comme l’ont observé les interlocuteurs marocains de la mission, « notre zone de confort est la même » : l’Afrique de l’ouest et centrale.
• La coopération triangulaire Maroc-France-Côte d’Ivoire, un format d’avenir ?
L’existence de cette « zone de confort commune » au Maroc et à la France et la volonté conjointe des deux pays de s’aventurer en dehors de cette zone, en Afrique de l’est notamment, a suscité l’idée que les deux pays pourraient élaborer une stratégie commune en Afrique, dans le cadre d’une coopération triangulaire nord-sud-sud.
Cette idée était confortée par le fait que la France et le Maroc ont une relation dense et de nombreuses convergences dans leur manière d’aborder le continent africain. La France demeure le premier partenaire commercial et le premier investisseur au Maroc. Les diplomaties de nos deux pays convergent quant à leurs objectifs pour le continent africain : bonne gouvernance et État de droit, règlement pacifique des différends, lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme religieux, etc. La convergence est évidente sur le plan sécuritaire : le Maroc a accompagné la France en Libye, au Mali, en Centrafrique et participe aux opérations de maintien de la paix de l’ONU dans plusieurs pays du continent. Un contingent marocain était ainsi déployé au sein de l’ONUCI en Côte d’Ivoire. Le Maroc contribue, aux côtés de la France, à la formation des forces spéciales ivoiriennes. Il est certain que l’expertise et le statut marocains dans le champ religieux, ainsi que sa volonté d’incarner un islam « du juste milieu » sont pour la France une option intéressante en Afrique, en résonance avec ses propres objectifs.
La reconnaissance du potentiel de cette coopération triangulaire a fait l’objet de plusieurs discours et manifestations publics au cours des dernières années. Ainsi, le Club des chefs d’entreprises France-Maroc, qui rassemble le Medef International et la Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) a fait de cette nouvelle triangulaire un axe de travail central. Le patron d’Attijariwafa Bank, Mohammed El Kettani, estimait ainsi que la France et le Maroc pourraient « mieux combiner les forces respectives des opérateurs économiques des deux pays en termes de recherche et développement, d’innovation, de ressources humaines, de coûts du risque dans l’objectif de bâtir de nouveaux avantages compétitifs à l’export et conquérir ensemble de nouveaux marchés, à cet égard le co-investissement des entreprises françaises et marocaines est de plus en plus ciblé et à double sens ».
À l’heure actuelle, ces réflexions semblent pourtant avoir trouvé peu d’applications pratiques. En Côte d’Ivoire, la concurrence est plutôt de mise entre les entreprises françaises et marocaines. Certes, certains groupes, comme Accor, Axa ou encore Peugeot font du Maroc une plateforme pour leurs activités en Afrique. Mais cet état de fait relève davantage d’initiatives individuelles que d’une stratégie concertée. Votre rapporteure pense cependant que cette piste de la coopération triangulaire devrait être creusée plus avant, sans a priori, tant les complémentarités du Maroc et de la France semblent importantes s’agissant du niveau de développement, du rapport au risque, de l’histoire, de la culture, du rapport au religieux, du niveau de développement, de l’image, etc.
2. La montée en puissance des pays émergents
La dynamique des pays émergents est aujourd’hui incontestable en Côte d’Ivoire comme ailleurs en Afrique. La présence chinoise n’y a pas le caractère parfois hégémonique qu’on lui trouve ailleurs sur le continent, dans des pays qui, à l’instar du Congo Brazzaville, ont une économie quasi exclusivement tournée vers l’exploitation des ressources minières. Cette présence chinoise est néanmoins en très nette expansion, comme celle d’autres acteurs émergents et asiatiques.
Ces nouveaux acteurs sont des concurrents sérieux pour les entreprises françaises. Comme le soulignent plusieurs chefs d’entreprises, ils viennent en Côte d’Ivoire avec de vrais projets structurants et des solutions de financement. S’ils pèsent encore relativement peu dans le stock des investissements directs étrangers en Côte d’Ivoire, ils parviennent à décrocher des marchés substantiels et soignent de plus en plus leur image.
• Les Chinois
- L’essor rapide des produits et entreprises chinoises
Il est incontestable que la Chine a récupéré une bonne partie des parts de marché perdues par la France depuis le début des années 2000. Elle assure ainsi 13% des importations ivoiriennes en 2016 contre 3% dix ans plus tôt. En 2015, ces importations s’élevaient à environ 1,1 milliard d’euros, un montant similaire à celui des importations en provenance de France. En revanche, la Côte d’Ivoire n’étant pas un grand pays exportateur de pétrole et autres ressources minières, la Chine n’est qu’une destination marginale pour les exportations du pays, de l’ordre 1% (86 millions d’euros en 2015), un taux globalement stable depuis cinq ans.
En Côte d’Ivoire, les entreprises chinoises ont une position très forte dans la cimenterie et le BTP, où elles décrochent une grande partie des marchés. Pour n’en donner que quelques exemples emblématiques, des entreprises chinoises ont été retenues pour la construction de l’autoroute Abidjan-Grand Bassam, celle du barrage hydraulique de Soubré et pour la réhabilitation et l’extension du port autonome d’Abidjan. Il convient de noter que ces différents projets bénéficient d’un financement chinois.
Par ailleurs, il semble que le chinois Startimes soit en bonne position pour remporter les marchés autour du déploiement de la TNT en Côte d’Ivoire. Or, ce chantier était jugé très important pour l’influence française en Afrique de l’ouest. Ce ne sera donc pas anodin si Startimes parvient à s’imposer.
- Un effort pour soigner son image
Comme ailleurs en Afrique, la Chine n’emploie quasiment pas d’employés locaux mais « exporte » ses travailleurs. C’est incontestablement l’une des faiblesses de l’offre chinoise, qui fait qu’elle reste considérée avec une certaine défiance dans le pays.
Néanmoins, la Chine soigne son image. Elle est un acteur important de l’aide au développement dans le pays. D’après l’AFD, c’est même le premier bailleur bilatéral en raison de deux prêts d’un montant de l’ordre de 800 à 900 millions d’euros octroyés récemment, qui venaient s’ajouter à d’autres aides en cours.
Comme partout ailleurs, l’aide chinoise est liée : elle finance des projets dont la construction est assurée par des entreprises chinoises, dans le cadre d’appels d’offre réalisés en Chine. La Chine doit ainsi « offrir » à la Côte d’Ivoire un stade olympique de 60.000 places pour la Coupe d’Afrique des Nations de 2021. Ses entreprises en assureront intégralement la construction, pour un budget global de 50 milliards de francs CFA (75 millions d’euros).
La mission n’a pas manqué d’entendre les appréciations mitigées sur la qualité des routes chinoises, dont la fine couche de bitume serait déjà hors d’état d’usage au bout de quelques années. En réalité, l’une des forces des entreprises chinoises est la flexibilité de leur offre : elles peuvent fabriquer une route pour 1000 ou pour 20.000 euros, en fonction de la demande. Si le bitume est trop fin sur certaines routes, cela tiendrait donc davantage à l’insuffisance des crédits engagés à cette fin qu’à une quelconque incapacité chinoise à bâtir des routes de qualité.
En outre, contrairement à une idée reçue, les Chinois s’appliqueraient de plus en plus à maîtriser le français pour évoluer en Afrique francophone. Ce souci serait l’une des motivations de la montée en puissance de l’enseignement du français en Chine, devenu la troisième langue étrangère enseignée après l’anglais (largement prédominant) et le russe. Le rapport de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) paru en 2014 recense environ 10.000 à 15.000 Chinois apprenant le français au niveau secondaire, 70.000 à 80.000 dans les universités et 10.000 à 20.000 dans des centres privés. Les Alliances françaises ont également recensé des demandes croissantes qui ont suscité la multiplication des implantations entre 2000 et 2010, année d’ouverture du quinzième établissement. 26 000 Chinois étudieraient actuellement le français au sein de ce réseau. Au total, l’OIF estime qu’entre 110.000 et 125.000 Chinois apprennent le français (ou en français) en Chine.
Par ailleurs, le nombre d’étudiants chinois en France n’a cessé de croître et devrait prochainement passer devant celui des Américains, qui représentaient jusqu’alors la première communauté étudiante du pays. En 2013, l’UNESCO décomptait environ 25.200 étudiants chinois en France dans le cadre de formations diplômantes, ce qui faisait de la France le huitième pays d’accueil de ces étudiants. Le ministère des Affaires étrangères, qui prend en compte l’ensemble des étudiants, en recensait environ 29.700 pour l’année académique 2014-2015 et observait un plafonnement de cette mobilité depuis 2010 – parallèlement à un plafonnement global de la mobilité étudiante chinoise à travers le monde.
L’attraction des étudiants chinois correspond à une politique volontariste des autorités françaises pour accroître l’influence de la France dans ce pays où celle des pays anglo-saxons demeure très hégémonique. Un rapport de Campus France relevait que la motivation principale des étudiants chinois en France était la culture du pays et sa langue (aspects mentionnés par environ 60% des étudiants) quand la qualité de la formation (47% des étudiants) et la réputation des établissements français (18%) apparaissaient comme des facteurs moins importants. Ainsi, les opportunités d’un travail en Afrique francophone – au sein des entreprises chinoises ou de la diplomatie – constituent indéniablement l’un des moteurs du dynamisme de l’apprentissage du français en Chine.
- Les Chinois, des concurrents mais aussi des partenaires ?
Au total, la Chine et les produits chinois n’ont pas conquis en Côte d’Ivoire une position hégémonique comme chez certains de ses voisins en raison du maintien d’une forte empreinte française. À titre d’exemple, la communauté française au Ghana a affirmé à la mission que, dans ce pays, « tout est chinois » : la Chine y a en effet conquis une part de marché de 26%.
Cependant, la Chine progresse indéniablement. D’après une source officieuse de la Banque mondiale datée de 2015, elle détenait alors 38% de l’en-cours de la dette ivoirienne contre 32% pour la France. Cette part tombe à 13%, contre plus de 50% pour la France, si l’on inclut le C2D. Ce dernier correspond néanmoins à une dette ancienne, ce ratio est donc moins révélateur de la dynamique récente de l’endettement ivoirien.
Pour une interlocutrice, les Chinois ont « saturé les capacités d’investissement » des Ivoiriens qui souhaitent à présent mettre l’accent sur la qualité, ce qui jouerait en la défaveur de l’offre chinoise. Cependant, les Ivoiriens sont aussi à la recherche de solutions de financement qui rendent l’offre chinoise particulièrement attractive.
Peut-on imaginer de capitaliser sur les capacités de financement et de fabrication chinoises d’un côté, le niveau technologique et l’image de marque de la France de l’autre, ce qui se traduirait par des co-investissements franco-chinois en Côte d’Ivoire?
C’est le sens de la « Déclaration sur les partenariats franco-chinois sur les marchés tiers » effectuée par les gouvernements des deux pays lors de la visite du Premier ministre Li Kepiang en France, en juillet 2015. Cet accord souligne la volonté mutuelle des deux pays de rechercher des partenariats entre entreprises françaises et chinoises pour intervenir partout dans le monde, prioritairement en Asie et en Afrique, afin d’exploiter au mieux les complémentarités productives, techniques et financières de chacun. Ces partenariats, qui doivent porter sur des projets de grande ampleur avec une dimension structurante pour le pays tiers, doivent ainsi être au bénéfice mutuel de toutes les parties, la Chine, la France et le pays tiers, qui bénéficie d’une offre plus compétitive.
Afin d’impulser la mise en œuvre de cet accord, un « fond franco-chinois pour l’investissement dans les pays tiers » a été créé en novembre 2016 par la CDC International Capital, filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), et le fond souverain chinois CIC Capital. Doté d’une force de frappe initiale de 300 millions d’euros, abondés à parité par les deux institutions, il a pour ambition d’atteindre les deux milliards d’euros dans les années à venir, en accueillant d’autres investisseurs institutionnels. Un tiers sera investi en Afrique, un tiers en Asie et un tiers dans le reste du monde.
Les secteurs recensés pour ces co-investissements sont les énergies renouvelables et l’environnement, l’industrie manufacturière, les biens industriels et de consommation de détail, la santé, la logistique et les infrastructures. Il existe indéniablement des besoins substantiels dans ces domaines en Côte d’Ivoire. L’ancien Premier ministre Kablan Duncan avait accueilli favorablement l’idée de co-investissements franco-chinois dans le pays ; ce type de montages était susceptible de répondre aux aspirations et besoins ivoiriens. La mission n’a cependant pas encore eu connaissance, à ce stade, de projets d’investissements conjoints en Côte d’Ivoire.
• Les Turcs
La Turquie a entamé depuis le début des années 2000 une stratégie d’ouverture vers l’Afrique. Celle-ci s’est traduite par une densification rapide du réseau diplomatique turc en Afrique : le nombre d’ambassades y a triplé entre 2009 et 2016. La Turquie s’est imposée comme un hub aérien majeur à destination de l’Afrique grâce à sa compagnie aérienne, la Turkish Airlines, qui dessert de nombreuses destinations sur le continent.
Les relations avec la Côte d’Ivoire ont pu prospérer à la faveur de la fin de la crise ivoirienne. La Turkish Airlines a ouvert une ligne directe à destination d’Abidjan en 2013. Le Président Ouattara s’est rendu à Ankara et Istanbul en mars 2015, et le Président Erdogan a inclus la Côte d’Ivoire dans sa tournée ouest-africaine de février 2016. Au cours de ces deux visites, des dizaines d’accords de coopération ont été signés. Une délégation importante d’hommes d’affaires turcs accompagnait le Président Erdogan en février dernier pour participer à un forum économique organisé dans la capitale.
Les investissements turcs en Côte d’Ivoire ont d’ores et déjà beaucoup progressé : de 150 millions de dollars en 2008, ils seraient passés à 390 millions de dollars en 2015, selon les données officielles turques. Les échanges commerciaux sont encore à un niveau assez modeste mais ont beaucoup progressé depuis 10 ans. La Turquie représente 1% des importations ivoiriennes en 2015 (82 millions d’euros), une part globalement stable depuis 2010. Ces importations sont très diversifiées : huiles végétales ou animales, fonte, fer et acier, chaux et ciments, chaudières et machines, préparations alimentaires… Par ailleurs, 2% des exportations ivoiriennes (208 millions d’euros) étaient destinées à la Turquie en 2015 (cacao et ses dérivés pour 95% du total ; caoutchouc, bois) contre 1% en 2010. Au total, la Côte d’Ivoire est le principal partenaire de la Turquie en Afrique subsaharienne francophone.
Les entreprises turques peuvent se prévaloir d’une certaine expertise dans les domaines de l’énergie, de la construction et des infrastructures. Elles ont une présence importante dans le secteur du BTP (Fergen, INCI Group) en Côte d’Ivoire. On les retrouve aussi dans l’immobilier (Beta Group), l’électroménager (Beko), l’ameublement (Dekoset), la brasserie (EFES Pilsen)… Au total, une vingtaine de groupes ou de filiales seraient implantés en Côte d’Ivoire. D’après la directrice régionale de Business France, les Turcs s’avèrent très « doués et pragmatiques », et leur compétence est reconnue.
À la différence de la France et de la Chine où les grandes entreprises jouent un rôle premier, les petites et moyennes entreprises (PME) sont la clé de la stratégie turque en Afrique. La Turquie promeut le partage de savoir-faire au sein de ces PME, éventuellement sous la forme de co-entreprises turco-africaines. A la différence de la Chine, la Turquie met ainsi en avant sa volonté d’embaucher et de former de la main d’œuvre locale.
Il convient enfin de noter que la Turquie a apporté des appuis à la police ivoirienne (formation aux techniques d’intervention rapides, dons de matériels) via le contingent turc déployé dans le cadre de l’ONUCI, actuellement en cours de retrait du pays.
• Les Indiens
L’Inde s’impose de plus en plus comme un partenaire important pour la Côte d’Ivoire. Le commerce bilatéral a été multiplié par deux entre 2011 et 2015, où il a atteint 800 millions d’euros. Cela fait de l’Inde le cinquième partenaire commercial de la Côte d’Ivoire ; le commerce bilatéral demeure cependant assez peu diversifié. Les importations ivoiriennes en provenance d’Inde sont principalement portées par les médicaments et les équipements médicaux et pharmaceutiques. Elles sont à peu près équilibrées par les exportations à destination de ce pays (4% du total), dont les produits agricoles représentent une part importante. Ainsi, bien que la Côte d’Ivoire ait détrôné l’Inde comme premier producteur mondial d’anacarde en 2015, la majeure partie de la production ivoirienne est exportée brute vers ce pays qui en assure la décortication et la transformation.
Quant aux investissements indiens en Côte d’Ivoire, ils ont dépassé les 500 millions de dollars en 2015 et se sont principalement portés sur les secteurs de l’agriculture (Olam, Surice qui dominent le commerce de la noix de cajou), de l’exploitation minière (Taurian Manganese, Tata Steel, King Ivoire…), des technologies de l’information et de la communication, de la pharmacie, de l’électronique et des transports.
Par ailleurs, l’Inde a accordé plusieurs prêts à la Côte d’Ivoire, notamment pour financer un projet d’interconnexion électrique avec le Mali (deux prêts de 30 et 24 millions de dollars) et un projet de développement de la filière rizicole (30 millions de dollars).
Signe de la volonté réciproque de l’Inde et de la Côte d’Ivoire d’approfondir leur « partenariat stratégique », le Président indien Pranab Mukherjee a effectué une visite de quarante-huit heures en juin dernier, accompagné de nombreux chefs d’entreprises. La Côte d’Ivoire a alors été le seul pays d’Afrique francophone visité par le Président Mukherjee. Cette visite a été l’occasion de conclure plusieurs accords et de finaliser un contrat pour la livraison de 500 bus indiens Tata pour la société des transports abidjanais, la SOTRA, un contrat d’environ 85 millions d’euros. L’Inde a par ailleurs été sollicitée pour fournir 3600 véhicules de transport pour cette société.
Lors de cette visite, le Président indien a inauguré le siège de l’Exim bank of India à Abidjan. La banque d’import-export indienne ne disposait plus de siège en Afrique de l’ouest depuis la fermeture du bureau de Dakar, en 2014. Cette nouvelle implantation doit favoriser la dynamique des investissements indiens en Côte d’Ivoire. L’Inde est intéressée en particulier par le potentiel minier et pétrolier du pays et pourrait jouer un rôle pour accélérer la transformation des produits agricoles. La Côte d’Ivoire souhaite également bénéficier de l’expertise indienne en matière d’informatique.
Au total, même s’il est encore en devenir, le partenariat ivoiro-indien connaît ainsi une réelle dynamique, sous l’impulsion des deux parties. Il convient de noter que ce partenariat comporte aussi un important pilier universitaire ; l’Inde constitue ainsi un pôle de formation des étudiants ivoiriens. D’après le Gouvernement ivoirien, plus de 500 étudiants ivoiriens auraient bénéficié de stages de formation en Inde tous frais payés (transport, inscription, scolarité). Cependant, la qualité de l’enseignement dispensé est réputée inégale.
3. Le rôle ancien de la diaspora libanaise
La Côte d’Ivoire abrite la plus importante diaspora libanaise du continent africain. En 2009, elle était évaluée à 60 000 personnes sur un total de 250 000 à 300 000 sur l’ensemble du continent.
Cette diaspora s’est constituée en trois principales vagues. La première, modeste, de la fin du XIXème siècle aux années 1920, était principalement constituée de chrétiens maronites fuyant le joug de l’empire Ottoman. En 1913, on dénombrait ainsi 1000 Libanais environ en Afrique occidentale française (AOF). La deuxième vague a eu lieu pendant le mandat français sur le Liban (1920-1943) : des Libanais ont alors tenté leur chance en AOF, encouragés par la France qui voyait d’un bon œil l’arrivée d’immigrés réputés travailleurs et adaptables. La troisième vague, la plus massive, a été provoquée par la guerre du Liban : des habitants du sud, musulmans chiites pour la plupart, ont alors fui la conscription et l’occupation israélienne pour rejoindre la diaspora dont le poids économique avait commencé à s’affirmer.
Du fait de son implantation parfois très ancienne, cette diaspora libanaise n’est plus vraiment étrangère en Côte d’Ivoire. La plupart de ses membres se considèrent comme Ivoiriens et ne vont que rarement au Liban, où peu envisagent de se réinstaller un jour. Cependant, les Libanais de la diaspora cultivent une identité propre : les mariages mixtes avec les Ivoiriens sont rares et ils détiennent leurs propres réseaux, centres de santé et lieux de culte. Ils sont souvent chiites, à la différence des musulmans africains, sunnites pour la plupart. Cette communauté a souvent des affinités avec la France et les Français : si les mariages mixtes ivoiro-libanais sont rares, les mariages franco-libanais sont assez fréquents.
En Côte d’Ivoire, la communauté libanaise a un poids économique de premier plan. Un article de Jeune Afrique relevait qu’ils étaient crédités, en 2009, de « 60% du parc immobilier, 80% des activités de distribution, 50% de l’industrie, 70% du conditionnement et de l’imprimerie » (85). D’après la directrice régionale de Business France, Sophie Clavelier, les Libanais souhaitent à présent monter en gamme et voudraient pour cela bénéficier de l’expertise des entreprises françaises : « leur cœur penche vers la France ».
À la différence des Français, les Libanais sont en grande majorité restés dans le pays lors de la crise ivoirienne. « Avec un penchant nettement légitimiste, toujours du côté du pouvoir, n’hésitant pas à participer généreusement aux campagnes électorales », ils ont des relais très efficaces auprès du monde politique, qu’ils parviennent à maintenir au gré des alternances.
• Le Nigéria
Depuis 2008, la France a perdu sa place de premier partenaire commercial de la Côte d’Ivoire au profit du Nigéria. L’envolée des cours du pétrole avait en effet profité au Nigéria, dont 90 % des flux avec la Côte d’Ivoire correspondent au et aux produits pétroliers. La part de marché du Nigéria s’est donc fortement accrue avant de chuter à partir de 2014, avec la baisse du prix international du pétrole : de 22% en 2014, elle est passée à 16% en 2015, contre 14% pour la France et 13% pour la Chine.
S’agissant des ventes ivoiriennes à destination du Nigéria, elles sont principalement constituées de produits pétroliers raffinés et représentaient 3,7% des exportations ivoiriennes en 2015 contre 5% en 2014. Cela fait du Nigéria le premier client africain de la Côte d’Ivoire.
Quant aux investissements nigérians en Côte d’Ivoire, ils sont principalement concentrés dans l’intermédiation financière. Il convient aussi de noter l’installation annoncée du groupe nigérian Dangote, appartenant au milliardaire Aliko Dangote, qui devrait prochainement construire une usine de cimenterie à Attinguié, à proximité d’Abidjan.
Le Nigéria détenait 3,7% du stock d’IDE de la Côte d’Ivoire en 2014, ce qui le plaçait en cinquième position, derrière la France, les Pays-Bas, la Suisse et les États-Unis. Cependant, les performances des banques nigérianes en Côte d’Ivoire restent modestes à ce jour. À la différence de leurs homologues marocaines, elles n’ont pas accompli de réelle percée en l’absence de stratégie éprouvée. Le principal acteur du secteur est la Diamond Bank, qui occupe le dixième rang national par les ressources. Elle devance l’United Bank for Africa (UBA), qui occupe la quinzième place sur vingt-trois, et la filiale ivoirienne de GT Bank, bonne dernière du classement.
Comment expliquer la piètre réussite des banques nigérianes en Côte d’Ivoire, alors qu’elles ont connu de vifs succès ailleurs, notamment au Ghana ? Les différences culturelles et la ténacité de certains préjugés à l’égard des Nigérians sont fréquemment invoquées à l’appui de ce constat. Certains établissements ont par ailleurs pâti de problèmes managériaux.
Plus profondément, les banques nigérianes n’ont pas encore réussi à se trouver un créneau, dans un contexte où les transactions sur les importations de pétrole brut en provenance du Nigéria sont pilotées par la Société générale de banque en Côte d’Ivoire (SGBCI), la BNP Paribas et Ecobank, et en l’absence d’opérateurs économiques nigérians structurés auxquels adosser leur activité. Cette situation pourrait toutefois évoluer avec la mise en œuvre de grands projets structurants et intégrateurs comme l’autoroute Abidjan-Lagos, le gazoduc ouest-africain ou encore la procédure d’interconnexion des réseaux électriques de la sous-région.
• Les autres partenaires africains
L’Afrique du Sud est très présente dans l’exploitation minière en Côte d’Ivoire (Rangold resources). Elle détenait ainsi le troisième stock d’IDE en 2015, avec un total estimé à 256 millions d’euros. Elle est aussi un acteur important de la téléphonie mobile avec son opérateur MTN, deuxième acteur du marché après Orange.
Les exportations ivoiriennes à destination de l’Afrique du Sud, de l’ordre de 288 millions d’euros en 2015, sont essentiellement composées d’or. Quant aux importations ivoiriennes en provenance d’Afrique du sud, elles sont à peu près stables en volume depuis 2010, de l’ordre de 90 millions d’euros par an, et sont principalement constituées de véhicules, de matières plastiques, de fonte, de fer et d’acier.
Il est notable que l’Angola apparaît en 2015 comme le premier client africain de la Côte d’Ivoire, avec 613 millions d’euros d’exportations. En réalité, ce chiffre reflète essentiellement une réexportation de matériels de navigations maritime en provenance de Corée du Sud ; en temps normal, les exportations ivoiriennes à destination de l’Angola sont structurellement faibles (9 millions d’euros en 2014). L’Angola pèse tout aussi peu dans les importations ivoiriennes : 14 millions d’euros au total en 2015.
Enfin, le Togo apparaît comme le deuxième investisseur africain en Côte d’Ivoire en 2015, avec un stock d’IDE estimé à 84 millions d’euros. Ces chiffres traduisent essentiellement la présence dans le secteur bancaire d’Ecobank et d’Orabank, dont les holdings sont implantées à Lomé.
Si l’Europe est globalement le premier partenaire commercial et premier investisseur privé en Côte d’Ivoire, ces flux sont portés par quelques pays, la France au premier chef.
Quelques autres pays jouent un rôle prépondérant dans les échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire. Les Pays-Bas en particulier sont la première destination des exportations ivoiriennes, avec une part de 11% en 2015, soit environ 1,287 milliard d’euros en 2015, largement devant les Etats-Unis (867 millions d’euros, 8%). Les ventes sont principalement constituées d’or et de cacao, pour lesquels les Pays-Bas jouent un rôle essentiel de plaque tournante en Europe, grâce au port de Rotterdam. La part de marché des Pays-Bas dans les importations ivoiriennes est nettement plus modeste, de l’ordre de 2% en 2015 (162 millions d’euros).
La Belgique et l’Allemagne sont respectivement la troisième et la quatrième destination des ventes ivoiriennes, avec une part de l’ordre de 6% du total en 2015 (respectivement 700 et 650 millions d’euros), devant la France. Le Port d’Anvers joue un rôle important pour l’importation des produits agricoles en Europe, en particulier le cacao, mais aussi le café, les fruits tropicaux, le caoutchouc, le bois transformé et les produits pétroliers. Un accord de partenariat a d’ailleurs été conclu en novembre 2012 pour inclure le port de San Pedro, premier port mondial pour l’exportation de l’or noir, dans le réseau international du Port d’Anvers. L’Allemagne compte pour 3% des importations ivoiriennes (236 millions d’euros), une part stable depuis 2008.
S’agissant des IDE en Côte d’Ivoire, la Belgique détenait un stock assez important, de l’ordre de 361 millions d’euros, en 2015, ce qui en faisait le deuxième investisseur après la France. Les statistiques de la BCEAO font de la Belgique le premier investisseur en termes de flux entrants en 2015, avec un total de 91 millions d’euros. Ces investissements se portent notamment sur les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie (Socfin), de la logistique (Sea Invest), du transport (Brussels Airlines, SIAT, Africa Trucks) et de la distribution (SMT, BIA).
La Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont aussi une présence assez importante, avec des stocks estimés respectivement à 114, 100 et 97 millions d’euros en 2015. Les opérateurs suisses sont présents dans l’exploitation minière et pétrolière (Glencore), l’agro-industrie (Nestlé), le commerce et l’intermédiation financière. Le stock néerlandais est investi dans la production et la distribution de gaz et le commerce. Les entreprises britanniques sont, quant à elles, implantées dans l’exploitation minière, le commerce, l’industrie manufacturière, le transport et l’immobilier.
6. Une influence anglo-saxonne croissante
• Une place non négligeable sur le plan économique
Les États-Unis et le Canada comptent parmi le deuxième cercle des partenaires économiques les plus importants de la Côte d’Ivoire. Les États-Unis en sont le deuxième client, avec environ 8% des exportations ivoiriennes en 2015, soit 867 millions d’euros, derrière les Pays-Bas. Ces exportations sont principalement constituées de produits agricoles, surtout du cacao, mais aussi du caoutchouc et des fruits. La balance commerciale est structurellement excédentaire en faveur de la Côte d’Ivoire. Les importations s’élevaient à 337 millions d’euros en 2015, ce qui fait des États-Unis le cinquième fournisseur de la Côte d’Ivoire, avec 4% du marché.
Sur le plan des investissements, l’empreinte des États-Unis demeure assez faible : selon la BCEAO, le stock d’IDE américains en Côte d’Ivoire n’était que de 53,6 millions d’euros en 2015 (12ème position), très loin derrière la France. Au total, une quinzaine de grands groupes américains sont présents dans le pays, dans les secteurs de l’agriculture, de l’agro-industrie, de la finance, de l’énergie et du pétrole.
Il convient aussi de noter que les États-Unis ont, depuis début 2016, inclus la Côte d’Ivoire dans leur programme de coopération du Millenium Challenge Corporation (MCC), qui bénéficie aux pays ayant engagé les réformes nécessaires dans les domaines de la gouvernance, de la transparence et de l’investissement dans les secteurs sociaux. À ce titre, le programme Compact devrait accorder à la Côte d’Ivoire entre 300 et 350 millions de dollars en dons sur cinq ans.
Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est à nouveau éligible, depuis 2011, à l’African growth and opportunity act (AGOA) qui octroie un accès préférentiel au marché américain pour les aux pays d’Afrique respectant les principes de l’économie libérale.
Le Canada joue quant à lui un rôle assez modeste dans les échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire : d’après les statistiques du Global Trade Atlas (GTA), les exportations ivoiriennes vers le Canada ont continuellement baissé depuis 2011, passant de 450 à 117 millions d’euros. Ces chiffres sont toutefois assez éloignés des données officielles du Canada, qui chiffre les importations en provenance de Côte d’Ivoire à 304 millions de dollars (environ 200 millions d’euros) en 2015. Ces exportations sont constituées de pétrole, cacao, minerais, caoutchouc, bois, fruits et noix. Ces statistiques officielles donnent des importations en provenance du Canada de l’ordre de 68 millions de dollars en 2015, correspondant à de l’aéronautique, de la machinerie, des engrais et de la viande.
S’agissant des investissements, 55 millions d’euros de nouveaux IDE canadiens ont été enregistrés en 2015 (statistiques de la BCEAO), ce qui place le Canada en troisième position en termes de flux. Le stock d’IDE canadiens est estimé à 86,7 millions d’euros en 2015. Ces investissements se portent principalement sur le secteur de l’exploitation minière (Endeavour Mining).
• Une influence croissante dans une Côte d’Ivoire de plus en plus ouverte sur le monde
D’après le sociologue ivoirien Francis Akindes, la France n’est plus la référence unique des classes moyennes ivoiriennes. Celles-ci sont de plus en plus tournées vers le monde anglo-saxon. En réalité, on observe un effet de génération : alors que la référence à la France reste première pour les plus de soixante ans, cette influence est concurrencée par celle de l’Amérique auprès des plus jeunes.
Cela tient à l’insertion de la Côte d’Ivoire dans la mondialisation et à la montée en puissance d’Internet dans le pays. D’après le guide de Business France sur la Côte d’Ivoire (86), le pays compte 8 millions d’internautes sur une population de 24 millions d’habitants. Ce ratio est appelé à s’accroître d’autant plus fortement que les Ivoiriens s’avèrent friands des technologies de l’information et de la communication, et pas simplement parmi les classes moyennes. La culture anglo-saxonne est ainsi largement diffusée par ce canal.
Cette influence résulte également de l’ouverture des universités américaines et canadiennes aux étudiants africains. À cet égard, le rapport de nos collègues François Rochebloine et Pouria Amirshahi sur la francophonie (87) montre bien comment le Québec conduit une stratégie volontariste de recrutement des étudiants d’Afrique francophone.
Au total, en 2015, 1054 étudiants ivoiriens détenaient un permis valide pour étudier au Canada. Les derniers chiffres disponibles de l’UNESCO recensaient par ailleurs 1283 étudiants ivoiriens aux États-Unis dans le cadre de cursus diplômants, ce qui fait de la Côte d’Ivoire le premier pourvoyeur d’étudiants d’Afrique subsaharienne francophone dans le pays. Les États-Unis et le Canada sont ainsi respectivement la deuxième et la troisième destination des étudiants ivoiriens, certes encore loin derrière la France (3400 étudiants ivoiriens en France dans le cadre de cursus diplômants en 2013 selon l’UNESCO, 6500 au total en 2016 selon le Gouvernement).
La fréquentation croissante des universités nord-américaines par les étudiants ivoiriens tient en partie à l’attrait qu’exercent les établissements d’enseignement et la culture anglo-saxonne. Mais elle n’est pas non plus sans lien avec la politique de visas conduite par la France, qui conduit certains étudiants refoulés aux portes des consulats ou découragés à se tourner vers d’autres destinations (cf. infra).
On observe aussi une influence anglo-saxonne grandissante parmi les élites ivoiriennes. À cet égard, le profil du président Ouattara est en rupture avec ses prédécesseurs, issus du système français : diplômé de l’Université de Pennsylvanie, il a fait une bonne partie de sa carrière au Fonds monétaire international (FMI). Pour ne citer que quelques autres exemples, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, Charles Gomis, est diplômé de l’Université de Californie de Los Angeles (UCLA) et Thierry Tanoh, l’actuel ministre du pétrole, est diplômé d’Harvard et a passé de longues années à la Banque mondiale.
L’évolution du profil de l’élite ivoirienne est à l’image de l’évolution de ce pays, désormais inséré dans la mondialisation et ouvert à de nouveaux partenaires économiques et de nouvelles influences culturelles. Ce changement de paradigme doit être intégré sans être appréhendé exclusivement sous l’angle de l’âge d’or perdu. Le ministre de l’Intérieur, Hamed Bakayoko, le soulignait devant la mission : « nos deux pays ont d’excellentes relations, bien des choses nous rapprochent. Mais nous devons les faire évoluer en fonction des circonstances, les adapter à la mondialisation : c’est un défi majeur. »
C. BÂTIR DES PONTS POUR UN PARTENARIAT DURABLE
En raison de tous les liens que nous avons évoqués, la France et la Côte d’ivoire ont un intérêt commun à fonctionner ensemble pour être plus fortes dans la mondialisation.
La familiarité qui caractérise nos relations est un ressort essentiel de notre partenariat. Elle doit donc impérativement être entretenue et développée, pour favoriser, au-delà des élites, une connaissance réciproque entre les populations, les territoires et les cultures.
Or, plusieurs interlocuteurs de la mission ont exprimé leur sentiment que les jeunes générations françaises ne s’intéressaient pas à l’Afrique, ce qui se traduirait par un éloignement et une perte progressive d’expertise. Nous devons entendre cet appel que nous font les Ivoiriens.
1. La diaspora, un vivier à mobiliser
Le rapport Védrine – Zinsou (88) paru en 2013 identifiait les diasporas africaines en France comme un levier potentiellement puissant mais trop faiblement exploité pour bâtir des partenariats en faveur du développement africain. En effet, les membres de la diaspora partagent la culture des deux pays, ce qui est indéniablement un atout pour répondre aux mieux aux attentes locales. Par ailleurs, ils ont souvent une sensibilité et un intérêt particulier au développement de leur pays d’origine.
• Canaliser les transferts de fonds de la diaspora en faveur du développement ivoirien
À l’heure actuelle, l’impact économique pour l’Afrique des diasporas présentes en France se traduit essentiellement par des flux financiers affectés à l’alimentation, la santé ou l’éducation des proches, pour un montant total de transferts estimé à 16 milliards de dollars par an. Ces flux sont rarement dédiés à des investissements productifs.
La mission a reçu le Club Efficience qui se donne notamment pour objectif de développer les liens entre franco-africains, acteurs économiques africains et investisseurs français. Il prévoit de lancer un fonds, l’« Efficience Africa Fund », destiné à drainer des participations de la diaspora africaine en Europe pour investir dans des PME africaines. Celles-ci sont en effet perçues comme le meilleur canal pour créer de l’emploi et favoriser le décollage économique de l’Afrique.
Ce fonds a été présenté lors du sommet Afrique-France de Bamako, en janvier dernier. Le Club cherche à convaincre 100.000 membres de la diaspora de contribuer à hauteur de 500 euros par an. Il espère pouvoir ainsi lever 15 millions d’euros la première année, 50 millions au bout de trois ans. Le fonds serait géré par Investisseurs et Partenaires, la structure pilotée par Jean-Michel Severino.
De telles initiatives devraient pouvoir bénéficier du soutien de l’AFD, qui pourrait par exemple garantir aux investisseurs un rendement supérieur par une sorte de bonification. Ces montages juridiques sont néanmoins complexes car ils impliquent de distinguer en fonction de l’origine de l’investisseur.
Recommandation n°11 : Poursuivre les efforts visant à diminuer le coût des transferts d’argent et mobiliser l’épargne de la diaspora africaine, y compris ivoirienne, vers des investissements productifs en faveur du développement du pays.
• S’appuyer sur les membres de la diaspora pour bâtir des ponts avec la Côte d’Ivoire
La France pourrait tirer un meilleur parti de sa vaste population franco-africaine diplômée pour renforcer son partenariat avec la Côte d’Ivoire.
La situation du Franco-Ivoirien Tidjane Thiam, éduqué en France et diplômé de Polytechnique mais finalement recruté à l’étranger (actuellement à la tête du Crédit Suisse) faute d’être parvenu à trouver un poste à la mesure de ses capacités en France, est devenue emblématique de l’incapacité de notre pays à tirer parti de sa population franco-africaine. Au-delà de ce cas, il existe de nombreux Franco-ivoiriens ou Français d’origine ivoirienne diplômés que la France pourrait mobiliser en faveur du développement de la Côte d’Ivoire.
Cette mobilisation butte sur deux obstacles majeurs. Premièrement, faute de statistiques ethniques, cette diaspora est assez mal connue ; elle est en outre peu structurée. Les entrepreneurs africains de la diaspora, en particulier les patrons de PME, sont ainsi mal identifiés et ne disposent pas toujours des réseaux leur permettant de savoir comment aborder le marché ivoirien.
Deuxièmement, comme évoqué antérieurement, la diaspora telle que nous l’envisageons est appréhendée au sens large. Il s’agit souvent de personnes bien installées en France, où elles ont leur famille, leur crédit à rembourser, etc. Il est fréquent que ces personnes soient tentées par une expérience dans leur pays d’origine, mais elles ne peuvent pas se permettre de partir pour travailler sous contrat local.
Comment lever ces blocages ? Le Club Efficience suggère de mettre en place un mécanisme qui permettrait aux membres de la diaspora de partir en Afrique pendant deux ans pour occuper des postes d’experts dans le secteur public ou para-public d’un pays africain donné, un peu sur le modèle des assistants techniques. Cette initiative devrait être soutenue par un programme d’aide publique au développement qui rémunérerait le différentiel entre ce que l’Etat d’accueil est prêt à payer et le salaire que l’expert aurait pu avoir en France. En Côte d’Ivoire, la marge de manœuvre importante offerte par le C2D pourrait, le cas échéant, être mobilisée à cette fin.
Ce dispositif favoriserait la mobilité des compétences de la France vers la Côte d’Ivoire, équilibrant quelque peu le flux du « brain drain » que connaissent de nombreux pays d’Afrique. Pour la France, la mobilisation de cette diaspora serait évidemment un atout en termes d’influence et d’image. Le ministère des affaires étrangères dit réfléchir à des montages de ce type.
Recommandation n°12 : Aller vers la mise en œuvre d’un mécanisme subventionné par l’AFD favorisant la mobilité des compétences de la diaspora ivoirienne de France vers la Côte d’Ivoire.
Recommandation n°13 : Solliciter des entreprises de la diaspora pour participer aux délégations qui accompagnent les voyages présidentiels ou ministériels en Côte d’Ivoire, de manière à leur donner plus de visibilité, mieux les identifier et favoriser leur mise en réseau.
2. Rapprocher les jeunes générations
• Le constat : une tendance à l’éloignement
C’est un fait, les Français diplômés des jeunes générations sont assez peu tournés vers l’Afrique ; les pays émergents, notamment asiatiques, sont désormais des destinations beaucoup plus courtisées pour lancer une carrière professionnelle. Les jeunes Français n’ont pas connu l’époque de la coopération, où il était fréquent d’avoir une expérience professionnelle sur le continent africain.
Cette remarque est aussi valable s’agissant des jeunes Ivoiriens des classes moyennes et supérieures. Pour eux, qui vivent dans un environnement mondialisé, la France n’est pas une référence exclusive. Elle n’est pas une destination incontournable pour les études ou le travail : à cet égard, nous avons évoqué l’attrait croissant du monde anglo-saxon.
La relation franco-ivoirienne va donc connaître un inévitable effet de génération qui pourrait fortement affaiblir les liens si les jeunes générations n’étaient pas mobilisées comme acteurs à part entière de ce partenariat.
Comment les associer ? Il importe d’exploiter tous les canaux d’échanges possibles pour bâtir des ponts entre nos pays, en veillant toujours à la réciprocité des flux. Pour cela, un premier impératif se fait jour : ouvrir davantage la France aux professionnels, artistes, étudiants ivoiriens qui peuvent nourrir cette réciprocité des échanges.
• Poursuivre l’adaptation de la politique de visas
La politique française de visas en Côte d’Ivoire
Les ressortissants ivoiriens sont soumis à l’obligation de visa de court séjour par l’ensemble des partenaires de l’espace Schengen et de visa de transit aéroportuaire par la France et l’Espagne.
La demande de titres de séjour pour la France enregistrée en Côte d’Ivoire ne cesse de croître depuis plusieurs années. En 2015, près de 36.000 demandes de visas ont été déposées pour 27.000 visas délivrés. Le taux de refus est ainsi de 24%, nettement au-dessus de la moyenne nationale de 10,3%, ce qui reflète la pression migratoire et la fraude documentaire. La Côte d’Ivoire est considérée par la France comme un pays à risque migratoire élevé, ce que confirment les statistiques des migrants illégaux recensés en Italie (cf. II.B).
Sur les 27.000 visas délivrés, 3500 étaient des visas de long séjour, répartis à parts à peu près égales entre les établissements familiaux et les étudiants.
Les huit premiers mois d’activité sur 2016 confirmaient la hausse des volumes traités, avec une augmentation de 26% par rapport à la même période en 2015.
La problématique des visas est un éternel facteur bloquant dans les relations de la France et de l’Afrique, déjà souligné par le rapport de Hubert Védrine et Lionel Zinsou. Cela faisait dire au sociologue ivoirien Francis Akindes que « la question des visas va, sur le long terme, faire perdre à la France son investissement en Côte d’Ivoire ».
En effet, en Côte d’Ivoire comme ailleurs en Afrique francophone, les étudiants et hommes d’affaires qui souhaitent se rendre en France se heurtent à des procédures de visas lourdes, bureaucratiques et parfois vexatoires qui peuvent les inciter à se tourner vers d’autres destinations. Une circulaire adoptée en mars 2013 afin de faciliter la délivrance de visas à caractère économique semble avoir amélioré quelque peu la situation. Néanmoins, de nombreux interlocuteurs de la mission ont souligné que la marge de progrès restait importante.
Recommandation n°14 : Poursuivre les efforts visant à fluidifier les procédures de demandes de visas et à ouvrir davantage la France aux étudiants, aux talents et aux artistes.
Recommandation n°15 : Prévoir l’attribution automatique d’un visa à tout étudiant ivoirien se voyant octroyer une bourse pour étudier en France, comme le préconisait le rapport Védrine – Zinsou.
• Favoriser les échanges entre étudiants
À l’heure actuelle, 6.500 étudiants ivoiriens se trouvent en France. Certes, notre pays est encore la première destination de ces étudiants, mais nous avons constaté qu’il perdait du terrain. Par ailleurs, ces flux sont à sens unique : les étudiants français ne vont pas étudier en Côte d’Ivoire.
Le Premier ministre Manuel Valls avait évoqué, lors d’un déplacement en Afrique de l’ouest en octobre dernier, l’idée d’un « Erasmus euro-africain ». Pour l’heure, aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur ce projet. Votre rapporteure estime néanmoins que c’est exactement le type d’initiatives susceptibles non seulement d’entretenir la flamme, mais de créer un nouveau type de relations entre la France et la Côte d’Ivoire.
Ce projet ne serait sans doute pas évident à mettre en place étant donné le différentiel qui persiste entre établissements français et ivoiriens. Un système d’Erasmus suppose en effet qu’un étudiant français puisse intégrer un semestre en Côte d’Ivoire dans le cadre de son cursus. Cela impose donc une bonne correspondance des cursus et des niveaux de formation. La Côte d’Ivoire s’est engagée dans cette voie, notamment en adoptant le schéma LMD (licence-master-doctorat). Cependant, le paysage de l’enseignement supérieur ivoirien, qui avait fortement pâti de la crise, est encore en pleine restructuration. L’idée d’un Erasmus est donc très bonne et doit constituer un objectif vers lequel cheminer, mais il ne pourra sans doute être atteint qu’à moyen terme.
Dans l’intervalle, l’accroissement du nombre de volontariats internationaux en entreprise (VIE) en Côte d’Ivoire serait sans doute le meilleur levier pour attirer davantage de jeunes Français. Actuellement, on en dénombre 82. Il serait probablement possible de l’accroître en collaborant davantage avec les entreprises et Business France.
Recommandation n°16 : Aller vers la mise en place d’un cadre d’échanges étudiants de type Erasmus avec la Côte d’Ivoire.
Recommandation n°17 : Augmenter le nombre de volontaires internationaux en entreprise (VIE) en Côte d’Ivoire en collaborant davantage avec les entreprises et Business France.
• Favoriser la montée en puissance d’une recherche franco-ivoirienne
Un interlocuteur de la mission a relevé qu’il était aussi particulièrement utile de développer les échanges dans le domaine de la recherche. Les échanges entre scientifiques français et ivoiriens existent de longue date ; ils ont connu une nouvelle dynamique depuis la fin de la crise, avec la conclusion de plusieurs accords entre établissements ivoiriens, français et le ministère de l’enseignement supérieur de Côte d’Ivoire. En particulier, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Centre pour la coopération internationale et la recherche agronomique pour le développement (CIRAD) sont des acteurs anciens en Côte d’Ivoire ; de nouveaux accords de partenariat et accords cadre de coopération ont vu le jour au cours des dernières années avec de nombreux établissements ivoiriens.
Il convient de prolonger ce mouvement en favorisant la constitution d’unités de recherche conjointes sur des thématiques importantes pour le développement ivoirien. L’objectif serait, à terme, de parvenir à un brevet de recherche ivoirien sanctionnant le travail d’équipes franco-ivoiriennes.
Recommandation n°18 : Appuyer la montée en puissance d’unités franco-ivoiriennes de recherche dont les travaux seraient, à terme, valorisés par un brevet ivoirien de recherche.
• Entretenir la connaissance mutuelle des élites politiques
La mission a constaté que le relatif éloignement des jeunes générations n’épargnait pas la classe politique – aussi bien ivoirienne que française. Il est important de trouver de nouveaux canaux d’échanges dans le monde politique, afin d’entretenir une bonne connaissance et une bonne compréhension mutuelle. La redynamisation des échanges parlementaires est un levier important sur lequel votre rapporteure a déjà eu l’occasion d’insister.
Nous pourrions envisager d’aller au-delà en mettant en place un programme du type « Young leaders » entre la France et la Côte d’Ivoire. Ce programme existe, par exemple entre la France et les États-Unis. Porté par la Fondation franco-américaine qui « œuvre à une meilleure compréhension mutuelle entre les deux pays et à la recherche de solutions partagées », le programme Young leaders organise des échanges et rencontres entre des jeunes dirigeants français et américains. Il rassemblerait aujourd’hui plus de 400 dirigeants issus du monde politique, de la haute fonction publique, de l’entreprise, des médias, de l’armée et de la recherche, sélectionnés par un jury en fonction du rôle qu’ils sont appelés à jouer dans la relation entre les deux pays. Ils se rencontrent lors de deux séminaires de cinq jours chacun organisés sur deux années.
Recommandation n°19 : Étudier la mise en place d’un programme de type « Young leaders » entre la France et la Côte d’Ivoire, de façon à renforcer la proximité et les échanges de vues entre les jeunes générations de dirigeants.
La coopération décentralisée est une très bonne manière de développer la connaissance mutuelle et les liens institutionnels entre deux pays en s’extrayant du carcan des relations internationales d’État à État et, en l’occurrence, de la dichotomie nord/sud. En effet, les collectivités locales établissent des relations sur une base d’égal à égal ; elles partagent les mêmes problèmes et les mêmes préoccupations.
Pourtant, cette coopération est quasiment inexistante entre la France et la Côte d’Ivoire. Elle s’est peu installée historiquement, au cours des décennies qui ont suivi la décolonisation, la Côte d’Ivoire apparaissant alors comme relativement prospère par rapport à ses voisins, sur lesquels se sont concentrés les actions de coopération entreprises.
Depuis la fin de la crise, la coopération décentralisée est restée à l’écart de la dynamique générale de rapprochement des deux pays, notamment sur le plan économique. Seules quelques initiatives ponctuelles ont vu le jour : au total, vingt-quatre coopérations sont recensées. Les collectivités françaises concernées sont essentiellement des communes et les coopérations portent dans leur grande majorité sur des échanges culturels et artistiques dans le cadre de jumelages. Il convient néanmoins de noter que Paris conduit une action extérieure d’appui aux associations chargées de la lutte contre le sida, pour un montant de 250.000 euros.
Ce niveau de coopération est particulièrement faible comparé à celui qu’on constate chez les voisins francophones de la Côte d’Ivoire que sont le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal ou encore le Bénin.
À l’heure actuelle, les avancées dans ce domaine se heurtent à la faiblesse de la décentralisation opérationnelle des territoires en Côte d’Ivoire. En effet, en dépit de la volonté décentralisatrice exprimée par le gouvernement ivoirien, on n’observe pas de réelle dynamique locale responsable. Les moyens humains et financiers des collectivités ivoiriennes demeurent insuffisants pour valoriser les avantages spécifiques de la coopération décentralisée.
Pourtant, le développement de relations étroites entre collectivités françaises et ivoiriennes recèle un réel potentiel pour accroître les échanges, améliorer la connaissance mutuelle et valoriser le savoir-faire des entreprises françaises, bien implantées dans le pays.
En particulier, des partenariats pourraient être noués entre régions pour favoriser le développement économique local dans des secteurs où l’expertise de petites et moyennes entreprises françaises pourrait ainsi être valorisée. Ils pourraient bénéficier de l’effet d’entraînement des soutiens apportés par la Délégation de l’Union européenne, dont les enveloppes demeurent actuellement peu utilisées en raison des faibles compétences en ingénierie des collectivités ivoiriennes, en difficulté pour mettre en forme leurs projets.
Pour Rémi Maréchaux, le directeur Afrique au ministère des affaires étrangères, il est utile d’appuyer la décentralisation ivoirienne, car celle-ci a une vertu d’efficacité, en assurant une plus grande redevabilité des élus face aux populations. La décentralisation pourrait en outre contribuer à élargir la base du pouvoir, puisque l’opposition pourrait diriger des mairies, ce qui contribuerait à dédramatiser les enjeux de la politique nationale.
Recommandation n°20 : Exploiter le potentiel de la coopération entre territoires français et ivoiriens en cherchant à mobiliser les financements européens prévus à cet effet. En l’absence de réelle décentralisation ivoirienne, travailler sur des approches de coopération territoriale mêlant services déconcentrés de l’État et collectivités territoriales.
La commission des affaires étrangères a examiné le présent rapport d’information au cours de sa séance du mercredi 15 février 2017.
M. Axel Poniatowski, président. L’ordre du jour appelle l’examen du rapport de la mission d’information sur la Côte d’Ivoire présidée par M. Philippe Cochet et dont la rapporteure est Mme Seybah Dagoma.
M. Philippe Cochet, président de la mission d’information. Il y a un peu moins d’un an, la présidente de notre commission, Élisabeth Guigou, de retour d’un déplacement en Côte d’Ivoire, proposait la création d’une mission d’information sur ce pays. Cela partait du constat qu’après la décennie agitée de la crise ivoirienne, la Côte d’Ivoire était un peu sortie du radar des travaux de notre commission. En quelque sorte, nous en étions restés au clivage Laurent Gbagbo/Alassane Ouattara.
Pourtant, aujourd’hui, on nous présente de plus en plus la Côte d’ivoire comme la nouvelle locomotive de l’Afrique de l’ouest. Qu’en est-il vraiment ?
C’est la question à laquelle les membres de la mission ont tenté de répondre. En toute honnêteté, nous devons dire que, lorsque la mission a été constituée, nous étions loin de soupçonner la difficulté du travail qui nous était demandé.
En effet, la Côte d’Ivoire est un pays de contrastes et de mélanges, qu’il est bien difficile de dépeindre et de résumer dans un rapport.
Un pays de contrastes, entre le miracle ivoirien des années 1960-1970 et la chute continue des années 1990 et 2000, avec l’enchaînement des crises économique, politique et militaire.
Un pays de mélanges, entres les ethnies extrêmement variées que l’on y trouve. La Cote d’Ivoire, a en effet, la particularité d’être au carrefour de quatre grands groupes ethniques, les akans au sud-est, les krous au sud-ouest, les mandingues au nord-ouest et les voltaïques au nord-est. Ces mélanges sont religieux aussi : le pays compte des proportions à peu près équivalentes d’animistes, de musulmans et de chrétiens, eux-mêmes plus ou moins teintés d’animisme.
Un pays de contrastes, entre les taux de croissance flatteurs qu’il connaît et la persistance d’une pauvreté massive, qui place la Côte d’Ivoire au 172ème rang mondial (sur 188) en termes d’indice de développement humain (IDH).
Un pays de mélanges, puisqu’il a, de longue date, été une terre d’immigration avec une tradition de vivre-ensemble qui semble avoir forgé un sentiment national bien réel, mais aussi des logiques ethnico-régionales qui demeurent lourdes.
Par ces quelques grandes idées, je souhaite vous montrer qu’il n’est pas évident de trouver le ton juste pour parler de la Côte d’Ivoire, et cela d’autant moins que les positions sur le sujet sont généralement très tranchées.
Nous nous sommes donc efforcés, à travers notre rapport, d’être aussi justes et balancés que possible, et nous espérons y être parvenus.
Que penser de la Côte d’Ivoire au début de l’année 2017 ?
On ne peut répondre à cette question sans prendre en compte le point de départ. Pour nous, le point de départ est 2011. Le pays sort alors de douze années d’une crise profonde qui l’ont vu coupé en deux, entre un nord occupé par les rebelles des Forces nouvelles favorables à Alassane Ouattara, et un sud contrôlé par le Président Laurent Gbagbo. Cette crise était politique, militaire mais aussi morale. Pendant douze ans, le non-droit et l’impunité se sont installés dans le pays. Des milliers de personnes sont mortes ou ont été victimes d’exactions ; les Ivoiriens en portent encore aujourd’hui les stigmates.
La crise ivoirienne avait officiellement débuté avec le coup d’État du Général Gueï contre le Président Henri Konan Bédié, en 1999. En réalité, elle était en germe depuis la mort, en 1993, du Président Houphouët-Boigny, le père de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, « le vieux », comme l’appelaient affectueusement les Ivoiriens. Sa disparition avait entrainé une crise de succession en partie à l’origine de la glissade des années 2000.
Ces évènements avaient aussi été précédés, à partir des années 1980, d’une grave crise économique. Cette crise avait remis en question le modèle ivoirien fondé sur la redistribution d’une rente abondante tirée de l’exportation de cultures de plantation comme le cacao et le café. Le retournement des cours mondiaux, dans les années 1980, avait ainsi profondément perturbé les grands équilibres socio-économiques du pays.
Tout cela pour vous dire qu’en mai 2011, lorsque le Président Ouattara, nouvellement élu, prend officiellement ses fonctions, au terme d’une crise post-électorale d’une rare violence, la Côte d’Ivoire va donc bien mal.
À la lumière de ce bref éclairage historique, que dire de la Côte d’Ivoire six ans après la fin de la crise ? L’impression que nous avons retirée de nos travaux est à l’image de ce pays : contrastée.
D’un côté, on a le sentiment d’un écart important entre le pays réel et l’image qu’en donnent les médias, bien que cet écart se soit peut-être en partie résorbé ces dernières semaines.
Le miracle ivoirien qu’on nous donne à voir est, dans une certaine mesure, bien réel. La Côte d’Ivoire a des atouts solides, à commencer par son agriculture puissante et diversifiée.
En effet, elle a su tirer parti de ses sols variés et fertiles pour conquérir un rôle mondial dans la production du cacao, dont elle est, loin devant le Ghana, le premier producteur, mais aussi de l’anacarde, de l’hévéa, des fruits tropicaux, de l’huile de palme et j’en passe.
La Côte d’Ivoire a aussi un stock d’infrastructures parmi les plus développés de la région, avec deux ports d’envergure mondiale, San Pedro et Abidjan, un aéroport international et six aéroports nationaux et un réseau routier relativement développé.
Le pays dispose également d’un potentiel minier et énergétique non négligeable et encore assez peu exploité : pétrole et gaz naturel off-shore, manganèse, or, diamant, hydroélectricité, etc.
Enfin, la Côte d’Ivoire a une remarquable ouverture aux nouvelles technologies, dont les Ivoiriens sont très friands, et qui présentent des opportunités considérables pour accélérer le développement du pays.
Depuis 2012, ces atouts paraissent intelligemment mis en valeur. Tous les indicateurs semblent au vert. Le taux de croissance a été en moyenne de 9% par an. Des investissements publics considérables permettent de moderniser et d’étendre les infrastructures du pays. La Côte d’Ivoire bénéficie d’un soutien massif de la communauté internationale, qui reprend ses quartiers à Abidjan, à l’image de la Banque africaine de développement (BAD). L’environnement des affaires s’est amélioré et l’on observe un retour en force des investisseurs privés qui font, de plus en plus, d’Abidjan une plate-forme pour leurs opérations dans la région. À cet égard, l’ouverture par Carrefour de son premier hypermarché en Afrique subsaharienne à Abidjan fin 2015 était tout un symbole.
Par ailleurs, lorsque l’on s’intéresse au pays, on est frappé par le dynamisme de l’équipe dirigeante conduite par le Président Ouattara. Indéniablement, il fait preuve d’une réelle ambition pour réformer et moderniser le pays. Pour y parvenir, il s’est entouré d’hommes de confiance, à l’image de son vice-président, auparavant Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, et du nouveau Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Ces derniers sont perçus comme de bons gestionnaires. Au total, la gestion économique ivoirienne jugée intelligente et prudente par les agences de notation et par les bailleurs, notamment le Fonds monétaire international (FMI), dont le Président Ouattara est issu.
En un mot, la Côte d’Ivoire donne l’impression d’être gouvernée. Et ses dirigeants ont fixé un cap, très ambitieux : celui de l’émergence en 2020.
Et pourtant, on constate que le miracle ivoirien n’est pas encore une réalité pour la majorité de la population, dont 46% reste en-dessous du seuil de pauvreté. Les inégalités sociales et territoriales sont immenses et semblent s’être accrues. En-dehors d’Abidjan, dans les campagnes et dans certaines villes du pays, à l’image de Bouaké, la deuxième ville, la pauvreté demeure massive. Près de 40% de la population n’est pas raccordée à l’eau potable ni à l’électricité. La Côte d’Ivoire connaît des taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés au monde. Globalement, de nombreux Ivoiriens ont le sentiment que leurs conditions de vie ne s’améliorent pas. Ils voient l’image qui est donnée de leur pays dans la presse internationale et ils protestent : « vous faites des routes, vous faites des ponts, mais les Ivoiriens ne mangent pas de béton ».
La première urgence pour le Président Ouattara est donc celle du développement.
En bon économiste, il a bien pris en compte les enjeux économiques de la diversification et de la montée en gamme de l’économie. Les dirigeants s’appliquent notamment à développer la transformation des produits agricoles. Ces évolutions sont indispensables pour rendre la croissance durable et créatrice d’emplois.
Mais pour y parvenir, la Côte d’Ivoire devra attirer davantage les investisseurs privés, qui restent prudents en raison d’un environnement des affaires encore compliqué. Pour le moment, le pays occupe le 142ème rang sur 190 dans le classement Doing Business. Les autorités devront donc encore progresser, notamment pour améliorer la fiscalité et réduire la corruption, dont de nombreux interlocuteurs nous ont dit qu’elle avait atteint un niveau problématique.
Les dirigeants devront aussi redoubler d’efforts pour redresser l’éducation. Autrefois réputé, le système éducatif ivoirien a fortement pâti des années de crise. Aujourd’hui, il ne répond pas aux besoins. Le problème de l’emploi des jeunes est massif : ils sont souvent au chômage ou cantonnés dans des petits boulots informels et peu productifs, sans réelle perspective d’évolution. Dans le même temps, les entreprises installées en Côte d’Ivoire disent ne pas parvenir à recruter des jeunes avec les compétences adaptées. Comme nous le disait un chef d’entreprise, « en Côte d’Ivoire il est plus facile de recruter un doctorant que de trouver un plombier zingueur ». La Côte d’Ivoire devra donc mettre l’accent sur la formation professionnelle.
L’éducation est un enjeu d’autant plus urgent que la jeunesse ivoirienne est nombreuse et appelée à s’accroître fortement au cours des prochaines décennies. Aujourd’hui, 60% des Ivoiriens ont moins de 25 ans. Si la natalité ivoirienne n’atteint pas les taux record que l’on connaît dans le Sahel, elle est tout de même de plus de 4 enfants par femme et ne connaît pas de réel infléchissement.
À l’heure actuelle, les jeunes Ivoiriens ont du mal à s’intégrer ; leurs repères ont été bouleversés par la crise qui a banalisé l’usage de la violence. Il est donc urgent de fournir des perspectives à ces jeunes qui, à défaut, pourraient se mobiliser, pour le meilleur et pour le pire.
Autre domaine où il semble impératif de progresser encore : celui de la réconciliation nationale. Comme vous le savez, pendant la crise, les Ivoiriens se sont divisés en deux camps, les « pro-Ouattara » et les « pro-Gbagbo ». En avril 2011, le Président Gbagbo a été arrêté, puis transféré à La Haye pour être jugé pour crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale. Vous trouverez dans le rapport un point sur le procès qui promet d’être long. À l’heure actuelle, une partie importante des partisans de Laurent Gbagbo refusent de participer au jeu politique. Ils contestent encore la légitimité du Président Ouattara et demandent la libération immédiate de leur leader.
L’emprisonnement de ce dernier, de même que le procès de Simone Gbagbo, alimente la thèse d’une « justice des vainqueurs ». Seuls les partisans du camp « pro-Gbagbo » seraient inquiétés pour leur rôle pendant la crise ivoirienne alors que des exactions ont été commises dans les deux camps. Sans entrer dans ce débat qui outrepasse les compétences de cette mission, nous constatons que de nombreux partisans de Laurent Gbagbo – plus de deux cent, selon les chiffres qui nous ont été donnés – sont encore aujourd’hui en détention provisoire.
Par ailleurs, environ 40.000 Ivoiriens qui s’étaient réfugiés dans les pays voisins lors de la crise post-électorale de 2011 se trouvent toujours en exil, majoritairement au Ghana et au Libéria. Ces réfugiés sont essentiellement des « pro-Gbagbo », qui refusent de rentrer de peur de subir des représailles ou d’être inquiétés par la justice, ou encore parce qu’ils ont perdu leurs biens et leurs terres. La persistance de ce problème six ans après la crise tend à alimenter les rancœurs et divisions entre les Ivoiriens.
Cette situation a évidemment un fort retentissement sur la vie politique ivoirienne. Les résultats des élections suggèrent un fort soutien à la majorité du président Ouattara, qui s’appuie sur une alliance entre son parti, le Rassemblement des Républicains (RDR), et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien Président Henri Konan Bédié. Le Président Ouattara a été réélu en 2015 avec 84% des suffrages et sa majorité a remporté 167 sièges sur 255 lors des élections législatives de décembre dernier.
Pourtant, ce constat est nuancé par la faiblesse de la participation politique et l’élection de nombreux élus indépendants : 75 au total.
Quant à l’opposition, elle est quasiment inexistante en Côte d’Ivoire : le Front populaire ivoirien (FPI), le parti historique du Président Gbagbo, conduit par Pascal Affi N’Guessan, n’a remporté que 3 sièges lors des dernières élections législatives. Cette absence d’opposition nuit évidemment au bon fonctionnement de la démocratie ivoirienne.
Les dirigeants ivoiriens vont donc devoir poursuivre leurs efforts pour se réconcilier avec l’ancien camp dit « pro-Gbagbo », et réciproquement. Pour cela, il faut que la justice fasse son œuvre et qu’elle tombe des deux côtés. De ce point de vue, le rapport comporte un certain nombre de constats sur la nécessité d’accroître l’indépendance et l’efficacité de la justice.
Il faudra aussi que les dirigeants ivoiriens trouvent le moyen de créer un jeu politique plus inclusif, où les oppositions peuvent s’exprimer et peser. On peut espérer que la réforme constitutionnelle adoptée en septembre dernier apportera certaines améliorations. Elle prévoit notamment la création d’un Sénat chargé de représenter la Côte d’ivoire « dans sa diversité ». Deux tiers de ses membres seront élus par les collectivités locales et le dernier tiers sera nommé par le Président, qui a laissé entendre que des personnalités de l’opposition y auraient leur place.
Les dirigeants ivoiriens devront aussi veiller à ce que toutes les ethnies se sentent représentées et participent à la construction du pays. Il s’agit ici de prévenir les phénomènes de repli ethnique et d’ostracisme qui ont fait sombrer la Côte d’Ivoire dans les années 2000.
Le maintien d’une situation sécuritaire stable est un autre enjeu de taille pour la Côte d’Ivoire. En mars dernier, l’attentat de Grand Bassam a montré que le pays était vulnérable à la menace terroriste. Même si cette menace semble pour le moment provenir plutôt de l’extérieur du pays, des prémices de radicalisation ont été observés et la Côte d’Ivoire doit se prémunir contre l’implantation de filières locales.
De manière tout aussi urgente, la stabilité de la Côte d’Ivoire dépend de son aptitude à réformer ses forces armées et de sécurité dont les capacités et la cohésion ont été fortement ébranlées par la crise.
À partir de 2012, le Président Ouattara avait fait preuve d’un certain volontarisme dans ce domaine en adoptant plusieurs réformes ambitieuses, avec notamment la création d’un Conseil national de sécurité réuni chaque semaine autour du Président et le vote d’une loi de programmation militaire.
Dans un premier temps, la normalisation de la situation sécuritaire a laissé penser que ces réformes portaient leurs fruits. Mais les récentes mutineries des militaires ont montré que le chemin à parcourir était encore long. Elles ont mis en lumière les dysfonctionnements de la chaine de commandement et le manque persistant cohésion de ces forces, six ans après la crise. De plus, ces mutineries se sont soldées par l’octroi de primes d’un montant considérable qui risquent de grever le budget de la défense.
À l’heure actuelle, la réforme de l’armée semble freinée par l’influence persistante des com’zones dans le dispositif sécuritaire ivoirien. Ces com’zones étaient les chefs militaires des rebelles du nord lors de la crise ivoirienne. Au nombre de dix, ils régnaient chacun sur un territoire dont ils contrôlaient à la fois les hommes et les ressources. Le Président Ouattara a cherché à réduire leur influence depuis, mais ces com’zones sont revenus au premier plan lors des récentes mutineries, qui ont conduit à nommer certains d’entre eux à des postes de premier plan.
La réforme du secteur de la sécurité est donc un chantier important. Et il est d’autant plus urgent que la Côte d’Ivoire a connu, au cours des derniers mois, une agitation sociale croissante, mélange d’expressions spontanées de la population, de grèves et manifestations dans la fonction publique et d’activisme au sein des universités. Il faut donc absolument éviter qu’une agrégation des mécontentements ne puisse remettre en cause la stabilité du pays.
Une autre question de fond n’a pas encore été vraiment traitée par les dirigeants ivoiriens, celle de la réforme du foncier rural, qui était l’une des causes profondes de la crise ivoirienne. Pour développer l’économie de plantation du pays, le président Houphouët-Boigny avait encouragé la colonisation agraire de la zone forestière ivoirienne, au centre puis à l’ouest et au sud-ouest. Il avait posé un principe : la terre appartient à celui qui la cultive.
Dès lors, de nombreux migrants allochtones (d’une autre région de la Côte d’ivoire) ou allogènes (d’un autre pays) avaient défriché la zone forestière ivoirienne et y avaient installé des plantations. Cependant, avec la crise économique, les populations autochtones ont revendiqué leur droit de propriété sur les terres.
Ce contexte de rivalité pour l’accès aux terres a favorisé le repli ethnique des Ivoiriens et la montée de la thèse de l’« ivoirité » qui conduisait à exclure de nombreux migrants stigmatisés comme « étrangers ». Aujourd’hui, les étrangers représentent 25% de la population ivoirienne et le problème de l’attribution de la propriété foncière reste entier. Ce sujet est d’une grande sensibilité et n’a pas encore été réglé par les dirigeants ivoiriens.
Que conclure de cette présentation ? J’emprunterais les termes de Serge Michailof en disant que la Côte d’Ivoire se trouve aujourd’hui « comme un cycliste sur une ligne de crête ». Ce pays recèle un immense potentiel, une formidable énergie qui peuvent le mener loin, et tirer avec lui l’Afrique de l’Ouest. Cependant, les défis sont nombreux, et supposent une ambition réformatrice généralisée et constante. Notre partenariat avec la Côte d’Ivoire doit s’inscrire dans cet objectif de moyen terme qu’est l’émergence de la Côte d’Ivoire ; je vais laisser notre rapporteure vous en dire plus à ce sujet.
Mme Seybah Dagoma, rapporteure de la mission d’information. Vous n’êtes pas sans savoir qu’entre la France et la Côte d’Ivoire, c’est une longue histoire.
Du temps de la colonisation, Félix Houphouët-Boigny militait pour l’égalité des droits entre colons et populations dites « indigènes » au sein du syndicat agricole africain. Mais il était loin d’être un pourfendeur de l’union avec la France, dont il pensait qu’elle avait beaucoup apporté à son pays. Ministre de la République française sous la IVème République, Houphouët-Boigny a pris acte de l’indépendance de son pays en 1960, plus qu’il ne l’a demandée. Le père de l’indépendance ivoirienne était, en effet, l’artisan d’une forte amitié, qui perdure aujourd’hui entre nos deux pays.
Dans les décennies qui ont suivi la décolonisation, il a appelé de ses vœux le maintien d’une présence française très importante, qui s’est traduite par l’envoi de milliers de coopérants techniques chargés de faire fonctionner les administrations ivoiriennes et de former leur homologues. Et le Président Houphouët-Boigny considérait en quelque sorte le 43ème Bataillon d’infanterie de marine (BIMA), stationné dans le pays à partir de 1970, comme une armée de la Côte d’Ivoire. Pendant cette période, des générations de fonctionnaires et de militaires ivoiriens ont été envoyés se former dans les écoles et universités françaises.
Ces échanges ont tissé des liens denses entre les élites politiques, administratives et militaires. Indéniablement, cette coopération apaisée a contribué à la construction d’un État ivoirien solide, qui a résisté à la crise profonde des années 1990 et 2000.
Cette époque est désormais révolue. La coopération technique a connu un coup d’arrêt dans les années 1990 : des milliers de coopérants que l’on trouvait à cette époque, il n’en reste aujourd’hui plus qu’une trentaine, qui ont un rôle d’appui et conseil, et non plus de substitution. Nous devons nous en réjouir. La France a changé, la Côte d’Ivoire aussi : nos deux pays aspirent aujourd’hui à des relations de partenariat, fondées sur la réciprocité.
Dans cet esprit, l’accord de défense qui nous liait à la Côte d’Ivoire a été remplacé en 2012 par un partenariat de défense qui organise une coopération entre nos deux pays et ne prévoit plus de clause d’intervention en cas d’agression extérieure. Et le 43ème BIMA a cédé la place aux Forces françaises en Côte d’Ivoire, dont la vocation principale est de servir de base opérationnelle avancée pour les opérations dans la région, notamment au Sahel.
Ces évolutions ne signifient pas que nous ne devons pas avoir de l’ambition pour nos relations. La Côte d’Ivoire et la France conservent des liens étroits et nombreux dont nous devons tirer parti, dans l’intérêt mutuel de nos pays.
Ces liens, quels sont-ils ?
Nous avons cité la connaissance mutuelle entre les élites. Ce sont aussi les diasporas, importantes dans les deux pays. En Côte d’Ivoire, on compte environ 25.000 Français, dont une majorité de double-nationaux. Les Ivoiriens de France seraient environ 700.000. La diaspora ivoirienne s’est constituée assez tardivement. Dans les années 1960 à 1980, elle était peu nombreuse et principalement composée de cadres qui venaient pour être formés en France. C’est surtout dans les années 1990 et 2000 que des vagues importantes de migrations économiques puis politiques ont été enregistrées. Il faut noter que cette diaspora a la caractéristique d’être plutôt qualifiée, puisque 30% des émigrants sont diplômés du supérieur. Nous considérons qu’elle est un levier potentiellement puissant mais trop faiblement exploité pour bâtir des partenariats en faveur du développement. Un chiffre est particulièrement éloquent : 16 milliards de dollars par an. Il s’agit du montant total des transferts des diasporas présentes en France pour l’Afrique. Ces flux financiers sont affectés à l’alimentation, la sante ou l’éducation ; ils sont rarement dédiés à des investissements productifs.
La langue française est évidemment un autre lien important avec la Côte d’Ivoire. Comme ailleurs en Afrique, le français académique y a perdu du terrain, notamment en raison des effets déstructurants de la crise sur le système éducatif. Malgré cela, il existe une exception ivoirienne, qui veut que le français ne soit pas simplement la langue des affaires, de l’enseignement et de l’administration, mais aussi une langue d’usage c’est à dire parlée dans la rue, en famille et entre amis. Les jeunes Ivoiriens se sont réellement approprié un français qu’ils ont adapté à leurs propres réalités, que l’on appelle le « nouchi ». C’est ainsi qu’à Abidjan, tout le monde parle français, un français certes parfois éloigné de celui qu’on enseigne, mais qui n’en donne pas moins accès à un univers francophone commun.
Ce partage de la langue est important car il donne à la France un rôle singulier dans une Afrique de l’Ouest dont l’intégration est, en partie, freinée par le fossé culturel entre anglophones et francophones. Nous nous sommes d’ailleurs rendus au Ghana et avons constaté que les Ghanéens avaient un fort désir de travailler avec la France, justement pour bâtir des ponts avec leur voisinage francophone.
La présence économique française en Côte d’Ivoire est un autre élément important de notre relation bilatérale. Comme partout en Afrique francophone, nos entreprises ont perdu des parts de marché depuis le début des années 2000. En Côte d’Ivoire, cette part est passée de 28% à 14% environ aujourd’hui. Plusieurs partenaires étrangers ont tiré profit du relatif retrait des entreprises françaises lors de la crise des années 2000.
Celles-ci conservent néanmoins une place centrale dans l’économie ivoirienne. Elles représentent 40 à 50% des recettes de l’impôt sur les sociétés, 30% du PIB et emploient 35.000 personnes. Cette implantation est très diversifiée et tous les grands groupes français opérant en Afrique subsaharienne sont présents en Côte d’Ivoire, dont ils font souvent une plateforme pour leurs opérations dans la région : Bolloré, Orange, Bouygues, la Société générale, BNP Paribas, Canal +, Castel, Danone, La Compagnie fruitière, Total, Alstom, Engie, pour n’en citer que quelques-uns. Cette présence est moins ancrée pour les PME françaises, qui ont davantage pâti de la crise.
Quels sont leurs principaux concurrents ? Indéniablement, les Chinois sont montés en puissance en Côte d’Ivoire, mais il n’y ont pas conquis l’hégémonie que l’on connaît dans d’autres pays africains, notamment en raison du fort ancrage des entreprises françaises, et aussi parce que le pays n’est pas un producteur majeur de ressources minières. Les Chinois ont tout de même ont une position très importante dans le BTP et la cimenterie, où ils remportent la plupart des marchés. Le Chinois Startimes s’est aussi positionné pour le déploiement de la TNT dans le pays, en concurrence directe avec notre pays. Et il est incontestable que la part de la Chine dans l’encours de la dette ivoirienne est en augmentation constante, même si cette part demeure à peu près équilibrée avec celle de notre pays.
À côté des Chinois, les Marocains ont accompli une réelle percée en Côte d’Ivoire, où ils bénéficient à la fois de leur francophonie, de leur identité de pays africain, proche des réalités ivoiriennes, et de l’influence plus générale du Maroc, notamment dans le champ religieux. Il faut reconnaître que les Marocains ont su se forger de solides atouts ; nos collègues Jean Glavany et Guy Teissier nous en ont déjà parlé : une stratégie africaine claire et volontariste, portée au plus haut niveau, par le Roi ; un pragmatisme et une aptitude avérée pour « faire des affaires » ; mais aussi une audace et une propension à la prise de risques assez importantes, notamment de la part des banques marocaines qui accompagnent vraiment l’expansion économique marocaine dans le pays.
Outre les Chinois et des Marocains, la Côte d’Ivoire s’applique à diversifier ses partenaires et développe de plus en plus ses relations avec des pays africains tels que le Nigéria et l’Afrique du Sud, avec l’Inde, la Turquie, la Corée et d’autres encore. Les Anglo-saxons et les Européens sont présents aussi, notamment dans l’agro-industrie et l’exploitation minière. Et il faut souligner le poids économique de la diaspora libanaise, la plus importante du continent avec environ 60.000 membres. Elle joue un rôle de premier plan dans des secteurs comme l’immobilier et le commerce.
Vous l’aurez compris, le marché ivoirien présente sans doute des opportunités, mais il est aussi hautement concurrentiel. Quel peut donc être l’avantage comparatif des entreprises françaises ?
Classiquement, on peut mentionner la francophonie, la stabilité institutionnelle qu’offre le franc CFA, l’attrait pour la marque France alors qu’émerge une classe moyenne estimée actuellement à 13% de la population, qui veut consommer des produits de qualité. En Côte d’Ivoire, les entreprises françaises bénéficient en plus d’un dispositif d’accompagnement très complet, avec un bureau régional de Business France, une antenne de BPI France, des chambres de commerce, la coface, proparco (filiale de l’AFD en charge du secteur privé) etc.
Autre avantage : le fait que les entreprises françaises soient bien positionnées et dotées d’une expertise reconnue dans des secteurs où les besoins ivoiriens sont importants : l’agro-industrie, la gestion urbaine, la production et la distribution électrique, entre autres.
Enfin, il faut le souligner, la France a, en Côte d’Ivoire, une aide au développement à fort effet de levier grâce à la mise en œuvre de contrats de désendettements (C2D). Ce dispositif permet à la France de refinancer sous forme de dons des échéances de dette remboursées par la Côte d’Ivoire. Dans le cadre de l’initiative des pays pauvres très endettes (PPTE), la France a annulé en 2012 une partie de la dette bilatérale de la Côte d’Ivoire, qui était considérable : 900 millions d’euros ont fait l’objet d’une annulation sèche, tandis que 2,9 milliards d’euros devaient être remboursés puis reversés à la Côte d’Ivoire sous forme de projets de développement cogérés avec les Ivoiriens. Ce montant considérable autorise l’AFD à intervenir en Côte d’Ivoire avec des dons annuels de l’ordre de 200 à 250 millions d’euros, un montant exceptionnel qui permet de conduire des projets à fort impact. Ces projets bénéficient évidemment aux entreprises françaises qui disposent d’un positionnement ad hoc dans de nombreux secteurs.
Pourtant, les entreprises françaises doivent savoir répondre à la demande des Ivoiriens, qui veulent aller vers la coproduction locale. Ils aspirent à des transferts de savoir-faire et de technologie afin de développer leur tissu industriel, d’accélérer la diversification et la montée en gamme de leur économie. Les entreprises doivent donc être ouvertes à des montages laissant plus de place au partenariat, à la réciprocité.
La réciprocité, ce concept nous a semblé être l’axe majeur pour donner un nouvel élan à nos relations avec la Côte d’Ivoire, dans tous les domaines. Les Ivoiriens nous l’ont dit, ils veulent continuer à travailler avec notre pays, comme partenaires. C’est aussi notre souhait.
Cette base posée, il nous a semblé que nous devions mettre l’accent sur tout ce qui pouvait favoriser la connaissance et la compréhension mutuelle, en particulier le rapprochement des territoires, la coopération décentralisée étant quasiment inexistante entre nos deux pays (24 coopérations recensées) mais aussi et surtout le rapprochement des jeunes générations. C’est un fait, les jeunes Français diplômés sont assez peu tournés vers l’Afrique ; les pays émergents, notamment asiatiques, sont désormais des destinations beaucoup plus courtisées pour lancer une carrière professionnelle. Les jeunes Français n’ont pas connu l’époque de la coopération.
Cette remarque est aussi valable s’agissant des jeunes Ivoiriens des classes moyennes et supérieures qui vivent dans un environnement mondialisé. Pour eux, la France n’est plus une référence unique. La relation franco-ivoirienne va donc connaître un inévitable effet de génération qui pourrait fortement affaiblir les liens entre nos deux pays.
À cet égard, notre rapport contient une série de propositions que je vous invite à consulter.
Je conclurai en disant que certes, la Côte d’Ivoire est aujourd’hui plus ouverte à d’autres influences, à d’autres partenaires. Cependant, je ne suis pas de ceux qui alimentent la nostalgie du tête à tête exclusif de la France avec ses anciennes colonies d’Afrique. Cette époque est révolue, et c’est tant mieux. Mais je constate que la Côte d’Ivoire reste très francophile, et je pense fondamentalement que le partenariat avec ce pays doit être investi et valorisé, avec un objectif explicite et commun de développement et de prospérité.
M. Axel Poniatowski. Vous parlez peu du facteur religieux dans votre rapport. Est-ce à dire que ce n’est pas un sujet ? M. Ouattara est lui-même un musulman, il vient du nord du pays. Lorsqu’il a été élu président, on avait entendu que cela pourrait mettre le feu aux poudres, ce qui n’a pas du tout été le cas. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette division religieuse nord-sud du pays ? Par ailleurs, vous dites que l’aide au développement française en Côte d’Ivoire s’élève en moyenne à 200 ou 250 millions d’euros annuels, soit environ 10% de notre aide au développement. Pourriez-vous préciser si cela correspond à des dons ou à des prêts ?
M. François Loncle. Je voudrais féliciter chaleureusement le président Philippe Cochet et la rapporteure Seybah Dagoma pour le travail qu’ils ont effectué dans le cadre de cette mission. Nous avons eu raison de prendre du recul sur la crise ivoirienne ; le moment était venu de faire le point. Vous l’avez fait de manière équilibrée, en dépassant le clivage entre « pro-Gbagbo » et « pro-Ouattara » qui a longtemps prévalu, y compris au sein de nos partis. Votre rapport contient une analyse très intéressante et des informations détaillées sur la situation économique, politique et sociale du pays. Au passage, je souhaiterais dire au président qu’à mon avis, les clivages sont plutôt ethniques que fondamentalement religieux en Côte d’Ivoire.
Par ailleurs, vous effectuez un certain nombre de préconisations au sujet de nos relations bilatérales. Je pense néanmoins que nous devrions essayer d’impliquer plus fortement l’Union européenne. Cela vaut pour la Côte d’Ivoire, mais aussi pour nos partenaires d’Afrique de l’Ouest et centrale. Nous pourrions tirer parti de l’investissement nouveau de l’Union européenne sur les questions sécuritaires dans le Sahel. La Haute Représentante de l’Union européenne, Federica Mogherini, a elle-même exprimé cet intérêt renouvelé de l’Europe lors du sommet de Dakar. Je pense que désormais, il nous faut raisonner davantage en Europe-Afrique qu’en France-Afrique.
Je souhaite enfin vous interroger sur les répercussions potentielles du procès de l’ancien Président Gbagbo sur la Côte d’Ivoire. Vous l’avez dit, ce procès est interminable ; c’est propre au fonctionnement de la Cour pénale internationale. Dans la situation où le Président Gbagbo viendrait à être libéré, quelles en seraient, d’après vous, les conséquences sur la situation politique en Côte d’Ivoire ? À l’inverse, quels seraient les effets d’un procès qui se prolongerait encore pendant plusieurs années ?
M. Michel Terrot. Je voulais à mon tour féliciter les deux auteurs du rapport, qui va vraiment au fond des choses. J’étais moi-même en Côte d’Ivoire peu de temps avant le déplacement de la mission. J’y ai constaté une chose que le rapport souligne bien. On observe une différence peu explicable entre la croissance soutenue que connaît la Côte d’Ivoire depuis plusieurs années, qui est d’autant plus significative qu’elle ne provient pas de revenus d’extraction, et la relative stagnation des indicateurs sociaux. La Côte d’Ivoire accuse un retard considérable pour ce qui relève de la protection maternelle et infantile, de l’éducation et des droits sociaux au sens large. Cela suggère un problème d’évaporation de la ressource. Il me semble qu’à cet égard, le rapport est sans complaisance.
De manière générale, je trouve que les interrogations et pistes de réflexions que vous dégagez vont dans le bon sens, s’agissant notamment des contrats de désendettement (C2D). Il nous reste encore plus d’un milliard d’euros de crédits à utiliser dans ce cadre, ce qui permettra à la France de continuer à financer d’importants projets en faveur du développement ivoirien au cours des prochaines années.
Je partage aussi vos réflexions sur la politique des visas. Il faut que nous fassions en sorte de permettre aux étudiants et autres acteurs africains les plus méritants de venir se perfectionner en France, faute de quoi ils se tourneront vers d’autres horizons. Nous les voyons déjà partir dans les universités canadiennes – en particulier pour les francophones – mais aussi américaines et chinoises.
M. Jean-Pierre Dufau. Il était très important de faire un rapport sur la Côte d’Ivoire, qui est un pays au cœur de l’actualité, dont l’avenir nous intéresse tous. Vous avez évoqué la création d’un Sénat comme participant à l’affermissement de la démocratie ivoirienne et à la réconciliation nationale. Je souhaiterais savoir comment cette initiative est perçue au-delà de la sphère politique, par la population ivoirienne ? Je pense notamment au mécanisme consistant à confier au Président la nomination d’un tiers des membres, plutôt que de les faire élire.
Vous avez évoqué un problème fondamental en Afrique, au-delà de la Côte d’Ivoire : la propriété foncière. La politique de colonisation agraire conduite sous le Président Houphouët-Boigny se poursuit-elle aujourd’hui ? Les autorités ivoiriennes font-elles en sorte de maîtriser les risques écologiques, avec par exemple des mesures pour préserver la forêt et reboiser ? Vous avez évoqué la présence de 25% d’étrangers en Côte d’Ivoire, que l’on retrouve notamment parmi les migrants qui ont colonisé le front agraire. Avez-vous des indications sur leur nationalité ? Trouve-t-on parmi eux des Chinois ? Nous savons qu’ils ont accaparé de nombreuses terres dans d’autres pays d’Afrique pour asseoir leur développement économique.
Vous avez raison de dire que la francophonie est très ancrée en Côte d’Ivoire. Le pays s’est d’ailleurs toujours investi dans les institutions de la francophonie, Organisation internationale de la francophonie (OIF) mais aussi Assemblée parlementaire de la francophonie (APF). Le président de l’Assemblée nationale ivoirienne, M. Soro, veille à toujours y être présent, ce qui est loin d’être le cas général pour ses homologues des autres pays. Ne pensez-vous pas que la francophonie soit un levier important pour bâtir le partenariat avec la France et la Côte d’Ivoire ? Au-delà de la dimension économique de la francophonie, je pense à sa dimension sociétale. La France ne doit-elle pas chercher à appuyer l’éducation ivoirienne, notamment celle des femmes, pour renforcer la francophonie ?
Enfin, pourriez-vous nous préciser s’il existe des domaines où les entreprises françaises pourraient intervenir davantage, notamment dans le cadre de coproductions avec les Ivoiriens?
M. Michel Destot. Pouvez-vous nous préciser ce qui relève du bilatéral et du multilatéral dans l’aide au développement que nous donnons à la Côte d’Ivoire ? Pensez-vous que la Côte d’Ivoire a vocation à jouer un rôle moteur – économique, mais aussi politique – au sein de la région ? Abidjan est devenue une capitale très importante par sa démographie ; je crois qu’elle est deux ou trois fois plus peuplée que Dakar, ce qui en ferait l’une des plus grosses métropoles d’Afrique. Cette situation pose évidemment des défis en termes de gestion urbaine. N’avons-nous pas un rôle spécifique à jouer pour appuyer la Côte d’Ivoire dans ce domaine ?
M. Thierry Mariani. Ce rapport est très intéressant, j’en félicite les auteurs. Pouvez-vous nous préciser où en sont les procédures engagées suites aux évènements de Bouaké où, en 2004, plusieurs militaires français avaient perdu la vie ? Il me semble que les choses ne sont toujours pas très claires à ce sujet. Par ailleurs, existe-t-il une réelle menace terroriste en Côte d’Ivoire, liée à la radicalisation de certains éléments et à la possible émergence de filières locales ?
M. Philippe Cochet. Vous évoquiez, monsieur le Président, la dimension religieuse. Elle est importante en Côte d’Ivoire, mais sans doute pas source de divisions comme elle peut l’être ailleurs. De nombreuses familles ivoiriennes comportent des personnes de différentes religions, qui vivent en harmonie sous le même toit. Ainsi, cette question semble n’être pas vraiment problématique. Plusieurs interlocuteurs, y compris des responsables religieux, nous l’ont confirmé.
Vous avez aussi mentionné l’aide au développement. Il est important de souligner que l’AFD a en Côte d’Ivoire son plus gros portefeuille de projets, grâce au mécanisme du C2D qui permet de déployer des montants considérables sous forme de dons. Sur le terrain, on observe d’ailleurs que, lorsque la France y met les moyens, elle obtient des résultats qui se mesurent en termes d’influence, mais aussi de retours économiques. Ce constat doit nous inciter à éviter de trop « saupoudrer » notre aide au développement.
Monsieur Loncle, vous nous avez interpelés au sujet du procès de Laurent Gbagbo. Nous ne pouvons pas faire de politique-fiction. C’est vrai que ce procès est long, trop long. Ce que nous constatons, c’est que la réconciliation prend du temps. C’est normal, c’est un processus. La crise a été très dure et a beaucoup marqué les esprits. Aujourd’hui, la situation est contrastée : on a progressé, mais la réconciliation n’est pas achevée.
Michel Terrot s’inquiétait de l’« évaporation » de l’argent public ivoirien et de l’absence de redistribution des fruits de la croissance. Il s’agit d’une perception bien réelle au sein de la population ivoirienne. Le Président Ouattara a mis l’accent sur le développement des infrastructures, ce qui rend la croissance très visible, d’autant plus qu’elle est médiatisée, mais les Ivoiriens expliquent qu’ils « ne mangent pas de béton ». Ils ont l’impression que les élites confisquent la croissance. De fait, de nombreux interlocuteurs nous ont rapporté leur sentiment que la corruption était très forte en Côte d’Ivoire, et qu’elle était véritablement endémique. Les autorités ont néanmoins affiché leur volonté de la réduire. C’est important, car si la corruption dépasse un certain niveau, elle risque de dissuader les investisseurs, notamment français, et de freiner le développement économique du pays.
Mme Seybah Dagoma. Au sujet des religions, je voudrais préciser que la division nord-sud n’est pas une grille de lecture vraiment pertinente, car on retrouve en réalité de très nombreux musulmans dans le sud du pays. Comme le disait Philippe Cochet, la population est très mélangée et les mariages mixtes sont fréquents. La religion n’est donc pas réellement un facteur de divisions. Une réserve toutefois : dans le nord du pays, on observe de plus en plus d’organisations non gouvernementales (ONG) dont on ne connaît pas les donneurs d’ordres. Cela répond aussi en partie à la question de Thierry Mariani. Néanmoins, pour le moment, la menace terroriste reste essentiellement extérieure.
J’insiste sur le fait que les montants que nous évoquions pour le C2D sont reversés à la Côte d’Ivoire sous forme de dons. Par ailleurs, l’AFD déploie toute la palette de ses instruments en Côte d’Ivoire, par exemple les garanties bancaires ARIZ en faveur des petites et moyennes entreprises, les prêts non souverains et, depuis récemment, les prêts souverains.
M. Terrot, vous avez raison de dire qu’il y a un paradoxe ivoirien. Les taux de croissance élevés ne se traduisent pas par une amélioration de la situation pour tout le monde. Les inégalités sociales et territoriales sont considérables. La différence est saisissante entre Abidjan et Bouaké, la deuxième ville du pays. La pauvreté reste massive : Philippe Cochet l’a dit tout à l’heure, 46% des Ivoiriens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, les autorités ne sont pas restées les bras croisés. Depuis 2012, plusieurs mesures résolument sociales ont été adoptées : création d’une couverture maladie universelle, hausse du salaire minimum garanti, déblocage des avancements indiciaires des fonctionnaires, école gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans… Des choses ont été faites, mais cela ne suffit pas. Les autorités ivoiriennes doivent donc persévérer dans ce sens.
M. Dufau, vous nous interrogiez sur la perception des Ivoiriens quant à l’institution prochaine d’un Sénat. Il faut préciser qu’en Côte d’Ivoire, un peu comme en France, on constate une forme de défiance des citoyens à l’encontre de la vie politique. Elle explique en partie l’abstention très forte que l’on observe lors des élections, qui résulte aussi de la consigne de boycott donnée par une partie de l’opposition. Certaines personnes ont pu critiquer la création d’un Sénat en raison des coûts supplémentaires qu’elle engendrera. Mais globalement, nous ne pouvons pas dire que nous ayons observé une opposition forte sur ce sujet au sein de la population ivoirienne.
M. Destot, je pense comme vous que l’intégration régionale de l’Afrique de l’Ouest est un sujet essentiel. Et il faut dire que, dans ce domaine, le Président Ouattara a joué un rôle très actif depuis sa prise de fonctions. Il a assuré pendant deux années consécutives la présidence de la communauté des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), puis celle de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il s’est aussi rapproché de son voisin ghanéen. En effet, la coopération entre la Côte d’Ivoire et le Ghana recèle un potentiel considérable ; dans le rapport, nous appelons cela « Ghanivoire ». Pour le moment, ce potentiel est très peu exploité, mais si ces deux pays travaillaient un peu plus ensemble, cela pourrait avoir un effet d’entraînement important pour la région. Cependant, de nombreux obstacles perdurent. C’est le cas de la langue, mais aussi de la monnaie : si la Côte d’Ivoire, qui fait partie de l’UEMOA, utilise le franc CFA, ce n’est pas le cas du Ghana. Sa monnaie, le Cédi, est bien plus faible que le franc CFA.
Je partage l’appréciation de Jean-Pierre Dufau, la francophonie est incontestablement un levier important en Côte d’Ivoire. Le pays accueillera d’ailleurs dans quelques mois les Jeux de la Francophonie. Les Ivoiriens sont très mobilisés dans ce domaine, comme vous l’avez souligné.
Il est vrai que la réconciliation est un processus inachevé. D’entrée de jeu, elle a été compliquée par le fait qu’une partie importante de l’opposition a refusé de participer aux mécanismes institutionnels. Cette situation perdure aujourd’hui. Nous le voyons bien en France, où la diaspora ivoirienne est très véhémente contre le pouvoir en place. Concernant la situation de Laurent Gbagbo, ce que nous pouvons dire, c’est qu’il bénéficie encore aujourd’hui du soutien actif d’un certain nombre de personnes.
M. Loncle, vous évoquiez l’Union européenne, cela me fait penser que la Côte d’Ivoire est désormais éligible, depuis quelques jours, au fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne qui a vocation à traiter les « causes profondes » des migrations. En effet, il faut savoir que les Ivoiriens sont la quatrième nationalité la plus représentée parmi les migrants qui arrivent illégalement en Italie. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire bénéficie des crédits du Fonds européen de développement (FED).
M. Philippe Cochet. Je souhaite revenir un instant sur la problématique du foncier, évoquée par Jean-Pierre Dufau. La colonisation agraire a posé deux problèmes distincts, les conflits pour l’accès à la propriété foncière et les risques écologiques suscités par la déforestation. Concernant le premier aspect, nous le disions, cette question n’est pas réglée aujourd’hui et demeure une source potentielle d’affrontements. Pour déterminer les droits de propriété, il faudrait déjà qu’un cadastre soit établi, et cette seule question pose problème. Par ailleurs, les migrants continuent de traverser comme ils le souhaitent des frontières qui demeurent théoriques du point de vue des populations. Ainsi, le phénomène se poursuit et se renforce. Il y a donc une certaine urgence à trouver une forme de résolution sur le partage des droits de propriété foncière. Cela dit, c’est plus facile à dire qu’à faire. Vu de France, nous ne nous rendons pas compte de la complexité de cette question, liée à la superposition de plusieurs droits coutumiers – individuels et collectifs – sur les terres. Quand une personne a exploité une terre pendant dix, vingt ans voire plus, Il est difficile de lui faire comprendre qu’elle doit à présent la restituer.
Par ailleurs, vous avez raison de dire que la colonisation agraire comporte des risques écologiques si elle n’est pas maîtrisée. C’est un problème pour la Côte d’Ivoire, qui a perdu 75% de sa surface forestière en cinquante ans. Les autorités cherchent désormais à protéger ce qui reste de forêt. Ce n’est pas toujours facile, car la pression foncière est intense et la Côte d’Ivoire a des possibilités agraires phénoménales. Cela dit, nous avons constaté que les surfaces étaient loin d’être utilisées au maximum de leur potentiel actuellement.
Mme Seybah Dagoma. Je voudrais simplement vous donner un chiffre : la surface forestière de la Côte d’Ivoire est passée de 16 millions d’hectares dans les années 1960 à 3,4 millions d’hectares aujourd’hui.
M. Philippe Cochet. Concernant la gestion d’urbaine d’Abidjan, évoquée par M. Destot, c’est sans doute un souci pour les dirigeants ivoiriens, mais je pense que la pression de la pauvreté tend parfois à reléguer au second plan les impératifs d’urbanisme.
Pour conclure, je tiens tout de même à souligner que nous avons été très favorablement impressionnés par la qualité du personnel politique ivoirien. Les gens que nous avons rencontrés nous ont semblé avoir une vraie vision, une vraie approche politique des principaux enjeux pour le pays. La Côte d’Ivoire est engagée dans un processus ; il faut donc laisser un peu de temps et faire en sorte que la stabilité soit préservée, afin de permettre à ce processus d’aller à son terme.
La commission autorise la publication du rapport d’information à l’unanimité.
SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION
Recommandation n°1 : Instaurer un échange régulier avec le Fonds monétaire international (FMI) lors des réunions des ministres de la zone franc pour renforcer la coordination des politiques économiques régionales.
Recommandation n°2 : Répondre à la demande ghanéenne en appuyant l’apprentissage du français, susceptible de favoriser l’intégration régionale, d’une part et les échanges avec la Côte d’Ivoire, d’autre part.
Recommandation n°3 : Remobiliser l’aide au développement et l’expertise françaises en faveur des pays du Sahel, dont la stabilité et le développement sont un enjeu essentiel et commun à la France et à la Côte d’Ivoire.
Recommandation n°4 : Étudier les moyens de donner une meilleure visibilité à la culture ivoirienne en France et favoriser les échanges entre les acteurs culturels de nos deux pays.
Recommandation n°5 : Appuyer la prise en compte par les autorités ivoiriennes de la situation des apatrides.
Recommandation n°6 : Renforcer les liens entre les parlements français et ivoirien, notamment dans le cadre des groupes d’amitié, en faisant en sorte de favoriser les échanges entre femmes députées.
Recommandation n°7 : Amplifier les actions dédiées à la justice dans le cadre du C2D et accroître les échanges entre professionnels de la justice français et ivoiriens de façon à mieux partager les expériences et bonnes pratiques.
Recommandation n°8 : Orienter une partie des crédits du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne en appui aux efforts du gouvernement ivoirien pour sécuriser l’état civil.
Recommandation n°9 : Préserver le remarquable outil d’intervention qu’est le C2D ivoirien en maintenant une gestion partenariale des projets et en fluidifiant au maximum les procédures.
Recommandation n°10 : Amplifier la coopération pour un développement durable de la Côte d’Ivoire, domaine à fort enjeu dans lequel un appui extérieur est indispensable et où la France a une expertise à faire valoir.
Recommandation n°11 : Poursuivre les efforts visant à diminuer le coût des transferts d’argent et mobiliser l’épargne de la diaspora africaine, y compris ivoirienne, vers des investissements productifs en faveur du développement du pays.
Recommandation n°12 : Aller vers la mise en œuvre d’un mécanisme subventionné par l’AFD favorisant la mobilité des compétences de la diaspora ivoirienne de France vers la Côte d’Ivoire.
Recommandation n°13 : Solliciter des entreprises de la diaspora pour participer aux délégations qui accompagnent les voyages présidentiels ou ministériels en Côte d’Ivoire, de manière à leur donner plus de visibilité, mieux les identifier et favoriser leur mise en réseau.
Recommandation n°14 : Poursuivre les efforts visant à fluidifier les procédures de demandes de visas et à ouvrir davantage la France aux étudiants, aux talents et aux artistes.
Recommandation n°15 : Prévoir l’attribution automatique d’un visa à tout étudiant ivoirien se voyant octroyer une bourse pour étudier en France, comme le préconisait le rapport Védrine – Zinsou.
Recommandation n°16 : Aller vers la mise en place d’un cadre d’échanges étudiants de type Erasmus avec la Côte d’Ivoire.
Recommandation n°17 : Augmenter le nombre de volontaires internationaux en entreprise (VIE) en Côte d’Ivoire en collaborant davantage avec les entreprises et Business France.
Recommandation n°18 : Appuyer la montée en puissance d’unités franco-ivoiriennes de recherche dont les travaux seraient, à terme, valorisés par un brevet ivoirien de recherche.
Recommandation n°19 : Étudier la mise en place d’un programme de type « Young leaders » entre la France et la Côte d’Ivoire, de façon à renforcer la proximité et les échanges de vues entre les jeunes générations de dirigeants.
Recommandation n°20 : Exploiter le potentiel de la coopération entre territoires français et ivoiriens en cherchant à mobiliser les financements européens prévus à cet effet. En l’absence de réelle décentralisation ivoirienne, travailler sur des approches de coopération territoriale mêlant services déconcentrés de l’État et collectivités territoriales.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
Nota bene : Cette liste rassemble toutes les auditions officiellement conduites par la mission. Elle n’a cependant pas une vocation exhaustive. Plusieurs rencontres et échanges conduits de manière informelle ne sont pas répertoriés ici mais ont également contribué à nourrir le rapport de la mission.
1) A Paris
– S.E. M. Charles Gomis, ambassadeur de Côte d’Ivoire en France et M. Vacaba Diaby, premier conseiller ;
– M. Jean-Christophe Belliard, directeur d'Afrique et de l'océan Indien à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et du développement international (18 mai 2016);
– Colonel Yannick Agazzini, chef du bureau Afrique de la direction du renseignement militaire (DRM) (25 mai 2016);
– M. Thomas Courbe, directeur général adjoint du Trésor (14 juin 2016);
– M. Francis Akindes, professeur de sociologie à l’université Alassane Ouattara de Bouaké, Côté d’Ivoire (21 juin 2016);
– M. Christian Bouquet, professeur émérite de géographie politique à l’université Bordeaux-Montaigne et chercheur au laboratoire Les Afriques dans le monde (LAM) (5 juillet 2016);
– M. Charles Konan Banny, ancien Premier ministre de la Côte d’Ivoire (15 novembre 2016);
– M. Richard Banégas, professeur de sociologie politique au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po (15 novembre 2016);
– M. Jean-Pierre Marcelli, directeur du département Afrique subsaharienne à l’Agence française de développement (AFD) (29 novembre 2016);
– M. Bruno Stagno Ugarte, directeur exécutif adjoint pour le plaidoyer de Human Rights Watch (29 novembre 2016);
– M. Bernard Houdin, conseiller de Laurent Gbagbo (18 janvier 2017);
– Me Emmanuel Altit, avocat de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale Internationale (25 janvier 2017);
– Général Bruno Clément-Bollée, ancien commandant de la force Licorne, ancien conseiller pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration (DDR) auprès du gouvernement ivoirien (25 janvier 2017);
– M. Rémi Maréchaux, directeur d'Afrique et de l'océan Indien à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et du développement international (8 février 2017) ;
– M. Jean-Michel Debrat, directeur général de la fondation Africa – France (8 février 2017)
– Dr Elie Nkamgueu, Président du club Efficience, accompagné de Christian Makolo Kabala, Directeur Développement France du Club Efficience (9 février 2017) ;
– M. Sansan Kambile, ministre de la justice de la Côte d’Ivoire (13 décembre 2017) ;
2) En Côte d’Ivoire (du 28 septembre au 2 octobre 2016)
– S.E. M. Georges Serre, ambassadeur de France en Côte d’Ivoire et M. Etienne Chapon, premier conseiller ;
– M. Daniel Kablan Duncan, Premier ministre ;
– M. Amadou Gon Coulibaly, Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence, maire de Korhogo ;
– M. Hamed Bakayoko, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la sécurité ;
– Mme Fadika Sarra Sako, Première vice-présidente de l’Assemblée nationale et M. Lazare Latte N’Drin, Secrétaire général ;
– Rencontre avec des représentants des partis politiques de la majorité :
• M. Mamadou Dely, Président du groupe parlementaire UDPCI à l’Assemblée nationale
• M. Joël N’Guessan, secrétaire général adjoint du RDR
• M. Maurice Guikahue, secrétaire exécutif du PDCI
• M. Yayoro Karamoko, Député RDR
• Mme Yasmina Ouegnin, députée PDCI
– M. Augustin Thiam, Gouverneur de Yamoussoukro ;
– M. Pascal Affi N’Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI), ancien Premier ministre et M. Alcide Djedje, FPI, ancien ministre des Affaires étrangères ;
– Mme Aïchatou Mindaoudou, Représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en Côte d’Ivoire ;
– Général Didier L’Hôte, commandant de la force militaire de l’opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) ;
– Rencontre à la chambre de commerce et d’industrie France-Côte d’Ivoire (CCI-FCI) :
• M. Pierre Héry, vice-président de la chambre, directeur général de la CMA-CGM ;
• M. Hervé Chaudron, secrétaire général de la chambre, directeur général de la CETACI ;
• M. Jean-Louis Menann-Kouame, directeur général de la BICICI ;
• M. Philippe Barbieri, directeur général d’Air France ;
– Mme Sophie Clavelier, directrice de Business France Côte d’Ivoire ;
– Visite au foyer Akwaba : Père Josep Enric Escano i Duran, directeur du foyer ;
– M. Francis Akindes, Professeur de sociologie à l’université Alassane Ouattara de Bouaké ;
– Visite aux Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) :
• Colonel Jean-Luc Kuntz, commandant des FFCI ;
• Colonel Xavier Lafargue, attaché de défense.
– Rencontre avec des personnalités ivoiriennes et représentants de la communauté d’affaires :
• M. Marc Alberola, directeur général d’Eranove ;
• M. Gilles Cardona, directeur général de la Soudotec, président des conseillers du commerce extérieurs de la France ;
• Me Jean-François Chauveau, Avocat ;
• Mme Martine Coffi-Studer, présidente du conseil d’administration de Bolloré Africa Logistics ;
• Mme Illa Donwahi, directrice de la Fondation Donwahi pour l’art contemporain ;
• M. Venance Konan, journaliste et directeur général du groupe Fraternité Matin ;
• M. Ramzi Omais, président directeur général de la SOTICI et de l’hôtel Tiama ;
• Mme Namizata Sangare, présidente de la Commission nationale des droits humains de Côte d’Ivoire.
– Rencontres lors du déplacement de la mission à Korhogo (nord, district des Savanes) :
• Rencontre avec des villageois et visite d’une école à Bêmavogo ;
• Rencontre avec des villageois autour d’une parcelle de coton à Nangounkaha ;
• Visite aux tisserands de Waraniéné et aux peintres sur toile de Korhogo.
– Rencontres lors du déplacement de la mission à Bouaké (centre, vallée du Bandama) :
• M. Kamal Hélou, consul honoraire de France à Bouaké ;
• Mgr Paul Siméon Ahouana, archevêque de Bouaké ;
• Mme Anne Poinsignon et M. Cédric Pennetier, chercheurs à l’Institut pour la recherche et le développement (IRD).
3) Au Maroc (du 25 au 27 septembre 2016)
– S.E. M. Jean-François Girault, ambassadeur de France au Maroc et Mme Elena Tonev, première secrétaire ;
– M. Brahim Fassi Fihri, président fondateur de l’institut Amadeus ;
– M. Karim El Aynaoui, directeur général de l’OCP Policy Center ;
– M. Said Maghraoui, directeur de la politique des échanges extérieurs au ministère du commerce extérieur du Maroc ;
– Mme Yacine Fal, représentante résidente de la Banque africaine de développement (BAD) ;
– M. Eric Baulard, directeur de l’AFD ;
– M. Zouhair Triqui, secrétaire général de Maroc export ;
– M. Abdou Diop, Président de la Commission Afrique et Sud-Sud de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).
4) Au Ghana (du 2 au 4 octobre 2016)
– S.E. M. François Pujolas, ambassadeur de France au Ghana, Mme Cécile Vigneau, première conseillère, M. Gwenolé Jan, conseiller économique
– M. Prosper Bani, ministre de l’Intérieur ;
– M. Emmanuel Bombande, vice-ministre des affaires étrangères et de l’intégration régionale ;
– Rencontre au Parlement :
• M. Emmanuel Kwasi Bandua, membre du parlement, président de la commission des affaires étrangères
• M. Isaac Osei, membre du parlement, vice-président de la commission des affaires étrangères, ancien ambassadeur du Ghana à Londres, ancien directeur du COCOBOD
• M. Amadu Sorogho, président de la commission du commerce et de l’industrie, président du groupe d’amitié Ghana-France
– Rencontres avec des organisations représentant la société civile :
• West Africa civil society institute (WACSI, soutien aux organisations de la société civile)
• Moremi Initiative et Global Women Development Promoters (droits des femmes)
• Ghana anti-corruption Coalition et Centre for Local Governance (lutte contre la corruption)
– Rencontre avec la communauté d’affaires française :
• M. Patrick Prado, directeur Allianz Ghana et président de la section locale des conseillers du commerce extérieur français et de la Chambre de commerce et d’industrie France-Ghana ;
• M. Gauthier Pourcelle, directeur général de Technip Ghana ;
• M. François Marchal, directeur général adjoint de Société Générale Ghana ;
• Mme Carole Ramella, fondatrice et directrice de GFA Consulting Ltd.
– Rencontre avec des représentants de la communauté d’affaires ghanéenne :
Les présidents de :
• Private Enterprise Federation (PEF): M. Nana Osei Bonsu
• Ghana Chamber of Commerce and Industry: M. Nana Dankawoso
• CEO Innohub, incubateur ghanéen : M. Nelson Amo
– Rencontre avec des personnalités de la société civile ghanéenne :
• Mme le docteur Joyce Aryee, fondatrice de Salt and Light ministries ;
• M. Franklin Cudjoe, président et directeur du think tank IMANI ;
• M. Kwesi Jonas, chercheur à IDEG ;
• M. Emmanuel Asante, président du Conseil national de paix ;
• M. Kwesi Botchwey, président de la Commission nationale de planification du développement.
– Visite au Kofi Annan International Peacekeeping Center :
• Air vice Marshal Griffiths Santrofi Evans, commandant du centre ;
• M. le docteur Kwesi Aning, directeur de la faculté de recherche.
– Mme Ioli Kimyaci, représentante du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) au Ghana ;
– Mme Amélie July, directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) au Ghana.
1 () Africanistan, Serge Michailof, Fayard, 2015.
2 () Côte d’Ivoire, le désespoir de Kourouma, Christian Bouquet, Armand Colin, 2011.
3 () Vingt-septième rapport du Secrétaire général sur l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, 30 mars 2011.
4 () « La réforme du secteur de la sécurité à l’ivoirienne », Aline Lebœuf, Les études IFRI, mars 2016.
5 () Rapport spécial du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire publié le 29 mars 2012.
6 () Rapport final du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire établi en application du paragraphe 27 de la résolution 2153 du Conseil de sécurité de l’ONU.
7 () Ibid., p.18-19.
8 () https://onuci.unmissions.org/la-division-ddr-0
9 () « Côte d’Ivoire : Ouattara veut protéger les minorités », interview au journal L’Express, 25 janvier 2012.
10 () Rapport final du groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire, op. cit.
11 () « Rapport sur les abus des droits de l’homme commis par les Dozos en république de Côte d’Ivoire », ONUCI et OHCHR, juin 2013.
12 () Côte d’Ivoire, le désespoir de Kourouma, Christian Bouquet, Armand Colin, 2011.
13 () Pour être éligible à la présidence de la République, il fallait « être né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens de naissance, n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et résider de façon continue en Côte d’Ivoire pendant les cinq années précédant la date des élections ».
14 () L’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) de Mabri Toikeuse, l’Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI) de Gnamien Konan et le Mouvement des forces d’avenir (MFA).
15 () Et nombre de ses soutiens...
16 () http://www.rfi.fr/afrique/20170110-cote-ivoire-guillaume-soro-repart-surprise-deuxieme-mandat-assemblee
17 () « Côte d’Ivoire : Ouattara veut « protéger les minorités » », interview au journal l’Express, janvier 2012.
18 () « La force de l’éléphant, pour que sa croissance génère plus d’emplois de qualité », situation économique en Côte d’Ivoire, Banque mondiale, décembre 2015.
19 () Africanistan, Serge Michailof, Fayard, 2015.
20 () Données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Food and agriculture organisation – FAO).
21 () « Examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire : volume 1, évaluation initiale, Les voies de développement », OCDE, 2016.
22 () Rapport du Groupe d’expert de l’ONU du 13 avril 2015, op. cit.
23 () D’après un rapport de la Société financière internationale (SFI/IFC) et Master Card foundation.
24 () « Cybercriminalité : arnaques, crimes et internet », Jeune Afrique, 18 février 2013. http://www.jeuneafrique.com/138332/societe/cybercriminalit-arnaques-crimes-et-internet/
25 () « Le défi des compétences : pourquoi la Côte d’ivoire doit réformer son système éducatif », la Banque mondiale, janvier 2017.
26 () « La force de l’éléphant, pour que sa croissance génère plus d’emplois de qualité », situation économique en Côte d’Ivoire, Banque mondiale, décembre 2015.
27 () La FEC est une facilité de prêt qui vise à soutenir les programmes économiques sur le moyen-long terme des pays qui connaissent des difficultés prolongées de balance des paiements.
28 () Le MEC a été créé pour apporter un concours à des pays qui sont aux prises avec de graves déséquilibres de balance des paiements à cause d’obstacles structurels ou affichent une croissance lente et une position de balance des paiements intrinsèquement fragile.
29 () « Le défi des compétences : pourquoi la Côte d’ivoire doit réformer son système éducatif », op. cit.
30 () Règlement délégué 1076/2016
31 () L’Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest rassemble huit Etats d’Afrique de l’Ouest utilisant le franc CFA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.
32 () La Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest rassemble 15 Etats d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.
33 () http://www.jeuneafrique.com/mag/312012/economie/integration-regionale-ca-ne-marche/
34 () Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. Il s’agit là du franc CFA XOF. Une autre union monétaire, la CEMAC, constitue la zone franc d’Afrique centrale, dont le franc CFA (XAF) n’est ni échangeable ni convertible avec le franc CFA de l’UEMOA.
35 () http://www.theafricareport.com/West-Africa/ghana-cote-divoire-a-new-country-ghanivoire-could-weld-together-west-africa.html
36 () Expression utilisée par le président ghanéen John Dramani Mahama lors de sa visite en Côte d’Ivoire, en juin 2016.
37 () M. Belliard était alors directeur du département Afrique subsaharienne et océan Indien au ministère des Affaires étrangères.
38 () Serge Michailof, op. cit.
39 () « Au Sahel, notre politique d’aide au développement s’est fourvoyée », interview de Serge Michailof, Le Monde, 29 avril 2016. http://www.lemonde.fr/international/article/2016/04/29/serge-michailof-le-sahel-est-constitue-d-une-serie-de-poudrieres_4911188_3210.html
40 () Serge Michailof, op. cit.
41 () Cette formule a été rapportée à la mission par des jeunes Ivoiriens
42 () http://carte.afd.fr/afd/fr/projet/reduire-la-mortalite-maternelle-et-infantile-en-cote-divoire
43 () Cette CMU doit proposer un régime contributif pour toutes les populations de Côte d’Ivoire en contrepartie d’une contribution mensuelle de 1000 FCFA à partir de l’âge de cinq ans, et un régime non-contributif pour les personnes en grande difficulté financière, intégralement prises en charge par l’État. La mise en place de cette CMU doit être très progressive : de 17% en 2015, son taux de couverture devrait atteindre 40% de la population en 2021.
44 () Les objectifs du millénaire pour le développement sont huit objectifs adoptés en 2000 à New York qui recouvrent de grands enjeux humanitaires : la réduction de l’extrême pauvreté et de la mortalité infantile, la lutte contre plusieurs épidémies dont le SIDA, l'accès à l’éducation, l’égalité des sexes, et l'application du développement durable. Ces objectifs devaient être atteints en 2015.
45 () Examen multidimensionnel de la Côte d’Ivoire, OCDE, op. cit
46 () « Le défi des compétences : pourquoi la Côte d’Ivoire doit réformer son système éducatif ? », la Banque mondiale, janvier 2017.
47 () Voir La crise ivoirienne, de Félix Houphouët-Boigny à la chute de Laurent Gbagbo, Thomas Hofnung, La Découverte, 2011.
48 () Conventions de l’ONU du 1954 relative au statut des apatrides et de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie
49 () Voir l’étude « L’urbanisation diversifiée : le cas de la Côte d’Ivoire », Madio Fall et Souleymane Coulibaly, Banque mondiale, 2016.
50 () « Comment bénéficier du dividende démographique ? Replacer la population au centre des trajectoires de développement de la Côte d’Ivoire », Jean-Pierre Guengant, novembre 2014.
51 () Par exemple, « Reconstruction « post-conflit », violence et politique en Côte d’Ivoire », Richard Banégas, octobre 2012, CERI Sciences Po.
52 () Surnommés ainsi en référence au film « La Cité de Dieu » qui raconte l’ultraviolence d’un quartier de Rio de Janeiro. Le Gouvernement demande à présent qu’ils soient désignés comme des « jeunes en conflit avec la loi ».
53 () « Criminalité et violence en Côte d’Ivoire », une étude du centre de recherche pour le développement international (CRDI) coordonnée par le professeur Francis Akindes.
54 () « Africanistan », Serge Michailof, op. cit.
55 () http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/cote-d-ivoire-ouattara-veut-proteger-les-minorites_1075076.html
56 () « La force de l’Éléphant », Banque mondiale, op.cit.
57 () http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/06/09/cote-d-ivoire-vers-une-enquete-sur-les-milliards-disparus-de-la-noix-de-cajou_4944917_3212.html
58 () « Africanistan », Serge Michailof, op.cit.
59 () « Rapport sur les viols et leur répression en Côte d’Ivoire », juillet 2016, ONUCI et Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme http://onuci.unmissions.org/sites/default/files/cote_d_ivoire_-_rapport_sur_les_viols_et_leur_repression_-_juillet_20161.pdf
60 () Aline Lebœuf, op. cit.
61 () Ils étaient au nombre de dix, contrôlant chacun une région du centre ou du nord du pays : Zakaria Koné, Losséni Fofana, Chérif Ousmane, Issiaka Ouattara dit Wattao, Fofié Martin Kouakou, Gaoussou Koné, Zoumana Ouattara, Ousmane Coulibaly, Hervé Touré dit Vetcho.
62 () cité par Aline Lebœuf, op.cit.
63 () Rapport final du Groupe d’experts sur la Côte d’Ivoire établi en application du paragraphe 27 de la résolution 2153 (2014) du Conseil de sécurité.
64 () Le Désespoir de Kourouma, Christian Bouquet, op. cit.
65 () « La question foncière à l’épreuve de la reconstruction en Côte d’Ivoire : promouvoir la propriété privée ou stabiliser la reconnaissance sociale des droits ? », J.P. Chauveau et J.P. Colin, Les cahiers du pôle foncier, 2014.
66 () J.P. Chauveau et J.P. Colin, op.cit.
67 () Interview du Président Ouattara dans l’Express, 25 janvier 2012.
68 () J.P Chauveau et J.P. Colin, op. cit.
69 () « La loi foncière en Côte d’Ivoire », notes de synthèse Foncier et développement, juin 2012.
70 () Félix Houphouët-Boigny, biographie en trois tomes, ed. Cerap-Karthala, 2011.
71 () http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/02/06/l-ombre-d-houphouet-boigny-plane-toujours-sur-la-cote-d-ivoire_4571219_3212.html
72 () « Comment la France a perdu l’Afrique », Antoine Glaser et Stephen Smith, Calmann-Léyy, 2005.
73 () Rapport d´information n°104 de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat sur la présence de la France dans une Afrique convoitée, Jeanny Lorgeoux, et Jean-Marie Bockel, 2013.
74 () Serge Michailof, op. cit.
75 () « Les nouveaux Français d’Afrique », François Soudan, Jacques Bertoin, Jeune Afrique, 30 juin 2008.
76 () « Diaspora ivoirienne : quels enjeux pour une Côte d’Ivoire en voie d’émergence ? », forum de l’OCDE, 7-8 mai 2015.
77 () Rapport « La langue française dans le monde » 2014, Organisation internationale de la francophonie.
78 () Burundi, Cameroun, Congo, RDC, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Ouganda, Rwanda, Tanzanie ; et hors Afrique : Bolivie, Honduras, Nicaragua.
79 () « L’armée française en Côte d’Ivoire n’a pas vocation à y intervenir, affirme son commandant », Jeune Afrique, 4 février 2017.
80 () Cette anecdote est rapportée par Antoine Glaser dans « Arrogant comme un Français en Afrique », publié aux éditions Fayard, en 2016.
81 () Les entreprises marocaines ont représenté 22% des entreprises agréées par le Centre de promotion des investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI) en 2015, contre 16% pour les entreprises françaises. La situation s’est pourtant retournée en 2016 ; les opérateurs français ont été les premiers investisseurs avec 12% des entreprises agréés, le Maroc n’arrivant plus qu’en sixième position, avec 6% du total.
82 () Extraits du discours prononcé par le roi Mohammed VI en visite à Abidjan en février 2014.
83 () L’accord de libre-échange Maroc-États-Unis est entré en vigueur en janvier 2006.
84 () Une zone de libre-échange pour les produits industriels était prévue dans le cadre de l’accord d’association UE-Maroc conclu en 2000 ; elle est entrée en vigueur en mars 2012. Par ailleurs, un accord entre l’UE et le Maroc « relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche » est entré en vigueur en octobre 2012. Des négociations sont en cours pour la conclusion d’un « accord de libre-échange complet et approfondi ».
85 () « Afrique : la longue marche des Libanais », Jeune Afrique, 13 octobre 2009.
86 () Guide des affaires Côte d’Ivoire 2016, Business France.
87 () Rapport d’information de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale sur la francophonie : action culturelle, éducative et économique, François Rochebloine et Pouria Amirshahi, 22 janvier 2014.
88 () « Un partenariat pour l’avenir : quinze recommandations pour une nouvelle dynamique économique entre l’Afrique et la France », rapport au ministre de l’économie et des finances, décembre 2013.
© Assemblée nationale