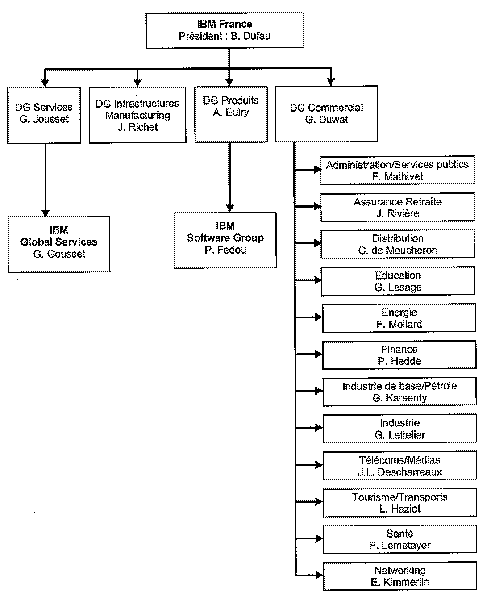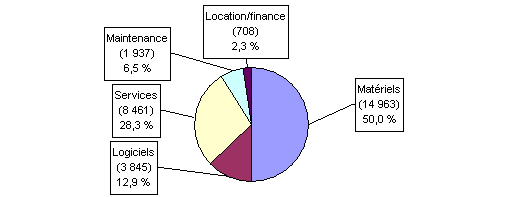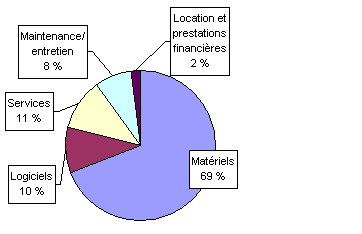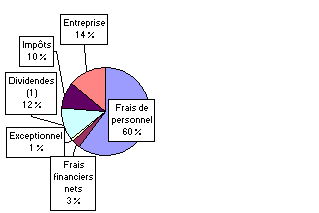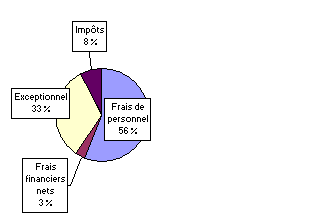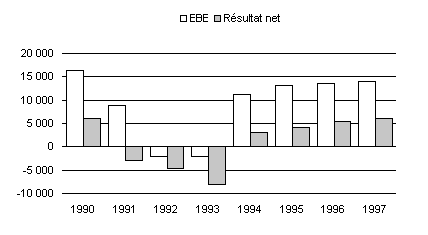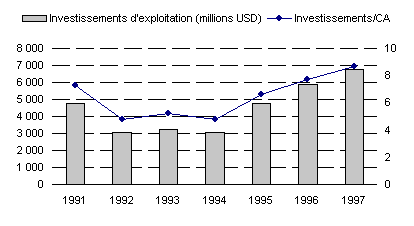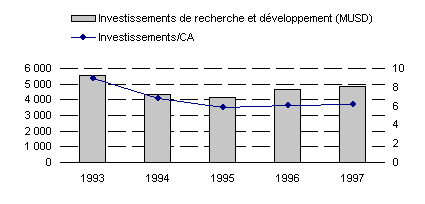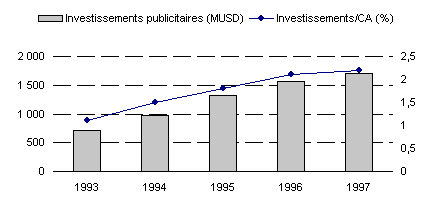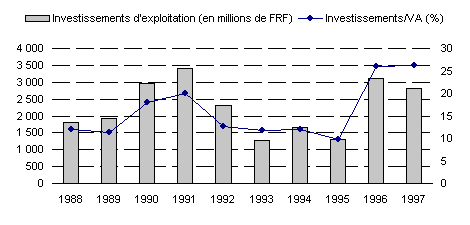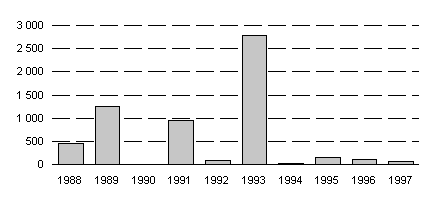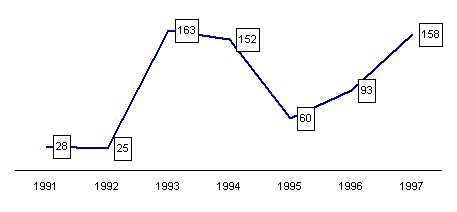TOME III (volume 2)
Chiffres clés
(1) Résultat d'exploitation/Immobilisations nettes + BFR (2) Résultat net/Fonds propres Source : rapports annuels
L'organigramme d'IBM au plan mondial résulte de l'organisation matricielle mise en place par Louis V. Gerstner en 1996 : à côté d'une division horizontale par grandes familles de produits ou services (stations de travail, technologies, serveurs, software), une branche horizontale « ventes et distribution » intervient comme support opérationnel avec une structuration tant géographique (par grandes régions du monde) que sectorielle (par grandes catégories de clientèles : banques, assurances, industries...) de ces opérations. Organigramme du groupe IBM
En 1997, une nouvelle entité dénommée IBM Global Services a été mise en place à l'échelle mondiale pour regrouper l'ensemble des unités en charge des prestations de services informatiques : conseil , ingénierie, intégration de systèmes, infogérance, maintenance matériels et applicatifs... IBM Global Services Ouest (basée à La Défense) couvre la France, la Belgique, le Luxembourg, le Moyen-Orient et l'Afrique.
En France, l'organisation combine également des divisions par grands types d'activités (services, produits...) et un service commercial support organisé par débouchés de clientèle.
Source : PAC Les principales sociétés du groupe IBM France sont : IBM France SA, CGI Informatique (ingénierie, intégration de systèmes, progiciels), Axone (infogérance, services réseaux), IBM France Financement et AMF SNC (Production Corbeil), dans un contexte où, malgré le recul régulier du poids de la maison mère, IBM France SA représente 86,8 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe français.
Source : rapports annuels La tendance est à la montée de IBM France SA au capital des sociétés dans lesquelles il ne détenait auparavant que des intérêts minoritaires : ainsi alors que trois sociétés seulement étaient intégrées globalement en 1992 pour 34 mises en équivalence, il y a en 1997 22 sociétés intégrées globalement pour 14 mises en équivalence. On observe cependant une petite réduction du périmètre d'activité en 1997 qui résulte d'une rationalisation du pôle services du groupe. Evolution du périmètre du groupe IBM France
Source : CGR Globalement, les principales sociétés du groupe sont détenues pratiquement à 100% comme c'est par exemple le cas de CGI (99,9 %) et d'Axone (99,2 %) (1). Enfin, notons que, faisant écho à la réorganisation au plan mondial, l'entité IBM Global Services Ouest regroupe désormais les activités de services de : · Axone (infogérance), · CGI Informatique (développement d'applications), · CIMAD (SAP, intégration de services), · Eurequip (consulting), · Intexis (intégration de services bancaires, gestion de réseaux), · Seprim (maintenance et support technique), · LY-D Informatique, · IBM France (IBM Intégration de systèmes, IBM Services clients et IBM Global Network avant la cession de ce dernier en décembre 1998).
Le portefeuille d'activités d'IBM Corp. IBM présente un profil d'acteur généraliste de l'informatique, atypique dans le secteur puisqu'il couvre l'industrie dans toutes ses composantes : matériels, logiciels, services et maintenance. On notera une évolution de son profil global avec : · un recul, sur longue période, de la part du hardware (matériels) passée de 52,3 % de l'activité en 1992 à 46,1% en 1997... · un infléchissement récent du software (logiciels) représentant 17,2 % des chiffres d'affaires 1992 et 1996, puis 16,4 % en 1997... · ...au profit des services, qui se sont progressivement hissés de 11,4 % des ventes en 1992 à 24,6 % en 1997. Le pôle maintenance décline également, ce qui reflète le déclin des systèmes propriétaires qui généraient, de facto, une clientèle captive sur ce segment. Les principaux segments d'activité IBM
* Original Equipment Manufacturer - équipements d'autres constructeurs vendus sous la marque IBM. Le portefeuille d'activités d'IBM France Structure du chiffre d'affaires 1997 de IBM France (MF)
Source : rapport annuel On observe, en France, le même déclin de l'activité hardware qu'au plan mondial, soit un recul de 13,3 % en 1997 pour un segment qui est ainsi passé de 67,5 % du volume d'affaires 1992 à 50 % des ventes 1997. Ce taux est cependant de 4 points supérieur à celui des matériels au plan mondial. Sur les cinq exercices en référence, la part des logiciels a oscillé entre 10,3 % du volume d'affaires en 1992 et 12,9 % en 1997, avec un « pic » à 14,1 % en 1994. En 1997, on constate un recul du poste software en valeur absolue de 4,1 %. Le repli de l'activité d'entretien s'inscrit, en France comme partout dans le monde, dans le contexte de l'avènement des systèmes ouverts au détriment des plate formes propriétaires. Sa part dans le chiffre d'affaires passe de 8,9 % en 1993 à 6,5 % en 1997 avec une baisse en valeur absolue de 13,6 % du montant des ventes pour cet exercice. Enfin, la part des services dans l'activité a plus que doublé, gagnant 16,6 points en valeur relative, de 11,7 % en 1992 à 28,3 % en 1997. Au total, les tendances au recul des matériels et à la montée en puissance des services s'observent aussi bien au niveau du groupe que dans la filiale hexagonale, avec toutefois une part relative plus importante des matériels et des services pour le groupe français. Evolution du portefeuille d'activités d'IBM (en parts relatives)
Les grands segments d'activité d'IBM France
Positionnement mondial Leader mondial de l'industrie électronique, le groupe IBM a réalisé en 1997 un volume d'affaires 18 fois supérieur à celui de Bull. Pour mesurer l'envergure du groupe, on a retenu un autre indicateur de comparaison : le montant alloué par IBM à la recherche et développement est supérieur au volume global d'activité du groupe français. Le numéro un mondial face au français Bull
Source : rapports annuels On trouvera ci-après des précisions concernant le positionnement du groupe dans les différents segments sur lequel il est présent. Positionnement d'IBM sur les grands segments de l'informatique
Positionnement sur le marché français IBM est, en volume d'affaires, le leader sur le marché des matériels, des logiciels et des services informatiques. IBM parmi les constructeurs informatiques en France
Source : 01 Informatique IBM parmi les principaux acteurs sur le marché français des services
(1) Y compris maintenance matériel, hors progiciels. (2) Changement de périmètre : exercice 1996, clôturé au 31 décembre 1996, exercice 1997 clôturé au 30 septembre 1997. (3) Estimations Pierre Audoin Conseil. (4) Exercice fiscal clôturé au 30 juin. Source : Pierre Audoin Conseil IBM parmi les éditeurs de logiciels en France
IBM France est une filiale à 100 % de la maison mère IBM Corp.
· Evolution 1997-98 L'année 1997 a été caractérisée par une reprise de la croissance de la dépense informatique (2), résultant avant tout de la progression des dépenses d'investissement consenties par les grands comptes (+ 11,1 %) après une période de restrictions budgétaires. La progression de ces mêmes dépenses d'investissement reste plus modérée du côté des PME françaises : + 6,6 %. En outre, la croissance globale du marché (3) a été, en 1998, supérieure à 7%. Le secteur des logiciels et services : + 7,1 % à 17 811 millions d'écus
Source : EITO Le secteur des matériels informatiques : + 7,6 % à 9 071 millions d'écus en 1998
Source : EITO Ces données montrent que, à l'instar des évolutions observées au plan mondial, la France vit, elle aussi, à l'heure des réseaux. Les segments les plus porteurs du marché français sont en effet, en 1998, les services réseaux (+ 11,1 %) et les petits et moyens serveurs · Caractéristiques Les tendances du marché français de l'informatique
La stratégie d'IBM France s'inscrit en phase avec celle de sa maison mère : c'est la déclinaison, sur le marché français, des orientations définies à Armonck au siège d'IBM Corp. Ainsi, après une phase difficile (dans le contexte de déclin des systèmes propriétaires et de la crise de 1992-93) qui se sont traduits par d'importantes mesures de restructuration dans la première moitié de la décennie, le groupe a repris l'offensive en prônant, de manière plutôt avant-gardiste, l'avènement de l'informatique centrée réseaux. Son comportement d'entreprise s'en est également trouvé modifié. Plus humble, le groupe n'écarte plus d'éventuelles réponses défensives pour contrer ses propres insuffisances ou faire face aux enjeux du secteur, même si le c_ur de sa stratégie demeure avant tout offensif. Réponses défensives · Stratégie de communication corporate Afin de rompre avec son image de groupe souffrant d'un complexe de supériorité par rapport à ses concurrents et aux autres acteurs de l'informatique en général, le groupe a mis en place une stratégie de communication corporate, symbolisée, à l'échelle mondiale par le passage de la dénomination de Big Blue à The new Blue. A titre exemplaire, le rapport d'activité du groupe n'indique pas son nom en couverture, mais comporte la photo en noir et blanc d'une jeune fille décontractée, les mains dans les poches, avec pour seule mention « The new blue ». Cette volonté d'humaniser son image et, par là, de se rapprocher du grand public s'est traduite, en France, par une politique de communication « de proximité » : · présence dans le RER à la station Auber de micro-ordinateurs Aptiva en libre service pendant plusieurs jours (en 1996) ; · campagne de presse sur le e-business où le groupe présente directement, avec leurs photos, ses ingénieurs commerciaux et technico-commerciaux en charge des questions de commerce électronique (en 1998 et 1999). Ici IBM communique, tant sur son offre de produits et services (4) que sur la nouvelle volonté d'ouverture et de transparence de la compagnie. · Stratégie de partenariats IBM s'allie avec des partenaires spécifiques. Ainsi, en France à titre d'illustration : · le logiciel de base de données DB2 est développé avec la société Business Objects, · le logiciel Catia (e-business) est commercialisé en partenariat avec Dassault Systèmes. · Stratégie de distribution indirecte Les partenariats d'IBM sont avant tout des partenariats commerciaux, ces derniers lui permettant d'accroître ses ventes et sa pénétration des marchés. Elle s'inscrit dans un modèle de vente diamétralement opposé à ceux prônés par des acteurs comme Dell ou Compaq. En 1997, plus de 30 % des ventes a été réalisé via le réseau de partenaires commerciaux, ce qui représente une progression moyenne de 20 %. Ainsi : · 65 % du chiffre d'affaires des RS/6000 (gamme Unix) provient des revendeurs à valeur ajoutée ou des grossistes ; · la majorité des micro-ordinateurs sont commercialisés en mode de distribution indirecte ; · les grossistes et revendeurs représentent 60 % des ventes de la division imprimantes ; · de nouvelles firmes (Centron, Ilion, NPS...) se sont ajoutées à la liste des 200 partenaires commercialisant les produits réseaux en 1997. Un programme de formation Neteam leur a été dédié. Réponses offensives · Une stratégie d'offre globale IBM a adopté, dans les années 1994-95 un positionnement d'intégrateur des systèmes, (ce qui l'a conduit à rompre largement avec son ancienne politique propriétaire), afin d'être en mesure de proposer des solutions recouvrant des produits IBM aussi bien que des produits non IBM. Le numéro un mondial de l'électronique a ainsi été amené à se renforcer dans les domaines des logiciels et des services. · Renforcement dans les logiciels Ce renforcement s'est d'abord traduit par le rachat des éditeurs de logiciels Lotus (juin 1995) et Tivoli (janvier 1996), puis par la création d'une filiale dédiée à ce segment d'activité IBM Software Group. Lotus a permis à IBM de se positionner comme le leader du groupware (applications permettant le travail en groupe) ; le produit phare Notes est intégré aux offres serveurs et la version Domino dispose des fonctionnalités d'un browser (logiciel de navigation). De plus, Lotus a été le vecteur de développement de Java avec e-Suite, package de logiciels bureautiques. Le rachat de Tivoli, leader des logiciels de management de systèmes, de la gestion des réseaux de micro-ordinateurs et de serveurs en informatique distribuée, a apporté à IBM un environnement complet d'administration de systèmes orienté objet. En 1998, l'acquisition de Unison et de Software Artistry a permis de compléter l'offre de Tivoli par une nouvelle version Tsunami. · Renforcement dans les services En 1997, IBM a marqué la volonté de se renforcer dans les services par la création d'une nouvelle entité dénommée IBM Global Services (IGS), regroupant l'ensemble des opérations du groupe dans les services. Cette structure, qui peut s'appuyer sur la présence historique d' IBM sur tous les segments de l'informatique est le navire amiral du groupe dans sa stratégie d'offre de solutions globales, qui vont du conseil à l'infogérance en passant par l'intégration de systèmes, la formation ou les services réseaux. L'un de ses atouts clé pour la clientèle réside dans sa capacité à accompagner les grands comptes au niveau mondial. · Une stratégie de pionnier dans l'informatique en réseau IBM a joué un rôle avant-gardiste dans la montée en puissance de ce marché. La poursuite de son offensive dans l'informatique « réseau-centrée », avec pour mots d'ordre la promotion du network computer, le renforcement de la politique d'offre orientée réseaux au sein de tous les métiers de l'entreprise et la pénétration du marché du e-business, s'est notamment traduite par : · la migration des produits IBM propriétaires vers des produits acceptant les technologies Internet (protocole TCP-IP): par exemple un système 390, un AS/400 ou un serveur Netfinity peuvent être des serveurs Web ; pour illustrer cette mutation du groupe, l'AS/400 disposant des technologies du serveur Domino et d'une machine virtuelle Java est maintenant doté d'une particule « e », pour souligner sa transformation en serveur de commerce électronique ; · la création d'une infrastructure dénommée Network Computing Framework (NCF) spécialisée dans le e-business qui présente les technologies d'IBM de façon complète et homogène ; · l'adoption du langage Java pour son offre réseaux ; l'alliance avec Sun Microsystems a d'ailleurs pris une autre envergure avec l'annonce, au premier semestre 1998, du lancement d'un nouveau système d'exploitation dénommé « Java OS for business » orienté vers les applications professionnelles et destiné notamment à équiper les network computer haut de gamme d'IBM et les Java stations. La cession du réseau de télécommunications IBM Global Network, en décembre 1998, à AT&T s'explique par le souci d'IBM Global Services de ne pas concurrencer les opérateurs de télécoms, clients d'IBM pour les services et les équipements réseaux. Or, IGS souhaite désormais nouer des partenariats avec des opérateurs pour favoriser le développement de l'activité services réseaux.
A court et moyen termes, IBM France aura à relever deux défis majeurs : à l'export et sur son marché domestique grand public. · Redynamiser l'export En 1996 et 1997, le chiffre d'affaires export d'IBM a reculé chaque année de 14,6 % pour finalement à peine retrouver son niveau de 1993, de surcroît particulièrement bas puisque situé dans un contexte de crise économique. A ce titre, on notera que le transfert éventuel en Irlande de l'activité de personnalisation des machines destinées au marché européen du site de Montpellier aurait un impact négatif sur le volume d'affaires export de la firme française. · Améliorer ses performances sur le marché grand public Sur le segment de la micro-informatique, IBM réalise en France des performances honorables sur les marchés professionnels : il se situe à la deuxième place sur le segment des serveurs Intel derrière Compaq et à la troisième place sur le segment des portables (14 %) derrière Compaq (16,4 %) et Dell (15%). Cependant ses résultats sont décevants sur le marché des ordinateurs de bureau grand public (5,5 % en unités vendues) où il est très nettement distancé par Packard Bell NEC (22,9 %) et Compaq (8 %). Les commandes des PC d'entrée de gamme demeurent à un niveau insuffisant par rapport aux positions concurrentielles du groupe sur d'autres segments. Or, dans un contexte de pénétration des marchés Internet, la cible grand public apparaît stratégique.
Evolution du chiffre d'affaires
Source : rapports annuels Sur dix ans, IBM a connu une érosion de ses ventes, à un rythme moyen de près de 3 % par an, malgré l'intégration de CGI et de Axone en 1993 qui ont apporté respectivement 1 933 MF et 415 MF de chiffres d'affaires supplémentaires. En l'absence de cessions significatives sur la période, c'est donc essentiellement la décroissance interne d'activité qui est responsable du recul des ventes. En fait, le groupe a surtout vu ses ventes chuter depuis la crise informatique de 1992-1993. Les prix ont chuté suite à l'entrée de concurrents sur le marché, ce qui s'est traduit par de sévères restructurations pour abaisser les coûts de production (cf. 3.5.). Evolution du chiffre d'affaires par activités
(1) TCMA de 1991 à 1997 pour les activités services et maintenance/entretien. (2) L'activité services est incluse dans l'activité maintenance/entretien jusqu'en 1990. Source : rapports annuels Répartition du chiffre d'affaires par activité
Source : rapports annuels Les deux activités qui ont le plus reculé sur la période sont les ventes de « matériels » et la « maintenance/entretien » ce qui s'explique par : · le déclin des systèmes propriétaires qui représentaient une clientèle captive, tant pour la division hardware que, de facto, pour la maintenance ; · un problème de compétitivité-prix obtenus en France face à la concurrence asiatique et américaine. Les activités « logiciels » et « location/prestations financières » progressent modérément. En revanche, l'activité « services » bénéficie, depuis quelques années, d'une forte croissance (supérieure à deux chiffres), en partie grâce à un marché porteur (+ 17 % en France en 1997) et pour une autre partie grâce à l'intégration d'Axone et de CGI. Le groupe est parvenu à réorienter à temps son portefeuille d'activités. Par comparaison, le chiffre d'affaires consolidé d'IBM Corp. a augmenté de 31,6 % entre 1988 et 1997. La reconversion du groupe mondial sur le software est plus marquée puisque la part des ventes de matériels est inférieure à 48 %. Toutefois, cette même activité continue de bénéficier d'un trend ascendant (+ 10 % entre 1992 et 1996) alors qu'elle chute sérieusement pour IBM France sur la même période (près de 30 %).
Evolution de la valeur ajoutée
(1) Valeur ajoutée calculée à partir de la formule suivante : résultat opérationnel + dotations nettes aux amortissements et aux provisions + frais de personnel. Source : rapports annuels La valeur ajoutée générée par le groupe IBM France s'est réduite de près d'un tiers en dix ans. En fait, la chute s'est surtout produite à partir de 1993 lors de la crise de l'informatique. La consolidation de CGI et d'Axone a fait remonter le niveau d'intégration (les services ayant un niveau de la valeur ajoutée supérieur) mais les pressions continues sur les prix font de nouveau décliner le taux de valeur ajoutée qui termine en 1997 en recul de 3,7 points en moins par rapport au ratio de 1998. Le marché est devenu nettement plus concurrentiel. Evolution des dépenses d'exploitation
(1) Inclus dans les coûts de production et les frais administratifs et commerciaux. Source : rapports annuels Par rapport à un chiffre d'affaires qui baisse en moyenne de 2,7 % par an depuis 1988, les coûts de production des produits ne baissent pas suffisamment vite. L'accent a davantage été mis sur les frais administratifs et commerciaux. De plus, les frais de personnel sont presque restés stables en dépit de la baisse d'activité constatée. Par ailleurs depuis 1994, un effet de ciseau s'opère entre une valeur ajoutée déclinante et des frais de personnel qui se maintiennent au même niveau. Il en résulte un laminage des marges depuis cette date alors qu'elles étaient restées à peu près stables entre 1998 et 1994 (malgré la crise de 1993). La marge brute d'exploitation se réduit ainsi de moitié et le résultat opérationnel (affecté, en plus, par les restructurations) est divisé par trois. Evolution des marges
Source : rapports annuels Répartition du résultat opérationnel du groupe IBM France
* Y compris CER. ** Corrigé de l'impact du changement de méthode comptable chez CGI, le résultat opérationnel s'élève à 885 MF (+ 17 MF par rapport à 1996) soit 4,1 % du chiffre d'affaires. Source : rapports annuels La marge sur les activités M & D (production et développement) fluctue fortement en fonction des prix du marché. La crise de 1993 qui s'est traduite par la chute des prix des composants informatiques (notamment des DRAM) a eu pour conséquence un résultat opérationnel négatif. L'insuffisante marge sur les activités commerciales et les services Autofinancement Evolution de l'autofinancement
Source : rapports annuels Malgré des marges assez faibles et un taux d'investissement élevé (16 %), IBM autofinance largement ses investissements d'exploitation, sur la période 1988-1997. Deux exercices se soldent par un déficit du solde économique (DAFIC) : · 1991, du fait d'un taux d'investissement anormalement élevé et d'une forte hausse du besoin en fonds de roulement, provoqué par une montée des stocks d'encours de près de 1,8 milliard de francs ; · 1997, en raison d'une forte chute de l'excédent brut d'exploitation et du maintien d'un taux d'investissement très élevé (le plus fort de la période en comparatif de la valeur ajoutée) afin de terminer la mise en _uvre de la nouvelle ligne de production de DRAM de 64 Meg. Evolution des investissements financiers nets des cessions
Source : rapports annuels Le groupe IBM France a recouru à la croissance externe par exception en privilégiant la sélectivité. Ses plus grosses opérations se sont réalisées en 1993, avec le rachat des minoritaires de CGI et d'Axone qui a permis leur intégration globale. Ces deux opérations représentent près de la moitié des investissements financiers du groupe sur dix ans. Côté cessions, les mouvements opérés par le groupe ont été également modérés puisque seulement 3,4 milliards de cessions ont été réalisées sur dix ans. Au total, IBM France a privilégié une croissance interne autofinancée en cherchant à consolider ses acquisitions.
Répartition de la valeur ajoutée
(1) Versés l'année n. Source : rapports annuels La structure de répartition de la valeur ajoutée s'est profondément modifiée durant la période d'analyse sous l'effet de deux mouvements : · jusqu'en 1991 la part de l'entreprise s'est accrue, la part des impôts et des frais financiers étant faible ; · en 1997, la part des frais de personnel s'est accrue, la pénurie de main d'_uvre et l'inflation sur les salaires de certaines qualifications conjuguée à une forte pression concurrentielle expliquent ce phénomène.
Poids de la distribution dans la valeur ajoutée et taux de distribution des bénéfices
Source : rapports annuels Compte tenu de la dégradation des résultats d'IBM France à partir de 1992, la société ne procède plus à des distributions de dividendes depuis cette date. Jusqu'à cette époque, la distribution a été élevée, comparée au résultat du groupe. Il reste toutefois pour la société mère IBM Corp. le versement régulier de redevances groupe, représentant entre 7,7 % et 8,7 % du chiffre d'affaires sur les six derniers exercices. Ces redevances sont, en l'absence d'information à leur sujet, sans doute relatives à des frais de gestion siège, l'utilisation des marques ou des dépenses de notoriété/marketing partagées.
Evolution des coûts de restructuration
(1) Charges de restructuration engagées au titre de l'exercice. Source : rapports annuels Suite à la crise informatique de 1992-1993, le groupe IBM France a inscrit près de 2 milliards de FRF de provisions pour restructuration en 1992, sans compter deux autres milliards qui ont été alloués au titre de provisions exceptionnelles sur des équipements jugés obsolètes. Ces provisions ont été utilisées lors des exercices 1992 à 1995. Depuis cette date, les plans de restructuration ont été allégés et les reprises de provisions ont permis d'apporter une contribution positive à la marge opérationnelle. La charge d'impôt Evolution de la charge d'impôt
(1) Avant amortissement des écarts d'acquisitions et quote-part dans les SME. Source : rapports annuels Le groupe IBM France n'a pas procédé à une optimisation fiscale très poussée. Sur dix ans son taux d'imposition apparent a été supérieur au taux légal. Le groupe est donc plutôt en retard de crédit d'impôt. Les pertes de 1992 à 1995 n'ont en effet pas encore été entièrement compensées par des résultats imposables suffisamment importants depuis cette date. Ainsi, le solde des impôts différés actif-passif et des crédits d'impôt présentent fin 1997, un débit de près de 560 MFR. De ce fait, le taux effectif d'imposition (impôt exigible/résultat imposable) approche les 75 %.
Evolution des rentabilités économique et financière
(1) Résultat opérationnel/Immobilisations nettes + BFR (2) Résultat net/ Fonds propres Source : rapports annuels La rentabilité économique est en moyenne, sur les dix dernières années, tout à fait satisfaisante. Elle connaît toutefois deux années noires en 1993 et 1997 durant lesquelles le groupe n'a pu tenir des marges correctes dans les services, tout en subissant une sévère chute des prix sur les ventes de ses composants (en particulier sur les DRAM). En revanche, la rentabilité financière s'établit à un niveau médiocre sur la période. Les restructurations de 1992 à 1994 ont en effet fortement pesé sur les résultats qui ont subi de lourdes pertes durant ces exercices (- 2,5 milliards de FRF, - 2,2 milliards de FRF et Au total, la rentabilité financière du groupe IBM France est faible, et en dessous des standards recherchés (supérieures à 10-12 %). Evolution de l'EBE et du résultat net d'IBM Corp.
Source : rapports annuels Au niveau monde, IBM Corp. a subi de la même façon la crise du début des années 90 avec un an d'avance. Ses rentabilités se sont, en revanche, nettement mieux redressées avec des rentabilités économiques dépassant 25 % depuis 1996 et des rentabilités financières revenues à des taux de 24 % en 1996 et même 30 % en 1997. Le groupe IBM France est donc bien en retrait des performances du groupe.
Evolution de la structure financière
(1) Endettement net / fonds propres Source : rapports annuels Le groupe IBM France se trouve être relativement endetté sans que sa structure financière puisse être considérée comme pénalisante. La filiale du numéro un américain est en fait davantage pénalisée par la réduction de ses fonds propres générés par les pertes successives de 1992 à 1994 que par un accroissement de son endettement. D'ailleurs sur la période, le groupe a plutôt mené une politique de désendettement. Celle-ci a été permise par un DAFIC globalement positif et une politique de croissance externe globalement mesurée (cf. 3.3.) Au niveau monde, IBM Corp. se retrouve avec un taux d'endettement net/fonds propres proche de sa filiale française du fait de sa politique de rachat d'actions qui a porté sur plus de 16 milliards d'USD entre 1995 et 1997, réduisant d'autant les fonds propres.
Evolution des investissements d'exploitation du groupe IBM Corp.
Source : Rapports d'activité Le groupe IBM Corp. connaît depuis 1994 une croissance régulière et récurrente de ses investissements d'exploitation. Ces derniers absorbent également une part croissante du chiffre d'affaires. En 1997, ils ont essentiellement concerné les services professionnels et les capacités de production pour les disques durs et la micro-électronique. Des mesures de réduction des coûts et la mise en place de nouvelles structures plus flexibles ont conduit à des désengagements, notamment la cession par IBM Corp. de son réseau mondial de télécommunications IBM Global Network à ATT pour un montant de 5 milliards de USD. Chaque année IBM Corp. dépensait 200 millions de dollars pour entretenir ce réseau. Le maintien de celui-ci à un niveau compétitif requérait des dépenses trop élevées d'investissements pour en justifier la conservation dans le portefeuille d'activité du groupe, tout en mettant le groupe en porte-à-faux vis-à-vis de ses partenaires commerciaux dans les télécoms La croissance de ces dépenses s'est réalisée parallèlement à d'importantes opérations de croissance externe. IBM Corp. a procédé notamment aux acquisitions de : · Lotus pour 2,9 milliards de USD en 1995. Cette opération lui a permis de se positionner comme leader sur le marché du groupware (nouvelle catégorie d'applications permettant le travail en groupe) ; · Tivoli (716 millions de USD) en 1996. Cet achat a apporté à IBM TME un environnement complet d'administration de systèmes orienté objets, offre que cette filiale a renforcée en 1998 avec le lancement d'une nouvelle version dénommée Tsunami, elle-même réalisée grâce aux acquisitions de Unison, de Software Artistry et de NetObjects. · La progression des investissements en R&D Evolution des investissements de recherche et développement du groupe IBM Corp.
Source : Rapports d'activité La politique de réduction des coûts au cours des années 1993, 1994 et 1995 s'est traduite par une réduction des dépenses de recherche et développement sur ces trois exercices. Le groupe a en particulier, sur cette période : · réorganisé ses sites de recherche en 15 sites contre 26 auparavant ; · substitué à la part des investissements habituellement consacrés à la recherche dans le hardware une partie des montants inclus dans les investissements de croissance externe dans les deux sociétés de logiciels Lotus et Tivoli. Le coût d'acquisition de ces deux sociétés reprend effectivement une partie des frais de R & D qui correspondent à la recherche dans les logiciels. Si l'on réintègre le coût de la R&D de ces deux entreprises, en 1995 et 1996, le budget respectivement pour ces deux années s'est élevé à 6 010 et 5 089 millions de dollars. Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de nouveau à partir de 1996. En cohérence avec la politique du groupe, le domaine des logiciels ainsi que celui des services concentrent la majeure partie des dépenses de R&D. Ces activités devraient consommer 60 % des investissements de R&D en l'an 2000, contre un peu moins de la moitié cinq ans auparavant (Source : LMI du 8 mars 1996) puisque l'essentiel des coûts de fabrication des logiciels consiste en frais de R&D. 1997 a par ailleurs été marqué par la volonté d'IBM Corp. de reprendre un leadership technologique, en particulier en amont de l'industrie électronique avec l'annonce de la fabrication des puces pour radiotéléphone conçues à partir du silicium-germaniun. · La progression des investissements publicitaires Evolution des investissements publicitaires du groupe IBM Corp.
Source: Rapports d'activité L'offensive d'IBM dans les logiciels et le software, avec notamment le rachat de Lotus en 1995, coïncide avec la forte croissance des investissements publicitaires. La nouvelle vision stratégique orientée essentiellement vers les solutions pour le commerce électronique constitue un des vecteurs porteurs pour le groupe IBM Corp. L'ampleur de cette option stratégique se retrouve particulièrement dans la campagne marketing mondiale mise en place par le groupe autour du e-business avec un budget de 800 millions de dollars essentiellement consacré à ce thème. Face à la concurrence, le groupe est contraint de faire la promotion de son offre.
Il n'existe aucuns éléments récapitulatifs sur le dispositif industriel français. Une liste non exhaustive a pu néanmoins être établie sur la base des documents fournis. Les unités de production de Groupe IBM France
Source : Rapports de gestion du Conseil d'Administration
· Evolution des investissements d'exploitation Les investissements d'exploitation du Groupe IBM France
Source : CGR Les investissements corporels sont restés proportionnellement stables sur la période 1992-1995. Cette pause a succédé à une période lourde d'investissement et préparé la forte progression de 1996 et 1997. Cette dernière est le fait de la création de la ligne de production de mémoires de 64 Megabits sur le site de Corbeil-Essonnes. Les investissements liés à cette nouvelle ligne ont respectivement pesé pour 1 587 millions de francs en 1996 et 1 915 en 1997. Les investissements des deux derniers exercices (1996 et 1997) sont, par ailleurs, à l'origine d'une baisse du taux d'amortissement des immobilisations corporelles. Celui-ci est passé de 56,4% au 31 décembre 1997 contre 66,5 % au 31 décembre 1995. Le portage des investissements relatifs à la nouvelle ligne de production 64 Megabits s'est fait uniquement au travers de deux sociétés du groupe IBM France. Portage des investissements de la nouvelle ligne de production
Source : CGR En 1997 les investissements autres que la ligne de production 64 Megabits sont passés de 1 514 millions de FRF à 891 millions, en net recul. Ceci est le fait : · d'une baisse des investissements industriels divers à 205 millions de FRF contre 576 en 1996 ; · d'une diminution importante des investissements pour le matériel de location suite à la forte progression de 1996. Le site de Montpellier est spécialisé dans la fabrication de gros serveurs produit, depuis fin 1997, des systèmes intégrant la technologie Cmos et non plus bipolaire. Ce changement technologique implique, selon la Direction, deux fois moins de main-d'_uvre (Source : Les Echos, 25 mai 1998). Toutefois, le groupe IBM France a marqué sa volonté de pérenniser cette usine: · en investissant dans une première étape, 50 millions de FRF ; · en mettant en place le « centre de support des solutions parallèles » (PSCC), créant ainsi un nouveau métier. Néanmoins, la direction du groupe IBM France a indiqué qu'en octobre 1997, une étude avait été lancée pour analyser le transfert éventuel en Irlande de l'activité de personnalisation des machines destinées au marché européen. La décision devrait intervenir à la mi-1999. · Investissements de croissance externe L'évolution du périmètre d'activité du groupe
Source : CGR Sur la période 1992-1997, le nombre d'entreprises consolidées en intégration globale a augmenté significativement. Le renforcement du nombre de filiales par création et/ou augmentation des pourcentages d'intérêts détenus dans des participations jusqu'alors minoritaires en est la principale explication. Ceci renvoie à la stratégie de renforcement de l'activité dans les domaines des services et à la volonté de filialiser certaines activités et fonctions. Les investissements financiers (en millions de FRF)
Source : CGR Sur la période 1990-1997, seuls les investissements financiers de 1993 sont substantiels sous l'influence de la croissance externe qui avait marqué cet exercice. L'opération majeure de cet exercice correspond à la prise de contrôle de CGI et d'Axone. En 1997 comme 1996, les acquisitions d'immobilisation financières concernent notamment les rachats d'intérêts minoritaires avec pour conséquence un renforcement de la part du groupe dans certaines filiales. Ces opérations se sont réalisées en vue d'une plus grande intégration de certaines filiales.
Le tableau ci-dessous récapitule les évolutions des effectifs moyens de l'ensemble du groupe IBM au niveau mondial. Evolution des effectifs moyens du groupe IBM
Source : IBM Annual Reports A partir de 1990, le groupe IBM a procédé à la réduction de ses effectifs : entre 1991 et 1992, près de 40 000 emplois avaient ainsi disparu, dans le cadre d'une sévère politique de downsizing ; celle-ci s'est poursuivie jusqu'en 1995 ce qui se reflète dans l'évolution des effectifs, présentés dans le tableau. En 1995, la tendance s'inverse et une hausse du nombre des salariés est enregistrée. Celle-ci s'explique par une modification de périmètre avec l'intégration du personnel de Lotus. En 1996, en revanche, les embauches ont repris (26 000 embauches au total) tandis qu'IBM s'est également enrichi des salariés de Tivoli. Enfin, en 1997, la tendance à l'augmentation des effectifs s'est accentuée puisque ceux-ci ont progressé de 12 %. Cette évolution s'explique par les embauches réalisées dans les secteurs porteurs. IBM Global Services a recruté 15 000 personnes entre 1996 et 1997 ; cette hausse renvoie aussi à l'intégration d'effectifs dans le cadre des contrats d'outsourcing. Les autres activités génératrices d'emplois sont le stockage et les filiales Lotus et Tivoli, spécialisées en logiciels, activité actuellement en forte croissance. Les unités de production et de commercialisation localisées dans les marchés émergents sont également à l'origine de recrutements. Enfin, les rachats de firmes, telles que Union Software, ont grossi les effectifs. Cette progression a cependant été atténuée par la politique de distribution indirecte mise en place par le groupe dans des segments tels que les PC.
Les évolutions des effectifs d'IBM France, retracées ci-dessous en effectif moyen et en effectif fin de période, ne sont pas corrélées aux évolutions du groupe au niveau mondial. En effet, alors qu'au niveau mondial, les effectifs décroissaient fortement en 1993, ils augmentaient, au contraire, nettement en France. IBM France n'a été touché par la réduction des effectifs qu'à partir de 1994 sans que cela atteigne l'ampleur des mouvements réalisés au niveau mondial. Parallèlement, la baisse des effectifs s'est poursuivie en France en 1995 et 1996 alors que la remontée des effectifs avait commencé au niveau mondial. Enfin, si la progression des effectifs est réelle en France en 1997, elle n'a pas, là encore, l'ampleur de celle qu'on enregistre pour le groupe IBM dans son ensemble : soit + 0,2 % pour IBM France contre +12,0 % pour la totalité du groupe. La croissance des effectifs en 1993 est relative à des effets de périmètre (Axone et CGI). Evolution des effectifs d'IBM France
(1) Le calcul de cet effectif ne comprend pas les détachés d'IBM France qui se trouvent en dehors du territoire métropolitain ; en revanche, il comprend les effectifs temps plein et temps partiel sans distinction. Source : CGR IBM France Par type d'emplois, la tendance générale est à la décroissance des effectifs concentrés sur les activités « matures » (DRAM, Manufacturing MOP...) ainsi que des effectifs Infrastructures tandis que le recrutement s'opère plutôt sur les activités de services. Sur longue période, le poids relatif des filiales dans la structure d'emploi du groupe a été considérablement rehaussé face au poids d'IBM France SA : il est ainsi passé de 24,1 % des effectifs totaux en 1993 à 40,9 % en 1997, soit une progression de 16,8 points en quatre ans. Le graphique ci-après présente la ventilation des effectifs pour 1997 entre les quatre principales sociétés du groupe. Répartition des effectifs moyens par sociétés (données 1997)
Source : CGR IBM France En 1997, les filiales CGI et Axone ont été des lieux d'accueil privilégiés pour les effectifs. Il y a eu, en particulier, concentration des embauches sur CGI du fait du dynamisme de son activité : ainsi, 25,7 % du personnel embauché en CDI en 1997 l'a été sur CGI contre 12,7 % en 1996. En 1998, le phénomène s'est amplifié avec un taux d'embauche dans cette filiale d'environ 54,4 %.
Par structure de qualification IBM France se caractérise par une part importante de cadres au sein de ses effectifs : leur présence a, par ailleurs, tendance à s'accentuer, notamment depuis 1993. Ils représentaient ainsi 60,6 % des effectifs totaux en 1997 contre 51,9 % en 1993 et 49,2 % en 1992. Cette progression s'est faite, avant tout, au détriment de la catégorie « maîtrise et assimilés » et, dans une moindre mesure, de la catégorie « employés » ; celle-ci a d'ailleurs légèrement progressé en part relative en 1997. Au contraire, la décroissance du poids relatif de la catégorie « maîtrise et assimilés » correspond à une tendance continue depuis 1992 où ils représentaient alors 22,2 % des salariés du groupe. Evolution et répartition de la structure de qualification d'IBM France
Source : CGR IBM France Pour la seule année 1997, on observe la poursuite de la baisse du taux d'encadrement : le poids relatif des cadres qui avait été porté à 61,1 % du total en 1996 est ramené à 60,6 % à fin 1997. La catégorie « maîtrise et assimilés » connaît, en 1997, une nouvelle baisse de ses effectifs et ne représente plus que 15,7 % des effectifs totaux. La seule croissance des effectifs en 1997 porte sur la catégorie « employés » avec + 2,8 %, qui fait suite à une progression de 5,2 % en 1996. Ils représentent 23,7 % des effectifs consolidés en 1997, soit le taux le plus élevé depuis 1993. Cette évolution pour la période récente a été notamment influencée par la montée en puissance de Seprim. Comparaison des structures de qualification d'IBM France SA
Source : CGR IBM France Par société, l'analyse de la répartition des catégories fait apparaître des structures de qualification très hétérogènes qui renvoient à des différences dans la nature des activités et, peut-être, à des pratiques diverses en matière de gestion des personnels et d'attribution des statuts. Les filiales Axone et, plus encore, CGI concentrent une part relative de cadres particulièrement importante alors que la part des employés y est très faible. Chez CGI, par exemple, ils représentent 2,8 % des effectifs. Au contraire, les salariés de Seprim sont classés en employés à 85,2 % ; la maîtrise est particulièrement peu représentée dans cette filiale avec une part relative de 5,1 %. La répartition des effectifs entre les différentes catégories est plus équilibrée chez IBM France SA mais les cadres représentent néanmoins plus de la moitié des effectifs. Par type de contrat Compte tenu de l'information disponible, il ne nous est pas possible d'analyser la part des personnels sous CDD au sein d'IBM France. Nous disposons, en revanche, de données concernant la présence de personnel travaillant à temps partiel ainsi que sur le recours à l'emploi intérimaire. · Le personnel sous contrat de travail à temps partiel Evolution du nombre de salariés à temps partiel
Source : CGR IBM France Le développement du travail à temps travail est continu dans le groupe de 1991 à 1996 ; le mouvement de progression ne s'interrompt qu'en 1997. Entre 1991 et 1997, la part des salariés à temps partiel est ainsi passée de 6,9 % à 11,2 %. La progression la plus marquée a eu lieu en 1993 (+ 31,8%), sous l'effet des difficultés du groupe. · Le recours aux intérimaires Evolution du nombre d'intérimaires (moyenne mensuelle)
Source : CGR IBM France Les effectifs intérimaires sont, quant à eux, en croissance sensible sur la période. Ils augmentent fortement en 1993 et 1994 au moment où IBM France voit son chiffre d'affaires d'abord reculer en 1993, puis stagner en 1994. Le recours aux intérimaires est ensuite bien moindre mais sans jamais redescendre à son niveau initial. Une nouvelle pointe est enregistrée en 1997 alors que le niveau des ventes est encore en repli. Les 158 intérimaires de 1997 se décomposent en 99 pour Seprim, 49 pour LLO, 9 pour IBM SA et 1 pour Lyd Informatique. En revanche, aucun intérimaire n'est recensé pour les autres filiales et, en particulier, pour Axone et CGI, ce qui s'explique par la pénurie de main d'_uvre qualifiée et le niveau de qualification élevé des salariés recrutés.
Les charges de personnel ne sont pas identifiés en tant que tels dans le compte de résultat d'IBM France. Les frais de personnel indiqués ci-dessous sont le résultat d'une reconstitution indicative réalisée à l'attention du comité de groupe d'IBM France. Le tableau ci-après reflète les efforts engagés par le groupe pour maîtriser ses charges de personnel ; ceci a cependant été réalisé avec plus ou moins de succès. Evolution des charges de personnel d'IBM France
Source : rapport annuel En 1992 notamment, les charges de personnel ont reculé de 7,9 % alors que les effectifs ont enregistré une baisse de 14,6 %. Au contraire, l'année 1993 a été marquée par un repli significatif des charges de personnel alors que les effectifs progressaient parallèlement : il faut cependant rappeler que l'augmentation des salariés à temps partiel (donc aux coûts salariaux moins lourds) et des intérimaires (qui ne figurent pas dans les charges de personnel) a été particulièrement importante cette année-là. En 1994 et 1995, les charges de personnel ont diminué de façon plus marquée que les effectifs pour augmenter à nouveau de + 5,0 % en 1996 alors que les effectifs continuaient à baisser. Enfin, une pression sur les coûts salariaux a été opérée en 1997 avec une légère baisse des charges de personnel (- 0,1 %) dans un contexte de légère reprise des effectifs (+ 0,2 %).
· Au niveau du groupe IBM Evolution de la productivité apparente du travail du groupe IBM
Source : IBM Annual Report La politique de réduction des effectifs, conduite jusqu'en 1995, explique la progression jusqu'à cette date de la productivité apparente du travail. Elle commence à décroître à partir de 1996 avec la reprise de l'augmentation des effectifs. Le recul s'est d'ailleurs amplifié en 1997, la productivité retrouvant un niveau similaire à celui observé trois ans auparavant. · Au niveau du groupe IBM France Pour ce qui concerne IBM France, la productivité apparente du travail a diminué de 14,4 % entre 1991 et 1997. Ce recul peut s'expliquer par la modification du portefeuille d'activités au profit de services plus consommateurs de personnel. Evolution de la productivité apparente du travail d'IBM France
(1) Effectif moyen comprenant des salariés à temps partiel. Source : CGR IBM France
IBM France ne communique pas sur sa politique de formation au niveau du groupe. Les informations présentées ci-dessous concernent les principales sociétés du groupe et sont issues des bilans sociaux de ces sociétés. Nombre d'heures de stage rémunérées en moyenne par salarié
* Base : effectifs moyens de la liasse fiscale. Source : CGR IBM France Dépenses de formation en pourcentage de la masse salariale
* Cet indicateur ne figure pas dans le bilan social de Seprim. Source : CGR IBM France Le nombre moyen d'heures de stage consacré par salarié est structurellement plus important chez CGI que dans les autres entités. Cette caractéristique est principalement due, en 1997, à la formation des nouveaux embauchés et la nécessité de suivre les évolutions technologiques. Axone est l'entité qui consacre le moins de moyens à la formation, notamment si on le mesure en nombre d'heures de stage rémunérées consacrées à chaque salarié. Dans les activités de services, le capital humain constitue un actif stratégique d'où un taux d'effort nettement supérieur à l'obligation légale, soit 1,5 % de la masse salariale. Annexe
(1) Remarques : les chiffres de ce tableau corrigent ceux publiés dans la plaquette groupe et qui ne sont par ailleurs éliminées des mises en équivalence Virtuality House. Cliquer
ici pour revenir au sommaire du tome III () Voir en annexe la liste des sociétés du périmètre de consolidation du groupe IBM France (document 5). () La dépense informatique, recouvre du point de vue de l'entreprise cliente, l'ensemble des frais relatifs aux matériels, aux logiciels, aux services, aux frais de personnel et aux coûts indirects. () Le marché représente le cumul du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés du secteur informatique dans cette industrie. () La campagne de communication autour du e-business a représenté un budget de 800 MUSD au plan mondial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Source : Le Monde Informatique
Source : Le Monde Informatique