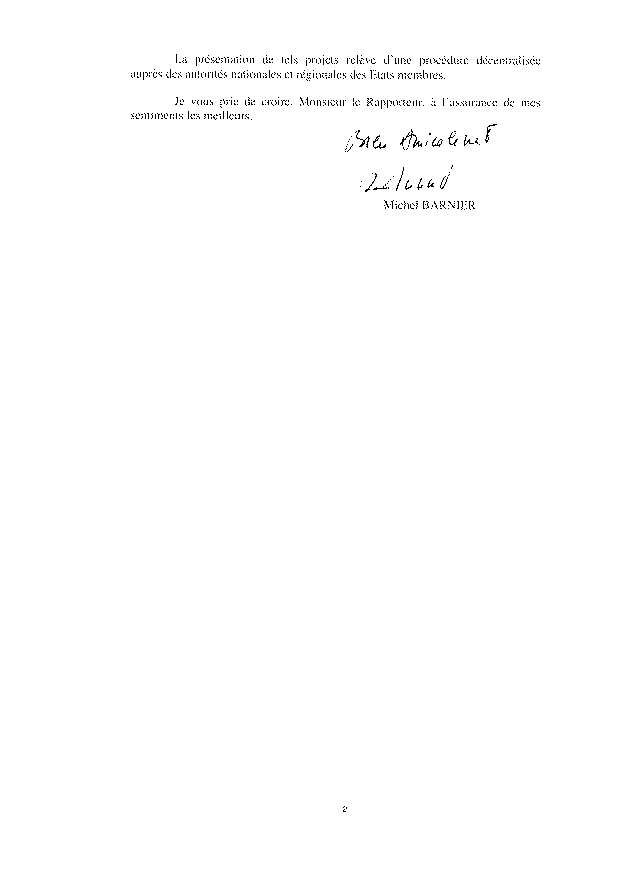Audition de M. Michel BARNIER,
commissaire européen chargé de la politique régionale (1)
(extrait du procès-verbal de la séance du 13 mars 2000 à Bruxelles)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. le Président : Monsieur le commissaire, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir. Nous nous étions rencontrés au Havre où vous m'aviez semblé hésitant sur le principe de cet entretien.
M. Michel BARNIER : Ma réaction au Havre, quand vous m'avez parlé de l'audition, provenait du fait que, dans l'esprit collégial qui est le nôtre, les collègues directement en charge d'une question sont prioritaires. Lorsque je me suis rendu en Bretagne et, quelques semaines plutôt, en Charente- maritime, c'étaient davantage les dégâts de la tempête qui étaient en cause que ceux de la marée noire : j'ai seulement manifesté mon intérêt pour ce sujet.
Cela étant, je suis à votre disposition pour vous donner mon sentiment. Sur ce sujet, j'ai d'ailleurs rencontré Mme Wallström, commissaire européen chargée de l'environnement, ainsi que des membres de la direction générale qui suivent ces questions.
De façon claire, si l'on doit parler de prévention - et prévenir coûte moins cher que réparer, comme je l'ai toujours soutenu avant même que d'être ministre de l'Environnement en France -, c'est Mme de Palacio, commissaire européen chargée notamment des transports, qui possède la clé ou les clés au niveau européen où vous avez situé l'action à mener. Elle est décidée à utiliser ces clés de manière volontariste. Vous avez eu l'indication des orientations sur lesquelles elle travaille, précisément en matière de réglementation, de contrôle dans les ports, de surveillance des bateaux, de l'obligation de la double coque, qu'à titre personnel j'avais moi-même préconisée.
Quand vous rencontrerez Mme de Palacio, elle vous dira certainement que ce sont ses idées et qu'elle fera en sorte qu'elles deviennent celles de la Commission dans un temps relativement rapproché. Dès le mois de mars, le Collège devra délibérer sur ces orientations et vous pouvez compter sur moi pour les appuyer.
Pour sa part, Mme Wallström a sous son autorité l'action de l'unité de sécurité civile. C'est une unité modeste mais qui a joué son rôle dans l'affaire de l'Erika. C'est une sorte de réseau où l'on échange des informations au niveau européen, où l'on met en _uvre des demandes précises de matériel dont un État membre ne dispose pas : ce fut le cas de bateaux, de barrages flottants, de machines à démazouter les oiseaux.
Si vous me permettez une opinion personnelle, cela a aussi mis en évidence un problème probablement plus franco-français : celui du manque de moyens, qui a obligé les responsables à transporter des barrages flottants d'un bout à l'autre de la côte atlantique, et même à aller en chercher en Angleterre ou en Irlande. On a aussi pu constater le manque de centres immédiatement mobilisables pour le nettoyage des oiseaux.
J'ai visité un de ces centres, mis en place dans des conditions d'improvisation totale, avec une formidable bonne volonté. Je pense qu'un pays comme la France, comme l'Italie et d'autres, vu la longueur de ses côtes devrait posséder un ou deux centres mobiles immédiatement utilisables. Je me demande également si les maires des communes dont les côtes ou les plages sont protégeables par des barrages ne devraient pas disposer en permanence de matériel adéquat sur place. J'ai été frappé par cette recherche des barrages flottants ; on a fini par en trouver à 26 kilomètres, mais prêtés par onze pays. N'y a-t-il pas une leçon à en tirer pour la France, leçon valable d'ailleurs pour chaque État membre ? Quand la possibilité existe, ne faudrait-il pas prévoir un plan d'équipement de sauvegarde des côtes ou des plages les plus sensibles ?
M. Louis GUEDON : M. le commissaire, les choses vont encore beaucoup plus loin que votre pensée ! La protection des côtes françaises est prévue par le plan POLMAR terre, qui ne s'occupe que des entrées de port et d'estuaire ; il délaisse complètement tout ce que vous dites par rapport à nos côtes, en particulier les rivages sédimentaires que sont les plages.
M. Michel BARNIER : C'est exactement ce que je voulais dire : je sais que les ports peuvent être protégés. Ce qui m'a frappé, c'est que les plages ne pouvaient l'être ; physiquement, il n'est pas possible de protéger toutes les plages.
M. Louis GUEDON : Je suis un maire dans ce cas. Le préfet nous a dit ne pas être concerné par notre problème dans le cadre du plan POLMAR terre et ne pas vouloir en entendre parler.
M. Michel BARNIER : Il est clair qu'il faudra modifier ou compléter le plan POLMAR.
Nous avons aussi quelques crédits - 300.000 euros, soit 2 millions de francs - pour des études d'évaluation des effets de telles catastrophes. Une petite ligne budgétaire pour des secours d'urgence a été supprimée en 1997 ; elle se montait à 5 millions d'euros par an pour faire face à de tels cas. Mais ce sont 5 millions d'euros pour toute l'Europe : en cas de catastrophe, il ne restait de toute façon plus rien très rapidement. S'il faut créer une ligne de secours d'urgence, elle doit être créée par le Parlement européen sur proposition de la Commission et des gouvernements, mais être certainement plus substantielle.
Voilà les trois niveaux d'action. Le plus important reste celui de la prévention au niveau de la réglementation, et c'est la Commission qui en a la maîtrise. Quand on parle de réparation, il y aussi ce que je pourrais faire, comme je l'ai dit en Bretagne l'autre jour, pour assumer, aux côtés des autorités nationales, une partie de la réparation et ce que pourrait faire mon collègue Franz Fischler, avec l'IFOP ou le FEOGA.
M. Prodi a répondu par une longue lettre à M. Jospin sur l'ensemble de ces sujets. La Commission est ouverte aux propositions françaises, dans le cadre du règlement général des fonds structurels, pour adapter nos interventions en vue de faire face à ces besoins de réparations avec pragmatisme et souplesse.
Au-delà des pêcheurs, dont les pertes peuvent être pour partie compensées par le biais de l'IFOP, le problème touche notamment les ostréiculteurs ; il devrait être possible d'aider ceux qui ont été touchés. J'ai également été frappé de voir les détériorations occasionnées par le mini raz-de-marée, la tempête en Charente et les dégâts aux installations d'ostréiculture ou de conchyliculture. L'indemnisation pour perte d'exploitation qui, selon la règle de l'IFOP, est ouverte aux pêcheurs et calculée en fonction du temps d'immobilisation ou de la perte des bateaux, devrait être étendue à l'indemnisation de l'ostréiculture dans une certaine proportion.
Pour l'avenir, j'ai rappelé en Bretagne une idée à laquelle je travaille depuis très longtemps, ainsi que Mme Wallström dont c'est précisément le domaine. Devenu commissaire, j'ai jugé le moment venu d'utiliser mon pouvoir d'agir pour la faire avancer. Il s'agit de la création d'une force européenne de sécurité civile. Je ne vise pas seulement la réparation de dégâts provoqués par une marée noire, mais tous les dégâts de catastrophes plus ou moins naturelles, face auxquels ce n'est pas la bonne volonté qui manque, ni forcément l'argent, mais une certaine coordination et la lisibilité procurée par une intervention européenne.
En cas de tremblement de terre en Grèce, pays membre de l'Union européenne, ou en Turquie, pays voisin de l'Union européenne, en cas d'inondation en Pologne, de marée noire en France, en cas de catastrophes beaucoup plus graves en Amérique du Sud, avec les 30.000 morts au Venezuela, chaque pays européen part seul : des pompiers français, des médecins britanniques, des chiens d'avalanche italiens. L'Europe n'existe pas. Je me dis qu'au fond, ce serait là un vrai sujet pour une action plus efficace et plus lisible de l'Union européenne et que l'on pourrait créer ce que j'appellerai une « Force d'intervention européenne de sécurité civile » .
Il ne s'agit pas ici de mettre sur pied une « super administration » et que tout le monde soit à Bruxelles ! Dans mon esprit, il s'agirait seulement d'identifier des unités spécialisées dans chaque pays, sur la base du volontariat, en fonction des compétences spécifiques de chaque nation. Ces unités seraient considérées comme des membres d'une Force européenne, mobilisables ensemble, avec des entraînements communs, un état-major unique basé à Bruxelles. Elles seraient habituées, selon les besoins, à partir en totalité ou en partie. Leurs membres auraient appris à travailler ensemble, à partir ensemble, à se parler, à démultiplier leurs efforts. En même temps, une telle force aurait plus d'allure pour l'Union européenne, quand elle partirait en Grèce ou sur la côte Atlantique, que les pays pris isolément.
Nous travaillons sur cette idée avec Mme Wallström. La Commission devrait pouvoir la réaliser dès l'instant où nous serions assurés de disposer de moyens supplémentaires de la part du Conseil des ministres et du Parlement. Voilà pourquoi une commission comme la vôtre est importante pour faire avancer les idées et la perception politique des choses.
Il est exclu de demander à la Commission davantage d'actions sans augmenter son budget. Mais mon idée n'est pas de mobiliser des milliards d'euros ; il suffirait de créer un état-major commun et d'utiliser des moyens en respectant la subsidiarité.
L'opération pourrait même être réalisée sous forme de volontariat. Nous parlons beaucoup de coopération renforcée dans le cadre de la réforme du traité de l'Union européenne. Voilà un bel exemple de réalisation possible.
Je le dis parce que la protection civile n'est pas toujours une compétence nationale. Par exemple, les Länder allemands sont très vigilants et susceptibles sur ce sujet, qui fait partie de leur domaine de compétences. Pour bâtir une telle force européenne, on pourrait démarrer sur la base d'une coopération renforcée qui, dans un premier temps, ferait appel aux pays volontaires. C'est un bon sujet. Comme la France a été touchée plus que d'autres, elle pourrait en prendre l'initiative ou, au moins, la soutenir. La Commission souhaite s'exprimer bientôt sur ce point.
Voilà pour mon point introductif, mais je suis tout prêt à échanger avec vous.
M. le Rapporteur : J'ai quelques interrogations aux limites de vos compétences ; elles concernent directement la sécurité et la réglementation. Une question que l'on se posera certainement est celle de Malte et de Chypre, ainsi que d'autres pays susceptibles d'entrer dans l'Union européenne. Pour moi, ils sont déjà à ses portes mais ne respectent pas les normes ; c'est le moins que l'on puisse dire. Dans la négociation qui s'ouvre ou qui est en cours, cette dimension ne pourrait-elle pas être évoquée ?
M. Michel BARNIER : La réponse est clairement oui. Cela a été expressément dit à Malte et Chypre ; les Chypriotes ont d'ailleurs fait une déclaration, voici quelques jours, pour annoncer qu'ils abandonneront le pavillon de complaisance, car c'est une condition pour faire avancer la négociation ou un risque pour eux de la voir retardée.
M. le Rapporteur : La condition est donc la fin du pavillon de complaisance ?
M. Michel BARNIER : Oui, ainsi que le respect des réglementations européennes telles qu'elles existeront au moment de leur entrée dans l'Union, et donc pas seulement en leur état actuel. C'est un peu la même chose concernant Schengen. Je me suis battu à Amsterdam pour intégrer Schengen dans le Traité, car c'est un acquis communautaire qui n'existait pas jusqu'à présent. Pour tout pays qui entrait dans l'Union européenne, il n'existait pas de conditions en matière d'asile, de visa, d'immigration, de sécurité, de lutte contre la drogue, de lutte contre les mafias. Sinon vous entreriez dans l'Union européenne sur la base de critères économiques, sans subir de contraintes quant à la sécurité et à la lutte contre la criminalité internationale. Schengen constitue une obligation nouvelle dans la Communauté, pour tous les nouveaux pays candidats, de respecter certaines règles en matière d'Etat de droit. Officiellement, l'idée sera de faire respecter l'acquis communautaire tel qu'il sera alors ; il est donc important de le faire changer avant.
M. le Rapporteur : L'adhésion sera-t-elle obligatoire, même au mémorandum de Paris, c'est-à-dire au contrôle des normes ? Cela leur est-il notifié dans les propositions ?
M. Michel BARNIER : Oui, tout à fait. Nous avons visé ce point dans le projet de communication préparé par Mme de Palacio. Quand un commissaire fait une communication, ce n'est pas comme un Gouvernement : là, on voit arriver les textes des autres ministres au dernier moment ! Ici, nous voyons préalablement tous les textes des autres commissaires. Nos vingt chefs de cabinet travaillent ensemble, en collège, sur les mêmes textes.
M. le Président : Quelle sera l'attitude de certains pays qui sont déjà membres de l'Union, comme la Grèce notamment ?
M. Michel BARNIER :. Parlons franchement. Certains pays, comme la Grèce, poseront un problème dans l'évolution et le degré de sévérité des normes. C'est pourquoi il faut « battre le fer pendant qu'il est chaud » et - si vous me permettez un conseil - que le gouvernement français fasse pression sur ce sujet, maintenant. Le naufrage de l'Erika est encore très proche, mais les crises passent. Ce sera une grosse bataille que nous ne sommes pas sûrs de remporter.
Posez la question à Mme de Palacio de savoir si, sur ces matières ou sur ces parties de matière, nous sommes à la majorité qualifiée ou à l'unanimité. C'est aussi une raison pour laquelle je suis favorable à l'extension de la majorité qualifiée. Vous ne pouvez pas soumettre un sujet sous le régime de l'unanimité, car un pays membre peut bloquer tous les autres.
M. le Président : Sur de tels sujets !
M. Michel BARNIER : Oui, je ne parle pas de majorité qualifiée sur des sujets graves, institutionnels ou sensibles comme la fiscalité, mais je parle de sujets comme celui-là. Il faudrait pouvoir décider à la majorité qualifiée, quand l'intérêt général est en cause. On ne peut se satisfaire de l'exigence de l'unanimité sur un tel sujet si nous voulons avancer, même s'il y a une pression médiatique circonstancielle ou conjoncturelle qui peut aider, comme c'est le cas actuellement.
M. le Président : Pour quelques mois encore, dans la mesure où l'Erika continue à faire parler de lui !...
M. le Rapporteur : Ma seconde interrogation porte sur la possibilité de développer le cabotage. L'un des risques majeurs étant la saturation en Manche, dans le cadre de règlements communautaires n'y a-t-il pas moyen de favoriser des expérimentations de lignes de cabotage comme cela se fait en France dans le cadre de l'aviation ? Il existe à cet effet un fonds de péréquation qui permet d'aider le lancement d'une «déviation aérienne» pendant deux ou trois ans. Le cabotage en privilégiant une navigation d'un port à l'autre à l'intérieur de l'Europe, permettrait de désengorger le trafic en Manche.
M. Michel BARNIER : Qu'entendez-vous exactement par cabotage ?
M. Louis GUEDON : La marine marchande comporte plusieurs catégories : des navires au long cours, des gros navires qui font des traversées transocéaniques ; ensuite, le cabotage, avec des navires plus petits qui ne feront pas de grandes traversées, mais qui naviguent de port en port, dans un même pays ou dans des pays voisins, comme en Europe. Il y a donc deux marines marchandes : la marine au long cours et la marine de cabotage.
M. Michel BARNIER : D'accord, mais je ne vois pas comment le cabotage met moins de bateaux dans la Manche. Moins de gros bateaux, peut-être ?
M. François GOULARD : Moins de gros bateaux aux points sensibles.
M. Michel BARNIER : C'est possible. Il convient de voir si le règlement le permet, mais la demande doit émaner de plusieurs Etats membres.
M. le Rapporteur : Cela pourrait-il alors être éventuellement envisageable ?
M. Michel BARNIER : Oui, je n'y vois pas d'obstacle a priori. Je vais faire vérifier ce point : mes services sont les mieux placés pour répondre. Si l'idée est retenue, il faudrait que ce soit un processus initié avec le soutien de la Commission.
M. le Président : Bien des observations ont déjà été formulées par la Commission européenne sur cette question du cabotage. Mais, à l'évidence, sur des produits aussi dangereux ou polluants que le pétrole, c'est une piste à creuser.
M. Michel BARNIER : Posez cette question à Mme de Palacio. Mais plusieurs Etats membres doivent être d'accord. Le seront-ils ? Les Pays-Bas le seront-ils ?
M. le Président : Des accords ont déjà été passés entre les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne. Ce sont les accords de Bonn de 1994. C'est dans ce cadre-là aussi que nous pourrions aller plus avant, compte tenu du nombre des navires qui transitent en Manche, compte tenu aussi des risques encourus par tous ces navires qui passent au large de l'île d'Ouessant. Nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle catastrophe : elle pourrait alors s'étendre sur tout le rivage atlantique ; la même catastrophe se produisant en plein milieu de la Manche, toutes les plages des côtes sud de la Grande-Bretagne plus celles de Cherbourg au nord seraient touchées.
M. Michel BARNIER : Bien sûr, il s'agit de la quantité mais aussi de la qualité des bateaux, cette dernière étant liée au problème des sociétés de classification, qui font plus ou moins bien leur travail, mais aussi à la surveillance exercée dans les ports. Avons-nous vraiment les moyens de surveiller les bateaux ?
Je prendrai pour exemple une situation que j'ai vécue comme ministre de l'Environnement, avec les conteneurs de détonateurs perdus en mer, en 1993. Que s'était-il passé ? Un porte-conteneurs chargé au Havre, sans doute, avait sa cargaison mal arrimée : un ou deux conteneurs sont passés par-dessus bord, au cours d'une tempête au milieu du golfe de Gascogne. Des milliers de détonateurs jaunes se sont échoués sur les plages. A-t-on vraiment les moyens de bien vérifier l'arrimage des conteneurs, la qualité des bateaux ?
M. le Rapporteur : Ce n'est pas seulement un problème français.
M. le Président : Il faut connaître le contenu des conteneurs, savoir où se trouvent les conteneurs qui renferment des marchandises éventuellement dangereuses. Il faudrait que ceux-là fassent l'objet de soins plus importants. J'ai le sentiment que rien n'oblige actuellement un armateur à donner des précisions suffisantes aux services compétents de sécurité sur les précautions prises en matière d'arrimage.
M. Michel BARNIER : Prévoir la traçabilité des conteneurs... Je me suis posé une autre question : n'existe-t-il pas, dans la Manche ou sur les côtes européennes, une sorte d'aiguillage ? Au moins dans les zones à fort trafic, ne pourrait-on imaginer un endroit où les bateaux repérés par des balises seraient suivis ?
M. le Rapporteur : C'est le cas aujourd'hui pour les bateaux transportant des matières dangereuses. Ils sont obligés de se signaler en entrant en Manche. C'est aussi le cas pour les bateaux présentant des avaries.
M. Michel BARNIER : Est-il techniquement impossible dans ces eaux communautaires et, peut-être, dans des zones plus denses comme la Manche ou l'Atlantique, d'avoir un suivi permanent, par radar ou balise, de tous les bateaux qui naviguent ?
M. le Rapporteur : C'est possible, mais la difficulté n'est pas tant celle-là que la qualité du bateau qui entre. Je pense que l'idée d'une agence européenne de contrôle, comme certains armateurs ou autres corporations maritimes l'exposent actuellement, est une idée intéressante. Mais cela touche directement à la question de la souveraineté et mettrait sans doute énormément de temps à se mettre en place.
Par contre, avoir dans le domaine de la sécurité maritime le même dispositif que pour une intervention de la sécurité civile, serait une idée à approfondir : elle permettrait d'assurer une coordination des moyens de contrôle et de coordonner les contrôleurs dans les ports, d'avoir un outil commun de normalisation et de vérification.
M. François GOULARD : Pour des profanes que nous sommes, une question touchant au fonctionnement des institutions : la présidence française est-elle en position de permettre une avancée sérieuse des idées de solution européenne, qui semblent très utiles sur plusieurs points dans ce dossier, dans les années qui viennent ? Quelle est l'influence de la présidence qui sera évidemment sensibilisée à ces sujets plus qu'à d'autres ? Quelle est son influence réelle dans la marche des affaires européennes ?
M. Michel BARNIER : Ma réponse est oui, dès l'instant où il y a conjonction d'une volonté politique de la présidence et de la Commission. En effet, la Commission a seule l'initiative des propositions ; le Conseil ne peut être saisi autrement que par une proposition de la Commission. Il se trouve que nous sommes dans cette situation : la Commission en place, sans avoir besoin qu'on le lui demande puisqu'il suffit qu'un commissaire soit sensible à une question - comme Mme de Palacio - a ainsi décidé, à la lumière de l'accident de l'Erika, de se saisir de cette question depuis six mois déjà. Elle ne se saisit pas seulement de cette question, mais de bien d'autres encore, comme le ciel unique. Des propositions sont déjà prêtes. Il y aura une initiative de la Commission.
Je réponds maintenant à la question : une proposition de la Commission sans volonté politique au niveau du Conseil restera bloquée. Nous avons une conjonction extrêmement favorable au texte de la Commission, qui ne constitue pourtant qu'une base, bien entendu encore perfectible. Mais bien que le texte existe, il peut encore être bloqué par inertie. Cela dure quelquefois des années. Un délai de six mois, c'est court.
M. le Rapporteur : Le texte dont nous parlions tout à l'heure, et qui concerne le Conseil transports, sera-t-il prêt pour fin mars ?
M. Michel BARNIER : La Commission soumet le texte au Conseil des ministres, ce qu'elle fera ce trimestre. Tout ce semestre est sous présidence portugaise ; le Portugal n'est pas indifférent à ces questions. Pourquoi tout de suite ? Parce que six mois, c'est très court. Le fait d'être introduit devant le Conseil des ministres des transports en mars fait gagner deux à trois mois de maturation. Après cela, si la présidence française en a vraiment la volonté, il peut devenir un résultat de la présidence française. A la place du Premier ministre, je m'y attacherais.
M. François GOULARD : C'est donc un dossier très important pour nous ?
M. Michel BARNIER : Oui et un autre point important pour nous, c'est que Mme de Palacio a raccourci ces délais, normalement plus longs pour un texte de la Commission. Travailler en trois mois est assez rare. Elle a raccourci les délais pour gagner du temps, pour pouvoir introduire ce texte maintenant, afin que la présidence portugaise ait le temps de commencer le travail de maturation. Toute démarche réalisée auprès du Gouvernement portugais est utile.
En effet, comment cela se passe-t-il en termes de procédure ? Chaque présidence est très soucieuse d'engranger des résultats ; elle désire montrer qu'elle a fait avancer des dossiers. C'est l'enjeu d'une présidence : sensibiliser l'opinion du pays aux questions européennes, mais aussi montrer que la présidence s'est montrée efficace. A chaque semestre, le bilan de la présidence est réalisé : plus ou moins terne ou brillant. Tout dépend donc des conseils européens qui se déroulent à ce moment-là.
La présidence française est confrontée à un enjeu important. Au sein du Collège des commissaires européens, je suis chargé de la conférence intergouvernementale sur la réforme des institutions. Sur quoi le bilan de la présidence peut-il être lisible en décembre ? Sur le résultat de la réforme des institutions - qui n'est pas évident - et sur deux ou trois sujets comme la sécurité des transports maritimes. La présidence portugaise met l'accent sur l'emploi et la société de l'information.
Je vous rappelle que la présidence a la maîtrise de l'ordre du jour du Conseil ; elle dispose donc d'un vrai pouvoir pour faire avancer les choses. Elle inscrit certains problèmes à l'ordre du jour ou non, elle entame des mesures dilatoires ou non, elle pousse ou elle retient. Si le Gouvernement français veut faire avancer et aboutir cette question, il le peut.
Après nous, il y aura la Suède, qui peut être aussi motivée par ce sujet, et ensuite la Belgique.
Si l'on parle de résultat politique, en tant que Français, je trouverais magnifique que la présidence française aboutisse à un résultat concret dans le domaine qui nous intéresse. Bien sûr, s'agissant de la Grèce et d'autres pays, les choses n'iront pas aussi facilement.
M. le Président : Il y a aussi les pays baltes qui demandent à entrer dans l'Union européenne. Je suppose qu'ils seront traités de la même manière, comme Malte ou Chypre ?
M. Michel BARNIER : Bien sûr. La Grèce participe déjà à l'Union européenne. Si nous désirons obtenir un résultat sous présidence française, il faut que ce soit le résultat des Quinze.
M. le Rapporteur : Le texte qui sera présenté est un projet de directive ou un ensemble de réglementations ?
M. Michel BARNIER : Il s'agit de trois projets de directives. Nous ne sommes pas dans un exercice intellectuel de livre blanc qui propose un débat. Ce sont bien trois projets de directives. Il est possible que, si les discussions des chefs de cabinet se déroulent dans de bonnes conditions, ces projets soient approuvés dès la semaine prochaine par le Collège des commissaires.
Les discussions sont en cours en ce moment même entre chefs de cabinet. Les choses se passent de manière très particulière : il n'y a pas d'arbitrage de la part d'un Premier ministre, toutes les décisions sont prises à vingt. Quand il y a désaccord entre les commissaires, c'est le Collège qui arbitre, par vote ou par consensus. C'est un travail d'élaboration, un travail très collectif. Il est donc possible que l'affaire passe dès mercredi prochain.
Je vais quand même vérifier en ces domaines s'il s'agit de la majorité qualifiée ou de l'unanimité. Je ne sais pas si tel ou tel pays maritime acceptera que l'affaire passe à la majorité qualifiée.
M. le Président : Cela permettrait de faire en sorte que l'instance politique de l'Union européenne prenne l'initiative par rapport au poids que représente l'Organisation maritime internationale, qui a tendance à rester inféodée à certains Etats du pavillon, alors que l'instance politique de l'Union européenne ne leur est nullement soumise.
M. Michel BARNIER : Je suis extrêmement sensible à votre plaidoyer pour la construction européenne. Cela ne m'étonne pas de vous.
M. le Président : Bien sûr que non. Si tout allait dans le même sens que celui que nous venons d'évoquer, nous n'aurions aucune difficulté.
M. Michel BARNIER : Ce que l'on dit pour le transport maritime, on pourrait le dire aussi pour la défense, pour la politique étrangère. C'est la question de savoir si nous sommes maîtres de notre destin.
M. François GOULARD : A supposer que l'on retienne l'idée d'un corps de garde-côtes européen, la constitution d'un tel organisme paraît-elle réaliste, accessible ou, au contraire, utopique ?
M. Michel BARNIER : La conception d'un nouvel organisme de coordination me paraîtrait intéressante, mais s'agira-t-il d'engager sur place des gens nouveaux ?
M. le Rapporteur : D'après les promoteurs de ce concept, ce sont des personnels nouveaux. On crée de toutes pièces une police européenne de la mer.
M. Michel BARNIER : Il existe déjà des polices de la mer, des polices nationales : qu'en faites-vous ? Vous les coordonnez ou vous leur attribuez d'autres tâches complémentaires ?
M. Louis GUEDON : Le problème que nous rencontrons, c'est la diversité des moyens et l'absence de coordination de ceux-ci. Dans les ports, six vedettes sont toujours à quai : gendarmes, douaniers, affaires maritimes, etc. Ces vedettes se court-circuitent. On a pu voir leur efficacité avec l'Erika...
M. Michel BARNIER : Là, c'est un problème franco-français.
M. le Rapporteur : C'est plutôt une question de coordination des forces.
M. Michel BARNIER : Comme je l'ai suggéré pour la sécurité civile, les garde-côtes seraient identifiés comme tel ou tel corps d'Etat, tel ou tel corps local, mais rattachés à une organisation européenne. Ces gens-là se formeraient ensemble, ils disposeraient d'un matériel cohérent, de normes cohérentes, ils suivraient des formations communes.
M. Louis GUEDON : Le danger, c'est d'avoir quatre bateaux et quatre équipages, mais sans argent pour les mettre en fonction. Avec un bateau et un équipage véritablement opérationnels, on disposerait en fait de plus de moyens.
M. Michel BARNIER : Ce problème ne concerne pas l'Union européenne. Elle pourrait seulement dire : « Monsieur le ministre des Transports ou de la Mer, en France, Monsieur le ministre belge, Monsieur le ministre britannique, nous vous demandons d'identifier, sur chaque portion de vos côtes, les hommes et les matériels qui participeront à ce corps. Ces gens-là seront formés ensemble. Nous imposerons des coordinations, une harmonisation des normes, une direction commune. » Ils devront se montrer solidaires.
M. François GOULARD: Cette solution est-elle vraiment accessible ?
M. Michel BARNIER : Oui.
M. le Rapporteur : C'est l'agence européenne.
M. Michel BARNIER : Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux constituer une agence européenne de sécurité civile, à vocation plus large, avec notamment une possibilité d'intervenir en matière de sécurité maritime.
M. le Rapporteur : Il est vrai que le problème touche autant la police que la sécurité civile, ainsi que le contrôle sur mer.
M. Michel BARNIER : S'il s'agit de questions de police, il faut voir dans quelle mesure elles peuvent être déléguées dans le Traité. Mais cela peut être l'objet d'une coopération renforcée.
M. le Rapporteur : De toute façon, d'après les articles de presse sur les intentions bruxelloises à ce sujet, l'un des thèmes sera aussi le contrôle des contrôleurs, leur formation et l'harmonisation des normes. Nous sommes proches de ce concept.
M. Michel BARNIER : J'espère pouvoir faire passer une idée dans le Traité : nous nous trouvons dans le cadre de ce que pourrait être une coopération renforcée entre un tiers des pays membres, qui voudraient aller plus loin, y compris dans la coordination de leurs pouvoirs de police délégués, sans pour autant engager les autres Etats membres.
M. le Rapporteur : Il vous paraît possible d'introduire cette notion de coopération renforcée dans le cadre de la réforme des institutions ?
M. Michel BARNIER : Oui. La coopération renforcée est l'une des propositions de la Commission. Il faut un tiers des pays membres sans qu'aucun autre pays ne l'empêche.
M. le Rapporteur : S'agissant de quels types de compétences ?
M. Michel BARNIER : Dans le cadre des objectifs du Traité.
C'est un cas de coopération. Les Quinze ou les vingt pays n'ont pas le même intérêt pour ce sujet, mais il est très facile de trouver un tiers de pays favorables.
M. le Président : Je vais plus loin. Cinq ou six pays doivent constituer ce tiers. Or, France, Belgique, Portugal, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne : nous en sommes déjà à sept pays prêts ! Nous pouvons donc déjà mettre en place. Quelle est la compagnie maritime, y compris grecque, qui peut se passer de venir à Rotterdam ?
M. Michel BARNIER : Je vous rappelle, messieurs, comment s'est créé Schengen : sept pays de l'Union européenne ont décidé de gérer leurs frontières ensemble. Il n'existait aucune clause de coopération renforcée dans le Traité, à l'époque, il y a quinze ans. Il n'existait pas de compétences en matière de sécurité des citoyens. La convention de Schengen était extérieure au Traité. Sa création a été tellement rapide qu'après, les autres pays ont demandé d'intégrer Schengen dans le Traité.
L'idée de coopération suit le même chemin : nous nous trouvons tous au même endroit, personne ne retourne en arrière. Ceux qui nous rejoignent le font à cet endroit des acquis communautaires du moment. Sur cette route, certains partent en avance. Voilà un sujet de coopération renforcée qui touche à la police.
Pour l'instant, la réglementation veut que le projet soit caduc si un seul pays s'y oppose. Cela dit, les pays qui le souhaitent peuvent agir en dehors du Traité. Nous sommes dans le cadre européen et nous tâchons de l'utiliser. Actuellement, si quatre pays voulaient ensemble mettre sur pied une association sur la sécurité des côtes, ils pourraient le réaliser en dehors du Traité. Mais nous voudrions que ces bonnes idées puissent être soumises aux Quinze autour de la table, dans le cadre communautaire. Si ce cadre communautaire doit servir à quelque chose, c'est bien à cela.
En outre, j'ai proposé de faire sauter la clause de l'unanimité qui existe actuellement : un pays peut bloquer tous les autres.
M. Louis GUEDON : Même s'il n'a aucune raison, même s'il n'y participe pas ?
M. Michel BARNIER : Oui. Nous voudrions donc supprimer cette clause.

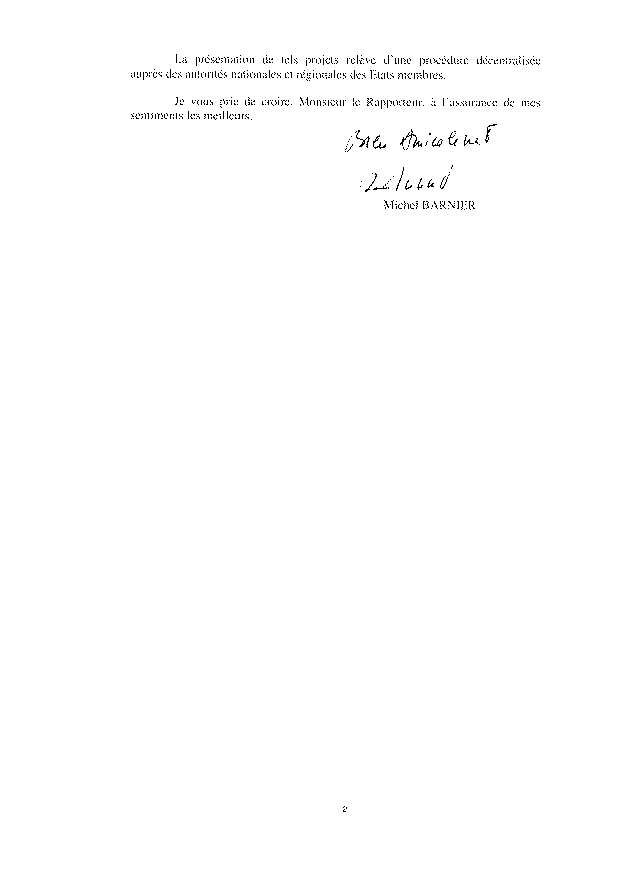
Audition de Mme Margot WALLSTRÖM,
commissaire européenne chargée de l'environnement
(extrait du procès-verbal de la séance du 13 mars 2000 à Bruxelles)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Mme Margot WALLSTRÖM : Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous exposer mon point de vue sur la prévention d'accidents tels que celui de l'Erika. J'ai été bouleversée, quand je suis allée sur place, de voir les volontaires et les sapeurs-pompiers qui nettoyaient à la main en sachant qu'il y aurait sans doute une nouvelle marée noire le lendemain. C'était un travail exigeant beaucoup de temps et certainement très déprimant.
M. Barnier et moi-même avons écouté les préoccupations exprimées par les gens sur place, préoccupations touchant notamment à l'avenir de l'ostréiculture, du tourisme ou au simple fait d'habiter à cet endroit. Évidemment, à la Commission, nous sommes nous-mêmes préoccupés de cette situation et nous voulons en tirer des enseignements quant aux mesures à prendre.
Vous savez que nos moyens sont limités dans le cadre de l'unité de protection civile. Son personnel et son budget sont modestes. Voilà pourquoi nous avons discuté du développement de nos activités de protection civile. Il s'agit d'étudier comment faire. Pour l'instant, nous sommes disposés à contribuer à l'examen de l'impact sur l'environnement et, dès que l'observatoire chargé de rédiger des propositions concrètes aura rendu ses conclusions, nous serons disposés à allouer 300 000 euros.
Très tôt après ma prise de fonction de commissaire, j'ai assisté à une première réunion du Conseil au cours de laquelle fut débattue une proposition visant à lutter contre la pollution marine, tant volontaire qu'accidentelle. Il s'agirait de coordonner les efforts et de s'informer les uns et les autres pour savoir comment venir en aide en cas d'accidents de ce genre. A présent, nous en sommes à la première lecture au Parlement européen ; la seconde lecture aura lieu dans un avenir très proche. J'espère qu'il n'y aura pas de retard puisque nous savons déjà à quel point un tel dispositif serait utile.
Premier volet : le développement de nos activités de protection civile. Deuxième volet : cette proposition en matière de pollution marine. Troisième volet : le domaine relevant de Mme Loyola de Palacio, que vous allez rencontrer, je crois. Elle est responsable du transport maritime et des propositions en matière sécurité dans ce domaine. Quatrième volet : notre proposition sur la responsabilité en matière d'environnement. Nous avons déjà présenté un livre blanc à ce propos. C'est un volet très important de notre politique en la matière.
Tout ce travail est essentiel afin de renforcer les efforts que nous déployons déjà. Il nous faut davantage de succès en ce domaine pour éviter l'impact de ces accidents ainsi que des déversements volontaires.
Nous vivons à une époque où les satellites sont capables de traquer les mouvements d'un individu, mais nous sommes confrontés à des centaines de déversements illicites ce genre. Nous devons donc redoubler d'efforts pour nous montrer plus efficaces. C'est votre souhait également.
Je suis tout à fait disposée à vous fournir les informations dont vous aurez besoin pour le travail de votre commission d'enquête.
M. le Rapporteur : Mme la commissaire, merci de nous recevoir. Je voulais vous interroger sur quelques points.
D'abord, le livre blanc que vous avez mentionné sur la responsabilité environnementale se traduira-t-il par des conséquences directes ayant rapport avec la pollution maritime ? Comment voyez-vous l'application du livre blanc dans le domaine de la pollution maritime quant à la responsabilisation ?
Notre deuxième préoccupation est la coordination indispensable des Etats maritimes en matière de prévention. Certains sont favorables à des garde-côtes, d'autres pensent qu'il faut organiser les moyens de prévention et de police au sein d'une agence européenne spécialisée. Votre direction a-t-elle déjà réfléchi à ce sujet ou relève-t-il uniquement de la responsabilité de Mme de Palacio ?
Mme Margot WALLSTRÖM : Dès l'accident de l'Erika, nous nous sommes penchés sur la question de la responsabilité environnementale. En fait, un choix se présente : soit on choisit les possibilités fournies par les conventions internationales, soit on choisit d'agir par le biais des procédures qui ont trait à la responsabilité environnementale. Il s'agit donc de coordonner les procédures nationales et internationales en ce domaine. Je réponds donc oui, ces procédures pourraient s'appliquer à ce cas.
De plus, Mme de Palacio présentera prochainement une communication qui abordera, entre autres, la question que vous avez soulevée.
M. le Rapporteur : Le livre blanc sur la responsabilité environnementale se traduit-il dès à présent par certaines réglementations opératoires ?
Mme Margot WALLSTRÖM : Non. Différentes solutions sont possibles. Il conviendra d'en discuter avec les Etats membres et les autres parties prenantes pour voir ce qui s'applique dans le cas donné. On peut choisir les voies offertes par le livre blanc ou les conventions internationales. On choisit l'un ou l'autre : cela dépend des conditions, cela dépend du domaine.
Je donne un exemple : les dégâts envers la « biodiversité » . Il existe là un lien avec les sites Natura 2000 ; si un tel site est concerné, on opte pour la voie du livre blanc ; dans le cas contraire, ce serait la voie des conventions internationales. Mais je pourrai en dire plus en août.
M. le Rapporteur : A quoi seront affectés les 300 000 euros dont vous avez parlé ?
Mme Margot WALLSTRÖM : Les 300 000 euros financeraient une étude sur l'impact environnemental, comme cela a déjà été le cas lors d'autres sinistres. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous mettre en rapport avec notre unité protection civile.
Je vous donne l'exemple des oiseaux. Il est important de bien comprendre ce qui s'est passé pour être mieux préparé la prochaine fois et aborder dans de meilleures conditions leur réintroduction. Voilà pourquoi nous nous intéressons à l'impact sur l'environnement.
M. François GOULARD : La Commission s'intéresse-t-elle à la nature des produits transportés par voie maritime ? Estime-t-elle que des progrès doivent être accomplis pour la connaissance de ces produits, ce qui pourrait entraîner des normes de contrôle sortant peut-être du strict domaine de l'environnement, mais intéressantes pour la connaissance précise des produits transportés par les bateaux qui naviguent dans les eaux européennes ? Avez-vous des réflexions à ce propos ?
Mme Margot WALLSTRÖM : Mme de Palacio se penche sur cet aspect. Il convient d'améliorer le système de contrôle et d'information pour que nous sachions avec précision ce qui est transporté. J'en suis informée grâce aux consultations inter-services.
M. le Président : En matière de responsabilité, un débat a lieu en France entre l'armateur, l'affréteur, les Etats ; y a-t-il une réflexion à votre niveau concernant les diverses responsabilités et leur partage ? Pour ce qui nous concerne, ce serait un partage entre Total Fina, l'armateur de l'Erika, le pavillon de l'Erika, la société de classification. Avez-vous poussé cette réflexion?
Mme Margot WALLSTRÖM : Nous arrivons en plein c_ur du sujet et c'est très compliqué s'agissant de transport maritime. Il faut étudier la législation en vigueur et l'interpréter. Sur la base de notre texte sur la responsabilité environnementale, il sera nécessaire de bien cerner cette question. Dans quelle mesure peut-on faire partager la responsabilité et, de manière précise, déterminer le responsable ? Sans être experte en ce domaine, je crois savoir qu'il existe des conventions internationales qui régissent déjà ce genre de question.
M. François GOULARD : Êtes-vous favorable, sur un plan très général, au principe « pollueur-payeur » ?
Mme Margot WALLSTRÖM : Certainement.
M. le Président : Cela ne représente-t-il pas alors une sorte de permis de polluer ? En quelque sorte : « Je pollue mais je paierai les dégâts, parce que j'ai les moyens. »
M. le Rapporteur : Le FIPOL actuel est un système de mutualisation des risques supportés par l'ensemble des compagnies pétrolières. On paie la même somme pour une catastrophe quelle qu'elle soit, et quel qu'en soit l'auteur ; que le bateau soit vieux ou neuf, c'est le même prix. C'est une espèce d'assurance pour polluer.
M. le Président : Je complète, si vous le permettez. Je crois savoir qu'en même temps, pour ne pas faire porter complètement les choses sur Total, d'ores et déjà, l'armateur a fait jouer ses droits à l'assurance et s'est fait rembourser les 80 millions de francs que valait le navire.
Mme Margot WALLSTRÖM : Je comprends votre point de vue. Vous avez raison : le risque est que le pollueur se dise que, puisqu'il paie, il peut faire n'importe quoi. Cela dépend aussi de la somme à payer.
N'oublions pas non plus le rôle des compagnies d'assurances ; elles obligeront les sociétés pétrolières à prendre les mesures qui s'imposent. Pensez à ce qui se passe dans l'industrie automobile. Les compagnies pourraient imposer des doubles coques. Voilà comment les choses se passent dans une économie de marché. Une incitation de ce type permettrait d'éviter des accidents dans l'avenir.
D'autre part, un accident de cette ampleur coûte très cher et produit un mauvais effet sur la réputation d'une compagnie pétrolière : elle perd de sa crédibilité. Ces grandes entreprises doivent aussi apprendre à être plus humbles et à mieux communiquer avec le public. Voyez ce qui s'est passé en Roumanie, lors de la récente pollution du Danube : la compagnie minière affirmait que les poissons étaient morts non pas à cause du cyanure mais parce qu'il y avait trop de glace et de neige, ou qu'ils s'étaient suicidés. Donc n'importe quoi !
Les gens sont furieux parce qu'ils sont bien informés et n'acceptent pas ce genre d'explication. C'est l'expérience qu'a subie Total Fina en France. Une réputation peut se perdre en une après-midi. Pensons à ce qui se passe aux Etats-Unis, pensons à des cas de travail des enfants. Les informations sont diffusées sur le Net et des sommes faramineuses sont perdues en l'espace de quelques heures. Les gens boycottent les sociétés en cause.
Voilà pourquoi il est donc très important de bien informer le public.
Audition de M. François LAMOUREUX,
directeur général de l'énergie et des transports,
et de Mme Georgette LALIS, directrice des transports maritimes,
à la Commission européenne
(extrait du procès-verbal de la séance du 13 mars 2000 à Bruxelles)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. François LAMOUREUX : Nos services préparent un projet de communication qui, à l'heure actuelle, est en consultation interservice à l'intérieur de la Commission ; il est donc semi-public. Pour vous faciliter les choses, je vous remettrai le projet de communication en son état actuel de consultation. Certaines modifications apparaîtront sans doute sur divers points lorsque la Commission adoptera la communication définitive : elle comporte plusieurs initiatives et diverses propositions juridiques assez précises. Nous en reparlerons.
La Commission devrait adopter cette communication et les propositions d'accompagnement dès le 22 mars. Une présentation en sera faite au Conseil des ministres des Transports le 28 mars, ainsi qu'une présentation aux commissions compétentes du Parlement européen, sans doute au début du mois d'avril, puisque les textes proposés seront adoptés selon la procédure de codécision.
Nous procédons en deux étapes. Compte tenu de l'urgence, nous faisons une première communication qui concerne essentiellement la sécurité des pétroliers ; c'est celle qui sera adoptée le 22 mars. Nous espérons que les textes qui l'accompagnent seront adoptés par le Conseil au moins au niveau de l'accord politique, sous présidence française. Ensuite, dans le courant du second semestre, une deuxième communication sera faite sur divers points que nous n'avons pas encore pu étudier suffisamment en détail. Elle sera assortie de certaines propositions. Cette communication sera présentée suffisamment tôt pour susciter un deuxième débat sous présidence française, lors d'un Conseil des ministres des Transports.
Je vous présente succinctement ce qui est actuellement sur la table et ce qui constituera probablement le second volet, ultérieur, des propositions de la Commission, afin de clarifier le débat.
La première communication part d'un constat : 70 % du pétrole entrant en Communauté est transporté par des pétroliers qui transitent au large des côtes de la Bretagne et de la Manche. En cas d'accident, ce sont ces régions qui pâtissent essentiellement des catastrophes pour des raisons liées à des phénomènes de vents et de courants. Une directive européenne ne peut pas modifier la direction du vent : ces régions resteront plus soumises que d'autres aux conséquences des sinistres. Il reste 30 % du pétrole qui transite par la façade méditerranéenne. Cela dit, la communication précise bien que les conséquences d'une catastrophe du type Erika en Méditerranée seraient beaucoup plus importantes.
Dans la communication, nous rappelons qu'à chaque catastrophe, les Etats membres se tournent vers la Commission. Lors du naufrage de l'Amoco Cadiz, c'est le Conseil européen lui-même qui, en 1978, avait demandé à la Commission une série de propositions, d'ailleurs finalement intégrées dans la législation communautaire. D'expérience, nous avons cependant pu constater un certain décalage entre nos propositions et les textes adoptés par le Conseil.
Un exemple : en 1978, des textes assez ambitieux se sont traduits en définitive par des résolutions du Conseil sans aucun texte contraignant. Il a fallu attendre le milieu des années 90 et d'autres catastrophes pour voir adoptés les premiers textes.
Ce phénomène s'explique pour deux raisons. D'abord, un débat n'a toujours pas été tranché : un certain nombre d'Etats membres n'ont pas fait leur choix entre une action communautaire, régionale, du type américain, et une action générale à travers l'Organisation maritime internationale (OMI). Aussi, lorsque la Commission avait émis ses premières propositions, les Etats membres avaient finalement décidé de laisser agir l'OMI.
Nous considérons pour notre part au contraire que l'OMI est une institution respectable, qui produit de belles normes, mais que le problème réside dans leur application. Or, l'OMI est dépourvu de tout moyen de les appliquer. En outre, pour des raisons de géographie et de concentration du trafic, que j'ai évoquées tout à l'heure, rien n'interdit qu'une région du monde, en l'espèce l'Union européenne, puisse aller plus loin. C'est un vrai débat et, parmi les différents Mémorandums, dont celui élaboré par la France, cette question n'est pas complètement tranchée : on joue sur les deux tableaux.
La deuxième raison pour laquelle, dans le passé, les propositions de la Commission ont eu du mal à être adoptées, dans un premier temps, ou l'ont été avec une portée moins importante que désirée, c'est que l'unanimité était de rigueur. A présent, ce type de proposition devrait pouvoir être adopté à la majorité qualifiée.
Nous rappelons tout cela en termes très diplomatiques, de même que nous rappelons la réglementation internationale existante et l'acquis communautaire. En outre, nous expliquons pourquoi nous procédons en deux temps par rapport à tout cela.
Dans un premier temps, nous souhaitons faire des propositions de trois ordres. Tout d'abord, renforcer la directive existante concernant les contrôles par les ports de l'Union européenne, afin de déployer une sévérité accrue pour les navires inférieurs aux normes. Ensuite, bannir de tous les ports de l'Union les navires de plus de quinze ans d'âge qui ont été immobilisés plus de deux fois au cours des deux années précédentes et figurant sur une liste noire que publierait la Commission. Cette liste serait alimentée par une série de données, figurant notamment dans EQUASIS.
Par ailleurs, les contrôles sur les pétroliers seront renforcés en fonction de leur âge et devront porter systématiquement sur les citernes à ballast. Nous prévoyons aussi que les navires soient obligés d'envoyer, préalablement à leur arrivée dans un port, une série d'informations pour que les inspecteurs puissent mieux préparer leur contrôle. Nous recommandons enfin aux Etats membres un effort de recrutement et une formation accrue des inspecteurs. L'harmonisation des contrôles devrait éviter la création de ports de complaisance.
J'attire votre attention sur l'inégalité des contrôles opérés à l'intérieur de la Communauté, État membre par État membre. C'est assez intéressant, notamment pour une commission d'enquête comme la vôtre.
Deuxième proposition : elle vise les contrôles exercés par les sociétés de classification auxquelles les Etats membres ont délégué leur pouvoir de vérification. Nous suggérons en outre une série d'améliorations concernant la qualité de ces contrôles, telle la mise en place d'une procédure communautaire afin de suspendre l'agrément accordé à certaines sociétés de qualification, voire de retirer cet agrément. Nous suggérons aussi que leurs responsabilités soient pleinement engagées en cas de négligence.
Troisième proposition : elle offre de généraliser l'interdiction des pétroliers à simple coque en fonction d'un calendrier un peu plus rigoureux que celui des Etats-Unis, avec trois dates en fonction de la taille des pétroliers : 2005, 2010 et 2015.
Ces propositions forment un tout cohérent. A la lecture du document, vous remarquerez une « cross fertilization » entre les informations dont disposent les sociétés de classification et les résultats des contrôles par les autorités des ports, de sorte que, même avec des contrôles profondément différents pour une société de classification - chargée de mettre un bateau en cale sèche et d'en inspecter la structure - et pour l'inspection au titre de l'Etat du port, chacun puisse disposer des résultats et données les plus récents.
Seconde étape : qu'envisageons-nous de faire ? D'abord, systématiser les échanges d'informations entre tous les acteurs du secteur maritime - ce n'est pas toujours évident - en renforçant le système Equasis. Nous voudrions que les armateurs, les assureurs, les sociétés de classification soient prêts à un maximum de transparence. Tout le monde pouvant interroger les banques de données, les responsabilités seront plus claires en cas d'affrètement douteux ou sous normes.
Nous envisageons l'amélioration de la surveillance de la navigation maritime, en particulier dans les zones les plus fréquentées par les pétroliers. En 1993, nous avions proposé une directive prévoyant que les bateaux transportant des produits dangereux ou polluants devaient se déclarer.
Ce texte qui n'a pas été adopté est une illustration de ce que je disais au début : les Etats ont invoqué la question de la souveraineté nationale s'agissant des contrôles dans les eaux territoriales ; ce texte est donc bloqué. Nous désirons le relancer pour obtenir une véritable obligation d'information et pour développer la surveillance de la navigation maritime des bateaux les plus dangereux grâce à une coopération accrue entre les États membres. Nous ne sommes pas demandeurs de compétence communautaire. L'arsenal de mesures de la première communication (en cas d'adoption) devrait permettre d'empêcher les navires dangereux de relâcher dans les ports de la Communauté. Ainsi, nous aurions la garantie que l'Union ne dispose d'aucun port de complaisance.
S'agissant de la mise en place d'une agence européenne de sécurité maritime, beaucoup de choses ont été dites, écrites et proposées à ce sujet. Je ne peux pas préjuger de la future décision de la Commission, mais nous ne sommes pas très favorables à des garde-côtes européens : ce serait placer la charrue avant les b_ufs. Aux Etats-Unis, ces garde-côtes exercent des compétences extrêmement variées : de la lutte contre la drogue - activité qui constitue leur principale source de financement et dans laquelle ils font preuve d'une extrême efficacité - au contrôle en matière de pêches, en matière de navires, aux missions de protection civile, illustrées par les feuilletons télévisés...
Sur le plan communautaire, les compétences n'ayant pas été véritablement transférées, il ne sert à rien de créer maintenant des garde-côtes européens. En revanche, nous sommes plus favorables à la création d'une agence de contrôle des contrôleurs ou d'inspection des inspecteurs, de surveillance de leur efficacité, d'assistance sur le plan technique dans nombre de cas délicats. Nous n'ignorons pas les responsabilités énormes confiées aux inspecteurs et les pressions qu'ils subissent quand il s'agit d'immobiliser un bateau. Nous tenons à assurer une plus grande uniformisation. Il s'agirait donc d'une structure plutôt légère. Si les compétences se développent dans les autres domaines, cette agence de sécurité maritime pourrait devenir un jour un corps de garde-côtes européen.
Enfin, le point le plus délicat concerne le développement de la responsabilité des divers acteurs du transport maritime du pétrole. Le régime de responsabilité est jusqu'à présent gouverné par des conventions internationales, ce qui n'est d'ailleurs pas spécifique au transport maritime puisque le même constat peut être fait à propos du transport aérien. La responsabilité du transporteur est limitée. Il existe une responsabilité collective dans le cadre du FIPOL, mais limitée également.
Nous voudrions nous engager dans une triple direction : d'abord, concernant le transporteur, s'inspirer des Américains et décider que le transporteur donne des garanties de paiement en cas de dommages. Ensuite, que le FIPOL augmente son plafond, ce qui n'est pas facile vu que le FIPOL est une convention internationale engageant de nombreuses nations, toutes n'étant pas européennes. Enfin, au-delà de ces mesures collectives d'indemnisation, nous voulons proposer qu'en cas de négligence grave, la responsabilité du propriétaire de la cargaison puisse être illimitée. Cela suppose que les Etats membres acceptent de se doter d'une législation le prévoyant et prévoyant des sanctions adéquates. En effet, sauf pour le cas de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, il n'existe pas de compétence de cette dernière en ce domaine.
C'est le deuxième paquet. Comme dans ce cas il n'y a pas d'acquis communautaire, même insuffisant, il faut tout mettre à plat, notamment les questions de responsabilité, avec cet imbroglio entre régimes nationaux et internationaux. Nous pourrions nous montrer intarissables sur la responsabilité des sociétés de classification, par exemple. Vous verrez à quel point notre texte est compliqué, car les Etats membres ne sont pas d'accord sur le régime de responsabilité des sociétés de classification. L'un évoque le droit romain, l'autre des coutumes maritimes remontant à Grotius. C'est compliqué. Le deuxième paquet implique donc davantage de temps de notre part.
Mais la présente communication rappellera aussi la nécessité pour les Etats membres d'agir plus vivement sur le plan international, au sein de l'OMI. S'agissant des négociations d'adhésion, nous souhaitons que le négociateur puisse s'appuyer sur une position commune des Quinze, pour que Chypre et Malte appliquent, avant même leur adhésion, l'acquis communautaire existant, mais aussi les dispositions que nous proposons d'adopter.
Sans attendre le deuxième paquet, nous souhaitons discuter avec les compagnies pétrolières afin qu'elles s'engagent, par anticipation sur nos propositions, à ne plus affréter de tankers de plus de quinze ans d'âge et à prendre certaines mesures pour améliorer immédiatement la sécurité.
Dès la présentation du premier paquet au Conseil des ministres des Transports du 28 mars, en fonction de l'accueil réservé à nos propositions, nous engagerons des discussions pour obtenir cet accord avec les compagnies pétrolières. A défaut d'accord, dans la deuxième communication, nous proposerions des directives beaucoup plus contraignantes.
Voilà rapidement résumés ce que nous mettons au point, l'articulation entre les deux paquets et le souhait d'un accord rapide et basé sur le volontariat pour l'application des premières mesures.
M. le Rapporteur : Merci pour toutes ces informations. A propos de la possibilité de l'adoption de ces orientations par le Conseil des ministres des Transports de la fin mars ou du second paquet dans un deuxième temps, le sentiment de la Commission est-il que ces mesures, assez audacieuses par rapport au dispositif en vigueur, ont des chances d'aboutir du fait de l'émotion suscitée par l'Erika, ou bien est-ce que la bataille sera terrible ?
M. François LAMOUREUX : Sur le plan psychologique, l'affaire de l'Erika est malgré tout très franco-française. Au même moment, une pollution importante s'est produite sur les côtes turques sans être autant médiatisée. Nous avons du mal à expliquer - je le dis au nom de la Commission - ce que je disais depuis le début : en définitive, deux ou trois régions françaises font toujours les frais d'une navigation intense qui bénéficie à l'ensemble de l'Union européenne. Des consommateurs des autres pays de la Communauté paient moins cher leur essence parce que nous sommes plus laxistes dans les transports. Or, on sait que certains endroits présentent plus de risques que d'autres. L'effet Erika a son importance en France, mais est très relatif dans les autres pays.
Nos propositions sont élaborées pour obtenir une majorité qualifiée. C'est le rôle de la Commission : il ne sert à rien de prêcher dans le désert. La proposition des garde-côtes européens n'aurait été acceptée par aucun État.
Pour nous, le principal risque est celui que j'indiquais dès le début de l'entretien, à savoir que les Etats membres nous disent : « Vous allez dans le bon sens, mais plutôt que de faire des actions communautaires sur une base régionale, allez à l'OMI ». Sur ce plan, nous ne sommes pas très optimistes, bien que nous pensons que nos propositions tiennent la route.
Si Mme de Palacio ne peut pas vous recevoir aujourd'hui, c'est parce qu'elle est en négociation intense avec les Américains sur le problème des hush kits. Or, il s'agit d'une problématique un peu similaire à celle des transports maritimes : après un certain temps, les Etats membres préfèrent un bon compromis à l'OACI plutôt qu'une mesure rigoureuse au niveau communautaire. Là, ils avaient pris cette mesure : dès le 4 mai, les avions hush kits ne peuvent plus se poser en Europe. Alors que la deadline se profile, ils proposent de chercher un compromis avec les Américains, de ne pas faire preuve d'autant d'intransigeance, de proroger d'un an ou deux...
Pour essayer de répondre clairement à cette question, politiquement, il faut que l'Union européenne sache ce qu'elle veut : faire référence à l'OMI, s'accorder tous pour que l'OMI aille plus loin, c'est très bien. Mais, simultanément, il convient de prendre énergiquement, par anticipation, des mesures communautaires qui peuvent, elles, être contrôlées.
L'avantage de l'Union européenne par rapport à l'OMI, c'est qu'il existe des procédures d'infraction, une Cour de justice et même, si des arrêts ne sont pas appliqués, des possibilités de sanction. C'est ce que tout le monde maritime craint en définitive. Le débat est simple : ils sont tous pour des normes ambitieuses mais craignent que la Commission publie une liste noire de bateaux sous-normes, qu'elle cite les Etats qui ne respectent pas les règles et les assigne devant la Cour de justice. Le Luxembourg, par exemple, détient une flotte importante puisque toute la flotte belge est essentiellement placée sous pavillon luxembourgeois.
Nous vivons dans un monde qui dispose de belles règles non sanctionnées.
M. le Rapporteur : La Commission estime donc qu'il n'est pas besoin de rajouter des règles à l'OMI, car le corpus de normes est suffisant, et qu'il est inutile de s'engager dans une procédure longue et compliquée ? Au fond, il vaut mieux bien appliquer les règles actuelles ?
M. François LAMOUREUX : Nous complétons les normes en vigueur sur certains points, en matière de contrôle notamment.
M. le Président : Ne pensez-vous pas que les pays les plus exposés, comme le Portugal, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne - j'exclus le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche qui ne sont pas menacés - les Etats du port donc - avec Rotterdam, Anvers, Le Havre, Dunkerque, Marseille, Hambourg - devraient prendre une position commune, un accord régional imposable en matière d'accès à leurs ports ?
Quelle compagnie de navigation peut se passer de Rotterdam ou d'autres grands ports ? Quel Etat du pavillon peut se passer de l'accès à ces ports ? Ne peut-il se conclure, à l'image de l'accord de Bonn en janvier 1994, un accord régional Manche-Mer du nord, allant plus loin et évitant le recours à l'OMI ?
M. François LAMOUREUX : La mesure n'a de sens que communautaire. Vous citez des pays, mais il y en a d'autres : la Grèce est une puissance maritime plus importante que la France. La solution doit être communautaire : il faut uniformiser les contrôles dans tous les ports sous peine de voir se développer des ports de complaisance. Des accords régionaux ont déjà été tentés : le Mémorandum de Paris va même au-delà de l'Union européenne. Mais en bouclant un accord régional, on retombe sur le même problème : quelle est la garantie de contrôle efficace ? C'est pourquoi il faut la base du droit communautaire pour avoir des contrôles véritablement efficaces.
Sur les possibilités d'un accord, il faut savoir que la présidence française va jouer un rôle décisif, et ce d'autant plus que la France a été frappée de plein fouet par cette affaire. Dès janvier, l'Allemagne a demandé d'inscrire ce dossier au Conseil Affaires générales. Nous pensons aussi que sa dimension est telle qu'il ne doit pas rester uniquement une affaire des ministres des Transports. Je souhaite que la France le mette à l'ordre du jour des Affaires générales et du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Les ministres de l'Environnement peuvent aussi avoir leur mot à dire.
Le plus grand risque est d'édulcorer les propositions, par exemple de ne pas interdire les navires à coque simple en 2015 mais en 2020. Cela dit, nous pensons qu'il faut aussi tenir compte du Parlement européen. S'il est vraisemblable que certains pays trouveront ce paquet trop ambitieux et se seraient contentés de réformes demandées à l'OMI, la matière reste soumise à la codécision et le Parlement européen trouvera sans doute nos propositions trop peu ambitieuses, de sorte qu'il en rajoutera. Le rôle de la Commission se situe entre le Conseil et le Parlement, dans le cas de la procédure de codécision, pour arriver à une position intermédiaire.
Mme Georgette LALIS : Des trois propositions sur la table, celles qui modifient les dispositions communautaires existantes passeront la première étape du Conseil et subiront peut-être à ce stade une certaine édulcoration. Mais, au Parlement, les choses vont se rééquilibrer, surtout en ce qui concerne les sociétés de classification.
La troisième proposition est certainement la plus délicate : elle concerne les coques simples et les coques doubles. A ce sujet, beaucoup d'objections ont été formulées mais certaines sont des objections de fond et d'autres de principe. Presque tous les Etats membres sont habitués au fait que le monde maritime soit géré de façon intergouvernementale. C'est ce qui se passe à l'OMI : les administrations maritimes des Etats membres ont beaucoup de réticence à accepter que la Commission ait son mot à dire en matière de sécurité maritime.
D'autres Etats membres ont des problèmes de fond : ils possèdent des flottes, des officiers, des marins, des armateurs. Tous ces gens perdront de l'argent du fait de nos propositions, mais cette situation ne concerne pas une majorité d'Etats membres.
Cela dit, sur la question de principe portant sur le niveau de décision, intergouvernemental ou communautaire, certains Etats membres ne reconnaissent actuellement pas que Bruxelles ait son mot à dire en matière de législation sur la sécurité maritime. Depuis 1993, nous nous battons contre cette exclusion des instances communautaires, sur laquelle reposait, d'une certaine manière, le Mémorandum de Paris.
M. François LAMOUREUX : Avec des taux de contrôles par les Russes assez étonnants ! Vous verrez en lisant le tableau. A quoi cela sert-il de persévérer dans cette voie ?
Ici, les mêmes personnes s'occupent de la sécurité maritime des pétroliers et de la sécurité maritime des ferries. Notre réglementation communautaire en matière de sécurité maritime des transports de passagers, relativement protectrice, est née de l'affaire de l'Estonia. A chaque fois , il faut des catastrophes et c'est la même bataille pour avancer. Dans ce dernier cas, il nous avait déjà été expliqué qu'il valait mieux recourir à des accords régionaux ou à des règles internationales.
Une proposition de la Commission visant à modifier des normes communautaires déjà en vigueur va être soumise au Conseil et au Parlement. Nous ne sommes pas hostiles à ce que ce texte soit amendé sur tel ou tel point, mais le problème est de conserver un minimum en dessous duquel nos propositions ne doivent pas être édulcorées. Si leur « ligne de flottaison » n'était pas respectée, si nos propositions étaient dénaturées, il est possible que la Commission les retire plutôt que d'arriver à un mauvais compromis. Nous constaterions alors publiquement que les Etats membres préfèrent passer par l'OMI.
Nous ne souhaitons pas ce résultat parce qu'il y a quand même une véritable prise de conscience. En fait, même si l'Erika a surtout une résonance française (je laisse de côté la qualité du produit transporté), même si le nombre d'accidents de ce type a diminué, l'opinion publique ne tolère plus ce genre de choses. C'est l'élément nouveau et important. Mais certains pays diront que, depuis la catastrophe de l'Erika, le prix du pétrole a augmenté et qu'il s'agit de ne pas encore pénaliser leurs entreprises.
M. Louis GUEDON : Vous nous avez fait part d'une communication qui sera soumise à la fin du mois et qui présente un intérêt certain en clarifiant certains éléments, en codifiant d'autres, en réglementant, en mettant quelque rigueur dans la gestion des transports maritimes.
Vous avez dit avec raison que, dans cette affaire, il y a les Etats, les armateurs, les affréteurs, les sociétés de classification. Vous avez fort bien expliqué que le danger, c'est le non-respect de ces textes sous prétexte que le pétrole coûte très cher et qu'il ne faut pas augmenter son prix de transport. Pourtant l'expérience indique qu'une amélioration de la sécurité n'occasionnera qu'une faible augmentation du prix du litre à la pompe. Au début de votre intervention, vous avez aussi dit que 70 % du pétrole entrant dans la Communauté mettent en danger les populations de la Bretagne et des pays de la Loire. Ces populations, auxquelles nous appartenons, n'accepteront plus que, par appât du gain, des sociétés aux bénéfices très importants continuent à mettre définitivement en péril l'économie de régions entières, qui vivent de la mer et qui ne survivront plus avec une mer polluée.
Je vous pose la question : si certains pays ne souhaitaient pas souscrire à la proposition, pour des raisons financières, d'appât du gain, en invoquant des frais trop importants, la Communauté aurait-elle la possibilité de les sanctionner en les traduisant devant la Cour de justice des communautés européennes ?
M. François LAMOUREUX : Non. L'avantage en termes d'application est que, si les normes de l'OMI sont reprises dans des textes communautaires, lorsqu'un Etat ne les applique pas en n'effectuant pas les contrôles, par exemple, ou en n'interdisant pas l'entrée de ses ports, nous pouvons le poursuivre devant la Cour de justice des communautés européennes.
M. Louis GUEDON : C'est un point très important pour nous et il faut le clarifier au maximum. Vous venez de nous développer une série de directives qui, de mon point de vue, paraissent très intéressantes. Vous introduisez une rigueur là où il en manque encore. Que ce soit à travers l'OMI ou à travers ces directives, l'important et l'intérêt à nos yeux est la mise en application.
Je vous ai cité tout à l'heure les intervenants dans la chaîne du transport pétrolier ou des produits dangereux. En cas de résistance de l'un ou l'autre intervenant ou en cas de non application, dès lors que votre document est adopté, le moyen de répression serait de traduire le contrevenant devant la Cour européenne ?
M. François LAMOUREUX : J'ai peut-être été très vite et vous n'avez pas tout à fait tort de l'interpréter ainsi. Plusieurs contrevenants sont possibles. Dans le premier texte, il s'agit pour les Etats membres de développer des contrôles à travers leurs administrations maritimes et leurs inspecteurs dans les ports. S'ils ne le font pas, si l'on constate qu'un port n'a pas ciblé les contrôles comme l'exige la Commission, c'est alors l'Etat qui est contrevenant et qui est renvoyé devant la Cour de justice.
La deuxième directive concerne les sociétés de classification : elles-mêmes sont alors contrevenantes. Nous proposons de retirer ou de suspendre leur agrément à titre de sanction.
M. le Président : Et s'il s'agit d'une société de classification qui n'est pas située en Europe ?
M. François LAMOUREUX : Tout dépend si elle est reconnue par la Communauté, si elle a obtenu son agrément.
Dans le troisième texte, il est question des pétroliers à simple ou double coque. On retombe dans le premier cas de figure : un État ne doit pas laisser ses autorités accepter que ces navires à simple coque, qui seront progressivement interdits, relâchent dans ses ports ou que des compagnies qui sont soumises à sa juridiction, pour du trafic évidemment communautaire, se dotent de ce genre de navire.
M. Louis GUEDON : Et l'armateur qui accepte, pour des questions financières, de faire transporter des produits dangereux dans n'importe quelles conditions ?
M. François LAMOUREUX : Celui-là ne peut pas relâcher dans les ports de la Communauté ; c'est clair. On retombe dans le premier cas de figure : il appartient à l'Etat du port de le lui interdire. Monsieur le député, de toute façon, il peut s'agir d'une société pétrolière d'origine européenne, basée aux Bahamas, dont les navires naviguent en haute mer. L'affaire de l'Erika est assez révélatrice : cela se passe en haute mer, avec une société basée aux Bermudes, avec un nom français : Total Fina International. La façon d'appréhender et de sanctionner ensuite, c'est de prendre les acteurs les uns après les autres et, en premier lieu, les Etats qui ont une responsabilité certaine.
M. Louis GUEDON : Eux relèvent de la Cour de justice européenne. Les sociétés de classification ne risquent que le retrait de leur agrément, les armateurs relèvent de la loi des Etats, mais les affréteurs, de quel régime relèvent-ils ?
M. François LAMOUREUX : Il s'agit de notre deuxième paquet : l'affréteur relève d'un régime de responsabilité de l'Etat, mais dont nous voulons poser les principes sur le plan communautaire, à travers une directive. Je pourrais écrire celle-ci assez vite, mais des problèmes juridiques complexes surgissent un peu partout, même chez nous. La directive peut être assez simple : au-delà de l'indemnisation collective dans le cadre du FIPOL, s'il est démontré qu'un affréteur a commis une négligence, dont le degré reste à déterminer, sa responsabilité doit être mise en cause devant les tribunaux de l'Etat dont il relève. Chaque Etat membre doit se doter d'une législation à cette fin et de sanctions permettant l'indemnisation du dommage.
Ces compagnies objectent qu'elles contribuent déjà au FIPOL ; en fait, c'est nous tous qui contribuons au FIPOL. Le gros problème vient des compagnies pétrolières qui ne veulent pas voir poser le principe de leur responsabilité illimitée.
M. Louis GUEDON : J'en reviens à la fin de ma question : parmi ce panel de responsabilités, les Etats relèvent de la Cour de justice des communautés européennes. Il y a 15 Etats dans l'Union européenne ; l'un est condamné, mais il ne respecte pas les décisions de la Cour européenne. Quels sont les moyens à disposition de l'Europe pour faire respecter un jugement rendu par la Cour ?
M. François LAMOUREUX : La Commission revient devant la Cour de justice et le Traité prévoit maintenant des sanctions financières, parfois conséquentes. La France subit d'ailleurs actuellement une procédure de ce type à propos du non-respect de la directive sur la protection des oiseaux migrateurs.
Le contrôle par la Cour de justice des communautés européennes a aussi de l'importance en matière de responsabilité politique. Dès que nous aurons une condamnation d'un Etat membre parce que, de notoriété publique et constatée par un jugement, il n'effectue pas les contrôles nécessaires dans les ports, nous disposerons d'une arme politique. S'il s'entête, le Traité a prévu des sanctions financières. Mais c'est davantage la condamnation par la Cour elle-même qui est importante.
M. le Rapporteur : Un point technique : la première communication se traduira par des directives. Le deuxième paquet aussi ?
M. François LAMOUREUX : Je ne peux pas préjuger exactement de la forme juridique qui sera retenue pour les quatre points que j'ai énumérés mais, si l'on se dirige vers une agence de contrôle des contrôleurs ou d'inspection des inspecteurs, ce sera un règlement, probablement basé sur l'article 235 du Traité. S'agissant de la question de la responsabilité des affréteurs, il peut s'agir d'une directive. Enfin la surveillance de la navigation relève aussi d'une directive.
Sur les autres points, comme les échanges d'informations, tout dépendra de la bonne volonté des acteurs. Si certains ne veulent pas concourir à l'alimentation du système EQUASIS sur la base du volontariat, nous pourrions nous réserver la possibilité de rédiger une directive. Ce sera là extrêmement compliqué, car nous devrons tenir compte de la confidentialité et du secret des affaires ainsi que d'autres articles du Traité.
M. François GOULARD : Sur la question des doubles coques, avez-vous eu un débat interne ? Nous constatons en France que cette solution, d'un point de vue technique, est contestée. Elle est présentée comme ayant des inconvénients et n'étant pas une garantie absolue dans certaines circonstances. Il est vrai aussi que, les Etats-Unis ayant pris les devants, il est assez difficile de retenir d'autres formules techniques. Chez vous, ce point a-t-il été admis facilement ou a-t-il fait l'objet d'un débat et d'une réflexion ?
M. François LAMOUREUX : Au sein des services de la Commission et au sein de cette direction générale, ce point a fait l'objet de très amples débats.
Georgette Lalis a suivi l'affaire bien plus que moi. En fait, il y avait un problème politique : lorsque les règles américaines seront définitivement en vigueur, les bateaux interdits là-bas viendront inévitablement chez nous. Le deuxième problème découle d'une notion juridique peu française mais très importante sur le plan du droit communautaire : la confiance légitime. Les Américains ont annoncé leurs mesures il y a dix ans. Les gens se sont donc préparés. Nous, nous leur donnons dix ans de moins pour se préparer. De bonne foi, quelqu'un qui vient de commander un tanker peut marquer son mécontentement : il lui faut vingt ans pour l'amortir. Nous ferons face à de tels cas.
Le troisième problème a été largement débattu, Georgette Lalis y reviendra : à qui cela profitera-t-il en termes industriels ? Même si l'on impose la double coque, même si la sécurité que peut représenter une double coque est contestée, la plupart des accidents sont dus à des erreurs humaines : double coque ou pas, rien n'aurait changé pour l'Amoco Cadiz. Double coque ou pas, cela reste une construction navale relativement simple. Pas comme le futur Queen Mary II, qui sera construit à Saint- Nazaire. C'est sans doute surtout du travail pour des chantiers navals coréens, ou pakistanais maintenant ; les Japonais sont, quant à eux, de moins en moins présents dans ce secteur.
Nous avons donc eu un débat interne. De même que nous ne pouvons pas - je le dis objectivement - garantir qu'avec cette disposition, nos armateurs, nos affréteurs disposeront dans les temps d'un parc de bateaux suffisant répondant aux nouvelles normes de construction.
Nous avions des débats techniques, des débats juridiques et - je reviens à mon premier point - un vrai problème politique : en ne prenant pas une telle mesure, le risque était énorme que ces bateaux bannis des Etats-Unis viennent chez nous.
Parmi nos propositions, c'est celle qui est d'ores et déjà la plus contestée. Nous avons consulté l'industrie, réuni des groupes d'experts des Etats membres. Là-dessus, nous savons que nous aurons une double difficulté : le Parlement européen nous dira que ce n'est pas suffisant, certains Etats membres nous parlent déjà de 2008, mais nous ne savons d'où sort cette date. A cela s'ajoute le problème industriel.
Mme Georgette LALIS : Je voulais répondre à la question technique que vous avez posée : en 1993, l'OMI a décidé que la double coque était le meilleur modèle pour éviter des risques de pollution en cas de collision ou d'échouage.
Là où la double coque est contestée, c'est dans le cas d'une explosion : il semble qu'elle présente plus de risques sur ce plan. Reste la question que l'industrie prend comme argument contre notre proposition : quid des problèmes de structure ? L'Erika concerne un problème de structure. La question reste ouverte. La corrosion est-elle la même pour un navire à double coque que pour un navire à simple coque ? Probablement pas.
M. François LAMOUREUX : De toute façon, les produits de l'Erika n'auraient pas explosé.
Mme Georgette LALIS : D'après les statistiques disponibles, on remarque que la grande majorité des accidents de pétroliers résultent de collisions et d'échouages. Il ne s'agit pas de problèmes de structure ou d'explosion. A l'époque, l'OMI avait décidé qu'il s'agissait du meilleur modèle.
Premièrement, nous n'avons pas voulu contredire l'OMI s'agissant d'une règle internationalement acceptée. Nous avons donc introduit la notion de modèle équivalent, de protection équivalente. Nous parlons de double coque ou d'équivalent. Parmi les équivalents, figure bien entendu la technique du pont intermédiaire. Nous avons donc laissé la porte ouverte pour une recherche industrielle vers un modèle équivalent.
M. François LAMOUREUX : Sur le plan technique, on navigue entre Charybde et Scylla. Soit le produit est dit blanc et présente un risque important d'explosion, donc un risque pour l'équipage, tout en ayant un impact moindre sur l'environnement. Soit le produit est noir et il ne présente ni risque d'explosion ni risque pour l'équipage, mais produit des effets plus dommageables pour l'environnement.
M. le Rapporteur : Cette prise de conscience d'une politique maritime commune, passant par l'élaboration de normes au niveau communautaire, va-t-elle jusqu'à mettre en _uvre une politique du pavillon ? Quand vous négocierez avec Malte ou Chypre, parlerez-vous aussi des pavillons ou vous limiterez-vous aux normes ?
Par ailleurs, le thème du label « pavillon européen » sur les pavillons nationaux, qu'ils soient bis ou autres, peut-il revenir à l'ordre du jour ?
M. François LAMOUREUX : Au stade de la communication, nous ne voulons pas surcharger le débat avec l'affaire du pavillon. Il existe de vieux projets d'un pavillon européen ; il sera très joli sur les bateaux, sans pour autant changer la réalité. Même avec un pavillon européen, qui pour des raisons fiscales et sociales, relève d'une décision à l'unanimité, vous ne pourrez pas empêcher des compagnies d'affréter des bateaux battant des pavillons de complaisance.
Quand on regarde les Etats disposant de pavillon dits de complaisance, contrairement à une idée répandue, la plupart disposent de bateaux parfaitement en règle vis-à-vis des normes, voire meilleurs que les nôtres, meilleurs que les pavillons européens. Mais vous avez bien entendu aussi des pavillons de complaisance qui ne respectent pas les normes. Il s'agit d'une question plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord.
Comme pour les garde-côtes, si l'on désire traiter à fond le problème des pavillons de complaisance, il faut se mettre d'accord pour une politique sociale sur le plan maritime avec tous les moyens qu'elle implique. Nous n'avons jamais contesté les aides en matière de formation de marins, etc. Il n'existe pas d'intervention du budget communautaire, mais nous encourageons en la matière vivement les Etats à le faire. Ils doivent avoir une approche commune en matière de fiscalité et de création de ces pavillons bis, ter, etc. Le pavillon européen doit devenir « la cerise sur le gâteau », bien uniformisée, des mesures sociales et fiscales.
Mme Georgette LALIS : Dans la directive sur les sociétés de classification, un article concerne les Etats de l'Union européenne en tant qu'Etats du pavillon. Il stipule qu'ils doivent appliquer toutes les normes internationales et avoir des autorités, des administrations maritimes propres en vue de contrôler leur flotte. C'est sur cet article que nous nous basons pour demander à Chypre et à Malte de se doter d'une administration maritime appropriée. Même sans pavillon européen, cet acquis communautaire embryonnaire existera donc. On modifie le texte d'un article d'une précédente directive pour créer cet acquis, qui nous servira de base de négociation.
Il y a aussi le cas de candidats à l'Union européenne qui, sans être des pavillons de complaisance à proprement parler, ont de très mauvais résultats en matière de sécurité : la Roumanie avec 60 % de détention, mais aussi la Turquie, la Pologne, l'Estonie... Ils ont tous de très mauvais pavillons, de petites flottes.
M. le Président : Le respect de cette nouvelle disposition est une condition pour retenir la candidature de ces Etats ?
M. François LAMOUREUX : Oui.
M. le Président : J'avais cru comprendre que, dans le cadre de la préadhésion, les cinq ou six premiers Etats étaient en avance par rapport aux autres pays candidats d'Europe centrale et orientale.
M. François LAMOUREUX : Ce n'est pas exact. M'étant occupé d'élargissement pendant quatre ans, je peux vous démontrer que la République tchèque est déjà derrière la Slovaquie et que cet écart continuera à s'accroître. Qu'il y en ait cinq d'un côté et cinq de l'autre ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui, ni sur le plan économique, ni sur le plan social.
Cela dit, pour répondre à votre question, lors des précédents élargissements, y compris celui de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, etc., on a demandé si le candidat était d'accord pour appliquer l'acquis communautaire et s'il désirait des périodes de transition. Des discussions s'en sont suivies : l'Espagne a demandé le plus long délai avec dix-sept ans et demi pour la pêche. Mais jamais il n'a été posé comme condition d'adhésion l'application du droit communautaire, l'application de l'acquis, avec vérification de leurs capacités réelles à appliquer l'acquis. C'est pourquoi l'exercice peut durer longtemps.
Or, il ne suffit pas qu'un pays candidat affirme avoir transposé les directives dans son ordre juridique interne, en présentant la photocopie de son Journal officiel. Il doit en démontrer l'application. Comment ? Par une démonstration devant la Commission européenne et les Quinze Etats membres qu'il dispose des budgets et des personnels pour ce faire.
Pour bien connaître le dossier de l'élargissement, mon exemple préféré est la Roumanie et l'agriculture : 40.000 fonctionnaires travaillent au ministère de l'Agriculture en Roumanie, dont 40 vétérinaires. Les contrôles vétérinaires en Roumanie s'effectuent dans un immeuble nettement plus petit que celui-ci, où les gens se penchent par la fenêtre et notent les plaques minéralogiques des camions. C'est tout. Nous exigeons - et nous sommes prêts à les aider grâce à des financements - qu'ils se dotent de 300, 400 ou 500 vétérinaires.
La pêche a toujours été le problème le plus compliqué dans chacune des négociations d'élargissement. Vous verrez, quand nous arriverons au nombre de contrôleurs de la pêche en Pologne : c'est édifiant ! Une des conditions sine qua non est que la Pologne se dote de contrôles en matière de pêche.
Il ne suffit pas simplement de transposer les directives, il faut faire la démonstration de l'application de l'acquis. La Commission procède à cet effet à des vérifications précises : on compte les douaniers, les gardes à la frontière de la Pologne, qui deviendra notre frontière vis-à-vis de la Biélorussie, à la frontière de la Roumanie, vis-à-vis de la Moldavie. Nous avons même vérifié s'ils disposaient d'équipements imperméables. Nous avons pu constater que les douaniers et les garde-frontière roumains ne sortent jamais dès qu'il pleut parce qu'ils n'ont pas d'équipement imperméable ! Le kilométrage des voitures des garde-frontière polonais atteint 50 ou 100 kilomètres par an, faute d'essence...
Leurs contrôles effectifs sont aussi peu probants en matière de transport maritime. C'est pourquoi Georgette Lalis disait tout à l'heure que nous allons vérifier que ces pays candidats se sont dotés d'administrations capables d'effectuer des contrôles.
M. le Rapporteur : Ces discussions sur la partie maritime ont déjà commencé ?
Mme Georgette LALIS : Oui. Avec Chypre, elles sont déjà bien avancées. Avec Malte, elles commencent. Malte déclare vouloir faire quelque chose : il faut les mettre à l'épreuve.
M. François LAMOUREUX : Beaucoup de bateaux battant pavillon maltais ne relâchent jamais dans un port de Malte. Les vérifications doivent donc être effectuées dans un port où l'Union européenne est en mesure d'exercer un contrôle effectif.
M. le Président : Le Luxembourg a-t-il une administration maritime ?
Mme Georgette LALIS : Une toute petite, mais l'essentiel de la flotte belge est sous pavillon luxembourgeois. Il délègue ses fonctions de certification à plusieurs sociétés de classification et estime les contrôles strictement.
M. le Rapporteur : S'agissant de l'agence de sécurité maritime européenne, le dispositif que vous proposez serait constitué d'équipes de contrôleurs, c'est-à-dire d'un système de contrôle des sociétés de classification : cela ira-t-il jusqu'à la mise en _uvre des politiques de coordination d'intervention en mer ?
Par exemple, peut-on imaginer qu'à terme, les politiques de coordination du trafic et du sauvetage en Manche soient placées sous l'égide de l'agence de sécurité maritime européenne. Cela fait-il partie de vos objectifs ? Cette agence peut-elle avoir une vocation d'incitation en vue de renforcer tel ou tel moyen de contrôle et de surveillance du trafic ?
M. François LAMOUREUX : Cela peut aller jusque là. Nous sommes à peu près au clair sur les compétences de cette agence. Elle aura des missions d'évaluation, aussi bien dans les ports qu'auprès des sociétés de classification. Elle contribuera à la formation des inspecteurs dans les ports. Elle contribuera à bien vérifier que, dans les pays candidats, tout ce qu'ils ont annoncé s'applique réellement. Elle collectera toutes les informations nécessaires, gérera les bases de données.
Dans le deuxième paquet, nous n'excluons pas, et nous l'indiquerons dès la présentation du premier paquet, que cette agence puisse intervenir pour mieux coordonner la gestion du trafic maritime dans un certain nombre de zones. Si les Etats en étaient d'accord, ils pourraient même déléguer cette fonction. Se pose alors un problème de responsabilité...
M. le Président : ...et de souveraineté...
Mme Georgette LALIS : De toute façon, de souveraineté !
M. François LAMOUREUX : L'agence dépendra de la Commission ; c'est donc la Commission qui devra assurer la responsabilité. En fait, c'est moi qui la prends.
M. le Rapporteur : Dans un tel dispositif, si un Erika se trouve en plein milieu de la Manche, c'est vous qui donnez, éventuellement, l'ordre de tirer s'il ne veut pas s'arrêter ?
M. François LAMOUREUX : Oui, si les Etats ont transféré de telles compétences à l'Union européenne, mais cela n'est pas réaliste. Un autre élément est également fondamental pour les inspecteurs : c'est le cas de l'inspecteur qui ne sait pas quelle décision prendre à l'issue d'une inspection. Il a découvert que ce bateau ne possède pas tous les papiers nécessaires en matière de classification, que tel ou tel matériel de sécurité manque. Or, il a la responsabilité, tout seul, d'immobiliser un bateau qui veut prendre la mer. Cet inspecteur doit pouvoir, en joignant rapidement l'agence, décrire la situation et obtenir un soutien technique, voire politique, de la part de l'agence auprès des Etats membres.
Par ailleurs, il est relativement facile de détecter des navires dangereux qui dégazent illégalement. Il est évident que cette agence devrait disposer d'une collecte de l'information et alerter directement les pays membres pour qu'ils prennent les sanctions.
Si un bateau se livrait à de tels délits, si par des moyens technologiques, l'agence pouvait le détecter, soit directement, soit par satellite, soit parce que les Etats l'en informent, il faudrait qu'elle puisse immédiatement informer les autres Etats membres pour que, dès qu'il relâchera dans un port, le bateau puisse être sanctionné.
Nous n'excluons pas un développement des tâches de l'agence allant plus loin que l'harmonisation des contrôles. C'est aussi une raison pour laquelle nous voulons un débat avec les Etats membres pour savoir dans quelle mesure ils sont prêts à transférer certaines de leurs compétences. Il ne sert à rien de faire une proposition en sachant qu'elle ne sera pas suivie. Ainsi, avant d'aller plus loin s'agissant du contrôle en Manche et en Mer du nord, nous voulons être assurés que le Royaume-Uni et la France sont d'accord, par exemple.
M. le Rapporteur : C'est le c_ur du problème.
M. François LAMOUREUX : Oui, de même que pour une européanisation, même sur une base régionale, des contrôles, de la détection des navires et de la gestion du trafic.
M. le Président : C'est ce que j'entendais par la régionalisation des initiatives et l'application des directives. Le tout sous l'égide de l'Union européenne, sans attendre que tous les Etats membres soient d'accord. Il est probable en effet que la Grèce n'acceptera pas certaines contraintes. Par contre, des pays du nord-ouest de l'Europe, compte tenu du nombre de navires qui passent et de l'importance de leurs ports, peuvent être amenés à marquer leur exaspération de devoir supporter l'ensemble des risques. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas mais, quand le risque est inhérent à des irresponsabilités telles qu'on les a connues, on ne l'accepte plus. Pour accéder à nos ports, il faudra montrer patte blanche. Lors d'une audition, il nous a été dit qu'on perdait la trace d'un navire sortant de Méditerranée et passant Gibraltar ; il peut réapparaître quelques jours plus tard à l'entrée de la Manche, sans avoir été détecté par quelque moyen que ce soit.
Mme Georgette LALIS : Il existe effectivement un trajet durant lequel il ne peut être capté par aucun centre de détection.
M. le Rapporteur : Le renforcement du dispositif de détection fait-il partie de vos propositions ?
M. François LAMOUREUX : Oui.
M. le Président : Que se passe-t-il alors ? Que fait-on dans le cas d'un navire qui arrive dont il apparaît qu'il n'est pas conforme ? On le renvoie dans l'Atlantique ?
M. François LAMOUREUX : Le seul moyen dont dispose l'Union européenne est d'interdire ses ports. On ne peut pas arrêter le transit.
M. le Président : Mais avant qu'il ne pénètre dans les « eaux européennes » ?
M. François LAMOUREUX : On peut signaler à tous les pays de ne pas l'accepter, d'où l'importance de la liste noire. Mais vous verrez que les Etats réagiront en refusant que la Commission se mêle de ce problème, en soutenant que tout se sait dans ce milieu.
Des moyens technologiques sont au point, comme le système Galileo, système communautaire en cours de développement et qui, dans quatre ou cinq ans, nous donnera notre indépendance quant au positionnement des navires. Il suffira d'introduire l'obligation d'un équipement particulier afin d'avoir un positionnement en temps réel. Nous devrions vous remettre une brochure à ce sujet.
Mme Georgette LALIS : Ce n'est pas par hasard si la France se retourne vers l'OMI : c'est parce qu'existent des conventions internationales, notamment sur la navigation dans les détroits, comme la Manche, Gibraltar, Messine, etc., et des règles sur le transit libre dans les mers. Nous devons rester prudents. Même si nous avons une directive pour les navires qui entrent dans les ports ou qui partent avec des cargaisons dangereuses, nous devons la modifier afin de pouvoir repérer les navires en transit, qui n'ont pas l'intention de relâcher dans un port européen.
M. le Rapporteur : En Manche, les navires en transit qui n'ont pas l'intention d'entrer dans un port communautaire ne doivent pas être légion !
Mme Georgette LALIS : Ils peuvent se rendre en Norvège, en Russie, dans toute la Baltique, ou, en sens inverse, faire route vers Gibraltar.
M. François LAMOUREUX : Un, nous sommes la première puissance commerciale du monde. Deux, les Norvégiens suivront, d'après ce qu'ils m'ont encore dit ce matin. Bien sûr, ce n'est pas un filet pour pêcher tous les bateaux sous-normes, mais il existe une sanction objective dans le fait de ne pas pouvoir entrer dans un port de la Communauté étant donné les répercussions commerciales. Pour l'instant, c'est ce que nous voulons privilégier.
M. le Rapporteur : Dans l'Oil Pollution Act américain, il est exigé de préciser les caractéristiques des produits dangereux avant de toucher un port des Etats-Unis. Ce n'est pas notre cas. Vos propositions reprennent-elle cet élément ?
Mme Georgette LALIS : La directive Hazmat (Hazardous material) concerne la surveillance du trafic pour les navires à cargaison dangereuse ou polluante. Elle date de 1993 et comprend l'obligation de donner les caractéristiques de la cargaison. L'Erika avait transmis ces données : elle avait respecté la directive à cet égard.
M. le Rapporteur : Pas s'agissant des caractéristiques chimiques précises du fioul qu'elle transportait. Or, selon la législation américaine, il faut signaler qu'on transporte du pétrole qui a telles et telles caractéristiques.
Mme Georgette LALIS : Je ne sais pas si nous allons aussi loin dans les détails de la cargaison, mais les grandes caractéristiques doivent s'y trouver : fioul lourd ou light product.
Nous examinons la modification de cette directive. François Lamoureux l'expliquait : nous la simplifierons, car elle est trop bureaucratique, sans beaucoup d'effets, et nous la renforcerons sur le contrôle et les notifications à fournir par les navires. J'ai une copie à votre intention. Eurorep (European Reporting System) est une directive par laquelle nous avons souhaité que tous les navires qui transitent dans les eaux territoriales de l'Union européenne se signalent. Les Etats membres ont refusé et tenu ce type de propos : « Il existe une clause dans la convention sur le droit de la mer, la liberté de navigation. Par ailleurs, les Etats membres sont souverains dans leurs eaux territoriales ; de quoi vous mêlez-vous ? » C'est la seule directive non adoptée depuis 1993. Nous allons intégrer cette Eurorep dans la deuxième partie de la communication. Il existe de nos jours des transpondeurs automatiques, un matériel technique par lequel les navires peuvent envoyer leur signalement complet à terre. Si nous obligeons tous les navires à posséder un transpondeur, ce que l'OMI va rendre bientôt obligatoire, le signalement sera facilité et automatique.
M. le Rapporteur : Serait-il possible de dresser une liste des initiatives prises par la Commission en matière de réglementation maritime, et non adoptées ?
Mme Georgette LALIS : Vous recevrez la liste de toutes les propositions adoptées et de toutes les propositions pendantes. En effet, aucune n'est rejetée : elles restent simplement pendantes.
M. François LAMOUREUX : Les propositions faites par la Commission en 1978 ont été rejetées. C'est intéressant parce que cela se passait après l'Amoco Cadiz.
Mme Georgette LALIS : Notre liste commence en 1990.
M. François LAMOUREUX : Il y avait déjà une vie avant 1990 et il serait intéressant de la rappeler.
M. le Rapporteur : C'est important pour nous. En France aussi, nous avons pris des initiatives après 1978, plus ou moins suivies. Mais ce qui serait intéressant, ce serait de disposer des actions initiées par la Commission et refusées lors des Conseils des ministres par tel ou tel Etat membre. Un des risques actuels est de voir les propositions formulées par la Commission ne pas être acceptées par les Etats membres et que le ballon soit passé à l'OMI.
M. François LAMOUREUX : Je peux d'ores et déjà vous donner les conclusions du Conseil des Transports dans l'hypothèse la plus pessimiste.
M. le Président : Et ce risque de temporisation existe-t-il réellement ?
M. François LAMOUREUX : Il existe pour la troisième proposition. Pour les deux autres, c'est un risque non de dénaturation mais d'émasculation. On dira : « Pourquoi interdire un bateau de plus de 15 ans ? Mieux vaut placer la barre à 20 ans ». On veut faire des contrôles ciblés de telle façon : on répondra qu'il est préférable de cibler de manière plus douce. Le grand argument, repris par tous, résultera du manque d'inspecteurs. Lors des premiers contacts avec les Etats membres, ils étaient d'accord sur le fond, mais faisaient aussi valoir le manque d'inspecteurs en nombre suffisant. Il faudrait une période de transition, allant jusqu'à deux ans. Ce sera un vrai problème politique pour la Commission.
M. le Président : Il y a un autre problème politique : quelqu'un nous a dit que 3.500 pétroliers circulent dans le monde. Cela me paraît beaucoup. Comment faites-vous pour remplacer 3.500 pétroliers d'ici 2008 ?
M. François LAMOUREUX : Nous reparlerons de cette date de 2008 ! Le premier problème est déjà que nos dates soient acceptées : 2008 serait très bien. Mais nous ne touchons pas aux petits pétroliers en dessous de 600 tonnes. Pour les autres, c'est un problème de renouvellement du parc des pétroliers.
Mme Georgette LALIS : La capacité en matière de construction navale mondiale existe et dépasse même les besoins. La question est de savoir si les armateurs pourront investir, puisqu'ils perdront déjà sur la valeur de leurs bateaux d'occasion, devenus presque invendables. Le marché stagne. De plus, les compagnies pétrolières ne contribuent guère à les aider sur ce plan en ne s'engageant pas dans des contrats à long terme. Les armateurs disent être disposés à changer leurs flottes au profit des doubles coques, s'ils peuvent s'appuyer sur de nouveaux contrats sur trois ans ou cinq ans pour l'affrètement du navire à construire. Malheureusement, les compagnies pétrolières privilégient l'affrètement spot.
M. François LAMOUREUX : Vous publierez votre rapport à un bon moment. Le Conseil Transports aura lieu le 28 mars et un autre se tiendra en juin. Toujours sous présidence portugaise.
Ce sera intéressant parce que l'effet de la communication de la Commission, telle qu'elle a « fuité », a eu un effet sur le marché, tant en ce domaine que dans d'autres. L'intérêt est de voir la virulence des réactions en faveur ou contre la proposition de la Commission. L'important est que cet effort de renouvellement de la flotte commence dès maintenant et que la stratégie des acteurs du marché s'infléchisse au plus vite.
Une proposition de la Commission reste quand même le texte de référence. C'est pourquoi nous sommes inquiets sur le sort de notre troisième proposition : tous les arguments nous seront opposés - construction navale, emploi, prix du pétrole, etc. - pour qu'elle ne soit pas adoptée. Nous ne l'entendons pas ainsi.
Pour répondre à votre question, nous avons eu des débats : nous n'allons pas changer de date au gré de la discussion, ni vis-à-vis du Parlement, ni vis-à-vis du Conseil.
M. le Président : On nous a dit que, pour les doubles coques, l'argument du coût de la mesure est discutable. Qu'en pensez-vous ? Je parle du coût pour les compagnies pétrolières.
Mme Georgette LALIS : Le coût n'est en effet pas extravagant, d'autant que le marché s'est déjà tourné vers des pétroliers de meilleure qualité que l'Erika. Des armateurs, en tant qu'individus, sont assez heureux de l'annonce de nos propositions, mais ils ne veulent pas que la Commission s'en mêle. Ils m'ont dit être contents parce qu'ils ont trouvé des affréteurs pour des navires pour lesquels ils n'en trouvaient pas auparavant, lorsque les pires du marché détenaient tous les contrats. Le marché est donc déjà en train de remonter en qualité.
M. le Président : C'est peut-être la période d'émotion.
Mme Georgette LALIS : Oui, mais cette période d'émotion durera : notre troisième proposition restera sur la table.
M. François LAMOUREUX : Avant la sortie de votre rapport, vous pourrez mesurer l'effet réel des positions présentées au Conseil des ministres. Fin juin, les autorités françaises pourront vous dire exactement les positions respectives des Quinze sur ces paquets.
Mme Georgette LALIS : Les propositions du 28 mars, acceptées par la majorité des Etats membres, auront pour effet que, même si devant notre troisième proposition, les Etats membres disent vouloir retourner à l'OMI, l'OMI sera obligé de s'activer.
M. le Président : Si le 28 mars, le Conseil des ministres européens ne suivait pas vos propositions, cela aurait un effet politique désastreux difficile à imaginer.
M. François LAMOUREUX : Le 28 mars, vous aurez une présentation par la Commissaire, Mme de Palacio. Tout le monde dira que c'est très bien. C'est pour cela que la date de vos travaux est intéressante. Après, les propositions descendront dans les « soutes », les groupes de travail du Conseil, au plus proche des intérêts catégoriels - rien d'injurieux à cela. Lors du Conseil de juin, un rapport résumant le travail effectué au sein de ces groupes sera publié ; nous pourrons alors vérifier la réalité de l'accueil fait à nos propositions.
M. Louis GUEDON : Des groupes de pression pourraient faire évoluer des décisions de la Commission, d'un côté comme de l'autre : rien n'empêche que 10.000 personnes viennent manifester à Bruxelles pour montrer qu'elles sont très attentives à ce dossier.
M. François LAMOUREUX : Nous vous remettrons donc divers documents.
J'attire votre attention sur les données retraçant les efforts respectifs des Etats en matière de contrôles. Sans commentaire.
Nous sommes à votre disposition après que ces communications aient été adoptées. Comme vingt Commissaires travaillent sur le sujet, ce que je viens de vous dire peut encore être modifié.
Audition de M. Patrick HENNESSY,
directeur chargé des aspects environnementaux de la politique d'entreprise et des industries spécifiques
à la direction générale Entreprise de la Commission européenne
M. Kostas ANDROPOULOS,
chef de l'unité chargée notamment des industries maritimes,
M. Ronald VOPEL, membre de l'unité
(extrait du procès-verbal de la séance du 13 mars 2000 à Bruxelles)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. le Rapporteur : Ma première question concerne l'obligation de la double coque. Si les dispositions proposées au Conseil des Transports à la fin du mois sont mises en _uvre, l'obligation de double coque sera rapidement décidée.
Quelles conséquences voyez-vous sur le marché à la suite de cette décision, en cas d'application ? Inversement, considérez-vous que la mesure décidée à travers l'Oil Pollution Act américain (OPA), qui a imposé l'utilisation progressive de la double coque, a eu des effets sur la construction navale en Europe ? Par ailleurs, la norme E3 qui a été envisagée un moment, vous paraît-elle aujourd'hui une norme susceptible d'être remise sur le chantier ?
M. Patrick HENNESSY : Je vais vous livrer assez tôt à mon collègue Andropoulos, car pour ma part, je n'aborderai que le volet politique.
Nous apportons notre plein soutien à l'initiative prise par le Commissaire chargé des Transports pour l'introduction de la double coque en 2010. Nous avons été consultés sur les conséquences sur le marché. Cela nous intéresse beaucoup. A notre avis, compte tenu de la situation sur le marché mondial et de la situation des entreprises de chantiers navals européens, il est peu probable que les chantiers européens profitent dans l'immédiat du retrait des navires à coque simple, qui ne seront plus autorisés ; leur remplacement fournira sans doute plutôt du travail aux chantiers extra-communautaires. Cela dit, il y aura sans doute des effets dans la mesure où l'industrie des petits pays tiers profitera de cet accroissement d'activité, ce qui pourrait avoir aussi quelques répercussions sur l'industrie européenne.
Je laisse la parole à M. Andropoulos pour répondre plus en détail sur cet aspect ; M. Vopel répondra sur l'effet de la législation américaine et les normes E3.
M. Kostas ANDROPOULOS : M. le Rapporteur, vous avez mis le doigt sur trois sujets qui nous préoccupent beaucoup ces derniers jours.
Votre premier point : si l'on décide l'obligation de la double coque sur les nouveaux navires à partir d'une certaine date, quelle seront les conséquences sur le marché ? Nous avons eu des entretiens approfondis avec notre industrie de construction navale européenne, d'abord, puis avec nos collègues de la Direction Générale Transports. Nous avons pu leur fournir les éléments à notre disposition concernant les capacités mondiales et les possibilités de construire des navires à double coque à partir d'aujourd'hui. C'est à eux d'évaluer les prévisions de la demande.
Grosso modo, pour nous, la capacité existante actuellement au niveau mondial se situe entre 30 et 35 millions de tonnes de jauge brute. Tout dépend de la demande dans les dix prochaines années pour savoir si elle peut être satisfaite. Nos collègues de la DG Transports sont en train de faire leurs propres évaluations.
Concernant votre deuxième question sur les effets de l'OPA sur la construction navale européenne, M. Vopel me contredira si nécessaire. Dans les dix dernières années, il n'y a eu pratiquement pas de construction de navire européen VLCC (very large crude carrier), à l'exception d'une commande exécutée par un chantier danois et de la construction d'un navire à double coque de type E3 en Espagne, à Puerto Real. L'annonce et l'adoption de la législation OPA aux Etats-Unis a eu une influence indirecte sur les chantiers navals européens ; les ordres se sont plutôt déplacés vers l'Asie ou bien sont restés aux Etats-Unis si le navire était sujet au Jones Act, en vigueur dans ce pays.
Concernant le troisième point sur le fameux navire écologique économique européen, il s'agit pour nous d'un concept très valable. D'abord, c'est un concept européen qui, à l'époque, a reçu un support financier des instances communautaires. Le problème avec ce type de design, c'est que nous avons cru comprendre que le prix de revient du navire était élevé. C'est la raison pour laquelle un tel schéma, un tel design n'a pas été utilisé pour la construction de navires en Europe, sauf dans un cas, avec un bâtiment construit dans les chantiers espagnols, que j'ai déjà cité.
Dans quelle mesure est-il possible de transférer une partie de la demande espérée au profit des chantiers navals européens ? C'est vraiment notre souci et notre souhait, mais il est clair que l'introduction d'une législation par la Commission doit être correcte et respectueuse de la législation existant au niveau mondial, particulièrement au regard des normes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ce n'est pas toujours évident : insérer une clause demandant la construction de nouveaux navires en Europe serait peut-être contraire aux usages.
M. Patrick HENNESSY : Cette question ne se pose guère. Si vous me le permettez, M. le Président, je vais maintenant passer la parole à M. Vopel à propos de l'impact sur les marchés et d'autres questions.
M. Ronald VOPEL : Je n'ai pas-grand-chose à ajouter. Le E 3 est intéressant : le concept est valable mais, pour le marché, je pense qu'il est trop cher pour le moment. Il faut discuter des voies à suivre pour introduire ce concept sur le marché. C'est assez difficile car l'OMI a son mot à dire sur ce sujet. Par ailleurs, en raison des surcapacités sur le marché, on doit pouvoir remplacer assez rapidement les simples coques qui existent aujourd'hui par de nouveaux bateaux.
M. le Rapporteur : La double coque vous paraît-elle une bonne technologie ?
M. Ronald VOPEL : La double coque est efficace en cas de collision ou d'avarie. Peut-être aurait-on rencontré le même problème avec l'Erika s'il avait eu une double coque, car il avait aussi d'autres défauts. L'âge constitue aussi un problème grave. Nous n'avons aucun navire double coque vieux de 24 ans. Cela fait une belle différence !
M. le Président : Vous affirmez qu'il y a actuellement une surcapacité, ce qui signifie que l'on pourrait rapidement interdire tous ces types de navires sous normes, sans attendre ?
M. Kostas ANDROPOULOS : Il faut considérer deux aspects : la surcapacité concerne la production, mais il faut étudier aussi la demande.
M. le Président : La surcapacité pour quoi ? Pour les moyens de transport ? Une surcapacité de moyens de construction ?
M. Ronald VOPEL : De construction : la surcapacité des chantiers, au niveau mondial.
M. le Président : J'avais cru comprendre une surcapacité de tankers.
M. Patrick HENNESSY : Non, non ! C'est dans le cadre du remplacement des navires.
M. le Président : Mais je pense qu'il y en a une aussi.
M. Ronald VOPEL : La plupart des surcapacités se trouvent en Asie.
M. Patrick HENNESSY : Les surcapacités sont en Asie et la capacité de remplacement est bien là. Mais M. Andropoulos disait clairement qu'au moment où sera décrétée l'interdiction, ce n'est pas forcément l'industrie européenne qui en profitera directement ; c'est une priorité secondaire, après la sécurité, qui vient en tête.
M. le Rapporteur : Pour élargir le sujet, comment peuvent se concilier votre position actuelle et votre action à l'égard des atteintes à la libre concurrence de la part d'Etats comme la Corée ?
M. Patrick HENNESSY : D'abord, nous connaissons un problème de fond avec les navires : ce ne sont pas des produits comme les autres, pour lesquels on doit respecter les dispositions anti dumping. Le bateau n'est pas un produit comme un autre. Le seul moyen d'arriver à une solution avec la Corée, à travers l'OMC, est fondé sur une initiative prise par l'industrie elle-même.
Nous avons tenté de trouver un terrain d'entente avec les Coréens. Mais il faut savoir que le problème en Corée concerne les chantiers navals, bien sûr, mais il est aussi beaucoup plus large, plus général à travers leur système d'aides publiques et bancaires. Comme les possibilités d'intervention sont assez limitées mais pas totalement closes en vertu des règlements OMC, il faut que les initiatives viennent d'abord de l'industrie. L'industrie des chantiers navals européens elle-même est en train de préparer des plaintes. Des négociations débutent demain.
A cet égard, M. Vopel doit partir pour préparer les négociations avec la Corée, avec pour objectif d'arriver à un accord contraignant qui poussera les Coréens vers une augmentation de prix et une réduction de capacité. Mais c'est un pays assez opaque avec lequel il est difficile de traiter. M. Lamy est en première ligne à cet égard ; ses services dirigeront les négociations. Nous participerons pour l'assister sur le plan technique.
M. Kostas ANDROPOULOS : Encore un élément : en novembre, le dernier Conseil a examiné un rapport que les services de la Commission ont établi sur le comportement coréen dans le cadre des chantiers navals. Nos services ont établi qu'il existe des quasi-preuves que le prix auquel les chantiers coréens vendent leurs navires constitue presque du dumping. Comme vient de l'expliquer M. Hennessy, les navires ne sont pas importés de sorte que vous ne pouvez pas appliquer les notions traditionnelles de dumping, telles que définies par l'OMC.
Suite à cette conclusion du Conseil, nous avons essayé d'attaquer le problème sous quatre angles différents.
D'abord, à travers un dialogue bilatéral avec les Coréens, dans lequel le dernier épisode de la saga est une réunion prévue demain, sous l'autorité des services de M. Lamy. Il pourra sans doute vous en parler plus longuement tout à l'heure.
La deuxième voie, comme vient de le signaler M. Hennessy, c'est la plainte dite ROC (Règlement Obstacle au Commerce - CE N° 3286/94) résultant d'un règlement interne à la Communauté ; il prévoit que l'industrie doit introduire une demande pour des consultations bilatérales avec le pays concerné, pour étudier s'il y a vraiment une raison d'initier une procédure anti-subsides auprès de l'OMC. Ce serait une étape préparatoire avant d'en arriver à l'OMC.
Le troisième point, c'est le Fonds monétaire international (FMI) qui a octroyé à la Corée des fonds très importants pour se restructurer. A nous d'essayer d'étudier si toutes les conditions liées à l'octroi de ces aides par le FMI sont bien respectées dans le cadre de la construction navale. Comme il est très difficile d'établir que l'argent est bien arrivé à la construction navale, l'idée a été abandonnée. Il faut au moins réussir à établir le respect de toutes les conditions imposées par le FMI.
La dernière voie possible se situe au niveau multinational, comme l'OCDE. Il convient de chercher une solution au niveau mondial pour permettre aux chantiers navals de travailler dans des conditions de concurrence égales.
Voilà les diverses façons dont nous procédons.
M. François GOULARD : Pensez-vous que, malgré la différence de prix entre E3 et double coque, le E3 pourrait s'imposer dans un avenir plus lointain ?
M. Ronald VOPEL : Si le double coque est acceptée par l'OMI, il n'y aurait plus beaucoup de chances pour ce standard européen. Il existe toujours des concepts plus élaborés, mais le marché doit les soutenir.
M. Kostas ANDROPOULOS : Le E3 n'est-il pas un cas spécial de double coque ? C'est une double coque particulière. Elle pourrait donc éventuellement être admise aussi. D'après des industriels, c'est une question de prix. Si le prix moyen des navires augmente à un tel niveau que le E3 puisse être compétitif, nous avons alors en mains un atout pour les chantiers européens.
M. le Président : En fait, les spécifications de la Commission européenne pour la double coque laisseront une marge d'interprétation suffisamment large pour permettre d'aller vers le moins cher ?
M. Kostas ANDROPOULOS : C'est une réaction naturelle du marché : tout le monde cherche le prix le moins élevé.
M. le Président : Pourtant, parmi les doubles coques, certaines, comme le E3, procurent davantage de sécurité encore, tout en restant des doubles coques.
M. Patrick HENNESSY : C'est une question d'exigences minimales adéquates à établir...
M. Ronald VOPEL : ...et toujours soumises à des compromis au niveau international.
M. Kostas ANDROPOULOS : A l'OMI, il existe des règles établies au niveau international que les gens doivent respecter. Je vois mal comment en sortir. Le marché de la construction navale est un marché global et l'idée est d'essayer d'établir des règles du jeu respectées par tous les participants. Mais c'est encore une fois un problème technique.
M. Ronald VOPEL : La plupart des pétroliers ne sont pas soumis aux législations européennes : ils sont immatriculés au Liberia, à Panama, aux Bahamas.
M. le Président : Rêvons un peu : peut-on imaginer que l'Europe, avec son pouvoir économique, son pouvoir d'achat, sa puissance impose sa réglementation, compte tenu des risques que les pays européens encourent ? Nous avons subi le Torrey Canyon, l'Amoco Cadiz et d'autres. La Manche est l'un des endroits les plus dangereux de la planète en matière de circulation maritime. Serait-il possible de dire « halte ! » , d'imposer que tout bateau voulant pénétrer dans nos eaux territoriales pour se rendre à Rotterdam, Hambourg, Anvers, Dunkerque, Le Havre ou Felixstowe, ce qui représente une grande partie du commerce maritime de la planète, satisfasse à ces normes européennes ?
Quelle est la compagnie maritime au monde qui peut se passer de ces ports ? Aucune. Le poids commercial de Rotterdam empêche quiconque de refuser de s'y rendre. C'est tout le marché européen qui est derrière cela.
M. Patrick HENNESSY : C'est justement le but de l'exercice que d'exiger que tous les bateaux qui entrent dans n'importe quel port européen doivent se plier aux exigences ; c'est l'objectif qui sera proposé au Conseil. Les propositions en cours d'élaboration constituent un énorme pas en avant. L'important est de faire en sorte que les propositions ne traînent pas. Habituellement, nous proposons et les choses traînent en longueur.
M. le Président : Votre Direction et votre Commissaire y sont favorables ?
M. Patrick HENNESSY : Tout à fait. On attend parfois durant deux ans un accord entre le Conseil et le Parlement européen. Il s'agit d'éviter que l'affaire ne s'enlise à cause d'une surenchère dans les exigences de sécurité. Il est important d'adopter le dispositif aussi vite que possible. Allez-vous voir des représentants du Parlement européen ?
C'est important : le message doit passer. Au niveau de la Commission, nous sommes parfaitement convaincus ; au niveau du Conseil aussi. La présidence française s'installera bientôt. Il reste donc uniquement le Parlement européen à convaincre.
M. Kostas ANDROPOULOS : La décision de la Commission concernant le paquet de propositions sera prise dans dix jours ; ce sera ensuite au Parlement et au Conseil de poursuivre.
Audition de M. Pascal LAMY,
commissaire européen chargé du commerce
(extrait du procès-verbal de la séance du 13 mars 2000 à Bruxelles)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Pascal LAMY : Sur le fond, je n'ai à connaître des affaires qui vous préoccupent qu'à deux titres : le premier comme membre du Collège, étant assez impliqué dans ses décisions ; le second, pour tout ce qui concerne les aspects commerciaux.
Les navires ont diverses particularités du point de vue du droit commercial international, puisqu'ils sont de nulle part ; ils constituent des exceptions dans le domaine des importations et exportations : les navires ne s'importent ni ne s'exportent. Tout ce qui touche à la réglementation internationale appartient au domaine de Mme de Palacio, et moi, je ne considère la problématique qu'en fonction des obstacles d'ordre commercial.
Cela étant, sur le fond et avec six mois d'expérience dans cette fonction, ce problème d'une réglementation internationale - et de son application - me paraît tout à fait typique d'un certain nombre de problèmes de gouvernance mondiale que nous rencontrons aujourd'hui. Pour faire bref, c'est un système soumis à des normes mondiales, mais dont la réalité montre qu'elles ne sont pas effectivement mises en _uvre. Autrement dit, nous sommes pris entre un certain nominalisme, c'est-à-dire des règles normatives, et une réalité, c'est-à-dire notre incapacité à les mettre en _uvre.
Pourquoi ? Pour des raisons dont l'histoire a montré la très grande stabilité. Finalement, la position est assez confortable que d'énoncer des règles et de les brandir, mais en même temps de démontrer que leurs conditions d'application effective sont d'une telle complexité et posent tant de difficultés que ces règles ne pourront jamais être mises en _uvre.
D'autres domaines dans le monde génèrent la même situation. Pour l'utilité d'un exercice de style comme celui que vous pratiquez, après avoir consulté le dossier, je souhaite retracer rapidement l'histoire de ce qui a succédé à l'Amoco-Cadiz. Je suis frappé, avec la connaissance approximative que j'en ai, du parallèle qu'il est possible d'établir. Avec l'affaire de l'Amoco-Cadiz, c'est le drame : les pouvoirs publics français considèrent qu'il faut absolument passer à un échelon de réglementation supplémentaire.
C'était en 1978. Vingt ans plus tard, après les déclarations de bonnes intentions, même au niveau de l'Union européenne, pas grand-chose n'a été réalisé. Plus exactement, le nombre de normes a augmenté. Entre-temps, les décisions sont prises à la majorité qualifiée, ce qui a pu simplifier les choses par rapport à l'unanimité. Encore que... Au fond, de fait, on a refusé à l'époque la solution proposée aujourd'hui, qui consiste à régionaliser l'application de règles mondiales.
M. le Rapporteur : C'est la solution telle qu'elle sera proposée aujourd'hui ?
M. Pascal LAMY : Oui, je suis sûr que c'est la solution qui sera proposée ; il est impossible d'en élaborer une autre. C'est la seule et c'est d'ailleurs celle retenue par les Américains, après les quelques ennuis qu'ils ont subis.
A mon avis, l'une des questions intéressantes - je n'ai pas la réponse mais vous aurez tout le temps d'y travailler - est de savoir pourquoi rien n'a pas été fait. Quels ont été les obstacles, les raisons qui font qu'avec les mêmes problèmes, la même capacité de réglementation mondiale et les mêmes difficultés à la faire appliquer, les décisions voulues à l'époque sont restées lettre morte ?
Il est vrai qu'au moins pour ce qui concerne l'Union européenne, le monde maritime ne s'est pas empressé de se communautariser. A l'époque, l'unanimité s'imposait, c'est vrai. Le parallèle avec le transport aérien vient de suite à l'esprit. Dans ces domaines, on a du mal à s'y mettre ; il doit exister des réticences avec de bonnes raisons à tout cela. De plus, il faut observer lucidement qu'elle présente incontestablement une difficulté, cette mise en _uvre régionale de normes qui, en théorie, sont les mêmes pour tous mais qui, appliquées de manière régionale, ont, en réalité, créé des espaces aux niveaux de compétitivité différents pour les navires.
Dans de telles conditions, beaucoup peuvent dire que ces contraintes ne sont pas imposées aux concurrents. C'est alors le début d'une lente dissolution de ces contraintes elles-mêmes ou de leur mise en application.
Voilà la vraie difficulté, le fond du problème : l'Union européenne doit-elle se lancer dans la voie d'une mise en _uvre régionalisée de ces règles mondiales ou non ?
Je vous suggère de retracer l'historique de cette question depuis 1978 que je n'ai plus en tête et je serai curieux de vous lire si vous le réalisez : si mes souvenirs sont bons, c'est déjà ce que nous avions fait à l'époque : une proposition de la Commission, en bonne et due forme, s'est trouvée, par ces effets de magie des conseils européens et autres transmutations étranges, transformée en résolution, qui s'est elle-même transformée en autre chose qui, à son tour, s'est vue évoluer encore ! Finalement, on s'est retrouvé avec un élément non discutable juridiquement. C'est l'image que j'ai gardée, mais mes souvenirs sont très flous, car mon regard sur cette affaire date d'un premier passage.
M. le Rapporteur : Après 1978, des propositions ont été faites par la Commission de l'époque, saisie par la France, et ont été transmises à l'OMI ; en fait, elles ne sont toujours restées qu'une transmission à l'OMI. Le fait a permis des avancées réglementaires de l'OMI, qui ont mis un temps fou à être avalisées, par ailleurs : l'organisation du rail à l'ouest d'Ouessant, les couloirs de circulation et l'obligation pour les navires de se signaler à leur arrivée.
Cette journée le confirme : une différence de contexte apparaît. En tant que parlementaires français, nous remarquons cette volonté d'élaborer des textes forts, que l'Union européenne décide d'appliquer elle-même. Jusqu'où cela ira-t-il ? Le Conseil des ministres des Transports suivra-t-il ? La présidence française pourra-t-elle agir ?
M. Pascal LAMY : C'est tout l'enjeu que je ressens ; il est similaire à d'autres problèmes de gouvernance et de leur interface avec les relations économiques extérieures de l'Union, dans l'environnement, l'aviation civile, les télécoms, le Codex alimentarius, etc. C'est toujours la même problématique. Elle est là un peu asymptotique.
Il s'agit de faire appel à l'expérience, de bien étudier ce qui s'est passé et de l'expliquer. Mon message, c'est que le démarrage d'un tel processus avec les meilleures intentions du monde ne suffit pas ; le chemin sera long et difficile.
Si l'on met des doubles coques partout ou si l'on accroît le taux de vérification ou si l'on sanctionne les sociétés chargées des vérifications et qui ne les exécutent pas, tout cela n'est pas simple et induit des conséquences en termes de localisation d'activité, en termes d'emplois. Attention, je ne dis pas : « y a qu'à, faut qu'on » . Le parallèle avec le passé démontre un risque de démarrer très haut dans les intentions et, chemin faisant, en tenant compte des intérêts des uns et des autres, de se retrouver avec des capacités de mise en _uvre qui ne sont guère effectives.
M. François GOULARD : Une différence quand même. Vous avez évoqué l'exemple de normes environnementales que nous imposerions à nos industries européennes, ce qui créerait une situation de moindre compétitivité par rapport à d'autres zones mondiales. La différence est que tous les bateaux ont vocation, à un moment de leur carrière, à gagner les ports européens. S'il existait une norme européenne plus sévère, elle aurait en fait vocation à s'appliquer à l'ensemble du monde. Si les deux grandes zones économiques, Etats-Unis et Europe, sont à peu près à égalité de dureté de législation, nous avons une chance d'arriver à un impact mondial. Ce n'est pas le cas dans de nombreux autres domaines réglementaires.
M. Pascal LAMY : Je l'admets tout à fait. Mais le fait est que les Américains l'ont réalisé et que nous ne l'avons pas fait. Il doit bien y avoir une explication.
M. le Rapporteur : Les dispositions américaines imposant des navires battant pavillon américain pour le cabotage sur leurs côtes sont-elles considérées par la Commission comme une entrave au commerce international ?
M. Pascal LAMY : Autant j'ai de problèmes avec la taxe sur les ports aux Etats-Unis, autant sur le reste, je n'ai aucun cas de litige.
M. Louis GUEDON : Finalement, votre exposé est clair, très intéressant et, a le mérite de la transparence, mais il est pessimiste. Vous êtes un historien, vous vous fondez sur les enseignements du passé, en particulier de l'Amoco-Cadiz. Vous avez parfaitement bien développé les conséquences, les suites de ce désastre vingt ans après. En réalité, la montagne n'a même pas accouché d'une souris ! On sent chez vous la crainte de voir se renouveler le même phénomène lorsque la passion et la pression seront retombées ; l'actualité du moment amènera notre pays et l'Europe vers d'autres sujets. Notre problème passerait par pertes et profits.
Votre exposé, M. le Commissaire, montre toute la crainte des populations maritimes. On ne pourra plus dire que l'Erika c'était « la faute à pas de chance », que c'était le destin, que nous n'avions pas l'expérience de ce type de chose ; on ne peut plus accepter voir les côtes bretonnes et des Pays de la Loire être régulièrement la poubelle de l'Europe.
Plusieurs des intervenants précédents nous ont parlé de textes en préparation, en discussion, en cours de présentation. Mais le fond de votre pensée, c'est que l'Europe n'est pas constituée de populations maritimes, à l'image d'ailleurs de la France, où les terriens sont majoritaires, qu'elle n'a pas nos fibres, nos aspirations, ni nos ennuis. Vous avez le sentiment que tous ces textes en préparation qui partent d'une bonne volonté, d'une observation logique, d'un bon sens, qui sont intelligents, vous avez l'impression que tout cela va passer à côté de la plaque.
M. Pascal LAMY : Ce n'est pas une impression et ce n'est pas du pessimisme, mais bien de la lucidité.
M. Louis GUEDON : C'est encore plus grave de la part d'un Commissaire.
M. Pascal LAMY : Non, la Commission doit s'impliquer dans cette affaire. Pour ma part, je soutiendrai Mme Loyola de Palacio dans ses projets, car je les approuve. Mais nous nous trouvons dans un processus où la Commission propose et où le Conseil et le Parlement décident. C'est la codécision qui s'applique en la matière.
Le jour où nous avons lancé la proposition, nous avons réalisé 10 % du chemin ; il ne nous reste que 90% du processus législatif à effectuer au sein de l'Union européenne, entre le Conseil et le Parlement ! Après, il faudra appliquer ces dispositions.
La Commission a un rôle très important dans le processus législatif. Une proposition qu'elle met sur la table ne peut pas modifiée sans son accord, sans que les Etats membres le décident à l'unanimité. Mais les Etats membres peuvent faire traîner le processus, parfois très longtemps. La représentation permanente vous fournira volontiers la liste des propositions qui sont sur la table du Conseil depuis quinze ans.
La seule solution pour passer outre ce type de blocage consisterait à utiliser une procédure de carence où la Commission saisit la Cour de justice en disant que le Conseil est en carence et ne veut pas décider. Politiquement, c'est assez confortable, car un drame éventuel pourrait passer sous la responsabilité du Conseil. Mais, dans les faits, c'est bien l'Union européenne qui est en cause : Commission, Conseil ou Parlement, c'est pareil.
Je veux dire simplement qu'il faudra s'armer de pas mal de résolution pour faire passer les textes proposés. Si l'on aboutit à une législation communautaire, la Commission, chargée des vérifications de sa mise en _uvre lancera des procédures d'infraction si cela n'a pas été traduit correctement dans les législations nationales ou si ce n'est pas appliqué ; ce jour-là, il s'agira d'avoir un caractère suffisamment solide que pour faire face.
Ce ne sont que des constatations très générales. Mon sentiment sur le sujet, comme sur un certain nombre de sujets de gouvernance mondiale, c'est qu'il règne un certain confort collectif à dire quelque chose puis à prendre quelques libertés, aussi grandes que possibles, dans la mise en _uvre. Tout cela est difficile et compliqué.
Si l'on exige des pétroliers à double coque, des gens vont demander où est-ce que ces navires seront produits. On s'apercevra alors que la construction des pétroliers aujourd'hui ne se réalise plus chez nous, ni en Corée d'ailleurs, mais au Pakistan. Rien n'ira de soi : certains armateurs refuseront pour des raisons de coûts, de compétitivité ou d'autres motifs.
Un dossier un peu analogue concerne les nuisances sonores des avions. Même problème et même punition. Tout le monde est d'accord pour réduire le bruit des avions mais on commence par regarder qui sont les propriétaires, qui les finance, qui les fait atterrir et sur quel aéroport : les choses se compliquent alors.
M. le Président : Compte tenu de leur poids respectif, si les Etats-Unis ont affiché leur volonté d'instaurer la double coque en 2010 et que l'Union européenne ne s'y décide pas à la même époque, j'imagine que nous hériterons de tous les vieux engins à risques dont ils ne veulent plus.
M. Pascal LAMY : Nous nous trouverons dans la position inverse de celle qu'ils prennent en matière de nuisances sonores aériennes.
M. le Rapporteur : Vous avez le sentiment que nous avons intérêt à agir très vite pour profiter de l'émotion de l'Erika parce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que cela passe. Après, sera-t-il trop tard ?
M. Pascal LAMY : Non, je n'ai pas ce sentiment et je ne le souhaite pas. La raison en est simple : vingt ou trente ans après l'Amoco-Cadiz, la globalisation du monde est devenue la règle et des événements de ce type sont interprétés non seulement à la lumière de ce que vous disiez - les gens à vocation maritime trinquent et les terriens ne se bougent presque pas - mais aussi sous un angle plus global : si l'on ne prend pas garde à la portée de la situation, elle générera des réactions anti-globalisation qui, techniquement et politiquement, posent problème. A moi, en tout cas.
La globalisation est une bonne chose pourvu qu'elle soit maîtrisée et accompagnée de certaines règles. Or, de tels exemples prouvent par l'absurde que, sans règles, il n'y a pas de pilote dans l'avion. La conscience politique de cette réalité est beaucoup plus forte qu'il y a vingt ans.
De ce point de vue, normalement, les réticences prévisibles d'un certain nombre d'intérêts, économiques ou non, rencontrés sur le chemin d'une pareille législation et de sa mise en force, devraient être équilibrées par la prise de conscience qu'il convient de se garder de provoquer une réaction de rejet d'une partie de la population vis à vis de la globalisation et la libéralisation des échanges. A cet égard, la situation politique est la meilleure. Certes, l'émotion risque de s'émousser, notre époque poussant à une consommation rapide des faits d'actualité, mais cette affaire recèle un plus, et tous les tenants de la thèse d'une mondialisation maîtrisée et régulée y voient un enjeu très fort.
M. le Rapporteur : Du coup, cela peut se passer vite ?
M. Pascal LAMY : Non. Les processus sont complexes et il faut un certain nombre d'acteurs déterminés : les plus déterminés dans le processus législatif sont les élus. Ce sont eux qui font la décision finale.
M. le Rapporteur : Dans la discussion avec Malte et Chypre en particulier, cette exigence sera-t-elle fortement marquée ?
M. Pascal LAMY : Ils n'ont pas le choix : c'est leur ticket d'entrée. Ils crieront, se fâcheront, expliqueront qu'on ne les connaît pas, qu'on ne tient pas compte de leur spécificités. Ils se trouvent dans une situation où ils doivent passer par le portillon.
M. le Rapporteur : Ce ne sera donc pas un débat ?
M. Pascal LAMY : Un débat aura lieu, mais si l'Union européenne décide de tenir bon, ils devront s'y soumettre. Cela fera partie de l'acquis communautaire.
Je ne suis pas du tout pessimiste, mais toutes ces négociations me font penser que la seule voie possible en l'occurrence est la régionalisation de la mise en _uvre. C'est un pas assez fort, mais rien ne sera possible sans une certaine détermination pour aller jusqu'au bout.
M. le Rapporteur : Certains Etats s'opposeront à cette proposition.
M. Pascal LAMY : Tout cela sera subtil. Personne ne dira non ; ils prétexteront des études, du temps de vérification, certaines conditions. Ce sera subtilement tactique. Puis, il y aura un débat au Conseil, avant de confier le dossier à un groupe chargé d'une étude technique plus poussée, à réaliser par des gens extrêmement compétents...
Rien n'est simple à ce niveau : il ne suffit pas de dire pour ou contre. Ces sujets sont techniquement relativement compliqués. Cela dit, ceux qui veulent pousser à la roue devront s'intéresser de très près à ce qui se passe au Conseil et au Parlement : logiquement, le Parlement européen doit être un allié dans une telle affaire.
M. le Rapporteur : Votre conseil pour pousser les propositions de la Commission que nous estimons favorables, c'est de nouer des contacts avec le Parlement ?
M. Pascal LAMY : C'est de travailler aussi avec le Parlement européen.
M. le Rapporteur : Peut-on envisager qu'une commission parlementaire agisse auprès d'un certain nombre de gouvernements ?
M. Pascal LAMY : En principe, le lobbying avec les gouvernements des autres pays de l'Union est logiquement du ressort du Gouvernement français. Mais, avec le Parlement européen, en termes de valeur ajoutée du lobbying, une initiative des parlementaires français peut-être profitable.
M. le Rapporteur : Le « paquet » de propositions de Mme de Palacio doit être présenté au Parlement au début avril ? Il devra au préalable être adopté par l'ensemble de la Commission.
M. Pascal LAMY : Oui, je ne prévois pas de problème majeur à cet égard. Il doit passer à la Commission de la semaine prochaine, le 22 mars, puisqu'il doit être adopté avant le Conseil Transports du 28, mais je suppose qu'il s'agira là d'un exposé général.
M. le Rapporteur : Le dispositif proposé n'est pas choquant pour un commissaire chargé du commerce ?
M. Pascal LAMY : Non, j'ai déjà connu le b_uf aux hormones et d'autres cas bien plus complexes.
Nous rencontrerons sans doute des problèmes à ce sujet, mais c'est à nous d'y veiller et je ne vois pas d'obstacles majeurs. Il ne s'agit pas d'un problème aussi complexe que celui des biotechnologies.
M. François GOULARD : Est-ce que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ne peut pas s'intéresser à des obstacles non tarifaires, comme le fait de rejeter des bateaux ne répondant pas aux normes de nos ports ?
M. Pascal LAMY : Bien sûr qu'elle peut s'y intéresser. Là, nous entrons sur le terrain de la compatibilité entre des règles de libéralisation commerciale et des règles de protection technique, environnementale ou sanitaire, sociale à la limite. C'est un vieux sujet qui peut se régler par la cohérence de la législation ou qui, s'il ne trouve pas de solution, passe devant le mécanisme de règlement des différends de l'OMC.
Selon la philosophie de l'OMC, théoriquement, il est accordé le droit à une partie contractante à l'OMC de se protéger pour des motifs environnementaux. Dès lors que l'on apporte correctement la preuve qu'il ne s'agit pas d'une mesure protectionniste déguisée, que ce n'est pas une question de navires qui ont trois pieds deux pouces ou deux pieds et trois pouces, les uns étant les nôtres et les autres les leurs. Dès lors qu'on n'est pas dans ce cas de figure, on n'a pas grand-chose à craindre de l'OMC.
M. François GOULARD : En principe, ce sont des normes semblables aux normes OMI qui sont proposées par la Commission européenne. Le projet consisterait à les faire respecter dans les eaux et les ports européens.
M. le Président : La Commission européenne semble mieux à même de faire respecter ces normes ?
M. Pascal LAMY : Bien sûr, à condition qu'il y ait quelques moyens pour le faire. Mme de Palacio vous en parlera certainement. Il faut des fichiers de surveillance, des banques de données : cela coûte très cher. Mais nous ne commencerons pas à faire la quête à ce stade.
M. le Rapporteur : Par rapport aux enjeux et par rapport aux coûts de la pollution, ce n'est jamais cher payé !
M. Pascal LAMY : D'accord, mais ce ne sont pas les mêmes qui paient.
Voilà en gros comment je vois les choses de la place que j'occupe : c'est une affaire de longue haleine et il faut prendre du souffle. On en aura besoin sur la distance.
Audition de M. Francis BREVAULT, commandant du port du Havre
et de M. Michel DARCHE, directeur d'exploitation du port,
accompagnés de M. Bernard COLOBY, directeur de la communication
(extrait du procès-verbal de la séance du 27 mars 2000 au Havre)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Brévault, Darche et Coloby sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Brévault, Darche et Coloby prêtent serment.
M. Francis BREVAULT : En principe, vous trouverez exposées dans ce fascicule que je vous remets toutes les missions de la capitainerie, dont celle qui concerne le suivi des marchandises dangereuses et des navires en escale.
Le rôle du commandant de port, qui est un officier de port choisi par le directeur, est d'assurer l'exercice de l'autorité portuaire dans les missions régaliennes du port. Il est placé sous le contrôle et la direction du directeur d'exploitation et rattaché, pour les missions régaliennes, au directeur général. Il anime et coordonne une équipe d'officiers de port, capitaines et lieutenants, pour l'organisation des mouvements portuaires de navires - entrée, sortie, présence, déhalage - mais aussi de tout ce qui est fluvial ou fluvio-maritime.
C'est un des objets principaux de la capitainerie. Cela étant, son rôle ne s'arrête pas là où commence celui du préfet maritime. Nous avons une interface dans l'organisation du trafic maritime, où nous agissons par délégation d'arrêtés préfectoraux du préfet maritime, pour ce qui est de la circulation des navires en mer ou à l'approche du Havre. Il a été créé une entité, qui s'appelle Baie de Seine Trafic, dont le contrôle est assuré par la capitainerie, pour assurer la régulation du mouvement de commerce dans cette zone et tenir compte des navires fréquentant les ports du Havre, de Rouen et de Caen Ouistreham. Cette extension de nos missions est le fruit d'une décision du préfet maritime.
Nous agissons donc en fonction de ces différents arrêtés non pour la surveillance, comme il est souvent indiqué dans le rôle des officiers de port, mais pour l'organisation des mouvements. C'est la différence que nous avons avec un CROSS - centre régional opérationnel de sécurité et de sauvetage - qui, lui, assure la surveillance et engage des opérations quand il s'agit de sauvetage et de secours en mer.
Vous aurez probablement l'occasion d'aller à la vigie où l'on vous montrera les moyens mis en _uvre pour l'accueil des navires. Tout navire se présentant qui ne fait pas l'objet d'un signalement particulier par un centre de sécurité de navire ou un préfet maritime entre dans le port sans difficulté. Il y a présomption d'innocence : il navigue, il faut le recevoir ; son escale a été préparée depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois, entre son représentant, l'agent maritime, et les services de la capitainerie pour définir à quel endroit il sera positionné, en fonction de la nature des chargements ou déchargements et du stationnement qu'il aura à effectuer dans le port du Havre. Nous appliquons donc un principe de précaution, en nous renseignant sur les caractéristiques des navires et éventuellement leur passé ou ce qui nous a été signalé, mais n'avons pas de soupçons a priori. Le soupçon vient éventuellement de l'autorité maritime.
En revanche, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux opérations commerciales qu'il effectuera à l'intérieur du port : chargement, déchargement, transit de marchandises dangereuses, sachant que le navire lui-même quand il entre dans un port peut éventuellement constituer un risque pour les personnes, les biens et l'environnement. Il va donc falloir prendre des précautions pour lui assurer la garantie d'une bonne escale - le port doit être un havre sûr pour le navire que nous recevons -, mais il faut aussi veiller à ce que le navire ne constitue pas un risque pour l'environnement, les personnes et les biens.
A nous d'étudier au cas par cas, de façon systématique, les opérations que le navire est amené à faire. Nous aurons connaissance de ces opérations par l'agent maritime, bien sûr, mais aussi par le transitaire, le chargeur du navire ou encore par le manutentionnaire qui manifestera des besoins précis. Il y a donc un phénomène de coordination et de préparation de cette escale qui permet de déterminer l'endroit exact où nous allons mettre le navire en fonction des opérations commerciales qu'il doit effectuer.
A l'import, nous allons forcément surveiller l'endroit où seront débarquées les marchandises dangereuses. Nous sommes beaucoup plus attentifs à la marchandise dangereuse ; nous avons d'ailleurs un bureau spécialement chargé de ce suivi. Nous allons définir l'emplacement exact où devra se trouver la marchandise dangereuse et ses conditions de débarquement.
Nous faisons de même à l'export.
Il nous faudra également assurer la coordination des différents règlements nationaux. La tâche se complique un peu puisqu'il n'y a pas adéquation parfaite entre la réglementation du rail, de la route, du fluvial et du maritime. Nous avons pris énormément de retard dans l'élaboration du règlement des ports maritimes ou dans l'évolution du règlement du transport des marchandises dangereuses. Le règlement en vigueur actuellement date, en effet, de 1951.
M. le Rapporteur : C'est le règlement concernant le transport ?
M. Francis BREVAULT : Oui. Certes, des annexes le complètent et le modifient. Cela étant, nous sommes en attente depuis quatorze ans de la refonte du règlement des ports maritimes qui se promène de commission ministérielle en commission ministérielle. Il y a bien des projets mais qui n'aboutissent pas.
M. le Rapporteur : Ce règlement interviendrait sur les problèmes de sécurité ?
M. Francis BREVAULT : Forcément puisque c'est la bible qui doit nous fixer, en fonction de l'intérêt général, les possibilités qu'offrent les ports en matière d'importation, d'exportation et de stationnement.
J'en citerai un exemple. Comme vous le savez, le trafic routier doit s'interrompre le samedi à midi. Comment voulez-vous faire du « juste à temps » avec un navire censé arriver le lundi matin ou le dimanche soir, qui parfois prend du retard ? Il y aura à un moment donné une rupture de charge qui nous obligera à prendre la marchandise plutôt que de la refuser, car on ne peut pas demander à un transporteur routier de repartir d'où il vient et lui dire qu'il n'a pas le droit de stationner ici. Nous sommes donc obligés de prendre quelques mesures dérogeant à des codes totalement obsolètes qui ne nous permettent pas de prendre les mesures réglementaires que nous impose le code des ports maritimes. C'est ce qui fait que, très souvent, nous entendons les importateurs et les exportateurs dire que la réglementation portuaire française est telle que, dans la pratique, ils se trouvent contraints de passer par d'autres ports. Ce n'est pourtant pas la volonté des ports.
De plus, la France est une grosse exportatrice de marchandises dangereuses, que ce soit en explosifs, en nucléaire, en chimie, en peroxydes. Il faut donc que nous puissions offrir cette possibilité et que quelques ports soient équipés en conséquence. Le port du Havre se trouve bien équipé, c'est un peu notre credo ; l'annonce du port, c'est : « Le Havre : premier port à l'importation et dernier à l'exportation. » La réglementation internationale du transport de marchandise dangereuse prévoit qu'on la débarque le plus tôt possible et qu'on l'embarque le plus tard possible.
M. le Rapporteur : Cela figure dans la réglementation internationale ?
M. Francis BREVAULT : Tout à fait. La marchandise dangereuse doit passer le moins de temps possible en mer.
M. le Rapporteur : C'est dans les textes de l'OMI ?
M. Francis BREVAULT : Tout comme la ségrégation de marchandise dangereuse.
M. le Rapporteur : Par dangereuse, on entend aussi « dangereuse pour l'environnement » ? Le pétrole est-il considéré comme marchandise dangereuse ?
M. Francis BREVAULT : Oui. Cependant, pour nous, le pétrole est probablement un danger pour l'environnement mais présente moins de risques que les peroxydes, les explosifs ou, éventuellement, l'uranium.
Nous ne négligeons pas, loin de là, le transport de produits pétroliers. Néanmoins, il existe d'autres sources de pollution qui peuvent être beaucoup plus effrayantes. Je pense, par exemple, à une fuite de chlore ou d'ammoniaque qui peut se produire sur un navire en difficulté ou lors d'opérations commerciales. Nous gardons donc un regard attentif, peut-être encore plus attentif sur le risque qui peut paraître bénin ou anodin, sur un navire bien peint, bien propre ou tout petit, car le petit navire peut parfois constituer un risque supérieur à celui d'un très gros.
Bien sûr, notre souci, compte tenu du port éclaté d'Antifer que je n'ai pas eu le temps de vous présenter mais que vous connaissez bien, est lié aux risques que nous pouvons rencontrer en cas de pollution. Cela peut être la rupture d'un bras de chargement, mais aussi une défectuosité dans une citerne, une citerne qui se déchire lors d'un mouvement fléchissant ou d'une rupture de cloison.
De plus, se pose le problème des côtes. Nous le savons parce que nous avons eu des exemples de pollution qui nous échappent avec les histoires de marée. L'efficacité d'un barrage, avec la variation que nous avons dans le marnage - l'amplitude de marée - et le courant qui va derrière, est très limitée. Un barrage ne peut rien retenir dès lors qu'il n'y a pas d'écluse ou quelque chose de physique entre les deux, et ce n'est pas un barrage qui peut représenter cet élément physique permettant de retenir une pollution quand il s'agit d'un avant-port ou d'Antifer.
Je me souviens que lors du Katia...
M. le Président : Le cas du Katia nous a été présenté il y a quelques jours lors de l'audition des Abeilles internationales. Il s'est cassé en deux, c'est bien cela ?
M. Francis BREVAULT : C'est une petite pollution que nous avions eue dans le port. Le port, comme le préfet maritime, a des moyens de lutte contre la pollution à sa disposition, mais bien souvent ceux-ci ne sont pas en adéquation avec ce qui se passe.
Mettons les choses au pire et imaginons qu'une citerne se rompe au Havre ou à Antifer. Avec les marées, on sait très bien que la pollution ne se limitera pas au seul port et ira polluer et souiller le littoral d'Etretat aux plages de Deauville. Cela relève de la compétence du préfet maritime. Nous serons démunis. Il faut donc travailler en amont pour éviter qu'une telle catastrophe se produise, tout en sachant bien que si elle se produisait, compte tenu des éléments de marée, on ne pourrait pas la retenir. Bien sûr, nous nous donnons les moyens d'avoir des barrages, pour en chaluter éventuellement une partie, mais nous ne ferons pas tout. Pour nous, cela a toujours été la part du feu : faire l'essentiel, mais malheureusement pas tout.
Nous avons promis de tout dire : il ne faut pas se croire capables d'avoir une réponse totale, d'autant que l'organisation du plan POLMAR terre ou POLMAR mer pose aussi quelques difficultés, si ce n'est de coordination, du moins de moyens car ce ne sont pas les mêmes barrages que l'on met en amont ou en aval d'une écluse. Une pollution en amont de l'écluse François Ier, c'est certainement très gênant en raison des quais, des fortes amplitudes d'eau, des médias, mais cela n'ira pas polluer les plages de Deauville avec des produits dispersants.
Il faut donc faire un travail en amont. C'est pour cela que la capitainerie a mis en place un bureau des marchandises dangereuses pour le suivi de toutes ces opérations. Dernièrement, une personne a été nommée pour suivre plus précisément toutes les opérations commerciales des navires chimiquiers et pétroliers lors de l'embarquement et du déchargement. Cette personne suit concrètement, physiquement, ces opérations. Dans un premier temps, elle passe constater si l'amarrage du navire est correct, avant d'autoriser le début du pompage ou du chargement de la cargaison. Dans un second temps, elle vérifie la fameuse ligne équipotentielle, qui permet une stabilité dans le flux magnétique du navire. Elle regarde si la pression est suffisante, si l'inertage est bon pour faire le crude oil washing, et procède également à d'autres petites inspections qui lui permettent, non pas de juger de la fiabilité du transport maritime - car cela, c'est le travail des Affaires maritimes de port state control - mais de la qualité du navire pendant les opérations de chargement ; à tel point que, très souvent, elle examine l'état de la salle de pompes pour voir s'il n'y a pas eu de fuite. Mais elle ne descend pas dans la coque pour étudier l'état du navire, ce n'est pas son rôle.
M. le Rapporteur : C'est le rôle des Affaires maritimes ?
M. Francis BREVAULT : En effet. Toutefois, cela devient le rôle des officiers de port quand ils découvrent quelque chose de suspect. L'officier de port a alors le devoir de prévenir les Affaires maritimes d'une constatation de ce type qu'il aurait faite.
M. le Rapporteur : Le devoir réglementaire ?
M. Francis BREVAULT : Oui. Il doit signaler aux Affaires maritimes tout dysfonctionnement constaté. Cela fait l'objet d'un article du code des ports maritimes. Il le fait donc systématiquement. N'oublions pas que les officiers de port sont tous d'anciens officiers de la Marine marchande ou de la Marine nationale possédant une connaissance approfondie des navires. Ils émettent un avis certainement éclairé dans le suivi et le contrôle des navires en réparation.
Pour ce qui est de la réparation navale, l'officier de port suit en permanence la demande de travaux faite par le port par le biais de l'agent maritime. Il est donc en mesure de faire des constats sur la qualité du navire lui-même, qui doivent être rapportés à l'autorité maritime, fondés sur l'impression générale, ce sentiment que l'on acquiert avec une certaine expérience pour dire qu'il est en bon ou en mauvais état. Certains signes ne trompent pas, comme un manque d'ancre, un manque de radar, un manque de baleinière, des marques de charge noyées. Comme vous le savez, les navires ont un certain tirant d'eau, quand ils sont trop enfoncés, trop sur la peau de l'eau, nous avons une appréciation à donner.
Nous avons donc un rôle de coordination à assurer avec le chef du centre de sécurité des Affaires maritimes. Tout comme nous jouons depuis quelque temps au Havre un rôle renforcé avec les CROSS, puisque nous avons signé avec le CROSS de Jobourg une convention d'échange entre le VTS - Vessel Traffic Service - et ce CROSS (ce dispositif sera bientôt rejoint par les CROSS Gris-Nez et CROSS Corsen), pour leur fournir des éléments concernant tous les navires transportant des marchandises qui quittent la Baie de Seine, c'est-à-dire non seulement Le Havre, mais aussi Rouen et Caen-Ouistreham.
Au mois de juin, nous devrions faire avec M. Serradji une grand-messe avec Jobourg pour officialiser ces échanges d'informations qui nous permettront d'avoir les positionnements des navires en fonction de leurs données commerciales. Nous échangeons ces informations contre la liste ou le manifeste des marchandises. Il faut savoir que les capitaineries sont les autorités compétentes pour détenir les manifestes qui doivent être déposés avant que les navires n'appareillent, que ce soient les capitaineries du port de départ ou d'un port de la Communauté européenne. Si nous n'avons pas ce manifeste des marchandises dangereuses au Havre, l'agent maritime doit nous dire dans quel port européen celui-ci se trouve et nous devons avoir les moyens de rapatrier, sous forme souvent électronique, toutes ces données, que nous transmettrons bientôt à ce pointeur national dont on parle dans la directive HAZMAT, la fameuse directive 93/75. Ce pointeur national sera créé à Jobourg. La volonté s'en est fait jour dernièrement. Mais, nous avions déjà mis en place nos propres échanges d'informations.
M. le Rapporteur : Quelles informations allez-vous donner ?
M. Francis BREVAULT : Nous allons fournir les informations sur les navires qui transportent des marchandises dangereuses, avec l'heure de sortie des navires du port, en disant : « Ce navire quitte le port du Havre, s'en va vers l'ouest, vers le nord-est. » Gris-Nez ou Jobourg seront informés ou nous informerons directement Jobourg qui relaiera à Gris-Nez. C'est ce que l'on appelle des échanges de données. La capitainerie a une autre appellation, elle parle d'un « centre de services de trafic maritime », que l'on peut associer à un VTS portuaire. Les CROSS sont des VTS côtiers. La complémentarité de ces deux VTS fournit une perception très rationnelle du trafic.
Nous avons donc un suivi permanent des marchandises dangereuses assez performant dans la façon de systématiser toutes les escales. C'est peut-être un avantage que nous avons sur les Affaires maritimes qui, elles, doivent, en vertu du Memorandum of understanding (MOU) de Paris, avoir 25 % de visites de navire. L'action de la capitainerie concerne tous les navires entrant au port du Havre et transportant des marchandises dangereuses. Même en transit, nous devons mesurer les conséquences sur l'impact non seulement économique, mais aussi écologique et de sécurité civile.
Bien sûr, pour cela, il faut du monde. Nous accordons une priorité de plus en plus importante à ce service de marchandises dangereuses, à tel point que, compte tenu des effectifs, nous sommes obligés de supprimer des missions d'exploitation en affectant à ce service des officiers de port des écluses, par exemple, car il est plus important d'avoir quelqu'un de terrain pour suivre le navire, que d'avoir un officier commandant l'ouverture et la fermeture du pont pour le passage de l'écluse.
Cette évolution est liée à la prise de conscience de la nécessité de revoir la réglementation. Car notre difficulté vient bien souvent non pas de la réglementation, mais bien de son inadéquation.
M. le Rapporteur : Inadéquation entre les règlements et le nombre de personnes permettant leur contrôle ?
M. Francis BREVAULT : Non, entre les différentes réglementations nationales sur les transports.
M. le Rapporteur : Entre les modes de transport ?
M. Francis BREVAULT : C'est cela. La difficulté est que les capitaineries sont actuellement obligées, par expérience car c'est vraiment du compagnonnage que nous faisons dans la formation des officiers de port, de prendre des mesures de bon sens, en se disant, par exemple, que la marchandise ne va repartir en Suisse ou dans le nord parce que le bateau n'est pas encore arrivé. Le bateau a été dérouté ou a pris quelque retard, mais il va venir. C'est ainsi que certaines marchandises peuvent rester au port quatre ou cinq jours, au lieu des deux jours prévus, cantonnées dans des périmètres de sécurité, parce qu'il paraît plus normal de les faire attendre dans un lieu à l'écart que de leur demander de reprendre l'autoroute pour revenir dans quatre jours. Nous n'avons pas de centre qui nous permette de faire une massification de la marchandise dangereuse sur des aires de stationnement. Je vous montrais tout à l'heure comment on fait du dépotage ou de l'empotage de conteneurs. On reçoit la marchandise sous une certaine forme, en sac ou en caissettes, qu'il faut rentrer à l'intérieur du conteneur.
Pour certaines marchandises comme les explosifs ou les uraniums, pour lesquelles l'organisation du suivi est beaucoup plus pointue, puisque ces marchandises sont soumises à des autorisations spéciales ou peuvent bénéficier de dérogations leur permettant de circuler le dimanche, nous pouvons freiner ou accélérer le transport en fonction de l'arrivée du navire. Il est prévu que la première opération d'un navire débarquant de la marchandise dangereuse soit d'envoyer sa marchandise la plus dangereuse à terre de façon à ce que les moyens d'évacuation mis en place avant l'arrivée du navire soient opérants.
M. le Rapporteur : Ce sont les produits dangereux qui descendent les premiers ?
M. Francis BREVAULT : Certains produits dangereux car, dans la nomenclature de l'OMI, qui va de 1 à 9, on trouve des peintures, des vernis, etc. Il est certain que les parfums ou les alcools de bouche qui, bien sûr, s'ils flambent peuvent être spectaculaires, sont moins dangereux que des roquettes, sans parler des risques que font peser les peroxydes, beaucoup plus insidieux et pouvant engendrer une pollution de l'atmosphère.
Or nous sommes parfois amenés à recevoir ce type de marchandises par le biais de navires en difficulté. Le préfet maritime ne le sait pas toujours car, tant que le navire est sur l'eau, il ne constitue pas une source de pollution. Mais il arrive qu'un navire en provenance d'un port étranger nous signale une fuite sur un conteneur, en nous disant qu'il lui faut le débarquer au Havre parce qu'il ne peut continuer sa traversée avec. Que faisons-nous alors ? Devons-nous lui interdire de rentrer au port et lui demander de se promener en mer ? Le préfet maritime n'est pas toujours informé dans ces cas. Nous le prévenons qu'un navire est en train de subir des fuites, mais, s'il s'agit de peroxydes, par exemple, il vaut mieux que ces fuites se produisent au milieu de la Manche plutôt que d'avoir un conteneur de peroxydes positionné sur un terminal, obligeant à délimiter un périmètre de 1500 mètres à l'intérieur duquel personne ne pourra entrer pendant plusieurs jours, qui va paralyser toute la manutention du port.
Il nous arrive ainsi d'avoir ce genre de décision à prendre et nous sommes obligés de juger de la pertinence de la déclaration du commandant en envoyant une personne à bord, éventuellement quelqu'un de la sécurité civile, dès qu'il y a une prise de pilote, pour analyser le risque. Pour nous, le navire n'est pas potentiellement dangereux, c'est sa cargaison qui l'est.
Parfois, il vaut mieux laisser le navire au large, mais qu'allons-nous en faire ? Il va bien falloir finir par le rentrer, même s'il contient des produits chimiques et qu'il fuit. Vous vous rappelez l'histoire de l'Ever Decent et du Norvegian Dream lorsqu'ils se sont rentrés dedans en Manche. Les bateaux brûlaient et les autorités portuaires d'Anvers et de Rotterdam n'étaient pas très chaudes pour recevoir un navire en train de brûler. Les préfets maritimes - ou leur équivalent - avaient tendance à dire d'aller à terre. Il est vrai qu'il est souvent plus facile d'organiser les secours à terre, car nous avons d'autres moyens, surtout si la mer est mauvaise, mais il ne faut pas oublier aussi que si vous signalez qu'un navire en difficulté arrive, tout le monde sera sur le quai pour le voir passer.
Ce sont ces mesures de bon sens que nous avons apprises par l'expérience, qui nous permettent non pas de nous faire une spécialité des navires en difficulté, mais d'organiser le transport et la manutention de ces marchandises dangereuses, sachant les risques inhérents à leur transport. D'un autre côté, si nous disons qu'il faut bien les transporter même si elles représentent des risques, Anvers et Rotterdam seront très contents de nous les envoyer. Très souvent, les ports de Rotterdam et d'Anvers, sur certains risques écologiques, poussés par les pressions écologistes, refusent certaines quantités d'explosifs.
M. le Rapporteur : Les pressions écologistes sont plus fortes à Rotterdam qu'ici ?
M. Francis BREVAULT : Peut-être à Rotterdam, mais maintenant, nous y faisons aussi attention. Lorsqu'il y a des tensions à Cherbourg pour les déchets radioactifs, le port de remplacement auquel on pense est toujours Le Havre. Mais, dans ces cas-là, nous prévenons le préfet ou le sous-préfet qu'il risque d'avoir à régler un trouble à l'ordre public et, avant que le feu vert soit donné, on analyse la situation. On ne peut pas, sous prétexte d'avoir un navire de plus, se retrouver avec un port bloqué. C'est déjà arrivé. Mais nous ne pouvons pas non plus nuire à l'image de marque du Havre et nous n'avons pas forcément besoin d'un coup d'éclairage sur un navire qui vient amener trois boîtes.
M. le Rapporteur : De combien de personnes disposez-vous pour contrôler la sécurité des navires ?
M. Francis BREVAULT : Le bureau des marchandises dangereuses compte un capitaine et son adjoint, lui-même capitaine, auxquels il faut ajouter quatre personnes qui travaillent en semi-permanence avec des astreintes à domicile, plus une autre personne chargée du vrac liquide, soit sept personnes au total.
M. le Rapporteur : La dernière venant d'arriver ?
M. Francis BREVAULT : Oui, nous avons créé un poste. Lorsque nous avons sorti les officiers de bord des écluses il y a un an...
M. le Rapporteur : Cette personne est donc rattachée au bureau des marchandises dangereuses ?
M. Francis BREVAULT : Il est rattaché au bureau des marchandises dangereuses et au bureau de placement et de coordination, ce dernier étant celui qui détermine quand et où l'on met les navires. Vous l'apercevrez cet après-midi. Il regardera si tout se passe bien et contrôlera les fameuses check lists remises au navire et à l'opérateur. L'opérateur et le navire vont s'entendre sur les cadences et les conditions de déchargement en regardant si, ici, tout est bien fermé, si, là, tout est ouvert, si le téléphone est en place, si la pression est bonne, etc. Il y a cinquante points à vérifier.
L'opérateur signe pour lui. Dans le cas précis de cet après-midi, ce sera la Compagnie industrielle maritime. Le commandant ou le second capitaine précisent qu'ils sont capables de faire ceci ou cela. C'est ce que l'on appelle la check list. Elle sera contrôlée par l'officier de port, qui vérifie s'il y a bien des croix partout, si tout est conforme. S'il y a un problème, il interdira de commencer les opérations tant que la difficulté ne sera pas résolue.
M. le Rapporteur : La check list porte uniquement sur le fonctionnement des chargements ?
M. Francis BREVAULT : Exactement, ou du déchargement.
C'est un mode opératoire convenu entre le navire et le port, sous contrôle des textes : tout est-il bien verrouillé ? La fameuse ligne équipotentielle est-elle mise ? Faut-il deux ou trois bras ? Qu'en est-il de la pression, de l'assiette du navire ? etc. L'officier de port, notamment à Antifer, surveille l'assiette du navire. Il n'est pas question de laisser un navire se décharger n'importe comment. Il faut lui permettre d'appareiller s'il arrivait quelque chose. C'est toujours le gros problème à Antifer : le navire pourra-t-il tenir s'il y a un coup de vent de suroît de force 8 ou 9 ? Ce sera difficile. Il faut donc qu'il soit capable d'appareiller dans les meilleurs délais et en bon état, sachant que s'il n'appareille pas en bon état, il y a un risque que je suis obligé de soumettre au préfet maritime, en lui signalant que ce bateau que nous renvoyons n'est pas très bien équilibré pour naviguer.
Il faut savoir qu'un bateau de 300 000 ou 350 000 tonnes qui commence à « cavaler un appontement » est effrayant. Vous avez l'impression que l'appontement va partir avec - malheureusement, ce n'est pas qu'une impression, cela peut se produire. Il faut donc prendre des précautions et avoir toujours sur place un remorqueur des Abeilles non seulement pour l'incendie, mais aussi pour la sortie, un pilote et de la main d'_uvre pour amener le bateau en toute urgence en mer, où il sera beaucoup moins dangereux que dans le port.
Très souvent d'ailleurs, nous mettons cap à l'ouest les navires transportant des marchandises dangereuses, prêts à sortir en cas de difficulté, même si aujourd'hui, les navires étant mieux équipés, avec deux hélices, un propulseur, nous acceptons cap au sud ou cap au nord. C'est une affaire de réglementation locale. En effet, le règlement des ports maritimes, celui qui définit le cadre dans lequel nous devons évoluer, peut et doit être complété par un règlement local. Ce règlement local est établi en fonction de la géographie portuaire et soumis au conseil d'administration qui le transmet au préfet.
M. le Rapporteur : Vous faisiez état de la nécessaire réévaluation de la réglementation des ports maritimes. Avez-vous des explications sur les raisons du retard pris en la matière ? On parle de code des ports ?
M. Francis BREVAULT : Non, de règlement des ports maritimes. C'est en 1985 qu'il a été jugé nécessaire de revoir le règlement des ports maritimes. En effet, les règlements locaux ne peuvent pas évoluer sans cadre national. Or, ce cadre national n'existant pas, les capitaineries, par le biais des directeurs de ports, face à l'évaporation de ces marchandises dangereuses qui allaient charger à Anvers, Rotterdam ou Barcelone, ont jugé nécessaire de revoir notre réglementation.
Certaines capitaineries ont pu estimer qu'elles n'y pouvaient rien. C'est encore le cas dans certains ports d'intérêt national, où l'on entend dire : « Je ne suis pas là pour déroger à la loi. Je suis chargé de l'appliquer. » Mais la loi de 1985-1987 sur la décentralisation a vu la création de ports départementaux, et là où il y avait moins d'exigences, on a vu certains ports se faire une spécialité dans le transport de marchandises dangereuses, à l'image de Saint-Brieuc, qui traite des ammonitrates, parce que les ports français ne doivent pas traiter des nitrates ou des nitrates d'ammonium. C'est complètement fou ! Actuellement, tout ce qui est refusé en nitrates et ammonitrates au port du Havre et de Rouen va à Elbeuf parce que la réglementation dans un port départemental ou un port municipal n'est pas la même !
M. le Rapporteur : Actuellement, ces marchandises traversent l'agglomération rouennaise.
M. Francis BREVAULT : Oui, comme c'est le cas à Dunkerque. De grands importateurs français, face à la réglementation ou au manque d'évolution de certaines parties de ces règlements, préfèrent charger à Anvers. Les ammonitrates de Elf-Atochem vont à Anvers. On a déjà essayé de faire évoluer la réglementation. Quand on veut faire évoluer la réglementation concernant les marchandises dangereuses, on sait que l'on prend un risque, mais un risque analysé, mesuré, on n'a pas envie de faire sauter le port ! Mais la commission interministérielle n'arrive pas à dégager un compromis parce que chacun s'en tient à son avis, que se soit l'Industrie, l'Environnement ou la Direction des ports...
M. le Rapporteur : C'est la raison pour laquelle la réglementation met tant de temps ?
M. Francis BREVAULT : Oui, c'est la principale raison.
M. le Rapporteur : Elle est trop rigide actuellement ?
M. Francis BREVAULT : Totalement.
M. le Rapporteur : Sur quels points ?
M. Francis BREVAULT : Justement sur les problèmes d'environnement et d'industrie. On nous dit de faire attention, de transposer à cet effet les prescriptions des DRIRE en matière de production d'explosifs. Mais un navire, un port, une gare de triage, ce n'est pas pareil ! Ce sont des zones de transit temporaires, ce ne sont pas des zones de production. Il n'est pas donc nécessaire de faire ce genre de choses. Il y a un risque à un moment donné que l'on doit certes cerner, mais ce n'est pas un risque permanent.
Derrière tout cela, il y a la fameuse directive Seveso II. La France doit se donner les moyens, les ports doivent se rendre compte du risque potentiel généré par le stationnement ou la manutention d'une marchandise dangereuse.
Cette réglementation est d'autant plus mal faite que s'il n'y a pas de manutention au sens propre, physique, comme dans le cas de la marchandise à l'import-export que l'on manutentionne, on peut carrément fermer les yeux sur la marchandise dangereuse en transit, en disant qu'elle est sous la responsabilité du commandant du navire. Oui, mais s'il arrive un accident à bord du navire, le feu ou un problème d'explosion ou de pollution, il finira bien par arriver chez nous. Cela aura bien des conséquences sur l'environnement, sur les personnes et les biens. C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut que le transit soit pris dans sa globalité. Il est peut-être moins dangereux du fait qu'on ne manutentionne pas des marchandises dangereuses dans ce cas, mais à la capitainerie, à chaque instant, nous avons la liste des navires transportant des matières dangereuses, pas seulement celle de ceux qui font de la manutention, mais celle de tous ceux qui stationnent dans le port. Car si un jour un accident se produit sur un bateau, nous serons bien obligés pour lutter contre le sinistre, avec le commandant, des pompiers, de connaître la nature de la marchandise dangereuse. Les pompiers vont naturellement se tourner vers nous pour nous demander où est le risque.
M. le Rapporteur : Vous connaissez la nature de la marchandise ?
M. Francis BREVAULT : Oui, nous sommes obligés de la connaître. Mais la réglementation pourrait nous permettre, éventuellement, de l'ignorer. Nous pourrions dire que c'est du transit et qu'en conséquence, nous ne nous en occupons pas. Une évolution de la réglementation portuaire est donc bien nécessaire.
Mais quand une demande est envoyée dans les ministères, il y a une grande difficulté pour que cela nous revienne rapidement car on pense industrie, on ne pense pas seulement maritime et l'on nous répond que l'on ne peut accepter des dérogations trop importantes au vu des normes industrielles imposées à certaines entreprises et établissements. Les ministères de l'industrie et de l'environnement bloquent et nous, nous ne pouvons pas établir de règlement local. Nous ne pouvons que prendre des mesures de bon sens et espérer que tout se passe bien !
Si j'applique les textes de la réglementation maritime, je peux refuser un navire en difficulté justement au nom de la protection de l'environnement, des biens et des personnes. Cela étant, pour les navires en difficulté, vous verrez dans le recueil que nous pouvons parfaitement travailler avec les préfectures maritimes, dès lors que nous nous connaissons. C'est alors que les préfectures maritimes découvrent le rôle de l'autorité portuaire car pour vous en donner un exemple, dans les conférences maritimes régionales, que tout le monde connaît, les commandants de port ne sont pas invités. Ils ne font pas partie de la liste ! Nous y participons par délégation mais ils nous découvrent quand un beau jour, un commandant de port demande une évaluation ensemble et conjointe. Quand on est depuis quelques années dans le port et que l'on a tissé des liens avec l'autorité maritime, que l'on connaît le chef du centre de sécurité, l'adjoint ou le préfet maritime, on essaie d'avancer avec eux, mais si nous voulions nous draper dans notre dignité, nous pourrions totalement les méconnaître et rester isolés.
Mais le préfet maritime, qui est un homme de passage, nommé pour deux ou trois ans, sortant de la Marine nationale, ne connaît pas les prérogatives qu'il peut avoir et celles que peut avoir l'autorité portuaire. Si elles ne sont pas complémentaires, nous allons le nez dans le mur.
M. le Rapporteur : Il n'existe aucun lieu de rencontre institutionnel ?
M. Francis BREVAULT : On se rencontre quelques fois lors de déjeuners.
M. le Rapporteur : Ce n'est pas du tout pareil.
M. Francis BREVAULT : Nous apprenons à nous connaître. Nous sommes d'anciens marins de la Marine marchande ou nationale, nous connaissons parfaitement le rôle du préfet maritime et celui des administrateurs, mais eux ne connaissent pas le rôle de l'autorité portuaire en matière de sécurité.
M. le Rapporteur : Estimez-vous que la répartition des tâches entre préfet maritime, direction des Affaires maritimes et port soit claire ?
M. Francis BREVAULT : Pour moi, elle l'est parfaitement. En revanche, je ne suis pas persuadé que les autres connaissent le rôle de l'autorité portuaire, nos missions régaliennes et la réglementation portuaire. Bien sûr, les gens chargés de la sécurité des navires nous connaissent mieux parce que nous nous côtoyons sur les navires. Mais je ne suis pas sûr qu'une direction régionale des Affaires maritimes, voire départementale,...
M. Michel DARCHE : Pour aller au bout de la logique, il faut aller jusqu'au préfet de région. Quand les pompiers doivent intervenir, le maire a aussi sa part de responsabilité. Quand on parle des relations entre le préfet maritime et le port, on peut aussi se poser la question des relations existant entre le préfet maritime et le préfet terrestre. Ce sont des questions qui se sont posées de façon difficile récemment.
M. Francis BREVAULT : N'oublions pas le rôle du maire dans la prévention et l'établissement des moyens qui sont transférés à la CODIS actuellement, mais dont il est toujours l'autorité compétente.
M. Michel DARCHE : De même, le commandant de port a certaines fonctions en termes de sécurité, mais il n'en a pas les moyens. A l'époque, ces moyens étaient à la disposition des maires, maintenant ils n'existent même plus. Il y a les moyens d'un côté et les compétences de l'autre, et tout cela doit pourtant naviguer ensemble dans des situations de crise.
M. Francis BREVAULT : C'est l'arrêté du 31 août 1966. Actuellement, un papier remet apparemment la balle au centre sur les prérogatives des uns et des autres. Il est, à mon avis, intéressant.
M. le Rapporteur : On dérive sur une question de sécurité terrestre.
M. Francis BREVAULT : Oui.
M. le Rapporteur : Quel pourcentage de marchandises dangereuses réceptionnez-vous en vrac ?
M. Francis BREVAULT : On a parlé à un moment donné de plus de 20 %, y compris le pétrole, sachant qu'un navire lui-même transporte des soutes... L'opération du Katia qui a fait parler d'elle n'était pas de la manutention, c'était un simple accident, comme un pneu coincé sur un trottoir et là, la coque s'est déchirée et l'on a vu 180 tonnes à l'eau et toutes les difficultés FIPOL derrière.
M. Michel DARCHE : Les vracs liquides, qui sont les plus dangereux, représentent deux tiers du trafic, 40 millions tonnes de pétrole, de produits raffinés et de produits chimiques, c'est-à-dire environ 40 millions de tonnes sur un total de 60. J'imagine mal un seul porte-conteneurs entrant dans le port du Havre sans un conteneur dangereux, sachant que la moitié des escales sont des porte-conteneurs.
M. le Rapporteur : Pour vous, ce conteneur dangereux est clairement identifié ?
M. Francis BREVAULT : Oui, nous connaissons exactement son emplacement.
M. le Rapporteur : Sur tous les bateaux ?
M. Francis BREVAULT : Cela figure sur la déclaration du commandant.
M. le Président : Vous le vérifiez ?
M. Francis BREVAULT : Oui, bien sûr, nous avons sur les B plans, c'est-à-dire sur la liste du chargement, la localisation exacte de la marchandise dangereuse sur le navire. C'est aux Affaires maritimes de contrôler l'emplacement réel, mais elle n'en a plus les moyens. C'est ce que l'on appelle la « ségrégation » de la marchandise dangereuse, concept de l'OMI que nous appliquons.
M. le Rapporteur : Vous dites que vous ne contrôlez plus le positionnement, mais vous pouvez le faire ?
M. Francis BREVAULT : Il nous intéresse en cas d'événement au port. Pour savoir où sont les conteneurs dangereux.
M. le Rapporteur : Parce que, en cas d'incendie, c'est vous qui êtes responsable ?
M. Michel DARCHE : Nous avons parfois quelques occasions de le vérifier. Lorsque nous avons eu un accident sur un portique, par exemple, une demi-heure après j'étais sur le quai. Avec le B Plan, nous avons su tout de suite que le conteneur sur lequel le portique était tombé contenait des marchandises dangereuses ; il s'agissait de bouteilles de parfum.
M. Francis BREVAULT : Lorsque le MSC Carla a cassé au large des Canaries, le dernier port touché était Le Havre. Nous avons donc communiqué l'emplacement exact où se trouvait la marchandise dangereuse à bord. Nous avons pu constater alors qu'elle était partie au fond de l'eau, puisqu'elle était placée sur la partie avant, qui était au fond.
M. le Rapporteur : La qualité des produits des conteneurs vous est adressée quand le bateau quitte le port de départ ?
M. Francis BREVAULT : En principe, il doit y avoir un suivi, une traçabilité. Si c'est du transit, nous devons l'avoir avant que le navire franchisse les digues et quand il s'agit d'import ou d'export, nous devons l'avoir avant. Cela étant, avec la durée de transit entre Anvers et Rotterdam, très souvent, nous avons la liste complète des marchandises dangereuses quand le navire est déjà au port, voire reparti.
M. le Rapporteur : Quand il a fait escale chez vous. Mais s'il y a une crise, vous ne pouvez pas savoir.
M. Francis BREVAULT : Si, parce que le commandant du navire est obligé, avant d'entrer, de déclarer la marchandise dangereuse qu'il a sur un bon de pilotage. Nous avons donc tout de suite le bon de pilotage, que nous confrontons avec la déclaration de l'agent maritime. C'est ce dernier qui doit être en mesure de regrouper toutes les informations des transitaires qui nous donnent la marchandise à l'export ou à l'import. Le transit ne nous arrive pas toujours à temps, mais si nous avons besoin de le connaître, il suffit d'interroger le port de provenance. Nous avons actuellement des échanges au travers d'un système qui s'appelle Protect, sur la marchandise dangereuse, sur sa situation à bord et sur une date d'entrée et de sortie. C'est une plate-forme informatique de marchandises dangereuses qui a été innovée au port du Havre.
M. Michel DARCHE : Dans certains cas, pas si rares d'ailleurs, les choses vont tellement vite qu'un navire peut être le matin en opération à Anvers et dans l'après-midi au Havre. Des marchandises dangereuses chargées le matin sont au Havre à la nuit.
M. le Rapporteur : Vous parliez de plate-forme.
M. Francis BREVAULT : Oui, une plate-forme informatique. Si vous avez le temps, nous pourrons aller la voir.
M. le Rapporteur : De quand date-t-elle ?
M. Francis BREVAULT : Nous sommes encore en train de la développer. Elle a déjà certaines fonctionnalités et permet des échanges avec les autres ports, principalement avec le CROSS Jobourg, car nous venons d'établir une convention avec les Affaires maritimes afin de pouvoir coller aux réalités du terrain et avoir une meilleure traçabilité. Elle est en place depuis deux ans.
M. le Rapporteur : Sa mise en place a-t-elle été liée à un événement particulier ?
M. Francis BREVAULT : Non. Elle est due à une nécessité de travail, notamment celle d'assurer le suivi de la marchandise dangereuse. Notre principal problème est d'imposer aux transitaires des déclarations électroniques. Nous avons tenu quelques grand-messes à cet effet. Nous en avons une bientôt au GHAAM (Groupement Havrais des Armateurs et Agents Maritimes). Toute la complexité de l'affaire est d'analyser toutes les demandes des transitaires, d'une part, de surveiller que tout est bien au carré ; d'autre part, nous pouvons le recevoir par coursier, par fax, par téléphone. Nous leur répondons que puisque l'autorité portuaire peut imposer la déclaration électronique, ils doivent nous faire de la déclaration électronique. Certains ports comme Anvers ont rendu cela obligatoire depuis un certain temps en disant que sinon, non seulement ils relèveraient cela comme une infraction, mais que si on leur envoyait du papier, ils feraient payer le traitement du papier parce que ce n'est pas la même chose quand on est obligé de feuilleter 300 pages de manifeste pour rechercher la classe 2.2 et le conteneur inscrit en mêmes caractères que les autres. On est obligé de taper du poing sur la table en disant : « Attention, vous avez des obligations. Le chargeur doit nous faire la déclaration directe ou par son transitaire. » Mais le chargeur de Clermont-Ferrand ne sait pas toujours comment procéder.
M. le Rapporteur : Vous avez déjà refusé l'entrée de bateaux dangereux ?
M. Francis BREVAULT : Non, nous n'avons jamais refusé. La seule chose, c'est que nous n'avons pas toujours accepté aussi vite que les sauveteurs ou le préfet maritime auraient souhaité que nous le fassions.
M. le Rapporteur : Les nouvelles dispositions qui viennent d'être prises vous gênent-elles ?
M. Francis BREVAULT : Pas du tout, si le principe d'évaluation est appliqué et le risque analysé conjointement. J'ai vu que pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, le préfet maritime pouvait imposer que le navire rentre. Je vois mal comment un port pourrait refuser un paquebot en train de couler. Cela étant, je vois mal aussi que le préfet maritime n'organise pas des secours en amont si le bateau est en train de couler. Il ne va pas dire : « Vous serez sauvés si vous allez au Havre. » Il se donnera les moyens d'agir.
Ma seule réticence - mais quand on analyse les risques, on en revient toujours là - est que l'on doit avoir la qualité non seulement de l'armateur, mais aussi de l'assureur. Vous verrez sur la couverture du document que je vous ai remis, le Happy Fellow. Il transportait du gaz. Il a subi une déchirure complète. En sortant de Seine, il s'est fait aborder par un navire, dont le nez est écrasé, comme vous pouvez le voir sur la dernière image. Ce bateau, avant d'avoir la garantie qu'on allait pouvoir dominer le risque et au cas où il arriverait quelque chose, que l'on puisse le couvrir, n'avait que 500 000 francs de responsabilité. Compte tenu du risque, nous en avons demandé 250 fois plus.
Pour nous, il ne fallait pas que ce bateau coule à l'entrée du port. S'il coule à quai, c'est certainement très ennuyeux, cela paralyse le quai pendant un certain temps, mais imaginez tous les risques encourus s'il coulait durant le transit entre le chenal, les digues et le passage de l'écluse parce qu'il fallait l'envoyer en amont de l'écluse François 1er.
M. le Président : Pour parler de risques encourus, faire venir un navire vers un port comme Le Havre afin de le mettre à l'abri des tempêtes, pour mieux circonscrire éventuellement la pollution, c'est à première vue une solution, mais imaginez les deux morceaux de l'Erika à l'entrée du Havre ! Quelles sont les conséquences ?
M. Francis BREVAULT : Les deux morceaux...
M. le Président : On l'amène vers Le Havre et au lieu de couler comme il a coulé, il coule là, au large.
M. Francis BREVAULT : La pollution est dans la Baie de Seine. C'est le premier élément. Le deuxième élément étant que s'il coule ici, au large du Havre, on ne rentre plus.
M. le Président : Pendant combien de temps ?
M. Francis BREVAULT : Des mois.
M. le Président : Il est donc aussi important d'évaluer les conséquences économiques, écologiques, etc.
M. Francis BREVAULT : Je pense que l'on aurait alors choisi le renflouement du bateau. Il n'est pas question de s'amuser à découper le navire sous l'eau,...
M. le Rapporteur : Ici, dans le port du Havre ?
M. Francis BREVAULT : Dans le port ou dans son chenal. La première mesure à prendre aurait été une opération de renflouement du navire. En fonction de la section dans lequel il est coulé, cela va paralyser le trafic trans-Manche, si l'on arrive par le nord. On pourra peut-être en faire passer quelques-uns uns, tout ne sera peut-être pas paralysé. Mais s'il est planté entre les digues et l'écluse François 1er, il n'y a plus aucun trafic. Tout est paralysé.
Cela a été l'objet de Port 2000 : la sécurité du port. Quand on voit la saturation des mouvements à l'intérieur du port, il est temps de faire quelque chose.
M. le Président : Nous nous sommes aperçus, au cours des auditions, qu'un certain nombre d'accidents n'avaient pas été prévus. Avez-vous envisagé le cas de figure d'un navire qui coule au large du Havre et bloque tout ? Si l'on ne peut plus entrer, on ne peut plus sortir non plus ?
M. Francis BREVAULT : Oui, bien sûr.
M. le Président : Donc certaines navires resteront « scotchés » à l'intérieur ?
M. Francis BREVAULT : Les mesures se prendraient en fonction de l'endroit où ils seraient. Nous n'avons pas de plan de procédure pour chaque cas. Mais il faut bien savoir comment nous serons éventuellement amenés à faire. Il faudrait prévoir cela de la bouée L.H.A (Le Havre atterrissage) jusqu'à l'écluse François 1er, par tronçons de deux cents ou trois cents mètres, et dire ce que l'on ferait dans ce cas. Nous serions obligés de réagir en fonction de l'endroit où il a coulé. Nous n'avons pas travaillé en amont sur cette hypothèse d'un bateau qui coulerait là ou là.
Ce que je redoute ce ne sont pas deux gros bateaux qui se rentrent dedans - il y aura de la casse, ce sera spectaculaire et, malheureusement, peut-être quelques personnes en seront victimes - mais ce qui est plus à craindre, c'est que lors d'un croisement d'un gros porte-conteneurs et d'un petit bateau, le petit bateau se retrouve sous le gros : compte tenu de la réserve de stabilité du petit feeder, il va couler au pied s'il passe sous l'étrave d'un bateau de 80 000 tonnes qui rentre parce qu'il a eu une avarie de barre. S'il est coulé, ce sera un obstacle. Ce ne sera pas aussi impressionnant que l'Erika, il ne va pas se planter, il se couchera probablement sur le fond et cela fera une bosse de la largeur du navire. Pour les gros pétroliers de la CIM, la navigation sera impossible.
C'est au cas par cas que l'on doit juger de la pertinence des opérations à conduire.
Il faut savoir, ce qui n'apparaît pas au Secrétariat général de la mer, que le port, compte tenu du risque que représente un navire qui fuit ou qui brûle, peut juger qu'il serait beaucoup mieux dehors. De ce point de vue aussi, il y a une évaluation des risques à effectuer en attirant l'attention du préfet de région et du préfet de département, quitte à leur faire demander à leur collègue préfet maritime de prendre le bateau qui présente plus de risques au port qu'en mer et donc, d'accepter qu'il aille polluer à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. La situation se complique...
M. le Rapporteur : Ce n'est jamais arrivé ?
M. Francis BREVAULT : A Marseille, il y a une dizaine d'années. Il est rentré et on a estimé qu'il valait mieux qu'il aille dehors. Il est arrivé aussi que l'on pétarde des navires pour les couler au large.
M. le Rapporteur : Au large ?
M. Francis BREVAULT : Oui, quand on peut.
Vous savez dans le problème du politiquement correct, si l'Erika n'avait pas cassé, qu'aurait-il fallu faire ? L'envoyer sur la plage à La Baule. S'il arrive un tel accident ici, nous disons que s'il faut envoyer le navire quelque part, c'est à Deauville.
M. le Rapporteur : La décision est difficile à prendre.
M. le Président : Que pensez-vous de l'hypothèse que j'ai entendue de mise en _uvre de moyens lourds permettant de tracter ces bateaux subissant des avaries fortes plus au large, d'évacuer les personnes à bord ?
M. Francis BREVAULT : M. le président, vous avez vu, quand il fait mauvais temps, on n'arrive pas à remorquer. L'Erika, il n'a pas été possible de le remorquer. Il a fait 0,4 mille. Même avec un très gros remorqueur comme celui qui y était, par vent de force 7 ou 8, cela n'avance pas. Cela maintient éventuellement une dérive, cela permet de tenir un cap, mais l'avant de l'Erika a coulé à 0,4 mille de l'arrière. On ne peut pas faire grand chose dans ces cas.
Mais il est certain que dans l'accueil des navires en difficulté puisque nous sommes obligés de l'évoquer, la première chose est cette évaluation commune. Que l'on ne trouve pas une décision du préfet maritime qui dise de faire route vers Le Havre et qu'arrivé au Havre, le commandant de port dise qu'il n'en veut pas.
Nous avons déjà eu des missions avec le chef du centre de sécurité des navires : M. Arnold, responsable chargé de la sécurité à la Capitainerie, était parti avec lui en Angleterre pour faire traverser un gros tanker sur lequel on nous signalait une petite déchirure. Les Anglais n'en voulaient plus à Lyme Bay et il faisait mauvais temps. Il y avait un vent de noroît assez fort, il ne pouvait pas redoubler la Cornouaille pour aller là-bas. Donc le seul port qui était susceptible de le recevoir était Antifer. Pourquoi pas ? La difficulté était de lui faire traverser la Manche. Il avait une déchirure, mais de quelle ampleur et avec quelles conséquences possibles ?
Nous sommes allés voir. La fuite faisait 600 mètres carrés, 20 par 30. Elle ne présentait pas de risque pour une opération commerciale au port d'Antifer. Lui faire traverser la Manche, nous aurions su mais ensuite que faire ? Une fois le navire déchargé, les Affaires maritimes vont le bloquer au port. Imaginez ce navire bloqué à Antifer : il va certainement gêner les escales des autres. Dans cette évaluation, il faut donc analyser jusqu'au bout les conséquences de la décision. Nous voulons bien décharger le navire mais une fois déchargé, il n'est pas question qu'il soit bloqué au port, parce que sinon, nous perdons en termes d'exploitation... Vous lirez l'exemple du Ming Fortune. Nous avons sauvé ce navire. Cela étant, comme il a été bloqué par les Affaires maritimes, par mesure de rétorsion, nos amis taiwanais ne comprenant pas que le directeur du port n'étant pas la même organisation que les Affaires maritimes, nous ont abandonné pendant un an à un an et demi en disant que nous les avions bloqués au port du Havre pour faire marcher notre réparation. C'est faux, c'était une décision du chef du centre de sécurité des navires, qui disait qu'il ne pouvait pas reprendre la mer. Comme Le Havre n'avait pas été choisi pour faire la réparation, ils ne voulaient pas le laisser sortir. L'autorité portuaire était accusée.
M. le Rapporteur : En dehors du pétrole, quel type de marchandises dangereuses transitent par Le Havre ? Dans quelles proportions ?
M. Francis BREVAULT : Tout ce qui est chimie, butane, propane...
Je vous donnerai la liste. Je n'en connais pas la proportion, mais je peux vous la donner pour 1998 et 1999.
M. le Rapporteur : Combien de personnes du bureau des marchandises dangereuses interviennent sur les bateaux pour constater que le chargement et le déchargement se fait correctement ?
M. Francis BREVAULT : Cinq.
M. le Rapporteur : Tous les bateaux de transport dangereux sont-ils systématiquement contrôlés ?
M. Francis BREVAULT : Systématiquement. Mais, pour l'instant, nous ne pouvons y procéder ni le samedi ni le dimanche parce que, dans l'organisation actuelle, le bureau s'occupe du terre-plein et de la sécurité. L'analyse des dossiers est prioritaire et, comme il y a moins d'activité des agents maritimes ces jours-là, il a la nécessité d'étudier et de préparer le travail. Nous devrions améliorer le système de suivi permanent des navires en escale avec la fermeture de l'écluse et les officiers de port que nous récupérerons.
M. le Rapporteur : C'est pour éviter un incident dans le port ?
M. Michel DARCHE : Un incident sur les opérations de chargement et de déchargement car ce sont celles dont nous avons la charge.
M. Francis BREVAULT : Mais nous n'avons pas d'officier de port pour contrôler en permanence les moments fléchissants ou les efforts tranchants du navire. Du moment que la check list est bien remplie, il y a deux ou trois contrôles, mais l'officier de port ne reste pas en permanence.
M. Michel DARCHE : Nos officiers de port sont des marins exploitants, ce sont des gens qui ont navigué, qui étaient sur la passerelle. Ce ne sont pas des mécaniciens ou des constructeurs. Ce sont des gens qui savent comment fonctionne un navire. Même s'ils ne connaissent pas forcément la structure de ces navires, ils savent les utiliser.
M. Francis BREVAULT : Ce ne sont pas des constructeurs. Mais ils connaissent les conséquences de défauts de construction ou d'usure de structures.
M. Michel DARCHE : Oui, ils connaissent les ficelles du métier.
M. le Rapporteur : Par le biais de la plate-forme informatique, vous avez la composition du chargement. Avez-vous également sur la même donnée l'identification du bateau avec ses caractéristiques ?
Est-il complètement absurde de vous interroger sur l'opportunité d'une relation des données issues de cette plate-forme informatique et du système Equasis qui doit être mis en place ?
M. Francis BREVAULT : Cela peut tout à fait être complémentaire. D'ailleurs, j'ai reçu ici la personne chargée du développement d'Equasis avec le chef du centre de sécurité.
M. le Rapporteur : Existe-t-il une plate-forme informatique du même type concernant les produits dangereux à Rotterdam ou à Anvers ?
M. Francis BREVAULT : C'est en effet le cas à Anvers et Rotterdam. Pour ce qui est des ports français, je puis vous dire que Marseille est venu voir la nôtre avant-hier.
M. le Rapporteur : Sinon, vous êtes les seuls à avoir cela sur Manche - Mer du Nord ?
M. Francis BREVAULT : Dunkerque avait suivi, mais c'est plus au regard de sa propre organisation dans l'autorité portuaire, dans le fonctionnement, la collecte, l'analyse, les moyens...
M. le Rapporteur : A Saint-Nazaire ?
M. Francis BREVAULT : Non.
M. le Rapporteur : En Grande-Bretagne ?
M. Francis BREVAULT : Je crois que Felixstowe dispose d'une base de données.
M. le Rapporteur : Le même système ?
M. Francis BREVAULT : Pas exactement le même, mais la possibilité de faire des échanges entre X400 et les autres.
M. le Rapporteur : J'aimerais que nous puissions voir la vôtre si nous avons le temps.
M. Francis BREVAULT : Oui, bien sûr. Sinon, je vous ferai une note à ce sujet. Je vous ferai également parvenir le pourcentage des marchandises dangereuses passant par Le Havre.
M. le Rapporteur : Avant de partir, j'aimerais savoir quelles sont vos relations avec les Affaires maritimes.
M. Francis BREVAULT : Elles sont bonnes.
M. Michel DARCHE : Mais nous avons des intérêts qui sont parfois divergents. Des décisions prises par les Affaires maritimes peuvent être lourdes de conséquences pour nous.
M. Francis BREVAULT : Pour l'instant, ils se drapent dans un effet de dignité, affirmant que c'est à eux de faire le contrôle. Mais ils ne peuvent le faire vraiment par manque de moyens.
M. le Rapporteur : De votre côté, avez-vous parfois le sentiment de manquer de moyens ?
M. Francis BREVAULT : Oui, mais nous, nous pouvons nous donner les moyens d'en avoir. Nous avons vu l'effet d'annonce des trente officiers de port. Malheureusement, sur les trente-cinq postes à pourvoir, il y a eu seulement vingt-cinq candidatures. Aujourd'hui, l'officier de la marine marchande est très courtisé. Auparavant, nous pouvions en avoir dans les ports mais c'est plus difficile à l'heure actuelle.
Audition de M. Jean-Yves BERROCHE, directeur régional des affaires maritimes,
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ, chef du centre de sécurité des navires du Havre,
M. AUZOU, inspecteur du centre de sécurité,
et M. LE SAOUT, administrateur des affaires maritimes
(extrait du procès-verbal de la séance du 27 mars 2000 Au Havre)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Jean-Yves Berroche, Jean-Paul Guénolé, Auzou et Le Saout sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Jean-Yves Berroche, Jean-Paul Guénolé, Auzou et Le Saout prêtent serment.
M. Jean-Yves BERROCHE : Je suis heureux de recevoir votre Commission et espère que cette journée d'explication sur le terrain sera éclairante sur la prise en compte des impératifs de sécurité pour les marins et du respect de l'environnement maritime.
Recevoir votre Commission d'enquête est un événement majeur pour la Direction des affaires maritimes ; elle est à la mesure du risque que représente la navigation de navires dangereux et sous normes transportant des produits polluants.
Je me permettrai de rappeler deux attributions prioritaires de la Direction des affaires maritimes, pour que vous voyez bien comment nous nous situons par rapport aux travaux de la commission.
Les deux missions essentielles des Affaires maritimes sont, d'une part, la gestion du marin, avec toutes les implications sociales, de formation et d'application du code du travail maritime - même si ce n'est pas aujourd'hui votre souci premier, c'est pour nous une attribution majeure -, et d'autre part, une mission qui contribuera sans doute à la pérennité des affaires maritimes, la sécurité du navire. C'est le domaine, au plan technique, des centres de sécurité des navires pour l'aspect contrôle et, au plan opérationnel, des CROSS, qui assurent le volet sauvegarde de la vie humaine en mer et le volet sécurité de la navigation. Ce sont les deux structures techniques et opérationnelles des Affaires maritimes qui interfèrent dans ce domaine.
M. Guénolé, qui est à ma droite, est le chef du centre de sécurité du Havre. Ce dernier est vraisemblablement le centre le plus exposé aux risques en France pour le trafic pétrolier recensé. Transitent en Baie de Seine 35 millions de tonnes de produits pétroliers entre Antifer et Le Havre ; en ajoutant l'aval de la Seine, nous atteignons 40 millions de tonnes, chiffre tout à fait considérable.
M. Guénolé vous exposera les conditions d'exercice du centre de sécurité des navires, avant de répondre à vos interrogations.
Mais au préalable, je présenterai très brièvement - je m'y engage - la situation des risques du transport maritime au plan régional. Celle-ci constitue une bonne « illustration » de l'ensemble du débat. En effet, le complexe constitué par les ports autonomes de Rouen et du Havre est le plus gros centre d'accueil de produits noirs de France. Ces vracs passent chaque jour le long des berges de la Seine, sous nos falaises, de Port Jérôme à Antifer.
La Direction des affaires maritimes et ses deux centres de sécurité du Havre et de Rouen veillent avec la plus grande attention aux mouvements des navires en baie de Seine, très soucieux que nous sommes du respect des normes de sécurité. Le chenal de Seine, lieu particulièrement fragile et sensible au plan écologique, attire un trafic commercial maritime constitué pour moitié de pétroliers.
Pour faire prévaloir les impératifs de sécurité que mon administration a en charge, je dispose en premier lieu de deux tours de contrôle : le CROSS Jobourg, à la pointe du Cotentin, et le CROSS Gris- Nez, au niveau du 50ème parallèle dans le Pas-de-Calais, situés tous deux juste en face de dispositifs de séparation de trafic. Ces centres exercent une fonction de sauvegarde de la vie humaine en mer, une fonction d'assistance aux navires en difficulté et une fonction de suivi de la navigation qui monte aujourd'hui en puissance, avec probablement la création d'un centre international de recueil des données des navires et de suivi du trafic à partir de 2001. Ces centres assurent enfin une fonction d'information au titre de la prévention...
M. le Rapporteur : Quand vous parlez d'un centre international, à quoi faites-vous allusion ?
M. Jean-Yves BERROCHE : Au sein de la structure de Jobourg sera créé un centre international de recueil et d'exploitation des données pour le suivi du trafic maritime entre Gibraltar et Rotterdam. Toutes les informations seront centralisées au CROSS Jobourg, qui sera connecté avec EQUASIS, ce qui permettra d'avoir en temps réel l'identification des navires, leur situation en termes de caractéristiques - transport ou non de produits dangereux - et en termes d'identification des marchandises à bord. Cette base de données préfigurera le dispositif futur qui sera, nous le pensons, celui de l'attribution d'une lettre ou d'un certificat de conformité aux navires qui voudront accéder à nos ports. Mais c'est une vision qui est un peu plus lointaine, dont nous pourrons reparler tout à l'heure.
Nous disposons donc de ces deux centres qui sont, avec les centres de sécurité, des atouts absolument majeurs de suivi et de respect des normes de sécurité.
En second lieu, mes services entretiennent des relations étroites avec le préfet maritime de la Manche - Mer du nord, qui est en charge de la circulation maritime et coordonnateur de la mise en _uvre des moyens affectés au secours des navires en difficulté et à la lutte contre la pollution. Nous travaillons de plus en plus en synergie avec le préfet maritime, dont le rôle, je le rappelle, est d'exercer l'action de l'Etat en mer au titre des intérêts civils, et absolument pas un rôle au titre de la Marine nationale.
D'autres produits polluants et dangereux transitent dans notre région. C'est en Haute-Normandie, sur les bords de Seine, que se trouve la plus grande concentration de France d'usines relevant de la directive Seveso. Nous avons du côté de Port-Jérôme et au sud de Rouen cinquante établissements et vingt et un assimilés, qui exportent en conteneurs les produits de cette industrie chimique. Je pense notamment au pyralène. Pour l'ensemble de la région, ces flux maritimes de produits chimiques représentent 20 % des vingt millions de tonnes de matières dangereuses, soit 4 millions de tonnes, auxquels s'ajoutent pour le secteur havrais et la Manche - Mer du nord les produits phytosanitaires et les produits contenant des substances nucléaires entre la zone du Havre et la Russie, et entre le port de Calais et le port de Douvres, parce que, comme vous le savez, les produits contenant des substances nucléaires sont interdits de passage dans le tunnel sous la Manche.
Une grande partie de ces trafics de produits dangereux que je viens de mentionner est opérée par des navires battant pavillon étranger. Pour ceux qui touchent les ports de Rouen et du Havre, cela représente 90 à 95 % de la flotte.
M. le Rapporteur : Y compris les bateaux qui transportent des produits nucléaires ?
M. Jean-Yves BERROCHE : Oui.
M. le Rapporteur : Quand vous parlez de produits nucléaires, de quoi s'agit-il ?
M. Jean-Yves BERROCHE : Je ne saurais trop vous le dire. Ce sont des éléments issus des relations que nous avons à partir de la centrale de Gravelines avec l'Angleterre. Mais je n'ai pas d'informations plus précises sur ce point.
M. le Rapporteur : C'est donc essentiellement entre Dunkerque et Douvres ?
M. Jean-Yves BERROCHE : Entre le port de Calais et Douvres. Il s'agit du trafic camions qui n'est pas autorisé à emprunter le tunnel et qui doit nécessairement passer sur les bateaux, pour lequel il existe d'ailleurs des bateaux spécialisés dans le transport de ces camions, qui ne sont pas transportés avec des passagers.
Par rapport aux 90 % de navires étrangers que j'évoquais précédemment, la plupart battent pavillon dit économique, pavillon de complaisance, et représentent 80 % des 90 % de la flotte étrangère passant dans nos eaux. C'est un pourcentage auquel on peut se fier.
Pour ces raisons, m'appuyant sur les conclusions du rapport du BEA-mer, dans ses conclusions sur le naufrage de l'Erika, j'ai retenu pour le secteur Le Havre-Rouen, que les produits pétroliers les plus dangereux et les plus polluants sont transportés par les navires pétroliers les moins sûrs. A cet égard, j'ai parfois l'impression, dans cet écoulement de trafic, que nous vivons, au sein des Affaires maritimes, sur un tonneau de poudre... ou de produits chimiques.
En ma qualité de directeur des affaires maritimes et de président de la commission régionale de sécurité pour la façade Manche - Mer du nord, j'ai initié une réorientation de l'activité du contrôle des navires sur les pétroliers. Les décisions du 6 mai, dont le renforcement annoncé des moyens des centres de sécurité des navires, m'incitent à le faire avec détermination.
Le message dont je voudrais vous faire part en guise de conclusion, c'est que pour les intérêts de la sécurité maritime, deux types de mesures de prévention me paraissent revêtir une importance et une priorité absolues.
Premièrement, c'est le contrôle a priori des navires qui accèdent à nos ports, qui devront nécessairement et, espérons-le à court terme, pouvoir justifier, comme je le disais précédemment, d'une lettre ou d'un certificat de conformité aux normes de sécurité ; cette lettre de conformité étant naturellement délivrée par l'autorité maritime de l'Etat d'accueil. C'est l'aspect préventif du travail d'un centre de sécurité.
Deuxièmement, c'est le signalement obligatoire de tout navire auprès des CROSS, c'est-à-dire de tout navire à destination des eaux communautaires, qui permet l'identification des navires et de leur cargaison et vise à s'assurer de leur situation régulière au regard de la réglementation, qu'elle soit nationale ou européenne. C'est l'aspect CROSS.
Tous deux me paraissent majeurs, la prévention devant primer sur les mesures de répression et de contrôle dont va vous parler M. Guénolé. Je cesse là mon propos et, sans transition, lui cède la parole.
M. le Président : Pourriez-vous nous présenter rapidement les personnes qui vous accompagnent ?
M. Jean-Yves BERROCHE : M. Guénolé est administrateur en chef des affaires maritimes et chef du centre de sécurité des navires du Havre, auquel je demanderai de nous exposer le cas du Mimosa, exemple tout à fait illustrant du rôle du centre de sécurité des navires en termes d'interdiction de navigation. M. Auzou est inspecteur du centre de sécurité des navires du Havre et chef mécanicien. Enfin, mon adjoint, M. Le Saout, est administrateur des affaires maritimes.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Le centre de sécurité a constitué un petit dossier, qui comprend une présentation synthétique des centres de sécurité et de leur action, puis en forme de réponse aux problèmes qui se déduisent de cette présentation, le numéro de mars 2000 du bulletin Amarres, qui est la revue de la direction des Affaires maritimes et des Gens de mer, dans lequel est repris le texte de la Charte sur la sécurité maritime et les mesures décidées lors du dernier comité interministériel de la mer (CIM), ainsi que quelques autres éléments.
Vous trouverez également dans ce dossier, pour la partie strictement réglementaire, des feuillets concernant le contrôle par l'Etat du port, c'est-à-dire les dispositions réglementaires que nous avons à appliquer pour le contrôle des navires étrangers. Sans multiplier la documentation, il s'agit de la transposition en droit interne des dispositions européennes, de celles du Mémorandum de Paris et de la résolution 787 de l'OMI sur le sujet.
J'y ai ajouté un rapport de l'OCDE de 1996, que vous avez peut-être déjà par ailleurs, dont le titre est évocateur : Avantages concurrentiels dont bénéficient certains armateurs du fait de l'inobservation des règles et normes internationales en vigueur. Je l'ai inséré, bien que l'aspect économique n'entre pas du tout dans les préoccupations du centre de sécurité. Mais il n'était pas inintéressant.
M. le Président : Cela fait partie de nos préoccupations.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Je vais donc vous parler maintenant du Mimosa, pour vous montrer la nature des problèmes auxquels nous pouvons être confrontés en centre de sécurité. Le Mimosa était - je ne sais s'il l'est toujours - en janvier 1995, un pétrolier de dix-huit ans d'âge battant pavillon norvégien bis, c'est-à-dire NIS, chargé de 330 000 tonnes de pétrole brut de Mer du nord, chargées au terminal BP au nord de l'Ecosse et faisant route vers les Etats-Unis, par très mauvais temps puisqu'il y avait force 10.
Ayant constaté que le navire avait de l'assiette et était sur le nez, le capitaine et son second se sont aperçus que le peak avant, l'extrême avant, était plein d'eau. Un pic avant plein d'eau, cela représente 10 000 tonnes. Ce n'est pas rien s'agissant d'un navire de près de 350 mètres de long ; le capitaine a donc décidé de ne pas faire route vers les Etats-Unis et de venir se mettre à l'abri en Grande-Bretagne, bien évidemment avec l'accord des Coast Guards. Les autorités britanniques, de concert avec l'armateur, ont contacté le préfet maritime à Cherbourg pour avoir l'autorisation de venir décharger à Antifer, parce que c'était la solution économiquement la plus intéressante.
Pour prendre sa décision, le préfet maritime, en accord avec le directeur régional, a désigné une équipe d'évaluation qui comprenait un inspecteur du centre de sécurité, ancien chef mécanicien, M. Arnold que vous avez peut-être vu ce matin, aujourd'hui responsable de la sécurité au port autonome, qui est un ancien commandant de navire de commerce, et moi-même. Nous nous sommes donc rendus à Brixham pour inspecter ce navire et fournir un avis au Préfet maritime. Nous n'avons pas pu le faire parce qu'il faisait trop mauvais, il y avait trois mètres de creux et trente-cinq n_uds de vent. Il était trop dangereux d'être hélitreuillés et de monter à bord du navire.
J'ai dû donner un avis au préfet maritime, avec MM. Arnold et Thoumire, l'inspecteur qui était avec moi, après avoir visionné la vidéo des plongeurs qui étaient allés inspecter la coque et après avoir discuté avec l'armateur et la société de classification, étant bien entendu que je ne me concertais pas avec mes collègues anglais puisque l'on discutait d'autorité à autorité. La réunion a rassemblé une quinzaine de personnes autour d'une table durant tout un après-midi.
L'avarie était la suivante : il manquait 400 mètres carrés de tôle à l'étrave qui étaient tombés à l'intérieur sous l'effet de la mer. J'ai rendu au préfet maritime un rapport dûment circonstancié que j'ai rédigé dans la nuit parce qu'il faisait mauvais et qu'il fallait prendre une décision rapide, qui lui est parvenu par fax et dont la conclusion était un avis défavorable à la venue du navire à Antifer, car je n'étais pas sûr que la structure du navire tiendrait, même durant ce petit voyage de 100 milles nautiques, par une mer de force 10. Le premier élément dont il fallait se rappeler était celui-là : 330 000 tonnes de pétrole brut, soit une fois et demi l'Amoco Cadiz, si l'on veut le prendre comme étalon.
Ce qu'il est intéressant de tirer comme enseignement de cette affaire, outre le fait qu'il n'y a eu ni casse ni pollution, est qu'elle s'est terminée par un allégement sur place, en faisant venir trois allégeurs de 150 000 tonnes chacun, trois pétroliers plus petits, pour un transbordement du gros dans chacun d'eux.
Il est intéressant, dans cette affaire, de voir pourquoi nous en sommes arrivés là.
Ce navire était sous pavillon norvégien NIS, un pavillon un peu parallèle, sans souci de polémique, à ce que nous connaissons chez nous, avec le pavillon Kerguelen, chez les Anglais, l'île de Man, chez les Danois, le DIS. Chacun a son pavillon qui n'est pas strictement le pavillon métropolitain. Ce navire avait un équipage composé de cinq nationalités différentes. Il était surveillé par le DNV, qui est à la Norvège ce que le bureau Veritas est à la France, c'est-à-dire la société de classification nationale.
M. le Rapporteur : Un organisme sérieux ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Il fait partie des grandes sociétés de classification de l'IACS.
Ce navire naviguait sans aucun contrôle direct de l'administration norvégienne, tout était entièrement délégué à la société de classification. Vous n'aviez qu'un contrôle relativement formel sur l'effectif minimum du navire, c'est-à-dire sur le nombre de marins qu'il faut mettre à tel ou tel poste à bord, car cet aspect du contrôle relève obligatoirement de l'Etat du pavillon et il n'est pas possible de le déléguer aux sociétés de classification.
Cet exemple du Mimosa est particulièrement significatif, car la quasi-totalité des problèmes de contrôle par l'Etat du port que nous rencontrons avec les navires que nous arrêtons sont le fait de navires qui ne sont pas soumis au contrôle de fait de l'administration du pavillon elle-même, même ponctuel, même épisodique.
A cet égard, en France, nous faisons le contraire puisque nous vérifions tous les navires Kerguélen comme s'ils étaient sous régime métropolitain, du point de vue de la sécurité. Cet exemple est instructif à ce titre.
M. le Rapporteur : A votre avis, un contrôle de l'administration aurait-il permis de s'apercevoir de la lacune ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Peut-être pas, parce que l'exercice n'est pas facile.
M. le Président : Cela veut dire que parmi des pavillons NIS, réputés sérieux...
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Oui !...
M. le Président : ...même dans un pays à forte tradition maritime comme la Norvège, certains ne font pas l'objet de contrôles par l'Etat du pavillon.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Tout le problème est là. Déléguer c'est bien, mais ce n'est pas facile car cela suppose un partage des tâches, sauf si c'est zéro ou cent. Zéro, on ne délègue rien ; cent, on délègue tout.
Si on délègue, le problème réside dans le contrôle de l'exercice de la délégation. Si vous faites un contrôle par audit au siège de la société de classification - puisque cela fonctionne ainsi, par un système qualité -, vous allez à Oslo, vous allez à Paris au Bureau Veritas. Vous voyez un certain nombre de choses, mais il y a le c_ur du problème et il y a un système qualité qui l'enrobe. Quand vous faites un audit de société de classification au siège, vous ne voyez que l'enrobage. Sur les navires, au cas par cas, nous allons au centre du problème, par nécessité et par fonction. C'est comme cela que l'on vérifie vraiment !
M. le Président : Peut-on avoir la liste des Etats du pavillon qui délèguent, comme la Norvège ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Absolument. Vous l'aurez en vous adressant à l'OMI puisqu'il doit obligatoirement être fait état à l'OMI des délégations accordées.
M. le Rapporteur : En Norvège, la délégation est totale pour tout contrôle ? Il n'y a pas d'administration maritime ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Pas à ma connaissance.
M. le Rapporteur : Pour le NIS ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Oui.
M. le Rapporteur : Mais ce n'est pas le cas pour le pavillon plein ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Pour le norvégien plein, c'est comme chez nous pour le pavillon métropolitain, du moins je le suppose.
M. le Rapporteur : Cela veut dire qu'il existe une administration pour contrôler les normes du pavillon plein, mais par pour le NIS.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Ce que l'on nous dit - que je n'ai évidemment pas pu vérifier parce que pour cela, il faut être dans le système - c'est qu'entre l'administration norvégienne, le DNV et les armements, les experts tournent.
M. le Rapporteur : Les mêmes ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : C'est ce que l'on m'a dit. Je ne suis pas en mesure de le vérifier.
M. Jean-Yves BERROCHE : J'ai la réponse concernant les produits nucléaires. Il s'agit, premièrement, d'uranium enrichi à destination de la Fédération de Russie, aux termes d'un très vieux contrat passé il y a une trentaine d'années, deuxièmement, de minerai d'uranium, plus précisément d'hexafluorure d'uranium, en provenance de pays d'Afrique, et troisièmement, de préexportation, préconditionnement de marchandises nucléaires vers le Japon. Telles sont les trois catégories de transport de substances nucléaires.
M. le Rapporteur : Que vous avez à contrôler ?
M. Jean-Yves BERROCHE : Qui passent par Le Havre. Le Havre est une plate-forme pour l'expédition, le conditionnement et la réception de marchandises nucléaires.
M. le Rapporteur : Cela se fait dans quel secteur du port du Havre ?
M. Jean-Yves BERROCHE : Je ne sais pas. M. Guénolé, peut-être le savez-vous ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Je ne sais pas exactement. En amont de François Ier. En tout cas, ce n'est pas dans la partie basse du port.
M. le Rapporteur : Mais il existe un quai identifié et protégé ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Je ne sais pas. C'est le commandant du port qui pourrait vous répondre. Je sais qu'il y a un parc à marchandises dangereuses.
M. le Rapporteur : Nous le savons aussi. Il en a été question lors de la première audition, ce matin.
Pourrais-je savoir, concernant ce trafic de matières dangereuses nucléaires pour les années 1998 et 1999, les bateaux qui ont transporté ces matières, avec leur pavillon et leur âge ? Je vous le demande formellement.
M. Jean-Yves BERROCHE : Pourrons-nous vous l'adresser par la suite ?
M. le Rapporteur : Oui ; les produits, l'âge, la nationalité des bateaux et leur société de classification.
M. Jean-Yves BERROCHE : Nous vous indiquerons aussi, si vous le souhaitez, les substances qui sont transportées majoritairement entre Calais et Douvres.
M. le Rapporteur : Oui.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Après cet exemple du Mimosa, je reviens au cadre plus général. Dans un centre de sécurité, les missions sont les suivantes.
Premièrement, nous assurons le contrôle de la sécurité des navires français de commerce, de pêche et de plaisance au titre de nos attributions d'Etat du pavillon avec, dans le cas des navires de commerce, les responsabilités qui découlent de la ratification par la France des conventions de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de l'Organisation internationale du Travail (OIT). Nous appliquons pour ces bâtiments la réglementation internationale, les normes de sécurité internationales ainsi que, le cas échéant lorsqu'il existe, le supplément prévu par la loi et le règlement français.
Deuxièmement, nous contrôlons également la sécurité des navires étrangers de commerce sur la base des normes de sécurité internationales de l'OMI et de l'OIT, au titre du contrôle par l'Etat du port avec, puisque nous sommes sur le territoire français, les procédures prévues par la loi et les règlements français. Exemple de procédure : nous sommes habilités, M. Auzou et moi, à inspecter les navires étrangers. Tous les inspecteurs qui font du contrôle de navires étrangers ont une carte d'inspecteur.
Troisièmement, autre mission qui ne concerne pas directement les navires mais qui est plutôt un service aux autres secteurs administratifs des affaires maritimes, nous apportons un appui technique en matière de contrôle des effectifs à bord des navires, en matière de dérogations de brevets - puisqu'il y a des règles, il y a forcément des exceptions -, en matière d'examen et de concours de la marine marchande et en matière d'application du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. L'enquête du BEA-mer est une enquête technique et administrative au sens du décret de 1981, les enquêtes nautiques sont des enquêtes pénales telles que prévues par la loi de 1926 et les commissions d'enquête comptent forcément un inspecteur du centre de sécurité, voire plus, autant que de besoin.
Nous fournissons également un avis technique sur les dossiers économiques de construction de navires de pêche, ainsi qu'un avis technique sur les autorisations exceptionnelles de transport de passagers à bord, concernant notamment de petits navires de commerce portuaire ou de pêche lors des manifestations bien connues des Fêtes de la mer qui, en général, suscitent un fort afflux de personnes. Tout cela obéit au principe de précaution.
Nous avons, bien entendu, nos propres contingences de fonctionnement. Lorsque nous faisons un contrôle de navire, en particulier de navire français, nous remplissons un rapport de visite qui répond à un certain format, avec ou sans prescriptions. Lorsqu'il y a prescription, par nature, c'est une décision administrative qui doit être notifiée dans les règles et dans les formes.
Le contrôle des navires, qui est notre mission essentielle, s'opère en deux temps ; je parle là du contrôle de la sécurité des navires français et ne m'intéresse qu'aux navires de commerce - pour pouvoir vous faire percevoir les différences de contrôle entre navires français et navires étrangers - et plus précisément aux navires d'un certain tonnage, ceux de plus de 500 UMS destinés à une navigation internationale.
Le premier temps est le passage obligatoire du dossier par une commission d'étude.
M. le Rapporteur : UMS ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Universal Metric System. C'est le nouveau système de jauge qui a remplacé les tonneaux. Les tonneaux, c'était la convention d'Oslo de 1949, me semble-t-il, et les UMS, c'est la convention de Londres de 1969, qui a des implications énormes, parce que la jauge sert de calcul à énormément de droits - droit de port, droit de douane, etc. Cette convention est entrée en application pour les navires neufs en 1982 et pour les navires existants en 1994. Elle est relativement récente et donne une idée du délai pour une entrée en vigueur pleine et entière : vingt-cinq années !
Je vais traiter de ces navires car cela permet d'établir le parallèle entre les navires de commerce français et étrangers.
Pour les navires français, la première étape obligatoire est le passage du dossier devant une commission d'étude. Généralement, pour ces navires, il s'agit de la commission centrale de sécurité, qui se trouve à Paris et qui, conformément au décret, est présidée par le ministre ès qualité et dont la présidence est, en fait, déléguée au sous-directeur de la sécurité maritime, M. Beaugrand que vous avez certainement rencontré, un des sous-directeurs placé sous les ordres de M. Serradji, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer.
Une fois que la commission d'étude a fait son travail, qu'elle s'est réunie autour d'une table avec un rapporteur, qu'elle a épluché tout le dossier et fait des remarques et que l'armateur en a tenu compte au fur et à mesure de la construction de son navire, nous passons à la seconde étape, celle des commissions de visite.
Ces commissions de visite sont le fait des centres de sécurité des navires, des gens se rendent à bord.
Le système français des commissions de visite, en cela conforme au système international, comprend une visite de mise en service pour commencer, puis des visites annuelles. Nous voyons donc le navire tous les douze mois.
M. le Rapporteur : Les navires qui passent dans le port ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Non, nous allons les chercher là où ils sont.
M. le Rapporteur : Vous parlez de ceux qui sont immatriculés en France ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Il s'agit de ceux immatriculés en France et rattachés au centre de sécurité du Havre car le rattachement d'un navire ne se fait pas à l'administration française en général, mais à un...
M. le Rapporteur : ...centre de sécurité.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Voilà.
Pour les navires immatriculés en métropole, le rattachement est d'office celui du port d'immatriculation. Un navire immatriculé au Havre sera automatiquement rattaché au centre de sécurité du Havre, l'immatriculation étant la partie administrative et la sécurité la partie technique. Un navire immatriculé aux Iles Kerguelen, aux TAAF, aura un centre de sécurité de rattachement.
M. le Rapporteur : Par qui est décidé son rattachement à tel ou tel centre ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Par Paris, par la sous-direction de la sécurité des navires en fonction de la demande de l'armateur et aussi des contingences des services pour avoir une certaine répartition des tâches.
J'en cite un exemple significatif : France Shipmanagement - shipmanager comme on dit, ou gérant de navires - a récupéré au fil des années des navires qui appartenaient auparavant à BP France, à Total France et à Shell France. Ces navires étaient répartis entre des centres de sécurité de Dunkerque, du Havre et de Saint-Nazaire. On s'est donc retrouvé, à partir d'armements différents, avec un seul shipmanager, dont le siège était à Nantes. Etant donné qu'il fallait assurer la continuité, que chaque centre de sécurité connaissait ses navires, on les y a laissés, jusqu'à ce qu'ils sortent de flotte. Par contre, les navires neufs qui viennent sous pavillon français et qui sont pris par France Shipmanagement, qui est maintenant installé en Belgique, sont tous rattachés par souci d'unité au centre de sécurité de Saint-Nazaire, parce que son suivi administratif relève de la direction départementale de Nantes.
C'est souvent ainsi que l'on procède. Retenez donc que jamais un navire français n'est lâché dans la nature sans avoir un quartier de rattachement pour ses affaires administratives et un centre de sécurité de rattachement pour ses affaires techniques. Cela signifie que quand un armateur demande sa visite annuelle - tous les douze mois, plus ou moins trois mois puisque c'est le créneau accordé par la réglementation -, il ne va pas la demander à un centre de sécurité quelconque mais à son centre de sécurité de rattachement qui l'assure lui-même ou demande le concours d'un autre centre de sécurité. De cette façon, nous avons un réel suivi. Sinon, les visites seraient éparpillées et le risque serait évidemment que les navires puissent passer au travers.
M. le Président : Quand il le demande à un autre centre de sécurité, il s'adresse à un centre français ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Oui.
M. le Président : Pas question que ce soit un autre centre de sécurité en Europe au sein de l'Union ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Non. A ce titre, j'ai refusé il n'y a pas très longtemps, en 1999, au consul d'Italie à Paris, de procéder à une visite de sécurité de l'un de ses navires, qui était un cas un peu particulier. Il s'agissait d'un navire rapide, un NGV, forme catamaran à coque en aluminium, destiné à quitter le continent européen pour être exploité en Amérique du sud, au Vénézuela, me semble-t-il, mais toujours sous pavillon italien. Le navire étant au Havre, l'armateur avait jugé plus pratique de contacter son consul à Paris pour que celui-ci nous demande de faire la visite de sécurité, pour lui délivrer les titres pour aller au Venezuela. J'ai répondu par la négative. Je n'ai pas voulu prendre un tel dossier sans avoir tous les éléments en main et sans avoir fait faire les choses de A à Z, ce qui n'était pas le cas.
Comme nous n'avons pas l'expérience de navires rapides au centre de sécurité du Havre, puisque chacun a un peu sa famille de bateaux, j'ai contacté mon collègue de Marseille qui a en charge les NGV de la SNCM, qui m'a conseillé de ne pas y toucher, car ce sont des contrôles très complexes qui se font selon une méthode qui ne s'apprend pas au pied levé, et un contrôle ne se fait pas à moitié. J'ai refusé pour cette raison et d'autant plus que je connaissais la vraie raison, bassement matérielle, qui était derrière la demande : l'armateur ne voulait pas payer le déplacement de l'inspecteur italien. J'avais donc une double raison pour refuser.
Tout cela pour vous dire que, dans la pratique, nous ne faisons pas de visites de certification de navires étrangers, pas plus que je ne demande à mes homologues étrangers de faire une visite de certification de mes navires.
M. le Rapporteur : Combien de temps prend une visite annuelle ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Elle prend une journée.
M. le Rapporteur : A combien de personnes ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Quatre, en principe.
Il faut être bien avancé dans le descriptif pour avoir une vision d'ensemble et savoir qui fait quoi, car il y a une répartition des tâches bien précise prévue par les textes entre la société de classification et nous, le problème étant que tout soit bien jointif, sans trou ni recouvrement.
Donc, en termes clairs, quand nous contrôlons des navires français, nous faisons des visites périodiques et exhaustives. C'est la caractéristique du contrôle de sécurité des navires français, qu'ils soient en immatriculation métropolitaine ou Kerguelen. Nous étions la semaine dernière au Japon, les inspecteurs Auzou, Robin et moi-même, pour la visite annuelle d'un pétrolier français et nous repartons dans le Golfe persique jeudi pour un autre pétrolier.
M. le Rapporteur : Vous ne faites pas ces visites ici ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Nous les inspectons là où ils sont.
M. le Rapporteur : A la date donnée ou pas ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : C'est forcément dans le créneau des douze mois plus ou moins trois mois, mais pas forcément en France.
Ce sont eux qui nous demandent la visite, puisque ces visites sont périodiques et programmées.
M. le Rapporteur : Cela dure une journée à quatre. Que regardez-vous ? Qui sont ces quatre ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Un président, comme dans toute commission administrative, un inspecteur pont, un inspecteur machines et un inspecteur radio. Ce dernier est fourni par l'Agence nationale des fréquences.
M. le Rapporteur : Que faut-il pour être inspecteur ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Pour être inspecteur, la logique serait d'aller chercher d'anciens capitaines ou d'anciens chefs mécaniciens, parce que tous nos interlocuteurs sont des capitaines ou des chefs mécaniciens en exercice.
M. le Rapporteur : Donc, j'ai fait carrière dans la marine marchande pendant quinze ans, je passe un concours d'inspecteur ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : C'est un peu plus compliqué car, pour l'instant, le recrutement des marins ayant été plutôt abandonné pour des raisons propres à la fonction publique et statutaires, le mode de recrutement en vigueur est un concours d'inspecteur des affaires maritimes calqué sur le mode des autres concours techniques de la fonction publique, c'est-à-dire que nous avons essentiellement des universitaires, des gens qui n'ont pas navigué.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous répéter ? Et pourrions-nous avoir les textes du dispositif de recrutement des concours d'inspecteurs ? Vous recrutez des personnes qui n'ont pas navigué et ont tout appris dans les livres ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Dans les livres, avec un peu de navigation pendant la formation qui dure deux ans. La formation se déroule, pour l'instant, au CIDAM, le Centre d'Information et de Documentation des Affaires Maritimes de Bordeaux. Un projet de réforme est en cours. Globalement, nous prenons des gens d'un niveau minimal de Bac+3 ou Bac+4, qui passent ce concours administratif comme ils pourraient passer le concours des TPE, d'ingénieur météo, etc. Ils viennent suivre à l'école des affaires maritimes une formation de deux ans, la première année étant purement scolaire et universitaire, la seconde une formation en alternance qui comprend des embarquements, dont notamment un embarquement d'un mois et demi ou deux sur un grand navire de commerce.
M. le Rapporteur : Cela vous paraît-il suffisant ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Je ne sais si je dois répondre...
M. le Rapporteur : Vous êtes obligés de répondre.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Cela ne me paraît pas suffisant.
M. Jean-Yves BERROCHE : Je voudrais apporter un complément d'information. J'ai cinq centres de sécurité sur la façade Manche - Mer du nord et les inspecteurs de la sécurité, par exemple, ceux de Caen, qui ne sont pas issus de la filière navigante, ont évoqué avec moi le problème de leur formation sur le plan technique, sur le plan de la connaissance de la structure des navires et ont demandé à bénéficier d'un complément de formation. Ils ont demandé, au terme de je ne sais combien de temps d'affectation, un recyclage parce qu'ils estimaient qu'ils étaient peut-être opérationnels pour les navires de pêche mais que, s'agissant des navires-citernes, il fallait qu'ils apprennent plus et encore.
M. le Rapporteur : Vous, monsieur Guénolé, ne faites pas partie de cette catégorie ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : J'ai été administrateur et, avant, officier de marine.
M. le Rapporteur : On ne trouve plus de gens qui ont navigué qui seraient intéressés ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : On en trouverait qui sont intéressés.
M. le Rapporteur : On en trouverait ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Oui, mais le recrutement dans la fonction publique de type classique se fait par concours et à quarante ans maximum, sauf dérogation. Nous souhaiterions, dans les centres de sécurité, pouvoir mettre en face des gens pouvant répondre à nos interlocuteurs, c'est-à-dire à des capitaines et des chefs mécaniciens dotés des plus hauts brevets de navigation et de la plus longue expérience qui soit sur les navires ; à des gens des services techniques des armements ; à des experts des sociétés de classification ; à des experts maritimes ; à des experts judiciaires ; sur les navires de pêche, aux patrons pêcheurs, voire aux capitaines de pêche pour les anciens. Le commandant Brévault était capitaine de pêche à Terre Neuve.
Il est évident que si nous n'avons en mettre en face d'eux que des connaissances livresques, nonobstant les capacités personnelles des gens, il nous riront au nez.
M. le Rapporteur : Donc, vous revendiquez d'anciens officiers de la marine marchande.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Au moins un subtil dosage entre les nécessités techniques, car il nous faut les mêmes experts qu'en face, et le fait que nous sommes une administration de la fonction publique qui, c'est normal, a ses propres contingences de gestion.
M. le Président : Ce n'est pas facile. Il est vrai que limiter à quarante ans, sauf dérogation particulière, cela exclut une bonne part des candidats potentiellement intéressants.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Tel qu'il est défini actuellement dans la fonction publique, le statut d'inspecteur des affaires maritimes du 10 novembre 1992, modifié en 1997, dispose qu'il faut telles compétences et quarante ans maximum. Nous pensons, quant à nous, qu'il faut une autre compétence, et quarante ans... minimum !
M. le Rapporteur : Vous personnellement ou... ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : L'ensemble des chefs de centres de sécurité.
M. le Président : Il faudrait donc un dispositif particulier, dérogatoire au sein de la fonction publique. Est-ce un problème financier ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Non. Je ne veux pas m'avancer. M. Auzou est mieux placé que moi pour en parler, mais je pense que, vu le régime particulier de sécurité sociale de l'ENIM, l'Etablissement National des Invalides de la Marine, qui permet de prendre pension à partir de cinquante ans, mais limitée à vingt-cinq annuités - donc, cinquante-cinq ans est plus intéressant -, vu que c'est un travail d'expert à terre, qu'il n'y a pas les contraintes liées à la fatigue de la navigation, créer une catégorie à partir de cinquante ans, ce serait très bien. Et puis cela fait autorité, c'est très bien.
M. le Rapporteur : Et cela crée des carrières.
M. AUZOU : Quand un inspecteur, capitaine ou chef, arrive à bord d'un bateau, cela représente quelque chose. On ne s'amuse pas à vous raconter des histoires.
M. Jean-Yves BERROCHE : Pour votre dossier, voici, sortie cette semaine dans la revue « le marin » la position d'un navigant de la marine marchande sur la nécessité de recruter d'anciens marins ainsi que des statistiques marchandises dangereuses que vous avez demandées, mais que je compléterai. Elles représentent, en gros, 2 millions de tonnes.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Une augmentation de plus de 100 % en l'espace de 10 ans.
Je pense que M. Auzou serait plus à même que moi de vous en parler, puisqu'il est chef mécanicien, avec trente ans de navigation et qu'il a eu à former deux de ses jeunes collègues inspecteurs issus de la nouvelle formule.
M. le Président : Peut-être vaut-il mieux que vous finissiez votre exposé. Nous pourrons en reparler ensuite.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Les navires français, qu'ils soient métropolitains ou immatriculés TAAF, font l'objet, selon le principe de contrôle en matière de sécurité, d'une commission d'étude et de visite. Nous les voyons tous les douze mois, plus souvent s'il y a besoin, sur la base d'un système de visites périodiques, exhaustives et programmées, puisque c'est l'armateur qui demande la visite annuelle. Celles-ci se déroulent avec l'aide des sociétés de classification d'une façon que je vous expliquerai.
Les navires étrangers sont ceux que nous voyons au titre du contrôle par l'Etat du port. Chez eux, on ne sait pas trop ce qu'il se passe, si ce n'est que quand il n'y a pas de rôle effectif de d'administration du pavillon, c'est de notoriété publique. Pour tous les pavillons exotiques que vous connaissez, il est bien connu que l'administration du pavillon n'est qu'une administration d'enregistrement. Certains pas très éloignés de nous sont d'ailleurs plus exotiques que l'on ne pourrait le croire.
M. le Rapporteur : C'est-à-dire ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : L'île de Man, par exemple.
M. le Président : Que pensez-vous du Luxembourg ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Je n'ai pas eu d'exemples malencontreux avec le Luxembourg. J'en ai eu avec Malte, l'île de Man,...
M. le Rapporteur : Nous devons nous rendre à Malte prochainement. Si vous pouviez nous établir une note sur vos déboires avec Malte, cela nous rendrait service car j'aimerais bien aller là-bas avec un point de vue de praticien sur les bateaux de Malte et savoir comment se font les contrôles à Malte vus de chez nous.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Dans la commission d'étude sont présents l'administration, la sous-direction de la sécurité maritime, les représentants des sociétés de classification - en France, c'est le Bureau Veritas -, les représentants des armateurs et des assureurs maritimes ainsi que la Marine nationale et les syndicats de marins. C'est donc une commission mixte. Les gens reçoivent les dossiers avant de venir à la réunion, généralement mensuelle, où ils expriment leurs avis.
Ensuite, un autre groupe de personnes se rend à bord. Ce ne sont pas les mêmes. Normalement, il y a peu de chances qu'une anomalie passe au travers.
M. le Rapporteur : La commission d'étude a lieu à l'accueil du navire ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Elle a lieu à la construction du navire ou à l'entrée en flotte, s'il s'agit d'un navire déjà existant venant d'un autre pavillon, ce qui est tout à fait possible et revient au même.
Pour les pavillons où tout est délégué à la société de classification, l'armateur ayant le choix de sa société de classification, tout se passe au niveau de la société de classification. Il n'y a donc plus de commission d'étude mixte ni de commission de visite...
M. le Rapporteur : Pour l'Etat du pavillon, mais pour le contrôle chez vous ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Pour ce qui concerne les navires étrangers, au lieu de visites périodiques, programmées et exhaustives, nous faisons des visites inopinées, parce que c'est ainsi que les prévoient la résolution de l'OMI, la directive européenne et notre règlement. Au lieu d'être exhaustives, ces visites se font par sondage. Cela revient à dire que nous ne pouvons techniquement pas, et n'avons certainement pas la prétention de nous substituer au contrôle de l'Etat du pavillon.
Si nous avons un indice, si par exemple un bateau commence à s'ouvrir sous la coque et qu'une fuite d'hydrocarbures remonte à la surface, nous pouvons procéder à des investigations. Il suffit alors de tirer le fil de la pelote de laine. Mais, sans indice, si nous nous présentons sur un navire dont la peinture est belle, dont les gens se tiennent correctement, possèdent les brevets adéquats, même si le bateau est en mauvais état - parfois, c'est très bien caché -, nous ne voyons rien. Nous passons à côté, d'autant plus que les navires en opération commerciale sont dans une configuration telle que vous ne voyez rien de ce qui se passe à l'intérieur puisque ce qui se passe à l'intérieur ne se voit véritablement qu'en arrêt technique, en carénage, c'est-à-dire tous les deux ans et demi, par la société de classification. L'exercice est classique.
M. le Rapporteur : La visite en carénage tous les deux ans et demi est obligatoire ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Pour l'instant, elle n'est obligatoire que tous les cinq ans.
M. le Rapporteur : Donc, tous les cinq ans, c'est la cale sèche obligatoire.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : D'après une résolution de l'OMI, il est cependant possible de remplacer l'inspection de la coque à deux ans et demi par une inspection par plongeurs. Evidemment, lors d'une inspection par plongeurs, on ne voit pas la même chose. Le Mimosa, qui avait dix-huit ans quand nous l'avons vu, avait fait l'objet, puisque les échéances sont de cinq ans, d'une inspection en cale sèche à quinze ans et d'une inspection par plongeurs à dix-sept ans et demi, à Dubaï. La coque avait été réparée non pas en cale sèche comme cela aurait dû se faire parce que c'étaient de gros travaux qui nécessitaient du travail à chaud sur la coque, mais simplement « navire sur le cul », comme on dit, en le mettant en assiette positive, de façon à relever l'étrave et à faire les travaux au moins cher.
M. le Rapporteur : Cela veut dire qu'à Dubaï, ils avaient déjà décelé ce qui allait se révéler par la suite ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : C'est ce que nous en avons déduit, en procédant par hypothèse car c'est ainsi que nous avons dû faire. Toute la technique de l'entretien avec le représentant de la société de classification, DNV, qui avait été dépêché pour la cause, a consisté à trouver les bonnes questions à lui poser - nous étions trois, nous avions moins de chances de nous tromper qu'à un -, à suivre le raisonnement, à nous concerter entre inspecteurs pour, finalement, transmettre mon avis au préfet maritime. Pour eux, l'astuce consistait à nous entraîner dans la discussion avec des éléments que nous n'avions pas, mais qu'ils connaissaient parfaitement.
Ce genre d'exercice se renouvelle, de façon moins critique, bien sûr, à chaque fois que nous visitons un navire étranger. Le problème est d'aller voir ce qu'il y a sous le vernis. Et ce vernis est, la plupart du temps, bien épais et très dur à casser.
Vous avez donc nos navires français pour lesquels je crois pouvoir dire que la signature des inspecteurs français sur les titres de sécurité a de la valeur à l'étranger, d'autant que ces navires savent, lorsqu'ils subissent des contrôles abusifs par l'Etat du port - ce sont des choses qui arrivent aussi - que nous apportons notre concours à l'armateur. S'il y a une prescription parce qu'il y a une avarie, l'inspecteur de l'Etat du port va demander une rectification. C'est normal, c'est son rôle. Mais s'il dépasse ses prérogatives, c'est à nous de fixer la limite et de rappeler que le navire porte le pavillon français. Nous servons aussi à cela et nous pouvons nous le permettre parce que nous connaissons bien nos navires.
C'est la raison pour laquelle je dis que le contrôle par l'Etat du port n'a pas du tout vocation à remplacer le contrôle par l'Etat du pavillon. Que chacun s'occupe de ses affaires ! Cela n'empêche pas d'intensifier les contrôles par l'Etat du port et de demander peut-être plus de renseignements que nous ne le faisons actuellement et d'aller, par exemple, vers un système du type de ce qui existe dans le federal regulation américain, qui est tout simplement l'émanation de l'Oil Pollution Act de 1990, qui a fait suite à la marée noire de l'Exxon Valdez : qui fait qu'aucun navire citerne ne touche le territoire des Etats-Unis sans y avoir été préalablement autorisé par tout un système d'inspections - lettres de certification, etc. Aux Etats-Unis, l'armateur dépose un dossier et attend un premier feu vert. Ensuite, une inspection a lieu à la première touchée et un deuxième feu est actionné. S'il est vert, il reçoit une letter of compliance, qui lui donne le droit de toucher le territoire des Etats-Unis pendant un mois.
M. le Rapporteur : Ce n'est vrai que depuis l'OPA ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Oui.
M. le Président : Mais cela ne marche que parce que les Etats-Unis ont la même réglementation du Pacifique à l'Atlantique et du Golfe du Mexique au Canada. Ce que nous n'avons pas de la Méditerranée à l'Atlantique.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Ils ont quelques soucis, malgré tout, avec les Etats fédérés qui, pris séparément, ont tendance, pour certains, à en rajouter.
M. le Rapporteur : Il n'y a pas de problème de dumping.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Ce n'est pas du dumping, c'est de la surenchère.
Leur système fonctionne bien parce qu'ils disposent de gros moyens, qui ne sont pas du tout comparables aux nôtres mais qui sont à l'échelle du pays, à l'échelle linéaire des côtes. Maintenant, je ne sais pas si nous pourrions faire de même. Nous sommes plutôt sur une bonne dissuasion. Eux, c'est le contrôle systématique de tous les navires. Mais en mettant en place un système fondé sur la dissuasion - vous pouvez venir, mais sachez que si, chez nous, on trouve quelque chose, on arrête tout - et en faisant cela un certain nombre de fois, normalement, vous rééquilibrez les choses. C'est une autre façon de procéder, par le couple dissuasion-sanction.
M. le Rapporteur : On m'a dit que l'on ne respectait pas les 25 % du contrôle prévus par le Memorandum de Paris (MOU). Le constatez-vous ici lors du contrôle de l'Etat du port ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Oui.
M. le Rapporteur : Quelles en sont les raisons ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Le manque de personnel.
M. le Rapporteur : Combien êtes-vous pour assumer ces fonctions de contrôle à la fois sur les bateaux français et étrangers ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Présentement, un et demi. Jusqu'à l'été dernier, nous avions quatre inspecteurs au centre de sécurité du Havre.
M. le Rapporteur : Ce sont les quatre qui sont partis au Japon ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Le centre de sécurité du Havre comptait jusqu'à l'été dernier quatre inspecteurs, un chef de centre, un contrôleur de catégorie B qui ne contrôle que les navires en dessous de vingt-quatre mètres, et une secrétaire.
Sur les quatre inspecteurs, nous avions deux capitaines au long cours, l'un pour les pétroliers, l'autre pour les porte-conteneurs et deux chefs mécaniciens, dont M. Auzou, un pour les pétroliers, l'autre pour les porte-conteneurs. Le capitaine au long cours pour pétroliers est parti à la retraite, l'autre capitaine a eu quelques ennuis de santé, le chef mécanicien de pétrolier est parti et a été remplacé par un autre chef mécanicien de pétrolier du même âge mais auquel il faut le temps de la mise en route. Il occupait auparavant un poste de professeur d'enseignement technique maritime à la mutuelle de la marine marchande de Marseille, après avoir fait vingt ans dans la coopération en Afrique et y avoir exercé notamment les prérogatives d'inspecteur. Enfin, nous avons M. Auzou.
Est arrivé entre-temps un jeune inspecteur venant de la nouvelle filière, à l'issue de son embarquement au commerce durant sa deuxième année de formation en alternance, mais il a besoin d'être formé. En termes clairs, je ne peux pas le lâcher comme ça, car il n'a jamais navigué, excepté durant les deux mois de sa formation.
M. le Rapporteur : Pour assurer normalement les 25 %, plus les missions de la commission de sécurité normale, combien de personnes faudrait-il au centre de sécurité du Havre ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Il me faudrait huit inspecteurs d'expérience. Si vous prenez en compte les nécessités de voyage, puisque nous assurons une trentaine de missions par an à l'étranger, ce qui est assez lourd, auxquelles s'ajoute la nécessité du contrôle des navires, notamment des navires de pêche puisque nous avons quatre-vingt-dix navires de pêche qui demandent un suivi extrêmement précis.
M. le Président : Au Havre ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Entre Le Havre et Fécamp. J'ai, par exemple, trois gros navires de pêche industrielle qui sont basés au Pays-Bas, tous les navires de pêche artisanale, sans compter tous les navires portuaires du lamanage, pilotage, remorquage, etc. Tous demandent un bon suivi, de façon à pouvoir tenir notre position de neutralité entre les armateurs et les marins car lorsque nous allons à bord, nous entendons tous ceux qui demandent à être entendus, armateurs comme marins. Bien sûr, c'est l'armateur qui organise matériellement les choses, mais nous entendons à chaque fois les marins, en tant que de besoin, soit directement soit par le biais du CHSCT. Cela entre dans nos missions.
Nous faisons aussi de l'appui technique aux services administratifs : examens, commission, enquêtes s'il est besoin. Il ne faut pas oublier le temps de formation, qu'il faut bien aménager pour chacun parce que la réglementation évolue en permanence.
C'est ainsi que j'estime à huit le nombre d'inspecteurs du centre de sécurité parmi lesquels il faudrait trois capitaines, navires secs et navires citernes, trois chefs mécaniciens, navires secs et navires citernes. Ce sera peut-être un peu plus facile puisque la formation actuelle de capitaine de première classe est polyvalente.
M. le Président : Le problème est qu'il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir déjà navigué.
M. le Rapporteur : Cela demande un certain nombre d'années ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Trente ans. Ceux qui ont suivi la filière complète ont fait lieutenant mécanicien, lieutenant passerelle, second mécanicien, second passerelle, chef mécanicien, commandant. C'est le parcours complet, pour ceux qui ont actuellement cinquante ans et plus.
Pour faire ce métier, nous ne sommes pas en concurrence avec les armements puisque ces derniers cherchent des gens qui naviguent et nous des gens qui ont navigué...
M. le Rapporteur : Sauf que ceux-là, vous ne pouvez pas les recruter !
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : C'est un autre problème.
M. le Président : C'est uniquement un problème lié au concours d'accès à la fonction publique. Les dispositions récentes vous permettent de récupérer quelques créations de postes, sauf que cela ne résoudra en rien votre problème, parce que vous ne trouvez pas d'anciens navigants, puisque vous ne pouvez pas les recruter.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Nous n'avons pas le droit de le faire, mais ils existent. Nous recevons quelques candidatures spontanées et je connais quand même pas mal de gens dans le milieu qui seraient intéressés.
M. le Rapporteur : Ils sont là, mais vous n'allez pas pouvoir les prendre.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Pour l'instant, c'est la situation. Il y a une petite ouverture pour une dizaine, mais à titre exceptionnel. Huit, pour deux fois trois ans non renouvelables. C'est un problème.
M. le Rapporteur : Il y a de la matière puisqu'il y a l'assèchement de la formation des officiers de marine. Nous avons donc des gens sur le marché.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : J'en connais un, qui était chez Delmas : licenciement économique à cinquante-trois ans. Il n'a pas envie de s'arrêter de travailler, il m'a demandé s'il n'y avait pas un poste d'inspecteur chez nous.
M. le Président : Vous nous confirmez qu'il n'y a pas de problème financier derrière cette mesure ?
M. Jean-Yves BERROCHE : Sauf qu'on recrute aussi des ingénieurs pour les inspecteurs des affaires maritimes, qui peuvent être architectes navals et ingénieurs de l'environnement...
M. le Rapporteur : Mais ce n'est pas ce qu'ils font.
M. Jean-Yves BERROCHE : Ce sont ceux-là qui sont venus me voir et ont demandé à avoir une formation maritime.
M. le Président : Il faudrait recruter au moins à quarante-cinq ans. Une fois sorti de sa formation, il a trente-cinq ans. Si l'on veut qu'il ait la bouteille nécessaire pour faire face à ses homologues, il faut qu'il ait navigué huit ou dix ans. Cela porte à quarante-cinq ans. Celui-là, si vous voulez le recruter comme inspecteur, il faut le payer comme un commandant.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Cela, on ne le pourra pas.
M. le Président : C'est bien ce que je disais, le problème financier se pose.
Je reviens donc là-dessus parce que j'avais cru comprendre que vous disiez que ce n'était pas le problème principal. Je pense, pour ma part, que l'on peut arriver à contourner le problème de l'accès à la fonction publique, mais qu'ensuite, on se heurtera au problème financier car il faudra payer ces inspecteurs non pas 10 à 15 000 francs par mois, mais trois ou quatre fois plus.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Un peu moins : 25 à 30 000 francs. Peut-être plus, en effet, dans certains cas.
Mais il existe un biais : cinquante ans, droit à pension acquis et à cinquante-cinq ans, vous avez le droit d'avoir le salaire public et la pension. A cinquante-cinq ans, nous avons des gens compétents et c'est ce que nous recherchons.
M. le Rapporteur : C'est une piste majeure.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Le biais est connu. Il est là.
M. le Rapporteur : Ils auraient cinquante-cinq ans.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Cinquante à cinquante-cinq ans.
M. le Rapporteur : Sauf qu'à cet âge, ils peuvent aussi recevoir d'autres propositions, tout aussi intéressantes.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Je connais un capitaine d'armement qui vient de prendre sa retraite, pas du service technique, mais du service d'armement (c'est-à-dire DRH). Il a tout de suite été embauché par un cabinet d'expertise. Mais cela n'intéresse pas tout le monde d'avoir ce rythme de vie.
Je trouve que notre métier présente l'attrait que vous êtes complètement dégagés des contingences économiques et financières dans la prise de décision. C'est la technique, uniquement la technique. L'armateur peut toujours dire que c'est impossible, qu'il lui faut son bateau, nous avons un règlement à respecter, et c'est tout. C'est purement technique. C'est une autre forme d'intérêt. Jusqu'à présent, il s'est toujours trouvé d'anciens capitaines et chefs mécaniciens pour venir mettre leurs talents et leur expérience au service de l'administration ; des gens qui font autorité, ne l'oublions pas ! Parce que si l'on ne fait pas autorité vis-à-vis des commandants et des chefs...
M. le Rapporteur : Quel était leur statut avant ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Contractuel, 1974. C'est d'ailleurs le statut de M. Auzou. Mais à partir du moment où est créé un statut dans la fonction publique - en l'occurrence, c'est par décret - le principe qui prévaut, c'est que l'on ne peut plus recruter par contrat.
M. le Rapporteur : Or, dans le cas précis, c'est indispensable.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Néanmoins, la loi de 1984 sur le statut général de la fonction publique, dans son article 4, me semble-t-il, le permet pour les postes pour lesquels vous ne trouvez pas par la voie habituelle du concours ce qu'il vous faut.
M. Jean-Yves BERROCHE : Sauf que, dans l'intervalle, il y a eu des discussions au sein des commissions administratives paritaires, donc, au sein de la fonction publique, qui ont fait que les portes ont plutôt été fermées sur ce point précis. Il est, en conséquence, devenu très difficile de recruter par voie contractuelle.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : C'est un état de fait, pas un état de droit.
M. Jean-Yves BERROCHE : Vous aviez demandé d'avoir une idée du nombre de visites effectuées par rapport à celles qui auraient dû être faites, j'ai le chiffre pour Dunkerque : il s'établit entre 5 et 8 % par rapport aux 25 % prévus par le MOU. C'est une donnée qui a été comptabilisée au bateau près, pour l'année 1999.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Au centre de sécurité du Havre, du 1er octobre 1993 à l'année 1998 incluse, parce qu'en 1999, du fait du départ des personnels, nous n'avons pas pu maintenir le chiffre, la moyenne était de 600 visites de navires par an, tout compris, français et étrangers, dont 300 de navires français et 300 de navires étrangers, notre quota fixé par Paris pour les navires étrangers étant de 204.
M. le Rapporteur : Cela faisait donc quel quota ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Nous devions être à 30 %.
M. le Rapporteur : Vous étiez au-dessus.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : C'était dû à une situation particulière car, jusqu'au moment où il a pris sa retraite l'été dernier, le capitaine au long cours qui s'occupait du contrôle des pétroliers faisait la majeure partie de ce chiffre des navires étrangers. C'était une personne qui faisait autorité, exactement ce qu'il fallait. Depuis qu'il est parti, nos chiffres ont chuté...
M. le Rapporteur : Combien avez-vous fait en 1999 ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : 540 visites, à peu près.
M. le Rapporteur : Et pour les navires étrangers ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : 240.
M. le Rapporteur : Vous êtes dans les temps.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Oui, parce que nous avons couru sur l'avance acquise pendant les huit premiers mois de l'année.
M. le Rapporteur : La cause du mauvais résultat d'ensemble, c'est Dunkerque ?
M. Jean-Yves BERROCHE : C'est Dunkerque.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Mais cette année, nous ne tiendrons pas notre quota. Nous serons en dessous. Nous nous occupons en premier lieu de nos navires, nos marins et nos armateurs. C'est logique puisque c'est une obligation prévue par les textes.
M. le Président : Vous disiez tout à l'heure que pour faire face aux 25 %, il vous fallait huit inspecteurs.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : En 1987, le centre de sécurité du Havre comptait sept inspecteurs, deux secrétaires et un contrôleur. Il y avait plus de navires français et moins de contrôle de navires étrangers. Mon estimation ne se fonde donc pas sur une situation théorique, mais sur une situation qui a existé. Je pense que trois chefs plus trois capitaines, parce qu'il y a des chances que ce soit des capitaines de première classe de la navigation maritime qui aient rempli les deux fonctions, ce qui facilite encore le travail, nous permettrait d'avoir trois équipes de deux. Si vous voulez faire du contrôle sur les navires étrangers, que vous voulez faire un exercice d'incendie, d'avarie de barre ou autre - qu'il faut rendre compatible avec les opérations commerciales, car vous verrez sur le pétrolier cet après-midi, qu'en réalité, sur un navire comme ça, en déchargement, quand toutes les précautions de sécurité sont prises, on voit peu de choses -, donc, si vous voulez un contrôle à caractère opérationnel, il vous faut un inspecteur à tel point du contrôle et un autre pour suivre les gens à bord. Il n'en faut donc pas un, mais deux.
C'est la technique de base. D'ailleurs, quand on a de gros pépins sur des navires étrangers, nous y allons à plusieurs. Pour la routine, un inspecteur suffit, mais quand on a flairé un problème ou que l'on a reçu des informations, que l'on a mis le nez sur un dossier ou que l'on a signalé une avarie, il faut y aller à plusieurs. C'est la bonne pratique.
Souhaitez-vous que je vous explique en détail, tel que nous le voyons sur le terrain, les rôles respectifs entre société de classification et administration ?
M. le Président : Bien sûr.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Pour tout navire, vous avez un armateur. Cet armateur exploite le navire. Quand je parle d'armateur, il s'agit d'armateur au sens de la loi française de 1969 sur l'armement et les ventes maritimes ou, plus généralement, car c'est une pratique qui se répand sous les pavillons étrangers, ce que l'on appelle les shipmanagers, les gérants nautiques de navire.
Vous avez aussi une société de classification qui contrôle le navire. Je parle là de gens sérieux, ceux de l'IACS : Bureau Veritas, DNV, Lloyd's Register of Shipping, entre autres.
Puis, vous avez dans le cas français, une administration du pavillon. En France, c'est la Direction des affaires maritimes et des gens de mer, avec ses commissions d'étude et, sur le terrain, les centres de sécurité des navires. Cette administration du pavillon contrôle également le navire.
On peut donc se poser la question de savoir si la société de classification et l'administration du pavillon ne font pas double emploi. Vu ainsi, ce n'est pas très explicite. Pour voir ce qu'il y a sous le vernis, il faut voir quels sont leurs rôles respectifs. En fait, la relation entre l'armateur et la société de classification est une relation de prestation de service. Quelle sera la consistance de cette relation de prestation de service ?
Pour faire simple, les conventions internationales SOLAS et MARPOL fixent l'objectif à atteindre : le navire est comme ci ou comme ça, on doit avoir tel résultat ; il doit être suffisamment solide pour flotter dans telle et telle condition et ne doit pas polluer. La société de classification, qui se conforme à ces conventions pour la classification des navires, précise par exemple dans son règlement que pour arriver à tel résultat, il faut telle épaisseur de tôle en tel point du navire. L'objectif étant fixé par la convention, la société de classification détermine le moyen de l'atteindre.
Il faut chercher l'explication de ce fonctionnement dans l'histoire. Les sociétés de classification datent du XIXème siècle ; le Bureau Veritas de 1828, le Lloyd's Register of Shipping de 1834. Elles ont été créées à l'instigation des assureurs. D'ailleurs, le Bureau Veritas n'était pas installé initialement en France mais en Belgique, à Anvers. Les sociétés de classification avaient donc un rôle dans le contrôle de la sécurité des navires bien avant l'administration d'Etat. C'est vrai dans tous les pays. Le premier statut d'inspecteur de la navigation, en France, date de 1909 : il s'appelait inspecteur de la navigation et du travail maritime.
Donc, historiquement, une grosse part du contrôle du navire a reposé sur la société de classification. Pour donner un ordre d'idée, là où nous alignons cinquante inspecteurs sur toute la France, le Bureau Veritas en aligne un millier dans le monde, de différentes nationalités, certes, mais cela vous donne une idée de la différence des moyens. C'est la raison de la très forte implication des sociétés de classification dans le contrôle de la sécurité des navires, quels que soient le lieu et le pavillon des navires.
Il n'en demeure pas moins que dans le système actuel, vous avez une administration du pavillon parce que les conventions de l'OMI sont, au sens du droit international public, des traités qui répondent à la Convention de Vienne de 1948. Elles sont ratifiées par des Etats souverains. Ce sont donc eux qui endossent la responsabilité de l'application de ces conventions. Les Etats souverains, donc les administrations du pavillon, délèguent une partie de leur tâche à des sociétés de classification. Je n'étais pas là lorsque le système a été mis en place, mais je suppose qu'il résulte de la prise en compte de la réalité historique que je viens de décrire, celle de la présence des sociétés de classification sur ce métier depuis longtemps. Ainsi, un partage des tâches a toujours existé entre sociétés de classification et administrations du pavillon, partage qui s'est opéré sans errements jusqu'à il y a trente ans, sachant que le métier de base des sociétés de classification est le franc bord, c'est-à-dire la détermination de la cargaison que l'on peut mettre à bord pour voir de combien le navire peut s'enfoncer sans couler. Dans un navire, vous avez le droit de mettre de la cargaison jusqu'à la ligne de flottaison et vous n'avez pas le droit de le charger plus au-dessus, c'est ce que l'on appelle le franc bord.
M. le Rapporteur : Historiquement, cela vient des assurances.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Tout cela est savamment expliqué dans l'excellent ouvrage de M. Boisson intitulé Politiques et droit de la sécurité maritime, dont chacun chez nous est pourvu. Toutefois, cet ouvrage traite peu du rôle de l'administration du pavillon. Mon collègue de Dunkerque, qui donnait des cours en DESS de droit maritime à la faculté de Lille, se chargeait de rétablir la balance.
Pour continuer d'expliciter qui fait quoi, je dirais que la relation entre armateur et société de classification est une relation de prestation de service, bien évidemment à titre onéreux. C'est du conseil, de la vérification technique, de l'assurance qualité que l'armateur demande à la société de classification, pour lesquels celle-ci sera rémunérée. C'est logique.
Entre l'administration du pavillon et l'armateur, la relation qui s'établit est une relation de tutelle, celle applicable à toute activité industrielle, et une relation d'autorité. C'est ainsi par construction. Vis-à-vis de la société de classification, la relation sera aussi une relation de tutelle et d'autorité, mais avec, en plus, la notion complémentaire de délégation.
Sous tous les pavillons, pour les raisons historiques que je viens d'évoquer, la délivrance du certificat de franc bord est déléguée par l'administration du pavillon à la société de classification. C'est vrai partout. Mais la délégation est plus ou moins large. Chez nous, elle s'arrête au franc bord. Dans tous les autres certificats, comme par exemple celui que j'ai ici, à savoir un certificat d'aptitude au transport de produits chimiques en vrac, il est dit par la société de classification, sur la base d'une liste, les produits que ce navire peut transporter. C'est la société de classification qui le fait et nous, nous délivrons le certificat et endossons le tout.
Cela paraît un peu formel, mais l'Etat prend là une grosse responsabilité. Et si nous voulons contrôler ce qui se passe et pouvoir demander des comptes, le seul moyen est bien de demander que nous soit montré ce qui se fait.
Voilà pour le cas français.
M. le Président : Dans cette hypothèse, vous couvrez la société de classification ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Non, parce qu'elle a une obligation de déclaration vis-à-vis de nous. Le texte est ainsi fait. C'est celui de la loi de 1983 modifiée, complété par un décret de 1984 modifié sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution. Le décret est un décret d'attribution. Il prévoit une commission d'étude dont vous parliez tout à l'heure, les commissions de visite et les compétences de tel et tel. Ce décret prévoit notamment que si nous voyons le navire un jour donné, que celui-ci est en bon état et que nous lui donnons ses certificats, tout ce qui se passe jusqu'à la visite annuelle suivante, qui serait susceptible de remettre en cause la signature ou le visa que nous avons donnés, doit nous être signalé par le capitaine, l'armateur ou la société de classification. Le système est verrouillé de cette façon. Et l'on obtient un système à peu près équilibré.
Sous pavillon étranger, le contrôle est plus ou moins délégué. Mais il est certain que vous ne pouvez pas faire exercer l'autorité par un organisme privé qui se fait payer - il est d'ailleurs normal qu'il se fasse payer. Il m'est arrivé sur des navires français d'être en désaccord avec la société de classification. Dans ce cas, cela s'arrêtait là, car notre système est équilibré, aucun des trois protagonistes n'est en mesure de tout faire lui-même en termes de contrôle. Nous n'avons pas les moyens de prendre la place de la société de classification ; il n'est pas question de chercher à avoir ses moyens, ce serait énorme, et la société de classification ne peut exercer l'autorité parce qu'elle est tenue par ses contingences économiques et financières.
M. le Rapporteur : Y a-t-il des bateaux français qui prennent d'autres sociétés de classification que le Bureau Veritas ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Oui, parce que nous avons quatre sociétés de classification reconnues en France, qui ont donc le droit de délivrer un certificat de franc bord : Bureau Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas et Germanischer Lloyd's. Ces sociétés de classification ont le droit de faire ce que je viens de décrire sur les navires français. Si vous prenez l'American Bureau of Shipping (ABS), ce ne sera pas possible parce que celui-ci n'est pas reconnu par l'administration française. A ma connaissance, il n'y a pas eu accord entre lui et l'administration française, pour des question de plafond de responsabilité. Dans la marine, un élément économique à prendre en compte est la limitation de la responsabilité de l'armateur et des différents intervenants. L'administration française exige qu'il n'y ait pas de plafond de responsabilité et l'ABS ne marche pas sans plafond de responsabilité.
M. le Président : Et le RINA ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Le RINA n'en fait pas partie et n'en a jamais fait partie.
En termes clairs, lorsque nous examinons un navire, il est évident que sa société de classification est un élément à ne pas négliger, en ce sens que ces sociétés de classification reconnues en France, nous les connaissons un peu plus que les autres.
M. le Président : Sait-on si les autres pays européens de la Communauté européenne disposent d'une administration du pavillon ou pas ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Oui.
M. le Président : Qu'en est-il des Grecs ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Les Grecs présentent une particularité. Il existe bien le Hellenic Register of Shipping... dont la particularité est d'appartenir aux armateurs grecs. C'est en fait une société de classification. Il est le seul qui n'ait pas reçu d'habilitation de la Commission de Bruxelles. Toutes les autres l'ont.
M. le Président : Les vieux pays maritimes, ce sont ceux-là. Le béotien que je suis pensait que les vieux pays maritimes comme la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, etc., tous ces pays de forte tradition maritime, avaient su mettre en place un certain nombre de contrôles de l'Etat.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : La situation est en train d'évoluer. En effet, quand dans l'exercice de contrôle, vous avez tutelle, autorité et délégation, une partie du travail consiste nécessairement à aller voir par-dessus l'épaule de la société de classification ce qu'elle fait. Cela a toujours été le cas pour ce qui est de la structure du navire. Le partage classique des tâches entre eux et nous étant, à eux la coque et la machine, à nous tout l'équipement. Mais aujourd'hui, et depuis quelques années, du fait de la nécessité de développer des marchés, d'harmoniser des normes de sécurité européennes, pour prendre l'exemple de la France, ce n'est plus l'administration française, donc la commission centrale de sécurité que j'ai citée tout à l'heure, qui vérifie la conformité aux normes d'approbation des matériels d'armement, c'est-à-dire des équipements que l'on va mettre à bord des navires - en bref, les embarcations, les équipements anti-pollution, etc. En raison d'une directive européenne qui a mis du temps à être élaborée et sur laquelle on s'est mis d'accord comme d'habitude, tout cela est maintenant délégué à ce que l'on appelle des « organismes notifiés ». Leur appellation vient de ce qu'ils reçoivent notification de telle ou telle administration européenne du fait qu'ils ont le droit de faire telle ou telle chose.
Pour reprendre le schéma dans son ensemble, prenons, dans le domaine de la pollution, l'exemple d'un séparateur d'hydrocarbures - machine que l'on pose dans la cale pour filtrer ce qui va aller à l'extérieur, le principe étant de ne rejeter que du propre, pas plus de 15 PPM d'hydrocarbures. Ce matériel est soumis à des normes d'approbation qui sont des normes techniques internationales, définies en l'occurrence par l'OMI. Auparavant, c'était l'administration française qui vérifiait la conformité du matériel à la norme d'approbation, maintenant, c'est l'organisme notifié qui le fait. Il y a une délégation.
On se trouve donc dans le cas de figure d'aller voir à bord si le matériel fonctionne, de devoir demander les papiers délivrés par l'organisme notifié et, au besoin, si vraiment on sent que quelque chose ne va pas, d'aller faire un contrôle par-dessus la tête de l'organisme notifié pour savoir ce qu'il a fait pour arriver à accorder l'approbation.
Pour avoir eu à le faire à quelques reprises, je dois dire que l'on rencontre parfois des choses bizarres.
Donc, la grosse évolution de notre métier est que, bien sûr, nous conservons une partie du contrôle direct, mais que l'exercice de contrôle des contrôleurs se développe aussi. Il nous faut conserver la capacité d'aller contrôler au c_ur du sujet, au c_ur des matériels eux-mêmes, les procédures d'approbation, afin de bien vérifier que le contrôle a bien été fait avec un test effectué dans telles conditions, a duré tant de minutes, et ainsi de suite.
Mais il nous faut aussi acquérir, sous le vocable assurance qualité que l'on connaît dans la marine, c'est-à-dire sous le sigle ISM, International Safety Management, la capacité d'aller contrôler les contrôleurs. Ce système d'assurance qualité ne peut fonctionner valablement sur le plan technique que si vous avez le contrôle du siège des organismes notifiés, mais aussi le contrôle à bord, matériel par matériel. C'est une évolution importante, qui nécessite une formation à la démarche qualité que l'on connaît par ailleurs dans l'industrie terrestre - normes ISO 9000, etc. - et qui est, pour nous, transposée par le code ISM, c'est-à-dire le code international pour la gestion de la sécurité de l'exploitation. Qui dit exploitation, dit conduite du navire. Parler de conduite de navire ne signifie pas seulement connaître la technique à la façon d'un ingénieur, ce n'est pas suffisant ; les gens qui conduisent les navires ne sont pas ceux qui les construisent. Exactement, comme ceux qui appliquent des textes ne sont généralement pas ceux qui les élaborent. Il existe une complémentarité entre les deux ; les deux doivent se rejoindre, mais vous devez tenir compte de la séparation qui existe entre les deux. Il ne peut en être autrement si l'on veut que tout fonctionne efficacement.
Je vous disais tout à l'heure qu'avec des navires étrangers, le vernis peut être très épais, difficile à casser. Si vous n'avez pas des gens d'expérience, vous ne trouverez pas le défaut. Sans compter que la masse de tests ne cesse de croître puisque la technique se complique. L'administration de la technique et la fabrication de normes se complexifie aussi. Mais il arrivera un moment où il faudra parvenir à comprimer la progression des textes parce que, au bout, c'est un individu qui doit signer.
M. Jean-Yves BERROCHE : J'aurais voulu que M. Guénolé nous dise un mot du risque pénal car c'est un problème que nous ressentons très fortement. Les responsabilités sont assez fortes pour l'exercice de ce contrôle des navires et l'on se rend compte que l'on est parfois confronté à une prise de risque qui va au-delà de notre capacité réelle à étudier le dossier à fond.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Si vous me demandez, par exemple, si j'ai accentué les contrôles des pétroliers depuis l'affaire de l'Erika, ma réponse sera négative, pour deux raisons. La première est celle que je vous ai expliquée, elle est liée à nos contingences matérielles : nous n'avons pas le nombre suffisant d'inspecteurs. La seconde tient au fait que l'on ne peut pas ne pas essayer d'imaginer ce qu'il se serait passé si, par malheur, mon collègue de Dunkerque était allé à bord et n'avait rien trouvé. Et je crois que personne n'aurait rien trouvé.
M. le Président : Je ne le crois pas.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Le problème est grave car cela fera fuir les prises de responsabilités. Il y a certainement quelque chose à faire. C'est Furiani au sens large.
M. Jean-Yves BERROCHE : Pour se rapprocher du niveau de 25 % de contrôle des navires étrangers, on aura peut-être plus tendance à aller contrôler des navires relativement récents et bien connus plutôt que des navires qui sont sous-normes.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Il est fondamentalement anormal, tous les professionnels vous le diront, navigants, armateurs comme contrôleurs, que nous soyons, nous, contrôleurs des Etats du port, susceptibles d'être inquiétés pour une affaire comme celle de l'Erika alors que c'est l'Etat du pavillon qui n'a pas fait son travail. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Ce n'est absolument pas acceptable par les professionnels.
M. le Président : En même temps, si j'ai bien compris, l'Erika avait fait l'objet d'une réparation dans un chantier qui, semble-t-il, ne répondait pas aux normes ou du moins n'avait pas les qualifications qu'il fallait ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Il y a eu cela aussi.
M. le Président : Comment pourrait-on faire la chasse à ce genre de procédés consistant pour un armateur étranger...
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : L'armateur était grec.
M. le Président : C'est un européen. Comment faire la chasse à ce genre de procédés qui consiste à mettre le bateau en réparation dans un chantier qui ne bénéficie pas des qualifications requises ? Car, en fait, ce sont des dumpings en cascade.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Tel que je le vois, pour les navires que nous avons à inspecter...
M. le Président : C'est sur ces points a priori qu'existe un manque.
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : Je mets de côté les navires français. Certes, nous ne sommes pas parfaits et pouvons passer à côté d'un manque, le risque zéro n'existe pas, mais ils sont quand même parmi les plus surveillés, quel que soit le type de navires : passagers, pétroliers, chimiquiers. Prenons le cas des navires étrangers, qui représentent tout de même 95 % de ce qui arrive dans nos ports. Il y a donc matière à contrôle et à s'inquiéter de ce qui se passe sur ces autres navires. Pour faire la chasse, comme vous le disiez, il faut un ensemble de mesures qui ne relèveront pas seulement du contrôle. Il y aura obligatoirement des mesures à caractère économique.
Pour en donner un exemple, j'ai eu affaire à un armateur qui n'était pas d'accord avec ma décision. Naturellement, je retenais son navire à quai. En termes clairs, il avait sauté une cale sèche avec la complicité de la société de classification et l'accord explicite de son administration du pavillon, sous prétexte qu'il allait à la démolition. Cela n'empêche que, sur le chemin, il transportait une cargaison à destination du Havre, qui était la moitié de ce qu'elle aurait dû être, parce qu'il avait été mis dehors par le terminal BP. Ensuite, il allait au Pakistan dans un chantier de démolition mais reprenant malgré tout au passage une cargaison en Algérie, me semble-t-il. Le tout en ayant, sous une apparence légale, sauté une cale sèche obligatoire.
J'étais en désaccord avec cet armateur. J'ai pris les mesures nécessaires et il m'a mis tout de suite sous les yeux un document prévu par SOLAS et MARPOL, que je connais par c_ur évidemment, qui fait que l'armateur a le droit de demander une indemnisation si son navire est retenu indûment. Il faut bien qu'il y ait un garde-fou, pour l'équilibre. Je lui ai dit que je connaissais bien ce texte et lui ai sorti les textes français présentant les voies de recours. Ensuite, quand il a eu tourné le dos, j'ai demandé à son agent, parce que nous nous connaissons, Le Havre est une petite communauté maritime, combien de bateaux avait cet armateur et si les autres faisaient également escale au Havre... L'affaire en est restée là.
M. le Président : Il a fait escale après ?
M. Jean-Paul GUÉNOLÉ : En fait, cet armateur a fait faillite. Il avait onze single ship companies. Voilà ce que l'on peut voir.
Ce que nous allons voir cet après-midi pour établir un parallèle avec le Mimosa, est un pétrolier norvégien de treize ans d'âge, « nickel » à ce que l'on me dit. Il a été visité en dernier lieu le 3 février à Rotterdam. Je connais bien l'agent. C'est grâce à lui que cette visite sera possible.
Audition de M. Jean-Marc SCHINDLER,
représentant permanent de la France auprès de l'OMI,
conseiller maritime de l'Ambassade de France en Grande-Bretagne
(extrait du procès-verbal de la séance du 11 avril 2000 à Londres)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Jean-Marc SCHINDLER : Avant de me présenter, permettez-moi de vous dire que je suis tout à fait heureux de vous accueillir à Londres et je veillerai à ce que votre visite soit la plus profitable possible.
De formation, je suis administrateur des Affaires maritimes. A Londres, je suis à la fois représentant permanent de la France auprès de l'Organisation maritime internationale (OMI) et conseiller maritime de l'Ambassade de France en Grande-Bretagne. Ma première fonction occupe entre les deux tiers et les trois quarts de mon temps ; ma deuxième fonction le reste. Ces deux types de travail sont très différents : l'OMI constitue un cadre international multilatéral alors que les relations franco-britanniques relèvent d'un cadre international bilatéral. D'ailleurs, sur la plupart des questions, je n'ai pas les mêmes interlocuteurs.
Je sais que vous connaissez bien le sujet, mais je me permettrai de vous livrer quelques réflexions avant d'engager un débat.
Contrairement à l'activité aérienne, l'activité maritime est longtemps restée libre. Elle est de plus en plus encadrée : ce mouvement a été initié depuis de nombreuses années sur le plan national mais il est plus récent sur le plan international. L'OMI, qui était une organisation consultative maritime intergouvernementale à sa création en 1948, n'est devenue un organisme légiférant qu'en 1982, ce qui est assez récent.
Quel est le contexte ?
L'activité maritime est, par définition, internationale puisqu'un bateau traverse les océans et les régions pour se rendre d'un pays à un autre. Le fait que cette activité soit restée libre longtemps a constitué un obstacle à toute tentative de régulation. La variété des cultures et des organisations a constitué un second obstacle : les continents ne raisonnent pas de la même façon et ils n'ont pas les mêmes systèmes juridiques. Mais cette idée de régulation internationale de l'activité est née un jour pour une raison très simple : la seule solution pragmatique pour permettre à un bateau d'aller d'un pays à un autre sans rencontrer de difficulté particulière, résidait dans l'instauration d'un système unique.
Cette difficulté originelle constitue encore aujourd'hui un risque. Dans beaucoup de domaines, nombreux sont les Etats qui veulent se doter de législations particulières. L'accident de l'Erika en offre d'ailleurs une nouvelle illustration. Tel est, en tout cas, le point dur de la réglementation. Nous avons dû nous battre récemment pour une activité qui nous concerne, celle du transport de matériels nucléaires entre Cherbourg et le Japon. Nombre de pays cherchaient à interdire ce type de transport et refusaient qu'il passe le long de leurs côtes. Il est évident que ce type d'activité doit être parfaitement encadré et que, dans ce domaine comme dans celui du transport pétrolier, la prévention est vraiment la seule action efficace.
Le développement de l'activité, et donc de la dangerosité y afférente, a donné lieu à une tentative d'élaboration d'un droit de la mer. Sa réussite a débouché sur la convention de 1982 sur le droit de la mer. Celle-ci décline un certain nombre de principes, tels que ceux de la responsabilité, du droit des Etats côtiers et de la liberté de navigation. Cette convention de 1982 sur le droit de la mer n'a été ratifiée par la France qu'en 1996, ce qui est assez récent.
M. le Rapporteur : Or ce droit n'est appliqué que depuis 1994 !
M. Jean-Marc SCHINDLER : Cela dépend, certains pays tels les Etats-Unis n'ont toujours pas ratifié ladite convention, le Congrès n'ayant pas donné son accord. Néanmoins, l'administration américaine reste un grand défenseur du droit de la mer.
Une multitude de conventions techniques ont été élaborées. La convention SOLAS est l'une des premières à l'avoir été sur le plan international à la suite de la catastrophe du Titanic. Elle définit la façon dont les navires sont construits. La convention MARPOL définit quant à elle, la prévention de la pollution par les navires. Réécrite en 1948 et en 1960, la convention SOLAS actuellement en vigueur a été adoptée en 1974. En revanche, le droit de la mer a été mis en place par la convention de 1982.
Malgré cette liberté initiale, vous voyez que l'activité maritime est de plus en plus encadrée, contrôlée et suivie. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, les choses ne restent pas en l'état sur le plan international. Elles sont non pas statiques mais dynamiques. Toutefois, il est extrêmement difficile de parvenir à un consensus permettant d'aboutir à un texte, sachant que l'OMI compte 157 pays de cultures complètement différentes. Il n'est donc pas aisé de dégager une majorité.
M. le Président : L'OMI fonctionne-t-elle selon le principe de la majorité ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Elle fonctionne essentiellement selon le principe du consensus, qui diffère un peu de celui de la majorité, mais c'est un pays- une voix.
M. le Président : Quelle que soit l'importance de la flotte ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Quelle que soit l'importance de la flotte et du pays !
M. le Rapporteur : Je pensais que la Grèce avait plus de voix que la France.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Non en revanche, les contributions des pays sont calculées pour 30 % en fonction de leur poids dans le système des Nations Unies et pour 70 % en fonction du tonnage de la flotte immatriculée sur leur registre. Par conséquent, un pays tel que Panama ou le Liberia a une voix, mais il représente 10 % du budget de l'Organisation.
M. le Rapporteur : Cela joue ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Cela joue non pas dans les débats, mais dans la considération que le secrétariat a à l'égard du pays ! (Sourires.)
M. le Rapporteur : Depuis combien de temps êtes-vous à Londres ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Je termine ma sixième année.
M. Jean-Pierre DUFAU : Dans le prolongement d'une question précédente, le mode de financement de l'OMI influe-t-il sur sa capacité de rétorsion à l'égard d'un Etat membre ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Cela peut jouer mais il faut que les pays à grande flotte, tels que le Liberia, Panama ou les Bahamas, prennent position ensemble. S'ils décident que telle disposition ne doit pas être adoptée, elle ne le sera pas.
M. le Président : A l'instar des Etats-Unis qui mettent l'OMI en difficulté !
M. le Rapporteur : Est-ce dissuasif ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Tout à fait, mais sur certaines questions, on va jusqu'à procéder au vote.
Les grands principes généraux visant à élaborer une convention ou à adopter certaines orientations doivent faire l'objet d'un consensus. Toutefois, si tel ou tel point achoppe, il est procédé au vote et c'est le résultat qui compte.
D'un autre côté, il existe un clivage entre les pays développés et les pays en voie de développement. Pendant six ans, j'ai constamment essayé d'affranchir la France de ce clivage. La France est l'un des seuls pays de l'OMI à entretenir un dialogue avec les deux camps.
Je disais tout à l'heure que la situation n'était pas statique sur le plan international, mais qu'il y avait une évolution permanente. Citons à titre d'exemple la convention SOLAS qui définit la façon dont les navires sont construits. Cette convention, adoptée en 1974, a été modifiée en 1981, 1983, 1987, 1988 - par trois amendements -, 1989 - par deux amendements -, 1990 - par trois amendements -, 1991, 1992 - par cinq amendements -, 1994 - par quatre amendements -, 1995 - par deux amendements -, 1996 -par six amendements -, 1997 - par deux amendements -, 1998 et 1999. En d'autres termes, cette convention a été modifiée quasiment tous les ans.
Certains de ces amendements modifiant la convention SOLAS ont été déposés à la suite d'accidents. Tel fut le cas en 1990 à la suite du sinistre du Herald of Free Enterprise qui a fait naufrage au large de Zeebrugge. Il en a été de même en 1995, à la suite du naufrage de l'Estonia qui a coulé en Baltique en 1994.
M. le Président : Les amendements en question ont été adoptés à la suite d'accidents de bateaux à passagers plutôt que dans le prolongement du naufrage de navires-citernes ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Dans les deux cas !
M. le Président : Bien que l'opinion publique soit plus sensible aux questions concernant la vie humaine, aucune différence n'intervient dans l'un ou l'autre cas ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Suite à l'accident de l'Erika par exemple, des modifications seront certainement apportées à la convention SOLAS et également à la convention MARPOL.
M. le Rapporteur : Au titre de la méthode, un amendement à une convention en vigueur présenté par un Etat est-il entériné par un vote ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Oui !
M. le Rapporteur : A la suite de ce vote, est-il applicable ou doit-il faire l'objet d'une ratification ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Tout dépend de la teneur de l'amendement !
Par exemple, dans le cadre de la convention MARPOL, tout dépend si l'amendement porte sur les annexes ou s'il porte sur la convention elle-même. S'il vise à modifier la convention, il doit être de nouveau ratifié. S'il porte sur certaines annexes, ce qui peut être le cas en matière de double coque, il entrera en vigueur par tacite approbation.
M. le Rapporteur : Quel est le nombre d'Etats requis pour ratifier une modification des conventions ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Le nombre d'Etat est déterminé par chaque convention. Il s'agit d'un nombre d'Etats représentant un certain pourcentage de la flotte mondiale.
M. le Rapporteur : Nous y voilà !
M. Jean-Marc SCHINDLER : En général, il s'agit de quinze Etats représentant 50 % de la flotte mondiale. Mais ces chiffres, propres à chaque convention, peuvent varier.
M. le Rapporteur : Par conséquent, la convention n'est applicable que si elle est validée par quinze Etats représentant au moins 50 % de la flotte ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Par exemple ! Je précise en outre que tout amendement adopté par tacite approbation fait l'objet d'une procédure de sauvegarde : le secrétaire général diffuse l'amendement et, après un certain temps, il entre automatiquement en vigueur, sauf si un certain nombre d'Etats s'y opposent dans un délai donné.
Il existe deux systèmes, sachant que chaque convention définit la procédure d'amendement.
Dans le premier, les conditions d'entrée en vigueur de l'amendement sont quasiment remplies de la même manière que celles de la convention, c'est-à-dire un certain nombre d'Etats pour un pourcentage donné de la flotte mondiale.
Dans l'autre, en l'occurrence celui retenu pour les annexes de la convention SOLAS l'amendement entre en vigueur automatiquement sauf si un nombre donné d'Etats s'y opposent.
M. le Président : Et ce, quel que soit le pourcentage de la flotte que ces Etats représentent ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : En général, les deux sont liés et c'est là que réside le verrou du système !
M. le Rapporteur : Compte tenu de la dissuasion que représente la participation financière au fonctionnement de l'OMI et du verrou que constitue l'acceptation de la validation d'une convention, c'est ainsi que les Etats à grande flotte font la loi ? Qu'en pensez-vous ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : J'aurais tendance à dire que les Etats à grande flotte faisaient la loi...
M. le Rapporteur : Et qu'ils la font moins ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : ... et qu'ils la font moins, pour un certain nombre de raisons.
Très récemment, l'Organisation n'avait que la responsabilité d'établir les conventions. Elle ne se préoccupait absolument pas de leur mise en _uvre qui relevait de la responsabilité des Etats. Etant donné que ce système ne fonctionnait pas, est apparu le contrôle par l'Etat du port.
M. le Rapporteur : Les Etats ont donc décidé de contrôler que les conventions de l'OMI étaient bien appliquées, n'est-ce pas ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Tout à fait !
M. le Rapporteur : Seuls les textes validés par tous les Etats membres sont contrôlés par l'Etat du port ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Absolument, mais ils sont de plus en plus contrôlés !
M. le Rapporteur : Et contraignants ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Contrôlés et contraignants, en effet !
La procédure a été enclenchée avec le Mémorandum de Paris et, depuis, sept ou huit systèmes de contrôle par l'Etat du port ont été institués dans le monde. Autant dire partout : que ce soit à Tokyo, au Japon, ou à Viña del Mar, en Amérique du Sud. Auparavant, les bateaux qui risquaient de se faire contrôler en Europe pouvaient aller naviguer ailleurs pour ne pas être embêtés, alors qu'ils le sont maintenant partout dans le monde.
Par ailleurs, nombre d'Etats côtiers - pas ceux du pavillon - ont fait entendre leur voix à l'OMI. Ils estimaient qu'il n'était pas normal que certains Etats du pavillon n'appliquent pas correctement les conventions. Sous la pression de ces Etats, l'OMI a créé voilà huit ans un sous-comité FSI - Flag State Implementation. En charge de l'application des instruments de l'OMI par l'Etat du pavillon, ce sous-comité a pour objet de définir le niveau d'application de chacune des conventions et de leurs annexes et d'y veiller. Il s'agit évidemment d'une démarche à long terme.
Dans cette affaire, il s'agit de distinguer deux types d'Etats et c'est là que le débat peut faire l'objet d'une distorsion. Certains Etats refusent délibérément une telle application parce que leur intérêt économique s'y oppose. D'autres ont un intérêt portuaire à l'activité maritime, si je puis dire, mais ils n'ont pas les moyens ni le savoir-faire pour développer un contrôle sérieux par l'Etat du pavillon. Autrement dit, nous nous heurtons à la situation suivante : parmi l'ensemble des Etats qui n'appliquent pas bien les conventions, certains voudraient bien le faire et d'autres s'y refusent. Or quand nous les mettons tous dans le même sac, si j'ose m'exprimer ainsi, nous avons beaucoup trop de monde contre nous ! La démarche du FSI vise donc à séparer le bon grain de l'ivraie.
C'est ainsi que nous avons été à l'origine d'une démarche qui s'est amplifiée au cours de ces trois ou quatre dernières années.
Nos amis britanniques qui avaient décidé d'observer comment les Etats fonctionnaient et de mettre les « bons » d'un côté et les « mauvais » de l'autre, ont dû renoncer à leur démarche devant l'opposition à laquelle elle s'est heurtée.
M. le Rapporteur : Vous parlez des Etats du pavillon ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Il avait été décidé d'observer le fonctionnement des Etats du pavillon, de faire figurer les bons sur une liste blanche et les mauvais sur une liste noire et d'évacuer ces derniers.
M. le Rapporteur : C'est-à-dire qu'il était envisagé d'interdire l'entrée dans les ports aux navires battant de mauvais pavillons ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Montrés du doigt, l'entrée dans les ports, devait effectivement leur être interdite.
M. René LEROUX : Cette idée n'était soutenue que par les Britanniques ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Les Britanniques, les Scandinaves et les Américains.
M. René LEROUX : Pas la France ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : La France soutenait le principe mais pas la méthode.
En fait, nous avons proposé de séparer les bons des mauvais pavillons et, pour aider les bons, de dresser la liste des responsabilités des Etats du pavillon qui figurent dans toutes les conventions. Le sous-comité FSI a donc dressé la liste des obligations de tout Etat du pavillon.
M. le Rapporteur : Cela n'avait pas été fait auparavant ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Non !
M. le Rapporteur : Par conséquent, à quoi servaient les conventions internationales auparavant ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : En fait, on estimait que les Etats étaient assez grands pour savoir ce qu'ils devaient faire.
M. le Rapporteur : Depuis quand ce sous-comité FSI existe-t-il ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Depuis huit ans et cette liste a été dressée voilà trois ou quatre ans.
M. le Rapporteur : Cette liste récapitule les responsabilités et les devoirs de l'Etat du pavillon ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Tout à fait.
M. le Rapporteur : Etant donné que nous nous rendons prochainement à Malte, serait-il possible de nous en fournir un exemplaire pour savoir comment les autorités maltaises remplissent leurs obligations d'Etat du pavillon ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Je vous remettrai ce document.
Quand cette liste a été dressée, la France a souhaité poursuivre et approfondir le travail pour savoir si les Etats remplissaient bien leurs responsabilités.
M. le Rapporteur : Comment ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : La discussion a tourné en rond pendant un certain temps. Finalement, un formulaire d'auto-évaluation a été établi. Ce document permet de voir si l'Etat est en mesure de satisfaire ou pas à ses obligations. Pour l'instant, ce dispositif est purement facultatif. Mais tous les Etats européens ont décidé qu'avant la fin de l'année 2000, ils seraient dotés de ce formulaire d'auto-évaluation. Les Etats-Unis ont adopté une attitude identique. Par conséquent, une pression internationale est exercée pour que chaque Etat fournisse son document. Dans un premier temps, les Etats voulaient garder pour eux ces formulaires. Nous avons réussi à obtenir qu'ils les transmettent à l'OMI pour diffuser de nouvelles statistiques. Le sous-comité FSI saura ainsi, convention par convention, les points qui sont bien appliqués et ceux qui ne le sont pas.
A la suite de l'accident de l'Erika, la France a proposé de rendre obligatoire ce formulaire qui, pour l'instant, n'est que volontaire.
M. le Rapporteur : Pour rendre ce formulaire obligatoire, il faudra que l'OMI délibère pour que le principe soit admis par l'ensemble des pays ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Absolument !
En tout cas, alors que nous sommes partis de très loin, nous nous orientons réellement vers la coercition et la transparence.
Citons un autre exemple qui va dans le même sens. En 1978, l'OMI a établi une convention sur la qualification des équipages. Il s'agit de la convention STCW qui, sous la pression d'un certain nombre d'Etats - dont le nôtre - et ainsi que celle du Secrétaire général, a complètement été refondue en 1995. Tandis que la convention de 1978 contenait le minimum minimorum de qualification que les Etats ont accepté, celle de 1995 qui définit le niveau adéquat de qualification pour un poste donné est extrêmement contraignante. Par conséquent, du minimum minimorum, nous sommes passés à un niveau satisfaisant.
Par ailleurs, la convention elle-même donne à l'organisation un pouvoir de contrôle de l'action des Etats, c'est-à-dire que chacun des pays membres de l'OMI a dû complètement revoir son système de formation. En France, le ministère des Transports a organisé plusieurs journées consacrées à l'éducation maritime et il a totalement revu son système de formation des équipages français. Il a fallu constituer un dossier comportant tous les textes de lois, décrets, arrêtés ainsi que les contenus des cours. Ce dossier a été adressé au secrétariat de l'OMI qui a établi une liste des responsables compétents en formation maritime. Un groupe d'experts étudie le dossier de chacun des pays pour s'assurer de la conformité à la convention STCW de 1995.
M. le Rapporteur : Est-ce volontaire ou libre ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Cela est obligatoire !
M. le Rapporteur : Depuis 1995 ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Depuis 1995, date à partir de laquelle chaque Etat devait fournir son dossier. Nous devrions aboutir très prochainement à la « liste blanche » des pays dont le système de formation est conforme à la convention et dont les titres seront acceptés par tous les autres pays.
Les Philippines posent actuellement un problème considérable, car sur ses 122 écoles, seules 2 auraient été conformes à la convention. Actuellement, le pays procède au changement complet de son système pour qu'il devienne conforme à la convention.
Bien que passée complètement inaperçue, cette décision a fait l'objet d'une petite révolution au sein de l'OMI. Pour la première fois, une convention confiait à l'OMI des pouvoirs de contrôle, ce qui, à mon avis, constitue une première étape.
M. le Rapporteur : Serait-il possible d'avoir un résumé en français de la convention STCW ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Probablement par le ministère.
M. le Président : Par l'intermédiaire du directeur des Affaires maritimes et des gens de mer, M. Serradji.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Sur ce problème, M. Serradji a d'ailleurs saisi la balle au bond !
M. le Rapporteur : Il a bien fait d'ailleurs !
M. Jean-Marc SCHINDLER : Travaillant en parfaite symbiose avec lui, je lui ai fait valoir les besoins des pays étrangers en termes de formation. Il tente donc actuellement de spécialiser certaines de nos écoles pour former des étrangers.
M. René LEROUX : Quand cette application interviendra-t-elle ? Vous parliez de la fin de l'année 2000 ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : La fin de l'année 2000 marque l'échéance à laquelle les pays devront fournir leur formulaire d'auto-évaluation.
M. le Rapporteur : Sur la convention STCW ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Sur l'ensemble des conventions !
Je vous ai cité deux exemples : d'une part, celui du formulaire d'auto-évaluation qui vaut pour l'ensemble des conventions et, d'autre part, celui de la convention STCW par laquelle le secrétariat de l'OMI se voit attribuer des pouvoirs de contrôle.
M. Louis GUEDON : Chaque pays contrôlera donc son voisin ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Voilà ! C'est ainsi que certains de nos experts ou de nos personnes compétentes ont participé au contrôle du dossier des Etats-Unis.
La convention STCW ayant été finalisée en 1995, les Etats devaient remettre leur dossier jusqu'en 1997 ou 1998. Nous sommes donc actuellement dans la phase d'épluchage des dossiers détaillés et de validation. D'ici à la fin de l'année 2000 ou au tout début de l'année 2001, le secrétaire général de l'OMI sera en mesure de dresser une liste des Etats dont le système de formation est conforme à la convention STCW, ce qui constituera un pas en avant. Je vous rappelle que le niveau d'exigence de la convention est totalement différent du précédent.
M. le Président : Je reviens sur le premier exemple. Peut-on imaginer que parmi ces Etats désireux de respecter les obligations incombant aux Etats du pavillon, certains n'aient pas les compétences, l'administration et la culture requises et qu'ils s'adressent, dans le cadre d'une coopération, à un pays plus expérimenté dans le système - tel que la France -, pour les aider à mettre en place, comme cela a été fait pour l'adduction d'eau par exemple, une administration maritime digne de ce nom et capable d'assainir leur flotte ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : C'est le cas ! Pressentant l'évolution des choses, je me suis rapproché du Quai d'Orsay et de la structure du ministère des Affaires étrangères chargée de la coopération aujourd'hui. Il s'agissait, à l'époque, du ministère de la Coopération, le but était d'établir un protocole de coopération technique entre la France et l'OMI. C'est sur cette base que nous aidons un certain nombre de pays à assumer leurs responsabilités. Nous y avons consacré 450 000 francs en 1996 et en 1997, 800 000 francs en 1998 et en 1999 et, pour 2001, nous envisageons...
M. le Président : Des montants ridiculement modestes au regard du budget !
M. Jean-Marc SCHINDLER : A vrai dire, je fais ce que je peux ! (Sourires.)
M. le Président : A quelles fins sont utilisées ces sommes ? Sont-elles destinées à rémunérer notamment des techniciens et des experts ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Avant de répondre à votre question, je conclus sur l'aspect financier.
Pour 2001, nous envisageons un plan sur plusieurs années pour sécuriser une certaine somme. Au fil des années, l'OMI a établi un plan intégré de coopération technique qui a été élaboré en partenariat avec les pays receveurs et l'organisation. Un comité de la coopération technique définit les priorités stratégiques d'aide aux pays qui en ont besoin. Ces priorités concernent, d'une part, la ratification des conventions et, d'autre part, les conditions d'application correctes des conventions ratifiées. Ce plan intégré de coopération technique définit, pour chaque Etat demandeur, les opérations à mener pour atteindre un niveau satisfaisant.
M. le Rapporteur : En formation ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Dans tous les domaines, que ce soit en termes de capacité pour leur administration de remplir ses missions au titre de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port, ou bien en termes de formation. Bref, ce protocole que la France a signé avec l'OMI est destiné à faciliter la mise en _uvre des actions intégrées dans ce plan.
M. le Président : Cela passe donc par l'OMI ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : En effet ! L'organisation a élaboré un catalogue des actions qui seraient utiles, voire indispensables, pour parvenir à relever le niveau de l'ensemble des Etats. Mais elle n'a pas les moyens financiers de réaliser ces opérations. Nous avons donc voulu montrer l'exemple en décidant d'y participer.
M. Jean-Pierre DUFAU : Cet exemple a-t-il été suivi par d'autres Etats ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Oui !
M. Jean-Pierre DUFAU : Où en est-on à l'heure actuelle plus globalement ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Cette initiative a été suivie par Singapour et par le Danemark, si je ne m'abuse.
Parallèlement, compte tenu du dialogue qu'entretient la France avec les pays développés et les pays en voie de développement, une résolution a été prise au cours de l'assemblée de l'OMI de 1997, par trente-cinq pays en voie de développement, plus la France, pour demander au secrétaire général d'affecter tous les fonds inutilisés de l'organisation au profit de la coopération. Il s'agit, en particulier, de plusieurs millions de livres sterling stockés dans un fonds de publication constitué par la vente - très rentable - des publications de l'OMI. Par conséquent, cette résolution oblige le secrétaire général à consacrer cet excédent au profit de la coopération.
S'ajoutent à ce fonds de la coopération technique doté de plusieurs millions de livres sterling, les actions que les Etats, de leur côté, tentent de mettre en place. Nous essayons de leur tenir un discours cohérent en ces termes : « Pour vous aider à vous remettre en question et à vous auto-évaluer, nous avons constitué un catalogue d'actions et nous consacrons des financements. Maintenant, allons-y ! »
M. le Rapporteur : Aux termes de la convention STCW, il est obligatoire de fournir certains éléments. Comment l'Etat du pavillon qui ne remplit pas ses obligations est-il pénalisé ? Par voie de conséquence, si je me réfère à ce précédent-là, admettons
- hypothèse d'école - qu'après avoir fait l'inventaire de l'application de la convention MARPOL, elle soit rendue obligatoire comme nous le demandons, comment pénaliser tout manquement à ses prescriptions ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Le système de pénalisation, qui vaut ce qu'il vaut, est prévu dans la convention STCW mais pas dans les autres. En fait, c'est l'inscription ou la non-inscription sur la « liste blanche » des pays qui respectent les dispositions de la convention qui constitue la sanction. Le pays qui n'appartient pas à la « liste blanche » se verra refuser ses marins sur tous les autres bateaux.
M. le Rapporteur : Il est certain qu'il se verra refuser tous ses marins ? Cela s'est-il déjà produit ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : La « liste blanche » n'étant pas encore parue, je ne saurais vous le dire !
M. le Rapporteur : Mais telle devrait être la logique ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Absolument ! Si à l'occasion de sa visite sur un bateau, l'inspecteur de l'Etat du port s'aperçoit que ledit pays ne figure pas sur la liste...
M. le Rapporteur : Le bateau reste au port ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Voilà !
M. le Président : C'est le propos que nous a rapporté voilà quelques jours un inspecteur du centre de sécurité des navires de La Rochelle qui nous a dit avoir refusé de laisser partir un navire sur la base de l'incompétence du second capitaine qu'il avait relevée.
M. le Rapporteur : Et ce non pas au titre de la convention STCW, mais sous sa responsabilité personnelle et entière.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Cela montre bien l'intérêt qu'ont les deux parties. L'Etat du port aura l'assurance d'une qualification reconnue avec la « liste blanche ». En revanche, pour l'Etat du pavillon, le titre ne sera plus attribué à la tête du client. S'il figure sur la « liste blanche », son titre ne devra pas être refusé pour incompétence. Par conséquent, pour certains Etats du pavillon - je pense, en particulier, à Panama qui tente de redorer son image -, il s'agit aussi d'une garantie. Si leur système est reconnu et si leurs équipages sont qualifiés, il ne sera pas possible de dire que leurs bateaux sont mal gérés.
M. le Rapporteur : Dans quels délais cette « liste blanche » sera-t-elle mise en place ? Pensez-vous que nous puissions interroger le secrétaire général de l'OMI à ce sujet demain ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Oui ! Vous pouvez parfaitement lui demander dans quels délais il envisage la publication de la « liste blanche ».
M. le Rapporteur : Cette publication fera-t-elle des dégâts, à votre avis ? Pensez-vous que beaucoup d'Etats ne figureront pas sur la « liste blanche » ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Des cas se présenteront sans nul doute. On peut penser à cet égard aux Philippines. Mais j'avoue avoir quelques inquiétudes quant aux modalités qui seront mises en place par l'OMI pour gérer ce dispositif.
M. le Rapporteur : Nous pourrons nous en entretenir demain avec le secrétaire général de l'OMI.
M. Jean-Pierre DUFAU : Imaginons un cas limite quelque peu pervers, celui d'un Etat du pavillon, panaméen par exemple, figurant sur la « liste blanche », donc agréé, alors que l'équipage panaméen n'est pas agréé. Dans ce cas, est-il possible de recourir à un autre équipage sur un bateau du pavillon de Panama ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Bien entendu ! Par exemple, un bateau sous pavillon de Panama peut avoir un équipage exclusivement indien si celui-ci est reconnu.
M. le Président : L'Erika était un bateau pourri mais son équipage n'était pas incapable !
M. le Rapporteur : En tout cas, son équipage était adapté à ce qu'il coûtait !
M. Jean-Marc SCHINDLER : Et homogène !
M. Jean-Pierre DUFAU : Il faudrait envisager de faire un « paquet cadeau », si je puis dire, de toutes les dispositions prévues dans les conventions relatives au navire lui-même, à son état, au respect des précautions à observer sur le navire et à l'équipage, sans s'en tenir uniquement à la qualification de ce dernier. Il faut que s'applique la totalité de la procédure.
M. Louis GUEDON : Les qualifications porteront donc sur la formation de l'équipage et la reconnaissance des diplômes. Compte tenu de la liberté de navigation dont vous nous parliez tout à l'heure, le contrôle de l'équipage portera sur la validation du diplôme de chaque membre de cet équipage dont la nationalité peut être étrangère au pavillon sous lequel il navigue, n'est-ce pas ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Bien entendu ! Mais il s'agit aussi de tenir compte, au titre de la qualification, du système de reconnaissance des brevets. J'attire votre attention sur le fait que le contrôle est effectué par l'Etat du port. En fait, nous, sur un navire français, nous reconnaîtrons tel ou tel brevet, mais rien n'empêchera un pays de reconnaître tous les brevets figurant sur la « liste blanche ».
M. Louis GUEDON : Même les brevets achetés ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Théoriquement, c'est-à-dire si le système est bon, ils ne le seront plus !
Par ailleurs, les brevets font l'objet de conditions de revalidation. Un marin ou un capitaine n'a pas un brevet à vie. Celui-ci doit être revalidé tous les cinq ans.
M. le Rapporteur : Dans ce dispositif, le contrôle est effectué par l'Etat du port. N'est-il pas envisagé de l'assurer par l'Etat du pavillon ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Dans mon esprit, mais telle n'est sans doute pas l'opinion générale, le contrôle par l'Etat du port existe parce que le contrôle par l'Etat du pavillon est un échec.
M. le Rapporteur : Nous sommes donc bien d'accord !
M. Jean-Marc SCHINDLER : Il faut bien comprendre que la convention STCW met en place un dispositif tout à fait nouveau par rapport à toutes les autres conventions existantes. La difficulté consistera précisément à amener ces autres conventions à peu près au même niveau que la convention STCW. Quant aux modalités, je ne suis pas devin ! Par exemple, le formulaire d'auto-évaluation est un des moyens d'y parvenir, d'autant plus qu'il est proposé de le rendre obligatoire. Par ailleurs, au sein de l'OMI, des idées ont été émises en faveur du contrôle de ce que fait un Etat par les autres Etats. Un tel dispositif existe dans l'aviation civile, l'OACI ayant un corps d'inspecteurs de différents pays qu'elle envoie dans tel ou tel pays. Certes, à terme, nous procéderons ainsi, mais dans quels délais ? Là est le problème !
M. le Président : Vous avez donc le sentiment d'un accord ?
M. René LEROUX : Ou d'une volonté pour l'instant ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Plutôt d'une volonté !
M. le Rapporteur : Partagée ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Tout n'est certes pas parfait à l'OMI - loin s'en faut ! - mais le principe du laisser-aller qui prévalait voilà une dizaine d'années quant au niveau de performance de l'Etat du pavillon n'a plus cours. En cas d'accident, même minime, il est procédé à un examen de ce qui a été fait par l'Etat du pavillon. Par conséquent, la pression sur les Etats concernés augmente de plus en plus. Par ailleurs, les dispositifs qui ont commencé à être mis en place vont être amplifiés. Un exemple frappant est celui de Panama et du Liberia. Panama a fait des efforts assez considérables depuis trois ou quatre ans pour essayer de revaloriser son image de marque.
M. le Rapporteur : Quels types d'efforts ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : D'abord, Panama a payé ses cotisations à l'OMI, ce qui n'est pas négligeable au regard du budget de cette dernière. Ensuite, Panama intervient beaucoup plus fréquemment. Certes ses positions visent encore à défendre les grandes flottes et à recourir à la procédure anglo-saxonne du laisser-faire, selon laquelle chacun est responsable. Mais Panama se sent maintenant concerné et attaqué.
L'attitude du Liberia est quelque peu différente. S'il a la même attitude de présence aux travaux de l'OMI, il considère que l'on ne donne pas assez d'importance aux Etats à grande flotte qui, de surcroît, sont de gros contributaires. Du coup, il n'a pas payé sa contribution complètement.
Parmi les 157 Etats membres, 32 pays font partie du Conseil de l'organisation. Panama est y entré, alors que le Liberia en est sorti.
M. le Président : Est-ce exact que derrière la flotte du Liberia, il y a les Etats-Unis ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Oui, je pense qu'ils ont quelque influence.
M. le Président : D'après ce que nous avons pu comprendre, en cas de conflit majeur, la flotte libérienne serait la flotte supplétive de la flotte américaine.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Je n'irais pas jusque là ! Beaucoup d'autres pays ont des bateaux sous pavillon du Liberia ou de Panama.
M. le Président : Si tel était le cas, cela expliquerait, de manière générale, le bon état de la flotte libérienne.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Il est certain que le Liberia a longtemps constitué un pavillon des plus puissants. Mais depuis quatre ou cinq ans, compte tenu de l'évolution dont je vous parlais, Panama a nettement pris le pas sur le Liberia. En l'occurrence, il est clair que s'est produite une fuite des bateaux du Liberia vers Panama.
M. le Rapporteur : Quelle nature de fuite ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : De pavillon !
M. le Rapporteur : De quels pays ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Je ne saurais pas vous en dresser une liste exhaustive, mais de tous les pays, me semble-t-il. En France, des armateurs ont certainement un avis autorisé sur la question. Je pense par exemple à la Sté Dreyfus qui doit avoir des bateaux sous ces pavillons. Le CCAF devrait pouvoir vous renseigner.
M. le Rapporteur : Vous dites que l'on s'oriente vers un dispositif généralisé dans les autres conventions qui s'apparentera à celui mis en place par la convention STCW ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Je ne sais pas s'il s'y apparentera. En fait, avant la création voilà huit ans du sous-comité FSI, il n'y avait aucune velléité de contrôle de l'action des Etats. Or il est certain que depuis cette création, on s'oriente de plus en plus dans cette direction. En témoignent notamment la convention STCW et le formulaire d'auto-évaluation. L'idée est maintenant bien établie que les problèmes rencontrés aujourd'hui dans le domaine maritime sont liés non pas tant à l'existence de règles qu'à leur application. Par conséquent, la pression va nécessairement s'amplifier dans ce domaine.
M. le Rapporteur : Dans quels délais ? Imaginez-vous un mouvement s'opérant sur une dizaine d'années, voire plus ?
M. le Président : Cette question relève peut-être du pronostic ! (Sourires.)
M. Jean-Marc SCHINDLER : Personnellement, je pense que d'ici à une dizaine d'années, la situation aura nettement évolué.
M. le Rapporteur : La perspective est celle d'un dispositif MARPOL multicontrôlé, n'est-ce pas ? Tel est l'objectif ! L'auto-évaluation fera place à des corps d'inspecteurs ou à un système dans lequel chacun appréciera l'attitude de l'autre. Pensez-vous que cette perspective ne se heurte plus à une opposition insurmontable des membres de l'OMI ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : L'idée n'est pas encore franchement acceptée, mais il est évident qu'elle progressera en ce sens. Dans quels délais ? Je n'en sais rien. Néanmoins, depuis la création du sous-comité FSI il y a huit ans, et depuis la convention STCW de 1995 ainsi que le formulaire d'auto-évaluation d'aujourd'hui, force est de reconnaître que les choses ont beaucoup évolué en moins de dix ans. Elles continueront à progresser dans les dix années à venir. Il est même probable qu'elles s'accélèrent.
En revanche, il faut vraiment agir avec la mentalité internationale. Il s'agit d'un point délicat ! Par exemple, en 1997, s'est produit l'accident du Nakhodka, un pétrolier russe en mauvais état qui s'est cassé en deux au large du Japon. Depuis le naufrage de l'Erika, les Japonais ont l'impression qu'un tel sinistre est un événement beaucoup plus important quand il se produit en Europe que quand il survient au Japon. Or cela est négatif, à mon avis ! Pour indemniser les victimes immédiatement, l'ensemble des Etats européens veulent prendre des mesures extrêmement fortes. Or les Japonais étaient seuls pour les prendre à la suite de l'accident du Nakhodka. Ce n'est que tout récemment que le FIPOL a porté à 70 % le taux d'indemnisation des Japonais pour un accident survenu en 1997. Ils ont donc le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Voilà pourquoi je disais que c'était négatif.
M. le Président : Cela ne tient-il pas au fait que cet accident de l'Erika affecte la France, laquelle joue un rôle dans la communauté européenne ? A partir de là, quelles sont les relations entre l'OMI et la communauté européenne en tant que puissance politique potentielle ? De ce point de vue, peut-on parler d'une nouvelle donne ? Si demain, sous des formes différentes, les Etats-Unis et l'Europe se mettaient d'accord pour imposer une nouvelle donne, compte tenu du poids que cet ensemble d'Etats représente dans le commerce international, ne serait-ce pas de nature à balayer les réticences qui peuvent exister et à accélérer le processus ?
Par ailleurs, si demain, l'Europe, toute seule, avec les ports que l'on connaît
- Rotterdam, Anvers, Hambourg et Felixstowe -, exigeait que plus aucun navire poubelle ne circule dans les eaux des quinze, ne serait-ce pas de nature à accélérer les choses ? Quel est l'armement, quel est le pays qui peut se permettre de ne plus avoir accès à Rotterdam ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Vaste question !
L'Europe est effectivement une donnée dont l'OMI est maintenant obligée de tenir compte de plus en plus, essentiellement sur le plan politique.
En revanche, à la base, surgit une source de conflit, et je m'en explique. Les mesures que peut prendre l'Europe sont régionales et celles que peut prendre l'OMI sont mondiales. Or pour l'OMI, tout ce qui est régional est mauvais, à commencer par l'Oil Pollution Act américain.
Par contre, que l'on travaille sur une stratégie des alliances, oui ! Si les pays qui ont des intérêts communs interviennent groupés, ils pourront très facilement contrebalancer les grandes flottes.
M. le Rapporteur : Groupés, c'est-à-dire l'Europe...
M. Jean-Marc SCHINDLER : ...et les Etats-Unis, par exemple, bien qu'il ne s'agisse pas d'une évidence sur le fond des dossiers.
Cela étant dit, parmi les mesures envisagées à la suite du naufrage de l'Erika, l'une d'entre elles mérite, à mon sens, d'être prise. Elle n'a pas grand chose à voir avec l'accident, mais il faut profiter de l'effet de ce sinistre pour la faire passer. Je veux parler de l'affaire des pétroliers à double coque et à simple coque.
L'obligation des pétroliers à double coque est une mesure que les Américains ont décidée unilatéralement. Le chef de la délégation américaine avec qui j'en ai discuté avant l'accident de l'Erika, m'a dit que les Etats-Unis avaient perdu, au moins pendant cinq ans, une considérable influence dans les instances maritimes internationales parce qu'il s'agissait d'une décision unilatérale.
Dans l'état actuel des choses, je suis intimement persuadé - et c'est à cela que l'on travaille avec le ministère des Transports et le Quai d'Orsay - que l'on peut, avec l'aide de Bruxelles et conjointement avec Bruxelles, transformer cette mesure en une mesure mondiale.
Nous travaillons actuellement sur les propositions françaises, adressées par les ministères respectifs des Affaires étrangères, des Transports et de l'Environnement, sur un schéma dont je souhaite qu'il reste entre nous.
D'abord, une proposition serait soumise au comité de la protection du milieu marin de l'OMI qui doit se réunir en octobre prochain.
A cet égard, deux possibilités sont offertes. La première consiste à adopter une mesure régionale. L'autre consiste à prendre une mesure dans le cadre de l'OMI. A l'égard de l'ensemble du monde, si nous prenons d'emblée une mesure régionale, nous aurons beaucoup de mal à l'imposer. En revanche, si notre attitude consiste à dire que cette mesure sera meilleure dans le cadre d'une application mondiale, donc à aller devant le forum mondial qu'est l'OMI pour lui demander de prendre cette mesure, je suis quasiment certain que nous obtiendrons quelque chose au niveau mondial. Rien n'empêche cependant l'Europe de continuer par ailleurs à travailler sur la question et de voir comment elle pourrait être traitée au plan régional.
M. le Président : Pensez-vous qu'elle pourrait être prise dès la fin de l'année, et ce pour des raisons de calendrier liées à la procédure ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Pas d'ici à la fin de l'année !
Une proposition d'amendement à la convention MARPOL pourrait être soumise au comité de la protection du milieu marin. En vertu précisément des procédures, le texte doit être discuté et approuvé, ce qui nous conduit au mois d'octobre prochain. Ensuite, l'amendement sera diffusé pendant les six mois de délai obligatoire, ce qui nous conduit à la réunion du comité de la protection du milieu marin de juillet 2001. Enfin, il sera adopté.
M. le Rapporteur : Comme amendement ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Comme amendement à la convention MARPOL !
M. le Rapporteur : Mais à la suite de son adoption, il faudra que les Etats le ratifient ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Pas du tout ! Il entrera en vigueur automatiquement.
M. le Rapporteur : En annexe de la convention MARPOL ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Tout à fait !
Il entrera donc en vigueur seize mois après, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2002.
Pourrions-nous avancer plus rapidement dans le cadre de l'Union européenne ? Je n'en suis pas certain ! En revanche, si en nous adressant à l'OMI le schéma que je décrivais ne fonctionnait pas et que nous décidions de travailler sur cette question au sein de l'Union européenne, personne ne pourra nous reprocher d'avoir pris une mesure régionale. Nous pourrons toujours rétorquer que l'OMI n'ayant pas voulu la prendre, nous en Europe, nous la prenons !
M. Louis GUEDON : A l'occasion des auditions de ces trois derniers mois, nous avons beaucoup entendu parler de l'OMI et en bien. Vos propos confortent donc ce que nous avons entendu sur son rôle qui a notamment contribué à pallier les problèmes internationaux.
Toutefois, au cours de ces auditions, quatre points ont été mis en exergue.
En premier lieu, on nous a mis en garde - à tort ou à raison - contre les limites mondiales de l'OMI quant à son efficacité par rapport à chacun des Etats.
En deuxième lieu, on a attiré notre attention, suite à l'accident de l'Erika, sur la dangerosité des couloirs de navigation de la Mer du nord et de la Manche, très étroits et très peuplés, et donc sur les risques qu'encouraient les pays riverains.
En troisième lieu, on nous a parlé de l'affaire des Coast Guards.
En quatrième lieu, une idée a été lancée : étant donné que l'OMI fait bien son travail mais qu'elle est trop diluée sur la planète, ne conviendrait-il pas de créer un système européen de prévention, de surveillance, de police et de réglementation ?
Vous qui avez une grande expérience des relations internationales dans le domaine maritime, pensez-vous que cette idée a des chances de prospérer ou faut-il d'emblée l'abandonner ?
M. Jean-Pierre DUFAU : Avant de traiter d'autre sujets, je reviens un instant sur l'affaire des pétroliers à double coque et sur la façon d'aborder le processus.
Selon vous, quelle devrait être l'attitude d'un pays récemment victime du sinistre de l'Erika, la France en l'occurrence, à l'occasion du lancement de ce genre d'initiatives ? Après avoir déblayé le terrain, cela suppose au préalable un certain nombre d'alliances, car ce que vous dites n'est pas neutre en termes stratégiques.
La tendance des pouvoirs publics français qui doivent accéder prochainement à la présidence de l'Union européenne sera effectivement de porter ce dossier sur les fonds baptismaux européens, avec le sentiment que le poids de l'Europe pèsera ainsi plus lourd. Or stratégiquement, vous pensez que cette mesure serait perçue comme une mesure régionale par la grande majorité des pays membres de l'OMI. Par conséquent, si nous devons la porter directement devant l'OMI, quelle stratégie devons nous suivre ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Je crois qu'aller seul au combat, ce n'est jamais bon !
M. le Rapporteur : L'Europe ne sera pas seule !
M. Jean-Marc SCHINDLER : C'est vrai, mais il faut développer une stratégie avec les pays qui, dans le monde, ont à faire face au même type de problèmes. Citons, par exemple, les Etats-Unis, mais aussi l'Afrique du Sud. A l'instar de la Bretagne, tous les bateaux contournent le Cap de Bonne Espérance.
Ce n'est pas à moi qu'il appartient de déterminer la stratégie de la France. En revanche, je vais vous faire part de ce dont je suis convaincu. La mesure de prévention ou de protection qui est souhaitée peut être prise au niveau soit mondial, soit régional. Dans les deux cas, il y aura un calendrier. Si le calendrier mondial est à échéance de dix ans, prenons-la sur le plan régional ! Si dans les deux cas, l'échéance est à peu près identique, je crois que l'on aurait tort de privilégier le régional.
M. Jean-Pierre DUFAU : Faut-il privilégier les pétroliers à double coque ou supprimer les pétroliers à coque unique ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Je crois qu'il convient plutôt de supprimer les pétroliers à simple coque.
M. Jean-Pierre DUFAU : Et ce, afin d'ouvrir d'autres possibilités que celles prévues dans le système américain, n'est-ce pas ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : En effet ! Cela étant, la France s'est battue contre les pétroliers à double coque. Elle est à l'origine de l'adoption par l'OMI d'un dispositif alternatif dit « à pont intermédiaire ». A ma connaissance, rares sont les bateaux à double pont qui naviguent. Il n'en existe qu'un en France, me semble-t-il.
J'en viens à l'importante question posée tout à l'heure par M. Guédon parce que la construction des navires est une chose, mais la façon dont ils sont conduits et surveillés et celle dont l'Etat réagit en est une autre.
Il faut savoir que la France est parmi les Etats pionniers s'agissant des dispositifs existant en Manche. Ces dispositifs sont essentiellement français. Il existe trois centres de surveillance côté français et un côté anglais. La France s'est dotée depuis belle lurette de remorqueurs d'intervention en haute mer, alors que les Anglais en ont mis en place voilà seulement deux ans, et encore en nous demandant comment procéder ! Quel plaisir personnel, en tant qu'ancien marin, d'être interrogé par un Anglais qui estime que j'en sais plus que lui sur la question maritime !
Actuellement, nous travaillons en parfaite symbiose avec les Anglais, en vertu de l'accord, Manche-Plan.
Le Manche-Plan est une réalité depuis quinze ans. Il définit la façon de traiter un accident dans la Manche. Le premier qui est prévenu le déclenche. S'il s'agit d'un accident d'un bateau anglais avec uniquement des Anglais à bord mais qui survient en zone française, l'opération peut être déléguée aux Anglais. Bref, il existe toute une codification de l'action à mener. Le CROSS de Gris-Nez et le centre de Douvres suivent exactement les mêmes bateaux, s'échangent toutes les informations et fonctionnent en parfaite symbiose.
En revanche, je déplore qu'un fait ne soit pas mis en exergue, et je m'en explique. Le Pas-de-Calais est fréquenté par environ 600 bateaux par jour, soit un peu plus de 200 000 bateaux par an. A ma connaissance, mais il conviendrait de vérifier les chiffres, entre six et douze abordages se produisent chaque année, généralement sans gravité. Cependant l'action des CROSS évite entre 150 et 200 accidents graves. Sincèrement, ces actions sont efficaces.
Pour en revenir à votre question, il n'est pas du tout utopique d'assurer une continuité de surveillance de Gibraltar jusqu'au nord de la Mer du nord. Tel est l'avenir ! Par ailleurs, il ne sera pas difficile d'instaurer un échange d'informations entre les différents pays européens. C'est le cas avec les Anglais et les Belges. Je ne vois pas pourquoi ce ne le serait pas avec les Hollandais.
M. le Rapporteur : Il s'agit là d'un dispositif ne relevant pas de l'OMI mais propre à l'Europe, n'est-ce pas ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Voilà !
M. Louis GUEDON : Votre réponse peut donc se résumer en ces termes, M. le conseiller : oui à une information fiable et transparente et confiance aux Etat européens ; non à une organisation européenne mettant des moyens en commun, excepté l'exemple des CROSS.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Nous pouvons parfaitement mettre en place un système de surveillance complètement intégré.
M. Louis GUEDON : Nous pouvons aller jusque-là ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Oui !
M. Louis GUEDON : Votre réponse est donc affirmative ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Absolument ! Je dirai même qu'à l'OMI, nous avons toutes les chances que ce système intégré soit retenu au titre de la sécurité. Un navire ne s'annoncera ainsi qu'une fois et tous les autres le suivront, ce qui évitera un lourd travail administratif. Le secrétaire général a dit clairement que toute extension du dispositif existant en faveur d'une meilleure efficacité sera bien vu à l'OMI. Il s'agit donc d'une excellente démarche.
M. le Rapporteur : Avant de poursuivre sur ce thème de la sécurité, je souhaite revenir sur celui de la stratégie.
Tout le monde s'accorde à reconnaître que ce qui pose problème, c'est non pas l'absence de réglementation, mais la non-application de cette réglementation. Les textes sont suffisants et tout fonctionnerait parfaitement bien s'ils étaient appliqués, excepté certaines dispositions techniques, notamment celles concernant les pétroliers à double coque.
Tout le monde s'accorde également à reconnaître qu'il suffit de demander à l'OMI de faire appliquer ces textes pour que ce soit l'enterrement de première classe !
Ces propos, unanimes, nous ont été tenus un peu partout, que ce soit à Bruxelles ou à Paris. Compte tenu des propositions françaises, du Mémorandum des autorités françaises, du fait que le Conseil des ministres européen a pris acte d'une série de propositions de la Commission, on nous dit, bien que nous ne puissions pas savoir quelle suite y sera réservée, que le rôle de la France est de veiller à ce que dans les six mois à venir, des dispositions soient prises. On nous dit également de ne pas les renvoyer à l'OMI, car si elles l'étaient, par le Conseil des ministres des transports de la fin de l'année, rien ne se ferait. Bref, nous venons à Londres avec ce sentiment.
Dans ces conditions, comment est-il possible que l'OMI pilote les propositions qui sont faites par la Commission et qui nous agréent globalement puisqu'elles sont très proches des propositions françaises ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Sur ce point, la réponse est multiple. Je n'entre pas dans le détail des propositions parce qu'elles sont très différentes.
Sur le plan de la stratégie et du principe, il m'est difficile de répondre à votre question. En fait, on ne peut pas demander à l'OMI de faire ce qu'elle ne peut pas faire, étant donné qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition. Autrement dit, vous ne pouvez pas demander à un agent de la force publique de faire respecter la loi si vous ne l'y avez pas habilité avant. L'OMI se trouve dans une situation similaire actuellement. Le problème, c'est non pas qu'elle ne veut pas mais qu'elle ne peut pas.
M. René LEROUX : On tourne en rond alors !
M. Jean-Marc SCHINDLER : Non ! Il faut mener une réflexion de fond sur les moyens de donner des pouvoirs efficaces à cette organisation.
Bien entendu, il serait délicat de lui demander dès maintenant de faire appliquer nos propositions. En revanche, en les isolant les unes après les autres, je crois que nous pourrions y parvenir. Je vous citais d'ailleurs tout à l'heure l'exemple de la suppression des pétroliers à simple coque.
M. le Rapporteur : En termes politiques, il est impossible pour les pouvoirs publics français de laisser passer l'émotion suscitée par le naufrage de l'Erika. La présidence française de l'Union européenne se doit d'aboutir à des positions fortes. Si l'on dit que l'on a confiance en l'OMI, ce sera politiquement ingérable, non seulement pour le gouvernement français, mais aussi à l'égard de l'opinion publique.
M. Louis GUEDON : N'oublions pas les propos de M. le conseiller, selon lesquels si l'Europe présente un projet intelligent au titre de la sécurité du transport maritime de produits polluants ou dangereux, l'OMI l'intégrera avec bienveillance.
M. Jean-Pierre DUFAU : Toute décision prise unilatéralement par les Etats-Unis, Etat fédéral, n'est pas considérée réellement comme une décision régionale. Même si l'OMI ne les a pas faites siennes en tant que telles, il n'empêche que les positions américaines pèsent fortement sur elle.
Si à la suite de l'accident de l'Erika, l'Europe prend des décisions contraignantes et claires en matière de contrôle, celles-ci seront considérées comme des décisions régionales, dites-vous. Au lieu d'arriver à exercer une influence sur l'OMI, on a quasiment le sentiment d'une rivalité, si bien que des blocages s'opèrent alors qu'il conviendrait d'aller dans le même sens.
Compte tenu de l'implantation en Europe du siège de l'OMI, je ne comprends pas qu'à l'instar des Américains, nous n'exercions pas une pression pour faire passer facilement à l'OMI ce qui est porté par l'Union européenne.
M. Jean-Marc SCHINDLER : C'est précisément le message que j'ai tenté tout à l'heure de vous faire passer en insistant sur la nécessité de travailler sur les deux données en parallèle. Ce que redoute le plus le secrétaire général actuellement, c'est que l'Europe prenne une mesure et que l'OMI ne soit pas associé au processus. Par conséquent, ce dernier fera tout ce qu'il peut pour faire passer les mesures auxquelles tiennent les Etats membres de l'Union europénne...
M. Jean-Pierre DUFAU : J'irais même plus loin, en caricaturant quelque peu mon propos pour mieux illustrer le fond de la pensée que j'ai exprimée tout à l'heure : c'est quasiment la guerre des polices !
M. Jean-Marc SCHINDLER : En quelque sorte !
M. Jean-Pierre DUFAU : Ne pourrions-nous pas aussi imaginer une autre attitude qui consisterait à faire comprendre que l'Europe n'intervient pas uniquement pour elle, mais qu'elle souhaite déclencher, à partir de son cas personnel et de son éthique propre, un processus qui serait repris dans le cadre de l'OMI ? Pourquoi serait-ce nécessairement antinomique ? Pourquoi ce qui est proposé par l'un se ferait-il au détriment de l'autre ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Je ne vous ai pas dit clairement que les propositions et avancées dont je parlais tout à l'heure ont toutes été faites par des pays européens. Il est clair que l'influence européenne à l'OMI est très forte, ce qui provoque même un « ras-le-bol » de certains autres pays, si vous me permettez cette expression.
M. Jean-Pierre DUFAU : Mais ces propositions et avancées n'ont pas été faites par l'Union européenne !
M. le Président : Pas par l'organe politique !
M. Jean-Marc SCHINDLER : Non, parce qu'en vertu de la convention, seuls les Etats sont membres de l'Organisation. La Commission ne peut être qu'observateur...
M. le Rapporteur : Elle est observateur ici ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Elle l'est !
C'est généralement le pays qui exerce la présidence de l'Union européenne qui s'exprime et porte les initiatives de l'Union au sein de l'OMI.
M. Jean-Pierre DUFAU : Par conséquent, en termes stratégiques, il vaut mieux que ce soit le pays qui exerce la présidence de l'Union européenne qui soutienne les propositions de la Commission à l'OMI avec l'aval de la Commission.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Tout à fait !
Sachant que ce sont les gouvernements membres de l'OMI - et non son secrétariat - qui décident, profitons de l'effet Erika et réfléchissons avec nos amis européens à la façon de doter l'organisation de pouvoirs de contrôle.
M. le Rapporteur : Comment imaginez-vous ces pouvoirs de contrôle ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Ce que j'évoquais tout à l'heure en me référant à l'OACI est un bon exemple de ce qu'il faudrait mettre en place.
Il s'agit de travailler sur la question, d'engager une réflexion et de soumettre des propositions précises à l'OMI, et ce dans un cadre européen. Nous pouvons parfaitement entre nous, pays européens, réfléchir à la façon dont l'OMI pourrait veiller à l'application de ces conventions. Le problème de l'OMI actuellement s'apparente à celui de l'agent qui n'a pas le pouvoir de verbaliser.
M. Louis GUEDON : Nous sommes entièrement d'accord avec votre conclusion. Cette idée fort sympathique n'est-elle esquissée qu'autour de cette table ou a-t-elle déjà germé au sein de différents Etats européens, avec l'espoir qu'elle réponde à des v_ux déjà formulés ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Cette idée a déjà été lancée au-delà de cette table, mais pas très au-delà ! Nous n'en sommes réellement qu'à l'aube de la réflexion. Je peux vous dire que nous avons travaillé avec le Quai d'Orsay sur cette idée de se doter d'un système potentiel de contrôle au sein de l'OMI, en commençant par examiner ce qui est mis en place dans les autres organisations internationales spécialisées, en particulier par l'OACI. Ce travail devrait tout naturellement déboucher sur le partage de la réflexion et un brainstorming avec nos amis européens.
M. le Président : Ne craignez-vous pas que la Communauté européenne ait tendance à mette en place un tel système de contrôle au niveau régional ?
M. le Rapporteur : Idéalement, le contrôle devrait être assuré par les Etats du pavillon qui devraient appliquer les textes de l'OMI. Puisque ce n'est pas le cas, on a instauré un dispositif avec des mémorandums permettant aux Etats du port de jouer ce rôle de gendarme.
Etant donné que l'on ne parviendra pas à faire la police avec les Etats du pavillon, l'OMI ne peut-elle pas considérer qu'on la confie aux Etats du port, que tous les mémorandums soient gardiens de la paix et que l'Organisation soit le législateur international ?
M. le Président : J'ajoute une autre raison : si les Etats-Unis ont mis en place leur système, c'est parce que la pression de l'opinion publique exigeait que les représentants des Américains, leur gouvernement fédéral, leurs Etats prennent des mesures.
M. Louis GUEDON : En France !
M. le Président : Certes, en France, mais aussi en Europe, dans une position différente ? Le Pays de Galles a été souillé voilà quelque temps et la Turquie vient de l'être dans le Bosphore, sans parler de la Baltique ! Compte tenu du nombre de bateaux qui fréquentent et traversent la Manche et la Mer du nord et qui risquent un jour - c'est une forte probabilité - d'entrer en collision, autrement dit compte tenu de la dangerosité de ces couloirs de navigation, ne croyez-vous pas que cette exigence politique, celle que l'on entend sur les côtes de l'Atlantique sous le slogan « plus jamais ça ! » trouverait un juste écho à l'OMI ? Je serais tenté de dire vulgairement que les gens « s'en fichent » de l'OMI. Ils exigent des mesures du gouvernement français et de l'Europe, sinon cela ne sert à rien.
Par conséquent, la pression va devenir nettement plus forte. Si l'OMI tarde en disant qu'il lui faut recueillir les voix des Etats, procéder aux votes, respecter les délais, cela pourrait ne donner lieu à aucune initiative européenne comme cela pourrait aussi se traduire par une réaction rapide de l'Union européenne.
M. Jean-Marc SCHINDLER : On peut en dire autant de l'OMI ! La convention SOLAS a été modifiée en 1995 pour régler les problèmes révélés par la catastrophe de l'Estonia qui s'était produite en 1994 et qu'avaient subi nos amis suédois, finlandais et norvégiens.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous faire une note sur cette dernière modification ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Je précise toutefois que cet accident a tout de même provoqué la mort de 900 personnes.
M. le Président : C'est pourquoi je vous ai posé tout à l'heure la question de savoir si une distinction était opérée entre les navires à passagers et les navires de fret.
Par ailleurs, la protection de l'environnement n'est pas reconnue dans la prise en charge par le FIPOL. Nous sommes donc encore loin de ce qu'attendent les régions côtières.
M. Jean-Marc SCHINDLER : N'ayant pas compétence pour déterminer des orientations politiques, je me contente personnellement de vous faire part de ma perception des choses.
M. le Rapporteur : C'est d'ailleurs tout l'intérêt de notre entretien !
M. René LEROUX : Les membres de l'organisation ont-ils été émus par ce qui est arrivé en France ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Absolument ! Nous avons reçu de nombreux témoignages de solidarité, à commencer par celui du secrétaire général de l'OMI. Certes, cela fait partie de son métier, si j'ose dire, mais sincèrement, l'émotion a été grande.
Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un accident majeur en particulier parce que, indépendamment des causes réelles de l'accident, ce sinistre témoigne d'un manquement au système mis en place par l'OMI au sujet du contrôle par l'Etat du port, du contrôle par l'Etat du pavillon et du contrôle par les sociétés de classification. L'OMI estime qu'un tel accident n'aurait jamais dû arriver et qu'à un moment donné, il aurait fallu dire « stop » à ce bateau !
Actuellement, l'organisation réfléchit et, indépendamment des propositions françaises, je suis convaincu que d'autres pays présenteront leurs propres propositions pour tenter de répondre à cette question : pourquoi le filet de sécurité a-t-il laissé passer ce bateau ?
M. René LEROUX : Cela expliquerait l'accélération visant à aménager les conventions et à les modifier par voie d'amendements ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Actuellement, des mesures sont mises en place, mais nous ne connaissons pas la cause technique exacte de l'accident.
M. le Président : Les Etats qui sont en cause, dont la Grèce, Malte et Chypre, auront-ils les moyens de s'opposer à cette évolution au sein de l'OMI ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Vous faites allusion au jeu des alliances ! Si nous trouvons suffisamment d'appuis, nous pouvons parfaitement réussir. Mais comme vous le souligniez, il s'agit réellement d'une stratégie. Mettons de notre côté tous les pays susceptibles d'avoir le même intérêt que nous, mais ne partons pas seuls au combat !
M. le Rapporteur : Même avec les Européens ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Au sein de l'OMI, organisation mondiale, le groupe européen est le plus fort. A un moment donné, nous avons même eu instruction de parler au nom de l'Union européenne. Le consensus est réel, me semble-t-il, pour conserver le principe d'une voix pour chaque Etat. Prenons en compte cette considération, mais mettons-nous d'accord entre nous pour élaborer des documents signés par vingt ou trente Etats. Tel est le maître mot et sans doute le mot de la fin !
Audition de MM. Robin BRADLEY et Collin WRIGHT,
représentants du Secrétariat permanent de
l'International association of classification societies (IACS)
accompagnés de M. Jean-Marc SCHINDLER,
représentant permanent de la France auprès de l'OMI, conseiller maritime de l'Ambassade de France en Grande-Bretagne
(extrait du procès-verbal de la séance du 12 avril 2000 à Londres)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président.
M. Robin BRADLEY : M. le président, madame et messieurs les députés, il me semble préférable de vous expliquer le point de vue de l'IACS dans les domaines que vous souhaitez explorer, en suivant l'ordre des questions dont vous nous avez saisis. Nous disposerons ainsi d'un cadre qui nous permettra d'engager un débat.
Ces questions ne m'étant parvenues que lundi dernier, mes propos pourront présenter des lacunes. Pour pallier d'éventuels oublis, je ferai de mon mieux pour vous faire parvenir, par la suite, des compléments d'information.
Pour argumenter les réponses à vos questions, j'ai apporté un certain nombre de documents que je vous remettrai à la suite de mes explications. Sans objection de votre part, je vais donc commencer à répondre à ces questions.
Votre premier point concerne plus particulièrement l'IACS et recouvre cinq questions.
La première s'intéresse au statut et au mode de fonctionnement de l'IACS. Avant de vous apporter des précisions à ce sujet, je tiens à vous remettre deux documents dont l'un s'intitule : « L'IACS et l'OMI, les liens essentiels ».
Permettez-moi de vous expliquer en quoi consiste l'IACS.
L'association compte 10 sociétés de classification membres et 3 sociétés de classification associées.
Les 10 sociétés de classification membres de l'IACS sont : l'American Bureau of Shipping basé à Houston, le Lloys's Register of Shipping au Royaume-Uni, le Det Norske Veritas, le Bureau Veritas, le RINA en Italie, le Germanisher Lloyd en Allemagne, le Russian Maritime Register of Shipping basé à Saint-Pétersbourg, le Korean Register of Shipping en Corée, la China Classification Society en Chine et le Nippon Kaiji Kyokai au Japon.
Les trois sociétés de classification associées à l'IACS sont : le registre polonais Polski Rejester Statkow, le registre croate Hrvatski Registar Brodova et le registre indien Indian Register of Shipping.
L'un des documents effectue un rappel historique sur lequel je n'insiste pas. Si cette question vous intéresse, vous pourrez consulter ledit document.
L'IACS est régie par un conseil au sein duquel siègent les dix membres. Le président actuel est le Dr Payer qui sera remplacé à la fin du mois de juin prochain par un membre de la Nippon Kaiji Kyokai de Tokyo. Le nouveau vice-président, M. Ponomarev du registre russe succédera à M. Hidaka.
Un deuxième comité, dénommé « groupe de politique générale », qui est une instance de l'IACS, se compose également de dix membres. Ces membres sont les représentants des dix sociétés de classification appartenant à l'IACS. Il est également présidé par la société de classification qui détient la présidence du conseil. La présidence du groupe de politique générale est actuellement assurée par M. Hormann du Germanisher Lloyd de Hambourg.
Ce groupe de politique générale est, en fait, chargé du travail technique de notre association. Par ailleurs, il assure, en coordination avec nous, le secrétariat et le travail de trente groupes de travail chargés des différentes questions techniques qui relèvent de l'IACS.
Chacune de ces instances se réunit deux fois par an. Le conseil se réunit en juin dans la ville du pays auquel le président appartient et au mois de décembre à Londres où siège l'association. Le groupe de politique générale, quant à lui, se réunit, chaque année, en mars et en octobre, et ce dans le pays auquel appartient le président en exercice.
Relèvent de la responsabilité des sociétés de classification : la réglementation technique, les normes, les directives et les inspections connexes relatives à la conception, à la construction et à la conformité des navires, ainsi qu'à toutes leurs installations, et ce conformément à un certain nombre de règles internationales adoptées par l'OMI et ratifiées par les Etats.
Pour situer le contexte, les sociétés de classification interviennent maintenant davantage dans le domaine opérationnel ou au profit des personnes puisqu'elles assurent un travail de certification au titre du code ISM.
Le troisième document dont je vous ai parlé, intitulé « La sécurité des navires et la prévention de la pollution - Régime réglementaire », a été réalisée par M. Smith, le représentant permanent auprès de l'OMI. Etant retenu à une autre réunion qui a lieu ici même, ce dernier vous prie de bien vouloir l'excuser de son absence. Cette brochure décrit plus en détail les rapports essentiels entre l'IACS et l'OMI. C'est au dos de cette brochure que figure un rappel historique de l'évolution de l'IACS et de la création des sociétés de classification.
La deuxième question de ce premier point concerne les critères que doivent remplir les sociétés de classification pour devenir membres de l'IACS. A cet égard, la charte de l'Association internationale des sociétés de classification explicite les conditions d'appartenance. Pour simplifier, je dirais que pour devenir membres de l'IACS, les sociétés de classification doivent répondre à des critères de qualité et de quantité. Il en est de même pour les sociétés de classification associées à l'IACS, ce qui répond à votre troisième question.
En termes de quantité, les membres doivent avoir participé activement aux groupes de travail pendant une période d'au moins trois ans. Ils doivent avoir une expérience de trois ans en tant que société de classification. Ils doivent détenir une flotte classée, comptant au moins 1 500 navires d'une jauge supérieure à 100 tonneaux, avec une jauge brute totale de 8 millions de tonnes. Dans le cas d'un navire appartenant à deux catégories, cette moyenne ne peut représenter que 50 % du navire et de la jauge. Les membres de l'IACS doivent également compter un personnel de 150 inspecteurs et de 100 experts techniques qui doivent tous être qualifiés et formés, conformément aux procédures fixées par l'association.
En termes de qualité, les sociétés de classification doivent posséder un certificat de conformité agréé par l'IACS.
L'IACS a son propre système de contrôle et de supervision. Un secrétariat de la qualité rend compte au conseil et non pas à moi qui en suis le secrétaire permanent. Il rend compte également à un comité directeur qui est composé des représentants des dix sociétés de classification membres. Le mandat de son président, d'une durée plus longue, n'est pas renouvelé tous les ans. Par ailleurs, le comité consultatif sur la qualité, dont sont membres les représentants de l'industrie maritime en général, est indépendant de l'IACS. Il assure un certain contrôle sur la qualité et l'indépendance du système de surveillance de la qualité. Chaque société fait l'objet d'un audit qualité tous les ans.
J'ai largement répondu à la première question qui est peut-être la plus importante pour vous décrire le mode de fonctionnement de l'IACS.
Quant aux sociétés associées, elles doivent satisfaire à peu près à la moitié des critères de quantité, soit la classification de 750 navires - mais d'une jauge brute totale de 2 millions de tonnes - et l'emploi de 75 experts et spécialistes.
En ce qui concerne les certificats de qualité, les sociétés de classification associées à l'IACS doivent satisfaire exactement aux mêmes critères que ceux exigés des sociétés de classification membres. Elles sont également censées satisfaire aux critères de notre code de déontologie, ce qui fait l'objet d'un autre document que je pourrais vous remettre.
Toujours dans ce premier point, la deuxième partie des questions a trait à la suspension des membres de l'IACS. Un cas récent est intervenu. Vous posez la question de savoir dans quelle mesure il s'agit d'un phénomène fréquent. En 1997, un membre a été suspendu, suite à des questions de transfert de procédures de classement. J'y reviendrai dans un instant. La société membre en question a tiré les choses au clair et elle a ensuite satisfait aux critères de qualité mais plus à ceux de quantité. C'est la raison pour laquelle cette société est devenue membre associé. Elle n'est plus membre de plein droit.
Avant d'aborder les initiatives récentes prises par l'IACS et d'évoquer, à ce titre, les changements de classe récemment intervenus, souhaitez-vous poser des questions complémentaires ?
M. le Rapporteur : Monsieur le secrétaire général, je voudrais vous poser deux questions portant sur l'appartenance des sociétés de classification à l'IACS et sur le poids de cette association dans l'activité de classification des navires.
En premier lieu, qui vérifie que les critères de qualité et de quantité sont bien respectés par les membres de l'IACS ? Avez-vous un organisme de contrôle supérieur ou les membres se contrôlent-ils mutuellement ? Comment cela se passe-t-il, en cas d'éviction d'un des membres ?
En second lieu, quel est le pourcentage de tonnage contrôlé par les sociétés membres de l'IACS dans le monde et quel est le pourcentage de tonnage qui ne l'est pas par les 10 sociétés membres de l'IACS et les 3 sociétés associées ?
M. Robin BRADLEY : J'en viendrai à votre seconde question dans un instant. Si toutefois mes réponses ne répondaient pas à votre attente, vous me la formulerez de nouveau.
Vous m'interrogez sur les critères de qualité. Le secrétariat à la qualité a été créé au début des années quatre-vingt dix. Le secrétaire a sous ses ordres deux responsables de la vérification et il emploie également des vérificateurs indépendants. Il fonctionne conformément à une procédure très strictement établie par le conseil de l'IACS. Tous les ans, il procède à un audit au titre du suivi de chaque société membre, pour s'assurer que chacune d'elles répond bien aux critères que nous avons fixés et pour vérifier également leurs propres procédures de qualité. Il se concentre surtout sur les exigences communes aux membres de l'IACS en vertu de la procédure unifiée que nous avons mise en place. Enfin, il réalise ce qu'on appelle un audit vertical : après s'être rendu au siège et après avoir rendu visite aux différents bureaux extérieurs de la société concernée, il examine également les navires classés par la société en question pour s'assurer que la procédure est bien respectée à bord de chacun des bateaux. Le secrétaire à la qualité rend compte au conseil à deux reprises chaque année. S'il s'agit de suspendre un membre, il appartient au conseil, après avoir posé un certain nombre de questions et émis un certain nombre de critiques, de proposer une procédure de suspension.
La démarche quotidienne, si je puis dire, de la gestion de ces affaires dépend d'un comité de la qualité qui, je vous l'ai indiqué, est constitué de dix membres représentant chacun une société de classification membre de l'IACS. Son président reste en exercice pendant trois ou quatre ans. Ce groupe se réunit deux fois par an avec le comité consultatif sur la qualité. Cet organe externe comprend des représentants de l'industrie. Il s'agit donc de garantir, au regard de l'activité industrielle, que le système de qualité fonctionne de manière indépendante, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement influencé par les membres de l'IACS. Ces derniers n'ont pas à contrôler directement le fonctionnement du comité de la qualité.
M. le Président : Un incident vous conduit-il à faire une enquête particulière si la société de classification du navire en question fait partie de vos membres ? Dans ce cas, comment cela se déroule-t-il ?
M. Robin BRADLEY : Si vous le voulez bien, j'évoquerai le cas de l'Erika pour vous expliquer ce qui a été fait par l'IACS.
A la suite d'une réunion extraordinaire du conseil qui s'est tenue au mois de février dernier, un communiqué de presse a fait part des grandes lignes des mesures qui allaient être prises par l'IACS. Plus récemment, un autre document que je mets également à votre disposition a été élaboré. Ce document décrit les décisions prises par le conseil de l'IACS.
Sous l'angle de l'enquête - puisque telle est la question spécifique que vous posez -, l'enquête officielle concernant l'événement relève de la responsabilité de l'Etat du pavillon. Les membres de l'IACS sont prêts, bien entendu, à apporter leur aide si elle est sollicitée par l'Etat du pavillon.
Une des initiatives prises par le conseil dans le cadre de sa réunion extraordinaire, a été de lancer une enquête de qualité portant sur 10 navires classés par la société de classification concernée, c'est-à-dire le RINA, et acceptés par ladite société de classification au cours des dernières années. Anciens, les navires retenus par l'enquête interne sont ceux qui présentent, en fait, le risque en tant que conséquences d'accident le plus élevé. Il s'agit essentiellement de pétroliers et de navires-citernes. Cette enquête maintenant interne à l'IACS est en cours actuellement.
Le RINA a également lancé une enquête technique. Le rapport préliminaire de cette enquête à laquelle ont participé ladite société de classification, un expert italien, me semble-t-il, et un service basé à Londres, le Three Quays Marine Services, a été publié lundi dernier.
Voilà les précisions sur les objets de l'enquête qui répondent à votre interrogation.
M. Jean-Pierre DUFAU : Je souhaite vous poser une question complémentaire. Comment expliquez-vous les délais entre la date à laquelle s'est produite la catastrophe de l'Erika, le démarrage de l'enquête du BEA-mer français à la fin de la première quinzaine de décembre 1999, la réunion du conseil en février dernier et l'enquête préliminaire du RINA parue voilà trois jours ?
M. Robin BRADLEY : En ce qui concerne l'enquête, je n'ai aucune influence ni sur sa durée, ni sur le temps que les intéressés souhaitent y consacrer. Il leur appartient d'en décider.
M. Jean-Pierre DUFAU : Ma question porte non pas sur la durée mais sur le démarrage de l'enquête ?
M. Robin BRADLEY : La production du rapport du RINA dépend entièrement du RINA. Je n'ai aucune influence sur son échéancier, si je puis dire.
La réunion extraordinaire du conseil s'est tenue au mois de février dernier, mais dans l'intervalle, nombre de questions avaient été déjà formulées. S'agissant des résultats, j'aborde deux points.
Vous relèverez qu'il avait été annoncé que l'IACS constituerait un comité d'enquête, en cas d'événements graves. L'objectif est, bien entendu, de fournir rapidement une expérience technique à l'Etat du pavillon qui est responsable, en vertu des conventions internationales en vigueur, de la mise en _uvre d'une enquête portant sur le sinistre. (2)
Cela étant dit, les délais et les dates retenus dépendent des sociétés de classification membres, en l'occurrence de celle qui mène sa propre enquête.
La convention internationale sur la responsabilité de l'Etat du pavillon pose des problèmes à l'IACS dans la mesure où il ne nous est pas possible de monter à bord du navire et d'interroger le commandant de bord.
J'aborde maintenant le deuxième point de votre questionnaire concernant le statut de chacune des sociétés de classification membres de l'IACS. Je ne suis pas en mesure de répondre. S'agissant de sociétés individuelles, elles sont officialisées de façons différentes et, en tant que secrétaire permanent, je n'ai pas de détails sur leur statut exact. Je pourrais évidemment vous les obtenir, mais je n'ai pas eu le temps de les rechercher au cours de ces deux derniers jours.
Le troisième point de votre questionnaire vise à savoir si nous pouvons établir un classement de la fiabilité des 10 sociétés membres de l'IACS. Je ne pense pas que vous puissiez vous attendre à ce que je m'avance trop à ce sujet ! (Sourires.)
Nous n'établissons pas de classement parmi les sociétés. Comme je vous l'ai dit, elles font l'objet d'un examen par le comité de la qualité, et ce tous les ans. Elle doivent donc satisfaire à certains critères. Toutes sont donc sur un pied d'égalité.
Cela étant dit, nous nous intéressons aux statistiques émanant, par exemple, des autorités portuaires. Nous essayons de surveiller les performances sur lesquelles nous attirons l'attention des membres. Mais nous n'établissons pas de classement.
M. Jean-Pierre DUFAU : A en juger par l'exemple que vous avez cité tout à l'heure, il n'y a que des déclassements.
M. Robin BRADLEY : En termes de sanctions, voulez-vous dire ?
M. Jean-Pierre DUFAU : Avez-vous procédé uniquement à des suspensions ou également à des radiations définitives ?
M. Robin BRADLEY : Nous ne pouvons recourir qu'à une sanction : si un membre ne satisfait pas aux critères de qualité, il est suspendu !
M. le Président : Ce qui est arrivé au RINA, est-ce un mauvais point pour son classement ?
M. Robin BRADLEY : Pour le classement en général, voulez-vous dire ?
M. le Président : Si à la suite du naufrage de l'Erika, un autre accident survient dans les prochains mois en mettant en cause la même société de classification, l'IACS sera-t-elle conduite à se poser des questions ?
M. Robin BRADLEY : Si le même événement se produisait, nous mettrions en _uvre le même processus d'enquête en matière de qualité. Toutefois, nous ne tirerions aucune conclusion tant que nous n'aurions pas fait d'enquête.
M. le Rapporteur : En termes de conséquences d'une suspension pour une société de classification, dans l'exemple que vous citiez, cela s'est-il traduit par une perte importante de chiffre d'affaires par rapport aux armateurs et aux sociétés d'assurances ? L'enjeu est-il important ?
M. Robin BRADLEY: Extrêmement ! Toutes les sociétés de classification membres et associées reconnaissent l'importance pour elles d'être liées à l'IACS. Occuper la présidence de l'association est également un enjeu très important pour les membres. Par conséquent, si une lacune ou une carence est mise en lumière lorsque les responsables de la qualité contrôlent une société de classification, les conséquences sont effectivement très importantes. C'est un fait grave !
Quant à la question concernant le pourcentage de la flotte mondiale, en tonnage et en unités, classé par les sociétés de classification membres de l'IACS, nous allons vous communiquer quelques chiffres.
M. Collin WRIGHT : Pour calculer le pourcentage de la flotte mondiale qui est couverte par les sociétés membres de l'IACS, nous disposons des chiffres des membres. Les chiffres que nous allons vous communiquer proviennent en l'occurrence du Lloyd's Register of Shipping qui dispose, en fait de la banque de données la plus importante sur les flottes mondiales. Certes, les membres tiennent à jour la liste de leurs navires, mais le Lloyd's Register of Shipping dispose également de détails sur les autres navires.
D'après les estimations, l'IACS représente 90 % du tonnage mondial, soit un peu plus de la moitié des navires. Cela signifie que les plus gros navires, par exemple ceux qui transportent des cargaisons lourdes et les pétroliers, sont classés par les membres de l'IACS, tandis que les navires plus anciens et de tonnage moins important moins de 2 000 tonneaux -, sont moins couramment classés par l'IACS. Généralement, à la fin de leur vie, si je puis dire, ces navires passent entre les mains de sociétés qui ne sont pas membres de l'IACS.
Vous demandez si les chiffres ont changé au cours des dernières années. Nous n'avons pas pu procéder à cet exercice, mais les services du Lloyd's Register of Shipping nous ont fourni quelques indications. La tendance générale marque une diminution du nombre de bateaux classés par les membres de l'IACS, mais en tonnage, ils sont, en fait, plus importants. Peu de grands pétroliers VLCC sont classés par des sociétés de classification telles que le bureau du Honduras, par exemple.
Pour répondre précisément à votre question, nous devons faire un résumé historique de l'évolution de la situation au cours des dernières années. Etant donné que nous ne nous sommes pas livrés à cet exercice pour notre propre compte, nous donnerons suite à votre demande.
M. le Président : Dans les réponses que vous apporterez, nous souhaiterions que vous précisiez le nombre de navires, et le tonnage.
M. Robin BRADLEY : Dans la brochure qui vous sera remise, il est indiqué que nous classons plus de 90 % du tonnage supérieur à 520 000 tonnes de jauge brute, soit environ 491 000 tonneaux. Les chiffres du Lloyd's Register of Shipping seront plus précis sans être très différents.
Par ailleurs, les 46 000 navires classés par les sociétés de l'IACS représentent plus de la moitié de la flotte mondiale. Nous réalisons un certain nombre d'enquêtes avec quelque 6 000 enquêteurs et des personnels spécialisés dans quelque 600 bureaux de par le monde.
Ces chiffres figurent d'ailleurs dans notre brochure. Les plus récents seront très proches de ceux-ci étant donné que ce document a été révisé dernièrement.
Vous nous demandez de détailler cette proportion pour chacune des sociétés membres de l'IACS et de préciser la présence de chacune d'elles dans le monde, notamment le nombre de centres qu'elles entretiennent, le nombre de pays où elles sont présentes et le nombre d'experts qu'elles emploient.
A ce sujet, nous allons vous remettre un tableau récapitulatif dans lequel figurent les pays dans lesquels les sociétés de classification de l'IACS sont représentées, ainsi que leur nombre de bureaux et d'experts de par le monde. Seuls les chiffres concernant la China Classification Society nous font encore défaut.
Lorsque nous disposons de l'information requise, nous la ventilons en « exclusif » et en « non exclusif ». Nous compléterons ce tableau et nous vous le ferons parvenir par l'intermédiaire de M. Schindler.
La question visant à savoir quel est le pourcentage de la flotte mondiale certifié par les sociétés de classification membres de l'IACS est intéressante. Vous souhaitez également savoir si cette proportion a notablement varié en vingt ans. En outre, vous nous demandez de vous fournir la liste des Etats qui délèguent leur compétence de contrôle des navires en leur qualité d'Etat du pavillon.
Nous en faisons rapport à un des sous-comités de l'OMI. Les informations que vous nous demandez figurent dans un document d'information que nous allons également vous remettre. Il s'agit en fait d'un tableau en haut duquel sont inscrites les sociétés membres et les Etats du pavillon. Au milieu de ce tableau, figurent les lettres « F » ou « P » : « F », Full en anglais signifie que la délégation est complète ; « P » précise que la délégation est partielle. Les codes figurant également en haut du tableau font référence à ce qui est délégué : SOLAS pour les navires de transport de cargaisons et les navires à passagers, MARPOL et la convention sur le tonnage.
Bref, vous trouverez dans ce tableau toutes les informations qui vous intéressent.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Pour faire le lien avec ce dont nous avons parlé hier, il s'agit précisément d'une demande du sous-comité FSI - application des instruments par l'Etat du pavillon - visant à savoir dans quelle mesure les Etats du pavillon déléguaient leurs responsabilités. L'IACS a donc fourni un travail extrêmement important, recensant, pavillon par pavillon, tout ce qui était délégué par les Etats du pavillon et tout ce qui était effectivement assumé par eux. Telle est donc la démarche dont je parlais et qui vise à avoir une meilleure approche de l'action des Etats, en tant qu'Etats du pavillon.
M. le Rapporteur : Pensez-vous que le fait, pour les sociétés de classification, d'être à la fois un organisme de certification et un organisme de classification des navires est une bonne chose ?
Par ailleurs, ne pensez-vous pas qu'il est dommageable que des Etats ayant une flotte importante n'aient pas une administration propre, directement sous leur responsabilité ? D'une part, cela donnerait à l'IACS et à ses sociétés de classification membres une autonomie et une identité plus fortes. D'autre part, cela éviterait les interprétations faites au sujet de tel ou tel événement, voire les procès d'intention.
M. Robin BRADLEY : Si je me place dans la perspective de l'IACS et de ses membres, je dirai que le premier dépositaire d'expertise en matière de construction navale est le système d'ingénierie détenu par les sociétés de classification.
A ce titre, permettez-moi de vous faire part d'un point de vue personnel qui n'est pas nécessairement celui de l'IACS. Le sous-comité FSI est l'un des plus importants de l'OMI parce que les responsabilités, aux termes des conventions internationales en vigueur, sont celles des Etats du pavillon. C'est un fait que nombre d'entre eux délèguent à nos membres, ce qui est une bonne affaire pour eux ! Après tout, c'est ce qui les intéresse !
Toutefois, je pense que les Etats du pavillon - et Dieu sait si la liste est longue ! - n'auront jamais, dans la pratique, l'expertise requise au sein de leur propre administration, excepté les grands Etats maritimes. Je crains que les autres ne puissent prétendre acquérir cette expertise qui restera détenue par les sociétés de classification.
Je répète qu'il s'agit là d'un point de vue personnel parce que j'ai été responsable de l'administration de l'Etat du pavillon pour le Royaume-Uni qui est maintenant la MCA, Maritime and Coastguard Agency. L'administration du Royaume-Uni délègue beaucoup aux sociétés de classification, en tout cas à 6 d'entre elles.
M. le Rapporteur : Au titre de la certification ?
M. Robin BRADLEY : Elle délègue les fonctions statutaires, mais elle conserve sa responsabilité en termes de qualité, du moins sur la façon dont ce travail délégué aux sociétés de classification est mené à bien en son nom. Elle vérifie donc la qualité des contrôles effectués par les sociétés de classification.
M. le Président : Revenons sur la répartition des activités entre l'autorité du pavillon britannique et les sociétés de classification. Comment l'équilibre est-il assuré ? Comment le contrôle est-il effectué ?
M. Robin BRADLEY : Là encore, cette question ne concerne pas l'IACS. Les autorités du Royaume-Uni effectuent l'audit de leurs organisations reconnues, et ce de manière très approfondie. La Commission européenne a pris l'initiative d'assumer une partie de ces responsabilités au nom des Etats membres. Mais l'administration du Royaume-Uni dispose d'une équipe chargée de réaliser des audits. D'ailleurs, elle mène à bien actuellement l'audit d'un de nos membres.
Nombre de questions intéressantes se greffent sur ce sujet. Je pense par exemple au code ISM. Les sociétés de classification se sont écartées de leurs missions de base traditionnelles pour s'aventurer dans le domaine opérationnel. Le Royaume-Uni, seul cas dont je suis vraiment en mesure de parler, a gardé la responsabilité d'audit au titre de l'ISM. Si l'administration envisage de déléguer cette responsabilité en temps utile, elle gardera toujours celle de l'audit des sociétés de classification délégataires. C'est l'histoire du braconnier devenu garde-chasse ! Pour devenir garde-chasse, il est bon d'avoir été braconnier auparavant. C'est la raison pour laquelle le Royaume-Uni a décidé de procéder à cette certification ISM avant d'envisager de déléguer cette fonction.
M. Jean-Pierre DUFAU : Existe-t-il des exemples de différends qui se seraient produits entre l'Etat du pavillon et une société de classification ? De même, pourriez-vous nous faire part d'exemples de procédures qui auraient été engagées pour destituer une société de classification n'ayant pas bien fait son travail ? En cas de différends, comment cela se règle-t-il ?
M. Robin BRADLEY : Vous vous référez à des cas où des Etats du pavillon ne seraient pas satisfaits de la performance d'une société de classification et vous voulez savoir ce qui est fait dans ce cas-là, n'est-ce pas ?
M. Jean-Pierre DUFAU: L'Etat du pavillon ayant la responsabilité et la société de classification la compétence technique, un conflit peut survenir puisque, de toute façon, l'avis ou la décision de la société de classification engage la responsabilité de l'Etat. Si différends il y a eu, comment ont-ils été réglés ?
M. Robin BRADLEY : En fait, je n'ai aucun exemple à vous fournir, aucun cas à vous citer. Si vous en avez, je suis preneur !
La dernière partie des questions qui font l'objet du cinquième point porte sur un sujet que nous avons déjà eu l'occasion d'esquisser, celui des Etats du pavillon qui ne disposent pas d'une administration de contrôle des normes statutaires définies par les conventions internationales.
M. le Rapporteur : Il s'agit du tableau auquel vous avez fait allusion tout à l'heure ?
M. Robin BRADLEY : En effet.
Vous partez du principe que si cette responsabilité est déléguée, c'est parce que l'Etat du pavillon n'a pas la compétence requise. C'est une hypothèse !
M. le Président : Cette responsabilité est déléguée par l'Etat du pavillon parce qu'il n'a pas la compétence requise ou parce qu'il ne souhaite pas l'assumer !
M. Robin BRADLEY : Nuance effectivement très importante parce que l'Etat du pavillon doit avoir à la fois la compétence et la volonté !
M. le Président : Se pose tout de même un problème lorsque des Etats du pavillon ont des flottes extrêmement importantes et qu'ils ne disposent pas des moyens administratifs ou techniques en propre pour assumer leurs responsabilités.
En d'autre termes, si un petit Etat du pavillon a une petite flotte, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie de mettre en place une structure lourde. En revanche, s'il immatricule des centaines, voire des milliers de navires, ne pensez-vous pas que le fait qu'il ne dispose pas d'un minimum d'administration pose problème ?
M. Robin BRADLEY : Vous devriez poser cette question à l'OMI. Elle est intéressante parce que certains des plus gros pavillons, si je puis dire, sont également des pavillons de complaisance, tels que définis par la fédération internationale des transports maritimes. Mais cette question, je le répète, relève plutôt de l'OMI que de l'IACS.
Vous posez ensuite une question concernant les mécanismes de coopération et d'échange d'informations relatives aux navires entre les sociétés de classification membres de l'IACS.
En ce qui concerne les transferts et changements de classes...
M. le Rapporteur : Que voulez-vous dire par « transferts de classes » ?
M. Robin BRADLEY : Je veux parler des changements d'attribution des classes entre les sociétés membres de l'IACS, c'est-à-dire entre deux d'entre elles.
Dans ce cas particulier, l'historique du navire fait et fera l'objet de davantage de lisibilité. C'est une des initiatives qui a été mise en place à la suite du sinistre de l'Erika. Actuellement, si un navire change de classe, donc de société de classification au sein de l'IACS, la société de classification « perdante » et la société de classification « gagnante », si je puis dire, font toutes deux rapport au secrétariat permanent. La société de classification « gagnante » doit veiller à ce que toutes les enquêtes en cours ou toutes les conditions de classement qui avaient été établies par la société de classification « perdante » soient satisfaites avant de pouvoir véritablement assumer le classement du navire. Tel est le système de contrôle en place.
A la réunion du conseil, nous avons décidé d'améliorer l'efficacité de la procédure de changement de classe. D'abord, nous avons accru les exigences au niveau de l'enquête. Ensuite, nous avons amélioré les méthodes de contrôle de l'épaisseur de l'acier du navire. Enfin, nous avons également prévu qu'il fallait, en quelque sorte, constituer un dossier informatique qui puisse être transféré d'une société de classification à une autre. Par conséquent, nous avons pris des mesures visant à améliorer l'échange et le transfert d'informations d'une société de classification à une autre.
Par ailleurs, le système d'alerte précoce, déjà en place, fait plus particulièrement l'objet de notre attention depuis le sinistre de l'Erika. Il sera révisé. C'est un outil pour les membres de l'IACS qui leur permet de cerner et d'identifier des faiblesses récurrentes.
M. le Rapporteur : Pensez-vous qu'il est normal qu'un armateur puisse changer de société de classification sans aucune raison explicitée ? En analysant ce qui s'est passé avec l'Erika, nous avons eu le sentiment - mais celui-ci n'est peut-être pas fondé - que certaines sociétés de classification étaient réputées plus accommodantes que d'autres et qu'en cas d'incertitude, le propriétaire ou l'armateur pouvait passer d'une société de classification à une autre sans aucun souci d'une année sur l'autre.
Ne serait-il pas souhaitable qu'une codification oblige, comme c'est le cas pour d'autres activités de la vie économique, de ne changer de société de classification qu'à l'issue d'une certaine période ? Un contrat établi pour une certaine période pourrait éviter l'apparition de sociétés de classification plus ou moins accommodantes, plus ou moins exigeantes. Peut-être pourrions-nous parler de « complaisance » - mais le terme ne conviendrait pas à cette instance de l'IACS et il pourrait être mal interprété par vous-même ? Néanmoins, nous nous interrogeons à ce sujet.
Mme Jacqueline LAZARD : Ma question va dans le même sens que celle du rapporteur tout en la complétant : les changements de sociétés de classification pour un même navire sont-ils fréquents ? Par ailleurs, n'en va-t-il pas de la crédibilité de l'IACS de rendre obligatoire l'échange d'informations entre les sociétés de classification en cas de changement par les armateurs ?
M. Robin BRADLEY : Oui, nous devons en effet améliorer les échanges d'informations et il faudrait les rendre obligatoires. Nous nous orientons d'ailleurs dans ce sens.
Votre question comporte deux volets.
D'abord, certaines des mesures qui visent à renforcer la procédure de changement des sociétés de classification tendent précisément à décourager ces changements. En fait, des études beaucoup plus approfondies seront exigées et elles sont coûteuses.
Quant à savoir si de tels changements sont fréquents, j'avoue que je ne le sais pas très bien. Je ne crois pas que cela intervienne fréquemment, mais les navires changent régulièrement de propriétaire et de nom. La seule chose qui ne change pas, c'est le numéro OMI du navire. Lorsqu'ils souhaitent changer de société de classification, les propriétaires ont des raisons de le faire. Ils en ont le choix. Ils peuvent également changer de pavillon. Or les pavillons délèguent aux sociétés de classification, conformément à des accords passés avec ces dernières. Il peut donc arriver qu'un navire soit classé par telle société de classification mais que celle-ci ne soit pas reconnue par le nouvel Etat du pavillon. En fait, il existe une multitude de situations et de cas de figure.
Jusqu'à ce que le problème de l'Erika nous conduise à nous concentrer sur cette question, l'industrie était tout à fait d'accord avec ce qui avait été fait par l'IACS pour renforcer sa procédure de classement. L'objectif était d'empêcher qu'un propriétaire puisse changer de classification pour rechercher un régime plus « bénin », si je puis dire, en termes de normes de sécurité.
Même si notre entretien avait lieu quatre mois plus tôt, c'est-à-dire avant le sinistre de l'Erika, je dirais - je l'ai même dit - que notre procédure concernant le changement de société de classification a pratiquement éliminé les transferts de classe au sein de l'IACS pour les raisons que je viens d'évoquer.
Sachez que nous renforçons cette procédure actuellement.
M. le Rapporteur : Avant le sinistre de l'Erika, les décisions avaient été prises en ce sens ?
M. Robin BRADLEY : Oui. Avant le sinistre de l'Erika, les procédures de transfert de classe étaient déjà en place et elles avaient déjà été renforcées à plusieurs reprises. Après le sinistre, elles l'ont été de nouveau.
M. le Rapporteur : Renforcées et acceptées par le conseil ?
M. Robin BRADLEY : Oui, par le conseil.
M. le Rapporteur : Par conséquent, il est aujourd'hui très difficile pour un même propriétaire, sous un même pavillon, avec le même bateau, de changer de classe pour des raisons non explicitées ?
M. Robin BRADLEY : Absolument !
M. le Rapporteur : Quelles sont les exigences posées par l'IACS ? Bien que nous ne soyons pas des techniciens, pouvez-vous nous donner des exemples d'exigences posées pour le transfert de classe ?
M. Robin BRADLEY : Lorsqu'un navire change de société de classification, une étude est faite sur les conditions d'appartenance du bateau à une classe. Je vais demander à mon collègue de vous expliquer ce qu'il faut entendre par là.
M. Collin WRIGHT : Le principe de base, dont les mesures de renforcement sont actuellement à l'étude, est le suivant : la société de classification « gagnante » doit traiter le navire comme s'il était encore classé par la société de classification « perdante » et même de façon encore plus stricte parce que cette dernière pourrait étendre ses conditions de classe.
Les conditions de classe du navire découlent d'une étude, d'une enquête qui a déjà été réalisée. Si vous constatez que des réparations doivent être faites mais que, d'un point de vue technique, il n'est pas nécessaire de les réaliser sur le champ parce qu'elles ne présentent pas de menace pour la sécurité, le navire peut continuer à faire commerce. Dans une société de classement unique, si des raisons techniques sont invoquées, les conditions de classe peuvent être prolongées. Des réparations devront donc être effectuées à un moment ou à un autre dans le temps, sauf en cas de transfert de classe. Le dispositif est donc maintenant plus strict.
De plus, des inspections doivent être faites en fonction du type de navire et de son âge. Ce sont ces inspections complémentaires que l'on souhaite renforcer, à la suite du sinistre de l'Erika. Davantage de navires seront inspectés, notamment les navires-citernes. Il est donc envisagé d'accroître les inspections.
Le soupçon d'un traitement préférentiel subsiste. Aussi la société de classification « gagnante » doit faire un rapport à la société de classification « perdante » sur ce qu'elle a réalisé. Elle doit faire part à cette dernière des mesures qu'elle a prises. La société de classification « perdante » effectue des contrôles et si elle est insatisfaite, elle peut contester. Dans le cas de la suspension que nous avons évoqué, c'est ce qui s'est produit. Les sociétés de classification qui ont perdu le navire ont contesté ce que le membre avait fait, ce qui a débouché sur un audit complémentaire et sur les résultats que nous avons évoqués. Par conséquent, le système fonctionne.
Bien entendu, aucune société de classification ne souhaite perdre un navire et elle vérifiera que la société de classification « gagnante » fait bien ce qu'il faut.
M. Jean-Pierre DUFAU : Cette exigence liée au contrôle de la société de classification « perdante » par rapport à la société de classification « gagnante » existe-t-elle entre Etats en cas de changement de pavillon ?
M. Robin BRADLEY : Non, il n'y a rien de similaire.
M. René LEROUX : Je reviens sur le problème de l'Erika pour poser des questions très courtes.
Le bateau Erika a tout de même été contrôlé à plusieurs reprises par le RINA avant le contrôle par l'équipage qui, d'après ce qui est indiqué dans le rapport de cette société de classification, aurait été soi-disant mal fait.
Mes questions sont les suivantes : suite au rapport qui vient d'être publié, notamment dans la presse, j'aimerais savoir quel crédit vous portez à la version défendue par le RINA au sujet des causes de cet accident ? Estimez-vous acceptables les conclusions de ce rapport ? Estimez-vous normal que le RINA transfère ses responsabilités sur le capitaine ?
M. Robin BRADLEY : Vous m'aviez dit qu'il s'agissait de questions très courtes ! (Sourires.)
Le rapport a été publié lundi dernier. Je représente les 10 membres de l'IACS qui n'ont pas eu le temps d'y réfléchir ni de parvenir à une conclusion. Je ne suis donc pas en mesure de vous répondre.
M. le Président : Compte tenu des impératifs horaires, nous ne parviendrons pas à traiter toutes les questions. Sans doute pourrez-vous nous apporter des éléments de réponse par écrit en nous adressant des documents.
Dans l'immédiat, pourrions-nous traiter le neuvième point qui concerne les nouvelles propositions faites par la France et le rôle que l'Europe pourrait être conduite à jouer à l'égard des sociétés de classification ? Pourrions-nous connaître l'avis de l'IACS sur ces questions ?
M. Robin BRADLEY : Ce neuvième point concerne effectivement le rôle de la Commission européenne et ses récentes propositions. Il fait référence à la directive n°94-57.
En termes généraux, l'IACS souscrit aux propositions visant à amender cette directive. Cela étant dit, nous avons quelques questions concernant, notamment, la suspension ou le retrait de l'agrément des sociétés de classification négligentes et le mécanisme qui permettrait d'y procéder. Pour l'IACS, il est également important que la base des décisions et des jugements soit saine et cohérente. Il faudra donc sans doute débattre plus avant de cette question. Néanmoins en termes généraux, l'IACS peut souscrire fondamentalement aux modifications de la directive n°94-57 soumise au Conseil et au Parlement européen.
M. le Rapporteur : Une question également importante concerne la mise en _uvre du système EQUASIS. L'IACS est-elle favorable à une coopération accrue dans le cadre de cette mise en _uvre ?
M. Robin BRADLEY : Tout à fait ! D'ailleurs, l'IACS a été l'une des premières, me semble-t-il, à fournir des informations à EQUASIS. J'ai participé à la première réunion du comité de rédaction et il est très clair que nous avons fourni des informations de base pour assurer le démarrage d'EQUASIS. Notre contribution a sans doute été plus importante que celle de n'importe quel autre participant à ladite réunion.
Nous avons déjà fourni des données d'essai au cours des deux dernières semaines. Nous faisons donc tout notre possible pour apporter notre appui à EQUASIS.
Bien évidemment, un problème peut se poser quant à la propriété de l'information : à qui appartient cette information ? Mais notre attitude vise à rechercher la plus grande transparence possible.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Nous vous remercions beaucoup de votre collaboration qui est vivement appréciée.
M. Robin BRANDLEY : Merci à tous !
Je vais donc vous remettre les documents d'information dont je vous ai parlé. Je précise que celui qui résulte de la réunion extraordinaire du conseil de l'IACS du 16 février dernier et qui complète les informations qui ont été publiées dans le communiqué de presse, a été remis à un certain nombre de personnes qui l'ont sollicité, mais il n'a pas encore été rendu public.
M. le Rapporteur : Le communiqué de presse également ?
M. Robin BRADLEY : Le communiqué de presse, c'est une autre affaire. Je peux également vous le remettre.
M. le Président : Vous souhaitez que le document dont vous nous parliez à l'instant ne soit pas publié in extenso ?
M. Robin BRADLEY : Oui !
M. le Rapporteur : Permettez-moi de vous poser une dernière question : l'enquête interne que vous avez diligentée après l'affaire de l'Erika fera-t-elle l'objet d'un compte rendu public ou ne s'agira-t-il que d'une affaire interne à l'IACS visant à lui permettre de juger de l'efficacité ou non du RINA ou de toute autre considération ? Dans quels délais cette enquête sera terminée et ses résultats connus ?
M. Robin BRADLEY : S'agissant des délais, je ne suis pas en mesure de vous répondre.
Lorsque le compte rendu de l'enquête aura été réalisé, il sera soumis au Conseil. Celui-ci pourra souhaiter organiser une conférence de presse à l'issue de sa prochaine réunion, sans doute en Grèce, à Poséidonia. Je suis sûr que la question sera posée ! En cas d'informations disponibles, il appartiendra alors au Conseil de décider de les communiquer. Mais le compte-rendu en tant que tel sera interne. La réunion du Conseil se tiendra le 31 mai et le 1er juin prochain. La conférence de presse est prévue pour le 7 juin.
M. le Président : Donc avant la publication de notre rapport.
M. le Rapporteur : Vous parlez de la conférence de presse de l'IACS qui sera organisée par la réunion du Conseil prévue à Poséidonia ?
M. Robin BRADLEY : La date est en effet fixée au 7 juin prochain, mais il s'agit d'une conférence de presse à caractère général, qui n'est pas organisée à cause de l'Erika. Elle était prévue de toute façon.
M. Collin WRIGHT : Permettez-moi de revenir brièvement sur les délais d'enquête.
On a parlé des visites de navires en cause, lesquelles ne se font pas du jour au lendemain. Il faut que les navires soient au port et que l'on entame ces enquêtes. Par exemple, une enquête prévue aujourd'hui sur un navire ne commencera qu'à condition qu'il arrive ce jour. Rien ne garantit que tous les rapports seront disponibles d'ici au mois de juin prochain. C'est possible, mais ce n'est pas garanti. C'est même assez peu vraisemblable.
Audition de M. William O'NEIL,
Secrétaire général de l'OMI,
accompagné de
M. JONES, director administration division,
M. KHALIMONOV, director marine environnement division,
M. MITROPOULOS, director maritime safety division,
et Mme BALKIN, director legal and external relations division
(extrait du procès-verbal de la séance du 12 avril 2000 à Londres)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. William O'NEIL : M. le président, Mme et MM. les députés, je vous souhaite la bienvenue à l'OMI. Le service d'interprétation simultanée devrait faciliter notre débat et nos échanges. C'est ainsi que nos travaux sont généralement organisés à l'OMI.
Laissez-moi tout d'abord vous présenter les personnes qui siègent à mes côtés à cette tribune. En fait, cette salle est conçue pour des réunions d'un type quelque peu différent de la nôtre ce matin et je ne considère pas que nous soyons dans une situation d'opposition. (Sourires.)
Siègent à mes côtés M. Jones, Director Administration Division, M. Khalimonov, Director Marine Environnement Division, M. Mitropoulos, Director Maritime Safety Division, et Mme Balkin, Director Legal and External Relations Division.
La réunion, très utile, qui s'est tenue hier soir à la Résidence de M. l'Ambassadeur de France nous a donné la possibilité d'engager quelques échanges liminaires sur la situation du transport maritime au Royaume-Uni et en France. Nous tenons une nouvelle fois à remercier, par l'entremise de M. Schindler, son Excellence M. l'Ambassadeur d'avoir organisé ce dîner.
C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir au siège de l'OMI, même si les circonstances qui ont motivé votre déplacement à Londres ne sont pas très favorables. Bien entendu, nous sommes très préoccupés par les répercussions du naufrage de l'Erika et par les conséquences de ce sinistre pour l'environnement, en l'occurrence dans les régions affectées par les nappes d'hydrocarbures.
Une nouvelle fois, nous souhaitons rendre hommage, d'une part, aux autorités françaises qui ont conduit les opérations d'assistance en mer et, d'autre part, à la Marine nationale et à la Royal Navy qui ont assuré la sécurité de l'équipage et grâce à laquelle nous n'avons à déplorer aucune perte de vie humaine.
M. le président, à l'occasion de chacune des nombreuses réunions de nos comités et sous-comités que nous avons tenues à l'OMI depuis le début de l'année, j'ai souligné à plusieurs reprises combien cet accident est source de préoccupations pour nous. Nous attendons les résultats de l'enquête pour tenter de comprendre les raisons pour lesquelles ce navire s'est trouvé dans une telle situation. Précisément, j'ai demandé que cette enquête soit accélérée dans toute la mesure du possible pour savoir exactement ce qui s'est passé.
Néanmoins il est difficile d'envisager à ce stade des mesures pour remédier à la situation. Les autorités françaises nous ont déjà soumis un rapport préliminaire sur les causes possibles de ce naufrage, ce qui nous donne des pistes pour remédier à la situation. Je ne pense pas que nous soyons obligés d'attendre les résultats complets d'une enquête plus détaillée portant sur les circonstances de cet accident pour réfléchir à de telles mesures. Il y a certaines considérations auxquelles nous ne saurions surseoir. Les informations dont nous disposerons au fil des étapes seront certainement suffisantes pour nous conduire à prendre des mesures, en particulier d'ordre réglementaire. Lorsque celles-ci seront envisagées, j'aimerais que l'OMI en soit saisie.
C'est au sein de notre organisation que les décisions concernant les règles de la navigation internationale doivent être prises pour être appliquées à l'échelle mondiale. J'insiste sur ce point parce que nous sommes convaincus qu'il ne s'agit pas de se contenter d'examiner le problème à l'échelle régionale. Bien entendu, toute mesure nécessaire de redressement devrait être applicable à tous les navires de par le monde pour qu'un tel accident ne se reproduise pas.
Nous sommes très conscients de la nécessité d'examiner à fond les difficultés existantes et nous devons veiller, quelles que soient les mesures qui seront envisagées à la suite de cet accident, à ne pas transférer le problème dans tel ou tel autre point du globe. Je souhaitais insister sur ces différents aspects avant d'engager notre échange de vues sur ce qui s'est passé.
Bien entendu, nous avons pris connaissance du document que vous nous avez fait parvenir concernant le mandat de votre commission. Nous avons été saisis par les ministres français des Affaires étrangères et des Transports de certaines informations relatives à l'accident. Comme il nous l'a été demandé, nous les avons diffusées à tous les membres de l'OMI qui sont donc au courant de leur contenu.
Nous avons également suivi de très près les réponses et les réactions observées en France. Notre attention s'est portée sur des suggestions envisageant des mesures réglementaires de réponse et de coopération. Lors de la réunion du sous-comité sur la conception et l'équipement des navires qui s'est tenue ce matin, il a été décidé d'accepter la proposition soumise par la France et le Japon concernant la résistance longitudinale des navires. A cet égard, des mesures sont donc déjà prises au sein de notre organisation.
Nous sommes très conscients de la nécessité de montrer que nous pouvons réagir sans retard. L'OMI est parfois accusée de lenteur quant à la prise de décisions et de mesures. Nous sommes incontestablement obligés de respecter certaines dispositions réglementaires des conventions pertinentes de l'OMI concernant les délais pour introduire certaines modifications. Ces délais ont été fixés par les parties à ces conventions pertinentes lors de leur élaboration. Ces contraintes inhérentes au système peuvent, bien entendu, avoir des répercussions sur certains éléments que nous pourrions souhaiter examiner avec vous.
Cela étant dit, nous avons été en mesure dans le passé d'accélérer le processus en fonction des nécessités. Par exemple, dans le cas de l'Estonia, ce navire à passagers accidenté dans la mer Baltique et enregistrant une perte de près de 1 000 vies humaines, nous avons court-circuité nos procédures normales. Dans un délai de trois ou quatre mois, nous avons pu formuler des recommandations qui ont été examinées par le Comité de la sécurité maritime. Ensuite, s'est tenue une conférence visant à modifier la convention SOLAS et les dispositions de la convention sur la formation des équipages STCW. Par conséquent, dans la mesure où l'OMI en est saisie, la prise en compte est immédiate.
Etant donné la possibilité de modifier la convention CLC et la convention portant création du Fonds, il pourrait s'avérer nécessaire de relever les limites prévues par le second de ces deux textes. Nous avons attiré l'attention des membres sur la nécessité de formuler des recommandations quant à ce qu'ils souhaiteraient voir figurer dans la convention. Un certain nombre de parties étaient d'accord pour introduire des modifications. Pour que le Comité juridique puisse en délibérer, la demande devrait être déposée six mois auparavant. Ce délai court à compter de vendredi prochain. Nous avons donc insisté pour que toutes les mesures soient prises afin que ces propositions soient déposées dans les délais requis. Le Comité juridique pourra ainsi les examiner dans six mois, lors de sa prochaine réunion. Dès vendredi prochain, nous serons en mesure de diffuser ces demandes dans les trois langues de travail de l'organisation.
Par conséquent, en fonction de l'objectif recherché et des éléments visés, les processus nous permettent d'accélérer les choses, point sur lequel je souhaitais attirer votre attention avant d'aborder notre débat.
Nous sommes très sensibles au fait que dans le système de sécurité qui n'est pas entièrement le nôtre, des activités tentent de couvrir certaines situations. Par exemple, les sociétés de classification sont censées mener à bien les inspections structurelles et techniques liées notamment aux coques et aux machines des navires. Etant donné que cette responsabilité leur incombe, nous nous en remettons à elles. Nous comptons également sur les autorités portuaires pour effectuer certains contrôles pour lesquels elles sont compétentes. Cette responsabilité leur est d'ailleurs confiée par les gouvernements des pays concernés. Nous comptons aussi sur les propriétaires de navires pour assumer leurs responsabilités, ainsi que sur les Etats du pavillon. Tels sont en général les filets de sécurité en place pour assurer des garanties et éviter que se produisent des accidents.
Ce système de contrôle et d'examen a généralement bien fonctionné dans le passé. A plusieurs reprises, il a donné des résultats satisfaisants. Dans le cas précis de l'Erika, il est indéniable que ce système a échoué. Ce que nous pouvons faire maintenant c'est examiner le problème dans le détail et prendre les mesures appropriées.
Le système d'inspection et de protection qui nous semblait jusqu'à présent suffisant et adéquat n'ayant pas fonctionné, nous devons réfléchir aux modifications qu'il conviendra d'y apporter dans ses différents échelons. C'est sur ce point, extrêmement important, que nous nous concentrons actuellement.
Telle est la toile de fond que je souhaitais rappeler, M. le président, pour introduire notre débat.
Vous nous avez fait parvenir un questionnaire. Bien entendu, nous sommes prêts à répondre dans le détail et par écrit à ces questions pour vous faciliter la tâche. Certaines d'entre elles se prêtent mieux en effet à des réponses écrites. Nous sommes également tout à fait disposés à aborder avec vous, ce matin, celles qui vous tiennent particulièrement à c_ur. Je m'en remets donc à vous, étant donné les contraintes de temps auxquelles vous êtes soumis. Sans doute convient-il de nous concentrer sur celles qui vous paraissent les plus importantes ou qui revêtent un caractère d'urgence, étant entendu qu'en réponse à vos questions, nous vous soumettrons un document écrit.
M. le Rapporteur : M. le secrétaire général, Mme, MM. les directeurs, il est vrai qu'une partie des questions qui vous ont été transmises pourront faire l'objet de réponses écrites, plus techniques et plus opportunes pour nous.
A la suite de votre intervention liminaire, M. le secrétaire général, je souhaite aborder les problèmes stratégiques et les problèmes de fond.
La principale question eu égard à l'inquiétude de l'opinion publique et à ce que nous avons vécu est, me semble-t-il, la suivante : peut-on attendre de l'OMI de nouvelles mesures fortes permettant d'éviter des accidents similaires à celui de l'Erika, alors que les « filets de sécurité », selon vos propres termes, n'ont pas fonctionné ? N'est-il pas préférable que nous prenions l'initiative au niveau européen de dispositions strictement régionales ? A cet égard, le modèle est celui des Etats-Unis qui, par l'Oil Pollution Act, ont pris des mesures dont tout le monde s'accorde aujourd'hui en France à reconnaître la pertinence.
Quelles sont les attentes de la France ? Etant donné le temps que prendra l'OMI pour adopter des mesures, d'autres catastrophes peuvent se produire. Par conséquent, agissons au niveau européen ! Si l'Europe prenait des dispositions fortes, comment pourraient-elles ne pas s'appliquer puisque le trafic à destination de l'Europe est indispensable pour l'activité du commerce mondial ? Tel est le problème de fond.
J'en viens à notre seconde préoccupation. D'après les travaux que notre commission a menés jusqu'à présent, le dispositif réglementaire, même s'il suppose des améliorations comme nous l'avons constaté ce matin, est globalement intéressant. Mais la difficulté réside dans l'impossibilité de l'appliquer. Par conséquent, l'OMI peut être considérée par nous comme un excellent organisme de législation maritime mais n'ayant aucune capacité de police. Vous me répondrez qu'il appartient, en principe, à l'Etat du pavillon de l'assurer. Etant donné qu'il ne le fait pas ou faiblement et que l'OMI ne veut pas s'y substituer, nous en revenons donc à la première question : ne vaut-il pas mieux que l'Europe, à l'instar des Etats-Unis, prenne des dispositions unilatérales en raison, notamment, de la grande émotion suscitée par le naufrage de l'Erika et de ses conséquences ?
Telles sont les questions de fond.
M. William O'NEIL : Questions ô combien importantes !
Je crois avoir répondu en partie à votre première question à l'occasion d'une remarque liminaire. Nous ne pensions pas, pas plus que la communauté maritime d'ailleurs, qu'il était souhaitable que les Etats-Unis prennent des dispositions unilatérales. Nous y étions assez opposés. En fait, quand la révision de la convention MARPOL concernant les navires à double coque et la disparition de certains types de pétroliers a été examinée à l'OMI, les Etats-Unis avaient déjà pris des dispositions unilatérales. A l'unanimité, les gouvernements ont cependant décidé de ne pas s'aligner sur les dispositions prises par les Etats-Unis au sujet de la disparition progressive des pétroliers existants.
En d'autres termes, la communauté internationale maritime était au courant de la démarche des Etats-Unis et elle avait décidé de ne pas s'y rallier. De plus, la principale différence introduite par les Etats-Unis avait trait à la responsabilité. Leur dispositif en la matière était différent de celui prévu par la convention CLC et par la convention portant création du Fonds. Historiquement parlant, les Etats-Unis n'ont pas accepté les conventions relatives à la limitation de la responsabilité dans le domaine maritime. Ils ont donc mis en place leur propre régime sur la responsabilité tout en posant l'exigence pour les propriétaires de navires de prouver qu'ils disposent d'une certaine couverture d'assurance.
Telles sont les deux différences principales entre la démarche unilatérale entreprise par les Etats-Unis et celle suivie par le reste de la communauté maritime. A ma connaissance, aucun autre élément important n'a été introduit dans l'initiative américaine.
Les activités maritimes internationales sont quelque peu particulières en ce sens que les navires ne sont pas, contrairement à d'autres moyens de transports, fixés à un même endroit. Les navires se déplacent librement de par le monde. Certains, tels les transbordeurs rouliers et les ferries, s'occupent de trafic local. Telle n'est pourtant pas la grande majorité des activités de la marine marchande mondiale. Les activités des pétroliers sont particulièrement significatives : alors qu'un navire citerne reçoit un chargement d'hydrocarbures, en cours de transport, sa destination change, ainsi que le propriétaire de la cargaison. Telle est la façon courante dont ce genre d'affaire se traite. Il est donc très important que le régime imposable aux navires soit uniformisé de par le monde. A défaut, la situation deviendrait tout à fait chaotique : certaines régions pourraient estimer que telles réglementations ou telles dispositions valent pour elles, alors que d'autres pourraient avoir une vision totalement différente. Il serait extrêmement préjudiciable à l'industrie maritime de s'orienter vers l'adoption de réglementations régionales qui constitueraient un obstacle considérable à son bon fonctionnement dans le cadre d'une logique économique.
Nous comprenons bien la position de la Commission européenne qui peut imposer ses contrôles sur les navires qui dépendent d'elle, sous réserve que le Conseil des ministres prenne une telle décision. Nous comprenons également qu'elle soit davantage en mesure de réagir rapidement. C'est un fait.
Les processus de l'OMI sont sans doute plus lents, ce qui n'est pas nécessairement négatif. Si la communauté européenne estime qu'une décision s'impose alors que certaines parties du monde dans lesquelles les progrès technologiques ne sont pas aussi avancés ont une vision différente, si une donnée commerciale s'immisce dans ce raisonnement, les répercussions pourraient être catastrophiques pour l'ensemble des transports maritimes de marchandises.
Par exemple, si l'Afrique estimait que son idée était meilleure que celle des autres continents ou si les Sud-Américains ou les Asiatiques considéraient que leur réponse à un problème donné était la meilleure et décidaient d'introduire des normes, des réglementations ou des restrictions en matière de trafic maritime, la situation deviendrait absolument chaotique.
L'OMI a été créée pour éviter ce genre de situations indésirables. L'objectif était de parvenir à une uniformisation et à une normalisation des règles acceptées par la communauté internationale. L'Europe septentrionale et l'Amérique du nord sont à l'origine de l'initiative qui a conduit à la création de l'OMI. Elles étaient convaincues de la pertinence de cette solution, seule susceptible de résoudre les problèmes de cette industrie des transports maritimes.
Les circonstances n'ont pas vraiment changé, même si des pressions peuvent peser à un moment ou à un autre. S'agissant du long terme et plus particulièrement de la question de la responsabilité, nous avons déjà pris une mesure au sein de l'OMI pour nous attaquer au problème. Dès que nous serons saisis par la France et les autres pays concernés d'une proposition visant à renforcer la sécurité maritime du transport pétrolier, nous la traiterons. Vous ne devez pas pour autant considérer que l'OMI est imparfaite. Envisager des décisions unilatérales serait aller à l'encontre des intérêts de l'industrie des transports maritimes.
En outre, la question de la mise en _uvre des normes est problématique et nous l'étudions depuis longtemps au sein de l'organisation. Nous sommes conscients des difficultés qui ont trait au respect des dispositions d'ordre réglementaire dans la pratique, c'est-à-dire à bord des navires.
Le système est clair : toutes les décisions réglementaires sont prises par les membres de l'OMI, que ce soit dans le cadre de la convention SOLAS, de la convention MARPOL, de la convention sur les lignes de charge ou de celle relative à la responsabilité. La plupart des décisions sont prises par consensus de la communauté internationale des transports maritimes. Il est très rare que nous ayons recours au vote.
S'agissant d'une organisation intergouvernementale, ce sont donc les gouvernements qui prennent les décisions leur paraissant pertinentes. Il leur appartient ensuite de veiller à l'application effective de ces décisions dans la pratique, c'est-à-dire à bord des navires. Cette obligation leur incombe. Certes, certains la remplissent mieux que d'autres et nous en sommes conscients !
Les Etats du pavillon, quant à eux, ont davantage tendance à se référer à la notion de « registre ouvert », car ce sont eux qui ont le plus grand nombre de navires immatriculés. Il est donc très important pour ces pays de bien comprendre qu'ils ont des devoirs et des obligations. Par ailleurs, par la mise en place de dispositions administratives, d'administrations maritimes et de lois maritimes, ainsi que par la compétence de ceux chargés d'assumer des responsabilités, les Etats peuvent veiller à ce que les navires battant leur pavillon respectent les normes fixées par les conventions. Tel est le cadre.
L'OMI énonce les réglementations. Les Etats du pavillon ont des obligations à assumer. C'est parce que certains n'y satisfont pas comme le souhaiterait le reste du monde que l'idée de contrôle par l'Etat du port a été introduite. Nous savons tous que le nombre de navires figurant sur les registres a diminué. Là encore, sont concernés les Etats-Unis et le Canada, ainsi que l'Europe. Mais les pays en question n'étaient pas convaincus du fait que les navires satisfaisaient à certaines exigences fixées par les conventions, d'où l'instauration du contrôle par l'Etat du port.
Destiné à contraindre les Etats du pavillon à remplir leur devoir, celui-ci est appliqué d'abord par le biais du Mémorandum d'entente de Paris. Toutefois, le contrôle de l'Etat du port qui a vu ses responsabilités élargies, si je puis dire, couvre maintenant la plupart des régions du monde : l'Asie, l'Amérique Latine, l'Afrique, la Méditerranée et la Mer noire. Par conséquent, la plupart des Etats du port effectuent ce contrôle sur une base régionale. L'idée consiste à uniformiser le système d'inspection.
L'autre donnée tout à fait importante concerne l'échange d'informations pour que la qualité des navires soit notifiée au prochain port d'escale mais aussi que cette notification soit transmise également à l'ensemble des opérateurs et des autorités compétentes. Les informations qui circulent permettent ainsi d'identifier les navires et ce qui se passe du point de vue d'un pavillon ou d'un pays, par exemple.
Les trois échelons de ce système concernent les mesures d'ordre réglementaire, l'Etat du pavillon et le contrôle de l'Etat du port.
S'agissant du contrôle de l'Etat du pavillon, une certaine délégation de responsabilités a été introduite. Lorsque l'Etat du pavillon estime qu'il n'est pas en mesure d'assumer toutes ses responsabilités, il fait appel aux sociétés de classification. Ce sujet mériterait quelques commentaires compte tenu des différences observées entre les sociétés de classification quant à leurs compétences et à leur fonctionnement. Il serait cependant opportun de traiter cette question à part, car je souhaiterais formuler plusieurs observations qui pourraient avoir des incidences sur notre débat à caractère général que nous tenons actuellement.
Concernant la mise en _uvre effective des réglementations de l'OMI, nous n'étions globalement pas satisfaits. Le sous-comité d'application des instruments par l'Etat du pavillon a précisément été créé pour examiner ce problème et les mesures à envisager pour le surmonter. En particulier, nous avons étudié les raisons pour lesquelles l'Etat du pavillon pouvait avoir des difficultés constatées par les contrôles de l'Etat du port. L'Etat du pavillon n'est-il pas compétent et a-t-il besoin d'une aide pour assumer ses responsabilités ? Ou bien s'en moque-t-il et essaie-t-il tout simplement de collecter des revenus avec l'enregistrement des navires ? Le sous-comité d'application des instruments par l'Etat du pavillon examine donc ces questions. Ainsi avons-nous développé des directives pour aider les Etats du pavillon à s'acquitter de leurs responsabilités.
Nous ne voulons pas qu'un Etat du pavillon puisse se contenter d'un certain type d'enregistrement des navires qui ne satisferait pas à certaines conditions de sécurité. S'ils veulent « vendre leur pavillon », si vous me permettez l'expression, sur la base des conditions d'emploi et de rémunération de l'équipage ou d'avantages fiscaux, cela est leur affaire ! Il s'agit, en fait, d'une activité commerciale. En revanche, il n'est pas question que les considérations liées à la sécurité entrent dans l'opération commerciale que suppose la vente d'un pavillon.
C'est pourquoi nous continuons de déployer des efforts pour que les Etats du pavillon soient en mesure de s'acquitter de leurs obligations. Nous avons mis en place un formulaire d'auto-évaluation à l'usage de tout Etat du pavillon. Il s'agit en quelque sorte d'une check list des normes de sécurité auxquelles ces Etats du pavillon doivent satisfaire. Ce formulaire leur permet de se rendre compte s'ils remplissent ces conditions de sécurité élémentaires. Dans la négative, ils sont encouragés à nous contacter pour que nous les aidions. Nous leur envoyons régulièrement des experts du secrétariat ou des consultants, pour les aider soit à mettre en place la législation requise, soit à donner à leur administration l'orientation technique requise, soit à former du personnel si nécessaire. Voilà les actions menées par l'OMI dans ce domaine !
Nous souhaiterions que le sous-comité sur la mise en _uvre de l'Etat du pavillon joue un rôle plus positif. Ce sera le cas au fil du temps. Nous n'y parviendrons pas du jour au lendemain, d'autant plus que la question de la souveraineté intervient toujours. Si nous nous mêlons de leurs affaires, les Etats nous répondent que nous portons atteinte à leur souveraineté, ce à quoi ils s'opposent. En fait, nous avons réussi à dépasser cet obstacle de la souveraineté avec la convention STCW. Pour la première fois, nous avons introduit dans une convention une disposition selon laquelle l'Etat du pavillon est tenu de me fournir à moi, secrétaire général de l'OMI, des informations relatives à sa formation des équipages, qu'il s'agisse des compétences et des qualités des instituts de formation ou des personnels chargés de dispenser cette formation.
Après examen des informations qui nous sont adressées, il nous appartient de dire si les certificats de compétence délivrés par les Etats parties à la convention sont acceptables ou non au niveau international. C'est la première fois que ces droits qui relèvent de la souveraineté nationale sont en fait délégués. On peut supposer que cette disposition sera accentuée à l'avenir dans le cadre de certaines conventions spécifiques. Il ne serait certes pas pertinent qu'elle soit applicable sur tous les sujets et dans le cadre de toutes les conventions. Elle ne doit être appliquée qu'au cas par cas.
Au regard de la question de la souveraineté nationale, le précédent de la convention STCW a créé une réelle percée, voire d'une novation qui nous permet de surmonter le problème de la mise en _uvre de certaines mesures. Bien entendu, il n'est pas question pour nous de devenir les policiers du monde dans le domaine de l'industrie des transports maritimes. Nous ne disposons d'ailleurs pas des ressources nécessaires pour le devenir. Mais il s'agit de parvenir à un changement d'attitude par rapport au passé. Le domaine maritime est sans doute l'un des derniers bastions de la liberté. Certes, il est difficile de s'attaquer à certains de ces bastions, mais nous y sommes parvenus, me semble-t-il, dans le domaine précis que je viens d'évoquer.
Ce changement est considérable et la responsabilité est lourde pour notre organisation. Dès lors que nous acceptons qu'un pays ait un système de formation et de délivrance de brevets reconnu par tous les autres, il faut veiller à une application précise et réglementaire. Telle est la situation pour ce qui concerne le volet afférent à la mise en _uvre de la réglementation internationale élaborée et adoptée par l'OMI.
J'ajoute que nous avons déjà élaboré un code international de gestion de sécurité des navires, ayant déjà réglé la question des gens de mer avec la convention STCW. Nous avons élaboré le code ISM qui oblige dorénavant les compagnies de transport maritime à procéder à une analyse pour savoir si elles répondent bien aux exigences en matière de sécurité. Chacun de leurs navires est certifié séparément ce qui représente également un changement important.
Le code ISM stipule qu'un armement maritime identifie un responsable de haut niveau devant assumer un certain nombre d'obligations. L'Etat du pavillon doit y veiller. Cette responsabilité lui incombe. Une des raisons pour lesquelles le code ISM a été institué est qu'il était parfois difficile de s'adresser à la personne responsable. Dans le cas de l'Erika précisément, il a été assez difficile de déterminer qui était le propriétaire. Si tout avait bien fonctionné, le code ISM nous aurait permis de surmonter cette difficulté. Certes, il peut être utile d'envisager des sanctions, mais il y a une certaine réticence à en introduire dans les conventions. La communauté internationale hésite à envisager des sanctions à l'encontre d'un pays. Cette pratique n'est pas couramment acceptée, mais elle s'exerce dans certains cas.
Tel est le cadre dans lequel nous opérons.
M. Jean-Pierre DUFAU : Si j'ai bien suivi votre raisonnement, le code ISM n'aurait pas été strictement appliqué dans le cas de l'Erika ?
M. William O'NEIL : Je n'ai pas une idée complète de la situation en ce qui concerne l'Erika. Nous ne disposons pas de tous les résultats de l'enquête. Néanmoins, d'un point de vue pratique, des problèmes se sont posés.
En sa qualité d'Etat du pavillon, Malte a accordé le certificat ISM du bateau et a émis le document de conformité. L'Etat du pavillon était donc censé pouvoir identifier le propriétaire. Si tel n'a pas été le cas, c'est parce que le système n'a pas fonctionné comme il aurait dû. Mais l'obligation d'identification était prévue.
M. le Rapporteur : Dans le prolongement de votre exposé initial, j'ai bien noté que l'OMI recommande aux différents Etats l'instauration d'un système d'auto-évaluation de la mise en _uvre de l'ensemble des dispositions et des différentes conventions de l'OMI.
Je vous interroge donc sur deux points : d'une part, ce dispositif a-t-il vocation à devenir obligatoire ? D'autre part, s'agissant d'auto-évaluation, qui peut contrôler la fiabilité de l'évaluation ? Si l'intention est bonne, les résultats suivront-ils ?
S'agissant du cas précis de l'Erika et dans le prolongement des propos tenus à l'instant par mon collègue, est-il prévu que l'OMI diligente une enquête ou s'appuie sur celle du gouvernement français ? Si d'aventure cette dernière était en contradiction avec d'autres éléments - je pense en particulier à l'appréciation différente du RINA et du bureau du ministère des transports -, qui arbitrera et qui proposera ? Par ailleurs, comment envisagez-vous l'évolution de ce dispositif d'enquête que vous allez mener ? Quelle sera son articulation avec les enquêtes de l'IACS ?
M. William O'NEIL : Examinons d'abord les aspects réglementaires de cette auto-évaluation du point de vue de la sécurité et de la protection de l'environnement.
Cette orientation a été requise par le sous-comité d'application des instruments par l'Etat du pavillon, qui a introduit ce formulaire. Certains pays estimaient que ce dispositif devait être rendu obligatoire et d'autres considéraient que les résultats devaient être communiqués à tout le monde. Cependant, selon une grande majorité d'entre eux, ce formulaire ne devait pas présenter un caractère obligatoire. Cette proposition visant à rendre obligatoire ce dispositif d'auto-évaluation n'a finalement pas été acceptée même dans le cadre d'une coopération technique.
M. le Rapporteur : Le caractère obligatoire a été proposé par l'OMI ?
M. William O'NEIL : Lorsque la question a fait l'objet d'un examen, cette proposition a été faite par certains membres de l'OMI. Mais le consensus qui s'est dégagé en conclusion des débats s'est traduit par une opposition à l'encontre de ce caractère obligatoire. Il a même été envisagé de renoncer complètement à ce formulaire d'auto-évaluation. Il a finalement été accepté, à condition qu'il soit volontaire.
Quant à la question de savoir si nous menons des enquêtes, nous n'y sommes pas autorisés. Cette obligation incombe à l'Etat du pavillon qui, en cas d'un incident de pollution ou d'une collision entre deux navires, collabore avec les autorités côtières concernées par le sinistre. L'année dernière, s'est produit un incident dans la Manche, un paquebot battant pavillon des Bahamas est entré en collision avec un navire porte-conteneurs panaméen. L'incident étant survenu le long des côtes britanniques, les autorités panaméennes ont fait appel aux garde-côtes du Royaume-Uni pour les assister sur l'enquête.
En ce qui concerne l'Erika, je ne sais pas quels sont les rapports entre la France et Malte, ni ce qui a été décidé. Toutefois, sur la base des éléments qui découleront des résultats de l'enquête, des propositions d'action réglementaire pourront être soumises à l'OMI par n'importe quel pays. La France bien entendu, mais aussi n'importe quel pays membre peut saisir l'OMI d'une proposition. Tel est le système.
A la suite de ces précisions, je souhaiterais, M. le président, que nous examinions encore certains points précis. Je dis « nous », mais en fait je devrais faire la part entre les suggestions qui nous ont été faites et les idées qui nous sont propres.
Sur la base d'informations préliminaires, nous avons tous pris connaissance du rapport du RINA et nous avons tous lu dans la presse les critiques qui ont été formulées. Il me semble cependant important que toute proposition de modification soit ciblée sur la convention SOLAS, la convention MARPOL, la convention CLC et la convention portant création du Fonds.
A propos de la convention CLC, je vous ai indiqué que des mesures allaient être prises pour relever les limites prévues.
En ce qui concerne la convention MARPOL, je souhaite insister sur deux points.
Comme vous l'avez souligné, le champ d'investigation de votre commission ne se limite pas au cas de l'Erika. Mais, en l'espèce, le produit transporté par le navire est sans doute l'un des pires puisqu'il s'agit de résidus issus de la transformation d'hydrocarbures. Ce produit lourd et extrêmement sale est généralement transporté par des navires spéciaux, de plus en plus vieux et de plus en plus rares. Les navires plus récents, de meilleure qualité, qui transportent habituellement des produits propres, refusent de transporter des hydrocarbures persistants.
Au sein du Comité sur la protection de l'environnement - MEPC -, il avait été envisagé que la convention MARPOL soit modifiée pour ce qui concerne le transport de ce genre de matériaux par voie maritime. Cette proposition n'a pas été acceptée. Pour ma part, je considère qu'il faudrait à présent donner suite à une recommandation allant dans ce sens.
M. le Président : Qui ne l'a pas acceptée ?
M. William O'NEIL : Les membres du Comité sur la protection de l'environnement, et ce à l'unanimité.
Il serait néanmoins pertinent de passer en revue toutes les dispositions relatives au transport de ce type de produit qui est, je le répète, très spécial. Il y aurait lieu, me semble-t-il, d'imposer certaines exigences aux navires qui assurent le transport d'hydrocarbures persistants, lesquelles ne vaudraient cependant pas pour les navires qui transportent, par exemple, du pétrole brut ou du diesel. Nous devons faire preuve d'une grande prudence et éviter de contraindre l'ensemble de l'industrie des pétroliers à assumer un régime réglementaire très strict à cause de ce segment particulier de l'industrie.
Sans doute serait-il opportun d'imposer des limites quant à la taille des navires. Sans entrer dans le détail des mesures susceptibles d'être envisagées, ces questions méritent sans aucun doute un examen approfondi.
M. Jean-Pierre DUFAU : Quelle est la destination de ces résidus issus de la transformation d'hydrocarbures ? A quoi servent-ils ? Pourrait-on, par exemple, en limiter le transport ?
M. William O'NEIL : Si ces substances doivent être transportées, nous voulons qu'un régime réglementaire adapté soit mis en place précisément pour garantir leur transport dans de bonnes conditions. Ils sont utilisés pour les soutes et certaines installations situées en bord de mer. Pour être pompé, ce produit très lourd nécessite un système à la chaleur. En fait, il s'agit d'un produit résiduel issu de la transformation des hydrocarbures. En d'autres termes, il s'agit des déchets de la chaîne pétrolière.
Certaines des propositions que je viens d'évoquer ont été soumises au MEPC avant le sinistre de l'Erika, mais elles n'ont pas été acceptées. Je souhaite donc que le MEPC en soit de nouveau saisi pour couvrir les exigences particulières de ce type de substance.
M. Jean-Pierre DUFAU : J'ai bien compris votre remarque sur les difficultés tout à fait particulières du transport de ce type de cargaison. Mais sachant que les risques sont tels et que ce fioul n°2 n'a pas d'utilité, pourquoi ne pas envisager d'en limiter le transport et de considérer le problème en amont, c'est-à-dire de l'éliminer sur les lieux mêmes où il est stocké ?
M. William O'NEIL : Cette question relève non pas de la compétence de l'OMI malheureusement, mais de celle d'une autre instance.
Je souhaite attirer votre attention sur un problème connexe, celui des hydrocarbures de soute utilisés comme combustible pour le navire. Certains navires de gros tonnage, porte-conteneurs ou navires à passagers, transportent du combustible dans des soutes de 10 000 tonnes d'hydrocarbures, situées dans des parties non protégées du navire, c'est-à-dire à proximité des parois externes. Nous devrions examiner cette question concernant le transport de ces hydrocarbures de soute en grande quantité par les navires d'aujourd'hui.
Par ailleurs, il est nécessaire d'améliorer le contrôle du trafic maritime. J'ai avancé la notion de contrôle positif du trafic un peu similaire - sans l'être tout à fait - à celui en vigueur dans l'industrie de l'aviation civile. A Singapour, on m'a parlé de contrôle du trafic actif, ce qui signifie que la personne chargée du contrôle à terre a un rôle à jouer à l'égard du navire. En particulier, il lui indique la façon de procéder dans certains cas, ce qui fait appel à plusieurs éléments tels les systèmes de séparation du trafic et de notification préalable, les conditions météorologiques, la densité de trafic. Par exemple, dans la Manche ou dans le Détroit de Malacca en Asie, je suis convaincu que ces mesures de contrôle du trafic doivent être prises. A défaut, nous risquerions de connaître d'autres incidents tragiques.
M. le Président : Compte tenu des risques existants, du nombre de navires qui sillonnent l'espace maritime du nord au sud, nous devrions rendre le pilotage hauturier obligatoire dans la Manche et la Mer du nord et également entre la Grande-Bretagne et le continent...
M. William O'NEIL : La question du pilotage que vient compléter celle du contrôle positif - et vice et versa - est un autre problème.
Le pilotage obligatoire ne me paraît pas nécessaire pour tous les navires dont certains sont dotés d'officiers tout à fait responsables et compétents à bord. Les pilotes qui connaissent les circonstances et les conditions locales aident le commandant de bord à s'acquitter de sa tâche. Le pilotage doit se limiter à ces missions. Bien entendu, les pilotes ne sont pas chargés de la responsabilité du navire, laquelle incombe au commandant.
Dans certaines eaux territoriales, il est indéniable que le pilotage est indispensable. Un navire qui fréquente pour la première fois certaines eaux ne pourrait pas s'en sortir sans pilote. D'ailleurs, l'équipage ne le souhaiterait pas. En revanche, dans d'autres secteurs, les gens de mer à bord du navire connaissent tellement bien les conditions locales que le recours au pilotage n'apporterait rien.
Par conséquent, la question du pilotage obligatoire doit être abordée dans un contexte plus large. Elle ne représente pas une solution totale au problème, même si elle est d'une importance majeure au titre de la sécurité. Le contrôle actif du trafic est une piste à développer.
Je me permets d'aborder un autre problème qui concerne plus particulièrement la chaîne d'inspection défaillante et la responsabilité des sociétés de classification. Nous devrions veiller à ce que ces dernières soient plus réglementées et vraiment compétentes. Tandis que certaines sont excellentes, d'autres sont très médiocres. Certaines sont membres de l'IACS mais pas toutes. De plus, parmi celles qui sont membres de l'IACS, certaines sont tangentes.
Comment veiller à ce que les sociétés de classification assument leurs responsabilités ? Comment veiller à ce qu'elles accomplissent leur tâche comme elles le devraient ?
Depuis les années 80, les sociétés de classification se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas très bonne réputation. Elles ont procédé à un certain nombre d'évaluations de qualité à titre individuel. Elles ont également demandé aux compagnies d'assurances de les aider, sans obtenir leur concours toutefois. Elles se sont alors adressées à l'OMI qui a accepté. Un responsable de l'OMI a donc participé à cet exercice en qualité d'observateur et il a aidé pour toutes ces questions d'évaluation de la qualité. Nous pensions que nous ne pouvions pas, d'une part, condamner ces sociétés de classification et, d'autre part, refuser de les aider à améliorer la qualité de leurs prestations.
Le moment est venu de réexaminer la question du fonctionnement de ces sociétés de classification et celle de l'autoréglementation qu'elles se sont imposées, afin d'envisager des dispositions complémentaires.
En ce qui concerne le contrôle de l'Etat du port, nous devons veiller à ce que ceux qui l'exercent soient bien formés. Par ailleurs, il nous faut être conscients des limites de cet exercice. Les responsables du contrôle de l'Etat du port n'ont pas le temps d'examiner toutes les parties d'un navire-citerne ou d'un grand vraquier pour des raisons diverses. Par exemple, des cargaisons gazeuses ne permettent pas l'accès à toutes les parties du navire.
Il ne faut pas croire cependant que tous les problèmes sont réglés par la mise en place d'un système de contrôle par l'Etat du port. Il faut définir les responsabilités au titre de la classe et celles exercées au niveau du contrôle par l'Etat du port, puis vérifier qu'elles sont bien assumées, de même que celles de l'Etat du pavillon. Si ce n'est pas le cas, il faut envisager de réagir. Les propriétaires de navires font partie de la chaîne de responsabilités. Certains, excellents, satisfont à leurs obligations. Mais pas tous, - loin s'en faut ! - De ceux-là, il convient de se débarrasser ! Un des objectifs de notre organisation est de s'assurer que les navires qui ne répondent pas aux normes requises soient interdits de commercer.
Telles sont les réflexions que je tenais à livrer à votre commission, en espérant avoir évoqué tous les domaines que vous souhaitiez aborder. Si vous estimez que certaines questions n'ont pas été suffisamment développées ou si vous désirez des informations complémentaires, nous restons, mes collaborateurs et moi-même, à votre disposition.
Audition de MM. David ROWE,
chef de la division pour la sécurité maritime,
John WREN, responsable des questions de pollution,
de responsabilité et d'indemnisation, à la division politique,
Robin MIDDLETON, secretary of state representative,
David WITHE,
chargé des normes techniques de construction des navires,
David HOWARD, expert en pétroliers,
et Douglas PATTERSON,
responsable de la politique en matière d'équipement des navires,
au ministère de l'environnement, des transports et des régions,
John MAIRS,
chargé de la politique en matière de sauvetage et des garde-côtes
à la Maritime and Coast Guards Agency
(extrait du procès-verbal de la séance du 12 avril 2000 à Londres)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président.
M. David ROWE : M. le président, nous sommes très heureux que le gouvernement britannique puisse vous aider dans vos travaux.
Je souhaite vous présenter mes collègues qui appartiennent tous au ministère de l'environnement, des transports et des régions, très grand ministère qui dépend de M. Prescott, vice-Premier ministre : M. David Withe s'occupe des normes techniques de construction des navires ; M. David Howard est notre expert en pétroliers ; M. John Mairs est chargé de la politique en matière de sauvetage et donc, à ce titre, des garde-côtes ; M. John Wren, de la division politique, s'occupe des questions de pollution, de responsabilité et d'indemnisation, y compris celles ayant trait au FIPOL ; moi-même, David Rowe, je suis chef de division pour la sécurité maritime au ministère de l'environnement, des transports et des régions ; M. Douglas Patterson est responsable de la politique en matière d'équipement des navires et M. Robin Middleton est le représentant du secrétaire d'Etat, récemment nommé à ce poste tout juste créé, mais très expérimenté au sujet des questions de sécurité du transport maritime dont il s'est d'ailleurs entretenu lundi et mardi dernier avec votre préfet maritime pour la Manche.
Vous nous avez fait parvenir un questionnaire qui couvre les principaux domaines du champ d'investigation de votre commission. Si vous le souhaitez, nous pouvons examiner les questions dans l'ordre dans lequel vous nous les avez soumises et je vous propose de répondre brièvement à chacune d'entre elles.
De toute manière, des documents complétant les informations que nous vous donneront oralement dans le cadre de cet entretien seront remis à votre secrétariat.
Je précise également que nous sommes prêts, bien entendu, à répondre aux questions que vous souhaiterez nous poser aujourd'hui ou ultérieurement par écrit par l'intermédiaire de votre secrétariat qui dispose de nos coordonnées.
Votre première question a trait à des éléments statistiques. A ce sujet, nous vous remettrons le rapport annuel et le plan d'action de l'Agence maritime des garde-côtes. Celle-ci fait partie de notre ministère et relève donc du gouvernement central. Néanmoins, elle a des responsabilités particulières qui sont décrites dans ce rapport où il est également dressé un bilan des actions réalisées tout en ouvrant des perspectives d'avenir.
Environ 1 500 bateaux de transport de marchandises battent pavillon britannique. Leur capacité représente 4,5 millions de tonneaux de jauge brute dans toutes les catégories. Nous ne pensons pas qu'il y ait véritablement surcapacité. L'industrie des transports maritimes vient de traverser une période de « vaches maigres », si je puis dire, et toutes les compagnies qui ont survécu ont une charge de travail importante. Nous n'avons donc pas de problèmes de surcapacité. Quant à l'âge moyen de nos navires, nous ne le connaissons pas, mais une enquête à cet égard nous permettra de vous communiquer ultérieurement les renseignements souhaités.
Il n'existe pas encore de dispositifs en faveur du pavillon britannique. Le Parlement légifère actuellement en faveur d'une fiscalité intéressant tous les secteurs commerciaux et prévoyant un régime fiscal particulier en fonction du tonnage détenu par une compagnie. Le détail figure dans le document qui vous sera remis, mais retenez qu'il s'agit de l'adaptation de régimes existant dans d'autres pays, tels les Pays-Bas et l'Allemagne.
Je souhaite attirer votre attention sur deux traits caractéristiques de ces régimes. Vous pouvez choisir d'y souscrire ou non, mais si vous y souscrivez, vous devez les appliquer pendant dix ans. Ces dispositions sont censées donner une certaine assurance au titre des responsabilités fiscales. Si vous adoptez ces régimes, vous bénéficiez d'une situation fiscale privilégiée. Mais en échange, vous êtes censés financer la formation de l'équipage, en l'occurrence celle des officiers dans le domaine de l'ingénierie. Vous devez également offrir des postes de formation en proportion du nombre de marins et si ce n'est pas le cas, vous versez à un fonds une certaine contribution pour que d'autres compagnies puissent en bénéficier. Il ne s'agit pas de charité. Notre préoccupation recouvre les ressources humaines, l'intérêt de l'industrie, les questions afférentes à l'assurance et les dispositions d'ordre réglementaire dont nous dépendons pour assurer la qualité des services en mer.
Le Royaume-Uni ne dispose pas de « pavillons bis ». Nous autorisons certaines de nos colonies ou ex-colonies, telles l'île de Man, à avoir des registres propres sur lesquels nous n'exerçons cependant aucun contrôle. Notre démarche est donc tout à fait libérale à l'égard de l'implantation des compagnies. Les capitaux peuvent se déplacer librement. Si ces compagnies souhaitent choisir des pavillons étrangers, rien ne les en empêche. Toutefois, une instance réglementaire supervise ces registres sur le plan de la sécurité, c'est-à-dire que nous veillons à qu'ils respectent les conventions internationales. C'est là notre responsabilité à moi et à mes collègues. En revanche, d'un point de vue commercial, la situation est celle d'une concurrence pleinement ouverte.
En ce qui concerne les statistiques dont nous disposons sur les accidents, nous vous communiquerons quelques informations complémentaires. Néanmoins, nous pouvons d'ores et déjà faire état d'expériences récentes dans ce domaine. Je laisse M. John Mairs développer plus précisément ce point.
M. John MAIRS : Les informations les plus pertinentes que je suis en mesure de vous soumettre, je les tiens du comité consultatif sur la protection de la mer.
Sur une base annuelle, ce comité recueille des statistiques concernant des accidents qui se sont produits aux abords du Royaume-Uni et qui ont entraîné une pollution par les hydrocarbures. Je vous ai préparé un rapport qui recueille les données des trois dernières années, c'est-à-dire de 1996, date à laquelle est survenue la catastrophe du Sea Empress, 1997 et 1998. Ce document couvre les principaux problèmes de nappes d'hydrocarbures que nous avons connus. Le rapport concernant l'année 1999 ne sera disponible qu'en août prochain. Sa parution interviendra donc trop tardivement pour les travaux de votre commission.
Ces trois rapports décrivent les naufrages du Torrey Canyon, du Braer et du Sea Empress comme des catastrophes de grande ampleur. Mais ces sinistres ont tendance à masquer les incidents de pollution de routine qui ne sont pas non plus sans importance. Les hydrocarbures finissent toujours par atteindre et affecter les côtes dans des proportions non négligeables, même si les quantités sont relativement réduites.
Le nombre de statistiques rassemblées dans ces rapports est considérable parce que le seuil minimum est en fait très faible. Nous enregistrons des incidents qui représentent simplement des déversements de cinq litres. Il s'agit donc d'incidents concernant des petits ports ou d'incidents de pollution liés à l'industrie pétrolière offshore.
Tels sont les trois rapports que je vous soumettrai, en espérant qu'ils vous seront utiles.
M. David ROWE : Votre seconde question concerne les dispositifs administratifs et juridiques de prévention des accidents et des pollutions.
Quelle est la base juridique de notre action ?
Nous avons la grande chance d'être investis de pouvoirs très larges par la législation et la réglementation de base. La loi sur le transport maritime adoptée successivement par les deux chambres du Parlement en 1996 et 1997 nous confère des pouvoirs très vastes et nous autorise à établir une réglementation dite secondaire, laquelle est examinée par le Parlement. Ces questions techniques n'étant généralement pas controversées par les partis politiques, nous disposons d'une importante marge de man_uvre.
Ainsi, pour transposer une directive européenne en loi nationale, nous recourons à la législation dite secondaire. De même, pour transposer une convention internationale en loi nationale, nous devons suivre certaines procédures et en référer au ministère des affaires étrangères, mais nous pouvons recourir à ce système de législation dite secondaire.
Bien entendu, nos juges exercent un contrôle vigilant et nous avons coutume de procéder à une large consultation pour ce qui concerne les projets de législation secondaire. Tel projet élaboré par l'un de mes collègues est examiné par le siège. Ensuite, le ministre autorise des consultations à la lumière desquelles est créé un instrument statutaire. Ce dernier est soumis au Parlement et, s'il n'y a pas d'objection, il acquiert force de loi. En théorie, il est possible de demander à aller au-delà des mesures envisagées.
L'administration est de la responsabilité du Vice-premier ministre dont je dépends - M. Prescott -, du ministre des transports - Lord MacDonald Of Tradeston - et du secrétaire d'Etat à la navigation - M. Hill. Le travail est réalisé en collaboration avec la division politique pour élaborer des projets et veiller au bon respect des mesures adoptées en faveur de l'Agence maritime des garde-côtes, dite Maritime and Coastguard Agency ou MCA.
La MCA, unité à symbole propre, publie un rapport distinct. Mes collègues, MM. Patterson et Mairs, appartiennent à cette instance, mais nous travaillons ensemble. Elle est le fruit d'une ancienne organisation d'experts et de garde-côtes. Compte tenu de leur grande compétence professionnelle, les experts élaboraient des propositions et fournissaient des rapports sur la section technique des navires, tandis que les garde-côtes se préoccupaient essentiellement des opérations de sauvetage et des mesures à prendre en cas de pollutions à la suite d'accidents. En fait, nous avons rassemblé ces deux instances pour couvrir la totalité du cycle, de la prévention à la réaction.
D'autres organisations jouent également un rôle important dans ce domaine. Citons à cet égard le ministère de la défense - qui fournit des moyens de secours et de sauvegarde -, nos ressources propres évoquées dans le rapport, et une organisation à but non lucratif, la Royal National Life Boat Institution, qui n'est pas financée par l'Etat. Il s'agit d'une organisation caritative qui assure des services de secours en mer. Par ailleurs, les autorités responsables des phares assurent leur entretien, prélèvent une taxe à l'entrée des ports et fournissent les aides à la navigation.
Pour vous apporter des précisions quant aux normes imposées par le Royaume-Uni pour la construction des navires, je laisse le soin à David Withe d'intervenir.
M. David WITHE : Les normes appliquées aux navires battant le pavillon du Royaume-Uni se fondent sur les conventions internationales qui ont été adoptées par le biais de l'OMI : la convention SOLAS, la convention sur les lignes de charge et d'autres conventions relatives à la construction navale.
En ce qui concerne l'équipement et les équipages, nous respectons également les conventions pertinentes. Historiquement parlant, les normes des navires britanniques sont plutôt plus élevées, en tout cas différentes de celles imposées dans d'autres pays. En fait, dans la mesure où nous offrons une meilleure sécurité, c'est quelque peu contre-productif pour nous et cela a pu jouer en notre défaveur. Nous constations en effet que la plupart des navires qui battaient le pavillon du Royaume-Uni nous quittaient pour des registres ouverts ou des pavillons de complaisance, tout en continuant à fréquenter nos ports. C'est la raison pour laquelle nous avons dû adopter un régime de contrôle de l'Etat du port qui consiste à inspecter les navires qui arrivent dans nos ports parce que notre influence, en tant qu'Etat du pavillon, avait diminué.
M. David ROWE : J'ajoute que nous ne permettons pas que nos normes soient en dessous de celles prévues par les conventions internationales applicables. Nous sommes très vigilants et si nous ne voulons pas non plus aller au-delà des normes requises par les conventions, nous veillons à ce qu'elles soient scrupuleusement respectées.
M. le Président : Combien d'inspecteurs mettez-vous en place dans les ports pour effectuer les contrôles dont vous parliez ?
M. Douglas PATTERSON : Nous disposons d'environ 150 inspecteurs, mais tous ne dépendent pas des ports. Ils réalisent aussi un certain travail de contrôle de l'Etat du pavillon. Les derniers chiffres dont j'ai eu connaissance et qui datent de deux ans faisaient état de 60 inspecteurs basés chaque année dans les ports.
M. le Président : Soixante inspecteurs sont basés chaque année dans les ports pour assurer le contrôle de l'Etat du port, dites-vous ?
M. Douglas PATTERSON : Tout à fait.
M. le Président : Par rapport au nombre total de 150 inspecteurs, que font les 90 autres ?
M. Douglas PATTERSON : Il réalisent un travail de contrôle de l'Etat du pavillon.
M. David ROWE : Vous trouverez davantage de détails sur ces activités de contrôle d'Etat du pavillon dans notre rapport. Nous publions des objectifs en ce qui concerne nos activités et les rapports sont établis en fonction de ces objectifs.
Comme Douglas Patterson vient de vous le dire, deux volets caractérisent nos activités : celles exercées au titre de l'Etat du pavillon et celles exercées au titre de l'Etat du port. Mais nous avons, bien entendu, d'autres responsabilités.
Je laisse maintenant le soin à David Withe de répondre à la question relative aux exigences particulières concernant les compétences des chantiers et des personnels effectuant les réparations.
M. David WITHE : Les vérifications sont effectuées non pas auprès des personnes qui réalisent le travail mais au niveau du résultat, par le biais des sociétés de classification sur lesquelles nous exerçons un contrôle. Par conséquent, ce contrôle opéré à un niveau assez élevé se concentre plutôt sur le résultat et le processus.
M. David ROWE : Vos questions suivantes portent sur l'identification des navires ou plutôt sur la surveillance de la navigation. C'est en tout cas ainsi que nous les avons interprétées.
Notre politique est fondée sur l'idée de préservation de la liberté de navigation. Comme toute nation maritime, en l'occurrence la France, le Royaume-Uni a tout intérêt à maintenir un accès libre à la mer. Notre intérêt secondaire - que partage certainement la France - concerne la défense et les affaires étrangères. Nous reconnaissons donc d'emblée à un navire le droit de passage innocent au large de nos côtes sans qu'il y ait interférence quelconque. Toutefois, dans certains secteurs, il existe des systèmes d'acheminement, le plus significatif étant situé dans la Manche entre le cap Gris-Nez et Douvres. Là, des contrôles sont exercés. Ils sont non pas imposées au niveau national mais décidés par l'OMI. L'ensemble des acteurs du transport maritime les acceptent pour des raisons de sécurité. Des dispositions similaires sont, me semble-t-il, applicables au large de la côte de Bretagne. D'ailleurs, la France envisage d'accroître ou d'élargir ces mesures et leur portée aux abords de Cherbourg.
En outre, les autorités portuaires interviennent aussi sous réserve qu'elles soient averties au préalable. Cela relève donc non pas de l'Etat, mais des autorités portuaires qui doivent être averties à l'avance du passage des navires.
En ce qui concerne la surveillance d'un secteur maritime à des fins de sauvetage ou de lutte contre la pollution, les garde-côtes disposent d'un réseau de centres de communications côtiers. Leur nombre, actuellement de 21, sera réduit à 16 grâce aux technologies nouvelles. Ils sont implantés de manière stratégique tout autour de la côte du Royaume-Uni. En fait, ce réseau couvre une surface maritime qui s'étend bien au-delà des eaux territoriales. Aux termes de la convention des secours en mer, nous sommes responsables d'un secteur maritime qui rejoint les eaux territoriales de la France et de l'Irlande. A cette fin, les garde-côtes maintiennent un contrôle radio 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 et les fréquences radio de détresse sont bien connues. Dans la pratique, cette disposition permet de couvrir le secteur maritime dont nous sommes responsables à des fins de sauvetage et en cas de pollution. Si un navire est en détresse, l'Agence des garde-côtes répondra au problème. En fait, il s'agit d'intervenir à différents niveaux selon la nature du problème.
L'infrastructure maritime - balises, phares, systèmes de circulation - relève essentiellement des autorités responsables des phares. Celles-ci sont financées par un fonds public, bien qu'il ne s'agisse pas d'un service strictement public. C'est une particularité britannique et irlandaise que nous envient nos collègues, selon leurs propres dires. Nos canots de sauvetage sont financés par des organisations caritatives et nos phares par l'industrie. Les contribuables participent à ce financement. Bref, cette situation nous est enviée ! En fait, il s'agirait d'une responsabilité statutaire quant à ce qui est nécessaire et quant à l'entretien jugé nécessaire pour cette instance.
M. John MAIRS : Comme M. David Rowe vient de l'indiquer, les autorités des phares en sont les responsables. L'Agence maritime des garde-côtes est également intéressée par cette question et nous avons des entretiens avec tous ceux qui s'y intéressent, tel, par exemple, le comité de la sécurité de la navigation britannique qui a présenté des propositions visant à modifier certains dispositifs.
Il ne s'agit donc pas d'avoir une organisation qui prend des initiatives. Tout est centralisé et fait l'objet d'un accord. Les initiatives qui sont prises sont harmonisées.
M. David ROWE : En fait, bien que nous disposions de plusieurs autorités et d'administrations distinctes avec des responsabilités spécifiques, nous nous situons dans une tradition de coordination entre ces différentes instances. Toutefois, en dernier ressort, les garde-côtes pèsent peut-être plus lourd dans la balance puisque, en cas d'accident, ce sont eux qui devront organiser les sauvetages ou mettre en place des plans de lutte contre la pollution.
M. John MAIRS : J'en viens maintenant à votre question concernant les équipages et les normes qui leur sont applicables.
Comme l'a indiqué David Rowe, nous appliquons les conventions de base : la convention SOLAS, la convention MARPOL et celles du BIT. Des dispositions nous permettent de reconnaître les autres nations et leurs ressortissants, ce qui rejoint la convention STCW sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. Par conséquent, au Royaume-Uni, tout le monde est traité sur un pied d'égalité.
M. David ROWE : Dans le prolongement de votre question relative aux structures actuelles de l'administration britannique en charge de la sécurité maritime, je tiens à préciser que nous avons une tradition d'inspiration libérale en ce qui concerne notre politique commerciale.
Par conséquent, la réponse à votre question est claire et simple : si une compagnie britannique souhaite utiliser des navires battant un pavillon étranger, elle peut le faire et elle peut également recruter un équipage étranger.
Il existe tout de même certaines restrictions en ce qui concerne la nationalité du commandant de bord de certains navires britanniques. Ce dernier doit appartenir à certaines catégories nationales, en l'occurrence s'il s'agit d'un navire de défense ou d'un navire revêtant une utilisation stratégique quelconque. Ces restrictions ne sont cependant pas très sévères. Si vous voulez commander un navire britannique, il faut que vous soyez un ressortissant britannique ou bien le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, d'un Etat de l'OTAN ou du Commonwealth, voire le ressortissant d'un ou deux Etats qui n'appartiennent pas à ces organisations internationales. Au total, vous pouvez être ressortissant d'environ 53 pays différents. Cette restriction n'est donc pas très contraignante, mais notre tradition, bien ancienne, est celle du libre marché, en tout cas dans le domaine maritime.
Certes, nous avons observé un phénomène de reflux vers les pavillons britanniques, avant même que les mesures fiscales ne soient introduites. Il y avait plusieurs raisons à cela. Aussi, nous avons revu notre procédure d'acceptation en l'élargissant. Nous en faisons d'ailleurs état dans notre rapport. Ensuite, pour des questions d'accès à la ville de Londres, les compagnies étrangères étaient traditionnellement autorisées à enregistrer leurs navires et à les immatriculer sous pavillon britannique. Toutes ces explications figurent également dans le rapport.
M. John MAIRS : Comme vient de le souligner David Rowe, notre approche est très libérale, mais des contrôles sont tout de même en place. Par exemple, nous ne souhaitons pas laisser circuler certains certificats de complaisance et nous veillons à préserver certaines normes et conditions de travail minimales.
M. David ROWE : La situation n'est pas celle de la ruée vers l'or ! Nous exerçons certains contrôles lorsqu'ils nous semblent nécessaires, mais notre politique générale privilégie le libre marché.
M. le Rapporteur : En complément, permettez-moi de poser une question annexe : combien de bateaux sont immatriculés à l'île de Man ?
M. David ROWE : Au total, 200 ! Nous avons une certaine responsabilité en ce qui concerne le maintien de la sécurité de ces navires, mais nous n'exerçons aucun contrôle sur leur administration commerciale.
M. John MAIRS : En ce qui concerne le pavillon britannique, il existe un certain nombre de normes. Tous les deux ou trois ans, nous exerçons un contrôle sur les navires immatriculés sur ce registre.
M. David ROWE : J'ajoute que les experts, à l'instar des juristes, souhaitent que les normes standard soient constamment examinées. Si plusieurs experts se rencontrent, vous aurez, comme pour les juristes, autant d'opinions différentes que d'experts ! Par conséquent, un dialogue permanent s'instaure.
M. John MAIRS : En ce qui concerne les cargaisons dangereuses, nous appliquons les conventions pertinentes selon les substances concernées.
M. le Président : C'est-à-dire les conventions de l'OMI ?
M. David ROWE : Absolument.
Certes, dans certains domaines, l'Union européenne a adopté sa propre législation, mais soyons clairs : dans presque tous les domaines, l'Union européenne a adopté les normes de l'OMI comme base de sa législation propre. Ensuite, elle a élaboré une interprétation de ces normes qui vaut donc pour l'ensemble de la Communauté européenne.
Il s'agit là d'une novation. Comme vous le savez sans doute, la tradition au sein de l'OMI veut que chaque nation interprète la convention en fonction de son droit. En fait, nombre d'entre nous ont pensé que le processus de l'Union européenne est très utile parce qu'il renforce l'interprétation commune. Dans certains pays membres de l'Union, nous avons le sentiment que les décisions sont imposées par Bruxelles. Mais dans le domaine de la réglementation maritime, nous avons constaté que sur le plan technique, Bruxelles consulte largement les Etats membres pour parvenir à une interprétation commune des conventions de l'OMI avant d'édicter sa propre réglementation. À notre avis, ce processus est satisfaisant dans la mesure où il nous donne une base solide, même si l'interprétation technique donne lieu à des conflits possibles et à des débats animés.
Cependant, je ne voudrais pas vous donner le sentiment qu'il soit possible d'opérer des choix et que des conflits importants se produisent. Le processus vise à harmoniser les deux juridictions dans les domaines où l'Union européenne a légiféré. Dans ceux qui ne font pas l'objet d'une législation européenne, nous nous en remettons aux réglementations de l'OMI.
Pour répondre à la question concernant notre mode d'inspection des navires de transport de marchandises au titre des contrôles de l'Etat du port ou de l'Etat côtier, je laisse le soin à John Mairs d'intervenir.
M. John MAIRS : En ce qui concerne les navires étrangers dans les ports du Royaume-Uni, nous suivons les directives de l'Union européenne. Nos inspecteurs jouent un double rôle en représentant l'Etat du port et l'Etat du pavillon, ce qui leur donne une vaste expérience qu'ils mettent à profit dans l'exercice de ces deux fonctions.
Les experts sont généralement des professionnels qui ont une grande expérience de la navigation parce qu'ils ont navigué dans la marine marchande ou parce qu'ils ont été ingénieurs dans cette dernière. Nous disposons également d'architectes de chantiers navals et de juristes. Mais les deux tiers de ces experts sont soit des gens de mer compétents, soit des personnes qui ont une grande expérience des chantiers navals.
S'agissant de la répartition du travail entre les sociétés de classification et nos experts, nous avons délégué environ 80 % de nos tâches aux premières. Quand nous pouvons leur déléguer certaines responsabilités, nous le faisons ! Mais nous avons pour principe de nous occuper toujours de tout ce qui relève de la sécurité fondamentale en ce qui concerne les navires de transport de marchandises et les navires à passagers. Nous vérifions également nous-même la sécurité secondaire s'agissant, par exemple, du transport de matières dangereuses et du respect des cotes. En revanche, pour ce qui concerne la stabilité des navires, nous nous en remettons aux sociétés de classification.
Pour conclure sur la sécurité des navires, nous considérons au Royaume-Uni que les réglementations sont suffisantes. Le problème est plutôt de savoir comment elles sont appliquées. Quels que soient l'existence et le nombre d'instances en place, il importe de contrôler l'application pratique des réglementations.
M. le Président : Comment les appliquer ? Quelle autorité utiliser ? Quelles sanctions prévoir ?
M. John MAIRS : L'autorité découle de la législation maritime qui confie la responsabilité de l'exécution des conventions internationales, d'abord, au ministre des transports et, ensuite, aux instances chargées de leur application pratique.
Quant aux sanctions, en général, nous n'allons pas jusqu'à ce stade. Lorsqu'une personne fait un certain travail pour nous de façon non satisfaisante, nous commençons par nous en entretenir avec elle. L'idée consiste donc à assurer un certain contrôle pour éviter d'en arriver au stade de la catastrophe. Nous essayons d'orienter les intéressés et de les mettre sur la bonne voie pour éviter des difficultés ultérieures.
M. John WITHE : Nous comprenons le travail des sociétés de classification et nous procédons à des audits régulièrement. Nous les inspectons, ainsi que leurs locaux. Nous montons à bord des navires et nous pouvons vérifier comment ces sociétés de classification fonctionnent et comment elles sont gérées. Nous exerçons donc un contrôle au niveau de la réglementation qui concerne les sociétés de classification et aussi au niveau du travail qu'elles accomplissent en notre nom.
M. John MAIRS : Pour en revenir à la question que nous évoquions tout à l'heure, nous pourrions ne plus reconnaître ces sociétés de classification en guise de sanctions, mais nous essayons d'éviter d'en arriver à ce stade. La plupart de ceux qui travaillent dans les sociétés de classification sont tout à fait prêts à faire du bon travail. S'ils mettent en danger la sécurité, une fois qu'ils en sont alertés, ils se rallient généralement à notre position.
M. David ROWE : Je souhaite ajouter une réflexion à cette observation. Je ne crois pas que quiconque doute de la nature de nos rapports. Les sociétés de classification font le travail de l'Etat, lequel est représenté dans notre secteur par M. Prescott, notre ministre. Tout cela nous ramène donc à sa responsabilité. Si toutefois nous avions le sentiment que la qualité du travail d'une société de classification était insuffisante, nous serions très critiques si des mesures n'étaient pas prises pour y remédier. Nous commencerions pas envoyer une équipe d'audit et si nous n'obtenions pas de résultats, nous ne reconnaîtrions plus cette société. Mais je ne crois pas qu'une société de classification serait prête à perdre son statut de la sorte. Il est bien évident que si nos critiques n'étaient pas justifiées, nous commettrions une erreur en leur retirant le statut que nous leur avions accordé.
M. le Président : Travaillez-vous avec les 10 sociétés de classification qui sont reconnues par l'IACS ? Faites-vous un choix parmi ces 10 sociétés ou ne retenez-vous que le Lloyd's Register of Shipping ?
M. John MAIRS : Avant de répondre à votre question, j'ajoute une précision. En cas de problèmes avec une société de classification, nous procédons à un audit spécial, un audit régulier ayant lieu tous les deux ans.
Pour en revenir à votre interrogation, nous reconnaissons 6 sociétés de classification. Nous tenons largement compte des desiderata des propriétaires de navires. Nous estimons que la reconnaissance de six sociétés est suffisante, mais si un propriétaire de navire souhaitait que nous en reconnaissions une de plus, nous répondrions à son v_u.
M. le Président : La communauté européenne ne vous oblige-t-elle pas à consulter plus largement dans le cadre des règles de mise en concurrence ?
M. John MAIRS : La directive de l'Union européenne sur les sociétés de classification reconnaît un grand nombre de sociétés, mais elle n'impose pas à notre administration de les autoriser toutes à réaliser un travail pour notre compte.
M. David ROWE : Oui, nous avons la possibilité de faire un choix parmi les sociétés de classification reconnues et nous en avons retenu six : le Lloyd's Register Of Shipping, le Bureau Veritas, le Norske Veritas, le Germanisher Lloyd, l'American Bureau Of Shipping et le Registro Italiano Navale.
M. le Président : Vous avez retenu le RINA... (Sourires.)
M. David ROWE : Nous l'avons retenu !
M. le Président : C'est intéressant ! (Sourires.)
M. David ROWE : J'ajoute que des sociétés ne figurent pas sur notre liste, mais tel est le choix que nous avons opéré.
La mesure actuellement proposée par l'Union européenne vise à introduire une modification du régime de reconnaissance des sociétés de classification au sein de l'Union européenne. Si je ne m'abuse, mais je parle sous le contrôle de mes collègues, la procédure de reconnaissance est prévue par la directive n°94-57. Un Etat membre peut reconnaître une société de classification, ce qui signifie dans la pratique que celle-ci est presque automatiquement reconnue au sein de l'Union européenne. En fait, chaque Etat membre peut choisir une société de classification parmi celles qui ont été reconnues. La Commission voudrait centraliser le processus de reconnaissance, en prévoyant un avis technique qui interviendrait au niveau de la sélection.
Nous considérons que les dispositions actuelles sont satisfaisantes. Nous savons exactement ce que font les sociétés de classification pour nous. En fait, elles assument une fonction de l'Etat puisqu'elles travaillent pour nous. En dernier recours, nous sommes responsables du travail qu'elles accomplissent.
Venons-en aux questions sur les garde-côtes et les dispositifs d'aide en cas d'accidents. Pour y répondre, je passe la parole à M. Douglas Patterson.
M. Douglas PATTERSON : Vous nous posez une série de questions qui débordent le seul cadre de ma compétence. Etant dans l'obligation de vous quitter dans quelques instants, je vais aborder celles concernant mon domaine d'activité.
S'agissant des missions de recherche et de secours en mer, je vais vous remettre un document paru très récemment, à l'occasion d'une conférence portant sur les services de recherche et d'assistance en mer. Ce document explique très clairement quels sont les moyens dont le Royaume-Uni dispose à cet égard, au titre notamment de la disponibilité d'hélicoptères.
Les hélicoptères de recherche et d'assistance en mer sont fournis par la Royal Air Force - qui en a 6 -, la Royal Navy - qui en a 2 - et les garde-côtes - qui en ont 4. Chacun de ces hélicoptères est prêt à décoller en quinze minutes dans la journée et en quarante-cinq minutes la nuit. Tout point dans un rayon de 40 milles de la côte doit être atteint dans un délai d'une heure le jour. Tout point dans un rayon de 100 milles de la côte doit être atteint en deux heures de temps la nuit. Tels sont les critères de couverture du Royaume-Uni.
Ces précisions répondent, me semble-t-il à votre question relative aux hélicoptères. Le document que je vais vous remettre contient une multitude de renseignements détaillés qui vous intéresseront, notamment l'équipement qu'ils transportent pour chaque vol.
En ce qui concerne le nombre de remorqueurs affrétés par le Royaume-Uni, nous en disposons de 4 pour les services d'urgence. Ils relèvent de l'Agence maritime des garde-côtes. Deux sont basés en Ecosse, un troisième sur la côte ouest et le quatrième à Douvres. Actuellement, c'est le Royaume-Uni qui assure - en hiver exclusivement - ce service de remorquage parce que nous pensons que c'est le plus rentable. Nous ne connaissons pas les raisons précises pour lesquelles nous avons fait ce choix. Il est donc prévu d'engager prochainement une réflexion sur les conditions de réalisation de ce service de remorquage afin d'envisager une éventuelle couverture toute l'année. Les conditions qui nous seront faites par les opérateurs nous apparaîtrons sans doute plus rentables dans l'hypothèse où nous assurerions ce service toute l'année.
Vous nous interrogez également sur l'efficacité des garde-côtes qui a fait récemment l'objet d'un examen par le National Audit Office, le comité des comptes publics et le comité spécialisé - composé de députés. Le travail accompli par ces derniers a certes reçu un soutien, mais il a suscité tout de même un certain nombre de questions qui ont conduit Lord Donaldson à étudier le plan quinquennal des garde-côtes. Ce rapport, qui est à votre disposition, recense les critiques formulées, les raisons pour lesquelles elles ont été émises et les recommandations relatives à cette stratégie définie sur cinq ans. Ce document vous renseignera sur les missions de recherche en mer et de sauvetage qui ont été réalisées dans telle ou telle région, les ressources et les moyens dont disposent les centres de coordination, notamment les canots de sauvetage.
Suite au sinistre du Sea Empress qui a entraîné une pollution importante au Royaume-Uni, on s'est demandé si l'on disposait de pouvoirs suffisants pour assurer la protection des côtes en cas d'un incident entraînant une pollution par hydrocarbures. Là encore, Lord Donaldson a souhaité réexaminer nos pouvoirs pour proposer leur éventuelle modification. En résumé, nos pouvoirs ont été jugés suffisants, mais la façon dont ils ont été utilisés lors de l'accident du Sea Empress n'a sans doute pas fait l'objet d'une réflexion assez approfondie. Dans le document intitulé Donaldson's Review que je tiens à votre disposition, Lord Donaldson a donc formulé un certain nombre de recommandations. Robin Middleton vous expliquera plus en détail comment elles ont été mises en _uvre dans le plan d'urgence national. Nous sommes donc aujourd'hui plus à même de faire face à un incident tel que celui du Sea Empress.
En conclusion, Lord Donaldson, juriste et spécialiste des questions de la mer, a réalisé un certain nombre de rapports pour nous au fil des années. Le plus important a fait suite à l'accident du Braer en 1993. Cet accident nous a conduits à remettre en question la politique que nous suivions et les pratiques que nous observions.
Comme partout, nous tirons les leçons de nos expériences. C'est l'accident du Braer, pétrolier qui s'est échoué au sud des îles Shetland en 1993, qui a suscité le rapport de Lord Donaldson. Les recommandations qu'il préconisait ont été quasiment toutes exécutées, à l'exception de quelques-unes. L'une est aujourd'hui reprise par la Commission européenne : elle concerne l'amélioration des contrôles de l'Etat du port.
Après l'accident du Sea Empress, nous avons estimé que les pouvoirs étaient suffisants, mais que nos méthodes de mise en _uvre devaient être améliorées. Lord Donaldson a élaboré un autre rapport sur cette question, ce qui a donné lieu à la création du poste de représentant du secrétaire d'Etat qu'occupe Robin Middleton. Lord Donaldson a ensuite été invité par le gouvernement à analyser le fonctionnement du service des garde-côtes, étude qu'il a menée l'année dernière. Les recommandations qu'il a formulées ont été prises en compte, ce qui a donné lieu à de grandes améliorations. J'espère que nous n'aurons pas encore besoin de faire appel à ses services, mais il a réalisé un excellent travail. (M. Patterson se retire.)
M. David ROWE : Venons-en aux actions que nous mettons en place en cas d'accident entraînant une pollution, et aux conséquences en termes de responsabilité et d'indemnisations, ainsi qu'à la capacité des ports à répondre aux situations de détresse.
M. John WREN : Domaine ô combien important ! J'évoquerai essentiellement les principaux instruments juridiques que nous appliquons en termes de responsabilité.
En ce qui concerne la limitation de cette responsabilité en matière de créances maritimes, la convention adoptée en 1976 est actuellement encore en vigueur. Nous avons ratifié les modifications dont elle a fait l'objet par le protocole de 1996. La Russie a également ratifié ce protocole et nous attendons que huit autres Etats le ratifient pour qu'il entre en vigueur. Il vise à relever de 250 % le plafond de responsabilité des propriétaires pour toutes les catégories de navires, excepté les pétroliers.
S'agissant du FIPOL, le Royaume-Uni, comme la France, en est membre, puisqu'il a adhéré à la convention portant création du Fonds et au protocole de 1992. Vous savez sans doute qu'une proposition visant à relever les limitations au titre des indemnisations a été formulée. Je l'ai donc transmise à M. le secrétaire général de l'OMI au nom des Etats qui la présentent, au premier rang desquels se situe la France.
La convention de 1996 signée par huit Etats, dont le Royaume-Uni et la Russie - la semaine dernière très exactement -, n'est toujours par ratifiée.
M. le Rapporteur : A quelle convention faites-vous référence ?
M. John WREN : Il s'agit de la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer des substances nocives et potentiellement dangereuses, dite convention HNS. Cette convention très complexe prévoit une indemnisation, d'une part, par le propriétaire du navire et, d'autre part, par le réceptionnaire ou le propriétaire de la cargaison. Elle a donné lieu à de nombreuses discussions au sein de l'Europe et de l'OMI. Des progrès ont été obtenus dans le cadre d'un travail réalisé en coordination. Nous souhaitons que cette convention soit ratifiée et mise en _uvre. Le Royaume-Uni et la Russie sont les deux seuls pays qui, jusqu'à présent, ont pris les mesures législatives nécessaires à sa ratification.
La lacune du régime de la responsabilité concerne les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute. Les intéressés sont souvent contraints d'intenter des actions devant les tribunaux et de poursuivre en justice. La convention sur la responsabilité pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute prévoit une responsabilité stricte du transporteur et exige une assurance obligatoire couvrant les dommages en cas de pollution provoquée par les hydrocarbures de soute. Elle permet également au demandeur de porter plainte directement contre l'assureur, ce qui facilitera considérablement les démarches.
Une conférence diplomatique sur la coopération internationale en matière de préparation et de lutte contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses est prévue au printemps prochain en vue de l'adoption des dispositions cette convention.
M. le Rapporteur : Avec quels partenaires ?
M. John WREN : Tous les pays membres de l'OMI ! Cette proposition est d'ailleurs soutenue par plusieurs pays européens.
Avant de poursuivre notre réflexion, il me semble opportun de faire part de notre expérience suite aux accidents du Braer et du Sea Empress. A cette époque, l'indemnisation payable par le Fonds pour un événement déterminé était limitée à 60 millions de droits de tirage spéciaux. En 1992, elle a été portée à 135 millions de DTS.
De notre expérience, nous avons tiré un certain nombre de leçons.
Les demandes ne sont pas toujours honorées entièrement ni immédiatement, compte tenu des délais qui font souvent l'objet de retards.
Par ailleurs, les demandeurs ont toujours besoin d'avoir recours à des experts. Le FIPOL leur apporte son concours en termes d'expertise, mais le gouvernement devrait également pouvoir leur apporter une aide à cet égard. La présence d'un expert est une réelle nécessité.
En outre, un Etat ne devrait sans doute pas soumettre de demande d'indemnisation pour permettre un meilleur dédommagement des particuliers.
De même, lorsque vous représentez votre pays pour formuler une demande d'indemnisation auprès du FIPOL, vous devez défendre les intérêts de vos demandeurs tout en préservant ceux de votre industrie qui contribue au financement du Fonds. Il est donc difficile de respecter un certain équilibre, mais cette question intéresse davantage les fonctionnaires que les politiques ! (Sourires.) Je précise que je tiens ce propos en tant que fonctionnaire !
Enfin, il est toujours préférable d'éviter, si possible, de porter la demande devant les tribunaux. Plus les demandeurs sont aidés, plus ils sont prêts à se faire représenter par le gouvernement plutôt que de poursuivre en justice, ce qui entrave par la suite les marges de man_uvre. Jusqu'à ce mois-ci, c'est-à-dire sept ans après l'accident, le gouvernement britannique était encore saisi de demandes au titre des dommages subis à la suite du sinistre du Braer. Il s'agissait de parvenir à un équilibre dans la mesure où nous étions en concurrence avec d'autres demandeurs. Je précise que le gouvernement a décidé de renoncer à toute demande d'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre.
Bref, il faut savoir que les procédures administratives peuvent s'étendre sur plusieurs années, comme je le soulignais à l'instant en évoquant le cas du Braer, et que des leçons peuvent être tirées de chaque incident - tous étant différents.
Mon collègue indiquait tout à l'heure que la majorité des pollutions provenait des décharges opérationnelles. Nous avons renforcé les sanctions avec pour objectif une meilleure application. Nous publions les noms de ceux qui sont responsables d'une pollution.
M. le Rapporteur : Vous les publiez dans la presse ?
M. John WREN : Oui, nous publions leur nom, le montant de l'amende et les conséquences, bref tous les détails.
Les aéronefs de surveillance nous sont aussi d'un grand concours, mais il est toujours difficile de prendre un contrevenant en flagrant délit.
Au titre des structures portuaires qui font l'objet d'une de vos questions, les navires devraient avoir l'obligation d'évacuer leurs déchets dans des stations de déballastage et des décharges prévues à cet effet dans nos ports qui sont contraints de se doter de plans de gestion. Cette démarche, initialement volontaire, est devenue par la suite obligatoire. Cette idée, qui s'est développée en Grande-Bretagne, fera l'objet d'une directive de l'Union européenne. Comme la France, nous la soutenons. Tout navire se verra ainsi imposer l'obligation de prévenir le port sur son intention de décharger ses déchets et sur la nature de ceux-ci, ce qui nous permettra de vérifier sa cargaison.
En conclusion, l'une des recommandations de Lord Donaldson vise à identifier, autour de nos côtes, les zones à haut risque. Nous venons de publier un document analysant les déplacements des navires, les incidents constatés et leurs répercussions sur l'environnement. Il s'agit réellement d'une innovation dans le domaine de l'analyse de la valeur environnementale de certaines zones qui entourent nos côtes.
M. David ROWE : Pour conclure, je vous propose d'examiner les deux dernières questions concernant les dispositifs d'aide dont nous disposons en cas d'accident ainsi que le rôle des ministres.
L'organisme responsable a tous les pouvoirs conférés au ministre compétent. Il en dispose à titre permanent, que ce soit pour mener des opérations de sauvetage ou pour faire face à des incidents de pollution. Il lui est également possible d'assurer la prise en charge des exercices de sauvetage, ce qui constitue une nouveauté retenue à la suite d'une recommandation de Lord Donaldson formulée après la catastrophe du Sea Empress. Mon collègue, M. Middleton qui est le représentant personnel du ministre, travaille en étroite collaboration avec l'Agence maritime des garde-côtes.
L'obligation première des garde-côtes est la sauvegarde de la vie humaine. Il leur revient, ensuite, d'éviter tout incident éventuel de pollution et de faire face à tout accident entraînant une pollution.
Avant de revenir sur l'une de vos questions concernant la position du Royaume-Uni au sujet du plan de travail de l'Union européenne et de l'OMI, je donne la parole à Robin Middleton pour vous apporter des précisions complémentaires.
M. Robin MIDDLETON : J'ai eu le privilège et le plaisir de rencontrer cette semaine en France le préfet maritime pour la Manche. A l'occasion de ce déplacement, j'ai eu l'occasion d'expliquer le rôle du Secretary of State Representative créé initialement en 1984 et plus récemment pérennisé, son mode de fonctionnement et les responsabilités qui m'incombent. Je me propose de vous remettre les notes que j'avais préparées à cet effet.
Lorsqu'un incident survient, nous mettons en _uvre l'étape de planification et nous mobilisons le grand plan d'urgence.
M. David ROWE : Dans de telles circonstances, nous déclenchons en effet le plan national d'urgence. Par ailleurs, le plan prévoyant la coopération anglo-française dans la Manche - le Manche plan - peut être également mis en _uvre.
M. Robin MIDDLETON : Une fois que le plan national d'urgence entre en vigueur, les services des garde-côtes sont les premiers à agir en cas d'incident, et ce dans les 24 heures. Il sont chargés de vérifier l'ampleur de l'incident et de mettre en place les mesures destinées à parer à la situation.
Pour ne pas abuser de votre temps, je précise simplement que les incidents auxquels nous avons dû faire face et les exercices auxquels nous procédons nous ont permis de réaliser de notables progrès en termes de mobilisation des services. Nous avons beaucoup appris en termes de gestion de crise. Ces exercices nous ont été très utiles et profitables pour améliorer notre réactivité. Ce sentiment est également partagé par les propriétaires de navires et toutes les autorités concernées.
M. David ROWE : Pour terminer, évoquons les perspectives d'avenir !
S'agissant du service de remorquage, nous envisageons une éventuelle couverture toute l'année ainsi qu'une meilleure couverture géographique. Il est effectivement prévu que le remorqueur basé à Douvres qui assure actuellement ce service exclusivement en hiver offre une couverture à l'année.
Quant à la position du Royaume-Uni en général, notre ministre en a fait rapport à Bruxelles lors du Conseil des transports qui s'est tenu en mars dernier. Compte tenu de nos expériences, nous partageons les préoccupations de la France au sujet de la vulnérabilité de nos côtes respectives face aux incidents susceptibles de provoquer des pollutions. Bien entendu, nous sommes tout à fait prêts à coopérer avec la France au sein de l'OMI pour la mise en application de toute mesure susceptible d'améliorer les contrôles. Nous entretenons déjà une coopération étroite dans plusieurs domaines avec les autorités compétentes au sein de l'Union européenne dans le but de renforcer et de faire appliquer les normes en vigueur.
Nous préconisons deux mesures essentielles.
La première vise à améliorer la surveillance des sociétés de classification.
A ce sujet, la Commission européenne, sous la présidence portugaise, a présenté une proposition tendant précisément à exercer un contrôle plus étroit sur les sociétés de classification. Nous souhaitons que cette décision soit entérinée par le Conseil des transports prévu en juin prochain. En tout cas, nous espérons qu'un accord politique interviendra, ce qui devrait être le cas compte tenu de la réponse positive des ministres des transports des Quinze.
M. le Rapporteur : Sur toutes les propositions ?
M. David ROWE : Uniquement sur celle concernant les sociétés de classification.
Je précise que la Commission européenne a formulé deux autres propositions. L'une d'entre elles concerne le renforcement des contrôles de l'Etat du port.
A cet égard, il s'agit de mettre en commun toutes les ressources qui existent en Europe. Certaines normes d'inspection ne peuvent pas connaître une application généralisée. Il conviendrait, nous semble-t-il, de concentrer notre action sur certains risques particuliers, notamment sur les navires battant des pavillons qui ont mauvaise réputation.
Dans ce domaine, la Commission européenne a suivi les recommandations de Lord Donaldson qui visaient à accroître une application collective des mesures de protection et d'inspection. Nous appuyons fortement cette proposition de la Commission européenne. Il faudra convaincre les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne de nous suivre. Nous essayerons par tous les moyens diplomatiques possibles de les y inciter.
La dernière proposition de la Commission européenne tend à interdire les pétroliers à coque unique.
Sur ce dernier point, nous souhaiterions obtenir une réponse de la Commission européenne sur les conséquences économiques d'une telle mesure. Nous en acceptons le principe qui fait déjà l'objet d'un consensus au sein de l'OMI. Il s'agit maintenant de savoir dans quel délai cette disposition peut entrer en vigueur. Je ne critique pas la Commission européenne pour ne pas nous avoir fait part des incidences économiques qu'on peut attendre de cette proposition, mais nous souhaiterions en être informés parce qu'il nous faut défendre la décision, une fois qu'elle est prise.
J'en reviens à la seconde mesure que nous préconisons. Elle vise à examiner la meilleure façon de protéger les côtes de l'Europe. La plupart des contrôles que nous pouvons exercer doivent être effectués dans les ports. Si un pétrolier se rend, par exemple, en Méditerranée, en Syrie ou en Egypte, il traversera les côtes de l'Europe sans aucun contrôle. Nous préconisons les mêmes mesures pour les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Nous estimons que la meilleure solution consisterait en une combinaison des mesures prises à l'échelle européenne avec celles décidées au sein de l'OMI. Nous en examinons les modalités.
En conclusion, nous préconisons des mesures pratiques et d'urgence, sachant que nous sommes prêts à coopérer avec d'autres Etats à cet égard.
M. le Rapporteur : Nous vous remercions infiniment de ces réflexions extrêmement intéressantes. Nous regrettons d'autant plus d'être pris par le temps que toutes les observations formulées dans la seconde partie de votre propos correspondent tout à fait à nos préoccupations.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être validée par les intervenants.
Audition de M. Måns JACOBSSON,
administrateur du FIPOL,
accompagné de M. Jean-Marc SCHINDLER,
représentant permanent de la France auprès de l'OMI,
conseiller maritime de l'Ambassade de France en Grande-Bretagne
(extrait du procès-verbal de la séance du 12 avril 2000 à Londres)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Måns JACOBSSON : Je suis très honoré de m'entretenir avec des députés français, en regrettant toutefois que vous représentiez des régions de France malheureusement frappées par une marée noire.
Je souhaite concentrer cet exposé sur les questions d'indemnisation, ainsi que sur les questions économiques et financières. Cela ne signifie pas que nous ne soyons pas conscients des autres conséquences de ce sinistre, peut-être encore plus graves, sur le plan humain. Nous sommes conscients de la frustration de ceux qui voient leur profession et leur vie perturbées et qui éprouvent tant d'incertitudes quant à leur avenir. Nous avons tous présent à l'esprit ces considérations que je n'aborderai cependant pas dans mon exposé parce que vous les connaissez bien mieux que moi.
Vous avez aussi certainement évoqué au cours de cette journée des sujets peut-être encore plus importants, en particulier les mesures à envisager pour améliorer la situation et éviter que de tels sinistres surviennent encore dans l'avenir. Nous nous accordons naturellement à reconnaître que la prévention est préférable à l'indemnisation. Mais tel n'est pas notre mandat ni l'objet de notre entretien. Je n'interviendrai donc pas à cet égard, sauf pour répondre à d'éventuelles questions.
Précisément, avant de répondre concrètement aux questions que vous avez bien voulu me soumettre et éventuellement à d'autres tout aussi importantes, je me propose de vous donner un aperçu général du cadre du système d'indemnisation des pollutions accidentelles par hydrocarbures.
Comme vous le savez, nous travaillons ici dans le cadre de conventions internationales mises en _uvre par l'OMI en 1969 et en 1971. Ces conventions ont été révisées plus tard, dans les années quatre-vingt dix, et adoptées en 1992. Ce sont celles de 1992 qui sont concernées dans le cas de l'Erika.
La première d'entre elles concerne la responsabilité civile des propriétaires de navires, en principe limitée, et le montant de limitation est déterminé en fonction de la jauge du navire. Dans le cas de l'accident de l'Erika, il s'agit d'environ 84 millions de francs.
Si pour un tel sinistre, ce montant ne suffit pas pour indemniser les victimes, le FIPOL entre en scène et indemnise à concurrence du montant total de l'ordre de 1,2 milliard de francs. Ce montant inclut la somme payée par le propriétaire du navire ou son assureur.
M. le Rapporteur : Vous parlez bien de 1,2 milliard de francs, y compris la somme versée par le propriétaire du navire ?
M. Måns JACOBSSON : Il s'agit très exactement de 1 211 966 881 de francs.
On peut légitimement se demander pourquoi 1,2 milliard et non pas 1 milliard ou 2 milliards de francs. Cette décision politique a été prise à l'occasion de la conférence diplomatique de 1992. Elle a été ensuite ratifiée par l'Assemblée nationale et le Sénat français. Comme toutes les décisions, il s'agit de compromis politiques entre les Etats qui ont des intérêts variés.
La convention portant création du Fonds a institué un organisme connu en France sous le sigle de « FIPOL », tant sa dénomination est longue et rebutante. Il revient donc à ce dernier d'administrer ce système. Il ne s'agit pas d'une organisation spécialisée des Nations Unies à proprement parler, comme l'OMI en offre l'exemple. Toutefois, dans son mode de fonctionnement, sa structure est comparable à toute organisation des Nations Unies. Je m'en explique.
Une assemblée générale, composée de tous les Etats membres, se réunit au moins une fois par an, en principe en octobre. Cet organe prend des décisions de principe, telles l'élection de l'administrateur, l'élaboration du budget et l'approbation des comptes. Par ailleurs, il élit un comité exécutif composé de quinze Etats, et ce par rotation : c'est-à-dire qu'un Etat ne peut faire partie du comité exécutif que pendant deux ans seulement, ce qui donne ainsi la possibilité à d'autres Etats d'en faire partie. La France est actuellement membre du comité exécutif.
La France a toujours joué un rôle moteur dans la création et le développement du système. Lorsqu'un groupe de travail intersessions a réexaminé voilà huit ou neuf ans les critères de recevabilité des demandes d'indemnisation, la réunion, du reste très importante, était présidée par la France. Le président français, un contrôleur d'Etat de haut niveau, a été ensuite président du comité exécutif et, pendant six ans, de l'assemblée générale. En octobre dernier, il a décidé de se retirer, ce que nous avons tous regretté. Nous avons accepté sa décision, car exercer un mandat pendant six ans, c'est long ! Vous savez mieux que quiconque, M. le président, qu'il n'est pas toujours très facile de présider des réunions ! (Sourires.)
Il est également important de savoir que l'industrie ne prend pas part aux décisions des organes délibérants, lesquelles sont prises exclusivement par les Etats à travers les représentants des gouvernements.
La composition des délégations est très variée selon la structure administrative et politique des pays. En France, nos interlocuteurs sont pour les questions politiques - en principe - le Quai d'Orsay et, pour les questions plutôt administratives - par tradition -, l'agence judiciaire du Trésor du ministère des Finances. À titre comparatif, il s'agit, dans mon propre pays, la Suède, du ministère de la Justice et, en Finlande, du ministère de l'Industrie. Bref, la composition des délégations dépend de la structure administrative et politique des pays. Très souvent, les représentants de ambassades, comme c'est le cas pour la France, sont aussi membres de la délégation.
Comment ce système est-il financé ?
Quand nous nous sommes réunis à Bruxelles en 1971 pour arrêter la convention d'origine, nous avons tous eu la même instruction de notre ministre des Finances : pas d'argent public ! L'idée était d'obliger les propriétaires de navires à être couverts par une assurance et de s'adresser à l'industrie maritime privée pour en financer une première tranche. Il était alors logique que l'industrie pétrolière participe également pour une deuxième tranche. C'est ainsi qu'il a été proposé - la France a été l'un des pays à évoquer cette idée - d'établir un système de solidarité financé par les industries pétrolières, mais décidé et régi par les gouvernements. Au regard du droit international, ce fut une novation.
Par conséquent, chaque entité résidant dans un Etat membre, qu'elle soit privée ou publique, qui reçoit certains types d'hydrocarbures après avoir été transportés par mer sur une année, doit payer un montant décidé par l'assemblée générale.
Nous avons, par ailleurs, tenu une session extraordinaire de l'assemblée la semaine dernière, pour lever des contributions afin de financer les indemnisations consécutives à l'accident de l'Erika. Il est très rare que l'assemblée se réunisse en session extraordinaire à cette fin. Je l'ai proposé parce qu'il est important, me semble-t-il, que nous disposions de fonds liquides pour pouvoir payer.
En ce qui concerne le financement du FIPOL, l'industrie pétrolière française participe approximativement à concurrence de 9 % du montant total. Les pays dont l'industrie pétrolière apporte la plus grande contribution sont le Japon avec 26 %, la Corée du sud et les Pays-Bas. La France occupe à cet égard le quatrième rang après ces trois pays. Quand les nouvelles conventions entreront en vigueur pour l'Italie, elle occupera le deuxième rang et la France pourra alors réduire sa contribution.
Comment agir en cas de sinistre ?
En cas de sinistre de petite ou de moyenne importance, nous essayons, en principe, de traiter les demandes à une échelle bilatérale avec les demandeurs au premier rang desquels se trouvent en général les gouvernements ou les autorités publiques. Dans ce cas, il est possible de traiter les demandes par correspondance ou par des réunions avec les autorités compétentes.
En cas de sinistre majeur donnant lieu à de grands dommages et affectant notamment un grand nombre de personnes de condition modeste, à savoir les pêcheurs, les petits hôtels ou les petites entreprises, il n'est pas décent de les inviter à envoyer leurs demandes à Londres. C'est ainsi que nous avons décidé voilà huit ou neuf ans d'installer un bureau local dans la région frappée par la marée noire. Ce fut le cas à La Corogne - en Espagne -, aux îles de Shetland - au Pays de Galles -, au Venezuela, au Japon et plus récemment, comme vous le savez, à Lorient.
Les frais administratifs afférents à l'installation de ce bureau et les honoraires des experts sont prélevés, non pas sur le montant de 1,2 milliard de francs, mais sur le budget d'administration du FIPOL. Il est important de procéder ainsi parce que l'ouverture d'un bureau et le recours à des experts, éventuellement pendant plusieurs années, peuvent induire des frais considérables.
Les experts sont choisis à la lumière des problèmes posés. En principe, il est préférable de s'adresser à ceux qui connaissent bien le pays et les circonstances locales. C'est pourquoi dans le cas précis de l'Erika, la grande majorité des experts sont français. Nous disposons aussi d'experts internationaux, et ce pour une raison bien précise : tous les gouvernements, y compris le gouvernement français, ont toujours insisté sur l'importance d'une application uniforme des conventions pour tous les pays membres afin de respecter, d'abord, l'équité et, ensuite, une certaine uniformité dans l'application des droits. Cette seconde exigence est due au fait que l'industrie pétrolière d'un pays - prenons l'exemple de la France - participe au financement tendant à indemniser des dommages dans un autre pays. Prenons l'hypothèse que les tribunaux suédois auraient tendance à avoir une interprétation généreuse de l'admissibilité, tandis que les tribunaux français prendraient une approche restrictive. Par conséquent, sans cette uniformité dans l'application des conventions, l'industrie pétrolière française se retournerait contre le gouvernement français en ces termes : « Pourquoi payer en vertu de ce jugement « excessif » rendu par le tribunal en Suède ? »
C'est pourquoi les gouvernements ont toujours insisté sur la nécessité de parvenir à une certaine uniformité dans le traitement des demandes d'indemnisation des différents sinistres.
Pour cette raison, après les grands sinistres du Braer et de l'Aegean Sea, l'assemblée a constitué un groupe de travail intersessions, présidé par un contrôleur d'Etat français, afin d'étudier les critères à appliquer au titre de la recevabilité des demandes. Ces critères ont été entérinés après avoir été décidés, non pas par le secrétariat du FIPOL, mais par les représentants des gouvernements des Etats membres dans le cadre de l'Assemblée générale, et ce à juste titre. Il appartient non pas aux fonctionnaires internationaux de décider de la politique du Fonds, mais aux Etats et aux gouvernements.
Ces critères ne sont cependant pas immuables. Si à la lumière de l'expérience, les gouvernements estiment qu'ils doivent être modifiés, il est possible d'en saisir les organes délibérants. De même, des types de demandes que nous n'aurions pas prévues peuvent être soumises au comité exécutif à qui il revient alors de prendre position sur telle ou telle question de principe.
Les critères qui ont été adoptés sont entérinés dans le manuel sur les demandes d'indemnisation. Il est révisé quand l'assemblée ou le comité exécutif décide d'y introduire de nouveaux critères ou des modifications.
Evoquons une autre donnée importante : les pays que j'ai mentionnés et qui financent le système font tous partie des pays dits riches. Il s'agit des pays industrialisés. En réalité, les pays qui sont les dix plus grands contributeurs sont tous membres de l'OCDE : ils financent environ 90 % des contributions totales. Dans une perspective plus large, tel est l'esprit des déclarations du sommet de Rio, la solidarité internationale pour la protection de l'environnement maritime s'exprime à travers le principe du « pollueur-payeur » qui s'applique non pas à titre individuel, mais au titre de l'industrie pétrolière en tant que collectivité.
En cas de sinistre majeur, quelle est la situation si les demandes dépassent le montant maximal d'indemnisation disponible qui représente, dans le cas du sinistre de l'Erika, 1,2 milliard de francs ?
Dans ce cas, en vertu de la convention - et la loi française est très claire à cet égard - il faut traiter tous les demandeurs sur un pied d'égalité. Que les demandes soient présentées dès les premières semaines suivant le sinistre ou juste avant le terme de la période de prescription de trois ans, toutes doivent être traitées exactement de la même façon. Dans ce cas, les indemnités versées à chaque demandeur font l'objet d'une réduction proportionnelle, à moins que le demandeur renonce à son droit. Comme vous le savez, c'est le cas de la compagnie Total Fina et du gouvernement français. Total Fina a décidé de prendre place en dernière position des demandeurs d'indemnisation et le gouvernement français en avant-dernière position. Le gouvernement britannique avait pris une décision similaire à deux reprises, comme le gouvernement de Corée d'ailleurs. Mais naturellement, il appartient aux gouvernements eux-mêmes d'en décider.
Le problème pour nous est de savoir ce qu'il est possible de faire dans cette situation d'incertitude dont nous sommes aujourd'hui tous conscients. Que convient-il de faire avant que la situation ne soit claire ? Nous en avons discuté à plusieurs reprises avec le gouvernement français et nous nous accordons à reconnaître qu'il est impossible d'estimer à l'heure actuelle le montant total des demandes admissibles.
M. le Rapporteur : Avec qui en avez-vous discuté ?
M. Måns JACOBSSON : Nous avons évoqué le sujet avec les autorités françaises concernées, le Quai d'Orsay, l'agence judiciaire du Trésor et les autres ministères concernés, à l'occasion d'une réunion qui s'est tenue au Quai d'Orsay.
Nous nous accordons tous à reconnaître qu'il n'est pas possible de faire maintenant une estimation du montant total du préjudice subi. Tout d'abord, nous ne savons pas quand les interdictions concernant la pêche seront levées. Nous savons que la situation évolue de façon positive, mais des problèmes subsistent. Ensuite, la situation dans le domaine du tourisme est encore plus vague parce que la saison touristique n'a pas encore commencé. Nous disposerons des premières indications probablement après Pâques, mais la grande saison touristique est celle des mois de juillet et d'août.
C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord avec le gouvernement français de ne pas fixer de pourcentage d'indemnisation dans l'immédiat mais plutôt de demander à l'assureur de procéder à des paiements provisoires jusqu'à concurrence du montant lié à la responsabilité du propriétaire du navire.
M. le Rapporteur : A concurrence de quel montant ?
M. Måns JACOBSSON : Il s'agit de 84 millions de francs utilisés au titre des versements provisoires afin de répondre aux demandes. Je dispose aussi du pouvoir de procéder à des paiements provisoires pour les personnes ayant des difficultés financières, et ce jusqu'à concurrence d'environ 50 millions de francs.
M. le Rapporteur : En plus des 84 millions de francs ?
M. Måns JACOBSSON : Tout à fait !
M. le Rapporteur : Par conséquent, provisoirement, il est possible d'allouer jusqu'à 134 millions de francs ?
M. Måns JACOBSSON : Environ ! Le Club P&I assurant le propriétaire de l'Erika a commencé à payer après le sinistre, mais pour ma part mon autorité de faire des paiements provisoires est soumise à certaines restrictions.
Après m'être entretenu avec le président de cette question, j'ai proposé de convoquer le comité exécutif en session extraordinaire le 5 juillet prochain, pour prendre une décision au sujet du paiement. Cette proposition a été acceptée la semaine dernière. Nous pensons qu'à cette date-là, nous évaluerons non pas plus certainement mais plus clairement la situation dans le domaine de la pêche et peut-être aussi dans celui du tourisme, notamment au regard des réservations.
Nous croyons qu'ainsi, il sera possible de résoudre les problèmes imminents. Ce n'est pas tout à fait satisfaisant, mais c'est en tout cas ce que le comité exécutif était prêt à faire de mieux pour l'instant.
En ce qui concerne les chiffres - qui datent [du 30 juin 2000] (3) -, nous avons reçu [1 158] demandes initiales et [492] demandes additionnelles. Nous parlons de « demandes additionnelles » lorsqu'une demande présentée, par exemple, en janvier et février par un demandeur pour couvrir ses pertes fait l'objet d'une deuxième demande pour couvrir celles enregistrées en mars. Nous considérons alors cette deuxième demande comme une demande additionnelle.
Hier soir, des paiements d'un montant de l'ordre de [10 473 923] de francs ont été effectués auprès de [415] demandeurs. Des chèques d'un montant total de[1 311 034] de francs sont établis, mais ils n'ont pas encore été retirés par les demandeurs. Le temps de leur téléphoner et de les inviter à retirer leur chèque entraîne toujours quelques jours de délai.
Par conséquent, les paiements ont été autorisés pour l'instant pour un montant de l'ordre de [11,7] millions de francs. Comme vous le constatez, il s'agit d'un montant beaucoup plus élevé que celui que vous avait donné M. Jacquemin. Cela prouve que les choses ont commencé à bouger davantage.
Comment traiter ces demandes ? Là est le problème ! Je me suis entretenu aujourd'hui avec le Club P&I assurant le propriétaire de l'Erika et les experts de pêche ; nous avons décidé de porter les effectifs des experts de pêche de 4 à 6. Au cours de nos discussions, la possibilité d'accroître encore davantage ces effectifs a été évoquée. Mais si les experts sont trop nombreux, nous nous heurterons à un problème de coordination et d'égalité de traitement. Nous voulons donc examiner clairement la situation. S'il s'avérait nécessaire de recourir à des experts supplémentaires, nous le ferons ! En principe, nous nous adressons à Cofrapêche qui est, d'après nos interlocuteurs à Paris, le plus qualifié en France.
Comme nous l'enseigne l'expérience des sinistres précédents, il faut du temps pour rôder le système. En témoignent ces cinq derniers jours au cours desquels les montants versés au titre des indemnisations ont augmenté considérablement. Certes, ils n'ont pas tout à fait augmenté comme nous l'aurions voulu, mais il semblerait que les paiements devraient intervenir maintenant plus rapidement. De même, le nombre de dossiers examinés chaque semaine devrait s'accroître.
Nous avons dû également faire face à un problème. Il ne s'agit nullement d'une critique - tant les formalités sont compliquées ! -, mais dans les premiers temps, les demandes qui n'étaient pas très bien présentées étaient nombreuses. Les documents explicatifs ont été nettement améliorés, ce qui est de nature à simplifier la tâche des experts. J'ai appris ce matin que les dossiers reçus ces deux dernières semaines étaient plus complets, ce qui permettra aux experts, qui étaient obligés de contacter les demandeurs et de réclamer des précisions, de gagner du temps.
Nous avons aussi constaté lors des deux premiers mois, que les demandes reçues émanaient plutôt des pêcheurs à pied et concernaient plutôt de petits montants. Nous commençons maintenant à recevoir des demandes plus importantes, notamment celles des ostréiculteurs, si bien que les montants à honorer seront plus élevés.
Je sais qu'un problème considérable affecte les marais salants. Nos experts sont tout à fait conscients de la situation difficile dans laquelle se trouvent les demandeurs et de l'importance que peuvent représenter ces demandes d'indemnisation. J'espère que des solutions seront trouvées et que les risques liés à la pollution s'estomperont avec la réduction de concentration des hydrocarbures dans les eaux.
Vous vous interrogez à juste titre sur les critères de recevabilité. Ceux-ci ne sont pas trop stricts, les gouvernements ayant souhaité que nous conservions une certaine flexibilité, et ce pour deux raisons. D'abord, la situation n'est pas la même dans tous les pays. Ensuite, il nous faut adapter nos procédures d'examen en fonction des demandes et des situations. Si l'on fixe des critères extrêmement précis, il sera difficile d'examiner les demandes en fonction des circonstances particulières.
Nous observons cinq types de demandes.
M. le Rapporteur : Actuellement ?
M. Måns JACOBSSON : Non, en général !
La première catégorie de demandes se réfère aux dommages aux biens - par exemple, bateaux et outils de pêche. Comparés à d'autres et dans leur principe même, ils sont faciles à examiner parce qu'il est possible d'évaluer les frais à engager pour procéder aux opérations de nettoyage, pour repeindre un bateau ou remplacer les filets.
La deuxième catégorie de demandes concerne l'indemnisation des opérations de nettoyage en mer et à terre, notamment des plages. Ces demandes proviennent plutôt des autorités publiques, c'est-à-dire des gouvernements, des municipalités, des régions et, dans le cas précis de l'Erika, elles correspondent en grande partie aux dépenses engagées dans le cadre du plan POLMAR. Elles seront probablement canalisées et, ensuite, il sera fait application du principe de subrogation, comme j'ai dit tout à l'heure, pour venir prendre place en dernière position avant Total Fina.
Vendredi dernier, nous avons reçu six demandes de municipalités pour couvrir les postes qui ne le sont pas par le plan POLMAR. C'est ce que nous appelons les coût fixes et qui constituent la troisième catégorie de demandes qui nous sont adressées. Comme vous le savez, le plan POLMAR couvre les charges additionnelles que les municipalités n'auraient pas supportées si le sinistre n'avait pas eu lieu. Le FIPOL a largement discuté de cette question dans les années quatre-vingt. L'idée consistait, par ce système d'indemnisation, à placer le demandeur dans la même situation économique que si le sinistre n'avait pas eu lieu.
M. le Président : Je suis désolé de vous interrompre, mais nous sommes au regret M. Guédon et moi-même de vous quitter, ce qui ne doit nullement vous empêcher de poursuivre l'entretien avec nos collègues.
M. Måns JACOBSSON : Comme je vous l'ai indiqué lorsque vous m'aviez fait part de vos impératifs horaires, je suis prêt à vous faire parvenir un document écrit que j'élaborerai avec mon équipe à l'issue de cet entretien. N'hésitez pas non plus à me faire part éventuellement de questions complémentaires que vous souhaiteriez me soumettre après réflexion avec M. le rapporteur. Nous sommes tout à fait disposés à coopérer dans toute la mesure possible. (M. le Président et M. Guédon quittent la réunion.)
Comme je le disais, si l'on applique cette idée visant à placer le demandeur dans la même situation économique que si le sinistre n'avait pas eu lieu, nous ne devons pas payer de frais fixes, sinon la municipalité serait placée dans une meilleure position chaque fois que se produirait un sinistre. Par ailleurs, si l'on procédait ainsi, on favoriserait les pays qui n'ont pas de plan d'urgence et qui n'auraient recours qu'à des entreprises privées parce qu'il s'agit de paiements réels. Les gouvernements ont estimé qu'il était dans l'intérêt non seulement du FIPOL mais aussi de la société en général, d'encourager les pays à mettre en place des structures pour combattre les marées noires d'une manière efficace. Pour cette raison, la décision a été prise, à l'encontre du droit normal, que le FIPOL accepterait de payer des frais fixes, à condition qu'ils soient étroitement liés aux opérations et qu'ils ne comportent pas de frais généraux n'ayant qu'un rapport éloigné avec l'événement. Cela montre aussi que dans le cadre d'un organisme, les Etats peuvent ensemble faire évoluer le droit international, pour faire face aux problèmes de la société.
Pour cette raison, nous sommes tout à fait prêts à examiner ces six demandes d'indemnisation au titre de coûts fixes, tout en veillant naturellement à éviter tout doublon avec les fonds obtenus dans le cadre du plan POLMAR. Mais compte tenu des relations que nous entretenons avec le gouvernement français, je suis tout à fait confiant !
Certaines demandes sont plus difficiles à examiner, telles celles déposées au titre de préjudices consécutifs. Elles représentent la quatrième catégorie de demandes traitées par le FIPOL. Citons, par exemple, le manque à gagner d'un pêcheur dont le bateau ou les filets sont contaminés. Pendant quelques semaines, il ne lui est pas possible de pêcher parce qu'il lui faut nettoyer ses matériels. Dans ce cas, quid des pertes de revenus ? Tous les systèmes juridiques acceptent ces types de demandes et le FIPOL aussi. Comme l'estiment les juristes, il s'agit là d'une conséquence de l'événement portant atteinte aux biens et ce droit est protégé par la loi. Reste à savoir comment apprécier ces pertes. Il s'agit là d'une réelle difficulté !
Autre cas, celui du pêcheur plus chanceux dont les filets n'ont pas été contaminés du tout mais qui est dans l'impossibilité de pêcher parce que la zone de la mer où il exerce normalement son activité est polluée et qu'il ne peut pas pêcher ailleurs pour diverses raisons : soit il n'y est pas autorisé, soit son bateau est trop petit pour sortir. Quid de la perte de recettes de ce pêcheur ? La majorité des systèmes juridiques refusent de l'indemniser, car le dommage qu'il a subi ne relève pas du droit protégé par la loi.
Citons également le cas d'un hôtel situé sur une belle plage frappée par la marée noire, ce qui entraîne l'annulation des réservations effectuées par les touristes auprès de l'établissement. Les tribunaux de plusieurs pays estiment que, dans ce cas, les demandes d'indemnisation ne sont pas recevables s'agissant d'une plage publique.
A la suite d'un examen de ces cas, le FIPOL a considéré que, d'un point de vue social et politique, ne pas donner suite à de telles demandes était inacceptable. C'est ainsi qu'à été prise la position de principe visant à considérer ce type de demandes. Comment expliquer au pêcheur dont les filets n'ont pas été contaminés mais qui subit une perte de revenus du fait de l'événement qu'il ne sera pas indemnisé, alors que la demande de son collègue dont les filets ont été souillés sera prise en considération ?
M. le Rapporteur : Pourquoi celui dont le filet est intact ne le serait pas ?
M. Måns JACOBSSON : Précisément, au regard de milliers de demandes de ce type au fil des années, nous avons défini un certain nombre de critères pour prendre en considération ces dossiers ayant trait à un « préjudice économique pur », selon l'expression utilisée par les juristes. Pour que celui-ci ouvre droit à réparation, il doit y avoir un degré « raisonnable » de proximité entre la contamination et la perte ou le dommage subi par le demandeur. Pour déterminer si ce critère de la proximité raisonnable se trouve rempli, un certain nombre d'éléments sont pris en considération.
Le premier est le lien géographique. La proximité géographique est-elle suffisante entre l'activité du demandeur et la contamination ?
Le deuxième est le degré de dépendance économique du demandeur par rapport à la ressource affectée. Le demandeur a-t-il la possibilité de faire d'autres affaires pour réduire sa perte ? L'entreprise en question fait-elle partie intégrante de l'économie de la zone atteinte par la pollution ? Nous essayons ainsi d'avoir une impression globale de ce lien de proximité. Dans ce cadre, les demandes des entreprises de pêche de la zone affectée et des hôtels situés sur des plages polluées sont en principe prises en considération.
Naturellement, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la côte contaminée, les problèmes commencent à surgir. Dans ce cas-là, il faut systématiquement les examiner à la lumière des circonstances particulières des demandeurs. En cas de doute, je dois les soumettre au comité exécutif parce qu'il appartient aux gouvernements de donner au secrétariat les directives, quant à la politique du FIPOL à cet égard.
Une fois la demande acceptée, en principe, il s'agit de savoir comment établir la perte en termes monétaires. Dans les domaines du tourisme et de la pêche, il n'y a pas une vérité absolue, car il convient d'estimer les revenus de ce pêcheur si le sinistre n'avait pas eu lieu. Calcul très difficile ! Il faut appliquer une méthode indirecte de calcul du préjudice, en comparant le chiffre d'affaires du demandeur sur les deux ou trois années précédentes tout en tenant compte des autres circonstances - par exemple s'il s'était doté d'un équipement plus performant. Dans le cas d'un hôtel, il faut tenir compte de l'éventuelle augmentation de ses capacités, c'est-à-dire s'il s'est agrandi en créant quelques chambres supplémentaires. Il s'agit aussi de savoir si au fil des années, le chiffre d'affaires a varié et, dans l'affirmative, pour quelles raisons. Par exemple, l'hôtel peut être mal entretenu ou son nouveau propriétaire est moins commerçant que le précédent. Bref, dans la mesure du possible, il convient d'examiner chaque demande en fonction des circonstances particulières.
Une fois soumise, toute demande est enregistrée par le bureau chargé de la coordination sur le plan administratif. Ensuite, le dossier est transmis aux experts compétents. Ces derniers procèdent à un examen, discutent avec le demandeur et formulent une recommandation qui sera soumise à Londres pour décision par le Club P & I, l'assureur et le FIPOL. En principe, ici, à Londres, les décisions sont prises assez rapidement. Le problème qui se pose est plutôt celui du temps nécessaire à l'évaluation. La semaine dernière, une décision a été prise en deux heures pour un demandeur qui était en grande difficulté financière. Il était important d'attirer l'attention de nos experts sur ce problème : si des demandeurs sont confrontés à de réelles difficultés financières, il faut traiter leur cas plus rapidement que les autres dans toute la mesure du possible. Il y a naturellement toujours une question d'équité. Les demandeurs ne sont pas tous dans la même situation et il ne s'agit pas, bien entendu, de traiter tous les cas en priorité.
La dernière catégorie de demandes qui nous sont adressées recouvre les dommages à l'environnement. En effet, outre les problèmes d'ordre juridique et politique d'une pollution, se posent des problèmes environnementaux. Cette question des dommages à l'environnement a été examinée à la suite de demandes présentées à l'occasion d'un sinistre survenu en Union Soviétique et fondées sur la règle de calcul suivante : chaque tonne d'hydrocarbures échappée du navire est supposée avoir pollué « x » mètres cubes d'eau et chaque mètre cube d'eau est supposé avoir perdu une valeur « y » de roubles. Le calcul consistant à multiplier « x » par « y » aboutissait à une somme considérable, vu les mètres cubes d'eau de la mer Baltique ! L'assemblée générale du FIPOL a estimé que de telles méthodes n'étaient pas acceptables. Il a été décidé que l'indemnisation ne concernerait que le demandeur ayant subi une perte économique réelle. Cette position, prise en 1980, a été entérinée dans le texte des conventions de 1992. Cette question n'était pas tant juridique que politique. Elle a fait l'objet non pas d'une décision du FIPOL, mais d'une décision politique prise par les gouvernements dans le cadre de la conférence diplomatique. Il n'est cependant pas tout à fait correct de dire que, dans le cadre des conventions, le FIPOL n'indemnise pas les dommages à l'environnement. Nous le faisons dans une certaine mesure en indemnisant les opérations de nettoyage des plages et leur remise en état, ainsi que les pertes économiques causées par les dommages à l'environnement.
Je sais que des associations d'environnement estiment que cette approche est trop restrictive et posent la question de savoir pourquoi le FIPOL ne veut pas indemniser des demandes relatives aux dommages à l'environnement calculées en fonction de méthodes théoriques où mathématiques. Il me semble que la question se pose plutôt en ces termes : jusqu'à quel point les gouvernements sont-ils prêts à faire peser un fardeau économique sur leur industrie pétrolière ? La question est donc bien politique !
Par ailleurs, si nous avions accepté ces demandes un peu théoriques, il en serait résulté une certaine concurrence par rapport aux demandeurs plus directement concernés et, également, une moindre protection pour d'autres demandeurs, à moins d'établir des priorités dans l'indemnisation. Si les gouvernements souhaitent tel ou tel changement, cela ne relève que d'un enjeu politique. Mais nous ne pouvons pas considérer des principes de fonctionnement et d'indemnisation différents dans le cadre actuel.
Il s'agit aussi de tenir compte du fait qu'un système international ne peut fonctionner que si les critères retenus font l'objet d'un consensus général. Si nous décidons de réviser une convention par un vote, alors que les marges sont très étroites en conférence diplomatique, il existe toujours le risque que les pays importants ne ratifient pas cette révision.
Mais les conventions actuelles sont la loi et le cadre dans lequel doit fonctionner le FIPOL, notamment le comité exécutif.
Vous avez également soulevé deux autres questions dont celle de l'action intentée en justice à la suite de précédents sinistres. Si un demandeur n'est pas satisfait de l'offre qui lui est faite, il a tout à fait le droit, et ce à juste titre, d'aller devant les tribunaux. Cela relève du contrôle juridictionnel des tribunaux du pays frappé par la marée noire. Tout demandeur dispose d'un délai de trois ans pour porter son action, mais il ne perd rien pour négocier. Si les négociations n'aboutissent pas, on peut consentir des acomptes et on peut soumettre aux tribunaux les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord.
Les demandes ne sont pas nécessairement rejetées ou acceptées totalement. Si un accord intervient sur huit points sur dix, nous pouvons régler ceux sur lesquels nous sommes d'accord et continuer à discuter, voire aller en justice pour ceux sur lesquels nous ne le sommes pas.
Au cours des vingt dernières années, sur quelque 100 sinistres survenus dans 25 pays, 93 d'entre eux, dont ceux du Tanio, de l'Amazzone et du Haven qui ont frappé la France, ont été indemnisés à l'amiable. S'agissant des autres sinistres, la majorité des demandes ont été réglées à l'amiable. Quelques actions ont été portées devant les tribunaux, mais il ne s'agit certainement pas de tous les demandeurs !
Vous vous interrogez sur les résultats des litiges en justice. Le FIPOL a-t-il gagné ou perdu ? Nous n'avons pas fait l'objet de beaucoup de jugements, mais dans le cas du Braer, par exemple, nous les avons tous gagnés. Nous avons rejeté un certain nombre de demandes qui ont été portées devant les tribunaux, lesquels les ont également rejetées sur tous les points. En réalité, les tribunaux écossais ont été beaucoup plus restrictifs dans leur raisonnement que le FIPOL. Certes, il nous arrive aussi de perdre. Mais après tout, ce n'est pas grave parce qu'il s'agit d'un contrôle juridictionnel qui met en _uvre le droit du demandeur. Nous ne prétendons nullement détenir toute la vérité dans tous les cas.
Vous avez aussi posé la question d'une augmentation du montant maximal du Fonds, proposition faite par le gouvernement britannique, qui sera traitée dans le cadre du comité juridique de l'OMI en octobre prochain. On entre là dans le champ politique. Or il n'appartient pas au secrétariat du FIPOL, donc aux fonctionnaires internationaux que nous sommes, de faire des commentaires sur les questions politiques qui relèvent après tout des compétences des gouvernements des Etats membres.
S'agissant de la révision des conventions qui ont été mises en _uvre voilà déjà un certain nombre d'années, il n'est pas surprenant que les gouvernements, à la lumière de l'expérience acquise au fil des années, s'inquiètent de savoir si le dispositif est vraiment à jour et s'il répond encore aux besoins de la société qui a bien changé en vingt-cinq ans.
Il ne revient cependant pas au FIPOL de savoir si le dispositif juridique international doit être amendé et, dans l'affirmative, sur quels points, ni même d'émettre un avis. Il appartient à chacun des gouvernements de considérer la question et, ensuite, de la soulever au niveau international. Je regrette, mais il ne m'appartient pas de faire des commentaires à ce sujet. Certes, j'ai mon avis personnel. Tous les problèmes tels que ceux afférents aux montants, au respect des prorata et au règlement des litiges, ne sont pas tous résolus aujourd'hui par les conventions. Nous en sommes tous conscients et nous qui les vivons le savons mieux que quiconque !
Seuls les gouvernements peuvent décider si les conventions doivent être modifiées et dans quelle mesure parce que toute modification constitue un exercice assez difficile. Quand vous voulez modifier une disposition au plan national, vous pouvez déposer un amendement à l'Assemblée nationale. Il vous faudra peut-être un certain temps pour obtenir cette modification, mais vous pouvez le faire si cet amendement exprime vraiment une volonté politique. Mais au plan international, il faut organiser des travaux préparatoires, tenir une conférence diplomatique et demander aux parlements nationaux de ratifier les modifications adoptées. Bref, la procédure n'est pas très rapide et votre gouvernement le sait très bien.
Je m'excuse d'avoir sans doute été un peu long, mais je tenais à vous donner un aperçu général de la philosophie et de la structure dans le cadre de laquelle nous devons travailler.
M. le Rapporteur : Je vous remercie infiniment de ces précisions, M. l'administrateur.
Avant de donner la parole à mes collègues pour vous poser éventuellement des questions, je me permets d'ouvrir le débat.
Suite à la catastrophe de l'Erika, nous nous posons la question de savoir si le montant maximum à disposition du Fonds - 1,2 milliard de francs - couvrira la dépense totale qui sera connue rapidement, d'ici à la fin de l'été, compte tenu notamment des risques majeurs encourus par l'hôtellerie. Telle est notre grande interrogation. Les engagements financiers, jusqu'à présent modérés, connaîtront une montée en puissance qui s'amplifiera, précisément, avec le manque à gagner de l'hôtellerie.
Si le montant total des préjudices n'excède pas 1,2 milliard de francs, il n'y aura pas de discussion, même si l'Etat ne peut pas y prétendre et je crois qu'il s'en fera une raison.
En revanche, s'il excède 1,2 milliard de francs, nous serons inévitablement dans une logique contentieuse : l'opinion publique n'acceptera pas que des manques à gagner du fait de préjudices dûment constatés soient à la charge de ceux qui ont subi les dommages liés à la pollution. Si l'on entre dans une logique de contentieux, comment et de quelle manière faire appel en justice contre l'une de vos décisions ou à l'égard de Total Fina, voire de l'Etat, selon les sensibilités et la qualité des avocats ?
Compte tenu aujourd'hui de cette grande incertitude, nous avons, si je puis dire, deux épées de Damoclès au-dessus de nos têtes : premièrement, va-t-on réussir à vider convenablement le contenu de fioul n° 2 restant dans les cuves de l'Erika ? Deuxièmement, le FIPOL pourra-t-il payer l'ensemble des dépenses induites par la pollution ? Voici, en substance, ma première interrogation de fond !
Un problème interne se pose également à nous. Les victimes, immédiatement recensées, devront attendre assez longtemps pour obtenir un dédommagement dans la mesure où vous insistez sur les pourcentages. Se pose donc un problème de transition. Je pense au monde de la petite hôtellerie qui vit sur les arrhes et qui, bien entendu, n'en a pas reçues, compte tenu des circonstances. S'il est normal que dans votre logique, vous attendiez de voir comment la situation évolue avant de donner suite aux demandes des intéressés, il est tout aussi normal que les victimes s'inquiètent. Nous sommes donc très interrogatifs sur ces problèmes de délais.
M. Måns JACOBSSON : Il est légalement impossible pour le FIPOL d'allouer plus de 1,2 milliard de francs d'indemnités. S'il y a d'autres responsabilités, il appartient aux tribunaux français d'en décider. Outre des questions de responsabilité légale, se posent également des questions de responsabilité morale. Mais dans le cadre de la répartition de ce montant de 1,2 milliard de francs, le gouvernement français et Total Fina se sont pour l'instant retirés. Si par exemple, le montant total des demandes approuvées s'élevait au bout du compte à 1,5 milliard de francs, sachant que seulement 1,2 milliard de francs est disponible, les demandeurs seraient indemnisés à 80 % par le FIPOL. En cas de responsabilités supplémentaires des autres personnes, il appartiendrait aux tribunaux français d'en décider.
J'insiste sur cette lacune du système : chaque fois qu'une somme limitée est disponible, il est difficile de faire indemniser les victimes rapidement. La question qui se pose est de savoir si les gouvernements seraient prêts, dans un cadre international, à s'engager dans un système de responsabilité illimitée. Jusqu'à présent, ils ne l'étaient pas !
Quant aux délais, j'espère que nous pourrons maintenant les accélérer, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Nous avons augmenté les effectifs d'experts et si telle est la solution, nous sommes tout à fait prêts à les accroître encore davantage. Il n'est pas question de faire des économies sur le plan monétaire, car il est aussi dans notre intérêt d'agir aussi rapidement que possible.
Nous comprenons parfaitement les craintes et les incertitudes que peuvent éprouver toutes les victimes, surtout actuellement dans le domaine de la pêche et, peut-être plus tard, dans celui du tourisme. Avec l'assureur, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour avancer aussi rapidement que possible.
M. le Rapporteur : Aujourd'hui, pour les pêcheurs à pied, par exemple, vous payez 100 % des préjudices estimés ?
M. Måns JACOBSSON : L'assureur paye 100 % dans des cas appropriés !
M. le Rapporteur : L'assureur, dites-vous ? Pour l'instant, les fonds mobilisés sont financés par l'assureur de l'Erika ?
M. Måns JACOBSSON : En vertu des conventions internationales sur la responsabilité civile, en l'occurrence celle du propriétaire du navire, il revient à l'assureur de payer jusqu'à sa limite avant que le FIPOL n'intervienne.
M. le Rapporteur : Comme je l'ai indiqué dernièrement à notre commission d'enquête, car des échos nous reviennent à nous qui sommes tous élus du littoral, si en fonction du 1,2 milliard de francs prévisible et des chiffres qu'il aura à sa disposition, le FIPOL annonce qu'il rembourse les dommages à 50 % de leur estimation par les demandeurs, alors que tout le monde s'attend aujourd'hui à être indemnisé à 100 % - ce qui sera d'ailleurs peut-être le cas -, ce sera la révolution ! Des incidents se sont déjà produits à Lorient et d'autres, bien plus importants, pourraient bien suivre.
Nous vous mettons en garde, comme nous avons mis en garde notre gouvernement, sur cette situation qui sera extrêmement sensible, surtout au cours de l'été prochain. L'opinion pense que le FIPOL paiera.
M. Måns JACOBSSON : Je comprends le problème et il est clair que les paiements effectués jusqu'à présent auprès des demandeurs sont provisoires.
Si toutefois, le montant total des demandes devait excéder 1,2 milliard de francs, nous n'aurions pas d'autres choix que de veiller à ce que tous les demandeurs soient traités sur un pied d'égalité. Je comprends bien les problèmes qui se posent, mais le FIPOL n'a pas légalement d'autre option.
Mme Jacqueline LAZARD : En premier lieu, je voudrais revenir sur ce problème de l'indemnisation. Vous venez de dire à l'instant que vous étiez tenu d'indemniser tout le monde sur un pied d'égalité. Pourtant, des premières indemnisations ont déjà été consenties. N'auriez-vous donc pas tendance à mettre la barre un peu bas, précisément pour ne pas être confrontés au risque d'une indemnisation provisoire plus élevée que l'indemnisation définitive ?
En second lieu, je souhaite obtenir une précision sur un point. Quand un demandeur n'est pas satisfait de l'indemnisation qu'il a reçue, peut-il éventuellement faire appel, auprès du FIPOL, avant d'en arriver à des procédures contentieuses ?
M. Måns JACOBSSON : Ma réponse à votre seconde question est affirmative. Si le demandeur n'est pas satisfait, il peut toujours invoquer les raisons pour lesquelles il considère que notre position est erronée. Il peut nous communiquer des informations supplémentaires. Nous sommes toujours prêts à réexaminer un dossier. Surtout s'il s'agit d'une question de principe, rejetée par moi ou l'un de mes collègues sous ma responsabilité, l'intéressé peut toujours demander au FIPOL qu'elle soit soumise au comité exécutif pour décision.
Je ne parle pas des montants qui sont des questions techniques. Je suis d'ailleurs certain que le gouvernement français veillera, comme l'a fait auparavant, par exemple, le gouvernement britannique, à ce que le comité exécutif soit bien saisi des questions de principe. Si le gouvernement français considère que l'administrateur ou son collègue a une position trop restrictive et que le comité exécutif estime que ma position est erronée, je l'accepte. Je n'ai certainement pas d'état d'âme à cet égard.
Je réponds également par l'affirmative à votre première question. L'assureur prend naturellement des risques. S'il paye maintenant 100 % et qu'au bout du compte, on n'aura à payer que 80 %, il aura payé au-delà de sa limite. C'est un risque que l'assureur court maintenant. Il est prêt à le faire pour permettre au système de fonctionner. En réalité, il se peut qu'en fin de compte, le prorata soit de 80 %, alors que le Club P&I a déjà payé 100 %. C'est un risque commercial que l'assureur est prêt à prendre pour aider ceux qui sont confrontés à des difficultés financières. Mais l'évaluation des pertes n'est pas faite différemment maintenant. Elle sera faite de la même manière pour constater les pertes réelles subies et reconnues.
M. René LEROUX : Ma question est très courte, M. Jacobsson, car vous avez apporté déjà beaucoup d'éléments de réponse aux questions que l'on se posait.
Pouvez-vous nous indiquer la répartition en pourcentage, par professions et par activités, des 2,5 millions de francs que vous avez déjà versés ? Pourriez-vous nous donner copie de ce document ?
M. Måns JACOBSSON : Tout à fait.
M. René LEROUX : Par ailleurs, vous dites que vous paierez les opérations de nettoyage des plages. Mais celles-ci sont aujourd'hui prises en charge intégralement par le plan POLMAR.
M. Måns JACOBSSON : En effet, mais le FIPOL y contribuera ensuite à condition qu'il reste de l'argent !
M. René LEROUX : Nous sommes donc bien d'accord.
Je vous remercie aussi d'avoir parlé des marais salants.
En outre, vous dites que le gouvernement français va abandonner sa créance, tout comme la compagnie Total Fina. En avez-vous confirmation ?
Je vous pose une autre question peut-être un peu « piège ». Les maires de Loire-Atlantique ont reçu jeudi dernier le Président de la République, M. Jacques Chirac. Ce dernier a annoncé qu'il allait demander que les fonds du FIPOL soient multipliés par six. Quel est votre avis sur le sujet ? Comment pourra-t-on y arriver ? Est-ce réaliste ou pas ?
Enfin, vous disposez d'un montant disponible de 1,2 milliard de francs. Si un autre naufrage, identique à celui de l'Erika se produisait demain matin, disposeriez-vous d'un autre fonds de 1,2 milliard de francs ?
M. Måns JACOBSSON : Tout à fait ! Il s'agit de 1,2 milliard de francs mis à disposition pour chaque sinistre.
M. Jean-Pierre DUFAU : En guise de boutade, pourquoi dans ces conditions, ne donnez-vous pas 2,4 milliards de francs pour l'Erika ?
M. Måns JACOBSSON : Parce que les gouvernements ne l'ont pas voulu ainsi !
M. Jean-Pierre DUFAU : Il s'agissait d'une boutade !
M. Måns JACOBSSON : Pour procéder à une augmentation du montant maximal disponible pour le FIPOL, deux possibilités sont offertes.
La première, plus rapide, est celle d'utiliser une procédure simplifiée qui peut, pour le moment, porter cette augmentation à 50 %. Cela peut se faire au mois d'octobre prochain, mais la décision se prenant à la majorité des membres, cela demande tout de même un certain temps.
La seconde, visant à obtenir une augmentation plus importante, suppose la tenue d'une conférence diplomatique et, ensuite, la ratification des modifications apportées à la convention par les parlements des Etats membres du Fonds. Cette procédure peut prendre du temps.
Si j'ai bien compris d'ailleurs, le gouvernement français et sans doute aussi le gouvernement britannique sont décidés à exploiter les deux possibilités. Ils souhaitent obtenir, dans une première étape, une augmentation immédiate, et ce à moyen terme, puis, dans une seconde étape, aller plus loin.
M. Jean-Pierre DUFAU : Comme le disait notre rapporteur, le problème est à considérer du point de vue de ceux qui ont subi un préjudice pour lequel ils n'ont aucune responsabilité et auquel ils n'ont donc pas à contribuer.
Lorsque l'évaluation globale sera faite et, comme toute estimation, elle sera peut-être sujette à caution, il importe que les victimes soient indemnisés par toutes les parties prenantes, au premier rang desquelles le FIPOL - qui aura une part essentielle -, mais aussi les assurances - que vous avez évoquées - et, éventuellement, d'autres fonds.
Il ne serait pas admissible - il s'agit du principe de base - que des victimes, étrangères à ces événements, puissent subir des préjudices et doivent y contribuer. Il faudra revenir fortement sur ce point.
La première précaution qui consiste déjà à augmenter rapidement la participation du FIPOL pour faire face aux cas d'urgence et à se lancer, ensuite, dans une instruction plus approfondie si malheureusement d'autres cas se présentaient, est absolument nécessaire. Mais le FIPOL n'est pas le seul concerné ! Les assureurs le sont également, ainsi que d'autres acteurs que vous avez cités.
Pour l'instant, on montre du doigt la responsabilité du propriétaire du navire, mais il va falloir, me semble-t-il, approfondir toutes ces questions de responsabilité et d'indemnisation.
M. Måns JACOBSSON : Sur proposition du gouvernement français, le FIPOL a constitué un nouveau groupe de travail intersessions qui va se réunir en juillet prochain pour étudier une gamme de problèmes. Nous invitons les gouvernements à proposer des sujets de discussion avant le 1er juin pour que je puisse établir une liste afin de mener à bien cet exercice.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Deux aspects doivent être pris en considération : d'une part, le traitement du cas Erika et, d'autre part, l'évolution pour l'avenir qui est assez clairement définie dans l'immédiat.
Nos amis britanniques ont réagi très vite, en proposant d'utiliser un dispositif existant dans la convention pour augmenter les plafonds, et ce par procédure d'amendement tacite. Je ne suis pas en mesure d'annoncer un chiffre, mais cette décision augmentera significativement le montant actuel et le doublera peut-être.
M. le Rapporteur : Cette disposition pourrait-elle s'appliquer dans le cas de l'Erika ?
M. Jean-Marc SCHINDLER : Je ne le pense pas dans la mesure où une telle modification n'est pas rétroactive. Pour être prise, cette décision nécessite une procédure d'amendement. Elle ne sera donc pas entrée en vigueur pour s'appliquer au cas de l'Erika. C'est la raison pour laquelle je faisais le distinguo entre le traitement du cas Erika dans le cadre de la convention existante et la préparation de l'avenir.
Outre cette action que je qualifierais de « rapide », il existe une action à long terme. Le Premier ministre a défini, parmi les priorités du gouvernement, celle visant plus particulièrement à porter les montants d'indemnisation du FIPOL à 1 milliard d'euros. Or cette décision, nous ne l'obtiendrons pas avec le système d'amendement automatique de la convention actuelle. Cela veut donc dire qu'il faut réfléchir à une modification de la convention.
La démarche est engagée. Nous avons demandé la constitution d'un groupe de travail. Nous n'allons pas nous contenter simplement d'obtenir une augmentation des montants. Nous allons aussi chercher, d'une part, à intégrer les dommages subis par l'environnement et, d'autre part, à mieux responsabiliser les opérateurs. Je parle de ceux qui ordonnent aux navires de transporter une cargaison d'un endroit à un autre. En effet, on doit inciter les chargeurs à recourir à des navires de meilleure qualité.
Tel est notre objectif, même si, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de décrire techniquement quelle en sera la forme.
Mme Jacqueline LAZARD : Dans ce cas-là, ne serait-il pas aussi possible d'envisager de mieux qualifier la notion d'actions « raisonnables » de lutte contre la pollution - seules couvertes par le Fonds - qui semble tout de même un peu floue.
M. Måns JACOBSSON : Il s'agit d'un critère technique objectif et non d'un critère politique. Prenons l'exemple de celui qui a dû prendre des mesures pour que soient réalisées des opérations de nettoyage. Il faut se mettre à sa place et considérer la connaissance qu'il avait de la situation au moment où il a dû prendre des décisions. Il ne s'agit pas de dire, six mois après, que cet homme est stupide parce qu'aucun résultat n'a été obtenu. Il faut se mettre dans la position de cet individu qui a dû prendre des décisions très tard le soir ou dans la nuit, alors qu'il ne disposait que de peu d'informations, tout en supposant qu'au fur et à mesure de l'évolution de ses connaissances techniques, il était prêt à réexaminer la situation.
Il faut aussi appliquer ce critère sous l'angle du raisonnable et autoriser une marge d'erreur à ceux qui doivent agir. Mais le fait qu'un gouvernement décide d'entreprendre diverses actions ne doit pas être considéré en soi comme étant nécessairement raisonnable !
D'autre part, ce n'est pas parce que l'opération s'avère être un échec qu'il faut nécessairement la rejeter. Il était peut-être raisonnable de la réaliser compte tenu des connaissances que l'on avait à ce moment-là, même si elle n'a pas réussi. Le raisonnable joue dans les deux sens. Il faut prendre en considération, non pas nécessairement le résultat, mais ce qui est considéré comme étant raisonnable et décidé à la lumière des connaissances du moment. Toutefois, je ne crois pas qu'il soit possible de définir ce qui est raisonnable. Il s'agit d'une notion un peu subjective.
M. le Rapporteur : Je vous remercie vivement d'avoir accepté de consacrer un peu de votre temps à cet entretien.
M. Måns JACOBSSON : Pour ma part, j'ai été très honoré de m'entretenir avec vous et je vous ferai parvenir une synthèse écrite la semaine prochaine.
Audition de MM. George GREENWOOD, chairman,
D.J.Lloyd WATKINS, secretary and executive officer,
of International Group of P & I Clubs,
MM. Ian C. WHITE, managing director,
et Clément LAVIGNE, biologiste,
of The International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF),
M. Chris HAVERS, director of P & I Clubs - West of London,
accompagnés de M. Jean-Marc SCHINDLER,
représentant permanent de la France auprès de l'OMI,
conseiller maritime de l'Ambassade de France en Grande-Bretagne
(extrait du procès-verbal de la séance du 12 avril 2000 à Londres)
Présidence de M. René LEROUX, Vice-président
M. George GREENWOOD : Avant d'engager notre entretien, je tiens à vous préciser que le 20 avril prochain, nous serons à Paris pour être auditionnés au Sénat. Par conséquent, si à l'issue de cet entretien vous souhaitiez nous rencontrer de nouveau, nous pourrions organiser une réunion à Paris la semaine prochaine.
Je souhaite tout d'abord vous présenter mes collègues : Lloyd Watkins, est président de l'International Group et Chris Havers, président du sous-comité sur la pollution maritime. Ian White, directeur de l'International Tanker Owners Pollution Federation, l'ITOPF, un organisme indépendant chargé d'assurer le contrôle des opérations de nettoyage à la suite de pollutions par les hydrocarbures, est accompagné de son collègue Clément Lavigne, un des experts de l'ITOPF.
Le groupe international des P & I Clubs et le Fonds, ainsi que d'autres instances gouvernementales de par le monde, s'adressent à l'ITOPF. Nous avons recours à son avis pour ce qui concerne les opérations de nettoyage et les créances générées à cet égard ainsi que tous les plans d'urgence relatifs à la pollution et les questions techniques liées à la pollution par les hydrocarbures.
Treize P & I Clubs sont regroupés au sein du groupe international afin de mutualiser les risques entre eux. Chaque Club fournit une partie de la réassurance pour les autres Clubs. Il s'agit donc d'une mise en commun de nos responsabilités. Nous sommes assureurs mutuels des navires acquis et administrés par les propriétaires. Nous avons également une mutuelle de Clubs, une sorte de coopérative des coopératives, qui assure la réassurance. Dans le cas de créances au titre de la pollution par les hydrocarbures, les montants sont élevés.
Compte tenu du temps dont nous disposons, il me semble préférable de vous faire parvenir par écrit des renseignements détaillés sur les Clubs. Le document qui vous a été remis vous donne d'ailleurs des informations générales nous concernant.
Puisque j'évoquais à l'instant la question de la réassurance, je me propose de répondre à la première de vos questions écrites qui nous ont été préalablement communiquées. Elle concerne précisément notre système de réassurance.
Comme je l'ai indiqué, nous procédons essentiellement par une mise en commun de la réassurance au sein du groupe international. Tous les risques encourus par chaque Club sont donc partagés au sein du pool, et ce au-delà de 5 millions de dollars. La limite supérieure de couverture fournie par le groupe dans ce système de mise en commun est de l'ordre de 4,25 milliards de dollars. Il serait tout à fait impossible à chaque Club d'offrir un niveau de couverture aussi élevé sans ce système de mise en commun : bien évidemment, aucun des Clubs n'est, à titre individuel, suffisamment solide financièrement pour le garantir. En mettant en commun 90 % des actifs des propriétaires de navires, nous pouvons offrir un système de réassurance de très haut niveau.
Dans le cas un peu particulier que constituent les dommages causés par la pollution par les hydrocarbures, nous limitons la couverture à un niveau inférieur, lequel a progressivement augmenté au fil des années. Il s'élève actuellement à 1 milliard de dollars. La couverture offerte par les Clubs à titre individuel est donc limitée à 1 milliard de dollars pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures et à un peu plus de 4 milliards de dollars au titre de la couverture générale.
Grâce à cette mise en commun, notre système de réassurance maritime est le plus important au monde. Nous plaçons nos contrats un peu partout dans le monde. Le système de réassurance par cette mise en commun démarre à 30 millions de dollars et s'élève jusqu'à 1 milliard de dollars pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures.
Les Clubs comptent beaucoup sur ces contrats de réassurance pour absorber et encaisser les pics et dépressions liés aux très importantes demandes. Nous n'en avons que quelques-unes par an, mais sans réassurance, notre mise en commun financière devrait s'adapter aux variations de demandes. Dans une certaine mesure, nous dépendons donc de la capacité du marché mondial à fournir la réassurance requise. Le montant de la couverture que nous pouvons offrir est déterminé, dans une certaine mesure, par le montant de la couverture disponible sur les marchés de la réassurance mondiale.
Or ce montant varie. Les marchés commerciaux connaissent une période « douce », c'est-à-dire que le montant de couverture disponible est important et que les taux sont relativement faibles. Nous avons donc été en mesure, récemment, d'acheter davantage de réassurance pour les cas de dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures que par le passé, et ce à des coûts relativement économiques. Une des raisons de ce phénomène est le contexte assez favorable des préjudices constatés au titre des dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures. Bien entendu, le sinistre de l'Erika fait exception à cela.
D'une manière générale, la performance ayant été assez bonne récemment, l'appréciation du risque par les réassureurs est moins importante que ce qu'elle serait dans d'autres circonstances. Dans leur analyse du risque, les assureurs - les underwriters - prennent en considération les dispositions de la convention CLC lorsqu'il leur faut examiner le montant du risque de par le monde, pour nous offrir une réassurance - et par notre biais, à nos membres - afin de couvrir les dommages résultant de ce type de pollution.
Le montant et le coût de la couverture que nous pouvons acheter sont donc en partie déterminés par l'existence de la convention CLC. En effet, les limites prévues par celle-ci fixent un plafond pour les créances qui pourront être ensuite honorées au titre des dommages imputables aux pollutions par hydrocarbures. S'il n'y avait pas de limite pour les propriétaires de navires en ce qui concerne leur responsabilité au titre des dommages liés à la pollution, l'appréciation du risque et le risque encouru par les underwriters seraient beaucoup plus élevés. Par conséquent, leur intérêt pour ce type de risque en serait réduit.
Si les underwriters estiment que le risque est relativement réduit, vous pouvez acheter davantage de couverture que s'ils considèrent que le risque est très élevé. Cela vous paraît peut-être quelque peu paradoxal mais en fait, plus le risque est grand, moins les underwriters souhaitent fournir une couverture. Lorsqu'il s'agit pour nous d'acheter une couverture de réassurance sur le marché, surtout au titre de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, il est très important que les underwriters sachent que la convention CLC sur la responsabilité civile est en place.
Par le passé, nous ne pouvions pas acheter les montants de réassurance que nous pouvons acheter aujourd'hui. En fait, la performance des propriétaires de navires s'est améliorée dans ce domaine, si bien que la situation est pour nous plus favorable : nous pouvons acheter des montants supérieurs de réassurance. Lorsque les assureurs nous vendent ce niveau très élevé de réassurance, ils partent du principe que nous ne leur soumettrons pas de demandes pour réparation. Un assureur qui offre une limite très élevée ne prévoit pas de devoir apporter des fonds à hauteur de cette limite. S'il prévoyait ce cas de figure, il ne vendrait pas ce montant de réassurance ou il nous le proposerait à un coût tellement élevé que nous risquerions de ne pas pouvoir le financer.
Dans ce système de réassurance, n'oublions pas que la possibilité qui nous est offerte d'acheter de la réassurance pour les dommages dus à la pollution jusqu'à concurrence d'un montant de 1 milliard de dollars est fondée sur une appréciation « historique » du risque par les assureurs souscripteurs, qui pensent que le système actuel, mis en _uvre par la convention CLC, restera en place.
Cette considération a des incidences sur les autres questions dont vous nous avez saisis. En termes très simplifiés, si l'assureur souscripteur pensait que le propriétaire ne pourrait pas limiter sa responsabilité au titre de la convention CLC, ou s'il pensait que les catégories de préjudices qu'il doit couvrir au titre de la convention CLC allaient fortement s'élargir, son appréciation du risque changerait : la disponibilité de la couverture d'assurance serait remise en cause, étant entendu que le prix changerait également de manière extrêmement radicale. Cette donnée ne dépend nullement du contrôle des P & I Clubs. Il s'agit d'un phénomène mondial, si je puis dire.
Si nous pouvons acheter ces volumes de réassurance, c'est parce que nous sommes des acteurs importants qui représentent 90 % des intervenants du secteur. C'est aussi pourquoi nous pouvons avoir accès à des niveaux supérieurs et à des prix inférieurs à ceux qui pourraient être obtenus par d'autres.
Compte tenu de notre capacité à acheter de la réassurance, vous pourriez vous dire a priori que si les Clubs peuvent offrir une couverture de 1 milliard de dollars, ils devraient donc pouvoir financer les demandes jusqu'à concurrence de ce montant. En fait, c'est plus compliqué ! Si nous nous attendions à ce que de telles demandes nous soient adressées régulièrement, nous n'aurions pas la couverture dont nous disposons actuellement. C'est un phénomène commercial. Imaginez la réaction des assureurs souscripteurs s'ils pensaient que la situation devait se concrétiser !
Vous pourriez me rétorquer : « Pourquoi offrez-vous alors cette couverture ? » Je vous répondrais que c'est en partie parce qu'un tel système constitue en quelque sorte une solution de sécurité pour l'industrie. Il faut que le propriétaire du navire sache que, au cas où, la couverture existe. On ne part pas du principe qu'elle sera utilisée, mais c'est une hypothèse : elle existe « au cas où » !
Par ailleurs, les affréteurs savent, aux termes des clauses de leur charte-partie
- cette dernière est en rapport avec une législation mise en place en Californie qui impose une couverture d'un certain niveau pour opérer -, que les propriétaires peuvent fournir ce niveau de couverture. Nous donnons donc aux propriétaires la possibilité d'opérer en partant du principe qu'ils n'auront pas besoin de faire appel à ce nous pouvons leur offrir. Ils peuvent y faire appel une fois, mais il est bien évident que ces montants ne seraient pas disponibles en continu.
Tel est, en fait, le paradoxe commercial du niveau de couverture que nous pouvons offrir actuellement.
Auriez-vous des questions à nous poser sur cet aspect très précis ?
M. le Rapporteur : Puisque vous garantissez la responsabilité civile de l'armateur, la question qui nous intéresse plus particulièrement est de savoir quelles sont vos relations avec les sociétés de l'assurance corps des navires qui couvrent la coque et les machines, et avec celles qui assurent la marchandise. Existe-t-il des relations particulières entre ces « deux mondes » ou la séparation est-elle totale entre les acteurs ?
M. George GREENWOOD : Oui, il s'agit bien de mondes totalement différents. Il y a plutôt des assureurs souscripteurs qui essaient de faire des bénéfices que des assureurs mutualistes. En fait, nombreux sont les assureurs souscripteurs qui, sur tous les marchés du monde, s'intéressent à l'assurance corps et facultés. Certains de ces assureurs souscripteurs assurent également la réassurance. Nous avons donc des liens avec certains d'entre eux.
S'instaure une sorte de compétition entre nous et les assureurs de la marchandise puisqu'ils assurent la cargaison des navires que nous assurons. L'assureur facultés engage donc parfois des poursuites à l'encontre de nos propriétaires de navires, d'où cette situation de confrontation, voire d'opposition, dans laquelle nous nous trouvons avec eux.
En revanche, nous entretenons des relations amicales avec le marché de l'assurance corps, notamment à Londres, dans la mesure où il s'intéresse au navire et nous aussi. Notre démarche est différente à l'égard de ces assureurs. Nous n'avons cependant pas beaucoup de contacts avec eux et nous n'agissons pas de concert, sauf pour des cas isolés.
La façon dont nous organisons nos membres est assez différente de celle dont les assureurs souscripteurs de corps réagissent. Nous pouvons créer des politiques communes que l'assureur souscripteur de corps ne serait pas en mesure d'appliquer sur son marché, même si les politiques en question le séduisaient. Nous, nous ne sommes que 13 organisations. Si nos membres décident d'adopter une certaine pratique, c'est possible. Les 13 organisations sont toutes liées par des contrats de réassurance. Nous partageons et nous assumons les risques les unes des autres. D'un certain point de vue, nous sommes une organisation unique. Si nous prenons la décision de ne pas couvrir un risque parce que nous nous réassurons mutuellement, cette décision commune vaut pour tout le monde.
En revanche, sur le marché commercial, chaque compagnie d'assurance individuelle agit dans son propre intérêt et dans celui de ses actionnaires : elle essaye de faire des bénéfices. Par conséquent, même si elle a de la sympathie pour certains objectifs, elle n'est pas en mesure d'adopter une politique aussi cohérente. Je ne porte pas de jugement de valeur. Je constate simplement que ce marché a un comportement différent pour les raisons que je viens d'expliciter.
Nous avons également signé la charte sur la sécurité en mer. Nous rencontrons des représentants du secteur de l'industrie maritime et nous parlons de toutes ces questions, mais nous ne travaillons pas de concert sur ces questions de politique à suivre ou à adopter. Bien souvent, la personne qui assure la marchandise est la même compagnie qui assure le corps, c'est-à-dire la coque, d'où ces conflits d'intérêt qui compliquent beaucoup les choses.
En ce qui concerne la sécurité des navires, là encore notre position est relativement différente de celle des sociétés d'assurance parce que nos propriétaires de navires sont directement concernés par l'existence et le respect de certaines normes. Ils peuvent donc utiliser notre système. Par exemple, s'agissant des sociétés de classification, nous avons des règles communes. Du fait du sinistre de l'Erika, nous les réexaminons actuellement et nous les renforçons. Nous pouvons le faire d'une manière beaucoup plus cohérente que le marché commercial qui est éparpillé de par le monde. Des milliers d'intervenants sont concernés sur le marché commercial.
M. le Rapporteur : Vous avez des règles communes aux 13 clubs P & I à l'égard des sociétés de classification, dites-vous ?
M. George GREENWOOD : Oui.
M. le Rapporteur : Vous nous dites qu'à la suite du sinistre de l'Erika, vous allez réexaminer vos règles communes. Pourriez-vous nous préciser quelles sont ces règles communes ? Pourquoi voulez-vous les modifier ou les renforcer ?
M. George GREENWOOD : Je devrais d'abord dire que nous ne sommes pas parvenus à une décision définitive en la matière. Mais dans une perspective historique, si je puis dire, nous avions, nous et les assureurs du corps, des règlements et des clauses qui obligeaient tous les navires que nous assurons à être classés par une société de classification reconnue.
M. le Rapporteur : Reconnue par l'IACS ?
M. George GREENWOOD : Nous ne spécifions pas que la société de classification doit être membre de l'IACS. Comme vous le savez, quasiment 90 % des navires de par le monde sont classés par des sociétés de classification membres de l'IACS. Mais dans certaines situations, des tonnages locaux contrôlés par les gouvernements ne font pas l'objet d'un classement par une société de classification, qu'elle soit ou non membre de l'IACS. D'une manière générale, tout notre tonnage est classé par des sociétés de classification membres de l'IACS étant donné qu'elles sont approuvées. Il arrive toutefois que des sociétés de classification membres de l'IACS ne soient pas approuvées par un Club individuel.
Bref, nous avons cette règle commune. En 1991, nous l'avons renforcée parce que, comme vous le savez, les sociétés de classification ont fait l'objet de certaines critiques. Nous avons donc décidé d'adopter une règle un peu plus stricte. Aujourd'hui, nous procédons à nouveau à un examen pour voir si des modifications s'imposent en vue de la rendre encore plus rigoureuse et stricte.
Nous ne tendons pas nécessairement à critiquer les sociétés de classification en tant que telles, mais nous souhaiterions tirer davantage parti du système en le rendant plus strict, afin que nous puissions contrôler nous-mêmes notre tonnage de manière plus efficace.
Bien entendu, nous comptons sur les sociétés de classification en ce qui concerne les aspects techniques des navires que nous assurons. Il ne s'agit que d'un exemple, car dans nombre de cas, nous avons des règles communes. Si vous examinez les règlements du Club dont Chris Havers est directeur ou les règlements de mon Club, vous constaterez qu'ils sont quasiment identiques parce que nous partageons les risques. En revanche, je ne partagerais pas ses risques si ses conditions d'assurance offertes étaient beaucoup moins strictes et beaucoup moins exigeantes que les miennes. Nous pensons que, de la sorte, nous parvenons à faire beaucoup plus dans le domaine de la sécurité que le marché de l'assurance corps.
Cela étant dit, il est vrai que nous avons assuré l'Erika. Mais le fait que nous examinions actuellement ces règles de classification n'a pas de rapport direct avec ce sinistre. En revanche, comme tout le monde, nous devons réfléchir aux problèmes qui ont été soulevés. La communauté européenne, elle-même, examine ces problèmes de classification. Nous nous posons donc la question de savoir comment contribuer à ce processus. Il s'agit simplement d'adopter une attitude responsable !
M. Lloyd WATKINS : Permettez-moi d'ajouter une réflexion à titre d'exemple concret. Compte tenu de cette mise en commun, tous les Clubs sont conscients de cette nécessité pour eux d'agir de concert. Une des conditions de couverture est liée au respect du code ISM par tous les navires. Or le marché de l'assurance corps n'en a pas la possibilité parce qu'il n'a pas cette cohérence à laquelle nous sommes parvenus par cette mise en commun.
Toujours à titre d'exemple, nous sommes en mesure de fournir des données sur nos membres au système EQUASIS, ce qui sera très utile dans l'avenir me semble-t-il. Or le marché de l'assurance corps n'en a pas non plus la possibilité. Il s'agit d'un marché très fragmenté. Si les marchés français et britannique se disciplinaient, les intéressés pourraient aller chercher une couverture ailleurs ! Mais cela ne vaut pas pour la couverture des Clubs P & I. Nous pouvons tirer parti de notre cohérence pour relever les normes.
M. le Rapporteur : Comment allez-vous agir pour relever les normes ? Allez-vous rencontrer les sociétés de classification pour leur dire que vous relèverez les normes de telle ou telle manière ? Quels types de normes allez-vous relever ? Vous attacherez-vous au nombre d'inspecteurs que compte chaque société de classification, à la qualité de ces derniers, à la qualité des classifications antérieures ou au fait qu'aucun des navires classés par elles n'a eu de sinistre ?
Sur quels critères allez-vous vous fonder pour relever les normes d'acceptabilité des sociétés de classification ?
M. George GREENWOOD : En fait, nous ne nous concentrons pas sur la possibilité que nous aurions de faire des suggestions pour relever les normes des sociétés de classification. Nous sommes en contact avec ces dernières. Nous allons précisément rencontrer celles qui sont membres de l'IACS le 5 mai prochain, dans le cadre d'un groupe de rencontre industriel créé par l'IACS, afin d'examiner leur attitude et leur comportement après le sinistre de l'Erika.
Comme vous le savez, l'IACS a élaboré un document qui contient un certain nombre de suggestions quant à ce qui devrait être envisagé. Certaines sont excellentes. Nous essayerons donc d'appuyer les propositions qui nous paraîtront valables.
Nos règles se concentrent davantage sur la transparence de l'information entre les sociétés de classification et nous-mêmes parce que, nous, nous dépendons de ces dernières pour ce qui est de l'aspect technique des navires. Bien que notre règlement nous autorise à avoir accès à des informations émanant des sociétés de classification, nous pensons qu'il faudrait peut-être renforcer ce lien pour qu'il devienne encore plus transparent. Il faut que nous demandions aux sociétés de classification de nous fournir des informations. Du moins, c'est ainsi que les choses sont prévues. Nous envisageons donc d'obliger les sociétés de classification à nous fournir certaines informations, sans que nous ayons à les solliciter.
En effet, si nous pouvions obtenir des informations avant qu'une situation qui ne nous satisferait pas ne se concrétise, nous pourrions ainsi anticiper les problèmes. Il est peut-être très intéressant de pouvoir poser des questions ou de demander des informations après un sinistre, mais cela n'empêche pas l'accident de se produire. C'est pourquoi nous pensons devoir nous concentrer sur ce point. Par exemple, nous essayons de voir s'il ne nous serait pas possible de demander que nous soit communiquée toute information relative à un transfert de classe d'un navire d'une société de classification à une autre avant même que ce transfert soit opéré. Nous aurions ainsi un rôle plus actif dans le processus.
Il s'agit non pas d'usurper ou de remplacer les sociétés de classification, mais plutôt de participer davantage à leurs activités, d'en apprendre plus sur les navires que nous assurons, de donner une certaine valeur ajoutée au processus. N'oubliez pas que nous assurons des dizaines de milliers de navires au sein de notre groupe international ! D'un point de vue pratique, il s'agit donc d'un problème considérable. Certains estimeront peut-être que cette démarche suppose l'échange d'un tel volume de documents écrits qu'elle sera impraticable. Mais nous y réfléchissons !
En ce qui concerne les normes des sociétés de classification, nous essaierons de les encourager à entamer ce processus, mais nous ne pouvons pas le faire par le biais de notre réglementation propre.
Sans doute ai-je déjà trop parlé ! Des experts à mes côtés connaissent beaucoup mieux que moi la question de la convention CLC et du FIPOL qui nous a été soumise dans le questionnaire que vous nous avez adressé. Peut-être souhaitez-vous approfondir cette question et entendre nos experts à ce sujet ?
M. le Rapporteur : Nous les entendrons avec plaisir, mais je crains que nous soyons pris par le temps.
Mme Jacqueline LAZARD : Parmi les questions qui vous ont été posées, la réponse sur l'une d'entre elles nous intéresse plus particulièrement : quelle est votre position au regard des propositions de la France visant à augmenter les plafonds d'indemnisation des conventions CLC et FIPOL ?
Par ailleurs, quelles ont été vos relations avec le FIPOL dans le cas de précédents sinistres ?
M. Chris HAVERS : Les Clubs P & I ont un protocole d'accord avec le FIPOL qui les autorise à coopérer dans le traitement des demandes, ce qui suppose généralement de créer un bureau, de mettre en commun l'expertise technique et d'échanger des informations sur la recevabilité des demandes d'indemnisation. Nous avons donc des contacts étroits avec le Fonds pour ce qui concerne tant les demandes d'indemnisation que les questions de principe.
M. George GREENWOOD : En ce qui concerne le relèvement des plafonds, nous y sommes favorables dans les limites du système tel qu'il existe actuellement. Je suis certain que M. Jacobsson vous a fait part des paramètres qui, dans le protocole, autorisent une augmentation automatique des limites des plafonds.
A notre tour, nous souhaiterions vous poser une question qui nous préoccupe.
Si j'ai bien compris, le processus visant à modifier les limites du Fonds est en cours et la procédure est ou va être engagée. Toutefois, une telle modification ne devrait pas intervenir du jour au lendemain, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de trois ans, ce qui est, semble-t-il, le délai requis. Vous devrez obtenir l'accord de nombreux gouvernements pour y parvenir. De plus, des délais spécifiques sont également prévus dans la convention, dont une première période de dix-huit mois. Ian White serait plus habilité que moi pour en parler.
Bref, nous nous demandons si cette période de trois ans préoccupe beaucoup le gouvernement français parce que, après tout, dans ce laps de temps, une autre demande à titre de réparation pourrait intervenir. Cette question vous préoccupe-t-elle ?
M. le Rapporteur : Nous ne représentons pas le gouvernement français, mais nous pouvons vous faire part de ce que nous pensons à ce sujet.
Notre inquiétude n'est pas levée par la décision ou le souhait du gouvernement français d'augmenter les plafonds. Elle porte sur la capacité pour le FIPOL et la convention CLC à couvrir le préjudice réel de la catastrophe de l'Erika. Or nous pensons que le montant de 1,2 milliard de francs ne suffira pas à le couvrir, même si la compagnie Total Fina se retire et même si l'Etat français abandonne son droit à recouvrement de ses créances. Le préjudice touristique en particulier - je ne parle pas du préjudice environnemental - sera extrêmement important.
Citons l'exemple d'un département, celui de la Vendée. De mémoire, le chiffre d'affaires touristique, y est de l'ordre de 10 milliards de francs. Il suffit donc d'une baisse de l'activité touristique de 10 % pour qu'un département, quasiment à lui seul, épuise complètement le Fonds FIPOL. Or quatre départements sont touchés presque dans les mêmes conditions, d'où notre inquiétude. Evidemment, cela milite en faveur de l'augmentation du plafond, mais étant donné qu'il n'y a pas d'effet rétroactif, la question reste posée.
M. Jean-Marc SCHINDLER : Sur cette question, nous sommes effectivement confrontés au fonctionnement d'un système existant. Nous avons donc à faire face à la situation avec les dispositifs actuellement en vigueur. Comme l'a dit M. le rapporteur, il apparaît très clairement, aux yeux du gouvernement français, que les plafonds du Fonds n'ont plus de commune mesure avec la réalité ou la potentialité des dommages. Par conséquent, il faut impérativement faire quelque chose.
Pour cela, il existe deux moyens et le gouvernement français souhaite les utiliser tous les deux.
En premier lieu, il s'agit d'utiliser un moyen existant, celui des mécanismes de la convention FIPOL et plus particulièrement son article 33, pour essayer de porter le niveau des plafonds du Fonds au maximum possible. Mais nous savons déjà ou nous considérons d'ores et déjà que ce ne sera pas suffisant. Le gouvernement français a donc engagé une démarche qui sera entreprise, d'abord, au sein du FIPOL et, ensuite, auprès de l'OMI. Il a commencé à réfléchir à une modification ou à une renégociation de la convention FIPOL pour parvenir à une augmentation significative des niveaux qui a été, a priori, fixée par le Premier ministre français à 1 milliard d'euros, c'est-à-dire à environ 6,5 milliards de francs.
Par ailleurs, le gouvernement français poursuit deux autres objectifs. Il s'agit de voir s'il serait possible, premièrement, d'inclure les dommages à l'environnement et, deuxièmement, d'introduire des moyens permettant de mieux responsabiliser les affréteurs.
Telles sont les idées ou pistes de réflexion. Ces deux dernières pistes, en particulier, n'ont fait l'objet d'aucune proposition parce que l'on se rend parfaitement compte de la complexité du problème. Mais nous estimons que le débat doit avoir lieu et qu'il s'agit de rechercher des solutions.
Nous serions intéressés de connaître votre propre sentiment en tant qu'experts sur cette démarche. Je conçois qu'il soit un peu difficile pour vous de vous exprimer ex abrupto. Si vous le souhaitez, cette question peut être vue dans un deuxième temps ou faire l'objet d'une intervention écrite.
M. le Rapporteur : Je crains qu'il soit difficile d'en débattre en quelques mots. Vous pourriez nous faire parvenir une intervention écrite ou nous pourrions nous en entretenir à Paris la semaine prochaine.
M. George GREENWOOD : Bien entendu, nous sommes prêts à aborder cette question, mais je crains effectivement que nous n'en ayons pas le temps.
Etant donné que nous devons être à Paris le jeudi 20 avril prochain au matin, peut-être pourrions-nous envisager d'arriver la veille, le mercredi 19, et mettre à profit ce déplacement pour évoquer ces questions très importantes.
Je suggère, pour terminer cet entretien, que Ian White qui est sans doute la personne la plus experte au monde dans ce domaine revienne sur la question des dommages et de l'évolution des différents cas du premier jour jusqu'à celui où la demande est vraiment satisfaite.
M. Ian WHITE : Il est très difficile d'aborder une question aussi complexe que les dommages environnementaux dans un laps de temps très court. Mais comme M. Greenwood vient de le rappeler, nous sommes un groupe technique. M. Lavigne et moi-même, nous sommes des biologistes spécialisés dans les questions marines. Je me suis beaucoup occupé des dommages résultant des sinistres de l'Amoco-Cadiz, du Tanio, du Gino, ainsi que de bien d'autres cas similaires en France et ailleurs.
Cette question des dommages environnementaux est extrêmement délicate. Vous le savez, au titre de la convention CLC et de la convention portant création du Fonds, les mesures de réhabilitation sont indemnisables. Bien souvent, il n'est pas nécessaire d'entreprendre de nombreuses actions pour une remise en état des sites. Par conséquent, le débat porte non pas tant sur la réhabilitation de l'environnement que sur une indemnisation monétaire pour la période de remise en état.
Ce concept a été particulièrement développé aux Etats-Unis. Mais à la vérité, cette question devient moins scientifique. Il s'agit davantage d'un calcul artificiel consistant à évaluer le dommage subi pendant la période au cours de laquelle l'environnement reprend le dessus. C'est-à-dire à une époque où nous ne pouvons pas faire grand-chose pour accélérer ce processus de restauration.
A cet égard, vous pouvez toujours produire n'importe quel chiffre ! Contrairement à la demande d'un pêcheur ou d'un hôtelier qui peut être chiffrée parce que vous avez là une ressource qui a une valeur, il n'y a rien de très scientifique dans l'évaluation d'un dommage écologique.
Nous sommes tous des environnementalistes, mais un oiseau de mer n'a pas de valeur en francs. Il faut donc faire un calcul et nous avons constaté, dans les cas américains, que l'on parvenait à des chiffres absolument considérables. Or, les fonds libérés sont souvent destinés à des fins tout à fait différentes de la réhabilitation de l'environnement dans son état initial. Bien souvent, il s'agit donc beaucoup plus d'une pénalisation économique que d'une avancée concrète pour l'environnement touché.
Je serais très heureux d'en parler plus en détail parce que cette question a de multiples facettes. Aux Etats-Unis, nous avons constaté que le coût de l'évaluation scientifique, outre les frais de réhabilitation, est en général extrêmement élevé. Lorsque vous commencez à payer de telles sommes au titre de dommages environnementaux, se pose alors la question des limites et des sommes disponibles pour les victimes ayant véritablement subi un préjudice économique. Bien souvent, ces dommages environnementaux entrent en conflit avec les créances des pêcheurs ou des acteurs de l'industrie hôtelière ou touristique.
M. le Rapporteur : Parce que le plafond est bas ?
M. Ian WHITE : La situation est la même si le plafond est très élevé car il s'agit de dommages calculés et non pas de dommages réels. Comme vous l'avez dit vous-même, vous connaissez le montant maximum de la créance d'un pêcheur ou d'un hôtelier parce que vous savez ce que vaut cette ressource. Mais pour l'environnement, n'importe quel chiffre serait applicable !
M. le Rapporteur : Dans le domaine de l'hôtellerie, la situation dans le nord de la Bretagne est exactement la même que celle du sud de la Bretagne, alors que le nord n'a pas subi de pollution. Le chiffre d'affaires est pour l'instant en baisse très sensible, mais il est vrai que nous ne sommes qu'en avril. En tout cas, cela se traduit par un déficit global d'image. Je sais bien que ce paramètre ne se chiffre pas et ne se démontre pas, mais il n'est pas négligeable dans le monde actuel.
M. Ian WHITE : D'accord, mais il est tout de même plus facile de le chiffrer que les dommages environnementaux. Les hôtels peuvent donner des chiffres, prouver qu'ils ont subi une perte par rapport à l'année précédente et présenter des lettres de clients ayant annulé leur réservation. Il s'agit là d'une différence fondamentale ! Dans ce cas précis, vous pouvez véritablement calculer la valeur financière de la perte, tandis qu'au titre de l'environnement, la valeur chiffrée que vous calculerez sera automatiquement artificielle. Même si nous sommes tous favorables à une remise en état de l'environnement, en vérité, il y a une limite à ce que vous pouvez faire. C'est triste, mais c'est ainsi !
M. George GREENWOOD : Cette question est très sérieuse et je ne voudrais pas donner l'impression de ne pas la considérer comme telle. Mais nous avons constaté qu'aux Etats-Unis, les demandes pour dégâts environnementaux suscitent beaucoup de litiges. Il faut notamment faire appel à des experts chargés de faire des évaluations. Bref, beaucoup de fonds servent à financer des opérations qui n'ont rien à voir avec ceux qui ont subi des dommages.
De surcroît, cela a conduit à des résultats souvent tout à fait extraordinaires. Des systèmes ont même été créés pour attribuer une valeur à certains animaux. Les chiffres sont peut-être faux - Ian White les connaît peut-être mieux que moi ? - mais citons l'exemple des loutres, une espèce que l'on ne trouve en l'occurrence qu'en Alaska et qui est certainement un très bel animal. Bref, pour différentes raisons que je ne connais pas, les loutres de mer se sont vues attribuer une valeur de 80 000 dollars à la suite du sinistre de l'Exxon Valdez.
M. le Rapporteur : Pour l'ensemble des loutres ?
M. Clément LAVIGNE : Par animal !
M. le Rapporteur : En nous référant au modèle américain, dès demain matin, nous nous occuperons des oiseaux ! (Sourires.)
M. George GREENWOOD : Ne prenez pas cette question à la légère ! Ces coûts encourus absorbent de l'argent qui devrait, en fait, revenir à ce que nous considérons comme des demandes légitimes.
En fait, les loutres de mer qui avaient été introduites dans la mer se faisaient dévorer par les requins. Il s'agit non pas d'une plaisanterie, mais d'un réel gâchis d'argent. Cela tient de la chimère ! Les fonds libérés doivent servir à dédommager ceux qui ont véritablement subi un préjudice, tels les pêcheurs et les hôteliers, d'autant que le système existant couvre bien les préjudices réels.
M. le Président : De quel montant serait indemnisé aujourd'hui, pour une loutre, le maire d'une commune qui vit au quotidien ces problèmes de pollution ? (Sourires.)
M. George GREENWOOD : Pour chaque loutre ?
M. le Président : Oui.
M. George GREENWOOD : D'un chiffre très élevé, vu la valeur qui serait attribuée à chaque animal !
M. le Rapporteur : Nous sommes désolés de mettre fin précipitamment à cet entretien, mais nous devons impérativement vous quitter, en vous remerciant de votre contribution.
M. George GREENWOOD : Etant nous-mêmes tenus par le temps, nous comprenons !
M. le Président : Messieurs, je vous remercie.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être validée par les intervenants.
Audition de M. Loïc LAISNE,
administrateur des affaires maritimes,
directeur du CROSS Corsen,
en présence du vice-amiral d'escadre Yves NAQUET-RADIGUET,
préfet maritime de la région Atlantique
et du commissaire général Yves MERLE
(extrait du procès-verbal du déplacement à Brest, le 14 avril 2000)
MM. Loïc Laisne, Yves Merle et Yves Naquet-Radiguet sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées.
M. Loïc LAISNE : Les CROSS, organisation gérée par la direction des Affaires maritimes et des gens de mer, appartiennent au réseau international des centres de coordination de sauvetage maritime.
Ils sont au nombre de 5 en métropole : le CROSS Gris-Nez, le CROSS Jobourg, le CROSS Corsen, le CROSS Atlantique situé à Etel et le CROSS Méditerranée situé à La Garde. Par ailleurs, 2 centres opérationnels de sauvetage maritime sont implantés outre-mer : le COSMA à Fort-de-France pour la zone des Antilles et le COSRU au port des Galets, à La Réunion pour la zone étendue de l'océan Indien.
Sous l'autorité opérationnelle du préfet maritime, les CROSS assurent la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer, la surveillance de la navigation dans le cadre des dispositifs de séparation de trafic d'Ouessant, des Casquets et du Pas de Calais. La surveillance des pollutions - leur rôle consistant à cet égard à faire le relais entre les agents verbalisateurs, le parquet, les gendarmes, les centres de sécurité des Affaires maritimes et les directions départementales pour que les navires auteurs de pollutions soient bien poursuivis -, la surveillance et la police des pêches maritimes et la diffusion de l'information nautique pour les marins. Telles sont les cinq missions assurées par les CROSS.
Le CROSS Corsen est un centre émetteur de Navtex Météo, c'est-à-dire qu'il émet sur tout le golfe de Gascogne des informations régulières, communiquées aux bateaux par fax. Les Anglais couvrent une zone au nord et les Affaires maritimes couvrent également une zone en Méditerranée, par le CROSS Méditerranée situé à La Garde, à proximité de Toulon.
En ce qui concerne le personnel relevant du ministère de l'Equipement, le CROSS Corsen est actuellement armé par 55 personnes, dont 51 au plan d'armement, 5 officiers des Affaires maritimes et 5 fonctionnaires civils dont 3 contrôleurs des phares et balises. Le personnel de la Marine nationale « hors budget défense », c'est-à-dire dépêché par la Marine nationale et rémunéré par le ministère de l'Equipement, est constitué de 40 officiers mariniers, quartiers maîtres et matelots.
Ces effectifs seront légèrement modifiés étant donné qu'avec la professionnalisation, ils seront portés à 51, dont 9 fonctionnaires civils affectés au service technique. Celui-ci sera en effet assuré par des fonctionnaires des phares et balises.
En matière de recherche et de sauvetage maritimes, la zone de Corsen s'étend en Manche et en Atlantique du mont Saint-Michel à la pointe de Penmarc'h.
Le réseau international des centres de coordination de sauvetage maritime a été institué par la convention internationale de l'OMI de 1979, signée à Hambourg, en Allemagne.
Le CROSS Corsen travaille en étroite coopération avec les Coast Guards britanniques de Falmouth. Au sud, le CROSS Etel couvre tout le golfe de Gascogne.
M. le Rapporteur : Existe-t-il à Falmouth un centre similaire à celui de Douvres ?
M. Loïc LAISNE : Bien entendu ! Les Britanniques ont 6 centres équivalents à nos CROSS et une vingtaine équivalents à nos sous-CROSS sur leurs côtes.
M. le Rapporteur : Vous êtes-vous déjà rendu vous-même au centre de Falmouth ?
M. Loïc LAISNE : Oui, mais voilà plus de dix ans lorsque j'étais rattaché au CROSS Jobourg.
M. le Rapporteur : Le centre de Falmouth est-il identique à celui de Douvres ?
M. Loïc LAISNE : Non ! Le centre de Douvres a une mission de surveillance de la navigation à l'instar du CROSS Corsen, alors que celui de Falmouth n'est qu'un centre de sauvetage. Il est donc plus proche du CROSS Etel. Le centre de Falmouth travaille essentiellement avec le CROSS Etel et celui de Douvres travaille main dans la main avec le CROSS Gris-Nez : les Français surveillent la voie montante et les Anglais la voie descendante du dispositif de séparation de trafic.
M. le Rapporteur : Le CROSS Corsen a-t-il des relations directes avec le centre de Douvres ?
M. Loïc LAISNE : Pas du tout ! Nous passons par le CROSS Gris-Nez qui travaille nettement plus avec le centre de Douvres qu'avec les autres CROSS français. Le CROSS Gris-Nez et le centre de Douvres sont en liaison constante dans les échanges d'informations sur le trafic.
M. le Président : Swansea est-il un centre équivalent à celui de Falmouth ?
M. Loïc LAISNE : Tout à fait ! Parmi les différents centres britanniques dont Falmouth, Douvres, Swansea, Aberdeen et Clyde, seul celui de Douvres assure des missions de surveillance de la navigation étant donné que le trafic est moindre dans la zone sud et que les vents dominants sont ouest, ce qui est une chance pour les Anglais ! Si une personne tombe à la mer, elle a toutes les chances d'être rabattue par les vents sur les côtes de Bretagne !
Précisons que les zones de sauvetage ne recouvrent pas nécessairement les zones de souveraineté, s'agissant de la délimitation des eaux françaises et britanniques. En d'autres termes, nous travaillons aussi dans des zones britanniques et en étroite coopération avec nos collègues britanniques. Par exemple, si une opération doit être menée en zone française mais à la limite des eaux territoriales, nous pouvons demander des moyens britanniques, en l'occurrence des hélicoptères du centre de Falmouth, et c'est nous qui les coordonnons.
Aux termes de la convention OMI de Hambourg datant de 1979, la mer est découpée en régions de recherche et de sauvetage qui ne respectent pas nécessairement les frontières. Les Etats s'engagent dans ces zones à fournir l'assistance nécessaire à toute personne en détresse. Ils mettent en place des centres de coordination de sauvetage maritime qui doivent disposer de moyens pour assurer leurs missions de sauvetage.
En matière de sauvetage précisément, en 1999, le CROSS Corsen a coordonné 770 opérations contre plus de 1 000 en 1998. En moyenne, sur cinq ans, nous coordonnons 826 opérations par an. Sur ces 770 opérations, 43 % d'entre elles ont été réalisées au cours de la saison estivale, ce qui s'explique par l'accroissement du taux de fréquentation.
Quant au bilan des opérations de sauvetage, 19 personnes sont décédées et 12 ont disparu, soit un nombre total de 31 victimes. Bien que le nombre d'opérations ait été moindre en 1999 qu'en 1998, nous avons enregistré une personne décédée de plus. Les opérations ont donc été plus graves et marquées par une recrudescence nette des accidents de plongée, soit 4 décédés et un disparu.
En ce qui concerne les moyens, le préfet maritime représente le Premier ministre et tous les ministres sur le littoral. Le CROSS, par délégation, peut faire intervenir tous les moyens de l'Etat et il en prend le contrôle opérationnel en cas d'opérations de sauvetage. Nous pouvons également faire appel à des moyens privés.
Au titre des moyens terrestres, 43 % de nos opérations sont assurées par la gendarmerie ; 43 % par les pompiers ; 10 % par des moyens divers et 4 % par le CCMM. La gendarmerie effectue principalement des enquêtes terrestres destinées à savoir si les gens sont bien sortis en mer. Notre problème majeur est lié aux fausses alertes et nous sommes tenus à un travail d'analyse nettement plus approfondi que les pompiers avant de déclencher toute opération. Nous nous posons la question de savoir notamment s'il s'agit réellement d'une alerte et quels moyens adéquats envoyer. Il est plus facile à terre de prendre son véhicule et de se rendre sur les lieux pour constater la situation. En cas d'opération en mer, la nuit et par mauvais temps, une phase préliminaire visant à déterminer quelle est la meilleure méthode et quel est le moyen le plus efficace pour intervenir s'impose à nous. Nous ne pouvons pas risquer la vie des gens de la SNSM par mauvais temps, de nuit, dans les rochers, sans disposer au préalable d'éléments forts.
S'agissant des moyens aériens, 42 % de nos opérations sont assurées par la sécurité civile, en l'occurrence les hélicoptères Dragon 29 ; 39 % par la Marine nationale ; 7 % par les douanes ; 9 % par la gendarmerie nationale et 3 % par les autorités étrangères. En période d'opération, la Marine nationale enregistre un pourcentage plus important, en particulier par l'utilisation de Breguet-Atlantique qui restent souvent longtemps sur zone. Il s'agit d'avions lourds, très efficaces dans les missions de repérage et pour la couverture de grandes zones de sauvetage.
Quant à la définition et au temps d'utilisation des moyens, nous avons mis en _uvre 994 dispositifs l'année dernière contre 1 364 en 1998. Pour les moyens nautiques, nous travaillons à plus de 50 % avec la Société nationale de sauvetage en mer qui est particulièrement bien représentée sur la pointe de Bretagne. Les équipes sont compétentes et disposent de canots tout temps.
M. le Président : Puisque vous parlez de la SNSM et de la Marine nationale, où intégrez-vous l'intervention de l'Abeille Flandre ?
M. Loïc LAISNE : L'Abeille Flandre n'intervient quasiment jamais pour nous en matière de sauvetage. Son intervention est intégrée dans les chiffres de la Marine nationale. Etant affrétée par la Marine nationale, ce remorqueur constitue pour nous un moyen de la Marine nationale.
J'insiste sur le rôle important que joue la SNSM dans les opérations de sauvetage. Les équipes sur Molène et Le Conquet sont performantes, mais nous avons un souci majeur en ce qui concerne l'île de Sein, qui est traditionnellement une zone importante de sauvetage et qui dispose d'un canot tout temps très efficace. Compte tenu du vieillissement de la population, les habitants désertent l'île l'hiver, si bien que l'équipage est ancien. Or envoyer une équipe d'un certain âge en mer, par grosse tempête, pour assurer une opération de sauvetage n'est pas la solution idéale. La question devra donc bien être posée un jour.
M. le Président : Dans ce cas, quelle est la solution ?
M. Loïc LAISNE : Audierne !
M. le Rapporteur : C'est-à-dire qu'un bateau d'Audierne se rend sur les lieux ?
M. Loïc LAISNE : Tout à fait, mais il faut équiper Audierne.
Mme Jacqueline LAZARD : Audierne n'a pas le bateau adéquat ?
M. Loïc LAISNE : Si, Audierne est bien équipé. Sur toute la pointe de Bretagne, la SNSM est extrêmement bien équipée.
Le CROSS Corsen peut mettre en _uvre les canots SNSM de Saint Guénolé, d'Audierne, Camaret, Molène, Ouessant, Portsall, Aberwrac'h dans le Finistère Nord, celui de Loguivy de la mer dans les Côtes d'Armor et de Saint-Malo en Ille et Vilaine
L'essentiel de nos installations techniques, en particulier les radars qui surveillent le dispositif de séparation de trafic, est situé sur la tour du Stiff à Ouessant - qui dépend du CROSS Corsen. Le premier radar a été créé en 1965 dans le Pas-de-Calais et le deuxième en 1973 à Ouessant. En 1979, à la suite du sinistre de l'Amoco-Cadiz, le dispositif à trois voies a été instauré sur Ouessant et l'Abeille Flandre a pris sa faction. L'année 1982 a été marquée par l'ouverture du CROSS Corsen.
Quant à l'organisation du trafic, les bateaux empruntent les routes de navigation de la Manche et passent par Corsen avant d'embouquer le dispositif de Jobourg et de se retrouver dans le Pas-de-Calais.
Le CROSS Corsen est un service de trafic maritime côtier. En matière de surveillance, nous travaillons également selon les règles de l'Organisation maritime internationale. Le CROSS a donc une activité de base internationale. Nos missions concernent la surveillance de la navigation, l'information des usagers, l'assistance à la navigation et la régulation du trafic.
Il est très important de savoir qu'en matière de surveillance de la navigation et d'assistance à la navigation, nous ne démentons jamais le capitaine du navire. C'est lui qui est responsable de sa navigation. Nous ne donnons jamais de consignes ni d'ordres au commandant. En revanche, nous pouvons lui donner des conseils et lui apporter une assistance.
M. le Rapporteur : Peut-il arriver que vos conseils ne soient pas suivis ?
M. Loïc LAISNE : Rarement !
M. le Rapporteur : En d'autres termes, vous n'êtes pas un aiguilleur de la mer, ni un contrôleur !
M. Loïc LAISNE : Exactement !
Mais nous donnons assez rarement des conseils aux commandants. Nous attirons leur attention sur des situations.
M. le Rapporteur : De votre propre autorité ?
M. Loïc LAISNE : Oui ! Si nous voyons sur notre radar des navires arriver en situation rapprochée ou prendre des routes douteuses, nous les appelons immédiatement pour les en avertir et connaître leurs intentions, bref les inviter à la prudence.
M. le Rapporteur : Si d'aventure, le navire ne vous écoute pas, vous ne pouvez rien dire ?
M. Loïc LAISNE : Non ! C'est d'ailleurs bien prévu dans les textes de l'Organisation maritime internationale : le CROSS CORSEN en cas d'infraction caractérisée aux règles édictées par les conventions de l'OMI dresse des constats qui sont transmis à l'Etat du pavillon. Le CROSS dresse également des procès-verbaux d'infraction à la réglementation applicable dans les eaux territoriales.
M. le Rapporteur : Cela ne vous arrive pas souvent de ne pas être suivis ?
M. Loïc LAISNE : Quasiment jamais ! Il est rare que nous donnions des conseils aux commandants.
M. le Rapporteur : Rare, c'est-à-dire ?
M. Loïc LAISNE : Il m'est difficile de le chiffrer, mais cela doit nous arriver entre 50 et 100 fois par an sur un trafic de 51 000 navires.
J'en viens à la zone de compétence du CROSS Corsen et à la zone de couverture du radar.
Le dispositif de séparation de trafic d'Ouessant est fondé sur un principe assez exceptionnel dans le monde, celui de circulation à trois voies. Il n'existe que deux dispositifs de ce type dans le monde, qui permettent d'écarter les pétroliers des côtes. En fait, les pétroliers et les navires gaziers chargés doivent passer par la voie montante ouest, c'est-à-dire par la voie la plus extérieure qui se trouve entre 27 milles et 33 milles de la côte. Ainsi, si nous constations une anomalie, l'Abeille Flandre aurait le temps d'intervenir pour prendre la remorque. Un pétrolier qui serait en panne dans la voie montante et qui dériverait à 5 ou 6 n_uds mettrait cinq heures pour venir s'échouer sur Ouessant.
M. le Rapporteur : Ce qui permet le temps d'intervention, n'est-ce pas ?
M. Loïc LAISNE : Absolument !
La voie descendante, située entre 16 milles et 21 milles, est empruntée par tous les bateaux qui passent, qu'ils soient dangereux ou pas.
M. le Rapporteur : Le danger est moindre en descente qu'en montée ?
M. Loïc LAISNE : Non ! Identique !
M. Yves NAQUET-RADIGUET : On admet souvent qu'ils descendent plutôt à vide et qu'ils remontent plutôt à plein.
M. Loïc LAISNE : Mais le danger est équivalent ! Des pétroliers montent par la voie extérieure, mais des porte-conteneurs transportant des matières radioactives passent par la voie la plus proche d'Ouessant. Le pétrole n'est pas le seul produit à présenter un danger. Bien d'autres navires qui passent par la voie montante transportent également des produits extrêmement dangereux.
Sachez qu'en 1999, sur 51 074 bateaux détectés par notre radar, 50 776 nous ont appelés, ce qui représente une moyenne de 140 bateaux par jour. Une obligation fixée par l'Organisation maritime internationale contraint les navires à se signaler. Pour l'instant, ils ne doivent le faire qu'à Ouessant et à Gris-Nez. Des discussions ont lieu actuellement pour étendre cette obligation également à Cherbourg, au CROSS Jobourg.
En vertu d'une décision de l'Organisation maritime internationale, entrée en vigueur en juillet 1997, tous les bateaux de plus de 300 tonneaux, qu'ils transportent ou non des matières dangereuses, doivent nous appeler à 35 milles. Par conséquent, 99,5 % des bateaux qui passent nous contactent et cette obligation est parfaitement respectée.
M. le Rapporteur : Parfaitement, dites-vous ?
M. Loïc LAISNE : Parfaitement, et nous enregistrons une amélioration considérable des contacts avec les navires. Lorsqu'en 1986, j'étais chef du service « Opération » au CROSS Jobourg, des bateaux de la Marine nationale, tant ici à Corsen qu'à Jobourg, faisaient encore de la permanence sur le rail pour obliger les bateaux à se signaler et à respecter les règles parce qu'ils passaient n'importe comment. Des bateaux étaient déroutés et les infractions étaient multiples. Aujourd'hui, nous n'enregistrons qu'une infraction significative par mois.
M. le Rapporteur : Pour non-identification ?
M. Loïc LAISNE : Non ! Mais je vais vous faire part des chiffres.
Comme je l'indiquais tout à l'heure, en moyenne 140 bateaux nous appellent par jour.
Au titre du trafic, en 1999, sont passés par le rail d'Ouessant : 1 907 pétroliers, 982 gaziers, 37 975 navires non dangereux et 9 900 bateaux dangereux. Par ailleurs, 102 millions de tonnes de pétrole ont transité l'année dernière par Ouessant, ce qui représente 280 000 tonnes par jour, ainsi que 20 000 tonnes de gaz par jour et 130 000 tonnes d'autres produits dangereux, tels les produits chimiques éventuellement en vrac et en conteneurs. Voilà la densité du trafic ! Celui-ci est encore plus important dans le Pas-de-Calais, compte tenu des trafics entre les grands ports du nord et la traversée des car-ferries.
En ce qui concerne la synthèse de l'action du CROSS Corsen en 1999 : 282 navires ont été sous surveillance pour des raisons diverses et 195 ont présenté des avaries, graves ou pas. Il peut s'agir d'un changement d'injecteur en été par beau temps, ce qui ne représente pas un danger important ; il peut s'agir aussi d'une avarie en hiver, par grosse tempête. Citons l'exemple du Victor, un bateau en très mauvais état, dont la machine commençait à être envahie par l'eau et qui n'avait plus ni électricité, ni énergie ; bref, il était impératif d'aller le chercher en mer et de le ramener au port de Brest pour éviter qu'il s'échoue sur la côte en cas de vent !
M. le Président : Heureusement qu'il ne transportait que du blé !
M. Loïc LAISNE : N'oublions pas les soutes ! Les 280 000 tonnes de pétrole sont des hydrocarbures transportés, mais il faut prendre aussi en considération les soutes des 140 bateaux qui passent chaque jour, lesquelles contiennent, chacune, entre 5 000 et 30 000 tonnes de fioul. Précisons également qu'il s'agit de FO2 - fioul n°2 -, ce produit particulièrement polluant que transportait l'Erika.
Nous avons également constaté au cours de l'année 1999 5 abordages dans notre zone. Ils concernaient principalement des bateaux de plaisance et des chalutiers. Nous avons enregistré 53 procès-verbaux...
M. René LEROUX : Y compris pour les chalutiers ?
M. Loïc LAISNE : Oui ! Mais nous ne pouvons pas nécessairement le savoir.
M. René LEROUX : S'agit-il essentiellement de chalutiers ?
M. Loïc LAISNE : Non, pas ici ! Ce que vous dites est très vrai pour ce qui concerne le Pas-de-Calais, mais nous ne sommes pas ici dans une zone de pêche.
Par ailleurs, en 1999, 7 navires ont été remorqués et 23 bateaux en difficulté ont été escortés par l'Abeille Flandre jusqu'à l'entrée du port de Brest, ce qui représente 30 bateaux assistés dans des situations très graves. En outre, nous avons signalé au Mémorandum de Paris 57 bateaux qui ont eu des comportements bizarres ou dont nous savions qu'ils étaient en difficulté. Sur ces 57 bateaux, 21 d'entre eux ont été détenus à la suite d'inspections ou présentaient des déficiences à rectifier.
Quant à l'évolution des infractions, 53 procès-verbaux ont été dressés, dont la plupart ont été transmis à l'Etat du pavillon. Parmi ces 53 infractions, 40 % sont des défauts de signalement. Les autres, parmi les plus graves, concernent des contresens, soit 5 en un an.
Il est significatif de remarquer qu'en 1996, nous avions enregistré 48 infractions. Mais, à l'époque, le système de déclaration obligatoire n'était pas en vigueur. Par conséquent, le nombre d'infractions est non pas en augmentation comme on pourrait le croire, mais en diminution continue puisque, à compter de 1997, il faut prendre en considération les infractions pour défaut de déclaration OUESREP, c'est-à-dire de la déclaration obligatoire.
M. le Président : De quelle manière expliquez-vous la chute brutale des infractions entre le début et la fin des années 90 ?
M. Loïc LAISNE : Les navires ont, me semble-t-il, une meilleure perception du rôle des services côtiers de surveillance du trafic. Ils nous appellent, prennent contact avec nous et suivent nos conseils. Notre collaboration est excellente.
M. le Président : Nous constatons également une diminution très importante du nombre d'infractions. Les navires seraient-ils de meilleure qualité ?
M. Loïc LAISNE : Non ! Les navires ne sont certainement pas de meilleure qualité. C'est bien là tout le problème ! En revanche, les équipages ont pris l'habitude d'appeler le CROSS quand le navire passe à Ouessant. Ils ont également pris l'habitude de respecter le dispositif. Cette pratique est entrée dans les m_urs, d'autant plus que nous sommes toujours présents sur les ondes.
M. le Président : Pour quelles raisons le nombre d'infractions a-t-il globalement diminué puisque vous dites que les navires ne sont pas de meilleure qualité ?
M. le Rapporteur : Il s'agit d'infractions aux règles de la circulation et non pas de contrôles de l'Etat du port.
Loïc LAISNE : Tout à fait ! Notre action n'empêchera pas un bateau pourri de se casser en deux ou de tomber en panne, à l'instar du Victor.
M. le Président : Comme l'indique à juste titre Jean-Yves Le Drian, il s'agit donc d'infractions aux règles de circulation.
M. Loïc LAISNE : Absolument ! Une voiture pourrie peut rouler sur l'autoroute sans commettre d'infraction au code de la route.
M. Yves MERLE : Par ailleurs, les facilités de positionnement se sont généralisées, donnant ainsi une grande précision à des navigations auparavant souvent aléatoires.
M. Loïc LAISNE : Quant à la surveillance particulière, sur 282 navires sous surveillance, 195 d'entre eux sont tombés en avarie machine. Outre ces incidents, ce sont surtout des désarrimages et des abordages qui se produisent, mais rarement des incendies.
S'agissant de la surveillance des pollutions en 1999, 16 cas ont été détectés - contre 31 en 1998 -, dont plus de la moitié dans les eaux territoriales. Deux dossiers ont été transmis au tribunal compétent.
M. le Rapporteur : Pourquoi pas les autres ?
M. Loïc LAISNE : Dans 11 cas, la source de pollution n'a pas pu être identifiée et, dans les autres, les preuves n'étaient pas évidentes.
M. le Rapporteur : Je suppose que l'on ne connaîtra que dans quelques années les suites qui seront réservées à ces deux dossiers transmis au tribunal compétent ?
M. Loïc LAISNE : Sans doute ! En revanche, je vous cite un exemple concret, vécu récemment.
En février dernier, un bateau grec qui remontait sur Dunkerque, le Lya, a été détecté par les hélicoptères des douanes en flagrant délit de pollution. Prévenu en temps réel par l'avion des douanes, le CROSS a lui-même averti le parquet de Brest - puisque l'infraction a été constatée dans les eaux territoriales -, ainsi que la gendarmerie, le centre de sécurité des Affaires maritimes et la direction départementale des Affaires maritimes de Dunkerque. Attendu à Dunkerque, le bateau a été inspecté dès son arrivée à quai par le centre de sécurité. Il a fait l'objet d'une enquête de gendarmerie. Le bateau a été bloqué à quai plus d'une semaine pour rectifier ses défaillances et une caution a été fixée pour lui donner l'autorisation de partir.
J'ai cité cet exemple pour insister sur l'importance du rôle du CROSS. Sachant que le bateau passe rapidement, il convient de réagir vite pour qu'il soit attendu au port d'escale. Il faut savoir que le bateau qui passe sur la pointe de Bretagne le soir est le lendemain à Dunkerque, d'où il repart après 5 ou 6 heures d'escale. Or quand le bateau est reparti, le responsable de l'infraction pénale est le commandant et non l'armateur. Si le commandant a changé au cours du voyage et que le bateau fait escale à Dunkerque, les poursuites judiciaires sont très difficiles à mettre en _uvre.
M. Aimé KERGUERIS : Pourriez-vous nous donner un ordre de grandeur de la caution ?
M. Loïc LAISNE : Son montant a été relativement faible : 50 000 francs. Le blocage du bateau pendant une semaine a été plus dissuasif !
M. le Rapporteur : Ce dossier date de cette année, n'est-ce pas ?
M. Loïc LAISNE : De février 2000 pour être exact !
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous faire parvenir les éléments détaillés le concernant ?
M. Loïc LAISNE : Je vous les transmettrai !
En ce qui concerne la coordination de la police des pêches, le nombre d'opérations est ici assez faible. Elles concernent essentiellement des activités de braconnage dans les Côtes d'Armor et le fameux problème des chalutiers pélagiques qui nous a conduits, cette année, à en dérouter quatre.
M. François CUILLANDRE : Vous nous avez parlé d'une autoroute maritime à trois voies au large d'Ouessant et, plus loin, d'une autoroute à deux voies avec un dispositif de séparation de trafic. Le passage de l'une à l'autre pose-t-il des problèmes ?
M. Loïc LAISNE : Il faut reconnaître que cela pose des problèmes, mais il s'agit du meilleur compromis possible afin d'éloigner suffisamment les pétroliers pour laisser à l'Abeille Flandre le temps d'intervenir. Il est vrai que les bateaux doivent se croiser et tout croisement de routes de navigation présente un danger. Mais il faut savoir que si nous faisions passer les pétroliers dans la voie montante Est, ils seraient à 7 milles d'Ouessant. En cas d'avarie par tempête, l'Abeille Flandre ne disposerait plus que d'une heure pour intervenir, ce qui ne lui donnerait pas le temps nécessaire pour être sur zone et passer la remorque.
M. Yves NAQUET-RADIGUET : La question visant à changer de sens, est posée mais, franchement, je n'en suis pas partisan quand on sait qu'il a fallu quinze ans pour faire passer les bateaux dans le bon sens ! Imaginez la situation si nous décidions brutalement d'en changer ! En tout cas, sachez que la question est à l'étude.
M. Yves MERLE : Si l'on supprimait la voie la plus proche de la terre, on serait obligé, en principe, de changer le sens des deux autres voies pour les rendre conformes, ce qui demanderait des mois, voire des années pour que les bateaux puissent réellement l'admettre.
M. Loïc LAISNE : Un autre argument mérite d'être pris en considération : nombreux sont aujourd'hui les bateaux qui coupent à l'extérieur pour s'écarter de la voie, soit parce que tel est le souhait du commandant, soit parce qu'ils arrivent des Antilles ou des ports du nord du Venezuela par exemple.
M. le Président : Ils se signalent aussi malgré tout ?
M. Loïc LAISNE : Pas tous !
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Ils ne sont pas obligés de se signaler !
M. le Président : Pourtant, tous les navires ont l'obligation de se signaler.
M. Loïc LAISNE : A 33 milles, ils sont quasiment hors de la portée de notre radar qui couvre jusqu'à 35 milles, voire 40 milles. L'obligation de déclaration d'OUESREP ne s'applique que dans un cercle de 35 milles de rayon centré sur Ouessant.
M. le Président : Je suppose qu'ils ne doivent pas non plus obligatoirement se signaler à Jobourg ?
M. Loïc LAISNE : Non, en effet !
M. le Président : En revanche, ils doivent se signaler obligatoirement à Gris-Nez, n'est-ce pas ?
M. Loïc LAISNE : Absolument !
M. le Président : Avons-nous une idée du nombre de navires qui coupent et s'écartent ainsi de la route de navigation et que l'on retrouve ensuite au large du Havre ou de Gris-Nez ?
M. Loïc LAISNE : Non ! Précisément, une étude sera réalisée dans les mois à l'avenir en collaboration avec les Britanniques pour le quantifier.
M. le Rapporteur : Combien de bateaux passent ici ?
M. Loïc LAISNE : En fait, 51 000 bateaux passent dans le dispositif de séparation de trafic et à proximité immédiate.
M. le Rapporteur : Et combien en Manche ?
M. Loïc LAISNE : On ne le sait pas ! D'après Gris-Nez, il s'agirait de 600 bateaux par jour.
M. le Rapporteur : Personne n'est en mesure de dire quel est le nombre de bateaux qui passent en Manche ?
M. Loïc LAISNE : Personne !
M. le Rapporteur : Ni les Anglais, ni nous ?
M. Loïc LAISNE : Pour être précis, nous le savons parfaitement mais uniquement entre Gris-Nez et Douvres. N'oublions pas non plus le trafic de car-ferries qui ne transite jamais par ici. Ils effectuent leurs traversée notamment entre Douvres et Calais.
M. le Président : En revanche, Jobourg les connaît ?
M. Loïc LAISNE : Non ! Leur trafic intéresse Douvres et Calais !
M. le Rapporteur : Le centre de Douvres est-il équipé d'un radar ?
M. Loïc LAISNE : Oui !
M. le Président : Vous dites que sur les 200 000 à 300 000 bateaux qui naviguent sur la Manche chaque année, vous en dénombrez 51 000 qui passent dans le dispositif de séparation de trafic, n'est-ce pas ?
M. Loïc LAISNE : Le chiffre exact est de 51 074.
M. le Président : Quel est le nombre recensé par les Anglais ?
M. Loïc LAISNE : Les Anglais ne le savent pas parce qu'ils ne font pas d'opérations de surveillance, mais ils y sont intéressés.
Pour conclure, je précise que sur 51 074 navires détectés en 1999 par notre radar dont la portée varie entre 35 milles et 40 milles, 825 l'ont été hors du dispositif. Or, à partir de 35 milles, il devient difficile de détecter tous les navires. Plusieurs milliers de navires passent donc en dehors du dispositif et rejoignent ensuite le dispositif à deux voies des Casquets. Ces navires prennent cette route volontairement et continueront à le faire. C'est pourquoi j'estime que le changement de sens du dispositif ne s'impose pas de façon évidente. Il convient de réaliser une étude détaillée de trafic pour avoir toutes les données du problème avant de prendre une décision.
Audition de MM. Michel GIRIN, directeur, et Georges PEIGNÉ, directeur adjoint du centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE),
en présence du vice-amiral d'escadre Yves NAQUET-RADIGUET,
préfet maritime de la région Atlantique
(extrait du procès-verbal de la séance du 14 avril 2000 à Brest)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président.
M. le Président rappelle à MM. Michel GIRIN, Georges PEIGNÉ, et Yves NAQUET-RADIGUET que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. Michel GIRIN, Georges PEIGNÉ, et Yves NAQUET-RADIGUET prêtent serment.
M. le Rapporteur : J'ai tout d'abord quelques questions à vous poser concernant les études réalisées par le CEDRE. Comment sont-elles proposées ? A quelles fins ? Pour quelles raisons sont-elles acceptées ou refusées ? Comment sont-elles financées ?
M. Michel GIRIN : Nous faisons des suggestions mais nous ne réalisons nos études qu'à la demande. Par exemple, si nous proposons une étude sur la veille technologique pour la lutte en mer, il se peut que la Marine nationale se dise intéressée et finance nos travaux.
De même, si nous décidons de proposer une étude sur l'optimisation de l'emploi des dispersants parce que nous nous rendons compte qu'il nous reste encore à apprendre sur ce sujet, la Marine nationale et Elf Aquitaine peuvent être intéressés et, par conséquent, en financer la moitié chacun.
Lorsque nous avons proposé une étude - qui n'a d'ailleurs pas été financée - sur les cartes de sensibilité applicables aux cours d'eau en cas de pollution, nous nous sommes heurtés à un problème : celui de l'absence de partenaires volontaires. Cette étude est donc restée en suspens. Dans ces conditions, de deux choses l'une : ou nous la présentons de nouveau l'année suivante en essayant d'être plus convaincants, ou nous l'abandonnons au profit d'autres projets qui paraissent sur le moment plus importants et plus urgents.
Chaque année, la moitié des études que nous présentons est retenue et trouve des financements, souvent conjoints ; celles qui ne le sont pas restent en attente.
M. François CUILLANDRE : En d'autre termes, les études que vous réalisez sont financées par des contrats avec un ou plusieurs partenaires...
M. Michel GIRIN : Absolument!
M. François CUILLANDRE : ... et non sur fonds propres ?
M. Michel GIRIN : Pas exactement !
Vous avez raison de soulever cette question. La partie fonds propres nous permet d'assurer l'astreinte, l'urgence, la réponse à l'urgence, l'intervention, le service de documentation, bref la base de notre activité et non pas des activités de recherche. Par conséquent, le choix opéré par les organismes qui nous financent fixe sur quel objet porteront les études que nous réaliserons sur une année. Nous n'avons pas de degré de liberté, encore que, de temps en temps, tous les deux, Georges Peigné et moi-même, nous mettons de côté un peu d'argent de l'année précédente pour réaliser ce qui nous tient vraiment à c_ur, même sans en référer à notre comité stratégique. Ce degré de liberté que nous nous accordons ne représente cependant que 10 % de nos activités de recherche, 90 % des expérimentations du CEDRE répondant aux désirs et servant les intérêts des organismes qui nous financent.
S'agissant de la Marine nationale, une part importante de son budget de programmation est consacrée à la mise à jour permanente de ce que l'on appelle « l'état de l'art ». Il s'agit d'un document qui concerne l'organisation de la lutte contre la pollution maritime dans les autres pays européens, aux Etats-Unis et au Canada. Cela nous permet de tenir au courant la Marine nationale de ce qui se fait ailleurs.
Je tiens donc à insister sur le fait que l'on ne nous refuse pas certains contrats mais plutôt que certains contrats ne trouvent pas de financement.
M. le Rapporteur : Ne serait-il pas souhaitable que vous disposiez d'un minimum de fonds propres pour mener les études que vous jugez indispensables au titre de la recherche et qui ne trouvent pas de financement parce que personne n'est a priori directement intéressé ?
M. Michel GIRIN : Si vous me demandez si tel est mon souhait, je vous réponds clairement par l'affirmative ! De toute évidence, nous le souhaitons tous au CEDRE ! (Sourires.) Mais pour l'instant, ce n'est pas dans nos moyens.
M. le Rapporteur : J'ai bien compris, mais dans le cadre de cette commission d'enquête, nous pouvons nous permettre de faire des propositions ! (Sourires.)
M. Michel GIRIN : Nous avons toujours ce sentiment de frustration en interne, nous qui vivons dans ce monde et dans cet élément, si je puis dire. Tous les ans, à l'issue de la réunion du comité stratégique qui décide de la programmation de l'année et qui se tient au mois d'octobre, nous regrettons qu'un ou deux dossiers que nous aurions bien aimé lancer ne soient pas retenus.
Pour illustrer mon propos, je cite un exemple concret et tout simple. Pourquoi la coopération régionale caraïbe n'a-t-elle pas été lancée, alors qu'un bateau, le Dolly, est actuellement sous l'eau en Martinique, chargé de bitume ? Sincèrement, nous éprouvons de la peine ! Pourquoi ne pas avoir commencé à réfléchir sur l'action que nous serions en mesure de mener pour faire face à des situations susceptibles de se produire aux Antilles ?
Il s'agit d'un exemple parmi d'autres ! Georges Peigné pourrait vous en citer d'autres. En interne, nous avons tous un dossier qui nous cause des soucis particuliers. Cela étant, il ne s'agit pas de se faire des illusions ! Nous disposons de moyens limités et, chaque année, nous nous disons, à propos d'un dossier concernant un accident, anodin ou majeur, que si nous avions pu réaliser telle ou telle étude, nous aurions été mieux armés pour faire face à l'accident en question. Telle est aussi la limite de nos moyens !
M. Georges PEIGNE : Il est certain que toutes les études que nous réalisons au titre de la recherche et de l'expérimentation correspondent à un besoin que nous ressentons comme tel.
M. le Rapporteur : J'imagine bien que vous ne proposez pas n'importe quoi !
M. Georges PEIGNE : Les propositions que nous soumettons ont toutes, au préalable, fait l'objet de discussions. En fait, avant de parvenir à un catalogue de propositions qui sera soumis aux différents contributeurs financiers potentiels, une discussion est largement engagée en amont. La réflexion que nous consacrons à élaborer des propositions consomme du temps ! Par conséquent, nous essayons d'emblée d'optimiser ce temps, en nous orientant plutôt sur des propositions correspondant à des besoins et susceptibles de recueillir un accord entre notre propre estimation de la demande et l'estimation qui peut être faite par les organismes susceptibles de nous accorder un financement. Là, s'opère un premier niveau de filtre. Ensuite, le cycle de filtres s'affine effectivement jusqu'aux décisions qui seront prises quant à ce qui sera ou non financé.
M. Michel GIRIN : Nous sommes également en présence de différents niveaux de qualité et de force de relations. Pour ce qui concerne la lutte en mer contre les pollutions par les hydrocarbures, nous sommes en relation permanente avec la Marine nationale, dont nous sommes les voisins géographiques.
M. le Rapporteur : Vos relations sont-elles bonnes ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Franchement oui ! Elles sont parfaites ! J'avoue d'ailleurs avoir personnellement souffert des attaques médiatiques portées contre le CEDRE à la suite du sinistre de l'Erika. Quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, nous étions ensemble. Si ce n'étais pas moi qui répondait aux critiques ou aux demandes d'information parce que je ne disposais pas des éléments, Michel Girin s'en chargeait ou son adjoint direct. Par conséquent, nos relations sont excellentes.
Toutefois, le Centre d'études pratiques de la pollution (CEPPOL), qui était jusqu'à présent notre interface avec le Commandant Daniélou, est actuellement monopolisé par l'affaire de l'Erika. Ladite cellule travaille donc moins actuellement sur des études avec le CEDRE. Mais étant donné que nous travaillerons de concert sur les opérations de pompage, la permanence de nos relations restera inchangée.
M. Michel GIRIN : Je précise qu'un officier du CEPPOL travaille à mi-temps au CEDRE, sauf depuis le sinistre de l'Erika par manque de temps, ce qui est logique.
M. le Rapporteur : Quelle est la qualification des 4 personnes recrutées par le CEDRE en contrat à durée déterminée?
M. Michel GIRIN : Il s'agit de jeunes ingénieurs qui étaient au chômage et qui ont fait des stages chez nous.
M. le Rapporteur : Ils travaillent sur l'affaire de l'Erika ?
M. Michel GIRIN : Absolument !
Une jeune fille travaille à mi-temps sur le sinistre de l'Erika et à mi-temps sur d'autres dossiers pour lesquels nous devons rattraper le retard accumulé. Une autre jeune fille est quasiment à plein temps sur l'Erika en Loire-Atlantique tant la pression est forte ans ce département. Un jeune homme travaille à mi-temps sur l'achèvement d'un guide de suivi écologique, une étude importante dont nous allons avoir besoin pour l'Erika. Nous l'avons rattrapé au vol, si je puis dire, puisqu'il était en fin de stage, pour l'envoyer travailler également à mi-temps dans le Morbihan. Enfin, une jeune femme travaille dans le Finistère et commence à lancer la cartographie de l'histoire des chantiers. Si nous devons un jour nous battre devant les tribunaux, ce qui pourrait bien se produire, nous devrons disposer de toutes les données sur les chantiers, des éléments ordonnés et organisés de démonstration afin de savoir ce qui a été fait et comment.
M. le Rapporteur : Qu'en est-il des deux autres personnes dont vous nous parliez au cours de notre visite ?
M. Michel GIRIN : Il s'agit de deux Vannetais affectés au PC. Toutes les semaines, je recevais un fax d'un sous-préfet ou d'un préfet me demandant d'affecter 2 personnes en permanence au PC et, toutes les semaines, je répondais que nous avions fait tout notre possible - mais en vain - pour donner satisfaction à tel sous-préfet. Le Morbihan a finalement trouvé une solution simple et pratique : étant donné qu'il ne parvenait pas à nous convaincre d'affecter en permanence 2 personnes au PC, une convention a été passée avec nous. De ce fait, 2 Vannetais locaux que nous allons former ici pendant une semaine ont été recrutés. Ils seront en relation avec le personnel.
M. Georges PEIGNE : Une solution pratique et qui nous soulage !
M. Michel GIRIN : Avec la Marine nationale, la convergence est totale : nous travaillons en étroite concertation et dans le cadre d'échanges permanents. En revanche, dans les domaines de la lutte contre les pollutions en eau douce ou à terre, nous n'avons pas d'interlocuteurs aussi solides que la Marine nationale qui est le bras opérationnel de la lutte en mer. Nous nous entretenons avec un département, un préfet ou un représentant de la direction de l'eau du ministère de l'Environnement. Il n'existe pas de bras opérationnel de la lutte à terre.
Quand il s'agit de traiter de pollutions des eaux douces et des eaux continentales, nous avons affaire à tout un ensemble de bras opérationnels divers. Qu'il s'agisse de contrats portant sur la veille technologique ou sur la réflexion scientifique, nous travaillons main dans la main et efficacement avec la Marine nationale. Dès que nous entrons dans le domaine de la chimie et de la lutte contre la pollution des eaux douces ou du littoral, nos interlocuteurs sont multiples et très divers, si bien que les situations deviennent complexes. Par exemple, pour organiser un stage de formation aux zones de défense, il faut rechercher des financements auprès des agences de l'eau, d'une collectivité territoriale et de la direction de l'eau du ministère de l'Environnement. En fait, il s'agit de bricolage en raison de l'absence d'unité de commandement.
M. le Rapporteur : Quelles sont vos relations avec les pays étrangers, en Europe et dans le monde ? En dehors de la formation, avez-vous des commandes ?
M. Michel GIRIN : Nous avons remis au secrétariat de la commission d'enquête une copie des deux derniers états de l'art, partie « mer », pour les pays étrangers. Nous les obtenons en dialoguant avec une dizaine d'interlocuteurs au Japon, aux Etats-Unis et dans différents pays européens. Ces collaborations, en particulier dans le cadre de contrats européens puisque nous travaillons avec nos partenaires européens sur des appels d'offres, nous permettent de recevoir des documents de leur part. Je montrais tout à l'heure un volume qui retrace toute la réflexion de la commission d'enquête allemande sur l'accident du Pallas et ses conséquences. Ce cargo chargé de bois, qui est tombé en panne devant les côtes danoises, a pris feu et a dérivé vers les côtes allemandes pour s'échouer sur les îles d'Amrun, un site de réserve ornithologique. Cet accident qui s'est produit voilà deux ans a provoqué un drame en Allemagne, et ce pour deux raisons essentielles. D'une part, alors que le bateau brûlait, le fuel de soute s'est propagé sur l'ensemble des îles, tuant ainsi des dizaines de milliers d'oiseaux. D'autre part, les Allemands ont ainsi découvert que leurs bateaux destinés à lutter contre les pollutions ne pouvaient pas travailler en mer, par faible profondeur. En l'occurrence, le Neuwerk, tout neuf et qui sortait quasiment pour la première fois, ne pouvait pas opérer sur site parce qu'il n'avait pas de fond plat.
Ce document, rédigé en allemand, développe une réflexion fort intéressante sur les améliorations techniques et surtout organisationnelles à envisager, l'Allemagne ayant découvert que son système de lutte contre ce type de pollution n'était pas tout à fait au point. Dans ce type de situation -que nous avons vécu, nous avec le préfet maritime -, les cabinets ministériels ont rapidement assuré la gestion de la crise.
Ce document, fort intéressant et riche d'enseignements, n'a qu'un défaut, celui d'être rédigé en allemand. Nous devons donc absolument le faire traduire en français pour notre usage commun.
M. le Rapporteur : D'autant plus que l'Allemagne a dû connaître le même problème au titre de l'organisation de la lutte en mer ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Précisément, à titre d'anecdote et en complément des propos de Michel Girin, le chef d'état-major de la Marine allemande est venu à Brest pour étudier le mode d'organisation des moyens de lutte contre les pollutions en France à la suite de l'accident de l'Erika. Il a reconnu que le système mis en place en Allemagne n'avait absolument pas fonctionné. Il en a conclu que l'Allemagne devait s'organiser comme la France !
M. le Rapporteur : Je suis convaincu que le système français repose sur une bonne organisation, en termes opérationnels, en cas de crise parce qu'il faut que ce soit un marin qui commande d'autres marins. En ce sens, notre système donne satisfaction, sous réserve de quelques améliorations. En revanche, il ne donne pas satisfaction en termes stratégiques et techniques.
M. Michel GIRIN : Le document dont je viens de vous parler s'intitule : « Rapport de la Commission d'enquête sur l'accident du Pallas ».
M. le Rapporteur : Il s'agit du rapport d'une commission d'enquête parlementaire ?
M. Michel GIRIN : Non, il émane du ministère des transports.
Nous avons le même rapport, cette fois-ci en japonais, sur l'accident du Nakhodka.
M. le Rapporteur : C'est d'autant plus intéressant qu'à Londres, nous avons beaucoup entendu parler du Nakhodka. Nous avons assisté à une séance de l'OMI de laquelle se dégageait une alliance objective entre la France et le Japon.
M. Michel GIRIN : Depuis l'année dernière, nous avons lancé un programme de coopération avec l'Institut japonais de recherche sur les navires. Ce dernier a reçu pour mission, à la suite de l'accident du Nakhodka, de travailler sur les techniques de repérage de nappes dérivantes. Cet institut a donc essayé de mettre au point des techniques plus performantes que celles qui existent actuellement et qui ne sont pas faciles à mettre en place. Sa réflexion a porté notamment sur les modalités techniques permettant d'éviter que l'avant d'un navire chargé de fioul et dont la pointe sort de l'eau, dérive vers une zone touristique. Telle est la situation qu'ont connue les Japonais avec cet accident du Nakhodka dont l'avant a dérivé sept jours durant avant de s'échouer sur les côtes touristiques. Imaginez le tollé au Japon ! Cet institut travaille également sur le problème de structure des navires.
M. le Rapporteur : Il s'agit là de l'objet du débat auquel nous avons assisté à Londres : le renforcement de la structure des navires.
M. Michel GIRIN : Entre techniciens, nous tenons d'ailleurs avec cet institut, les 6 et 7 juillet prochain, un séminaire de confrontation sur le thème « Nakhodka contre Erika, échange d'expériences ». Un technicien japonais de l'institut est venu à Brest, la semaine dernière.
M. le Rapporteur : Existe-t-il au Japon un institut qui correspond au CEDRE ?
M. Michel GIRIN : Pas tout à fait ! Cet institut est spécialisé dans les navires, mais il a reçu certaines missions élargies.
M. le Rapporteur : Cet institut a donc l'intention d'élargir ses compétences ?
M. Michel GIRIN : En fait, le CEDRE va collaborer avec cet institut dans les domaines d'intérêt mutuel, en particulier sur la lutte contre les pollutions en mer. Sachez que cet institut ne travaille pas du tout sur la lutte contre les pollutions à terre. Nous n'avons donc pas d'interlocuteur au Japon dans ce domaine.
Actuellement, les techniciens de cet institut essayent de mettre au point un laser, similaire à celui mis en place sur un avion canadien voilà trois ans. Cela peut être un élément complémentaire pour le repérage de nappes situées à quelques centimètres sous la surface de l'eau, c'est-à-dire légèrement recouvertes par l'eau, notamment par des vagues en cas de mauvais temps.
Par ailleurs, les techniciens de cet institut surveillent l'épave du Nakhodka dont la moitié arrière, située à 2 700 mètres de fond, continue de fuir. Il en sera d'ailleurs ainsi pendant des années, sachant qu'il n'est pas possible de pomper le contenu de ses cuves à 2 700 mètres de fond.
M. le Rapporteur : Un dispositif tel que le CEDRE, avec les mêmes compétences, n'existe qu'aux Etats-Unis, n'est-ce pas ?
M. Michel GIRIN : Il n'existe aucune structure qui ait, comme le CEDRE, une fonction de recherche et d'assistance technique sur les pollutions marines et des eaux douces.
En revanche, il existe des structures qui ont des responsabilités, soit dans le domaine de l'eau douce, soit dans le domaine marin, soit dans le domaine de la recherche scientifique. Aucune ne combine plusieurs fonctions à l'instar du CEDRE. Elles sont cependant d'une dimension nettement plus importante que la nôtre et leurs fonctions sont beaucoup plus larges.
M. le Rapporteur : Sur les pollutions ?
M. Michel GIRIN : Tout à fait !
L'agence norvégienne de l'environnement, par exemple, est en charge des mêmes responsabilités que nous sur l'eau, qu'elle cumule avec des responsabilités sur l'air et sur la terre. De plus, elle a pour fonction de coordonner les moyens de l'Etat et de la Marine en cas d'urgence. Je m'empresse toutefois de préciser qu'aucune urgence ne s'étant présentée, il n'a jamais été possible d'en tester le fonctionnement. En tout cas, il s'agit d'une agence en recherche-développement qui a une mission de coordination des moyens.
Bref, chaque pays a son organisation qui lui est propre. Je suis cependant incapable de vous dire quelle est la meilleure ! Toutes présentent des avantages et des inconvénients !
M. le Rapporteur : Comme vous l'avez indiqué, vous assurez une mission de formation. Passez-vous des contrats avec tel ou tel pays qui vous demande assistance ?
M. Michel GIRIN : J'ai reçu ce matin même un fax me confirmant qu'un projet de contrat pour la lutte contre les pollutions accidentelles avait reçu l'agrément de l'administration du port de Singapour. Une convention devrait donc être signée avec ce dernier pour lui fournir conseil et expertise en cas de pollutions accidentelles.
M. Georges PEIGNE : Et ce, à la suite d'un audit.
M. le Rapporteur : Sur quoi portait cet audit ?
M. Georges PEIGNE : Une personne du CEDRE s'est rendue sur place pour compléter un audit sur les risques de pollution, surtout par les produits chimiques, pouvant affecter le port de Singapour.
M. Michel GIRIN : Cet audit a fait suite à un abordage entre deux navires devant Singapour. Cet abordage avait provoqué une prise de conscience sur place.
M. le Rapporteur : Vous ne vous préoccupez pas du risque nucléaire ?
M. Michel GIRIN : Non, à une exception près ! Je croyais que nous ne devrions jamais nous en occuper. Mais quand le MSC Carla s'est cassé en deux au large des Açores avec, à son bord, un conteneur contenant deux irradiateurs de laboratoire, le ministère de l'Environnement s'est adressé à nous en nous disant que nous étions les seuls à pouvoir situer ces deux irradiateurs de laboratoire dans le navire. Nous avons donc fait des recherches, à la suite desquelles le ministère nous a demandé si leur présence dans le fond marin était dangereuse. J'ai indiqué qu'il était bien entendu que le CEDRE n'était pas concerné par le risque nucléaire. Il nous a été répondu que s'agissant de nucléaire civil commercial, nous devions être capables de faire face à l'urgence.
M. le Rapporteur : Souhaitez-vous voir vos compétences élargies à cet aspect ?
M. Michel GIRIN : Question délicate ! Disons que nous n'avons pas, en ce domaine, la même compétence que pour d'autres sujets.
M. le Rapporteur : Vous pouvez l'acquérir ?
M. Michel GIRIN : Certes ! De même, nous n'avons pas la compétence épidémiologique sur un produit comme le fioul, ni la compétence quant aux éventuelles maladies pourtant en résulter. C'est seulement à l'occasion de l'incident du Carla que nous avons découvert ce qu'était un micro-becquerel par exemple ! Par conséquent, nous pouvons apprendre !
M. le Rapporteur : Sur l'épidémiologie ou la toxicité, se pose un vrai problème, celui du discours : qui dispose de l'autorité pour se prononcer sur le sujet ? Qui est le référentiel pour éviter des paniques parmi les populations ? Je ne sais pas quelles seront nos propositions à cet égard, mais le problème est réel.
Nous nous félicitons de cette rencontre, car tout le monde tient les même propos, mais nous étions, nous-mêmes, quelque peu interrogatifs.
Votre proposition serait donc d'élargir vos compétences et vos moyens et de faire du CEDRE un lieu unique...
M. Michel GIRIN : Dans des limites prudentes ! Il ne s'agit pas non plus d'aller trop loin et de nous demander d'être capables de répondre à tout sans en avoir les moyens !
M. le Rapporteur : Nous sommes bien d'accord !
M. Michel GIRIN : Nous avons vécu très douloureusement une situation dans la deuxième quinzaine de décembre : nous ne parvenions pas à faire notre travail parce que nous étions littéralement assaillis par tous ceux, particuliers ou journalistes, qui n'arrivaient pas à obtenir une réponse par téléphone. Parce que nous étions les seuls techniciens du secteur, nous étions submergés de demandes, ce qui nous empêchait totalement de réaliser notre travail.
Christophe Rousseau qui était l'homme de la situation, si je puis dire, et qui essayait de répondre aux questions, pourrait en témoigner. Vous n'aurez malheureusement pas l'occasion de le rencontrer puisqu'il ne sera de retour de Roumanie que ce soir. Il vous aurait expliqué, comme pourraient le faire les secrétaires du CEDRE, qu'une petite structure comme la nôtre ne peut pas se permettre de ne pas répondre au téléphone, même si nous l'avons souhaité plus d'une fois ! Quand il nous est arrivé de ne pas être joignables, les articles de presse les plus négatifs à notre sujet ont été publiés ! En l'occurrence, le journaliste du Monde, qui a écrit l'article le plus négatif sur nous, fait partie de ceux qui n'ont pas pu nous joindre par téléphone. Il a rédigé son article sans nous avoir parlé au préalable.
M. le Rapporteur : Il s'agit d'un problème global de porte-parole ?
M. Michel GIRIN : Oui !
M. le Rapporteur : Le préfet maritime est porte-parole technique sur les questions opérationnelles, n'est-ce pas ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Nous avons tenté de procéder ainsi pendant cette période : j'ai essayé d'être le porte-parole. Mais les journalistes n'en ont que faire ! Tel est le problème ! Parce qu'ils n'obtiennent pas les informations qu'ils attendent ou parce qu'ils téléphonent à un moment qui n'est pas opportun ou pour je ne sais quelle autre raison, toujours est-il qu'ils s'adressent directement au CEDRE !
M. Michel GIRIN : Quand ils ne parviennent pas à joindre le CEDRE, ils contactent le ministère de l'Environnement qui, lui-même, leur répond qu'il appartient au CEDRE de répondre. De mon côté, je reçois un appel d'un attaché de cabinet qui me demande de répondre au journaliste parce que le ministère ne dispose pas des éléments pour cela. Si je réponds aux journalistes que je suis désolé et que nous n'avons pas le temps de leur consacrer un moment parce que nous effectuons notre mission de conseil technique, j'apprends le lendemain qu'un article de presse est malgré tout publié avec des éléments récupérés ailleurs !
Tout le problème est lié à l'absence d'une structure suffisamment solide pour donner suite aux demandes et pour pouvoir y répondre.
M. le Rapporteur : Avez-vous eu des rapports directs avec le secrétariat général de la mer ?
M. Michel GIRIN : Tout à fait ! Nous avons des relations étroites avec le secrétariat général de la mer qui est représenté au sein de notre conseil d'administration. Le secrétaire général est d'ailleurs présent à toutes les réunions.
Nos deux interlocuteurs de base sont les préfectures maritimes et le secrétariat général de la mer.
Pour répondre précisément à votre question, pendant la deuxième quinzaine de décembre dernier, le contact était constamment établi entre le CEDRE et le secrétariat général de la mer au même titre qu'avec la préfecture maritime. A deux reprises, le secrétaire général adjoint de la mer m'a d'ailleurs conseillé de décrocher le téléphone pour pouvoir travailler. Je lui ai alors répondu : « D'accord, mais que va-t-il se passer ? »
M. le Rapporteur : Comment envisagez-vous la réponse à ce problème ?
M. Michel GIRIN : L'autorité responsable, c'est-à-dire l'Etat et non pas nécessairement la préfecture maritime, devrait créer une cellule chargée de répondre à toutes les questions posées.
M. le Rapporteur : Une cellule ad hoc pour répondre à toutes les questions ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Exactement, à l'instar de ce qui est mis en place par la Marine nationale ! Immédiatement, une équipe de 5 à 10 personnes venant de Paris ou, le cas échéant, de Cherbourg, devrait être constituée pour renforcer les capacités susceptibles de répondre à toutes les questions.
M. le Rapporteur : Il faudrait donc, par exemple, que les plans POLMAR mer ou POLMAR terre, éventuellement révisés, prévoient qu'en cas de crise, une cellule de communication, dont la constitution serait à définir, est mise en place sous une autorité précise.
M. Michel GIRIN : Plutôt un PC communication qu'une cellule, avec un porte-parole général !
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Nous avons essayé de procéder ainsi avec notre cellule de relations publiques dont nous avons porté les effectifs de 5 à 14 personnes.
M. le Rapporteur : Je suppose que tel n'était pas leur métier...
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Absolument pas ! C'est bien là que réside le problème !
M. le Rapporteur : ... et qu'il serait nécessaire de prévoir aussi des exercices, n'est-ce pas ?
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Exactement !
M. Michel GIRIN : Tout à fait !
M. le Rapporteur : Il est tout aussi important, me semble-t-il, de gérer l'information de l'opinion publique que de devenir opérationnel par des exercices préalables, tels que ceux prévus dans les plans POLMAR mer et POLMAR terre.
M. François CUILLANDRE : Toutefois, cela n'empêchera pas les journalistes d'écrire ce qu'ils ont envie de publier !
M. le Rapporteur : Bien entendu, excepté cependant sur certaines questions techniques telles que celle de la toxicité. Je pense à un autre problème qui risque de se poser, celui des indemnisations. Même si, pour notre part, nous sommes plutôt sereins, l'opinion publique attend des informations, d'où la nécessité de mettre en place une cellule de crise.
M. François CUILLANDRE : Il était tout de même tentant pour le journaliste du Monde d'écrire, en résumé, que du pétrole appartient à Total Fina qui finance le CEDRE, lequel n'est donc pas objectif !
M. Yves NAQUET-RADIGUET : Absolument !
M. le Rapporteur : Bien entendu !
M. Michel GIRIN : Il s'agit toujours de savoir à qui profite le crime ! Vous vendez du papier en aggravant la situation et, pour la rétablir, vous vendez des placards publicitaires ! Les publicités destinées à rétablir l'image de la Bretagne et de la Loire-Atlantique seront diffusées sur des chaînes de télévision qui gagnent sur les deux tableaux. Cela fait partie du jeu ! Le système est ainsi conçu !
La seule réponse que, pour notre part, nous pouvons apporter est une meilleure organisation. Le rôle du CEDRE est d'être présent auprès de l'autorité qui répond, en apportant sa modeste pierre dans son domaine de compétence. Mais comme vous l'avez constaté sur les questions de toxicité, il faut la pierre du CEDRE, celle de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), celle de l'Institut français du pétrole (IFP) et celles de bien d'autres acteurs. En face, la pierre rougie au feu est celle du laboratoire qui s'est autoproclamé compétent et qui a décidé que tous les autres avaient tort !
M. le Rapporteur : D'accord, mais notre rôle ne consiste pas à faire cet exercice.
M. Michel GIRIN : Si vous ne l'aviez pas fait, qui l'aurait fait ?
M. le Rapporteur : Ce n'est pas notre rôle ! Notre mission concerne davantage les questions d'indemnisation. Nous avons abordé les questions de toxicité parce que l'événement nous commandait d'assurer cette mission et nous avons bien fait de l'exercer.
M. Michel GIRIN : Mais où était le coordinateur de POLMAR terre ayant autorité pour assurer une telle mission ?
M. le Rapporteur : Il n'y en avait pas...
M. Michel GIRIN : Voilà !
M. le Rapporteur : ... et il n'y en a toujours pas ! Honnêtement, la circulaire du ministère de la santé est si catastrophique que nombre de maires ne l'affichent pas !
Audition de M. Yvon OLLIVIER,
préfet de la région PACA, préfet des Bouches du Rhône,
accompagné de
M. Jean-Michel FROMION, sous-préfet d'Istres,
M. Louis LE FRANC, directeur de cabinet du préfet,
Mme Josiane GILBERT, directrice du service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile (SIRACED PC)
(extrait du procès-verbal de la séance du 18 avril 2000 à Marseille)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. Yvon Ollivier, Jean-Michel Fromion, Louis Le Franc et Mme Josiane Gilbert sont introduits.
M. le Président rappelle à MM. Yvon Ollivier, Jean-Michel Fromion, Louis Le Franc et Mme Josiane Gilbert que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées.
M. Yvon OLLIVIER : Nous sommes très heureux de vous accueillir.
M. le Président : De nos rencontres d'hier, je retiens un sentiment général de confiance qui, sans doute, existait également en Atlantique. Personne n'avait imaginé qu'une catastrophe du genre de l'Erika souillerait plus de 400 km de côtes. On en était resté à l'idée qu'un naufrage se produit au large, éventuellement sur les rochers, et que le pétrole est circonscrit sur quelques dizaines de kilomètres. Or, là, ce sont bien 400 km qui sont concernés.
Comment fait-on pour coordonner les plans POLMAR terre, POLMAR mer sur une telle distance ?
Quand on voit des pétroliers de 300 voire 400 000 tonnes à quelques dizaines de milles des côtes, en cas de problème il est clair que la pollution ne sera pas circonscrite sur quelques centaines de mètres et quelques plages. Je n'ai pas le sentiment que cette donnée soit bien intégrée.
Autre problème : les médias.
Le préfet maritime de Brest et ses collaborateurs ont mis en avant le choc constitué par la venue de centaines de journalistes et la pression qu'ils ont exercée, à tel point que les fax étaient saturés.
Comment fait-on concrètement pour éviter ce genre de chose ?
Comment répondre de façon coordonnée, sensée, raisonnable à la presse afin d'éviter les dysfonctionnements des services de l'Etat ? C'est cette question qui ressort de la crise de l'Erika.
Ensuite, on retrouve une grande partie des revendications que nous avons entendues en Bretagne : des moyens supplémentaires, en particulier humains, à savoir que les réservistes puissent être mobilisés plus longtemps, quand il s'agit de gens techniquement, administrativement, juridiquement compétents, que les 30 jours habituels.
On recherche des accords d'une part avec les Italiens, d'autre part avec les Espagnols. Un certain réalisme permet d'envisager, progressivement, une configuration similaire à celle de la Manche et la Mer du nord, même si l'on n'a pas les mêmes traditions maritimes. En face, ce n'est pas la Grande-Bretagne, mais le Maghreb. Ils ont toutefois pris conscience que leur principale ressource c'est le tourisme et que toute pollution qui viendrait souiller leurs plages serait catastrophique. Ils sont donc en train de s'équiper et seraient prêts à collaborer pour trouver des ententes. C'est un point positif.
Voilà, en vrac, un certain nombre d'éléments qui justifient, dans les mois à venir, de tirer toutes les conséquences de l'Erika sur les différentes façades maritimes au plan national, mais surtout international.
Autre élément : en cas de pollution, à quelques dizaines de milles des côtes, il n'y a pas en Méditerranée - ni en Italie, ni en Espagne, ni en France - de moyens de pompage en mer ; en Atlantique, les moyens techniques étaient insuffisants.
M. le Rapporteur : Le principal constat en Atlantique, c'était l'insuffisance criante des moyens de pompage en mer. On n'a jamais imaginé que l'on aurait à régler le problème en mer. On ne savait pas faire.
M. le Président : En Atlantique, quelques moyens se sont révélés inadéquats. Ici, si l'on devait faire face à un problème comme l'Erika, il faudrait faire venir les moyens des Pays nordiques, et le temps qu'ils arrivent...
De toutes les façons, on sait que, quel que soit l'endroit où cela se passerait, au-delà d'un vent de force 5, 6, les moyens actuels sont inopérants.
M. Edouard LANDRAIN : Le côté positif, c'est la qualité des douanes françaises, qui disposent de moyens aériens remarquables, notamment photographiques, en vision infrarouge ou en système de télémesure, thermomesure sur la longueur, l'épaisseur et le volume des nappes. Cela nous a semblé être à la pointe de la technologie.
M. le Président : C'est très positif.
M. le Rapporteur : C'est opérationnel pour lutter contre le déballastage ?
M. le Président : Avec des limites. Il faut repérer quel navire est coupable, récolter les preuves permettant de le poursuivre.
M. Yvon OLLIVIER : La zone d'intervention des douanes pour surveiller le déballastage ne va pas loin. J'ai l'impression qu'il faudrait aussi que la marine nationale ait un minimum de moyens en la matière.
M. Louis LE FRANC : 3 000 navires par an sur le port.
M. Yvon OLLIVIER : Quel est le volume en pétrole ?
Mme Josiane GILBERT : 40 % de l'approvisionnement national par voie maritime.
M. Yvon OLLIVIER : Sur Fos. Cela veut dire qu'il y a une concentration de risques extrêmement forte.
Face à cette concentration de risques, à terre - on essaiera de vous le montrer - on a une organisation de moyens qui permet de faire beaucoup, mais lorsque c'est malheureusement déjà trop tard. Enfin, on limite les dégâts.
L'important, c'est la surveillance maritime et les capacités de pompage.
Sur ce plan, vous dites que vous avez trouvé une très grande confiance dans les propos tenus. Cependant, je serais assez inquiet quant aux capacités réelles de surveillance préventive de ce qui se passe en Méditerranée et à la capacité de détection de ces déballastages très fréquents. Il suffit de circuler sur les côtes méditerranéennes pour voir de petites pollutions qui résultent des dégazages en mer, dont très peu sont repérés, mais j'ai l'impression que les infractions relevées en ce moment au large de nos côtes ne sont pas très nombreuses.
M. le Rapporteur : Il y a aussi un problème d'identification. Nous l'avons constaté en Manche. C'est une des difficultés. Il sera sans doute proposé des mesures de lutte contre ces pollutions dans le cadre du projet de loi de transposition de directives communautaires en matière de transports, qui sera examiné avant la fin juin, car il y a un problème d'identification et de poursuite.
M. Yvon OLLIVIER : Absolument.
M. le Rapporteur : Nous verrons cela dans le rapport, mais le nombre de poursuites réelles et de condamnations...
M. le Président : ...deux condamnations ont été prononcées en Méditerranée. Deux capitaines ont été condamnés chacun à 300 000 francs d'amende.
M. le Rapporteur : Il y a un réel problème.
M. Yvon OLLIVIER : Il y a très peu d'infractions relevées.
M. le Rapporteur : Le constat sur les moyens de pompage en mer est une préoccupation majeure. Cela confirme ce que l'on nous a dit en Manche et sur la côte Atlantique. Techniquement, on peut le faire, mais on n'a pas l'outil dimensionné pour une pollution de grande ampleur.
M. Jean-Michel FROMION : M. le préfet, pour compléter votre propos, j'ai eu l'occasion l'année dernière de traiter d'une pollution qui résultait d'un déballastage vraisemblablement important au large de Toulon et cela a touché l'ensemble des côtes depuis Bandol jusqu'à Marseille.
J'en retiens que vous avez mille fois raison, les douanes ont des moyens techniques très efficaces. Il faut toutefois leur associer immédiatement les moyens de courantologie et de météo pour avoir une prévision précise quant au devenir et au morcellement des nappes, à l'évolution de la pollution. On est toujours très gêné pour mesurer avec précision le point d'impact de ces pollutions.
Il serait souhaitable d'avoir un dispositif peut-être mieux constitué pour étudier la courantologie et prévoir de façon fiable la dérive des pollutions.
Cette expérience nous a manqué pour savoir où mettre en place les barrages de prévention pour fermer telle ou telle calanque, tel ou tel port, telle ou telle plage.
M. le Rapporteur : Avez-vous le sentiment que ces moyens météo, intégrant la courangologie, existent quelque part ailleurs qu'en France ?
M. Jean-Michel FROMION : Les moyens existent, mais il faudrait peut-être leur donner une autre dimension, que l'on ait une capacité d'action immédiate, à savoir que, sur zone, il nous faudrait envoyer des moyens plus fins et plus précis afin de gérer sur la micro zone notre problème.
M. le Rapporteur : En dehors de ce problème-là, s'agissant du plan POLMAR, quand ont eu lieu les derniers exercices dans les départements de PACA ?
On s'est aperçu en Atlantique que les exercices POLMAR avaient été irrégulièrement organisés. Par exemple, dans un département que je connais bien, au moment de déposer les premiers déchets de pétrole, - c'était en plus le jour de Noël - on s'est aperçu que les lieux prévus dans le plan POLMAR avaient disparu ou étaient fermés.
Avez-vous fait des exercices POLMAR terre ? Comptez-vous en faire ? Etes-vous bien sûrs des lieux de réception des déchets, que ce soit des déchets pétroliers ou d'autres ? Et à quelle date ont eu lieu ces exercices ?
M. le Président : Contrairement à ce qui se passe en Atlantique, la Méditerranée est coincée entre l'Espagne, le sud de la France et l'Italie. On a là une sorte de poche. A l'évidence le problème se pose, en cas d'événement semblable à celui de l'Erika, d'une pollution débordant largement la zone PACA, touchant l'Italie, l'Espagne éventuellement et également le Languedoc Roussillon.
Y a-t-il eu ou est-il envisagé des exercices, des rencontres prenant en compte ce type de catastrophe ?
M. le Rapporteur : Dans le même ordre d'idée, mais pour revenir à la comparaison avec l'Atlantique, une des questions d'organisation était le problème de la coordination des différents plans POLMAR terre, qui sont des plans départementaux. A partir du moment où l'on n'était plus dans le cadre départemental, jamais on n'avait fait un exercice de montage d'un dispositif comprenant le préfet maritime, le préfet de région et les autres intervenants. Il y a donc eu un certain nombre de ratés dus à une coordination assez confuse entre POLMAR mer et POLMAR terre.
Ce qui nous frappe le plus, - je pense que l'on fera des propositions à cet égard - c'est l'aspect communication du plan POLMAR. En effet, nous ne pouvons pas, dans une période de risques avec des phénomènes de panique, ne pas prendre en compte les problèmes de communication. On n'a pas du tout imaginé dans le dispositif en vigueur sur la côte Atlantique - chacun l'a constaté et le sait - une telle invasion des médias sur le PC de crise, qui était tout petit. Si cela se produisait en Méditerranée, ce serait également ingérable. Le PC crise brestois était petit et le préfet maritime avait autour de lui un nombre limité de collaborateurs. C'était quasiment ingérable, mais les personnels ont fait au mieux.
De même, concernant la partie sécurité des bénévoles, des acteurs, et pour gérer la question de la toxicité du fioul, tout le monde a fait tout et n'importe quoi.
M. Yvon OLLIVIER : Aujourd'hui, notre organisation est essentiellement départementale. On reviendra peut-être sur le plan POLMAR terre.
A l'évidence, l'organisation départementale n'est pas adaptée à une situation telle qu'une pollution marine de grande ampleur. C'est pourquoi, à la suite de l'affaire de l'Erika, j'ai demandé au préfet maritime que nous tenions non seulement des réunions, mais que nous mettions en place une organisation coordonnée entre le préfet maritime d'une part, le préfet de zone d'autre part. En effet à ce niveau, ce n'est plus en réalité le préfet de région qui est susceptible d'intervenir, c'est davantage le préfet de zone de défense qui, ici, est l'interlocuteur du préfet maritime car il y a adéquation des limites de zones de compétences terrestres et maritimes.
Sur le plan des principes, il est entendu que l'on travaille désormais entre ces deux structures, préfecture de zone et préfecture maritime.
Ceci étant, compte tenu des demandes que nous avions dans l'immédiat, émanant en particulier des élus nous interrogeant sur ce que nous avions de disponible et sur ce que nous pouvions faire, - nous avons été interpellé notamment par le maire de Martigues, M. Lombard, qui s'est manifesté dans la presse - nous avons commencé à apporter des réponses départementales sur l'organisation du plan POLMAR terre, mais il reste à faire un gros travail avec la préfecture maritime. Nous n'avons pas véritablement démarré de façon très concrète, car il s'agit de prendre en considération l'ensemble de la côte méditerranéenne.
Je souhaiterais, avec le préfet maritime, organiser une coordination au-delà de notre région, même au-delà de la région PACA. La zone de compétence, c'est PACA, Languedoc-Roussillon et Corse. Il faut pouvoir s'organiser sur les trois régions administratives et, au-delà, créer les rapports nécessaires avec les Italiens et les Espagnols. C'est ce qui s'est fait ponctuellement d'ailleurs il y a une dizaine d'années au moment où j'étais en poste dans les Alpes-maritimes et où nous avions eu quelques pollutions résultant du vent d'est. Avec l'influence du courant ligure, qui nous ramène régulièrement des pollutions venant de la région de Gênes, nous avions été amenés à ce moment-là à travailler avec les autorités italiennes de Gênes.
Nous avons besoin avec le préfet maritime de voir les choses de façon aussi large que possible, aussi ai-je demandé des réunions de travail. Le sujet a été abordé lors de la conférence maritime régionale, organisée par le préfet maritime chaque année. J'avais demandé que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour. Il ne l'était pas formellement, mais il a été évoqué au cours des discussions, sous un angle d'ailleurs qui était celui de la répression des pollutions en mer puisque, lors de cette conférence, des magistrats de la Cour d'appel avaient été invités.
Donc, à cette occasion, a été évoquée la question de la répression des délits en mer. Nous avions aussi commencé à aborder dans son principe la coopération organisée entre le préfet maritime et le préfet de zone de défense. Comme aujourd'hui les orientations du ministre de l'Intérieur et du Gouvernement consistent à renforcer le rôle du préfet de zone de défense dans l'organisation administrative et à lui donner de nouveaux moyens, j'espère que, dans les semaines ou les mois à venir, ces priorités se traduiront par des décisions de type réglementaire ou financier. L'affaire de l'Erika a souligné que notre organisation administrative actuelle, qui a pourtant intégré ce concept de zones de défense, n'a pas pour autant tiré les conséquences de ce concept s'agissant des moyens mis à la disposition du préfet de zone de défense. En plus, sur le secteur Atlantique, il y avait un problème de découpage des zones de défense.
M. le Rapporteur : C'est certain. De plus, en raison des erreurs de prévision de dérive des nappes, les préfets de département, qui ont la responsabilité du plan POLMAR, se sont arrachés les moyens disponibles, mais il n'y avait pas vraiment de régulateur pour l'attribution de ces derniers.
M. Yvon OLLIVIER : Il y a une réflexion en cours sur cette question.
M. le Rapporteur : Les élus soutenaient leur propre préfet, au détriment éventuellement des autres. Cela a duré 15 jours.
M. Yvon OLLIVIER : En Méditerranée, normalement, administrativement, les choses devraient être plus simples. Il y a une autorité administrative unique qui est le préfet de zone de défense et un seul préfet maritime. Entre les deux structures, disposant par ailleurs d'un centre opérationnel et de moyens de communication, on doit arriver à s'organiser. Concrètement, aujourd'hui, c'est encore perfectible.
M. le Rapporteur : Y a-t-il jamais eu en Méditerranée un exercice global organisé à partir d'une hypothèse d'école - ne prenons pas le pétrole puisque notre mission ne concerne pas uniquement le pétrole - de déversement d'un produit encore plus dangereux s'étendant sur une large partie de la Méditerranée ?
Mme Josiane GILBERT : Il s'agit d'une question concernant la zone de défense, notre compétence est départementale.
Sur ces problèmes d'articulation des rôles du préfet maritime et des préfets terrestres, nous avons quand même une ébauche de dispositif opérationnel.
Nous n'avons pas encore travaillé la dimension pollution marine à cette échelle, mais nous avons travaillé sur le plan de secours à naufragés en mer (SECNAV). Là, nous avons touché du doigt, de manière très concrète, les difficultés de l'articulation entre ces deux autorités. Nous n'avons pas travaillé sur les problèmes de pollution, mais sur le problème de secours aux personnes. C'est déjà une première approche, qui nous facilitera sans doute le travail à venir s'agissant des pollutions marines.
En ce qui concerne les exercices POLMAR terre au niveau du département, cet après-midi, la responsable du service maritime que vous verrez vous indiquera les dates. Je suis en poste depuis deux ans, mais on m'a indiqué qu'il y avait eu des exercices de pose de barrages assez nombreux. Je ne pourrais pas vous préciser les dates, je ne les ai pas en tête.
Vous évoquiez tout à l'heure les problèmes d'identification des lieux de stockage des déchets. Dans le cadre de la refonte du plan, datant de 1984 - il est en refonte, quasiment achevé mais non encore signé - nous disposons d'une identification très claire des lieux où nous stockerions le produit recueilli et des numéros de téléphone type ORSEC, c'est-à-dire H24, pour actionner les centres de dépôt.
Les lieux d'entreposage des déchets sont parfaitement répertoriés et opérationnels.
M. le Rapporteur : Dans un département, cela n'avait pas été révisé depuis 1981, donc, rien ne correspondait plus à rien.
M. Louis LE FRANC : Actuellement, nous sommes en pleine refonte du plan POLMAR. Au plan départemental, le travail est quand même pas mal avancé.
Mme Josiane GILBERT : Il suffit de prendre la plume, de compiler les éléments et de le rédiger, ce que nous nous proposons de faire d'ici la fin du premier semestre, mais nous disposons du schéma d'alerte réalisé avec tous les partenaires dans le cadre de groupes de travail sur la mer et du schéma de conduite des opérations. Nous saurions où positionner les postes de commandement opérationnels et les postes de commandement avancés. Nous saurions qui dirige. Nous avons également organisé un pré-positionnement géographique des différents éléments du dispositif.
M. Louis LE FRANC : Nous en avons avisé les maires. Au plan départemental, on a essayé d'impliquer plus fortement les maires du pourtour de l'étang de Berre, car ils sont tenus de réaliser des plans communaux. Les maires ont donc été sensibilisés sur leur rôle et l'importance de réaliser ces plans communaux, qu'ils ne savent pas faire. Nous sommes là pour leur apporter notre appui technique et leur expliquer comment réaliser un plan communal.
Ils sont inquiets - vous en verrez quelques-uns cet après-midi - car ils ne savent pas de quels moyens ils disposent, quel type de coordination il faut mettre en _uvre, comment l'Etat peut s'associer à leur côté pour mettre en place un dispositif de lutte contre la pollution. En fait, c'est un mécanisme global qu'il convient de mettre sur pied et sur lequel il y a peu d'informations.
Tout en mettant sur pied ce nouveau plan POLMAR terre, nous les aidons à mettre en place, chacun en ce qui le concerne, des plans communaux. Six communes sont concernées.
M. le Rapporteur : Pour quand est prévue la fin de la révision du plan POLMAR terre ?
Mme Josiane GILBERT : Nous avons envisagé la fin du premier semestre.
M. le Rapporteur : Etes-vous informés des plans POLMAR terre des autres départements ?
M. Yvon OLLIVIER : Il faudra vérifier au niveau de la zone de défense quel est l'état d'information existant sur les dispositifs des autres départements. Ce ne sera pas au niveau de la préfecture de région, mais au niveau de la préfecture de zone.
M. le Rapporteur : Eventuellement, vous êtes-vous coordonnés avec les autres plans POLMAR terre des autres départements ?
M. Yvon OLLIVIER : Je ne crois pas. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Au niveau zone de défense, nous ne sommes pas véritablement organisés. Il y a la compétence théorique. En pratique, on n'est pas encore allé très loin dans la coordination.
M. Jean-Michel FROMION : Si l'on fait une petite analyse de risque, il y a une zone entre Marseille et le Rhône qui est découpée en deux sous-régions, la Côte bleue, avec les calanques, donc des zones très difficiles d'accès, et la zone plus particulièrement névralgique qui est celle du Golfe de Fos, où l'on voit passer l'ensemble des transports de matières polluantes et dangereuses, et qui comprend la mer intérieure qu'est l'étang de Berre. Ce dernier présente deux risques particuliers, l'un qui est le fait de sa traversée par un certain nombre d'oléoducs et l'autre, plus traditionnel, des pétroliers qui vont décharger ou charger des produits à Berre dans le fond de l'étang.
A la suite d'une demande assez forte de la part des élus de savoir si l'on était organisé sur le plan départemental pour faire face à la menace potentielle, j'ai organisé une réunion avec l'ensemble des élus de la zone littorale et de l'étang de Berre. Ce qui représente 18 communes.
Nous sommes convenus ensemble d'organiser et de mettre en chantier non pas des plans communaux infra POLMAR, comme la circulaire le prévoit, mais des plans intercommunaux sur des zones homogènes. C'est un peu l'idée que vous évoquez avec la coordination interdépartementale. On va d'emblée se mettre dans la meilleure des dispositions, en cas d'échec des préventions, pour traiter les pollutions dans trois secteurs, la côte bleue, le golfe de Fos et le bassin de l'étang de Berre proprement dit. Ce travail est engagé et nous nous appuyons pour le réaliser sur l'existant, c'est-à-dire que quelques communes avaient déjà un plan d'alerte, un plan de réponse aux différents risques de leur secteur, que l'on va spécialiser en plan infra POLMAR.
M. le Rapporteur : Infra POLMAR communal ou intercommunal ?
M. Jean-Michel FROMION : Chaque commune, maintenant, est en train de réfléchir et de travailler à l'organisation d'un plan. Je leur donnerai à cet effet un schéma assez harmonieux et homogène pour que, d'emblée, on ait des documents compatibles aussi bien avec les autres plans communaux qu'avec le plan POLMAR. Les choses iront bon train. D'ici la fin du printemps, une ébauche des schémas intercommunaux sera faite et d'ici la fin de l'année, sûrement, nous aurons terminé une mise à plat de ces plans intercommunaux.
Deux points essentiels méritent une attention particulière.
Des maires me paraissent très inquiets et redoutent un peu les orientations de la circulaire qui prévoit que l'Etat mette à disposition, sous convention et à titre payant, les moyens dont ils pourraient avoir besoin. Ils m'ont fait part vivement et violemment de leur émotion quand on leur a dit que l'on monterait un plan intercommunal et que, s'il y avait besoin de moyens, l'Etat les mettrait à disposition moyennant paiement.
M. le Rapporteur : Quels moyens ?
M. Jean-Michel FROMION : Les barrages et autres moyens que l'on pourra mutualiser dans nos plans intercommunaux.
M. Louis LE FRANC : En fait, les moyens du centre de stockage et d'intervention POLMAR qui sont à Port-de-Bouc.
M. Jean-Michel FROMION : Les maires que vous rencontrerez cet après-midi vont s'exprimer. Là, une clarification sera peut-être nécessaire.
Mon point de vue est que l'on pourrait, dans certains cas, éviter de leur mettre la facture immédiatement sous les yeux.
M. le Rapporteur : Je ne comprends pas bien. Dans le cadre du plan POLMAR, vous avez des lieux de stockage et des moyens techniques d'intervention. C'est le plan POLMAR.
M. Jean-Michel FROMION : ... il est infra POLMAR tant que le préfet ne déclenche pas le plan POLMAR.
M. le Rapporteur : Quand c'est POLMAR, c'est couvert par l'Etat. Quand c'est infra POLMAR, ce n'est pas le cas, donc, vous mettez à disposition moyennant paiement.
M. Jean-Michel FROMION : Dans la circulaire, il y a deux niveaux d'intervention. Le niveau communal, c'est-à-dire que les maires sont responsables de leur commune et de leur littoral. Puis, lorsqu'il y a une pollution de plus grande ampleur, le préfet peut déclencher le plan POLMAR. A ce moment-là, bien sûr, les choses sont différentes.
M. le Président : Les communes en question sont celles qui bordent l'étang de Berre ?
M. Jean-Michel FROMION : Ce sont celles qui sont sur la zone littorale entre Marseille et le Rhône, c'est-à-dire Le Rove, Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet, Martigues, Port-de-Bouc, Port-St-Louis et Fos et, de l'autre côté, vous avez dix communes qui sont riveraines de l'étang de Berre.
M. le Président : C'est-à-dire qu'elles estiment sans doute qu'une pollution dans ce secteur-là peut être une pollution majeure compte tenu de la vocation de la zone, ne nécessitant pas forcément le déclenchement des moyens lourds du plan POLMAR, mais pour eux c'est la catastrophe avec un grand « C ». Donc, ils ne voient sans doute pas pourquoi ils devraient payer.
M. le Rapporteur : Qui déclenche le plan infra POLMAR ?
M. Jean-Michel FROMION : C'est le maire lorsque l'information lui parvient en direct.
M. le Rapporteur : Le maire de quelle commune ?
M. Jean-Michel FROMION : Le maire de la commune qui paraît la plus menacée. Cette question nécessite toutefois une réponse nuancée dans la mesure où nous aurons l'information vraisemblablement avant le maire. C'est une liaison entre la préfecture et la municipalité qui fera que l'on pourra dire au maire de telle ou telle commune, à la zone intercommunale par exemple de la côte bleue, qu'il faut déclencher le plan infra POLMAR intercommunal.
M. Yvon OLLIVIER : Jusqu'au déclenchement du plan POLMAR, on reste dans le domaine de la police municipale.
M. Jean-Michel FROMION : J'avais demandé aux maires qui sont sensibles - vous le verrez, ils sont très concernés et ils participent très bien à toutes les actions de sécurité que l'on met en place - d'envoyer des missions d'observation sur l'Atlantique afin d'analyser la situation et d'en tirer des observations et des enseignements.
La leçon la plus importante qu'ils ont ramené de leur voyage, c'est une crainte farouche du bénévolat.
Nous avons déjà réfléchi avec eux et nous allons organiser, par avance, l'effet bénévole. Vous avez parlé de l'effet média, nous le prendrons aussi en compte, mais nous allons surtout organiser l'effet bénévole un peu à la manière de ce qui a été fait il y a quelques années avec la Croix Rouge formant les bénévoles pour intervenir sur les routes, dans les postes de secours, etc. Donc, on a l'idée immédiatement d'aller assez loin pour apaiser un peu cet effet bénévole. Il faut trouver les lieux d'accueil, encadrer immédiatement les bénévoles avec du personnel communal que nous allons faire former.
Nous avons la chance autour de l'étang de Berre de disposer d'un centre privé qui s'appelle la FOSST (Fast Oil Spill Team). C'est un centre qui est propriété de Elf et Total maintenant, qui dispose de moyens privés relativement importants pour faire face aux pollutions locales.
Ce centre dispose d'une capacité de formation. Nous nous appuierons sur celle-ci pour assurer une formation aux personnels municipaux, afin de répondre par avance à cette crainte que les maires ont ressenti devant l'afflux des bénévoles.
Chez nous, on le voit très souvent, lorsqu'il y a des opérations de propreté et d'environnement, on a immédiatement énormément de bénévoles. Donc, il nous faut bien organiser et bien maîtriser ce phénomène pour éviter d'être débordé.
Pour le reste, il faut, dans ces plans communaux et intercommunaux, aller dans le détail. Vous avez évoqué tout à l'heure les points de stockage, etc. Il s'agit non seulement de ces lieux, mais aussi de l'ensemble des routes, des chemins d'accès, de prévoir l'ensemble du détail pour la mise en exécution de ces plans particulièrement difficiles.
J'ai eu la chance d'être présent en Bretagne à l'époque de l'Amoco Cadiz comme St Cyrien, j'en garde un souvenir assez fort : c'est la prévision dans le détail qui fait un bon plan.
M. le Rapporteur : C'est utile, mais en même temps je pense à l'actualisation permanente des plans POLMAR. En dehors de ce que vous dites sur les bénévoles, qui étaient effectivement très difficile à gérer, le point le plus sensible était la non-actualisation des plans POLMAR terre dans certains départements, ce qui a donné des moments d'incertitude.
Sur les relations avec les autres pays, Italie et Espagne, rien ne dépend de la responsabilité du préfet de région ou du préfet de défense ?
M. Yvon OLLIVIER : A ma connaissance, dans la période récente, il n'y a pas eu de contact institutionnalisé.
M. le Rapporteur : Vous, en tant que préfet de région, vous n'avez jamais rencontré quelque homologue que ce soit, Espagnol ou Italien ?
M. Yvon OLLIVIER : Me concernant, non, mais je ne suis là que depuis six mois. En revanche, j'ignore si Jean-Paul Proust l'a fait.
Mme Josiane GILBERT : Sur cette thématique, je ne pense pas.
M. le Rapporteur : Et le préfet maritime, l'a-t-il fait ou non ?
M. le Président : Il a des contacts avec les Italiens. Pour les Espagnols, je n'ai pas le sentiment qu'il existe des liens formels.
M. le Président : Il estimait que les Espagnols n'avaient pas de moyens importants sur leur façade méditerranéenne. De l'autre côté, ils en ont avec le Biscaye plan.
M. le Rapporteur : Côté Atlantique, nous avons des relations avec l'Espagne officielles et formalisées.
M. le Président : Côté Méditerranée, il avait l'air de penser que la bonne volonté ne manquait pas, mais qu'il n'y avait peut-être pas de moyens significatifs.
M. le Rapporteur : Hypothèse d'école : un produit chimique dangereux a été déversé, vous, préfet de la zone de défense, qui allez-vous voir en Espagne ? Est-ce vous ou le préfet maritime ?
M. Louis LE FRANC : C'est le préfet maritime.
M. Yvon OLLIVIER : Au niveau des préfectures également, mais, pour le moment, cela se situe au niveau du département. Je suis sûr que mon collègue préfet des Alpes-maritimes a, comme je l'avais il y a dix ans, des relations suivies avec ses collègues de Gênes et d'Impéria pour ce sujet-là en particulier. Cela ne se situe pas au niveau de la zone, mais au niveau du département. Je suis persuadé que, dans le cadre du plan POLMAR Alpes-maritimes, il y a une organisation avec les Italiens. Et le préfet maritime a, de la même façon, des liens avec l'autorité italienne.
M. le Rapporteur : Et avec les Espagnols ?
M. Yvon OLLIVIER : Il existe un accord d'assistance mutuelle pour la sécurité civile avec l'Espagne et l'Italie.
M. le Président : Les Espagnols, ce n'est pas PACA, c'est la zone de défense.
M. Yvon OLLIVIER : Tout à fait.
M. le Rapporteur : Côté Atlantique, un accord récent a fonctionné pour l'Erika. Il venait d'être signé.
En Méditerranée, il semble qu'il n'y ait pas d'équivalent, donc, c'est une vraie question. Imaginons un produit toxique, y compris dans des conteneurs, qui dérive en mer.
M. le Président : La zone de compétence française descend très au sud à 400 kilomètres des côtes. Il n'y a pas de zone économique en Méditerranée, à la différence de l'Atlantique et de la Manche. L'instauration d'une zone écologique aurait l'intérêt de transformer ou de dépasser les clivages en fonction d'intérêts communs.
M. Edouard LANDRAIN : Dans le canal de Corse, on a limité les possibilités de passage dans les Bouches de Bonifacio.
M. le Président : Il y a un accord entre la France et l'Italie pour ne plus y faire passer de navires transportant des produits dangereux. Sauf que cet accord ne vaut pas pour les autres pavillons. Ils sont tenus de signaler qu'ils transportent des produits dangereux, mais en vertu de la liberté de circulation en mer, on ne peut pas leur interdire de passer par là. Ce qui pose quelques problèmes, le courant ligure n'étant pas loin.
M. le Rapporteur : Quand j'étais venu ici, on avait abordé ce sujet-là, mais il n'y avait pas encore d'accord avec les Italiens.
M. le Président : L'autre élément important qui pèse sur les comportements ou, en tout cas, justifie une certaine attitude, c'est qu'entre Gibraltar et Suez, les principales lignes internationales ne concernent pas la Méditerranée du nord, c'est-à-dire que si un bateau a un problème là-bas, au sud, le pétrole ne viendra jamais jusqu'ici. Quand on est dans l'Atlantique, les courants font que, de toute façon, que l'on soit à 50 ou à 100 milles, à un moment ou à un autre, le pétrole arrivera sur les côtes françaises. Si l'on est en Manche, si le navire à un problème à 10 milles des côtes britanniques, le pétrole n'ira pas vers les îles britanniques, il viendra vers les côtes françaises. On n'est pas dans la même configuration ici, ce qui explique la sensibilité nouvelle des pays du Maghreb et la façon d'appréhender - ce n'est pas critique, mais un constat tout simplement - que j'ai sentie hier chez nos interlocuteurs à l'égard de ces risques.
M. le Rapporteur : D'où une question sur l'autorité méditerranéenne de circulation. C'est un vrai sujet.
En Manche, on est en train progressivement d'y arriver. Les gens se voient. Ici, pas du tout.
M. Yvon OLLIVIER : Ici, on en a besoin. Il va y avoir d'ailleurs la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement dans le cadre du processus de Barcelone à Marseille en novembre prochain. Compte tenu de ce qui s'est passé avec l'Erika, de tous les travaux que nous menons en ce moment, de tous les constats que l'on fait, il apparaît que ce pourrait être un sujet à l'ordre du jour que d'organiser une autorité méditerranéenne en matière de surveillance maritime.
M. le Président : Au moins s'agissant la Méditerranée occidentale, avec l'Italie, le Maghreb, l'Espagne et la France.
M. Yvon OLLIVIER : Tout à fait, car cela devient une préoccupation commune à tous ces pays. On a vraiment besoin d'améliorer le système de surveillance et de prévention et, à un moment donné, le système de lutte contre la pollution. Tous ces pays sont assez proches les uns des autres. En cas de gros pépin, on est tous concernés.
M. Edouard LANDRAIN : M. le préfet, les modifications du plan POLMAR dont vous nous avez parlé tout à l'heure, avec la montée en puissance du rôle de la zone de défense, était-ce envisagé avant le drame de l'Erika ou est-ce simplement une résultante des problèmes qui se sont passés dans l'ouest ?
M. Yvon OLLIVIER : Une réflexion existait déjà avant l'Erika. Elle a été renforcée par ce qui s'est passé en décembre et mon prédécesseur, Jean-Paul Proust, qui est maintenant directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, tient beaucoup à ce que ce dossier avance.
Il serait intéressant que vous en parliez avec lui car il pilote personnellement les travaux menés sur le renforcement des moyens donnés aux préfets de zone de défense.
Il vient déjà d'y avoir quelques regroupements des zones de défense. C'était une première étape. Mais, il y a ensuite toute une série de mesures qui sont envisagées. A la lumière de son expérience ici, il vous parlera sûrement de la nécessité d'une coopération internationale avec l'Italie et l'Espagne en particulier.
Mme Josiane GILBERT : Au niveau de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la réflexion sur la refonte du plan était antérieure au problème de l'Erika. Tout est dans nos cartons et le plan n'est pas rédigé dans sa forme la plus noble, mais les travaux avaient démarré, puisqu'une circulaire du Premier ministre de 1997 imposait déjà la refonte du plan POLMAR.
Nous avons démarré les travaux en février 1998, fait travailler des groupes de travail, mais, ensuite, nous avons été assujettis à la préparation de la Coupe du Monde. Nous nous sommes donné comme échéance cette fin de premier semestre 2000 pour finaliser la rédaction du document.
M. le Rapporteur : Il serait intéressant que l'on ait l'état dans les autres départements.
Mme Josiane GILBERT : Je vais regarder pour cet après-midi.
M. Yvon OLLIVIER : Allez-vous dans d'autres départements de Méditerranée ?
M. le Rapporteur : Non. Nous n'avons malheureusement pas le temps. En fait, c'est un peu comme une pelote de laine, on tire et on trouve énormément de choses. Mais l'on ne dispose que de six mois.
M. Yvon OLLIVIER : Nous allons vous donner le maximum d'informations au niveau zonal, avec en particulier l'état d'avancement des plans POLMAR et les exercices POLMAR car ce sujet vous intéresse particulièrement, ce que je comprends.
M. le Rapporteur : De toute façon, ce secteur ne sera pas plus pénalisé que le secteur Atlantique où la situation était assez dramatique s'agissant de l'actualisation et des exercices. Il n'y avait plus eu de catastrophe depuis un certain temps et la vigilance avait diminué. C'est un phénomène humain normal. En fait, on a constaté que la seule zone toujours très sensibilisée à une éventuelle pollution était le nord Finistère, les Côtes d'Armor.
Le préfet maritime peut-il faire intervenir un bateau italien, un bateau espagnol ? Non. En Manche, oui.
M. Yvon OLLIVIER : Il y a le plan RAMOGEPOL qui concerne les Alpes-maritimes, Gênes et Monaco. Enfin, il existe des accords d'assistance mutuelle avec l'Italie et l'Espagne, pour la sécurité civile.
M. le Rapporteur : Avec l'Espagne, il y a un accord récent en Atlantique. De ce fait, dans l'affaire de l'Erika, il a pu être appliqué.
Nous sommes allés en Angleterre la semaine dernière. La coopération n'est pas aussi bien développée qu'on le souhaiterait, mais elle existe.
M. le Président : Il y a même des possibilités d'intervention avec les Anglais qui dépassent les limites territoriales.
M. le Rapporteur : C'est un vrai sujet.
M. Yvon OLLIVIER : Oui.
M. Louis LE FRANC : Ce sera sans doute intégré dans la refonte complète des plans POLMAR terre et mer car M. Roncière, secrétaire général de la mer, lors de la conférence maritime régionale, nous avait annoncé que ces plans allaient être fusionnés en un seul plan. La question des coopérations internationales y sera sans doute abordée.
Mme Josiane GILBERT : Les plans de secours à naufragés constituent déjà un document unique, avec un volet mer et un volet terre.
Vous avez évoqué la nécessaire surveillance maritime, l'amélioration des moyens de lutte, et notamment des capacités de pompage en mer qu'il faut accroître. Là aussi des mesures ont déjà été prises, mais ce qu'il conviendrait de développer et surtout d'harmoniser au niveau européen, en tout cas pour les pays concernés sur la Méditerranée, c'est le contrôle des bateaux. En effet, si les bateaux ne coulent pas, nous n'avons pas de préoccupations ni en mer, ni à terre.
M. le Président : Un dispositif va être mis en place sur les navires neufs à partir de 2002, 2003 : il s'agit d'un transpondeur. Cela devrait permettre de connaître rapidement les caractéristiques du navire, son âge, ses différents problèmes, les matières transportées. C'est un élément de sécurité, car il fournit automatiquement nombre d'informations importantes. Mais cela ne concernera que les navires neufs. Le problème est de savoir de quelle manière on intervient pour améliorer la sécurité des navires plus anciens, sans parler de l'élimination des navires sous-normes, qui est un autre problème.
M. Yvon OLLIVIER : Et s'agissant de la perspective de relèvement des normes ?
M. le Président : Il y a tout un jeu entre l'OMI et la Communauté européenne. A l'évidence, l'OMI ne souhaite pas que la Communauté européenne joue un rôle trop important. Cependant, le Gouvernement français semble souhaiter que la Communauté européenne intervienne en tant que contrôleur.
M. le Rapporteur : En réalité, nous pensons que la réglementation existante est assez significative, mais qu'il faudrait déjà l'appliquer strictement. Nous allons en parler à Malte la semaine prochaine. C'est le troisième pavillon de complaisance du monde.
M. Louis LE FRANC : Il me paraît important de vous indiquer, puisque l'on parle beaucoup de l'espace méditerranéen, qu'il existe un organe opérationnel de dimension zonale, le CIRCOSC, le Centre interrégional de coordination des opérations de sécurité civile, qui dépend du préfet de zone, qui a une parfaite connaissance de toutes les autorités en charge de la sécurité civile dans l'espace méditerranéen de par sa mission de lutte contre les feux de forêt et de secours aux victimes de grandes catastrophes comme, par exemple, les séismes en Turquie ou des opérations de secours d'ordre humanitaire, comme au Kosovo et en Albanie.
Ceux qui sont à la tête de cet organe opérationnel, qui est d'échelle zonale connaissent parfaitement leurs vis-à-vis.
M. le Président : Y compris dans le domaine maritime ?
M. Louis LE FRANC : Peut-être pas dans le domaine maritime, où des contacts éventuels peuvent être pris par le préfet maritime, qui dispose d'un organe opérationnel, le CROSSMED.
M. le Rapporteur : Il y a au moins une méthodologie au niveau du CIRCOSC.
M. Louis LE FRANC : Oui. Les autorités méditerranéennes en charge de la sécurité civile s'y rencontrent. Il y a des échanges. Des visites régulières sont organisées par ces pays au sein de cet organe opérationnel. Donc, il y a déjà une connaissance de leurs vis-à-vis dans l'espace méditerranéen.
M. le Rapporteur : Imaginons, je reviens sur ce scénario-là, qu'un bateau poubelle ayant des substances très toxiques passe à Gibraltar, personne ne le sait. Il arrive dans la zone, il y a une grosse tempête, des conteneurs ou des fûts, vont à la mer : que se passe-t-il ? J'imagine que vous avez fait de tels scénarios, c'est tout à fait possible.
M. Yvon OLLIVIER : Sur la nécessité de renforcer la structure de zone de défense, nous sommes en avance par rapport aux autres zones de défense du fait de l'existence du CIRCOSC de Valabre, qui est un centre opérationnel très pointu, très bien organisé, avec des moyens de liaisons très importants et qui fonctionne dans de très nombreuses occasions car, en matière d'incendie de forêt, avec l'Italie et l'Espagne, il y a des échanges fréquents de moyens. C'est plutôt dans le sens France vers Espagne et Italie, car nous sommes plutôt mieux dotés pour la lutte contre le feu. Les interventions sont fréquentes sur l'Espagne et l'Italie à travers le CIRCOSC.
M. le Rapporteur : On peut s'inspirer de cela.
M. Louis LE FRANC : Et maintenant à l'échelle zonale, je suppose que le préfet maritime a dû vous en parler hier, le CROSSMED, certes, avertit directement le préfet du département, mais aussi directement le CIRCOSC. Donc, il est tout de suite au courant d'une pollution qui pourrait s'orienter vers un des départements de la zone de défense. C'est l'organe opérationnel central sur lequel le préfet de zone s'appuie pour fonder son appréciation.
M. Yvon OLLIVIER : Cela existe déjà. On n'a pas besoin de mettre en place des liaisons pour transmettre au CIRCOSC puisqu'ils ont déjà l'habitude de travailler ensemble.
M. Edouard LANDRAIN : Qui sont les interlocuteurs du CIRCOSC dans les pays étrangers ? Est-ce la région, l'Etat ?
M. Yvon OLLIVIER : Le contact avec les autorités en charge de la sécurité civile de ce pays va de soi ; une information précise et complémentaire sur les questions zonales vous sera donnée cet après-midi.
Audition de M. Claude CARDELLA,
président du port autonome de Marseille,
président de la Chambre de commerce et d'industrie,
M. Joseph MOYSAN,
commandant du port autonome de Marseille,
et M. François AGIER,
directeur opérationnel du port de Fos,
(extrait du procès-verbal de la séance du 18 avril 2000 à Marseille)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
MM. François Agier, Claude Cardella et Joseph Moysan sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, MM. François Agier et Claude Cardella prêtent serment.
M. Claude CARDELLA : Bienvenue à Marseille. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous avons beaucoup travaillé il n'y a pas si longtemps avec M. Le Drian s'agissant de la réforme des ports.
Cette commission doit effectuer un travail extrêmement complexe, d'après ce que j'ai compris, et nous sommes tout à fait disposés à vous apporter les éléments que vous souhaitez.
Aussi, nous avons demandé à François Agier de faire la présentation du port de Marseille et au Commandant Moysan de répondre à toutes les questions que vous aurez à poser.
Ensuite, il y a une visite de navire prévue au port et nous nous retrouvons pour le déjeuner au Club House vers 13 heures.
M. le Président : M. le président, je voudrais vous remercier de votre accueil.
Nous sommes venus vous voir - pas uniquement d'ailleurs le port de Marseille, mais aussi le préfet maritime, ainsi que le préfet de la région PACA - car il nous a semblé en effet que, s'agissant d'un problème comme celui de la sécurité des transports maritimes pour les produits polluants ou dangereux, nous avions à regarder bien évidemment la façon dont les choses se passaient dans le secteur Atlantique, en Manche-Mer du nord, - nous avons effectué un déplacement au Havre et nous avons vu le préfet maritime de Cherbourg. Mais il eut été sans doute déplacé et en tout cas insuffisant de ne pas venir nous rendre compte de la façon dont les choses se passent en Méditerranée.
Nous avons déjà rencontré hier un certain nombre de personnes et de services : le préfet maritime, le CROSS, les douanes, les affaires maritimes.
A l'évidence, s'il existe des similitudes avec ce qui se passe sur la partie occidentale de notre pays, il y a aussi des différences.
Le port de Marseille est le premier port pétrolier de France. Rien que ce fait justifie notre présence ici. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus, pas uniquement pour faire plaisir, mais parce qu'un certain nombre de problèmes sont posés.
M. Claude CARDELLA : C'est aussi pour nous un plaisir de savoir que vous travaillez sur ce dossier extrêmement important pour la Méditerranée et pour Marseille. Donc, le tout fait que nous sommes très heureux de participer à cette réflexion.
Sans plus tarder, je vais demander à François Agier de vous présenter le port de Marseille.
M. François AGIER : Juste un mot pour excuser Eric Brassart, le directeur général du port, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Il m'a demandé de le représenter. Je suis le directeur de toute la partie ouest du port autonome, des bassins de Fos.
J'ai prévu de vous faire une présentation très rapide du port de Marseille avec quelques images et quelques chiffres.
Ensuite, le Commandant Moysan pourra vous détailler différents sujets qui ont davantage trait à la sécurité des navires.
Très rapidement, le port de Marseille, c'est tout d'abord deux sites, le site de Marseille et le site de Fos.
Pour avoir une idée des échelles, le site de Marseille, tel qu'il est représenté sur la carte, rentre à peu près dans la darse principale du site de Fos qui est ici. Nous disposons donc à Fos d'espaces beaucoup plus importants puisque la totalité de la zone représente 10 000 hectares.
Le port en quelques chiffres.
En termes de trafic, ce sont 60,07 millions de tonnes d'hydrocarbures par an, 13,76 millions de tonnes de vracs solides, 3,55 millions de tonnes de vracs liquides et pratiquement 13 millions de tonnes de marchandises diverses. En termes de conteneurs, cette dernière donnée représente 620 000 conteneurs et 1,65 millions de tonnes de soutage.
Nous assurons 40 % des besoins en pétrole brut nationaux.
Environ 1 500 personnes travaillent sur nos sites, dont 500 personnes à Fos, 500 personnes opérationnelles à Marseille, et à peu près 500 personnes au siège et dans les services centraux.
Juste quelques indicateurs financiers sur la période 1995-1999 pour souligner la forte augmentation de la marge nette d'autofinancement : nous avons réalisé un gros effort pour être en mesure de relancer des investissements qui étaient tombés à des niveaux bas en 1997-1998, afin de répondre véritablement aux besoins de rénovation d'un certain nombre d'installations et de modernisation pour les années à venir, selon un plan d'entreprise que le Conseil d'Administration a approuvé en juillet 1998 et qui prévoit, jusqu'en 2004, puis durant la période suivante jusqu'en 2010, un certain nombre de développements des installations.
Je vous présente rapidement l'organigramme afin que vous compreniez la logique de la structuration du port. Un secrétariat général s'occupe de toutes les affaires centrales.Deux directions opérationnelles sont en place, l'une à Marseille, l'autre à Fos. Je suis en charge de cette dernière.
La direction des trafics a pour mission de développer ce qui constitue le marketing portuaire, les produits que nous allons vendre, que ce soient les navettes ferroviaires, les navettes fluviales, les nouveaux marchés sur lesquels il peut y avoir des développements. La direction commerciale a vocation à assurer les relations avec le client.
Ensuite, un certain nombre de services sont rattachés directement à la direction générale. Il s'agit tout d'abord d'une mission sécurité sûreté au sens sûreté de la marchandise, principalement pour éviter le vol. Ensuite, il y a la capitainerie du port dont le Commandant Moysan a la charge. Il y a également une mission développement spécifique pour la logistique et toute la partie logistique de Fos, notamment avec la zone distriport, ainsi qu'une mission chargée de la coopération internationale.
Je voudrais maintenant vous montrer, car vous n'aurez pas la possibilité dans le délai imparti de voir l'ensemble des sites, trois des points de Fos qui sont peut-être les plus problématiques par rapport aux questions que vous avez à traiter aujourd'hui.
Le site de Lavéra est le terminal pétrolier hydrocarbure qui a été créé en 1950. Il est au centre d'une agglomération, relativement importante, formée par Martigues et Port-de-Bouc. Il reçoit à peu près 2 000 escales par an, aussi bien des gaziers ou des hydrocarbures raffinés que des chimiquiers. Sur le site, se sont développées des industries pétrochimiques et un certain nombre de dépôts : des produits chimiques avec des pontons capables de traiter jusqu'à six, sept produits en même temps pour ce que l'on appelle les navires multi-produits. De plus en plus, des navires avec des réservoirs séparés peuvent traiter différents produits. Nous avons donc un ensemble d'installations adaptées à ce type de trafic.
Ensuite, le deuxième site important, c'est le terminal pétrolier de Fos avec quatre grands pôles pétroliers qui traitent l'ensemble de l'approvisionnement en brut.
M. le Rapporteur : Ce n'est que du brut ? Il n'y a pas de brut du tout à Lavéra ?
M. François AGIER : Il y a un peu de raffiné à Fos, mais à Lavéra, il n'y a pas de brut du tout.
M. Joseph MOYSAN : La seule nuance que l'on peut y apporter, c'est que, par rapport au brut, certains naphtas que l'on reçoit à Lavéra, les naphtas 1, 2, sont classés en brut. Mais s'agissant du pétrole brut, il ne transite que par Fos.
M. François AGIER : Le brut, c'est sur Fos. Le naphta sur Lavéra est déjà un brut élaboré.
Le troisième point, c'est le terminal de conteneurs de Fos. Nous avons, comme sur tous les terminaux à conteneurs, à gérer un certain nombre de matières dangereuses avec des produits classifiés. Nous traitons une partie des trafics chimiques conteneurisés qui passent par là.
M. le Rapporteur : Quelle est la proportion de conteneurs sur le site de Fos par rapport au site de Marseille ?
M. François AGIER : Deux tiers, un tiers. Nous en avons 360 000 par an à Fos. Il y en a 140 000 dans les autres terminaux de Marseille.
En tout, le port, reçoit 600 000 équivalents 20 pieds par an.
M. le Rapporteur : Quelle est la distance entre les deux sites ?
M. François AGIER : A peu près 40 kilomètres.
M. le Rapporteur : Quels sont vos principaux concurrents, notamment dans le sud de l'Italie ?
M. François AGIER : En Italie, c'est Gênes et, en Espagne, c'est Barcelone. C'est un peu simplificateur de dire cela car, en Espagne, Valence fonctionne très bien et en Italie, il y a d'autres ports. Il y a Trieste, mais c'est de la concurrence qui concerne le trafic de pétrole brut.
Nous approvisionnons en pétrole brut les raffineries locales mais aussi, les raffineries proches de Lyon, le sud de l'Allemagne et la Suisse.
Pour ces deux derniers marchés, le port de Trieste est notre concurrent puisqu'il dispose, avec le pipe de l'OTAN, de la possibilité d'approvisionner ces raffineries.
M. le Président : Là vous nous donnez une photographie d'aujourd'hui, mais y a-t-il une évolution positive ou négative dans les transports de produits type pétrole ? Et pour les produits chimiques, où en êtes-vous ?
M. François AGIER : Les trafics sont relativement stables depuis ces dernières années. Il n'y a pas de progression importante.
Il est possible de constater un déclin du trafic global d'hydrocarbures, dû à une baisse de l'approvisionnement en pétrole brut car la consommation globale diminue.
M. le Président : Il n'y a pas une augmentation de l'importation des produits raffinés ?
M. François AGIER : Globalement, cela se traduit par une baisse. Il y a bien un peu plus d'importations de raffinés, mais pas suffisamment pour compenser la baisse des importations de brut, car la consommation nationale diminue et le raffinage s'effectue de plus en plus dans les pays producteurs, qui sont en train de s'équiper de raffineries. Nous avons aussi tout le problème de l'ensemble des raffineries qui, en 2003, tomberont sous le coup de la réglementation européenne concernant les rejets dans l'atmosphère et qui probablement fermeront car elles ne seront plus conformes.
Donc, nous constatons une baisse du trafic des hydrocarbures et nous anticipons une baisse encore plus forte d'ici à 2003.
Il y a à peu près 40 à 45 millions de tonnes d'hydrocarbures qui transitent par le port aujourd'hui et une baisse d'environ 5 à 6 millions de tonnes est attendue à terme.
Par contre, les trafics de chimie augmentent. Il y a une augmentation de plus en plus importante des vracs chimiques, aussi bien pour les produits de base que pour les produits à l'exportation.
M. Joseph MOYSAN : J'avais prévu de vous parler d'une escale, comment nous la préparons, la gérons, comment s'opèrent les opérations en temps réel, les opérations commerciales, le suivi des opérations commerciales, les opérations annexes, tout ce qui est avitaillement, et de détailler tout ce qui peut poser problème à un moment donné par rapport à vos préoccupations en matière de sécurité.
Je comptais aussi parler des déchets, tout ce qui est slops et sludges et des stations de déballastage de Fos et de Lavéra.
S'agissant des problèmes de pollution et de l'organisation mise en en place avec les marins pompiers, nous avons une spécificité à Marseille puisque, précisément, nous disposons de marins pompiers. Mais dans les bassins ouest, cela pose problème aujourd'hui. Le port autonome supporte seul la charge financière.
Un mot à propos du plan POLMAR par rapport aux différentes relations que nous avons avec la préfecture et les relations avec les affaires maritimes et le centre de sécurité.
Voilà tout ce que j'avais prévu, mais en une demi-heure, cela va être difficile.
M. le Président : Nous disposons d'un certain temps. La visite technique ne prend pas énormément de temps.
M. Joseph MOYSAN : Au niveau des installations du port de Marseille, un arrêté commun du préfet maritime et du préfet gère la circulation entre les bassins est et les bassins ouest, avec une définition des chenaux, un peu comme en Atlantique et en Manche, mais la particularité à Marseille est qu'il y a une zone dans laquelle le port est compétent en matière de circulation.
Vous pouvez voir les limites administratives du port sur cette carte. Pourquoi cette forme ? Une zone a été incluse dans les limites administratives du port pour les transbordements de navire à navire. La zone comporte à la fois le mouillage ouest du port, le mouillage est et le mouillage nord.
L'étang de Berre est divisé en deux zones, l'une sous la compétence du préfet maritime, et l'autre sous la compétence du préfet terrestre, zone portuaire dont nous assurons la police.
M. le Rapporteur : Cela ne vous paraît pas compliqué ?
M. Joseph MOYSAN : Effectivement, cela peut le paraître pour vous qui le découvrez. Ce qui pose vraiment problème, c'est l'étang de Berre. Ce n'est pas un problème nouveau.
Aujourd'hui, il y a une discussion entre la préfecture maritime et la préfecture des Bouches-du-Rhône sur la possibilité de confier tout ce qui serait plan POLMAR ou autres au préfet terrestre. Cela s'est déjà fait pour le plan de secours de l'aéroport, où le préfet maritime a confié la responsabilité des secours au préfet dans sa zone.
Hormis cette particularité pour l'étang de Berre, le reste est parfaitement géré, en collaboration étroite avec la préfecture maritime. Nous n'avons pas de problème particulier de ce point de vue.
Une question sera abordée cet après-midi par les maires : ils sont sensibles à la circulation des avitailleurs qui font la liaison entre Marseille et Fos. Ces bateaux passent relativement près de la Côte bleue. Je ne sais pas si la préfecture maritime vous en a parlé hier, mais il y a un groupe de travail sur le sujet pour les éloigner un peu du rivage, entre 2 et 3 milles. On ne peut pas non plus trop les éloigner car ce ne sont pas de très gros navires de mer. Il faut donc faire un choix pour la circulation de ces avitailleurs qui sont chargés de 2 à 3 000 tonnes de fioul ou de gasoil marine.
À Marseille, la surveillance du chenal d'accès pour les navires transportant des matières dangereuses nous incombe également.
Pour revenir un peu sur ce qu'a dit François Agier concernant les bassins est et ouest, les ratios, le nombre d'escales et les tonnages : on peut constater une diminution des tonnages, mais une augmentation du nombre d'escales.
Ceci est dû à l'augmentation des escales de navires de croisière et autres pour les bassins est. Pour les bassins ouest, c'est essentiellement dû à une augmentation générale du nombre des navires lors des années passées.
Le nombre d'escales de navires de pétrole brut s'établit à 461 navires, pour un tonnage de 45 millions de tonnes.
Pour les hydrocarbures raffinés : 636 navires pour 9 millions de tonnes.
Pour les vracs liquides transitant par Lavéra, Fos Pétrole, l'étang de Berre et Port Saint-Louis, je vous montre cette répartition car, cet après-midi, vous aurez aussi des questions de la part du maire de Martigues, M. Lombard, au sujet du trafic dans le canal de Caronte, depuis la mer pour accéder dans l'étang de Berre. Il pose des problèmes de sécurité car les navires passent en pleine ville, avec des produits chimiques et du gaz. Ce sont des navires de petite taille qui font de 120 à 130 mètres. Le maire y est sensible à juste titre. Il y a aussi quelques transports d'hydrocarbures.
M. le Rapporteur : Quels bateaux vont sur l'étang de Berre ?
M. Joseph MOYSAN : Les petits navires transporteurs de gaz, de produits chimiques et quelques navires transportant des hydrocarbures.
M. le Rapporteur : Où vont-ils ?
M. Joseph MOYSAN : Ils vont charger des produits chimiques à Berre, pour l'exportation. Ils font de l'importation ou de l'exportation de gaz chez Shell. Et chez Total, ils chargent des hydrocarbures.
M. François AGIER : La raffinerie de Shell est à la pointe de Berre et la raffinerie de Total est à La Mède. Ce sont les accès à ces deux raffineries qui se font à travers l'étang de Berre.
M. le Rapporteur : Pour les bateaux qui traversent Martigues, n'y a-t-il pas eu de transbordement avant ?
M. François AGIER : Ces bateaux vont en général directement sur les postes à quai privé de la raffinerie de Total et de la raffinerie de Shell.
M. le Rapporteur : Donc, c'est du brut d'une manière générale ?
M. François AGIER : Pas forcément.
M. Joseph MOYSAN : Non, il n'y a pas de brut. Il s'agit de produits chimiques, de gaz et d'un peu de produits raffinés.
M. François AGIER : On parle de la raffinerie de Shell, mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un complexe chimique. Toute la partie raffinerie a disparu. C'est assez récent, depuis deux, trois ans. S'agissant de Total, il s'agit de réexpédition de produits raffinés.
M. Joseph MOYSAN : C'est très limité.
M. François AGIER : Toute l'arrivée de brut se fait spécifiquement par Fos et ces produits sont stockés dans les trois dépôts du secteur.
M. le Président : On peut comprendre l'émotion du maire de Martigues s'il voit passer sous ses fenêtres des navires transportant des produits chimiques. Quelle catégorie ? Dangereux, pas dangereux ?
M. Joseph MOYSAN : Dangereux. Il y a des gaz, des produits chimiques comme le toluène... mais aussi des huiles industrielles qui ne sont pas dangereuses. Cela remonte à la création de tout ce complexe pétrochimique dans les années cinquante. Toutefois, les quantités ont beaucoup diminué. A l'époque, on faisait rentrer des navires pétroliers de 180 m dans l'étang de Berre. Aujourd'hui, les navires qui passent dans le canal de Caronte font 130 m maximum.
M. le Président : Y a-t-il un projet, un plan, des études pour modifier ce trafic ?
M. Joseph MOYSAN : Actuellement, non. Une partie des produits du complexe pétrochimique est traitée à Lavéra.
M. le Président : Quand on voit la façon dont - c'est aussi un peu annexe par rapport à notre préoccupation, encore que ces produits circulent sur des navires - les plans d'occupation des sols envisagent les choses à partir des contraintes de sécurité, notamment du fait de la directive Seveso, pour les mêmes produits que ceux que vous avez dans vos navires et qu'il faut maintenir à des distances plus que respectables de la moindre habitation, là, ces mêmes produits sont stockés sur des navires, passent dans un canal et, au bord de ce canal, je suppose qu'il y a des habitations.
M. Joseph MOYSAN : Oui, tout à fait.
M. le Président : On n'est pas à l'abri demain d'une réglementation européenne ou autre qui impose d'autres modes d'accès à des équipements comme ceux-là. Il n'y a pas d'étude menée là-dessus ?
M. Joseph MOYSAN : Actuellement, non.
M. François AGIER : Il y a deux sites.
Le site historique de Lavéra qui, quelque part, se situe dans la problématique que vous indiquez et pas loin d'habitations.
Le site de Fos et les terrains disponibles ultérieurement qui sont éloignés de toute habitation.
M. le Rapporteur : Là, il y a de l'espace.
M. François AGIER : C'est sur cet espace disponible que nous comptons, s'il devait y avoir un développement fort de la chimie. De plus, il s'agit d'un site lié à tout un tissu de raffineries.
M. Edouard LANDRAIN : A terme, vous envisagez la fermeture au trafic du canal vers l'étang de Berre ?
M. le Rapporteur : Pour l'instant, non.
M. François AGIER : C'est toute la logique de la raffinerie Shell de Berre qui s'écroulerait plus ou moins.
M. le Rapporteur : J'imagine que les élus du secteur ne veulent pas non plus la fermeture.
M. François AGIER : La raffinerie de Berre représente une très importante taxe professionnelle, non seulement pour la ville de Berre, mais aussi pour l'ensemble.
M. le Président : Il n'y a que Port-de-Bouc qui éventuellement proteste.
M. Joseph MOYSAN : C'est tout le problème de la région. Cet après-midi, le maire de Berre vous dira qu'il veut défendre son complexe pétrochimique car, derrière cela, il y a l'emploi et un certain nombre de revenus.
Le maire de Martigues, lui, a toute la zone de Lavéra.
On est un peu pris en sandwich entre le complexe pétrochimique de Lavéra, les installations portuaires et la ville de Port-de-Bouc en face qui ne perçoit pratiquement rien de toute la manne qui provient de cette zone.
M. le Président : Et qui appelle de ses v_ux une communauté de communes.
M. Edouard LANDRAIN : Ne peut-on pas imaginer une alimentation par des tuyaux en partant du grand complexe de Fos plutôt que de faire du trafic maritime dans un canal relativement étroit ?
M. Joseph MOYSAN : Le problème pour la chimie en particulier est que ce sont des petits lots de 500, 1 000 tonnes. Si vous avez un pipe qui vient de Shell Berre jusqu'à Lavéra pour faire ce genre de produits, il faudra pratiquement un pipe par type de produit. Ce n'est quasiment pas réalisable ou alors il faudrait un préstockage à Lavéra ce qui se fait déjà pour certains produits.
M. Edouard LANDRAIN : La commune de Martigues touche des royalties au passage des navires ?
M. Joseph MOYSAN : Non.
Je vous présente juste l'organigramme de la Capitainerie, mais je ne vais pas y revenir car j'ai eu mon collègue du Havre qui m'a dit vous avoir présenté un peu notre travail.
Notre organigramme est peut-être un peu différent de celui du Havre puisque nous avons deux sites, avec une organisation des bassins totalement identique à celle des bassins ouest, bien qu'ils nourrissent des préoccupations un peu différentes. Toutefois, nous avons calqué les deux organisations depuis deux ans, avec M. Agier et la direction générale, de façon à avoir les mêmes activités, la même répartition des tâches.
Je vous présente les chenaux de circulation maritime. Ils résultent d'un arrêté commun préfet maritime et du préfet terrestre. Vous pouvez visualiser le chenal montant, le chenal descendant, pour les navires de plus de 1 600 tonnes de jauge brute, transportant des vracs liquides. On l'applique également aux porte-conteneurs puisqu'un article dans cet arrêté le mentionne.
Pour Marseille, même chose. Les questions de sécurité sont moins préoccupantes puisque nous n'avons pas tous ces problèmes d'hydrocarbure, de produits chimiques et de gaz que l'on a sur la zone de Fos, mais par contre les passagers.
Je vous décris rapidement, le déroulement d'une escale. Voilà l'annonce d'un pétrolier relativement ancien. Annonce du navire par l'agent maritime, avec les informations dans le système informatique dont nous disposons au port. Le système de gestion des escales des navires (Logiciel) est un système ouvert. L'agent maritime annonce son navire. Il met une date d'arrivée, une date de départ.
M. le Rapporteur : Il annonce son navire par votre système interne informatique ?
M. Joseph MOYSAN : Par le système informatique. Il indique qui est le réceptionnaire, le type de produit transporté...
Vous retrouvez ici les tirants d'eau du navire, le « ok » de l'agent, c'est-à-dire que pour lui le navire est prêt à rentrer et il a reçu toutes les informations venant de son correspondant, donc de l'armateur.
Derrière, le travail fait par la capitainerie, avec le fichier navire qui comprend le tirant d'eau, la jauge brute, la jauge nette, l'année de construction, etc. C'est notre propre fichier, qui comprend toutes les informations que nous avons pu récupérer.
M. le Rapporteur : Il s'agit là du même bateau ?
M. Joseph MOYSAN : Oui, je vous montre le déroulement d'une escale.
M. le Rapporteur : La première fiche, c'est l'agent qui vous l'annonce ?
M. Joseph MOYSAN : Oui, et cela c'est notre propre fichier.
M. le Rapporteur : Et vous avez tous les bateaux ?
M. Joseph MOYSAN : Nous avons tous les bateaux qui passent par Marseille. Quand un nouveau navire nous est annoncé, nous l'enregistrons et le rentrons dans notre fichier. Nous prenons des informations soit dans le Lloyd's, soit, s'il n'est pas référencé, nous demandons à l'agent de nous envoyer un certificat.
M. le Rapporteur : Comment s'appelle votre fichier ?
M. Joseph MOYSAN : C'est le fichier dans le logiciel ESCALE.
M. François AGIER : Nous avons le logiciel escales et un second logiciel dédié à la marchandise (PROTIS).
M. Joseph MOYSAN : Ensuite, des actions sont menées pour l'attribution du poste.
Vous retrouvez ici, sur une autre fiche, le « ok » de l'agent, de l'exploitant, c'est-à-dire les installations pétrolières ou du raffineur si l'on travaille en direct avec le raffineur, le « ok » du placement navire. Je ne parle pas trop du « ok » de vigie : puisqu'il est déjà mis parce qu'il s'agit d'une escale réalisée, mais, dans la pratique, il n'intervient qu'à l'entrée réelle du navire dans le port.
C'est un logiciel partagé.
M. François AGIER : C'est un système de gestion informatique.
M. le Rapporteur : Cela s'appelle le fichier escales ?
M. Joseph MOYSAN : Tout cela, c'est le système escale des navires (Logiciel).
M. le Rapporteur : Je vous laisse finir car ma question portera sur l'articulation entre ce système-là et le système d'information sur les normes des bateaux, sur leur qualité et sur l'accès aux informations.
M. Joseph MOYSAN : Il n'y a pas de lien entre eux. Ce que je vous montre concerne uniquement le port. C'est un outil du port mis à la disposition de la communauté portuaire, des agents maritimes, du port et des services du port pour pouvoir travailler et échanger les informations.
Dans ce système, il y a également un système de messagerie.
Nous sortons une feuille de prévisions, deux fois par jour qui détaille les navires attendus en rade, les navires attendus à quai, les mouvements de poste à poste et les sorties.
La vigie peut intervenir à tout moment : si tout le monde est bien d'accord, l'opération peut se dérouler. Si quelqu'un n'est pas d'accord, le navire va au mouillage. Il ne rentre pas à quai. A partir du moment où l'on n'a pas tous les feux verts, le navire ne rentre pas et il va en mouillage.
M. le Rapporteur : Ce sont les feux verts techniques ?
M. Joseph MOYSAN : Oui. A l'entrée, un numéro d'escale est attribué, la date et l'heure constatées d'entrée dans le port.
L'officier de port assiste à l'accostage du navire. Dans l'exemple présenté, le navire est entré à 14 heures 55, avec un tirant d'eau de 15,40 m. Il a utilisé trois remorqueurs. L'officier de port a fait sa visite quelque temps plus tard.
M. le Rapporteur : Sa visite ?
M. Joseph MOYSAN : Visite sécurité. Nous verrons après les points que nous vérifions. Il fait une visite sécurité/opération commerciale.
M. le Rapporteur : Je ne comprends pas. Il serait bien que l'on puisse avoir le commentaire que vous faites sur ces fiches en plus de l'enregistrement.
Pour revenir à la visite sécurité, c'est une sécurité marchandises ?
M. Joseph MOYSAN : A l'arrivée du navire, un contrôle est fait par la vigie sur la circulation et l'entrée du navire.
Un officier de port est sur le terrain et va à l'accostage du navire. Il constate les problèmes liés à la grande voirie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'avarie aux ouvrages, pas de problème particulier. Ensuite, il fait une visite sécurité. Il contrôle que la check-list a bien été remplie et que tout est en ordre.
Je vais vous montrer les points qu'il va regarder quand il va faire cette visite.
M. Edouard LANDRAIN : C'est vous qui faites la check-list ?
M. Joseph MOYSAN : La check-list est une obligation réglementaire préconisée par l'OMI et intégrée à la réglementation française.
M. le Rapporteur : L'officier de port fait cela quand le bateau arrive ?
M. Joseph MOYSAN : A son arrivée, il assiste à l'accostage. Une ou deux heures après, il revient et il vérifie tous les problèmes liés à la sécurité des opérations, à la pollution : vérification que tous les panneaux sont fermés, qu'il n'y a pas d'échelle de pilote le long du bord, pour éviter que quelqu'un puisse monter à bord depuis la mer, que les remorques de sécurité à l'arrière et à l'avant sont en place, de façon à pouvoir sortir le navire en cas de gros pépin ou de sinistre, que l'amarrage est correct...
M. le Rapporteur : C'est une recommandation de l'OMI, mais qui vise à assurer la sécurité du navire dans le port ?
M. Joseph MOYSAN : C'est avant tout pour assurer la sécurité du navire dans le port. C'est notre souci. Je ne suis pas sûr que ce soit pareil dans tous les ports, mais à Marseille, voilà ce que l'on fait.
Nous avons un souci particulier du fait de la concentration de pétroliers, chimiquiers et gaziers dans nos installations. C'est pour cette raison que tout cela a été mis en place.
Par rapport aux règles de l'OMI, la check-list est obligatoire.
M. Edouard LANDRAIN : C'est appliqué ici, pas nécessairement ailleurs ?
M. Joseph MOYSAN : Tout est appliqué sur les terminaux du Port Autonome de Marseille.
M. le Rapporteur : Quel est le lien entre la check-list, l'action de l'officier de port et le centre de sécurité du navire ?
M. Joseph MOYSAN : Pour l'instant, il n'y en a pas, sauf en cas d'accident ou d'incident.
M. le Rapporteur : Donc, nous parlons uniquement de la sécurité du bateau dans le port ?
M. Joseph MOYSAN : Oui. D'ailleurs j'avais prévu de vous parler, à la fin de mon intervention, de nos relations avec le centre de sécurité.
M. le Rapporteur : Admettons que le navire est bien amarré et que tout est en ordre. S'il y a un risque, comment procède-t-on à son déplacement ?
M. Joseph MOYSAN : Nous pouvons effectuer ou faire effectuer un mouvement d'office à un navire (Code des Ports).
Pour les navires de brut, nous donnons un certain nombre d'autorisations, notamment pour le lavage au crude. L'agent maritime doit formuler une demande de lavage en crude, au nom du navire.
M. le Rapporteur : Qu'entendez-vous par demande de lavage au crude ?
M. Joseph MOYSAN : Les navires pétroliers, tout particulièrement ceux transportant du brut, pour des raisons de sécurité et commerciales, font du lavage avec leur propre pétrole pour éviter les dépôts en fond de citerne et la corrosion sur toutes les parois de citerne. C'est une recommandation. Il y a aussi un aspect commercial car tout ce qui reste dans les fonds de citerne c'est de la perte sèche à la fois pour l'armateur, mais aussi pour le vendeur de la cargaison. Le réceptionnaire ne prend en compte que ce qu'il a bien reçu.
Liées aux opérations d'escale, un certain nombre d'opérations sont nécessaires, l'avitaillement et autres, qui posent des problèmes de sécurité, mais nécessaires pour le navire.
Tout cela est relativement réglementé afin de pouvoir travailler en toute sécurité dans le port.
Aujourd'hui, nous avons des difficultés à faire respecter ces règles car l'avitaillement est une nécessité, l'armateur a tout intérêt à le faire en temps masqué pour éviter des retards. Un certain nombre de règles tirées de l'arrêté de 1951 commencent à être un peu vieillottes.
M. le Président : Pouvez-vous expliciter la notion de temps masqué ?
M. Joseph MOYSAN : Quand on parle de temps masqué, c'est qu'une opération a lieu pendant une opération commerciale.
M. le Président : En fait, d'autres activités se font pendant le déchargement ou le chargement ?
M. Joseph MOYSAN : Tout à fait. Nous l'avons codifié. Selon le cas, elles peuvent se faire avant, pendant les opérations ou après les opérations. Selon le type de danger auquel on est exposé, les règles sont différentes. Une table d'aide à la décision permet de voir comment il est possible de gérer ces opérations annexes pendant l'escale du navire. Des opérations sont autorisées pendant le chargement ou le déchargement selon le type. Pendant le chargement, peu de choses sont autorisées en principe puisque vous avez le risque de dégagement dans l'atmosphère de gaz explosif.
M. Edouard LANDRAIN : Quels sont les produits qui résultent des opérations de nettoyage des citernes ?
M. Joseph MOYSAN : Les slops sont les produits issus de lavage des citernes. Vous avez transporté, par exemple, du fioul et vous voulez transporter derrière du gasoil, de l'essence, Commercialement, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligés de laver vos citernes. Vous faites un lavage à l'eau froide ou chaude. Vous obtenez un résidu que l'on appelle du slops. Les sludges étant les eaux sales d'exploitation du navire, les résidus des machines.
M. Edouard LANDRAIN : Qu'en fait-on ?
M. Joseph MOYSAN : Nous en reparlerons après.
Nous séquençons les opérations pour la sécurité des navires produits chimiques, les multi-produits notamment, car les transporteurs, des navires de 200 m, peuvent avoir entre 30 et 40 citernes.
En principe les gros lots sont débarqués d'abord et les petits lots ensuite pour avoir un gain de temps sur l'opération, mais aussi pour le faire en toute sécurité. En fait, on ne démarre pas toutes les opérations et tous les produits en même temps. Les opérations sont séquencées, les petits lots se faisant en temps masqué des grands lots.
Pour l'entrée des navires et la sécurité dans le port, quand il faut ouvrir les citernes d'un navire pétrolier, chimiquier ou gazier dans le port, nous demandons l'intervention d'un chimiste, selon la réglementation portuaire en vigueur, afin d'obtenir les valeurs conformes à la réglementation portuaire.
Ce n'est pas directement lié à votre mission, mais je vous montre un peu comment nous travaillons par rapport à l'ensemble des opérations effectuées dans le port.
Pour vous donner une petite idée de ce que cela peut représenter sur une année, c'est-à-dire l'année 1999, il y a eu 43 lavages à l'eau des navires qui ont changé de produit ou qui ont été amenés pour réparation, 91 interventions chimiques et 99 autorisations de travaux.
S'agissant des autorisations spéciales qui concernent les avitaillements, l'embarquement de pièces, de vivres ou le traitement des slops ou des sludges : il y a eu 2 300 autorisations l'an dernier.
Une particularité doit être également notée s'agissant du transbordement. C'est en effet une opération à risque que nous soumettons à certaines conditions, que ce soit en rade ou à quai.
Dans la rade, nous les limitons aujourd'hui aux hydrocarbures et au gaz. Auparavant, la zone de transbordement dépendait du préfet maritime.
M. le Rapporteur : C'est-à-dire ?
M. Joseph MOYSAN : Elle relevait de la zone régie par le préfet maritime. Maintenant, elle dépend du port. Elle se trouve dans les limites administratives sous compétence du préfet terrestre.
Avant, c'était le préfet maritime qui fixait les conditions de transbordement, aujourd'hui, c'est nous qui le faisons, tout en avertissant le préfet maritime. C'est toutefois limité aux hydrocarbures, aux gaz et à quelques produits un peu similaires aux hydrocarbures que sont l'éthanol et le méthanol.
M. le Rapporteur : Y a-t-il de nombreuses opérations de transbordement dans l'année ?
M. Joseph MOYSAN : Très peu, mais c'est une opération à risque que nous maîtrisons.
M. le Rapporteur : Cela fait combien d'opérations ?
M. Joseph MOYSAN : En rade, on doit en faire trois ou quatre par an.
Par contre, à quai, il s'en réalise beaucoup plus. L'avantage est que cela se déroule dans des installations où il est plus facile de maîtriser une pollution éventuelle.
Comment fait-on face aux sinistres ou aux éventuels pépins ?
Nous avons un plan d'urgence port en cours de refonte, un peu comme le plan POLMAR, la préfecture a dû vous le dire. L'ancien est toujours en service, mais un peu dépassé.
M. le Rapporteur : De quand date l'ancien ?
M. Joseph MOYSAN : Le dernier plan doit dater de 1991 ou 1992. Il a quand même quelques années. Il y a eu une grosse évolution à la fois dans l'organisation du port et dans les services.
Je ne vais pas vous détailler l'objet de ce plan, cela prendrait beaucoup de temps. Il comprend notamment l'organisation générale de la lutte contre les sinistres dans les ports, c'est-à-dire le rôle du maire, du SDIS et du CIRCOSC, etc... Particularité marseillaise : il y a le CODIS et le COSSIM, le COSSIM étant l'organisme équivalent du CODIS, mais pour les marins pompiers.
S'agissant des centres de secours susceptibles d'intervenir dans le port, à Marseille, tout va bien, car il n'y a qu'une commune. Par contre, dans les bassins ouest, il y a six communes concernées.
Nous avons par ailleurs des protocoles d'assistance avec des industriels dans la zone de Fos. Tous les industriels dans cette zone sont soumis à la directive Seveso et ont établi des plans particuliers d'intervention (PPI) et POI. Nous en sommes partie prenante, au même titre que la police ou les grands services de l'Etat. Ces plans comprennent toutes les fiches réflexes pour déclencher une alerte.
Dans les installations des bassin ouest, il y a aussi une particularité pour les installations pétrolières. Par une démarche volontaire, nous avons créé l'équivalent d'un POI pour les industriels, alors que les installations portuaires n'ont pour l'instant pas l'obligation d'en établir un. Cela va le devenir, car il y a une étude en cours par le secrétariat général de la mer, le ministère de l'Intérieur et la direction des ports. Cela ne va pas tarder à être mis en place, mais jusqu'à présent il n'y en avait pas l'obligation.
Par contre, il y a eu une démarche volontaire de la part de Marseille, avec la DRIRE et avec tous les organismes concernés, pour créer un POI à Lavéra et un POI à Fos.
Le POI de Lavéra est terminé.
M. le Rapporteur : C'est interne au port ?
M. Joseph MOYSAN : Oui. Tout ce que je vous montre est interne au port. C'est le plan portuaire de sécurité tel qu'il va être défini par la commission qui travaille aujourd'hui au niveau du secrétariat général de la mer.
Pour revenir à notre rôle en matière de PPI et POI, PPI surtout, sur le site de Lavéra, vous avez un PPI très complexe puisque tous les industriels sont dans un PPI global. En cas de problème, on connaît les rayons de danger, il y a des risques d'explosion, d'asphyxie, d'intoxication, de pollution.
Les points d'arrêt impératifs sont par exemple : canal du Rhône, pont de St Gervais, etc.
Lorsque l'officier de port de vigie reçoit l'appel venant de la préfecture ou venant de l'industriel en disant de déclencher un PPI, il a une fiche réflexe précise pour engager les actions qu'il a à mener. Il doit vérifier qu'il n'y a pas de navires engagés et les faire s'arrêter au bon point pour éviter qu'ils ne rentrent dans la zone à risque.
Dans l'ancien plan, mais on retrouve également cet élément dans le plan actuel, était comprise la lutte antipollution, qui vous concerne de plus près en cas de pollution traitable par les moyens locaux, sans déclenchement du plan POLMAR.
M. le Rapporteur : Si le plan POLMAR est déclenché, vous participez à la cellule de crise du préfet des Bouches-du-Rhône ?
M. Joseph MOYSAN : Nous sommes partie intégrante de la cellule de crise et nous devenons prestataires de service, c'est-à-dire que le port devient un prestataire comme n'importe quelle entreprise. Le préfet peut réquisitionner les moyens dont nous disposons pour mettre en _uvre le plan POLMAR.
Comment nous insérons nous au niveau du plan POLMAR ? Notre plan comprend également les PC fixes, les différents PC opérationnels et les PC avancés, en coordination avec ceux prévus dans le plan POLMAR..
M. le Rapporteur : Les PC opérationnels sont activés quand il y a crise, pas autrement ?
M. Joseph MOYSAN : Non, ils ne sont pas activés autrement. C'est uniquement en cas de déclenchement du plan POLMAR ou de problème grave.
Le port dirige les opérations de secours si cela se situe dans ses installations, sous l'autorité du préfet.
Il y a quand même la particularité du Golfe de Fos. Vous avez pu constater l'étendue de cet espace qui dépend du port. Il pourrait y avoir un jour un déclenchement du plan POLMAR si le sinistre qui s'y déroulait était important.
Je vous montre juste une fiche réflexe pour mémoire. Voilà le scénario : alerte incendie, pollution par un navire chimiquier à quai. Vous retrouvez les marins pompiers, l'officier de secteur, l'officier de permanence, le commandant de port, toute la chaîne des différentes personnes à prévenir.
Avec cela, il y a une page d'aide à la décision pour le chef de quart.
Les premières mesures à prendre sont le sauvetage des personnes, la protection des biens, la vérification de la disponibilité du pilotage et du remorquage, la mise à disposition d'engins, le transport des marins pompiers à bord, l'évacuation de l'équipage, la consultation de la liste des produits. Il faut tenter d'évaluer rapidement les risques d'explosion, de pollution, d'asphyxie, d'intoxication, prendre les premières mesures de confinement et mettre en place la police du plan d'eau.
Ce n'est pas un guide à suivre, pas quelque chose de catégorique. C'est une première fiche de réflexion pour le chef de quart de vigie en attendant que les autorités arrivent.
Je vais vous parler rapidement du déballastage. Je ne vous parlerai pas des colis, du transport de produits chimiques en conteneurs, qui pose des problèmes spécifiques, mais mon collègue Brévault, du Havre, qui fait 1,2 million de conteneurs, c'est-à-dire deux fois plus que nous, a dû vous l'expliquer plus largement. C'est pour cette raison que j'ai davantage orienté mon intervention sur les vracs liquides, car la différence avec Le Havre se situe là.
Voilà la check-list dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous trouvez tous les éléments : le navire est-il bien amarré ? Les remorques d'urgence sont-elles prêtes ? Le navire est-il prêt à se déplacer ? On retrouve tous les éléments que l'on a vus tout à l'heure sur la fiche de rappel qu'a l'officier de port lorsqu'il visite le navire.
Enfin, voilà le règlement local pour le transport de matières dangereuses. C'est l'arrêté préfectoral qui se rajoute à l'arrêté de 1951.
M. le Rapporteur : Vous avez dit que l'arrêté de 1951 était obsolète. Si vous pouviez nous en dire plus sur ce sujet et nous indiquer ce qu'il faudrait modifier selon vous.
M. Joseph MOYSAN : Il est obsolète surtout parce qu'il date de 1951 et qu'à cette date, il n'y avait pas les transports modernes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conteneurs. Toute cette évolution dans le transport maritime n'a pas été prise en compte et ne l'est pas encore à l'heure actuelle. Le projet est sur les rails dans les différentes commissions interministérielles.
Juste deux mots sur le déballastage.
Il y a deux stations de déballastage, l'une à Fos, l'autre à Lavéra. On y procède à la décantation et ensuite à la valorisation du produit.
M. le Président : Les deux stations ont des vocations identiques ?
M. Joseph MOYSAN : Elles ont des vocations identiques et, comme ce sont deux sites totalement séparés, il fallait bien pouvoir recevoir les effluents à un moment ou à un autre.
Les tonnages déversés dans ces installations, environ 440 000 tonnes en 1999, sont en diminution depuis le début de l'année 2000.
M. le Rapporteur : Cela représente quoi 440 000 tonnes ?
M. Joseph MOYSAN : Cela ne veut pas dire grand chose. Le port de Fos est essentiellement un port de réception de produits. Donc, on ballaste plus que l'on ne déballaste. 400 000 tonnes, par rapport au nombre de navires, cela peut paraître faible.
M. le Président : Pourtant ce n'est pas un problème de coût.
M. Joseph MOYSAN : Non, ce n'est pas un problème de coût car nous facturons 94 centimes la tonne.
M. le Président : C'est plus un problème de temps passé. On peut déballaster ailleurs sans perdre de temps.
M. le Rapporteur : 440 000 tonnes de produits...
M. Joseph MOYSAN : Hydrocarburés. Il y a surtout de l'eau avant décantation. Les navires, en principe, ont fait une partie de leur décantation à bord et ils nous envoient le reste, sauf pour ceux qui font du lavage à quai, qui laissent la totalité, qu'il s'agisse de lavage à l'eau chaude ou à l'eau froide.
M. le Rapporteur : Le fait que cela baisse depuis le début de l'année...
M. Joseph MOYSAN : Cela a augmenté en 1999 puisque l'on était à peu près à 350 000 tonnes en 1998, contre 440 000 tonnes en 1999.
Inversement, depuis le début de l'année, on voit que cela baisse. J'en ai discuté avec le chef de service du pétrole. On pense que c'est dû à l'affrètement de navires plus récents suite à l'Erika.
M. le Président : Connaît-on le nombre d'escales et le nombre de navires qui pourraient déballaster ?
M. Joseph MOYSAN : Je ne sais pas.
M. le Président : Vous ne quittez pas le port si vous n'avez pas un certificat de déballastage ?
M. Joseph MOYSAN : On va y arriver avec les obligations européennes.
M. Edouard LANDRAIN : Le jour où il y aura cette obligation, êtes-vous en mesure de pouvoir le faire avec tous les navires ? Avez-vous potentiellement la capacité à le faire avec les deux postes ?
M. Joseph MOYSAN : En termes de capacité, on a la possibilité de recevoir. Le problème sera le contrôle. Il faut être très réaliste. Pour tout ce qui est déchets, au sens de la directive en cours de discussion, que l'on souhaiterait appliquer même par anticipation, la vraie question est de savoir qui contrôle et comment.
Si le Gouvernement souhaite appliquer rapidement la directive en préparation en matière de déchets, un des problèmes qui va se poser, c'est qui contrôle et les moyens qu'il faut pour le faire.
M. le Rapporteur : Je vous propose que l'on parle de cela à table car c'est un sujet important. D'autant plus que le projet de transposition de directives en matière de transports - on s'en préoccupe un peu - va être discuté bientôt à l'Assemblée et passera au Sénat avant fin juin.
Il est probable que l'on amende le texte pour anticiper sur l'application de la future directive européenne sur le déballastage. Cela va devenir l'actualité dans les semaines à venir avant même que le rapport soit rendu.
M. le Président : On peut toujours adopter un texte superbe, s'il n'y a pas les moyens de l'appliquer, cela ne sert à rien.
M. Joseph MOYSAN : Globalement, au niveau international, les textes existent en la matière. On va les amender, mais comment va-t-on les appliquer ? Les ports ont-ils tous les moyens de réception pour le faire et qui va contrôler ?
M. le Rapporteur : C'est un de nos sujets aussi.
Audition de Mme Maryse CANEPA,
maire-adjoint de Carry-le-Rouet,
M. Bernard CHABLE,
conseiller municipal de Martigues, délégué à la mer,
M. Sauveur RIBATTI,
maire-adjoint de Berre l'Etang,
M. André VARDARO,
maire d'Ensuès-la-Redonne, président du parc marin
M. Paul VIDEAU,
conseiller municipal de Berre l'Etang,
vice-président du Multipôle de l'Etang de Berre
et délégué à l'environnement
(extrait du procès-verbal de la séance du 18 avril 2000 à Marseille)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Mme Maryse Carnepa, MM. Bernard Chable, Sauveur Ribatti, André Vardaro et Paul Videau sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, Mme Maryse Carnepa, MM. Bernard Chable, Sauveur Ribatti, André Vardaro et Paul Videau prêtent serment.
M. André VARDARO : Je suis un maire sans étiquette politique ; il y a 30 ans que j'officie. Je dirai exactement ce qui se passe, surtout en tant que représentant des maires de la Côte bleue, qui comprend les communes qui partent à l'ouest du port de Marseille, à notre droite en regardant la mer, et allant jusqu'à l'entrée du canal de Caronte qui regroupe la commune de Rognes, Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins et une partie des Martigues.
Martigues est l'un des plus grands complexes européens de pétrochimie, un peu comme du côté du Havre, que je connais bien aussi. Ayant toujours travaillé dans la pétrochimie, je sais quel type de produits y sont traités.
Il y a 17 ans, en concertation avec les maires des communes précitées, toutes tendances politiques confondues, nous avons constitué un parc marin qui est un peu le fleuron en Méditerranée puisque, jusqu'à ces jours derniers, nous étions le plus grand parc protégé de Méditerranée, avec deux réserves intégrales, l'une de 210 hectares et l'autre de 85 hectares. Nous avons mené une collaboration étroite entre les professionnels de la pêche, les comités locaux de pêche et les prud'homies de pêche. C'est quelque chose de très important, nous avons fait progresser la faune et la flore, et notamment la quantité du poisson. Tout le monde est satisfait du résultat.
Depuis quelques années, nous faisions quelques remarques auprès des Affaires maritimes, puisqu'en permanence le port de Marseille est relié avec les bassins ouest, le port de Fos et celui de Lavéra, avec des automoteurs ou des engins qui transportent des produits pétroliers, des produits chimiques - on ne sais pas toujours ce qu'ils transportent. Mais on sait qu'ils passent au plus près des côtes, pour avoir un parcours le plus court possible pour rejoindre Marseille.
Au début, nous croyions que c'était des engins qui faisaient environ 600 tonnes mais nous savons désormais par l'Administration qu'ils font jusqu'à 2 000 tonnes. Nous craignons pour nos côtes rocheuses, très escarpées, difficiles d'accès et à défendre, en cas d'incident, surtout que ces engins n'ont qu'un moteur de propulsion, une simple panne avec un vent d'ouest de force 6 ou 7, et c'est vite fait d'être drossé sur la côte.
Sur ma commune, j'ai eu deux petites marées noires ; ce n'était ni des incidents, ni des accidents, mais c'était du déballastage accidentel, ou peut-être le contrôle n'étant pas effectué, ils en ont profité pour vider les ballasts et les déchets des machineries. Cela a coûté assez cher à la commune. Il est difficile de se débarrasser de certains produits, on le voit actuellement sur la côte Atlantique.
Nous avons toujours été préoccupé par ce problème et à plusieurs reprises nous avons adressé à l'administrateur des Affaires maritimes des courriers pour essayer de faire repousser plus au large le trafic et pour que soient étudiés les moyens de secours adéquats en cas d'incident.
Je peux parler au nom de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône, ayant été chargé de m'occuper du plan POLMAR terre. Depuis quelques années, nous avons pris conscience, au niveau départemental, de la nécessité de défendre et protéger la mer.
Sur le littoral de la Côte bleue, nous observons tous les jours des dangers. Nous avons bien une organisation prévue en cas d'accident, mais nous aimerions que ce trafic soit repoussé le plus loin possible de notre rivage. Les navires passent en effet dans la bande des 300 mètres...
S'agissant des précédentes pollutions, nous avons réussi à intervenir puisque c'étaient des produits légers et à mettre des barrages, mais cela a coûté 60 000 francs à ma commune.
Voilà pour la commune d'Ensuès-la-Redonne, et surtout pour le parc marin.
Le suivi scientifique est permanent.
M. Bernard CHABLE : Nous avons les mêmes soucis que M. le maire d'Ensuès-la-Redonne, puisque les péniches croisent très près des hauts fonds et du cap à contourner pour se diriger vers Fos ou Lavéra.
Par ailleurs, le souci de la ville était plutôt, en cas d'accident, d'être prête à intervenir : en particulier, quels moyens pourraient être prépositionnés en permanence, de telle manière qu'en cas de sinistre, on puisse intervenir rapidement.
L'autre souci qui s'est fait jour dans la catastrophe de l'Erika était : comment se débarrasser des produits ramassés et où les stocker ?
Après la catastrophe de l'Erika, on a réglé les choses à chaud.
C'est à peu près tout ce que nous avons à dire sur ce chapitre, puisque le maire de Martigues a été l'un des premiers à interpeller le Gouvernement là-dessus.
M. Paul VIDEAU : Le multipôle de l'Etang de Berre est un district qui, par définition, est condamné à disparaître ou à se modifier, il comprend : Rognac, Saint Chamas, Berre, Velaux, Lançon-de-Provence, La-Fare-les-Oliviers et Berre-l'Etang.
Notre particularité est que nous sommes tout autour de l'Etang de Berre. Il y a quelques mouvements de petits navires, car pour traverser l'étang il faut un faible tirant d'eau. Notre souci majeur porte sur les oléoducs qui traversent l'étang dans tous les sens. Ce n'est pas du transport maritime, mais cela suscite aussi de grosses interrogations.
Nous sommes allés en délégation à Lorient, nous avons rencontré le préfet à Rennes et le vice-président de la communauté de Lorient.
M. le Rapporteur : Je suis le président de la communauté de Lorient.
M. Paul VIDEAU : C'était le maire de Hennebont.
M. le Rapporteur : C'est le vice-président, chargé de la sécurité.
M. Paul VIDEAU : Il y a environ un mois.
Il nous est apparu, au cours de ces visites, que la liaison entre POLMAR-mer et POLMAR-terre avait été mal assurée. Cette articulation semble tarder à se mettre en place au niveau de l'Etang de Berre. Or, il s'agit d'une petite surface, et nous serions perdus dans les heures qui suivraient en cas d'incident.
On ressent de plus en plus à travers les médias cette fameuse question pollueur/payeur. D'après le peu de discussions que nous avons eues, en définitive c'est la commune qui a fait l'avance des frais, puis a pris contact avec le FIPOL, système que je trouve bizarre et qui a l'air très lourd à man_uvrer.
Je me demande comment une commune, qui se trouve face à de telles difficultés, peut arriver à gérer ce genre de problème. Il y a tous les problèmes d'intendance.
Mme Maryse CANEPA : Je confirme les déclarations faites par M. Vardaro, maire d'une commune qui jouxte la nôtre.
Naturellement, notre gros souci porte sur le fait que ces fameux bateaux passent très près de la côte et que la commune n'est pas équipée pour intervenir rapidement en cas d'incident. Les accès à notre commune sont restreints, nous serions dans l'incapacité d'intervenir immédiatement en cas d'incident sur le littoral de notre commune.
M. Sauveur RIBATTI : Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. Videau, puisque c'est la même commune.
M. Paul VIDEAU : Nous étions ensemble à Lorient.
M. le Rapporteur : Avez-vous été bien reçus ?
M. Paul VIDEAU : Oui.
M. le Rapporteur : Dans les différentes communes, êtes-vous amenés à discuter du plan POLMAR-terre et de son actualisation ?
Dans la gestion du plan POLMAR-terre, ne serait-il pas souhaitable que, d'une manière ou d'une autre, les maires soient associés ? De quelle manière pensez-vous que c'est possible ?
M. Paul VIDEAU : Pour POLMAR-terre, nous avons réfléchi, mais il faudrait que nous soyons encadrés par des services de l'Etat.
M. André VARDARO : Depuis deux ans, le département des Bouches-du-Rhône, connaissant toutes ces difficultés, a travaillé avec la préfecture. Je parle au nom de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône qui a fait une étude des responsabilités et des risques au niveau du département. C'est un département très dangereux puisque nous avons plusieurs sites type Seveso.
La préfecture est en train de réaliser des plans de prévention et de sécurité. Nous avons abordé la question des transports maritimes dans le cadre du plan POLMAR-terre qui est en cours d'actualisation. Le rapport n'est pas terminé, ce sont les services préfectoraux qui le réalisent.
Des réunions sont préconisées pour assurer la concertation avec tous les maires et pour essayer de programmer les interventions. A ce jour, rien n'a été fait, c'est en cours de réalisation. Ce naufrage de l'Erika activera peut-être les décisions préfectorales de relance des plans de prévention et de sécurité.
L'élaboration et la mise à jour de ces documents sont très importants. Plusieurs réunions ont eu lieu, mais le document définitif n'a pas encore été imprimé.
M. le Rapporteur : Les plans de prévention... ?
M. André VARDARO : Mer et terre. C'est la préfecture qui a ces dossiers directement à l'étude.
M. le Rapporteur : C'est le plan POLMAR ?
M. André VARDARO : Les deux en même temps, on mène tout ensemble : POLMAR-mer et POLMAR-terre.
M. le Rapporteur : C'est en révision et vous êtes acteurs ?
M. André VARDARO : Oui.
L'Union des maires souhaite que, dès que les documents seront publiés, l'information soit donnée à l'ensemble des maires concernés par ces problèmes.
Toute l'analyse a été faite, il a bien été établi que sur la Côte bleue une réunion doit être organisée par le sous-préfet, M. Fromion, pour informer les maires des dispositions nécessaires en cas d'incident. A ce jour, rien ne nous a encore été distribué, mais l'étude est faite et elle est en cours d'impression.
M. le Rapporteur : Que pensez-vous de la présence des maires dans le processus décisionnel de POLMAR-terre ? On s'aperçoit en effet que de nombreux moyens municipaux doivent être mis en _uvre en cas de sinistre.
M. André VARDARO : Les communes n'ont pas toutes les moyens nécessaires, qui peuvent dépendre du service départemental de sécurité d'incendie et de secours, puisque nous sommes l'un des derniers départements qui est en train de réaliser la départementalisation du service de secours et d'incendie. Cette organisation sera peut-être difficile à mettre en place, car la ville de Marseille a un bataillon de marins pompiers, et les autres communes sont sous l'égide du Conseil général, qui règle les problèmes du service départemental de secours et d'incendie.
Dans les mesures de préventions à prendre, il faut déterminer les secteurs et les lieux d'intervention ainsi que le type des matériels à mettre en _uvre. Les inventaires ont été faits, mais rien n'a été communiqué aux collectivités.
M. le Rapporteur : Pour le matériel à mettre en _uvre dans le cadre du plan POLMAR, les besoins n'ont pas été communiqués ?
M. André VARDARO : Pour l'instant, rien. Suite à l'intervention du maire de Martigues dans la presse et auprès du Gouvernement, une pré-réunion a eu lieu à la préfecture avec le sous-préfet, M. Lefranc, qui était présent tout à l'heure. On nous a indiqué que ces dossiers étaient à l'étude.
M. le Président : Pourrait-on avoir communication de la lettre ?
M. le Rapporteur : On nous a parlé ce matin des plans infra-POLMAR.
M. André VARDARO : Rien n'a été communiqué aux collectivités.
M. le Président : Ce sont des plans qui ne nécessitent pas la mise en place ou le déclenchement du plan POLMAR. Ce sont des problèmes qui se situent en deçà de ce qui peut justifier le déclenchement du plan POLMAR.
Tant que le préfet n'a pas pris de dispositions pour déclencher ledit plan POLMAR, les responsabilités relèvent des maires et tous les moyens que l'Etat est amené à mettre à la disposition des communes pour faire face aux pouvoirs de police du maire sont évidemment à la charge de la commune.
M. André VARDARO : Ce sont les trois niveaux d'intervention prévus en cas d'incident : la commune avec son maire et son chef de corps représente le premier niveau. Selon l'importance, cela passe au chef de zone, puisque l'on a divisé cela en zones et, ensuite, au préfet, en fonction de l'importance des dégâts.
Cet organigramme, qui est en cours de préparation et qui a été étudié, n'a pas encore été communiqué aux communes concernées.
M. Edouard LANDRAIN : Vous avez participé à sa conception ?
M. André VARDARO : Oui.
M. Paul VIDEAU : Cela signifie que, si un maire est trop pressé pour s'engager dans un processus de nettoyage ou de réhabilitation quelconque, tant que le plan POLMAR n'est pas déclenché, c'est à ses frais ?
M. André VARDARO : C'est selon importance de l'incident.
M. Paul VIDEAU : Comment le mesure-t-on ?
M. André VARDARO : Les services spécialisés détermineront l'ampleur du sinistre.
Cela avait coûté 60 000 francs à Ensuès-la-Redonne, c'était le corps de sapeurs pompiers volontaires de la commune avec quelques pompiers du secteur qui étaient intervenus. Les dégâts et les dépenses ont été maîtrisés. Selon cette étude, les trésoriers payeurs auront un compte spécifique pour les dépenses engagées dans cette lutte ; tout est programmé, mais la détermination du niveau de risque appartient au préfet et à lui seul.
M. Paul VIDEAU : Le maire doit prendre une décision, s'il ne la prend pas assez vite, on va lui reprocher ; s'il va trop vite il va payer on lui reprochera aussi : le système est un peu tordu.
M. Bernard CHABLE : La zone Martigues, Port-de-Bouc, Fos, relève de la compétence des marins pompiers. Chaque fois qu'il y a quelque chose, les marins pompiers interviennent.
M. le Rapporteur : Pas en ville.
M. Bernard CHABLE : Pour tout ce qui est pollution maritime, les marins pompiers interviennent efficacement et immédiatement. Ils vont du port autonome jusqu'au canal de Caronte.
M. André VARDARO : Ils ont un secteur bien déterminé. Pour les communes, ce sont les corps de sapeurs-pompiers des communes.
M. Bernard CHABLE : Maintenant, ils sont départementalisés.
M. Paul VIDEAU : Ces corps ne sont équipés d'aucun matériel.
M. le Rapporteur : Quels corps ?
M. Paul VIDEAU : Les corps de sapeurs-pompiers locaux.
M. le Rapporteur : Ils ne sont pas équipés de quel matériel ?
M. Paul VIDEAU : De lutte contre la pollution, nous n'avons rien.
M. le Président : Pour vous, ce sont les marins pompiers ?
M. Bernard CHABLE : Pour tout ce qui est pollution maritime.
M. le Rapporteur : Si c'est une pollution à terre, c'est la mairie.
M. André VARDARO : Il y a une différence entre le domaine public et le domaine maritime.
M. Bernard CHABLE : Sur le DPM, ce sont les marins pompiers ?
M. André VARDARO : Il y a deux secteurs : le port autonome de Marseille a déterminé des secteurs où l'intervention du bataillon de marins pompiers est possible.
M. le Président : Il ne recouvre pas le DPM ?
M. André VARDARO : Pas partout.
M. le Rapporteur : C'est plein de subtilités...
M. André VARDARO : Tout ce qui est en dehors de ce périmètre d'intervention, relève du département ou des corps de sapeurs-pompiers des communes.
M. le Président : Ce matin, le problème du passage de navires dans le canal de Martigues a été évoqué.
M. Paul VIDEAU : C'est le canal de Caronte, qui communique entre le golfe de Fos et l'Etang de Berre.
M. Bernard CHABLE : Il s'agit souvent de petits navires qui procèdent à l'avitaillement des bateaux sur rade.
M. le Rapporteur : On nous a dit qu'il y avait beaucoup de transport de produits chimiques.
M. Bernard CHABLE : Les quantités de produits chimiques qui ne peuvent pas, du fait de leur volume, être véhiculées par les oléoducs sont transportées périodiquement par des bateaux qui traversent la ville de Martigues.
M. le Président : Cela peut poser des difficultés. Qu'est-ce qui empêche dans les années à venir que les autorités communautaires ou nationales décident, de la même manière qu'il est interdit de stocker, d'entreposer, de faire circuler des produits réputés dangereux ou entrant dans la classification « produits Seveso », d'interdire leur circulation à proximité des habitations ?
M. André VARDARO : Il y a des réglementations, la DRIRE y veille.
M. le Président : Pour le moment, elles n'interdisent pas le passage des produits par ce fameux canal.
Vous n'avez pas exprimé de préoccupations, mais les autorités préfectorales, le sous-préfet d'Istres ont soulevé cette question. En même temps, il n'y a aucune alternative qui soit étudiée, envisagée, ou en tout cas affichée ou annoncée.
S'il n'y a pas d'alternative et qu'une telle directive était adoptée, les conséquences pour les activités industrielles situées au bord de l'Etang de Berre seront lourdes. Que vous inspire cette perspective ?
M. André VARDARO : L'exploitation de la pétrochimie se fait surtout sur le complexe de Lavéra. Le complexe de Berre est une pétrochimie de transformation, ce sont des produits différents. Le plus important en matière de pétrochimie est à Lavéra, qui se situe à l'entrée du canal de Caronte et où tous les produits chimiques viennent du groupe NAFTA, composé de plusieurs groupes industriels chimiques.
M. le Rapporteur : Sur quelle commune se situent ces installations ?
M. André VARDARO : Martigues.
L'inquiétude à propos de ce qui peut être transporté par le canal ne doit pas être exagérée. A mon avis, si c'est bien réglementé on ne rencontrera pas les mêmes risques que pour le transport entre le port de Lavéra et la Méditerranée.
Les deux types d'usines sont différents, Berre ne fabrique pas les mêmes produits que Lavéra, il y a peut-être des propylènes, des butylènes, mais pas des exabutanols ou les produits plus dangereux encore exploités et traités à Lavéra.
M. Bernard CHABLE : Ces bateaux vont à Berre et à Châteauneuf.
M. André VARDARO : Châteauneuf n'est qu'une raffinerie, ce n'est pas une usine pétrochimique, on transforme des produits pétroliers pour les combustibles et carburants.
Berre est une raffinerie qui traite des produits lourds qui sont transportés par pipeline. Elle les transforme en gaz et alcools.
Lavéra, ce n'est pas le même genre d'exploitation ; il n'y a que la DRIRE qui pourra indiquer le type d'exploitation. Cela signifie que, pour le canal de Caronte, nous connaissons les produits et la réglementation est appliquée par les Affaires maritimes et les services de la DRIRE.
M. Bernard CHABLE : Cela représente seulement un à deux bateaux par semaine qui traversent Martigues.
M. le Rapporteur : Combien transportent des produits chimiques ?
M. Bernard CHABLE : Je ne sais pas.
M. André VARDARO : Ce sont des petits bateaux, des caboteurs, les tirants d'eau sont faibles. Pour l'essentiel, ce sont des produits gazeux qui sont transportés, mais liquéfiés.
M. le Rapporteur : Vous ne vous sentez pas trop menacés par ce type de pollution, ce qui vous paraît plus dangereux c'est éventuellement une situation type Erika, c'est-à-dire un pétrolier faisant naufrage un jour de tempête ?
M. André VARDARO : En fait, il y a deux craintes. Il peut y avoir un bateau qui soit désemparé un jour de grand mistral ou de vent d'est, mais il peut aussi y avoir la rupture d'un oléoduc.
D'autres produits plus dangereux circulent dans les oléoducs que ce qui est transporté dans les bateaux.
M. le Rapporteur : Avez-vous fait des exercices antipollution dans vos communes, en relation avec les services de l'Etat ?
M. Bernard CHABLE : A Martigues, oui.
Dans les écoles de Lavéra, il y a des exercices périodiques.
M. le Rapporteur : On n'a jamais imaginé à titre d'hypothèse d'école qu'un pétrolier de 250 000 tonnes s'ouvre en deux devant Martigues, afin de mettre tous les moyens en place et de faire un exercice POLMAR.
M. Bernard CHABLE : Cela n'a jamais été réalisé.
Des brochures ont été distribuées à la population en cas d'explosion ou d'incident dans les raffineries.
M. le Rapporteur : Les services de la préfecture ou du port autonome n'ont jamais expérimenté in vivo l'hypothèse d'une catastrophe du type Erika ou pétrochimique, en indiquant qui fait quoi, où l'on stocke les produits, etc. ?
M. Paul VIDEAU : Il n'y a que les informations Seveso qui sont obligatoires de par la loi, elles ont lieu tous les cinq ans. Un plan « Sésame » a été mis en place au niveau des écoles. Mais, il n'y a jamais eu d'exercice grandeur nature sur le terrain.
De plus, la faible profondeur de l'étang compliquerait la mise en _uvre du matériel. Pour trouver un tirant d'eau de 2 mètres, il faut être à 150 m du rivage. Il serait difficile de prendre un barrage prévu pour la mer et de le mettre dans l'étang.
M. le Rapporteur : Je ne pensais pas seulement aux moyens techniques, mais à l'étude du fonctionnement administratif des plans.
M. Paul VIDEAU : Nous avons eu une expérience le 2 janvier 1994, lorsqu'un bac a craqué, et qu'une trentaine de mètres cubes de produits légers sont partis dans l'étang. A notre demande expresse, le plan FOST a été actionné.
Monsieur le sous-préfet d'Istres l'a déclenché à 20 heures, le barrage est arrivé par avion de Londres le lendemain matin à 8 heures, il a été mis en place à 13 heures, mais ce n'était plus la peine de le poser.
M. le Président : En quelle année ?
M. Paul VIDEAU : En 1994, on peut vous certifier la date.
Mme Maryse CANEPA : On manque de moyens pour agir rapidement.
M. Paul VIDEAU : Nous n'avons même pas de moyens légers locaux.
A Berre, nous avons fait venir et stocker par nos sapeurs pompiers des boudins Rhovyl pour essayer de parer au plus pressé, que l'on met à la sortie des égouts, des déversoirs ou des déshuileurs, mais cela s'arrête là. On ne va pas acheter un barrage alors que l'on ne saura pas s'en servir. C'est aussi un problème. Avec la meilleure des volontés, on ne peut pas acheter du matériel si l'on ne sait pas s'en servir. Pour mettre un barrage, il faut un bateau. Nous sommes complètement démunis.
Mme Maryse CANEPA : Nous vivons dans un pays qui est essentiellement maritime, nos frontières maritimes étant immenses, et on ne s'est jamais tourné vers la mer ; c'est malheureux. Il faut qu'il arrive une catastrophe, et encore !
M. le Rapporteur : C'est l'un des sujets de notre rapport.
Finalement, vous n'êtes concernés par les problèmes de prévention que dans le cadre de la révision du plan POLMAR, vous voulez que l'on vous demande votre avis. Vous n'avez pas de matériel propre ; d'ailleurs, ce n'est peut-être pas aux communes d'en avoir.
M. André VARDARO : L'inventaire sera établi dans le dossier que la préfecture instruit et le mode opératoire sera indiqué à chacune des communes. Comme je vous l'ai dit, ce plan actualisé n'a pas encore vu le jour.
M. le Rapporteur : Cela ne va pas tarder, nous étions à la préfecture.
M. André VARDARO : Il précise les types d'interventions, la répartition des postes de commandement, etc., mais il n'a pas encore été imprimé.
M. Paul VIDEAU : Le matériel a été défini ?
M. André VARDARO : L'inventaire est fait, mais s'agissant des besoins, c'est au service départemental de secours et d'incendie ou au bataillon qu'il appartiendra de les formuler.
M. Edouard LANDRAIN : Les centres de secours principaux dépendant du SDIS n'ont pas été instruits du tout ? Ils n'ont pas fait d'entraînement, ils n'ont aucune formation ?
M. le Rapporteur : Ce sont les marins pompiers.
M. Edouard LANDRAIN : Non, pas sur certaines zones.
M. Paul VIDEAU : Tout ce qui a trait au SDIS n'a jamais fait aucun exercice.
M. le Rapporteur : La coordination de l'ensemble des acteurs dépend du préfet, qui a autorité sur les marins pompiers en période de crise, mais il n'y a pas d'exercice POLMAR-terre qui ait déjà été réalisé.
A priori, il n'y a pas de moyens de lutte antipollution bien identifiés, sauf ceux que vous avez vus hier. Les matériels sont à Toulon.
M. André VARDARO : Il y a deux commandements dans les Bouches-du-Rhône. Pour tout ce qui dépend du port autonome de Marseille et tout ce qui est portuaire industriel (port de Fos, de Lavéra, une partie de l'Etang de Berre), c'est le bataillon de marins pompiers qui intervient, mais pour tout le reste du département, puisque c'est la loi de 1996 qui s'applique, c'est le CODIS, le commandement départemental qui est compétent. Il y a une disparité dans l'action, car les uns sont chargés du secours et de l'incendie, mais ils n'ont pas la spécialisation nécessaire pour tout ce qui est chimique ou industriel.
M. le Président : Normalement, les marins pompiers interviennent sur tout le domaine portuaire.
M. Paul VIDEAU : J'avoue que je ne sais plus.
M. le Président : Vous ne savez plus et vous êtes chargé de la sécurité.
M. André VARDARO : Nous sommes des communes intermédiaires entre Lavéra, mais industrialo-portuaires.
Nous avons des ports de plaisance et des ports professionnels où il y a des professionnels de la pêche.
M. le Président : Les marins pompiers sont rattachés au port autonome de Marseille. Dans tout ce qui dépend du port autonome de Marseille, l'intervention revient aux marins pompiers.
Vont-ils jusqu'à l'intégralité du domaine public maritime dépendant de l'autorité du port autonome de Marseille ou sont-ils plus limités ? Ce qui signifie qu'il y a des parties dans les communes autour de l'Etang de Berre qui ne seraient pas prises en compte ?
M. Paul VIDEAU : Tout dépend en fait du délai d'intervention. Pour le port de la Pointe, qui se trouve au c_ur de l'Etang de Berre, SHELL fait systématiquement appel à nos pompiers, car dans les trois minutes qui suivent nous sommes sur place, alors que pour venir de Marseille il faut deux heures.
M. Bernard CHABLE : Il y a deux ans, il y a eu un gros incendie sur les collines de Marseille. Les marins pompiers ont essayé d'intervenir et un conflit s'est manifesté avec les personnels départementaux.
M. le Président : Ce n'est plus le domaine public maritime.
M. André VARDARO : Les commandements sont différents.
M. le Rapporteur : C'est préoccupant, mais cela rejoint des constatations que l'on peut faire ailleurs.
M. le Président : Il faut qu'il y ait une prise en compte du risque par la population, notamment au moyen d'exercices réguliers.
A Martigues, des exercices sont organisés pour les enfants des écoles, au cas où un problème aurait lieu dans une installation industrielle. Mais il n'y a pas la même approche des risques s'agissant d'un problème maritime ; or, cela peut aussi arriver.
M. Paul VIDEAU : On devrait se trouver dans le cas particulier des PPI (Plans Particuliers d'Intervention). Mais, par définition, l'industriel estime que c'est hors de ses zones de responsabilité.
Si un tuyau craque à l'intérieur des clôtures de l'industriel, c'est son problème ; s'il craque à 50 cm au-delà de la clôture, ce n'est plus son problème. Certaines choses sont curieuses.
M. Edouard LANDRAIN : Des clarifications ont été demandées dans le passé. Que vous a-t-il été répondu ?
M. Paul VIDEAU : Que c'était à l'étude.
M. André VARDARO : La départementalisation des sapeurs pompiers dans les Bouches-du-Rhône a pris sept ans pour être réalisée. On avait demandé aux maires de se mettre d'accord. Sur 119 communes, il y a 66 corps de sapeurs pompiers, Marseille à part, puisque c'est le bataillon de marins pompiers. Chacun commandait, on a essayé d'organiser selon la loi de 1996, et les maires n'étaient pas encore d'accord.
Puis cela a été rendu obligatoire par la loi et c'est entré en service. Ma commune, avec un corps de sapeurs-pompiers volontaires de 56 personnes - même le lieutenant est volontaire -, a subi depuis l'année dernière 30 % de majoration. Jadis, cela marchait bien, cela marche de la même façon, mais avec 30 % de plus. Je suis monté au créneau.
Actuellement, il y a toujours des communes qui ne paient pas et les autres ont payé 30 % de plus.
Dans ce commandement, peut-être faudrait-il clarifier qui commande, qui fait quoi.
M. Bernard CHABLE : Les marins pompiers de chaque entreprise sont efficaces.
M. André VARDARO : Les entreprises spécialisées dans ces fabrications de produits dangereux jadis avaient leurs propres pompiers.
Par exemple NAFTA Chimie à l'époque travaillait avec une centaine de sapeurs-pompiers professionnels au sein de l'entreprise. Ils avaient la formation et l'entraînement nécessaires.
Comme ces grandes sociétés ont dégraissé leur personnel, NAFTA Chimie n'a plus que 20 sapeurs-pompiers et s'est retournée vers la commune car, payant sa taxe professionnelle, elle estime que c'est à nous de la défendre.
Les pompiers reviennent très cher à la commune de Martigues car il faut les former à tous ces feux chimiques et difficiles. Cela devient du super professionnalisme.
C'est là que, étant départementalisé, il faudra que le département, soit recrute des super professionnels, soit s'adapte aux besoins de ces industriels. Le problème est difficile à résoudre.
M. Paul VIDEAU : On nous a dotés d'un matériel ultra sophistiqué pour faire face aux risques de la raffinerie et de la pétrochimie, il a fallu former le personnel en conséquence.
M. André VARDARO : Mes pompiers ne sont que des volontaires, lorsque l'on a eu ces petites marées noires à la suite d'un incident dont on n'a pas pu déterminer la nature, nous nous sommes déguisés en balayeurs de la mer. Nous avons essayé de mettre des produits, de la poudre de perlimpinpin que l'on a trouvée. Nous y sommes arrivés : les Affaires maritimes sont venues et un PC a été créé rapidement. C'était le premier stade d'intervention.
Comme je compte mon argent, cela m'a coûté 60 000 francs, et je ne me suis retourné contre personne. Tant que ce sont des petites pollutions, 60 000 francs peuvent passer en pertes et profits, mais imaginez le volume nécessaires en cas de grosse pollution de la côte rocheuse. C'est un peu comme en Bretagne : à certains endroits il n'y a pas de sable.
M. Paul VIDEAU : Avec la marée en moins.
M. André VARDARO : Pendant 20 ans, nous avons essayé de protéger notre littoral, puisque Martigues en fait partie. Les professionnels de la pêche, tout le monde en est conscient. Tous les jours nous avons un bureau scientifique qui analyse l'eau, en surface et en profondeur.
Lorsqu'on parle de pollution, cela ne concerne pas que la pollution par les hydrocarbures, mais les autres pollutions.
Il y a des communes qui ont des pavillons bleus, car à 15 mètres du rivage, vous avez 15, 20 ou 25 mètres de fond. On arrive à bien travailler, mais on constate par le courant ligure des amenées de produits, que l'on surveille en permanence. Dans ce parc marin, nous avons créé des emplois.
M. le Rapporteur : D'où viennent les produits ?
M. André VARDARO : D'Italie.
Nous avons des couloirs maritimes car les tankers qui rentrent et sortent du port de Fos ont un parcours à respecter. En analysant les déchets, nous trouvons des emballages ou des sacs venant de Hongkong. Nous sommes vigilants sur le courant ligure qui vient de Gênes, mais on n'est à l'abri de rien.
Jusqu'à ce jour, tout a bien marché, mais...
Nous avions adressé une lettre aux Affaires maritimes en demandant que ces navires passent plus loin, pour avoir le temps de maîtriser la pollution en cas d'incident ou d'accident, ou bien de les doter d'un moteur auxiliaire. Depuis quelques jours, ils passent au-delà de la bande des 300 mètres.
M. Bernard CHABLE : Une organisation les « Casques Verts » a prépositionné sur l'aéroport de Marignane des boudins pour intervenir en France ou ailleurs en cas de pollution.
M. Paul VIDEAU : C'est à la disposition de tout le monde ?
M. le Président : J'ai entendu parler de cela. J'ai reçu les lamaneurs de Marseille, de Sète, de l'Atlantique et de la Manche : ils m'ont signalé, sachant qu'une commission d'enquête existe, qu'eux aussi participaient à la sécurité. Les lamaneurs participent à la mise en place des barrages car ils ont des petites embarcations qui sont très maniables.
Ils ont décidé, parce qu'ils estiment remplir un rôle de service public, non seulement de poursuivre ce travail de protection dans les ports, mais de se former également pour pouvoir partir sur d'autres sites internationaux où pourraient arriver des pollutions, car d'autres pays n'ont pas les mêmes moyens que nous.
Merci à vous, en espérant que tout ceci reste du domaine de l'hypothèse et que rien de grave n'arrive.
Audition de Mme Marie-Christine BERTRANDY,
responsable de la cellule qualité des eaux littorales (CQEL)
au service maritime des Bouches-du-Rhône,
M. Philippe BODINO, chef d'état major adjoint de la zone de défense
et de sécurité civiles,
M. Jacques BOLOPION, directeur régional des affaires maritimes,
M. Georges CLAUSTRES, directeur régional des douanes,
Mme Josiane GILBERT, directrice du SIRACED PC,
M. Joseph MOYSAN, commandant du port de Marseille,
M. Thierry QUEFFELEC,
sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la zone sud pour les affaires de défense et de la protection de la forêt méditerranéenne,
M. Pierre SECOND, chef du service de défense et de sécurité civiles
à la direction régionale et départementale de l'équipement,
M. Jean-Pierre VALLAURI,
chef de groupe à la subdivision des Bouches-du-Rhône,
M. Germain VERLET, administrateur principal des affaires maritimes responsable du centre de sécurité de la navigation à la direction régionale des affaires maritimes
(extrait du procès-verbal de la séance du 18 avril 2000 à Marseille)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président.
Mme Marie-Christine Bertrandy, MM. Jacques Bolopion, Georges Claustres, Mme Josiane Gilbert, MM. Joseph Moysan, Pierre Second, Dominique Tixeront, Jean-Pierre Vallauri et Germain Verlet sont introduits.
M. le Président leur rappelle que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. A l'invitation du Président, Mme Marie-Christine Bertrandy, MM. Jacques Bolopion, Georges Claustres, Mme Josiane Gilbert, MM. Joseph Moysan, Pierre Second, Dominique Tixeront, Jean-Pierre Vallauri et Germain Verlet prêtent serment.
M. Jacques BOLOPION : Je présume que vous souhaitez que la réunion de ce jour soit plus particulièrement centrée sur les problèmes de pollution marine.
Je vous propose d'aborder cette question à travers deux problèmes, le premier étant celui des pollutions à partir des navires et le deuxième étant celui du traitement de ces mêmes pollutions.
S'agissant du premier problème, nous sommes le service le plus directement concerné.
Hier, vous avez vu le CROSS et vous avez pu constater qu'il n'y avait pas de CROSS chargé à proprement parler de la circulation, sauf peut-être un embryon dans les Bouches de Bonifacio avec le sémaphore de la marine. Le CROSS joue un rôle de prévention en ce qui concerne les règles de circulation des navires, et le suivi d'un certain nombre d'avaries de navires en bande côtière.
Deuxième élément du dispositif : l'activité du Centre de sécurité des navires (CSN) que vous avez vu en fin de matinée.
Je vais passer la parole à M. Verlet, Capitaine de 1ère Classe, responsable de ce centre. Il va vous indiquer quelle est l'activité du centre du point de vue de la prévention des pollutions.
M. Germain VERLET : Pour être très bref, j'ai fait une petite fiche pour résumer la convention MARPOL, même si elle présente des lacunes, elle retrace les grandes lignes.
En fait, les annexes I et II détaillent ce qu'il faut contrôler sur un navire, au titre de sa conception technique, et c'est le rôle des commissions d'études, commissions centrales de sécurité, et commissions générales de sécurité pour les gros navires, pour les problèmes de mise en service et ensuite de visites annuelles périodiques des navires français, mais également au titre du contrôle de navires étrangers, ces deux derniers domaines relevant des CSN.
La Convention MARPOL détaille ce que l'on doit contrôler sur un navire à tous les stades de sa vie.
Je vous ai fait une fiche sur l'activité du Centre de sécurité des navires. Le nombre de navires immatriculés au Centre de sécurité des navires de Marseille est particulier car il y a énormément de vedettes à passagers : nous avoisinons les 300 vedettes à passagers. C'est une charge de travail importante et l'une de nos priorités. Nous avons aussi beaucoup de navires de plaisance. Par contre, très peu de navires de pêche dépendent de notre centre.
Aussi, nous effectuons plus de 700 visites de navires de commerce français.
S'agissant des moyens, nous disposons de onze inspecteurs qui arrivent à peu près à faire face aux tâches qui nous sont confiées. Sur le cycle de l'année, nous avons une période d'activité entre mars et juin principalement consacrée aux navires à passagers, qui ont une activité saisonnière. À ce moment-là, nous faisons beaucoup moins de visites de contrôle de navires étrangers.
Le nombre de navires étrangers visités par an est relativement faible : moins d'une centaine.
M. le Rapporteur : Quel pourcentage par rapport aux obligations du Mémorandum de Paris ?
M. Germain VERLET : Un petit 10 %.
M. le Rapporteur : Ce n'est pas assez.
M. Germain VERLET : Non.
M. le Rapporteur : Je suis sorti ce matin de la visite du porte-conteneurs italien avec l'impression que le nombre d'inspecteurs était suffisant. Dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, la France va demander un renforcement des contrôles en Europe. Il faut faire le ménage chez nous avant de demander aux autres de faire le leur. Si vous faites 10 %, c'est à cause du manque de moyens, ce n'est pas de la mauvaise volonté...
M. Germain VERLET : Ce n'est pas forcément parce qu'il il n'y a pas assez de monde. Il y a d'abord ce problème cyclique pendant trois mois où l'on ne fait pratiquement que des visites de navires à passagers, sauf des navires étrangers qui posent problème et sont signalés par la capitainerie ou le pilote. Dans ce cas, nous agissons en priorité sur ce type de navire.
Par ailleurs, à Marseille, beaucoup de bateaux, comme celui que vous avez vu tout à l'heure, sont des bateaux qui font du cabotage méditerranéen, donc qui reviennent souvent dans le même port, et on ne peut pas les visiter de nouveau. Un bateau qui ne présente pas de défectuosité ne peut pas être visité plus de deux fois dans un intervalle de six mois. Cela nous handicape aussi par rapport au respect des objectifs du MOU, car nous n'avons pas de trafic de longs courriers qui viennent de façon aléatoire.
M. le Rapporteur : Cela explique les 10 % ?
M. Germain VERLET : En grande partie. Certains jours, nous aurions des disponibilités pour faire des visites et nous ne trouvons pas de bateaux, tous ceux présents dans le port nous étant déjà connus. C'est une spécificité de Marseille par rapport à des ports comme Le Havre où les bateaux ne sont pas réguliers comme ici.
M. le Rapporteur : S'agissant des infractions constatées au titre du contrôle par l'Etat du port, quels sont les pavillons les plus mauvais à Marseille ?
M. Germain VERLET : Il n'y pas de règles générales. Dans les mois qui ont précédé, les plus mauvais navires relevaient plutôt des pavillons des Pays de l'Est (Bulgarie, Ukraine, Géorgie, etc.).
M. le Rapporteur : Lorsque vous vous interrogez sur l'opportunité ou non de contrôler un bateau, avez-vous des informations directes venant des autres pays du Mémorandum de Paris ?
M. Germain VERLET : Nous sommes connectés sur la base de données de St-Malo.
En fait, nous travaillons en plusieurs temps ; nous notons les bateaux entrant dans le port, nous interrogeons la base de données du port autonome et, ensuite, nous regardons les précédents. Si ces bateaux ont des déficiences graves, nous les mettons en priorité absolue ; si ce sont des déficiences mineures, nous les visitons si nous avons le temps.
Le facteur de sélection se détermine selon un coefficient intégrant le pavillon, l'âge, le type du navire, la classification, etc.
M. Jacques BOLOPION : Les navires qui nous causent le plus de problèmes, ce sont les petits vraquiers qui viennent charger du sucre, des céréales, du sel, et que l'on trouve toujours aux mêmes endroits (Port St-Louis, Port la Nouvelle).
De plus, ce sont des types de navires avec lesquels on rencontre de nombreux problèmes de pollution par déballastages. Ce sont des navires qui posent des problèmes de sécurité mais aussi de pollution.
Je vous ferai passer des comptes rendus du CROSS pour toute l'année 1999. En juillet dernier, nous avons constaté 12 pollutions par déballastages avec des nappes qui font autour de 5 ou 6 000 mètres de long. Cela n'arrête pas de toute l'année, certains mois sont plus ou moins forts.
Sur cette photo prise par un avion des douanes, vous pouvez constater un dégazage par un cargo cambodgien se rendant à Port-la-Nouvelle.
M. le Rapporteur : Pour le vraquier identifié, comment avez-vous pu constater la provenance du déballastage ?
M. Jacques BOLOPION : Je vous lis le message, « c'est un avion « Nord 262 » qui a constaté un rejet en mer effectué par cargo..., rejet stoppé lors du deuxième passage, nature inconnue, photo prise. Pas de nappe de pollution d'hydrocarbure dans le Golfe... destination Port-la-Nouvelle ».
Je vous lis un autre message : « Pollution due certainement à un dégazage, un cargo (Isolabora ?), port d'attache Palerme, faisant route au nord, nappe d'environ 500 sur 8 000, puis diverses nappes épaisses tout autour, nappes très diluées... ».
Nous avons sans arrêt ce type de messages, ce qui m'a frappé en arrivant ici.
M. Georges CLAUSTRES : Je confirme ces chiffres, sur 180 sorties d'avion d'une durée de trois heures, nous avons 140 pollutions significatives.
Nous relevons seulement les pollutions significatives, peut-être à la différence d'autres administrations, pour qui un chiffon imprégné de mazout constitue une pollution.
M. le Rapporteur : Vous les avez identifiées ?
M. Georges CLAUSTRES : Sur ces 140 pollutions significatives, 90 % sont des pollutions orphelines, c'est-à-dire dont il est pratiquement impossible de trouver la provenance. Le travail des douanes est d'essayer de faire le lien entre la pollution constatée et la proximité d'un bateau.
Pour cela, on identifie la pollution, on la fait confirmer par notre appareillage électronique (dimensions, orientation, surface, épaisseur et position géographique précise). Ensuite, on prend un certain nombre de photos à la fois de la pollution, du navire avec le nom et le port d'attache apparent, il faut descendre suffisamment bas pour pouvoir identifier le bateau, en essayant de voir de quel endroit du bateau sort la source de pollution.
10 % seulement des auteurs des pollutions sont identifiés.
M. le Rapporteur : Ce sont les chiffres pour 1999 ?
M. Georges CLAUSTRES : Oui. C'est stationnaire, c'est ce que l'on constate tous les ans.
M. le Rapporteur : Si vous sortiez plus, vous constateriez plus ?
M. Georges CLAUSTRES : A quelque chose malheur est bon, puisque l'on a essayé de profiter du naufrage de l'Erika pour obtenir une augmentation du potentiel d'heures. Notre Direction Générale nous avait alloué 450 heures en potentiel opérationnel pour des opérations POLMAR. Pour 2000, nous avons obtenu 500 heures, ce qui va accroître le nombre de sorties (4).
M. le Rapporteur : Vous allez accroître le nombre de constatations ?
M. Georges CLAUSTRES : Ce sera le même ratio.
M. le Rapporteur : S'agissant des pollueurs identifiés, connaissez-vous les suites juridiques ?
M. Georges CLAUSTRES : Notre rôle se borne à transmettre un procès-verbal type qui est établi de façon informatique.
Par contre, nous n'avons pas toujours connaissance de ce que deviennent ensuite les procès-verbaux.
M. le Rapporteur : Qui peut nous dire ce que sont devenus ces procès-verbaux sur la zone ?
M. Jacques BOLOPION : La préfecture maritime.
Le bilan 1999 du CROSSMED, pour toute la Méditerranée, fait état de 215 pollutions.
M. le Rapporteur : Les autres sont constatées par d'autres administrations que la douane ?
M. Jacques BOLOPION : Les trois principales sources sont les pilotes de ligne, notamment aux abords des aéroports de Marseille et de Nice, les avions de la Marine nationale et les avions des Douanes.
215 pollutions ont été signalées en 1999, dont 184 par hydrocarbures. Parfois, il y a d'autres types de pollution : des ordures agglomérées ou autres. Nous avons identifié 23 auteurs.
M. le Rapporteur : Est-ce généralement la Douane qui les identifie ?
M. Jacques BOLOPION : Oui. Ou bien les avions de la Marine en prenant le nom du bateau.
Quand je parle d'auteur identifié, cela signifie que l'on a vu un bateau sur la nappe ou à proximité.
Ensuite, ces constatations ont entraîné 182 investigations complémentaires, qui ont abouti à 8 dossiers d'infractions, dont un seul dans nos eaux territoriales. Pour le reste, nous ne sommes pas compétents, c'est en dehors de nos eaux territoriales. En fait, il y a un dossier pour 215 pollutions signalées.
M. le Rapporteur : Un dossier traité, puisqu'il est dans la zone des 12 milles.
Il serait intéressant de savoir ce qu'il est advenu de cette procédure. Il y a une chance sur deux qu'il ne soit rien advenu. Ne vous sentez-vous pas démoralisés ?
M. Georges CLAUSTRES : C'est notre métier, il ne me semble pas que l'on soit démoralisé.
M. le Rapporteur : Tout ce que vous avez fait en 1999 ne servira qu'à une procédure judiciaire, et l'on n'en est pas sûr.
M. Jacques BOLOPION : Il y a une très bonne collaboration entre l'ensemble des intervenants et des administrations, y compris pour le suivi des navires jusqu'au port.
Ceci dit, lorsqu'un navire est suspecté, et l'on en parlait ce matin avec M. Verlet, même si l'on n'a pas de preuve, on l'« épluche » dans d'autres domaines sur le plan de la sécurité, ce qui a un effet dissuasif. Il se rend compte qu'il est surveillé.
Les gens commencent à savoir que la France, après l'Erika, est assez nerveuse sur ces questions, donc tous ces vols, ces constatations et enquêtes faites lorsque les navires viennent au port - il y a quand même eu 182 investigations -, nous questionnons les ports étrangers, nous interrogeons l'armateur en mettant la pression sur les pollueurs potentiels.
M. le Rapporteur : Quel est le rôle réel de l'Etat du pavillon quand les infractions constatées sont situées au-delà des 12 milles ?
M. Jacques BOLOPION : Le navire cambodgien qui a été pris devant la Corse ne va pas passionner le Cambodge...
M. le Rapporteur : Cet exemple est intéressant.
Combien de démarches internationales ont été faites par rapport aux infractions constatées s'agissant des navires étrangers au-delà des 12 milles ?
M. Jacques BOLOPION : L'expérience que j'ai porte davantage sur les infractions au dispositif de séparation de trafic, mais à mon avis c'est du 100 % : on le fait systématiquement.
M. le Rapporteur : Et le retour ?
M. Germain VERLET : 10 % des infractions notifiées aux Etats du pavillon donnent lieu à un courrier accusant réception.
M. le Rapporteur : Que disent-ils ?
M. Germain VERLET : Qu'ils font quelque chose. Engagent-ils vraiment des poursuites ? C'est une autre question.
M. le Rapporteur : On peut le savoir ?
M. Germain VERLET : Le Bureau NM2 à Paris pourra vous donner une réponse, c'est le bureau du trafic maritime et du sauvetage.
M. le Rapporteur : Estimez-vous qu'avec les heures de vol complémentaires allouées vous aurez un dispositif de surveillance suffisant ?
M. le Président : 160 jours à la place de 140.
M. Georges CLAUSTRES : Cela va certainement améliorer notre action. Cela dit, on pourrait encore augmenter.
M. le Rapporteur : Auriez-vous besoin de deux avions ?
M. Georges CLAUSTRES : Pour la Méditerranée, ce serait peut-être un peu trop. Ce qu'il faudrait, ce serait accroître encore un peu plus le potentiel d'heures de vol et passer à 600 avec le même avion.
M. le Rapporteur : C'est-à-dire avoir des équipages plus importants.
M. Georges CLAUSTRES : Dans le cadre de nos missions de surveillance douanière, nous disposons d'un quota d'heures POLMAR. Il pourrait être complété.
M. le Président : 9 000 F de l'heure.
M. Georges CLAUSTRES : Entre 8 et 9 000 F.
M. Jacques BOLOPION : Pour finir, un point à signaler s'agissant de la convention MARPOL, un manque me paraît assez grave, que l'on a constaté dans une affaire précise de pollution par un chimiquier.
Nous avons découvert qu'il y avait une pratique de lavage des citernes par les chimiquiers, qui était habituelle dans le Golfe de Fos, et qui était autorisée par la réglementation internationale.
Nous avons pu constater dans ce cas précis que je mentionnais qu'il s'agissait d'un navire qui partait chargé de phénol et d'acétone. Ce sont des produits chimiques plutôt dangereux. Nous avons fait une enquête très précise, il a été photographié, etc., pour finir par nous rendre compte qu'il était en règle vis-à-vis de la réglementation internationale.
Contrairement aux hydrocarbures, la Méditerranée n'est pas une zone spéciale pour les chimiquiers.
M. le Rapporteur : Nous l'avons noté.
M. Jacques BOLOPION : Cela nous paraît tout à fait anormal.
M. le Rapporteur : Avez-vous des relations avec vos collègues italiens ou espagnols ?
M. Georges CLAUSTRES : Oui, régulièrement. Nous pouvons intervenir à leur demande dans leur zone de compétence, mais pas de notre propre initiative.
M. le Rapporteur : Sur des problèmes de pollution ?
M. Georges CLAUSTRES : Notre avion peut être amené à intervenir à la demande d'Etats étrangers.
M. le Rapporteur : Y a-t-il une convention avec l'Italie et l'Espagne sur le sujet ?
M. Georges CLAUSTRES : La seule convention que je connaisse est RAMOGE.
M. le Rapporteur : Il n'y a pas de textes ?
M. Georges CLAUSTRES : Nous sommes certainement les mieux équipés techniquement dans le bassin Méditerranéen, donc nous intervenons à la demande des autres Etats, ce qui a eu lieu à plusieurs reprises en 1999.
M. le Rapporteur : Pour des problèmes de pollution ?
M. Georges CLAUSTRES : Tout à fait. Nous intervenons pour des constatations de pollution. Nous sommes intervenus pour les Italiens en 1999.
M. le Rapporteur : C'est une sorte de gentlemen's agreement ?
M. Georges CLAUSTRES : Oui.
M. Jacques BOLOPION : Nous avons aussi des contacts avec les autres pays pour les contrôles dans le cadre du MOU. Au niveau opérationnel, le CROSS a des relations quotidiennes avec les Espagnols et les Italiens. Ceci étant, il s'agit de problèmes de sauvetage. Ils se parlent, échangent des informations sans arrêt et ils se rencontrent. Ainsi, lorsqu'il y a des problèmes de pollution marine, et que plusieurs pays sont intéressés, des relations immédiates sont nouées à partir du sauvetage.
En fait, c'est le sauvetage qui constitue le moyen de jonction entre les pays. C'est sans difficulté que nous avons des relations avec Rome, Barcelone sur ces questions, via le CROSS, mais pas directement entre administrations.
Il n'y a pas de relations institutionnelles entre administrations.
M. le Rapporteur : Cela n'a jamais été modifié, il n'y a pas de convention.
M. Jacques BOLOPION : Sur le plan sauvetage en mer, oui, il y a des conventions entre les différents Etats qui définissent les zones d'intervention ; par contre, pas sur le plan des relations entre administrations pour la lutte contre les pollutions.
M. le Rapporteur : Peut-on avoir un rappel des conventions ?
M. Germain VERLET : C'est la convention SAR.
M. le Rapporteur : Il n'y a pas de conventions spécifiques pour la lutte contre les pollutions entre la France et l'Espagne en Méditerranée alors que, sur la côte atlantique, cela existait. Même si cela a été signé peut-être 15 jours avant l'Erika, cela a marché.
M. Jacques BOLOPION : Je propose que l'on passe à la lutte à terre contre les pollutions marines.
Nous pouvons partir d'un cas réel qui s'est passé cet été. Les 2, 3 et 4 juillet 1999, il y a eu une pollution par hydrocarbure importante, en pleine saison estivale, sur le littoral, de Cassis à La Ciotat, à partir d'une pollution marine qui avait été repérée et suivie d'ailleurs dès le départ par la Marine, qui a fait l'objet d'un traitement en mer, et qui ensuite a été traitée à terre dans des conditions difficiles. C'était en pleine saison estivale, et une partie de la pollution s'est déroulée pendant un week-end.
C'est une opération qui s'est très bien déroulée, dont la presse nationale s'est largement faite écho. Des traitements en mer ont été poursuivis par le Mérou jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire tant que la nappe était encore en mer.
Après, un relais très rapide a été pris par les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône à partir du 2 juillet, avec un traitement qui devait représenter plusieurs kilomètres linéaires de côte, c'est-à-dire une petite pollution, mais en Méditerranée, durant la saison estivale et dans des endroits très touristiques.
M. le Rapporteur : C'était du pétrole lourd ?
M. Jacques BOLOPION : Un pétrole classique, un fioul pas très léger non plus.
M. le Rapporteur : Le Mérou pompait ce pétrole ?
M. Jacques BOLOPION : Il a pu traiter la nappe, je ne sais pas si cela n'a pas été fait par dispersants.
M. le Rapporteur : C'était quelque chose de léger ?
M. Jacques BOLOPION : C'était une nappe qui commençait à se disperser, elle a traîné assez longtemps en mer, elle est arrivée sur la côte assez dispersée.
M. le Rapporteur : A-t-on identifié le bateau ?
M. Jacques BOLOPION : Non.
C'est un avion des douanes qui a repéré la nappe qui comportait deux parties, en forme de fer à cheval, de grande taille avec 9 nautiques d'un côté et 2 de l'autre. Elle était constituée de boues d'hydrocarbures. 70 sapeurs-pompiers ont été engagés, plusieurs barrages et un certain nombre d'embarcations, de plongeurs, etc. ont été mis en place pendant deux jours.
M. le Président : Quelle est l'origine d'une telle pollution ?
M. Jacques BOLOPION : La nappe peut venir de loin selon les conditions de vent. Là, elle avait été rabattue à la côte, c'était probablement des vents de sud ou des vents d'est.
Si cela avait été le mistral, on ne l'aurait jamais vu arriver. D'ailleurs, en 1999, on a constaté beaucoup de pollutions, même si ce n'est pas une année record, parce que l'on a eu un régime de vents assez différent de ce qu'il était habituellement, avec moins de mistral et beaucoup plus de vents d'est ou d'ouest.
M. le Rapporteur : Les inspecteurs formés par la marine marchande, arrivant à la retraite, seront remplacés par des diplômés de l'université ayant peu navigué. Il semble que ce soit un gros problème, pas uniquement pour les Affaires maritimes mais aussi pour les sociétés de classification, pour les officiers de port, pour le pilotage, pour les CROSS.
En lisant votre tableau, c'est très significatif.
M. Jacques BOLOPION : Il est très concret.
M. le Rapporteur : Quel type de carrière peut-on imaginer pour que nos divers outils de contrôle puissent disposer du personnel compétent ?
M. Jacques BOLOPION : Le vivier des officiers de la marine marchande susceptibles de devenir inspecteurs des centres de sécurité des navires aujourd'hui me paraît à peu près tari.
On vient de faire un concours de pilotage à Marseille il y a 15 jours. Un pilote au port de Marseille gagne autour de 50 à 60 000 F net par mois, avec en plus un régime de travail qui n'est pas déplaisant.
Il y avait deux places et seulement deux candidats, ce qui vous donne une idée de l'état du marché. Compte tenu de ce qui est offert dans la fonction publique, il est difficile de suivre.
S'agissant des officiers de la marine marchande expérimentés, on pourra en trouver un par-ci par-là, mais il ne faut pas espérer opérer des recrutements par ce biais. Donc, il est nécessaire de faire appel à des ingénieurs ou diplômés de l'enseignement supérieur.
En revanche, on constate qu'à la sortie des écoles nationales de la marine marchande, c'est-à-dire ceux à Bac + 6 et qui ont le diplôme d'études supérieures de la marine marchande, entre 25 et 33 % des diplômés ne naviguent jamais. Donc, ils vont dans un certain nombre de métiers à terre et ils partent pour des rémunérations assez comparables à ce que gagne un cadre A débutant dans la fonction publique.
Evidemment, ils n'ont pas la qualité de l'inspecteur que vous avez vu ce matin, qui était un ancien commandant et qui a navigué pendant 25 ans, mais vous avez des gens qui ont été formés à Bac + 6 à une formation d'officier de la marine marchande, qui ont pratiquement passé une année d'embarquement effectif sur un navire de la marine marchande.
Là, on a sans doute un vivier à préparer sous forme de classe préparatoire au concours de la fonction publique, en leur disant qu'ils peuvent être officiers de ports, inspecteurs de la sécurité du navire, officiers du corps technique aux affaires maritimes, administrateurs aux affaires maritimes.
L'Ecole Nationale de la Marine Marchande (ENMM) de Nantes, chef de file du réseau des ENMM, a prévu un certain nombre de spécialisations et va organiser une préparation aux concours administratifs, notamment pour les élèves des ENMM du niveau diplôme d'études supérieures de la Marine Marchande (DESMM) qui ne voudront pas s'engager dans une carrière de navigant.
M. le Rapporteur : Il faut augmenter le nombre de places dans ces écoles pour augmenter le potentiel et obliger à un temps de navigation réelle dans la carrière.
M. Jacques BOLOPION : C'est inclus dans leur six ans de formation.
M. le Président : Un ingénieur ENSAM n'a jamais navigué.
M. Jacques BOLOPION : Sauf à l'école pendant trois mois, mais ce n'est certes pas suffisant.
M. le Rapporteur : Nous serons amenés à faire des propositions, c'est vraiment une question très préoccupante.
M. Germain VERLET : Comme je côtoie les navigants en faisant des visites de navires, je constate chez ceux qui sont proches de la retraite un intérêt pour devenir inspecteurs, mais ils sont bloqués car on a arrêté de recruter chez ces navigants.
M. le Rapporteur : Il faudrait prévoir un système propre aux navigants, avec des incitations financières et des mesures spécifiques pendant un certain nombre d'années, et par ailleurs trouver un autre système pour assurer les relais, autrement ce n'est pas la peine de demander un ajustement de la réglementation.
Je voulais demander à la DRIRE, s'il y a une pollution cette nuit, demain matin savez-vous où déposer les déchets ?
M. Jean-Pierre VALLAURI : Je parle sous le couvert de M. Second de la DDE, puisque nous avons piloté ensemble le groupe POLMAR pour la filière « évacuation des déchets ». Nous avons considéré qu'il pouvait y avoir trois filières de déchets : la filière des déchets liquides, la filière des déchets pâteux et la filière des déchets solides.
Nous avons examiné les possibilités existantes, réelles, pour recevoir ces produits. Le port autonome nous a bien confirmé par écrit au cours de la démarche qu'il pourrait mettre à disposition l'un des deux bacs de décantation, d'une capacité de 12 000 m3, le second pouvant être également réquisitionné en complément si nécessaire avec des moyens de pompage de 250 m3/h.
C'est à proximité des zones où les bateaux peuvent arriver, et, en fonction des moyens de transport, si un incident arrivait sur les Bouches-du-Rhône. On peut penser qu'en une heure, voire une heure et demie on pourrait acheminer ces produits liquides sur leur lieu de stockage.
En cas de besoins complémentaires, il y aurait les stockages existant dans les quatre raffineries et les deux dépôts pétroliers.
Les bacs d'orage des usines d'incinération représentent des volumes importants. Les industriels ont été consultés pour pouvoir mettre à disposition ces bacs en cas de réquisition ; ils peuvent donner des grands volumes pour accueillir les déchets pâteux.
M. Pierre SECOND : Les dépôts ont été identifiés, que ce soit pour les liquides et les pâteux, comme pour les solides, qui arrivent ultérieurement, lorsque l'on ramasse les produits sur la plage.
Deux dépôts sont capables de stocker et de traiter les déchets, l'un dans le Gard et l'autre dans l'Hérault.
Nous avons considéré que dans le cas d'un incident, qui correspondrait à 15 ou 20 000 m3 de déchets liquides récupérés et 5 000 m3 de déchets pâteux, il existe des moyens à proximité des zones considérées permettant d'avoir une réponse quasi immédiate de disponibilité, avec réquisition des installations industrielles.
M. le Président : Avez-vous évalué l'importance des capacités d'accueil ?
M. Jean-Pierre VALLAURI : Oui, tout à fait.
24 000 m3 rien qu'au port autonome dans les deux bassins de décantation, sans parler d'une expérience que l'on a montée avec SHELL Berre, qui pourrait mettre à disposition du préfet un bac sous réserve d'être autorisé à ne pas le désaffecter.
L'usine d'incinération est à côté et il s'agit simplement de stocker le produit dans un endroit qui ne pose pas de problème de récupération ensuite. Ce serait dommage de détruire cette possibilité, alors que pour un coût relativement minime d'entretien, avec un financement approprié ce bac pourrait rester sur place et servir au plan POLMAR.
Sur le principe, cette question est résolue, il reste peut-être à trouver quelques financements et à finaliser un accord entre SHELL et la puissance publique.
M. Pierre SECOND : Les moyens de transport pour les liquides sont des citernes, et des bennes pour les pâteux. Ils sont identifiés.
M. le Rapporteur : Y compris les jours de fête ?
M. Pierre SECOND : Oui.
M. Jacques BOLOPION : En Méditerranée, le problème vient de la Corse. Je ne sais pas comment cela se passerait. On a dû vous dire à la Préfecture maritime que les risques les plus importants se manifestent là-bas, compte tenu des concentrations de trafics. Je ne sais pas où ils en sont pour le stockage, mais ce serait bien compliqué.
M. le Rapporteur : S'il y avait une réglementation en Méditerranée du même type de celle qui existe en Manche, on pourrait très bien imaginer que l'Etat puisse intervenir sur des bateaux au-delà des 12 milles : cela vous manque-t-il pour la répression du dégazage ?
M. Jacques BOLOPION : Le bilan ne serait pas beaucoup plus extraordinaire, au lieu d'en prendre un on en prendrait neuf.
M. le Rapporteur : C'est la convention de Montego Bay qui a exclu la Méditerranée du système des ZEE ?
M. Jacques BOLOPION : La Méditerranée pose des problèmes de délimitations entre pays riverains, notamment dans des pays comme la Turquie, la Grèce ou la Libye et la Tunisie qui ont des relations conflictuelles. Il a donc été décidé d'en rester là. Toutefois, les Espagnols ont créé une zone exclusive de 49 milles pour la pêche dans le secteur des Baléares.
M. le Rapporteur : Unilatéralement ?
M. Jacques BOLOPION : Nous avons protesté et la Commission a estimé que c'était légal. Nous sommes en train de préparer pour la pêche une zone de 50 milles, des démarches sont en cours.
M. le Rapporteur : Quand la Commission a-t-elle estimé que c'était conforme à la convention ?
M. Jacques BOLOPION : C'est assez récent, il y a environ deux ans. Cela posait des problèmes aux thoniers sétois qui pêchent le thon au large des Baléares.
M. le Rapporteur : C'est un sujet rémanent.
M. le Président : On nous a parlé de zone écologique à constituer en Méditerranée. Un tel projet n'a de sens que si cela retient l'attention des différents partenaires italiens, français et espagnols.
M. Jacques BOLOPION : Vous parlez du très grand triangle qui couvre la moitié de la Côte d'Azur, le golfe de Gênes, qui se termine au sommet de la Corse, qui est une zone de protection pour les cétacés.
Il faut connaître les effets précis de cette initiative, dont on nous dit que cela ne change rien mais dont on pense que cela peut en fait changer beaucoup de choses. Cela inquiète beaucoup les pêcheurs, comme on veut protéger les cétacés dans ce secteur, ils estiment qu'un jour ou l'autre on leur interdira certains modes de pêches. Les pêcheurs sont très vigilants sur cette affaire, ainsi que le ministère de l'Agriculture et de la Pêche.
Toutefois, il est expressément stipulé que tous les types de pêches actuellement en vigueur peuvent continuer à s'exercer dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Les NGV ont un système sophistiqué de repérage des cétacés afin d'éviter de les heurter. Depuis qu'ils font la traversée entre la Corse et le continent, ils heurtaient en moyenne une fois par an un cétacé. Cela a des conséquences au moins financières pour la SNCM et toutes les compagnies qui ont ce type de navires.
Sur le plan écologique, une vigilance particulière est apportée par un certain nombre d'organisations écologistes ou para écologistes sur la qualité des eaux dans le secteur, et notamment une très grande vigilance par rapport aux nappes d'hydrocarbure et aux ordures.
La partie nord du golfe de Gênes, compte tenu des régimes des vents et des courants, est une zone de concentration de pollutions venant d'ailleurs, soit portée par les vents, soit portée par les courants.
M. le Président : Cette mesure est de nature à concentrer un peu plus l'attention d'un certain nombre de structures associatives ou autres sur cette zone, et à effectuer une pression supplémentaire sur ceux qui sont amenés à effectuer des dégazages.
M. Jacques BOLOPION : Nous exerçons une pression en ce sens par le biais de nos contrôles.
M. le Président : Avec quels pavillons avez-vous le plus de difficultés ? Un recensement est-il fait ? Malte, Chypre ne sont pas loin, la Grèce non plus, la Turquie et un certain nombre de pays comme la Roumanie, la Bulgarie, sont-ils problématiques ?
M. Germain VERLET : Ce sont particulièrement les ex-pays de l'Est qui posent problème, bien que l'on ne puisse pas faire de généralisations. Ce sont souvent des petits vraquiers, des bateaux à taux de frets très bas.
M. Jacques BOLOPION : Compte tenu de leur forme et de leur tirant d'eau relativement faible, ils sont sensibles au mauvais temps. D'ailleurs, sur les trois navires qui se sont échoués récemment à Port-la-Nouvelle, il y avait deux fluvio-maritimes.
Nous avons eu un cas d'école, avec le Simba, qui battait pavillon géorgien, dont tous les papiers étaient faux. Il avait produit de faux certificats internationaux de sécurité, il n'était pas assuré, il avait triché sur son numéro international de navire en prenant le nom d'un autre navire pour se rajeunir.
Lorsqu'il est arrivé à la côte, il venait charger des céréales à Port-la-Nouvelle. Son déséchouement est en cours, aux frais du contribuable français et la totalité de l'équipage a été rapatrié. L'armateur nous semble être grec, mais il est difficile à identifier certainement du fait du nombre de sociétés écrans.
M. le Président : Un des éléments soulevés ce matin concerne les relations avec les pays voisins, l'Espagne d'une part et l'Italie d'autre part. Compte tenu de la nature et de l'envergure de certaines pollutions, entre Perpignan et Menton, on n'est pas à l'abri.
Ressentez-vous la nécessité d'aller vers une coordination des moyens ? Une discussion est-elle engagée, afin de promouvoir dans cette partie ouest de la Méditerranée une action concertée, coordonnée avec les différents pays ?
M. Thierry QUEFFELEC : Des moyens aériens sont ponctuellement prêtés à l'Espagne ou à l'Italie.
Par delà les premiers rapports d'hommes à hommes à la frontière, il y a un rapport direct via le COAD (le Centre Opérationnel d'Aide à la Décision de la Direction de la défense et de la sécurité civiles à Paris) qui fait le lien avec les pays européens pour le secours aux personnes ou dans le cadre d'actions spécifiques.
Concrètement, lorsque le département limitrophe, par exemple les Pyrénées Orientales, rencontre un problème avec le département limitrophe espagnol, le premier lien international s'effectue via le CIRCOSC de Valabre, qui fait remonter l'information à Paris.
M. le Président : Y a-t-il déjà des coordinations formalisées en matière de lutte antipollution, une mise en commun des moyens entre notre pays et ces deux autres pays ?
M. Thierry QUEFFELEC : Nous pouvons fournir des moyens spécifiques en fonction de leur demande, sachant qu'une pollution peut très bien toucher à la fois la côte française et la côte espagnole. Il n'y a pas de plan spécifique préparé ou de moyens pré-programmés : c'est un accord d'assistance mutuelle.
M. le Président : Ne peut-on pas envisager de mettre en place un accord du type de celui qui a été négocié dans le golfe de Gascogne, entre la France et l'Espagne ? 15 jours avant le naufrage de l'Erika, un accord avait été passé et a permis la disposition de moyens espagnols pour venir en aide aux moyens français.
M. Thierry QUEFFELEC : On peut toujours l'envisager. Mais, en tout état de cause, le rôle du CIRCOSC n'est pas de commander directement, mais de renforcer, d'animer et de coordonner. Les renforts peuvent être demandés à une autre zone, et c'est le rôle du CIRCOSC de s'en assurer.
Il est toujours difficile de tout planifier à l'avance, car des choix difficiles doivent parfois être faits dans l'urgence, notamment s'il y a plusieurs crises au même moment et qu'il faut arbitrer suivant les niveaux de priorité.
M. Philippe BODINO : Nous disposons d'une convention d'assistance mutuelle qui se décline en un certain nombre d'arrangements administratifs ou de coopérations opérationnelles. Par exemple, avec l'Italie, nous avons une convention et un arrangement sur les feux de forêt, sur le secours en montagne, sur le secours de proximité.
M. Jacques BOLOPION : Lorsqu'on a une pollution en mer, le fait de la traiter en mer très vite, avec des moyens lourds et puissants, c'est autant de nappes qui ne toucheront pas la côte.
Je ne suis pas sûr que nous disposions en la matière de quelque chose de précis, d'efficace et de rapide, que ce soit avec les Italiens ou avec les Espagnols. Or, il faut aller très vite, surtout si l'on a un régime de vents défavorables. Il y a sans doute des avancées à réaliser.
Ceci doit être aussi vrai pour eux. De leur côté, ils ne doivent pas avoir les moyens de mobiliser très vite les moyens de la Marine nationale qui existent en Méditerranée.
Les coopérations sont plus au niveau du port de Marseille, qui a développé des instruments et des exercices. En cas de pollutions importantes, on rencontrerait des problèmes majeurs, avec la nécessité de faire venir très vite les moyens lourds de tout le pourtour de la Méditerranée.
A mon sens, deux pays en disposent, les Italiens et les Espagnols, peut-être les Grecs, et encore. Il faudrait se mobiliser.
M. le Président : C'est le sens de ma remarque.
A l'évidence, on repart d'ici avec le sentiment que si nous avons suffisamment éloigné des côtes un pétrolier en difficulté, sans pouvoir éviter qu'il déverse sa cargaison dans la mer, comment fait-on ?
En Méditerranée, il n'y a pas de moyens de pompage suffisamment efficaces et lourds pour faire face à une catastrophe majeure. Il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup plus en Atlantique, et, de toute façon, ils sont inopérants par des vents de force 5 ou 6. C'est ce qui ressort des entretiens que nous avons eus.
Une des priorités consistera à obtenir la mise en place de ces moyens sur chacune des façades. Ces besoins sont tels que l'on ne peut pas envisager que ce ne soit qu'un seul pays qui les mette en _uvre.
Cela passe sans doute par une meilleure collaboration et un commandement unique, comme cela se passe en Manche avec les Anglais, et par des accords complets afin de prévoir toute éventualité.
M. Jacques BOLOPION : Le port de Marseille a même apporté assistance à un certain nombre de zones, en dehors de la France, dans des cas de pollution. Il y a des équipes expérimentées depuis très longtemps pour lutter contre la pollution à Marseille, qui détient une véritable expertise dans ce domaine.
M. le Président : Ce sont des équipes destinées à s'occuper de pollutions dans d'autres ports ?
M. Jacques BOLOPION : Elles ne sont pas destinées à traiter de grandes pollutions océaniques, mais elles ont une expérience du pompage des hydrocarbures, de leur stockage et du traitement des produits chimiques.
M. Joseph MOYSAN : C'est toute la problématique de la solidarité en cas de pollution.
M. Edouard LANDRAIN : L'exemple que vous avez donné s'agissant de la pollution du mois de juillet dernier montre les insuffisances du dispositif, puisqu'il semblerait que la nappe n'ait pas été identifiée suffisamment tôt, pas détectée. Vous ne saviez même pas d'où elle venait, vraisemblablement ce sont des vents d'est qui l'auraient apportée, donc elle viendrait d'un pays étranger, en l'occurrence l'Italie.
L'Italie a-t-elle les moyens de détection suffisants pour avoir la même vigilance que la nôtre, à travers les systèmes aériens en particulier ?
M. Georges CLAUSTRES : Je ne serai pas totalement affirmatif, mais les moyens de télé-détection des douanes françaises constituent, me semble-t-il, le seul moyen existant à ce niveau-là en Méditerranée. Je demanderai à m'en assurer.
Mme Marie-Christine BERTRANDY : Je voudrais signaler un document que je peux mettre à votre disposition, qui a été élaboré dans le cadre de l'accord RAMOGE ; c'est la comparaison des réglementations en matière de protection de l'environnement sur la zone RAMOGE entre la France, l'Italie et Monaco.
L'objectif n'était pas de faire des études exhaustives mais de comparer sur un certain nombre de thèmes, dont la pollution accidentelle par l'hydrocarbure, ces réglementations et éventuellement d'en tirer des conséquences et des enseignements qui pourraient être mis en _uvre dans le cadre de l'accord RAMOGE, ou qui pourraient éventuellement permettre de transmettre des propositions au Gouvernement concerné.
J'ai animé ce groupe de travail pour la France.
Ce document est mis à jour deux fois par an, il donne lieu tous les trimestres à un bulletin d'actualisation. Actuellement, nous travaillons sur la jurisprudence pour abonder ce document.
Vous pourrez peut-être trouver quelques éléments de réponse à vos questions sur ce qui se fait dans la province de Gênes, la structure étant différente de la nôtre.
M. le Président : Quel est le rôle de la préfecture de zone dans la coordination des plans POLMAR ?
M. Thierry QUEFFELEC : La préfecture de zone s'occupe de l'ensemble des problèmes de sécurité civile. Elle n'a pas de pouvoirs propres, sinon celui d'animer et de coordonner l'ensemble des moyens et des renforts zonaux ou nationaux dont un département peut avoir besoin. Si le problème touche deux, trois ou quatre départements, la préfecture de zone organise l'ensemble des arbitrages et coordonne les actions.
M. Edouard LANDRAIN : Tout à l'heure, nous avons reçu les maires, et si j'ai bien compris, il y a un syndrome particulier à ce département : la bivalence entre les marins pompiers et les services du CODIS. On n'a pas très bien saisi la coordination, la responsabilité des communes qui risquent d'être atteintes par une pollution.
Mme Josiane GILBERT : Effectivement, nous sommes dans une situation atypique, le décret-loi de 1939 modifié ayant créé le bataillon des marins-pompiers de Marseille, unité militaire, compétent sur Marseille, ses ports, l'aéroport, l'aéroport de Marseille-Provence. Ce service de secours existe avec le Service départemental d'incendie et de secours, unité civile. Les deux services sont intégrés tant sur le plan de l'alerte que de l'action dans le plan POLMAR.
M. Edouard LANDRAIN : Un maire a un centre de secours, sans parler de l'aspect pécuniaire, celui-ci n'est pas entraîné, n'a pas de matériel. Ils ne savent pas comment faire et sont quelque peu désemparés.
Mme Josiane GILBERT : Nous nous attachons à développer dans le département des Bouches-du-Rhône, sur l'ensemble des risques majeurs et plus encore pour le risque pollution marine, puisque la circulaire du Premier ministre de décembre 1997 est le premier texte qui l'évoque, la réalisation par les élus de plans de secours communaux (cellule municipale de crise, recensement des moyens de lutte disponibles, connaissance et repérage des acteurs et de leur rôle...).
Une mission a été confiée en ce sens à M. le sous-préfet d'Istres, qui l'a évoquée ce matin.
M. Edouard LANDRAIN : C'est nécessaire.
Audition de M. Censu GALEA,
ministre des transports et des communications,
accompagné de M. Lino VASSALO,
directeur exécutif de la Malta Maritime Authority (MMA)
en présence de Son Excellence M. Didier DESTREMAU,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Malte
(extrait du procès-verbal de la séance du 25 avril 2000 à Malte)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur
M. le Rapporteur : Je vous remercie d'avoir bien voulu recevoir la commission d'enquête parlementaire sur l'Erika, et plus globalement, sur les mesures à prendre pour la sécurité maritime.
Notre recherche est axée sur trois points. Premièrement, le sinistre lui-même : tout le monde a-t-il bien fait ce qu'il fallait pour l'éviter ? Deuxièmement, la manière dont notre pays a réagi vis-à-vis de la pollution : les moyens mis en _uvre étaient-ils opportuns ? Leur organisation était-elle bonne ? Si tel n'est pas le cas, que fallait-il prévoir ? Et troisièmement, au-delà de ces deux premiers points, nous devons faire des propositions sur l'organisation générale de la sécurité du transport maritime en France et en Europe. Nous abordons à la fois les problèmes de la sécurité de circulation en Manche et en Méditerranée, les problèmes de contrôle des normes et celui des pavillons, ainsi que tout ce qui se rapporte à la sécurité au sens large.
Telle est notre mission. Evidemment, nous nous devions de venir à Malte, tout d'abord pour vous faire part de la grande émotion ressentie par les Français dans leur ensemble face à cette catastrophe. Des filières professionnelles entières sont très durement touchées. Pour le week-end de Pâques, la semaine dernière, nous avons dû à nouveau fermer des plages qui avaient été rouvertes au public, car le mauvais temps y avait encore déposé du pétrole. Nous ne connaissons pas aujourd'hui l'ampleur du préjudice financier, mais il sera énorme. Le secteur du tourisme, les pêcheurs, les ostréiculteurs ont été touchés et nous vivons dans l'angoisse du pompage du fioul de l'Erika, qui doit se dérouler à la fin du mois de mai. Celui-ci sera techniquement très difficile et s'il se passait mal et que nous ayons à déplorer une nouvelle marée noire, ce serait dramatique. Nous tenions à vous faire part de cette émotion, mais nous savons qu'elle est partagée et qu'il faut désormais nous efforcer de trouver avec nos partenaires les moyens d'agir pour éviter au maximum qu'un tel événement se reproduise.
Nous avons à ce sujet de nombreuses préoccupations et interrogations dont nous souhaitons vous faire part ce matin, à vous et à vos collaborateurs, bien que nous ayons déjà évoqué ces questions hier soir. Nous ne venons pas ici pour porter des accusations, mais pour essayer de trouver de nouvelles solutions.
M. Censu GALEA : Je vous remercie de votre présence car j'ai le sentiment qu'il est très important que le dialogue s'établisse afin de faire connaître ce qui se passe de notre côté, mais aussi d'entendre ce qui se passe chez vous. Je n'ai jamais douté de l'émotion que vous avez pu ressentir face au sinistre puisque nous-mêmes, ici, l'avons ressentie, très conscients que l'économie de cette partie de la France était essentiellement liée au tourisme et à la pêche. Nous savons que nombre de personnes ont été touchées, car beaucoup vivent de ces activités. Il est en effet très important d'analyser ce qui s'est passé et tout aussi important de voir ce qu'il est bon de faire pour l'avenir. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'un accident a lieu en ce même endroit. C'est tragique.
Mon souhait est que toutes les entités concernées dans l'affaire prennent les mesures nécessaires pour éviter qu'un tel sinistre se reproduise à l'avenir. Je répète ici ce que j'ai déjà dit à la presse, à laquelle nous avons accordé quelques interviews : nous sommes prêts à collaborer - nous le voulons - et à étudier les mesures à mettre en _uvre pour que cela ne se produise plus. Je voudrais souligner le fait qu'à travers la Malta Maritime Authority (MMA) qui a en charge le contrôle des navires sous notre pavillon - c'est M. Vassallo ici présent qui s'occupe de ces questions - nous veillons à ce que toutes les précautions nécessaires soient prises pour éviter un tel événement dans le futur.
M. Didier DESTREMAU : Excusez-moi, mais il y une petite nuance : le ministre vient de dire qu'il serait bon que vous voyez toutes les procédures qu'ils appliquent afin qu'il n'y ait pas de nouvel accident.
M. le Rapporteur : S'agit-il de mesures que vous venez de prendre ou de procédures déjà en place avant l'affaire de l'Erika ?
M. Censu GALEA : C'est une combinaison de toutes les mesures anciennes. Dans le passé, nous avons toujours veillé à ce que toutes les normes internationales soient respectées. Le sinistre de l'Erika a eu lieu le 12 ou 13 décembre mais déjà avant cela, une norme avait été promulguée par notre autorité maritime, sans relation avec l'Erika puisqu'elle lui était antérieure. Cette norme a d'ailleurs été transmise dès le 16 novembre 1999 à l'Union européenne dans le cadre des négociations d'adhésion.
M. le Rapporteur : De quelle norme s'agit-il ?
M. Censu GALEA : Nous vous donnerons une copie de ces règlements.
M. Lino VASSALLO : Il s'agit d'une loi qui améliore la législation de la marine marchande et prend en compte les conventions internationales les plus récentes. C'est le parlement qui donne le pouvoir au Gouvernement, non seulement de s'en tenir à ces conventions, mais de veiller à ce que l'administration suive exactement ces normes. Ces dispositions existent déjà, mais elles avaient besoin d'être remises à jour en vue de tous les nouveaux développements qui ont eu lieu en ce domaine. Une convention est en particulier concernée, la convention n° 147 de l'OIT. Bien entendu, il existe d'autres dispositions, mais je ne vais pas vous donner le résumé de tout cela maintenant.
M. Censu GALEA : D'ailleurs, la dernière loi promulguée par le parlement, avant l'incident de l'Erika, traitait de la pollution et des responsabilités des autorités locales vis-à-vis de la pollution marine. Ce sont les conventions CLC et FIPOL 1992, c'est-à-dire les protocoles les plus récents.
M. Censu GALEA : Nous sommes partis du protocole ancien, mais il faut toujours se mettre à jour pour suivre les modifications en cours.
Je crois que je peux m'arrêter là, mais je tiens encore à préciser que notre Gouvernement était très préoccupé après le sinistre.
M. Lino VASSALLO : Il faut dire aussi que l'Erika était couvert par le dispositif FIPOL de 1992, le plus récent.
M. le Rapporteur : De combien de temps disposons-nous, M. le ministre ?
M. Censu GALEA : Autant que vous le désirez.
M. le Rapporteur : Je sais que nous devons assister à une réunion technique, aussi allons-nous aborder les questions politiques. Je vais sans doute commencer par vous dire des choses désagréables mais après, je l'espère, plus agréables.
M. Censu GALEA : Alors, permettez-moi de vous offrir avant un café. (Sourires).
M. le Rapporteur : En France et en Europe, que vous le vouliez ou non, vous avez l'image négative d'un pavillon de complaisance. Vous pourriez me répondre que les bateaux sous pavillon de complaisance ne sont pas les seuls à avoir des sinistres. Vous rappeliez tout à l'heure que nous avons déjà subi sept sinistres sur nos côtes, le plus spectaculaire d'entre eux fut l'Amoco Cadiz qui était un bateau américain récent avec un équipage américain. Nous dirions, en religion catholique, avec tous les sacrements ! Mais cela ne l'a pas empêché de faire des dégâts considérables.
Toutefois, les statistiques des sinistres dans le monde montrent que les bateaux les plus dangereux sont ceux naviguant sous pavillon de complaisance et les bateaux anciens. Nous avons la liste.
M. Censu GALEA : Je l'ai aussi ici.
M. le Rapporteur : La réprobation française et européenne s'est portée sur l'ensemble des pays ayant des pavillons de complaisance. Pour nous, Malte fait partie de ces pays.
De quoi vous accuse-t-on ?
Premièrement, on vous accuse d'un manque de transparence dans le processus de propriété et de mise en _uvre du bateau. L'exemple de l'Erika est spectaculaire à cet égard : pour comprendre qui est le propriétaire réel, il faut déjà beaucoup de temps.
Deuxièmement, on vous accuse d'un contrôle insuffisant, tant sur le plan technique que social, car on sait bien que les équipages composés de membres de différentes nationalités constituent un risque supplémentaire.
Troisièmement, on vous accuse aussi d'être le lieu d'accueil d'un capitalisme d'une autre époque.
M. Louis GUEDON : Les montages juridiques que l'on peut constater avec les pavillons de complaisance peuvent paraître à la limite de la moralité.
M. le Rapporteur : Voilà pour la partie désagréable.
De manière que j'espère plus agréable, nous pensons que l'entrée de Malte, qui dispose d'une flotte importante, dans l'Union européenne peut être une chance aussi bien pour l'Europe que pour Malte, car l'Europe est aujourd'hui dépendante d'autres pays pour ses approvisionnements et son commerce maritime : Panama, Liberia, Honduras, et demain peut-être d'autres comme la Russie. Que Malte adhère à l'Union européenne avec une flotte aux normes et de bon niveau peut être une chance. Nous souhaitons que la catastrophe de l'Erika puisse servir à cela.
J'ajouterai un dernier point, politique, qui correspond à nos conversations de fin de repas d'hier, mais c'est à ce moment-là que l'on se dit les choses les plus importantes. (Sourires) La Convention des Nations unies sur le droit de la mer précise qu'il faut qu'il existe un « lien structurel » entre un État et une flotte afin d'éviter une flotte artificielle. Nous nous interrogions hier sur ce lien. Sans doute, la définition du lien futur pour votre pays est-elle la qualité de cette flotte et sa vocation à servir l'Europe, même si Malte ne compte pas elle-même beaucoup de marins et s'il n'y a pas beaucoup de capital maltais dans la flotte maltaise. Le lien pourrait être la vocation de Malte à assurer le trafic maritime européen.
M. Jean-Michel MARCHAND : Et la qualité du service.
M. le Rapporteur : C'est sur ce point que nous sommes tombés d'accord hier.
M. Censu GALEA : Je pense que c'est une bonne occasion pour nous aussi et, par conséquent, je ne reprendrai pas ce que vous venez de dire à ce sujet. Je reviendrai plutôt sur les points négatifs, si vous le permettez.
J'apprécie beaucoup - tout particulièrement après l'accident de l'Erika qui vous a touché - qu'il existe une perception, en France mais aussi dans d'autres pays d'Europe, des conditions des travailleurs et du manque de contrôle et de transparence. L'effet négatif en a été fortement ressenti, particulièrement en France. Cela est dû au fait que ce secteur de l'économie est un secteur dont personne ne parle jusqu'à ce que survienne un sinistre comme celui-là. Personnellement, je pense que dans l'opinion publique, je ne parle pas des personnes directement concernées mais de l'opinion publique en général, les choses sont semblables à celles qui se passent lorsqu'il y a un problème d'aviation civile. On ne parle jamais de navigation ou d'aviation civile, sauf quand se produit un sinistre. L'opinion publique n'a pas une grande connaissance de ces domaines, ce qui rend difficile l'explication des procédures que nous suivons ici ou dans d'autres pays.
Si nous essayons de mettre cet aspect du problème de côté et de nous concentrer sur la transparence et les conditions de travail des équipages, je suis sûr - c'est ce que l'autorité maritime m'assure - que, concernant la transparence sur la propriété des bateaux, l'autorité maritime possède tous les détails nécessaires, que nous pourrons vous présenter si vous le souhaitez.
Quant aux contrôles, à part celui que l'autorité maritime effectue elle-même, il existe ceux, plus précis, qu'effectuent les sociétés de classification, à qui ces contrôles sont spécialement délégués.
Je reviens sur les conditions d'emploi sur le navire. En la matière, j'ai eu l'an dernier quelques informations sur ce sujet par l'ITF. Nous avons conduit des investigations afin de connaître la vraie nature de ce problème. Ce n'était pas exactement ce que l'ITF nous avait indiqué, mais en effet, la MMA a dû à certaines occasions aider des équipages qui en avaient besoin, ce qui montre qu'il y avait des problèmes, mais ils ont pu être résolus.
Quant aux équipages des bateaux, on m'informe qu'ils sont bien formés.
M. Lino VASSALLO : Avec la nouvelle convention STCW, cela sera encore plus vrai puisque, dans deux ans, tous les équipages et officiers devront être certifiés par l'Etat du pavillon, en plus de la certification qu'ils ont déjà reçue de leur pays.
M. Censu GALEA : Le dernier point important que vous avez mentionné est le fait que la marine marchande et l'enregistrement des bateaux sont devenus deux activités importantes à Malte. Nous avons toujours répété - et personnellement, je continuerai à le faire - que l'on ne peut pas laisser dire que nous sommes devenus le quatrième pavillon mondial simplement du fait de l'accroissement du nombre de bateaux et du tonnage enregistrés sous pavillon maltais. Le plus important est la qualité des navires qui viennent pour l'enregistrement. Nous sommes bien conscients qu'un accident comme celui qui est arrivé pourrait tout ruiner en une seconde. Pourtant, ce n'est qu'un des 3000 navires enregistrés à Malte.
M. Lino VASSALLO : 3000 si l'on compte les bateaux de plaisance ; 1400 seulement, si l'on considère seulement les navires marchands, sachant que les navires de transport de passagers sont inclus cette dernière catégorie.
M. Censu GALEA : Nous savons bien qu'un sinistre ou deux peuvent détruire tout le travail que nous avons réalisé depuis dix ans par la MMA.
M. le Rapporteur : Un autre sinistre, et ce serait fini.
M. Censu GALEA : D'ailleurs, puisque que nous évoquons cet aspect, je puis vous assurer que nous sommes prêts à appliquer les nouvelles normes non seulement parce que ce sont des normes de l'Union européenne qui s'imposeront à nous, mais bien parce qu'elles répondent à notre propre volonté.
M. le Rapporteur : Je vais donner la parole à mes collègues qui souhaitent aussi vous poser des questions.
M. Censu GALEA : N'hésitez pas à le faire. Si elles sont trop techniques, je cèderai la parole à M. Vassallo. Celui-ci souhaiterait d'ailleurs que je précise que l'autorité maritime doit remettre son rapport d'activité directement au Parlement tous les ans.
Mme Jacqueline LAZARD : Avant d'aborder des aspects plus techniques, pensez-vous, M. le ministre, disposer de moyens financiers et humains suffisants pour effectuer le contrôle de navires ?
M. Censu GALEA : Au plan financier, il n'y a pas de problème, nous disposons de l'argent dont nous avons besoin, il n'y a aucune limite au budget dont nous pouvons disposer. Nous rencontrons parfois des problèmes en ressources humaines. Nous ne disposons pas toujours du nombre suffisant de personnes qualifiées, mais c'est un problème mondial. C'est ce que disait le contrôleur du port à Dunkerque après le sinistre, se lamentant sur le fait qu'il ne disposait que de quatre inspecteurs. C'est un problème international, pas local.
M. Lino VASSALLO : Cela me ferait plaisir de pouvoir dire que nous n'avons pas assez de ressources, mais je ne le peux pas puisque, soit le Gouvernement, soit l'autorité compétente me donne les moyens dont j'ai besoin. Je ne peux pas dire cela.
M. Didier DESTREMAU : Le pavillon maltais dispose de quatre-vingt-dix contrôleurs ou inspecteurs répartis dans le monde. Je voudrais connaître le mode de sélection de ces personnes. Selon quels critères sont-ils choisis ? C'est absolument vital car l'Etat maltais se repose sur les jugements donnés par ces contrôleurs-inspecteurs. Comment l'Etat maltais sait-il qu'au fin fond du Honduras, il y a un contrôleur sérieux et crédible ?
M. le Rapporteur : Ces quatre-vingt-dix inspecteurs dont nous parlons sont-ils des personnels dépendants de l'autorité maritime, payés par elle, ou dépendant de sociétés de classification ?
M. Lino VASSALLO : Je puis vous répondre très clairement sur ce point dès maintenant si vous le souhaitez, mais je comptais vous exposer le système dans son intégralité au cours de notre rencontre à la MMA. C'est en effet un point crucial. Nous parlerons des critères de choix des inspecteurs, des contrôles, des arrangements financiers, etc. Je peux cependant vous dire à propos des ressources, qu'alors que normalement nous effectuons trente à quarante inspections par mois, ce mois-ci à titre d'exemple, nous avons eu l'occasion d'inspecter plus de soixante navires car nous possédions les ressources humaines et financières nécessaires. Naturellement, il peut arriver que certains mois nous en fassions moins, mais si cela est nécessaire, nous prenons les mesures qui s'imposent.
Il ne faut pas oublier cependant qu'à moins d'avoir un soupçon sur un bateau, nous ne pouvons pas, ce ne serait pas juste, retenir un bateau au port. En cas de soupçon, nous pouvons le garder au port une journée entière pour permettre l'inspection nécessaire et s'il y a confirmation de ce soupçon, le navire restera au port autant de temps qu'il faudra pour faire les réparations nécessaires. Si c'est nécessaire, nous lui retirons notre pavillon.
M. Louis GUEDON : Sans entrer dans une discussion technique, je voudrais cependant souligner qu'il y a les arguments juridiques, qui sont serrés et très bien construits, et puis il y a la réalité, qui est vraiment immorale.
Prenons l'exemple de l'Erika : c'est un vieux bateau. Les contrôles techniques donnent des conclusions différentes. Nous avons les « gros » contrôles techniques, qui exigent que le bateau soit mis en cale sèche, et les contrôles « intermédiaires » qui n'ont aucune signification véritable. Même si certaines sociétés de classification sont reconnues par des instances comme l'IACS, nous savons bien, tous, qu'elles sont d'inégale valeur.
Poursuivons notre exemple : l'Erika est un vieux navire, en mauvais état, sur l'avenir duquel les avis divergent. Il prend la mer avec une cargaison dangereuse, un équipage certes compétent mais qui ne connaît pas la navigation nord atlantique, qui réagit mal aux situations de tempête auxquelles il est confronté. Dix-huit heures s'écoulent entre un message de détresse et le naufrage, en raison de nombreux aléas - retrait du SOS, etc. - et des procédures que cela entraîne. Mais la conséquence, c'est le drame que nous vivons aujourd'hui !
Il y a donc des réponses techniques, des réponses juridiques, mais les réponses de fond, les réponses morales ne peuvent pas s'abriter derrière un montage juridique. Au même endroit, sept naufrages ont déjà eu lieu. Mais, je vous le disais hier soir, au huitième, c'est la révolution !
M. Jean-Michel MARCHAND : Pour compléter la remarque qui vient d'être faite, je dirai qu'il est important que nous ayons une discussion sur l'avenir, mais nous ne pouvons pas oublier ce qui vient de se produire, c'est-à-dire la catastrophe écologique et économique, et le fait que, soit par manque de transparence, soit par des montages juridiques complexes, chacun se réfugie derrière quelqu'un d'autre pour ne pas prendre ses responsabilités, des responsabilités certes morales, mais qui ne peuvent avoir pour seul objet la moralité, mais aussi des conséquences financières et économiques. Or, la justice ne pourra s'appuyer que sur les montages juridiques existants. Aussi faut-il les faire évoluer pour que les responsabilités de chacun soient clairement établies au préalable, qu'il s'agisse de la responsabilité de l'Etat du pavillon, de l'armateur et de celle des affréteurs, dirai-je pour être simple car c'est certainement bien plus complexe.
M. Censu GALEA : Comme vous le savez, c'est un aspect assez compliqué de la navigation. Il ne s'agit pas simplement d'être propriétaire d'un bateau et de transporter un produit d'un pays à l'autre. Tant de personnes sont impliquées dans l'affaire. Je demeure d'accord avec vous lorsque vous dites que chacun doit prendre ses responsabilités. C'est essentiel.
Pour répondre à votre commentaire, pour ce genre d'affaires et la façon dont on la traite, bateau battant pavillon de complaisance ou autre, les complications existent toujours. Je souhaite aussi qu'à l'avenir soient connues préalablement les personnes concernées par ce genre d'affaires.
Au sujet des commentaires que vous avez faits auparavant, vous avez mentionné pratiquement tous les problèmes concernant les bateaux.
M. le Rapporteur : Concernant l'âge des bateaux ?
M. Censu GALEA : Je ne nierai pas le fait que l'Erika ait été un bateau ancien. Tout le monde sait qu'il avait vingt-quatre ou vingt-cinq ans. La question ne se pose même pas. Mais il me semble que la principale question qu'il faut se poser, pour l'avenir, est celle de savoir si l'on doit accepter que des bateaux de cet âge soient utilisés pour ce genre de transport.
M. le Rapporteur : C'est la grande question.
M. Censu GALEA : Je sais qu'il y a des discussions actuellement, en France ainsi qu'au sein de l'Union européenne, au sujet de la réduction de l'âge limite des bateaux. Bien entendu, nous serons les premiers à adhérer à de nouvelles normes internationales. Nous n'enregistrerions pas de bateaux de plus de vingt ans s'il était décidé que les bateaux ne doivent pas dépasser cette limite d'âge.
Au sujet des rapports divergents constatés à la suite du sinistre de l'Erika, il est très important de préciser que si un bateau change de société de classification, la responsabilité des deux sociétés, l'ancienne et la nouvelle, est engagée.
M. Lino VASSALLO : La société de classification perdante aussi bien que la gagnante.
M. Censu GALEA : La transparence est, pour moi, très importante.
Vous avez dit également que les sociétés de classification reconnues par l'IACS ne sont pas toutes d'un niveau équivalent. Il serait bon qu'elles parviennent à uniformiser leur niveau de compétence. Vous avez évoqué, par exemple, le délai de dix-huit heures qui s'est écoulé entre le message de détresse et le naufrage et les problèmes qui s'en sont suivis. Je ne suis pas en mesure de porter un jugement éclairé sur cet aspect, mais sans doute M. Vassallo pourra-t-il le faire. Naturellement, nous menons actuellement des investigations.
M. le Rapporteur : M. le ministre, avant que nous nous séparions, je tenais à vous dire qu'évidemment, nous allons être interrogés sur notre venue ici...
M. Censu GALEA : Ah bon ? Ils savent que vous êtes à Malte ?
M. le Rapporteur : En France.
M. Censu GALEA : En France mais aussi à Malte. C'était une plaisanterie car vous n'êtes pas invisibles ! (Sourires)
M. le Rapporteur : A Malte, nous ne dirons rien. Mais, en France, même avant la remise du rapport, nous aurons à donner notre impression. Pouvons-nous dire qu'il y a volonté du Gouvernement maltais non seulement d'appliquer de manière extrêmement rigoureuse toutes les normes en vigueur, mais aussi d'anticiper ce que l'Europe pourra dire et faire demain pour être, en 2003, les bons élèves de la classe ?
M. Censu GALEA : J'espère que nous serons les professeurs.
M. Didier DESTREMAU : Ce que vient de dire M. Le Drian est extrêmement important parce que Malte, une fois dans l'Union européenne, sera le pays européen possédant la plus grande flotte. Ce sera peut-être le seul ou un des rares points où Malte sera en position de leader. C'est la raison pour laquelle M. Le Drian dit qu'il serait bon que vous commenciez à prendre des décisions avant d'entrer dans l'Union européenne, pour montrer la direction, telle l'étoile vers laquelle il faut se diriger. C'est un élément de qualité, mais aussi de responsabilité.
M. Censu GALEA : Je pense que vous pourrez constater tout à l'heure tout ce que la MMA a fait et est encore en train de faire de ce point de vue. Mais nous voudrions souligner, en tant que Gouvernement, qu'il faut que les normes européennes soient des normes internationales, et qu'elles soient effectivement observées.
M. le Rapporteur : Soit, mais...
M. Censu GALEA : Mais ?
M. le Rapporteur : ...nous savons, d'une part, que pour faire bouger l'OMI, il faut du temps et, d'autre part, que la modification de certaines dispositions se heurte à la résistance des pavillons de complaisance. C'est une constatation.
Aussi nous nous demandons s'il ne faudra pas prendre des dispositions européennes drastiques, de la même manière que les Etats-Unis ont promulgué le Oil Pollution Act. Les Etats-Unis ont réagi dès le premier accident, nous en sommes au septième. La position que je défendrai dans mon rapport, si mes collègues en sont d'accord, est que si nous n'arrivons pas à faire suffisamment évoluer les décisions au niveau international sous la présidence française, nous prendrons des dispositions communautaires fortes, conformes aux orientations qui sont aujourd'hui proposées au Conseil des ministres des transports, d'autant que nous savons aujourd'hui que nous aurons le soutien des Allemands et des Britanniques, ce qui est une grande nouveauté.
M. Censu GALEA : M. Vassallo pourra vous répondre puisqu'il participe très souvent à ces réunions techniques. Il sait tout. En tant que représentant de la MMA, il travaille à l'OMI en étroite collaboration avec les représentants français. Ils sont très souvent en train de présenter de nouvelles propositions, y compris avant la réunion.
M. Lino VASSALLO : Je suis d'accord avec vous pour dire que parfois, très souvent même, le système de l'OMI est très long à bouger. Cependant, l'OMI a pris récemment des dispositions visant à réduire tous ces délais.
De plus, ma propre expérience me fait dire qu'en utilisant les bonnes tactiques au cours des discussions avec les pavillons importants comme ceux du Panama, du Liberia, de Malte, des Bahamas ou de Chypre, nous pourrions arriver à beaucoup plus. Nous avons eu une excellente collaboration avec la délégation française. Cette dernière nous a très bien traités - et lorsque je dis « nous », je ne parle pas seulement de Malte.
Mais si les délégués français nous ont toujours traités comme des homologues, ce n'est pas le cas de toutes les délégations. Certaines ne recherchent vraiment pas la collaboration ; elles essaient plutôt de s'imposer. Ce n'est sans doute pas bien, mais une telle attitude a amené la délégation de Malte, et d'autres, à adopter une position négative. Je suis sûr que cela pourrait vous être confirmé par votre délégué auprès de l'OMI. Je puis vous assurer que nous avons d'excellentes relations avec les délégués français de l'OMI. Leur attitude a été très positive en comparaison de celle d'autres délégations. Lorsque l'on parvient à convaincre les grands pavillons - qui sont prêts à être convaincus -, de nouvelles décisions peuvent être prises assez vite puisque ces pavillons contrôlent, à eux seuls, 50 % du tonnage mondial. Je peux vous assurer, pour les connaître personnellement, que la volonté d'améliorer la situation existe. En disant cela, je suis conscient de prendre une grande responsabilité, non seulement pour Malte, mais aussi pour les autres délégations. Mais je le fais sans hésitation, car je suis sûr de ce que j'énonce.
Un autre point, si vous me le permettez, à propos de notre adhésion aux normes européennes. Il est très important que je souligne le fait qu'actuellement, le ministère est en contact avec la Commission à Bruxelles pour parler des directions dans lesquelles il va falloir travailler à l'avenir. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'au cours de la présidence française, le chapitre du transport sera ouvert à la discussion.
M. le Rapporteur : En fait, elle l'est depuis le dernier Conseil des ministres des transports qui s'est tenu le 28 mars. La question sera abordée une nouvelle fois lors de la réunion de Lisbonne à la fin juin, mais la présidence française souhaite faire de ce dossier l'un des plus importants qu'elle aura à traiter.
M. Lino VASSALLO : Je parle des négociations entre Malte et l'Union européenne.
M. Didier DESTREMAU : C'est très spécifique, car chaque pays à ses propres chapitres, mais il est sûr que nous, Français, nous pouvons insister sur le chapitre transports de Malte, qui est l'un des trente et un chapitres, pour qu'il soit ouvert durant la présidence française.
M. Censu GALEA : C'est le chapitre de Malte, pas des autres pays.
M. le Rapporteur : Nous vous remercions.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être validée par les intervenants.
Audition de MM. Marc BONELLO,
président de la Malta Maritime Authority (MMA),
Lino VASSALLO, directeur exécutif de la MMA,
Oscar BORG, directeur en chef de l'autorité,
Alfred CREMONA, directeur du yachting,
et Charles SCHEMBRI, directeur des ports,
en présence de Son Excellence M. Didier DESTREMAU,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Malte
(extrait du procès-verbal de la séance du 25 avril 2000 à Malte)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur
M. Marc BONELLO : Je vous souhaite la bienvenue à Malte, bien que nous l'ayons déjà fait hier soir. J'espère que nos discussions seront aussi fructueuses que possible. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'esprit dans lequel je souhaite travailler avec vous est celui d'une pleine coopération afin de parvenir à des objectifs communs. Pour commencer, je rappellerai brièvement le travail et les fonctions de la Malta Maritime Authority.
L'autorité maritime de Malte a été créée par la loi de 1991 et assume les responsabilités en matière d'activités portuaires, d'activités de yachting et d'activités de navigation marchande.
En principe, l'autorité doit répondre devant le Parlement, mais naturellement, elle est guidée par la politique du gouvernement du jour. L'autorité est gérée par un conseil de direction constitué de neuf directeurs. Quatre directeurs internes travaillent à plein temps : M. Charles Schembri, directeur des ports, M. Lino Vassallo, directeur de la marine marchande, M. Alfred Cremona, directeur du yachting et M. Oscar Borg, directeur en chef de l'autorité. Nous avons cinq autres directeurs, externes et à mi-temps, dont je suis le président.
La raison de cette composition du conseil est d'essayer autant que possible d'assurer une transparence des opérations de l'autorité et de vérifier que ses membres font ce qu'ils doivent faire.
Pour décrire les activités actuelles de l'autorité, je me concentrerai plus particulièrement sur les activités de chacune des directions.
Commençons par le directorat de yachting.
L'une de ses tâches au cours des mois qui viennent sera de renforcer ses fonctions en tant que régulateur. Traditionnellement, l'attribution de lieux d'amarrage pour le yachting relevait de la seule responsabilité de l'autorité maritime. L'autorité travaillait donc également au sein d'un environnement commercial. Récemment, le Gouvernement a approuvé deux projets importants, ce sont deux projets commerciaux pour des centres de yachting dans le port, l'un touchant une partie de Cotonera et l'autre étant le projet de Manoel Island.
L'autorité maritime est déjà propriétaire et gère deux ports de yachting. Le premier est situé dans la zone de M'sila, formant partie du port principal, le second dans le port Mgarr à Gozo. A long terme, il est possible que nous laissions au secteur privé le soin de gérer ces centres. C'est mon intention, mais je pense refléter le sentiment de ce conseil car cela répond à notre mission, notre souhait, d'agir en tant que régulateur. Nous constatons une forte augmentation des demandes de lieux d'amarrage ces dernières années. Avec les projets de Cotonera et Manoel Island, nous sommes sûrs de pouvoir répondre, au moins partiellement, à ces demandes.
Le plus important pour l'autorité n'est pas seulement de fournir un lieu d'amarrage, mais d'offrir une réelle qualité des installations existant dans ces centres de yachting, afin de pouvoir offrir des services équivalents à ceux des centres de yachting du monde entier.
Voilà ce que j'avais à dire concernant cette activité. Je ne sais si quelqu'un souhaite ajouter des éclaircissements ou en demander ?
Passons à la direction des ports.
Comme je l'ai déjà dit pour l'autorité du yachting, la ferme intention de l'autorité maritime est de renforcer son rôle de régulateur vis-à-vis des activités du port.
Je me réfère principalement à un projet commercial que l'on vient d'approuver concernant les bateaux de plaisance et de croisière, dont l'activité se tiendra juste en face de ce bâtiment. Une entreprise privée sera responsable de la construction et de la gestion d'un terminal de croisières et de passagers également. Encore une fois, la fonction de l'autorité est de s'assurer les meilleurs niveaux et de vérifier que les consommateurs reçoivent la meilleure prestation au meilleur prix, naturellement dans un esprit de libre concurrence.
Quant aux autres fonctions de la direction des ports, l'autorité vient de commander un rapport afin d'établir des objectifs à long terme. Il ressort très clairement de ce rapport que l'autorité maritime devrait autant que possible garder autant d'espaces de quai disponibles afin que les fonctions de l'autorité ne soient pas compromises à l'avenir. Cela ne signifie pas que l'autorité ne demandera pas au secteur privé d'exploiter ces terrains, mais il est important qu'elle conserve la propriété des quais et des embarcadères pour que nos objectifs à long terme ne soient jamais compromis. Le directeur de l'autorité des ports pourra vous expliquer cela plus en détails si vous le souhaitez.
Une autre conclusion importante de ce rapport est que l'autorité maritime devrait aussi vite que possible réformer et mettre à jour ses habitudes de travail au sein des ports. Je pense notamment aux opérations de chargement qui se fondent malheureusement encore sur des pratiques assez anciennes. Cela est certes conforme au développement d'autres ports du bassin méditerranéen, qui ont souffert de désavantages semblables, cependant, si Malte veut aller dans la bonne direction, il est important que non seulement la manière dont opèrent les travailleurs du port soit régulée mais que toute l'organisation des dockers soit mieux adaptée à ces opérations de chargement.
M. le Rapporteur : Vous parlez des opérations de manutention de marchandises ?
M. Marc BONELLO : De l'ensemble des opérations de manutention, de chargement, etc.
M. Charles SCHEMBRI : De ce point de vue, la situation chez nous est similaire à celle qui existait il y a dix ans dans les ports français.
M. Marc BONELLO : La raison en est que quelques-uns des droits des travailleurs de ports sont hérités. Dans un tel système, il est très difficile d'apporter des réformes. Il faut donc faire cela en conformité avec tous les partenaires, en incluant les syndicats.
M. le Rapporteur : J'étais le ministre français qui fut chargé à l'époque de cette réforme.
M. Charles SCHEMBRI : Je pourrais peut-être vous consulter ? (sourires).
M. le Rapporteur : Bien volontiers. Mais c'est une tâche difficile.
M. Marc BONELLO : Nous en sommes conscients. Nous savons que ce ne sera pas une tâche facile, particulièrement avec les syndicats, qui adoptent parfois une attitude très militante.
Passons maintenant à la direction de la marine marchande.
M. Vassallo me corrigera si mon historique n'est pas correct. Le registre maltais de navigation s'est séparé du registre britannique en 1973. Depuis cette époque, notre loi sur la navigation, le Shipping Act, a subi plusieurs réformes, qui ont permis d'attirer plus de tonnage à Malte. Mais, à mon avis, la disposition la plus importante de cette loi fut celle qui donne des garanties substantielles à ceux qui financent le projet, c'est-à-dire aux banques, car la plupart des bateaux sont hypothéqués. En 1988, il y a eu une modification de la loi : les financiers des bateaux marchands, dont les propriétaires étaient étrangers, ont reçu appui et garantie, notamment par le biais de l'hypothèque.
M. le Rapporteur : Je ne vois pas comment cela fonctionne. Etes-vous le seul pays à faire cela ? Comment cela fonctionne-t-il techniquement ?
M. Lino VASSALLO : Avant 1988, nous avions déjà pris des dispositions concernant ces hypothèques des navires.
C'était le système normal que l'on trouve au Royaume-Uni, en France et ailleurs. C'est le même principe que les hypothèques qui régissent la propriété des bâtiments, mais c'est plus important pour les navires puisque ces réglementations sont attachées aux navires où qu'ils aillent. Avant 1988, les banques n'étaient pas particulièrement favorisées par rapport aux hypothèques. Toutefois, en 1988, le rang de priorité des banques a été élevé sur la liste et nous avons introduit certaines mesures, comme celle de ne pas pouvoir sortir une deuxième hypothèque sans l'autorisation de la première. La MMA doit en informer la banque. Bien qu'elle ne puisse nous empêcher d'autoriser cette deuxième hypothèque, elle peut, cependant, prendre les dispositions nécessaires pour défendre ses propres intérêts. Nous avons donc donné aux financiers l'assurance que, lorsqu'ils prêtent de l'argent à un bateau enregistré à Malte, leurs intérêts sont protégés.
M. Didier DESTREMAU : Le succès du pavillon de Malte repose sur ce principe : c'est la banque qui a la première priorité sur le bateau, avant le propriétaire du bateau, avant l'équipage qui n'est pas payé, avant le chargeur/affréteur. En cas de saisie ou de vente du bateau, c'est la banque qui, la première, reçoit le premier versement.
M. Lino VASSALLO : Elle n'est pas la première. Lorsqu'il y a des réparations, c'est celui qui a effectué la réparation qui est payé en premier, avant la banque. De même, l'équipage du dernier voyage est prioritaire, ainsi que les sociétés de remorquage et ceux qui portent assistance lors du sauvetage du navire.
M. Didier DESTREMAU : Mais, en définitive, les banques sont très haut placées pour récupérer une bonne partie de l'argent que les assurances versent en cas de bateaux endommagés ou naufragés.
M. le Rapporteur : En cas de naufrage ?
M. Didier DESTREMAU : En cas de naufrage, de vente et autre, les banques sont prioritaires, presque avant tous les autres.
M. le Rapporteur : C'est l'Etat maltais qui garantit cela ?
M. Lino VASSALLO : Je comprends votre préoccupation. La juridiction appliquée à un bateau est celle de l'Etat où se trouve le bateau. Donc si une vente est faite en France, normalement, la juridiction française a la préséance. On ne peut donc pas tout à fait dire que la loi maltaise a la priorité, puisque cela dépend du lieu où se trouve le bateau.
Mais, bien entendu, il existe des intérêts divers. C'est un sujet un peu compliqué qui demanderait qu'une discussion lui soit entièrement dédiée, mais ce que le président voulait vous faire bien comprendre, c'est que les amendements qui ont été apportés à notre loi en 1988 ont donné confiance aux banques dans le système maltais.
M. Marc BONELLO : Je voulais également vous signaler que très prochainement, notre Parlement examinera des amendements à la loi, dans le but d'en améliorer les dispositions, en rendant notamment un service plus sûr et plus fiable. Le directeur de la navigation pourra, si vous le souhaitez, revenir sur ce thème par la suite.
Les modifications de la loi sur la marine marchande qui ont eu lieu au cours des dernières années ont été largement responsables de l'explosion en tonnage que nous avons connue. De 1988 à nos jours, nous avons enregistré un accroissement de 2 millions de tonnes par an, atteignant aujourd'hui un total de 26 millions de tonnes. L'autorité maritime a suivi cette croissance puisque d'une petite structure, elle est devenue ce que nous sommes actuellement.
M. le Rapporteur : M. le président, nous serait-il possible d'obtenir la courbe de la progression de l'armement maltais depuis 1988 ?
M. Marc BONELLO : Cela ne présente aucun problème. Le directeur de la navigation vous donnera les chiffres que vous souhaitez.
M. le Rapporteur : Pourrions-nous également disposer d'un résumé de la loi de 1988 ?
M. Marc BONELLO : Certainement. Nous vous communiquerons également une copie des amendements qui sont maintenant proposés au Parlement.
Je tiens à souligner que nous ne sommes jamais satisfaits des ressources que nous avons en main. Nous cherchons toujours à améliorer nos ressources afin d'assurer le meilleur service. La réputation du pavillon maltais nous est très chère. Donc, tout sinistre comme celui de l'Erika, nous amène à prendre les mesures nécessaires pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Grâce à Dieu, la situation de l'Erika ne se produit pas tous les jours.
Lorsqu'un petit pays comme le nôtre, se trouve confronté à un tel désastre, il s'agit pour nous d'étudier de quelle façon nous pouvons faire face à la situation, en tant qu'Etat du pavillon responsable de l'Erika. Nous n'avons jamais éludé nos responsabilités dans cette affaire et je m'engage à tout mettre en _uvre pour analyser ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation, non seulement en raison de ce qui est arrivé à l'Erika mais, plus généralement, parce que des réformes de modernisation sont toujours nécessaires.
Le message que je voudrais faire passer aujourd'hui est que j'assure votre Gouvernement que nous prenons à c_ur cette affaire et que nous espérons que dans les mois à venir, nous pourrons travailler très étroitement avec nos partenaires internationaux, dont vous-mêmes, afin d'atteindre ces objectifs. Si vous l'acceptez, je pense que nous pourrons regarder l'avenir avec optimisme.
Bien sûr, nous ne pouvons pas être très précis aujourd'hui puisque nous avons besoin de lire le rapport français afin de décider des directions à prendre pour l'avenir.
Vous m'avez déjà fait part hier soir de quelques propositions que la France compte faire à l'Union européenne. En tant que pays aspirant à rejoindre cette Union, il est de notre intérêt de nous conformer autant que possible à ces propositions. Nous sommes d'accord sur ce point, c'est l'esprit général qui nous guide. Naturellement, il nous faudra entrer dans le détail.
La dernière direction que je vous présenterai n'est pas tout à fait une direction, mais plutôt un bureau - corporate office - que nous avons mis en place au sein de cette autorité, dont le directeur général est M. Borg. Ce bureau est chargé de la gestion générale et assure la cohésion de toutes les directions. Il remplit également des fonctions telles que l'acquisition, la communication et la publicité, entre autres. Il s'occupe bien sûr des projets financiers. Nous traitons, par exemple, en ce moment un projet assez important dont nous sommes responsables et que nous finançons également. Il s'agit de la construction d'un port tous temps, du moins nous l'espérons, qui sera situé dans le nord de Malte, à Cirkewa.
M. le Rapporteur : Vous comptez faire de ce port, un port qui fonctionnera par tous les temps ?
M. Marc BONELLO : De façon générale, le port de Gozo est assez bien protégé. Du côté maltais, à Cirkewa, ce n'est pas si bien protégé.
M. le Rapporteur : C'est un projet interne, qui ne concerne que Malte ?
M. Marc BONELLO : Oui, c'est cela. Il s'agit de prolonger la jetée existante, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'amarrage et une augmentation de la protection. C'est ce bureau, le corporate office, qui est en charge de ce projet. Les travaux commenceront cet été et nous espérons qu'ils seront achevés d'ici trois ans.
Après cet aperçu général des fonctions de l'autorité, j'aimerais souligner également que le Gouvernement a déjà entrepris depuis quelque temps des réformes dans le domaine de la régulation. Cela n'est pas forcément lié au sinistre de l'Erika.
Il est donc possible que la MMA participe de ce processus de réforme, qui pourrait également inclure une régulation des services de l'aviation. L'idée du transport, maritime et aérien, placé sous un corps régulateur semble être l'option préférée par le Gouvernement. Rien n'est encore fermement décidé et, bien entendu, le Gouvernement étudie à l'heure actuelle toutes les options. C'est certainement intéressant que vous sachiez cela puisque ces réformes devraient avoir lieu dans les six à huit mois. C'est du moins l'intention du Gouvernement.
M. le Rapporteur : Voulez-vous dire englober l'autorité maritime au sein d'une autorité plus large ?
M. Marc BONELLO : Oui, c'est cela. La fonction régulatrice de la MMA et ce qui relève aujourd'hui du département de l'aviation civile, pourraient être « chapeautés » par un corps régulateur commun.
Le service public des transports terrestres - autobus, cars, etc. - est déjà une autorité séparée, l'autorité des transports, qui est chargée de la gestion du système de transport public et de tous les véhicules en ce qui concerne la circulation routière.
M. Didier DESTREMAU : Cette démarche s'inscrit dans un cadre plus global visant à séparer juge et parties. C'est déjà vrai pour tout ce qui est radio et télévision et pour le transport terrestre. Cela devrait l'être bientôt pour les télécommunications. Ce n'est pas encore le cas du transport aérien et maritime.
Dans le grand cadre de la libéralisation, le Gouvernement ne veut plus avoir une fonction d'opérateur, mais cherche à adopter une position de régulateur.
M. Marc BONELLO : L'idée principale est que le transport international, maritime et aérien, relève de la seule responsabilité de cette autorité - bien entendu, quant aux fonctions régulatrices - alors que le transport local, c'est-à-dire les véhicules, relèverait de l'autorité des transports.
M. le Rapporteur : Nous vous remercions. Le mieux serait sans doute que M. Vassallo nous expose les initiatives que vous comptez prendre et celles que vous mettez déjà en _uvre.
M. Lino VASSALLO : Si vous le permettez, je reviendrai un peu en arrière.
Tout d'abord, l'administration du pavillon est presque entièrement placée sous la responsabilité de la MMA. Je dis « presque » car un point ne dépend pas de l'autorité maritime, mais reste de la responsabilité de notre ministère : ce sont les permis accordés aux systèmes radio des bateaux. Je parle là des permis qui doivent être délivrés conformément à l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). Délivrer des certificats en conformité avec les normes internationales est de la responsabilité de cette autorité.
L'intention du Gouvernement est que cette partie minime, qui ne relève pas de notre responsabilité, finisse par être aussi gérée par nous afin que la gestion du pavillon de l'Etat maltais, relève d'une autorité unique, afin que les propriétaires n'aient à se reporter qu'à une seule autorité et, qu'au sein du système gouvernemental, il ne subsiste aucun doute sur la question de savoir qui est responsable de quoi.
Ainsi, la ligne de responsabilité sera parfaitement transparente, claire et pourra être déterminée assez facilement. C'est, à mon sens, un aspect très important si nous voulons parvenir à un contrôle encore meilleur de nos bateaux.
Comme M. le président vient de l'expliquer, l'autorité est directement responsable devant le Parlement, et la direction de la marine marchande devant le conseil de l'autorité. Il n'y a plus de doute sur qui est responsable de quoi.
Notre direction est divisée en quatre départements différents. Je vous donnerai un extrait du rapport annuel dans lequel tout cela est bien expliqué.
Le premier, non pas le premier au sens d'un classement, est le département de l'enregistrement des bateaux d'un point de vue juridique. C'est le département qui délivre la certification juridique des bateaux, qui s'occupe de l'enregistrement des hypothèques, du transfert de propriété, etc.
Ensuite, nous avons le département technique. C'est celui qui s'intéresse à la performance technique du bateau. Il autorise les sociétés de classification, et les contrôle. C'est lui qui opère l'inspection de l'Etat du pavillon. Je reviendrai sur ce point par la suite. C'est aussi lui qui opère le contrôle de l'Etat du port. Je crois savoir que la situation est identique en France. L'un de vos collègues me disait hier soir qu'à Malte comme en France et ailleurs, le contrôle de l'Etat du pavillon et celui de l'Etat du port relèvent de la même organisation puisque tous deux doivent faire appliquer les mêmes conventions internationales.
Puis, nous avons le département de la recherche et du développement. Sa fonction principale est de se tenir à jour sur tout ce qui se passe dans l'industrie de la navigation, non seulement du point de vue commercial, mais aussi du point de vue de la réglementation, qu'il s'agisse de celle de l'OMI ou d'autres organisations, et notamment tout particulièrement de celle de l'Union européenne. C'est de son devoir de mener des recherches pour le développement, de recommander les mesures nécessaires afin que nous puissions poursuivre nos développements et continuer à travailler en engageant des actions pour rester à jour et suivre tout ce qui se passe aujourd'hui.
Nous accordons une grande attention aux mots « recherche et développement » car le développement sans la recherche n'est pas possible, mais, inversement, des recherches sans développement ne signifient pas grand-chose.
Un autre département s'occupe des services communs à toutes ces directions. J'en donnerai pour exemple les services fiscaux.
Si vous le permettez, je reviendrai sur le département de l'enregistrement. Pour qu'un navire soit enregistré à Malte - et lorsque je parle de navire, je pense à un navire quel qu'il soit, yacht ou autre - la société propriétaire doit être maltaise. Mais cette compagnie maltaise peut appartenir à des partenaires ou des actionnaires qui ne sont pas maltais.
M. le Rapporteur : Le propriétaire doit être maltais ?
M. Lino VASSALLO : La compagnie propriétaire doit de droit maltais. Les actionnaires de la compagnie peuvent être étrangers.
Par exemple, l'Erika était la propriété d'une compagnie maltaise, Tevere Shipping, mais les actionnaires de Tevere Shipping étaient deux compagnies étrangères du Liberia.
M. le Rapporteur : Quel était le capital de la société Tevere ?
M. Lino VASSALO : Je crois qu'il était de l'ordre de 2 000 dollars, mais la compagnie recevait comme capital le bateau lui-même. Le capital de la compagnie était, en fait, le bateau lui-même.
M. Didier DESTREMAU : La création de sociétés maltaises ne nécessite aucun dépôt, comme chez nous. Le capital, c'est le bateau.
M. le Rapporteur : Cela veut dire que les deux compagnies libériennes, sous le couvert de Tevere, ont acheté le bateau ? C'est Tevere qui a acheté le bateau ?
M. Lino VASSALO : Oui, c'est bien cela. Ce système fonctionne dans de nombreux pays, y compris des pays de l'Union européenne.
M. Didier DESTREMAU : Ce n'est pas Tevere qui a acheté le bateau. C'est Tevere qui l'a reçu en tant qu'unique capital de la société nouvellement créée.
M. le Rapporteur : Je l'ai bien compris, mais je voulais l'entendre.
M. Lino VASSALLO : La compagnie maltaise a acheté ce bateau.
M. le Rapporteur : Virtuellement.
M. Lino VASSALLO : En fait, la Royal Bank of Scotland, les bénéficiaires de l'hypothèque pesant sur le bateau, a donné l'argent à la compagnie maltaise qui a mis en garantie le bateau.
M. le Rapporteur : Je n'avais jamais entendu parler de banque écossaise.
M. Didier DESTREMAU : Les banques écossaises se font une spécialité du financement, de l'achat de bateaux.
M. Lino VASSALLO : La Royal Bank of Scotland avait l'hypothèque sur les quatre bateaux, dont l'Erika, c'est-à-dire les quatre bateaux sistership qui étaient la propriété de la famille Savarese. En fait, une inspection du registre public (public register) démontre clairement le lien existant entre ces quatre bateaux. Un journaliste du Royaume-Uni est venu étudier tous les registres, puisque ce sont des registres publics, et a publié tout cela dans son journal, puisque tout cela était public. Je ne dis pas sistership parce qu'ils sont identiques, mais parce que tous quatre appartenaient au même propriétaire. Ces bateaux ne sont pas identiques, mais tous sont détenus par le même propriétaire. Il y a une hypothèque de 10 millions de dollars sur chacun d'eux. Cela démontre clairement le lien qui existe entre les quatre.
Pour revenir au processus d'enregistrement, le bateau doit donc être propriété d'une compagnie maltaise. Naturellement, une des conditions à l'entrée de Malte dans l'Union européenne est que cet obstacle pour des compagnies qui ne sont pas maltaises soit totalement levé. En conséquence, à l'avenir, il sera possible à une compagnie française ou d'autre nationalité de l'Union européenne d'enregistrer un bateau à Malte, sous pavillon maltais, puisque les compagnies locales et celles de l'Union européenne auront les mêmes droits.
C'est la modification qui nous est demandée d'un point de vue juridique.
D'un point de vue technique maintenant, pour l'enregistrement d'un bateau, nous faisons une différence entre un yacht et un navire. Pour qu'un navire puisse être enregistré à Malte et opérer à partir de Malte, il doit avoir une classification totale délivrée par une des sociétés de classification reconnues.
M. le Rapporteur : Vous parlez de la certification ?
M. Lino VASSALLO : Je parle de la classification. Il est important de distinguer classification et certification.
M. le Rapporteur : Qui fait cette certification ?
M. Lino VASSALLO : La classification est établie par les sociétés de classification, sans aucune intervention de notre part car cela n'a rien à voir avec le pavillon.
La certification, selon les conventions internationales, est également faite par les sociétés de classification mais, dans ce cas, les démarches sont faites au nom de la société maltaise.
Je dois dire aussi qu'au fil du temps, la distinction entre classification et certification devient de moins en moins nette car, avec la convention SOLAS et les nouveaux amendements, la certification de sécurité est très étroitement liée à la classification du bateau. Selon cette convention, un navire sans classification ne peut plus être certifié. C'était possible avant, ça ne l'est plus maintenant.
Il faut donc tout d'abord classer le bateau qui doit être enregistré. Puis, pour sa mise en _uvre, le bateau doit être certifié selon les normes des diverses conventions. Bien entendu, les conventions importantes sont SOLAS, MARPOL, la convention sur les lignes de charge et, dans le cas des pétroliers, les conventions CLC et FIPOL. Le navire doit avoir les assurances nécessaires ainsi qu'une certification de l'équipage conforme à la convention.
M. le Rapporteur : Quelle convention s'agissant de ce dernier point ?
M. Lino VASSALLO : La convention STCW 95. Voilà pour les conventions importantes qui gouvernent le fonctionnement d'un navire.
M. le Rapporteur : Lorsque quelqu'un veut s'inscrire sous le registre de Malte, son bateau doit avoir la classification. Celle-ci doit être faite par une société de classification, une des sociétés de l'IACS ?
M. Lino VASSALLO : Il y a, bien sûr, quelques exceptions assez spécifiques. Par exemple, un bateau en construction n'est pas encore classé. Mais il faut que nous sachions que la construction est supervisée par une société de classification.
M. le Rapporteur : Et la certification ? Je suis propriétaire d'un bateau. Je viens avec mes papiers. J'ai la classification par le Bureau Veritas. Ensuite, vous, Etat maltais, allez vérifier et me donner la certification ?
M. Lino VASSALLO : Lorsque vous venez chez nous, nous devons avoir directement la confirmation de la société de classification, qui nous confirme que le navire est classé, et nous devons obtenir une liste des recommandations. Si certaines recommandations sont sérieuses, nous n'accepterons pas le bateau. Il peut parfois s'agir de petites recommandations, comme ajuster une lumière, par exemple.
A ce stade, nous avons enregistré le bateau, mais nous ne lui avons pas encore donné l'autorisation d'opérer. Nous avons un système - et je crois que nous sommes peu à être dans ce cas - qui nous permet de donner un certificat non opérationnel, c'est-à-dire que le navire est enregistré mais n'a pas le droit d'exercer. Il se peut, par exemple, qu'un bateau soit en cale sèche pour des réparations : dans ce cas, il aurait l'autorisation d'enregistrement mais pas celle de fonctionnement. Afin de pouvoir fonctionner, ce bateau doit disposer de tous les certificats conventionnels.
Le certificat d'enregistrement doit être renouvelé chaque année.
M. le Rapporteur : Chaque année, après visite annuelle ?
M. Lino VASSALLO : Oui, on pourrait dire cela. Cela dit, les deux ne sont pas forcément simultanés. Par exemple, vous pouvez subir la visite annuelle de contrôle en juillet alors que le certificat d'enregistrement est valable jusqu'en septembre. Mais, en septembre, lorsqu'on renouvelle le certificat d'enregistrement, il faut que tous les certificats soient en ordre. Il est très rare d'avoir le renouvellement et l'inspection au même moment car l'inspection annuelle est toujours liée à la date de construction du bateau...
M. le Rapporteur : Inspection faite par la société de classification ?
M. Lino VASSALLO : ...tandis que le certificat d'enregistrement peut être fait deux ou trois mois après. Mais au moment du renouvellement, le bateau doit avoir tous ses certificats à jour, sinon, nous donnerons un certificat de non-fonctionnement. Le navire ne pourra pas avoir d'activité commerciale.
Mme Jacqueline LAZARD : Si je comprends bien la situation, le bateau a été reconnu apte par la société de classification, et ce n'est qu'ensuite que l'Etat maltais donne un certificat de fonctionnement ?
M. Lino VASSALLO : C'est bien cela.
Mme Jacqueline LAZARD : En conclusion, les bateaux qui sont sous pavillon maltais sont obligatoirement des bateaux aptes à naviguer, puisqu'il y a deux contrôles ?
M. Lino VASSALLO : Nous reviendrons plus tard sur ces contrôles, nous parlons pour le moment de la certification. Mais une partie du contrôle est que, chaque année, il y a ce renouvellement du certificat d'enregistrement, et ce renouvellement est étroitement lié à la possession par le bateau des divers certificats.
M. Didier DESTREMAU : Ne croyez-vous pas, M. Vassallo, que l'un des problèmes réside dans des différences entre les « sous-sociétés » de classification. Quand je parle de « sous-sociétés », je veux parler de toutes ces officines réparties dans le monde qui agissent au nom de Veritas, de Lloyd's, mais qui sont qualitativement très sensiblement différentes. Vous vous appuyez sur le papier remis par Veritas à Varna en Bulgarie, mais celui-ci est sans aucune mesure avec celui donné par Veritas au Havre ou à Marseille.
M. Lino VASSALLO : C'est un sujet que nous avons abordé plusieurs fois.
M. le Rapporteur : Je voudrais essayer de bien comprendre le dispositif par rapport à celui que nous connaissons en France. En France, nous avons une vérification par l'Etat du pavillon au moment de l'entrée en flotte, au moment de l'enregistrement et annuellement. Ce contrôle est effectué par nos propres autorités maritimes.
M. Didier DESTREMAU : Sans vouloir répondre à la place de M. Vassallo, ici l'Etat du pavillon n'a pas les moyens d'effectuer ce contrôle. Il le confie à l'une des huit sociétés qui ont elles-mêmes une multitude de branches.
M. le Rapporteur : C'est bien la question que je soulève !
M. Didier DESTREMAU : Oui, c'est le sujet, mais l'Etat lui-même ne fait rien parce qu'il n'en a pas les moyens. Il préfère le faire faire par l'une des sociétés internationales.
M. le Rapporteur : Mais à quoi servent les quatre-vingt-dix contrôleurs dont parlait M. Vassallo...
M. Lino VASSALLO : J'y venais.
M. le Rapporteur : Nous vous interrompons trop souvent dans votre exposé. Nous ne parlerons plus.
M. Lino VASSALLO : Oui. Je vais tout expliquer étape par étape car je dois d'abord expliquer la procédure, puis le contrôle de la procédure.
Je voudrais souligner l'importance du renouvellement du certificat d'enregistrement. La durée de vie de ce certificat est d'un an, très précisément. Si vous présentez aujourd'hui, 25 avril, un certificat aux autorités portuaires dont la date limite est le 24 avril, il ne sera plus valable. Cela n'a rien à voir avec les autres certificats que le bateau pourrait posséder. Le renouvellement de ce certificat est très étroitement lié à la certification technique du bateau.
A compter du 1er mars, une deuxième requête a été formulée : nous n'acceptons plus les bateaux dont la date de mise en service dépasse les vingt-cinq ans. Auparavant, c'était trente ans. L'âge vient d'être réduit à vingt-cinq ans.
Je dis cela en termes généraux car des cas particuliers, très spécifiques, peuvent aussi exister. Ainsi, nous avons enregistré sous notre pavillon un bateau de croisière construit dans les années 30, qui est un bateau de très haute qualité. C'est un bateau de croisière de très grand luxe, dont l'équipage est le double du nombre de passagers. Si demain, on nous présente une demande semblable, nous la prendrons en considération. Je ne dis pas qu'elle sera acceptée car elle sera soumise à des procédures rigoureuses.
Mais si l'on nous demandait d'enregistrer un pétrolier ou un porte-conteneurs de vingt-six ou vingt-sept ans, la demande serait refusée. En fait, nous l'avons déjà fait.
Autre obligation : les bateaux âgés de vingt à vingt-quatre ans doivent être inspectés non seulement par la société de classification, mais aussi par nos propres inspecteurs, dans le monde entier. Cette inspection peut être faite aujourd'hui par nos inspecteurs du port de Buenos Aires, demain au Havre, au Japon, etc. Entre quinze et vingt ans, l'inspection doit avoir lieu dans un délai d'un mois après la date d'enregistrement, toujours en sus de la certification par la société de classification. Bien sûr, entre zéro et quinze ans, il est aussi possible de le faire, mais les délais dont je parlais répondent à une norme que nous avons décidé d'appliquer nous-mêmes. Ce sont des mesures internes.
M. le Rapporteur : Depuis mars, des navires ont-ils quitté le pavillon maltais à cause de ces mesures ?
M. Lino VASSALLO : Je ne peux pas répondre exactement sur ce point, mais je suis à peu près sûr que certains ne sont pas venus à cause de cela. Vous ne savez jamais, malheureusement, la raison pour laquelle un bateau ne visite pas votre port. C'est un peu difficile à établir, mais ce système ne repose pas que sur des paroles en l'air. Il a été rendu public par le biais du système qui nous permet de faire parvenir des informations à l'industrie du shipping et de la navigation. Vous verrez également cela dans les formulaires que nous venons de vous remettre.
M. Marc BONELLO : Il semble exister des différences entre les sociétés de classification dans la mesure où certaines seraient plus rigoureuses que d'autres, ces différences ne variant pas seulement d'une société de classification à une autre, mais aussi, pour une même société, du port dans lequel est effectué la classification à un autre.
Cependant, les sociétés de classification sont une nécessité. Sans elles, l'industrie ne peut pas avoir les garanties dont elle a besoin. Une façon de faire face à ce problème serait, me semble-t-il, de tenir une sorte de comptabilité du travail rendu par ces sociétés de classification. Cela pourrait être la prérogative d'une organisation internationale. Cela dit, je ne sais quelle organisation devrait remplir cette fonction. Mais, à mon avis, cela devrait exister.
M. Lino VASSALLO : Voilà donc ce que l'on nous demande pour l'enregistrement de bateaux. Bien entendu, d'autres éléments entrent en ligne de compte : par exemple, un bateau ne peut pas être enregistré sous un autre pavillon et il faut également présenter d'autres documents juridiques, mais je m'en suis tenu aux plus importants : la propriété du bateau et l'annulation de l'enregistrement, du point de vue juridique, et, du point de vue des exigences techniques, la certification et la classification.
Un point très important au sujet de la certification est le nouveau système mis en place par le code ISM qui concerne les pétroliers, les vraquiers et les paquebots. Les bateaux certifiés ISM doivent avoir la garantie qu'il y a un directeur du bateau identifié très clairement, une personne désignée sur laquelle on a toutes les informations nécessaires, dont les coordonnées sont connues. Je ne parle pas des opérations commerciales, mais bien de la gestion technique du bateau, c'est-à-dire de la compagnie responsable de la manutention, de la fonction technique ainsi que de la certification. Il s'agit donc de l'aspect sûreté et environnemental du navire.
Selon cette convention, cette certification doit être, pour la société et pour le bateau, en relation avec la compagnie. Si le propriétaire change, le certificat du bateau doit aussi être modifié. Cela paraît juste puisque la certification du bateau doit être étroitement liée à la certification de la compagnie. Dans deux ans, vous le savez, ce système de gestion de sûreté s'appliquera à tous les bateaux, non seulement pour les trois types de navires que nous avons mentionnés, mais pour tous. C'est l'une des décisions primordiales que nous avons prises sur le plan international.
M. le Rapporteur : L'autorité maritime maltaise cherche-t-elle à savoir pour quelles raisons un bateau change de pavillon, change de société de classification ou, éventuellement, change de propriétaire ? Il y a toujours des raisons à de tels changements.
M. Lino VASSALLO : Non, il faut être très réaliste, nous ne savons pas. Un changement de propriétaire peut, en effet, ne pas être positif, mais neuf fois sur dix, un bateau change de propriétaire tout simplement pour des raisons commerciales. Par exemple, le propriétaire souhaite faire des investissements différents ou acheter un bateau plus grand.
Le changement de société de classification, quant à lui, doit être fait avec notre permission. Je ne l'ai pas dit avant, mais bien que nous autorisions les sociétés de classification en général - l'industrie sait, par exemple, que Malte reconnaît toutes ces compagnies -, lorsqu'un bateau change de pavillon pour obtenir le pavillon maltais, il nous faut toujours demander l'autorisation spécifique de la société de classification. Ainsi une analyse du bateau est faite. Tous les pavillons ne le font pas mais nous nous en tenons toujours à cette règle. Le propriétaire ne peut pas aller au Bureau Veritas ou au Lloyd's demander le pavillon de Malte. Il doit venir ici, où nous lui délivrons des instructions spécifiques afin de pouvoir donner ce permis. Lorsque le propriétaire ou le manager du bateau souhaite une exemption, qui est permise selon la convention, la société de classification n'a pas le droit d'accorder cette exemption sans notre permission, et, si une telle permission est accordée, elle doit s'accompagner de leurs recommandations et des raisons qui les motivent.
En cas de changement de classification, le propriétaire doit demander notre permission. Avant de l'accorder, nous nous assurons toujours que le système existant au sein de l'IACS pour le changement de société de classification soit respecté. Un de ces points est que la nouvelle société de classification doit rester en liaison avec la société antérieure afin de faire appliquer toutes les recommandations que cette dernière avait formulées. Mon sentiment est que ce système doit être internationalement amélioré ; l'Erika l'a très clairement démontré. Nous ne pouvons pas dire que ce système ne fonctionne pas, mais il a besoin d'améliorations.
Il est vrai que, par le passé, des navires changeaient de société de classification pour éviter des contrôles. Cela ne veut pas dire que le système soit mauvais ou bon, mais qu'il peut être amélioré. Il est important que toutes les informations de la société de classification précédente soient transmises à la société de classification suivante.
Un autre point du système que nous pourrions améliorer est que le nouveau propriétaire de bateau doit pouvoir avoir un accès direct et total aux informations. Assurément, dans ce domaine, il est nécessaire d'avoir plus de transparence, mais aussi plus d'échanges d'informations.
Il faut admettre également que le manager, le propriétaire d'un bateau préfère utiliser la société de classification de son propre pays. Les Grecs forment la seule exception à cela. La Grèce ne se sert que très rarement des sociétés de classification grecques, leur préférant des sociétés plus importantes et de nombreux propriétaires italiens apprécient la société de classification RINA. J'ai le sentiment que généralement, les propriétaires français aiment recourir aux services du Bureau Veritas.
C'est bien naturel puisque les bureaux sont installés dans le pays, la communication est plus facile et ils se sentent plus à l'aise pour travailler avec les sociétés de classification implantées dans leur propre pays, même si avec la globalisation de l'industrie, cela se perd.
L'Erika a changé de société de classification au profit du RINA au moment de la première analyse, c'est-à-dire après avoir été repris par les propriétaires italiens. Le bateau ayant été construit au Japon, ses spécifications étaient japonaises, mais les propriétaires ayant changé au cours des années, la société de classification a changé également au fil des propriétaires.
Nous avons parlé de ce qui se passe avant et au cours de l'enregistrement. Maintenant, je répondrai à la question que vous m'avez posée tout à l'heure au ministère concernant notre propre corps d'inspection.
Je souhaiterais éclaircir un point qui n'a pas toujours été très clair dans la presse internationale, même si je sais que tout doit être clair pour vous puisque vous avez été ancien ministre des affaires maritimes. Cependant, je tiens à dire qu'il existe une différence fondamentale entre l'expertise (survey) d'un bateau et l'inspection (inspection) du même bateau.
Les expertises des bateaux se font généralement par le biais de sociétés de classification, à des moments précis, presque toujours en cale sèche et tous les cinq ans. Avec l'introduction par l'IACS du nouveau système, qui s'applique donc globalement, même les expertises intermédiaires, qui doivent être réalisées tous les deux ans et demi, se font maintenant en cale sèche, l'IACS n'acceptant plus les expertises à quai, tous les deux ans et demi. Mais cela a été introduit après l'accident de l'Erika. Ces expertises se font régulièrement au cours de la vie d'un bateau.
M. Louis GUEDON : Cela ne s'est pas fait pour l'Erika.
M. le Rapporteur : Les dispositions dont parle M. Vassallo ont été décidées après le sinistre de l'Erika.
M. Lino VASSALLO : Auparavant, elles se faisaient à quai.
M. le Rapporteur : C'était juste un examen des documents de bord. Tous les cinq ans, il y avait l'expertise en cale sèche. Les autres expertises portaient avant tout sur l'examen des documents de bord.
M. Lino VASSALLO : Les expertises se faisaient lors de l'inspection.
M. le Rapporteur : L'inspection à quai n'est pas uniquement une inspection de papier. Il y avait également une inspection technique. Nous avons accompagné récemment deux inspecteurs de l'Etat du port en France, pour voir comment cela se fait. Il est vrai que la coque est examinée, mais ce n'est pas aussi complet que l'expertise en cale sèche. Il faut bien reconnaître malgré tout qu'une vraie inspection technique ne se fait correctement qu'en cale sèche. Nous sommes descendus dans la double coque d'un pétrolier au Havre.
M. Lino VASSALLO : C'est pour cela que je tiens à faire la distinction entre une expertise et une inspection. Car comme vous le disiez, certaines expertises sont impossibles à réaliser tant que le bateau est dans l'eau.
Mais, en plus de ces examens, durant sa vie, un bateau est inspecté.
M. Louis GUEDON : Selon ces nouvelles dispositions, le navire entrerait en cale sèche tous les combien ?
M. Lino VASSALLO : Tous les deux ans et demi.
Mme Jacqueline LAZARD : C'est une amélioration.
M. Lino VASSALLO : Pour en revenir aux sociétés de classification, tous les cinq ans, il y a le contrôle en cale sèche fait par la société de classification et, tous les deux ans et demi, il y a les études intermédiaires qui se font également en cale sèche. Mais, chaque année, il y a également des contrôles supplémentaires qui ne se font pas en cale sèche.
Par exemple, l'Erika a subi l'un de ces contrôles annuels au Monténégro en 1998. En 1999, trois mois avant l'accident, des examens annuels ont été réalisés, mais pas en cale sèche. Ceux de 1998 avaient été faits en cale sèche lors de la réparation du bateau.
Les pétroliers sont également soumis à ces contrôles. Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'ils ont lieu aussi tous les cinq ans.
En plus de tout cela, l'Etat du pavillon, l'Etat du port, l'affréteur, les assurances inspectent le bateau afin de vérifier que celui-ci est toujours conforme aux conditions sous lesquelles il a été enregistré. Il est facile de se perdre dans toutes ces inspections, cela m'arrive, même à moi.
Ces inspections se font de façon inopinée, sans prévenir, par l'Etat du port dès lors que le bateau entre dans un de ses ports, ou par celui du pavillon, par l'affréteur dès qu'il utilise le bateau, ou par les gens des assurances. Mais ces contrôles ne sont jamais aussi exhaustifs que les contrôles obligatoires. C'est pour cela que si l'Erika avait été inspecté à Dunkerque, comme vous le disiez hier soir, Dunkerque ne pouvait pas être tenu pour responsable de tout ce qui s'est passé. L'Etat du port ne peut pas être tenu pour responsable.
M. le Rapporteur : La dernière inspection de l'Erika a eu lieu en Russie, je crois. Ce que je voulais dire hier soir, c'est que si l'Erika n'avait pas subi une inspection en Russie...
M. Lino VASSALLO : L'inspection réalisée par la Russie était une inspection de l'Etat du port ?
M. le Rapporteur : Oui. Je parle de la même chose. C'était une inspection faite au titre du Mémorandum de Paris. C'est la raison pour laquelle Dunkerque n'a pas effectué un nouveau contrôle.
Si Dunkerque l'avait fait, il ne se serait rien passé de différent.
M. Lino VASSALLO : Sans doute n'auraient-ils rien découvert.
M. le Rapporteur : Les inspecteurs au Havre nous ont dit qu'ils n'auraient peut-être rien décelé. Cependant, ils disaient qu'ils auraient peut-être porté une responsabilité.
M. Lino VASSALLO : Je vais parler maintenant des inspections réalisées par l'Etat du pavillon.
Ces inspections ont lieu afin de vérifier l'état et le fonctionnement du bateau. Prenons un exemple : supposons qu'en janvier, nous ayons certifié que tel bateau possède quatre embarcations de sauvetage. En raison des intempéries de ces derniers temps, un accident se produit et il s'avère que l'un des canots de sauvetage est déficient. L'inspection de l'Etat du pavillon relèverait ce manque de conformité avec le règlement. C'est un exemple très simple, mais cela peut être beaucoup plus compliqué parfois.
Ces inspections s'adressent aux propriétaires et à l'équipage, elles veillent à ce que tous accomplissent leur tâche correctement. J'aime à faire le parallèle avec l'exemple de la voiture. Celle-ci peut avoir passé correctement le contrôle technique, mais parfois, la police vous arrête pour vérifier le bon fonctionnement des feux ou des freins. Ces contrôles, faits au hasard, sont l'équivalent des contrôles de l'Etat du pavillon.
M. le Rapporteur : Si je puis me permettre de vous interrompre, en tant qu'Etat du pavillon, vous vérifiez également à chaque enregistrement, que les inspections des sociétés de classification ont bien été effectuées ?
M. Lino VASSALLO : Oui, puisque certaines de ces inspections nous montrent certains manquements, mettent en évidence des points de défaillance qui ne devraient pas exister. Il est vrai qu'un canot de sauvetage peut s'endommager assez facilement, mais parfois les inspections révèlent des points de défaillance qui pourraient provoquer des accidents à court terme. Cela signifie que quelqu'un n'a pas bien fait son travail pour la société de classification. Dans ce cas, les mesures nécessaires sont immédiatement prises vis-à-vis de la société de classification.
Chaque fois qu'il y a une détention de l'Etat du port ou de l'Etat du pavillon, nous demandons toujours à la société de classification d'intervenir. C'est une des façons de contrôler la classification des bateaux.
M. le Rapporteur : Reste une question délicate : avec ou malgré ce système, votre flotte est l'une des plus pénalisées après les contrôles des Etats du port. Vous avez beaucoup de bateaux bloqués, et souvent. Quelle en est la raison ?
M. Lino VASSALLO : Si vous le permettez, je termine sur l'inspection.
Nous avons un nombre important de contrôleurs dans le monde entier. Ils ne sont pas directement employés par nous. Ce ne sont pas des inspecteurs qui dépendent totalement de nous, employés à plein temps, appartenant à mon bureau. Ce sont néanmoins des inspecteurs. Par exemple, l'une des organisations avec laquelle nous collaborons est la compagnie SGS, compagnie d'inspection bien connue. Les membres de cette compagnie nous informent des pavillons maltais qu'ils accueillent dans leur port. Nous savons naturellement où se trouvent nos propres bateaux. Lorsque toutes ces informations sont réunies, notre système cible leur délivre l'autorisation d'inspecter tel bateau.
Nous avons un formulaire très détaillé, identique à celui utilisé par tous les inspecteurs du Memorandum of understanding de Paris. Ils réalisent l'inspection et se mettent immédiatement en contact avec nous pour discuter des résultats de leurs investigations. Cependant, nous sommes seuls à décider si un bateau doit rester ou pas à quai. L'inspecteur n'a pas la prérogative de le faire mais, en cas de problème, il se met immédiatement en contact avec nous, quels que soient le jour et l'heure - cela peut être de nuit. C'est pour cela que nous avons toujours sur nous un portable pour pouvoir être joints immédiatement. Si le bateau doit rester au port, nous donnons l'autorisation de le maintenir.
Ces inspecteurs sont désignés par nous. Nos critères de choix de ces inspecteurs sont variés. Nous recevons des informations concernant les coordonnées et les compétences de chacun d'entre eux. Ils doivent être ingénieurs en chef ou déjà employés par l'organisation. Nous nous assurons qu'ils n'ont rien à voir avec l'enregistrement de bateaux sous un autre pavillon. Cependant, ils peuvent être amenés à faire des inspections pour d'autres pavillons.
M. le Rapporteur : Mais ils sont payés par vous ?
M. Lino VASSALLO : Oui, ils sont payés par nous, jamais par le propriétaire. Ils ne doivent pas être non plus employés par les sociétés de classification. Ils doivent être totalement indépendants de ces sociétés. C'est essentiel.
Lorsqu'un bateau doit être inspecté à nouveau, nous demandons au propriétaire de les payer. Mais ce n'est que pour la seconde inspection, jamais pour la première.
M. le Rapporteur : Pour la seconde inspection qui est effectuée à la suite d'une défaillance constatée lors de la première ?
M. Lino VASSALLO : Si la première inspection fait ressortir la nécessité de réparations, dans ce port ou dans un autre, le propriétaire devra payer les frais de la seconde inspection de vérification. Ce n'est jamais le cas pour la première, même si nous avons trouvé des points de défaillance car nous ne voulons pas que les propriétaires pensent que nous trouvons des défaillances pour leur faire payer les frais de la première inspection.
Parfois, il nous arrive aussi de procéder à une seconde inspection d'un bateau non parce qu'il a eu un problème, mais pour vérifier le travail accompli par le premier inspecteur. Si le premier inspecteur déclare que tout va bien et que deux ou trois semaines après, un autre inspecteur, dans un autre port, trouve des problèmes, nous en concluons que le premier inspecteur n'a pas fait son travail correctement. Il nous est parfois arrivé de terminer le travail à la place de certains inspecteurs, en envoyant les nôtres, parce que nous n'étions pas satisfaits de leurs performances. Il nous arrive d'envoyer nos propres inspecteurs pour tirer nos propres conclusions. C'est un processus continu.
M. le Rapporteur : Il nous reste peu de temps pour vous poser des questions.
M. Lino VASSALLO : Si vous le souhaitez, nous pouvons prolonger cet entretien. Cela dépend de votre programme.
M. le Rapporteur : Eventuellement.
Mme Jacqueline LAZARD : Il a beaucoup été question d'éléments concernant les structures des navires, leur motorisation, leurs instruments de navigation. Ils sont contrôlés. Mais quelle est votre position vis-à-vis des équipages quant à leurs certifications, rémunérations et conditions de travail et de vie à bord ?
M. Lino VASSALLO : Je l'ai déjà dit ce matin, la certification de l'équipage est contrôlée conformément à la convention STCW 1995.
Dans un proche avenir, lorsque les nouveaux amendements de la convention entreront en vigueur - en 2002 - tous les membres de l'équipage devront avoir un certificat renouvelé par les autorités du pavillon.
A cet égard, nous avons déjà remis un rapport sur la façon dont nous mettons en _uvre les conventions de l'OIT. Nous sommes satisfaits que ce rapport n'ait fait l'objet que d'une petite remarque de la part de l'équipe qui l'analysait. Nous veillons à ce que ses dispositions soit mises en _uvre et nous serons définitivement fixés par la publication de la liste blanche de l'OMI.
Nous avons même entrepris la vérification de certaines écoles. La semaine prochaine, deux membres de notre personnel se rendent en Grèce et, bien que nous n'ayons aucune restriction concernant la nationalité de l'équipage, la certification doit se faire en conformité avec les règles de la convention. Nous sommes très heureux de constater que les équipages, pas seulement ceux de nos bateaux, mais au plan international, sont assez homogènes. Pour reprendre l'exemple de l'Erika, tout l'équipage était de la même nationalité. Ils avaient une formation particulière au pétrolier et une certification. C'est, à mon avis, très important.
M. le Rapporteur : Pensez-vous que nous puissions nous revoir demain matin ?
M. Marc BONELLO : Malheureusement, je serai pris, mais M. Vassallo pourra certainement.
M. Lino VASSALLO : C'est possible.
M. Marc BONELLO : Puisque ce sera sûrement ma dernière intervention au cours de cette réunion, j'aurais voulu répondre à votre commentaire sur la détention des bateaux battant pavillon maltais.
Il semble qu'il existe une corrélation statistique entre le nombre de détentions et la taille du pavillon. N'ayant pas les statistiques sous la main, je ne puis vous donner de précisions, mais il serait intéressant de regarder si un pavillon plus grand que le nôtre a un nombre de détentions supérieur au nôtre. Mais il est sûr que, quel que soit le nombre de détentions que nous ayons pu avoir dans le passé, cela ne va pas nous empêcher de nous attacher à nous donner tous les moyens nécessaires pour faire baisser ce nombre.
M. le Rapporteur : Je ne suis pas tout à fait certain de votre raisonnement. Il est valable vis-à-vis de pavillons comme ceux du Panama ou du Liberia, mais pas vis-à-vis d'un pavillon comme celui du Danemark, par exemple.
M. Marc BONELLO : Lorsque je dis que nous allons nous donner plus de moyens, je parle d'un investissement en moyens humains au sein de notre corps d'inspecteurs, qui est imminent.
M. Lino VASSALLO : Nous pourrons parler de cela en détail demain, si vous le désirez.
M. le Rapporteur : Les chiffres dont je dispose font état de 343 navires détenus dans les ports, soit un sur cinq.
M. Lino VASSALLO : En 1998, 17 %.
Lorsque je dis 17 %, ce sont encore 17 % en trop mais, en 1997, nous étions à 20 % et en 1996, nous étions à 24 %. Naturellement, nous préférerions que ce soit 0 %. Nous avons fait des progrès, mais pas suffisamment. Nous en reparlerons demain.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être validée par les intervenants.
Audition de M. Roberto PATRUNO,
directeur du REMPEC
(Centre régional de réponse d'urgence
pour la pollution marine en mer Méditerranée)
en présence de Son Excellence M. Didier DESTREMAU,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Malte
(extrait du procès-verbal de la séance du 26 avril 2000 à Malte)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur
M. Roberto PATRUNO : Je vous remercie pour votre visite au REMPEC. Le REMPEC est un centre régional créé en 1977 dans le cadre de la Convention de Barcelone. C'est un centre des Nations unies qui travaille en coordination avec l'OMI et l'unité de coordination d'Athènes pour le plan environnemental des Nations unies.
La Convention de Barcelone est la base légale du Plan d'action pour la Méditerranée, établi en même temps que cette convention par les Etats européens et la Commission européenne, cette dernière étant également partie contractante de la Convention. Des protocoles sont attachés à cette Convention de Barcelone. Le deuxième protocole, mieux connu sous le nom de « protocole d'urgence », est relatif aux pollutions accidentelles en Méditerranée.
Le REMPEC a été créé pour aider les Etats à réaliser l'organisation nécessaire pour répondre aux accidents en mer et pour les aider en cas d'accident. Plus récemment, en 1997, les parties contractantes ont décidé que les compétences et les responsabilités du REMPEC seraient élargies au domaine de la prévention des accidents. On est en train de réviser le protocole d'urgence pour intégrer la prévention dans ses objectifs.
M. le Rapporteur : Elle n'y était pas auparavant ?
M. Roberto PATRUNO : Il était auparavant limité à la préparation à la lutte et la lutte, la coopération régionale pour l'échange de moyens, les échanges d'informations, les relations entre Etats en cas d'accidents, les rapports que les capitaines de navires doivent transmettre aux Etats lorsqu'ils ont constaté un accident - pas seulement un accident touchant leur navire.
On a compris que le deuxième protocole n'était pas suffisant pour répondre aux besoins des Etats, si on prend en considération les risques liés au transport maritime, notamment de produits dangereux - hydrocarbures et autres. Le protocole révisé est prêt. On espère que se tiendra fin septembre, peut-être en France, une réunion d'experts des Etats de la Méditerranée. Une conférence plénipotentiaire devrait ensuite se réunir pour l'approbation du protocole et la mise en _uvre de la procédure de ratification.
M. le Rapporteur : Il faut une modification de la Convention de Barcelone ?
M. Roberto PATRUNO : C'est cela, du protocole de cette Convention.
M. le Rapporteur : Quel constat faites-vous sur l'échange de moyens d'intervention en cas de pollution ? Estimez-vous aujourd'hui que, d'une part, les dispositions réglementaires sont suffisantes, dans le cadre du protocole, pour permettre d'échanger les moyens techniques ? D'autre part, ces moyens techniques sont-ils suffisants en cas de crise grave ?
En effet, le résultat de nos principales observations en Méditerranée - nous sommes allés à Marseille et à Toulon - est que, du côté français, on se préoccupe davantage des feux de forêt que d'un risque de pollution méditerranéenne. Il nous apparaît que si une catastrophe du type Erika survenait en Méditerranée, ce serait bien plus grave et que, curieusement, nous sommes moins bien préparés.
Il était donc intéressant de connaître votre analyse de la situation, non seulement vue du côté de la France, mais aussi de l'Italie, de l'Espagne ou autre, en cas de crise majeure.
Les instruments diplomatiques sont-ils suffisants ? Tout d'abord, existent-ils ? Je n'en suis pas sûr. Si oui, quels sont-ils par exemple entre l'Italie, la France et l'Espagne, qui devraient être les pays les plus intervenants, mais aussi au-delà ? Quels sont les moyens mis en commun ? Sont-ils suffisants ?
M. Roberto PATRUNO : Vous avez évoqué un sujet, à mon avis, capital. Nous sommes dans l'après-Erika. Malheureusement, on doit se rendre compte que l'attention des pays, des citoyens, de tous, aux risques liés à la navigation maritime ne surgit qu'après un accident très grave. On voit alors des commissions d'enquête, ce qui est très bien, mais après, on se rendort pour des années. Cela a été le cas pour le Torrey Canyon, pour l'Amoco Cadiz et l'Exxon Valdez. Chaque fois, après l'accident, cela bouge au niveau national dans les pays concernés, et aussi au niveau international. On a des idées, on produit des conventions internationales, et même des lois nationales mais, par la suite, malheureusement, on ne respecte pas les règles qu'on a décidé de mettre en place.
M. le Rapporteur : Nous sommes d'accord.
M. Roberto PATRUNO : Pour en venir à votre question, en Méditerranée, le réseau fonctionne sur le plan diplomatique et il est opérationnel. Les gens se connaissent, les liens existent. En cas d'accident, on peut contacter les pays voisins, ou n'importe quel pays, soit directement, soit par l'intermédiaire du REMPEC.
M. le Rapporteur : Existe-t-il des instruments juridiques à cet effet ou le lien est-il uniquement un lien d'amitié ?
M. Roberto PATRUNO : La base légale, c'est le deuxième protocole de Barcelone pour la Méditerranée.
Au niveau global, depuis 1990, il y a la convention OPRC de l'OMI, Convention pour la coopération et la collaboration internationale en cas d'accident maritime. Pour la première fois, dans une convention OMI, est réglementée la collaboration et la coopération des industries pétrolières, de l'industrie maritime, des centres de recherche, etc. Elle ne concerne pas seulement les organisations publiques ou étatiques, car en sont acteurs tous les organismes touchant au transport maritime, notamment le transport pétrolier. Depuis la fin mars 2000, un protocole à la convention OPRC relatif aux produits dangereux autres que les hydrocarbures a été signé à Londres. Il reste à ratifier ce protocole.
En Méditerranée, nous avons donc deux instruments légaux : le protocole de Barcelone et l'OPRC. Ce système fonctionne.
En décembre 1999, juste avant l'Erika, nous avons organisé un exercice d'alerte. Pour la première fois, nous n'avions prévenu personne. L'exercice a eu lieu un jour ouvré, bien sûr. Quatre-vingt pour cent des personnes des différents pays concernés ont répondu, et elles l'ont fait correctement, dans un délai raisonnable. On peut donc considérer que le réseau de communications et d'échange d'informations, le réseau opérationnel en Méditerranée fonctionne de manière raisonnablement acceptable. Bien sûr, il existe des pays, comme la Libye ou l'Algérie, avec lesquels il est parfois impossible d'entrer en communication.
M. Louis GUEDON : Vous nous avez parlé des réseaux, de la volonté politique, de l'application de la Convention de Barcelone. Notre expérience en tant que personnes touchées par une catastrophe nous montre que ce sont les moyens qui manquent. Entre la volonté politique et la réalité qui vous oblige à réagir après une tempête ou face à une catastrophe, il y a un océan difficile à combler. Or vous avez l'air rassuré quant aux moyens ?
M. Roberto PATRUNO : Non, je n'en suis pas encore arrivé à la question des moyens. Je l'aborderai après avoir évoqué la coordination inter-étatique.
M. le Rapporteur : M. Patruno parlait de la coordination politique, qui n'engage personne, si ce n'est sur le papier.
M. Roberto PATRUNO : Mais qui est très importante car quand on parle de la Méditerranée, on parle de régions différentes. L'accord entre les pays et un réseau qui fonctionne sont donc deux éléments très importants car nous parlons d'une région qui ne réunit pas que la France, l'Italie et l'Espagne.
M. Louis GUEDON : J'avais cru comprendre que vous aviez lancé une opération de façon impromptue un jour ouvrable, qui semblait vous avoir donné satisfaction.
M. Roberto PATRUNO : C'est exact, en ce qui concerne la communication.
M. Louis GUEDON : Tout reste donc à faire.
M. Roberto PATRUNO : Non, c'est important, car il faut déjà que les gens soient là et que ce soit bien ceux qui doivent effectuer le travail.
Pour ce qui est des moyens, quand on parle de pollution accidentelle qui, en principe, est une pollution massive et immédiate, ceux dont on dispose ne sont jamais suffisants. Il faut, bien sûr, avoir des moyens en quantité raisonnable. Il est même peu réaliste d'imaginer qu'un Etat, seul, puisse avoir les moyens nécessaires pour répondre à n'importe quel accident. La coopération internationale existe et l'industrie doit aussi contribuer de manière très importante. Cependant, il faut surtout que le système de réponse et le système de décision soient très rapides. De ce point de vue, la composante politique et la composante opérationnelle, technique, doivent travailler ensemble de manière efficace et rapide. C'est cela le problème capital d'une réponse à un accident polluant majeur.
Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, pour diverses raisons : parfois, la décision n'est pas correcte, parfois, elle n'est pas prise au bon moment ; parfois, des connotations variées et diverses vont retarder l'action. Je pense que ces données sont plus importantes que la quantité de moyens disponibles. En effet, aujourd'hui, on peut arriver en vingt-quatre heures n'importe où. A Southampton, par exemple, qui est un grand centre de sociétés pétrolières - elles sont six, réunies en un consortium - les Britanniques disposent d'une forte capacité de réponse en termes de moyens. Ils peuvent mobiliser en vingt-quatre heures, par avion, les moyens nécessaires pour répondre à des pollutions allant jusqu'à 30 000 tonnes d'hydrocarbure. J'insiste donc : ce n'est pas vraiment une question de moyens, mais de gestion de l'affaire.
M. le Rapporteur : Estimez-vous qu'aujourd'hui vous pouvez mobiliser sur un accident de type Erika en Méditerranée, des moyens suffisants de pompage en mer ? Je dis bien « moyens suffisants de pompage en mer » car la difficulté que nous avons eue avec l'Erika, c'est bien l'insuffisance de moyens de pompage en mer. En France, premièrement, nous n'avons pas les moyens, deuxièmement, nous ne savons pas faire. Si vous nous dites que vous avez les moyens techniques de pomper une pollution au milieu de la Méditerranée dans les eaux internationales, c'est important pour nous.
M. Roberto PATRUNO : Quand vous parlez de « pomper » l'hydrocarbure en mer, vous voulez dire « recueillir » le pétrole en mer ?
M. le Rapporteur : Tout à fait. Existe-t-il une autre solution en Méditerranée, puisque le trafic maritime le plus important passe ici, en ligne ?
M. Roberto PATRUNO : C'est l'axe principal, qui va de Suez à Gibraltar. Dans le cas de l'Erika, on a failli récupérer le pétrole en mer... Je n'étais pas là mais si on lit la presse...
M. le Rapporteur : On n'a pas réussi le pompage en mer.
M. Roberto PATRUNO : On n'a pas réussi en raison des mauvaises conditions météorologiques.
M. le Rapporteur : Pas uniquement. Le matériel n'était pas adapté.
M. Roberto PATRUNO : C'était un pétrole très lourd.
M. le Rapporteur : Malgré le gros temps, des équipages ont procédé à des sauvetages dans des conditions merveilleuses, qui forgent notre admiration, notamment le sauvetage de l'équipage de l'Erika. Des actes humains admirables. Donc, si nous avions eu le matériel, nous aurions eu les hommes de qualité pour faire en sorte que ce matériel soit opérationnel. Mais le matériel n'était pas à la hauteur.
M. Roberto PATRUNO : Le pompage du pétrole en mer est une opération qui est toujours très limitée par les conditions de mer et météorologiques. Même dans des conditions optimales, la technologie des équipements de pompage ne permet pas d'imaginer récupérer plus de 30 % du produit déversé. C'est le maximum que l'on puisse espérer dans des conditions optimales. Ce n'est donc pas cela, la solution du problème.
Dans le cas de l'Erika, je n'étais pas sur place, mais j'ai suivi très attentivement les choses, les circonstances étaient extrêmes : un fuel exceptionnellement lourd, le navire, les éléments. Bref, ce fut un cas extrêmement malheureux.
Si on considère que le pompage en mer est la solution du problème, alors ma réponse sera qu'en Méditerranée, nous n'avons pas les moyens suffisants pour faire le pompage dans un cas extrême.
M. le Rapporteur : Surtout que le désastre maritime peut se produire à l'est ou à l'ouest de la Méditerranée et que cela prend du temps pour que les moyens de l'est ou de l'ouest arrivent à l'opposé.
M. Roberto PATRUNO : Cela dépend. De toute façon, si l'alerte a été envoyée et le matériel demandé immédiatement, on peut imaginer qu'en quarante-huit heures, le matériel est en place.
M. le Rapporteur : Qui dirige l'opération dans ce cas ? Vous ?
M. Roberto PATRUNO : Non, le REMPEC n'est pas un centre opérationnel. Ce sont les Etats qui dirigent.
M. le Rapporteur : Si cela se produit dans les eaux internationales ?
M. Roberto PATRUNO : Même dans ce cas. Le REMPEC peut mobiliser une unité d'assistance, mais seulement d'expertise, si l'Etat concerné en fait la requête.
M. le Rapporteur : Si c'est dans les eaux internationales, comme il n'y a pas de zone économique exclusive de 200 milles, aucun Etat n'est concerné ?
M. Roberto PATRUNO : Il n'y a pas d'Etat directement concerné, mais les Etats peuvent intervenir s'ils pensent que cet accident peut avoir une conséquence pour leurs côtes.
M. le Rapporteur : En cas de litige, qui désigne l'Etat meneur de jeu ?
M. Roberto PATRUNO : En principe, cela doit être l'Etat le plus proche ou celui qui est le plus en danger. Il n'y a pas de règle.
M. le Rapporteur : Quand vous faites des exercices, vous ne les faites pas in vivo ?
M. Roberto PATRUNO : Non.
M. le Rapporteur : Parce que, si vous faites un exercice in vivo, il faut savoir qui commande.
M. Roberto PATRUNO : La responsabilité vis-à-vis d'un accident de ce genre est toujours celle d'un Etat, puisque des intérêts nationaux vont être touchés.
M. le Rapporteur : Nous sommes dans les eaux internationales en Méditerranée, à la différence de la Manche. Cette situation doit-elle perdurer car les raisons qui ont fait que la Convention sur le droit de la mer ne prévoit pas la zone des 200 milles en Méditerranée devraient peut-être être réexaminées aujourd'hui ? Cela pose un réel problème. Si un accident comme celui de l'Erika se produit dans les eaux internationales, qui s'occupera de l'épave ?
M. Roberto PATRUNO : Tout d'abord, rien n'empêche un État d'intervenir.
M. l'Ambassadeur : Ou aucun. Cela peut être un ou plusieurs, mais aussi aucun.
M. Roberto PATRUNO : Aucune règle n'empêche un État de prendre l'initiative d'intervenir.
M. l'Ambassadeur : Ça peut être la pagaille !
Mme Jacqueline LAZARD : Il n'y a pas forcément de coordination.
M. l'Ambassadeur : Quatre Etats peuvent envoyer des moyens et se bagarrer pour leur mise en _uvre. Vous réunissez les moyens, mais vous n'assurez pas la coordination entre eux ?
M. Roberto PATRUNO : La coordination, de plus en plus, est possible grâce aux conventions internationales. Grâce au réseau établi entre les Etats, aujourd'hui, il est toujours possible de se mettre d'accord. Par exemple, il existe un accord entre l'Italie, la France et Monaco, dans lequel tout est déjà étudié. La stratégie est d'arriver à avoir en Méditerranée des accords subrégionaux.
M. le Rapporteur : Mais ce n'est pas encore fait.
M. Roberto PATRUNO : Très récemment, nous avons établi un accord subrégional entre l'Égypte, Israël et Chypre qui fonctionne très bien. Nous allons maintenant essayer d'en instaurer un entre la Tunisie, l'Italie et Malte. C'est ça la solution.
M. le Rapporteur : Pour une catastrophe arrivant dans les eaux internationales proches de ces pays.
M. Roberto PATRUNO : Oui.
M. Louis GUEDON : Vous avez montré la difficulté de trouver des moyens à partir des pays méditerranéens. Or, trois des cinq premières flottes mondiales sont méditerranéennes : Malte, la Grèce et Chypre. Cela signifie que les flottes méditerranéennes sont, en raison même de leur importance, des dangers potentiels très grands puisque ces Etats posent les difficultés que l'on connaît. Peut-être y a-t-il une piste à suivre, qui peut être bonne ou mauvaise, en demandant que ces flottes viennent participer financièrement à la mise en place de moyens, compte tenu des profits qu'elles tirent du trafic maritime ?
Si l'on prend l'exemple de Malte, pays merveilleux mais dont les budgets sont limités, peut-on demander à l'Etat maltais de mettre en place des moyens opérationnels pour pouvoir résoudre ce type de problème ? La Libye, l'Algérie sont-elles en état de mettre en place ces moyens ? Par contre, ne serait-il pas normal de demander à ceux qui tirent des profits importants du trafic maritime de contribuer à la mise en place de moyens destinés à parer les risques qu'eux-mêmes provoquent ? Car ce ne sont pas l'Etat maltais, l'Etat chypriote, l'Etat grec, l'Etat libyen ou l'Etat tunisien qui provoquent des risques, mais ce sont les compagnies de navigation, qui sont les premières du monde.
M. Roberto PATRUNO : Vous abordez un sujet très important et très délicat.
Nous parlons de moyens de réponse à la pollution accidentelle, je souhaite souligner l'importance de travailler sur le plan de la prévention. En travaillant dans le domaine de la prévention, on peut imaginer d'engager une action, en plus, vis-à-vis des Etats du pavillon car, dans ce cas, on peut exercer une pression majeure. On peut aussi mieux utiliser le pouvoir de l'Etat du port, par exemple. C'est là encore un espace très important sur lequel il nous faut travailler pour diminuer le risque de pollution.
Pour en revenir aux moyens de lutte, je suis bien d'accord pour dire qu'il faut que les Etats soient raisonnablement équipés, mais si je devais vraiment choisir où mener la lutte, la vraie lutte, je ferais porter mes efforts sur le domaine de la prévention. Il reste énormément à faire en la matière alors que, pour la préparation de la lutte et la lutte elle-même, on peut certes mieux s'organiser, mieux s'équiper, mais de toute façon, il y a des limites.
M. le Rapporteur : Pensez-vous qu'il faille réexaminer la Convention du droit de la mer pour la Méditerranée ? Serait-il souhaitable que les zones économiques exclusives y soient établies ? C'est très compliqué, mais est-ce un objectif que l'on peut se fixer ?
M. Roberto PATRUNO : C'est très compliqué car les zones économiques exclusives en Méditerranée recouvrent des situations très différentes. Prenez l'Adriatique, le couloir de la Sicile, même dans la Méditerranée, il y a des bassins particuliers. Je pense qu'il faut encore travailler dans le domaine de la collaboration inter-étatique, notamment à la mise en place d'accords subrégionaux car il reste, de ce point de vue, des possibilités très importantes.
En ce qui concerne les équipements, Malte, par exemple, est un pays très bien équipé. Le matériel a été payé par la Commission européenne et l'Italie dans le cadre d'un protocole d'aide financière. Ils ont des bateaux, des moyens, des barrages, des écrémeuses. Pour un pays de 23 kilomètres de long, d'une centaine de kilomètres de périmètre, Malte dispose d'équipements proportionnellement bien plus importants que l'Italie.
Par ailleurs, certains pays de la Méditerranée n'ont presque rien. Le Liban n'a rien du tout, la Syrie presque rien, la Turquie rien d'exceptionnel, l'Albanie zéro. Bien sûr, dans ces pays, il faut des équipements.
M. le Rapporteur : Hypothèse : un accident se produit dans les eaux territoriales albanaises. Vous appellent-ils ?
M. Roberto PATRUNO : Oui, bien sûr. Je le pense. De toute façon, ils appellent l'Italie.
M. le Rapporteur : Pour demander comment faire ?
M. Roberto PATRUNO : Oui.
M. le Rapporteur : Et c'est vous qui coordonnez, qui faites venir les moyens de partout ?
M. Roberto PATRUNO : Nous pouvons le faire si l'Etat nous en donne mandat, cependant la décision opérationnelle reste toujours de la responsabilité de l'Etat. Nous sommes là pour les aider, les conseiller.
M. Louis GUEDON : Quelle responsabilité opérationnelle peut avoir un pays qui n'a aucun moyen ?
M. Roberto PATRUNO : C'est là qu'entre en jeu la collaboration. On intervient avec les moyens des autres Etats, mais c'est l'Albanie qui décide.
Mme Jacqueline LAZARD : Qui donne les ordres, en fait ?
M. le Rapporteur : Et si c'est dans les eaux internationales ?
M. Roberto PATRUNO : Dans les eaux internationales, ce serait l'Italie qui piloterait l'intervention. Mais dans les eaux territoriales, ce serait l'Albanie. Dans ce cas, il faudrait un consultant, un conseiller, en espérant que le décideur suive ses conseils.
M. l'Ambassadeur : Pour le REMPEC, qui est l'organisme de formation, de mise en condition et de coordination, cette désignation du coordinateur n'est-elle pas un problème ? Je suis militaire à l'origine et j'ai toujours entendu dire « une mission, un chef, des moyens ». S'il y a dix chefs, c'est la pagaille ! D'autant qu'avec des pays comme la Syrie, Israël, le Liban, il peut y avoir des problèmes considérables. La Turquie et la Grèce, ou que sais-je ? Ce n'est pas un problème pour vous ?
M. Roberto PATRUNO : Si l'on reste au niveau national, c'est le pays responsable qui choisit le coordinateur et il n'y a pas de problème. Dans le cadre d'un accord subrégional, comme celui liant Chypre, l'Égypte et Israël, les choses sont déjà organisées et l'on sait qui va coordonner dans les eaux territoriales.
M. le Rapporteur : C'est petit, les eaux territoriales.
M. Roberto PATRUNO : Oui, mais dans ce cas précis, nous avons le droit de la mer et les relations entre les Etats. Si les relations sont bonnes et qu'un accord spécifique a déjà été établi, cela ne devrait pas poser problème. On devrait même pouvoir envisager le cas d'un accident dans les eaux internationales proches.
Si les relations entre les Etats ne sont pas très bonnes comme, par exemple, entre le Liban et Israël ou le Maroc et l'Algérie, ce n'est pas évident. Bien sûr, nous interviendrons et nous donnerons nos conseils et nos avis, mais nous n'avons aucun pouvoir.
M. le Rapporteur : Mais vous les formez tout de même. Combien de personnes êtes-vous ici ?
M. Roberto PATRUNO : Nous sommes trois professionnels, et un quatrième, M. Alex Nicolau, grâce à la France car, depuis quinze ans, nous avons au REMPEC, un junior engineer, qui était auparavant payé par votre Gouvernement dans le cadre du service militaire. Aujourd'hui, le service militaire n'étant plus obligatoire en France, il est rémunéré par l'industrie pétrolière française.
M. le Rapporteur : Ce sont des effectifs très faibles.
M. Roberto PATRUNO : Oui, nous sommes surchargés de travail.
En ce qui concerne les cours de formation, aujourd'hui, par exemple, mes deux collaborateurs assurent un cours au Maroc. En juin, nous serons en Algérie, et ainsi de suite. La formation est un domaine dans lequel nous travaillons beaucoup. Nous pourrions même en faire encore plus.
M. le Rapporteur : Quand vous formez, vous formez les pompiers ?
M. Roberto PATRUNO : Nous avons trois niveaux de formation : les cadres administratifs-décideurs au niveau des Etats ; les personnels opérationnels ; les opérateurs directs qui, par exemple, peuvent être les sapeurs-pompiers.
M. le Rapporteur : Vous correspondez au CEDRE, en Méditerranée ?
M. Roberto PATRUNO : Nous travaillons beaucoup avec le CEDRE. Nous avons organisé les dernières assises régionales méditerranéennes en mars à Brest avec le CEDRE car nous ne pouvions pas les organiser ici.
M. le Rapporteur : Toutes proportions gardées, vous êtes comme le CEDRE ?
M. Roberto PATRUNO : Non, pas vraiment. Le CEDRE mène des actions de recherche, nous ne le pouvons pas.
M. le Rapporteur : Le CEDRE a une vocation nationale, la vôtre est internationale.
M. Roberto PATRUNO : Le CEDRE est à vocation nationale, il a beaucoup plus de personnel, il est mieux organisé. Nous sommes un très petit centre, même nos moyens budgétaires sont peu importants.
M. le Rapporteur : Ce sont les moyens budgétaires de l'ONU ?
M. Roberto PATRUNO : Oui. Ce sont les moyens budgétaires du Fonds d'Intervention pour la Méditerranée, qui est financé par les pays riverains. La France et la Commission européenne sont les contributeurs majeurs, ensuite il y a l'Italie, l'Espagne, la Grèce et on peut s'arrêter là parce que l'apport des autres est très minime. Ces contributions sont destinées au Plan d'Action pour la Méditerranée, dont le REMPEC est un petit élément. Ce plan couvre toute la Convention de Barcelone. Il y a d'autres centres. Une partie très importante du budget est utilisée par le Centre de coordination d'Athènes qui est très grand et très coûteux.
Mme Jacqueline LAZARD : Vous avez dit tout à l'heure que vous souhaiteriez mettre l'accent sur la prévention. Comment envisagez-vous de travailler en matière de prévention ?
M. Roberto PATRUNO : La Commission européenne a prévu des actions pour améliorer le contrôle par les Etats du port. On parle de s'aligner sur le règlement de l'Oil Pollution Act dans le but d'éliminer les pétroliers monocoques de la Méditerranée, en plusieurs phases - 2005, 2010 et 2015 - et d'assurer une meilleure collaboration entre les organisations publiques et les armateurs pour éviter les bateaux de plus de quinze ans d'âge pour le transport des matières dangereuses.
Ce sont déjà des actions intéressantes. Je pense, pour ma part, qu'il y a un potentiel très important dans le pouvoir de l'Etat du port. En effet, on a là la possibilité d'arrêter un navire s'il ne répond pas aux règles. On parle des bateaux sous pavillon de complaisance. Ces bateaux arrivent dans nos ports, il faut les inspecter sérieusement, les arrêter le cas échéant. On a un moyen très important.
M. Jean-Michel MARCHAND : Le premier moyen ne serait-il pas l'Etat du pavillon puisque nous avons en Méditerranée trois des principaux pavillons ? Et je n'ai pas dit de complaisance. Ce n'est pas bateau par bateau qu'il faudrait vérifier, mais ce sont les 1500 bateaux maltais qui pourraient être vérifiés.
M. Roberto PATRUNO : Je pense que l'Union européenne pourrait faire beaucoup vis-à-vis d'Etats faisant partie de l'Union, comme la Grèce, et vis-à-vis également des candidats à l'adhésion, mais il faut déjà travailler avec les pavillons qui appartiennent à l'Union, comme la Grèce et les Kerguelen car on peut difficilement faire la leçon aux autres quand on ne respecte pas les règles soi-même.
M. l'Ambassadeur : La délégation tiendra une conférence de presse qui sera, je crois, très importante puisque que tous les Maltais ont les yeux fixés sur cette commission. M. Le Drian avait pensé que peut-être vous pourriez y assister, au cas où seraient évoqués les risques d'accident majeur en Méditerranée et, précisément, autour de Malte, pour sensibiliser les Maltais au fait que ce qu'on laisse faire ailleurs peut aussi se produire chez eux.
M. Roberto PATRUNO : Avec plaisir. C'est très important et je suis très intéressé. Je viendrai.
Nous avons un livre d'or. J'aimerais, messieurs, avoir un mot du rapporteur et la signature de tous. C'est une occasion très importante pour nous.
J'étais à Bruxelles lorsqu'est paru le rapport du Sénat français. J'étais à l'époque expert national détaché.
Je voudrais ajouter un point, M. le rapporteur, si c'est possible. Dans les mesures que vous allez conseiller de prendre à l'avenir, je soulignerai l'importance de se mobiliser en coordination avec les règles et les organismes qui travaillent au niveau international - l'OMI, etc. On commettrait une erreur capitale en prenant seulement une initiative européenne.
M. le Rapporteur : C'est une vraie question car l'OMI fonctionne comme un pétrolier de 500 000 tonnes. Avant de prendre un virage ou de s'arrêter, il faut énormément de temps. Il y a la résistance de certains pays. Si nous n'arrivons pas à faire bouger l'OMI, l'Europe peut faire comme les Etats-Unis et imposer le respect de normes dans le cadre européen. A ce moment-là, si certains bateaux ne peuvent aller ni aux Etats-Unis ni en Europe, cela leur posera des problèmes. Pour l'instant, nous tenons - nous, Français pollués - ce raisonnement, y compris à l'égard de Malte. Nous mettrons les Maltais en garde, attirerons leur attention sur les directives européennes. Si elles s'appliquent, cela signifie que l'année prochaine, les bateaux qui ont été détenus plus de deux fois au cours des deux années précédentes et de plus de quinze ans d'âge seront interdits dans les eaux européennes, dans la zone économique exclusive. Je pense que si j'étais Maltais par exemple, je m'interrogerais. Vous avez raison sur le fond, mais...
M. Roberto PATRUNO : Mais, quand on parle de la Méditerranée, on ne doit pas oublier que, malheureusement, c'est une mer de passage : 70 % du trafic passe par la Méditerranée. C'est un trafic de passage dans les eaux internationales. La Méditerranée, ce n'est pas les Etats-Unis. Pour eux c'est très facile, c'est un pays avec ses eaux, sa zone économique exclusive, ils leur suffit d'interdire.
M. le Rapporteur : C'est vrai, ce raisonnement marche bien pour la Manche et la Mer du Nord parce que ce n'est pas une zone de passage mais une zone d'aboutissement. Si l'on est interdit portuaire aux Etats-Unis et dans cette zone, il vaut mieux faire un autre métier. Cela aura inévitablement des conséquences parce que moins de bateaux à risque circuleront, y compris en Méditerranée. C'est un élément de pression fort. L'idéal serait que des normes soient prises internationalement, évidemment. Mais je reconnais qu'il y a un problème de fond particulier à la Méditerranée.
M. Roberto PATRUNO : Pour les normes OMI, je vois que vous êtes très bien informés, et c'est un plaisir parce que parfois nous rencontrons des personnes qui ne sont absolument pas informées. Il faudrait que les pays européens siégeant à l'OMI parlent d'une seule voix...
M. le Rapporteur : Mais ce sera le cas.
M. Roberto PATRUNO : ... parce que l'on entend parfois des discours fort différents.
M. le Rapporteur : Il y a maintenant une évolution récente qui fait que les Allemands et les Anglais sont sur les mêmes positions que nous sur les risques de pollution. Ils se sont rendu compte que cela peut se produire partout et les Allemands, c'est la grande nouveauté, se sont aperçus que cela peut survenir en Baltique. Cela évolue donc et je pense que l'on devrait aboutir à des options très fortes sous la présidence française.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être validée par les intervenants.
Audition de M. Anton TABONE,
président de la Chambre des représentants maltais,
Mme Rita LAW et MM. Michaël AXIAQ, Carmelo BONNICI et Carmelo ABELA, députés,
en présence de Son Excellence M. Didier DESTREMAU,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Malte
(extrait du procès-verbal de la séance du 26 avril 2000 à Malte)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur
M. Anton TABONE : Je vous souhaite la bienvenue. Je sais que vous êtes à Malte dans le cadre d'une mission et que vous avez demandé à me rencontrer aujourd'hui par l'intermédiaire de votre ambassadeur. Celui-ci nous a fait part de votre souhait et nous voilà, heureux de vous accueillir et qu'il ait été possible de réunir ici des membres du Parlement, parmi lesquels le président du groupe d'amitié Malte-France.
En décembre dernier, j'ai ainsi rencontré Mme Aubert et ce fut l'occasion d'entretenir les relations entre les Parlements français et maltais. Durant sa visite, nous avons reconstitué le groupe d'amitié maltais ; cinq membres du Parlement en font partie, l'un d'eux n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il est en déplacement à l'étranger. Je voudrais vous présenter les membres du Parlement : Mme Rita Law, M. Carmelo Abela, M. Carmelo Mifsud Bonnici et M. Michael Axiaq. Ces deux derniers font partie de la majorité, M. Abela et Mme Law, de l'opposition.
J'ai pensé qu'il était bon que vous les rencontriez lors de cette visite à Malte.
M. le Rapporteur : Je vous remercie, monsieur le Président. L'Assemblée nationale a décidé de constituer une commission d'enquête, dont je suis le Rapporteur. Celle-ci réunit une trentaine de parlementaires de différentes sensibilités politiques. La délégation que vous avez devant vous reflète cela puisque M. Guédon représente le parti gaulliste, M. Marchand, le parti écologiste et Mme Lazard et moi-même, le parti socialiste.
Nous avons six mois pour rendre notre rapport et, pendant ces six mois, nous avons tout pouvoir d'investigation, sur notre territoire national naturellement. Notre souci est de proposer à notre Gouvernement des pistes d'action, des orientations, en particulier au moment où la France va présider l'Union européenne.
Nous avons en fait trois préoccupations. La première concerne l'accident lui-même - aurait-il pu être évité ? Que s'est-il passé exactement ? Qui a fait quoi ? -, sans du tout intervenir sur l'aspect judiciaire. La deuxième concerne la pollution - les autorités françaises ont-elles fait ce qu'il fallait pour remédier à la pollution ? Avions-nous les moyens ? Que faire demain pour que cela soit mieux ? La catastrophe est mal tombée puisque la marée noire s'est produite le soir de Noël. Notre troisième préoccupation, la plus importante, est d'envisager ce qu'il convient de faire pour éviter que de tels désastres ne se reproduisent, tant au niveau des normes de circulation, des normes de l'OMI, que de l'application de ces normes. Ce sont des sujets très vastes.
Il était logique que nous venions à Malte. Nous ne sommes pas venus ici dans un esprit de colère, mais pour saisir la façon dont vous fonctionnez, quelles sont nos différences d'appréciation et la manière dont vous concevez, dans le domaine maritime, votre entrée dans l'Union européenne. Nous avons reçu un accueil très agréable, nous avons pu dire franchement tout ce que nous pensions et nous avons senti de la part de nos interlocuteurs une volonté très nette de tirer les leçons de l'affaire de l'Erika et de faire des propositions de réorganisation en ce sens. Il reste, il ne faut pas se le cacher, des points de désaccord. Heureusement, sinon, nous n'aurions plus à nous revoir.
Je terminerai par deux remarques. Mes collègues pourront le dire aussi bien que moi car nous avons tous été directement touchés par la marée noire, nous avons nous-même ramassé le pétrole, c'est une catastrophe que nous ne voulons plus revoir. Elle s'est étendue sur quatre cents kilomètres de côtes et c'était la septième en vingt ans. S'il devait s'en produire une autre, il est sûr que nous aurions à faire face à une colère, à une révolte générale et je dois dire que si le pompage de l'Erika se passait mal le mois prochain, la situation serait très délicate.
La deuxième observation est que nous pensons aussi que « à quelque chose malheur est bon » et que ce sinistre peut être l'occasion de renforcer les liens entre Malte et la France. Nous nous réjouissons de la mise en _uvre d'un groupe d'amitié et nous transmettrons évidemment à Mme Aubert les conclusions de ce déplacement.
M. Anton TABONE : Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le rapprochement et suis heureux que vous ayez rencontré les autorités compétentes de Malte et pu obtenir les informations que vous recherchiez. Je comprends que vous avez eu de longues discussions avec elles et j'espère que les éléments que vous avez pu recueillir permettront de préparer l'avenir. Je suis sûr que les autorités maltaises disposent des normes nécessaires.
La discussion est toujours fructueuse et j'espère que cette réunion servira aussi au rapprochement entre nos deux Parlements. Malgré le contexte, on peut toujours parfaire les contacts pour parvenir à une relation positive et fructueuse. Il est d'ailleurs bien dans l'idée du groupe d'amitié Malte-France de servir ce rapprochement. Je ne sais si quelqu'un de ce groupe souhaite s'exprimer.
M. Michael AXIAQ : Bien que ce soit aujourd'hui une rencontre plus formelle, nous avons eu hier une longue discussion lors du déjeuner et vous savez déjà ce que nous pensons de l'affaire.
Le plus important, comme l'a dit mon collègue, est de pouvoir prévenir un autre accident. Nous sommes une nation maritime. On peut très bien comprendre votre position car si un accident semblable à celui que vous avez subi se produisait sur nos côtes, il aurait un impact terrible. J'ai le sentiment que la meilleure solution serait multilatérale. Le « coup de grâce » serait de convaincre l'OMI d'être plus stricte s'agissant du respect des normes qu'elle édicte.
Mon collègue et moi-même sommes aussi favorables à prendre les mesures bilatérales nécessaires. J'ai proposé dans les circonstances présentes que non seulement des initiatives soient prises pour agir à travers l'Union européenne - et nous serions heureux de participer aux discussions en tant que candidat à l'adhésion - mais également au sein du Conseil de l'Europe et du processus de Barcelone, ce qui permettrait d'inclure des côtes non-européennes, celles du Sud de la Méditerranée, par exemple. Néanmoins, il y a également d'autres pays au sein de l'Union européenne qui sont intéressés par ce problème, comme la Grèce, Chypre, l'Espagne, etc. Je suis persuadé que ce n'est que le début de discussions qui mèneront à un résultat positif.
Il faut aussi s'efforcer d'amortir les répercussions sur l'économie de l'édiction de nouvelles règles plus strictes, mais il faut également conserver un équilibre écologique de la nature. Je suis tout à fait favorable à ce qu'écrivait l'un de vos meilleurs écrivains, Pierre Teilhard de Chardin, qui accordait une immense valeur à l'écologie, bien plus élevée que la somme arithmétique des dommages constatés.
Mme Jacqueline LAZARD : La catastrophe de l'Erika est pour nous un véritable problème et crée un vrai malaise. Votre pays, comme d'autres -Bahamas, Chypre, etc. - est considéré sur nos côtes comme faisant partie de ceux qui font naviguer des bateaux non conformes. Une photo prise au moment du naufrage, qui a fait le tour du pays, montre écrit au-dessous du nom Erika, le port d'attache : Valletta. C'est la raison pour laquelle en venant ici, nous avions vraiment besoin de connaître le fonctionnement de l'autorité maritime maltaise. Et nous allons partir rassurés sur la volonté de votre pays de mettre en place des mesures pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise et de travailler avec les autres pays pour ce faire.
M. Carmelo ABELA : Je voudrais revenir sur quelques points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes évidemment désolés de l'accident qui vous a frappé, cela va de soi, mais je ne suis pas d'accord avec votre premier point. Comme vous avez eu l'occasion de parler avec l'autorité maritime de Malte, celle-ci a dû vous faire part des normes qui sont appliquées ici : elles sont en conformité avec l'OMI.
Il est évident qu'à Malte, il existe un consensus entre les deux partis politiques pour continuer à enregistrer toujours plus de bateaux, mais il faut, bien sûr, également améliorer le service et rechercher une meilleure qualité. Cette amélioration peut éventuellement passer par la modification de quelques points de la réglementation, mais elle n'a rien à voir avec le fait d'être un futur membre de l'Union européenne, puisque vous savez bien qu'il y a des points de divergence quant à l'adhésion de Malte à l'Europe.
Mais je crois que les autorités maltaises vous l'ont déjà dit, elles peuvent améliorer ce que nous faisons en ce moment. C'est l'aspect positif de ces tristes circonstances. J'espère que cette affaire ne concerne pas uniquement la France et Malte ; elle ne peut être traitée uniquement entre la France et Malte, être le fruit de discussions seulement bilatérales.
Nous savons les difficultés qui existent. Naturellement, je ne parle pas seulement du sinistre de l'Erika ; les risques existent et sans doute continueront-ils à exister, malheureusement. Si quelque chose doit être fait, il faut le faire. J'ai l'impression que nous nous contentons d'une analyse entre la France et Malte. Il faut élargir notre point de vue. Malte a aussi un rôle à jouer dans cette affaire. Parfois, des grands pays considèrent Malte comme un petit Etat qu'on peut gronder. Or, nous sommes la quatrième flotte mondiale. On nous considère de façon inférieure parce que nous offrons quelque chose de différent. Pour nous, c'est une activité qui est source de revenus importants. Il y a un consensus entre les deux partis pour dire que l'on devrait continuer dans ce sens.
En conclusion, les changements qui doivent être apportés doivent l'être sur un plan international. Comme vous l'avez dit, c'est la septième catastrophe. Il est évident que la plus récente est celle qui a le plus d'impact, mais il aurait fallu prendre des dispositions nécessaires bien avant.
M. Louis GUEDON : Je voudrais répondre à mon collègue député qu'il n'est nullement question de vous corriger. La France étant un pays de liberté, nous respectons tous les citoyens, et vous, en particulier. Nous comprenons tout à fait, c'est la richesse du dialogue, que des opinions variées puissent s'exprimer.
Notre Rapporteur, quand il nous a amené à Malte dans la cadre de la Commission d'enquête parlementaire, n'avait nullement l'intention de créer le dialogue malto-français. Nous partageons votre point de vue sur l'intérêt international des problèmes maritimes. C'est la raison pour laquelle la Commission que vous avez l'amabilité de recevoir s'est déjà déplacée à Bruxelles, pour rencontrer la Commission européenne, à Londres, pour rencontrer l'OMI ainsi que le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Elle se rendra également aux Etats-Unis. Mais si elle est venue à Malte, c'est parce que le navire qui a causé cette catastrophe portait le pavillon maltais et que l'on doit avoir, dans la Marine, l'honneur de son pavillon.
Des catastrophes, il y en a eu, nous le savons bien. Mais nous ne pouvons plus admettre que se produisent des naufrages de navires transportant des produits polluants et dangereux. Vous vivez au calme dans la Méditerranée, nous vivons dans l'Europe du nord et l'Atlantique nord est le lieu de tous ces naufrages. Ces navires sont des navires qui polluent et viennent ruiner l'économie de nos régions. Ils viennent, pour la septième fois, ruiner une population qui est dix fois supérieure à celle de Malte. Il y a des erreurs à ne plus commettre ! Il n'est pas normal que des sociétés pétrolières dont les profits sont considérables puissent ainsi, en toute impunité, ruiner des femmes et des hommes libres !
Nous voudrions dire puisque, comme le rappelait M. le Président, nous avons eu l'honneur de rencontrer l'autorité maritime de Malte, qu'un Etat maritime aussi important et respectable que celui de Malte, envers lequel nous avons beaucoup d'amitié, devrait s'interroger quand quatre cents des navires qui portent son pavillon sont interdits de navigation dans les ports européens.
M. Jean-Michel MARCHAND : Je voudrais reprendre deux points qui ont été évoqués par chacun d'entre vous. J'entends ce que vous dites, mais je ne partage pas cette opinion concernant les normes. Les normes actuelles n'ont pas permis d'éviter la catastrophe de l'Erika. Il nous faut donc remettre sur le métier cette réflexion et établir notamment la chaîne des compétences entre les Etats, les sociétés de certification, les armateurs et les affréteurs ; et par conséquent, établir aussi la chaîne des responsabilités.
Nous avons vu, à la suite de ce naufrage, tout le monde se dédouaner de ses responsabilités. Or il y a des responsabilités, au moins morales, vis-à-vis des personnes touchées.
Nous savons qu'il sera possible d'indemniser les travailleurs de la mer et de la côte, mais les indemnisations proposées n'auront aucun rapport avec les pertes occasionnées par le naufrage.
Je voudrais aussi revenir sur ce que j'ai entendu, mes chers collègues, concernant les dommages écologiques. J'entends avec plaisir que c'est une considération que vous partagez. Rien n'est prévu dans ce domaine. Et la jurisprudence passée nous préoccupe, pour ne pas dire qu'elle nous inquiète. Certains dommages seront irréparables. Or, vous le savez, nous sommes très attachés à la protection de la biodiversité ainsi que des écosystèmes. Cependant, dans cette chaîne de responsabilités, personne ne prend en compte ces dommages. Nous devons également porter ces problèmes soit au sein de l'Europe, soit de façon bilatérale, en espérant, bien entendu, que l'OMI les prenne en compte.
Mais nous pouvons vous assurer que nous ne baisserons pas les bras et que nous agirons dès maintenant au niveau de l'Europe pour pouvoir faire avancer les solutions qui sont urgentes à prendre.
M. le Rapporteur : Je dirai deux mots pour conclure.
Nous pensons que l'entrée de Malte dans l'Union européenne peut être une chance pour l'Europe parce qu'aujourd'hui, le trafic maritime de cette dernière est effectué par d'autres. Une puissance qui n'a pas de moyens maritimes est une puissance dépendante. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en désaccord sur la nécessité pour votre pays d'avoir une flotte importante. C'est votre vocation.
Deuxièmement, à notre sens, les normes actuelles suffisent globalement, à quelques modifications près. Le problème, c'est leur application, ici et ailleurs, en Europe et dans le monde. Si nous ne pouvons pas faire bouger l'OMI, nous proposerons que l'Europe agisse seule, comme l'ont fait les Etats-Unis. C'est ce que nous avons expliqué à vos autorités. Nous savons bien où réside la principale divergence entre nous. Il y en a une : celle de la méthode de contrôle.
Le chantier est ouvert. Donc, parlons-en et, alors, le fait que Malte possède une flotte importante peut être une force pour l'Europe.
M. Anton TABONE : Nous vous remercions de la contribution apportée par les membres de votre délégation. Le fait même que nous nous soyons rencontrés ce matin nous donne l'occasion de parler librement et cela illustre la bonne volonté affichée par les deux parties pour parvenir à de bonnes solutions.
Naturellement, nous regrettons énormément le sinistre qui s'est produit. Je suis très heureux de comprendre de ce que vous disiez que la rencontre avec les autorités maltaises vous a donné satisfaction, notamment quant aux informations que l'on a pu vous présenter et également en raison du fait que vous avez pu constater vous-mêmes que Malte a des autorités compétentes que vous pouvez contacter librement et rencontrer à l'occasion d'une mission à Malte.
Je suis d'accord avec tout ce que les différents partis ont exprimé, à savoir que nous devrions travailler à partir de nos expériences et de tout ce qui s'est passé afin de parvenir à des solutions positives.
Mais comme je l'ai dit au début de cet entretien, le fait que des membres du Parlement soient venus pour vous rencontrer ce matin, non seulement sur le plan de relations amicales, mais au niveau parlementaire, montre la bonne volonté qui existe entre les deux groupes et les deux pays, les deux parlements. Bien entendu, ce que nous souhaitons, c'est que la bonne approche et les bonnes solutions soient trouvées toujours et partout.
Je voudrais encore vous remercier d'être venus ici. Merci également aux membres du parlement maltais. Nous souhaitons avoir à nouveau l'occasion de rencontrer d'autres membres de votre Parlement, à La Valette ou à Paris.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être validée par les intervenants.
Audition de M. Lino VASSALO,
directeur exécutif de l'autorité maritime maltaise
(Malta Maritime Authority),
et du capitaine Joseph ZERAFA, directeur technique,
en présence de Son Excellence M. Didier DESTREMAU,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Malte
(extrait du procès-verbal de la séance du 26 avril 2000 à Malte)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur
M. Lino VASSALLO : Après cette visite de nos bureaux, nous pouvons recommencer à répondre à vos questions. Je vous ai préparé une documentation.
M. le Rapporteur : Pour renouer avec l'entretien d'hier, je voudrais revenir sur trois sujets très précis. Dans votre dispositif, établissez-vous entre la certification et la classification la même distinction que celle que nous établissons en France ? En liaison avec cette question pourriez-vous me dire quel est le rôle de RINA dans la certification et la classification qui sont faites par l'Etat maltais ?
M. Lino VASSALLO : Je ne peux vous dire si les mots ont la même connotation en français et en anglais. Un bateau est classifié par une société de classification.
M. le Rapporteur : A la fin de sa construction ?
M. Lino VASSALLO : A la fin de sa construction. Évidemment, cette classification doit être maintenue, renouvelée tous les ans. Cela ne se fait pas sous la juridiction du pavillon.
M. le Rapporteur : C'est l'armateur qui paie ?
M. Lino VASSALLO : C'est le propriétaire.
M. le Rapporteur : Nous sommes bien d'accord. La certification est faite...
M. Lino VASSALLO : Je parlais de la classification.
Le navire doit être ensuite certifié conformément aux conventions. Cela se fait sous l'autorité de l'Etat du pavillon. C'est pareil partout. C'est le propriétaire qui finance, mais cela se fait par la société de classification, sous la responsabilité du pavillon, au profit de l'Etat.
Je pense que c'est le même système en France.
M. Didier DESTREMAU : C'est donc la même société qui opère.
M. le Rapporteur : En France, la certification est effectuée par notre administration, sauf pour un point particulier qui est fait par Veritas. Mais à Malte, elle est effectuée par RINA.
M. Lino VASSALLO : Par RINA ou par toute autre société de classification.
M. le Rapporteur : Mais qui choisit la société de classification ? C'est vous ?
M. Lino VASSALLO : Non, c'est le propriétaire, sur la liste qui a été approuvée par nous.
M. le Rapporteur : C'est, à mon avis, le grand sujet de divergence entre nous.
M. Didier DESTREMAU : Vous laissez le propriétaire décider qui va certifier le navire, alors qu'en France, nous imposons une certification faite par l'Etat.
M. Lino VASSALLO : Je n'ai pas l'intention de critiquer cela mais, à mon avis, et je suis sûr que mes collègues peuvent le confirmer, le système utilisé à Malte est celui employé par la plupart des administrations, y compris des administrations européennes, pas seulement celle du Panama.
M. le Rapporteur : Supposons que je veuille construire un bateau. En tant que propriétaire, je le fais classifier par RINA après sa construction. Je viens vous voir, espérant me faire enregistrer sous votre pavillon. Ma société de classification est RINA, je vous la propose donc pour certification ?
M. Lino VASSALLO : Oui.
M. le Rapporteur : Et vous l'acceptez ?
M. Lino VASSALLO : Nous déléguons RINA. En fait, nous insistons pour que la classification et la certification du navire soient faites par la même société.
M. le Rapporteur : Pourquoi ?
M. Lino VASSALLO : Parce que celle-ci possède toutes les données sur le navire et sur sa construction.
M. le Rapporteur : C'est le point majeur de divergence. Tout est là.
Ensuite, pour ce bateau que je fais immatriculer chez vous, la vérification de la classification est faite régulièrement par RINA ?
M. Lino VASSALLO : Oui, parce que, comme je l'expliquais hier, la classification et la certification sont très étroitement liées. Vous ne pouvez pas avoir de certification sans classification. Avant, c'était possible, mais plus maintenant.
M. le Rapporteur : Cela m'amène à deux interrogations : que font vos quatre-vingt-treize inspecteurs ? Ils inspectent dans le monde entier, disiez-vous. Quel est le rôle de votre administration, en dehors de celui d'accepter les papiers ? Et, conséquence sur l'Erika, puisque RINA est à la fois le classificateur et le certificateur, vous n'avez plus rien à dire ?
M. Lino VASSALLO : Je voudrais insister encore sur le fait que c'est un système que l'on retrouve dans le monde entier. En Italie, par exemple, avant, le Gouvernement italien ne reconnaissait que RINA. Aujourd'hui, en raison de la nouvelle réglementation de l'Union européenne, le Gouvernement italien, ainsi que d'autres, ouvre également sa porte aux autres sociétés de classification. C'est juste une remarque complémentaire.
M. le Rapporteur : Je comprends bien.
M. Lino VASSALLO : Tout d'abord, lorsque le propriétaire veut enregistrer le bateau, il nous présente tous les documents de classification. Nous savons donc que le bateau est classifié par Veritas, RINA, Lloyd's ou une autre société.
Ensuite, c'est nous qui autorisons la classification.
Dans tous les cas, nous autorisons la société de classification pour procéder à une expertise conforme à la convention, pour pouvoir ensuite passer à la certification. Si la société de classification n'estime pas que le bateau répond aux normes en vigueur, elle nous en informe et commence alors le processus qui met en évidence les réparations nécessaires. Une fois ce processus achevé, nous pouvons permettre à la société de classification de fournir la certification.
Dans la majorité des cas, c'est une procédure très simple ; parfois, cela peut être un long processus de discussion, qui peut nous conduire à dire au propriétaire qu'il ne lui est pas possible d'obtenir la certification et qu'en conséquence, il ne peut être enregistré sous pavillon maltais.
La convention autorise quelques exemptions. La société de classification n'a aucun droit de fournir ces exemptions sans autorisation spécifique de notre part. Là encore, cette autorisation n'est parfois pas accordée, mais son obtention fait toujours l'objet de discussions et de vérifications.
Quant à nos inspecteurs, comme je l'ai dit hier, ils procèdent à l'inspection des bateaux de manière aléatoire après leur certification, durant la période qui s'écoule entre la certification et la reconfirmation, non seulement pour contrôler que la certification a été faite correctement, mais également pour confirmer que le navire répond toujours aux normes de certification. Car, comme je l'expliquais dans le petit exemple que je décrivais, si le mois dernier, nous avons certifié qu'un navire disposait de quatre ou cinq canots de sauvetage, il faut que nos inspecteurs confirment que le navire possède bien toujours cet équipement.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous dire combien vous avez eu de refus de certification l'année dernière, ou en 1998 ?
M. Lino VASSALLO : J'aurais un peu de mal à le dire...
M. le Rapporteur : Pas obligatoirement maintenant, vous pouvez nous faire parvenir le renseignement par la suite.
M. Lino VASSALLO : Comme je le disais à M. l'Ambassadeur, nous n'avions aucune statistique à ce sujet. Nous n'avons donc pas beaucoup de chiffres à vous fournir. Nous sommes actuellement en train de le faire puisque la Commission européenne nous a demandé de tenir un registre de tous les bateaux refusés, à la fois de ceux que nous n'acceptons pas, de ceux que nous n'avons pas enregistrés parce qu'ils ne respectent pas notre pavillon et ses règles, et de ceux qui ne se sont pas mis sous notre pavillon parce que nous n'acceptions pas ce qu'ils nous demandaient. Ces derniers sont un peu difficiles à cerner, parce que nous ne connaissons pas toujours les raisons.
Par exemple, lorsque nous constatons qu'un bateau a été détenu plus d'une fois ou qu'il est détenu pour des raisons assez graves, nous engageons les actions nécessaires non seulement pour les réparations, mais si nous voyons que le problème perdure, malgré les injonctions au manager du bateau, nous prenons les mesures nécessaires pour retirer ce navire de notre flotte ainsi que les autres bateaux de ce shipmanager.
Généralement, le capitaine Zerafa dresse la liste des noms de tous les bateaux ayant des problèmes techniques afin que M. Manjon, qui gère le registre lui-même, puisse prendre les mesures juridiques qui s'imposent.
Cependant, comme je le disais hier, nous suspendons le fonctionnement du bateau. Il peut s'écouler un laps de temps entre les recommandations et leur mise en _uvre mais, pendant ce temps, le bateau ne fonctionne plus.
M. le Rapporteur : Je pense néanmoins que le fait que la même société de classification, payée par l'armateur, soit à la fois l'outil de l'armateur et celui de l'Etat pose problème, même si cela se fait dans de nombreux pays. C'est une véritable question, que l'Union européenne est en train de poser.
M. Lino VASSALLO : Je comprends votre inquiétude mais un système de vérification doit être trouvé au niveau international.
M. Didier DESTREMAU : Pourquoi international ?
M. Lino VASSALLO : Je dis international, parce que ...
M. Didier DESTREMAU : Comme le disait M. Le Drian, si ce n'est pas vous qui choisissez la société de classification, on entre dans une logique de non-contrôle qui explique beaucoup de choses.
M. le Rapporteur : Pour poursuivre ce que dit M. l'Ambassadeur, je comprendrais intellectuellement que l'on reste dans le système des sociétés de classification, mais il me semble nécessaire qu'en tant qu'autorité de l'Etat, vous disiez au propriétaire qu'étant classé par RINA, vous le faites contrôler pour la certification par Lloyd's, par exemple. Dans ce cas, vous auriez un contrôle effectif.
M. Lino VASSALLO : Je comprends, votre inquiétude et je comprends également le sens de votre proposition, mais celle-ci doit être discutée dans un cadre international car se poserait une autre question éthique : deux sociétés de classification, par exemple, pourraient se chevaucher. A l'heure actuelle, nous n'employons pas ce système parce qu'il faut auparavant traiter certaines questions.
M. le Rapporteur : C'est une discussion qu'il faudra poursuivre car elle porte sur un sujet important.
M. Lino VASSALLO : Nous en discuterons certainement à l'avenir, y compris dans d'autres enceintes que dans ce bureau.
Capitaine Joseph ZEFARA : A titre d'exemple, lorsqu'un propriétaire achète un bateau au Japon, en Corée ou n'importe où ailleurs, le chantier naval présente un nouveau bateau classifié par une société de classification choisie par le chantier naval. C'est le chantier qui choisit.
M. Didier DESTREMAU : Cela ne change pas le raisonnement.
Capitaine Joseph ZEFARA : Ensuite, le propriétaire doit accepter ce bateau selon cette classification. Nous n'avons aucun contrôle sur cela.
M. Didier DESTREMAU : Mais ensuite, vous l'avez lorsque vous certifiez le bateau !
Capitaine Joseph ZEFARA : Lorsque l'on certifie un bateau, la société de classification fait des analyses qui se chevauchent. Nous ne donnerons pas un certificat de sûreté à moins que le bateau ne soit aussi classifié par eux.
Il devrait exister une organisation ultérieure qui puisse contrôler le travail de l'autre organisation. C'est bien votre idée ?
M. Louis GUEDON : S'ils sont juges et parties, cela ne va pas.
M. le Rapporteur : Tout à fait. Vous faites confiance aux sociétés de classification et vous vérifiez ensuite si les bateaux respectent bien les normes. Le problème principal est cette confiance totale dans les sociétés de classification.
Si votre pays prenait des initiatives fortes sur ce sujet, peut-être avec d'autres pays européens, ce serait bien perçu en Europe.
M. Lino VASSALLO : Je comprends votre inquiétude et ce serait, j'en conviens, un meilleur système. Vous dites que nous pourrions prendre l'initiative, mais une telle initiative ne peut être celle d'un seul pavillon. Elle demande un changement du système international.
M. le Rapporteur : A ceci près que si l'Europe décide de le faire et si Malte veut devenir membre de l'Union européenne, il faudra bien que vous acceptiez de le faire. Je parle bien de l'Union européenne, pas de l'OMI.
M. Lino VASSALLO : Je ne dis pas que nous serions contre ce système, je dis simplement qu'il est pratiquement impossible pour un seul pavillon de le faire...
M. le Rapporteur : Pour un seul ? Bien sûr.
M. Lino VASSALLO : ...car il faut que ce changement soit opéré au niveau international. Nous sommes donc d'accord ; nous vous seconderons.
Mme Jacqueline LAZARD : Ma question, technique, concerne le code ISM. Je reprendrai l'exemple de l'Erika, qui était certifié ISM. Or, nous avons la preuve que le système n'a pas du tout fonctionné. Cela ne vous a-t-il pas poussé à vous interroger sur la valeur de la classification faite par RINA ? Cela n'a-t-il pas engendré une certaine méfiance de l'Etat maltais envers cette société de classification ?
M. Lino VASSALLO : Une méfiance à quel sujet ?
Mme Jacqueline LAZARD : Je parle du code ISM. La communication n'a pas été facile entre le capitaine de l'Erika et l'armateur, le propriétaire, etc. Cela a contribué aux difficultés.
M. Lino VASSALLO : L'une des questions sur lesquelles nous menons des investigations est exactement celle-là, madame, pas seulement la certification de la société de classification. Il faut dire aussi qu'au moment de la certification, tous les systèmes fonctionnaient bien. Mais maintenant nous nous demandons si tous les systèmes ont vraiment été respectés. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Nous avons des doutes sur ce système, nous nous demandons s'il a fonctionné ou pas. Je parle de doutes car, pour l'instant, nous n'en sommes qu'aux soupçons, pas encore aux conclusions.
Trois mois avant l'accident de l'Erika, nous avions demandé un contrôle inopiné de la compagnie, qui a été positif...
M. le Rapporteur : De quelle compagnie ?
M. Lino VASSALLO : Panship.
M. Lino VASSALLO : Nous sommes conscients du nombre de bateaux retenus dans les ports européens. Nous y sommes extrêmement attentifs.
Mais l'essentiel des problèmes se pose avec les petits bateaux. Je ne dis pas, naturellement, que les plus grands n'ont pas de difficultés, mais, le plus souvent, ce sont des petits bateaux qui sont détenus, des bateaux qui font du cabotage en Europe. Nous prenons les mesures nécessaires afin d'éliminer ce problème.
Les statistiques font état une forte amélioration au cours des dernières années, mais je suis d'accord avec vous pour dire que le nombre actuel est encore trop élevé, bien plus élevé que la moyenne.
M. le Rapporteur : Pour relier les deux problèmes, supposons qu'il y ait eu deux sociétés de classification sur les bateaux en question, auraient-ils été autorisés à partir ?
M. Lino VASSALLO : Pourriez-vous répéter la question ?
M. le Rapporteur : Si je prends un bateau battant pavillon maltais, arrêté dans le cadre du MOU. Il a été autorisé par M. Vassallo, autorisé par l'Etat maltais, il est interdit par l'Etat du port. S'il y avait eu deux sociétés de classification, peut-être n'auriez-vous pas autorisé ce bateau.
M. Lino VASSALLO : Je suis bien d'accord, mais nombre de ces détentions ne résultent pas d'un problème de classification, mais d'un problème dans le nombre des membres d'équipage, ou de mauvais entretien. Cela n'a rien n'a voir avec la classification.
M. le Rapporteur : Nous aurions pu parler des heures mais, malheureusement, un autre entretien nous attend.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être validée par les intervenants.
Audition de M. Charles SCHEMBRI,
directeur des ports maritimes de la Malta Maritime Authority,
et de M. Charles ABELA, deputy directory,
en présence de Son Excellence M. Didier DESTREMAU,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Malte
(extrait du procès-verbal de la séance du 24 avril 2000 à Malte)
Présidence de M. Jean-Yves LE DRIAN, Rapporteur
M. Charles SCHEMBRI : Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie de nous donner l'occasion d'accueillir à Malte une délégation de parlementaires français. C'est un grand honneur pour nous. Nous espérons d'autres rencontres comme celle-là.
M. Didier DESTREMAU : C'est l'occasion de mieux nous connaître et de poursuivre nos relations sur une base plus saine.
M. Charles SCHEMBRI : Quel est l'objet principal de cette mission ?
M. le Rapporteur : Le Parlement français a décidé la création d'une commission d'enquête composée de trente parlementaires, à la suite de la catastrophe de l'Erika. Nous devons formuler des propositions avant le 15 juillet. Nous devons effectuer à la fois une analyse de l'accident et de la manière dont notre pays a su répondre à la pollution, mais aussi des propositions pour fixer des règles, pour éviter que cela ne se reproduise ; des règles pour la France, des règles pour l'Europe et, si possible, des règles pour le monde.
Evidemment, votre pays n'est pas aujourd'hui le pays qui suscite en France le plus d'enthousiasme, particulièrement dans les régions côtières car lorsque nous sommes en train de ramasser le goudron sur nos plages, nous pensons que nous le devons à un bateau maltais. Il était donc nécessaire que nous venions vous voir pour comprendre mais aussi pour essayer d'y remédier.
Nous venons donc sans cacher notre ressentiment, mais avec la volonté de le dépasser, d'autant que Malte, nous le savons, souhaite entrer dans l'Union européenne.
Nous avons donc de nombreuses questions à poser. Si vous permettez, je souhaiterais éclaircir deux points qui, je pense, concernent votre propre compétence. Le premier est très technique : avez-vous dans ce port ou à Marsaxlokk un dispositif pour le déballastage ? Si tel est le cas, comment est-il géré ? Sinon, comptez-vous en avoir un ?
M. Charles SCHEMBRI : Le directeur général du Shipping, M. Vassallo, vous parlera à propos de l'Erika.
Pour ce qui est de protection de l'environnement au sein du port, nous avons publié en 1996 des réglementations au sujet du transport maritime de produits dangereux, qui se fondent pour l'essentiel sur les conventions et les résolutions de l'OMI ainsi que sur la pratique internationale transcrite dans les codes de pratique, et qui ont, au fil des années, été mises en _uvre.
Avant la publication et la mise en _uvre de ces réglementations, des enquêtes ont été conduites pendant deux ans pour étudier la situation et analyser ce que nous pourrions mettre en place. Les conclusions de cette étude ont été qu'il y avait plusieurs installations de carburants, notées de 5 à 9, 10 étant la meilleure notre possible.
M. le Rapporteur : C'est le classement des bateaux qui venaient dans le port ?
M. Charles SCHEMBRI : Non, je parle des installations de carburant dans les ports.
M. Didier DESTREMAU : C'est tout ce qui a trait au mazout, au fioul, etc. Il parle de l'alimentation en carburant.
M. Charles SCHEMBRI : Lorsque les réglementations ont été publiées, elles ont permis à certains d'améliorer leur classement jusqu'à 8 %. C'est une satisfaction de dire qu'au cours de ces quatre dernières années, l'importation de carburant a augmenté de 30 % environ. Le volume d'approvisionnement en carburant a crû de 120 % au cours des quatre dernières années, atteignant près d'un million de tonnes par an.
Nous avons eu seulement un accident mineur portant sur un déversement de 100 litres au cours de ces années.
De plus, nous avons créé un Forum réunissant toutes les personnes travaillant de près ou de loin dans les installations pétrolières. Nous nous rencontrons tous les trois mois environ afin de discuter de la situation de cette industrie. Il existe des groupes de travail et des réunions pour les différentes industries, afin de diffuser les consignes les plus importantes pour la protection de l'environnement portuaire.
L'autorité maritime, avec un financement de l'Union européenne, a développé sa propre gestion des risques sur l'environnement maritime.
M. le Rapporteur : Vous parlez toujours de la gestion des risques dans le port ?
M. Charles SCHEMBRI : A l'intérieur du port et au sein de l'industrie d'approvisionnement en carburant.
M. Didier DESTREMAU : Pour le port, mais aussi pour tout ce qui est approvisionnement des navires en fioul hors du port, avec les bateaux chargés de fioul qui vont livrer en mer.
M. Charles SCHEMBRI : Nous avons une procédure complète avec des check lists avec tous les fournisseurs de carburants.
M. le Rapporteur : A quoi faisiez-vous référence lorsque vous parliez d'un classement de 5 à 10 ?
M. Charles SCHEMBRI : Nous avons visité des installations de carburant afin d'évaluer leur niveau de qualité.
M. le Rapporteur : Le niveau des installations de carburants à quai ?
M. Charles SCHEMBRI : Oui, nous avons vu quelles procédures ils avaient mises en place, afin de pouvoir les classer. Nous nous sommes fixés une échelle de classement allant de un à dix, dix étant accordé au meilleur. Certaines installations se situaient à neuf et d'autres à quatre ou cinq. Nous ne pouvions leur demander de quitter le métier, nous les avons donc aidés à s'améliorer. Nous les avons éduqués.
M. Didier DESTREMAU : La question de M. Le Drian était différente. Elle portait sur le déballastage.
M. Charles SCHEMBRI : Il y a différentes eaux de ballast. Il faut établir quelle est la qualité.
M. Charles ABELA : Pour ce qui est de l'eau de ballast dans les pétroliers, nous avons les installations adéquates. Nous en avons d'ailleurs deux : l'une à l'entrée du port ; l'autre, qui travaille à peu près à 40 % de sa pleine capacité comprend des filtres, des intercepteurs, permettant d'assurer le recyclage du fioul et des eaux de ballast dont on ne se sert plus.
Cela ne fonctionne pas encore à 100 % de sa capacité parce que, comme vous le disiez, nous nous inscrivons actuellement dans un processus d'adhésion à l'Union européenne. Le Gouvernement fait donc de son mieux pour mettre en application toutes les directives avant de fournir une licence, un permis, mais le mécanisme existe déjà.
M. le Rapporteur : Ces stations de déballastage sont-elles très utilisées ?
M. Charles SCHEMBRI : Oui.
Une directive de l'Union européenne recommande que les navires se débarrassent de leurs eaux de ballast dans les ports. Je pense que cela sera mis en application cette année à Malte. Cela signifie que les navires devront déballaster dans le port. Un système permettant de suivre ces procédures existe depuis trois ans au port de La Valette ainsi qu'à celui de Marsaxlokk. Lorsque nos inspecteurs visitent les bateaux qui viennent d'entrer au port et remarquent que leurs citernes sont pleines et qu'il n'y aura pas assez de place pour que le bateau puisse atteindre ainsi le prochain port, nous leur demandons de se débarrasser des déchets. Une fois cela fait, le capitaine du navire reçoit un reçu dont il pourra faire état dans le port suivant, montrant qu'il a déballasté à Malte.
M. le Rapporteur : Le taux d'utilisation des stations est-il important ?
M. Charles SCHEMBRI : Oui, assez.
Excusez-moi, je viens d'apprendre qu'il est possible d'aller visiter le Freeport et qu'ils nous attendent.
M. le Rapporteur : Deux ici et une Marsaxlokk, est-ce suffisant pour le trafic que vous enregistrez ?
M. Charles SCHEMBRI : Si ces installations ne fonctionnaient que pour ce port, le rapport coût / rentabilité ne serait pas suffisant.
Mais cela vous gênerait-il que nous continuions cette discussion demain parce que nous devons maintenant aller au port.
M. le Rapporteur : Pas du tout, mais auparavant je vais vous poser ma deuxième question, à laquelle vous pourrez réfléchir et apporter une réponse par la suite : comment appliquez-vous le contrôle par l'Etat du port ? En tant qu'autorité portuaire, vous devriez être les acteurs d'application des conventions internationales et disposer des moyens d'assurer le contrôle des navires qui passent dans vos ports.
Je ne parle pas du contrôle de l'Etat du pavillon, mais bien de celui de l'Etat du port.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être validée par les intervenants.
Audition du capitaine Thomas GILMOUR,
director of field activities et acting assistant commandant,
du capitaine WESTERHOLM,
du lieutenant Kenneth PIERRO, chargé des affaires internationales,
du lieutenant Mike PITTMAN, de l'Office of response,
de M. David DU PONT, de l'Office of standards evolution and developpement,
du lieutenant Joseph COST, de l'Office of compliance,
et du lieutenant commander Tim DEAL, de l'Office of response,
United States Coast Guard
(extrait du procès-verbal de la séance du 17 mai 2000 à Washington)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Capitaine Thomas GILMOUR : Je vous souhaite la bienvenue au quartier général de la Coast Guard. Je suis le capitaine Thomas Gilmour et je représente l'amiral North qui se trouve actuellement au comité de sécurité de l'OMI à Londres, où le sujet de l'Erika doit être abordé.
Aujourd'hui, un certain nombre d'intervenants vont s'efforcer de faire ressortir clairement la réponse qu'a constitué notre Oil Pollution Act de 1990 et vous expliquer, d'une part, comment nous avons évolué afin de mieux réagir préventivement aux pollutions par hydrocarbures et, d'autre part, comment nous avons quantifié les questions financières dans le cadre de cette loi. Nous nous pencherons également sur les mesures de prévention, c'est-à-dire celles que nous avons prises pour éviter les pollutions.
Le lieutenant Pierro parlera du rôle et des missions de la Coast Guard afin que vous compreniez les activités que nous remplissons en plus de la réponse aux pollutions et leur prévention. Il fera ressortir les relations entre toutes nos activités. Il parlera notamment des aides à la navigation, distinctes de la sécurité maritime, et de la protection de l'environnement. C'est néanmoins tout à fait lié au passage sans risque des navires dans nos cours d'eau. Mais si nous parlons beaucoup de services de trafic et des aides à la navigation c'est parce que ce sont des mesures importantes de prévention.
Cela sera suivi d'un rapide exposé sur l'OPA 90, qui vous présentera les mesures prises à la suite du naufrage de l'Exxon Valdez, tant au niveau juridique que réglementaire, qu'il incombe à la Coast Guard de mettre en _uvre.
Puis, vous aurez un exposé sur l'Office of Compliance, chargé de l'inspection des navires.
Enfin, nous nous intéresserons au système de gestion de crise que nous utilisons.
J'espère que vous tirerez quelque enseignement de cette matinée pour l'élaboration de votre rapport. Je crois savoir que vous rencontrez demain le National Pollution Funds Center - le Fonds national contre la pollution marine. Ils vous expliqueront leur action, leur responsabilité financière, ainsi que la gestion de ce fonds d'indemnisation des pollutions.
M. le Président : Je voudrais au nom de notre délégation vous remercier de votre accueil. Vous avez évoqué au cours de votre propos la réunion qui a lieu actuellement à l'OMI, à laquelle participe l'amiral North. Il y sera éventuellement question de l'Erika. C'est en effet ce naufrage qui nous amène ici. Le Parlement français a décidé la formation d'une commission d'enquête dans le cadre de l'Assemblée nationale et d'une mission d'information dans le cadre de l'autre assemblée, le Sénat.
Nous sommes venus aux Etats-Unis parce que vous avez eu à connaître une catastrophe de grande ampleur également, celle de l'Exxon Valdez. Cela nous intéresse, non pas pour copier, nous appartenons à des pays différents, mais pour voir de quelle manière nos pays peuvent répondre de façon coordonnée, similaire, aux risques de catastrophes écologiques qui remettent en cause les équilibres humains, économiques et écologiques. Tout ce que vous avez pu mettre en place à la suite du naufrage de l'Exxon Valdez nous intéresse donc.
Lieutenant Kenneth PIERRO : Je vous souhaite la bienvenue au quartier général de la Coast Guard. Je suis le lieutenant Kenneth Pierro, membre de l'équipe chargée des affaires internationales du commandement. Mes responsabilités comprennent la coordination des opérations internationales et la prise en charge des visiteurs étrangers.
Durant ce bref exposé, je vous présenterai les missions de la Coast Guard, ferai un bref historique, vous parlerai de notre organisation et vous dirai quelques mots sur les matériels que nous utilisons dans le cadre de nos missions.
La Coast Guard est l'une des cinq forces armées des Etats-Unis. En temps de paix, nous relevons du Département des transports et nous sommes chargés de l'application des lois, des opérations de recherche et de secours. Nous agissons au titre d'autorité de régulation. Toutefois, lorsque cela est nécessaire, ou après accord entre le Secrétaire à la défense et le Secrétariat aux transports, nous mettons nos moyens au service du Département de la défense, dans le cadre de notre mission de sécurité nationale.
En temps de guerre, le Président peut ordonner à la Coast Guard de se joindre à l'US Navy. La dernière fois que cela s'est produit a été lors de la seconde Guerre mondiale, lorsque la Coast Guard a fourni des navires de combat, a conduit les bateaux de débarquement lors du débarquement de Normandie et des campagnes dans les îles du Pacifique, a assuré l'escorte de convois et a participé à la lutte anti-sous-marine.
Les unités de la Coast Guard ont maintenant plus tendance à se déployer avec les forces d'intervention de la Navy. La Coast Guard déploie ses hommes et ses matériels aux côtés de l'US Navy, là où la Navy opère. Les vedettes rapides de la Coast Guard ont été déployées dans la Baltique, dans le Golfe persique, au Moyen Orient et en Amérique latine, pour fournir une assistance aux opérations du commandement en chef et au titre de notre sécurité nationale. Lorsque les unités de la Coast Guard se déploient avec les forces d'intervention de la Navy, elles sont considérées comme des groupes d'opérations spéciales rattachés au commandant de l'US Navy.
La Coast Guard s'organise autour de deux commandements opérationnels : un commandement de quartier général et l'équipe spéciale du commandement.
La Coast Guard comprend 36 000 hommes d'active répartis dans plus de 15 domaines de spécialité, 5 600 civils, 8 000 réservistes et 34 200 auxiliaires. Les réservistes sont des militaires qui, à l'exception de légères différences de salaire, d'avantages sociaux et de retraite, sont engagés à part entière dans les forces d'active. Les auxiliaires constituent une force volontaire au sein de la structure de la Coast Guard, qui complète les forces militaires en assurant le soutien des opérations de recherche et de secours, en donnant des cours de sécurité de navigation, en contrôlant les fréquences de détresse radio et en effectuant des contrôles de sécurité sur les navires de plaisance.
Chacun des deux commandants de zone est responsable de plusieurs régions plus petites, appelées districts.
Les missions confiées à la Coast Guard comprennent donc les opérations de recherche et d'assistance, la sûreté maritime, la sécurité des ports et des voies navigables, les opérations de maintien de la loi maritime (y compris la lutte anti-drogue, la protection des ressources marines vivantes et la lutte contre l'immigration clandestine), la protection de l'environnement marin, les opérations d'aides à la navigation, les opérations en milieu polaire, la gestion des voies navigables, la gestion des ponts, la défense nationale et la participation aux patrouilles glaciaires internationales. Nous effectuons toutes ces missions pour atteindre des objectifs quantifiables dans les domaines principaux de la sûreté maritime, de la sécurité maritime, de la protection des ressources naturelles, de la mobilité maritime et de la défense nationale.
Cette approche multi-missions permet à une organisation relativement petite de répondre à un grand nombre de problèmes maritimes et d'obtenir l'utilisation maximale des moyens matériels et humains. Les photos qui vous sont présentées décrivent certaines des missions au cours d'une journée type, chaque jour de l'année. Ainsi, en moyenne, nous conduisons chaque jours 191 missions d'assistance et sauvetage en mer, sauvons 14 vies et assistons 328 personnes.
En matière de recherche et d'assistance, nous fournissons une assistance aux personnes en détresse et protégeons leurs biens dans l'environnement maritime. Notre rôle est celui d'un coordinateur de recherche et assistance maritime dans le cadre du plan national Search and Rescue (SAR), et nous entretenons les installations de SAR le long des côtes américaines, de Guam, de Porto Rico et de nombre des plus grands canaux intérieurs. La Coast Guard fait également fonctionner le système AMVER (Automated Mutual Assistance Vessel Rescue) et a aidé à concevoir le système SARSAT - un système de satellite permettant de capter les ondes radio des positions d'urgence et de relayer l'emplacement du transmetteur aux unités SAR.
Nous mettons en _uvre les lois fédérales sur les bateaux battant pavillon américain en haute mer, et sur tous les navires dans les eaux territoriales américaines. Outre le fait qu'elle interdise l'entrée des trafiquants de drogue et des immigrants clandestins, la Coast Guard fait appliquer les réglementations en matière de pêche et de zone économique exclusive dans la limite des 200 milles marins.
La Coast Guard est chargée spécifiquement par le Congrès de faire appliquer les lois et les traités des Etats-Unis. Nous ne sommes pas soumis à la loi qui interdit aux personnels de l'US Army et de l'Air Force d'agir en tant qu'officiers de mise en application des lois.
De plus, le Département d'Etat a autorisé la Coast Guard à négocier en tant qu'agent du gouvernement américain avec certaines nations des Caraïbes pour s'associer avec les Etats-Unis dans la lutte contre la drogue.
La Coast Guard assure la sécurité des ports, des canaux, des installations de bord de mer, des bateaux et des personnes qui y travaillent contre tout accident ou dommage intentionnel, destruction ou blessure. La Coast Guard gère également la sûreté et la sécurité des ports ainsi que la protection de l'environnement.
M. le Rapporteur : Sur votre transparent, vous faites ressortir soixante-quatre contrôles de bateaux par jour. S'agit-il de contrôles techniques allant au-delà de ce que les documents prescrivent ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Ce sont des inspections physiques, qui englobent tous les bateaux naviguant sur le territoire américain, y compris les navires destinés aux passagers qui fonctionnent dans tous les Etats-Unis. Nous assurons en moyenne environ 120 contrôles sur documents par jour et 64 inspections physiques.
Lieutenant Kenneth PIERRO : Ce chiffre est une moyenne obtenue en divisant le nombre de contrôles annuels par 365. Tout comme pour le sauvetage, vous aviez le chiffre de 191 personnes secourues par jour. En fait, si nous sauvons 500 personnes sur un navire un jour, cela fait monter la moyenne.
La Coast Guard délivre des licences aux officiers et aux marins de la marine marchande. Nous régulons également les exigences minimales en matière d'équipage des navires commerciaux pour s'assurer qu'ils disposent du personnel suffisant pour fonctionner en toute sécurité.
La Coast Guard réduit les risques de mort, de blessure, de perte de biens et de dommages sur l'environnement en développant et en mettant en _uvre les normes de conception, de construction, de maintenance et de fonctionnement des bateaux de commerce et des installations offshore. Nous enquêtons en moyenne chaque jour sur 17 accidents maritimes.
Nous nous efforçons de réduire les risques de décès, de blessures et de dommages aux biens sur les bateaux de plaisance, en améliorant la sécurité et en assurant un développement et une utilisation plus sûre de toutes les eaux américaines.
La Coast Guard minimise les dommages causés par les substances polluantes émises dans la zone côtière, c'est-à-dire jusqu'à une distance de 3 milles des côtes, et réduit les menaces sur l'environnement maritime provenant de déversements accidentels de pétrole ou de produits dangereux. Nous aidons aussi à développer des plans de réponse à la pollution au plan tant national qu'international, et nous entretenons la force d'intervention nationale. Nous répondons en moyenne chaque jour à 34 pollutions chimiques ou par hydrocarbures.
En matière de commerce, nous assurons le passage sûr et efficace du trafic maritime en fournissant des services de radionavigation tous temps continus et précis. Nous entretenons aussi des dispositifs d'aide à courte et longue distance à la navigation, tels que phares et bouées, et exploitons des transmetteurs de radionavigation longue portée. Il existe 56 000 dispositifs d'assistance à la navigation fédéraux et 48 000 privés aux Etats-Unis.
La Coast Guard tire son origine du Revenue Cutter Service mis en place par le premier Secrétaire au trésor, Alexander Hamilton, en 1790. Le Revenue Cutter Service fut créé pour éliminer la contrebande dans les nouveaux Etats-Unis indépendants, ainsi que la perte de revenu résultant de droits de douane non perçus. La Coast Guard fut fondée lorsque le Revenue Cutter Service et le Life Saving Service fusionnèrent en 1915. Au fil des années, d'autres services, tels que le Lighthouse Service, le Lifesaving Service et le Steamboat Inspection Service lui furent ajoutés. L'émergence de ces différents services marqua le début des responsabilités multi-missions de la Coast Guard actuelle.
La Coast Guard américaine est entièrement financée par le gouvernement fédéral. Toutes les agences gouvernementales reçoivent leurs fonds sur différentes lignes budgétaires, par la même procédure. Chaque année, le Président soumet ses demandes budgétaires au Congrès. Cette demande couvre les dépenses gouvernementales pour le budget suivant. Près des 2/3 de la demande sont dévolus à des programmes « obligatoires », tels que la sécurité sociale, les programmes médicaux, le service de la dette nationale, etc. Le tiers restant, appelé financement discrétionnaire, est réparti entre les différents départements gouvernementaux.
Près de la moitié du financement discrétionnaire est versé au Département de la défense, le reste permettant de financer toutes les autres agences gouvernementales, y compris la Coast Guard. Cette dernière reçoit près de 300 millions de dollars de financement directement du Département de la défense pour pouvoir assurer les missions de défense nationale.
Le budget global de la Coast Guard est de 4,3 milliards de dollars en 2000. L'un des transparents qui vous est présenté vous montre comment nous affectons les sommes pour accomplir nos diverses missions. Les crédits se répartissent ainsi : aide à la navigation et opérations polaires : 19,2 % ; missions de lutte contre le trafic de stupéfiants : 17,7 % ; protection des ressources marines : 15,4 % ; sécurité maritime : 13, 7% ; recherche et sauvetage : 11,6 % ; protection de l'environnement marin : 11,4 % ; police de l'immigration : 5,5 %. Les coûts de personnel et autres frais généraux sont inclus dans le total du programme.
L'avenir de la budgétisation gouvernementale aux Etats-Unis sera fortement influencé par notre engagement à maintenir l'équilibre du budget fédéral, et par la demande, de la part des contribuables américains, que les agences soient comptables de leurs actions. Ces facteurs forcent les agences à devenir plus efficaces. Grâce à une plus grande indépendance technologique et à de meilleures pratiques de gestion, la Coast Guard a été en mesure de supporter une diminution de ses ressources, sans pour autant réduire sa présence ou son efficacité.
Nous utilisons de nombreux bateaux et avions dans l'accomplissement de nos missions.
La Coast Guard fait fonctionner les seuls brise-glace polaires américains. Nos bateaux patrouillent même les régions les plus reculées de nos eaux territoriales, de Guam à Porto Rico, et de Hawaï à l'Alaska. Nous disposons de 106 navires d'une longueur supérieure à 65 pieds (cutters) et de 88 vedettes de patrouille, plus petites.
Nous utilisons également certains des avions les plus sophistiqués au monde. Chaque avion de la Coast Guard est équipé pour voler dans les pires conditions météorologiques, c'est-à-dire lorsque les gens ont le plus besoin de nous. Nous disposons de 30 C-130 Hercules et de 23 biréacteurs Guardian. Nos 42 hélicoptères Jayhawk peuvent chercher pendant des heures les victimes d'accidents de bateaux ou patrouiller le long de certaines voies pour lutter contre les trafiquants de drogue.
Les 95 dauphins, quant à eux, se déploient à partir des ponts d'envol de navires de moyen et de grand rayon d'action, prolongeant ainsi la vision du navire bien au-delà de l'horizon ; et jusqu'aux deux pôles grâce aux brise-glace.
La Coast Guard représente les Etats-Unis dans de nombreuses organisations internationales, dont la plus importante est l'Organisation maritime internationale. La Coast Guard participe aussi aux programmes de coopération bilatéraux avec de nombreux pays par le biais d'accords et d'opérations. Elle envoie ses hommes à l'étranger, contre rétribution, accueille des étudiants étrangers dans ses écoles et abrite des cadets internationaux dans la US Coast Guard Academy.
Nous avons donc eu un bref aperçu de l'histoire de la Coast Guard et de nos cinq missions de base. Nous avons vu les structures en personnels et en moyens opérationnels, ainsi que leur organisation. Enfin, nous avons vu le fonctionnement de la Coast Guard au sein des organisations internationales.
Je vous remercie de votre attention. Avez-vous des questions ?
M. le Rapporteur : Quelle est la proportion de bateaux contrôlés par rapport au nombre de bateaux de commerce fréquentant les ports civils ? Je ne parle pas des bateaux de plaisance.
Capitaine Thomas GILMOUR : Les bateaux qui battent pavillon américain sont inspectés au moins une fois par an. Les bateaux battant pavillon étranger, qui sont de grands bateaux de passagers, le sont aussi au moins une fois par an, et tous les trimestres s'ils accostent aux Etats-Unis.
Pour les autres bateaux, je distinguerai entre les chimiquiers et les pétroliers et vraquiers.
Les premiers sont soumis à une inspection complète tous les ans. Nous faisons ce que nous appelons le Tank Vessel Examination. C'est une inspection moins approfondie que pour les bateaux battant pavillon américain, parce que nous ne contrôlons pas l'intégralité des points exigés pour les bateaux américains. Nous supposons que l'Etat du pavillon assume lui aussi ces inspections, bien que nous ne leur fassions pas totalement confiance... (Sourires.)
Sur les vraquiers, nous faisons une inspection annuelle, nous avons aussi un programme d'inspection par l'Etat du port. Nous accordons la priorité à nos bateaux et inspectons les bateaux sous pavillon étranger souvent, certains plus souvent que d'autres, en fonction de leur pavillon, de leur société de classification, de leur armateur et de leur historique.
Vous découvrirez cela lors de vos entretiens.
La parole est au lieutenant Mike Pittman et à M. David Du Pont.
Lieutenant Mike PITTMAN : Nous sommes très contents de faire votre connaissance. Nous vous ferons une présentation conjointe de l'OPA 90, prévention et réponse, que nous nous répartirons entre moi-même, Mike Pittman, et David Du Pont.
Voici notre organigramme, avec, en dessous du commandant de la Coast Guard, les systèmes, les ressources humaines, la sécurité maritime et les opérations. Dépendant de la Sécurité maritime, nous avons la division Normes, où travaille M. Du Pont, et la division Réaction, où je travaille.
Dans une année normale, l'économie américaine nécessite le transport d'1,2 milliard de tonnes de marchandises par mer, ce qui représente 95 % de notre commerce extérieur.
Nous pompons plus de 10,3 milliards de barils de pétrole brut offshore à proximité de nos côtes.
Nous transportons sur des péniches 331 millions de tonnes de charbon, de pétrole et de produits pétroliers raffinés par notre industrie.
Un certain nombre d'obligations légales représentent les fondements de notre programme. En 1972, le Clean Water Act qui traitait de la pollution des eaux, en particulier par le pétrole, et le Ports and Waterways Safety Act furent adoptés. Par la suite vint ce que nous appelons le CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act. Je suis certain que vous connaissez le Act to Prevent Pollution From Ships, qui est une mise en _uvre des dispositions MARPOL. Enfin, le Oil Pollution Act de 1990 apporte des changements significatifs au Clean Water Act de 1972.
M. David DU PONT : Je suis donc spécialisé dans la division Normes de la Coast Guard. Je vous parlerai brièvement de la prévention et des initiatives prises par la Coast Guard dans le cadre de l'OPA de 1990 et je conclurai cette présentation conjointe, avant que vous ne nous posiez des questions.
Avant l'accident de l'Exxon Valdez, il était possible de caractériser les nombreuses actions législatives et réglementaires prises par les Etats-Unis comme étant dirigées sur des accidents spécifiques et limités.
Avec l'Oil Pollution Act de 1990, la Coast Guard s'est concentrée sur cinq points majeurs : la prévention des accidents, la disponibilité, la capacité de réponse, la responsabilité et la compensation ainsi que la recherche et développement.
Il est évident qu'il vaut mieux éviter les pollutions que d'en passer par des mesures très coûteuses de nettoyage. L'OPA 90 a permis d'initier un certain nombre de réglementations visant à la prévention. Mais les règlements ne suffisent pas en eux-mêmes à assurer la sécurité et donc, en plus de ces règlements, nous avons mis en place un certain nombre de partenariats avec l'industrie et des collectivités pour garantir que nous pouvons renforcer le degré de sécurité, même en-dehors de régimes normatifs et réglementaires.
Les exemples de règlements émis par la Coast Guard après l'OPA 90 concernent la nécessité de navires à double coque, des normes générales parallèlement aux normes de l'OMI, des mesures opérationnelles pour les navires à simple coque afin d'accroître le niveau de sécurité dans le fonctionnement de ces derniers navires dans les eaux américaines, avant leur retrait programmé.
En plus, l'OPA donne à la Coast Guard la possibilité d'accéder au fichier national des permis de conduire et aux casiers judiciaires des marins américains, pour vérifier qu'ils n'ont pas fait l'objet de condamnations pour conduite en état d'ivresse ou n'ont pas d'antécédents de consommation de stupéfiants.
L'une des initiatives non réglementaires de la Coast Guard les plus importantes prises ces dernières années est notre programme Prevention through people. Nous essayons de voir comment supprimer les erreurs humaines associées au fonctionnement d'un navire. Nous travaillons avec des groupes industriels pour tenter de réduire le nombre des accidents.
Les photos qui suivent vous montrent que le nombre de pollutions dans les eaux américaines a fortement baissé. Ainsi, le nombre de pollutions majeures et moyennes est passé de 38 en 1990 à 8 en 1997.
Je vous remercie de votre attention et me tiens prêt à répondre à vos questions.
Lieutenant Mike PITTMAN : Je vais traiter de quelques éléments de la stratégie, surtout des principaux termes qui ont été soulevés après l'OPA 90. Les déversements d'hydrocarbures et de substances dangereuses sont illégaux. L'OPA 90 porte surtout sur les hydrocarbures. Le responsable doit notifier l'accident. Le responsable est chargé de payer les frais de nettoyage et de l'indemnisation, il a la responsabilité du nettoyage. L'OPA 90 exige le prédéploiement d'équipements de réponse aux pollutions, de la part du gouvernement et de la part de l'industriel.
M. le Président : Qu'entendez-vous par responsable ?
Lieutenant Mike PITTMAN : Ce que nous appelons la partie responsable, ou spiller, peut être un exploitant ou le propriétaire ; c'est une question qui revient au coordinateur fédéral. L'OPA 90 parle d'une personne responsable de la réponse à apporter.
Notre système de relations entre les différents planificateurs s'articule ainsi : nous avons une équipe d'intervention nationale. Nous avons ensuite des équipes régionale d'intervention. Puis des comités régionaux qui relèvent des équipes d'intervention régionale et des comités fédéraux d'intervention en cas d'urgence. Nous avons enfin des comités locaux de planification. En cas de crise, ils agissent à un niveau qui est pratiquement le niveau municipal.
Au niveau national, nous disposons d'une équipe d'intervention nationale (National response team-NRT) comme nous l'avons déjà dit, qui se compose de plusieurs agences du gouvernement américain. Elle comprend notamment la Coast Guard, l'administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA), l'agence de protection de l'environnement, le département des transports, le département de la défense, etc. Au-dessous, vous avez les équipes régionales d'intervention qui se composent des agences fédérales et locales. Enfin, intervient le coordinateur fédéral sur le terrain (Federal on-scene coordinator-FOSC)qui est désigné par la loi, qui remplit les attributions de direction des opérations qui lui sont conférées par l'OPA 90.
En conséquence, il y a eu plusieurs initiatives, dont la préparation au programme d'intervention en cas de pollution (PREP). Ce programme vise à organiser des exercices afin de développer les relations entre les administrations et acteurs concernés. Les exercices vont des interventions limitées à des interventions majeures, que nous avons appelé SONS (Spills of National Significance). En effet, l'un des problèmes que nous avons connus avec l'Exxon Valdez était que nous étions insuffisamment préparés à la prévention d'un accident majeur.
Un programme volontaire a été mis au point grâce aux forces gouvernementales avec des agences homologues qui ont des responsabilités en matière d'environnement. Le but était d'assurer l'intégration, la coopération et la coordination de tous les responsables d'intervention, à la fois au niveau des industriels et du gouvernement. Le coordinateur fédéral sur le terrain a des moyens d'intervention et l'autorité de mise en _uvre pour s'assurer que la partie responsable se chargera du nettoyage. Il a la capacité de prendre des arrêtés administratifs au titre de l'OPA 90 et de la loi sur la sécurité des ports et des voies maritimes de 1972. Il peut décider n'importe quelle action pour assurer la sécurité des ports et l'environnement.
Il a un accès immédiat à l'assistance technique, aux entreprises de nettoyage si la partie responsable n'est pas capable de se charger du nettoyage. Le coordinateur sur le terrain a la responsabilité de s'assurer que le travail est fait. Il a un accès immédiat également au super fonds et aux fonds fédéraux pour le financement d'hydrocarbures. Le super fonds est un montant qui est mis de côté pour faire face à des accidents, similaire au FIPOL. Le système facilite le remboursement et l'indemnisation des interventions, de l'expertise, de la technologie mise en place par les diverses agences fédérales. Il y a un équipement spécial prépositionné. Le coordinateur sur le terrain est chargé de la coordination des moyens fédéraux de confinement et d'élimination.
Comme je l'ai dit, nous avons des moyens prépositionnés tout le long des côtes : dix-neuf sites le long des côtes atlantique, pacifique et du Golfe du Mexique. De plus, on dénombre trois forces de frappe, celle de l'Atlantique, celle du Golfe du Mexique et celle du Pacifique, qui ont la même fonction, disposant d'un personnel hautement spécialisé qui peut venir renforcer des unités des Coast Guard afin d'augmenter leur capacité et leur expertise en ce qui concerne le fait de savoir quel équipement est le plus approprié pour un accident donné.
Nous allons en parler avec vous plus en détail, mais je voudrais vous montrer la structure de commandement. Nous avons les échelons responsables au niveau fédéral, puis les échelons au niveau de chaque Etat, puis, enfin, les échelons locaux. Ils forment ce que nous appelons un système de commandement en cas d'incident (Incident command system - ICS) qui associe directement la partie responsable, l'échelon fédéral et l'échelon fédéré.
L'OPA 90 a prévu un programme d'agrément des sociétés privées chargées du nettoyage (Oil spill removal organizations - OSRO), avec qui les transporteurs pétroliers sont tenus de souscrire des contrats d'assistance. Ce programme nous a permis d'établir un réseau de sociétés agréées capables de répondre sur toutes les façades maritimes à une pollution importante. Nous vérifions leur équipement et leur entraînement régulièrement.
Demain matin, au National Pollution Funds Center, vous entendrez une présentation plus détaillée sur les questions d'indemnisation, mais je voulais vous parler dès aujourd'hui de cette organisation, pour que vous puissiez mieux comprendre les relations entre financement et intervention.
Aux termes de l'OPA 90, nous avons un important fonds doté d'un milliard de dollars, l'Oil spill liability trust fund (OSLTF), avec, en son sein, des sommes plus modestes destinées spécifiquement au financement d'urgence des crises, des accidents critiques.
Pour ce qui est de l'application des dispositions répressives, la Coast Guard se charge des enquêtes et de la mise en application des lois américaines sur l'environnement maritime. Depuis la mise en _uvre de l'OPA 90, nous avons établi un programme de contravention car nous avons constaté que le volume de paperasserie administrative associé à chaque pollution était trop important. D'où la nécessité d'un programme permettant de faire face à des accidents mineurs. Une échelle adaptée de sanction a donc été établie dans le cadre de ce programme.
Voici un exemple précis de sa mise en _uvre.
Dans le cas de la compagnie de navigation grecque Anax International, les contraventions ont été très élevées, de l'ordre de 9,4 millions de dollars pour le déversement de 3 000 gallons de pétrole au large de San Fransisco. La Coast Guard a prélevé des échantillons de ce pétrole. Après avoir analysé le bateau qui était passé dans les parages de l'accident, notre laboratoire s'est chargé de l'analyse des échantillons. Nous avons pu faire une évaluation des « empreintes » de l'hydrocarbure et voir qu'il correspondait à celui du bateau.
Ces amendes se sont réparties ainsi : 2,5 millions de dollars pour violation du Clean water act ; 1,2 million de dollars destinés à couvrir les coûts d'enquête et de dépollution ; 5,5 millions de dollars pour la restauration des ressources naturelles.
Le capitaine du navire a été interdit dans les eaux américaines pour 3 ans et le responsable des machines a été condamné à 18 mois d'interdiction. Quant aux navires d'Anax, ils font l'objet pour 3 ans d'inspections particulièrement poussées lorsqu'ils se rendent dans les eaux américaines.
Capitaine Thomas GILMOUR : J'ajouterai encore deux éléments : le pétrolier a été arraisonné en haute mer par la Coast Guard aux termes de nos accords internationaux avec les Etats du pavillon ; nous nous adressons au Département d'Etat pour arraisonner les bateaux en haute mer après avoir obtenu l'accord de l'Etat du pavillon, Panama en l'espèce. Ce bateau avait quitté le port de San Francisco sans notifier l'accident. C'est pourquoi il y a eu pas mal de travail effectué en coulisse pour identifier le navire.
Lieutenant Mike PITTMAN : Autre exemple de cette action, la pollution en 1996 par le chaland North Cape à Point Judith, dans l'Etat du Rhode Island. Le règlement s'est monté à une valeur de 10 millions de dollars. Il est en cours. La compagnie Elkof a déjà payé 24,5 millions de dollars pour le nettoyage, les amendes et les dommages, tandis qu'un plan de restauration des ressources d'un coût de 28,3 millions de dollars est en cours d'étude.
M. le Président : Ce n'est pas fini ?
Lieutenant Mike PITTMAN : Cela prend longtemps. Vous verrez lors de vos discussions de demain avec le National Pollution Funds Center le dossier lui-même, la question de la responsabilité et la procédure de traitement de ce cas précis. Le remboursement des dépenses de la Coast Guard pour leur intervention est un long processus. Parfois, la négociation dure très longtemps.
Autre exemple : celui de la société Royal Caribbean Cruises qui avait fait des fausses déclarations concernant le déversement illégal d'hydrocarbures. Il ont reçu une pénalité de plus de 9 millions de dollars. Ils ont tenté de négocier l'amende à la baisse, mais ont finalement accepté de payer 18 millions de plus après avoir négocié dans le cadre d'une accusation portant sur vingt et une infractions.
Capitaine Thomas GILMOUR : Dans la première présentation, le lieutenant Pierro vous a parlé des missions multiples de la Coast Guard. Cette pollution d'hydrocarbures a été détectée par les avions de la Coast Guard lors d'une mission de contrôle dans les Caraïbes, à l'aide de caméras infrarouges dans les eaux internationales. Un grand nombre de crimes commis le sont dans la zone économique des Etats-Unis. Et les membres de l'équipage mentent souvent à la Coast Guard au sujet de ce qui a été fait. Nous avons pu tirer profit d'un avion qui n'était pas en mission de sécurité maritime. Mais puisque la Coast Guard est multi-missions, nous avons rapidement pu tirer avantage des informations fournies par cet avion qui effectuait une patrouille anti-drogue.
Lieutenant Mike PITTMAN : Je pourrais ajouter qu'il y a un excellent niveau de collaboration en matière de formation et de sensibilisation des pilotes afin qu'ils comprennent les questions importantes que doivent résoudre les responsables de la protection de l'environnement.
Nous avons des partenariats informels avec des industries qui font voler des avions dans les zones de production pétrolière offshore. Ils travaillent en collaboration avec nous, nous leur donnons des pistes qui permettent d'identifier des parties responsables.
Nous entretenons un partenariat avec quatre organisations, l'Agence de protection de l'environnement, l'Institut américain du pétrole, l'OMI et l'International petroleum industry environmental conservation association (IPIECA), pour mettre sur pied une conférence internationale sur les pollutions par hydrocarbures, encourager la recherche d'échange d'informations scientifiques et techniques et traiter des questions pratiques liées à la protection de l'environnement.
Pour résumer, les pollutions ont baissé de 50 % entre 1994 et 1997, nous sommes passés à un niveau de 1,5 gallon déversé par million de gallons transportés. Il est difficile de quantifier avec précision l'incidence de l'OPA 90 sur cette amélioration, mais nous avons la conviction que les efforts engagés en matière de prévention ont porté beaucoup de fruits. Le coût et les efforts en matière de responsabilité civile ont permis, dans une grande mesure, de réduire le nombre de pollutions.
Notre préparation pour lutter contre les pollutions a atteint un haut niveau en matière de matériel et d'expérience du personnel. Notre personnel et nos moyens sont bien répartis, bien entretenus.
Nous avons affiné nos mécanismes financiers et de coût afin d'améliorer notre capacité à gérer des pollutions importantes. C'était un grand défi, mais nous avons progressé sur de nombreux fronts grâce à des partenariats actifs avec le secteur privé, en matière de prévention - ce dont vous avait parlé M. Du Pont - et en matière de préparation et de réponse d'intervention. Il est moins cher de prévenir que de répondre, mais nous devons être en mesure de répondre en cas de pollution.
Je vous remercie.
M. le Rapporteur : J'ai de nombreuses questions, mais peut-être vaut-il mieux entendre tous vos exposés...
Une première série de questions concerne les exemples que vous avez donnés à la fin. Je pense en particulier au bateau grec. Tous ces exemples concernent ce que nous appelons des dégazages ou des déballastages ? Il ne s'agit pas d'accident ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Effectivement, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des actes volontaires, suivis de destructions intentionnelles de preuves.
Si vous le souhaitez, nous pourrons vous donner une synthèse de ces accidents.
M. le Rapporteur : Pour bien comprendre, qui a fixé le montant de l'amende ?
Capitaine Thomas GILMOUR : A un moment donné, une affaire est assez importante, donc, la Coast Guard engage la procédure. Quand nous constatons que c'est très important, nous travaillons en collaboration avec le Département de la justice pour traduire l'affaire en justice. Dans le cas du pétrolier de San Francisco, un règlement entre le Département de la justice et les parties responsables est intervenu avant le début du procès.
M. le Rapporteur : Existe-t-il un montant d'amende minimum ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Oui, dans le cadre de l'OPA 90 pour le déballastage, pour les infractions volontaires. Mais dans le cas précité, le responsable a payé beaucoup plus.
Lieutenant Mike PITTMAN : Ensuite, il y a d'autres lois, pas seulement l'OPA 90, qui étaient concernées, car il y avait toute une panoplie d'infractions, très nombreuses.
M. le Rapporteur : Techniquement, êtes-vous à même d'identifier l'origine du pétrole déversé et juridiquement capable de le prouver, en dehors des flagrants délits, y compris de nuit ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Nous avons ce que nous appelons des « empreintes digitales » de pétrole. Dans le cas du dégazage au large de San Francisco, il s'agissait de fioul provenant provenait d'une société qui fournissait un certain nombre de navires à San Francisco. En connaissant le moment du déversement, l'endroit et la destination de tous les navires qui transportaient ce pétrole, nous avons pu déterminer quel navire se trouvait dans la région au bon moment. Malheureusement pour les parties responsables, le déversement datait de trois jours auparavant et il était facile à retrouver.
Mais nous savions quelle en était la source et notre technique d'empreinte de pétrole a pu servir dans bon nombre d'affaires, une dizaine ou une vingtaine.
Lieutenant Mike PITTMAN : Après la promulgation de l'OPA 90, nos experts se sont réunis pour trouver une méthode d'identification des produits. Nous avons parcouru la procédure avec notre centre de recherche et de développement. Certains de ces fonctionnaires travaillent toujours pour la Coast Guard. Cela a pris du temps pour établir cette méthode, mais une fois établie, nous l'avons appliqué avec succès dans de nombreux cas.
Capitaine Thomas GILMOUR : Le laboratoire se trouve à Groton dans le Connecticut. Il dépend de la Coast Guard.
M. le Président : Vous avez évoqué tout à l'heure des accords qui pouvaient exister avec des pays d'origine des bateaux dans le cadre de l'arraisonnement que vous pouvez faire en haute mer. Pourriez-vous préciser cet aspect ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Dans le cas de cet arraisonnement ?
M. Jean-Michel MARCHAND : Ce que demande le président, c'est ce qui vous permet d'aller arraisonner un navire en haute mer. Quels sont les accords avec les Etats du pavillon que vous évoquiez, que vous avez établis ?
M. le Rapporteur : Pour compléter, jusqu'à quelle distance pouvez-vous aller ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Cet arraisonnement s'est produit dans les eaux internationales et nous avons reçu l'accord de l'Etat du pavillon d'arraisonner le bateau en haute mer. Nous avons un certain nombre d'accords en place pour la lutte contre la drogue et l'immigration illicite. Il n'en existe pas pour le pétrole ; mais nous avons travaillé avec le Département d'Etat et avec l'Etat du pavillon afin d'arraisonner ce bateau ; nous avons fini par recevoir l'autorisation de l'Etat du pavillon.
M. le Président : Qu'est-ce qu'un spiller ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Un spiller est l'entreprise, la personne morale qui déverse le pétrole, la société pétrolière, la société du navire.
Lieutenant Mike PITTMAN : Comme vous l'avez remarqué, la dernière fois que vous avez posé cette question, je n'ai pas donné une réponse directe. C'est au coordinateur fédéral sur le terrain qu'il appartient de désigner un responsable. Le coordinateur travaille en concertation avec les autorités nationales pour obtenir les avis et expertises nécessaires. Mais la décision finale est prise par le coordinateur fédéral sur place.
Capitaine Thomas GILMOUR : La question n'est pas facile.
M. le Rapporteur : C'est une question très importante pour nous.
Capitaine Thomas GILMOUR : J'étais capitaine en poste à New York. J'ai eu affaire à des pollutions par des navires battant pavillon américain et d'autres. Typiquement, du point de vue du navire, l'armateur est la partie responsable, dans la grande majorité des cas qui me viennent à l'esprit. Cela étant, j'ai travaillé en collaboration efficace avec les armateurs et les propriétaires d'installation pétrolières.
Normalement, la première question que pose la presse est de savoir qu'elle est la destination du pétrole, donc on identifie immédiatement cette personne. Dans pratiquement tous les cas, cette personne accepte de travailler avec nous.
Certains Etats disent que c'est le propriétaire de la cargaison qui est responsable. L'Etat de Californie, par exemple, responsabilise le propriétaire de la cargaison.
M. Aimé KERGUERIS : En ce qui concerne l'exemple du Royal Caribbean, il a été dit qu'il y avait eu vingt et une infractions et que l'amende avait été doublée pour fausse déclaration. Est-ce que cela devait être une déclaration après accident ou au moment de l'enquête ? Vous avez parlé de l'équipage. Sont-ce les membres de l'équipage ou le commandant du bateau ? S'agit-il de textes issus de l'OPA 90 ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Je dois dire que dans l'affaire du Royal Caribbean, une fois que nous avons eu ouvert la boite de Pandore, tout le monde était impliqué. Quand nos inspecteurs ont commencé à poser des questions, ils ont fait des fausses déclarations.
M. le Président : Etait-ce du pétrole de propulsion ?
Capitaine Thomas GILMOUR : C'étaient des déchets, du déballastage.
Mais en contrôlant d'autres navires de la même société, nos inspecteurs ont trouvé de fausses déclarations qui avait été faites dans bon nombre d'autres cas.
M. David DU PONT : Si vous permettez, la réponse était qu'il évacuait de l'huile de ballast. En fait, il déballastait illégalement en mer. Les membres de l'équipage ont fait des fausses déclarations pour appuyer un dossier de bord fantaisiste quant au relevé des opérations de déballastage. Leur activité n'était pas conforme aux règlements touchant les mesures de prévention.
M. le Président : Les ports américains sont-ils tous équipés en stations permettant de recueillir les déchets du déballastage ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Il existe des installations dans tous les ports principaux.
M. le Président : Donc, vous pouvez dire que si les navires doivent tous utiliser ces stations de déballastage, aucun navire ne peut vous répondre : « Je veux bien utiliser une station, mais il n'en existe aucune ! »
Capitaine Thomas GILMOUR : Dans la plupart des cas, non. Dans la majorité des ports principaux, il existe des sociétés qui font venir des barges sur les flancs des bateaux pour le déballastage.
M. le Rapporteur : Ce n'était pas du déballastage ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Non, c'était un accident entraînant un déversement du pétrole transporté.
M. le Rapporteur : Je reste sur le problème du déballastage, je ne parle pas des accidents, dans le cadre de l'OPA 90, quel est le niveau minimum de l'amende pour faute de déballastage ?
Lieutenant Mike PITTMAN : Je peux vous donner la page de la loi qui y fait référence. Je vous l'apporterai au déjeuner.
M. le Rapporteur : C'est donc l'OPA qui prévoit cela ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Oui.
M. le Rapporteur : Les amendes font-elles l'objet de recours en justice ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Bien sûr.
M. le Rapporteur : Avez-vous une statistique du rapport entre les constatations et les compagnies qui ont réellement payé l'amende ?
Lieutenant Mike PITTMAN : Je crois que le National Pollution Funds Center serait mieux placé que nous pour vous fournir cela.
M. le Rapporteur : Je le demande car en France, un seul a payé sur seize. Nous ne devrions peut-être pas le dire devant vous... Je n'ai pas bien compris l'affaire des « empreintes » pétrolières. Souvent, les pollueurs contestent la relation entre le pétrole découvert et celui transporté par le bateau. Il semble que votre système d'empreintes, cette banque des empreintes de pétrole soit un outil extrêmement intéressant.
Lieutenant Mike PITTMAN : Le laboratoire vous montre la répartition des hydrocarbures sur toute la palette des constituants du fioul. On dirait une empreinte digitale électronique. Même après les effets de la météo, nous avons établi que la comparaison est toujours possible.
M. le Rapporteur : Quand il s'agit d'un pétrole de propulsion, cela peut venir de la même production pour plusieurs bateaux. Comment fait-on la différence ?
Lieutenant Mike PITTMAN : De ce point de vue, je crois que le capitaine Gilmour a dit que même si le pétrole a été vendu à plusieurs navires, il savait, par recoupement, que ce navire était à l'endroit de la pollution à tel moment, l'information nous était venue d'une installation pétrolière de la baie de San Francisco.
M. René LEROUX : Tout à l'heure, dans vos propos liminaires, vous avez dit que vous ne traitiez pas tous les navires de la même manière, que vous les contrôliez notamment en fonction des pavillons, éventuellement de la société de classification, du propriétaire, etc. Au niveau du contrôle, avez-vous établi chez vous une classification des sociétés de classification et des pavillons ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Nous entrerons dans le détail du contrôle au cours de l'intervention suivante.
M. Jean-Michel MARCHAND : Pour compléter la question de notre rapporteur sur l'amende minimum encourue, pouvez-vous nous donner aussi le coût moyen d'une opération de déballastage dans un port, pour pouvoir déterminer si l'amende est vraiment dissuasive ?
Deuxième question : pouvez-vous nous parler des différents fonds d'indemnisation dont il a été question ? De quelle hauteur sont-ils ? A qui sont-ils destinés ?
Lieutenant Mike PITTMAN : Je crois qu'il vaut mieux poser cette dernière question aux personnes que vous verrez demain.
Capitaine Thomas GILMOUR : Le National pollution funds center gère deux fonds. L'un est destiné au pétrole, l'autre aux produits chimiques et dangereux. Ils vous diront comment fonctionne chacun d'eux.
M. le Rapporteur : Pour changer de sujet, la gestion de tous les matériels anti-pollution est-elle entièrement dirigée par la Coast Guard ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Par « tous les matériels », vous voulez dire les équipements permettant de répondre à une pollution ?
M. le Rapporteur : Oui.
Capitaine Thomas GILMOUR : Il existe deux types de matériels. Le matériel national que la Coast Guard gère dans le cadre de la National Strike Force. Mais la majorité des matériels se trouvant aux Etats-Unis est la propriété de sociétés privées de dépollution.
M. le Président : Donc, vous louez des matériels ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Non, nous dépendons surtout des sociétés privées pour fournir les matériels. C'est la personne responsable qui les engage. Il faut les identifier dans les plans de réponse.
Comme le lieutenant Pittman le disait, nous classifions et agréons les organisations de réponse aux pollutions pétrolières. Ce sont des entreprises privées. Elles doivent être identifiées sur le plan de lutte antipollution présent à bord et que nous devons approuver.
M. le Président : Peut-on préciser la question ? Une catastrophe se produit sur l'une des côtes des Etats-Unis. Il faut immédiatement mettre en place un certain nombre d'outils évitant au pétrole d'aller dégrader la côte, des barrages, par exemple. A qui appartiennent ces barrages ?
Capitaine Thomas GILMOUR : La Coast Guard possède des barrages, ainsi que les sociétés privées. Dernièrement, nous avons eu un exercice en Alaska, qui était similaire à l'Exxon Valdez, portant sur ce que nous appelons une pollution d'importance nationale. Dans un tel cas, nous déployons tous les moyens dont nous disposons, du secteur privé comme du secteur public.
M. le Président : Qui fait appel aux moyens du secteur privé ?
Capitaine Thomas GILMOUR : En cas de réponse normale, ce sont les parties responsables, l'armateur, qui ont établi un contrat de nettoyage avec les OSRO. Tant que tout se passe bien, le coordinateur fédéral sur le terrain et la Coast Guard n'interviennent pas.
En revanche, si cela se passe mal, la Coast Guard a l'autorité de reprendre la responsabilité de la dépollution. Dans ce cas, tous les paiements destinés au Fonds, tout ce que paye la partie responsable, sont triplés. Donc, le responsable de la pollution, le spiller, n'a pas intérêt à faire intervenir la Coast Guard.
Lieutenant Mike PITTMAN : Nous avons également des moyens de réponse qui comportent tous les matériels adaptés, en particulier pour le pétrole, dans tout le pays.
Dans chaque district, c'est-à-dire le niveau régional dans notre organigramme, il y a la liste des ressources disponibles dans cette région. Ceux-ci sont à la disposition du coordinateur fédéral sur place qui doit assister le responsable.
Capitaine Thomas GILMOUR : Généralement, le matériel qui appartient à la Coast Guard sert à des cas très importants, pour lesquels nous avons passé des marchés avec des entreprises privées.
M. Aimé KERGUERIS : Cela veut-il dire que vous donnez un agrément à un bateau ? Que vous lui demandez une provision de réparation d'accident ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Oui, il doit également nous montrer son plan d'intervention.
Lieutenant Mike PITTMAN : Voici quelques petits cadeaux pour vous : un guide intitulé Finance and Resource Management Field Guide, et un autre intitulé Field Operations Guide, dans le cadre de l'ICS.
Capitaine Thomas GILMOUR : En outre, vous aurez le résumé des dix dernières années d'activité depuis l'accident de l'Exxon Valdez, que la Coast Guard établit chaque trimestre. Et nous vous donnerons aussi une liste des sites internet de la Coast Guard dont les informations pourraient vous intéresser.
Capitaine Thomas GILMOUR : Pour prévenir la pollution, le contrôle des navires étrangers fait partie de notre programme de contrôle par l'Etat du port, programme fédéral. Lorsque nous parlons de régime de contrôle, nous en avons en fait deux.
Tout d'abord, l'inspection faite par l'Etat du pavillon. C'est le programme d'inspection destiné à son propre pavillon. L'autre, c'est le contrôle de l'Etat du port, durant lequel le port inspecte les navires étrangers. Je vous fais passer un document sur le programme et vous trouverez également la page web de notre programme d'inspection de l'Etat du port. Il contient notre dernier rapport annuel. Il énumère tous les Etats d'origine qui sont visés, les sociétés de classification, les exploitants et les armateurs. Vous y trouverez beaucoup d'informations si vous avez des questions à ce sujet.
Lieutenant Joseph COST : C'est la Coast Guard qui effectue ce deuxième contrôle ; nous l'effectuons au titre de notre programme de contrôle de l'Etat du port. La prévention de la pollution ne constitue qu'une partie de notre programme d'inspection. Nous inspectons également le système de sauvetage, de lutte contre l'incendie et de sécurité de la navigation. Aujourd'hui, je parlerai essentiellement de la prévention de pollution.
Voilà la méthode qu'utilise la Coast Guard pour prévenir des pollutions accidentelles des navires. Nous procédons à des visites annuelles et à des inspections. Nous nous assurons que les navires sont en conformité avec les accords internationaux. Nous inspectons la qualification et l'entraînement des équipages, le matériel spécialisé et les plans d'urgence. Dans le cadre de ces inspections et visites annuelles, nous examinons les pétroliers, les chimiquiers, les navires marchands, les chalands, les transports de passagers.
Pour la prévention de la pollution, nous examinons plus précisément les séparateurs d'hydrocarbures et le système d'alarme, les pompes de citerne des ballasts, les tuyaux, les appareils de surveillance de déversement d'hydrocarbures par-dessus bord, les tuyaux et les vannes de cargaison, le matériel de confinement des petites pollutions et l'éclairage des ponts. Nous nous intéressons également aux moyens de transmissions. C'est très important pour nous, pour le déchargement et la réception des liquides en vrac. Les intervenants doivent pouvoir communiquer entre eux. Nous inspectons les dispositifs de fermeture de pompe, les dispositifs d'urgence, les procédures de transferts et les modifications non autorisées.
Nous inspectons également la conformité aux accords internationaux. Nous examinons le certificat MARPOL. Les documents exigés par l'annexe II de MARPOL pour les navires nous indiquent quelles sont les cargaisons à bord du navire. Nous examinons également le registre des hydrocarbures des navires, le lieu et date de chargement, de déballastage. Tout cela doit être consigné dans le livre de bord.
Nous examinons également la compétence et les qualifications des marins. Pour les navires battant pavillon étranger, nous examinons le respect du règlement STCW V/I. La Coast Guard vérifie les certificats des marins américains.
Pour les équipements et dispositions spécifiques - c'est ce que la Coast Guard exige au-delà de MARPOL - pour un navire-citerne, il faut des équipements de décharge, pour le nettoyage de petites pollutions ou de petits déversements à bord. Une partie de cet équipement comprend des solvants, des pelles, des conteneurs de déchets récupérés et des émulsifiants. Nous exigeons également une alarme de déversement, ainsi que des systèmes de contrôle des chalands. Ces systèmes de contrôle exigent des ancres qui sont un moyen de récupérer le chaland si le remorqueur se détache.
Nous examinons également les plans du navire qui sont requis, à savoir : le plan d'urgence (Shipboard Oil Pollution Emergency plan - SOPEP) et le plan d'intervention des navires (Vessel Response Plan - VRP). Tous les navires exploités dans les eaux américaines sont obligés d'être munis de ces deux plans à bord. Nous les utilisons surtout pour des lieux spécifiques où les navires opèrent. Il faut un point de contact en cas d'accident et de pollution ; il faut qu'ils prouvent qu'il ont accès à du matériel de nettoyage.
Capitaine Thomas GILMOUR : Cela vaut pour les navires-citernes, les chalands et les navires de passagers.
M. le Rapporteur : Les navires de cargaisons normales ont-ils besoin d'un document, un accord avec une société de dépollution ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Oui, dans le plan d'intervention, ils doivent avoir des contrats. L'assurance, c'est différent. Cela ne fait pas partie du plan d'intervention. Les SOPEP concernent les navires non pétroliers, les cargos ; ils ne sont pas aussi complets que les plans d'intervention contre la pollution et que ceux destinés aux opérateurs de matériels.
Lieutenant Joseph COST : Finalement, nous appliquons aussi MARPOL. Nous avons le registre écrit, les livres de déchargement sur quai. Nous examinons le plan de gestion de l'élimination des déchets. Nous regardons s'ils ont un incinérateur. Nous contrôlons les décharges des plastiques. Et nous exigeons qu'il y ait des panneaux indiquant comment les déchets sont éliminés.
M. le Rapporteur : Combien de temps passez-vous pour inspecter un navire ? Combien de personnes utilisez-vous pour une inspection annuelle ?
Lieutenant Joseph COST : Pour l'inspection annuelle, il nous faut deux ou trois inspecteurs et un minimum de 5 heures.
M. le Rapporteur : Pour les bâtiments battant pavillon étranger. Mais pour l'inspection annuelle des navires battant pavillon américain ?
Lieutenant Joseph COST : Trois ou quatre inspecteurs, durant deux jours environ.
M. le Rapporteur : Lors de la visite des bateaux étrangers, vos inspecteurs descendent-ils dans le ballast ?
Lieutenant Joseph COST : Non.
M. le Rapporteur : Ils ne contrôlent pas le ballast ?
Lieutenant Joseph COST : Non, nous observons les opérations de déballastage.
M. le Rapporteur : Ma question était mal formulée. Dans ces contrôles, vérifiez-vous la solidité des coques et des réservoirs, les structures du navire ?
Lieutenant Joseph COST : Nous inspectons l'ensemble. Pour les pétroliers, nous inspectons une citerne centrale et nous assurons de son intégrité.
Pour les bateaux battant pavillon américain, nous menons une inspection bien plus poussée de la coque. Cela relève, de notre point de vue, de la responsabilité de l'Etat du pavillon.
M. le Rapporteur : Peut-on parler maintenant ici de vos relations avec les sociétés de classification ? Avez-vous accès avant l'inspection aux informations des sociétés de classification ?
Lieutenant Joseph COST : Non, mais nous avons des dossiers complets indiquant si le navire est déjà venu. Dans ce cas, nous avons des archives informatiques sur lui, récapitulant les informations tirées d'inspections antérieures. Mais nous ne voyons pas le certificat de classification tant que nous ne sommes pas montés sur le navire.
M. le Rapporteur : Mais, sur le navire, vous le voyez ?
Lieutenant Joseph COST : Absolument.
M. le Rapporteur : Avez-vous un avis sur les sociétés de classification ? Y a-t-il une hiérarchie pour vous ? Je ne parle pas des sociétés de classification américaines, mais de celles de navires battant pavillon étranger.
Capitaine Thomas GILMOUR : Sur le site web que je vous ai indiqué, nous n'avons pas d'avis sur les sociétés de classification, mais nous avons des faits. Nous avons toutes les sociétés de classification réparties en quatre catégories, en fonction du nombre de points que nous leur assignons : 0, 1, 3 ou 5 points. Les meilleures ont zéro. Vous pourrez voir cela.
En général, l'IACS est, à notre avis, plus performante, mais même au sein de l'IACS, on trouve des sociétés plus ou moins bonnes. Je vous encourage vivement à visiter le site web et à consulter les pages concernant les sociétés de classification, les pavillons et les armateurs. Vous pourrez même trouver une page sur l'Erika.
Lieutenant Joseph COST : Les sociétés de classification sont analysées en fonction du nombre de détentions subies par les navires aux Etats-Unis. Nous ne visitons pas les sociétés de classification, nous les évaluons.
Capitaine Thomas GILMOUR : Par la voie de l'OMI, du sous-comité de mise en _uvre de l'Etat du pavillon, les rapports proviennent des MOU de Tokyo et de Paris et des Etats-Unis. Ils fournissent des données concernant les détentions dans les pays, sur des navires spécifiques. Vous pouvez trouver des différences mais, globalement, les mauvaises performances sont toujours le fait des mêmes.
M. le Rapporteur : Vous arrive-t-il d'interdire la venue de bateaux dans les ports américains ? Par exemple, vous est-il arrivé de refuser l'accès à un bateau qui a été déjà retenu deux ou trois fois et qui annonce son arrivée? Bref, dans quel cas refusez-vous l'accès à vos ports ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Nous n'avons pas interdit un quelconque navire. Cependant, nous montons à bord de certains navires avant qu'ils n'entrent dans nos ports.
M. le Rapporteur : Quels navires ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Les navires relevant de la priorité n° 1. Nous avons une matrice de l'Etat du port, une matrice de gestion des risques qui classifie les navires en fonction de priorités qui vont de 1 à 4. Les navires de priorité 1 sont arraisonnés avant leur entrée dans le port. Nous essayons de monter à bord de tous les navires relevant de la priorité 1 ou 2, lorsqu'ils se trouvent au port.
Nous le faisons en fonction de l'armateur, de la société de classification de l'Etat du pavillon, de l'historique du bateau et en fonction de la fréquence de ses visites.
Nous voulons renforcer notre matrice de l'Etat du port avec un programme de qualité des navires, ce qui permettra de réduire le nombre de montées à bord sur des navires qui satisfont à certains critères. Avec les efforts que nous nous épargnerions en n'inspectant pas ces navires, nous maximaliserons nos efforts pour les autres navires, ceux qui présentent des risques. Ce programme sera mis en place jusqu'en 2001.
M. Aimé KERGUERIS : Quand vous contrôlez un bateau, avant qu'il soit entré dans le port et que le bateau n'est pas en état, que se passe-t-il ? Avez-vous dans vos ports des bateaux « ventouses », fixés à quai depuis plusieurs mois, qui ne sont pas en état de repartir ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Nous avons eu des navires que nous avons renvoyés du port, tout simplement pour non-conformité.
M. le Rapporteur : Vous les renvoyez ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Oui, parce qu'ils ne peuvent pas résoudre leur problème ici. Nous leur disons de ne pas revenir tant qu'ils ne sont pas conformes au code ISM. Le code de gestion de sécurité internationale est une initiative récente de l'OMI, mais il ne s'applique pas encore aux navires marchands, pas avant 2002, seulement aux navires pétroliers et aux bateaux de passagers.
Normalement, nous retenons les navires au port le temps que le problème soit réglé. Une fois celui-ci réglé, ils peuvent repartir. Cependant s'ils sont en si mauvais état qu'ils ne peuvent pas repartir, nous les retenons en attendant qu'ils aient effectué les réparations nécessaires ou pris les dispositions nécessaires en vue de réparations. Là, nous travaillons de près avec l'Etat du pavillon et la société de classification pour être sûrs que les réparations sont bien faites.
M. le Président : Si le bateau est apte à prendre la mer, qu'il ne présente pas de risque de naufrage, vous le renvoyez ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Normalement, si le bateau répare les problèmes, il a l'autorisation de rentrer dans les ports américains pour prendre en charge sa cargaison. Là où il y a des problèmes, où nous avons décelé des problèmes sur les navires qui ont invalidé la certification ISM - des problèmes que l'on n'a pas réglés rapidement, car ils font partie de la gestion d'ensemble du bateau - ils n'ont pas le droit d'accéder aux ports américains avant d'avoir un certificat valable qui est généralement émis par les sociétés de classification.
M. le Président : En France, nous avons dans plusieurs ports des navires poubelles, régulièrement. C'est un véritable problème. Le port du Havre en a eu un qui est resté pendant quatre ans. Avez-vous actuellement dans un port américain de tels navires battant pavillon étranger ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Nous avons eu quatre ou cinq navires qui ont été abandonnés aux Etats-Unis. Nous avons créé un système qui permet de les vendre aux enchères. Le premier cas a demandé six mois, mais les résultats s'améliorent au fur et à mesure. Dans le dernier cas, nous avons mis deux mois.
M. le Président : Que devient l'équipage dans un tel cas ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Normalement, l'équipage est rapatrié par la société. Parfois, nous avons été obligés de passer par le Département d'Etat et les ambassades.
M. Aimé KERGUERIS : Si un bateau reste plusieurs mois, que vous le mettez aux enchères, mais que la somme de la vente ne suffit pas, intervenez-vous auprès de l'Etat du pavillon ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Nous essayons d'intervenir après de l'Etat du pavillon dans tous les cas. Mais la situation que vous décrivez ne s'est pas encore présentée.
Vous avez plus de questions sur le contrôle par l'Etat du port que je ne supposais. J'ai un exposé sur le sujet que j'avais préparé pour une série de conférences aux Etats-Unis et à l'étranger. Je vous en donnerai un exemplaire. J'espère que cela répondra à un certain nombre de vos questions.
Lieutenant Commander Tim DEAL : Je vous parlerai des mesures de gestion de crise mises en place par la Coast Guard.
Pour commencer cet exposé, je m'appuierai sur un cas précis. Il y a quatre ans, en 1996, un porte-conteneurs a déversé 80 000 gallons de pétrole lourd dans la baie de San Francisco. Une cinquantaine de personnes ont participé à l'intervention. Vous pouvez garder cette affaire à l'esprit car lorsque je parlerai du système de réponse, j'y ferai allusion plusieurs fois.
Nous avions deux défis à relever. Le premier était politique. Nous étions face au maire de San Francisco, dont la ville a été touchée par le pétrole, et aux maires des communes adjacentes ; les pêcheurs ne pouvaient plus pêcher ; les porte-conteneurs ne pouvaient plus accéder au port ni le quitter ; il fallait fermer les parcs nationaux de la baie de San Francisco ainsi que leurs plages et certaines marinas.
L'autre défi était celui de perception de l'événement par l'opinion publique. La Californie est un Etat très conscient des problèmes écologiques. De nombreuses pressions s'exercent sur la communauté. Les touristes viennent de très loin pour visiter la ville de San Francisco et cette affaire entraînait une mauvaise publicité.
Toutes ces pressions sont externes à l'équipe chargée de dépolluer, mais ce sont des pressions réelles, auxquelles il faut faire face.
Il y avait aussi des défis internes, notamment en termes de moyens. Premièrement, les ressources en personnels et en matériels ont vite été épuisées. Il a fallu faire venir des gens d'autres Etats. Il a fallu faire vite pour éviter toute propagation. Cela demandait des moyens financiers.
Le deuxième défi interne, c'était le commandement unifié. En l'occurrence, il était composé d'un capitaine de la Coast Guard, d'un représentant de l'Etat de Californie et du pollueur, qui était un superintendant qui ne s'était jamais occupé de sa vie d'une telle situation. Subitement, il s'est retrouvé au sein de cette instance.
L'autre défi interne, ce sont les autres agences fédérales qui se présentent et demandent à participer. A vous de décider ce qu'il faut en faire. Vous ne pouvez pas les ignorer et il vous faut profiter de leurs talents, dans la mesure du possible. La raison pour laquelle la Coast Guard est adaptée, c'est qu'elle est parfaitement multi-missions. Il y a eu toute une gamme d'organismes qui ont répondu. Il nous fallait avoir des systèmes qui permettent d'agir.
Le système de commandement en cas d'accident (ICS) permet à la Coast Guard de traiter l'ensemble des pollutions. Celle de San Francisco était constituée par des produits dangereux.
Il y a cinq domaines fonctionnels dans notre système. Au sommet, le commandement. Cela peut être un commandement unifié si plusieurs agences sont impliquées ou un seul commandement, au sommet.
Pour appuyer ce commandement en chef, il y a un volet opérationnel. C'est une tâche tactique. Il sont sur le terrain. Ils dépolluent, vont éteindre les incendies, sont là pour appuyer ces opérations.
Les opérations s'occupent du présent ; la planification s'occupe de l'avenir, car il faut les gens immédiatement pour répondre le plus rapidement possible. Enfin, il existe une cellule logistique et une cellule financière.
M. le Rapporteur : Cela, c'est depuis l'OPA ?
Lieutenant Commander Tim DEAL : C'est cela.
Donc, logistique et financement ont permis aux effectifs opérationnels d'être plus efficaces car ils peuvent dialoguer sur place. Le fait que les fournisseurs logistiques soient dans la même salle que les responsables opérationnels a grandement amélioré leur efficacité.
Un système de commandement, doit s'articuler sur des principes de base tout à fait sains. Dans l'unité d'une chaîne de commandement, tout le monde sait à qui il doit répondre en amont et en aval. En cas d'urgence, c'est primordial.
Ensuite, il y a la souplesse organisationnelle. Vous créez l'organisation en fonction de l'accident et vous n'utilisez que ce dont vous avez besoin.
D'un point de vue technique, il faut également, lorsque vous réunissez un certain nombre d'agences, qu'elles parlent le même langage.
Pour la communication intégrée, dans le cas de San Francisco, regrouper des gens éloignés de 15 ou 20 km tout autour de la baie était difficile. Pour que la réponse fonctionne, il fallait qu'ils puissent parler ensemble. Le système de commandement était parfaitement conçu pour cela. Mais quand vous êtes fatigué, que vous avez faim, il est facile de s'égarer. Il faut que chaque responsable s'occupe de sept personnes au maximum.
Enfin, il y a un plan d'action en cas d'accident. J'en parlerai tout à l'heure.
M. le Rapporteur : Le responsable est un responsable de la Coast Guard qui est nommé et qui a l'autorité de fait sur tous les services, y compris sur les services qui ne sont pas les services directs de la Coast Guard, comme les finances et l'administration ?
Capitaine Thomas GILMOUR : La Coast Guard est au sommet du commandement, lequel peut être unifié. Il y a la participation du spiller et de l'Etat fédéré, mais ces trois éléments s'occupent de tout ce qui est en dessous. Ils essaient de travailler en équipe. Normalement, cela se passe ainsi. Mais la Coast Guard a toujours la maîtrise ultime de la gestion de l'accident.
Ce n'est pas toujours facile, tout le monde n'a pas les mêmes priorités. Mais nous avons suffisamment utilisé ce système pour savoir qu'il fonctionne.
M. le Rapporteur : Il y a une relation que je ne comprends pas très bien. C'est celle existant entre ce dispositif et celui que l'on voyait sur la pyramide de planification. C'est la même chose ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Non, là, c'est l'équipement de dépollution sur place. Il parle de l'équipement régional.
Lieutenant Mike PITTMAN : C'est le même dispositif qu'avec la pyramide. C'est la même chose.
M. le Rapporteur : Qui est le FOSC ? C'est lui qui commande ?
Lieutenant Mike PITTMAN : Oui. Ces deux représentations sont liées en effet. Le schéma montre la répartition du commandement unifié. Le coordinateur fédéral est l'officier de la Coast Guard.
Lieutenant Commander Tim DEAL : Oui.
La raison pour laquelle je vous montre cela est que nous avons parlé d'un commandement intégré. Mais en bas, ce n'est plus unifié. Vous pouvez avoir des fonctionnaires des Etats fédérés qui travaillent également dans les opérations dans le cadre de la Coast Guard, mais ce n'est pas unifié.
M. le Rapporteur : Cela veut dire que chacun fait ce qu'il a à faire.
Lieutenant Commander Tim DEAL : Absolument.
M. le Rapporteur : Par comparaison, cela veut dire que nos plans ORSEC seraient dirigés par les amiraux. Cela rejoint la proposition qui nous a été faite sur le préfet maritime. C'est une question importante pour nous.
Dans le cas d'une crise comme celle de San Fransisco, le FOSC est un membre de la Coast Guard.
Capitaine Thomas GILMOUR : C'est cela.
M. le Rapporteur : Il est à San Francisco quand la crise arrive ; s'il a besoin de moyens, c'est lui qui déclenche le processus ?
Lieutenant Commander Tim DEAL : Il se passe deux choses : d'une part, le spiller doit répondre avec le matériel et les ressources humaines ; d'autre part, la Coast Guard va fournir d'autres matériels ou d'autres ressources humaines. Ensemble, ils dépolluent, en mer et à terre.
M. le Rapporteur : Si l'Etat de Californie ou le maire n'est pas d'accord avec la manière de faire, c'est le FOSC qui décide au bout du compte.
Lieutenant Commander Tim DEAL : Cela n'arrive jamais.
M. le Rapporteur : Prenons un exemple. Vous êtes le FOSC et vous voulez avoir les pompiers de Californie. Vous avez le droit de leur demander, de l'exiger.
Lieutenant Commander Tim DEAL : Non. Si l'on prend la décision dans le cadre du commandement unifié, le responsable fédéral, à savoir la Coast Guard, doit s'adresser au représentant de l'Etat.
M. le Rapporteur : S'il y a plus d'un Etat ?
Capitaine WESTERHOLM : Il y a plusieurs gouverneurs. Il y a aussi un représentant local, quelqu'un qui représente la municipalité de San Francisco au sein du commandement unifié, et le pollueur. Tous ensemble, ils prennent, en équipe, les décisions pour savoir ce qu'il faut faire. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est avant tout le pollueur qui a la responsabilité de dépolluer. Si les moyens ne sont pas suffisants ou si le pollueur répond de manière insuffisante, la Coast Guard peut intervenir, passer un marché ou faire venir des moyens supplémentaires. Si alors l'Etat touché ou la municipalité propose ces moyens, nous pouvons nous en servir. Toutefois, nous n'avons pas le droit de l'exiger. Si les représentants locaux ou des Etats ne peuvent pas parvenir à un accord, ce qui est aussi une réponse en fin de compte, c'est la responsabilité de l'Etat fédéral de prendre les décisions de dépolluer comme il faut pour protéger l'environnement et assurer la sécurité du public.
M. le Rapporteur : Donc, in fine, l'Etat fédéral, c'est la Coast Guard pour l'ensemble de l'organisation.
Capitaine Thomas GILMOUR : Disons que le commandement unifié est une entreprise dont la Coast Guard détiendrait 51 % des actions.
Toutefois, nous devons être sensibles au fait qu'avec la responsabilité ultime, les décisions sont payées par les citoyens de la ville et de l'Etat car nous répondons à leurs intérêts.
M. le Rapporteur : Nous cherchions à établir une comparaison avec le système français.
Lieutenant Commander Tim DEAL : Nous nous avons parlé de l'ICS. Nous vous avons montré des fonctions dans le cadre de ces systèmes. Nous avons parlé des principes. Nos personnels sont entraînés dans leurs fonctions. Des publications existent déjà et nous pouvons, à faible coût, entraîner nos personnels pour répondre. Nous trouvons cela très rentable.
Capitaine Thomas GILMOUR : J'ajoute, pour ma part, que le système de commandement pour les accidents est appliqué et géré par d'autres agences fédérales, de même que par des organisations locales et fédérales, comme les pompiers et la police. Tout s'applique à ce système.
Lieutenant Mike PITTMAN : Avec cette pyramide de planification, lorsque le processus préalable de planification a eu lieu, nous sommes en interaction avec un même individu aux niveaux régional et local. Il est incorporé dans le système de commandement en cas d'urgence.
Lieutenant Commander Tim DEAL : Pour revenir à l'accident de San Francisco, je serai très bref, mais je peux vous montrer l'ICS en opération : vous avez les objectifs de commandement unifié, l'établissement d'une organisation des opérations pour poursuivre et atteindre les objectifs, un appui à l'organisation des opérations et à la gestion financière.
Des objectifs figurent sur un plan d'action. Sur une page de ce plan, le commandement unifié annonce les objectifs qu'il souhaite poursuivre. C'est extrêmement important. Si le commandement unifié ne dit pas à ses équipes ce qu'elles doivent accomplir, celles-ci ne sauront pas que faire et où aller. Ce sera une perte de temps, d'argent et cela aura un impact sur l'environnement. Ce plan n'est valable que vingt-quatre heures. Tous les jours, un nouveau plan est élaboré car la situation évolue. Le commandement doit donc en permanence réviser ses objectifs. Les objectifs doivent être spécifiques, précis afin que l'équipe puisse accomplir sa tâche avec le matériel mis à sa disposition. Il faut que celui-ci soit approprié et opportun et dans ce cas précis, fixé pour vingt-quatre heures. Je répète que cela est très important parce que, autrement, le reste de l'ICS ne peut pas fonctionner.
Puis un diagramme montre l'organigramme des opérations. Pour poursuivre les objectifs réalisés ici, un grand nombre de personnes participent à l'organisation. Tout à l'heure, nous avons parlé d'un commandement unifié. Il y avait des responsables à terre et également des responsables en mer. Vous y trouvez qui est responsable de la division E, par exemple. Quels sont ses effectifs ? Quel est son matériel ? Que doivent-ils avoir accompli en vingt-quatre heures ? Puis chaque division est reprise avec ses effectifs et les moyens qui lui sont attribués. Sur cet exemple, vous avez des questions liées à la sécurité. Comment font-ils pour communiquer avec l'équipe de commandement ?
M. le Rapporteur : Qui sont ces effectifs ? Je vois, par exemple, trente-sept personnes affectées à cette division. Qui les paie ?
Lieutenant Tim DEAL : Ce sont les gens responsables du nettoyage.
M. le Rapporteur : C'est la société mobilisée par le pollueur ?
Lieutenant Tim DEAL : La Coast Guard était en charge de la supervision. La compagnie liée par contrat par le pollueur était chargée de la dépollution. Les trente-sept personnes viennent de cette société contractante, à l'exception d'une ou deux personnes qui représentaient le gouvernement.
Capitaine Thomas GILMOUR : En Californie, il y a un plan préalable entre les Coast Guard et l'Etat, qui consiste à se partager les tâches. Ainsi, vous ne verrez pas un représentant de cet Etat et un membre de la Coast Guard sur le même poste. Nous y arrivons très bien ainsi.
M. le Rapporteur : Y a-t-il des fonctionnements différents selon les Etats ? Des conventions différentes ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Oui. Certains Etats sont beaucoup plus engagés que d'autres dans la lutte contre la pollution. La Californie a mis en place un mécanisme de financement qui est alimenté par les compagnies pétrolières qui opèrent dans l'Etat. En conséquence, ils ont une organisation bien dotée. D'autres Etats côtiers disposent d'organisations beaucoup plus réduites. Tout dépend des Etats.
M. le Rapporteur : Dans ce cas précis, les gens de Californie ne sont pas là ?
Lieutenant Commander Tim DEAL : Dans la division E, il y avait un superviseur de la Coast Guard. L'Etat de Californie était représenté par un individu qui surveillait les divisions D et le reste. Nous avons voulu étendre le champ de contrôle.
M. le Rapporteur : A quoi sert l'argent perçu par la Californie pour lutter contre la pollution si - cela doit être pareil dans les autres Etats - c'est le pollueur qui prend en charge la dépollution ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Il permet de recruter ceux qui sont responsables de l'intervention. Il y a également des programmes de R&D ainsi que plusieurs autres activités. Ils ont aussi une grande organisation de planification à faire.
Lieutenant Commander Tim DEAL : En vérité, le pollueur a une responsabilité limitée et certains pollueurs ne nettoient pas. Il appartient alors au gouvernement de l'Etat d'intervenir.
Capitaine Thomas GILMOUR : Très souvent, il arrive que vous n'ayez pas réussi à identifier le pollueur. Demain, au NPFC, ils pourront vous dire beaucoup plus exactement que moi le nombre de dépollutions que nous avons eues à mettre directement en _uvre.
M. le Rapporteur : Dans ce cas, l'Etat se substitue ?
Lieutenant Commander Tim DEAL : Non, c'est l'Etat fédéral qui se substitue.
Capitaine Thomas GILMOUR : Les Etats peuvent porter plainte contre le gouvernement fédéral, conformément à l'OPA 90.
Lieutenant Mike PITTMAN : Nous avons aussi des contractuels pour les chargés du nettoyage. Nous avons des tarifs de contrat pour les contrats de nettoyage.
Lieutenant Tim DEAL : Je vous montre cela pour démontrer à quel point il faut être organisé pour ces opérations. Pour chaque division, il y a une page correspondant aux opérations entreprises. Une fois que vous sortez du mode réaction et que vous engagez l'action, il faut cette planification. Pendant l'accident, à San Francisco, nous avons choisi de pourvoir ces postes. Nous avons recruté des gens qui devaient faire savoir où se trouvaient les effectifs, les matériels. Nous avons recruté des gens pour surveiller la situation.
Le commandement unifié a défini les objectifs en fonction de la situation. Par ailleurs, la documentation n'est pas un travail très intéressant, mais c'est un travail absolument nécessaire compte tenu des contentieux qui nous attendent normalement après une pollution. Enfin, il y a des gens qui sont préposés exclusivement à la démobilisation, pour sortir les personnels de l'aire de l'accident. Une fois que le contrat intervient, l'enjeu financier devient très grand. Pour eux, attendre toute la journée, cela va très bien, mais nous, nous voulons surveiller et limiter les coûts. Il faut donc quelqu'un pour surveiller la situation et leur demander de partir quand il n'y a rien à faire.
Il y a l'unité chargée des questions d'environnement, grâce à laquelle nous arrivons à établir des priorités entre les lieux, les plages à dépolluer. On traite des questions liées à la faune et à la flore. Leur contribution est déterminante pour le commandement unifié.
Nous avions également une section logistique en raison des distances que nous avions à parcourir, des effectifs en jeu et de la quantité du matériel à déployer. Pour cela, il nous fallait des spécialistes en logistique. Pour les transmissions, le terrain était vallonné, les distances grandes et, en plus, vous aviez toutes les îles. Aussi avons-nous fait intervenir des spécialistes en transmissions.
En fin de compte, nous arrivons à la comptabilité des coûts. C'est le rôle de la section finances. Nous avons recruté des gens pour suivre les coûts, ainsi que des personnes préposées aux questions de passation de marchés. Jusque là, nous négligions leur réponse, mais désormais, ils font partie intégrante du poste de commandement.
Capitaine Thomas GILMOUR : Il est très important pour nous de pouvoir calculer précisément nos propres coûts, car il sont pris en charge par la partie responsable. La partie responsable couvre les frais de la Coast Guard.
M. le Rapporteur : C'est la loi ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Oui.
M. le Rapporteur : Toute la question est dans la définition du responsable. Mais nous verrons cela demain, me semble-t-il ?
Capitaine Thomas GILMOUR : En effet, le NPFC pourra mieux définir ce qu'est une partie responsable, mais dans le cas d'un navire, c'est l'armateur propriétaire du bateau ; c'est indiqué sur le certificat de responsabilité financière, ainsi que sur le plan d'urgence du navire.
M. le Rapporteur : En aucun cas, vous n'avez eu affaire en tant qu'interlocuteur dans ces différentes affaires à l'affréteur comme responsable ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Parfois, c'est la même chose.
M. le Rapporteur : Est-il arrivé que dans la cellule restreinte de l'ISC, vous n'ayez pas le nom de l'armateur, mais de l'affréteur ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Non, c'est toujours l'armateur.
Capitaine WESTERHOLM : Après les opérations nous avons éventuellement les moyens de nous retourner vers l'affréteur.
M. Aimé KERGUERIS : Dans le cas où l'armateur est insolvable, que faites-vous ?
M. le Rapporteur : Prenons le cas de l'Erika. C'est 76 millions de francs d'assurance. Que faire avec une telle somme ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Nous avons eu le cas à Porto Rico d'un armateur ayant atteint ses limites. La Coast Guard est de toute façon intervenue.
M. le Président : Dans ce cas, vous ne récupérez pas les dépenses que vous avez exposées ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Mon grand-père m'a dit un jour que l'on ne peut pas saigner une pierre. Mais nous arrivons toujours à recouvrer les frais. Demain, vous pourrez leur demander ce qu'ils ont fait pour le Morest Jay à San Juan, Porto Rico.
Très rapidement, pour vous noyer sous des tonnes de papier, je vous remets ceci.
M. le Président : C'est très bien.
Capitaine Thomas GILMOUR : Vous trouverez les informations sur le programme de contrôle de l'Etat du port. C'est la conférence que nous avons faite en de nombreux endroits. Voici maintenant le Field Operations Guide, le manuel des opérations sur le terrain, pour le système de commandement de l'accident. Certains n'aiment pas que nous l'appelions FOG, à cause du brouillard. Voici également le manuel spécifique pour le responsable du financement et de la gestion des ressources.
M. Pierre HERIAUD : Je souhaiterais une précision à ce sujet. Nous avons eu une présentation tout à fait claire quant aux méthodes d'organisation, de travail, dans le cas de San Francisco. Mais votre organisation est une organisation en dix-neuf sites, en dix-neuf districts. Je voudrais savoir si c'est la même organisation qui prévaut partout où intervient un sinistre. Le mode de gestion de ces incidents est-il le même ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Nous avons cinquante-deux bureaux pour la sécurité maritime à travers les Etats-Unis. Chaque bureau est le coordinateur fédéral sur les lieux. L'officier de commandement de l'unité désigne un coordinateur sur le terrain pour les cas d'accident pétrolier. C'est stipulé dans le règlement. Cela concerne la zone côtière.
Dans de nombreux cas, il s'agit d'une cellule assez petite. S'il s'agit d'un grand accident, d'un accident d'envergure, ce sont des effectifs d'autres unités qui viennent soutenir. Nous avons deux protocoles à cette fin. Le premier, c'est le commandement d'accident régional, le second, le commandement national. Ces deux protocoles sont fonction de l'ampleur de la pollution.
Lieutenant Mike PITTMAN : Nous avons 19 sites sur lesquels nous avons prépositionné et où nous entretenons nos matériels.
M. René LEROUX : La catastrophe de San Francisco dont vous nous avez parlé date de 1996.
Lieutenant Joseph COST : Oui.
M. René LEROUX : Avez-vous eu l'occasion lors de cette dépollution, avec les responsables et les sociétés privées, d'utiliser des moyens de dépollution nouveaux ? Des Américains sont venus nous voir sur nos sites pollués avec un système de traitement par bactéries. En avez-vous entendu parler ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Nous avons conduit quelques expériences que nous appelons « bioguérison », ou remèdes biologiques. Nous avons mené des projets à base de microbes pétrophiles dans des aires marécageuses, mais c'est un processus à très long terme.
M. le Président : Ce n'est donc pas la solution.
Lieutenant Mike PITTMAN : L'OPA 90 prévoit une disposition qui nous permet d'explorer des possibilités en R&D dans le domaine des nouvelles technologies, à travers les mêmes agences gouvernementales de coopération que nous avons énumérées dans la National Response Team.
En vérité, cela crée de nombreux problèmes en raison des questions contractuelles avec l'Etat intéressé et des difficultés scientifiques. Le programme de R&D fonctionne donc en parallèle.
Capitaine Thomas GILMOUR : En fait, nous ne nous sommes pas tellement servi du remède biologique mais, dans le cas du New Carissa, nous y avons eu recours en prolongement sur le terrain pour brûler les hydrocarbures. Nous avons également utilisé des dispersants. Surtout dans le Golfe du Mexique. Nous pourrons vous donner les comptes rendus pour chacune des régions.
M. Jean-Michel MARCHAND : Vous avez abordé les problèmes que posent les solutions à long terme. Vous avez décrit un chantier de dépollution à court terme. Les conséquences sur l'environnement et sur les écosystèmes sont des conséquences à long terme. Que fait-on pour ces questions ? Qui en a la responsabilité ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Qui est responsable du suivi ?
M. Jean-Michel MARCHAND : Oui.
Capitaine Thomas GILMOUR : Une partie du dédommagement, par exemple, dans le cas de l'Exxon Valdez, est réservée à cela. En fait, nous avons des coordinateurs de suivi scientifique qui viennent de la NOAA.
M. Jean-Michel MARCHAND : Quand vous dites : « Nous avons.. », c'est la Coast Guard ?
Capitaine Thomas GILMOUR : Nous ne faisons pas d'études à long terme. Cela revient essentiellement à la communauté scientifique.
M. le Président : Nous vous remercions.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être relue par les intervenants.
Audition de Mme Jan LANE,
directrice du National Pollution Funds Center,
M. Jeffrey HULL, adjoint de la directrice,
M. John BAKER et le capitaine Derek A. CAPIZZI,
expert de la division juridique du Fonds
accompagnés de M. Jean-Michel BOUR,
conseiller transports à l'Ambassade de France aux Etats-Unis
(extrait du procès-verbal de la séance du 18 mai 2000 à Washington)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Mme Jan LANE : Je suis directrice du fonds national contre la pollution maritime, le NPFC. Je vous souhaite la bienvenue. Après un exposé liminaire sur le NPFC, je vous inviterai à poser toutes les questions que vous souhaitez.
M. le Président : Je vous remercie de votre accueil et de cette séance de travail. Vous savez les raisons qui nous amènent aux Etats-Unis : les côtes françaises ont été victimes, il y a quelques mois, d'une catastrophe majeure et l'Assemblée nationale a désigné une commission d'enquête parlementaire afin, non pas de faire le point sur la catastrophe elle-même, mais d'examiner les conditions permettant d'améliorer la sécurité des transports maritimes.
La France est un pays situé à l'ouest du continent européen, position extrêmement menacée, et si notre flotte connaît quelques difficultés, il passe chaque année au large des côtes françaises, vers Rotterdam et les pays du Nord de l'Europe et aussi en direction des ports français, des dizaines de milliers de navires dont une grande partie sont porteurs de produits polluants et dangereux. Comment faire pour réduire les risques ? Comment faire, une fois que la catastrophe a eu lieu malgré tout - car le risque zéro n'existe pas - pour réparer ? Comment faire en sorte que ce soient les responsables qui réparent ?
Ce sont les questions qui nous ont conduits ici, non pas pour copier ce que vous faites - encore que nous voyons des choses très intéressantes - mais simplement pour nous inspirer de la philosophie qui vous a amené à mettre en place un certain nombre de dispositifs.
Mme Jan LANE : Nous sommes également heureux de vous recevoir. Je cède sans plus attendre la parole à John Baker.
M. John BAKER : Sans doute connaissez-vous l'Oil Pollution Act de 1990 et les modifications que cette loi a entraînées. L'OPA a été adoptée en août 1990, après des années de débats au Congrès. C'est la loi la plus globale que la Coast Guard ait eu à mettre en _uvre. L'OPA 90 comporte cinq dispositions importantes : la modification des constructions, l'amélioration des relations entre les agences concernées et l'industrie pétrolière, le renforcement des contrôles sur les licences et les équipages, de nouvelles exigences concernant le fonctionnement des navires et des installations, le renforcement des exigences en matière de responsabilité et de compensation. Ce dernier domaine, qui fait l'objet du Titre I de l'OPA, est géré par le NPFC et fera l'objet de l'exposé de ce jour.
L'accident de l'Exxon Valdez nous a permis de tirer deux enseignements importants. Nous avons pris conscience d'une part, du fait que nous ne disposions pas de moyens suffisants, de crédits fédéraux suffisants pour traiter ces déversements, et d'autre part, de l'ampleur des dégâts, surtout en matière de ressources naturelles.
L'OPA 90 a tenu compte de ces insuffisances dans le cadre de son Titre I, qui contient des exigences en matière de responsabilité et de compensation. Le Titre I a mis en place l'utilisation d'un fonds doté d'un milliard de dollars pour un enlèvement rapide du pétrole. Il a également établi de nouvelles limites de responsabilité en matière de déversements, avec des modifications importantes en matière de responsabilité financière. Il a enfin élargi de façon significative l'étendue des dommages dont les pollueurs sont responsables.
Pour qu'un incident soit couvert par l'OPA, il faut qu'il réponde à plusieurs critères. L'accident doit s'être produit après le 18 août 1990 ; le coordinateur fédéral sur place - le FOSC - doit décider s'il y a déversement ou risque substantiel de déversement dans les eaux navigables des Etats- Unis. Ce coordinateur fédéral tiendra compte de la proximité du déversement, de la quantité de pétrole déversée et de tout obstacle qui pourrait empêcher le déversement de ce pétrole dans l'eau. Il prend également en compte les caractéristiques de la source du déversement ou de la menace, et l'impact potentiel de ce déversement.
Enfin, outre les points indiqués ci-dessus, la loi définit de manière large les « eaux navigables », qui comprennent les lacs, les marais, les marécages et les zones non désignées ; bref, toutes les eaux de surface.
Pour mettre en _uvre le Titre I, le commandant de la Coast Guard a mis sur pied le National Pollution Funds Center en février 1991.
Les principales missions de ce fonds sont relativement larges. Nous gérons le programme COFR, concernant les certificats de responsabilité financière ; nous finançons les travaux de nettoyage immédiats et initions la NRDA - Natural Resource Damage Assessment - évaluation des dommages occasionnés aux ressources naturelles ; nous payons des dédommagements en cas de sinistre ou de dommages liés à un déversement ; nous récupérons les coûts engagés auprès des parties responsables ; et nous gérons l'utilisation du Superfonds de la Coast Guard destiné à répondre aux déversements de matières dangereuses sur les zones côtières.
Nous sommes vraiment une entité au sein de la Coast Guard. Selon les circonstances, nous pouvons jouer le rôle de banquier, d'assureur, d'expert d'assurance ou d'agence de recouvrement.
Je vais entrer dans le détail de chacune de ces missions durant mon exposé.
Mme Jan LANE : Vous recevez un exemplaire de la documentation de ce fonds national contre la pollution.
M. John BAKER : Le NPFC compte huit divisions : la division de gestion des cas ; la division plaintes et dommages ; la division dommages aux ressources naturelles, qui est nouvelle ; la division certification des navires ; la division juridique ; la division technique des informations ; la division des services à la clientèle.
Actuellement, 118 personnes travaillent au NPFC, dont 75 % sont des civils et 25 % des militaires.
Dans chaque division, nous avons mis sur pied des équipes qui doivent répondre à chaque cas de pollution lorsque le fonds est ouvert. Ces équipes comportent des experts techniques issus de chaque direction. Quatre équipes travaillent en dehors du fonds et chacune est responsable d'une région donnée des Etats-Unis.
Chaque accident se voit attribué un « officier de cas » ; il y a donc un contact unique avec nos clients extérieurs. L'officier de cas est le coordinateur interne central et la personne de contact extérieur pour les communautés touchées, les parties responsables et les représentants des autres domaines fonctionnels de l'équipe.
La carte de la page 7 vous montre les équipes de cas, les districts de la Coast Guard et les régions de l'Agence de protection de l'environnement - l'EPA. Les quatre équipes sont réparties par région. La Coast Guard et l'EPA ont chacune leur propre structure régionale. La Coast Guard compte neuf districts ; l'EPA, dix régions. Près de la moitié de tous les déversements se produisent sur le littoral des 5ème, 7ème et 8ème districts de la Coast Guard.
Le fonds fait partie intégrante du dispositif national d'intervention, le NRS - National Response System. Ce dispositif se compose des équipes nationales et régionales d'intervention, des comités locaux et du centre national. Le coordinateur fédéral sur place a à sa disposition plusieurs moyens, dont les forces spéciales de la National Strike Force. Le NPFC assure la gestion financière, traite les plaintes et fournit une assistance juridique au coordinateur sur place, si besoin est, en cas de déversement.
L'Oil Spill Liability Trust Fund, fonds de responsabilité civile - OSLTF - est un fonds doté d'un milliard de dollars. Il a été créé par l'OPA 90. Il est financé de plusieurs manières : par une taxe de 5 cents prélevée sur chaque baril de pétrole national ou importé ; par les intérêts d'investissement sur le capital du fonds ; par le recouvrement des coûts provenant des parties responsables ; par les amendes civiles imposées aux parties responsables ; par des transferts en provenance d'autres fonds.
La loi prévoit aussi qu'en cas d'urgence, nous pouvons alimenter le fonds à partir des crédits supplémentaires d'urgence dont dispose le Congrès. A la date d'aujourd'hui, la taxe de 5 cents par baril de pétrole national ou importé a été la principale source de revenu du fonds. Cette taxe a été supprimée le 31 décembre 1994. Le Département du Trésor envisage une extension du domaine d'application de cette taxe. Le fonds continue à percevoir des revenus d'autres sources, y compris, depuis 1990, des transferts d'un montant de 325 millions de dollars en provenance du Trans-Alaska Pipeline Liability Fund.
L'OSLTF se compose de deux éléments : un fond d'urgence et un fonds principal.
Le fonds d'urgence est doté au départ de 50 millions de dollars, utilisés pour le financement des actions de nettoyage, pour l'accès de l'Etat au fonds et pour le lancement des évaluations des atteintes aux ressources naturelles. Jusqu'à aujourd'hui, le bilan de fin d'exercice de ce fonds d'urgence a été reporté sur les années ultérieures. Son solde actuel est de 74,8 millions de dollars.
Le fonds principal contient le reste de l'argent. Il est actuellement doté d'environ 1,2 milliard de dollars et, comme cela est prévu dans l'OPA 90, il est utilisé pour le financement des agences opérationnelles ainsi que celui de la recherche-développement, de l'EPA, de la Coast Guard ou du Département de l'intérieur par exemple. Il permet également de dédommager les coûts de nettoyage et les dommages qui n'ont fait l'objet d'aucun dédommagement.
Le schéma de la page 11 vous donne un aperçu général des recettes et des dépenses, ainsi que des contributions des différentes catégories en fonction des données cumulatives de 1990 à aujourd'hui. Vous pouvez voir que la taxe sur le pétrole constitue, de loin, la source la plus importante de revenus et que les crédits sont la source la plus importante de dépenses. 70 % des cas se situent dans une catégorie de dommages qui s'élèvent de 0 à 10 000 dollars ; toutefois, 85 % du fonds sont destinés à des cas qui dépassent une valeur de 100 000 dollars. Cette dernière catégorie représente également 80 % de l'argent que nous récupérons.
La notion du pollueur-payeur est l'un des principes premiers de l'OPA. Le NPFC est chargé de récupérer tous les coûts d'enlèvement et de dommage de la part du responsable, à concurrence de sa limite de responsabilité.
Avant l'OPA 90, rien n'était fait avec précision pour la récupération des coûts, le temps et les moyens manquaient pour recouvrer ces coûts. Depuis l'OPA et la mise en place du NPFC, le recouvrement des coûts a été renforcé. La gestion des cas et le recouvrement des coûts par le NPFC constituent désormais un élément important de cette procédure.
Quatre moyens principaux permettent d'accéder au fonds : directement, en passant par le coordinateur fédéral sur place ou en agissant comme sous-traitant pour lui ; par une demande de financement d'un Etat, d'un montant maximum de 250 000 dollars par accident, qui doit être adressée par l'intermédiaire du FOSC, mais ce moyen de financement est rarement utilisé ; par des individus, des sociétés ou des gouvernements qui demandent une compensation au titre des coûts d'enlèvement ou des dommages et qui soumettent une plainte au NPFC ; enfin, pour le lancement d'une évaluation des atteintes aux ressources naturelles. Les demandes sont présentées par un fonds d'agences fédérales pour un accident donné.
Les procédures écrites d'opérations techniques ont été élaborées par le NPFC et permettent de connaître les procédures d'accès au fonds par l'un de ces quatre biais. Des règles intérimaires ont été publiées pour l'accès des Etats et les plaintes. Nous vous remettrons une documentation complète, qui décrit toutes ces procédures d'opérations techniques.
L'une des missions principales du NPFC consiste à juger les réclamations. Les plaignants doivent tout d'abord demander des dommages à la partie responsable, sauf dans le cas d'Etats qui sont encouragés mais qui n'ont pas l'obligation de s'adresser d'abord aux parties responsables. Le NPFC est le deuxième moyen pour les plaignants : il n'intervient qu'après que les parties responsables aient refusé ou n'aient pas répondu dans un délai de 90 jours. Dans le cas de « déversements mystérieux », pour lesquels aucune partie responsable n'est identifiée, les plaignants peuvent s'adresser directement au fonds de dédommagement.
Il existe sept catégories de plaintes, qui recouvrent six types de dommages : les coûts d'enlèvement non dédommagés, qui doivent être traités en coordination étroite avec le coordinateur fédéral ; les atteintes aux ressources naturelles, qui ne peuvent être présentées que par l'Etat fédéral, l'Etat touché, une tribu indienne ou des groupements étrangers ; les atteintes aux biens immobiliers ou à la propriété personnelle, comme la présence de pétrole sur votre propre bateau ou dans votre hangar - ces demandes doivent également être traitées en étroite collaboration avec le coordinateur fédéral car la dépollution peut se faire pendant les opérations de nettoyage initiées par lui ; le manque à gagner - qui désigne les cas dans lesquels un particulier ou une entreprise a connu une diminution de ses revenus en raison d'un déversement : le cas le plus courant en la matière et le plus délicat à traiter est celui qui résulte de fermetures d'entreprises de pêche ou d'aquaculture, comme par exemple la pêche au homard et à la langouste, et l'utilisation des ressources naturelles pour assurer la subsistance des personnes ; la perte d'utilisation des ressources naturelles pour les Indiens qui tirent leur subsistance de ressources naturelles endommagées - saumons, phoques - et qui demandent réparation pour cette perte ; la perte de recettes gouvernementales dans le cas où l'Etat est dans l'incapacité de collecter des redevances, par exemple, en cas de fermeture d'un centre de loisir ou d'une plage ; l'augmentation des coûts des services publics dans le cas où le gouvernement devrait recruter des forces de police supplémentaires pour assurer la sécurité d'une installation fermée.
La représentation proportionnelle du nombre et du type de plaintes présentées au fonds montre que la majorité des plaintes touchent au non-dédommagement des coûts d'enlèvement. Viennent ensuite les plaintes pour les atteintes portées aux ressources naturelles, puis le manque à gagner ou la perte de bénéfice. On note seulement vingt-sept réclamations pour élévation du coût du service public. Il n'y a jamais eu de réclamation déposée pour perte de revenu ou perte de subsistance.
L'un des objectifs principaux de l'OPA est de s'assurer que les armateurs et les opérateurs de bateaux ont la capacité financière de payer les coûts d'enlèvement des polluants et de dédommagement des victimes. C'est pourquoi l'OPA 90 exige que les armateurs et les opérateurs apportent la preuve de leur responsabilité financière pour les coûts potentiels de déversement de pétrole et pour les atteintes à l'environnement avant de pouvoir entrer dans les eaux navigables américaines.
Les certificats de responsabilité financière, ou COFR, délivrés par la Coast Guard et attestant que la responsabilité financière a été démontrée, sont semblables à la vignette d'assurance des automobilistes qui est obligatoire dans bon nombre d'Etats américains. Les COFR sont vérifiés par la Coast Guard et les services des douanes dans les ports américains.
Les exigences en matière de responsabilité financière renforcent cet objectif en assurant que le propriétaire, l'exploitant, ou son garant, disposent effectivement des moyens disponibles.
La démonstration de la preuve de la responsabilité financière est nécessaire pour tous les types de bateaux, pas seulement les bateaux-citernes. Tous les bateaux de plus de 300 tonneaux de jauge brute - tjb - naviguant dans les eaux américaines sont obligés d'avoir ce certificat de responsabilité financière qui doit être conservé à bord du navire afin de permettre son contrôle lors de l'inspection de la Coast Guard ou de la douane.
La limite de responsabilité est fonction du tonnage du bateau, avec des minima et des maxima. Dans le cadre de l'OPA, la limite pour les bateaux-citernes est généralement deux fois plus élevée que pour un cargo. De l'ordre de 19 000 certificats, généralement valables pour trois ans, sont en vigueur à l'heure actuelle. Le NPFC traite environ 8 000 certificats chaque année, dont les nouveaux certificats, les changements de nom de navires, les renouvellements et les rééditions. Le plus grand bateau-citerne possédant le certificat est de 260 851 tjb, soit une responsabilité financière de 313 millions de dollars. Par comparaison, l'Exxon Valdez faisait 95 000 tjb. Sa limite de responsabilité serait de 115 millions de dollars.
Les bateaux de pêche de moins de 300 tjb n'ont pas besoin d'avoir de certificat. Cependant, ils sont responsables du coût du nettoyage et des dommages prévus aux termes de l'OPA, soit 600 dollars par tjb ou 5 000 dollars, selon ce qui est le plus élevé. Notre expérience nous a montré que le besoin de certification a une incidence profonde sur le recouvrement des coûts, car les taux de recouvrement pour les accidents mettant en jeu des navires munis de certificats sont de l'ordre de 100 %, alors que les taux de recouvrement pour les navires sans certificat sont inférieurs à 30 %.
Si un armateur n'est pas en conformité avec les impératifs de responsabilité financière de l'OPA, son navire est passible de détention, de se voir refuser l'entrée d'un port américain, de faire l'objet d'une sanction civile ou d'une pénalité civile à hauteur de 27 500 dollars par jour de violation, ou encore de saisie ou de confiscation. Les impératifs de responsabilité civile ne sont pas applicables aux bateaux publics, aux chalands non automoteurs qui ne transportent ni d'hydrocarbures ni substances dangereuses, ainsi qu'aux navires de moins de 300 tjb, à l'exception de navires de transbordement de pétrole dans la zone économique exclusive à destination des ports américains.
L'équipe d'intervention spéciale nationale - National Response Special Team - du NPFC fournit également de nombreuses informations directement à la Coast Guard et au personnel de l'EPA, par le biais de visites complètes, de ses capacités de traitement sur place des problèmes financiers et des plaintes, ainsi que son soutien juridique aux commandants en cas d'accident.
Dans le cas d'un accident pétrolier d'importance nationale, le directeur de la gestion des cas du centre devient le directeur de la division financière pour le système de commandement de l'accident. Des rapports d'activité trimestriels sont présentés aux commandants des districts, aux officiers de sécurité maritime de la Coast Guard, ainsi qu'au quartier général et aux bureaux régionaux de l'EPA.
Le NPFC participe également depuis longtemps à des exercices d'intervention en cas de pollution, ainsi qu'aux réunions des équipes d'intervention nationales et régionales.
Outre les déversements causés par les bateaux ou installations, l'OSLTF peut être utilisé pour répondre à un grand nombre de problèmes, dont le nettoyage de puits de pétrole et des réservoirs de stockage souterrains, les incendies de voitures, les accidents d'avion, les déraillements de trains et les accidents de camions-citernes. Il est également fait appel au fonds pour le pompage du pétrole en vue de réduire la menace importante provenant du déversement à partir de bateaux interdits ou saisis.
Les fuites naturelles de pétrole sont un autre exemple de la présence d'une autorité d'intervention aux termes du Clean Water Act et du financement par l'OSLTF ; elles ne constituent pas un accident couvert aux termes de l'OPA. Les demandes d'indemnisations de ce type de déversements ne sont donc pas couvertes.
L'administration maritime, la flotte de réserve opérationnelle de la Navy et d'autres installations fédérales sont parfois sources d'accidents et de pollution pétrolière. Alors que le coordinateur fédéral sur place peut utiliser le fonds pour intervenir en cas de déversement lorsque l'agence responsable ne prend pas les mesures adéquates, l'OSLTF cherchera à recouvrer les coûts auprès de cette agence fédérale. C'est l'exemple d'une intervention au titre du Clean Water Act, mais pas au titre de l'OPA.
Le Centre conduit également des séminaires sur l'emploi du fonds chaque année pour faciliter nos efforts de promotion et de compréhension de l'OSLTF. A la date d'aujourd'hui, plus de 900 représentants de la communauté d'intervention sur l'environnement ont participé à ces séminaires. Ce sont essentiellement des personnels d'intervention de la Coast Guard et de l'EPA, mais on compte également des organisations d'Etats, des sociétés, des organismes d'intervention en cas de déversements et des compagnies pétrolières. Nous nous sommes aperçus que ces séminaires étaient l'un des moyens les plus efficaces de faire comprendre notre programme d'intervention.
Le NPFC a mis en place une bibliothèque très complète de matériels d'information conçue pour fournir à nos clients les renseignements dont ils peuvent avoir besoin sur le NPFC, son rôle et ses missions, l'accès au fonds et son utilisation. Elle comprend notre rapport annuel, des brochures, des guides d'information, des vidéos, un guide de référence d'utilisation du fonds, contenant tous nos modes opératoires techniques. Elle a été organisée pour servir de référence précise pour le personnel sur le terrain.
Au-delà des documents écrits, le NPFC a normalisé et informatisé ses formulaires de suivi des coûts en format MS EXCEL et les a inclus dans son site web pour favoriser une lecture et un accès faciles par les personnels sur le terrain. Ces formulaires informatisés comprennent les taux d'intervention standards de la Coast Guard afin de permettre un calcul rapide et précis des coûts en personnels et en équipements de la Coast Guard.
C'est ainsi que s'achève cet exposé.
Mme Jan LANE : Avez-vous des questions ?
M. le Rapporteur : Nous vous remercions de la qualité de votre exposé. Je voudrais revenir sur la question de la responsabilité. Je n'ai pas tout compris. Pour bien clarifier, je voudrais revenir sur un point. Dans votre réglementation, le pollueur est toujours le propriétaire du navire ?
M. Jeffrey HULL : La « partie responsable » est définie comme le propriétaire, l'armateur, l'exploitant ou l'affréteur à vide.
M. le Rapporteur : C'est donc le responsable du navire et non celui de la cargaison ?
M. Jeffrey HULL : C'est cela. Le propriétaire de la cargaison n'est pas responsabilisé.
M. Jean-Michel BOUR : Cela a été proposé lors de la discussion de la loi. Le Congrès l'a refusé.
M. le Rapporteur : Je voudrais revenir sur le montant de responsabilité du pollueur. Le plafond n'est pas calculé ?
M. Jeffrey HULL : Tout dépend du type de navire et de la dimension du navire. Pour un navire-citerne, c'est 1 200 dollars par tjb. Il y a un minimum : si le navire dépasse 3 000 tjb, il y a une responsabilité minimale de 10 millions de dollars.
M. le Rapporteur : Quelle que soit la taille. Et à partir de là ?
M. le Président : 1 200 dollars par tjb, avec un minimum de 10 millions de dollars exigé pour les navires qui ont un tonnage supérieur à 3 000 tjb, mais pouvez-vous confirmer que la disposition concernant la limite de responsabilité n'est plus applicable en cas d'erreur ?
M. Jeffrey HULL : Absolument. La limite de responsabilité de l'opérateur ou du propriétaire du bateau peut être rompue pour plusieurs causes : négligences grossières, violations des réglementations fédérales, non notification de l'accident, non-coopération avec les autorités représentant le Gouvernement.
Il faut se souvenir que la rupture de la limite de responsabilité s'applique à l'armateur et au propriétaire du navire, pas à son gérant, ni aux sociétés d'assurances, qui garantissent la responsabilité financière du propriétaire.
M. le Président : Quel est le nombre de cas dans lesquels cette limite a été rompue ?
Mme Jan LANE : Moins de dix cas.
J'attire votre attention sur le fait que nous parlons là de deux choses différentes :le coût total des accidents ayant dépassé la limite et les hypothèses de déplacement de la limite de responsabilité des « parties responsables ». Si l'opérateur ou le propriétaire ne sont pas exposés à la responsabilité limite en raison de l'un des facteurs présentés, ils peuvent revenir déposer une plainte auprès de nous. Nous avons reçu quatre à cinq plaintes de parties responsables pour excès de limite de responsabilité, mais nous ne connaissons pas de cas où la responsabilité ait été rompue, les exposant ainsi à une responsabilité illimitée.
M. John BAKER : Il y a un cas.
M. le Président : Vous pouvez donc rompre la limite de la responsabilité, mais si le coût total de la pollution dépasse la limite et si vous pouvez prouver qu'il y a eu une faute...
M. Jeffrey HULL : Il ne s'agit pas simplement d'une faute. Il s'agit de négligence grossière.
M. le Rapporteur : Si le coût de réparation de la pollution dépasse le montant de la responsabilité et qu'il n'y a ni erreur, ni négligence, c'est le fonds qui paie ?
Mme Jan LANE : Oui, à hauteur de 1 milliard de dollars par accident. Il y a un plafond de 500 millions de dollars lorsqu'il y a atteinte aux ressources naturelles.
M. le Rapporteur : Pour les ressources naturelles, il n'est pas autorisé d'aller au-delà de 500 millions de dollars ?
M. Jeffrey HULL : Il est important de se souvenir que dans bien des accidents que nous avons connus aux Etats-Unis et qui ont dépassé la limite, la partie responsable n'a pas payé. Nous avons dû intervenir et couvrir les coûts parce que nous disposons du fonds et d'un mécanisme aux termes duquel la partie responsable continue à financer l'intervention et le nettoyage au-delà de la limite de responsabilité, sachant qu'il existe un mécanisme permettant de recouvrer ces frais pour le cas d'accidents.
M. le Rapporteur : Ce dispositif a-t-il entraîné des modifications de comportements entre les armateurs et leurs assureurs ?
M. Jeffrey HULL : Il y a eu des changements, par exemple, une coopération renforcée entre l'exploitant du navire et l'assureur, ainsi qu'une meilleure coopération entre eux et les autorités fédérales, parce qu'ils savent très bien que s'ils veulent obtenir le recouvrement de leurs frais, ils doivent prouver qu'ils ont coopéré et qu'ils ont fait ce que les autorités fédérales leur avaient demandé de faire.
Mme Jan LANE : Ils savent aussi que s'ils ne se coordonnent pas avec les plaignants ou ceux qui sont responsables des opérations de nettoyage, c'est nous qui recevrons leurs plaintes, qui les couvrirons, et qui recouvrerons ensuite les frais à leur dépens. Il vaut donc mieux pour eux coopérer dès le début car, de toute façon, ils vont payer.
M. Jeffrey HULL : Un autre problème est celui du rapport entre l'armateur et l'assureur, du fait des exigences d'action directe par nos COFR. Les assureurs sont devenus beaucoup plus sélectifs sur les navires qu'ils décident d'assurer. Ces dernières années, de nombreux navires qui avaient des COFR au titre de l'ancien régime ont décidé de ne pas obtenir les certificats d'assurance nécessaires. Ils ne commercent donc plus avec les Etats-Unis. Nous avons ainsi éliminé toute une classe de navires sous-normes qui, grâce à ce programme, ont décidé de ne plus venir aux Etats-Unis, soit parce qu'ils ne pouvaient pas se le permettre, soit parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir les garanties nécessaires de l'assureur.
M. Jean-Michel BOUR : L'armateur doit-il être dans un plan d'intervention ?
Mme Jan LANE : Le centre n'a pas la responsabilité programmée de tels plans.
M. le Rapporteur : La question de l'adhésion au fonds du FIPOL a-t-elle été posée ? Je sais que vous n'en êtes pas membres mais la question a-t-elle été débattue ?
Mme Jan LANE : Oui, au moment du débat sur l'OPA 90, nous en avons beaucoup discuté. La Coast Guard était favorable à une participation à ce fonds international, mais l'accident de l'Exxon Valdez a changé la donne. L'OPA a été ensuite promulguée, éliminant entièrement le fonds international en tant que choix possible pour les Etats-Unis.
M. le Président : Avez-vous imaginé que cela pouvait venir en complément de ce que vous aviez vous-même ? Car, si j'ai bien compris, dans le cas d'un navire qui ne fait pas acte de négligence et qui entraîne une catastrophe majeure, il existe une limite de prise en charge imposée. Quand cela s'applique à l'environnement, elle est de 500 millions de dollars et de 1 milliard de dollars en cas d'autres dégâts. Ne peut-on pas imaginer des catastrophes encore plus lourdes que l'Exxon Valdez, pour lesquelles, dans ce cas, l'apport du fonds de l'OMI pourrait être alors intéressant ?
M. Jan LANE : Si nous étions confrontés à un accident dépassant 1 milliard de dollars, je ne suis pas sûre qu'un fonds international mettrait à disposition beaucoup plus d'un milliard de dollars.
M. le Président : La France compte demander à la Commission européenne et à l'OMI de multiplier ce fonds par cinq, ce qui le mettra au niveau du milliard de dollars.
Mme Jan LANE : Je ne pense pas que les Etats-Unis révoquent un jour l'OPA 90. L'ampleur des dégâts admissibles par l'OPA y est tellement supérieure au régime international. Ce dernier est aujourd'hui très limité pour ce qui a trait aux dommages. Je pense que si nous étions confrontés à un accident dépassant le milliard de dollars, nous pourrions à nouveau solliciter le Congrès pour accroître ce fonds. Au Congrès, certaines forces sont déjà favorables à un effort supplémentaire qui permettrait d'atteindre 2,5 milliards de dollars. Ce n'est pas forcément lié à une augmentation par accident, mais tout simplement à l'adoption de la loi. Je suis sûre que la réaction du Congrès serait très favorable.
M. le Rapporteur : Existe-t-il des réglementations supplémentaires propres à chaque Etat qui viendraient en complément de la réglementation fédérale, ou en contradiction ?
M. Jeffrey HULL : Non, d'habitude, ces réglementations ne sont pas en contradiction. Normalement, les législations des Etats fédérés complètent l'OPA et amplifient les impératifs fédéraux pour ce qui est de la responsabilité. Il y a un paragraphe de l'OPA 90 qui dispose que les Etats peuvent mettre en _uvre leurs propres programmes de responsabilité.
M. le Rapporteur : Arrive-t-il que les Etats confèrent la responsabilité au chargeur ?
M. Jeffrey HULL : C'est le cas de certains Etats.
M. le Rapporteur : Lesquels ?
M. Jeffrey HULL : La Californie et l'Alaska.
M. le Rapporteur : Elle s'ajoute à la responsabilité du propriétaire du bateau, prévue dans l'OPA ?
M. Jeffrey HULL : C'est cela.
M. le Rapporteur : Serait-il possible de nous fournir une courte information sur ces deux exemples ?
M. Jeffrey HULL : Nous ne suivons pas nécessairement de très près ce que font les différents Etats. Mais nous pouvons vous faire entrer en contact avec les représentants de leurs agences.
M. le Rapporteur : Oui, sur l'Alaska et la Californie, ce serait intéressant.
Ma question suivante porte sur la méthode institutionnelle : le contrôle des certificats financiers est-il effectué par la Coast Guard et les douanes ?
M. Jeffrey HULL : C'est exact. Généralement, le bateau doit informer la Coast Guard locale vingt-quatre heures avant son arrivée dans les eaux américaines, car nous avons besoin d'un certificat valide de sécurité financière. Dans le cas contraire, ce navire sera refusé dans les eaux territoriales jusqu'à ce qu'il satisfasse à cette exigence ou qu'il décide de ne pas entrer. De plus, avant la sortie des eaux américaines, il doit passer par le bureau des douanes. A ce moment, le COFR sera également vérifié. Lorsqu'un bateau subit un contrôle au port aux Etats-Unis, le certificat est aussi contrôlé.
M. le Rapporteur : La douane peut le faire également ?
M. Jeffrey HULL : Oui.
M. le Rapporteur : Qu'appelez-vous les eaux territoriales, ce sont les 12 milles ?
M. Jeffrey HULL : Pour le COFR, c'est 3 milles. Mais les COFR couvrent un déversement jusqu'à la zone économique exclusive des Etats-Unis, qui est de 200 milles. Donc, les navires qui ont un COFR...
M. le Rapporteur : Je n'ai pas compris.
M. Jeffrey HULL : L'exigence de COFR est opposable aux navires dans une zone de 3 milles à partir des côtes américaines. Toutefois, si le navire se trouve dans la zone économique exclusive des Etats-Unis, qui est de 200 milles, en cas de déversement, le certificat peut être utilisé pour récupérer les coûts et assurer le règlement de la dépollution.
M. le Rapporteur : Cela veut dire que vous pouvez vérifier les navires dans les 200 milles ?
M. Jeffrey HULL : Uniquement dans le cas d'un transbordement dans cette zone économique exclusive. Si le navire se trouve à l'extérieur de la limite des 3 milles, qu'il n'est qu'en transit, qu'il n'est pas destiné à entrer dans un port américain, en général, nous ne vérifions pas le COFR car celui-ci n'est pas obligatoire.
M. le Rapporteur : Mais on ne contrôle pas le COFR au-delà des 3 milles ?
M. Jeffrey HULL : Non. Mais en cas de déversement au-delà des 3 milles, s'il y a un COFR, nous nous en servons pour récupérer le coût.
M. le Rapporteur : Jusqu'aux 200 milles ?
M. Jeffrey HULL : Oui.
M. le Rapporteur : C'est la même administration qui fait l'évaluation, l'expertise et qui paie en cas de dépassement ?
Mme Jan LANE : Oui.
M. le Rapporteur : Par exemple, pour l'évaluation des coûts écologiques, comment faites-vous pour évaluer, dans la limite des 500 millions de dollars, ce qui est écologique ou pas ? Avez-vous des experts spécialistes de l'écologie ?
Mme Jan LANE : Aux Etats-Unis, pour évaluer les dommages aux ressources écologiques, nous avons plusieurs administrations fédérales, qui sont des trustees de toutes les ressources : des responsables pour l'eau des zones côtières, des responsables des régions intérieures, etc. Elles gèrent le système et leur responsabilité première est de procéder à l'évaluation des ressources qui subissent des dommages dans leur région. Les Etats-Unis ont créé des règles, celles-ci doivent être suivies. Ces administrations fournissent des directives pour l'évaluation des dommages et l'élaboration de plans de restauration ou de dédommagement en cas de pertes de ressources naturelles que l'on ne peut pas restaurer.
Elles s'adressent d'abord à la partie responsable. Si celle-ci ne peut dédommager, elles s'adressent au NPFC. Nous avons une direction indépendante d'expertise technique qui examine leurs demandes et évalue les plans de restauration. C'est elle qui décide ensuite si nous sommes autorisés à leur fournir le financement. Nous finissons tout juste depuis deux ans de mettre en _uvre ce programme. Nous avons des centaines de demandes en cours de traitement.
Pour ce qui est de l'évaluation technique, nous avons, ainsi que les trustees, des experts d'évaluation technique qui sont des sous-traitants. Ils ont une expertise que nous n'avons pas chez nous.
M. le Rapporteur : Arrive-t-il que l'assureur d'un bateau vous poursuive sur l'évaluation des coûts que vous avez réalisée ?
Capitaine Derek A. CAPIZZI : Les Etats-Unis n'ont pas mis en jeu leur autorité souveraine. Donc, le NPFC ne peut être poursuivi en justice pour ces dommages. Notre seule obligation est de prendre une décision raisonnable. Nous ne pourrons être impliqués qu'en cas de décision arbitraire et non raisonnable. Le tribunal peut seulement nous demander de revoir notre décision pour parvenir à une décision rationnelle.
M. le Rapporteur : Le tribunal ne fixe pas la somme à payer ?
Capitaine Derek A. CAPIZZI : C'est cela. Cela ne veut pas dire que le tribunal ne demande pas parfois de restatuer.
M. le Rapporteur : Quel est le délai de présentation d'un dossier ?
M. le Président : Et quelle est la limitation ? Après combien de temps n'est-il plus recevable ?
Capitaine Derek A. CAPIZZI : Une demande doit être déposée dans les trois ans après que le dommage s'est produit ou après qu'il a été raisonnablement découvert.
Dans le cadre d'atteintes aux ressources naturelles, on décide conformément au règlement fédéral sur l'évaluation de ces dommages. Le délai est de trois ans après la conclusion de l'évaluation. Est ainsi prise en considération l'argumentation qui consiste à dire que le responsable qui effectue cette évaluation peut prendre son temps car la prescription ne commence pas à courir avant qu'il ait terminé.
Mme Jan LANE : Nous pouvons vous donner des documents à ce propos, mais cela figure sans doute sur notre site web.
M. le Rapporteur : Techniquement, la personne qui a subi un préjudice de pollution se fait rembourser par le NPFC, qui lui-même se fait rembourser par le responsable ? Comment cela se passe-t-il techniquement ?
Je prends un exemple. Je suis un hôtelier de l'Alaska, je n'ai plus du tout de visiteurs ; je vais voir le fonds ou je vais voir la compagnie Exxon ? Si c'est le fonds qui paie, il se retourne ensuite vers le responsable ?
Mme Jan LANE : Vous vous adressez tout d'abord à la partie responsable et si celle-ci ne vous répond pas dans un délai de 90 jours, vous vous adressez à nous.
M. le Rapporteur : A ce moment-là, vous payez et vous vous retournez contre la partie responsable ?
M. Jean-Michel MARCHAND : Ma question porte sur le même sujet. Qui peut déposer un dossier : une personne, une collectivité, une association de protection de l'environnement, par exemple ?
Mme Jan LANE : Oui. Cela est indiqué page 14 du document que nous vous avons remis.
Capitaine Derek A. CAPIZZI : Tout le monde peut déposer une plainte. Toute personne physique, collectivité locale, etc. La définition du plaignant est très large.
M. Jeffrey HULL : Pour revenir sur l'exemple de l'hôtelier, dans le cadre du déversement à San Juan, Porto Rico, le NPFC a payé un certain nombre de demandes de dédommagement déposées par les hôtels.
M. le Rapporteur : Avant de se faire payer par le responsable ?
M. Jeffrey HULL : Oui. C'est l'Etat qui s'en est occupé.
M. le Rapporteur : Ensuite, l'Etat s'est retourné contre le responsable ?
M. Jeffrey HULL : C'est cela.
Mme Jan LANE : Vous trouverez tout cela page 14.
M. le Rapporteur : L'OPA a-t-elle eu pour conséquence de renforcer la puissance et la solidité financière des armateurs qui viennent dans les ports américains ?
M. Jeffrey HULL : Oui et non, parce que nous faisons des évaluations plus importantes.
Mme Jan LANE : L'assureur évalue davantage les armateurs depuis l'OPA 90 car si l'enjeu est plus élevé, ils sont obligés d'indemniser.
M. le Rapporteur : Cette surévaluation est-elle le résultat de la relation entre armateurs et assureurs ?
Mme Jan LANE : Nous avons conduit un certain nombre d'études pour examiner tous les éléments de l'OPA 90. Des études très importantes ont ainsi été faites pour déterminer que les dispositions de responsabilité et de dédommagement de l'OPA 90 étaient l'aspect le plus efficace pour réduire et prévenir la pollution aux Etats-Unis. C'est indispensable pour que l'ensemble du dispositif fonctionne.
M. Jean-Michel BOUR : Y a-t-il eu une augmentation importante du coût de l'assurance ?
M. Jeffrey HULL : Au début, oui. Puis cela s'est atténué de manière spectaculaire depuis quatre ans. Au début, nous avions prévu des centaines de millions de dollars pour mettre en _uvre notre programme COFR dans la loi. Le coût de la première année n'était qu'une fraction de la somme à laquelle nous nous attendions. Ces coûts ont baissé de 300 % depuis trois ans.
M. Jean-Michel BOUR : Cela signifie-t-il que le coût de l'assurance actuelle est inférieur à ce qu'il était en 1990 ?
M. Jeffrey HULL : Non, il est toujours légèrement supérieur, mais bien moins élevé qu'il ne l'a été dans un premier temps.
M. Jean-Michel BOUR : Comment expliquez-vous cela ?
M. Jeffrey HULL : Cela tient au fait que le nombre de grands déversements a diminué. Donc, les sommes que nous payons ont diminué ainsi que le marché de l'assurance dans son ensemble.
Beaucoup de gens disent qu'il y a un excédent de capacité des marchés de l'assurance. Par conséquent, les primes diminuent car de nombreux assureurs se font de la concurrence ; elles diminuent afin d'augmenter l'activité.
M. René LEROUX : Au-delà des problèmes d'environnement, vous est-il déjà arrivé d'avoir à indemniser des collectivités pour une perte d'image due malheureusement à une pollution qui aurait donné à une région, à un site touristique, par exemple, un aspect très négatif ?
Capitaine Derek A. CAPIZZI : La compensation est limitée aux dommages admis par la loi. Les dommages que vous venez de décrire n'y figurent pas.
M. Jeffrey HULL : Toutefois, si une personne privée subit un manque à gagner en raison du déversement...
M. le Président : Comme, par définition, il n'y a pas de manque à gagner pour une collectivité...
M. René LEROUX : Avez-vous accompagné des collectivités pour des campagnes de promotion touristique ?
Mme Jan LANE : Nous n'avons jamais connu ce genre de problèmes mais, le cas échéant, nous examinerions de très près le cas d'une entreprise qui s'occupe du tourisme qui aurait un manque à gagner dû à un déversement. Nous en tiendrions compte.
Capitaine Derek A. CAPIZZI : Les dommages seraient transformés en une demande de dédommagement dans le cadre du secteur privé du tourisme. La réputation est un concept délicat à traiter en termes de manque à gagner. La preuve est difficile à établir en la matière, mais nous ne rejetterions pas la demande d'office, nous demanderions au plaignant de prouver comment, en raison d'une perception du public, il a subi une perte. Une perte d'image est un concept difficile à analyser.
Mme Jan LANE : Vous avez posé une question en termes de dédommagement de la collectivité. Nous n'avons pas de collectivité publique à but lucratif aux Etats-Unis. L'Etat est très peu impliqué dans la gestion du tourisme. C'est le secteur privé qui s'en charge.
M. le Rapporteur : Je reviens sur ce dont nous parlions précédemment : quelle est la proportion d'accidents - en 1999 par exemple - dans lesquels votre décision de remboursement a été contestée par l'assurance du pollueur ? Je ne comprends pas le mécanisme que vous nous avez décrit. Vous dites que le coût est de tant, que le pollueur doit payer tant ; vous reprenez la liste de la page 14 et vous dites que le pollueur doit payer ceci et cela. C'est vous qui évaluez le préjudice. Inévitablement, si l'assureur est pointu, il va contester, non ?
Mme Jan LANE : Cela dépend du type de préjudice. Il y a différents types de coûts. Pour le coût du nettoyage, le coordinateur fédéral a la responsabilité finale de la gestion de toute l'activité de dépollution. C'est lui qui décide des moyens nécessaires, après concertation avec l'Etat, le responsable et l'assureur. Nous espérons qu'ils parviennent à un accord sur la dépollution, mais en cas de désaccord, c'est le coordinateur sur place qui a le dernier mot. Nous respectons sa décision. Nous affecterons à la partie responsable tous les coûts encourus.
En ce qui concerne le remboursement des tiers et les accords d'appréciation pour les demandes de parties tierces - particuliers, personnes morales ou autres - qui ont subi des préjudices à la suite du déversement, il faut d'abord s'adresser à la partie responsable, si cela est possible. Dans le cas contraire, les parties tierces s'adressent à nous. L'une des premières choses que nous faisons est de retourner voir la partie responsable pour essayer de déterminer le processus et de voir la solution qu'elle envisage, pour connaître les raisons de son refus de compromis avec les parties tierces. Mais en fin de compte, notre décision est le résultat d'un examen indépendant, d'une décision indépendante, puisque nous avons l'autorisation, selon la loi, de rembourser.
Pour les atteintes aux ressources naturelles, c'est un processus différent, bien plus compliqué. Il n'y a pas de particulier qui subisse l'incidence.
Capitaine Derek A. CAPIZZI : Permettez-moi d'ajouter que quand nous imputons à la partie responsable les coûts juridiques et les coûts de dédommagement que nous avons payés, nous déterminons une somme, mais les tribunaux ne sont pas obligés de l'appliquer. Si nous ne parvenons pas à trouver un accord de paiement avec la partie responsable, nous sommes contraints de l'attaquer devant un tribunal. Nous demandons des sommes en fonction du bien-fondé de notre demande. S'il y a faute, nous devons le prouver devant le tribunal.
M. le Président : Avez-vous une liste de compagnies d'assurances recommandées parce que susceptibles de prouver, par leur sérieux, leur capacité à couvrir les montants importants en jeu ? Car nous parlons ici de dizaines voire de centaines de millions de dollars.
M. Jeffrey HULL : Oui, les assureurs doivent être homologués par nous. Nous examinons leurs finances, leurs opérations, leur capacité de traiter les demandes, leur réassurance, toutes leurs autres activités. Une fois cela fait, c'est alors seulement qu'ils peuvent nous donner des garanties d'assurance.
M. le Président : Cette liste de compagnies d'assurances se compose-t-elle de compagnies travaillant uniquement aux Etats-Unis ou connectées avec les Etats-Unis ?
M. Jeffrey HULL : Non, il n'y a aucune obligation de ce genre. Certaines ne s'occupent que de ce type d'assurance aux Etats-Unis, mais d'autres sont internationales. Par exemple, nous venons juste d'admettre AXA, la société française d'assurance. AXA nous a fourni ses garanties pour le compte de ses clients.
M. Jean-Michel BOUR : Lors d'un entretien que nous avons eu précédemment, vous avez dit qu'il y avait eu des controverses avec des sociétés de défense de l'environnement sur la méthode utilisée pour évaluer les dommages écologiques. Comment faites-vous l'évaluation ? Sur la base d'un coût de remplacement ?
Mme Jan LANE : Nous évaluons le coût de dédommagement, de la restauration.
Capitaine Derek A. CAPIZZI : Les dommages prévus dans la loi sont le coût de la restauration, le remplacement des ressources naturelles perdues, la diminution de la valeur de ces ressources en attendant la restauration, ou le coût d'évaluation des dommages. Grosso modo, les atteintes à l'environnement.
M. Jean-Michel MARCHAND : La restauration d'un écosystème peut demander des dizaines d'années. Les coûts d'évaluation tiennent-ils compte de cette durée ? Assumez-vous ces coûts sur autant d'années ?
Capitaine Derek A. CAPIZZI : Nous pouvons couvrir les coûts de restauration sur un nombre élevé d'années. Il est fort possible que pour cela, il nous faille plusieurs années. Cela varie d'un cas à l'autre. Mais un plan de restauration peut être établi sur plusieurs années.
Mme Jan LANE : Dans ce domaine, vous rencontrerez la National Oceanographic and Atmospheric Administration - la NOAA. C'est l'expert des Etats-Unis en la matière.
M. Jean-Michel MARCHAND : Continuez-vous à financer les dommages à la suite de la catastrophe de l'Exxon Valdez en Alaska ?
M. Jean-Michel BOUR : L'OPA a été adoptée après.
Capitaine Derek A. CAPIZZI : L'OPA ne s'applique pas à l'Exxon Valdez.
M. René LEROUX : Pouvez-vous nous préciser combien a coûté la catastrophe de l'Exxon Valdez ?
Mme Jan LANE : 2,5 milliards de dollars, selon les dernières informations dont je dispose.
M. le Président : Cela veut dire que l'on est largement au-dessus du maximum du milliard de dollars dont vous parliez tout à l'heure. Si la même chose se reproduisait, de façon encore plus importante - imaginez la Floride touchée -, cela signifierait qu'il faudrait augmenter les ressources du fonds.
Mme Jan LANE : Les rédacteurs de la loi n'avaient aucune idée du coût de cet accident.
M. le Président : Si cela devait se produire, il faut espérer que la partie responsable serait solvable. Cela veut-il dire qu'il faudrait augmenter les ressources du fonds ?
Mme Jan LANE : Ce serait probablement l'issue d'un tel accident. On reconnaîtrait que le plafond de l'accident stipulé par la loi est trop bas. Et je peux prédire qu'ils ne pourront pas le rendre rétroactif. Il y aura des coûts d'indemnisation dans le cas d'un tel scénario.
M. le Rapporteur : Dans le cas de l'Exxon Valdez, il y avait faute. Donc, de toute façon, le plafond de responsabilité de l'entreprise était illimité.
Mme Jan LANE : Il est très difficile de savoir ce qui se serait passé si l'OPA avait été vigueur.
M. Aimé KERGUERIS : En plus des indemnisations, l'Etat de l'Alaska a-t-il imposé des amendes ?
Mme Jan LANE : Je n'en connais pas le détail, mais je sais qu'il y a eu des réparations dans le cadre de la loi adoptée par l'Etat de l'Alaska.
M. le Président : Il nous a été dit lors de nos auditions, que l'Etat de l'Alaska avait imposé des pénalités très importantes à la compagnie Exxon.
Mme Jan LANE : C'est exact.
M. Jean-Michel BOUR : L'OPA 90 a dix ans. L'expérience a montré que cette loi semblait, pour le moment, avoir été efficace. Cependant le NPFC, en tant que principal organisme chargé de la mettre en _uvre, est certainement, pour ce qui concerne le nettoyage et le remboursement, l'un des organismes les mieux à même de juger de l'efficacité de l'OPA. Si celle-ci devait être amendée, quelles suggestions feriez-vous ?
Mme Jan LANE : Vous avez vu la limite de responsabilité pour certains types de navires. Je pense que nous pourrions examiner cela de plus près. Nous avons un taux de recouvrement de 100 % pour les bateaux possédant un COFR. Or, nous avons un taux de recouvrement nettement inférieur pour les navires qui ne sont pas obligés d'avoir un COFR. Je pense qu'il serait peut-être difficile politiquement d'étendre cet impératif à d'autres navires. L'industrie résistera et s'opposera à une telle modification, mais vous ne pouvez pas ne pas constater les résultats.
Il est très clair que ce volet du programme de la loi est très efficace. Nous avons vu des plafonds maxima de responsabilité imposés aux pétroliers. Pour les autres navires qui transportent des produits tout aussi dangereux que les pétroliers, les chalands par exemple nous pouvons envisager de relever les plafonds de responsabilité qui sont actuellement assez bas. Notre expérience nous a montré que les chalands posent un risque beaucoup plus grand de déversement d'hydrocarbures que les pétroliers.
Le plafond de responsabilité pour le déversement à San Juan a été de 10 millions de dollars et il a fallu 100 millions de dollars pour le nettoyage et l'indemnisation de ceux qui avaient subi des préjudices.
Nous avons des experts en justice et des limites ont été posées. Nous poursuivons devant la justice. C'est une question qui nous intéresse. Si nous étions un autre pays, nous pourrions recommencer à zéro, mais c'est difficile.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous faire un bref rappel de l'événement de San Juan ? Vous y avez fait référence à plusieurs reprises.
Mme Jan LANE : Bien sûr. Mais vous intéressez-vous aux aspects juridiques de l'affaire ?
M. le Rapporteur : Nous nous intéressons aux observations que vous venez de faire, qui montrent certaines limites de l'OPA 90 et la nécessité d'aller en justice.
Mme Jan LANE : Oui.
M. Jeffrey HULL : Souhaitez-vous disposer d'une synthèse de l'accident ?
Capitaine Derek A. CAPIZZI : Je ne me souviens pas très bien des détails de l'accident...
M. le Président : Il ne s'agit pas seulement des détails de l'accident en lui-même, mais plutôt des remarques que vous avez pu faire par la suite sur les limites de l'OPA 90.
M. le Rapporteur : Au cours de l'entretien, vous avez fait référence à plusieurs reprises à cet exemple. Il serait intéressant que nous ayons des détails, pour nous rappeler cet événement, et la nécessité pour vous d'aller en justice.
Capitaine Derek A. CAPIZZI : En janvier 1994, dans le port de San Juan, Porto Rico, un remorqueur remorquant un chaland a perdu le contrôle et le chaland s'est échoué sur un récif. Le déversement a été abondant et a affecté l'industrie du tourisme et les pêcheurs locaux. C'était le deuxième grand accident après la promulgation de l'OPA et le seul à exiger que l'on se penche de manière très approfondie sur le problème des dédommagements.
Le coût du nettoyage était très élevé, il dépassait les 70 à 80 millions de dollars. La partie responsable, le propriétaire du chaland, n'a pu établir ses limites, au moins au cours de son audition, et a été reconnue responsable de l'accident au plan criminel. Mais il n'avait que peu d'argent, étant donné que la limite de responsabilité n'était que de 10 millions de dollars. Le montant disponible au titre du COFR ne suffisait pas à couvrir une bonne part des dégâts et des dommages.
Maintenant, nous sommes engagés dans une action contre le nombre de parties qui se dissimulent derrière la partie responsable pour recouvrer nos propres coûts. Ce procès a été très long. Je peux vous donner des détails. Pour l'instant, nous avons affaire à un assureur de l'une des parties responsables qui avait des intérêts au niveau de l'hypothèque.
M. Jeffrey HULL : Ce qui est important, ce n'est pas tant que cinq ans après l'accident nous cherchions toujours à nous faire rembourser auprès des parties responsables, mais que le fonds ait été capable de couvrir le coût du nettoyage. Nous avons même monté un bureau des plaignants.
M. le Rapporteur : Combien de tonnes ?
Capitaine Derek A. CAPIZZI : 3 500 tjb.
M. le Rapporteur : Il y a des similitudes entre cet exemple et l'Erika, car ce sont des côtes extrêmement difficiles à nettoyer. Il faut faire intervenir des alpinistes...
Mme Jan LANE : Cela rappelle aussi l'Exxon Valdez.
M. le Rapporteur : ... juste avant une saison touristique, dans une zone très touristique !
M. le Président : Nous vous remercions de tous ces éléments.
Mme Jan LANE : Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information et pour aider les autres pays à éviter de tels problèmes.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être relue par les intervenants.
Audition de M. Wayne T. GILCHREST,
président de la sous-commission
chargée de la Coast Guard et du transport maritime
à la Chambre des représentants,
et de M. Eric WEBSTER, directeur de cabinet
(procès-verbal de la séance du 18 mai 2000 à Washington)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
(L'entretien débute avec M. Eric Webster, seul)
M. le Président : Je vous remercie de nous accueillir ce matin. Nous comprenons très bien les impératifs de M. Gilchrest ; nous-mêmes connaissons aussi cela à l'Assemblée nationale.
La visite que nous effectuons depuis deux jours aux Etats-Unis fait suite à la catastrophe qui a eu lieu il y a quelques mois sur les côtes occidentales françaises, consécutivement au naufrage de l'Erika. Nous avons été missionnés par l'Assemblée nationale afin de définir des orientations susceptibles d'améliorer les conditions de sécurité des transports maritimes pour les produits polluants et dangereux.
C'est un problème qui ne concerne pas uniquement la France, pas uniquement l'Europe. La preuve en est que vous avez également subi de tels sinistres en 1990 et depuis, ce qui prouve bien que les décisions législatives ne sont pas toujours suffisantes pour faire face à ce type de catastrophes. Mais il est vrai que les Etats-Unis ont mis en place, en 1990, un dispositif original, à l'échelle du pays. Nous sommes donc venus ici, non dans le but de chercher à copier ce que vous avez mis en place, car les conditions ne sont pas les mêmes, mais pour étudier les principes qui vous ont inspirés et, éventuellement, en déduire des orientations qui pourraient s'avérer utiles pour la France, mais aussi pour la communauté européenne dans laquelle nous vivons, dans la mesure où ce type de problèmes ne concerne pas, c'est évident, un seul pays, mais un ensemble de pays voisins.
Telles sont les questions qui justifient notre présence ici. Nous serions heureux d'en discuter avec vous et de voir les conclusions que nous pourrions en tirer.
M. Eric WEBSTER : Nous avons eu plusieurs auditions sur le sujet de l'Oil Polution Act de 1990. Cela depuis deux ans, afin de mieux comprendre si les modifications promulguées en 1990 sont toujours pertinentes aujourd'hui. Bon nombre d'éléments de cette loi étaient, à l'époque, révolutionnaires, fort différents de la manière habituelle de traiter ce genre de questions. En parcourant le pays, nous avons vu de près l'incidence positive de cette loi. Je pense notamment aux accords d'intervention et aux organisations qui ont été mis en place pour répondre à un déversement d'hydrocarbures en milieu marin. Je pense qu'en fonction de la manière dont votre Gouvernement envisage la situation, c'est une des meilleures qualités de cette loi.
M. le Rapporteur : Nous l'avons fait.
M. Eric WEBSTER : Ce sont vraiment les spécialistes. M. Wayne T. Gilchrest les apprécie et dépend de leurs informations et de leur expertise. Je suis heureux que vous ayez eu l'occasion de les rencontrer.
L'autre élément, à côté de la Coast Guard, c'est l'OMI. Le congressman Gilchrest s'est rendu deux fois à Londres pour participer à une réunion de cette organisation. De tous les corps législatifs, parlementaires, qu'il a vus, pour lui, l'OMI est certainement l'un des meilleurs. Nous faisons confiance à la Coast Guard et à l'OMI pour nous aider à comprendre la dimension internationale de ces problèmes.
Pour revenir à nos auditions et à nos enquêtes, l'un des problèmes potentiels que nous avons prévu est le suivant : lorsque vous promulguez une loi pour réagir à un événement spécifique, par exemple au naufrage d'un bateau ou à un déversement de pétrole, vous l'examinez dans un contexte précis, lié à une époque précise - par exemple, 1990 ou 2000 -, à une technologie et à une manière pour faire face à ce problème. Or, ce contexte évolue au fil des années, et la technologie de dépollution change également.
A notre avis, le cadre de l'OPA ne permet pas d'évoluer au fil du temps. Prenons l'exemple des pétroliers à double coque. Il existe des technologies nouvelles aujourd'hui, que ce soit celle que l'on peut mettre en _uvre pour déterminer une meilleure conception de navire ou une meilleure technologie de réduction d'un déversement. Nous espérons mettre à jour le calcul et les recherches qui permettent de faire progresser la conception.
Voilà ce que je peux dire de prime abord, mais je pense qu'il serait plus facile que je réponde à vos questions.
M. le Rapporteur : Ce que vous venez de dire signifie-t-il qu'il va y avoir une révision de la loi de 1990, ou qu'il existe déjà un rapport de la Chambre des Représentants sur cette loi ?
M. Eric WEBSTER : Comme je l'ai dit, nous avons déjà tenu deux auditions.
Lors des auditions, nous entendons le témoignage de groupes de défense de l'environnement, des sociétés de tankers, la Coast Guard, toute une palette de participants. Nous pouvons vous donner des renseignements plus précis sur ces auditions.
D'autres administrations ou d'autres personnes ont aussi profité d'une certaine manière du libellé de la loi rédigée en 1990. Une évolution spectaculaire ne sera pas facile à réaliser, mais je crois que, peu à peu, grâce à une sensibilisation continue, à une information renouvelée et à la mise en lumière de nouvelles technologies, nous pourrons commencer à débattre de nouvelles modifications.
Mais, il ne faut pas se leurrer, nous rencontrerons de fortes résistances de la part de groupes de défense de l'environnement et d'entreprises qui ont investi dans les technologies actuelles. Ils ne souhaitent aucun changement et estiment que cela permettrait à des groupes moins progressistes de ne pas être responsabilisés.
Nous espérons donc pouvoir apporter des modifications, mais ce ne sera pas pour demain.
M. le Rapporteur : Sur quels points souhaitez-vous apporter ces changements ?
M. Eric WEBSTER : Nous souhaiterions envisager une meilleure compréhension, une nouvelle technologie des navires ainsi qu'une nouvelle façon dont la Coast Guard passe en revue les déversements de pétrole. La méthode employée aujourd'hui par les Coast Guards est différente de celle de l'OMI : ils tiennent compte du nombre de déversements, qui constitue pour eux un critère plus important que la quantité de pétrole déversée en un seul déversement. Par exemple, cinq déversements de faible quantité sont bien pires, à leur avis, qu'un seul grand déversement. C'est l'un des points que nous essayons de modifier, en collaboration avec eux. Quand ils modifieront le calcul, nous pourrons participer à l'examen des technologies nouvelles car actuellement, ils refusent de faire des essais sur les technologies nouvelles parce qu'ils estiment que celles-ci sont moins efficaces que, par exemple, la double coque. Ce n'est qu'un exemple.
M. le Président : Si j'ai bien compris, vous estimez que l'orientation touchant à la double coque pourrait être remise en cause ?
M. Eric WEBSTER : Non, c'est une orientation très efficace. Cependant, cette orientation a été décidée en 1990 en raison d'une technologie qui était la technologie d'une époque. Nous souhaitons toujours que le plus grand nombre de navires possède une double coque - surtout les pétroliers -, mais nous voulons que les chercheurs et les entreprises se tournent également vers l'avenir, ce qui n'est pas le cas actuellement. On ne donne pas suffisamment de chances aux nouvelles technologies.
M. le Président : Un chantier naval en France a développé un système de double coque, avec un dispositif un peu différent de celui préconisé aux Etats-Unis. Cela veut-il dire que ce système pourrait être mis dans la discussion touchant à une amélioration des navires à double coque, tels qu'ils ont été développés depuis quelques années aux Etats-Unis ?
M. Eric WEBSTER : M. Gilchrest croit fermement que l'OMI est un bon organisme. Il souhaite qu'il y ait un débat collectif sur la question technologique et que tout le monde soit sur la même longueur.
Une autre question, qui va de pair avec celle de la double coque, est que bon nombre de navires ne sont pas des tankers transportant beaucoup de pétrole mais en ont juste pour leur propre usage : on pourrait développer une autre technologie, juste nécessaire pour permettre de minimiser leurs déversements. A mon avis, ce sera la prochaine phase à envisager car, avec la très bonne efficacité de la double coque sur les pétroliers, ce sont tous les navires commerciaux qui auront bientôt des doubles coques. Il faut donc examiner d'autres types de navires et voir comment minimiser l'incidence de leurs éventuels naufrages, de leurs déversements.
La France dispose-t-elle d'équipes d'intervention similaires à celle de la Coast Guard, toujours prêtes à réagir ? Dans le cadre de l'OPA, les entreprises devaient dépenser de l'argent afin de participer à l'établissement de ces équipes d'intervention. Par exemple, à Hawaï, en raison de la nature encore vierge de l'île, il existe des bateaux très sophistiqués, avec du personnel très performant, des ordinateurs, des modèles qui sont près à réagir à tout déversement possible. Hawaï dépend du tourisme et tout déversement serait inacceptable sur ses plages, non seulement d'un point de vue environnemental, mais également économique. Donc, cet Etat et l'Etat fédéral ont travaillé en collaboration avec les entreprises pour mettre sur pied un excellent dispositif d'intervention. C'est sans doute un système que vous pourriez envisager.
Toutefois, la meilleure technologie du monde n'empêchera jamais qu'une catastrophe se produise. Nous devons dépenser beaucoup d'argent et déployer beaucoup d'efforts pour pouvoir apporter des réponses à ce problème.
M. le Rapporteur : Je reviens sur les technologies. A l'OMI, on reproche aux Etats-Unis d'avoir créé une sorte de monopole sur la double coque et d'avoir imposé cette technologie à tout le monde, alors que d'autres possibilités techniques vont apparaître. Etes-vous prêts à modifier votre position et à faire en sorte que des bateaux qui n'ont pas de double coque mais qui présentent des garanties de même niveau, puissent être admis dans les eaux américaines ?
Par ailleurs, pourriez-vous développer ce que vous disiez à propos de cette nouvelle génération de pétroliers qui, si j'ai bien compris, permettrait de régler le problème des résidus de propulsion ? Cette recherche technologique se fait-elle dans les chantiers navals ?
M. Eric WEBSTER : Vous avez tout à fait raison en disant que les Etats-Unis ont obligé les autres à accepter la technologie de la double coque. Que pourrais-je dire de plus ?
Toutefois, M. Gilchrest essaie de travailler avec la Coast Guard afin de modifier la manière dont on examine les déversements, que cela aille plus dans le sens de l'OMI. Cela permettrait à d'autres technologies de pouvoir être considérées comme aussi efficaces que la double coque. Nous examinons un déversement et la quantité de pétrole qui en sort.
M. le Rapporteur : Quand vous parlez de déversements, vous vous situez dans un contexte de naufrage ?
M. Eric WEBSTER : Oui, en cas de catastrophe touchant un pétrolier.
Nous essayons de sensibiliser les autres, aux Etats-Unis, au fait qu'il convient de mieux travailler avec les autres pays de la communauté internationale afin de parvenir à une meilleure solution. Cependant, bon nombre d'intérêts aux Etats-Unis dépendent de la technique de la double coque, notamment les syndicats de la construction navale et les entreprises américaines qui ont déjà investi dans ce concept. Ceux-ci accepteront moins volontiers le changement. Ce sera une rude bataille.
M. le Rapporteur : Ce n'est pas tout à fait ce que suggérait ma question. Je comprends qu'il y ait une technologie américaine à préserver. Ma question est celle de savoir si des bateaux dotés d'une autre technologie présentant des garanties similaires, pourraient être autorisés à entrer dans les ports américains.
M. Eric WEBSTER : La Coast Guard n'acceptera pas d'accorder la même valeur à ces technologies qu'à la double coque. C'est ce que nous allons nous employer à faire modifier.
M. le Rapporteur : Cela se modifie par la loi ou par le règlement ?
M. Eric WEBSTER : Par la loi. En ce qui concerne le budget de la Coast Guard, nous leur avons demandé de revoir leur copie. Nous attendons. Nous n'avons pas encore reçu le rapport définitif.
M. le Rapporteur : Qu'entendez-vous par copie ?
M. Eric WEBSTER : Je me réfère là au formulaire d'évaluation de l'efficacité d'une technologie, celui qui évalue la performance de la technologie contre les accidents.
Nous nous sommes entretenus avec deux entreprises qui offraient des options différentes, des solutions de rechange aux navires à double coque. L'une d'elles, par exemple, consiste à utiliser du gaz pour faire pression sur le pétrole pour qu'en cas de déversement, la quantité de pétrole déversée soit moindre. La Coast Guard n'a pas voulu mettre à l'essai cette technologie. L'autre consiste à utiliser l'échange de ballast, mais les résultats n'ont pas encore été évalués. Ce sont là certaines des nouvelles technologies dont je parlais tout à l'heure.
Votre seconde question concerne la propulsion qui consiste à minimiser le volume de carburant déversé par un pétrolier ou d'autres navires - commerciaux ou de ligne -, qui ne sont pas à double coque. Nous voulons nous pencher sur la technologie à double coque et sur la technologie qui serait aussi efficace. Il faut également savoir ce que l'on entend faire des navires commerciaux.
Récemment, un navire a fait naufrage sur la côte ouest. Le risque de déversement était considérable. Plusieurs membres du Congrès voulaient invoquer de nouvelles règles et de nouveaux règlements concernant les capitaines et les sociétés, car ils pensaient que leurs compétences et leurs qualités de marins laissaient à désirer. C'est aussi une question qui intéresse certains législateurs au Congrès.
Comme nous le savons, dans la navigation internationale, de nombreuses compagnies battant pavillon de complaisance emploient des équipages originaires des pays du Tiers-Monde, qui souvent n'ont pas la même formation que les marins européens. C'est un autre problème qui intéresse également les membres du Congrès.
M. Gilchrest s'est rendu à Amsterdam pour assister à une conférence dont le thème était la remise à niveau de la performance des navires à travers le monde afin de faire face à cette situation.
Nous pensons néanmoins qu'il vaut mieux traiter ces sujets au sein de l'OMI, pour que cela ne soit pas imposé par les médias ou les membres du Congrès. Mais c'est toujours difficile. En France également, je suis sûr que le Parlement et l'exécutif ne sont pas du même avis. M. Gilchrest a toujours cherché à sensibiliser les autres et à les inviter à la discussion. Nous sommes très sensibles aux soucis et aux préoccupations des autres pays : ceux-ci nous concernent et concernent la Coast Guard américaine qui pourrait imposer certaines choses. M. Gilchrest préfère la conciliation et répète souvent que l'OMI est la meilleure des enceintes pour traiter ces problèmes.
M. le Rapporteur : Vous parliez tout à l'heure de pavillon de complaisance. Considérez-vous que le Liberia soit un pavillon de complaisance ? Quels sont, selon vous, les critères qui définissent un pavillon de complaisance, parce que le Liberia ne se considère plus comme tel ? Les responsables du registre libérien nous l'ont dit hier.
M. Eric WEBSTER : Tant mieux alors ! (Sourires.) Plusieurs membres du Congrès craignent que des compagnies préfèrent arborer certains de ces pavillons - car souvent ces pays ne poursuivent pas en justice, ne mènent pas d'enquêtes et ne suivent pas les problèmes jusqu'au bout, comme le font les Etats-Unis. C'est la préoccupation majeure.
M. le Rapporteur : En Europe, on considère que le Liberia est le pavillon américain bis. L'impression que nous avons eue hier allait plutôt dans ce sens parce que le siège de l'administration maritime du Liberia ne se trouve pas à Monrovia, mais à Washington et que l'encadrement, le brain trust, est composé essentiellement de cadres américains issus de la Coast Guard.
M. Eric WEBSTER : Bien sûr. Ils paient bien ! (Rires.)
En raison de la loi sur le cabotage pour les pavillons américains, les navires doivent être construits aux Etats-Unis, appartenir à un Américain et observer toutes les règles de la législation du travail.
M. le Président : Pour le cabotage, un navire doit-il avoir un équipage américain ?
M. Eric WEBSTER : Oui, pour le cabotage. C'est la raison pour laquelle, en raison de la nature très rigoureuse de ces lois, la plupart des sociétés américaines ont décidé de battre un autre pavillon. C'est plus rentable. Nous avons donc en place un système qui encourage, si je puis dire, les Américains à battre d'autres pavillons. Mais il n'y a jamais suffisamment de débats pour modifier cette loi. Le syndicat des marins, le syndicat des constructeurs navals et les autres syndicats ont tous beaucoup d'influence et il est difficile d'entamer un débat sur la possibilité d'amendement de la loi.
M. le Rapporteur : Pensez-vous que si le cabotage américain était ouvert, le Liberia serait moins fort ? Je ne comprends pas bien. Les bateaux libériens ne peuvent pas faire de cabotage.
M. Eric WEBSTER : Je pense que la concurrence est une bonne chose, mais certains éléments au sein de la société américaine ne sont pas du tout disposés à en discuter.
A titre d'exemple, même concernant les paquebots de croisière, il y a eu plusieurs législations rien que pour amender les lois concernant le cabotage des passagers. Cela ne va jamais très loin en raison des éléments que je mentionnais. Aussi devons-nous faire preuve de beaucoup de délicatesse à leur endroit, mais certaines des restrictions concernant le cabotage aux Etats-Unis devaient être modifiées. Si nous allions plus loin, il y aurait un plus grand nombre de navires battant pavillon américain. Mais je crains que cela demande plusieurs années avant qu'un véritable débat ne s'installe pour modifier ces législations.
M. le Rapporteur : La loi sur le cabotage date de quelle année ?
M. Eric WEBSTER : Elle date de 1920.
M. le Rapporteur : Combien y a-t-il de bateaux américains, globalement, affectés au cabotage ?
M. Eric WEBSTER : Je ne sais pas.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous avoir la proportion de bateaux de cabotage libériens ?
M. Eric WEBSTER : Il faudrait vous adresser à l'administration maritime pour cela ou à la Coast Guard.
Cette navigation de cabotage se charge souvent du transport de produits agricoles, en raison du nombre restreint des bateaux.
M. Jean-Michel BOUR : Il y a tout le Mississippi.
M. Eric WEBSTER : Un grand nombre de personnes qui travaillent dans l'agriculture et qui aspirent à une concurrence accrue insistent sur la modification de la loi concernant le cabotage.
M. Jean-Michel MARCHAND : Vous avez dit que l'OMI est une organisation excellente, voire parfaite. Cependant, les mesures que vous avez prises dans le cadre de l'OPA 90 l'ont été de façon unilatérale. Vous pensez bien que la France et l'Europe s'interrogent pour prendre des dispositions semblables et je suis interrogatif lorsque vous dites que l'OPA de 1990 risque d'être révisée. Souhaitez-vous l'assouplir, la rendre moins rigoureuse pour qu'elle soit mieux adaptée au marché ?
M. Eric WEBSTER : Tout d'abord, je ne peux parler qu'au nom de M. Gilchrest. Sa position ne reflète pas celle du Congrès.
L'accident de l'Exxon Valdez a été une véritable catastrophe et tout le monde a réagi. L'OPA 90 en fut le résultat. Mais c'était également un processus très politique, en raison de la diversité des intérêts en jeu. Je ne connais pas les règles et les normes internationales concernant les accidents pétroliers avant cette date mais, à cette époque, les ravages causés par l'accident ont affolé le Congrès. Il lui a fallu réagir avec vigueur. Aujourd'hui, je pense, au moins pour ce qui est de M. Gilchrest, que l'on s'intéresse beaucoup plus à un effort coopératif au niveau international. Cependant, si l'Europe ou la France devaient connaître une catastrophe d'une même ampleur...
M. le Rapporteur : C'est bien ce qui se passe.
M. Eric WEBSTER : C'est donc à vous qu'il appartient de décider ce qu'il faut faire, ce qu'il y a de mieux à faire, sachant que l'OPA 90 existe et que nous souhaitons une plus grande participation à l'OMI.
La révision de l'OPA 90, du point de vue de M. Gilchrest, consisterait à l'assouplir afin de la rendre plus adaptable à l'avenir, pas seulement en raison de l'époque à laquelle elle fut créée, mais aussi pour qu'elle ne reste pas liée à cette date.
M. Jean-Michel MARCHAND : J'entends bien vos propos, mais les mesures que vous avez prises en 1990 ont déplacé un certain nombre de bateaux vers nos côtes, en particulier les plus mauvais. Etes-vous prêts à nous soutenir au sein de l'OMI pour que des mesures aussi fortes que celles que vous avez prises soient appliquées au niveau international et que les assouplissements que vous envisagez garantissent toujours que les pollueurs resteront les payeurs ?
M. le Président : Pour compléter la question de M. Marchand, au sein de l'OMI, un certain nombre de forces ne veulent pas entendre parler de mesures plus rigoureuses et font tout pour freiner une avancée. Le mode de fonctionnement de l'OMI accorde une place très importante à un certain nombre de pays qui, comme le Panama, la Grèce, le Liberia ou d'autres, ne veulent pas de ces règles. Le problème est plus de convaincre l'OMI d'adopter des dispositions semblables à ce qui a été fait aux Etats-Unis que d'assouplir celles des Etats-Unis pour aller vers un consensus au sein de l'OMI, ce qui serait un retour en arrière dramatique.
M. Eric WEBSTER : Oui.
M. le Président : La position américaine ne devrait-elle pas plus être celle d'un soutien à l'Union européenne de façon à ce que des dispositions du même type que celles mises en _uvre ici soient mises en place sur le continent européen et que l'OMI soit amenée à imposer à l'ensemble des Etats du monde, à l'ensemble des armateurs du monde, quels qu'ils soient, les mêmes obligations ?
M. Eric WEBSTER : Avez-vous posé la question à la Coast Guard ?
M. le Président : Nous ne l'avons pas fait parce qu'il me semble que c'est une décision qui ne lui appartient pas. La décision est politique.
M. Eric WEBSTER : Certes, cependant le Congrès attache beaucoup d'importance et fait confiance à la Coast Guard. Dans cette même logique, pourquoi la France ne peut-elle pas promulguer une loi similaire à l'OPA 90, qui l'assurerait que les navires trop âgés ou ceux dont la construction n'est pas suffisamment sûre ne peuvent entrer dans ses eaux ?
M. le Président : La configuration géographique des Etats-Unis n'est absolument pas la même que celle de la France. Il faudrait plutôt la comparer à la configuration européenne. Or si les Etats-Unis sont un Etat fédéral, ce n'est pas le cas de l'Union européenne. Il n'existe pas d'autorité européenne. Ce que la France peut décider peut se heurter tout simplement aux décisions de la Grande-Bretagne, par exemple, et poser le problème du passage dans la Manche et dans la Mer du Nord. Le problème est donc politique et il s'agit de faire en sorte que, même si l'Union européenne n'est pas un Etat fédéral, une pression suffisante soit exercée pour que ceux qui s'opposent aux décisions du type de celles que vous avez prises en 1990, cèdent.
Nous avons, au sein de l'Union européenne, un certain nombre d'Etats qui ne sont pas près de bouger - la Grèce, par exemple - et comme un certain nombre d'intérêts américains sont derrière les armements grecs, maltais ou libériens, c'est bien de volonté politique qu'il s'agit. C'est la volonté politique qui fera que l'on mettra en premier la défense de notre environnement contre les pollutions plutôt que d'autres intérêts.
M. Eric WEBSTER : Votre situation est difficile. Les Etats-Unis et la Coast Guard ont-ils refusé de débattre de ce problème à l'OMI ?
M. le Président : Pas du tout.
M. Eric WEBSTER : Nous en discuterons avec la Coast Guard pour mieux comprendre leur point de vue et forger celui de M. Gilchrest. Il serait d'accord avec vous mais, vous l'avez dit, c'est un grand problème politique, même au sein de l'Union européenne et de l'OMI. Personnellement, il ne peut pas tout faire, mais il accepterait d'essayer. Il faut poser ces mêmes questions à M. Oberstar. Il n'aura pas forcément le même avis sur la question. Mais je précise que M. Gilchrest n'a rien contre la loi sur le cabotage, il estime simplement qu'il faut qu'un débat ait lieu sur le sujet.
M. le Rapporteur : Je ne suis pas certain que l'on se comprenne bien. D'un point de vue personnel, je trouve intéressant que les Etats-Unis réservent à leur pavillon leur propre cabotage. Les Européens pourraient faire pareil ; ce serait une bonne chose. Mais c'est un autre problème. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui est celui de l'Organisation maritime internationale, en dehors du cabotage.
Vous nous dites que M. Gilchrest peut nous aider sur tel ou tel problème mais je n'ai pas compris sur lequel exactement. Il faudrait dire que les Etats-Unis accompagneront les initiatives qui pourraient être prises par l'Union européenne et par la France, en particulier, à la suite de la catastrophe de l'Erika.
Les Etats-Unis ont réagi à l'Exxon Valdez par l'OPA. Ils ont pu le faire étant données leur puissance et leur géographie. Nous, nous ne pouvons sérieusement répondre à ces catastrophes qu'en agissant au sein de l'OMI. Nous ferons des propositions en ce sens. La bonne manière de nous aider serait de nous accompagner. Mais jusqu'à présent, vous avez réglé ce problème seuls, parce que vous pouvez le faire sans l'OMI, puisque l'OPA s'est faite sans l'OMI et même contre l'OMI dans la mesure où la double coque s'est décidée en dehors de l'OMI.
(M. Gilchrest entre dans la salle.)
M. Eric WEBSTER : (expliquant à M. Gilchrest.) Ils aimeraient savoir si les Etats-Unis accepteraient d'appuyer des changements analogues à l'OPA 90 au sein de l'OMI, car les Etats-Unis se sont débrouillés seuls après l'Exxon Valdez. Je parlais de votre appui à l'OMI. J'ai également expliqué que le Congrès n'est pas homogène sur ce sujet.
M. Wayne T. GILCHREST : Quelle est la question qui se pose ? Engager l'OMI à adopter un code de conduite international ? Je croyais que l'OMI avait déjà des règles similaires à l'OPA, de manière facultative.
La question est donc la suivante : l'OMI doit-elle adopter des dispositions sur les navires à double coque, ou du moins des règles générales plus rigoureuses, et imposer des règles écologiques plus rigoureuses au sujet des transports internationaux ?
M. Eric WEBSTER : J'ai dit également que vous, ainsi que d'autres parlementaires, pensiez travailler avec la Coast Guard sur ces sujets.
M. Wayne T. GILCHREST : Je souhaite travailler avec la Coast Guard et avec tout le monde qui m'écoute au sein du Congrès. Le Congrès est une place très dynamique. Les questions écologistes sont parmi celles qui nous divisent le plus, mais j'espère cependant travailler avec la délégation américaine auprès de l'OMI et avec toute autre délégation pour la protection des océans du monde.
M. le Rapporteur : Votre sous-commission a-t-elle des contacts réguliers avec les représentants de votre administration à l'OMI ? Les rencontrez-vous régulièrement ?
M. Wayne T. GILCHREST : Oui, nous pouvons les rencontrer périodiquement. Ce n'est pas le cas actuellement. Je parle aux membres de la délégation américaine auprès de l'OMI à peu près tous les trois mois. Mais c'est un survol général de toutes les questions qui se posent. J'espérais travailler en collaboration avec vous afin de mettre sur pied des questions bien précises, afin que la délégation américaine comprenne bien. Lors de réunions de notre sous-commission, on pourrait s'en occuper.
M. le Rapporteur : Est-ce à dire qu'après la catastrophe de l'Erika, vous-mêmes ayant vécu celle de l'Exxon Valdez, vous pourriez accepter de soutenir les efforts français pour une meilleure sécurité en mer que nous porterions devant l'OMI ?
M. Wayne T. GILCHREST : J'espérais bien sûr le faire après avoir vu les dossiers et en avoir parlé. Ma réponse est certainement positive. Le monde est de plus en plus petit ; nous sommes de plus en plus nombreux ; les navires plus grands, plus rapides, plus chargés. Les questions écologistes deviennent des questions de premier plan, mais peut-être pas assez vite.
M. Jean-Michel BOUR : En tant que représentants du Gouvernement français, mes collègues de l'Ambassade de France et moi-même avons engagé récemment une démarche auprès du Département d'Etat. Nous avons remis une copie du mémorandum que la France a envoyé à l'OMI. Ce mémorandum dresse la liste de toutes les propositions que nous comptons faire auprès de la Commission européenne. Nous pourrions vous en envoyer une également.
M. Wayne T. GILCHREST : Bien sûr.
M. le Rapporteur : Nous vous remercions. Cela veut donc dire que nous pouvons poursuivre, Parlement à Parlement, notre conversation sur le sujet ?
M. Wayne T. GILCHREST : Oui. Je voudrais organiser une réunion de suivi. Dans un mois, éventuellement avec les représentants de l'Ambassade. Je pense que nous pouvons élaborer une stratégie commune. J'espère que ce problème disparaîtra ou sera résolu si nous maintenons notre position.
M. le Rapporteur : La catastrophe de l'Erika a provoqué en France une intense émotion, semblable à celle qui avait secoué les Etats-Unis lors de l'accident de l'Exxon Valdez. Notre préoccupation est que cela ne se reproduise plus. Nous devons dans notre rapport suggérer un certain nombre d'orientations. Mais évidemment, sans une action internationale forte, nos efforts seront limités. Votre proposition nous intéresse évidemment. Ainsi, les parlements pourront, à côté des gouvernements, aider à l'amélioration des dispositions.
M. Wayne T. GILCHREST : J'appellerai dès demain les deux leaders de la délégation américaine à l'OMI, pour leur faire part de cette réunion. Lorsque nous aurons reçu le mémorandum présenté par le Gouvernement français, nous nous en entretiendrons avec vous. Nous restons en contact.
Nous vous remercions d'être venus. Excusez encore mon retard, le programme est parfois chargé ici.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être relue par les intervenants.
Audition de M. James OBERSTAR,
vice-président
de la commission fédérale des transports et de l'infrastructure
de la Chambre des représentants
et M. John M. CULLATHER,
directeur de cabinet du vice-président
(extrait du procès-verbal de la séance du 18 mai 2000 à Washington)
Présidence de M. Daniel PAUL, président
M. James OBERSTAR : J'entends que votre commission d'enquête s'occupe d'affaires maritimes, surtout de la question de la pollution des eaux.
M. le Président : Vous le savez, monsieur le président, nous avons connu au mois de décembre dernier une marée noire suite au naufrage d'un pétrolier au large des côtes françaises. Ce naufrage peut être comparable à ce qui s'est passé avec l'Exxon Valdez en Alaska. Vous êtes un francophone averti et vous avez la carte de la France en tête. La pollution s'étend du golfe du Morbihan jusqu'à Noirmoutier, soit 400 km de côtes polluées avec des plages comme celles de La Baule.
L'Assemblée nationale a donc décidé, au mois de janvier dernier, de désigner une commission d'enquête parlementaire, non pour faire le point sur le naufrage de l'Erika, c'est la justice qui en est chargée, mais simplement pour examiner les conditions d'une meilleure sécurité pour les transports maritimes de produits polluants et dangereux. La position de la France au sein de l'Europe tant géographiquement que politiquement fait que l'on ne peut imaginer que des dispositions soient prises unilatéralement. Même si nous souhaitons que notre Gouvernement en prenne un certain nombre dans le cadre national, nous devons envisager de faire des propositions dans le cadre européen. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer depuis trois mois les personnes concernées au sein de la Commission européenne.
Nous avons reçu également des responsables français. Nous sommes allés à l'OMI, à l'IACS, et avons également vu des responsables des P&I Clubs. De plus, nous sommes allés à Malte rencontrer les autorités maltaises.
Puis, nous nous sommes dits que les Etats-Unis avaient, en 1990, élaboré un système allant au-delà de l'OMI, contournant l'OMI, mettant l'OMI devant le fait accompli ; un système dont l'objectif est d'être une réponse globale aux problèmes de sécurité maritime, pour protéger tout simplement les côtes américaines. Il n'est pas question de faire la comparaison entre la France et les Etats-Unis, mais nous avons pensé que le système mis en place par l'Oil Pollution Act de 1990 était sans doute suffisamment intéressant pour que nous venions l'étudier et entendre différents responsables afin de recueillir leur appréciation et, éventuellement, leurs critiques dix ans après, parce que vous avez connu des marées noires depuis. Le système mis en place en 1990 n'a donc pas été suffisant pour les empêcher.
Nous ne sommes pas venus pour copier, mais pour étudier les principes qui pourraient guider une action politique française dans un cadre européen et dans le cadre de l'OMI. Le Gouvernement français a fait de son côté un certain nombre de propositions au niveau de la Commission européenne. La France va présider l'Union européenne à partir du 1er juillet, cela tombe bien. Le Gouvernement français a donc fait des propositions et il a adressé également aux autorités de l'OMI un mémorandum de façon à corseter, à renforcer les dispositions qui existent au niveau international.
C'est dans ce cadre que nous venons vous voir. Nous avons rencontré hier matin les responsables de la Coast Guard et hier après-midi les autorités du pavillon libérien qui sont ici, à Washington. Nous avons vu ce matin le National Pollution Funds Center, à midi M. Gilchrest et nous rencontrerons demain des représentants d'armateurs, des concepteurs de navires ainsi que les autorités dans le domaine de l'environnement, la NOAA.
Tel est notre programme. Nous repartirons demain soir avec sans doute beaucoup d'éléments pour parfaire notre connaissance de votre dispositif. Je vous remercie de nous recevoir car nous savons que votre emploi du temps est fort chargé. Devant l'animation qui règne dans cette grande maison, nous vous en sommes d'autant plus reconnaissants.
M. James OBERSTAR : C'est toujours pour moi un plaisir d'avoir l'occasion de parler français et de rencontrer des personnes d'expression française. Comme le sait très bien M. Jean-Michel Bour, j'accepte volontiers ces occasions malgré les difficultés liées au rythme du Congrès. Nous sommes actuellement en train de débattre du budget militaire, qui s'élève aux Etats-Unis à près de 292 milliards de dollars.
M. le Président : C'est le budget de la France.
M. James OBERSTAR : Pour notre seule défense ! C'est bien trop, les jouets des militaires sont coûteux.
Au moment du naufrage de l'Exxon Valdez, le fait extraordinaire était qu'un saumon valait plus cher qu'un baril de pétrole. Voilà la dimension de cette affaire, car le territoire qui fut touché était un domaine où les saumons sont les plus vigoureux, un lieu de fraie. Le mal fait était immense. Il me semble que la compagnie responsable, Exxon, a dépensé deux à trois milliards de dollars pour la restauration et pour le remplacement des valeurs perdues.
Vingt ans auparavant, nous avions eu la catastrophe du Torrey Canyon. J'étais à cette époque membre de la commission des affaires maritimes et nous avions fait passer un projet de loi supposé cerner ces affaires, mettre en place un système de protection, exiger des normes beaucoup plus élevées.
Ensuite est arrivée cette affaire de l'Exxon Valdez, liée principalement à un problème de conduite du bateau. Mais, le bateau n'était pas construit de façon à résister à un tel choc.
Tout d'abord, nous avons commencé à traiter le problème de ces catastrophes, Exxon Valdez et autres, en suivant trois axes principaux, auxquels l'OPA 90 répondait : comment dédommager ceux qui ont subi des préjudices ; comment empêcher que ce genre d'accident se reproduise à l'avenir et comment établir un code fédéral de conduite à tenir pour évaluer et réparer les dégâts sur les plages et dans la mer.
Nous avons établi un système de réponse rapide, de coordination entre divers niveaux du Gouvernement, qui comprend un système de réponse fédérale de l'Etat et un système de réponse local avec la Coast Guard et le bureau de protection de l'environnement. Vous avez sans doute la même chose en France, car le plus grand problème est de savoir qui doit répondre le premier, comment faire, quelle valeur protéger en premier et quel équipement permettra de répondre le mieux à un tel dégât. C'est ce que nous avons essayé de mettre en place pour empêcher que de tels accidents se reproduisent à l'avenir.
Nous avons également mis en place un système de surveillance des capitaines des bateaux. Si, par exemple, un capitaine a un problème pour conduite sur la route en état d'ivresse, s'il est pris deux ou trois fois par la police, nous avons un registre central auprès du Gouvernement fédéral où tous ces faits sont enregistrés et la compagnie de navigation peut faire une enquête sur son capitaine pour découvrir s'il a des antécédents, s'il a un problème avec l'alcool, la drogue ou autre chose.
Deuxièmement, du point de vue de la construction du bateau, nous avons insisté sur la technique de la double coque.
Troisièmement, pour compenser les dommages causés soit à l'Etat, soit au Gouvernement fédéral dans le domaine public, un fonds a été créé. Il s'agit d'un fonds dédié à un objet précis, un fonds affecté. Ce fonds dispose toujours de l'argent suffisant afin de compenser et de payer les coûts de nettoyage des eaux et des plages.
Ce sont les trois parties principales de l'OPA 90.
Il paraît que vous envisagez, au sein de l'Union européenne, d'aller au-delà de ces principes. D'après ce que j'ai lu, vous avez de très bonnes idées : bateaux de plus de quinze ans interdits d'entrée, boîte noire, une centralisation des informations dans les ports. Cela me paraît être de très bonnes idées. Si vous arrivez à réaliser ce projet, nous pourrons vous copier.
M. le Président : Ou bien collaborer pour aider à le mettre en place !
Vous avez été président de la commission des transports. Quel jugement portez-vous aujourd'hui sur l'OPA 90 ? Considérez-vous que c'est un outil qui a répondu à sa mission ? Pensez-vous qu'il faille le modifier ? Est-il suffisant tel qu'il est ?
M. James OBERSTAR : En matière de sécurité, on n'a jamais fini de travailler. Il faut toujours perfectionner. Nous ne pouvons pas nous en tenir là, mais je dois dire que cette loi nous a bien servi.
M. le Rapporteur : En l'état actuel des choses, est-il prévu d'apporter des modifications à la loi ?
M. James OBERSTAR : Il faut dire que dans ce Congrès, avec les Républicains au pouvoir, il est difficile d'avancer parce qu'ils sont plus ou moins du côté des grandes entreprises et pas tellement du côté de la sécurité.
M. le Rapporteur : Les dispositions que vous avez prises après l'Exxon Valdez étaient des mesures unilatérales de sauvegarde, sans tenir compte de l'OMI. Deux autres sujets marquent également une rupture avec l'OMI : d'une part, la technique de la double coque qui a été imposée par exclusivité, d'autre part, votre non-adhésion au fonds du FIPOL.
M. James OBERSTAR : Notre non-adhésion au FIPOL était liée aux limites très basses de ce fonds.
M. le Rapporteur : Après l'Exxon Valdez, vous avez donc établi un dispositif supplémentaire, mais qui a été développé en fait en dehors de l'OMI. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, chez nous, le traumatisme dans l'opinion publique est aussi fort que celui que vous avez subi lors de l'accident de Exxon Valdez. A mon avis, il sera encore renforcé pendant l'été, lorsque les gens voudront aller à la plage. Il importe vraiment d'agir.
La différence entre notre pays et le vôtre dans ce domaine, c'est que les bateaux qui sont au large des Etats-Unis viennent ou partent aux Etats-Unis alors qu'en ce qui nous concerne, ils ne s'arrêtent pas obligatoirement en France ; ils passent. Il y a sans aucun doute des initiatives à prendre, et nous jouerons certainement au niveau européen. Ce sera l'Union européenne qui prendra des dispositions, pourquoi pas, proches de celles prises par les Etats-Unis. Pour d'autres dispositions, nous pourrions passer par l'OMI. La procédure sera longue et, pour cela, il nous faut des alliés dont vous êtes, je vous le dis très librement. Vous avez pu prendre des mesures unilatérales, mais nous pouvons difficilement faire de même sur la durée.
Nous souhaitons donc savoir si votre Gouvernement, autant que vous puissiez le dire, serait susceptible de nous aider sur des propositions qui ont été faites par la France à l'Union européenne. C'est un sujet important parce que si nous voulons passer par l'OMI, il nous faut des alliés sur ce thème de la sécurité. En effet, à l'OMI beaucoup d'Etats se préoccupent davantage de shipping que de sécurité. Pour l'instant, la question qui est posée aux Etats-Unis est de savoir si cette stratégie pourrait être appliquée par vous.
M. James OBERSTAR : D'après votre expérience en tant que Français, êtes-vous disposés à faire quelque chose au niveau européen ou plutôt au sein de l'OMI ?
M. le Rapporteur : Sûrement au niveau européen ; mais si l'on veut pousser les normes de sécurité au maximum, il serait souhaitable que nous obtenions une validation par l'OMI, même si la procédure de l'OMI met du temps. Vous le savez bien puisque vous avez décidé d'agir seuls justement pour éviter cette lourde procédure. Jamais vous ne seriez arrivés à un accord sur ces bases.
M. James OBERSTAR : Déjà, il y a la pression de l'opinion publique américaine qui poussait pour que des mesures soient prises.
M. le Rapporteur : Nous sommes exactement dans la même situation.
M. James OBERSTAR : Mon conseiller dit que le problème pour nous, au sein de l'OMI, ce sont plutôt les Etats qui possèdent un pavillon de complaisance. Les Etats-Unis ne pensent pas que ces pays seront bien d'accord et, en raison de leur poids au sein de cette organisation, cela pose vraiment un grand problème.
Les Coast Guards des Etats-Unis sont très affirmatifs : ils pensent régler les autres affaires en imposant la technique de la double coque et des boites noires. Le gros problème, c'est de pouvoir imposer des règles à tous. Par exemple, le bateau New Carissa a fait naufrage l'année dernière sur les côtes de l'Oregon et il n'y a pas moyen d'obtenir des compensations de la compagnie qui contrôlait le bateau. Pas moyen de faire le nettoyage, si ce n'est avec des fonds des Etats-Unis. C'est un problème.
M. le Rapporteur : Seriez-vous favorable pour accompagner une démarche française visant un renforcement des normes à l'OMI ?
M. James OBERSTAR : Oui, je suis toujours favorable à la coopération internationale, surtout entre les pays européens et les Etats-Unis. Nous sommes les pays les plus avancés, ceux qui se retrouvent le plus volontiers pour faire avancer les choses. Je viens d'avoir une réunion avec Trasco-Casco, la compagnie chinoise. Elle compte 2 300 navires. Je n'ai pour ma part aucune confiance : je ne suis absolument pas sûr que les Chinois se préoccupent des affaires de sécurité maritime. Ils sont un peu en dehors de la loi.
M. le Rapporteur : Ils sont générateurs de risques ?
M. James OBERSTAR : Oui, exactement.
M. John M. CULLATHER : Les Etats-Unis doivent empêcher le chargement d'un navire immatriculé dans un pays qui n'applique pas suffisamment les normes de l'OMI.
M. le Rapporteur : Logiquement, ces bateaux doivent être interdits, empêchés.
M. James OBERSTAR : Par quel moyen ? C'est le problème. De notre point de vue et du point de vue européen, il est préférable d'avoir une structure internationale qui impose la loi, qui impose les sanctions.
M. le Président : Dans les conditions actuelles, si la France fait ses propositions à l'OMI, elle court le risque de voir les instances de l'OMI ne pas les reprendre, compte tenu du rapport de forces existant et des intérêts que vous évoquiez précédemment. D'où la démarche entreprise auprès de l'Union européenne afin que s'exprime une volonté politique. Il ne s'agit pas de supprimer l'OMI, mais de chercher à faire pression. Il est clair que si les États-Unis, forts de leur expérience de 1989 et 1990, appuyaient une démarche d'internationalisation de mesures de sécurité strictes, le poids d'un certain nombre de pays européens ajouté au poids des États-Unis pourrait faire basculer l'OMI. C'est pour cela qu'il est intéressant d'entendre ce que nous entendons depuis deux jours.
M. James OBERSTAR : Si, ensemble, nous développons un ensemble de lois, de sanctions et des fonds pour le nettoyage, comment insister pour que ces pays tiers participent au système de régulation ? Comment allez-vous les empêcher d'entrer dans vos ports ?
M. le Président : Comme vous le faites avec l'OPA. Il faudrait une OPA internationale.
M. le Rapporteur : Quand vous interdisez l'entrée de vos ports à certains bateaux pour des raisons de sécurité, ces bateaux vont ailleurs. Nous souhaitons donc qu'une mesure de renforcement des contrôles soit prise par l'OMI car la réglementation actuelle de l'OMI nous paraît satisfaisante. Le seul problème est qu'elle n'est pas appliquée.
M. James OBERSTAR : Je suis d'accord.
M. le Rapporteur : Je change de sujet, mais deux questions me préoccupent particulièrement. L'une porte sur les relations que vous entretenez avec le Liberia. Considérez-vous que son pavillon soit un pavillon de complaisance ? A votre avis, existe-t-il un rapport avec le pavillon américain ? Nous pensons, en Europe, que le Liberia est une sorte de pavillon bis américain. Partagez-vous ce sentiment ?
M. James OBERSTAR : Pas nécessairement. Je consulte mon conseiller.
M. le Rapporteur : L'autre concerne le concept de la double coque. Vous l'avez imposé sans qu'aucune autre technologie, qui ne soit pas une technologie de simple coque, ne soit admise. Mais il existe des technologies nouvelles - notamment celle du double pont -, qui permettraient également de renforcer la sûreté des navires. Y a t-il un moyen d'ouvrir une discussion sur ce sujet auprès de l'administration américaine ?
M. James OBERSTAR : On peut envisager une discussion menée avec notre commission et avec les Coast Guards pour le compte du Gouvernement. Ce serait une discussion très importante.
En ce qui concerne le Liberia, bien que de nombreuses compagnies américaines aient des bateaux sous pavillon libérien, cela n'a pas grande influence sur les décisions prises par notre Gouvernement.
M. le Président : Je me suis laissé dire qu'en cas de difficulté majeure, la flotte du Liberia serait mise à disposition de la flotte américaine.
M. James OBERSTAR : Pas nécessairement.
M. le Président : Mais cela n'est pas non plus exclu.
M. James OBERSTAR : Ce n'est pas non plus exclu, mais lors de l'affaire du Golfe, suite à l'invasion du Koweït, aucun navire de pavillon de complaisance n'a été mis à la disposition des Etats-Unis. Seuls les bateaux américains ont servi pour le transport.
Nous payons pour les assurances, pour les bateaux, et aucun ne nous a aidé pendant la guerre du Golfe.
M. le Président : Combien de bateaux la flotte américaine compte-t-elle, en dehors de la flotte de cabotage ?
M. James OBERSTAR : 114, en dehors du cabotage. A la fin de la seconde guerre mondiale, notre flotte comptait 5 230 navires américains. Cela représentait 25 millions de tonneaux. Aujourd'hui, nous avons 114 bateaux.
M. le Rapporteur : Le reste est sous pavillon libérien.
M. James OBERSTAR : Non. Certaines compagnies ont été rachetées par des armateurs non américains.
M. le Rapporteur : Ils sont tous partis des Etats-Unis !
M. James OBERSTAR : Mon conseiller me dit que c'est pour cela que nous sommes un pays qui insiste davantage sur le règlement de l'Etat du port que sur celui de l'Etat du pavillon. Quand comptez-vous lancer votre initiative ?
M. le Président : Le rapport que nous allons remettre fin juin-début juillet coïncidera avec la présidence de l'Union européenne par la France.
M. James OBERSTAR : J'espère que nous allons fêter Jean Monnet, Robert Schuman et Victor Hugo !
M. le Président : Je préfère, pour ma part, Victor Hugo.
M. James OBERSTAR : Je crois qu'il s'était réfugié à Guernesey.
M. le Président : La présidence française commence le 1er juillet. Le rapport fera des propositions au niveau national, au niveau européen et, bien évidemment, au niveau international parce que la sécurité maritime ne concerne pas uniquement la Manche, le golfe de Gascogne et la Méditerranée. Nous ferons donc des propositions parlementaires et nous verrons comment le Gouvernement les mettra en application en tant que Gouvernement de notre pays et en tant que président de l'Union européenne durant les six prochains mois.
M. James OBERSTAR : Si les élections se passent bien pour nous, Démocrates, et si nous gagnons la majorité à la Chambre des Représentants, je serai président de cette commission. A ce moment là, vous pourrez venir me voir et nous pourrons lancer une opération conjointe.
M. le Président : Il faut vous rendre compte que l'affaire de l'Erika est aussi importante pour nous que l'a été celle de l'Exxon Valdez pour vous. La pression publique est vraiment très importante.
M. le Rapporteur : Votre commission est-elle en relation régulière avec vos représentants à l'OMI ?
M. James OBERSTAR : Je ne sais pas. Mais mon conseiller me dit que la commission reçoit le représentant à l'OMI. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Je suis pourtant élu au Congrès depuis vingt-six ans.
M. Aimé KERGUERIS : J'ai cru que c'était la Coast Guard qui freinait l'évolution vers l'OMI. Mais si vous êtes, pour votre part, favorable à un travail en commun, je suppose que vous avez des arguments pour convaincre la Coast Guard ?
M. James OBERSTAR : Si nous disons aux Coast Guards que nous allons coopérer, cela ne posera pas de problème. C'est à nous d'entamer les discussions et de lancer le projet. Jusqu'à présent personne ne nous y a invité. Mais cela m'intéresse beaucoup.
M. le Président : Nous vous remercions de nous avoir consacré tout ce temps. Souhaitons que dans quelques mois vous regagniez votre siège ; nous ferons alors beaucoup de choses ensemble.
M. James OBERSTAR : Dans le domaine de l'aviation aussi, il y a beaucoup à faire. C'est le quatrième chapitre de la question de Boeing.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être relue par les intervenants.
Audition de Mme Sarah CHASIS,
senior attorney, directrice du programme
Oceans, Natural Resources Defense Council
et Mme Sally LENTZ, Ocean Advocate
(extrait du procès-verbal de la séance du 18 mai 2000 à Washington)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président.
M. le Président : Je vous remercie de nous accueillir au cours de notre bref séjour aux Etats-Unis. Vous connaissez, je suppose, la raison de notre voyage. Il y a quelques mois, une catastrophe maritime a eu lieu en France. La France est un pays très exposé parce que non loin de ses côtes passent des dizaines de milliers de navires dont une bonne partie transportent des produits dangereux - pétrole, matière chimiques, matières nucléaires. Le plus souvent, ce sont des produits pétroliers qui sont en cause, mais le fait est que la répétition de ces naufrages depuis une vingtaine d'années commence à entraîner des réactions de la population.
Au-delà, les conditions dans lesquelles l'Erika a fait naufrage posent un certain nombre de problèmes. A l'évidence, il s'agissait d'un navire sous-normes, certes dans une tempête, mais transportant un produit très polluant : le fioul n° 2. Je ne sais pas à quoi cette classification correspond ici, mais il s'agit d'un résidu de raffinage qui se révèle très difficile à retirer des côtes, des rochers, des plages. Il en reste encore 15 000 tonnes au fond de la mer dans les deux morceaux de l'Erika, qui s'est brisé.
L'émotion est grande. Les habitants de l'ouest de la France, de la Bretagne, des Pays de Loire, de la Vendée souhaitent que des dispositions très fortes soient prises afin que plus jamais l'on ne puisse voir ces images de côtes polluées, d'oiseaux mazoutés. Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale a donc été mise en place. C'est une délégation de cette commission que vous avez devant vous. Nous représentons tous les partis politiques présents au Parlement.
Il ne s'agit pas pour nous de venir copier ce qui se fait aux Etats-Unis, mais tout simplement de venir voir comment les Etats-Unis, avec l'Oil Pollution Act de 1990, ont eux-mêmes apporté une réponse globale aux problèmes qu'ils ont connus en 1989 avec l'Exxon Valdez. Cet Oil Pollution Act n'a pas empêché qu'un certain nombre d'autres pollutions surviennent, ce qui montre bien que le problème est récurrent et justifie sans doute que nous ayons des échanges afin de parvenir à des réponses globales et probablement plus internationales que celles qui ont été apportées jusqu'à présent.
En tout cas, votre expérience nous intéresse. Nous avons déjà rencontré les responsables de la Coast Guard, deux membres du Congrès, ainsi que les responsables du pavillon libérien basé à Washington. J'insiste sur cette particularité : la République du Liberia, pour ce qui concerne les transports maritimes, a son siège dans la banlieue de Washington ! Nous retirons de nos entretiens avec les partenaires américains des enseignements intéressants. Vous êtes parmi les personnes que nous souhaitions rencontrer. Votre expérience nous intéresse. C'est la raison de notre présence aujourd'hui.
Nous vous remercions de nous accueillir. M. le rapporteur aura certainement des questions à vous poser sur la façon dont vous abordez ces questions.
Mme Sarah CHASIS : Le Natural Resources Defense Council - NRDC - est une organisation environnementale, américaine, nationale et non lucrative. Nous avons des juristes et des scientifiques qui se penchent sur un large éventail de questions liées à la protection des océans, aux déversements d'hydrocarbures, à l'environnement, à l'énergie nucléaire, aux affaires publiques. Nous nous sommes intéressés à la question de la pollution pétrolière après l'accident de l'Exxon Valdez et nous sommes très actifs dans le cadre du processus d'évaluation des dommages qui avait été engagé par les agences fédérales. Nous avons également soutenu les efforts tendant à promulguer l'OPA.
Suite à l'échouage de l'Exxon Valdez, il y a eu d'autres accidents de navires dans le port de New York, qui résultaient d'une exploitation non conforme par des sociétés d'armement. Nous avons à nouveau essayé d'évaluer les dommages, de faire reconnaître la partie responsable et d'améliorer les mesures préventives qui étaient déjà en place.
Pour ce qui est de l'OPA 90, nous avons rédigé un rapport peu de temps après la promulgation de la loi ; il s'intitule : Safety of Bay. J'en ai ici une copie que nous pouvons vous laisser.
Vous avez là toutes les clauses de l'OPA, avec leur importance respective. Ce document traite également du statut de la Coast Guard et de la mise en _uvre de ces dispositions. Il a été élaboré au début des années quatre-vingt-dix. Nous pensons que l'OPA est une loi qui a du « muscle », surtout en ce qui concerne ses dispositions exigeant les pétroliers à double coque, l'augmentation de la responsabilité et le fait qu'il y a un potentiel pour une responsabilité illimitée en cas de conduite délibérée de négligence ou lorsque l'on peut prouver la violation des règlements contraignants. Nous pensons que le relèvement du niveau de responsabilité a encouragé les armateurs à améliorer leurs normes de sécurité.
D'autres dispositions portant sur la prévention des déversements d'hydrocarbures n'ont pas, à notre avis, été mises en _uvre avec toute la vigueur nécessaire par la Coast Guard. L'organisation de Sally Lentz a commencé, il y a quelques années, à porter plainte contre l'Environment Protection Agency et la Coast Guard, pour les forcer à promulguer les règlements prévus par la loi.
Bref, certains règlements ont été promulgués, mais ils ne nous donnent pas entière satisfaction. Nous avons donc publié ce rapport, dont je vous ai donné une copie, qui critique l'action menée dix ans après l'Exxon Valdez, et plus particulièrement celle de la Coast Guard. Nos publications concernent l'inaction au niveau des mesures internes et structurelles, s'agissant des pétroliers à simple coque, avant même de parler de la technique de la double coque, dont la généralisation - vous le savez -, prendra encore quelques années. De ce point de vue, la Coast Guard n'a pas vraiment mis en _uvre la loi.
La Coast Guard était également opposée à la nécessité des remorqueurs pour les ports, qui auraient permis de prévenir certains déversements. Elle n'est intervenue que dans deux régions : le Puget Sound et le Prince William Sound, nommés spécifiquement dans la législation. Mais il fallait que la Coast Guard soit plus active, d'après les statuts. Je ne veux pas vous donner trop de détails, à moins que vous ne soyez intéressés. Nous pensons que le statut cadre constituait une base forte, qui n'a pas été suffisamment respectée.
Le second volet de notre action, moins juridique, concerne le règlement émis par la NOAA pour l'indemnisation des dommages, lequel servait pour l'évaluation des dommages écologiques.
Mme Sally LENTZ : Je suis avocate. Nous faisons également partie des défenseurs de l'environnement au plan national, mais notre organisation est d'une taille plus réduite que la NRDC. Notre travail, depuis 1991, concerne essentiellement tout ce qui touche à la navigation et au transport maritime.
Je me suis intéressée, de manière active, à ce domaine depuis les années quatre-vingt. J'ai été membre de la délégation américaine à l'OMI, pour le compte des amis de la terre. Bien que nous travaillions sur ce sujet au plan national, nous nous y intéressons bien sûr également au niveau international, ce qui fait que je connais fort bien l'accident de l'Erika.
Pour ce qui est de notre évaluation de l'OPA 90, je vais répéter ce que Sarah a déjà dit, à savoir que, à l'exception des dispositions concernant la technique de la double coque et la responsabilité, ce qui a été écrit dans cette loi n'a pas été mis en _uvre. Bien d'autres mesures prévues dans cette loi n'ont jamais été appliquées. J'ai eu l'honneur d'être membre du comité de l'académie nationale des sciences qui a entrepris une évaluation de l'OPA 90, dix ans après. Je vous laisserai cette étude.
De ses conclusions, il ressort que la clause de la double coque n'étant pas encore entrée en vigueur, elle n'a pu avoir d'incidence particulière sur la réduction des accidents dans les eaux américaines. Il y a certes eu une réduction des accidents, mais le sentiment de ce comité était que nous n'étions pas capables de documenter le fait que la plupart des changements ne découlaient pas de l'OPA, dans la mesure où les clauses de responsabilité étaient assez minimes pour que l'industrie de la navigation prenne ses propres mesures en vue d'améliorer ses performances.
On peut dire que l'OPA 90 elle-même, en tout cas la clause de double coque, n'a pas eu d'impact majeur, puisqu'elle n'est pas encore entrée en vigueur. Néanmoins, comme il existe deux clauses, l'une sur la technique de la double coque, l'autre sur la responsabilité, cette dernière a forcé l'industrie à améliorer sa performance.
C'était l'un des sujets de discussion. Je pense que vous pourriez sans doute envisager des modifications dans le fonds du FIPOL, en particulier pour ce qui concerne le traitement qu'il fait des dommages à l'environnement. Dans ces conventions internationales, l'enjeu de la définition des dommages écologiques est très étroit, et c'est l'une des différences majeures entre la loi américaine et le modèle applicable aux eaux européennes.
J'ai d'autres réflexions dont j'aimerais vous faire part, mais peut-être avez-vous des questions à poser ?
M. le Rapporteur : Vous avez dit que vous avez été membre de la délégation américaine à l'OMI. Etiez-vous membre de cette délégation au titre de votre association ?
Mme Sally LENTZ : Oui. En fait, c'est assez inhabituel, mais au sein de la délégation américaine auprès de l'OMI, nous avons des représentants du secteur privé, des représentants de l'industrie des transports maritimes et des représentants des défenseurs de l'environnement. C'est à ce titre que j'ai été membre de la délégation pendant huit ans.
M. le Rapporteur : Cette représentation des associations écologistes existe toujours dans la délégation ?
Mme Sally LENTZ : Oui, ainsi qu'une représentation des armateurs.
M. le Rapporteur : Par ailleurs, vous avez beaucoup parlé de la technique de la double coque. Mais vous dites que la clause sur la double coque n'est pas appliquée, si j'ai bien compris ?
Mme Sarah CHASIS : Elle s'applique peu à peu, très lentement.
M. le Rapporteur : Mais la loi parlait d'une mise en application définitive en 2015. Donc, pour l'instant, elle est appliquée conformément à cette date.
Mme Sarah CHASIS : Oui, mais cela prend beaucoup de temps. Selon la dimension et l'âge des navires, les bateaux doivent être retirés s'ils ont une simple coque avant une certaine date. Ensuite, ils seront remplacés à une certaine date. Le délai court jusqu'en 2010-2015. Les navires qui ont un double fond ou une double paroi peuvent continuer jusqu'en 2015, mais le délai prévu par le statut est trop long.
M. le Rapporteur : Vous estimez que le délai prévu par la loi est trop long ?
Mme Sarah CHASIS : C'est cela.
M. le Rapporteur : Vous pensez donc qu'il faut revoir la loi ?
Mme Sarah CHASIS : Nous aimerions beaucoup, mais cela ne se produira pas.
M. le Rapporteur : Il serait impossible de raccourcir les délais, d'accélérer le mouvement ?
Mme Sarah CHASIS : Avec le Congrès actuel, c'est impossible, à moins qu'un très grave accident ne touche le pays.
Mme Sally LENTZ : Je suis d'accord pour deux raisons. D'une part, je pense que politiquement, tant aux Etats-Unis qu'au niveau mondial, il sera extrêmement difficile d'accélérer le processus, et d'autre part, se pose également la question de la capacité de l'armement à s'accommoder d'un calendrier accéléré. Il y a des doutes quant à la faisabilité d'une accélération de la disparition des navires à simple coque, d'un point de vue pratique.
Mme Sarah CHASIS : Actuellement, nous serions tout à fait favorables à une accélération du calendrier et au maintien de la pression. Nous pensons que les bateaux à double coque représentent une mesure de sécurité, même s'ils ne constituent pas la solution idéale ; mais je ne pense pas que le Congrès dans sa composition actuelle acceptera.
M. le Rapporteur : Savez-vous qu'en Europe, en France notamment, on estime que l'exclusivité de la technique de la double coque pour les eaux américaines en 2015 est une forme de protectionnisme déguisé...
Mme Sarah CHASIS : Non, je ne le pense pas.
M. le Rapporteur : ...parce que c'est une technologie qui, au moment du choix, était une technologie américaine ? Il existait d'autres technologies différentes, notamment celle du double pont, qui étaient proposées en Europe et que votre pays a refusées en estimant que seule la technologie de la double coque est sécurisante, ce qui n'est pas tout à fait sûr.
Nous pensons qu'il serait convenable qu'il y ait un élargissement de la technologie sécuritaire, et que celle-ci ne soit pas limitée à la double coque, même si aujourd'hui ce choix a été imposé en Europe en éliminant ainsi toute voie technologique alternative qui pourrait se présenter. En outre, il n'est pas totalement prouvé que la double coque soit le summum de la sécurité. Est-ce un débat auquel vous avez déjà été intéressées ?
Mme Sally LENTZ : Oui. En fait, j'étais également membre d'un autre comité scientifique de la National Academy, qui s'est penché sur la technologie de la double coque et l'a comparée à d'autres technologies. Nous nous sommes aussi intéressés à la technologie du double pont. Je ne pense pas que ce soit une action exclusive de la part des Etats-Unis, parce que nous ne représentons qu'une partie infime de la construction navale. Il n'y a donc aucune corrélation.
Ce que nous avons conclu de cette étude, après une longue analyse, c'est que la double coque allait permettre d'empêcher l'occurrence de déversements dans un grand nombre de cas, alors que le double pont n'avait jamais été mis au point.
M. le Président : Il l'a été en France.
Mme Sally LENTZ : Oui, mais à l'époque, il n'en existait pas. Ce rapport a été élaboré en 1991.
Nous avons conclu que la technique de la double coque permettait d'éviter la majorité des types d'accidents qui survenaient dans les eaux côtières des Etats-Unis, c'est-à-dire les déversements de faible intensité causés par les naufrages. Le fait que ces accidents soient minimisés était un facteur très important du point de vue des Etats-Unis ; si vous examinez le double pont, vous pouvez affirmer que cette technologie pourrait entraîner un nombre plus grand de petits accidents.
Le double pont est plus performant pour un accident de grande intensité, alors que la double coque est plus performante pour des accidents de faible intensité. A l'heure qu'il est, nous avons engagé une autre étude pour réexaminer la question de la double coque parce que les chantiers navals de ce pays souhaitent construire d'autres types de navires.
M. Jean-Michel BOUR : Un inventeur américain pousse fort pour une autre technique, mais jusqu'à présent la Coast Guard a réussi à le bloquer.
M. le Rapporteur : Le problème, en fait, est d'avoir considéré que ce choix était le choix qui devait s'imposer à tout le monde.
Mme Sarah CHASIS : Mais la convention de l'OMI autorise d'autres technologies.
M. le Rapporteur : Les Etats-Unis, non.
M. le Président : Les autres technologies sont possibles en dehors des Etats-Unis, mais quelle est la compagnie de navigation qui ne passe pas par ici ?
Mme Sally LENTZ : Sauf que s'il existe une solution de remplacement, qui a fait ses preuves, qui démontre qu'elle peut être aussi efficace que la double coque, la Coast Guard a la possibilité de s'adresser au Congrès pour demander aux autorités d'autoriser cette technologie.
M. le Rapporteur : Parlons franchement : le fait que le seul choix se soit porté sur la double coque a condamné toute recherche sur d'autres technologies qui pourraient être aussi performantes.
Cela ne signifie pas que nous soyons favorables au maintien de la simple coque actuelle, mais à partir du moment où l'option de la double coque est devenue l'option quasiment obligatoire pour venir aux Etats-Unis, tout le monde construit des doubles coques. Des alternatives technologiques, peut-être plus sécuritaires, auraient peut-être été possibles mais, même si l'OMI les autorise, à partir du moment où l'on ne peut pas venir aux Etats-Unis sans double coque, on fait des doubles coques !
Vous avez dit que les mesures concernant la responsabilité avaient été positives, et que bien d'autres aspects étaient abordés dans l'OPA, mais pas suffisamment appliqués. A quoi pensiez-vous précisément ?
Mme Sarah CHASIS : Vous retrouverez cela dans les documents que nous vous avons remis mais, pour vous répondre, je pensais au fait que l'on n'ait pas promulgué des normes de détection de fuites ; au fait que l'on ne promulgue pas des normes pour les appareils de trop-plein ; au fait que l'on ne rende pas plus rigoureuses les normes de lutte contre l'incendie et les normes de sauvetage ; au fait que l'on n'accroisse pas les exigences en matière de matériels d'intervention dans l'eau ; au fait que certaines exigences établies dans le début des années quatre-vingt-dix auraient dû être améliorées, mais ne le sont pas ; au fait que l'on n'ait pas promulgué des normes suffisantes pour le confinement et le retrait du matériel à bord.
M. le Rapporteur : Cela figurait dans la loi mais n'est pas appliqué ?
Mme Sarah CHASIS : Oui, ce sont des éléments qui étaient obligatoires, mais qui n'ont pas été appliqués.
M. Jean-Michel BOUR : Des réglements d'application de l'OPA continuent de sortir.
Mme Sarah CHASIS : Nous estimons que la Coast Guard américaine n'est pas un bon organisme de réglementation. Elle fait bien son travail sur le terrain en matière d'intervention, en cas d'urgence et d'accident, mais c'est tout. Il existe une relation très étroite, très marquée entre la Coast Guard et le secteur qu'elle réglemente.
M. le Rapporteur : Elle ne réglemente que 114 bateaux. Elle ne peut avoir d'alliance réelle, sauf à dire que la Coast Guard a une alliance avec les armateurs étrangers.
Mme Sally LENTZ : Non, mais il y a une autorité de l'Etat du port et cela c'est une autre question.
Un autre champ, en dehors de l'OPA 90, dans lequel la Coast Guard a été efficace a trait aux mesures de contrôle qui constituent l'élément de dissuasion pour lequel les navires sous-normes n'accèdent pas à nos ports. J'étais heureuse de voir que le récent mémorandum que la France a soumis à l'OMI suit le même ordre d'idées, car je pense que les navires sous-normes sont bien le problème.
Ce problème est lié au manque de responsabilisation par les Etats du pavillon. Dans la mesure où il est politiquement difficile de se pencher directement sur cette question, la seule alternative est que les Etats du port agissent. La Coast Guard a été efficace dans ce domaine, mais elle ne s'est pas penchée sur d'autres mesures de prévention. Par exemple pour les remorqueurs de certaines classes de navires - ceux qui transportent le pétrole lourd en l'occurrence -, la question se pose de ce que nous appelons un remorqueur de sauvetage dédié, c'est-à-dire un navire de sauvetage situé stratégiquement. Mon association a eu gain de cause pour en faire placer un à Puget Sound qui est une zone extrêmement dangereuse.
M. le Président : Ce sont de gros remorqueurs ?
Mme Sally LENTZ : Pas forcément gros, mais très puissants. Il s'agit de les situer stratégiquement, afin de pouvoir intervenir en cas d'accident potentiel. La Coast Guard ne le fait pas. Notre association lui intente actuellement un procès au motif qu'elle n'a pas encore identifié les régions où le besoin de mesures préventives se fait le plus sentir. C'était prévu par la loi, mais la Coast Guard n'a jamais rien fait en ce sens.
M. Jean-Michel MARCHAND : Vous avez dit que vous pensiez que c'était plutôt le relèvement du niveau de la responsabilité qui avait contraint ou incité l'industrie de la construction navale à prendre des mesures. Nous voulons bien l'admettre puisque la mise en _uvre de la clause de la double coque prend du temps.
Quelles qu'en soient les raisons, la conséquence que nous constatons est le déplacement des bateaux en mauvais état vers d'autres côtes, notamment vers les côtes européennes ; c'est-à-dire que les mesures unilatérales prises par les Etats-Unis, hors OMI, ont eu pour conséquence d'accroître les risques de pollution chez nous. La question que je vous adresse est donc de savoir si vous avez constaté une baisse des accidents et des pollutions grâce aux mesures qui ont été prises ou si, au contraire, vous pensez qu'il n'y a pas de progrès sensibles.
Mme Sarah CHASIS : Je pense que nous avons fait des progrès et qu'il y a une baisse des accidents aux Etats-Unis. Vous avez raison sans doute de souligner que les mesures prises aux Etats-Unis ont peut-être eu des conséquences non prévues, mais je crois que tout le monde aux Etats-Unis était frustré face à l'OMI et à son échec d'aller de l'avant.
Tout le monde estime qu'avancer tous à l'unisson est ce qu'il y a de meilleur. Mais si l'accord international ne maintient pas le bon rythme, il n'y a qu'un seul choix, celui d'avancer unilatéralement. Je pense qu'un certain nombre de mesures qui sont introduites dans le mémorandum présenté par la France à l'OMI, que nous avons reçu, sont excellentes et nous encourageons vivement les Etats-Unis à appuyer les efforts que vous déployez.
Mme Sally LENTZ : Je le pense également.
M. Jean-Michel MARCHAND : Vous pensez donc que nous avons intérêt à mettre en place, nous aussi, des mesures unilatérales si nous n'arrivons pas à entraîner des changements fondamentaux au sein de l'OMI. Les Etats-Unis et des associations comme les vôtres sont-ils prêts à nous soutenir ?
Mme Sally LENTZ : Non seulement vous avez intérêt à le faire si la communauté internationale ne fait pas le nécessaire afin de vous donner le niveau de protection que vous souhaitez mais, à mon avis, vous avez l'obligation de le faire pour les citoyens de votre pays et pour protéger leurs ressources. C'est malheureux car nous sommes tous d'accord pour dire qu'il serait bon d'avoir une politique générale, mais si vous connaissez bien l'OMI, vous savez que la plupart du temps, vous n'obtenez que le plus petit dénominateur commun.
Aussi faut-il parfois agir unilatéralement, comme l'ont fait les Etats-Unis, afin d'entraîner le reste de la communauté internationale. L'OMI est une organisation difficile à faire bouger. Elle a des racines très profondes dans le secteur du transport maritime. Il est difficile de surmonter les éléments politiques. Une action unilatérale sera peut-être le seul moyen de donner une impulsion à la communauté internationale. Je sais que les écologistes, ici et à l'étranger, seraient favorables à votre action.
M. le Président : Mais nous ne pourrons pas dire que nous ne connaissons pas les conséquences de telles mesures unilatérales et, cette fois, cela reportera les problèmes sur les côtes africaines et asiatiques. Ne serait-il pas bon de changer la règle de l'OMI selon le principe : un pavillon, une voix ?
Mme Sarah CHASIS : Vous pouvez essayer, mais je crois que Sally veut dire que cela risque fort de se traduire par un échec. Prendre une mesure unilatérale peut effectivement ne faire que déplacer le problème à court terme, mais ce sera un catalyseur, comme quand les Etats-Unis ont promulgué la loi sur la double coque.
M. Pierre HERIAUD : Vous êtes une association de défense de l'environnement qui regroupe 400 000 membres. J'aimerais connaître la hauteur de votre budget annuel, la nature de vos ressources, le nombre de personnels employés, s'il y en a, même si votre association est à but non lucratif.
En matière de défense de l'environnement, inévitablement, des procédures sont en cours. Quelle est l'importance du nombre de procédures engagées chaque année ?
Mme Sarah CHASIS : Notre budget annuel est de 30 millions de dollars. Nos sources de revenus proviennent de nos membres. Ils sont au nombre de 400 000 aux Etats-Unis, auxquels s'ajoutent des fondations et des donations privées. Nous recevons une petite somme de l'Etat, de l'ordre de 1 % de notre budget global.
Je n'ai pas à l'esprit l'importance des procès que nous engageons chaque année, mais c'est de l'ordre d'une quinzaine ou d'une vingtaine sur l'ensemble du territoire. Nous avons quatre bureaux : Washington, New York, San Francisco et Los Angeles. Nous travaillons également au niveau international pour certaines questions touchant à la pêche, aux produits chimiques, etc. Nous sommes 190 personnes pour l'ensemble de l'association.
C'est le trentième anniversaire de notre association aujourd'hui. Elle a été créée en 1970.
Mme Sally LENTZ : Dernièrement, j'ai lu dans la presse une proposition venant, paraît-il, de la France au sujet d'une « boîte noire » qui devrait être placée sur les navires pour la détection des déversements. Je n'ai pas très bien compris de quelle technologie il s'agissait.
M. le Rapporteur : C'est pour le dégazage.
M. le Président : On recherche le moyen de connaître les navires qui effectuent des rejets soit de déchets de soute, soit de déchets de ballast. C'est très difficile à déterminer parce qu'il existe un nombre très important de types de produits pétroliers et lorsque des rejets sont constatés en mer, il est difficile d'accuser un navire de l'avoir fait, même si on le prend sur le fait.
Or, dans certaines mers autour de la France, en Méditerranée, par exemple, le principal problème est constitué par les déversements de ce type. Un certain nombre de bateaux ont profité du naufrage de l'Erika pour déverser et ajouter leur pollution à la pollution existante.
Comment connaître le navire qui rejette ? L'idée a germé d'une « boîte noire » permettant de les identifier. Mais cette technique n'est pas encore au point.
Une autre idée serait, lorsqu'un navire effectue un chargement, d'intégrer dans le produit qu'il chargerait un colorant qui n'aurait pas de conséquence sur la qualité du produit, mais qui serait repérable immédiatement, de façon à connaître automatiquement le responsable de la pollution.
Sans être un spécialiste, je pense que c'est plutôt vers cela que nous proposerons de nous orienter, encore qu'il reste à trouver les modalités de la mise en place de ce genre de contrôle.
L'une des difficultés liées à ces rejets, c'est que les ports en Europe, en France notamment, ne disposent pas des outils permettant aux navires de se débarrasser, dans leur enceinte, des déchets de soute et de ballast. Nous n'en avons que deux, à Marseille et au Havre. Il est facile pour un bateau de nous répondre : « Nous voudrions bien, mais nous ne pouvons pas. »
Je pense qu'une des propositions de M. le rapporteur sera de généraliser ces dispositifs. Mais les armateurs et les commandants nous répondront toujours que le temps passé à se débarrasser des déchets dans les ports est du temps perdu.
L'une des solutions est donc le marquage indélébile des produits embarqués, de façon à reconnaître le propriétaire du navire.
M. le Rapporteur : Existe-t-il de votre côté, soit dans vos associations, soit dans d'autres, une analyse critique du fonctionnement de l'OMI ?
Mme Sarah CHASIS : Non.
Mme Sally LENTZ : Je voudrais bien, mais non.
Mme Sarah CHASIS : J'aimerais connaître votre délai pour la remise de votre rapport. Le protocole d'accord qui est présenté à l'OMI dépend-il de votre commission ? Il y avait un article le 15 mai dans le Financial Times. S'agit-il du même mémorandum que celui présenté par le Gouvernement français ?
M. Jean-Michel BOUR : Il y a d'abord eu une réunion organisée par le ministère des transports en France, réunissant des affréteurs français, des clients et toutes les compagnies pétrolières. Ils ont accepté un accord de façon volontaire. Puis nous avons remis une lettre à la Commission européenne et à l'OMI pour proposer des mesures que nous souhaiterions voir mises en place par l'OMI et par le biais de la Commission européenne.
Tout a été établi par le Gouvernement français. Le Parlement est d'accord, mais c'est l'exécutif qui agit.
M. le Rapporteur : Pour les délais, nous rendrons notre rapport à la mi-juillet. Il comprendra des propositions faites au Gouvernement. Nous pensons qu'il y a opportunité pour la présidence française de l'Union européenne de se saisir de ces propositions comme des autres propositions gouvernementales dont vous parliez pour faire avancer l'ensemble de la réglementation au niveau européen.
M. Jean-Michel BOUR : En effet, la France assurera la présidence de l'Union européenne au cours des six prochains mois et aura donc la possibilité de pousser certaines propositions. Nous souhaitons que ces mesures avancent au niveau européen.
M. le Président : Pour donner un exemple, un certain nombre de pays ne sont pas membres de l'Union européenne mais souhaitent le devenir, comme Malte, Chypre, les pays Baltes. La Commission européenne et le Conseil des ministres européens, chargés de cette question, peuvent tout à fait définir que les pays candidats ne seront admissibles qu'à partir du moment où ils auront satisfait à un certain nombre d'obligations. Cela existe dans d'autres domaines ; c'est ce que nous appelons les « piliers ». Ce sont des clauses obligatoires.
Il nous semble que l'opinion en Europe pourrait être prête à entendre que ces pays ne pourront en aucun cas devenir membres de l'Union européenne s'ils n'ont pas mis en place des administrations maritimes réelles - a contrario du Liberia - obéissant à des normes strictes et respectant l'équivalent de l'OPA ou un certain nombre de règles.
La rencontre que nous avons eue avec les commissaires européens à Bruxelles il y a quelques semaines nous a laissé entrevoir que c'est dans ce sens que l'on pouvait aller. Inutile de dire qu'il y a des oppositions, mais je pense qu'il serait malvenu d'affirmer, dans les mois ou les toutes prochaines années, que Chypre et Malte seront habilités à devenir membres de l'Union européenne sans un changement radical de leur politique maritime. Ce serait à faire désespérer les Européens de la construction européenne.
M. le Rapporteur : Ils l'ont compris. L'Erika étant sous pavillon maltais, nous nous y sommes rendus et les autorités maltaises se sont montrées extrêmement soucieuses de faire en sorte que l'on aboutisse à un résultat de respect des normes, même si elles se rendent compte que leur pays est loin de la situation idéale. Un des principes qu'il faudrait ériger à l'OMI - ce serait un beau combat - consiste sans doute à faire en sorte qu'il y ait une distinction entre les sociétés de classification qui travaillent pour l'armateur et celles qui travaillent pour l'Etat du pavillon. Ce sera sans doute une de nos propositions. Ce sera un beau combat, mondial.
Mme Sarah CHASIS : Si nous pouvons vous apporter une aide quelconque, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être relue par les intervenants.
Audition de Mme Kathy METCALF,
vice-présidente de la Chamber of Shipping of America
et M. Lars KJAER,
représentant du Council of European & Japanese Shipowner's Association (CENSA)
(extrait du procès-verbal du déplacement à Washington, le 19 mai 2000)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
(L'entretien débute avec M. Lars Kjaer, seul).
M. le Président : Nous vous remercions d'être venu. Vous connaissez le but de notre visite aux Etats-Unis. La catastrophe de l'Erika a amené l'Assemblée nationale française à mettre en place une commission d'enquête, dans le cadre de laquelle nous avons décidé de nous rendre à l'étranger. Nous nous sommes ainsi rendus à Bruxelles, pour rencontrer des membres de la Commission européenne ; à Londres, pour nous entretenir avec des représentants de l'OMI, de l'IACS ainsi que des autorités britanniques ; à Malte ; et aux Etats-Unis.
A Washington, nous avons eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de responsables : la Coast Guard, bien sûr, mais aussi des représentants du Congrès, un Républicain et un Démocrate, ainsi que des défenseurs de l'environnement.
Nous avons également vu les responsables du pavillon libérien, basé à Washington. Nous avons souhaité rencontrer d'autres armateurs, à travers vous.
M. Lars KJAER : Je suis le représentant du CENSA - Council of European, Japanese National Shipowners' Association -, et je représente également l'International Chamber of Shipping à Washington. Toutes deux sont des associations d'associations d'armateurs. La raison pour laquelle nous avons un bureau à Washington est que cela nous permet de suivre les événements aux Etats-Unis et d'essayer d'influer sur les décisions prises dans le domaine maritime.
C'est une tâche qui est devenue très difficile en raison de la disparition de la flotte marchande des Etats-Unis. La flotte internationale des Etats-Unis est de 200 navires, ce qui signifie que l'industrie restant encore aux Etats-Unis, le Congrès et l'administration adoptent de plus en plus une optique interne au sujet des questions maritimes. Le souci de solutions internationales devient de plus en plus réduit.
Je sais que l'Erika est un sujet de très grande inquiétude pour la France, pour le Parlement européen et pour les autorités européennes à Bruxelles. Nous approuvons totalement vos préoccupations mais, au cours des négociations indirectes avec les autorités françaises, nous nous sommes efforcés de mettre l'accent sur notre souhait de parvenir à des solutions internationales au titre du suivi après l'accident de l'Erika, et plus particulièrement des solutions prises dans le cadre de l'OMI. Nous sommes satisfaits de voir que le gouvernement français a tenu des réunions à l'OMI, à Londres, indiquant son intention de collaborer avec cet organisme dans le but de renforcer les mesures de sécurité pour l'industrie des navires-citernes ainsi que pour d'autres segments de l'industrie, vraquière en particulier.
Côté américain, si l'Erika a bien sûr fait la « une » des journaux, il est juste de dire que l'on s'intéresse essentiellement au transport de vracs. L'année dernière, au mois de février, un vraquier s'est échoué au large de l'Etat de l'Oregon, sur la côte ouest. Je ne sais si les membres du Congrès que vous avez rencontrés vous en ont parlé, mais aujourd'hui, au Congrès de même qu'à la Coast Guard, l'intérêt principal est axé sur des mesures de sécurité concernant les vraquiers. Sur cette question des vraquiers, nous avons encouragé l'administration à évoquer le problème au sein de l'OMI.
Ce sont là des préoccupations auxquelles nous nous rallions entièrement. Sans doute savez-vous qu'il y a quelques mois, un vraquier appelé Lida L a fait naufrage avec trente marins à bords. Ils ont été tués et l'accident n'a pas du tout été couvert par les médias. Sous vouloir saper l'importance de l'accident de l'Erika, nous vous encourageons ainsi que les autorités françaises en général à adopter une vue globale pour qu'un accord international, que nous espérons trouver au sein de l'OMI, puisse couvrir les sociétés de classification, le contrôle de l'Etat du port et également l'administration du pavillon.
Je serai le premier à admettre que les administrations du pavillon n'ont pas été vraiment à la hauteur de la tâche, d'où la nécessité de renforcer le contrôle de l'Etat du port. Nous partageons votre désir de vous débarrasser des armateurs qui sont en dessous de la norme parce que ces derniers nous imposent aussi, à nous qui sommes des armateurs responsables, une concurrence économique déloyale.
En conclusion, j'oserais donc espérer au nom du CENSA qu'un dialogue comme celui que nous avons aujourd'hui puisse aboutir à un accord global très efficace et qu'un paquet de mesures vienne renforcer nos efforts pour tendre à chasser les armateurs sous-normes.
M. le Président : Vous représentez, si je comprends bien, les armements européens et japonais. Représentez-vous des armements aux Etats-Unis ou ne représentez-vous que des pavillons nationaux d'Etats européens ou japonais ? Représentez-vous également le pavillon maltais, le pavillon libérien ?
Par ailleurs, quelles sont les raisons de la disparition aussi brutale, qui a surpris bon nombre d'entre nous, du pavillon américain ? Les Etats-Unis ne nous ont pas habitués à se séparer d'éléments de pouvoir. Or une flotte en est un. Cela tient-il à la nature des équipages sur les navires ? Est-ce un choix politique, stratégique ?
Nous avons entendu hier, au Congrès américain, des Républicains et des Démocrates nous exprimer l'idée que nous devons travailler au sein de l'OMI de façon à mettre en place au niveau international des réglementations plus strictes afin de faire la chasse aux navires sous-normes et à leurs pavillons. Incluez-vous là-dedans les pavillons de complaisance ?
Si vraiment une telle volonté se manifestait non seulement de la part des autorités publiques américaines mais aussi des représentants de l'organisme que vous représentez, je pense que l'avenir se présenterait sous de bons auspices et qu'il serait possible de faire adopter rapidement une réglementation beaucoup plus stricte car chaque jour qui passe est un jour où peut se produire une catastrophe comme celles que nous avons connues au cours des dernières années.
M. Lars KJAER : Pour ce qui est de la question de savoir qui je représente, je ne veux pas vous donner une réponse trop compliquée, mais le CENSA est le représentant des principaux pays maritimes de l'Union européenne, plus la Norvège, et le Japon.
Avec ma casquette de l'International Chamber of Shipping, je représente également d'autres associations d'armateurs créées au Liberia, à Chypre et dans des pays asiatiques comme la Corée. Mais je ne représente pas les associations créées à Malte.
M. le Président : Pourquoi ?
M. Lars KJAER : Je pense que Malte... Comment dire ?... Les administrations du pavillon, les bonnes administrations du pavillon, sont sensibles à leurs responsabilités internationales. Or, à Malte, l'administration du pavillon a encore besoin de se développer et d'assumer des responsabilités internationales.
Cela me ramène à ce que je disais précédemment : il existe des administrations du pavillon qui ne sont que des boîtes aux lettres, qui ne cherchent qu'à attirer le tonnage, mais qui ne prennent pas sérieusement leurs responsabilités.
C'est ce qui me conduit à dire qu'il existe une absolue nécessité du contrôle de l'Etat du port. Je répète ce que j'ai déjà dit, mais le secteur que je représente se considère comme un secteur d'armateurs responsables. Ils ne tournent pas le dos à leurs responsabilités en matière de sécurité. Nous ne nous dissimulons pas nos faiblesses. Nous voulons nous débarrasser des armateurs sous-normes, mais nous voulons également coopérer avec les gouvernements dans le but de trouver des solutions internationales, non seulement dans leur portée, mais aussi dans leur application. Le transport maritime est une véritable industrie internationale, qui demande des solutions internationales.
Dans votre troisième question, vous avez parlé de l'OMI. Je me suis déjà entretenu avec les autorités américaines à ce sujet. Je suis très satisfait d'apprendre qu'elles souhaitent coopérer avec les autorités françaises et avec d'autres encore, dans le cadre de l'OMI, pour trouver des solutions à l'échelle mondiale.
Sans vouloir être tatillon, je dois dire qu'une initiative consistant à retirer, de façon similaire à l'Oil Pollution Act de 1990, les navires à coque simple, présentée comme un fait accompli, comme la solution absolue, se heurterait à une forte opposition au sein de l'OMI et ne serait nullement la solution à laquelle notre industrie souscrirait.
M. le Président : Cela veut-il dire qu'il faudrait que les Etats-Unis reviennent sur l'OPA 90, de façon à faciliter les négociations au sein de l'OMI ?
M. Lars KJAER : La façon dont je conçois la situation est la suivante : bien sûr, l'administration américaine est obligée d'appliquer la législation américaine, l'OPA 90 ;. mais, si je comprends bien, les Etats-Unis voudraient faciliter une solution qui prenne en compte la règle XIII - G de la convention MARPOL qui établit des échéances de retrait de service pour les bateaux monocoques, afin de parvenir à une solution qui ait le soutien de la France, de l'Union européenne et d'autres gouvernements.
Cela signifierait que les Etats-Unis ne peuvent ratifier la règle XIII - G de la convention MARPOL parce qu'il leur est impossible de le faire. Mais je trouve satisfaisant qu'ils soient disposés à travailler avec la France puisque je comprends que des contacts ont eu lieu. Je sais que cette semaine, lors de la réunion du comité de la sécurité maritime de l'OMI, les Etats-Unis s'efforceront de faciliter une entente et la création d'un nouveau groupe de travail. La France sera invitée à faire ses propositions d'ici la fin juin, afin qu'une solution se dégage rapidement.
Nous comprenons très bien que les opinions publiques fassent pression pour qu'une solution soit trouvée. Je suppose qu'au lieu de vous limiter aux mesures liées aux pétroliers, ...
M. le Président : Mais nous ne nous limitons pas aux navires pétroliers. Notre mission s'attache aux problèmes de sécurité de tout navire transportant des cargaisons dangereuses ou polluantes.
M. Lars KJAER : Je le sais, mais du fait de l'Erika, certains proposent de se limiter aux pétroliers. J'ai appris que vous aviez rencontré des représentants de l'IACS. Aussi serai-je très franc avec vous aujourd'hui : nous sommes très critiques vis-à-vis des sociétés de classification. Nous le leur avons dit lors des rencontres et des réunions que nous avons eues avec elles au fil des ans. Mais elles n'ont jamais pris nos critiques au sérieux.
En fait, deux semaines avant l'Erika, nous avons eu une réunion avec l'IACS, au cours de laquelle nous nous sommes plaints, entre autres, de leur absence de transparence. Nous savons que se pose un problème de cette nature pour l'Erika. Nous avons critiqué, par exemple, les « sauts de classe » , les transferts entre sociétés de classification. En la matière, les armateurs sous-normes font de la spéculation. Comme il n'y a jamais de remise d'informations d'une société de classification à une autre, ces armateurs sous-normes ont la vie belle !
Nous avions dit à l'IACS que le moment était certainement venu pour que l'OMI renforce ses règlements concernant les sociétés de classification. Peut-être même est-il venu pour une entité de contrôle indépendante des sociétés de classification ?
Si Mme Metcalf avait été là, c'est elle qui aurait répondu à votre deuxième question concernant la disparition du pavillon américain, mais la réponse simple et évidente est que les sociétés de transport maritime américaines n'ont pas été rentables et que les investisseurs sont partis s'intéresser à d'autres secteurs. Je serais provocateur si je vous disais que les Etats-Unis n'ont pas eu une politique maritime depuis des années ou que la seule politique qu'ils aient eue comptait deux mesures : la protection du cabotage et les subventions accordées aux constructeurs, ainsi qu'à certains opérateurs de navires.
Il n'y a pas eu de mesures structurelles compétitives du type de celles que nous avons pu constater en Europe où, comme vous le savez, des mesures sont en place ou en train de se mettre en place pour donner au secteur maritime une base de concurrence au niveau international sans avoir à compter sur des subventions directes. Je pense à des mesures comme un deuxième registre, comme des taxations à la tonne, mais aussi à des mesures de sensibilisation et de politique sociale. Cela manque aux Etats-Unis. Il n'existe aucune volonté de parler de ce type de mesures : les syndicats n'ont pas voulu discuter de nouvelles propositions ; les armateurs n'ont pas eu d'incitations en raison de cet octroi de subventions.
Comme je l'ai déjà expliqué dans ma remarque liminaire, cela signifie que les gouvernements étrangers et les intervenants du secteur ne peuvent pas travailler en collaboration avec une industrie basée aux Etats-Unis. En conséquence, nous ne pouvons pas nous adresser au Congrès et au gouvernement pour plaider en faveur de solutions internationales, car il n'y a pas d'appui fort de la part du secteur maritime américain. Nous sommes donc handicapés dans nos efforts pour freiner « l'unilatéralisme » américain.
M. René LEROUX : Votre conviction sur la nécessité de passer par l'OMI a été très claire. J'aimerais revenir sur un des principes que les Américains ont adopté dans le cadre de l'OPA 90 : celui des navires à double coque. Nous aimerions que vous, qui représentez les armateurs européens et japonais, nous donniez franchement votre avis sur la technique de la double coque et sa fiabilité. Les vérifications sont-elles effectuées couramment et de quelle manière ? Pouvez-vous donner votre véritable sentiment sur ces vérifications ? Sont-elles vraiment efficaces ?
Avez-vous eu connaissance de la fabrication de l'E3, bateau européen dont un exemplaire a été construit ? Connaissez-vous ses caractéristiques et que pensez-vous de ce navire, qui est aussi un navire à double coque, mais d'une conception bien différente des bateaux que vous avez puisqu'il présente également un pont intermédiaire qui, visiblement, se heurte à la réglementation américaine ?
M. Lars KJAER : La question de savoir si la technologie de la double coque est bien la plus efficace est une question fort controversée. Elle est toujours posée aux Etats-Unis, tout comme ailleurs. Nous avons adopté la position suivante : l'OPA 90 a été promulguée, nous ne sommes pas forcément d'accord avec ses différents éléments, mais nous sommes surtout concernés par les obligations non négociables de ses dates limites. Il faut que les navires monocoques soient retirés...
M. le Président : Non négociables pour les Etats-Unis ?
M. Lars KJAER : C'est inscrit dans la loi. Dans l'OPA 90, les dates fixées ne sont pas négociables.
M. le Président : Il n'y a aucune possibilité de négocier ?
M. Lars KJAER : C'est cela, ce sont des mesures unilatérales...
M. René LEROUX : MARPOL fixe d'autres dates.
M. Lars KJAER : Exactement. Nous n'avons pas soutenu l'OPA 90 pour la raison qu'il s'agit d'une mesure unilatérale. Ses dates limites obligatoires signifient que les armateurs des navires qui s'attendaient à une durée de vingt ans, sont confrontés à la situation de voir leurs navires interdits au bout de quinze ans. C'est la raison pour laquelle nous appuyons la règle XIII-G de MARPOL, car elle ne comporte pas de dates limites obligatoires non négociables, mais cherche plutôt à mettre en place un plan d'élimination progressive. Encore une fois, même si le débat se pose toujours sur la pertinence de la double coque par rapport à d'autres solutions de construction, nous acceptons la règle XIII-G de MARPOL et nous allons travailler en collaboration avec la France, au sein de l'OMI, afin d'étudier et de voir rapidement si des modifications doivent être apportées à MARPOL. Une proposition tendant à avoir des dates limites non négociables dans la règle XIII-G MARPOL, j'en suis persuadé, ne recevrait pas l'appui de la majorité.
Ma préoccupation est donc la suivante : je pense que nous aurons un désaccord entre l'OMI et l'Union européenne et que l'Europe sera tentée de mettre en _uvre des mesures régionales encore différentes des mesures unilatérales américaines, avec le risque de porter atteinte à l'intégrité de l'OMI et de créer ce que j'appelle « une explosion des mesures régionales unilatérales » dans le monde entier. Cela serait nuisible à l'industrie et, en fin de compte, dommageable aux importateurs, aux exportateurs et aux consommateurs, car cela constituerait des barrières commerciales et ne ferait qu'accroître le coût des échanges.
M. René LEROUX : Vous ne m'avez pas dit si les vérifications de l'application de la loi sont régulières et efficaces ?
M. Lars KJAER : Je pense qu'en ce qui concerne la double coque aux Etats-Unis, la situation est très compliquée. Dès l'année 2015, aucun navire-citerne à simple coque n'aura le droit d'accéder aux ports américains mais, d'ores et déjà, dans le cadre de l'OPA 90, il y a des dates limites non négociables. A titre d'exemple, dès cette année, deux catégories de navires ne seront plus autorisées à accéder aux ports américains.
Qui contrôle cela ? La Coast Guard, qui est très efficace pour le contrôle de l'Etat du port. Il y a deux ans, la Coast Guard a créé une structure pour les vérifications. Vous avez là certains facteurs, vous en êtes conscients. La semaine dernière le Mémorandum de Paris a mis en _uvre un dispositif similaire. Là, vous avez un navire avec « un pavillon blanc » ou « un pavillon noir » ou « gris ». Les navires battant « pavillon blanc » ne font pas l'objet d'une vérification ou, du moins, pas aussi souvent car le propriétaire est responsable, tout comme l'administration du pavillon et la société de classification. Il n'en va pas de même des navires battant « pavillon noir ». Nous sommes tout à fait favorables à de tels dispositifs car être l'objet d'une vérification, cela signifie que le navire ne bouge pas, qu'il est au port et qu'il ne peut gagner d'argent. C'est dommageable à l'armateur responsable. Dans la mesure où les armateurs responsables ne sont pas vérifiés parce que justement ils sont responsables, ils peuvent ainsi continuer à gagner de l'argent, tandis que les armateurs sous-normes sont immobilisés. Et ainsi, nous espérons qu'un jour ils disparaîtront du marché.
Encore une fois, dans le contexte de l'OMI, nous sommes disposés à travailler de manière constructive, pour renforcer le contrôle de l'Etat du port. J'aimerais vous suggérer, en tant que parlementaires, d'aller encore plus loin et d'accorder des récompenses aux armateurs responsables, par exemple, en leur appliquant des taxes moins élevées dans les ports.
M. le Président : Comme à Rotterdam.
M. Lars KJAER : Mais la vérification dans le cadre de l'OPA 90 est très rigoureuse. Il pourrait être intéressant pour vous de savoir que la Coast Guard demande, 24 heures avant qu'un navire aborde un port américain, des informations sur le bateau, le numéro de classification de l'OMI, s'il dispose des certificats ISM. Donc la Coast Guard a la possibilité de savoir 24 heures au préalable si c'est un bateau autorisé ou s'il ne l'est pas, du fait qu'il ne dispose pas de tous les certificats ISM, qu'il est simple coque ou qu'il aurait dû être supprimé.
Le résultat de l'accident du New Carissa l'année dernière a conduit la Coast Guard à élargir cette exigence de préavis. Maintenant, c'est 24 heures de préavis ; bientôt, ce sera 48 heures avant d'aborder les eaux territoriales américaines.
M. le président. Dans les douze milles nautiques ?
M. Lars KJAER : C'est une mesure que nous appuyons parce que nous n'avons rien à cacher. Nous voulons que la Coast Guard dispose de l'information nécessaire.
M. le Président : Nous avons EQUASIS.
M. Lars KJAER : Nous avons fermement soutenu EQUASIS.
M. René LEROUX : Ma question portait précisément sur votre position par rapport à EQUASIS. Une meilleure connaissance de la flotte mondiale paraît être une nécessité. La France, l'Union européenne souhaitent développer le système EQUASIS. Quelle est votre position concernant une éventuelle coopération pour nourrir une véritable base de données ?
M. Jean-Michel MARCHAND : Vous avez dit, dans les mesures que vous souhaitiez, qu'il faudrait un audit indépendant des sociétés de classification. Afin d'avoir des informations justes et fiables, il faut que tous les partenaires soient parfaitement coordonnés les uns avec les autres et que les informations soient incontestables. Qui pourrait, dans la situation actuelle, commander cet audit indépendant ? Et qui paierait ?
M. Lars KJAER : C'est une excellente question. Si vous permettez, j'y répondrai d'abord. Nous sommes en faveur de la transparence dans notre secteur d'activité. Nous n'avons rien à cacher. Nous avons des armateurs sous-normes parmi nos membres. Nous les avons acceptés, mais il faut les cibler comme tous les autres armateurs sous-normes. Nous soutenons donc EQUASIS.
Nous le soutenons également, soyons honnêtes, pour des raisons purement économiques. Le Mémorandum de Paris permettra à EQUASIS, une fois celui-ci mis sur pied, de s'assurer qu'un bateau a été vérifié il y a un mois par la Coast Guard ou par le Mémorandum de Tokyo. Cela signifie que le Mémorandum de Paris conclura qu'il n'est pas nécessaire d'inspecter ce navire s'il a un « pavillon blanc », car ce sera le navire d'un armateur responsable, naviguant sous un pavillon responsable. Les vérifications, comme je vous l'ai dit, coûtent de l'argent. Nous sommes membres d'un groupe de correspondants d'EQUASIS et nous travaillons avec le Français responsable chargé de sa mise en place. La date de lancement est lundi ou mercredi de la semaine prochaine ; nous travaillons constructivement avec l'administration française sur EQUASIS.
J'essaierai également d'être honnête avec vous en évoquant un petit élément par rapport à l'ensemble de la question. EQUASIS a été créé, et c'est son principe originel, afin de collecter et de diffuser des informations liées à la sécurité. Les syndicats souhaitent y ajouter des informations pour savoir si l'armateur concerné a eu une négociation collective avec l'ITF, la Fédération internationale des transports. Nous croyons que ces informations ne sont pas pertinentes pour l'objectif initial d'EQUASIS. Les pourparlers des syndicats, les questions salariales sont importantes, mais le fait est de savoir si cela contribue à l'amélioration de la sécurité ou pas. A mon avis, on ne devrait pas demander à EQUASIS de se pencher sur cette question. Si nous le faisons, je crains qu'il ne soit tué au berceau.
Pour revenir à la question de M. Leroux, comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, nous avons essayé de travailler en collaboration avec l'IACS depuis des années afin que ses membres comprennent qu'ils bénéficient d'un privilège. Ils vérifiaient des navires pour le compte des armateurs et d'autres pour le compte de l'administration du pavillon. Ils ont le beurre et l'argent du beurre. Mais si vous voulez bénéficier de privilèges, il faut être responsable, il faut être transparent et il faut être intègre. De toute évidence, nous avons constaté que dans le cas de l'Erika quelque chose manquait. Nous avions identifié ces problèmes deux semaines seulement avant l'accident. Nous avons donc signalé cela aux sociétés de classification et leur avons demandé d'élaborer des mesures permettant d'atteindre davantage de transparence et de partage de leurs informations.
L'autre question était de savoir comment nous exerçons la pression. J'invite la France, dans le contexte du comité de la sécurité maritime de l'OMI, dans le cadre de la mission qui incombe à ce nouveau groupe de travail, à insister sur la nécessité de faire participer les sociétés de classification à un ensemble global.
J'espère avoir répondu à toutes vos questions.
(Mme Kathy Metcalf arrive dans la salle.)
M. René LEROUX : Vous ne m'avez pas donné votre sentiment sur le E3.
M. Lars KJAER : Je dois dire qu'il ne m'est pas facile de répondre à cette question.
M. le Président : Le sentiment que nous avons, c'est que la France a développé au travers de l'un de ses chantiers, - les Chantiers de l'Atlantique -, une réponse aux problèmes de sécurité différente de celle de la double coque. C'est un autre concept technique. Mais la position prise par les Etats-Unis - celle de la double coque - étant irréversible et devant être mise en place à une date déterminée, implique qu'aucune compagnie de navigation ne pourra s'en affranchir car aucune ne peut se permettre d'avoir dans sa flotte des navires à double coque et des navires d'un autre concept.
M. Lars KJAER : Oui.
M. le Président : Vous parliez d'industrie tout à l'heure. C'est une question industrielle extrêmement importante. Qui peut le plus peut le moins.
M. Lars KJAER : Je ne sais si Mme Metcalf souhaite répondre à cette question, en tant que représentant de sociétés basées aux Etats-Unis, mais nous n'avons cessé de répéter à maintes reprises à l'administration des Etats-Unis et au Congrès, lorsqu'ils étaient en pleine discussion sur l'OPA 90, que la question la plus importante n'est pas de savoir comment on atteint un objectif, à savoir l'élimination totale des déversements d'hydrocarbures, mais d'y parvenir. Il devrait y avoir d'autres solutions disponibles pour le secteur concerné.
C'est un débat qui continue encore aujourd'hui. De nombreuses études ont été lancées sur ce sujet et se poursuivent mais, Kathy me corrigera si je me trompe, je pense que le Congrès ne veut même pas engager ce débat. Le Congrès a confirmé que l'impératif lié à la technique de la double coque était maintenu et il n'est pas disposé à envisager d'autres questions.
Mme Kathy METCALF : Tout d'abord, je vous présente mes excuses pour ce retard, mais nos trains ne fonctionnent pas aussi bien que les trains européens. Si après la réunion et votre retour en France, vous avez des questions à me poser, vous pourrez toujours me contacter. Je serai heureuse de pouvoir collaborer avec vous.
Je vous donnerai une réponse non américaine à votre question. Je me rallie entièrement à la réponse faite par Lars. Un de nos problèmes - sans manquer de respect aux membres du Congrès -, c'est que nos représentants savent énormément de choses, mais qu'ils sont passés maître dans l'art de la politique. Au moment de l'accident de l'Exxon Valdez, ils ont tout à coup décidé qu'ils étaient passés maîtres en construction navale. C'était comme une boule de neige lancée, qui roulait, roulait et que l'on ne pouvait arrêter. Je pense pour ma part que toute action permettant d'atteindre notre but devrait être développée.
Je crois que l'industrie des transports maritimes pense qu'il nous faut nous assurer que nous avons parfaitement formé les gens plutôt que de changer la conception et la construction des navires. Ayant navigué comme officier sur des pétroliers dans le Prince William Sound, je peux vous dire que l'Exxon Valdez aurait pu avoir cinq coques, son échouage n'aurait pas été évité. Je vous exhorte donc au fur et à mesure que vous remontez ce parcours que nous avons entamé il y a dix ans, pour les raisons les plus malencontreuses, à laisser l'industrie atteindre le but que vous-mêmes lui aurez assigné, mais selon des modalités qui pourront être siennes.
M. Pierre HERIAUD : Je voudrais revenir sur EQUASIS et la transmission des données. Comment celle-ci est-elle assurée ? Nous sommes là dans un domaine de sécurité très élevée. Est-il envisagé un système particulier de cryptage des données ?
Mme Kathy METCALF : Je sais que la Coast Guard a été très intéressée par ce système mais, personnellement, je n'ai vu aucun élément de données relatif au sujet qui vous préoccupe.
M. Lars KJAER : Pour ma part, je ne peux que dire que lorsque le système sera lancé la semaine prochaine, il sera modeste. Mais, bien évidemment l'intention est de l'élargir progressivement à d'autres pays. Comme vous l'avez sans doute entendu dire par la Coast Guard, les Etats-Unis vont signer le mémorandum créant EQUASIS la semaine prochaine, une fois le système lancé. Dès la semaine prochaine, l'échange d'informations entre le Mémorandum de Paris et le contrôle de l'Etat du port par la Coast Guard pourra commencer.
Kathy, pour ton information, nous avons parlé du contrôle de l'Etat du port et de l'identification de navires sous-normes.
M. Pierre HERIAUD : Vous avez répondu à ma question sur le problème des délais, des structures et du système de fonctionnement, mais pas forcément sur celui de la sécurisation des données. En effet, cette base de données est tout à fait confidentielle. Même si elle peut ensuite être transmise dans diverses directions, n'importe qui ne peut y avoir accès, l'encombrer ou la modifier. C'est la raison pour laquelle je parlais d'un cryptage éventuel des transmissions.
M. Lars KJAER : Tel que je comprends le système et les intentions sous-tendant la création d'EQUASIS, le but essentiel est d'assurer la transparence pour les autorités, pour les armateurs, mais également pour les exploitants. Donc, je pense que le cryptage d'échanges de l'information entre les autorités interviendra à un stade ultérieur si, par exemple, il vise un pan de l'industrie ou un segment secondaire. Mais pour l'instant, les informations d'EQUASIS seront accessibles au public.
Cela étant, il n'y a eu, à ma connaissance, aucun débat quant aux modalités du cryptage ni à la date d'une entrée en vigueur.
Mme Kathy METCALF : Le système de contrôle de l'Etat du port par la Coast Guard est accessible via le site Web de la Coast Guard. Sur ce dernier, avec le numéro d'identification du navire, vous pouvez accéder à toute la liste concernant les navires, y compris les violations qui ont eu lieu.
M. le Président : Nous allons devoir interrompre cet entretien car nous devons partir à 9 heures 30. Je vous remercie d'être venus nous voir et de nous avoir fait part d'éléments intéressants, qui ont confirmé certains sentiments que nous avions. Je suis persuadé que le rapport que nous rendrons prendra en compte ces éléments mais, sans attendre, nous en ferons part dès la semaine prochaine aux autorités françaises puisque les choses pourraient s'accélérer dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne, et de celle des rencontres au sein de l'OMI. Les parlementaires que nous sommes tiennent informés l'exécutif des éléments et des sentiments que nous avons pu recueillir.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être relue par les intervenants.
Audition de Mme Linda B. BURLINGTON,
senior attorney au Bureau du conseiller général pour les ressources naturelles,
Mme Jean E. SNIDER, deputy director du Bureau d'intervention et de restauration,
M. Brian E. JULIUS, responsable de la région du Golfe du Mexique,
et de M. Russel J. BELLMER, expert en écologie
de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
(extrait du procès-verbal de la séance du 19 mai 2000 à Washington)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Mme Linda B. BURLINGTON : Je suis senior attorney au bureau du Conseiller général pour les ressources naturelles de la National Ocenanic and Atmospheric Administration, la NOAA. Ce centre est, entre autres fonctions, responsable de l'évaluation des dommages causés par les déversements de pétrole et de la restauration des ressources naturelles endommagées.
Notre groupe travaille de très près avec le bureau d'intervention et de restauration et, aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu du fonctionnement de ce bureau ainsi que de la manière dont il travaille en collaboration avec la Coast Guard et d'autres agences pour protéger nos ressources naturelles.
Je donnerai brièvement - car je sais que vous disposez de peu de temps - une idée de notre processus qui consiste à mettre en place des règlements et des procédures pour évaluer l'impact des accidents. Une des personnes ici présentes vous exposera comment évaluer ces impacts et ce que nous faisons pour réhabiliter l'habitat naturel. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations sur notre site web.
M. le Président : Je voudrais vous remercier de nous accueillir et en même temps vous présenter toutes nos excuses pour cette rencontre sans doute trop brève. Deux heures pour faire le point sur les questions d'évaluation et de réparation des dommages écologiques, c'est en effet trop court. Ce sont les impératifs de nos horaires. Je veux vous remercier d'avoir accepté cette rencontre et des conditions dans lesquelles vous l'avez préparée, car nous avons appris que vous acceptiez de quitter vos locaux, situés à l'extérieur de Washington, pour permettre à cette rencontre de se dérouler ici, au centre de la ville. Cela nous a bien facilité les choses.
Vous connaissez les raisons de notre venue à Washington : une catastrophe écologique, qui est aussi une catastrophe économique et une catastrophe humaine. Nous avons été désignés par nos collègues de l'Assemblée nationale française pour enquêter, non pas sur le naufrage lui-même, mais sur les moyens à mettre en _uvre pour éviter que ne se renouvelle ce type d'accident. Notre visite aux Etats-Unis s'inscrit dans ce cadre. Nous avons étudié l'Oil Pollution Act, rencontré la Coast Guard, d'autres organisations et agences que la vôtre, avons découvert les dispositifs qui ont été mis en place ici. Tout cela nous intéresse fort. Merci de nous faire partager l'expérience que vous avez acquise.
Mme Linda B. BURLINGTON : J'ai suivi dans la presse l'affaire de l'Erika.
Nous allons tout d'abord entendre le docteur Jean Snider qui est chargée de l'intervention en cas de marée noire.
Mme Jean E. SNIDER : Je suis très contente de faire votre connaissance. La NOAA a envoyé trois scientifiques sur le site de la catastrophe de l'Erika durant quelques semaines, à la demande des scientifiques français. Lors de la catastrophe de l'Exxon Valdez, en 1989, nous avions accueilli des scientifiques français en Alaska. Lorsqu'ils nous ont demandé d'envoyer les nôtres pour examiner le problème que vous avez rencontré, nous l'avons fait bien volontiers. Nous vous remercions de votre hospitalité.
Confrontés à un accident pétrolier, nous répondons généralement par cinq types de mesures : la prévention, la disponibilité, l'intervention, l'évaluation des dommages et la restauration. Je vous parlerai aujourd'hui de la phase d'intervention, et mes collègues interviendront sur l'évaluation des dégâts et la restauration. Je traiterai rapidement de la planification et de la préparation.
Au cours d'une intervention, la NOAA joue deux rôles : nous apportons l'expertise scientifique à la Coast Guard - la NOAA est leur conseiller scientifique - et nous sommes également le trustee des ressources naturelles. Nous représentons les agences fédérales, les Etats et les tribus indiennes pour la réhabilitation des ressources naturelles endommagées.
La NOAA est responsable de ces ressources dans les zones côtières et dans les zones au large. Au cours d'un accident pétrolier, nous tentons de minimiser les conséquences néfastes éventuelles de l'intervention elle-même. Une fois l'intervention terminée, nous évaluons les dégâts, bien que nous le fassions également aussi en cours d'intervention, mais l'évaluation des dommages devient alors l'objectif premier qui va constituer la base de la restauration. Cela vous donne le cadre des interventions dont nous vous parlerons cet après-midi.
En quelques mots, notre institution comporte plusieurs bureaux qui interviennent en cas d'accident pétrolier, non seulement des agences fédérales et d'Etat, mais aussi privés. Chaque bureau joue un rôle qui lui est propre. A titre d'exemple, je peux vous parler du département HAZMAT - Hazardous Materials Response, c'est à dire du bureau d'intervention pour les matières dangereuses.
Ce programme a commencé en 1976, après l'accident d'un pétrolier au large des côtes du Massachussett, qui déversa plus de 6 000 barils de fioul n° 6. C'est l'incident qui a sensibilisé le gouvernement des Etats-Unis à l'importance de la science en matière d'intervention. Notre groupe a alors été constitué comme un groupe d'experts devant fournir des données scientifiques aux principales agences concernées et à la Coast Guard sur les déversements dans les zones côtières. Nos personnels sont disponibles 24 heures sur 24 et interviennent sur site dans à peu près une centaine d'accidents par an. Ils peuvent également dispenser des conseils techniques par téléphone aux plaignants.
Pour répondre avec efficacité en cas d'accident pétrolier, il faut être situé à proximité pour pouvoir intervenir rapidement. Il est essentiel que le responsable arrive rapidement sur les lieux pour en évaluer les caractéristiques et pouvoir agir aussitôt. Plus la nappe d'hydrocarbure s'étend, plus le danger s'accroît, tandis qu'augmente l'atteinte à l'environnement. Nous avons donc des personnels qui travaillent avec la Coast Guard et d'autres agences fédérales et sont répartis tout autour des Etats-Unis, en Alaska et dans la région des Grands Lacs.
Au cours d'un accident pétrolier côtier, la Coast Guard dispose de plusieurs équipes qui viennent de différentes agences fédérales. C'est la responsabilité de chaque agence fédérale de donner à la Coast Guard tous les moyens dont elle a besoin.
La NOAA, pour sa part, fournit le coordinateur du support scientifique, le Scientific Support Coordinator (SSC), qui dirige une équipe d'experts pour servir d'appui scientifique. Ce sont les principaux conseillers scientifiques pour différents problèmes dont je vais parler brièvement. Ils interviennent régulièrement en cas de pollution, fournissent une assistance aux scientifiques de la communauté touchée qui ont une expertise locale, pour relayer ces informations au coordinateur fédéral sur le terrain de la Coast Guard, afin que ce dernier puisse synthétiser les problèmes opérationnels et scientifiques.
Ils sont également en liaison avec le groupe d'évaluation des dégâts et travaillent avec la partie responsable ou l'industriel responsable, ainsi qu'avec les organismes d'Etat et autres qui participent à l'intervention et doivent prendre en compte les impératifs de protection de l'environnement.
La structure de commandement que le gouvernement américain utilise en cas d'accident, l'Incident command system, est une structure très simplifiée. Notre groupe se trouve dans la cellule de planification. L'équipe d'évaluation des dégâts sert de lien avec la structure de commandement d'accident au niveau supérieur. Elle n'est pas vraiment impliquée dans la phase d'intervention, mais reste en contact constant avec le coordinateur fédéral sur le terrain.
Le SSC est responsable des questions environnementales et scientifiques qui peuvent avoir un impact sur une intervention en cas de pollution. Il est assisté par des modélisateurs qui établissent des analyses de trajectoires et traduisent ces informations en termes de mesures pouvant être utilisées pour minimiser l'impact sur l'environnement.
Nous mettons aussi fortement l'accent sur la gestion des informations, car en cas de marée noire, une information cohérente et opportune est extrêmement importante. Plusieurs personnes sur les lieux sont responsables de la collecte et de la gestion de ces informations. L'équipe de soutien scientifique doit pouvoir modifier le nombre et la composition de l'équipe sur le terrain pour pouvoir répondre de manière efficace.
Nous avons également un noyau dur de personnes dans notre bureau de Seattle, qui peut entreprendre des évaluations à plus long terme et fournir un soutien en matière d'expertise à ceux qui sont sur les lieux de l'accident.
Les quatre questions, classiques, que nous nous posons sont les suivantes : Qu'est-ce qui a été déversé ? En d'autres termes, quel type d'hydrocarbure ? Où va-t-il ? Qui sera atteint, quel sera l'impact sur les côtes ? Et comment cet impact peut-il être réduit ?
La première question est une question relativement banale. Les diverses sortes de pétrole ne se comportent pas de la même manière. L'éventail des contre-mesures est large. Il y a des périodes pendant lesquelles telle ou telle mesure ne peut être utilisée. C'est la raison pour laquelle la composition de l'hydrocarbure, son évolution dans le temps sont des données scientifiques essentielles pour le coordinateur fédéral sur le terrain.
La deuxième question est tout aussi essentielle, elle concerne l'évolution de la nappe. Les responsables sont en contact permanent avec les services météo. Ils font des observations sur place. Nous faisons des calculs à base de modélisation pour que le personnel d'intervention puisse bénéficier de projections et que le matériel soit sur les lieux en temps utile. Notre gestion d'information permet que toutes les vingt-quatre heures, nous disposions d'une carte informatique de la trajectoire prévue. Nous recevons des rapports météorologiques trois ou quatre fois par jour, disponibles pour l'information de ceux qui ont accès à notre système informatique.
Pour répondre à la troisième question - qui sera touché ? - il faut connaître les ressources biologiques de la région : quels sont les oiseaux, les poissons, les mammifères présents au moment de l'accident ? Une partie de notre planification d'urgence prend en compte la nature générale des ressources. Nous recueillons l'information au préalable, mais celle-ci doit être évaluée au moment de l'accident pour nous assurer qu'elle est techniquement correcte. Nous sommes donc en contact avec des scientifiques locaux pour nous assurer de la qualité de l'information. Nous recherchons également toutes les informations que peut demander le coordinateur fédéral sur le terrain. Nous regardons également si les ressources biologiques qui avaient été recensées sont toujours présentes, si la pollution est susceptible d'avoir à long terme des effets plus ou moins graves, et si l'environnement pourra se rétablir très rapidement.
Enfin, nous examinons la façon dont il est possible d'atténuer l'impact de la pollution. Pour ce faire, il faut établir des priorités parmi les ressources à protéger. Quelles sont les moyens d'intervention ? Pour l'Exxon Valdez, nous avions trois ou quatre barrages flottants autour d'une zone et des dispersants. Une évaluation doit être faite pour savoir s'il vaut mieux utiliser ou non les dispersants. L'intervention repose sur un compromis : intervenir à un endroit donné suppose d'accepter qu'un autre sera plus touché.
L'équipe scientifique doit être flexible dans sa composition. Les effectifs déployés sont fonction du niveau de la pollution. Nous avons établi la hiérarchie suivante : la pollution mineure ou potentielle, inférieure à 10 000 gallons, la pollution moyenne, entre 10 000 et 100 000 gallons, et l'événement majeur, supérieur à 100 000 gallons.
Pour les accidents mineurs, le SSC sur place, ou renseigné par téléphone, est en liaison avec les membres de l'équipe de Seattle. Pour les accidents moyens, vous pouvez avoir un à deux spécialistes sur le terrain : un biologiste et un « modéliseur ». Pour les accidents majeurs, vous pouvez avoir toute une équipe sur le terrain, avec des spécialistes de l'impact sur les ressources côtières, des opérations de nettoyage, des contaminations de la chaîne alimentaire...
Notre travail entre les pollutions consiste pour une part à effectuer un état des ressources biologiques existantes. Nous établissons une cartographie précise de tout le littoral américain, laquelle permet d'évaluer les ressources biologiques, l'utilisation humaine ou autre. Ces cartes montrent les lieux d'habitats des oiseaux, des poissons, des crustacés... Il s'agit de connaître les ressources de la région pour lesquelles l'équipe peut intervenir et d'être en mesure de suggérer au coordinateur sur le terrain quelles ressources sont à protéger en priorité.
Nous avons également des programmes informatiques qui nous rendent cette cartographie conviviale. Toute information est facilement disponible car elle est la clé de toute intervention, et disponible également de manière compréhensible. Nous disposons aussi d'un autre modèle informatique que nous utilisons sur le terrain tous les jours pour suivre l'évolution de la nappe.
Nous avons participé activement à l'étude des conséquences de l'accident de l'Exxon Valdez. Nous poursuivons toujours l'étude à long terme sur la restauration de l'environnement et l'impact des techniques de restauration utilisées dans la zone de Prince William Sound.
Nous disposons également de documents d'intervention pour aider les autres intervenants à comprendre les problèmes écologiques et la façon de procéder pour que des plans conjugués soient efficaces. La plupart des intervenants ne verront qu'un ou deux accidents dans leur vie. Nous fournissons beaucoup de matériel d'évaluation technique et participons à des formations pour que les gens comprennent les structures de gestion sur le terrain pendant un accident et certains des problèmes clés auxquels ils seront confrontés. A cet effet, nous organisons une vingtaine de stages pas an.
Nous avons des visiteurs nationaux et internationaux qui viennent suivre des cours sur les différents aspects des accidents, des cours sur l'évolution de l'impact sur le littoral et parfois, des cours adaptés à un groupe de personnes qui viennent pour un stage d'information bien précis sur tel ou tel aspect.
Mme Linda B. BURLINGTON : Je donnerai un bref aperçu de l'évolution de l'environnement réglementaire et législatif.
Vous connaissez l'OPA de 1990. Dans cette loi, il y a un volet qui prévoit de nouvelles réglementations en matière d'environnement et d'évaluation des dommages écologiques, qui a abouti à l'adoption des Natural Resource Damage Assessment Regulations de 1996. C'est à la NOAA qu'a incombé la charge de définir ces règles pour l'évaluation de l'incidence des pollutions sur l'environnement.
Les objectifs de l'OPA et des nouvelles réglementations sont de faire connaître l'environnement et de respecter les besoins du grand public. Nous restaurons, réhabilitons, remplaçons et acquérons l'équivalent des ressources naturelles et des services endommagés.
La raison pour laquelle cet aspect nous intéresse tellement aux Etats-Unis, c'est que plus de 60 % de la population américaine habitent dans les zones côtières. La restauration est la seule activité qui tient réellement compte des dommages écologiques causés par les êtres humains.
Nous partons du principe que le pollueur est le payeur. Cela me paraît évident et c'est finalement le même principe qui gouverne les conventions CLC et FIPOL.
Enfin, un aspect important de notre loi et nos réglementations est que l'intégralité des sommes que nous récupérons doit servir à restaurer ou remplacer ces ressources. L'argent que nous collectons est dépensé pour améliorer l'environnement.
Les trustees des ressources naturelles sont des responsables fédéraux, d'Etat ou des tribus indiennes, chargés de l'évaluation des dommages et de la restauration des ressources naturelles. La NOAA, en tant que trustee fédéral des ressources naturelles, est chargée par la loi d'évaluer l'ampleur des dommages, d'établir des programmes de réhabilitation et d'établir les règlements définissant les modalités de ces évaluations.
Afin de remplir ces missions, nous avons mis en place un programme d'évaluation des dommages et de restauration (Damage assessment and restoration program, DARP).
Le DARP est composé de trois cellules. La première est l'Office of general counsel, constituée de juristes qui s'occupent des questions juridiques liées au programme d'évaluation et de restauration.
L'autre cellule est le centre d'évaluation des dommages, composé de scientifiques.
La dernière est le centre de restauration. Un de ses responsables vous en parlera. Ce sont des spécialistes de la restauration de l'habitat et des ressources naturelles.
En cas d'accident, nous mettons sur pied une équipe composée de représentants de ces trois bureaux. Notre objectif est de travailler en équipe durant tout le temps que dure l'accident, du moment de notre première implication jusqu'à la fin de la restauration de nos ressources. Jusqu'à présent, cela c'est très bien passé. Nous connaissons nos objectifs, ce qui permet d'élaborer des plans sains et d'éviter les contentieux.
Aux Etats-Unis, jusqu'à il y a quelques années, l'une des activités principales liée aux accidents pétroliers était constituée par les litiges, les affaires judiciaires. Mais nous avons compris que ces contentieux mettaient plusieurs années à être réglés et que cela n'accélérait pas l'amélioration de l'environnement. Nous mettons donc l'accent sur la restauration et travaillons directement avec les parties responsables afin d'éviter autant que possible de recourir aux procédures judiciaires. Depuis deux ans, deux affaires seulement sont passées devant les tribunaux. Les autres ont été réglées à l'amiable.
Il existe deux types de restauration : la restauration primaire, qui vise à accélérer la restauration des ressources, par exemple, une plage dont nous avons nettoyé le sable souillé. Le deuxième type est la restauration compensatrice, qui est censée compenser l'utilisation des ressources perdues, par exemple, s'il s'agit d'une plage et que nous mettons trois semaines pour définir la réponse et deux ou trois semaines pour remplacer le sable, le public ne peut pas profiter de cette plage pendant cinq semaines. Cela permet d'indemniser le public en raison de la perte d'emploi de cette plage.
Le processus que nous avons mis en place pour la restauration des dommages se déroule en trois phases.
Premièrement, la phase de pré-évaluation, qui s'enclenche dès que nous apprenons un accident.
Deuxièmement, la phase de planification de la restauration, durant laquelle nous définissons les dégâts et planifions la restauration.
Troisièmement, la phase de mise en _uvre de la restauration.
Dans le cadre de la première phase, les deux questions qui se posent sont de savoir si les dommages sont tels qu'ils impliquent l'intervention de la NOAA. La seconde question que nous devons nous poser, étant donné que nous assurons la restauration, est de savoir si nous sommes en mesure de restaurer les dommages. Si les dégâts ne sont pas « réparables », ce n'est pas la peine de le faire.
Si nous passons à la phase de planification des restaurations, nous devons déterminer et quantifier les dommages. Nous passons ensuite à la sélection du processus de restauration. Nous étudions toutes les solutions possibles, nous décidons de la portée et de l'ampleur de la restauration et, enfin, nous choisissons la solution que nous préférons.
A la suite de la planification, nous mettons en _uvre la restauration. La partie responsable prend en charge le plan de restauration sous le contrôle du trustee, ou donne à ce dernier suffisamment d'argent pour qu'il assure lui-même la mise en _uvre de la restauration.
Le coût global de remise en état comprend les coûts de mise en _uvre de la restauration et les coûts de contrôle de celle-ci, car nous devons nous assurer que tout se solde par un succès. Les coûts exposés par la NOAA doivent être également récupérés. Nous avons le droit de recouvrer nos coûts.
Je cède maintenant la parole à M. Brian Julius.
M. Brian E. JULIUS : Je voudrais maintenant me pencher en détail sur la façon dont nous mettons en _uvre ces notions dans des cas précis d'accident. Je parlerai de notre succès dans la mise en _uvre de ces réglementations. Je prendrai l'exemple d'une pollution qui a eu lieu en Louisiane et qui est assez représentative des concepts généraux que nous employons. Enfin, je tirerai quelques conclusions dans le cadre de l'emploi de ces réglementations depuis cinq ans.
Comme l'a dit Mme Burlington, notre objectif dans toutes ces affaires de déversement de pétrole est de restaurer l'environnement et de satisfaire aux besoins du public. Cela se fait en deux étapes. Tout d'abord, il y a la restauration primaire, qui consiste à redonner aux ressources endommagées et aux services leurs conditions d'origine. Ensuite, la restauration compensatrice, indemnisant le public pour la perte d'emploi de la ressource naturelle entre la date du dommage jusqu'à la restauration intégrale.
Les procès représentent un coût. Dans notre évaluation, nous encourageons souvent le fait que les personnes responsables _uvrent elles-mêmes à la restauration. Cela permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent, car le secteur privé peut avoir des mécanismes de passation de marchés plus efficaces.
Pour vous expliquer brièvement comment fonctionne cette notion de perte d'emploi des ressources (imterim losses), je peux vous illustrer mon propos. Si des marécages, par exemple, sont touchés, il peut y avoir toute une gamme de services que ces ressources peuvent fournir. En cas d'accident, les services liés à ces ressources sont réduits. Si nous tenons pour acquis que ces ressources vont revenir à leur condition normale, nous tenons néanmoins à faire revenir ces services à leur état normal le plus rapidement possible.
Cela a un coût ; ce coût est celui de la restauration primaire et celui de la restauration compensatoire. La différence entre ce que fournirait la ressource sans accident par rapport à ce qu'elle devient en raison de l'accident, représente la perte intérimaire à récupérer.
D'autres facteurs entrent également en jeu s'agissant du coût global de la restauration, dont il faut tenir compte afin d'établir les sommes que nous demandons. Au sein des coûts de restauration du trustee, il faut ainsi tenir compte des coûts du contrôle des responsables supervisant les opérations, car il en faut pour surveiller les entrepreneurs. Il faut donc que nous récupérions tous les coûts de surveillance qui sont nécessaires pour s'assurer que la restauration répond correctement aux critères de performance.
Il peut cependant y avoir des aléas. Ceux-ci peuvent être liés au climat, aux orages, aux pannes technologiques, à tout élément pouvant constituer des raisons nécessitant une rectification de l'évaluation en cours de projet.
Il faut également intégrer les coûts de demande d'autorisations et les coûts du respect des lois écologiques. L'évaluation pouvant prendre plusieurs années dans le cadre de l'OPA, nous avons le droit de demander des intérêts sur les coûts écologiques entre le moment de leur réalisation et celui de leur évaluation définitive. Peut-être avez-vous l'impression que ce ne sont pas des coûts énormes par rapport à la restauration primaire, mais ils peuvent atteindre des centaines de milliers, voire des millions de dollars.
En ce qui concerne l'approche générale de la NOAA dans le cadre de l'OPA, nous faisons d'abord l'évaluation des dommages aux ressources et aux services. Puis, nous engageons la planification de la restauration, ce qui peut avoir lieu dès la toute première étape de la lutte contre la pollution. Des experts sont sur place et au moment de l'intervention.
Nous essayons de travailler en collaboration avec la partie responsable dans la phase de négociations des plans de restauration, mais dans certains cas elle n'est pas d'accord. Nous devons alors préparer les poursuites judiciaires. L'une des caractéristiques de l'OPA que nous apprécions est qu'en matière d'hydrocarbures, nous pouvons toujours nous adresser en premier lieu à l'Oil spill liability trust fund (OSLTF) si les parties responsables refusent de payer.
Pour la planification de la restauration, la première étape est l'évaluation des dommages. Le premier volet est celui de la détermination des dommages : il faut donc pouvoir mesurer l'altération exacte des ressources. Ensuite, il faut savoir quelle en est la nature et la cause. Il faut pouvoir relier la pollution au dommage identifié. Ensuite, il faut quantifier les dommages. Nous déterminons quelle est la nature ou le type de services atteints. Cela nous fournit une base technique pour évoluer les besoins de restauration.
Ensuite, vient la phase de sélection de la restauration. Il faut identifier la gamme de projets de restauration primaire et compensatrice. Nous nous appuyons sur l'expertise la plus large possible et sur les expériences passées. Une fois identifiées toutes les possibilités, nous les évaluons en fonction de critères déterminés. La rigueur de ces critères est d'une importance primordiale, les parties responsables pourraient arguer de leur arbitraire ou estimer qu'ils sont motivés par des considérations politiques. Cela permet d'avoir un base quantifiée pour l'évaluation.
Puis vient l'élaboration du plan de restauration. Ce plan prévoit un lien très fort avec l'évaluation écologique, qui constitue la clé de voûte de la restauration.
Ce plan fait ensuite l'objet de révisions à partir des commentaires du public. Nous organisons des consultations à toutes les étapes. Une fois les observations reçues, nous répondons individuellement à chacun. Puis, nous modifions le plan, pour atteindre enfin le plan définitif.
Cela donne le plan de restauration final, qui apparaît sur le site web. Je vous demande de regarder ce site. Je parlerai tout à l'heure d'un cas précis, qui constitue un excellent exemple de mise en _uvre de ce processus dans la réalité. Enfin nous entreprenons une restauration écologique et chimique des ressources biologiques pour les ramener aux conditions d'origine et nous nous occupons de la compensation des services perdus.
Nous passons en revue les critères généraux de sélection pour savoir quelle a été meilleure la méthode. Celle-ci peut varier selon la région et selon le site.
Envisageons maintenant les méthodes d'évaluation des dommages aux termes de l'OPA. Il existe deux approches de base. Une approche ressource par ressource, permettant que les services assurés par la restauration compensatoire soient équivalents à ceux perdus du fait des dommages. Cette approche sert dans le cas où le projet de restauration compensatoire a la même valeur et la même qualité que les ressources endommagées. Puis il y a une approche reposant sur la valorisation des dommages. Dans le cadre de cette approche, la première méthode est une méthode valeur à valeur. C'est à peu près la même chose que ressources à ressources. Par ailleurs, il y a la méthode où vous évaluez les pertes en termes monétaires, afin que le fond d'indemnisation compense jusqu'au maximum des pertes. Dans le cadre de l'OPA, cette méthode est utilisée uniquement en dernier ressort.
Nous visons donc la restauration plutôt que la récupération des dommages économiques. La restauration est tout de même le but ultime défini par l'OPA de 1990.
Nous avons développé un processus beaucoup plus ouvert. Le public participe dès le début de l'accident. Il est sollicité et apporte sa contribution à la mise au point du plan de restauration. Il y a une forte implication des citoyens autour de ces accidents. De plus en plus, nous allons vers une évaluation coopérative des dommages. Auparavant, les trustees effectuaient leur propre évaluation, les parties responsables faisaient la leur et à la fin, on essayait de déterminer la différence entre les deux évaluations, ce qui causait beaucoup de délais, des redondances de coûts puisque, finalement, c'étaient les mêmes études qui étaient faites alors qu'une seule aurait suffi. Il était beaucoup plus simple de travailler directement en équipe avec les parties responsables.
L'autre aspect utile a été de disposer de l'OSLTF. En cas de rupture des négociations, la personne responsable sait que même si elle ne nous paie pas dans l'immédiat, tôt ou tard, le fonds se retournera contre elle et la fera payer.
Nous avons également intégré de manière très étroite la biologie, l'écologie, l'économie, la gestion des ressources à toutes les étapes du processus d'évaluation. Nous avons jugé plus efficace que tous les membres de l'équipe technique participent directement au processus. Cette approche s'est révélée efficace. Depuis trois ans, 30 millions de dollars ont ainsi été recouvrés pour mettre en _uvre des plans de réhabilitation du milieu naturel.
Je voulais également vous présenter rapidement un cas qui illustre plusieurs des principes de l'OPA, il s'agit de l'accident de Lake Barre, en Louisiane. Il s'agissait de la rupture d'un oléoduc en 1997. Plus de 4 300 acres de marais ont été exposés, les oiseaux et la faune aquatique ont subi un fort impact. A son crédit, Texaco a été très coopératif. La société a identifié ses représentants, son maître d'_uvre, a convenu de payer les coûts d'évaluation du trustee, a mené des visites sur site, a travaillé avec les trustees pour identifier les catégories de dommages potentiels et les études de pré-évaluation sur le terrain, a mis sur pied des groupes de travail conjoints, a mené des réunions publiques...
Dans l'analyse de la méthode de restauration, il a été décidé que le rétablissement naturel était plus approprié.
Dans le projet de restauration sélectionné, 19 acres de marais ont été replantés, pour atteindre à terme 58 acres. Cet aspect du projet a été développé conjointement.
L'approche était basée sur la méthode ressource à ressource HEA (Habitat Equivalency Analysis). Elle utilisait un modèle informatisé pour évaluer les pertes en oiseaux et de la faune. Pour ces pertes, on utilisa la HEA pour la restauration des marais en vue de compenser la biomasse perdue.
Après cinq années de mise en _uvre de ces réglementations, nous avons conclu que le processus était très efficace pour parvenir à des règlements accélérés en vue de la restauration du milieu. Le mécanisme d'évaluation coopérative, associant les trustees et les responsables de la pollution, se révèle plus efficace. La participation accrue du public s'est traduite par des apports non négligeables au processus d'évaluation.
Mme Linda B. BURLINGTON : Je sais que vous êtes pressés, mais je vous propose un dernier exposé avant que nous passions aux questions.
M. le Président : Bien sûr.
M. Russel J. BELLMER : Je suis un expert en écologie. Le centre de restauration de la NOAA relève de l'agence nationale des pêcheries. Notre fonction est de reconstituer les habitats de poissons. Nous le faisons par le biais de différents programmes. Le Dr Julius vous a dit qu'il était important pour nous d'assurer le suivi de la restauration, pour deux raisons, d'une part, pour vérifier que le projet de restauration contribue effectivement à l'amélioration des ressources et, d'autre part, pour mettre au point des techniques d'amélioration permettant d'accélérer la mise en _uvre des projets de restauration.
Le centre de restauration a quatre programmes ; celui dont je vous parlerai est la procédure d'évaluation des atteintes aux ressources naturelles. Nous avons aussi un deuxième programme, un programme de restauration basé sur les communautés, qui permet aux collectivités, entreprises, associations et organisations diverses de participer à la restauration dans leur propre région. Le troisième programme est un programme de restauration de l'habitat régional et le quatrième, un programme de recherches en restauration.
Mais nous allons donc parler du programme d'évaluation des dommages écologiques. Nous menons des programmes de restauration à travers tous les Etats-Unis, de l'Alaska à Porto Rico.
Je vais vous donner quelques exemples de pollutions marines.
Le premier cas est celui du World Prodigy qui a déversé près de 300 000 gallons de fioul domestique dans la baie de Narraganset, dans le Rhode Island. Les projets de restauration de la NOAA s'élevait à 600 000 dollars. Nous avons mis au point divers sanctuaires pour des variétés de poisson et les homards et nous avons replanté des plantes subaquatiques.
En 1989, 250 000 gallons furent déversés par le pétrolier Presidente Rivera sur 40 miles de côtes dans le Delaware. Le règlement a coûté un peu plus de 2 millions de dollars. Nos activités de restauration ont consisté à stabiliser l'érosion sur l'île pour protéger l'habitat des hérons et les terres humides. Nous avons remplacé certains habitats par des herbes des marais et avons acquis et restauré 186 acres de terres humides. Nous restaurons également 450 acres en tant qu'habitat pour des aspects scientifiques et la pêcherie.
Une autre pollution d'environ 300 000 gallons de fioul n° 6 a résulté de l'accident du pétrolier B.T. Nautilus, dans l'Etat de New York. Le dédommagement a dépassé les trois millions de dollars. Tous les projets de restauration assurent des programmes de vulgarisation pour inciter les collectivités locales à participer. Nous avons également pu rétablir les populations de pluvier siffleur. Nous avons acquis 20 acres et restauré 80 acres de terres humides. Nous sommes entrain d'en restaurer d'autres.
Puis, l'American Trader, qui avait déversé 400 000 gallons de brut d'Alaska sur 60 kilomètres carrés au large, la nappe ayant ensuite atteint le littoral, causant la fermeture de plages dans le Sud de la Californie et nécessitant un règlement de 3,4 millions de dollars pour la restauration. Cela a permis un projet la création d'habitat pour les pélicans, la protection de sites de nichoirs et d'autres projets concernant l'étude des populations d'oiseaux.
L'un des projets de restauration les plus récents, est celui qui fait suite à la pollution par l'oléoduc Chevron, qui a éclaté en 1996 à Hawaï. Plus de 40 000 gallons de fioul n° 6 se sont répandus. Le financement de la restauration s'est élevé à 1,5 million de dollars. Il y a eu également la restauration d'un petit marécage et des espèces autochtones.
Je vous donnerai rapidement une idée générale des projets de restauration, de ce que nous faisons et de notre processus de travail.
Un aspect à bien prendre en compte s'agissant de restauration après un accident pétrolier est celui des conditions environnementales. Il y a souvent des populations très denses dans ces zones côtières, donc cette demande d'activités crée des problèmes connexes.
Nous aimons développer de petits habitats qui soient viables. Nous voulons que le projet de restauration ait une base solide. Nous aimons coordonner nos activités avec d'autres programmes en cours et associer le public à nos travaux.
Nous gérons intégralement nos projets pour accroître à la fois l'efficacité et la rentabilité. Nous nous attachons à intéresser le public au projet. L'incidence locale est très importante si vous ne voulez pas que ce site soit utilisé comme une décharge. Si les habitants des lieux n'adhèrent pas au projet, vous ne pourrez jamais le mener à bien.
Ensuite nous faisons des études de sites. Nous avons des cartes précises des sites que nous examinons. Une fois le processus public achevé, nous amorçons la mise en _uvre.
Parmi nos soucis prioritaires, il y a l'emplacement spécifique des projets de restauration. La surface envisagée est-elle assez étendue pour être autonome ? Il est très difficile d'avoir un marais salant d'un demi-acre, il faut une superficie plus étendue. Cet habitat peut-il permettre de rétablir les ressources disparues ? Son emplacement permet-il de développer le lien avec d'autres habitats ? Pour les zones d'habitat urbain, nous aimons assurer une relation étroite avec des terres humides adjacentes afin que les espèces puissent se déplacer d'un lieu à l'autre.
Nous devons décrire le site, le qualifier. Nous devons choisir la meilleure méthode pour le rétablir, le cas échéant envisager un calendrier, un échéancier des plans de nettoyage, ainsi qu'un programme de suivi des opérations, non seulement pour la préparation des sites, mais également pour la restauration ultime. Nous devons obtenir les autorisations nécessaires et évaluer le succès du projet par la suite.
Il faut également ne pas oublier d'inclure le public dans le processus. Non seulement le public s'implique ainsi dans l'affaire, mais aussi parce que sa sensibilisation peut contribuer à éviter que des problèmes de pollution similaires arrivent à l'avenir.
Nous définissons les fonctions de responsabilité du directeur de projet, qui est le point de contact et de révision constante du projet. Nous avons connu de nombreux problèmes, nous en tirons les enseignements. Par exemple, il faut avoir un plan correctement établi, il faut bien cibler les objectifs et fixer des buts précis. Souvent, le grand public ne comprend pas les limites de la mise en _uvre dans le cadre de la loi. Il faut les lui expliquer.
Je parlerai pour terminer de l'élément recherche. Nous allons publier un article portant sur quinze projets développés depuis cinq ans, dont un qui a permis de mettre en évidence un moyen pour améliorer les plantations de roseaux et de maximaliser la production.
Pour conclure, je tiens à vous rappeler pourquoi nous sommes là. C'est pour restaurer la pêche saine car, comme l'a dit un grand Français, si nous souffrons de notre mer, c'est tout l'homme qui va souffrir.
M. le Président : Nous vous remercions de toutes ces présentations de haut niveau.
Premièrement, pourquoi votre agence est-elle rattachée au ministère du commerce et non à celui des transports ?
Mme Linda B. BURLINGTON : Nous nous sommes posés la même question (Sourires), mais la principale mission de ce ministère est de mener l'activité commerciale aux Etats-Unis et le secteur de la pêche représente des millions de dollars de chiffres d'affaires. C'est pour des raisons politiques que nous avons été rattaché au ministère du commerce.
M. le Président : Une autre explication pourrait être que l'activité commerciale est génératrice de plus-values. Peut-être était-ce un moyen pour vous d'obtenir des budgets de montants plus élevés ?
Mme Linda B. BURLINGTON : J'aimerais que ce fût le cas, mais notre budget d'exploitation existe dans une grande mesure grâce à l'argent que nous récupérons. Nous nous finançons ainsi.
M. le Président : Précisément, quels sont les moyens ? On retrouve dans les présentations qui nous ont été faites des dispositifs qui existent aussi en France, mais qui semblent ici être concentrés de façon à donner plus de puissance à votre intervention. Quel est votre budget ? Quels sont vos moyens ? Combien de personnes employez-vous ? Quelle est l'origine des fonds dont vous disposez ? Vous vous faites rembourser par des pollueurs selon le principe « pollueur-payeur », comme vous le disiez tout à l'heure. Malgré tout, un certain nombre de pollueurs ne sont pas détectés et il peut arriver que certaines pollutions dépassent en montant le coût que vous aviez envisagé.
Vous avez évoqué tout à l'heure la contestation qui peut exister d'un certain nombre de décisions prises par la NOAA. Avez-vous des exemples de ces contestations ? Celles-ci viennent-elles, par exemple, de ceux qui doivent payer ? Ont-elles des chances d'aboutir ? Ces contestations peuvent-elles venir d'associations de défense de l'environnement vous soupçonnant de vouloir faire, éventuellement, des remises en état au rabais ? Car j'ai cru comprendre que, parfois, vous proposiez des réadaptations de paysages plutôt que des remises en état à l'identique. Pour les mangroves, par exemple.
J'en viens à la sensibilisation du public. Il se trouve que dans le port du Havre, nous avons eu pendant deux ans un débat public tout simplement parce qu'il est question de doubler la surface du port en l'étendant sur des espaces qui sont jusqu'à présent utilisés par les oiseaux et les poissons.
Le Gouvernement a initié ce que nous appelons le « débat public » : quelles options choisir ? Vous avez vous-même insisté sur la nécessité d'une grande sensibilisation du public afin d'intéresser plus largement et afin, je suppose, de faire aboutir un certain nombre d'objectifs de façon plus sûre.
Quelle est la réalité de la participation du public à vos objectifs ? Est-elle très importante ? Les moyens des médias - télévision ou autres - participent-ils à ces sensibilisations ? Disposez-vous de moyens pour cela, moyens réglementaires, législatifs, qui vous permettent de convaincre un certain nombre de partenaires des décisions que vous avez à prendre ?
Mme Linda B. BURLINGTON : Tout d'abord, l'an dernier notre budget s'est élevé à 1,2 million de dollars pour les questions d'expertise juridique. Au sein de la direction du conseil général, nous comptons douze avocats ; les centres d'évaluation de dommages environ vingt-cinq fonctionnaires ; la restauration occupe de l'ordre de treize personnes. Tout notre travail n'est pas couvert avec ce 1,2 million budgété lorsque nous récupérons de l'argent. Quand nous recevons de l'argent qui représente l'élaboration du plan de restauration, c'est pour notre compte. Nous pouvons nous en servir. La moitié de nos dépenses provient de la récupération, l'autre moitié du budget. Parfois, la proportion peut varier. S'il y a peu de remboursements une année, nous devons restreindre nos travaux. Il est arrivé que nous récupérions beaucoup d'argent et nous pouvons alors faire plus. Cela varie selon les années.
M. le Président : Quand vous dites 1,2 million de dollars, c'est seulement pour les juristes ? Combien représente l'ensemble ?
Mme Linda B. BURLINGTON : L'ensemble est de l'ordre de 5,5 millions de dollars pour tout : évaluation des dommages, etc.
M. Brian E. JULIUS : La majorité de notre travail est couvert par le remboursement des affaires, mais une partie de notre travail pour ce qui est de l'élaboration des méthodes et de l'appui nécessaire pour la mise en _uvre n'est pas directement remboursable dans la réglementation. Donc cette proportion du financement est couverte par les crédits qui nous sont donnés par le Congrès.
En outre, vous avez posé la question de savoir ce que nous faisons lorsque la partie responsable n'a pas suffisamment de moyens pour tout rembourser. Cette question est réglée par notre accès à l'OSLTF de la Coast Guard.
Il peut arriver aussi que nous ne connaissions pas la partie responsable, mais qu'il y ait tout de même des dommages. Dans ce cas, nous pouvons nous adresser à ce fonds.
Ce sont nos trois sources de financement : remboursement des affaires passées, budget alloué par le Congrès et fonds de la Coast Guard.
Votre seconde question concerne l'origine et le traitement des contentieux. Il y a plusieurs possibilités. Les plus fréquents sont les contentieux par les parties responsables. Le processus d'évaluation coopératif a toutefois permis de minimiser ces contentieux.
Il reste tout de même un petit nombre d'affaires où les principales questions techniques ou juridiques n'ont pas pu être réglées. C'est alors le tribunal qui tranche et c'est l'Etat fédéral qui a eu gain de cause à chaque fois. Si nous avons des informations techniques et de bons dossiers que nous établissons bien, nous avons une position très ferme et forte pour avoir gain de cause. C'est la raison pour laquelle il est très rare que nous passions devant le tribunal.
Vous avez demandé s'il arrivait que des groupes écologistes remettent en question notre restauration. Cela peut arriver. La question porte souvent non pas sur la qualité, mais sur la quantité. Si vous récupérez une somme, c'est pour faire le travail comme il faut. Il faut établir d'emblée le signalement et les critères de restauration afin que ce processus ait une base technique. Il ne faut pas le politiser.
Cela me rappelle une affaire que nous avons eue il y a trois ans. Les citoyens n'avaient pas compris les méthodes d'évaluation. Ils ont donc porté plainte auprès du tribunal. Nous avons eu une audition devant le tribunal pour savoir pourquoi nous n'avions pas tenu compte de leurs soucis. Ils ont été représentés par un avocat qui représentait aussi quelqu'un qui avait subi, à son sens, un préjudice. Il espérait profiter de notre affaire pour recevoir de plus amples informations. C'est classique dans ce genre de cas, mais ils n'ont pas bien compris le processus. Ils avaient des préoccupations valables. Le tribunal nous a autorisé à trancher.
J'ai fait beaucoup de travail dans le domaine de l'environnement et j'ai appris que le public doit absolument être impliqué et informé.
M. Aimé KERGUERIS : En France, il existe une organisation qui s'appelle le Conservatoire du littoral et des sites lacustres qui devient peu à peu propriétaire des zones à protéger par des financements particuliers.
Par comparaison, la NOAA est-elle amenée à acquérir des terrains ?
Mme Linda B. BURLINGTON : Nous faisons, dans notre centre de restauration, des efforts d'acquisition des terrains. Dans certains cas, la partie responsable peut aussi les acheter.
M. Russel J. BELLMER : Tout le travail de restauration est fait par les trustees représentant l'Etat fédéral, les Etats ou les tribus indiennes. Dans bon nombre de cas, les responsables vont décider de l'acquisition des terrains, par exemple les terrains dont j'ai cité des exemples. Avant d'acquérir un terrain, nous devons savoir qui en est le propriétaire. L'acquisition peut être effectuée par un organisme d'Etat ou l'Etat, des organisations de conservation de la nature ou encore un autre organisme qui assure la conservation du terrain et en a la propriété.
M. Aimé KERGUERIS : En cas de litige portant sur la restauration entre la NOAA et les collectivités locales, la seule solution de règlement est-elle d'aller devant un tribunal ou existe-t-il une administration chargée de l'arbitrage ?
Mme Linda B. BURLINGTON : Je ne sais pas. Il n'existe pas d'agence chargée d'un éventuel arbitrage entre l'Etat fédéral et les collectivités. Mais aucun cas ne me vient à l'esprit dans lequel il y aurait eu un procès avec une collectivité locale. Elles sont plutôt nos partenaires. A Lake Barre, la collectivité locale était mécontente, mais nous leur avons expliqué pourquoi nous avions fait ce choix. Il n'y a donc pas eu d'action en justice. Aux Etats-Unis, cela se fait couramment. Je ne sais si le centre de restauration a été impliqué dans quelque chose de ce type ?
M. Russel J. BELLMER : Nous avons tenu compte de la sensibilité du public, non seulement sur le processus, mais sur la solution à envisager. La restauration doit être directement liée aux ressources. Il faut tenir compte de la solution de restauration que le public souhaite. Dans la formulation de nos projets de restauration, il y a également une présentation de la part du public de ce que doit être le projet de restauration. Dans bien des cas, les différents secteurs du public n'ont pas les mêmes objectifs de restauration. Nous effectuons un effort de vulgarisation pour communiquer dans la presse, par des ateliers, par des annonces dans les journaux, sur notre site Internet. Nous publions des brochures que nous mettons à la disposition des écoles et des bibliothèques. Nous essayons d'ouvrir l'accès aux citoyens de façon à ce que ceux-ci soient impliqués.
Je voudrais également faire une observation lié à la perte des marécages de la surface de votre port. Une fois passé le processus OPA, une fois que nous avons approuvé le plan de restauration, nous avons les mêmes processus réglementaires pour n'importe quel projet. Nous avons environ 38 lois fédérales sur l'environnement que nous devons respecter...
M. Jean-Michel MARCHAND : Je souhaiterais revenir sur quelques points sur lequel je voudrais avoir confirmation. Vous êtes responsable de l'expertise des dégâts. Est-ce vous qui assumez les travaux de réparation ? Etes-vous aussi chargés du suivi de cette opération ? Avez-vous la responsabilité totale du projet qui est mis en _uvre ?
Vous nous avez dit qu'il n'était pas utile que vous interveniez lorsque le dommage était considéré comme irréparable. Est-ce un abandon complet de la situation telle qu'elle est après l'accident, une fois que l'on a, bien sûr, récupéré les produits ?
Ma troisième interrogation porte sur le rétablissement naturel. Existe-t-il dans ce domaine des possibilités de réexamen, c'est-à-dire lorsque le rétablissement naturel ne s'effectue pas conformément à vos prévisions ?
Enfin, à propos de l'implication du public, sur laquelle vous vous êtes déjà longuement exprimés, comment pouvez-vous maintenir l'implication du public sur la durée d'un projet car je suppose que la réhabilitation d'un espace demande des années, voire de dizaines d'années ?
Mme Linda B. BURLINGTON : Nous sommes responsables du processus dans son intégralité, dès l'accident et pendant l'expertise évaluative des dégâts, la planification, la mise en _uvre du projet et, enfin, nous évaluons les résultats de la restauration. Tout cela est de notre responsabilité. Nous essayons d'intéresser les parties responsables. Si la partie responsable ne veut pas participer, si elle ne veut pas payer, nous nous finançons auprès de l'OSLTF et menons seuls les travaux, à charge pour le fonds de se retourner contre le pollueur.
Quant à votre question concernant les dommages irréparables, si vous tenez compte de la restauration primaire, il se peut qu'il y ait des cas dans lesquels rien ne puisse être fait pour rétablir ces ressources et les ramener à leur niveau initial, lorsque les ressources ont été entièrement éliminées.
M ; Jean-Michel MARCHAND : Est-ce uniquement une question de coût ?
M. Brian E. JULIUS : Parfois, mais le plus souvent, c'est un problème de technique. Nous disposons de mécanismes visant à accélérer la restauration, mais dans la plupart des cas, notre action consiste à acquérir des ressources équivalentes.
En ce qui concerne le rétablissement naturel qui n'a pas eu lieu comme escompté, l'expérience a montré que bien que notre expertise soit faite avec beaucoup de soins, il y a toujours des imprévus que nous ne pouvons pas prévoir tels que des tempêtes ou la technique qui nous trahit.
Trois mécanismes peuvent alors être mis en _uvre. Premièrement, la partie responsable est soumise à des normes de performances de règlement. Il y a une obligation de résultat.
Deuxièmement, nous pouvons recourir à des fonds d'urgence. Il s'agit des cas dans lesquels la partie responsable a capitalisé son passif et fournit des fonds à l'avance. Souvent, nous ajoutons à ce règlement un fonds d'urgence pour tenir compte des révisions non prévues. Si le règlement n'est pas satisfaisant, si la restauration n'est pas satisfaisante, nous corrigeons le tir.
Troisièmement, nous n'apurons le contentieux que sur la base de certains critères, fixés à l'avance. Si la restauration ne fonctionne pas, nous avons toujours la possibilité de relancer le dossier.
Tels sont les trois mécanismes principaux que nous utilisons.
Sur ce thème, vous trouverez un document d'évaluation sur le web.
M. Pierre HERIAUD : Mes deux questions ont trait à l'évaluation des dommages.
Premièrement, malgré le caractère multidisciplinaire, on sent bien que l'évaluation est à caractère unilatéral. A-t-il été envisagé des contre-expertises ?
Deuxièmement, il y a l'évaluation, il y a la programmation sous la responsabilité du maître d'_uvre que vous êtes, et enfin, il y a les règlements financiers. A partir du moment où la programmation et la réalisation s'échelonnent sur plusieurs années, qu'en est-il des règlements financiers ? Y a-t-il de la part du pollueur-payeur ou de votre part un calcul d'actualisation pour un réglement immédiat ou des règlements annuels échelonnés ?
J'aimerais savoir cela parce que le rythme de vos investissements semble assez conditionné par les rentrées.
M. Brian E. JULIUS : Nous avons constaté que la contre-expertise est un instrument très utile pour nous, sachant que les parties responsables entreprennent un examen minutieux de toutes les expertises que nous dressons. Nous sollicitons également des experts indépendants et des universitaires pour revoir ces évaluations, identifier les fautes et les faiblesses.
Un autre outil que nous avons utilisé ces dernières années est, par exemple, le biais des journaux scientifiques. Ils permettent la sensibilisation non pas du public mais des experts. Aussi devons-nous diffuser ces idées parmi les experts aux fins de révisions publiques. C'est un élément essentiel pour faire admettre notre témoignage. Nous sollicitons très souvent ces entités indépendantes pour le cas où nous serions en opposition avec la partie responsable.
Mme Linda B. BURLINGTON : En ce qui concerne le financement, si vous avez un processus qui dure sur plusieurs années, le financement couvre plusieurs années. Nous avons un éventail infini de circonstances. Parfois, nous dressons l'expertise. Parfois, il faut attendre deux ou trois ans pour recouvrer nos coûts auprès de la partie responsable. Parfois, celle-ci paie et s'en va. Ce fut le cas à Lake Barre. Ils ont couvert les frais d'analyse des experts et ont effectué deux paiements à notre profit.
Si la partie responsable ne veut pas nous payer, nous faisons jouer le fonds de responsabilité qui est administré par la Coast Guard. Nous pouvons présenter à ce fonds notre coût et la demande de remboursement. Le fonds, par la suite, exigera le paiement par la partie responsable.
M. André ANGOT : Un des intervenants nous disait tout à l'heure qu'en cas de pollution sur une plage, le fonds indemnisait les particuliers ou les familles. S'agit-il seulement d'indemniser les commerces ou les hôtels qui ont une perte de revenu ou le fonds va-t-il jusqu'à indemniser les familles qui n'ont pas pu profiter de la plage pendant la pollution ?
Mme Linda B. BURLINGTON : Je sais que le fonds couvre toutes les pertes commerciales. Dans le cas d'une réclamation de particulier, les normes sont différentes. Si vous possédez ou utilisez en tant que particulier des ressources naturelles, certains recouvrements vous sont possibles.
M. René LEROUX : Vous avez parlé des déplacements de scientifiques de votre organisation en France à la suite de la catastrophe de l'Erika. J'aimerais savoir où ils se sont déplacés et quels enseignements ils ont tirés de leur venue.
Deuxièmement, avez-vous déjà utilisé pour la réhabilitation des sites naturels le système des bactéries dont des Américains sont venus nous vanter les mérites ?
Ensuite, êtes-vous déjà intervenu dans des sites naturels qui ont une activité de produits alimentaires ? Vous avez parlé tout à l'heure des marais salants. Chez nous, nous avons des marais salants qui produisent du sel alimentaire. Vous est-il déjà arrivé d'intervenir dans de tels sites et de réhabiliter ces sites pour que la production alimentaire puisse se poursuivre ?
Mme Jean E. SNIDER : Pour ce qui concerne les experts qui se ont déplacés en France, je vais vous envoyez les détails. Je ne sais pas qui ils ont rencontré.
En ce qui concerne le remède bactériologique, le débat continue sur la question de son efficacité. Il y a deux types de remèdes biologiques. Soit on introduit des engrais pour renforcer le taux de bactéries naturelles qui dégradent le pétrole, soit on ajoute une nouvelle bactérie à l'environnement. Cette bactérie dégrade spécifiquement le pétrole lorsqu'il y a eu un déversement pétrolier.
Nous ne pensons pas que le remède biologique soit la première réponse a apporter. Nous nous en servons dans des environnements réduits, pour des zones limitées, par exemple dans des cuves de pétroles. Nous nettoyons les cuves ainsi.
Mme Linda B. BURLINGTON : Avez-vous d'autres questions ?
M. le Président : Nous en aurions eu bien plus si nous avions eu plus de temps. Les deux heures et demies que nous avons passées avec vous ont été enrichissantes. Je vous disais tout à l'heure que nous avions des dispositifs qui ressemblent à ce que vous avez ici, mais nous n'avons pas cette concentration qui vous donne la force dont vous faites preuve et, qui, probablement, compte tenu des règles et des textes français, seraient aussi problématiques. C'est votre système. Je voudrais vous remercier en tout cas de l'attention et des réponses précises et concises que vous nous avez apportées et vous souhaitons bonne chance.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être relue par les intervenants.
Audition de M. Yoram COHEN,
Chief Executive Officer,
du capitaine John DELEORNARDIS, responsable des opérations maritimes,
MM. Brad BERMAN, conseiller juridique, responsable de l'enregistrement,
Michael DAVIS-SEKLE, chargé du programme d'inspection des navires,
Tony DUPREE, en charge des relations avec les sociétés de classification,
Tim KEEGON, responsable des aspects relatifs à la sauvegarde et au code ISM,
et du capitaine Vince BLACK, en charge de la certification STCW, du
Liberian International Ship & Corporate Registry,
(extrait du procès-verbal de la séance du 17 mai 2000 à Washington)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Yoram COHEN : Nous vous remercions d'être là. Nous sommes très heureux que vous ayez pris le temps de venir. Nous avons examiné très précisément l'évolution du problème de l'Erika. Nous vous assurons de toute notre sympathie face à ce drame.
Durant cet entretien, nous tenons à vous apporter tous les renseignements que vous souhaitez. La France est un pays très important tant pour qui est de la présence maritime, que pour ce qui est de sa position au sein de l'Union européenne. Nous apprécions les relations étroites que nous entretenons avec le Bureau Veritas : certains navires de notre flotte font l'objet d'un suivi en collaboration de notre part avec le Bureau Veritas, qui fait de l'excellent travail.
Nous examinons le passé, l'avenir et le présent. Nous estimons que nous avons les mêmes positions que l'OMI, les mêmes préoccupations et le même désir de résoudre les problèmes qui se posent. Je vais vous expliquer brièvement comment se fait l'enregistrement au Liberia et les relations qui existent entre les sociétés qui gèrent l'enregistrement et le gouvernement du Liberia.
Le registre libérien a été créé il y a plus de cinquante ans. Au fil des ans, il a énormément évolué. Nous sommes aujourd'hui une nouvelle compagnie et nous avons reçu le mandat de gérer le registre d'immatriculation. Avec le changement de gouvernement qui a eu lieu au début de cette année, le Liberia s'est rendu compte que l'enregistrement maritime est d'une importance primordiale. Il en a conclu que, pour que cette activité prospère, elle devait être gérée et exploitée par une société privée. La décision a été prise que cette société en question devait avoir son siège aux Etats-Unis afin de respecter les normes les plus élevées en matière de gestion, de contrôle, ainsi que de concurrence et de mise en application du droit maritime.
Je pense pouvoir dire que les relations que nous entretenons avec le gouvernement sont fondées sur la confiance. Ce dernier nous autorise clairement à faire fonctionner cette activité en termes d'efficacité et de fourniture de services, sans aucune ingérence politique. Nous ne subissons aucune pression politique en matière d'enregistrement, de mise en application des normes, ou autres.
Une grande souplesse nous est accordée pour la gestion quotidienne de l'enregistrement. Le gouvernement examine l'enregistrement ouvert dans le monde et nous sommes fiers de pouvoir dire que nos registres sont aussi bons que des registres tels que ceux de la France, de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis. Les registres sont tous différents. Ici, nous avons un niveau élevé de contrôle. Il peut arriver que d'autres contrôlent mal et c'est malheureusement cette disparité qui peut entraîner des catastrophes comme celle de l'Erika.
Dans l'industrie maritime, comme dans celle de l'aéronautique, des catastrophes peuvent se produire à tout moment. Mais avec un bon système d'enregistrement, avec des relations étroites avec les sociétés de classification et avec de bons contrôles portuaires, la plupart de ces drames pourrait être évitée. Il faut prêter attention aux détails. Il faut que les gens s'y intéressent vraiment.
En tant que registre, nous sommes installés aux Etats-Unis et nous avons la chance d'entretenir d'étroites relations avec la Coast Guard américaine. Ces relations sont vraiment superbes. Le flux d'informations circule dans les deux sens et nous parvenons à adopter à peu près la même position que la Coast Guard et l'OMI.
En fait, un grand nombre de responsables ici sont d'anciens membres de la Coast Guard. Ils commencent à la Coast Guard et quand ils arrivent à un certain niveau de compétence, nous les recrutons et ils viennent chez nous finir leur carrière. Certains d'entre eux interviendront aujourd'hui pour vous parler de leur mission. Quant à nous, en tant que société maritime, nous ne cessons d'élever le niveau d'exigence qui existait dans le passé.
Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire.
M. le Président : Je voudrais vous remercier. Cette rencontre n'était pas prévue. Le fait qu'elle puisse se tenir n'en est que plus important.
Vous avez évoqué au début de votre propos les raisons pour lesquelles l'Assemblée nationale française a désigné une commission d'enquête sur les questions de la sécurité du transport maritime. Il est vrai que le naufrage de l'Erika a été l'élément déclencheur, mais nous n'enquêtons pas sur l'Erika. Nous enquêtons sur les moyens qui pourraient être mis en _uvre afin que les navires qui passent au large des côtes françaises soient moins dangereux et préservent notre environnement littoral, parce que la population française dit : « Plus jamais ça ! » On sait bien que le risque zéro n'existe pas. L'activité maritime a toujours été, et sera toujours sans doute, une activité à risque. Mais, à l'évidence, il faut que nous arrivions à faire en sorte que soient bannis tous les éléments qui peuvent objectivement conduire à des catastrophes.
Nous sommes venus aux Etats-Unis non pour copier, car les Etats-Unis sont un grand pays, avec une structure, des lois et des traditions qui ne sont pas les nôtres, mais parce que certains dispositifs y existent et qu'il nous semblait bon de voir de quelle manière ils se sont mis en place, et éventuellement, s'il ne serait pas possible d'en tirer des enseignements. Ce que nous ont dit ce matin les responsables de la Coast Guard est intéressant à plus d'un titre.
Nous avons rencontré également le secrétaire général et les principaux représentants de l'OMI à Londres. Nous souhaitons que cette organisation soit plus stricte sur un certain nombre de prescriptions en matière de contrôles et en matière de sécurité de ceux qui naviguent. A partir du travail incontournable qui se fait au sein de l'OMI et de celui accompli par les Etats-Unis en créant une administration chargée de préserver à tout prix la sécurité des côtes américaines, nous souhaitons que parallèlement à ce qui est fait par l'OMI, des directives soient prises au niveau européen, afin que la politique européenne aboutisse à rendre plus contraignantes les conditions de circulation et de sécurité à proximité des côtes françaises.
Capitaine John DELEONARDIS : Je voudrais brièvement vous faire passer une liste des organismes pour vous donner une idée de l'ampleur de notre fonctionnement dans le monde entier. Environ 1 700 navires de commerce de par le monde sont immatriculés sur le registre libérien. Nous sommes très fiers de pouvoir dire que ces bateaux sont de très bonne qualité. Nous sommes très fiers de leurs performances, de leur haut niveau de qualité. Nous sommes très fiers de cet acquis et nous allons nous assurer que cela se maintiendra. C'est la base du registre libérien : une bonne qualité, saine, professionnelle, fondée sur des principes simples qui sont mis en _uvre par tous les armateurs. Les capitaines ont toujours ces documents à bord et s'y réfèrent constamment. Nous créons des règles de sécurité supplémentaires au fur et à mesure.
Pour donner un aperçu de notre organisation, vous entendrez par la suite M. Dupree, qui s'occupe des sociétés de classification, M. Michael Davies-Sekle, chargé des investigations, le Capitaine Vince Black, en charge des certifications STCW, M. Brad Berman qui est, à New York, chargé de l'enregistrement - il est également notre conseil juridique - et M. Tim Keegan, chargé de la sécurité et des programmes d'inspection, qui vous expliquera comment il fait procéder aux contrôles afin d'assurer que les navires sont conservés en bon état.
Nous avons un bureau à Londres qui est situé dans les mêmes locaux que notre délégation à l'OMI. Mme Agnes Taylor est en charge de cette délégation, assistée par une autre personne. Ce sont les délégués libériens à l'OMI. Le capitaine Tony Goddard a de nombreuses années d'expérience, en particulier dans le domaine des tankers. Nous avons une antenne en Grèce, avec le capitaine Carras, chargé du contrôle des navires, qui dialogue avec les armateurs afin de s'assurer que les questions obtiennent les bonnes réponses et que le suivi est bien assuré.
Nous avons également une antenne à Hongkong, tenue par M. Wu. Ce dernier dialogue avec les armateurs, les aide à comprendre leurs obligations et assure le suivi des questions.
Puis, nous avons également de petites antennes au Japon, dont le dirigeant est le capitaine Yoshiyama, qui est chargé notamment du contrôle de la zone de Tokyo.
A part ces responsables, nous avons 165 inspecteurs maritimes. Ce sont soit des capitaines à la retraite, soit des ingénieurs. Répartis dans le monde entier à des points stratégiques, ils exécutent ce que nous qualifions d'« inspections annuelles ».
Je ne tiens pas à monopoliser la parole, je terminerai simplement en indiquant que dans le dossier que nous vous remettons, vous trouverez une copie du code ISM. C'est la clé de l'amélioration des flottes internationales, surtout en ce qui concerne les pétroliers, les chimiquiers, les navires de passagers et les vraquiers. Nous suivons ce code très rigoureusement et nous assurons que ce suivi est bien assuré, tant par les sociétés qu'à bord des navires. M. Kegan vous en parlera.
Je donne maintenant la parole à M. Brad Berman pour traiter de certains des points importants des lois maritimes et des exigences auxquelles nous sommes confrontés pour nous assurer de l'excellente qualité des navires qui viennent se faire enregistrer sous pavillon libérien.
M. Brad BERMAN : Je suis un juriste américain. J'exerce depuis plus de quinze ans. Je me suis spécialisé exclusivement dans le droit maritime, en matière financière et administrative. Je dis cela parce que vous avez reçu deux documents dont l'un dresse l'état de notre droit. Mais la force du pavillon libérien réside dans le fait que l'armement libérien a été basé sur le droit américain. Donc, si vous cherchez un précédent et que celui-ci n'existe pas au Liberia, vous le trouverez aux Etats-Unis. Cela permet d'assurer une certaine stabilité pour les inscriptions financières. Les documents que vous avez dans le dossier vous montrent que le droit libérien tient compte du droit américain, là où existe un vide juridique. Je le constate tous les jours dans le programme d'inscription à New York.
Je voudrais souligner que certaines juridictions ont parlé de l'inscription provisoire. Il existe une inscription provisoire, mais au Liberia, chaque document est pris très au sérieux. Il n'est pas possible de nous soumettre des photocopies ou des copies de fax. Nous exigeons les originaux, que ce soit dans notre bureau de New York ou lors des inspections faites par nos inspecteurs dans un port étranger. Nous exigeons des documents sur les détails du navire, des renseignements sur l'armateur, et même sur le capitaine.
Nous exigeons également une procuration de la société de l'armateur qui stipule quelle entreprise a autorisé l'inscription du navire, car autoriser l'inscription de documents permet de connaître la personne morale. Nous exigeons également les factures de vente, le transfert des titres de propriété et de connaître le nom de l'armateur que nous inscrivons.
Les points 4, 5 et 6 concernent la documentation de la classe permettant d'établir une bonne classification du navire. Nous devons avoir l'aval de la direction de la sécurité maritime pour avoir la confirmation de la classe. Il faut une confirmation de la société de classification. Dans le cas d'un navire de plus de quinze ans, il faut en outre des enquêtes supplémentaires particulières. Dans chaque cas, il faut 72 heures de préavis pour avoir le temps de les passer en revue. Nous demandons ce préavis afin d'avoir le temps de les examiner.
Nous exigeons également l'autorisation préalable du registre précédent. Si un navire est transféré d'un registre à un autre, nous devons avoir l'autorisation préalable émise par le gouvernement. Par exemple, si c'est un navire de Chypre, il faut avoir l'autorisation de l'Etat chypriote pour le transfert du pavillon au Liberia. Il faut également un certificat de non-gage, pour pouvoir s'assurer qu'aucune hypothèque ne frappe le navire.
Nous exigeons aussi une preuve d'assurance de responsabilité civile sur laquelle doit être porté le nom de l'armateur et il faut que cette assurance couvre le rapatriement de l'équipage.
Nous examinons également les documents ISM originaux, à la fois pour la compagnie et pour la personne désignée.
Tels sont les documents que nous exigeons pour un enregistrement provisoire.
D'autres juridictions les demandent également pour l'inscription permanente au Liberia. L'inscription permanente existe lorsque l'on émet des certificats au nom du nouveau propriétaire.
Capitaine John DELEONARDIS : La parole est maintenant à M. Michael Davies-Sekle, qui vous donnera un rapide aperçu de notre processus d'investigation, c'est-à-dire de la façon dont nous nous assurons que nos normes ainsi que celles de l'OMI sont respectées.
M. Michael DAVIES-SEKLE : Je profite de cette occasion pour vous souhaiter également la bienvenue. Je suis donc responsable des investigations.
Ma fonction vient toujours après l'inscription des navires. Le droit maritime libérien prévoit une investigation des accidents - naufrages, collisions, infractions, pollutions, infractions aux séparations de trafic. Nous conduisons des enquêtes sur ces accidents du point de vue administratif. Nous ne faisons pas des enquêtes pour accuser qui que ce soit ou désigner un coupable. Nous recherchons simplement des informations exactes nous permettant de parvenir à des conclusions pour savoir ce qui a provoqué l'accident. Puis, une fois les causes clairement déterminées, nous demandons au représentant du Liberia auprès de l'OMI d'entreprendre une démarche en vue de modifier les règles internationales en conséquence.
Dans le cadre de notre investigation sur les accidents, nous menons deux types d'examens, car nous faisons aussi une enquête sur les personnels. En cas de faute du personnel, cela permet de savoir quelle est la qualité des marins qui travaillent sur un navire battant pavillon libérien. Je vous ai fait passer une description rapide de la manière dont sont conduites ces investigations, pour ce qui concerne la responsabilité et le respect des normes. En conformité avec les règles de l'OMI, nous établissons une distinction entre accidents, gros accidents et accidents très sérieux.
A la fin d'une enquête, nous élaborons un rapport qui est transmis à l'OMI à Londres, afin d'évaluer la performance des navires libériens lorsqu'une affaire demande des comparaisons avec d'autres administrations, comme par exemple, en cas de collision entre un navire battant pavillon libérien et un navire d'un autre pavillon. Je vous demande de vous reporter à la documentation que je vous ai remise.
Capitaine John DELEONARDIS : Je donne la parole à M. Tony Dupree, responsable chargé des sociétés de classification.
M. Tony DUPREE : Le Liberia a reconnu onze sociétés de classification qui peuvent travailler pour son compte, dont tous les membres de l'IACS ; il faut respecter la résolution A 739.
Ma tâche consiste à mettre en _uvre les règlements et à vérifier la capacité des sociétés de classification à faire leur travail. Toutes les conventions écrites entre chaque société de classification et le gouvernement libérien comportent une délégation de pouvoir en matière de droit de compte rendu.
Nous passons en revue les sous-traitants, nous pouvons leur demander d'autres contrôles ; nous surveillons leur activité en examinant leur audits et également en procédant à des contrôles de suivi des navires.
Dans le cadre de notre accord, nous avons le droit de suspendre un document si un navire n'est pas conforme, sans aval préalable de l'administration libérienne. Nous pouvons révoquer une documentation à tout moment. Je sais que nous avons beaucoup de points à voir ensemble, aussi je reste bref, mais je peux répondre à vos questions si vous le souhaitez. Sinon, la documentation que je vous ai remise est assez complète.
Capitaine John DELEONARDIS : Je passe la parole à Tim Keegan, responsable de l'inspection des navires pour le gouvernement libérien. Il fut également membre de la Coast Guard.
Il vous expliquera comment se passe le contrôle de l'Etat du pavillon pour tous nos navires, comment nous assumons nos responsabilités de surveillance, comment nous supervisons les sociétés de classification par rapport à leur délégation d'autorité lorsqu'elles délivrent des certificats réglementaires et comment nous assurons la supervision du processus ISM.
M. Tim KEEGAN : Je suis en effet responsable du programme de sécurité. Nous avons environ 165 inspecteurs de navires dans le monde entier.
Pour dresser une petite description de la flotte libérienne au cours des trois dernières années, je dirai qu'elle se compose de 1 800 navires pour 14 millions de tonnes. Sur la base du rapport de l'administration maritime américaine, on constate que, en octobre 1999, la flotte libérienne représentait 6 % des navires de plus de 1 000 tonnes, soit 11 % de la flotte mondiale. La page 4 du document que je vous ai fait passer montre la répartition en pourcentage des diverses sociétés de classification au sein de la flotte libérienne.
Ces chiffres me conduisent au c_ur même du sujet dont je voulais vous parler et à établir la comparaison. La sécurité fait partie intégrante des préoccupations de notre registre. Nous tenons compte des audits ISM pour la gestion de la sécurité des navires, et l'attribution des certificats. Nous nous assurons que les structures sont bonnes, que les équipements fonctionnent. De plus, nos inspecteurs nautiques sont chargés des inspections de sécurité annuelles.
Je parlerai d'abord du programme national de gestion de la sécurité de la flotte libérienne. Ce sont les chiffres de 1998, ceux de 1999 sont encore en cours de traitement.
D'après la répartition par type de navire, il est intéressant de noter que 463 navires qui devaient se mettre en conformité avec les résolutions de 1998 l'ont fait ; près de la moitié des autres doit être conforme au code ISM. Nous encourageons fortement les autres armateurs à se mettre en conformité avec le code ISM avant 2002.
M. le Rapporteur : Je n'ai pas compris.
M. Tim KEEGAN : Ce transparent montre la répartition des navires sous pavillon libérien qui ont des certificats de gestion de sécurité.
Capitaine John DELEONARDIS : A l'heure qu'il est, les navires battant pavillon libérien ont le certificat ISM, mais un certain nombre de vraquiers ne seront pas certifiés ISM avant 2002.
En gros, 75 à 80 % de la flotte ont déjà été certifiés ISM en 1998, alors que tous les navires devront être en conformité en 2002 seulement.
M. le Rapporteur : Près de 75 % aujourd'hui ?
Capitaine John DELEONARDIS : De l'ordre de 70 % de toute la flotte. Mais la totalité, 100 %, des navires qui devaient être en conformité dès 1998 l'étaient à cette date.
M. Tim KEEGAN : Quand se produit un accident mettant en cause des bateaux concernés par la certification ISM, nous examinons les rapports sur les accidents des navires, les rapports sur les accidents des personnels, les rapports sur les déversements d'hydrocarbures, les rapports de l'Etat du pavillon, les rapports des organismes reconnus, pour voir s'il y a des non-conformités.
Pour l'analyse de ces rapports, nous menons nos enquêtes avec les compagnies...
M. le Rapporteur : Excusez-moi, je voudrais revenir en arrière. Je vois le chiffre de quarante rapports...
Capitaine John DELEONARDIS : La conformité était de 100 % en 1998 pour les pétroliers, les chimiquiers et les vraquiers.
M. Yoram COHEN : Pour simplifier, disons que 100 % de la flotte est en conformité aujourd'hui. Cependant, 70 % de ceux qui devraient être en conformité en l'an 2002, le sont déjà. Restent 30 %, qui ont deux ans pour entrer en conformité.
M. le Président : Mais ils circulent toujours.
M. Yoram COHEN : Oui, mais il s'agit de navires qui n'ont pas à être en conformité actuellement.
M. le Rapporteur : En fait, j'ai vu le chiffre de quarante rapports apparaître. Cela signifie-t-il que quarante navires ont été sortis de la flotte ?
M. Tim KEEGAN : Tôt ou tard, on trouvera des navires qui ne seront pas en conformité. Mais ces navires n'ont pas été retirés.
M. Yoram COHEN : La non-conformité ne les touche pas encore ; elle ne les touchera qu'en 2002.
Capitaine John DELEONARDIS : La non-conformité est une expression qui a été créée dans le code ISM. Elle résulte d'un audit effectué par les sociétés reconnues - Recognized Organization - RO - et découle d'une détention par l'Etat du port ou d'un accident survenu en mer - accident de navire, perte humaine, toute sorte d'accident qui montre que le navire ou un gestionnaire ne fonctionne pas en conformité avec le programme de gestion de sécurité.
M. le Président : Dans le cas des quarante rapports que vous indiquez, qu'en est-il ?
Capitaine John DELEONARDIS : Les navires concernés fonctionnent toujours pour la plupart. Ce que nous faisons, c'est que nous assurons le suivi de leur non-conformité...
M. le Rapporteur : Et en 2002, ils devront être conformes ?
Capitaine John DELEONARDIS : Tous les navires seront conformes, peut-être à quelques petites exceptions près. Ces rapports de non-conformité peuvent nous parvenir de plusieurs sources : des RO, d'un inspecteur après un accident, etc. C'est ce que nous appelons « non-conformité » ; c'est quelque chose d'imprévu qui se produit.
A ce moment-là, nous entamons une investigation importante sur la source de la non-conformité, ce qui est également requis au titre du code ISM. Le dispositif ISM exige en effet que chaque non-conformité soit analysée et qu'une mesure corrective soit définie et mise en place.
Si cette investigation de non-conformité n'est pas faite correctement, nous exigeons, en tant qu'administration du pavillon, que la RO fasse à nouveau l'audit de la société gestionnaire ou du navire pour garantir que les mesures de correction seront bien prises.
C'est la substance même des quarante non-conformités qui apparaissaient dans ce tableau.
M. Tim KEEGAN : Je souhaiterais ajouter que nous n'avons pas besoin d'un accident ou de pertes humaines pour établir un rapport. Ces rapports ne prennent pas uniquement en compte les dommages. Il suffit que nous parvienne un rapport de nos inspecteurs maritimes pour que le processus soit enclenché.
Nous ferons un bref rappel de la manière dont nous conduisons les enquêtes. Pour vous donner un exemple, nous avons reçu le rapport d'un accident concernant un bateau de sauvetage, accident survenu au cours d'un exercice. Dès que le rapport nous est parvenu, nous l'avons examiné pour voir quelles étaient les non-conformités. Nous travaillons avec les personnes désignées et avec l'autorité compétente au sein de la RO pour revoir les cartes de route de l'accident pour que cela ne se reproduise jamais. Je suis chargé du contrôle de l'Etat du pavillon.
D'après le nombre de navires dans la flotte et le nombre d'inspections, vous pouvez remarquer que tous les navires ne sont pas inspectés. Certains ont été retirés du service, d'autres sont rayés du registre, et d'autres encore ne nécessitent pas d'inspection en raison de la nature de leur activité ou de leurs opérations.
La documentation qui vous a été remise indique également le type de fautes commises, fautes que les inspecteurs constatent lorsqu'ils mènent leurs inspections de sécurité.
Pour ce qui est de l'activité des dix ports les plus actifs en matière de contrôles, vous constatez que Singapour est l'un des plus actifs, ainsi que Rotterdam, la Nouvelle-Orléans, Philadelphie.
M. le Rapporteur : Ce sont les ports dans lesquels vos inspecteurs sont les plus actifs ?
M. Tim KEEGAN : Oui, je parle d'activité du point de vue des inspections libériennes.
M. Yoram COHEN : La raison pour laquelle ces ports sont les plus actifs, c'est que la plupart des navires libériens se rendent dans ces ports.
Nous en venons aux détentions dans les ports. Commençons par celles pratiquées selon le Mémorandum de Paris.
M. le Rapporteur : Comment faut-il lire les chiffres que vous nous montrez ? Cela veut-il dire, par exemple, que pour la France, 7 % des bateaux détenus sont libériens ?
M. Tim KEEGAN : Il s'agit des inspections pratiquées conformément au Mémorandum de Paris. Cela indique le nombre de navires inspectés.
M. le Président : Excusez-moi, le tableau précédent indique le nombre de navires, quel que soit le pavillon, qui sont retenus dans un port ?
M. Tim KEEGAN : Oui, quel que soit le pavillon. C'est extrait du rapport annuel du Mémorandum de Paris pour 1998. Vingt-cinq ont été retenus dans les ports. Les pavillons dont le taux de détention est le plus élevé sont indiqués page 20 de la brochure. Le Liberia n'y figure pas, il est même en bas de l'échelle.
Si vous prenez le Mémorandum de Tokyo, en 1998, il est remarquable de constater que l'on retrouve les mêmes pavillons avec le plus fort taux de détention.
M. le Rapporteur : Le Panama n'y figure pas. Doit-on lire que le Panama ne fait pas de trafic avec le Japon ou que les bateaux panaméens qui vont au Japon sont particulièrement propres ?
M. Tim KEEGAN : Le Panama fait aussi du trafic avec le Japon, mais son taux de détention par rapport aux inspections n'est pas aussi élevé que pour le Mémorandum de Paris.
Le graphique de la page 24 vous montre la distribution entre les moyennes du Mémorandum de Paris et d'autres systèmes de contrôles par l'Etat du port. Sachant que la moyenne s'établit à 14,3 % pour le Mémorandum de Paris, le Panama enregistre environ le même chiffre, puis viennent les Bahamas. Le Liberia est bien en dessous.
Selon le Mémorandum de Tokyo, le Panama n'atteint pas la moyenne, avec 7,29 % pour le taux d'inspection et de détention.
Les chiffres de l'US Coast Guard montrent le Panama au-dessus de la moyenne, tandis que le Liberia est bien en dessous et les Bahamas quasiment à la moyenne.
En prenant les éléments de ces trois tableaux - Mémorandum de Tokyo, US Coast Guard et Mémorandum de Paris - on peut établir que le Panama enregistre un taux de détention de 8 %, les Bahamas 6 % et le Liberia 4 %.
M. Yoram COHEN : De combien est-il pour des pays comme les Etats-Unis, l'Angleterre, la France, etc. ?
M. Tim KEEGAN : Pour les pavillons américains, français, norvégiens, ce taux est généralement supérieur à celui du Liberia.
Nous avons un excellent programme de sécurité. Les navires battant pavillon panaméen sont inspectés par nos inspecteurs et examinés par les sociétés de classification pour ce qui est de leur structure, de leurs équipements. Pour l'essentiel, les navires battant pavillon libérien font également l'objet d'audits par des organisations compétentes aux fins de déterminer s'ils disposent d'un système de gestion de sécurité adéquat.
Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli.
M. Yoram COHEN : Je tiens à profiter de cette occasion pour vous expliquer parfaitement l'importance de l'immatriculation de navires de commerce pour le Liberia. Cela vous permettra de comprendre pourquoi le Liberia impose des normes élevées pour la sécurité et s'assure de leur mise en application.
Le Liberia a connu dix ans terribles de guerre civile. La capitale du Liberia a été totalement détruite. Les gens mouraient de faim. Pendant les dix ans de cette guerre civile, toutes les institutions et toutes les infrastructures du pays ont été détruites : plus d'électricité, plus d'eau courante pendant dix ans ! Une seule institution a survécu : l'autorité maritime. Excusez-moi, une autre a également survécu, celle de la brasserie ! (Sourires.)
Il y a une raison à cela : aucune faction, pendant la guerre, n'a essayé de détruire le secteur maritime car l'industrie maritime est un domaine dans lequel la qualité du Liberia est reconnue comme étant sur un pied d'égalité avec les normes occidentales. Non seulement c'est une source de fierté pour le pays, mais c'est également la première ressource de l'Etat aujourd'hui. Pour mettre cela en perspective, imaginez une source de recettes qui représenterait pour le gouvernement français de 25 à 33 % du budget national. Sans cette source, vous auriez du mal à tenir le pays. C'est l'analogie que vous pouvez faire avec le Liberia. Le registre libérien produit au moins 30 % du budget national pour l'Etat. Donc, c'est une institution qui nous est très chère ; tous les hommes politiques, quelle que soit leur couleur politique, qu'ils soient de droite ou de gauche, comprennent qu'il est indispensable de la protéger.
De plus, c'est la première ressource de devises pour l'Etat. Près de 40 % à ce jour. Nous espérons tous qu'au fur et à mesure que le Liberia se reconstruira, ces chiffres iront en diminuant. Avant la guerre, ils étaient de l'ordre de 10 %. Juste après, ils étaient plus élevés. Donc, au Liberia, la seule institution qui soit intouchable est l'institution maritime. On la considère comme le « trésor numéro un »
Nous avons donc pris la décision de conforter cette institution. Au début, la tentation était de se dire que si nous voulions plus de recettes, il fallait enregistrer plus de navires. Mais si vous le faites sans prêter attention, sans faire aucune discrimination, vous attirez tous les bateaux médiocres, qui peuvent au bout du compte provoquer des problèmes et vous conduire au désastre. Si, par exemple, se produisait une collision entre deux grands bateaux citernes, dont un serait libérien, le Liberia s'effondrerait car le coût de la protection, le coût des enquêtes, les problèmes de relations publiques et de communication seraient tels qu'il faudrait des années pour s'en remettre.
Cela dit, tout comme pour l'aéronautique, il y a toujours un facteur de risque, de hasard. Vous pensez à protéger les côtes françaises contre les catastrophes futures. Mais prenons l'industrie de croisière. Vous ne pourrez jamais assurer, même sur la meilleure ligne de croisière au monde, qu'il n'y aura pas d'explosion dans la salle des moteurs, dans les Caraïbes, pendant la saison d'affluence.
Cela peut se produire. Aucun registre d'aucun pays n'est à l'abri. Cela étant, le gouvernement du Liberia et nous, en tant que société en charge du registre, avons pris la décision que nous ne voulions pas que les vieux navires viennent s'inscrire chez nous, nous ne voulons que des navires de qualité. C'est la raison pour laquelle, quand on compare nos taux de détention à ceux des Etats-Unis, de l'Angleterre, de la France ou du Japon, nous faisons mieux. Pourquoi ? Parce que pour le Liberia, le pavillon est un objet de vie ou de mort. Sans navires de qualité, ça ne marche pas.
A votre place, je me demanderais comment faire pour protéger les côtes françaises contre des catastrophes futures ou, au moins, comment réduire au maximum la possibilité de catastrophes. Nous avons une situation intéressante pour les navires libériens avec les républiques de l'ex-URSS, avec des pays comme la Russie, l'Ukraine, la Géorgie. Le Liberia ayant été aux côtés des Etats-Unis pendant la guerre froide, ces pays imposent des frais portuaires supplémentaires de l'ordre de 40 000 dollars, à tout navire libérien destiné à la Russie. C'est trop cher. Donc, les navires libériens ne s'y rendent pas. Toutefois, les navires de Malte, du Belize y vont. Aussi lorsque les Russes nous demandent ce que nous faisons, nous leur disons de regarder les indices de sécurité et de se dire qu'une catastrophe coûte beaucoup plus que 40 000 dollars ; c'est vingt ou trente années de taxation que cela leur coûterait !
Il y a aussi la question de la sécurité partagée entre les pays, la société de classification et le registre. A votre place, je me demanderais aussi quelle est la responsabilité des sociétés de classification. Avec qui travaillent-elles ? A qui sont-elles fidèles ? Dans toutes les sociétés cotées en bourse, en France, par exemple, les auditeurs publics, jouent un rôle crucial lorsqu'ils examinent les comptes. Ils s'assurent que le contrôle financier respecte les normes financières.
Nous estimons que les sociétés de classification devraient tenir le même rôle avec les armateurs. En fin de compte, leur rôle est très proche. Si les sociétés de classification travaillent pour les propriétaires, elles sont payées par les propriétaires. La grande question, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne ou aux Etats-Unis, est de définir le rôle des sociétés de classification pour être sûr qu'elles suivent les directives, les consignes. Vous pouvez toujours améliorer la sécurité en faisant des recommandations au sein de l'OMI mais, parallèlement, vous avez une lutte politique à mener pour savoir combien d'argent vous êtes prêts à dépenser pour votre protection et combien les compagnies commerciales sont prêtes à dépenser. Combien dépensent-elles pour les deux ?
La question centrale est de connaître les relations entre les registres, les propriétaires de bateaux et les sociétés de classification. Il est très important de définir les rôles de ce point de vue entre l'Etat du pavillon et les sociétés de classification. Ces sociétés travaillent-elles pour l'Etat du pavillon ou pour l'armateur ? A mon avis, il faut qu'elles jouent un rôle similaire à celui des auditeurs pour les sociétés cotées en bourse, et qu'elles soient responsables vis-à-vis du public.
Vous pouvez jouer l'avocat du diable - qui sait quelles sont les limites ? -, mais c'est la tâche la plus épineuse.
M. le Président : Nous avons quelques questions à vous poser.
Capitaine John DELEONARDIS : Excusez-moi, mais nous avons encore l'exposé du capitaine Black sur les procédures STCW. Ensuite, si vous souhaitez nous poser des questions, nous serons à votre disposition.
Capitaine Vince BLACK : J'ai la responsabilité de missionner les certificats d'officiers libériens et de qualification des marins.
Voici un certificat. Tout marin servant sur un navire battant pavillon libérien doit être en possession de l'un de ces livrets. Pour l'obtenir, il faut justifier d'une formation de base. Mon département s'assure que ces marins sont qualifiés. La majorité des certificats sont émis sur la base d'un certificat de marin de nationalité étrangère, car très peu de Libériens travaillent sur nos navires. Toutefois, nous faisons passer des examens aux personnes qui souhaitent être qualifiées par nous.
Si vous avez des questions, je peux vous répondre dès maintenant ou même par la suite, si vous souhaitez des éclaircissements à une date ultérieure.
Nous recevons souvent des demandes sur la validité du permis que nous délivrons. Nous répondons normalement sous vingt-quatre heures, par télécopie. Malheureusement, dans ce domaine aussi la fraude existe.
Nous faisons donc des enquêtes. M. Davies-Sekle passe beaucoup de son temps à conduire des enquêtes sur les rapports de fraude, qui lui indiquent qu'un permis a été fabriqué frauduleusement. Nous en avisons immédiatement l'armateur qui traduit en justice cette personne afin de protéger l'image de notre permis libérien.
Capitaine John DELEONARDIS : Tim Keegan a dit que nous disposions d'un réseau d'inspecteurs dans le monde entier, y compris en France, dans douze à vingt ports français. Ce sont des inspecteurs sous contrats qui travaillent uniquement pour nous, pour l'inspection de navires battant pavillon libérien. Mais ils peuvent aussi travailler pour d'autres pavillons. Ce sont des personnes très importantes pour nous car ils sont nos yeux et nos oreilles.
Nous avons une liste de ports français : Dunkerque, Le Havre, Rouen, Saint-Nazaire, Lorient, Brest, Marseille, Fos-sur-Mer, Saint Louis-sur-Rhône, etc., où se trouvent nos inspecteurs. Dans la plupart des cas, ce sont des ressortissants français qui ont été des officiers de la marine marchande. Nous passons en revue leur travail et lorsqu'un rapport d'inspection est rempli pour chaque navire, nous intégrons toutes ces informations et nous les comparons aux dispositifs de gestion de sécurité pour nous assurer que les gestionnaires et les capitaines du navire respectent bien les normes.
Dernier point avant d'en finir : nous suivrons le débat au sein de l'Union européenne, notamment les propositions de la Commission, consécutivement au naufrage de l'Erika. Vous trouverez, dans la pochette que je vous ai donnée, une lettre que j'ai écrite à tous nos armateurs et entreprises à la suite de cet accident, avec les opérations les plus approfondies, surtout pour les pétroliers, les chimiquiers, les gaziers, etc.
Je n'ajoute rien de plus, je sais que vous avez des questions à poser.
M. le Rapporteur : En vous remerciant de ces différents exposés, je voudrais dire au préalable que nous comprenons très bien que le Liberia souhaite avoir une flotte, mais nous, nous défendons notre territoire et son intégrité. Vous l'avez bien senti, monsieur Cohen, comme l'illustrent vos propos. De toute façon, il y a dans le débat autour de l'Erika une mise en accusation des pavillons de complaisance. Que vous le vouliez ou non, dans l'opinion publique, le Liberia en fait partie, même si nous pouvons reconnaître qu'une mutation importante a été apportée. Mais avouez que vous venez de loin !
Nous sommes également allés à Malte. C'était bien normal puisque l'Erika naviguait sous son pavillon. Il est vrai que le problème des sociétés de classification se pose parce qu'elles sont souvent juge et partie. Mais j'ai l'impression qu'il se pose aussi pour vous, ou peut-être ai-je mal compris ?
Si je suis un armateur qui fait construire son bateau en Corée et le fait contrôler par le KRS, lorsque je viens m'inscrire chez vous, qui va me contrôler ? Une des onze sociétés reconnues ? KRS, mais pour votre compte ? A Malte, c'est ainsi que cela fonctionne. Si vous êtes dans la même logique, cela ne peut marcher parce que le discours de M. Cohen contre les sociétés de classification, que je partage volontiers, ne peut fonctionner s'il ne l'applique pas au pavillon qu'il représente. Cela pose un véritable problème.
Ma deuxième question, que je pose tout de suite de façon à ce que nous puissions avoir un débat général, est la suivante : je suis toujours un armateur, américain, cette fois, qui fait construire son bateau en Corée et qui doit le faire immatriculer. Pourquoi l'immatriculer à Washington sous le pavillon libérien, alors que nous sortons de chez les Coast Guards qui viennent de nous montrer que la qualité du pavillon américain est très bonne ? Quel est le différentiel ? Est-il fiscal ? Social ? Est-ce que KRS, si elle est retenue pour la certification, permettra d'éviter un contrôle plus strict car KRS est peut-être plus souple que l'US Coast Guard qui me contrôlerait si je m'immatriculais sous pavillon américain ? Quel est ce grand mystère qui fait que pour un investisseur américain, il vaut mieux venir à la sortie de Washington plutôt qu'en centre-ville ?
C'est la question que nous nous posons. Bien entendu nous ne sommes pas naïfs. Nous avons déjà quelques éléments de réponse.
M. le Président : J'ajouterai une question à celles posées par M. le rapporteur. La dernière présentation qui nous a été faite portait sur les équipages. Je suis favorable au fait que lorsqu'un pays accepte d'accorder son pavillon à un navire, il le fasse à la suite d'une inspection de la qualité du navire et également de celle de l'équipage, car un bon navire avec un mauvais équipage constitue un réel danger. L'inverse est tout aussi vrai.
Avant que le pavillon libérien soit accordé à un navire, existe-t-il cette exigence au sujet de l'équipage ?
M. le Rapporteur : Ma troisième question concerne les sociétés de gestion nautique. On s'aperçoit que dans l'affaire de l'Erika, c'est un réel problème. Contrôlez-vous - j'ai cru comprendre que c'est le cas - les sociétés de gestion nautique que prennent les armateurs ? Les interrogez-vous sur leur manière de gérer leurs bâtiments ? Refusez-vous éventuellement des armateurs qui ont une gestion nautique aléatoire ?
M. Yoram COHEN : Permettez-moi de commencer. Ce sont des questions tout à fait justes, auxquelles il est parfois difficile de répondre, mais je crois que le meilleur moyen est d'être honnête sur le plan intellectuel de part et d'autre.
Donc, tout d'abord, pourquoi un armateur américain, français ou allemand viendrait-il s'immatriculer au Liberia plutôt que sous son pavillon national ? Je ferai un préalable d'ordre général. Il y a certains facteurs économiques qui entraînent cette décision. Toutefois, en règle générale, si vous pensez aux navires libériens, ce sont des navires plus jeunes. Si un navire a vingt ans, il faut qu'il subisse des contrôles particuliers pour pouvoir continuer à être immatriculé chez nous. Donc à un certain âge, les navires quittent le Liberia parce qu'ils ne peuvent rester, ils n'entrent plus dans nos standards. Les Bahamas font la même chose. Ces bateaux vont ailleurs.
M. le Rapporteur : Ailleurs, c'est où ?
M. Yoram COHEN : L'Erika a des bateaux s_urs ... Nous avons expulsé un très gros client, un des plus importants dans le monde. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas nous le permettre. Nous avons rencontré notre plus gros client et lui avons dit que nous ne voulions plus voir de tels navires.
M. le Rapporteur : Avant ou après l'Erika ?
Capitaine John DELEONARDIS : C'était après.
M. Yoram COHEN : Nous avons dit que nous parlions loyalement, c'était après. Mais il est assez fréquent que nous refusions des navires qui se présentent à nous. Il y a des règles ici !
Je suis extraverti. J'aime parler avec les gens. Je rencontre les nouveaux clients. De par ma nature, je sillonne le monde pour le compte du Liberia. Je précise toutefois que M. Deleonardis, ancien capitaine à la Coast Guard, a un droit de veto sur ma décision. Si le navire n'est pas de grande qualité, il le refuse.
De même, Michael Davies-Sekle est un avocat qui a une expérience de plus de quinze ans dans domaine maritime. Ce genre de bateau, même Chypre ne les accepte pas. Comment voulez-vous que le Liberia les accepte ? Autrement dit, sur le plan institutionnel, nous avons un mécanisme automatique pour la qualité.
Lorsqu'un propriétaire de bateau, une société française ou allemande décide de s'adresser à nous, il est certain que les considérations fiscales font partie de la décision. Toutefois, pensez à ce qui se passe en Europe de l'Ouest. En Norvège, ils ont le NIS qui a le même régime fiscal que nous. Les Britanniques font de même. Aussi, pourquoi les Norvégiens viennent-ils chez nous ? C'est la même chose pour l'Allemagne. Ce n'est plus pour la fiscalité ; ce ne sont pas non plus les questions sociales : c'est pour le service.
M. le Rapporteur : Qu'entendez-vous par là ?
M. Yoram COHEN : En tant que société privée, nous gérons l'immatriculation comme un business. Nous avons réfléchi en tant qu'entreprise ayant des concurrents. J'admire beaucoup la France. L'un des v_ux que je fais chaque année est d'apprendre votre langue.
Mais aucune administration d'Etat ne peut entrer en concurrence avec une entreprise privée. A titre d'exemple, si vous avez besoin d'un permis de conduire en France, vous vous adressez au service des véhicules. C'est une demi-journée pour avoir son permis. Mais aujourd'hui si vous voulez acheter une voiture, vous pouvez l'acheter sur votre ordinateur. Vous pouvez avoir la meilleure voiture au meilleur prix, qui vous est livrée le lendemain à votre domicile. Si les Etats ne peuvent pas faire concurrence au secteur privé, ils deviennent moins attirants.
Faisons l'analogie avec le secteur maritime. Le Seaman ID, la carte d'identité du marin, est comme un passeport. Vous devez en faire une demande : vous devez aller à Chicago, Washington, San Francisco ou New York. A moins que ce soit urgent, vous devez attendre quatre à six semaines pour obtenir un passeport. Sur l'Internet, vous pouvez tout avoir automatiquement.
Nous sommes une entreprise privée, qui gère une bureaucratie gouvernementale : chez nous, cela demande trois à sept jours. A partir du mois de juin, vous pourrez même faire votre demande par Internet. Vous effectuerez le paiement par Internet et vous aurez effectué toutes les formalités requises dans des délais qu'un gouvernement ne peut concurrencer, qu'il soit français ou néerlandais. Peut-être un jour serez-vous en mesure de le faire, mais vous bougez lentement.
La différence est là, c'est l'entreprise privée, mais administrative : une institution publique du gouvernement. Nous avons investi dans les ressources de la technologie afin d'optimiser la qualité de notre service. Voilà l'avantage.
Si, en France, le gouvernement décidait de privatiser certaines bureaucraties, vous pourriez peut-être nous rattraper, car la question n'est plus seulement une affaire fiscale. La question est de fournir un service aussi rapide et performant que possible. Ici, on ne finit pas à cinq heures. Tous ceux qui travaillent ici le savent, et les autres aussi. C'est pour cela que les navires viennent vers nous au lieu d'aller ailleurs.
Pour en venir à la gestion et l'inspection de la gestion des navires, une fois de plus, il s'agit de concurrence. Nous n'allons pas contrôler les sociétés de gestion....
M. le Rapporteur : Vous parlez bien de gestion nautique ?
M. Yoram COHEN : Oui. Nous ne les soumettons à aucun audit. Ils peuvent exploiter une excellente opération, mais gérer un mauvais navire. Notre but est d'examiner tous les navires.
Nous avons certainement certaines des meilleures sociétés de gestion nautique au monde. Il se peut que, tout à coup, nous voyions arriver de vieux navires et que ces sociétés viennent avec leurs équipes et me demandent : « Peux-tu nous rendre service ? Nous laisser souffler ? »
Ma réponse est que nous devons examiner tous les navires parce que nous sommes très intéressés par ce qu'ils nous offrent, mais que les accepter ne peut être une bonne chose pour personne.
M. Deleonardis répondra à votre question portant sur l'inspection.
Capitaine John DELEONARDIS : Dans le scénario que vous avez esquissé au sujet d'un navire construit dans un chantier naval coréen et des relations que nous entretenons avec les sociétés de classification de l'IACS, je dirai que chacune des onze sociétés que nous reconnaissons est apte à classer tout navire construit en Corée, au Japon, en Chine, aux Etats-Unis, en France ou n'importe où. Notre capacité, en ne travaillant qu'avec les meilleures sociétés de classification, permet à nos armateurs de ne faire appel qu'aux meilleures sociétés de classification, indépendamment du lieu où le navire est construit.
De ce fait, exiger que les sociétés de classification maintiennent un niveau de qualité, assure une cohérence des niveaux de sécurité et d'inspection qui satisfait aux normes et aux exigences les plus élevées. Le système de qualité est donc très important et nous y sommes très attentifs. Chaque année nous rencontrons toutes les sociétés de classification, aux Etats-Unis, dans notre bureau, et nous réexaminons le programme dans son intégralité. Nous organisons des présentations, des études sur des contrôles qui, à notre avis, n'ont pas été menés à bien. Nous examinons des cas précis. Pourquoi cela s'est-il produit ? Pourquoi votre inspecteur a-t-il fait ceci ou cela ?
Nous entretenons donc des relations étroites avec toutes ces sociétés de classification. Les armateurs respectent cela parce que ces relations sont le gage que les sociétés de classification feront un excellent travail d'inspection et assureront l'état statutaire de leurs bateaux. Ainsi, une certaine synergie se dégage de cette opération. Elle permet un renforcement en conservant un système qui assure le maintien par tous d'un haut niveau de qualité.
En ce qui concerne votre deuxième question concernant la Corée, nous pratiquons des inspections. En tant que membres de l'IACS, les sociétés de classification doivent maintenir la qualité aussi longtemps qu'elles émettent des certificats pour nous.
M. le Président : Les quelques exemples que nous avons de certaines sociétés de classification éminentes de l'IACS qui ont autorisé des navires poubelles retenus dans des ports européens, montrent - et d'ailleurs la Coast Guard le montre également - qu'il ne suffit pas d'appartenir à l'IACS pour être en quoi que ce soit éminent en matière de classification.
M. Yoram COHEN : C'est bien vrai. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Capitaine John DELEONARDIS : Nous sommes d'accord. Pour nous, le pavillon compte. Parce que les sociétés de classification travaillent pour nous, elles doivent appliquer nos normes. Nous ne sommes pas obligés d'accepter leur travail. D'ailleurs, dans de nombreux cas, nous ne le faisons pas.
M. le Rapporteur : En réalité, pour reprendre l'exemple d'un chantier coréen : je suis armateur américain et je fais construire en Corée ; j'émets un appel d'offres pour la société de classification ; j'ai tendance à prendre la moins chère. Le seul fait que je prenne telle ou telle société de classification vous agrée et elle devient, de fait, la vôtre. Certes, vous vous abritez derrière l'IACS.
Je pense que cela pose un grave problème, que nous avons déjà constaté à Malte. Le jour où nous sommes allés à Malte, le gouvernement maltais a sorti vingt bateaux de sa flotte et le RINA a, par ailleurs, sorti lui-même vingt bateaux, pas tous maltais. Donc, ces quarante bateaux qui jusqu'à présent étaient réputés propres sont devenus sales en un jour ! RINA fait partie de la liste des sociétés de classification que vous reconnaissez. Si un armateur arrive ici avec RINA ou une autre société de classification, vous le considérez comme bon. C'est là, me semble-t-il, que se pose le problème.
M. Brad BERMAN : Je souhaiterais ajouter une chose. Au moment où nous immatriculons un bateau sous pavillon libérien, le bateau est encore en période probatoire. Au moment de son enregistrement, de nouveaux documents sont fournis. A ce moment-là, nous diligentons un inspecteur que nous engageons pour travailler pour le Liberia, que ce soit pour un bateau neuf ou de seconde main.
Je travaille avec Tim Keegan. Notre inspecteur est sur le navire pour remettre les documents dans le cas d'un nouveau navire. Peut-être nous cachons-nous derrière le nouveau navire, mais dans le cas d'un navire de seconde main ou d'un navire qui bat un autre pavillon, nous nous assurons que les documents de classification sont en place. Il y a des cas où ces documents de classification ne sont pas disponibles. Nous disons alors aux armateurs qu'il n'y a pas conformité avec la société de classification et lorsque le navire arrive au port suivant, des inspections sérieuses sont menées que nous ne pouvions faire sur la base des documents de classification du fait des délais. Dans ce cas, notre inspecteur doit monter à bord pour procéder à ses propres investigations et confirmer que les réparations ont été effectuées conformément aux conditions de la société de classification pour délivrer les documents. Dans ce cas, nos amis ont accepté que les travaux soient effectués. Nous devions savoir ce que faisait la société de classification.
Dans le cas de l'Erika, Malte a dit trop fréquemment que la société de classification faisait « assez » attention. Nous faisons examiner les cas par des personnes pour voir si les documents sont valables.
M. Yoram COHEN : Je ne vais pas tourner autour du pot. Nous avons dit que nous aurions un débat honnête intellectuellement. Nous avons une liste de sociétés de classification. Nous savons que certaines ne sont pas bonnes.
M. Tony DUPREE : Nous recourons à beaucoup de sociétés de classification. Nous les attirons dans notre registre. Une société ne peut prolonger une inspection spéciale à moins de nous montrer toutes les conditions dans lesquelles l'inspection a été faite et de nous demander l'autorisation de prolonger. Sinon, nous ne le permettons pas.
Ce qui s'est passé à Malte n'est pas possible ici. Nos rapports sont très différents. Nos sociétés de classification savent qu'elles travaillent pour nous. Nous avons radié une société de classification pour ne pas avoir suivi nos règles.
Quant aux nouveaux navires, ou bien ils suivent toutes les règles de l'OMI, ou bien ils savent que nous sommes une entreprise privée et que nous pouvons mettre en _uvre les règles internationales beaucoup plus vite que la Coast Guard qui doit passer par le bureau du gouvernement.
M. Yoram COHEN : Sur les livres, vous pouvez avoir les meilleures lois. Sous le régime communiste, la constitution soviétique était la meilleure, dans les principes. Vous pouvez concevoir la meilleure des sociétés au monde sur le papier. Mais, en fin de compte, les gens ne sont pas stupides et, confrontés à la réalité, ils font le partage entre ce qui est et ce qui n'est pas.
« Nous avons le meilleur des régimes. Nous avons rédigé les meilleures lois. Nous suivons toutes les règles de l'OMI. » Tous les registres ouverts vous tiendront le même langage. Mais, au bout du compte, il faut savoir lire les statistiques et en analyser le sens. Il y a une raison pour laquelle nos statistiques sont analysées au plus haut niveau c'est que nous ne faisons pas confiance a priori. A partir de chaque catastrophe, on apprend à faire mieux pour l'avenir. Nous remettons en question telle ou telle société de classification se trouvant sur notre liste. Elles prennent leurs responsabilités et affirment vouloir faire mieux à l'avenir.
Nous faisons de notre mieux. Si, par exemple, la direction de notre organisation se trompe, les experts corrigent. C'est la crédibilité de la gestion qui est en jeu parce que, par exemple, tous ces gens venus de la Coast Guard, qui n'est qu'à seulement quinze minutes en voiture d'ici, ils rencontrent leurs amis. Si nous ne sommes pas à la hauteur, si cela ne marche pas sur un plan pratique, nous ne pourrons plus jamais attirer les meilleurs pour venir travailler chez nous. C'est la qualité de la gestion qui compte.
Je ne suis pas un marin. Je suis un entrepreneur. En tant que directeur de gestion, vous devez vous entourer des meilleurs experts maritimes que vous pouvez trouver. Pour nous, ce sont les Coast Guards. Vous trouvez les meilleurs résultats dans nos statistiques parce que nous faisons toujours les bons panachages d'effectifs, d'une manière qui nous permet de nous positionner comme un registre compétent.
J'accepte et je comprends le sentiment de l'opinion publique qui s'exprime en Europe, et selon lequel tous les registres ouverts sont les mêmes. Mais, quand vous faites les bilans, si vous tenez compte de l'âge des navires sous pavillon libérien ou bahaméen, vous verrez une différence par rapport aux autres registres ouverts, car nous essayons d'être des armateurs d'un type différent.
Devons-nous tirer la leçon des catastrophes ? Certes. Nous allons essayer de mettre en place un conseil consultatif indépendant en matière de sécurité. A la fin de l'année, nous examinons nos procédures et indiquons ce que nous avons fait de bien et quelles ont été nos erreurs.
M. Brad BERMAN : La majorité de notre flotte se trouve dans les sociétés de classification les plus respectées. Je ne me souviens pas d'un registre national qui ait d'autres impératifs. Je pense qu'un pavillon, quel qu'il soit, exige que vous soyez parmi les trois meilleures sociétés de classification.
M. Tim KEEGAN : La majorité sont pratiquement membres de l'IACS, comme je le disais dans mon exposé. ABS, BV, DNV et GL détiennent plus de 90 % de la flotte. RINA représente 1,7 %.
M. le Rapporteur : Le problème n'est pas RINA.
M. Tony DUPREE : La plupart de nos propriétaires emploient les meilleurs gestionnaires, les meilleures sociétés de classification, les meilleures assurances. Cela veut dire que nous essayons d'attirer des armateurs de qualité, qui soient responsables de la sécurité de leur flotte.
M. le Rapporteur : Mon interrogation rebondissait sur des propos tenus au début sur les sociétés de classification. Vous avez dit qu'un des principaux problèmes était celui posé par les sociétés de classification. Nous nous interrogeons sur le fait que les sociétés de classification choisies par un armateur, pour lui-même, deviennent aussi l'instrument de contrôle de l'Etat d'accueil, c'est-à-dire de vous, même si vous avez - plus qu'à Malte - des contrôles effectués par des inspecteurs. A notre sens, cette identité pose problème.
Vous disiez que vous êtes une entreprise, et vous êtes une société nationale, si je puis dire, puisque vous représentez l'Etat libérien. Ce point nous pose question. Il serait également intéressant d'avoir les statistiques du nombre de navires que vous avez sortis de flotte, pour des raisons diverses et variées - âge, non-respect de certaines normes - et, éventuellement, les bateaux que vous avez refusés. Votre argument serait encore plus fort si nous avions des chiffres, pas seulement des exemples.
M. Yoram COHEN : Nous tâcherons de vous faire parvenir des statistiques.
Mon premier commentaire concernera les statistiques. Il y a un nombre de navires que nous avons radiés. Cependant, nous voulons en arriver au point de n'avoir plus à en chasser un seul. Pourquoi peut-il arriver qu'une catastrophe survienne ? Nous voulons voir l'inspecteur. Il arrive que l'inspection se fasse trop tardivement. C'est pour cela que nous avons créé une culture. Dès lors qu'un navire atteint l'âge de quinze ans, il ne reste pas chez nous. Il ne s'agit pas de prendre en compte le nombre de navires auxquels nous disons de partir, mais il faut également tenir compte de leur âge. Si vous faites la moyenne de l'âge des navires, nous sommes bons.
Mon second commentaire est le suivant : je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a un problème dans les sociétés de classification qui travaillent pour nous. Si l'armateur choisit, nous sommes conduits par son choix. C'est lui qui paie, il doit être d'accord. Nous avons voulu définir un seuil. Nous avons choisi le seuil de l'IACS. Ce n'est peut-être pas assez. Vous pouvez dire que RINA est la plus petite. Peut-être ne devrait-elle pas être là ? Mais il faut, d'un point de vue législatif, bien définir le rôle de la loyauté, c'est-à-dire que l'avenir ira aux sociétés de classification fonctionnant comme des auditeurs publics, avec les mêmes responsabilités, si elles veulent accomplir un excellent travail. Le Liberia ne peut prendre cette décision tout seul. C'est une question dont il faut parler au sein de l'OMI et nous apprécierions une position commune avec la France sur le point de savoir comment résoudre cette question.
Encore une fois, je crois qu'il y a un problème : si un armateur paie, il peut demander à la société de classification de ne pas regarder. La seule possibilité que nous ayons consiste à dire qu'il y a un de nos contrôleurs qui regarde. Il existe donc un besoin, au niveau de l'OMI, de réglementer la sécurité et la responsabilité des sociétés de classification afin de les ramener à un niveau où elles fonctionnent comme des auditeurs. Nous serions très heureux de travailler avec la délégation française auprès de l'OMI.
Quand une catastrophe comme celle de l'Erika se produit, nous constatons une augmentation car, subitement, les armateurs qui s'adressent aux registres ouverts prennent peur. Ils ne pas veulent pas que les autorités françaises, allemandes ou britanniques leur tapent sur les doigts. Ils viennent chez nous.
M. Brad BERMAN : La plupart du temps, on pense que ce ne sont que des bonnes paroles. Mais nous les avons mises en pratique. Notre directeur général, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, a participé deux fois à la réforme MARE, qui est un groupe de registres nationaux et ouverts destinés à traiter des caractéristiques des registres de qualité. Ils se sont réunis aux Pays-Bas, l'an dernier, et au printemps, à Singapour. Nous avons été invités à procéder à un colloque similaire cet automne. Donc, lorsque nous parlons de bons registres, il faut savoir que des groupes y travaillent.
Capitaine John DELEONARDIS : Je voudrais compléter, sans être agressif. Nous ne pensons pas que l'élimination d'un navire de notre registre soit une attitude constructive, car elle ne résout pas le problème du navire qui ne respecte pas les normes. Nous préférons réparer le navire. Il faut le faire contrôler comme il faut ; il faut le faire fonctionner comme il faut ; il faut le gérer comme il faut. C'est une question très importante dès lors qu'il existe des différences en matière de normes de qualité. Donc, à notre avis, rayer un navire d'une flotte n'est pas la solution car il posera un problème ailleurs. Cela ne résout pas le problème. Il vaut mieux, comme l'a dit Tim, le résoudre.
C'est très difficile, cela prend beaucoup de temps, mais nous travaillons avec nos clients, avec nos armateurs, avec nos gestionnaires. Nous essayons de les conduire vers la bonne gestion de leurs navires. Nous estimons que c'est plus efficace car ces armateurs apprécient les relations constructives que nous nous efforçons de construire avec eux. Nous ne faisons pas de l'obstruction, nous essayons de les aider. Nous leur apportons nos idées, notre expérience, car nous sommes des opérateurs, des contrôleurs et nous faisons des enquêtes sur les accidents. Cela crée des synergies dans les relations. Il est très difficile d'écrire tout cela, de mettre cela sur papier, comme cela vient d'être dit. Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est d'examiner les dossiers. Cela revient à la surface.
M. Michael DAVIES-SEKLE : Je compléterai en disant que le Liberia a ratifié la plupart des conventions de l'OMI, dont les normes sont très élevées. En fonction de ces normes, les sociétés de classification, que ce soient RINA, BV ou KRS, doivent respecter les normes ratifiées par le Liberia dans le cadre des conventions internationales. Ces conventions visent en fait la liste des procédures que les sociétés de classification doivent respecter. Pendant la construction du navire, les auditeurs peuvent appeler notre bureau afin de savoir si tel ou tel point est respecté ou pas. Les sociétés de classification sont contrôlées de cette façon, même si l'armateur a le choix ultime de la société de classification.
M. le Rapporteur : On sent le souci de transparence et de qualité de la part du Liberia. En conséquence, êtes-vous prêts à transmettre à l'OMI l'ensemble des réponses aux questionnaires qui ont été envoyés à chaque Etat du pavillon pour savoir comment il applique les conventions de cette organisation internationale ? Il s'agit d'une disposition récente soutenue, en particulier, par l'Europe.
M. Yoram COHEN : Ma réponse est absolument positive. En fait, M. Berman, notre conseiller juridique général et notre responsable exécutif m'ont dit qu'ils estimaient que ce serait merveilleux pour le Liberia si nous étions les premiers à répondre et à mettre en _uvre cette auto-évaluation. Peut-être cela ne montrera-t-il pas que nous sommes parfaits, mais peut-être aussi allons-nous constater que nous ne sommes pas mauvais. Si nous sommes bons, cela nous permettra de montrer notre valeur. Ensuite, c'est peut-être nous qui deviendrons la norme.
Actuellement, en tout cas, nous travaillons sur cette évaluation. Elle sera faite très prochainement. Je voudrais bien vous en donner un exemplaire en même temps qu'à l'OMI.
Il ne s'agit pas de propagande ni de relations publiques, mais nous estimons que c'est une opportunité que nous devons saisir et qui peut être très importante pour nous. Il ne faut pas envoyer le problème à un autre registre, mais le résoudre. Peut-être verrons-nous que notre travail n'est pas aussi impeccable que nous le pensions et qu'il nous reste des problèmes à résoudre.
M. le Président : Vous avez, je suppose, des équipages qui viennent de différents pays. On pourrait discuter sur leur type de recrutement, mais ce serait bien long. Êtes-vous d'accord cependant pour dire qu'il doit, en matière d'équipage, y avoir unité de nationalité sur un même bateau ? L'Erika avait un équipage composé de marins exclusivement indiens.
M. le Rapporteur : C'était un bon équipage.
M. le Président : Y a-t-il, sur les bateaux battant pavillon libérien, une unité de nationalité des équipages ?
M. Yoram COHEN : A ma connaissance, non.
Capitaine Vince BLACK : Sur les navires battant pavillon américain, vous avez très rarement des équipages sans étrangers.
M. le Président : La même question a été posée ce matin au capitaine Gilmour. Sa réponse a été que la totalité des bateaux battant pavillon américain avait des équipages américains, sauf quelques cas particuliers de marins nés à l'extérieur qui, pour des raisons très précises, étaient intégrés dans les équipages américains. (Sourires.)
Capitaine John DELEONARDIS : Ce n'est pas tout à fait exact.
Capitaine Vince BLACK : Seuls les officiers américains doivent être des ressortissants américains. La majorité d'entre eux sont nés en Europe.
En vérité, les équipages viennent de partout : Porto Rico, Antilles, Caraïbes. Nous constatons la même chose sur les navires battant pavillon libérien. Des officiers d'origine européenne et des équipages antillais, chinois, philippins, indiens. L'important, c'est de parler anglais. (Sourires.)
Je sais qu'en France, vous êtes très sensibles à ce problème ! Je sais que les pilotes français qui arrivent de Paris ne veulent pas parler anglais, mais sur les navires, le commandant de bord doit parler anglais. Et les Chinois insistent pour que les marins parlent anglais. L'une des raisons pour lesquelles on retrouve autant d'Indiens et de Philippins sur les bateaux est qu'ils parlent couramment anglais. L'essentiel, c'est que les membres de l'équipage doivent parler anglais. Ce n'est pas la peine qu'ils soient de la même nationalité. Lorsque l'on travaille avec un pilote, il est important de parler et de comprendre l'anglais.
Capitaine John DELEONARDIS : Les qualifications des officiers et des membres d'équipage, c'est ce que nous examinons en premier. Bien entendu, la possibilité de parler anglais est également importante, mais nous avons toujours examiné avant tout la formation et l'expérience. C'est cela le facteur décisif pour savoir si les officiers ou les membres sont qualifiés. Pour nous, la nationalité n'a jamais été importante, surtout dans cette profession mondialisée. Une même nationalité n'est pas indispensable.
M. Yoram COHEN : Je comprends l'argument qui consiste à dire que c'est bien d'avoir des gens qui parlent la même langue, cela réduit les risques de mauvaise compréhension. Dans certaines régions du monde, des syndicats cherchent par ce biais à protéger les possibilités en matière d'emploi. Le problème est que si vous le faites, vous ne trouvez pas assez de marins car la majorité des équipages viennent d'Inde et des Philippines et la majorité des officiers viennent d'autres pays. C'est donc tout simplement un problème pratique. Comment le résoudre ? En fonction du nombre de personnes qualifiées pour ces emplois.
J'en parlais avec des armateurs allemands. Ils préfèrent les Allemands, mais ils ont des difficultés à trouver suffisamment de marins allemands. Ils ont donc pour règle d'avoir au moins deux officiers allemands et pour le reste, d'avoir un équipage aussi cohérent que possible.
M. Michael DAVIES-SEKLE : Dans la flotte libérienne, vous n'avez pas d'équipages composés de vingt et un hommes, par exemple, qui viendront chacun d'un pays différent, mais plutôt un bon nombre qui vient d'un pays et un autre groupe d'un autre pays. Il y a des différences, mais pas que des différences. Une majorité peut être philippine et les officiers européens, par exemple. Il y a souvent une mixité telle que le niveau de communication ne pose pas problème.
M. le Rapporteur : Contrôlez-vous les normes de l'OIT sur les équipages ?
M. Tim KEEGAN : Oui.
M. le Rapporteur : Souvent, les équipages changent. Ce sont les bureaux de gestion nautique qui les fournissent et qui ne sont pas toujours les mêmes pour un même bateau. Avez-vous des moyens de contrôle de ces dispositifs ? L'un des problèmes de la sécurité est aussi que l'équipage ne connaît pas le bateau.
Capitaine John DELEONARDIS : Aux termes de la convention STCW de 1995, tous les pays signataires, dont le Liberia, doivent fournir une formation de familiarisation pour les membres de l'équipage. Cela se retrouve aussi dans le code ISM, afin de s'assurer que chaque nouveau membre de l'équipage est familiarisé avec le bateau pour que ce qui est du matériel de sauvetage, du matériel de sécurité pour les dispositions de sauvetage, les tâches d'urgence, etc.
Dans le cas d'un navire de transport de passagers, ils sont également obligés de répondre à certaines normes afférentes à la protection des passagers. Ils ont des exercices périodiques et une formation à bord afin d'assurer que cela est abordé de façon continue. Les normes établies par la convention STCW sont mondiales et elles doivent être respectées par tous les pays.
Lorsque le capitaine Black passe en revue un certificat émanant d'un autre pays, ce pays doit satisfaire aux exigences imposées par la convention STCW. Ce sont des normes communes d'un niveau précis. Certains pays n'exigent pas que ces normes soient respectées. Nous ne reconnaissons pas les certificats émis par ces pays. C'est le cas, par exemple, du Panama. La base sur laquelle les certificats de ces pays ont été émis ne peut être déterminée avec exactitude, nous ne les reconnaissons pas tous. C'est ainsi que nous assurons un certain niveau de qualité.
M. le Président : Nous vous remercions.
N.B. : Compte tenu des délais de publication du présent rapport, l'audition reproduite ci-dessus, n'a pu être relue par les intervenants.
Audition de Mme Loyola de PALACIO,
vice-présidente de la Commission européenne,
commissaire européenne chargée des transports
(extrait du procès-verbal de la séance du 8 juin 2000 à Bruxelles )
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
Mme Loyola de PALACIO : Comme vous le savez, j'ai déjà eu certains contacts avec les personnes affectées par la marée noire de l'Erika. Votre commission d'enquête a déjà rencontré M. François Lamoureux, le directeur général, sur le sujet qui nous intéresse.
Je partage votre inquiétude et votre préoccupation pour éviter à tout prix à l'avenir que de telles situations se reproduisent. Une solution à l'échelon national est insuffisante et doit s'élargir à l'échelon européen, voire mondial. L'idéal serait d'aboutir à des solutions au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI).
Cela étant, le parfait étant l'ennemi du bon, nous devons travailler et avancer là où nous le pouvons en essayant de faire avancer d'autres instances. Cela signifie que comme responsable au sein de la Commission des transports, et donc de la sécurité maritime, j'ai préparé un paquet - que la Commission a présenté et que vous connaissez : il n'est que la première partie d'un projet plus vaste qui doit être complété par un second paquet qui sera présenté avant la fin de l'année.
Cela dit, certaines de ces mesures devraient également pouvoir être adoptées au sein de l'OMI. Le problème est que l'Union en tant que telle n'est pas membre de l'OMI - elle n'y siège qu'à titre d'observateur - et seuls les Etats membres ont la capacité de faire des propositions.
M. O'Neil, secrétaire général de l'OMI, que j'ai rencontré récemment pour discuter de ces sujets s'est montré inquiet de voir l'Union européenne faire cavalier seul sur ces questions. Il a compris que je souhaitais que des dispositions soient prises au niveau international, mais que la décision unilatérale prise par les Etats-Unis perturbait ce souhait. Il faut savoir que la double coque ou assimilé gêne les Américains s'agissant des standards de sécurité des pétroliers et autres bateaux transportant des matériaux à risques.
Si les Etats-Unis n'avaient pas fait cavalier seul, on aurait pu avoir une réglementation internationale et travailler la main dans la main avec tous les autres pour parvenir à des solutions globales. Pour ma part, je ne souhaite nullement que des Erika aillent s'échouer sur les côtes asiatiques ou africaines ! La mer nous intéresse tous au même titre.
Sachant que les Américains représentent plus de 25 % du trafic des pétroliers, cela signifie que les bateaux moins sûrs se déporteront sur les 75 % restants de ce même trafic - c'est-à-dire sur nous-mêmes qui représentons également 25 % du trafic -, avec les risques que cela comporte.
Politiquement, il me paraît inacceptable qu'un bateau, refusé par un port américain, vienne dans nos ports et soit confronté à un problème en face de nos côtes. Si un tel accident devait se produire, cela ferait un tel scandale que je n'aimerais pas être à la place du ministre concerné. Ce serait intenable et inadmissible. Or, c'est bien ce qui risque de se produire.
M. le Président : C'est ce qui se passe avec l'Exxon Valdez qui sillonne actuellement la Méditerranée.
M. le Rapporteur : L'Erika aurait été interdit aux Etats-Unis.
Mme Loyola de PALACIO : Non, cette nouvelle réglementation américaine n'aurait été applicable à l'Erika qu'au début de cette année et l'incident s'étant produit fin 1999, il aurait été admis aux Etats-Unis. En revanche, si l'accident s'était produit en décembre 2000, l'Erika aurait été exclu des côtes américaines, mais admis sur nos côtes. Voyez le scandale et l'indignation que cela aurait provoqué chez les personnes touchées et dans l'opinion publique en général !
Cela étant dit, que voulons-nous ? Des solutions concertées au niveau international. Or, dans ce contexte, le contrôle des autorités portuaires ne relève pas de solutions internationales, mais de solutions internes de la compétence nationale. Sur les aspects qui relèvent d'accords au sein de l'OMI, j'aimerais donc trouver un accord à ce niveau. Entre-temps, je continuerai à insister pour que l'Union européenne - comme l'ont fait les Etats-Unis - prenne des décisions supposant des exigences supplémentaires allant au-delà de ce qui a été prévu jusqu'à présent par les normes MARPOL.
Le premier paquet est connu : les deux premières directives impliquant la modification des directives relatives aux sociétés de classification et au contrôle dans l'Etat du port ont été très bien reçues par le Conseil. Je suis persuadée qu'il y aura un accord politique au Conseil.
Cela dit, je ne suis pas sûre de vouloir cet accord politique si ce paquet est tronçonné ; je veux donc le paquet complet pour éviter toute absence d'action qui essaierait de se justifier par ce morcellement. Pour moi, le paquet est un tout.
Les contrôles de l'Etat du port relèvent de nos compétences, sachant que ces contrôles sont limités en raison du peu de temps que passent les bateaux dans les ports. C'est donc surtout sur les sociétés de classification et leurs contrôles périodiques que retombe la plus grande responsabilité. Cela dit, les contrôles de l'Etat du port peuvent déceler au moins les plus gros problèmes.
A cet égard, nous avons également fortement renforcé nos propres contrôles, ce qui permet de pouvoir exclure l'arrivée au port de certains navires « à risques ».
La question des doubles coques et du non-accord avec les normes MARPOL actuellement en vigueur suscite une grande polémique, non pas seulement avec l'OMI, mais aussi avec certains Etats membres qui veulent s'en remettre à l'OMI. Cette position aurait été envisageable s'il n'y avait pas déjà eu cette décision unilatérale américaine qui affecte plus de 25 % du trafic pétrolier.
M. le Président : Sur ce désaccord avec certains Etats membres, de quelle manière pensez-vous surmonter les réticences ?
Mme Loyola de PALACIO : En les mettant face à leurs opinions publiques. Lors des séances du Conseil, je ferai état de la situation et j'expliquerai que tel Etat ne veut pas de cela, et est prêt à ce qu'un bateau rejeté par les Etats-Unis vienne s'échouer devant nos côtes en déposant divers matériaux polluants, causant ainsi la ruine de l'environnement.
Les opinions publiques sont extrêmement sensibles sur ce sujet : pas seulement en France, mais aussi en Espagne, au Portugal, en Grande-Bretagne, en Italie, dans tous les pays côtiers.
J'aime beaucoup la Bretagne que je connais bien, mais imaginez que l'accident de l'Erika se produise en mer Méditerranée ! Cela aurait été plus affreux encore. Or, il faut savoir qu'il y a 5 sisterships de l'Erika qui circulent dans ces zones.
Selon moi, c'est une question politique majeure. L'opinion publique en a assez ; de plus, le coût des investissements dans ces mesures de sécurité et la substitution des bateaux ne renchérirait que de quelques centimes le prix du transport des produits pétroliers et celui des produits eux-mêmes.
Certes, si cela oblige les armateurs à faire des investissements supplémentaires, les prix du transport des carburants risquent de monter. Cependant, l'augmentation des prix n'aurait qu'une incidence minime, alors que la diminution des risques serait considérable.
Le plus simple serait donc de confronter les pays qui ne sont pas disposés à évoluer dans ce sens avec leurs opinions publiques.
M. le Rapporteur : Sur les autres projets de directives - sociétés de classification, contrôle de l'Etat du port -, pensez-vous pouvoir parvenir à un accord à l'unanimité ?
Mme Loyola de PALACIO : Je suis optimiste quant au projet de directive sur le contrôle de l'Etat du port ; toutefois, le manque d'effectifs posera problème.
Il faudra compléter tout cela. Nous devrons rechercher la possibilité d'agir plus rapidement pour des bateaux sous-normes, abandonnés et qui encombrent les ports, ou qui, ancrés dans la rade, finissent par couler. Parfois, cela prend 5 à 6 ans pour en venir à bout. Il faudrait donc chercher des systèmes plus rapides. C'est ce que nous étudions avec les Etats membres et mon collègue Vitorino en charge des questions de Justice et Affaires intérieures.
Quant au second paquet, l'information en est l'élément clé. Des obligations d'information qui n'existaient pas jusqu'à présent sont imposées aux sociétés de classification : elles doivent, dès qu'il y a changement de société de classification, communiquer toutes les données en leur possession à la nouvelle société exploitante.
Il faut aussi renforcer les systèmes d'échange de l'information sur les résultats des enquêtes et des inspections effectuées par les autorités du port. Il faut également envisager les possibilités d'information avant l'entrée au port. Il y a d'ailleurs des propositions en ce sens de la part de la France. Généralement, les agents maritimes ont connaissance de l'arrivée d'un bateau avec plusieurs jours d'avance. Cette information devrait pouvoir être communiquée aux autorités du port qui pourraient ainsi décider, en fonction des informations, d'accepter ou non le bateau dans le port.
Il faut donc renforcer ce genre d'information, non pas seulement l'échange d'informations sur les inspections, sur la situation, mais aussi l'information préalable sur la progression géographique du bateau. Nous devons examiner plus avant cette aspect où subsistent certaines difficultés.
De même, une proposition concernant le repérage des bateaux à risques a été arrêtée au Conseil. Il faudra mettre cela en place en prévoyant un critère supplémentaire sur l'aide et le contrôle à la navigation. Dans certains endroits, comme en Manche, il y a des dispositifs spécifiques mais ils s'avèrent insuffisants.
Sans vouloir transposer dans le domaine maritime les mesures drastiques prises en matière de sécurité aérienne, il nous faut imposer certaines obligations, d'autant que les équipements sont très bon marché, pour éviter tout risque dans ces zones très encombrées.
M. le Rapporteur : Vous voulez parler des transpondeurs ?
Mme Loyola de PALACIO : Exactement. J'en ai parlé avec le secrétaire général de l'OMI, M. O'Neil. Il est d'accord.
M. le Rapporteur : S'agissant du deuxième paquet, quand en voyez-vous l'adoption ? Pour la fin de l'année ?
Mme Loyola de PALACIO : Non, seule la présentation peut être envisagée pour la fin de l'année. Nous touchons là à des sujets encore plus complexes, qui appellent un charpentage juridique très élaboré : c'est pourquoi ils ne pourront voir le jour que dans un deuxième temps. Cela dit nous comptons pouvoir le présenter avant la fin de l'année. L'approbation viendra dans le courant de l'année 2001.
C'est un point sur lequel on pourrait aller de l'avant avec l'OMI. Ce serait parfait.
Il y a aussi la perspective d'une agence européenne de sécurité qui ferait le contrôle des contrôleurs. Nous ne pouvons pas aller plus loin, comme par exemple penser à un corps de sauvetage. Pour le contrôle des contrôleurs, nous examinons jusqu'où nous pouvons aller.
La question est de savoir si l'on ne risque pas de multiplier les agences européennes, ce qui poserait problème. Cela étant, on pourrait augmenter la collaboration entre Etats membres, collaboration qui a assez bien fonctionné s'agissant de l'Erika. Nous examinons la question ; la décision n'est pas encore arrêtée en la matière.
Quant aux responsabilités, nous essayons d'agir à deux niveaux : au sein de l'OMI et au niveau régional. Nous pensons qu'il faut élever les plafonds de responsabilité, non seulement des armateurs mais aussi du FIPOL. Aux Etats-Unis, ils arrivent au milliard de dollars, alors que nous n'en sommes qu'à 180 millions. Cela fait une différence importante.
En outre, il faut prendre en compte la responsabilité de l'acheteur qui n'achète qu'après l'arrivée de la cargaison au port. Nous réfléchissons donc à la manière d'impliquer les destinataires de la cargaison, même si cela pose des problèmes juridiques importants, sinon les grandes compagnies mettront des intermédiaires. Les destinataires de la cargaison sont ceux qui, la plupart du temps, ou bien font directement le contrat des bateaux, ou bien en fixent les conditions.
C'est un sujet très complexe au plan juridique.
Pendant ce temps, nous préparons un accord par anticipation avec les compagnies pétrolières. Pour ma part, je n'y crois guère. Nous avons proposé d'aller de l'avant avec un accord de ce genre à la compagnie pétrolière responsable du désastre de l'Erika. Il n'y a pas eu le moindre signe, non pas d'enthousiasme, mais d'intérêt.
M. le Rapporteur : Vous avez proposé cet accord intérimaire, non pas seulement sur la responsabilité de l'acheteur, mais sur l'ensemble du dispositif du second paquet ?
Mme Loyola de PALACIO : Oui, mais j'ai le sentiment que cet accord ne verra pas le jour. Donc, il restera à mieux cibler les responsabilités et à augmenter les seuils de responsabilité si c'est juridiquement possible. Comme il est très difficile d'établir l'identité du destinataire, il faudra faire porter les responsabilités sur ceux qui sont clairement déterminés, c'est-à-dire les armateurs, les compagnies pétrolières, etc.
M. le Président : L'une des conclusions de notre voyage aux Etats-Unis a été celle-là, en tout cas pour moi. Cette responsabilisation accrue pèse sur les armateurs. C'est un facteur de nettoyage de ceux qui ne sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas les bateaux en bon état, de trouver les compagnies d'assurance agréées.
C'est un système qui n'est peut-être pas transposable totalement en Europe, mais qui a le mérite de faire du nettoyage. Sinon, même en s'attaquant aux compagnies pétrolières, il y a toujours le risque de se retrouver avec des Erika camouflés. Il faudra que les Erika camouflés paient ou que l'assurance qui a accepté de couvrir paie.
A défaut d'aller vers cette pénalisation du destinataire réel - c'est-à-dire Total qui vend à Total, éventuellement au travers de X -, il y a probablement à accentuer la responsabilisation financière...
Mme Loyola de Palacio : ... de l'armateur !
M. le Président : Oui.
Faut-il dire responsabilité illimitée ? C'est le cas aux Etats-Unis. Si l'on s'inspire des Etats-Unis pour un certain nombre de mesures comme la suppression des bateaux à simple coque, pourquoi pas après tout !
M. le Rapporteur : Nous aimerions avoir des précisions sur le déroulement politique de vos propositions, qui nous paraissent très intéressantes. Dans la discussion avec l'OMI, avez-vous aussi annoncé le second paquet ? Comment est perçue votre détermination à aller jusqu'au bout d'un dispositif strictement européen ?
Mme Loyola de PALACIO : Avec raison, l'OMI n'aimerait pas voir surgir des dispositifs régionaux qui affaibliraient sa position. Je crois que nous pouvons aussi avancer avec l'OMI. L'Europe ne devrait pas rompre là où il y a des réglementations internationales et faire cavalier seul. En revanche, là où certains ont déjà pris de telles mesures, face par exemple à une situation comme celle des doubles coques, je ne vois pas pourquoi l'Europe ne prendrait pas les mêmes garanties que d'autres. Mon approche est celle-là.
M. le Rapporteur : Concernant la première et la seconde directive sur les sociétés de classification et le renforcement du contrôle de l'Etat du port, la liste noire, vous proposez que l'Europe prenne des mesures unilatérales ?
Mme Loyola de PALACIO : Oui, parce que le contrôle de l'Etat du port entre dans nos compétences. Pour les sociétés de classification aussi parce que l'OMI est tout à fait d'accord. Dans ce domaine d'ailleurs, ce que nous allons faire, c'est rendre les exigences de l'OMI plus contraignantes. De même que l'OMI est tout à fait favorable à un certain contrôle maritime dans certaines zones de fort trafic. Mais il faut aller au-delà et mettre cela en place dans toute la zone économique exclusive.
M. le Président : Au moins en Manche et en Mer du Nord.
M. le Rapporteur : Nous sommes allés deux fois en Méditerranée. Comme vous l'avez dit, un drame de ce type en Méditerranée aurait des conséquences épouvantables. Il y a peu d'accords internationaux, guère de moyens. Pensez-vous opportun d'établir un dispositif spécifique pour la Méditerranée et de relancer l'idée de la zone économique exclusive sur cette mer ?
Mme Loyola de PALACIO : C'est un sujet délicat politiquement, mais en tant que ministre de la pêche, j'avais proposé en Espagne d'étendre la zone de protection de pêche jusqu'aux médianes. Le risque portait sur les zones de reproduction du thon rouge et de certaines autres espèces en difficulté en Méditerranée. L'Espagne a prolongé sa zone de protection de pêche jusqu'à la médiane où l'on applique les lois communautaires pour la pêche. Je ne suis plus en charge de ce ministère, mais j'ai entendu dire que l'Italie comptait faire la même chose, peut-être même l'a-t-elle déjà fait. J'imagine que la France le ferait également.
La protection de la Méditerranée est très importante. Si l'on prend la carte de la Méditerranée, on voit que le problème vient de la délimitation complexe des zones entre la Grèce et la Turquie, la Libye, l'Espagne et le Maroc.
L'idéal serait que tous les pays riverains de la Méditerranée prennent au sérieux le problème de la Méditerranée et acceptent des limitations pour permettre la survie de cette mer. Sans cela, la Méditerranée connaîtra de fortes difficultés dans l'avenir ; la situation y est très fragile.
J'ai établi la zone de protection de pêche hors des zones de difficulté de définition avec le Maroc et la Tunisie. Je l'ai fait avec la France et l'Italie. Evidemment, il n'y avait pas de difficulté majeure sur ce point, même si cela donnait lieu à discussion.
Tout cela pour vous dire que, en Méditerranée, l'instauration de la zone des 200 milles est délicate. L'idéal serait de pouvoir pousser la conférence de la Méditerranée à prendre des décisions à ce sujet. J'ai rencontré les responsables du ministère turc des affaires étrangères. Ils sont très inquiets à cause du passage du Bosphore où se produisent très souvent des accidents. C'est un détroit et le droit de passage innocent doit y être garanti. Une chose est le droit de passage innocent, une autre chose est la sûreté du passage. Nous devons être capables de combiner les deux, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
La sensibilité est grande après la grande tragédie en mer de Marmara. Il faudrait une action de la part de l'Union avec les pays riverains, non seulement l'ex-Yougoslavie, mais aussi les pays riverains du sud. Etendre à 200 milles sera très difficile, compte tenu du problème spécifique à la Méditerranée. Je serais plutôt favorable à un accord plus global, mais entre-temps, dans certaines zones, comme le golfe entre l'Italie, la France et l'Espagne, on pourrait envisager des mesures plus concrètes. Il me paraît difficile d'aller plus loin.
M. le Rapporteur : L'offensive que vous menez sur l'ensemble de ces points va-t-elle vous conduire à une situation conflictuelle avec l'OMI ou êtes-vous en situation de « gentlemen's agreement » ? Si ce dispositif est adopté dans un premier temps à la fin de l'année et le second paquet plus tard, va-t-on vers des relations froides avec l'OMI ou la politique que vous menez est-elle bien acceptée ?
Mme Loyola de PALACIO : J'espère que les 15 pays de l'Union vont agir à l'OMI et que la France présentera aussitôt que possible ses propositions. Comme M. O'Neil l'a dit, c'est l'une des questions les plus importantes : il faut que la France ou un autre Etat membre présente le paquet européen. Cela peut être le Portugal en tant qu'actuel président, ou la France. Si la France a des propositions différentes, elle peut les formuler avec le Portugal ces jours-ci. Il faut articuler la présentation concrète de notre paquet au sein de l'OMI pour que l'organisation puisse s'en saisir et en discuter. D'ailleurs, M. O'Neil est prêt à le faire.
J'ai ressenti une attitude de collaboration de sa part et de la part de l'OMI. Je crois qu'il faut essayer d'obtenir des résultats au sein de l'OMI. L'Europe ne doit pas faire cavalier seul, sans l'OMI, sauf là où d'autres l'ont déjà fait. Ce n'est pas nous qui rompons l'accord OMI, mais d'autres qui l'ont déjà brisé et nous avons dû suivre dans le même sens.
L'Europe ne devrait jamais rompre les accords de l'OMI, mais la vision est différente si ces accords ont déjà été brisés par une grande région. Dans ce cas, nous aussi, nous pouvons nous considérer comme libérés pour pouvoir exiger au moins les mêmes choses que celles que l'autre région a exigées. C'est mon approche.
M. le Président : Confirmez-vous que l'acquis européen en matière de sécurité maritime est valable pour les nouveaux entrants et pas uniquement pour Malte et Chypre ?
Mme Loyola de PALACIO : Pour la Roumanie, la Pologne, les Pays baltes, tout le monde. Il n'y a pas d'exception.
M. le Président : Pour les pays qui sont déjà dans l'Union ?
Mme Loyola de PALACIO : Les pays de l'Union doivent appliquer les normes. En général, nous n'avons pas de problèmes avec les pays de l'Union. Ils peuvent avoir du capital ailleurs sous forme de « pavillons de complaisance ». Des Européens sont propriétaires de bateaux sous pavillons panaméen, libérien, singapourien, etc... Les bateaux qui battent pavillon de l'Union ne posent pas de problèmes.
M. le Président : Et la relance d'un pavillon européen ?
Mme Loyola de PALACIO : C'est un sujet très complexe sur lequel nous travaillons. Le problème ne réside pas dans le pavillon européen, mais dans tout le système de coûts, d'impôts, de dumping social que l'on nous fait de-ci, de-là. Nous avons une situation où nous avons libéralisé complètement les échanges, sauf le cabotage national, le cabotage européen est lui aussi libéralisé.
Il y a d'autres questions sur lesquelles nous sommes en train de nous pencher, mais ce sont des sujets très difficiles, du fait que des mesures très fortes de libéralisation sont intervenues il y a une huitaine d'années.
Je vous remercie.
Audition de M. Alessandro BARISICH,
chef de l'unité chargée de la protection civile à la direction générale Environnement de la Commission européenne,
accompagné de MM. Guido FERRARO et Gilles VINCENT,
M. Bruno JULIEN,
chef de l'unité chargée de la protection de la nature
et M. Helmut BLOECH, chef de l'unité chargée de la protection de l'eau
(extrait du procès-verbal de la séance du 8 juin 2000 à Bruxelles)
Présidence de M. Daniel PAUL, Président
M. Alessandro BARISICH : En tant que responsable de l'unité de protection civile à la DG environnement, j'ai dans mes attributions toutes les situations d'urgence environnementales, technologiques et naturelles, dont les pollutions marines accidentelles.
M. Bruno JULIEN : Chef de l'unité chargée de la protection de la nature, j'ai en particulier effectué une mission avec Mme Wallström à Quiberon pour étudier sur place les effets de l'accident.
M. Gilles VINCENT : Je travaille avec M. Barisich et je suis plus particulièrement chargé du dossier concernant la coopération communautaire en matière de pollution marine accidentelle et opérationnelle.
M. Guido FERRARO : Je travaille avec Gilles Vincent sur la pollution marine.
M. Helmut BLOECH : Je suis chef de secteur à l'unité de protection de l'eau.
M. Alessandro BARISICH : Nous allons vous proposer une présentation de l'action de l'Union européenne dans ce domaine à l'aide de quelques transparents.
Je commence toujours cette présentation par une citation : « Il est probable que quelque chose d'improbable advienne » (Aristote). Ce n'est pas le résultat d'une analyse complexe d'évaluation des risques, mais le fruit de la pensée.
Quelle est la situation en matière de déversements dans les eaux européennes ?
Commençons par les petits déversements opérationnels de moins de 10 tonnes. En 1998, nous en avons observé 450 en mer Baltique et 800 en Mer du nord. Nous n'avons pas de chiffres pour la Méditerranée, alors qu'elle représente 0,7 % de la superficie des mers du globe et plus de 25 % du trafic pétrolier ! Si l'on pense au trafic captif en Méditerranée, aux terminaux, aux ports en Italie, en France, en Espagne, on pourrait un jour faire le constat que les déversements opérationnels en Méditerranée sont très élevés.
En tout cas, nous en avons plusieurs tous les jours au niveau de l'Union.
Les déversements qui varient entre 10 et 700 tonnes sont les plus insidieux, car ils n'ont pas l'air très important, mais ils peuvent créer des dégâts très importants au plan économique et écologique. Rappelez-vous le petit déversement sur la façade atlantique à la mi-août l'an dernier : deux départements ont dû interdire la baignade. Ces déversements sans être des catastrophes écologiques, peuvent faire beaucoup de mal à la nature, à l'économie et au tourisme.
Pour les déversements supérieurs à 700 tonnes, nous en avons eu 8 au cours des dix dernières années. Cette évolution ne correspond pas à l'évolution mondiale. Dans les années 70, il s'en produisait 25 par an en moyenne ; dans les années 80, une dizaine et dans les années 90, 3 ou 4. Il n'en demeure pas moins que, dans les années 90, nous avons connu dans l'Union le Haven à Gênes, l'Aegean Sea à La Coruna, le Braer dans les Shetland, le Sea Empress au Pays de Galles, maintenant L'Erika.
M. le Président : Les petits déversements dont vous aviez parlé concernent les déversements opérationnels. Pour les quantités supérieures, c'est accidentel. Les chiffres de 450 et 800 par jour en 1998 concernent bien les dégazages et déballastages observés !
M. le Rapporteur : A-t-on des chiffres pour la Méditerranée ?
M. Alessandro BARISICH : On a des estimations de 600 000 tonnes par an. Cela me semble excessif. C'est en tout cas le chiffre fourni par la convention de Barcelone, le PAM à Athènes et le REMPEC à Malte. Mais, c'est certainement important.
M. le Président : Même si c'est deux fois moins.
M. Jean-Michel MARCHAND : Le chiffre qui nous a été donné est de 800 000 tonnes.
M. le Président : Cela représente, chaque année dix Erika.
M. Alessandro BARISICH : En tout cas, c'est certainement énorme.
A la suite de l'Amoco-Cadiz, une résolution du Conseil a créé, en 1978, un plan communautaire d'action dans le cadre duquel nous avons mis en place un système d'informations, un programme de formation et d'échanges pour les spécialistes de la pollution accidentelle - qui est maintenant opérationnel - et un programme de projets pilotes.
En 1985, nous avons créé une task-force communautaire.
Un comité consultatif formé d'experts des Etats membres nous aide à en maintenir la cohérence parce que Bruxelles est très loin du terrain. Il nous faut donc des courroies de transmission pour bien calibrer et ajuster notre action.
Dans le système communautaire d'informations figurent tous les éléments sur les moyens de lutte : leur nature, leur localisation, leur disponibilité. Il a d'ailleurs été utilisé dans le cadre de L'Erika.
Dans le cadre du programme de formation et d'échanges, nous organisons des sessions au niveau stratégique pour les responsables de haut niveau. Pour les opérationnels, la formation se fait au niveau régional en vertu du principe de subsidiarité ; il n'est pas nécessaire d'intervenir au niveau communautaire pour avoir les cours de base.
Dans le programme de projets pilotes et d'analyse, nous avons financé des actions visant à améliorer les techniques et les approches de la lutte contre les pollutions accidentelles.
Mise en place à la suite de l'accident du Patmos dans le sud de l'Italie, la task-force rassemble les compétences et les systèmes d'expertise existant dans les divers Etats membres. Nous pouvons la mobiliser 24 heures sur 24 pour la mettre à disposition des autorités qui doivent faire face à une pollution majeure. Nous l'avons utilisée dans le cadre de L'Erika .
Sur les interventions de la task-force, vous avez les grands accidents pétroliers survenus dans l'Union à deux exceptions près : les déversements sur les côtes saoudiennes consécutifs à la guerre du Golfe - la communauté internationale s'était mobilisée et nous avons fourni l'expertise au gouvernement saoudien pendant 7 mois - et la pollution par les hydrocarbures dans le nord de la Russie où un pipe-line avait créé une situation impossible. Il s'agissait de même type d'expertise.
Aujourd'hui, il y a L'Erika. Comment cela s'est-il passé ? Pour compléter la vision de l'action communautaire, tout ce que nous avons fait sur la base d'une résolution du Conseil et de certaines de ses décisions et de celles de la Commission sera consolidé dans une nouvelle codécision Parlement / Conseil qui crée un nouveau cadre communautaire de coopération pour les années 2000-2006 et dont l'objectif est de soutenir ce que les Etats membres font dans le domaine de la lutte contre la pollution accidentelle, mais également de créer les conditions pour une assistance mutuelle efficace.
Les mers de la Communauté sont couvertes par une série d'accords opérationnels. Les plus importants sont :
· l'accord de Bonn, ayant pour parties contractantes tous les Etats riverains de la Mer du nord et la Communauté européenne.
la convention d'Helsinki qui couvre la Mer Baltique, regroupe tous les pays riverains et la Communauté européenne.
· la convention de Barcelone qui est le fait de tous les pays riverains de la Méditerranée et de la Communauté européenne.
· l'accord de Lisbonne, qui est un accord moins connu, bien qu'il couvre la zone de L'Erika. Signé en 1990, il n'est toujours pas ratifié. Il comprend la France, l'Espagne, le Maroc, le Portugal et la Communauté européenne.
La Communauté européenne est la seule entité qui soit partie contractante à l'ensemble de ces accords. Lui revient donc le devoir absolu d'_uvrer de manière à éviter des démarches contradictoires et d'éviter les doubles emplois, les doubles saisies de données. Notre position privilégiée nous oblige à jouer un rôle moteur pour essayer de faire avancer tous ces accords dans la même direction et dans une logique aussi commune que possible.
Les accords sont différents : la Baltique avec la Russie, la Pologne et les pays baltes sont différents de la Méditerranée avec le Maghreb, et de la Mer du Nord. Mais globalement, nous essayons de faire en sorte que tout ceci avance de manière cohérente.
Dans le cadre de L'Erika, j'ai rencontré l'amiral Naquet-Radiguet à Brest deux ou trois jours après l'accident en raison des nécessités de coordination immédiate avec les navires allemands et néerlandais. Un officier de liaison, chef des opérations en Allemagne a été détaché pour maintenir la liaison entre la préfecture maritime et les bateaux allemands et néerlandais.
A la demande du ministère de l'environnement français, nous avons recherché des barrières flottantes car on pensait pouvoir faire barrage efficacement avec ces instruments. En quelques heures, nous disposions de 26 kilomètres de barrières flottantes.
On a ensuite recherché des équipes de nettoyage pour soigner les oiseaux atteints en grand nombre.
Par la suite, M. Vincent s'est rendu sur place deux fois auprès de la préfecture terrestre, puis avec une mission de retour d'expérience communautaire. Tous les Etats membres se sont intéressés à cet accident, tant il est rare d'avoir ce type de polluant dans une zone où les conditions météo étaient aussi dures. Ils souhaitaient vraiment tirer un maximum d'enseignements dans les plus brefs délais.
M. Gilles VINCENT : Les experts ont contribué à l'examen des offres reçues par les autorités françaises à travers le CEDRE pour toutes sortes de services, dont la dépollution. Pour permettre de donner à cette analyse des offres une dimension européenne, nous avons mobilisé trois experts qui ont passés une semaine à Brest.
Nous avons informé les autres Etats membres concernés à partir des informations reçues des préfectures maritime et terrestre, pour qu'ils soient en stand-by pendant la durée des opérations et nous continuons de le faire.
M. Alessandro BARISICH : Notre contribution a, bien sûr, été limité. Nous ne sommes jamais en première ligne, mais nous essayons d'aider nos collègues à faire face à des situations extrêmes. Une pollution marine comme celle de L'Erika est une crise à multiples facettes qu'il est extrêmement difficile de gérer.
Vous avez rencontré Mme de Palacio. Vous savez donc tout sur la compensation et les trois couches (200 millions, 300 millions, 1 milliard.)
Nous avons préparé un schéma à l'échelle qui rend bien compte du saut qualitatif. Le point d'interrogation représente le niveau auquel va se situer le coût global.
M. le Rapporteur : A combien l'estimez-vous ?
M. Alessandro BARISICH : Je ne l'estime pas. On a senti, avec tout ce qui a été dit au cours des derniers jours, que l'élément crucial pour le coût sera l'évolution du tourisme.
M. le Président : Les chiffres sont contradictoires.
M. Bruno JULIEN : Sur l'aspect protection de la nature, peu de choses ont été faites pour le moment. On sait à peu près le nombre d'oiseaux touchés. Notre action est plutôt curative que préventive. Nous souhaiterions pouvoir aider à mesurer les effets précis de la catastrophe sur la biodiversité. Nous sommes entre les mains du gouvernement puisque l'Observatoire associatif créé à la suite de la catastrophe doit imaginer les types d'études qui devraient être faites. Nous avons annoncé notre volonté de participer, au niveau de 300 000 euros, aux études d'impact.
D'autre part, nous sommes prêts à mettre en place une meilleure coordination entre Etats membres pour le nettoyage des oiseaux lors de prochaines catastrophes. Mais nous n'avons reçu aucune proposition. C'est le ministère de l'environnement, direction de la protection de la nature, qui doit cordonner tout cela.
L'un des soucis importants des élus locaux était de donner une bonne image de la région. Or, j'ai été frappé d'entendre hier juste avant la saison touristique des déclarations très alarmistes qui vont dans le sens contraire.
M. le Rapporteur : Nous pensons que c'est la direction de la santé qui paiera l'ensemble des coûts de la pollution par l'intermédiaire des ondes !
Cela étant dit, nous sommes intéressés par les chiffres des pollutions accidentelles et non accidentelles en Europe en dehors de la Baltique.
M. Alessandro BARISICH : Au niveau mondial, nous pouvons vous fournir les séries longues des gros accidents ; les observations sur la Mer du nord et sur la mer Baltique au cours des dernières années qui montrent aussi que les dégazages augmentent.
Cela étant, nous n'avons pas d'information sur les déversements opérationnels en dehors de l'Union. Pour la Méditerranée, l'estimation des déversements opérationnels sera, comme vous le savez, une approximation.
M. Gilles VINCENT : Les chiffres dont nous disposons sont ceux sur les déversements observés. Il n'est pas possible de distinguer l'opérationnel du non opérationnel, quoique l'accord de Bonn prévoie de recueillir les chiffres sur les déversements opérationnels observés pour lesquels un élément de preuve a pu être utilisé pour permettre des suites juridiques.
M. Alessandro BARISICH : La plupart des déversements sont délibérés et proviennent de toutes sortes de bateaux : plaisanciers, pétroliers, les bateaux de pêche ; en tout cas rien de bon pour la mer.
M. le Rapporteur : Mes questions porteront sur l'événement lui-même et sur la collaboration avec les autorités françaises. Je retiens ce que vous avez dit sur les moyens mis à disposition. Quels étaient vos interlocuteurs ?
M. Alessandro BARISICH : Pendant la lutte en mer, c'étaient l'amiral Naquet-Radiguet et ses collaborateurs. Dès que la pollution est arrivée à terre, c'était le préfet de région délégué à la sécurité.
M. le Rapporteur : Votre collaboration en mer consistait à faire l'interface entre le préfet maritime et les autres pays de l'Union pour l'obtention de moyens techniques supplémentaires.
M. Alessandro BARISICH : Un peu moins en ce qui concerne les aspects opérationnels. C'est en réalité le préfet maritime qui gérait l'ensemble de la situation. Nous l'avons aidé à faire en sorte que le Neuwerk parte le plus rapidement possible. Nous avons fourni un officier de liaison, mais le patron était l'amiral. Nous étions là pour essayer de lui apporter l'aide des autres Etats membres dans la limite de nos moyens.
M. le Rapporteur : L'apport de bateaux supplémentaires passait-il par votre intermédiaire ?
M. Alessandro BARISICH : Pas vraiment. Il y a des implications financières énormes. Nous avons facilité les départs rapides. Mais la prise de décision relevait de la responsabilité de l'amiral comme c'est toujours le cas.
M. Gilles VINCENT : Il faut se rappeler, comme l'a dit M. Barisich, que les informations sur les moyens disponibles dans les autres pays figurent déjà dans le système communautaire d'information ou dans l'équivalent au niveau des accords régionaux. Ces informations étaient à la disposition des autorités françaises.
M. Alessandro BARISICH : Cela a été beaucoup plus clair pour la recherche de barrages, d'équipements et pour le nettoyage des oiseaux. Le Gouvernement français s'adressait directement à nous et nous avons répercuté et recherché les éléments.
M. le Rapporteur : C'est vous qui avez coordonné la venue des éléments pour la partie terrestre.
M. Alessandro BARISICH : Tout à fait ! Cela aurait pu être pareil pour la partie maritime. Notre système est conçu pour ne pas être centralisé. Le passage par Bruxelles ne doit pas être obligatoire car cela nuirait à son efficacité.
Dans l'urgence, les contacts ont été pris directement entre la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Nous sommes ensuite venus en support pour obtenir plus rapidement des décisions. Mais le système est voulu ainsi : il n'est pas nécessaire de passer par un point bureaucratique à Bruxelles. Nous sommes et nous resterons toujours des bureaucrates. Même si nous avons une capacité relativement opérationnelle, nous ne faisons pas partie du processus de prise de décision.
M. le Rapporteur : A l'exception de la communication évoquée tout à l'heure, avez-vous eu avec les autorités françaises des difficultés techniques de fonctionnement ? Estimez-vous après cette expérience qu'il faut modifier certaines dispositions ?
M. Alessandro BARISICH : Nous estimons qu'il faut en modifier un certain nombre. A cet égard, je quitterai momentanément le domaine de la pollution accidentelle pour en venir à la protection civile.
La semaine dernière, la Commission a décidé qu'elle allait proposer au Conseil la mise en place d'un mécanisme de coordination des interventions en cas de catastrophe majeure de toute nature, y compris les pollutions marines.
L'expérience de L'Erika, celle des tempêtes, en même temps que l'accident sur le Danube, Enschede aux Pays-Bas ou les tremblements de terre en Turquie ou en Grèce ont toujours fait apparaître un manque de coordination dans les premiers jours, les premières heures.
Notre ambition est de mettre en place un système d'information mutuelle précoce entre Etats membres.
Le type d'accident qui nous préoccupe survient environ tous les 10 ans dans un Etat membre. A chaque fois, la difficulté vient de ce que les hommes qui ont l'expérience et la culture de l'accident précédent ont changé.
Malheureusement, les organisations n'ont pas de mémoire. C'est un élément fondamental. Seuls les hommes ont de la mémoire. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans un disque dur, la mémoire reste biologique, humaine.
Chaque fois, on doit remettre en route un dispositif de coopération fondé sur des déclarations, sur des arrangements techniques ou administratifs. Cela prend les 48 ou 72 heures qui pourtant, sont souvent cruciales. C'est pourquoi, dans le cadre de la proposition que nous allons faire, nous allons introduire cet élément d'information réciproque immédiate entre les Etats membres. Ce serait une instruction qui pourrait se retrouver dans un plan POLMAR.
M. le Rapporteur : Ce serait un plan POLMAR européen.
M. Gilles VINCENT : Ce serait destiné à mettre en alerte une plate-forme de moyens disponibles au niveau européen, si nécessaire. Mais la mise en alerte doit être la plus rapide possible.
M. Bruno JULIEN : Lors de l'accident, j'étais en France tout à fait par hasard. J'ai fait part de mon inquiétude, mais il ne me semble pas que l'importance de la catastrophe ait été perçue immédiatement.
L'offre verbale d'assistance, qui ne pouvait pas être très importante de la part de l'Union européenne, n'avait pas été perçue immédiatement. Je n'ai pas eu non plus de communication directe avec les autorités françaises. Or, en matière de protection de la nature, il n'y a pas d'obligation des Etats membres de consulter la Commission, mais il y a des directives (la directive habitat, la directive oiseaux). Il eût donc été naturel qu'il y ait un échange immédiat.
Il y a une perception inférieure que je ne critique pas, car les gens ont été confrontés à des choses qu'ils n'attendaient pas. Il faut en tirer les enseignements. Les moyens se sont mis en route trop tard ; ils n'ont pas été suffisamment ordonnés.
Ceci n'est pas dit dans un sens critique ; nous voudrions en tirer des enseignements. Nous voudrions mettre en place un système qui, dans un cas identique, puisse être opérationnel, que ce soit en Grèce, en Irlande ou n'importe où.
M. le Président : Cela va-t-il jusqu'à la recherche d'une régionalisation de ces moyens ?
Si l'on envoie les éléments de secours du Danemark, de la Norvège, d'Ecosse ou d'ailleurs vers la Méditerranée en cas de difficulté, le pétrole risque d'être sur les côtes avant que cela n'arrive !
S'agissant de l'information, la mise en commun de ces moyens existants ou à créer n'implique-t-elle pas la connaissance, chez les Etats membres, voire d'autres Etats, de la concentration de ces moyens au niveau de la Baltique, de la Mer du nord, de l'Océan atlantique, de la Manche et de la Méditerranée, de façon à répondre rapidement sans faire traverser des milliers de miles marins à des équipements qui n'arriveraient que trop tard ?
M. Alessandro BARISICH : La réponse est non aujourd'hui. Nous connaissons la localisation des moyens qui est un élément central du cadre communautaire de coopération dont on vient de parler. Cela ne va pas jusqu'à l'incitation à faire des pré-positionnements. Nous pensons que les Etats membres font déjà cela avec un esprit de clairvoyance.
En Italie, il y a 70 bateaux pour les interventions. Ces moyens sont plutôt de taille réduite, mais très bien répartis tout le long de la côte.
La société de Salvamento, société para-étatique espagnole qui assure les fonctions de secours, d'antipollution etc, a 12 remorqueurs de grande taille, plus d'autres moyens parfaitement répartis en fonction de l'analyse des risques tout le long des côtes espagnoles méditerranéennes et atlantiques.
En Grèce, nous avons les éléments pour évaluer la situation.
En France, vous avez un grand stock POLMAR près de Toulon. Vous avez également le centre qui appartient à TotalElf et qui est maintenant en liaison avec celui de Southampton.
Une chose est importante dans la stratégie de lutte : il faut tenir compte des moyens du secteur privé qui sont tous transportables par avion. Ils peuvent être mobilisés sans coût car il y a un préjugé favorable à leur mobilisation de la part des assurés.
La stratégie est complexe. A priori, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin dans l'incitation. Mais nous sommes prêts à changer d'avis.
Nous discuterons de tout cela lorsque sera mise en _uvre cette nouvelle décision du Parlement européen et du Conseil sur la coopération en matière de lutte contre les pollutions accidentelles.
M. le Rapporteur : Le communiqué concernant cette nouvelle décision est public. Pouvons-nous l'avoir ?
M. Gilles VINCENT : Le communiqué dont nous vous parlions concernait la capacité d'intervention. Il vous sera remis.
La codécision du Parlement et du Conseil sur le cadre de coopération en matière de pollution marine, liée mais indépendante de ce communiqué, est en seconde lecture au Parlement européen la semaine prochaine. Des textes sont déjà disponibles : la proposition de la commission, la position commune du Conseil après la première lecture. Nous espérons qu'elle sera adoptée rapidement. Cela couvre la période 2000-2006.
M. Alessandro BARISICH : Nous allons vous fournir tous ces textes, notamment la position commune.
M. le Rapporteur : Vous disiez qu'il fallait tirer les conséquences au plan organisationnel. Quelles autres conséquences tirez-vous ?
M. Alessandro BARISICH : Nous constatons que les techniques, dont nous disposons actuellement, montrent des limites. Dans la lutte en mer, les performances, les moyens dont nous disposons sont loin d'être d'un niveau élevé.
Il faut considérer que nous avions, dans le cadre de L'Erika, le scénario le plus mauvais que l'on puisse imaginer : la saison la plus défavorable, la mer la plus exposée avec le Finistère - les zones les plus exposées de l'Union avec l'Irlande du sud-, les polluants les plus polluants que l'on n'ait jamais eus dans tous les déversements connus dans les zones communautaires (le fioul numéro 2), et un lieu de l'accident éloigné de la côte.
Le fioul a eu le temps de se répandre et de frapper 400 kilomètres ; nous n'avons jamais vu de l'huile rester en mer pendant 13 jours. L'accident a eu lieu le 12 décembre et la première arrivée massive la veille de Noël. L'huile a eu le temps de se répartir et de maximiser les dégâts.
La discussion que nous allons ouvrir portera sur nos chances d'améliorer nos capacités de lutte en mer. C'est la première grande question à laquelle nous devons répondre. Nous sommes prêts à favoriser et à financer des projets pilotes, des actions, des échanges de vues sur ces questions.
Ensuite, nous essayerons d'améliorer la formation des hommes. Notre souci est d'essayer de garder partout la mémoire des événements. L'Europe a 44 000 kilomètres de côtes. Nous essayons donc d'améliorer notre système de formation au niveau stratégique pour être sûrs que nous ayons partout des hommes qui aient un minimum de sensibilité et qui soient au courant de ce qui se fait dans les autres pays. Cette culture devrait permettre au système de mieux réagir.
Voilà pour les premiers enseignements. Ensuite, il faudra vraiment aller très loin. L'Erika sera un laboratoire. L'effet « mille-feuilles », c'est-à-dire les couches alternées de pétrole et de sable, que nous avons eu sur les côtes atlantiques, était inconnu jusqu'alors, du moins dans cette ampleur. A certains endroits, on trouve du pétrole à un mètre de profondeur, 30 cm de sable, puis une autre couche de pétrole et à nouveau une couche de sable, etc.
Tout cela va demander un effort de réflexion pendant au moins deux ou trois ans. Les techniques devront prendre en compte les quantités de matière à remuer pour essayer de nettoyer autant que faire se peut ces couches d'huile. Nous n'avons jamais eu autant de bénévoles pendant aussi longtemps, même pas pour les camps de réfugiés au Kosovo ! De plus, il ne faut pas négliger les 2500 professionnels employés tous les jours.
M. le Rapporteur : Nous sommes très inquiets sur la situation en Méditerranée. Notre rapport ne porte pas seulement sur l'Erika, mais aussi sur l'ensemble des moyens et des dispositions à prendre pour la France. La convention de Barcelone vous paraît-elle opératoire en termes d'assistance mutuelle en cas de pollution ?
M. Alessandro BARISICH : Notre politique est depuis des années d'essayer de soutenir la convention de Barcelone et notamment le Rempec pour les gros incidents. Le directeur actuel du Rempec était dans notre unité il y a 2 ans encore. L'osmose va très loin.
Nous avons conseillé, poussé le Rempec à se doter d'un système de task-force comparable au nôtre, ce qu'il a fait. S'il pense que notre soutien lui est nécessaire, tout le dispositif que je vous ai décrit peut être déployé en Méditerranée, même à l'extérieur de l'Union. Notre task-force, de par la décision du Conseil, est mobilisable en soutien de la convention de Barcelone partout dans les Etats riverains du sud de la Méditerranée.
Un grand projet de protection civile existe, par ailleurs, en Méditerranée où il y a une petite activité en matière de pollutions accidentelles.
M. le Président : Quand nous sommes allés aux Etats-Unis, et même dans certains entretiens que nous avons eus en France, la question a été posée de la réparation des dégâts écologiques, avec évidemment en filigrane la difficulté de l'évaluation.
Comment fait-on ? On sait rembourser à une collectivité locale, le coût des salaires correspondant à la mobilisation des personnels. On sait payer les machines à filtrer le sable. Mais comment fait-on pour se faire rembourser ou créer un fond permettant de prendre en compte les dégâts ?
Nous avons reçu Mme Voynet il y a quelques jours. Elle nous disait que certaines prises en compte se feront à court, moyen et long termes. Pour le court terme, on peut probablement. Le moyen terme, c'est quoi ? Deux ans ? Trois ans ou dix ans ? Sans parler du long terme...
D'autant que nous voyons ce qui s'est passé avec l'Amoco-Cadiz il y a plus de 20 ans. Dans la région, on s'aperçoit que la mer a un pouvoir de nettoyage considérable. Heureusement ! Mais à long terme, les modifications qui se produisent, de quelle manière sait-on les apprécier ?
Ces questions sont importantes s'agissant de régions comme la Charente ou le Finistère. Nous sommes dans des zones riches, non pas uniquement par leur économie, mais par leur diversité environnementale.
M. Jean-Michel MARCHAND : Pour compléter cette interrogation, je prendrai l'exemple d'un écosystème spécifique, à savoir les marais salants de Guérande et de Noirmoutier. Comment gérer dans le moyen et le long terme ? Pour le court terme, c'est réglé. Les paludiers ont décidé de ne pas ouvrir cette année. Encore faudra-t-il les maintenir en situation de fonctionner, c'est-à-dire les maintenir en eau.
Quels moyens avez-vous pour accompagner cette action sur le moyen et le long terme ? Quelle expertise a-t-on de la qualité de référence de l'eau ?
M. Alessandro BARISICH : La notion de dommage environnemental est simple dans son principe, récente et nous devons tous y travailler dans les années à venir.
Notre direction générale a publié le Livre blanc sur la responsabilité environnementale où il est dit que le principe de la prise en compte du dommage environnemental doit être adopté.
Quelle est notre expérience ? Les premiers qui ont essayé de donner une valeur au dommage environnemental sont les Russes à l'époque de l'Union soviétique. Ils avaient élaboré une législation pour le déversement d'hydrocarbures : tant de PPM par m3, tant de m3 , tant de roubles. Voilà comment était évalué le dommage environnemental : un certain nombre de millions de roubles !
C'est une approche. Ce n'est pas une prise en compte du dommage environnemental, mais plutôt une amende. Nombreux sont ceux qui continuent en disant que faute de mieux, il faut faire comme cela.
M. Bruno JULIEN : En matière de biodiversité, on est loin encore de pouvoir chiffrer. Le chiffrage n'est cependant pas le problème car il ne servira pas à restaurer.
Il y a deux techniques envisageables : la restauration, et la compensation. On commence à avoir une certaine habitude avec la gestion du réseau Natura 2000 où ces principes figurent dans l'article 6 de la directive Natura 2000 qui prévoit soit la restauration soit la compensation avec une autre partie du territoire pour préserver ce patrimoine biologique. Nous devons travailler dans ce sens pour voir ce que nous pouvons faire.
On peut chiffrer un coût en matière de restauration. La compensation est également un élément intéressant. C'est l'Etat membre qui paie la compensation s'il a une responsabilité civile. On peut désigner un autre territoire identique, une nouvelle zone Natura 2000 avec certaines espèces d'habitats identiques. Le problème qui se pose est que ce n'est pas le responsable, mais l'Etat qui devra payer. S'il y a des coûts liés à Natura 2000, on peut envisager le principe de pollueur / payeur.
M. le Président : Ce dispositif a ses limites. Les zones Natura 2000 ne sont pas extensibles. On peut difficilement transposer les espèces de la Méditerranée en Mer du Nord.
M. Bruno JULIEN : Notre réflexion n'est pas à son terme. On bute rapidement.
M. Alessandro BARISICH : Vous avez très certainement rencontré M. Jacobsson, le directeur du fonds et dont vous connaissez la position qui est comparable à celle des assureurs. On ne prend pas en compte tout ce qui n'est pas chiffrable.
Cela dit, le 4 juillet aura lieu une première réunion pour examiner les éléments à prendre en compte si l'on se lance dans une révision de la compensation de la CLC et du fonds. En bon administrateur, M. Jacobsson a demandé à tous les Etats membres la liste des sujets à discuter. Il a reçu une liste de 20 suggestions : le dommage environnemental est le second point.
Manifestement, on y trouve la même démarche que dans Natura 2000, c'est-à-dire ce désir de trouver une manière d'estimer le dégât environnemental. C'est une démarche entamée par le fonds à 10 ou 15 ans. Les choses avancent.
Il y a quelques précédents. A l'époque de l'accident du Haven, le Gouvernement italien a fait une demande de remboursement pour le dommage environnemental qu'il avait estimé à un certain nombre de milliards de lires. Le fonds ne l'a pas accepté, mais une transaction est finalement intervenue.
En dépit du fait que le fonds ne prenne pas en compte les dommages environnementaux, l'Italie a obtenu un arbitrage parce qu'elle avait engagé un bras de fer. Ce n'est pas qu'on ait été très loin dans le sens souhaité par l'Italie, mais c'est malgré tout un début.
Mme Jacqueline LAZARD : Une réflexion a-t-elle été menée sur les craintes éventuelles au niveau de l'activité pêche ?
M. Alessandro BARISICH : Cela concerne nos collègues de la DG de la Pêche. En tant qu'ancien de la direction générale de la pêche, je sais qu'il y a certainement eu une intervention car notre politique commune de pêche prévoit des indemnités pour les pêcheurs. On peut demander à nos collègues. S'il y a des éléments, nous vous les fournirons.
M. Jean-Michel MARCHAND : J'ai cru comprendre que vous aviez en responsabilité la qualité des eaux. Quelle expertise a-t-on pour comparer les qualités d'eau proposées ?
Pour reprendre l'exemple significatif du marais salant, les normes proposées paraissaient inacceptables. On tolérait un pourcentage d'hydrocarbures dans les eaux alors que les paludiers ne veulent absolument pas que le moindre hydrocarbure pénètre dans ce marais. Y a-t-il des chiffres auxquels on puisse se référer ?
M. Helmut BLOECH : Oui. Une directive européenne concernant les eaux de baignade fixe des valeurs de qualité contraignantes, une obligation d'échantillonnage et d'analyse et la nécessité pour la Commission de publier un rapport annuel.
Concernant les huiles minérales, la directive est bien claire. Elle dispose qu'il ne doit y avoir ni film visible à la surface de l'eau ni odeur. Les valeurs doivent être conformes à 95 %, y compris les huiles minérales. Des dérogations sont prévues en cas de catastrophe naturelle, d'inondation et de conditions météorologiques exceptionnelles, mais pas en cas de pollution par l'huile.
En résumé, l'observation d'un film visible d'huile minérale doit être considérée comme révélatrice d'une qualité d'eau non conforme.
En ce moment, il n'y a pas une protection générale de toutes les eaux en Europe. Elle concerne seulement les eaux de baignade, les eaux conchylicoles et des eaux utilisées pour l'extraction de l'eau potable.
Cependant, le Parlement européen et le Conseil sont dans la dernière étape d'adoption et de conciliation pour une nouvelle directive cadre sur l'eau qui doit établir une protection pour toutes les eaux - les eaux côtières, les eaux douces, les eaux souterraines - et l'obligation d'atteindre ou de maintenir l'objectif d'une bonne qualité pour toutes les eaux. Mais c'est pour l'avenir.
M. Jean-Michel MARCHAND : Ces normes ne sont pas assez strictes. Il est impensable de tolérer la moindre irisation sur des eaux, quelle que soit l'utilisation.
Quand cela se produit dans le marais salant, ce sont des produits alimentaires que l'on retrouve en fin de chaîne avec ce fioul. Même les eaux de baignade présentent des risques certains pour la santé.
M. Helmut BLOECH : La directive eaux de baignade date des années 70 et nous sommes dans un processus de révision. Nous allons présenter l'année prochaine une proposition de nouvelle directive sur la base de toutes les données et expériences scientifiques applicables.
M. le Président : Il nous reste à vous remercier de nous avoir reçus. Nous tenions à vous rencontrer sachant que vous êtes à la charnière de certains dispositifs et de certaines études prospectives dont le dommage environnemental n'est que l'un des aspects.
Nous sommes à la fin de notre commission d'enquête et la rencontre de ce matin va nous permettre de valider un bon nombre des données déjà recueillies. Nous vous remercions.