N° 3055 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 mai 2001. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES(1) en conclusion et présenté par -- TOME I RAPPORT : 2ème Partie (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. (2) La composition de cette mission figure au verso de la présente page. Défense. La commission de la défense nationale et des forces armées est composée de : M. Paul Quilès, président ; MM. Didier Boulaud, Jean-Claude Sandrier, Michel Voisin, vice-présidents ; MM. Robert Gaïa, Pierre Lellouche, Mme Martine Lignières-Cassou, secrétaires ; MM. Jean-Marc Ayrault, Jacques Baumel, Jean-Louis Bernard, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Bernard Birsinger, Jacques Blanc, Loïc Bouvard, Jean-Pierre Braine, Philippe Briand, Jean Briane, Marcel Cabiddu, Antoine Carré, Bernard Cazeneuve, Guy-Michel Chauveau, Alain Clary, François Cornut-Gentille, Charles Cova, Michel Dasseux, Jean-Louis Debré, François Deluga, Claude Desbons, Philippe Douste-Blazy, Jean-Pierre Dupont, Christian Franqueville, Pierre Frogier, Yves Fromion, Yann Galut, René Galy-Dejean, Roland Garrigues, Henri de Gastines, Bernard Grasset, Jacques Heuclin, Elie Hoarau, François Hollande, Jean-Noël Kerdraon, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean-Yves Le Drian, Georges Lemoine, François Liberti, Jean-Pierre Marché, Franck Marlin, Jean Marsaudon, Christian Martin, Guy Menut, Gilbert Meyer, Michel Meylan, Jean Michel, Charles Miossec, Alain Moyne-Bressand, Arthur Paecht, Jean-Claude Perez, Robert Poujade, Mme Michèle Rivasi, MM. Michel Sainte-Marie, Bernard Seux, Guy Teissier, André Vauchez, Emile Vernaudon, Jean-Claude Viollet, Aloyse Warhouver, Pierre-André Wiltzer. La mission d'information sur les conditions d'engagement des militaires français ayant pu les exposer, au cours de la guerre du Golfe et des opérations conduites ultérieurement dans les Balkans, à des risques sanitaires spécifiques est composée de : M. Bernard Cazeneuve, président ; M. Charles Cova, vice-président ; Mme Michèle Rivasi, M. Claude Lanfranca, rapporteurs ; MM. Jean-Louis Bernard, Alain Clary, René Galy-Dejean, Guy Teissier, André Vauchez et Aloyse Warhouver. DEUXIÈME PARTIE : L'EXPOSITION DES FORCES FRANÇAISES À DES RISQUES SANITAIRES DIFFUS ET VARIÉS 75 I. - LES DÉCISIONS DE PRÉVENTION ET LES RISQUES DE LA PRÉVENTION 75 A. LES MULTI-VACCINATIONS 75 1. Une couverture vaccinale réglementaire au risque biologique naturel 75 2. La décision d'effectuer en urgence deux vaccinations complémentaires 77 a) La mission de l'Institut de médecine tropicale du Service de santé des Armées 77 b) Un réel effort de vaccination sur le terrain 78 3. Certaines restrictions d'immunisation résultant plus de contingences matérielles que sanitaires 80 4. Une piste intéressante pour l'explication des pathologies des anciens combattants de la guerre du Golfe 83 B. LES MESURES DE PROTECTION « NBC » 87 1. Une menace avérée 87 2. Les équipements et les procédures d'alerte NBC 88 a) Les matériels de détection, protection et décontamination en vigueur au sein des forces lors du conflit 88 b) Une préparation des militaires pas toujours suffisante 96 3. Les décisions médicales de protection et de mise en condition 98 a) La saga de la Pyridostigmine 98 b) L'utilisation d'une substance éveillante nouvelle 108 II. - UNE EXPOSITION À DES RISQUES NON MAÎTRISÉS LORS DE L'ENGAGEMENT 125 A. LES AGENTS CHIMIQUES 125 1. Des émissions consécutives aux bombardements des sites irakiens de production ou de stockage 126 a) Cinq détections de contrôle d'agents chimiques positives 126 b) La conséquence des bombardements alliés 130 2. La non utilisation de l'arsenal chimique irakien pendant le conflit 132 3. Les risques de contamination de la base d'As Salman 133 4. Les dangers afférents à la destruction, après le conflit, des munitions irakiennes rémanentes 134 B. LES POUSSIÈRES D'URANIUM APPAUVRI DE CERTAINES MUNITIONS EMPLOYÉES PAR LES TROUPES AMÉRICAINES 136 1. Un emploi sur le théâtre par les forces américaines et britanniques désormais établi 137 a) L'intérêt opérationnel des munitions à uranium appauvri 138 b) Une utilisation massive contre les blindés irakiens 140 2. Une exposition incontestable des unités de la Division Daguet 141 a) Des régiments au contact de cibles détruites par les avions A 10 142 b) Une absence manifeste de sensibilisation des soldats concernés aux dangers 144 3. Un véritable sujet de préoccupation 146 a) Les risques afférents à l'inhalation de poussières d'uranium appauvri 146 b) Les doutes persistants sur la composition isotopique des munitions employées 148 c) Des précautions prises dans le cadre de l'expérimentation qui n'ont rien à voir avec les conditions opérationnelles du Golfe 152 C. LES FUMÉES DES INCENDIES DE PUITS DE PÉTROLE 153 1. Un risque concernant surtout le Détachement Daguet de Koweït City 154 2. Une exposition aux effets mal établis mais potentiellement nuisibles 156 a) Le problème majeur des particules de suie 156 b) Les autres polluants 157 DEUXIÈME PARTIE : Ayant pour objet de mettre en lumière les conditions d'exposition des militaires français engagés dans l'opération Daguet, la mission d'information est tenue de s'interroger sur les facteurs de risque auxquels nos soldats se sont trouvés confrontés. Le cadre général de la guerre du Golfe, évoqué précédemment, a démontré que le conflit présentait des dangers potentiels bien réels. A la lecture minutieuse des documents qui lui ont été transmis, la mission d'information est en mesure de préciser la nature des risques encourus et les unités françaises plus particulièrement concernées. A des risques afférents à la prévention sanitaire et technique, se sont ajoutés les risques opérationnels qui, paradoxalement, pour être moins maîtrisables, n'en ont pas nécessairement été les plus certains. I. - LES DÉCISIONS DE PRÉVENTION ET LES RISQUES DE LA PRÉVENTION La prévention des risques est une nécessité opérationnelle que personne ne conteste. Pour autant, il semblerait que les modalités de cette prévention ne soient pas toujours sans conséquence potentiellement dommageable. 1. Une couverture vaccinale réglementaire au risque biologique naturel Les risques de nature biologique paraissent avoir été relativement connus du S.S.A., du moins pour ce qui concerne la situation épidémiologique de la Péninsule arabique. En revanche, l'exposition des forces à des agressions ennemies au travers d'armes capables de porter divers bactéries, toxines ou virus, relevaient plus de conjectures que de certitudes quant aux capacités de l'Irak. Dans la note pour l'Etat-major des Armées du 4 janvier 1991, le Médecin général inspecteur Bladé, Directeur central du S.S.A., exposait la situation en ces domaines. A la date de la rédaction de cette note, il mentionnait : « Pour l'instant, seul le risque biologique naturel a été pris en compte ». Deux types d'actions ont donc été conduites en conséquence : - d'une part, la mise à jour du calendrier vaccinal réglementaire ; - d'autre part, la pratique de deux vaccinations supplémentaires. La liste des vaccinations réglementaires donnée par cette note est la suivante : « - tuberculose (selon l'âge) : vaccin BCG ; - diphtérie-tétanos : vaccin D-T ; - typhoïde : nouveau vaccin TYPHIM Vi remplaçant les anciens TAB et anti-typhoïdique monovalent ; - poliomyélite : vaccin injectable trivalent ; - hépatite virale A : gamma-globulines injectables ». Il est précisé : « Avant le départ, les médecins des unités ont contrôlé et complété les mesures de protection immunitaire réglementaires ». Au regard des informations épidémiologiques disponibles, les deux vaccinations complémentaires qu'il avait été décidé de mettre en _uvre concernaient : - la grippe : « Le vaccin a été administré à tous les personnels désignés par le commandement » ; - et la méningite cérébro-spinale : « L'ensemble des effectifs a reçu le vaccin bivalent A-C ». Les troupes de la Division Daguet relevaient principalement d'unités de la Force d'Action Rapide (FAR). Elles avaient déjà précédemment séjourné Outre-mer et notamment en Afrique. Le Médecin général inspecteur Bladé concluait d'ailleurs son développement relatif à la couverture vaccinale en ces termes : « Pour mémoire, ces personnels sont également immunisés contre la fièvre jaune, et bénéficient ainsi d'une protection contre neuf maladies infectieuses ». La note du Médecin général Bladé avait été précédée par une fiche d'information concernant les problèmes de santé publique susceptibles d'être rencontrés dans le Golfe persique (n° 2476 du 13 septembre 1990 DEF/DCSASS/AST/TEC/DR). Cette fiche transmise par le Médecin général P. Barabé, sous-directeur « Action scientifique et technique » précisait, s'agissant des vaccinations : « Aucun de ces pays n'exige de vaccination particulière : - le vaccin anti-amarile n'est demandé que pour les personnes venant de séjourner en zone d'endémie ; - le vaccin anticholérique, inefficace, n'est plus réclamé depuis plusieurs années. En revanche il est indispensable que le calendrier vaccinal réglementaire soit à jour, notamment les vaccinations contre le tétanos, la poliomyélite et la typhoïde, ainsi que la gamma globulino prophylaxie anti-hépatite A. La vaccination contre l'hépatite B est à recommander ». 2. La décision d'effectuer en urgence deux vaccinations complémentaires a) La mission de l'Institut de médecine tropicale du Service de santé des Armées L'Institut de médecine tropicale du Service de santé des Armées (IMTSSA) de Marseille a été chargé d'une mission sur le terrain, du 22 octobre au 7 novembre 1990, dont les objectifs étaient : - l'immunisation antiméningococcique et antigrippale des personnels ; - l'expertise de l'hygiène en campagne ; - l'étude des équipements en moyens « froids » des formations sanitaires ; - l'étude des besoins en soutien « laboratoire » de la Division Daguet. Ce travail était dirigé par le Médecin en chef spécialiste H. Delolme, ayant pour adjoint le Médecin principal, assistant des hôpitaux des Armées, J.P. Louboutin-Croc, qui ont rendu un rapport de fin de mission n° 329/IMTSSA/MEDCO, daté du 20 novembre 1991. La mission d'information a également eu communication des textes réglementaires officiels relatifs aux vaccinations et à l'hygiène dont les plus importants sont : - l'instruction modifiée du 7 août 1981 n° 2000/DEF/DCSSA/2/TEC2 relative à la pratique des immunisations dans les Armées ; - l'instruction du 10 janvier 1985 n° 103/DEF/DCSSA/2TEC sur la désinfection, la désinsectisation et la dératisation dans les armées de Terre, de Mer et de l'Air ; - la circulaire du 25 janvier 1985 n° 290 DEF/DCSSA/2/TEC/DR relative aux comptes-rendus sur l'état sanitaire des troupes et sur l'activité médico-chirurgicale des formations du Service de santé engagées dans les actions extérieures. Il convient de noter que la mission dévolue aux deux médecins de l'IMTSSA recouvrait non seulement l'ensemble du déploiement Daguet à la date de leur intervention, y compris l'Etat-major interarmées (EMIA) de Ryadh (200 militaires) et la base aérienne française d'Al Ahsa, mais également les 63 aviateurs implantés sur la base de Doha au Qatar dans le cadre de l'opération Méteil et les 335 militaires déployés sur plusieurs sites aux Emirats Arabes Unis (E.A.U.) dans le cadre de l'opération Busiris. La dispersion des lieux d'intervention de la mission et les distances ont obligé ses membres à se diviser en deux équipes (un médecin et un sous-officier) qui ont parcouru en une quinzaine de jours quelque 6 000 kilomètres par la voie aérienne (en Transall et Puma) et 1 000 kilomètres de routes et de pistes. Dès leur arrivée, les médecins se sont présentés pour une entrevue, au Général Roquejeoffre, alors Commandant des éléments français (COMELEF) Daguet et à son Chef d'Etat-major, le Général Le Pichon (le 23 octobre 1990). Puis ils ont eu des entretiens avec le Général Mouscardès, alors Commandant de la Division Daguet et le Médecin chef de cette Division, le docteur Ingelet (le 25 octobre 1990). b) Un réel effort de vaccination sur le terrain L'équipe du IMTSSA a accompli sur place un travail remarquable. Les vaccinations antiméningococcique (MCS) et antigrippale ont pu être réalisées en quelques jours sur un nombre de personnels très important. Aux pages 9 et suivantes de leur rapport de mission, les médecins Delhomme et Louboutin-Croc relatent précisément l'organisation et le bilan de l'opération dont ils avaient la charge : - au cours de chaque séance de vaccination, une liste nominative des personnes vaccinées a été dressée ; - en liaison avec les Médecins chefs des unités, les quantités de vaccins nécessaires à une vaccination des absents ou jugés trop fatigués ont été déposées soit dans les infirmeries des unités, soit à CRK ; - la mise à jour des pièces réglementaires (livrets médicaux réduits, carnets internationaux de vaccinations) a également été réalisée. En outre, les personnels du GSL-Avant de CRK, de la base aérienne d'Al Asha, du GSL-Arrière de Yanbu, de la base aérienne de Riyadh et de l'Etat-major interarmées (EMIA) ont également fait l'objet de cette double vaccination, sur la période du 24 octobre au 1er novembre 1990, pour des taux moyens de couverture vaccinale de 92,8 % (MCS) et de 92,4 (grippe). Ces cinq autres unités représentaient un effectif global théorique de 1 555 personnes. Enfin, deux conclusions majeures sont tirées par les médecins de l'IMTSSA (page 23) : ● à court terme, ils ont constaté que « la vaccination combinée antiMCS et antigrippale a été bien tolérée. En effet, aucune réaction adverse immédiate n'a été observée. Aucune consultation pour réaction adverse tardive n'a été enregistrée » ; ● pour l'avenir, ils ont suggéré qu' « afin de faciliter la mise en condition de départ outre-mer des personnels qui sont amenés à intervenir dans des délais très courts sur des sites extérieurs, il est proposé que les vaccinations antiamarile et antiméningococcique A + C soient réalisées systématiquement chez tous les personnels engagés ou de carrière de la FAR ». Cette dernière mention est complétée par la mise en exergue de l'idée d'établir un calendrier de vaccination spécifique à cette grande unité, en révisant à cet effet, l'instruction n° 2 800 du 7 août 1981 DEF/DCSSA/2/TEC2, relative à la pratique des immunisations dans les Armées. En outre, il fut décidé que l'état de fatigue des personnels comme l'incidence élevée d'affections diarrhéiques, justifiaient un report de la vaccination antigrippale pour certaines unités. Elle restait ainsi à réaliser ultérieurement par les médecins de ces troupes. Un tableau récapitulatif des vaccinations opérées sous la responsabilité de l'équipe de l'IMTSSA figure à la page 14 du rapport de mission :
Les taux de couverture vaccinale s'élevaient ainsi à 92,7 % (MCS) et à 31,6 % (grippe), en prenant toutefois les 725 vaccinations antigrippales déjà effectuées en France. 3. Certaines restrictions d'immunisation résultant plus de contingences matérielles que sanitaires Le document intitulé « Le Service de santé des Armées pendant les opérations au Moyen-Orient - 1990-1991 » (Tome 1), publié longtemps après la guerre du Golfe (octobre 1995) dresse un bilan des mesures arrêtées à cette occasion contre le risque biologique naturel ou armé dans un développement intitulé « La position adoptée par les troupes françaises » (pages 51 et 52) : ainsi, cette publication officielle qui émane de la DCSSA apporte a posteriori des éclaircissements susceptibles d'être considérés comme définitifs s'agissant des vaccinations effectuées ou mises à jour au cours de ces opérations. « Devant la menace biologique, l'attitude adoptée par le commandement français, sur avis de la direction centrale du Service de santé (DCSSA), consistait à prendre les mesures suivantes : Mesures générales Vérification et mise à jour éventuelle du calendrier vaccinal réglementaire Avant le départ pour l'Arabie Saoudite, les vaccinations réglementaires ont été vérifiées : - tuberculose : vaccin BCG, - diphtérie - tétanos : vaccin DT, - typhoïde : vaccin typhim Vi - poliomyélite : vaccin injectable trivalent, - hépatite virale A : gamma globulines injectables. Vaccinations particulières Après la confirmation de risques particuliers sur le théâtre, une mission d'épidémiologistes a été envoyée sur place par la DCSSA pour contrôler l'hygiène générale et pour procéder à deux nouvelles vaccinations : - vaccination anti-méningococcique A et C, - vaccination anti-grippale. Mesures spécifiques Choléra : Le nouveau vaccin Pasteur-Mérieux non encore commercialisé fut l'objet par la DCSSA d'une commande urgente. Charbon : Une commande de vaccins fut envisagée par la DCSSA. Les délais étant trop courts pour obtenir auprès des laboratoires américains qui les produisent les doses nécessaires, la prévention par la Doxicycline, à la dose de 300 mg par jour, lui fut préférée et adoptée pour les unités. Botulisme : La vaccination ne fut pas retenue par les experts du Service de santé des Armées ; le dépistage de la toxine dans l'eau par des kits spécifiques mis au point au CRSSA lui fut préféré. Variole : La plupart des militaires ayant bénéficié d'une primo vaccination avant 1985, le risque paraissait limité ; en outre, un demi million de doses de vaccin restait disponible. Rappel des précautions élémentaires Le masque et les vêtements fermés confèrent une importante protection, complétée par l'hygiène alimentaire et corporelle. Le contrôle et le traitement de l'eau (filtration et chloration) devaient être systématiques. Mise en place d'une cellule « biologie » Alors que pour les agents chimiques et nucléaires les détecteurs d'alerte étaient disponibles dans chaque unité, rien d'équivalent n'existait pour le risque biologique. Après concertation avec l'Etat-major des Armées et la Direction des Recherches, Etudes et Techniques (DRET), la DCSSA a mis en place une cellule « B » à l'HMC DAGUET. Un officier, spécialiste de la défense « B » du CRSSA a donc été envoyé à Rahfa le 25 janvier 1991 pour la diriger ; il détenait un mini laboratoire permettant la détection et l'identification des bactéries pathogènes. Un matériel complémentaire lui est parvenu au début de février 1991 rendant possibles des prélèvements d'air et l'identification raide de la toxine botulinique. Ce laboratoire était le seul du type mis en place par les armées alliées. Il était destiné à travailler si nécessaire en coopération avec elles. En pratique, aucune vaccination autre que les cinq réglementaires et les deux particulières, objet de la mission épidémiologique, ne fut pratiquée. La prise préventive de Doxicycline contre la peste et le charbon fut préconisée (300 mg par jour). » La mission d'information a relevé qu'en France comme à l'étranger, la pratique des multivaccinations n'avait pas véritablement fait l'objet d'études susceptibles d'être qualifiées de « poussées ». Ceci est vrai dans les domaines civils et militaires. Il apparaît éminemment souhaitable d'encourager cette voie de recherche, notamment en analysant les effets de l'administration de plusieurs vaccins sur de très courtes périodes et, si possible, d'examiner les conséquences de l'environnement particulier à ces multivaccinations et tout spécialement des situations de stress. Par ailleurs, la mission a également constaté des faits troublants concernant la tenue des documents de vaccinations, notamment aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne, pays pour lesquels ses interlocuteurs ont reconnu et parfois même sévèrement critiqué, le grand nombre de pertes « post Golfe » concernant ces documents. Apparemment, on doit se féliciter qu'il n'en a pas été de même en France. La pratique française du livret individuel reste en ce domaine, une excellente solution qui doit être confortée. En ce sens, il est très important qu'au regard des dates et vaccins reportés sur documents puissent, à l'avenir, être mentionnées les caractéristiques essentielles des sérums ou substances administrés (nom du fabricant et n° des lots). 4. Une piste intéressante pour l'explication des pathologies des anciens combattants de la guerre du Golfe Les vaccinations multiples sont considérées par les épidémiologistes américains et britanniques comme l'une des causes potentielles du « syndrome de la guerre du Golfe » les plus crédibles. Dans un article rédigé par ses soins en novembre 20001 et remis aux membres de la mission d'information, le Professeur Romain Gherardi, Chef du service d'histologie-embryologie-cytogénétique au Département de Pathologie du Centre hospitalier universitaire Henri-Mondor de Créteil, souligne que « les épidémiologistes britanniques ont mis en évidence une association faible entre le SGG2 et certains vaccins individualisés comme le tétanos (Unwin et al, 1999 ; Hotopf et al, 2000), mais surtout une association forte entre le SGG et les vaccinations multiples reçues pendant le déploiement ». Et l'article de préciser : « Le vaccin de loin le plus largement administré aux forces anglo-saxonnes pendant le déploiement était le vaccin contre le charbon (57,2 % des soldats britanniques), suivi de celui contre la peste (25,7 %) (Unwin et al, 1999). Le vaccin contre le botulisme n'a été administré qu'à une fraction de troupes US (n = 8 000) (Persian Gulf Veterans Coordinating Board, 1995) et le vaccin contre la coqueluche n'a été administré qu'aux troupes britanniques, à titre d'adjuvant du vaccin contre le charbon (Hotopf et al, 2000) ». Lors de son audition du 21 mars 2001, au terme de ses recherches bibliographiques, le Professeur Roger Salamon a confirmé que l'hypothèse des vaccinations était une piste sérieuse qu'il fallait envisager pour étudier les causes des pathologies des anciens combattants du Golfe, bien que les mesures de prophylaxie dont ont bénéficié les militaires français étaient très sensiblement différentes : « Si par exemple, aujourd'hui, on me demandait de sélectionner quelques facteurs de risque, je retiendrais non pas l'uranium appauvri ou la Pyridostigmine mais la vaccination, alors qu'elle a été, en France - j'en suis persuadé -, moins à risque qu'aux Etats-Unis ». La mission d'information partage totalement ce point de vue, notamment à la lumière des travaux très intéressants conduits par le Professeur Romain Gherardi sur la « myofasciite à macrophages », maladie observée et étudiée auprès de patients civils présentant des symptômes assez similaires à ceux des anciens combattants de la guerre du Golfe, et dont la cause supposée, à savoir l'hydroxyde d'aluminium contenu dans les vaccins tels que ceux contre l'hépatite B ou le tétanos, pourrait être identique. Au cours de son audition par la mission d'information le 28 mars 2001, le Professeur Gherardi a indiqué que les signes pathologiques présentés par les patients civils étudiés « étaient essentiellement un syndrome associant des myalgies et arthralgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires et articulaires, et un syndrome dit de fatigue chronique, c'est-à-dire une fatigue très importante et inexpliquée par les causes habituelles », soit des symptômes très proches de ceux que déclarent éprouver bon nombre d'anciens combattants de la guerre du Golfe malades. Parmi les 50 premiers patients, 94 % de ceux qui présentaient cette lésion dans le muscle deltoïde souffraient de douleurs musculaires diffuses, qui commençaient souvent aux membres inférieurs avec une tendance à une évolution ascendante et à une diffusion progressive. Selon le Professeur Gherardi, « ces douleurs musculaires, de façon quasi constante, avaient commencé après l'injection vaccinale. S'il n'y avait eu aucune relation entre ce syndrome arthromyalgique et les vaccins, il y aurait eu 50 % de myalgies apparues après et 50 % apparues avant le vaccin responsable. Cet élément est très important. En revanche, de façon très surprenante, le délai d'apparition de ces myalgies était souvent assez élevé puisque (...) l'apparition des premières manifestations musculaires avait lieu onze mois après l'injection du vaccin causant la lésion de "myofasciite à macrophages", avec des délais allant jusqu'à parfois deux ans ». Parallèlement, les patients se plaignaient d'une fatigue chronique inexpliquée et considérée comme sévère (c'est-à-dire les amenant à arrêter le travail ou à limiter très nettement leur activité physique), pendant plus de six mois chez 93 % d'entre eux. Enfin, ces mêmes patients souffraient très fréquemment d'une maladie de l'immunité, en particulier la sclérose en plaques. S'agissant du facteur explicatif mis en évidence par protocole scientifique, à savoir l'hydroxyde d'aluminium, le Professeur Gherardi n'a pas caché qu'elle était susceptible « d'éclairer l'hypothèse vaccinale à l'origine du "syndrome de la guerre du Golfe", même s'il convient de ne pas l'appeler ainsi, bien qu'il existe néanmoins un problème médical actuellement non résolu ». Les propos suivants, extraits du procès-verbal de l'audition du 28 mars 2001, sont à cet égard éclairants : « (...) l'hydroxyde d'aluminium est un adjuvant de plusieurs vaccins, notamment tous les vaccins contre le tétanos, à l'exclusion du DTP et du TP, et tous les vaccins contre les virus de l'hépatite B et de l'hépatite A. A ces trois vaccins conventionnels, il convient d'ajouter, fait très important, le vaccin contre le charbon ("anthrax" en anglais), vaccin de guerre administré pour prévenir les risques d'une attaque bactériologique par le charbon. Cette précision peut avoir son importance dans le cas qui vous préoccupe. Une fois émise l'hypothèse qu'il pouvait s'agir de vaccins aluminiques, nous avons confirmé l'application de ces vaccins par une étude épidémiologique, dans le cadre de laquelle nous avons repris les carnets vaccinaux des 50 premiers patients. Cette étude a été menée de façon indépendante par notre groupe médical et l'Institut de veille sanitaire qui vient de déposer ses conclusions. Nous sommes tous d'accord qu'il existe, de façon constante, un antécédent par un vaccin aluminique chez ces patients qui souffrent d'une « myofasciite à macrophages ». Le vaccin le plus fréquemment impliqué était le vaccin contre l'hépatite B (84 % des patients), mais il existait souvent des combinaisons de plusieurs vaccins aluminiques et 15 % des patients n'avaient été vaccinés que contre le tétanos. Le nombre de doses était variable, pouvant aller jusqu'à neuf. Un point extrêmement important, sur lequel je souhaite attirer votre attention, concerne le délai entre le moment de la vaccination, attesté par des chiffres figurant sur le carnet vaccinal, et celui de la biopsie musculaire. Ce délai était assez long puisque la médiane était à trois ans, et que certains patients, maintenant de plus en plus nombreux, avaient fait l'objet de délais allant jusqu'à huit ou neuf ans. Ainsi on peut retrouver cette lésion de « myofasciite à macrophages » huit ou neuf ans après l'injection intramusculaire d'un vaccin adjuvanté par l'hydroxyde d'aluminium. [...] Par conséquent, on peut maintenant considérer comme établi que la lésion « myofasciite à macrophages » est constamment associée à la présence de cristaux d'hydroxyde d'aluminium, lesquels sont eux-mêmes constamment liés à la vaccination intramusculaire avec un vaccin adjuvanté par l'hydroxyde d'aluminium ». En résumé, le Professeur Romain Gherardi et ses collaborateurs sont parvenus aux conclusions suivantes : - la « myofasciite à macrophages » est induite par les vaccins aluminiques ; - elle reflète la persistance, parfois pendant de nombreuses années, de l'aluminium dans le site d'injection ; - la lésion est immunologiquement active ; - elle est détectée chez des patients souffrant de douleurs musculaires diffuses et de fatigue chronique ; - ce tableau clinique général émerge postérieurement à la vaccination qui a causé la lésion musculaire. On observera, par transposition au cas des anciens combattants de la guerre du Golfe, que la « myofasciite à macrophages » pourrait expliquer les douleurs musculaires et les fatigues chroniques observées chez la plupart d'entre eux ainsi que les délais de latence de déclenchement des maladies dont ils font le plus souvent état. Il semble donc que cette hypothèse médicale doive faire l'objet d'analyses approfondies s'agissant des soldats ayant participé à la guerre du Golfe qui présentent des symptômes arthromyalgiques, le Professeur Gherardi s'étant déclaré disposé à effectuer des biopsies et des analyses à ceux qui en émettraient le souhait. La mission d'information, pour sa part, encourage vivement le ministère de la Défense et le Service de santé des Armées à faire preuve de coopération sur ce point. B. LES MESURES DE PROTECTION « NBC » Les mesures de protection NBC étaient à la fois médicales et techniques. Un tel risque était pris très au sérieux. Néanmoins, ces modes de prévention n'étaient pas toujours exempts d'imperfections, voire de défaillances. L'Etat-major des Armées semblait avoir une assez bonne connaissance des menaces chimiques et, dans une moindre mesure, biologiques que représentait l'Irak, au moment de l'engagement de nos forces. Une fiche du Centre d'exploitation du Renseignement militaire (n° 429/DEF/EMA/CERM/D2/CD du 27 janvier 1991) résume les capacités irakiennes particulières à ces deux risques. La mission d'information a constaté, à la lecture de cette fiche qui lui a été transmise, que l'intérêt manifesté par le régime irakien envers les armes chimiques remontait à la fin des années soixante (le début de la production datant de 1973 selon ce document qui relève que la prolifération de cet arsenal a été permise sous couvert de productions d'insecticides ou d'engrais parfois conduites en coopération avec certains pays occidentaux). Cette fiche énumérait également les lieux de production dont le plus important semblait être à Samarra (Ypérite, VX, tabun et sarin). On notera toutefois qu'aucune précision n'est fournie sur des lieux de stockage éventuellement distincts des usines suspectées de production. Il n'était ainsi pas fait mention, à cette époque, du site de Khamisiyah au sud de l'Irak, à quelque 200 kilomètres de Rafha où était installée la majeure partie de la Division Daguet avant l'offensive terrestre. Ce site entreposant des armes qui incorporaient du sarin et cyclo-sarin et du gaz moutarde, aurait fait l'objet de destructions par les troupes américaines d'occupation en avril 1991, après l'offensive terrestre selon les déclarations faites par les Irakiens aux inspecteurs de l'UNSCOM (Commission spéciale des Nations Unies chargée du désarmement de l'Irak) dès octobre 19913. S'agissant des moyens de dispersion, il est précisé que l'artillerie d'un calibre au moins égal à 120 mm était capable de délivrer des projectiles chimiques et que la majeure partie de l'aviation d'attaque ou légère irakienne pouvait réaliser des épandages. En revanche, le document faisait état qu'« aucune preuve concernant la réalisation en Irak de têtes chimiques pour missiles n'a été apportée à ce jour ». Mais cette hypothèse y était néanmoins qualifiée de « fortement probable ». Cette absence de certitude explique l'inconnue qui prévalait sur ce point au moment des premières attaques de Scud. Enfin, s'agissant des capacités de guerre bactériologique, la fiche se limitait à mentionner des recherches qui auraient été conduites (le rédacteur de la fiche employant le conditionnel) sur le charbon (anthrax), la toxine botulique et la salmonelle à Salman Park et Mossoul ainsi que par certaines universités. La conclusion du rédacteur est simple : « Aucune indication ne permet actuellement d'affirmer que ces recherches sont couronnées de succès et, a fortiori, qu'une utilisation de ces agents est possible ». 2. Les équipements et les procédures d'alerte NBC a) Les matériels de détection, protection et décontamination en vigueur au sein des forces lors du conflit ● Les caractéristiques des équipements Les matériels dédiés à la défense nucléaire, biologique et chimique (NBC) des militaires sont divers et assurent différentes missions. A cet égard, lors de l'audition de trois responsables de la Délégation générale pour l'Armement au sujet de ces équipements, le 16 janvier 2001, M. Gilles Fernandez, directeur du Centre d'études du Bouchet, a plus particulièrement insisté sur quatre fonctions : « La première vise à permettre aux forces de savoir quand il faut se protéger. C'est ce que nous appelons, dans notre jargon, "la détection d'alerte". Si un risque apparaît, il faut savoir qu'il apparaît pour pouvoir se protéger. La deuxième grande fonction est de savoir où est le danger, quelle est sa nature et, surtout, quand il disparaît. En effet, vous verrez tout à l'heure, en examinant les quelques équipements que nous avons apportés, que la protection contre les dangers "NBC" engendre une perte de confort et d'ergonomie. Il est donc important de pouvoir enlever les protections quand cela s'avère nécessaire. Pour ce faire, il convient d'assurer ce que nous appelons "la détection de contrôle". La troisième grande fonction consiste à faire en sorte que les forces puissent courir un risque minimal lorsqu'elles se trouvent en présence du danger - même si tout le monde sait que, dans tous les domaines, le risque zéro n'existe pas. C'est ce qu'on appelle "la fonction de protection". En quatrième lieu, lorsque des unités ont rencontré des agents "NBC", il faut les éliminer des matériels que les forces emploient. C'est ce qu'on appelle la "décontamination" ». 1) S'agissant des équipements de détection (dont les fiches techniques figurent en annexe4 au rapport), il convient de préciser que les forces avaient à leur disposition : - des détecteurs nucléaires DOM DOR 309 (adoptés en 1988), et des stylos dosimètres JER ; - des détecteurs d'alerte locale des agents chimiques (Detalac en abréviation), à raison d'un Detalac par section de 30 hommes, soit environ 200 appareils. Ne réagissant qu'à la présence d'organo-phosphorés (ce qui exclut l'ypérite de leur champ de détection), ces appareils donnaient une alerte modulée en fonction de la concentration de neurotoxique (tabun, sarin ou cyclo-sarin) dans l'air : ils pouvaient ainsi détecter une concentration de 2 mg/m3 d'agent neurotoxique non persistant en 2 secondes et une concentration de 0,1 mg/m3 de ce même produit en 2 minutes, seuil plutôt élevé puisque quatre fois plus important que celui des appareils actuellement en service. 2) En ce qui concerne les équipements de contrôle et d'identification, les soldats français disposaient : - à titre collectif tout d'abord, de détecteurs individuels de neurotoxiques (Detindiv), permettant de déceler, lors d'un contrôle postérieur à l'alerte du Detalac, une présence infime de neurotoxiques de 0,010 mg/m3. Matériel de détection destiné au contrôle, sa mise en _uvre permettait, le cas échéant, de lever l'alerte et ainsi de suspendre l'application des mesures de protection. Les unités médicales disposaient également, pour l'ensemble du dispositif, de 4, puis 6 appareils portatifs d'alerte et de contrôle chimique (AP2C), plus sensibles pour la détection d'agents chimiques organo-phosphorés et soufrés5 ; - à titre individuel ensuite, de la trousse de détection chimique et de contrôle ml 1 (TDCCM 1 bis), destinée elle aussi à des détections de contrôle postérieures à celles des Detalac. Permettant de déceler tous les gaz de combat dont l'ypérite et l'acide cyanhydrique, elle donnait la possibilité de percevoir la présence du sarin à des concentrations de 0,005 mag/m3. 3) En matière de protection, outre les abris collectifs construits en dur, les soldats disposaient : - d'une tenue survêtement de protection à port permanent (tenue S3P). Lors de son audition le 16 janvier 2001, M. Daniel Moronvalle, Chargé du développement et de l'acquisition du matériel de protection et de décontamination au Service des Programmes Nucléaires (SPNuc) a précisé : « Elle a été mise au point avant la guerre du Golfe, si bien que les forces impliquées dans cette opération avaient cette tenue. Elle était déjà plus confortable que la précédente. La tenue "NBC" outre-mer-TOM a été adoptée en octobre 1990. On en a envoyé et distribué un certain nombre au Golfe, mais tous les personnels du Golfe n'en ont toutefois pas disposé. Cette même tenue avait été déclinée dans une autre couleur, avec un bariolage destinée aux opérations en "Centre Europe" » ; - d'un appareil normal de protection à visière panoramique (masque à gaz) avec une cartouche filtrante 61/63, distribué à 6 000 exemplaires pour les personnels de l'armée de Terre et à tous les personnels de l'armée de l'Air ; - d'accessoires tels que des gants en cuir avec des sous-gants carbonés, des chaussettes carbonées et des tenues carbonées. 4) Enfin, comme l'a souligné M. Daniel Moronvalle à l'occasion de son audition : « En cas de contamination, le matériel en service à cette époque était le gant poudreur. Je vous signale que ce matériel est toujours en service et que nous prévoyons qu'il le reste dans les années à venir car il remplit parfaitement son rôle ». Pour le matériel, il existait un système de décontamination par pulvérisation de solutions décontaminantes modèle F1 (diéthylène triamide avec de la soude et du glycol, voire de la soude ou de l'hypochlorite). A la lumière des informations techniques dont la mission d'information a pu bénéficier, se posent en fait deux questions particulièrement importantes qui ont trait à la sensibilité des Detalac et à l'efficacité des radiamètres en service pour détecter les risques de radioactivité éventuels de l'uranium appauvri. Dans le premier cas, la mission d'information observe que les Detalac ont été retirés des forces et remplacés par des AP2C dont les seuils de détection sont plus bas, puisque M. Daniel Moronvalle a indiqué à ce sujet que : « Pour le soufre, on en est à 420 microgrammes/m3 et, pour le phosphore, à 12 microgrammes/m3. Il y a eu un bond technologique : ce sont des microgrammes et non plus des milligrammes ». Or compte tenu de la distance séparant les Detalac des forces et le temps de latence permettant le revêtement des accessoires de protection (tenue S3P et masque), on est en droit de s'interroger sur l'efficacité du dispositif de détection alors en vigueur. En effet, au cours de leur audition le 16 janvier 2001, les spécialistes de la protection NBC de la Délégation générale à l'Armement ont apporté les précisions suivantes : « M. Daniel Moronvalle : (...) En fait, sous le vent, on installe le Detalac à 300 mètres de distance de manière à avoir en plus un temps de réaction. [...] M. Gilles Fernandez : (...) on considère habituellement que, dans les pires conditions de concentration, à partir du moment où il y a une détection, on dispose de deux minutes et demi ou trois minutes pour se protéger quand on est en présence de ces concentrations, c'est-à-dire pour que le risque ne devienne pas un danger. Revêtir le masque, prend quelques secondes, d'où l'importance de ce que je disais tout à l'heure. En effet, l'équipement est l'élément d'un tout et l'entraînement des forces est très important parce que, en cas d'alerte, il faut effectivement que, dans les quelques secondes qui suivent, les soldats mettent leur masque, ce qui suppose que la tenue soit déjà prête. Il ne leur reste plus alors qu'à mettre le masque et la capuche, ce qui prend quelques secondes ». De fait, comme les alertes étaient fréquentes et qu'il est avéré que les forces n'étaient pas toujours suffisamment entraînées aux protocoles de protection, il n'est pas impossible que dans certains cas l'exposition à des traces d'agents chimiques n'ait pas été sans conséquences. Dans le second cas, il est apparu à la mission d'information que la Délégation générale pour l'Armement avait développé des sondes intégrées aux radiamètres dès 1988, sans pour autant être en mesure de préciser si ces sondes étaient susceptibles d'alerter les personnels face à un éventuel danger radiologique des munitions à uranium appauvri utilisées par les forces armées américaines. Tel est du moins ce qui ressort de cet extrait du procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2001 : « Mme Michèle Rivasi, co-rapporteure : Par conséquent, pouvez-vous nous dire en tant qu'experts si cet appareil est capable de déceler quelque chose par rapport à un obus à base d'uranium appauvri ? M. Jean-Pierre L'Hôte : Je ne peux pas vous le dire en ce qui concerne l'appareil tel qu'il est. Nous avons actuellement des sondes annexes à l'appareil qui ont été développées dans le cadre des risques technologiques. Il n'y a pas que l'uranium qui est concerné ; c'est aussi le cas d'un certain nombre de sources ponctuelles qui peuvent se trouver sur le terrain. Nous avons donc développé des sondes alpha, des sondes bêta et des sondes de grande sensibilité qui permettent de détecter pratiquement tous les radioéléments pouvant exister sur le terrain. Mme Michèle Rivasi, co-rapporteure : Mais pouvez-vous répondre à ma question sur cet appareil qui était utilisé pendant la guerre du Golfe ? M. Jean-Pierre L'Hôte : Nous n'avons jamais eu l'occasion de tester cet appareil vis-à-vis de l'uranium appauvri. En fait, nous n'avons jamais été confrontés à cette question. Mme Michèle Rivasi, co-rapporteure : Et vous n'avez jamais eu la curiosité de vous poser vous-même la question ? [...] M. Jean-Pierre L'Hôte : La question globale des risques radiologiques au niveau de l'OTAN, parce qu'il n'y a pas que le problème de l'uranium, s'est posée, en fait, à partir de l'année 1995. Mme Michèle Rivasi, co-rapporteure : En 1994 et 1995. M. Jean-Pierre L'Hôte : On a alors développé des sondes. Je peux vous dire qu'une sonde, en particulier, permet de détecter l'uranium sur sa raie gamma à 150 keV. C'est un problème qui n'existait pas en 1990. [...] M. Daniel Moronvalle : La sonde est sortie en 1988. Vous aviez aussi un boîtier dans lequel il y avait une canne pour mettre la sonde au bout. M. Bernard Cazeneuve, Président : Si ce matériel est sorti en 1988, cela veut dire que cette sonde aurait très bien pu être utilisée dans le cadre du conflit du Golfe. M. Daniel Moronvalle : Elle était adoptée et elle existait. Maintenant, je ne sais pas si elle a été utilisée ». Ne disposant pas de plus de précisions sur ce point, malgré ses demandes, la mission d'information ne peut apporter de conclusion sur ce point. L'occasion lui sera sans soute fournie de le faire dans son rapport sur les événements des Balkans. On observera néanmoins qu'en théorie, les militaires français auraient pu disposer, dès 1990, d'équipements de détection radiologique suffisamment précis pour détecter un éventuel danger lié à la radioactivité de l'uranium appauvri des munitions antichars utilisées par les alliés sur le théâtre d'opérations. Un rapport du Sénat des Etats-Unis de 19986 insiste aussi sur la fréquence excessive des fausses alertes résultant de l'imperfection des systèmes d'alarme en place dans les forces américaines et plus particulièrement le système M8A1, en raison d'une sensibilité à des variétés de substances largement employées dans le Golfe (produits à base de diesel, peintures, insecticides, concentration de sables etc...) mais sans rapport avec des toxiques de guerre (page 50). Depuis 1998, un nouveau système dit « Automatic Chemical Agent Detection Alarm » (ACADA) est progressivement mis en place dans les forces. Selon les enquêteurs du Sénat, il s'agirait d'un dispositif beaucoup plus fiable, désormais capable de détecter le gaz Moutarde et d'offrir, en conséquence, une garantie de réduction du nombre des fausses alarmes (page 54). ● Les défaillances observées S'agissant des matériels, les Detalac sont souvent mis en cause pour leur trop grande sensibilité. Ainsi, le rapport d'activité de l'Hôpital Médico-Chirurgical de Transit Air rédigé par le Médecin en Chef C. Mourareau, daté du 2 avril 1991 précise-t-il que le système de détection Detalac « a semblé nettement insuffisant dans le contexte (détection ciblée sur les organo-phosphorés, nombreuses fausses alertes, manque d'autonomie, maintenance lourde) »7. Ces matériels de détection ne sont toutefois pas les seuls à être fortement critiqués. Dans son rapport au Général de corps d'armée commandant les écoles de l'armée de Terre8, le Colonel Claude Baguet, commandant l'école de défense NBC de l'armée de Terre, analyse la valeur des matériels de défense NBC français. On y lit notamment que le Detalac fait l'objet de « pannes fréquentes » et « ne détecte pas l'Ypérite ». Cependant, il fait également valoir que les PDF1 étaient en « dotations réduites » et que « s'il n'y avait pas eu les FOX (matériels des unités spécialisées américaines) sous OPCON, nous n'aurions pas eu grand chose alors que la détection est la clé de la défense chimique dans notre concept ». Les Detindiv, pour leur part, étaient « en nombre très insuffisant » (tout comme les TDCCM1 et les AP2C) et mis en _uvre avec des « consignes d'utilisation délirantes ». Enfin, s'agissant de la tenue S3P, « son port » est qualifié de « difficile, voire impossible par temps chaud ». La mission d'information observe également qu'en règle générale, le retour d'expérience concernant la protection individuelle des militaires (tenues de protection notamment) reste très critique et pointe de nombreuses défaillances. Ainsi, le compte rendu du Médecin chef des services Puygrenier, écrit le 25 mars 1991, fait état de plusieurs anomalies constatées quant à l'entraînement des militaires au port des moyens de protection et à l'efficacité de ces derniers, et également s'agissant de la discipline pas toujours observée avec rigueur puisqu'est mentionné l'exemple du port de chaussures de toile à la place de rangers9. Et le Médecin chef des services Puygrenier de constater : « De nombreuses anomalies ont été constatées dès l'engagement au mois de janvier 1991. - Personnels arrivant avec des masques endommagés, mal adaptés au visage et équipés avec des cartouches de deuxième réserve très suspectes, possédant des informations recueillies dans leurs unités des plus extravagantes. - Personnels n'ayant eu aucune instruction sur l'habillage et le déshabillage ». Par ailleurs, ce même rapport souligne que certaines composantes de protection n'ont pas donné satisfaction : « Les chaussettes carbonées ne sont pas adaptées (doivent être mises par avance, port souvent mal toléré, usure en quelques jours...) (...). Les sous-gants butyl (armée de l'Air) sont trop fragiles et source d'hypersudation, ce qui les rend difficilement utilisables quant il s'agit de réagir à plusieurs alertes ». S'agissant des dotations individuelles en équipements de protection, on peut aussi lire pêle-mêle, dans le message n°76/B.A.RIYAD/CDT du Commandant de la base aérienne de Riyadh, le Colonel Barrans, au Commandant des forces françaises en Arabie Saoudite : compte rendu des enseignements tirés de l'opération Daguet en matière NBC daté du 6 mars 1991 : « L'échantillonnage des masques a été mal calculé : les masques taille 2 qui correspondent à la plus forte demande ont été livrés en trop petite quantité, au profit des masques de taille 3 beaucoup trop petits pour la moyenne des morphologies » ; la tenue T3P « peut difficilement s'appliquer sous un climat aussi chaud que celui d'Arabie Saoudite » ; « les demandes de matériel de détection NBC (...) n'ont pas été honorées alors que des matériels de détection radiologique et de sécurité nucléaire sont arrivés très rapidement à Riyadh sur ordre de l'Etat-major après l'annonce d'une menace d'utilisation d'une bombe `sale' par l'Irak. Il est dommage que ces ordres de mise en place aient prévalu sur les demandes des responsables NBC en Arabie Saoudite, qui connaissent mieux les nécessités opérationnelles ». Cette question des rechanges est importante puisque le Colonel Claude Baguet indique sans ménagement : « Il n'y a jamais eu de tenues pour les gros ou pour les grands ; au bout de deux mois, il n'y avait plus de rechange pour les gens de taille normale. Les nouveaux ANP VP F1 sont arrivés trop tardivement (G-3) pour réaliser un échange ».10 Au cours de son audition, le 20 mars 2001, le Colonel Jacques Dampierrre, chef de corps au 6ème Régiment de Commandement et de Soutien, a lui aussi évoqué cette situation tout en essayant d'y apporter une explication : « La protection NBC n'était pas très confortable car nous n'avions pas de matériel prévu pour temps chaud, même si nous avons reçu, tout à la fin, quelques combinaisons plus adaptées. Cela vient du fait, comme pour d'autres aspects, que la politique de défense de l'époque n'avait pas envisagé l'hypothèse d'une guerre chimique dans le désert. Par conséquent, nos collections, au Commissariat de l'armée de Terre, comportaient très peu de stocks de ces équipements. Mais nous n'avons pas souffert de la qualité des matériels. Nous avons rencontré des problèmes du fait que nous n'avions jamais un équipement disponible qui corresponde exactement au nombre des effectifs. Comme il y avait un freinage important sur la constitution de la force, au plan des effectifs, nous ne pouvions commander des matériels pour plus d'effectifs que nous n'en avions. (...) De même, au niveau des tenues, quand on demande au Commissariat d'équiper 1 000 hommes, il envoie une collection qui comprend des petites, des moyennes et des grandes tailles. Or les stocks avaient été constitués sur la base de statistiques relatives aux appelés, lesquels n'ont pas la même morphologie que les engagés. On manquait donc toujours d'un certain nombre de tailles, alors qu'une partie de la collection n'était d'aucune utilité. Tous ces problèmes ont été constatés sur le terrain car ils n'étaient pas prévisibles ». On le voit bien, tant les matériels de protection individuelle et collective, que les matériels de détection ont présenté des défauts non négligeables. Par ailleurs, les dotations individuelles des soldats ne correspondaient pas toujours aux besoins. b) Une préparation des militaires pas toujours suffisante Indiscutablement, les militaires français ont effectué des exercices réguliers de manière à être prêts à faire face au risque chimique. Ceux qui ont été dépêchés en Arabie Saoudite les premiers ont suivi une formation au cours du voyage, ce qu'illustrent de nombreux journaux des marches et opérations des régiments engagés dans le conflit. De même, des plans de déserrement chimique ont été élaborés par l'encadrement de chaque camp, comme l'illustre l'encadré qui suit, dès le début du déploiement. Les procédures à suivre étaient détaillées : à titre d'exemple, le plan de protection face à la menace chimique de la base aérienne d'Al Asha établi début janvier 1991 par le Colonel M. Amberg, Commandant Daguet de cette base, se décline en sept pages explicatives accompagnées de trois annexes. Outre les matériels de protection (masques à gaz ARF A 11 et ANP 51/53, tenues de survie anti-toxique, abris), de détection (papier détecteur Mle F1, Detalac, Appareil portable de contrôle de contamination-AP 2 C, Unité collective de détection chimique, réseau de plaquettes piqueté sur la base) et de décontamination (gants poudreurs individuels, solutions décontaminantes et moyens de dispersion, matériel de rinçage), ce document énumère les procédures de diffusion de l'alerte, les consignes de protection à suivre aux niveaux individuel et collectif, les moyens à mettre en _uvre et les attributions des personnels plus particulièrement concernés. Plan de déserrement Chimique d'Al Asha OPERATION DAGUET à K.K.M.C., le 23 Octobre 1990 Groupement de Soutien Logistique N° 425/ GSL AV/CDT NOTE DE SERVICE OBJET : Plan de déserrement en cas d'attaque chimique. La présente note a pour but de définir les modalités de désserrement vers une zone de regroupement en cas d'attaque chimique. I. GENERALITES 11 - Toute attaque par missile ou aviation est considérée comme chimique. 12 - On peut distinguer deux types d'alerte : 121 - Alerte avec préavis (minimum 6 heures). Correspond à des troubles à la frontière. Le « niveau 1 » sera appliqué sur ordre. 122 - Alerte sans préavis (ou préavis inférieur à 5 min.). Seulement par missile ou avion. LE BUT A ATTEINDRE EST DE SORTIR DE LA ZONE CONTAMINEE II. ALERTE AVEC PREAVIS Rassemblement sur ordre. III. ALERTE SANS PREAVIS (ou inférieur à 5 min.) 31 - De nuit : Dès réception de l'alerte, ou en cas de survol de C.R.K. par un avion qui répandrait à très faible hauteur (TEH) du chimique. 311 - Transmettre l'alerte en criant : « ALERTE GAZ » - sifflet par service de semaine. 312 - Mettre le masque ANP. 313 - Mettre la S3P dans l'ordre : · chaussettes carbone, · Pantalon, · Sous-gants carbone et gants peau, · Veste, · Cagoule agrafée par binome, · Rangers. 314 - Mettre au besoin les belages dans la musette. 315 - Sortir rapidement, mais sans précipitation, du bâtiment · Dernier étage par l'escalier de service (Secours). · 1er et 2ème étages par l'escalier central. 316 - Se regrouper aux véhicules : · Parking « P4 », · Parking « PL ». 317 - Désserrement vers le dépôt de munitions Les personnels de la boulangerie embarqueront dans un TRM du peloton de transport. Colonel LE GUEN Commandant le GSL De l'ensemble des documents examinés par la mission d'information, il ressort tout de même que la préparation des forces n'était pas nécessairement toujours à la hauteur des risques encourus. Dans son rapport au Général de corps d'armée commandant les écoles de l'armée de Terre11, le Colonel Claude Baguet, commandant l'école de défense NBC de l'armée de Terre, note que « le niveau d'instruction insuffisant au départ s'est amélioré ; lors du déclenchement des opérations terrestres, la connaissance des techniques de survie était excellente, mais les réactions tactiques saines face à l'incident chimique restaient mal connues ; d'où découlent certaines exagérations quant aux mesures de protection préconisées constatées au sein de certains détachements (ex : port systématique du S3P à l'intérieur d'un abri) ». De fait, l'impréparation relative des personnels était davantage le reflet d'un insuffisant entraînement des forces face au risque chimique avant même les événements du Golfe que le résultat d'une sous-estimation du danger sur le théâtre d'opération. Toujours est-il qu'il semble bien que les militaires engagés dans le conflit n'aient pas tous su comment appliquer les procédures de protection, ce qui a pu laisser à certains, tels le brigadier-chef Bernard Vandomme, rattaché au 6ème Régiment de Commandement et de Soutien, une impression de « panique ». 3. Les décisions médicales de protection et de mise en condition a) La saga de la Pyridostigmine ● Un usage préventif et généralisé au sein des forces Les préoccupations de la DCSSA sur le thème de la protection contre l'arme chimique dans ses différentes composantes, semblent avoir présenté un certain caractère de permanence. En témoignent les travaux de la sous-commission de la défense médicale contre les effets des armes chimiques dont les réunions sur un rythme bi-annuel, ont effectivement traité « en amont » certains des aspects les plus sensibles de cette protection. Sur le sujet de l'usage préventif de la Pyridostigmine, la question a été posée concernant une éventuelle prescription aux soldats ne disposant comme traitement d'urgence que de seringues auto-injectantes d'atropine. Une annexe au procès-verbal de la réunion de la sous-commission du 20 mars 1990, présidée par le Médecin général inspecteur Pasquier, Directeur du Centre de Recherches du Service de santé des Armées (CRSSA), mentionne : « En conclusion, nous pensons que la prescription de la Pyridostigmine doit être généralisée à l'ensemble des forces, même si, pendant quelques temps encore, certains combattants ne devaient disposer que de seringues d'atropine de première génération ». Dans ce même document (bordereau de transmission n° 1762/CRSSA/SDS du 19 avril 1990), une évaluation de l'effet de la Pyridostigmine par rapport à la physostigmine est établie : « NB. Etant incapable de franchir la barrière hémato-encéphalique, la Pyridostigmine ne protège pas l'acétylcholinestérase cérébrale. De nombreuses études montrent que cette molécule n'assure qu'une médiocre protection vis-à-vis des effets incapacitants en cas d'intoxication aiguë (Leadbeater et Coll. 1985). C'est la raison pour laquelle plusieurs auteurs préconisent une association prophylactique de physostigmine (ésérine) substance franchissant bien la barrière sang-cerveau et de scopolamine un anticholinergique dont l'action centrale est plus prononcée que l'atropine (Leadbeater et Coll. 1985 ; Somani et Dube 1989). La protection contre l'incapacitation due aux neurotoxiques OP12 est nettement meilleure. Néanmoins, la Pyridostigmine est supérieure à la physostigmine pour antagoniser les effets toxiques (létaux) ». Le recensement de la littérature médicale réalisé par le Rand's National Defense Research Institute à la demande du gouvernement américain révèle cependant que deux études conduites en 1995 et 1996 retiennent la possibilité d'une plus grande perméabilité de la barrière hémato-encéphalite dans des cas d'usage de Pyridostigmine en situation de stress (expérimentations sur la souris). Par ailleurs, une autre étude américaine s'est attelée à rechercher si une exposition durable à la chaleur (jusqu'à 38° Celsius) peut, sous certaines conditions d'environnement, accroître le risque d'un franchissement de la barrière hémato-encéphalite (étude également effectuée sur l'animal), dès lors qu'à été administrée de la Pyridostigmine.13 La mission a toutefois constaté que ses interlocuteurs aux Etats-Unis, et notamment les Professeurs Clauw et Gerrity de la faculté de médecine de Georgetown (Washington D.C.) ne retenaient pas pour certaines ces hypothèses, à ce jour, non prouvées sur l'homme. ● Un médicament connu La Pyridostigmine est, en fait, un médicament connu d'assez longue date des militaires notamment pour la prévention aux neurotoxiques. Ainsi, le « Manuel de l'OTAN sur les aspects médicaux des opérations de défense NBC » (AMedp-6-document non classifié) précisait dans sa réédition de juin 1980, soit dix années avant les opérations du Golfe : « b. Carbamates. Le prétraitement par le bromure de Pyridostigmine paraît être à peu près au point. La dose optimum est de 30 mg toutes les 8 heures. On peut espérer que le prétraitement par la Pyridostigmine supplantera le prétraitement par les oximes, excepté pour les personnels dont les yeux réclament une protection toute particulière contre le myosis 14 (ex. les équipages d'avion) » (chapitre 2 « Les neurotoxiques » pages 2-5). S'agissant du mode d'action des antidotes, ce même document mentionne « d. Les carbamates. Certains composés contenant un groupement carbamate, telle la Pyridostigmine, à condition qu'ils soient administrés avant l'intoxication et que l'atropine, l'oxime et les autres thérapeutiques soient mises en _uvre après l'empoisonnement, peuvent augmenter les chances de survie » (pages 2-3). La possibilité d'un usage par les armées de la Pyridostigmine, à titre préventif, présentait d'autant moins de caractère secret au début des années quatre-vingt, que ce médicament est largement prescrit par des médecins généralistes. Une famille de médicaments prescrits par la médecine civile, notamment pour le traitement des myasthénies, atonies intestinales ou gastriques, est apparue en France dès 1932. Les premières autorisations de mise sur le marché datent de 1944 et 1946 pour les formes d'ampoules puis de comprimés de la spécialité dite « Prostigmine ». S'agissant des mêmes affections, le docteur Yves Coquin, de la Direction générale de la Santé, a interrogé, à la demande de la mission d'information, le Directeur général de l'Agence française de Sécurité sanitaire et des produits de santé (AFSSAPS) pour obtenir des précisions concernant la spécialité actuellement en usage. Par une note du 30 janvier 2001 (jointe en annexe), M. Philippe Duneton, Directeur général de l'AFSSAPS a répondu : « L'unique produit à base de Pyridostigmine ayant obtenu une AMM en France est la spécialité Mestinon 60 mg, comprimé enrobé. Cette spécialité a obtenu l'AMM le 3 décembre 1974, validée le 10 janvier 1989 (Produits Roche). Le titulaire actuel (depuis le 7 mars 2000) est ICN Pharmaceuticals France - 24, rue Jean Rostand Parc Club Orsay 91383 Orsay Cedex. La rubrique "Effets sur la capacité de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines" de l'AMM validée le 10 janvier 1989 est vide (aucune modification concernant cette rubrique n'a été apportée depuis). Je joins à cette note une copie des autorisations de mises sur le marché et de leurs principales modifications. J'attire votre attention sur le fait que les données concernant la composition quantitative en excipients sont confidentielles. »15 Cet élément incontestable bat en brèche les affirmations de la journaliste Marie-Claude Dubin, qui dans un article publié ultérieurement à son audition par la mission d'information dans « Paris Match » (n° du 15 février 2001) a écrit que la Pyridostigmine était à l'époque de la guerre du Golfe « un médicament alors non autorisé et donné à 9 000 soldats français, selon les aveux tardifs du Général Roquejeoffre à l'Assemblée nationale, devant la mission d'information parlementaire... ». Par ailleurs, la Pyridostigmine ne faisait l'objet d'aucune dissimulation ou gestion particulière dans la pharmacopée de la Division Daguet. L'index thérapeutique Daguet publié en annexe V du rapport de fin de mission du 810ème HMCRA mentionne à deux reprises ce produit parmi les quelque 350 spécialités énumérées par ce document : d'une part, sous la forme injectable (6 boîtes) et d'autre part, sous la forme de comprimés de 30 mg (30 boîtes). On constate que la préparation des comprimés de Pyridostigmine à la disposition du SSA porte sur un dosage de 30 mg, inférieur de moitié à celui correspondant à la spécialité « Mestinon » que tout médecin peut dispenser, en France, à ses patients. ● Un long processus d'évaluation sur la base d'expertises Le principe d'emploi de la Pyridostigmine en tant que prétraitement contre le risque chimique a été arrêté au sein des armées françaises, au cours de l'année 1982. Une telle orientation était conforme aux préconisations de l'OTAN telles qu'exposées dans le document précité. Dans une fiche du 26 octobre 1982 adressée au Chef d'Etat-major des Armées par le Médecin général inspecteur Juillet, Directeur central du S.S.A., un point précis des propriétés de la Pyridostigmine est fourni sous le sceau de la sous-direction « Action scientifique et technique » (Bureau « Recherche »), « dans l'état actuel de nos connaissances ». Ce document est intégralement reproduit en annexe au présent rapport. La dernière mention de cette fiche mérite d'être citée : « La mise en place du produit doit s'accompagner d'une instruction à tous les niveaux ». En s'appuyant sur des rapports d'expertise, le Médecin général inspecteur Sclear, Directeur central du SSA, indiquait, deux années plus tard, au Chef d'Etat-major des Armées (lettre n° 351/DEF/DCSSA/AST/REC. du 23 septembre 1985) : « répondant à votre lettre de première référence16, je vous indiquais que le principe d'emploi de la Pyridostigmine, comme prétraitement, devait être retenu. Je vous confirme cette prise de position en y associant le traitement ci-dessus proposé ». Alors que le prétraitement par la Pyridostigmine se trouvait confirmé, cette lettre indiquait qu'en matière de traitement, une fois un militaire atteint par des neurotoxiques, un traitement dit « de deuxième génération » s'avérait désormais disponible. Ce traitement résultait des recherches conjointement menées par la Direction des Recherches, Etudes et Techniques (DRET) de la Délégation générale pour l'Armement (DGA) et les laboratoires du S.S.A., « en collaboration avec les centres spécialisés des armées occidentales ». Ce nouveau traitement constituait un progrès par rapport au traitement en usage (administration d'atropine par seringue auto-injectante) qui, selon cette lettre, manquait d'efficacité notamment contre le Soman. Il s'agissait d'injecter, dorénavant dès les premiers signes d'intoxication, trois substances : Atropine, Pralidoxine (Contrathion) et Diazepam (Valium) au moyen d'une seringue multicompartiments. Puis, dans une autre lettre à l'Etat-major des Armées (n° 47 DEF/DCSSA/AST/REC/CO du 7 février 1986), le Médecin général inspecteur Sclear faisait état d'une étude américaine sur les effets de ce produit sur l'homme sain. Des extraits traduits en français et considérés comme « les plus significatifs » du rapport TR 84-052 de l'Air Force aeromedical research laboratory intitulé « Effets de la Pyridostigmine sur les performances psychomotrices et visuelles chez l'homme sain » étaient joints à cette lettre. Au regard des résultats de cette étude expérimentale qui conclut à une bonne tolérance générale de la Pyridostigmine, le Médecin général inspecteur Sclear recommande néanmoins, par exception, une non-prescription de la Pyridostigmine aux personnels navigants opérationnels de l'armée de l'Air « ... pour lesquels une incapacitation aussi mineure soit-elle, n'est pas acceptable. Ce fait est d'autant plus légitime que les mesures de protection des personnels de l'armée de l'Air contre l'intoxication chimique, mettent le pilote à l'abri de ce risque, d'une façon quasi totale ». Le rapport d'origine américaine fait en effet état d'« une baisse de la capacité à réaliser des tâches multiples... ». Plus généralement, les auteurs de ce rapport émettaient une observation de prudence qu'il convient de souligner : « les baisses de performance observées le sont dans les conditions idéales d'un laboratoire ; les sujets ne sont pas " stressés ", l'ambiance est amicale et décontractée. Or, nous savons qu'une situation conflictuelle, une ambiance agressive peut faire apparaître ou aggraver une baisse de performance. On peut donc penser que la prise de Pyridostigmine en ambiance agressive peut provoquer un effet plus négatif que celui qui est présenté ici. L'analyse statistique des résultats peut n'apporter qu'une vue limitée des faits. Par exemple, supposons que dans une expérimentation les sujets présentent 30 % de réduction de leur performance pour les tâches complexes. Ces résultats en laboratoire, vraisemblablement, n'atteindront pas le niveau habituel de significativité. Cependant, la même détérioration de performance en situation militaire réelle peut avoir des conséquences considérables. » Sur la base de cette étude américaine de l'US Air Force, le personnel navigant de l'armée de l'Air française a d'abord été exclu du prétraitement par la Pyridostigmine. Dans une note à l'Etat-major de l'armée de l'Air, le Médecin général B. Brisou, sous-directeur « Action scientifique et technique » du S.S.A. (N° 200/DEF/DCSSA/AST/REC/CD du 16 avril 1986) rappelait ce principe de contre-indication à l'égard de la catégorie de personnels « ... qui reste, en revanche, soumis à l'autotraitement d'urgence en cas d'intoxication. De ce fait, les personnels navigants de l'armée de l'Air doivent être inclus dans les effectifs à doter de la seringue multi-compartiments ». Toutefois, une étude clinique réalisée dans le cadre d'une convention n° 25006-85 entre le Département de Pharmacologie clinique du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière et le Centre d'études du Bouchet (organisme relevant de la DGA) a abouti à faire évoluer cette position. Conduite sous la responsabilité du Professeur A.J. Puech, spécialiste en Pharmacologie clinique, cette étude dont les résultats ont été communiqués en novembre 1986 concernait la pharmacodynamie et l'évaluation de l'activité cholinestérasique de la Pyridostigmine en administration aiguë et chronique chez huit sujets volontaires sains de sexe masculin, âgés de 18 à 35 ans, sans antécédents médicaux majeurs ou allergiques. Cette expérimentation sur l'homme avait reçu préalablement à sa réalisation en contexte ambulatoire, l'aval du Comité d'éthique du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière. Le champ d'observation portait principalement sur les performances psychomotrices, la vigilance et la mémoire des sujets traités, sous Pyridostigmine pour une durée de 48 heures (comprimés de 30 mg pour trois prises quotidiennes à 8 h, 16 h et 24 h) et placebo (comprimés Duphar indiscernable de la Pyridostigmine et administré selon les mêmes modalités). En introduction au compte rendu de l'étude, le Professeur Puech rappelait les prophéties essentielles de la Pyridostigmine déjà mises en exergue par de nombreuses études (toutes les références expérimentales citées au titre de la bibliographie par l'étude sont d'origine anglo-saxonne) : « 1. INTRODUCTION 1.1 Buts de l'étude La Pyridostigmine (3-hydroxy-1-méthylpyridinium bromide diméthylcarbamate) est un composé quaternaire qui a la propriété de se lier réversiblement aux cholinestérases (carbamylation). Cette liaison a deux conséquences (cf. Figure 1) : * D'une part l'inactivation de ces enzymes. * D'autre part, elle empêche la fixation sur ces enzymes de produits organophosphorés qui forment avec elles des composés stables, entraînant une inactivation définitive. C'est à partir de cette dernière notion que l'on s'est intéressé à la Pyridostigmine en tant que traitement préventif d'une intoxication organophosphorée. » Dans ses conclusions, le Professeur Puech insiste sur l'innocuité du produit en soulignant toutefois que la faible posologie mise en _uvre ne peut assurer avec certitude l'efficacité de la protection. En tout état de cause, cette étude porte sur les effets de court terme et non de long terme de l'usage préventif de la Pyridostigmine : « 5. CONCLUSIONS L'objectif de cette étude était la recherche, chez l'Homme, d'effets centraux, périphériques et biologiques (enzymologiques), consécutifs à l'administration orale en traitement aigu et chronique (48 heures) de Pyridostigmine (30 mg toutes les 8 heures). Cette étude se situait dans le cadre d'une utilisation préventive vis-à-vis d'une éventuelle contamination par un agent neurotoxique organophosphoré. Elle a été réalisée en double aveugle contre placebo, chez 8 sujets volontaires, de sexe masculin, jeunes et en bonne santé, de façon à avoir un échantillon représentatif de la population susceptible de faire l'objet d'un tel traitement préventif. Les résultats mis en évidence avec la méthodologie employée ont été les suivants : - une absence presque totale d'effets centraux, - une absence d'effets périphériques, - une bonne tolérance, - une inhibition notable des cholinestérases sanguines (avec pour l'acétylcholinestérase un maximum de 8,8 p. cent le premier jour de traitement et 15,7 p. cent le troisième jour), inférieure toutefois aux valeurs préconisées comme nécessaires à une protection efficace. » Le seul effet contraire susceptible d'être imputé à la Pyridostigmine et reconnu comme tel par le S.S.A., sans toutefois justifier apparemment une contre-indication spécifique, est cité à la page 67 du document « Médecine des Armées » (N° spécial « Le Service de santé dans la guerre du Golfe » ; tome 20 n° 1 - 1992) : « Tout au plus, les effets résiduels d'un toxique général ou d'un antidote (dont la Pyridostigmine) pourraient gêner le protocole anesthésique ». Cette simple mention figure dans l'introduction d'un article du document précité qui a été corédigé par plusieurs médecins militaires. Il traite notamment des conditions de réalisation d'interventions chirurgicales sur des blessés ayant été contaminés par des armes de nature chimique. ● Une « valse hésitation » durable concernant les personnels naviguants de l'armée de l'Air Il paraît établi qu'au moment du déploiement des militaires français dans le Golfe, une certaine réticence subsistait quant à l'usage de la Pyridostigmine, spécialement au sein de l'Etat-major de l'armée de l'Air. Un mois avant que le Médecin général inspecteur Bladé ne lui succède à son poste, le Médecin général inspecteur J. Miné, Directeur central du SSA a adressé une note au Général Fleury, Chef d'Etat-major de l'armée de l'Air (N° 372/DEF/DCSSA/AST/REC/CD du 19 septembre 1990) par laquelle il lui indiquait lever toute contre-indication à l'usage préventif de la Pyridostigmine pour les personnels navigants opérationnels, au motif des progrès réalisés dans la connaissance du produit et en s'appuyant notamment sur l'étude conduite sur la responsabilité du professeur Puech qui « ... a démontré l'absence totale d'effets de ce produit sur la vigilance, l'attention et les facultés visuelles. Pratiquement, toutes les autres armées de l'Air occidentales prescrivent la Pyridostigmine à leurs pilotes ». Cette note avait pour objectif de « casser » le message n° 854/DEF/EMA.A/3.OPS/DPS/CD du 22 août 1990, par lequel le Général Fleury rappelait au personnel navigant la consigne de ne pas absorber de comprimés de Pyridostigmine. Interrogé par la mission d'information, le 28 novembre 2000, le Général d'armée aérienne Fleury, ancien Chef d'Etat-major de l'armée de l'Air (avril 1989-décembre 1991), a déclaré ne pas se souvenir de ces échanges et donc de la solution arrêtée pour les pilotes s'agissant d'un prétraitement dont le nom lui échappait d'ailleurs : il a en effet parlé de « protructimine » (sic) devant les membres de la mission. Au regard des informations dont elle a exigé la production, la mission d'information n'est pas en mesure de connaître avec certitude le degré d'usage préventif de la Pyridostigmine qui a été fait au sein des forces aériennes françaises dépêchées dans le Golfe. Elle dispose cependant d'un état précis des boîtes mises à la disposition de l'ensemble des forces sur le terrain et des restitutions opérées postérieurement aux opérations (document en annexe). De même, les caractéristiques de conditionnement et de fabrication (comprimés de 30 mg) lui ont été communiquées s'agissant d'un produit qui a fait l'objet, à l'époque, de commandes en urgence auprès de la Pharmacie centrale des Armées d'Orléans. ● Une non-dissimulation contrariée par un manquement du commandement En tout état de cause, l'Etat-major des Armées n'a pas cherché à cacher à l'opinion l'usage de la Pyridostigmine dans les forces au combat. La revue destinée au grand public « Terre Magazine » (Double n° spécial n° 22-23 de mars-avril 1991, « Golfe : l'armée de Terre en opération ») relate dans un de ses articles rédigé par M. Pierre Bayle, officier de réserve et journaliste (« L'offensive vue d'un VAB »), l'engagement du 1er Régiment de Spahis au sein duquel était « immergé » l'auteur de l'article pendant l'assaut terrestre. Ainsi pour le 23 février à 22 heures, ce soldat-reporter note : « L'ordre est transmis de prendre la deuxième pilule anti-chimique, celle qui permet à un tiers des neurones de survivre... Curieusement, l'équipage du VAB-Santé n'avait pas entendu l'ordre de prendre la première, huit heures plus tôt. Pourvu qu'ils ne tirent pas du chimique ! ». Cette narration, que l'on peut estimer précise, des faits tels qu'observés sur le terrain révèle l'absence d'une quelconque volonté de dissimulation et rend encore moins compréhensibles les « flottements » de la communication du ministère de la Défense ultérieurement constatés. Cet article montre, cependant, un facteur important : celui de la difficulté de connaître et de vérifier « en direct » comment les ordres d'administration d'une substance médicamenteuse sont diffusés et appliqués dans les unités. La mission d'information a conscience de l'existence d'une telle difficulté. Dans ce domaine, le non-respect des consignes comme l'automédication peuvent avoir des conséquences dommageables voire extrêmement graves. A cet égard, il reste regrettable que l'annexe 5 à l'ordre opérationnel n° 1 qui prévoyait l'administration de la Pyridostigmine « ...dès G-1, puis toutes les 8 h 00 jusqu'à nouvel ordre » n'ait pas été suivi d'effets pour ce qui concerne la décision du commandement d'arrêter ce prétraitement. En effet, aucun ordre écrit en ce sens n'est intervenu et, de ce fait, sa diffusion a pu être encore plus aléatoire. Au cours de son audition du 12 décembre 2000, le Général d'armée Bernard Janvier a d'ailleurs reconnu ce fait : « Je ne suis pas en mesure d'indiquer précisément à la mission d'information à quel moment j'ai donné l'ordre d'arrêter la prise de la Pyridostigmine, mais la menace étant levée le 28 février au matin, j'ai sans doute donné un ordre oral lors de la réunion des commandants d'unités qui s'est tenue à mon PC, à As Salman, à partir de 9 heures ». b) L'utilisation d'une substance éveillante nouvelle ● Le « Virgyl » un produit mis à l'étude par le Service de Santé des Armées Au regard des pratiques médicales constatées parmi les autres forces coalisées, la France s'est singularisée plus particulièrement sur un point. Il s'agit de l'administration d'une substance dite « éveillante » dont le nom de code militaire était le « Virgyl ». Cette molécule de synthèse faisait l'objet d'études depuis plusieurs années avant l'engagement des opérations du Golfe, en particulier au Centre d'Etudes et de Recherche de Médecine Aérospatiale (CERMA), une structure dépendant de la DCSSA et qui collaborait sur ce thème avec le laboratoire pharmaceutique privé Lafon. La poursuite de telles recherches n'a rien d'anormal en soi au sein de forces du niveau des Armées françaises qui s'interrogent de longue date comme la plupart de leurs homologues sur les moyens de mieux garantir les performances intellectuelles et physiques des militaires en opération et aussi de mieux connaître les limites à la fatigue comme les ressorts de la récupération individuelle. Contrairement à ce que la mission a relevé s'agissant de la Pyridostigmine, l'armée de l'Air n'a nullement manifesté une même réticence de principe vis-à-vis du « Virgyl » mais a joué un rôle essentiel dans les travaux concernant cette substance puisque c'est au sein du Laboratoire central de biologie aérospatiale du CERMA que les études et les premières évaluations ont été conduites. Comme l'a indiqué à la mission le Médecin général inspecteur Bladé lors de son audition, le spécialiste du Service de Santé des Armées chargé de ce programme était le médecin en chef D. Lagarde. Les sujets visés au premier chef par l'usage du « Virgyl » étaient les pilotes et techniciens de l'Air, les artilleurs, les conducteurs de poids lourds et, plus généralement, tout ceux dont la disponibilité opérationnelle peut être sollicitée sur de longues périodes, sans pouvoir être aisément remplacés à leur poste, ce qui est également le cas de certaines unités remplissant notamment des tâches de renseignement sur le terrain, comme les « CRAPS ». Les développements concernant le « Virgyl » poursuivaient ainsi un but compréhensible. Leur légitimité ne parait pas devoir être mise en cause dans le principe, si ces recherches visaient effectivement à trouver un substitutif à l'emploi d'« excitants » prescrits au combat par quasiment toutes les armées du monde dans des conditions plus ou moins précises et pour des effets difficilement maîtrisables. - A quelques semaines de l'offensive terrestre, le « Virgyl » dont l'un des noms de spécialité pharmaceutique est le Modafinil, avait fait l'objet de nombreuses expérimentations sur l'animal et, depuis peu, d'une expérimentation sur des volontaires sains. Sur ce point, le Ministre de la Défense avait sollicité au cours de l'année 1990, l'avis du comité d'éthique du SSA (CESSA) pour conduire une expérience sur des volontaires sains. Le procès verbal de la réunion tenue par le comité le 13 juin 1990, apporte d'intéressantes informations. En premier lieu et s'agissant de la justification de ce projet, il est indiqué que le Modafinil est une substance « ... efficace et pratiquement dépourvue d'effets secondaires » mais qu'il restait nécessaire d'une définir les conditions d'emploi sur l'homme « avant que son usage ne soit autorisé, usage qui ne pourrait être qu'exceptionnel et sur ordre des instances hiérarchiques supérieures ». Il peut paraître étonnant que l'innocuité de la substance qui en tout état de cause ne pouvait résulter, à cette date, que d'expérimentations sur l'animal, fasse figure de postulat dans ce document. En outre, il est indiqué que le Modafinil « est utilisée depuis quatre ans chez l'homme dans le traitement des troubles de la vigilance (hypersomnie) où elle a montré son efficacité sans effets secondaires ». Cette mention semble incomplète, dès lors qu'à défaut d'autorisation de mise sur le marché (cf. infra page 114) le traitement mentionné ne pouvait avoir lieu qu'en milieu hospitalier et probablement sur la base de protocoles spécifiques ne concernant qu'un faible nombre de patients. - Si le Comité d'éthique a émis un avis favorable au projet qui lui a été soumis, deux de ses appréciations limitent considérablement la portée de son approbation : . en premier lieu, le Comité a souhaité que les prises de Modafinil portent sur des doses inférieures à celles exprimées par les auteurs du protocole : de 900 mg/jour (3 prises de 300 mg toutes les huit heures), la recommandation qu'il a retenue a été de 600 mg/jour (3 prises de 200 mg toutes les huit heures) ; . en second lieu, le Comité a tenu à exprimer une réserve de principe : « Le CESSA unanime déclare qu'il est très grave de s'engager dans la voie de l'usage à des fins non thérapeutiques de ce type d'agent pharmacologique. Il émet les plus expresses réserves vis-à-vis d'une généralisation de son emploi. L'expérimentation projetée chez l'homme ne doit être entreprise que pour déterminer les conditions de son emploi dans des conditions tout à fait exceptionnelles, l'ordre d'utilisation de la substance ne devant être donné que par une des plus hautes autorités de la Défense nationale ». Cette observation de caractère solennel qui émane d'un organe consultatif relevant de la DCSSA (le signataire de l'avis est le Médecin général inspecteur Antoine, Inspecteur général du Service de Santé des Armées qui présidait le Comité) témoigne d'une attitude plutôt méfiante à l'égard du « Virgyl » pourtant développé au sien du Service. Il semble évident que ce produit a suscité une inquiétude quant aux risques de détournement ou d'excès dont son usage pouvait être l'objet. La mission d'information a été en effet amenée à constater chez les médecins militaires une gêne d'ailleurs persistante sur ce point, d'ailleurs soulignée par certains d'entre eux dans des rapports d'activité. ● L'expérimentation sur l'homme effectuée peu de temps avant la décision d'emploi L'opération « Dauphin » a été réalisée en novembre et en décembre 1990 (soit moins de trois mois avant le déclenchement de l'offensive terrestre), en milieu militaire, chez huit volontaires sains, à l'Hôpital d'instruction militaire (HIA) Larrey de Versailles. Cette opération avait pourtant d'évaluer l'efficacité de l'administration du « Virgyl » lors d'une privation de sommeil pouvant aller jusqu'à 60 heures, par la mises en _uvre de techniques de contrôle électrophysiologique et psychomotrice. - Sans qu'il soit nécessaire de reproduire intégralement les mesures alors effectuées du fait de leur caractère éminemment technique, on précisera cependant qu'elles ont principalement porté sur les latences moyennes d'endormissement des sujets sous placébo et Modafinil, la qualité du sommeil pré et post administration ainsi que sur des tests psychomoteurs de base (traitement spatial, raisonnement grammatical et calcul arithmétique). Les conclusions de cette expérimentation se sont avérées positives pour le Service de santé des Armées qui a considéré que le « Virgyl » permettait la conservation d'« un niveau de performance psychomotrices constant en dépit d'une privation de sommeil de 48 à 60 heures ». Dans une note de la Direction centrale du Service de santé des Armées (DCSSA) pour l'Etat-major des Armées, en date du 7 mars 1991 (donc postérieure à l'engagement terrestre), un premier bilan des dispositions prises par la DCSSA est dressé en matière de protection contre le risque « NBC ». Cette note consacre également un développement particulier au « médicament de l'éveil », un sujet apparemment distinct de l'objet principal de ce document. Sur ce dernier point un rappel important est mentionné en page 7 de la note : « Comme la substance éveillante « Virgyl » aurait pu être utilisée en ambiance chimique, il avait été vérifié (expérimentation effectuée sur des primates non humains) qu'il n'y avait pas d'incompatibilité ni entre le « Virgyl » et la Pyridostigmine, ni entre le « Virgyl » et l'autotraitement d'urgence sur des animaux intoxiqués17 ». Cette affirmation a posteriori rassurante précise l'existence de travaux antérieurs à l'expérimentation sur l'homme, afin de se prémunir contre d'éventuelles interactions entre le « Virgyl » et certains produits, sans toutefois retenir, à ce titre, les vaccinations. - C'est au point IV de la note précitée du 7 mars 1991 pour l'Etat-major des Armées, qu'une description précise est apportée sur la chronologie et les conditions de mise en _uvre du « Virgyl », sous le titre « Utilisation d'une substance éveillante » : « Le 18 janvier 1991, la DCSSA a procédé à la mise en place, auprès des médecins de l'opération Daguet, de 2 250 boîtes de huit comprimés de la substance éveillante appelée « Virgyl ». Ce composé avait fait l'objet d'une expérimentation chez l'homme en novembre 1990, dans des conditions se rapprochant de celles rencontrées en opérations. Son efficacité et l'absence d'effets secondaires avaient été démontrés. Dans l'hypothèse d'opération type « continu », ce médicament a donc été mis en place, son utilisation ayant été limitée à des situations opérationnelles dont l'évaluation appartenait au commandement, lui seul étant à même d'en ordonner l'emploi. Aucune information précise n'est encore parvenue, à la date de rédaction de cette note, sur l'utilisation qui a pu être faite du « Virgyl ». Il semble qu'il en ait été distribué lors du déclenchement de l'opération terrestre sur As Salman le 24 février 1991. Un rapport complémentaire sera rédigé lorsque toutes les informations auront été réunies. L'emploi de cette substance n'est justifiée qu'en opération. Hors temps de crise, en particulier sur le territoire métropolitain, son emploi n'est plus conforme à la législation française sur les médicaments. Aussi les boîtes non utilisées sont-elles en cours de rapatriement et elles seront stockées par la Pharmacie centrale des armées. La fiche en annexe rappelle les conditions d'emploi qui se trouvent dans chaque boîte ». La mission d'information estime pour sa part que l'administration d'une telle substance sans autorisation de mise sur le marché préalable justifie un suivi particulier des personnels (notamment les soldats du 11ème Régiment d'Artillerie de Marine et du 1er Régiment de Spahis) qui en ont absorbé au cours du conflit. S'agissant des forces aériennes, une directive n° 000163 / DEF / EMAA / 3.OPS / SV / CD du 31 janvier 1991, signée par le Général de corps Aérien Vallat, Major général de l'armée de l'Air, a clairement posé les principes et les limites d'utilisation du produit. En précisant d'emblée que l'administration du « Virgyl » ne pouvait correspondre qu'à « certaines situations particulières » et pour « le personnel dont l'activité est nécessaire à la conduite d'opérations réelles ou au support direct de ces opérations » (liste incluant les pilotes, contrôleurs aériens, officiers assurant le suivi et le contrôle des opérations, servants de l'artillerie sol-air etc...), cette directive encadrait strictement les conditions d'emploi, non sans avoir rappelé : « ce produit ne supprime pas la nécessité de sommeil ; il en diffère le besoin ». En tout état de cause, l'usage du « Virgyl » supposait, selon cette directive, que deux conditions soient réunies : - un personnel en situation de manque de sommeil ; - un besoin impérieux de poursuivre une activité soutenue, de terminer une mission se révélant plus longue qu'initialement prévue ou d'effectuer une nouvelle mission. De plus, une procédure était définie pour autoriser l'administration, à titre exceptionnel, de cette substance : a) la demande d'emploi est formulée par le Commandant d'unité, le Chef de détachement ou le Commandant de bord ; b) l'autorisation est donnée par le Commandant des Eléments Air en ce qui concerne les personnels en place sur le lieu des opérations, ou par le Commandant du Grand commandement d'emploi en ce qui concerne les équipages qui seraient amenés à effectuer au départ de la métropole, des missions en rapport avec les opérations en cours et qui se trouveraient dans les conditions définies au paragraphe précédent. c) Le produit est prescrit par le médecin de l'unité dans le strict respect de la posologie (cf. page précédente). En particulier le maintien de l'éveil ne devra pas dépasser 48 heures, et un nouveau cycle ne pourra intervenir que 15 heures, dont 8 heures de sommeil, après la dernière prise ». Pour ce qui concerne l'armée de Terre au regard des constations rapportées ultérieurement au conflit par des médecins militaires, il semble toutefois que les chefs de corps aient eu une plus large autonomie en ce domaine que les officiers supérieurs de l'armée de l'Air. A cet égard, l'audition du colonel Bernard Dampierre (E.R.), ancien chef de corps du 6ème Régiment de Commandement et de Soutien (6ème RCS) révèle que le « Virgyl » mis à sa disposition ne constituait pas pour lui une préoccupation essentielle et que ses directives, en la matière, n'avaient pas été clairement indiquées au sein de son unité ce qui pouvait laisser aux infirmiers une grande latitude. ● L'attitude ambivalente des médecins militaires Au début de l'année 1991, le Modafinil ou « Virgyl » n'avait pas reçu d'autorisation de mise sur le marché (A.A.M.), ni d'ailleurs aucune autre spécialité de base incorporant cette molécule. Ce point est avéré par les informations fournies par le Directeur général de l'Agence française de Sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSPS) au Directeur Yves Coquin de la Direction générale de la Santé, à qui la mission d'information avait demandé de lui fournir ces données essentielles. - Dans sa note du 30 janvier 2001, le Directeur général de l'AFPSSPS a apporté les précisions suivantes au Docteur Coquin qui en a immédiatement fait part à la mission d'information : « En réponse à votre fax du 15 décembre 2000, je vous informe qu'après avis de la commission d'AMM n° 142 du 6 décembre 1991, des autorisations de mise sur le marché ont été octroyées le 24 juin 1992 aux laboratoires : ● Lafon L pour la spécialité Modiodal 100 mg, comprimé ; ● Clin Midy pour la spécialité Modafinil Clin Midy 100 mg, comprimé. Le titulaire actuel (depuis le 16 mai 1994) est Lafon François 41, avenue Foch 75116 Paris. Ces AMM ont été octroyées avec les indications suivantes : ● Narcolepsie avec ou sans cataplexie ● Hypersomnie idiopathique. La spécialité Modiodal 100 mg, comprimé a fait l'objet d'une demande d'extension d'indication, accordée le 21 janvier 1994. La rubrique actuelle 4.1 « Indications thérapeutiques » du Résumé des Caractéristiques du Produit comporte les mentions suivantes : « Narcolepsie avec ou sans cataplexie, Hypersomnie idiopathique. Dans les formes typiques de narcolepsie avec cataplexie, le diagnostic est clinique. Dans les formes atypiques de narcolepsie et dans les hypersomnies idiopathiques, le diagnostic clinique doit être confirmé par : ● un enregistrement polygraphique du sommeil (EPS) au minimum de nuit ou de 24 heures (à l'hôpital ou en ambulatoire avec le système holter) et ● un test itératif de latence d'endormissement (TILE), réalisé par un centre d'exploration du sommeil. » A cet égard, il est intéressant de constater que le Service de santé des Armées s'appuie aujourd'hui sur les autorisations de mise sur le marché accordées postérieurement au conflit du Golfe, alors qu'au cours des opérations, la substance concernée avait pourtant été prescrite par anticipation de toute autorisation des autorités sanitaires. Dans une lettre du 13 décembre 2000 (n° 6574 / DEF / DCSSA / AST / TEC) adressée au Président de la mission d'information pour faire suite à sa demande datée du 20 novembre 2000 afin d'obtenir la communication des résultats des expérimentations conduites avant 1991, le Médecin général Gautier, actuel Directeur central du Service de santé des Armées, nous écrivait : « J'attire votre attention sur le fait que ce produit, le Modafinil, est actuellement commercialisé avec des restrictions d'utilisation très strictes liées non à une quelconque toxicité mais aux risques de mésusage et d'utilisation détournée. En conséquence, il apparaît indispensable d'éviter toute publication de ces essais afin de ne pas encourager ce type d'usage non conforme à l'autorisation de mise sur le marché telle qu'elle est décrite dans la fiche d'information thérapeutique publiée au journal officiel du 7 novembre 1999. » - L'esprit qui avait présidé aux réserves formulées sur l'emploi du « Virgyl » par le Comité d'éthique, au-delà même de la compétence consultative de cette instance, paraît également avoir été partagé par une partie des médecins du Service de santé des Armées. Différents rapports d'activité destinés à leur hiérarchie font état de ce qui pourrait être qualifié d'un « malaise » concernant le « Virgyl ». Les psychiatres dépêchés dans le Golfe ont ainsi mentionné certaines observations en ce sens. Dans le rapport sur son séjour opérationnel effectué du 17 janvier au 15 mars 1991, à l'Hôpital mobile de campagne et de transit Air (HMCTA) de Riyadh18, le Médecin en chef Gallé-Tessonneau, Professeur du Service de santé des Armées estime que « les modalités de la mise en place du « Virgyl » dans le cadre de l'opération Daguet sont à critiquer. L'absence d'information préalable, tant du commandement que du Service de santé des Armées a entraîné une attitude de méfiance, voire de suspicion à l'égard d'une substance inconnue de la grande majorité des utilisateurs et des prescripteurs. Une notice explicative pourtant rédigée de façon précise, mais qui n'était pas authentifiée par une référence scientifique ou par une autorité de Service, n'a pas suffit à entraîner une adhésion positive. Le caractère ambigu d'une prescription médicale sur ordre du commandement a encore ajouté à la confusion, chacun attendant des autres les informations nécessaires. Cela a conduit à une utilisation très restrictive et très limitée en pratique. Une initiative personnelle d'apport d'information s'est vite trouvée limitée par la grande dispersion des utilisateurs potentiels, par l'ignorance des limites de l'information autorisée, l'absence d'un responsable désigné et le risque de faire apparaître le « Virgyl » comme produit psychiatrique. Si la mise à disposition d'un tel produit semblait légitime dans de telles circonstances opérationnelles, encore aurait-il fallu l'accompagner d'une information suffisante effectuée par un responsable désigné et chargé d'en définir les conditions et modalités d'utilisation. Enfin, les aides pharmacologiques qui n'ont pas d'indication thérapeutique directe mais qui font cependant l'objet d'une prescription par le médecin présentent des implications déontologiques qui devront être mieux explicitées à l'avenir. » Pour sa part, le Médecin en chef Lafont, Professeur agrégé, Conseiller du Commandement en matière d'hygiène mentale au cours de l'opération Daguet mentionne ce déficit d'information dans son rapport d'activité19 : « ordre de diffuser le produit communiqué aux pharmaciens afin qu'il soit délivré, sous la responsabilité des médecins, mais sans qu'aucune information technique ne soit disponible ... Il va sans dire que ces attitudes de défiance, outre le malaise qu'elles engendraient, ne facilitaient pas l'exécution des ordres mêmes » (page 10). Ce psychiatre ajoutait : « ... à propos de l'utilisation du « Virgyl » déjà évoquée, une mise au point, sollicitée auprès de la Direction Santé de Riyadh a alors été effectuée par le Médecin en chef Gallé-Tessonneau » (page 15). Cette dernière observation confirme l'« initiative personnelle d'apport d'information » dont a fait état le premier psychiatre dont la mission d'information a relevé, ci-dessus, les observations. Plus tardivement dans un ouvrage collectif « Psychiatrie militaire en situation opérationnelle », publié en 1998 dans la collection scientifique de la revue « Médecine et Armées » et de la Société française de Médecine des Armées, le Professeur Lafont tirera des conclusions d'ordre déontologique sur l'usage en opération de produits hors du champ thérapeutique : « L'utilisation de substances destinées à améliorer les capacités opérationnelles pose d'importants problèmes. Ces produits ne sont pas des médicaments destinés à traiter un état pathologique, ils ne peuvent pas non plus être assimilés à des vaccins ou à une protection contre les agressions, tels que la Pyridostigmine, par exemple. Le type en est le Modafinil, eugrégariant, strictement limité dans son emploi thérapeutique à des indications peu nombreuses. Son emploi en situation opérationnelle ne peut pas être tenu pour l'inverse de celui des tranquilisants. Ces derniers répondent à des demandes inscrites dans une perturbation passagère, du sommeil ou affective, soumise au médecin dans le cadre de ses attributions. Tout autre est l'administration de psychotropes à des sujets sains, hors d'un acte de prescription. Le problème est que, même si l'ordre de la prise de telles substances émane du commandement, la compétence des médecins pour être requise, directement ou pas, soit qu'on les en instaure dépositaires, soit qu'on leur demande d'en surveiller les effets éventuellement gênants ou les abus possibles. Il n'est pas envisageable d'engager la responsabilité du corps médical dans la décision d'usage de ces molécules, mais il est aussi très difficile pour lui de demeurer totalement à l'écart après qu'elle ait été effectivement prise. Les médecins seront inévitablement comptables des effets latéraux, s'il s'en produit ou des conséquences de l'interaction avec d'autres psychotropes. Ils ne peuvent donc ni se solidariser avec l'emploi opérationnel de telles substances, ni se désolidariser des suites éventuelles de leur administration » (pages 319 et 320). Ces observations révèlent des interrogations légitimes d'ordre déontologique mais aussi une gêne sans doute plus profonde. Les médecins du Service de santé des Armées ont exprimé une crainte diffuse à l'occasion de l'épisode du « Virgyl ». Elle traduit leur inquiétude de se voir en quelque sorte dépossédés par les états-majors pour la détermination des conditions d'usage d'une substance au développement de laquelle les chercheurs du Service de santé ont pourtant pris une part déterminante. C'est peut-être pour cette raison que dans sa conférence sur « Les leçons médicales de la guerre du Golfe » prononcée, le 10 juin 1992, devant des étudiants en médecine à l'Ecole du Service de santé des Armées de Bordeaux, le Professeur Cudennec n'évoque à aucun moment le « Virgyl » ou Modafinil, alors qu'il décrit très en détail l'ensemble du dispositif sanitaire, les moyens de prévention et les traitements planifiés puis mis en _uvre dans le cadre de cette opération. (texte de cette conférence transmis à la mission d'information) ● L'insuffisance du bilan médical des conséquences de l'administration du produit Dans un rapport du CERMA (n° 91-30 de septembre 1991), un bilan a été dressé pour ce qui concerne la question de la vigilance au cours du conflit du Golfe. Ce travail a été réalisé par la Division de Neurophysiologie dirigée par le Médecin en chef Lagarde au sein du Laboratoire central de biologie aérospatiale. Ce chercheur était également l'instigateur-coordinateur de l'expérimentation « Dauphin » conduite dix mois auparavant. - Ce document confirme d'ailleurs que la Division de Neurophysiologie travaillait de longue date sur des substances d'éveil. Il précise en effet que le Modafinil est une molécule de synthèse (diphénylméthyl-sulfinyl-2-acéanide) dont le précurseur l'Adrafinil (ou Olmifon) avait fait l'objet d'études dès 1980. Les travaux de recherche ont essentiellement été effectués sur le macaque Rhésus « modèle primate privilégié pour l'étude du sommeil de l'homme », avant toute expérimentation sur l'homme. (page 10) Au sein du Laboratoire central de biologie aérospatiale, les noms de code attribués au Modafinil étaient : CRL 40476 ou CRL 40028D1. La première évaluation « de terrain » concernant les effets de l'administration du « Virgyl » semble avoir été traduite par le compte rendu de la mission du Médecin principal F. Louisy, effectuée les 12, 13 et 14 mars 1991, auprès de la Division Daguet et plus particulièrement au sein du 11ème Régiment d'artillerie de marine (11ème RAMA)20. Ce document rappelle, en premier lieu que sur la base des résultats de l'expérimentation « Dauphin » considérés comme probants « ... il fut décidé de mettre à la disposition du personnel opérationnel la molécule sous le nom de code « Virgyl » (réf. message n° 88 / DEF / DCSSA / CO du 18 janvier 1991) : ce message précisait d'ailleurs que « ce produit n'est pas inscrit au Vidal... ». Dans le même laps de temps, le C.E.R.M.A. et le Centre de Recherches du Service de Santé des Armées (C.R.S.S.A.) vérifiaient sur l'animal que l'association du VIRGYL avec les thérapeutiques contre l'agression chimique d'une part, et un toxique d'autre part, n'étaient pas contre indiquée. Les résultats furent communiqués par messages n° 54/CERMA/S.DIR.RECH./CD du 08 février 1991 et n°70/CERMA/S.DIR.RECH./CD du 20 février 1991 ». « La décision d'utilisation du « Virgyl » était du ressort du commandement en liaison avec le médecin d'unité. » « Le « Virgyl » a été mis à la disposition de régiments de la division Daguet suite à une décision de commandement. Par une note du 12 février 1991 (n° 458 / COM.DIV.DAGUET / CEM), il était précisé que le médicament « était réservé aux personnels pour lesquels la nécessité du maintien d'un éveil prolongé de 4 ou 5 heures était opérationnellement indispensable ». En outre, cette note précisait que « la désignation des personnels concernés était de la responsabilité du commandement » et que « la prise du « Virgyl » se ferait uniquement sur ordre, à raison de 2 comprimés en 1 prise unique seulement ». - Les conditions de l'enquête conduite par le Médecin principal Louisy apparaissent parfois insuffisantes, même s'il est aisément concevable que son intervention, au lendemain de l'offensive terrestre, ait pu rencontrer certaines difficultés d'ordre pratique. Ainsi, ce médecin semble avoir fondé son appréciation concernant l'étendue de l'utilisation du « Virgyl » sur les déclarations qui lui ont été faites par le responsable « Santé » de la Division. Elles l'ont amené à considérer que le 11ème RAMA avait été le seul régiment à procéder à une administration à grande échelle de ce produit. Il a donc concentré son étude sur cette unité pour laquelle il relève que « l'ordre a été donné d'utiliser le « Virgyl » dans la soirée du dimanche, après avis du Médecin chef, afin d'assurer l'efficience opérationnelle des personnels au moins pour la nuit du dimanche au lundi21 ». (page 4) Puis selon la technique de l'interrogatoire des personnels portant sur une quarantaine de militaires au total, le Docteur Louisy a constaté une utilisation inégale du produit au 11ème RAMA : si tous les cadres de son PC en ont fait usage, seule la batterie dite B4 a également fait un large usage du « Virgyl » contrairement au deux autres batteries du régiment. Par ailleurs, il a noté l'« oubli » (entre guillemets dans le compte rendu) de l'officier commandant l'unité TC2 (train de combat du régiment comptant environ 230 hommes), auquel le Médecin-chef avait pourtant confié le produit : aucun des utilisateurs du TC2 n'ayant en conséquence absorbé de « Virgyl ». S'agissant des autres régiments, « une rapide enquête conduite auprès de médecins chefs » a conforté le Docteur Louisy dans son opinion que « hors du 11ème RAMA, aucun de ces régiments n'a utilisé le « Virgyl » pendant la phase intense des opérations terrestres. Tout au plus, la prise a été ponctuelle et elle a surtout concerné les chauffeurs de véhicules, lorsqu'ils devaient assurer une conduite de nuit ». Cette affirmation ne correspond pas exactement aux déclarations faites devant la mission d'information par différents responsables qui ont plutôt indiqué que le 1er Régiment de Spahis avait probablement été l'unité la plus concernée par le « Virgyl ». Un article de « Terre Magazine » n° 22-23 de mars-avril 1991, une publication officielle à destination du grand public, mentionne d'ailleurs la distribution du « Virgyl » par les infirmiers du 1er Régiment de Spahis, dès l'après-midi du 23 février : « - 16h30 : l'infirmier fait le tour de l'escadron pour distribuer les pilules de « Virgyl », celles qui permettent de ne pas dormir pendant 48 heures ». 22 Mais l'observation la plus importante du compte rendu précité concerne la posologie : « Dans certains cas, la posologie préconisée pour la prise de ce médicament n'a pas été rigoureusement suivie, conformément aux directives de la note de service émanant du Comfor. L'erreur a porté tant sur la quantité de produit à intégrer (2 comprimés en 1 fois pour certains, 2 comprimés à 2 ou 3 reprises séparées par des intervalles de 8 heures pour d'autres, 1 comprimé en 1 fois ...) que sur le moment de la prise du médicament (1ère prise le dimanche matin ou le dimanche soir) ». Les conclusions de ce compte rendu portent à la fois sur : - l'efficacité du « Virgyl » : « éveil de très bonne qualité avec une vigilance maintenue de très bonne performance malgré un manque de sommeil évident ». Les propos du Médecin chef du 11ème RAMA tels que rapportés témoignent : après la prise du 2ème comprimé, d'« un confort intellectuel », d'« un esprit clair », de l'absence de sensation d'« yeux brûlés » ; - l'innocuité du « Virgyl » : absence d'« effets adverses » (pas de surexcitation ou de difficultés d'endormissement), possibilité d'acquérir, soit pendant la période d'effet du médicaments, soit après cette période, « un sommeil volontaire et de bonne qualité, sans difficultés particulières au réveil ». Le docteur Louisy a noté que l'absorption concomitante de la Pyridostigmine n'entraînait pas d'effets secondaires notables, sauf un faible nombre de cas de troubles intestinaux « que l'on attribue sans doute à l'usage de la Pyridostigmine, comme l'ont confirmées des observations faites chez des individus ayant utilisé la seule thérapeutique préventive anti-toxiques ». En dépit d'une méthode quelque peu empirique dans l'analyse, les conclusions tirées pour l'avenir par ce médecin militaire paraissent judicieuses : « On peut s'étonner enfin de l'imparfaite observance du traitement, l'utilisation du VIRGYL ayant été inégale, parfois mal comprise et en tout cas insuffisante. Il existe des causes évidentes et des raisons tacites. Les causes évidentes résident dans le fait que l'information émanant du COMFOR, par le biais de la note de service précisant les conditions d'utilisation de la molécule, n'est pas descendue au niveau de toutes les unités. Il en résulte qu'un certain nombre de médecins et de commandants d'unité se sont retrouvés possesseurs d'un médicament nouveau, mal connu, avec sa notice d'utilisation certes, mais n'ayant pas l'agrément des structures de commandement et de chefferie Santé divisionnaires. Les raisons tacites sont en première analyse explicables par le fait que l'arrivée de ce médicament, peu connu, ayant une connotation expérimentale, a suscité, chez les médecins peu informés aussi bien que chez les personnels non médecins, une certaine méfiance et une confusion dans l'observation du traitement, même avec l'aval du commandement divisionnaire. L'utilisation du VIRGYL, dans des conditions opérationnelles, devra donc faire l'objet d'études ultérieures, en prenant en compte le fait qu'une meilleure information sur le médicament devra être apportée aux personnels, quant à ses modes d'action, ses indications, ses conditions d'utilisation et son inocuité ». Le rapport-bilan du CERMA fait également état d'une étude réalisée à l'Hôpital d'instruction des Armées (HIA) Begin à Saint-Mandé au retour d'un groupe de militaires appartenant aux commandos de recherche et d'action dans la profondeur (CRAPS). Cette évaluation réalisée au début du mois de mars 1991 n'a concerné qu'un nombre limité de sujets (une dizaine) qui avaient la particularité d'avoir été dépêchés de France, le 11 février 1991, pour accomplir des missions de nuit immédiatement après leur arrivée dans le Golfe (c'est-à-dire dix jours avant l'offensive terrestre). Les conducteurs de véhicules et le médecin-chef de ce groupe ont absorbé du « Virgyl » : aucun effet secondaire, voire perturbateur du sommeil ultérieur, n'a été constaté parmi eux. Il est vrai que cette catégorie de personnels est, par nature, particulièrement bien entraînée et résistante. Le rapport note en conclusion de ce développement : « la difficulté rencontrée par le médecin-chef pour se procurer le "Virgyl" auprès de la pharmacie de l'hôpital de campagne. La seule connaissance du médecin-chef sur le produit était issue d'un article paru quelques semaines auparavant dans "Médecine et Armées" que cet officier avait emporté avec lui ! ». ● Les leçons à tirer Le bilan de l'utilisation du « Virgyl » dans les forces reste à parfaire. Les études de long terme que le rapport du CERMA semblait annoncer n'ont pas été communiquées à la mission d'information. Il n'est pas certain que les personnels ayant fait l'objet des premiers bilans, en mars 1991, aient été ultérieurement suivis, du moins pour ce qui concerne d'éventuels effets durables ou récurrents du « Virgyl ». - Si la mission a pu connaître le nombre de boîtes de cette substance mises en place au cours des opérations (2 250 boîtes de 8 comprimés chacune), elle n'a pas disposé comme pour la Pyridostigmine, d'un état détaillé des boîtes restituées et éventuellement détruites au terme du conflit. Dans ces conditions, aucun chiffre précis ne pouvait être reconstitué quant à la population ayant absorbé sur place un ou plusieurs comprimés de « Virgyl ». Cette donnée ne semble d'ailleurs pas connue du Service de santé des Armées, ce qui serait manifestement une grave lacune alors qu'il s'agissait du premier usage, en opération, d'une molécule nouvelle. Un défaut d'information, d'ailleurs relaté par des comptes rendus, a suscité méfiance et confusion, y compris de la part de chefs de corps et de médecins-chefs d'unité, à l'égard d'un produit qui conservait de la sorte une forte connotation expérimentale. En l'absence de registres spécifiques tenus par les médecins et les infirmiers, la mission d'information en est réduite à estimer sur la base des témoignages et rapports d'activité, que le nombre des personnels relevant de la Division Daguet qui aurait utilisé le « Virgyl », serait, en toutes hypothèses, inférieur à 10 % des effectifs. Une évaluation « raisonnable » pourrait porter sur un nombre compris entre 400 et 700 militaires. Un manquement de cette nature augure mal des possibilités d'étude à long terme supposant la constitution de cohortes d'utilisateurs, sauf en se fondant sur les seules déclarations d'anciens militaires qui, à dix années de distance, peuvent ne plus se souvenir avec certitude des substances qu'ils ont eu l'ordre de prendre, ou encore confondre différents produits. - Quand bien même l'histoire de la médecine prouve qu'un certain nombre de progrès aient pu résulter des pratiques de guerre, ce qui est d'ailleurs principalement vrai en matière chirurgicale, les médecins militaires ne sont pas pour autant habilités à mettre en _uvre sur le terrain des substances ou des thérapeutiques non validées par les autorités sanitaires et, de ce fait, dans un cadre extra-légal ou extra-réglementaire. A défaut, l'opinion ne manquerait pas de considérer que le Service de santé des Armées outrepasse ce qu'il lui revient de faire. Un risque de suspicion durable peut en résulter et, alors, d'inévitables polémiques fondées ou infondées se développeront. Elles pourront dès lors porter jusqu'à des accusations d'expériences inconsidérées sur l'homme. Le militaire n'est d'ailleurs en aucune façon un sujet captif, vis-à-vis duquel aucune obligation d'information n'existerait pour ce qui concerne les soins ou mesures de prévention administrés dans l'exercice de son service. Au regard de cette considération, le cas du « Virgyl » peut certes présenter un certain particularisme. Cette substance n'est pas un véritable médicament. Son administration en opération ne poursuit en effet aucune finalité thérapeutique. Il s'agit d'un eugrégariant qui pourrait tout au plus être assimilé à la catégorie plutôt floue de certains « médicaments de confort » qui ont plus particulièrement pour objet d'améliorer voire de mieux garantir un domaine de la performance physique ou psychologique. D'ailleurs, la frontière avec l'usage des produits dits « dopants » reste imprécise. Quoi qu'il en soit la pharmacopée militaire ne peut se distinguer de la pharmacopée civile par l'adjonction plus ou moins secrète de molécules et de substances non validées voire inconnues des autorités sanitaires. S'il peut s'avérer exact que le « Virgyl » ne présente pas les effets secondaires ou les désagréments des amphétamines ou du Maxiton (cet argument a été évoqué devant la mission d'information par des responsables du Service de santé des Armées au cours des auditions), la substitution ainsi réalisée n'en demeure pas moins critiquable. Les amphétamines et le Maxiton relèvent de catégories connues de substances dont l'usage contrôlé est solidement établi sur une longue expérience de prescriptions médicales. Leurs contre-indications, comme leurs effets contradictoires ou perturbants, font l'objet de recensements et d'analyses détaillés qui sont publiés dans la littérature médicale. Les neurologues et les psychiatres acquièrent, dès leur formation, une somme de connaissances sur leur usage, même s'il n'est pas possible en ce domaine de prétendre atteindre l'exhaustivité dans l'appréciation des effets particuliers à de telles familles de médicaments, et bien, qu'en l'espèce, leur administration n'aurait été circonscrite qu'à des sujets considérés comme sains. Il en allait en tout cas différemment du « Virgyl » qui, au début de la décennie quatre-vingt-dix, n'avait pas été dispensé hors du cadre de protocoles expérimentaux concernant un très petit nombre de sujets. Aucune spécialité intégrant cette substance ne bénéficiait, à l'époque de la guerre du Golfe, d'une autorisation de mise sur le marché (AMM). A cet égard, une interrogation s'impose sur les limites à apporter aux développements de molécules ou de substances qui seraient principalement effectués par les centres de recherche relevant de la seule médecine militaire. Qu'elles soient conduites à titre exclusif ou en coopération avec des laboratoires privés, ces opérations méritent, à tout le moins, de faire l'objet d'une déclaration puis éventuellement d'une information vis-à-vis des autorités sanitaires. En dehors de toute considération sur l'éventuelle nocivité de court ou de moyen terme du « Virgyl », la mission d'information estime que cette préconisation vise pour l'avenir à éviter de stériles polémiques, en faisant en sorte que le Service de santé des Armées ne puisse plus éluder les premières étapes fondant la crédibilité des procédures de pharmaco-vigilance. II. - UNE EXPOSITION À DES RISQUES NON MAÎTRISÉS LORS DE L'ENGAGEMENT D'après les documents reçus par la mission d'information et les différentes auditions, il est apparu que la plupart des dangers envisageables (menaces chimiques, biologiques et nucléaires) avaient été pris en considération. Cependant, le déroulement des opérations s'est effectué dans de telles conditions psychologiques (fatigue, stress des soldats) et climatiques (vent de sable, chaleur) que les menaces n'ont pas été forcément toujours maîtrisées. De même, les militaires n'ont pas (ou peu) été sensibilisés à des risques qui n'étaient pas perçus comme tels à l'époque, à savoir les poussières d'uranium appauvri et les particules de suie dégagées par les puits de pétrole incendiés par les Irakiens. Dix ans après les événements, la mission d'information elle même a rencontré quelques difficultés pour faire reconnaître, si ce n'est mettre au jour, certains éléments susceptibles d'apporter des éclaircissements indispensables à la compréhension, tels les comptes-rendus des alertes chimiques des Detalac et les rapports isotopiques des munitions françaises à uranium appauvri. Grâce à ses investigations approfondies, la mission d'information est en mesure de préciser la nature et les circonstances des expositions auxquelles les militaires français ont pu être soumis pendant la guerre du Golfe : elles tiennent tout à la fois aux émissions de neurotoxiques et aux possibles inhalations de poussières d'uranium appauvri ou de fines particules résultant des incendies des champs pétrolifères koweïtiens. La nature de la menace chimique ayant déjà été précisée, c'est sur ses manifestations et sa réalité pour les militaires français que l'on s'attardera. Troublés par le nombre d'alertes des Detalac en fonction dans les forces, les membres de la mission d'information se sont plus particulièrement intéressés à leurs causes. Il leur a souvent été répondu que ces alertes étaient fausses, en raison de l'extrême sensibilité de ces appareils. Pour autant, quand bien même ce fut le cas, il y a eu des alertes confirmées, de sorte que l'on peut affirmer que les militaires français ont bien été en présence de neurotoxiques et de vésicants. Ces événements se déroulant avant l'offensive terrestre, on peut en déduire qu'ils résultaient des bombardements de sites irakiens de production d'agents chimiques ou de stockage de ce type d'armes. Au demeurant, la mission d'information ne dispose pas d'éléments susceptibles d'accréditer l'hypothèse que l'Irak ait utilisé ses armes chimiques lors de l'attaque au sol par la coalition. Par ailleurs, les éléments recueillis ne permettent pas d'infirmer l'hypothèse, soulevée notamment par la journaliste Marie-Claude Dubin, lors de son audition le 9 janvier 2001, selon laquelle l'aérodrome d'As Salman aurait pu receler des munitions chimiques. On notera néanmoins que si elle s'en trouve confirmée, l'exposition de certaines des unités de la Division Daguet aux neurotoxiques irakiens n'a vraisemblablement pas dépassé de faibles concentrations. 1. Des émissions consécutives aux bombardements des sites irakiens de production ou de stockage Le risque chimique aurait davantage résulté des conséquences des bombardements alliés que de la stratégie des forces irakiennes. a) Cinq détections de contrôle d'agents chimiques positives Selon une fiche du ministère de la Défense sur les détections chimiques relevées dans le Golfe qui a été adressée au Département d'Etat américain le 27 décembre 2000, cinq détections de contrôle par les Détecteurs individuels de neurotoxiques (Detindiv), postérieures à des alertes de Detalac, se sont révélées positives entre le 19 et le 21 janvier 1991, soit trois jours après le début des bombardements aériens contre l'Irak. Faisant référence à des déclarations prêtées au Général d'armée Raymond Germanos par un quotidien national, s'agissant de l'exposition des forces françaises à des faibles concentrations de neurotoxiques ou de vésicants, le Général d'armée Bernard Janvier, Commandant de la Division Daguet lors de l'offensive terrestre, a confirmé les faits lors de son audition : « J'ai lu dans le Monde du 5 décembre une intervention du porte-parole du Service d'information et de relations publiques des Armées (SIRPA) de l'époque qui indiquait que suite aux bombardements en Irak, des destructions d'armes chimiques auraient pu être produites. Cette affirmation peut expliquer des déclenchements de Detalac, du fait de traces très fugitives de neurotoxiques. Si mes souvenirs sont bons, je situerai ces événements dans une période proche du 21 janvier, quand la division a réalisé cette bascule de Hafar Al Batin vers Rafha ». D'après l'étude technique relative aux détections chimiques fournie par le ministère de la Défense et se fondant sur les informations des journaux de marches et d'opérations des unités engagées, tous les régiments français sur le terrain, à l'exception du 2nd REI et du 1er RS, ont été confrontés à une ou plusieurs alertes de Detalac entre le 19 et le 21 janvier 1991. ALARMES DES DETALAC RECENSÉES PAR LES ARCHIVES
Ces dates de détection sont corroborées par les rapports établis sur le sujet par la Commission des Anciens combattants du Sénat américain ainsi que par la Commission de la réforme de l'administration de la Chambre des Représentants23. En effet, les Sénateurs et les représentants américains évoquent eux aussi la détection par les unités spécialisées tchèques et françaises stationnées à la Cité du Roi Khaled d'agents neurotoxiques et de vésicants, les 19, 20 et 21 janvier 1991. La mission d'information constate que le Gouvernement français n'a pas confirmé aux parlementaires américains ces informations, alors même qu'il a répondu favorablement aux demandes de l'administration du Président Clinton deux ans plus tard. Selon les données transmises à la mission d'information par le ministère de la Défense, les détections de contrôle positives confirmant les alertes de Detalac ont été plus particulièrement enregistrées par : - le groupement de soutien logistique de la Cité du Roi Khaled, le 19 janvier à 16 h 30 ; - le groupement de soutien logistique de la ZAL, le 20 janvier à 08 h 00 ; - le 3ème RIMa, le 21 janvier à 09 h 47 ; - le 4ème RD, le 21 janvier à 13 h50 ; - l'Etat-major de la Division, le 21 janvier à 23 h 30. Tous les comptes-rendus NBC, consécutifs aux alertes des Detalac, qui ont confirmé la présence de neurotoxiques, ont insisté sur le caractère « infinitésimal » des concentrations relevées. Ainsi, le message n° 1320/COMFOR DAGUET/RENS du 20 janvier 1991, souligne cette précision en se basant sur les résultats des tests effectués par les spécialistes Tchèques participant à la coalition : « Le 19 janvier entre 16 h 30 et 17 h 30 locales, une alerte a été déclenchée à CRK suite à la détection d'un nuage de neurotoxique se déplaçant à l'Est de la ville en direction du Sud ; l'unité tchécoslovaque installée sur place a procédé aux analyses, sa conclusion est que le produit est trop dilué pour être dangereux ». De même, un message de l'officier NBC de la Division Daguet, datant du 21 janvier 1991, insiste lui aussi sur cet aspect : « Détection de neurotoxiques sur Olive. 1) (...) un nuage de neurotoxique a été détecté zone de CRK le 20/01. 2) Nuage détecté ce matin proviendrait du même nuage ramené par le vent. 3) Mesure faite à CRK a donné présence en quantité infinitésimale sans aucun effet sur personnel de Tabun, Soman, Ypérite ». La mission d'information prend note du faible risque estimé pour les personnels, compte tenu du matériel de protection systématiquement porté par les militaires en pareilles circonstances. Il n'en demeure pas moins que certains témoignages laissent à penser qu'il n'est pas impossible que certains soldats, isolément, n'aient pas respecté les consignes de sécurité, ou ne l'aient fait que partiellement. Ainsi, dans son rapport du 25 juin 1991, le Pharmacien chimiste Ramirez dresse un constat révélateur à la date du 9 décembre 1990, soit un mois et demi avant les alertes confirmées : « Accroissement de la tension internationale qui se traduit par une augmentation du rythme des alertes. Celles-ci se produisent surtout en fin de nuit vers 05 h 00 à 07 h 00 du matin. Cette intensification des " entraînements " provoque deux effets antagonistes : une diminution du facteur panique, le personnel dominant de mieux en mieux l'enchaînement des séquences aboutissant au déserrement ; une banalisation des alertes liée à la fréquence de ces dernières : un phénomène de lassitude va s'installer provoquant un allongement de la période de prédéserrement (séquence du réveil, habillage avec la tenue S3P, embarquement dans les véhicules) ». Dans ce cas très particulier seulement, l'exposition avérée à des traces de neurotoxiques (sarin et cyclo-sarin notamment) et d'ypérite pourrait peut-être ne pas avoir été sans conséquences. Il appartiendra aux experts scientifiques de se prononcer à ce sujet. b) La conséquence des bombardements alliés L'étude technique relative aux détections chimiques fournie par le ministère de la Défense envisage les causes éventuelles de la présence des neurotoxiques détectés par les éléments français entre le 19 et le 21 janvier 1991. La destruction de dépôts chimiques irakiens est privilégiée, même si l'utilisation de certains insecticides (notamment américains) ne semble pas exclue. LES DISTANCES SÉPARANT LES POSITIONS FRANÇAISES 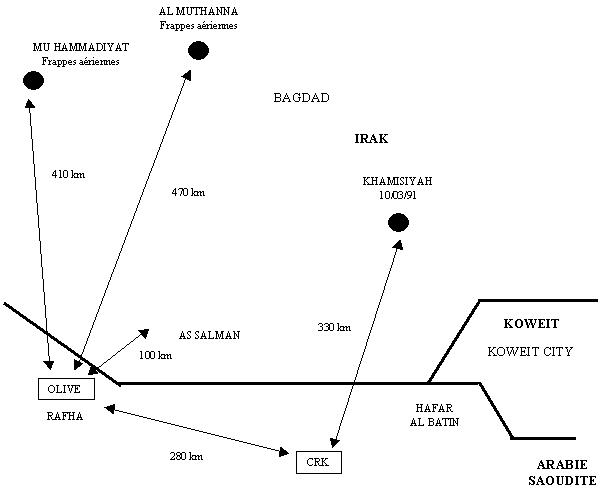 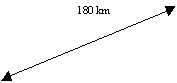 WHITE Source : annexe n° 6 de l'étude technique relative aux détections chimiques fournie par le ministère de la Défense. Cette conclusion s'appuie sur les comptes-rendus opérationnels, tels le message n° 1320/COMFOR DAGUET/RENS du 20 janvier 1991, déjà cité, qui précise que le nuage de neurotoxiques décelé la veille « provient vraisemblablement d'une usine chimique irakienne détruite par les bombardements aériens coalisés ». De même, le message n° 52/COV/DIV DAGUET/OPS du 21 janvier 1991, indique-t-il de manière sommaire : « Mesures effectuées font apparaître présence neurotoxiques (Tabun, Soman, Ypérite) en quantité faible. Origine probable : destruction usines chimiques Irak ». L'hypothèse d'émissions résultant du bombardement de sites irakiens de production ou de stockage d'agents chimiques s'appuie sur le constat que l'aviation alliée a pris ces objectifs pour cibles dès le début des raids, le 17 janvier 1991. Au demeurant, les vents dominants, actifs pendant le conflit, rendent concevable le transport de produits toxiques très dilués à plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire jusqu'en Arabie Saoudite. L'annexe 6 de l'étude technique relative aux détections chimiques fournie par le ministère de la Défense, reproduite ci-dessus, illustre les distances, en kilomètres, qui séparaient les différents sites où se sont trouvés les soldats français et les dépôts d'armes chimiques irakiens susceptibles d'avoir été touchés par des bombardements alliés. En imaginant que les conditions météorologiques aient favorisé la diffusion des neurotoxiques stockés dans les sites endommagés ou détruits, on ne peut que convenir que leur concentration aurait été diluée dans l'air ambiant. L'étude technique relative aux détections chimiques mentionnée précédemment, parle de concentrations inférieures à 0,01296 mg.minute/m3. Au cours du déplacement à New York d'une délégation de la mission d'information, M. Hans Blix, président exécutif de la commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations-Unies pour l'Irak (UNMOVIC) a précisé que cette instance, sur la base des travaux de la précédente commission de l'ONU (l'UNSCOM), disposait d'un certain nombre de données sur les sites de missiles qui avaient été répertoriés et qu'en matière chimique et biologique, seuls quelques sites résiduels avaient sans doute pu échapper à des frappes alliées. La mission d'information souhaite que cette somme de connaissance soit exploitée par le ministère de la Défense afin de mieux apprécier certains des risques d'exposition chimique de nos forces par rapport à des dates et à des zones de détection pour lesquelles subsistent des doutes. 2. La non utilisation de l'arsenal chimique irakien pendant le conflit La Division Daguet n'a vraisemblablement pas été l'objet d'attaques chimiques de la part des Irakiens : nulle mention en est faite dans les comptes-rendus d'opérations. Un point de situation DAGUET du 25 février 1991 précise même : « Selon les artilleurs irakiens prisonniers : leurs batteries ne sont pas approvisionnées en munitions chimiques ». Le Général d'armée Bernard Janvier, Commandant de la Division Daguet au moment de l'offensive terrestre, a semblé lui aussi exclure cette éventualité : « Nos soldats avaient été clairement informés sur la nature et sur le marquage des obus chimiques irakiens. D'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés à Rochambeau, notre premier souci a été d'interroger les artilleurs irakiens qui nous ont confirmé qu'ils n'avaient pas à leur disposition d'armes chimiques. Cela n'exclut pas, bien entendu, le risque de délivrance de substances chimiques par des roquettes ou par des épandages. Toutefois, aucun projectile n'a été trouvé dans notre zone et aucune mention de destruction n'a été formulée par les Américains dans les comptes-rendus ou les réunions de commandement tenues après l'engagement, le 12 mars, et auxquelles j'ai participé ». De même, Mme Marie-Claude Dubin, journaliste présente aux côtés du 6ème REG au moment de l'offensive terrestre a-t-elle déclaré lors de son audition : « J'ai pu parler avec de nombreux prisonniers irakiens. Ils m'ont dit que l'Irak ne disposait pas d'armes chimiques en première ligne ». De cet ensemble d'informations, deux conclusions peuvent être esquissées : - d'une part, la présence de neurotoxiques détectée par les Detalac et les Detindiv entre le 19 et le 21 janvier ne résulterait pas d'attaques chimiques irakiennes ; - d'autre part, les militaires français n'auraient pas été directement exposés à des munitions chimiques irakiennes au cours de l'offensive terrestre, du 24 au 28 février. 3. Les risques de contamination de la base d'As Salman Alors que les responsables militaires auditionnés par la mission d'information n'ont pas insisté sur les conditions dans lesquelles l'aérodrome d'As Salman a été investi par les troupes françaises, Mme Marie-Claude Dubin, journaliste qui accompagnait les soldats français sur le terrain a exposé des souvenirs emprunts de doutes et de suspicions quant aux munitions employées par l'aviation de la coalition pour détruire cette base irakienne : « Je suis donc entrée avec le Colonel de la Légion dans la base. Tous les hangars avaient été percutés par des obus dont près de la moitié n'avait pas explosé. Je me souviens d'ailleurs que le Colonel n'avait pas l'air heureux : il découvrait des choses qui ne semblaient pas correspondre aux éléments d'information qui lui avait été fournis par les services de renseignement américains. Il trouvait notamment que ces derniers s'étaient volontairement montrés, d'une certaine façon, trop pessimistes. Il s'attendait à découvrir un avion sur deux encore rangé dans les hangars, or il n'y en avait plus un seul et il ne s'attendait peut-être pas à voir autant de munitions et de bombes dont la moitié n'avait pas explosé. Je me souviens de ses paroles : " Que de cochonneries, que de cochonneries ! ". A-t-il vu ce jour-là qu'il s'agissait d'obus à uranium appauvri, je n'en sais rien. Mais il était effectivement étonné devant tant de désinformations de la part des Américains. Je pense qu'il y avait un grand nombre de munitions pas très saines, notamment pour les personnes qui en respiraient les émanations ». La piste de l'aérodrome d'As Salman a effectivement été sérieusement endommagée : deux cratères importants et deux autres moins importants au nord ouest de la piste principale de même que deux cratères de moyenne importance sur la piste secondaire étaient répertoriés par les points de situation DAGUET du 26 février 1991. Par ailleurs, il a été constaté de « nombreux éclats de bombes » selon le compte-rendu sur l'état de la piste d'As Salman datant du même jour. Pour sa part, le Général d'armée Michel Roquejeoffre a estimé que l'aérodrome d'As Salman avait « été traité avec des bombes antipistes, mais pas avec des obus d'avions A 10 ». Ce point semble très vraisemblable, compte tenu des caractéristiques antichars des obus à uranium appauvri. Plus prégnant paraît en revanche le risque chimique sur le site. De façon incidente, la mission d'information a relevé des éléments relativement inquiétants parmi les documents qui lui ont été transmis. Tout d'abord, le message Grand Duc DAGUET du 12 janvier 1991 évoque en ces termes l'éventualité du stockage de produits chimiques à As Salman : « un stock de produits chimiques destinés à la contamination du terrain a été probablement constitué au terrain d'aviation d'As Salman Nord en 3039N-4435E ». Ensuite, le journal des marches et opérations de l'Etat-major du 3ème RIMa (21 décembre 1990-18 avril 1991) fait état d'informations troublantes en ce qu'il évoque, le 21 janvier 1991 à 9 h 47, la présence en Arabie Saoudite d'un « nuage toxique », « constitué de Tabun, de Soman et d'Ypérite » et « provoqué par la destruction d'un dépôt d'armes chimiques situé à As Salman en Irak ». De ce fait, la présomption de dépôt d'armes chimiques sur l'aérodrome d'As Salman, déjà évoquée par le compte-rendu du 12 janvier 1991, se trouve confortée. De surcroît, l'hypothèse d'une contamination chimique du terrain d'As Salman n'est pas à exclure. Tout ceci pourrait ne pas avoir été sans conséquences sanitaires sur les éléments français amenés à « dépolluer » l'aérodrome (notamment le 6ème REG) et les unités stationnées aux alentours. En effet, ces personnels ont été amenés à travailler sur la piste d'As Salman pendant près d'un mois, jusqu'au 24 mars 1991. La mission d'information espère donc que des experts scientifiques se saisiront de cette question pour en évaluer les éventuelles conséquences. 4. Les dangers afférents à la destruction, après le conflit, des munitions irakiennes rémanentes Après la cessation des hostilités terrestres, le 6ème REG a été amené à assurer la destruction des munitions non explosées et des sous-munitions autour du site d'As Salman sous le contrôle de la Division Daguet. Le Général d'armée Michel Roquejeoffre a indiqué à ce sujet : « Après le 28 février 1991, ces légionnaires ont " dépollué ", ce terme étant préféré à celui de " déminé ", compte tenu du fait que pour une mine on trouve dix autres engins non explosés. J'ai moi-même assisté à des séances de dépollution - tout champ de bataille, y compris dans le désert, est semé de tels engins -, et je peux vous dire que les débris étaient ramassés avec précaution, désamorcés et détruits ». Le risque lié à la nature de cette mission est difficile à apprécier. Les messages COMDIV DAGUET/OPS et télécopies portant comptes-rendus quotidiens du 10 au 20 mars 1991 mentionnent ainsi la destruction de quatre bâtiments sur le site de l'aérodrome d'As Salman, la « dépollution » de champs de tirs et la destruction de deux fourneaux à munitions, la destruction de dépôts de munitions sur le site de l'aérodrome d'As Salman, et la « dépollution » des abords du village d'As Salman. Le message COMDAGUET/OPS portant compte-rendu du 23 mars 1991 précise qu'au total, le 6ème REG a détruit notamment 1 860 roquettes (RPG 7 et 9), 300 obus de mortier de 60 mm, 1 500 obus de mortier de 82 mm, 590 obus de mortier de 120 mm, 1 bombe d'une tonne, 1 bombe de 500 kg et 66 obus de 60 mm avec 18 grenades à fusil. Le 23 mars 1991, avant son départ pour CRK et Koweït City, le 6ème REG a également détruit 610 obus de 152 mm sur le site de Rochambeau. Parallèlement à la « dépollution » des environs d'As Salman, les éléments français du Détachement Daguet de Koweït City ont été amenés à effectuer le déminage et la dépollution de plusieurs sites dans la capitale koweïtienne. Il n'y est à aucun moment indiqué qu'ils sont intervenus sur l'aéroport de Koweït City. Au 31 mars 1991, le bilan des destructions de munitions opérées par le détachement Daguet s'élevait à : 92,3 tonnes d'obus, 236 missiles, 38 armements lourds, 3 chars, entre autres. La nature des munitions détruites tant par le 6ème REG que par le Détachement Daguet de Koweït City n'est pas précisée, mais il n'est pas établi que les soldats français ont été en contact avec des munitions chimiques car aucun incident chimique lié à cette activité spécifique des militaires français n'est mentionné dans les documents dont la mission d'information a eu connaissance. Selon la fiche de l'Etat-major des Armées rédigée le 13 novembre 2000 en réponse à une demande de la mission d'information, la photo (ci-jointe) du numéro de « Terre Magazine », qui a été prise en Irak et qui fait état de la manipulation d'armes chimiques par un militaire français (en l'occurrence le Lieutenant-Colonel Jacquemet), renvoie à une période postérieure au conflit et illustre la mission d'un spécialiste français auprès de l'UNSCOM, en novembre 1991, dans le dépôt de Khamisiyah. 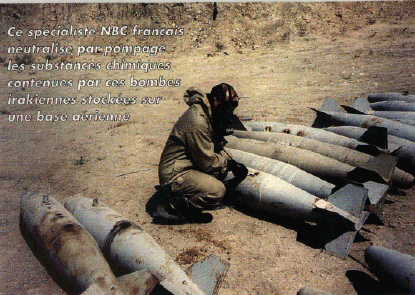 On ne saurait pour autant en déduire que les soldats français n'ont détruit aucune munition chimique immédiatement après le cessez-le-feu et qu'ils n'étaient exposés à aucun risque, même si cela s'avère peu probable. B. LES POUSSIÈRES D'URANIUM APPAUVRI DE CERTAINES MUNITIONS EMPLOYÉES PAR LES TROUPES AMÉRICAINES Il est certain que les forces terrestres et aériennes américaines, et dans une moindre mesure les chars anglais, ont recouru à des munitions à uranium appauvri au cours de la guerre du Golfe. Les troupes françaises, pour leur part, n'en auraient pas utilisé (ce type d'armes n'étant pas encore au point). La question de l'information du commandement français au sujet de l'usage de munitions à uranium appauvri sur le théâtre d'opérations reste entière mais la mission d'information, se fondant sur des recoupements de documents qui lui ont été transmis, est en mesure d'expliciter les conditions d'exposition de certaines unités françaises aux risques que ce type de munitions induisent. Cette exposition aux conséquences de l'emploi d'obus à uranium appauvri est assez préoccupante, ne serait-ce que parce que les précautions désormais applicables aux personnels au contact de tels armements ne semblent pas avoir été en vigueur lors des opérations. Avant d'aller plus avant, il convient d'expliciter au préalable ce qu'est l'uranium appauvri, résidu dont l'utilisation n'est pas uniquement militaire. L'encadré ci-après s'inspire de données vulgarisées et publiées dans la presse scientifique. Qu'est-ce que l'uranium appauvri ? L'uranium sert à la combustion des réacteurs de centrales nucléaires et à la réalisation des bombes atomiques. Le produit de base est l'uranium naturel extrait des mines, qui est constitué à 99,3 % de l'isotope U 238 et à environ 0,7 % de l'isotope U 235. Les différents isotopes d'un même élément chimique ont un noyau comportant un nombre identique de protons (numéro atomique) mais différent de neutrons. L'uranium 235 est fissible : si on le « bombarde » avec un neutron, il se casse en libérant de l'énergie et des neutrons. Ces derniers peuvent à leur tour casser des atomes d'U 235. On parle de réaction en chaîne : contrôlée dans le réacteur d'une centrale nucléaire, elle est poursuivie jusqu'au bout lors d'une explosion atomique. L'uranium naturel n'étant pas assez concentré en U 235 pour être utilisé comme combustible nucléaire, la réaction en chaîne ne peut être maintenue, faute du bon isotope. Il faut donc augmenter sa proportion en U 235 (seul vrai combustible) jusqu'à de 3 à 4 %. C'est pourquoi dans des usines d'enrichissement, on « arrache » par diffusion gazeuse les isotopes d'U 235 de l'uranium naturel. D'un côté on dispose donc d'un uranium enrichi destiné aux centrales nucléaires. De l'autre, un uranium appauvri où l'isotope U 235 ne représente que 0,2 % de la masse. Il s'agit d'un déchet radioactif que l'on stocke dans des sites surveillés. Depuis que les centrales nucléaires fonctionnent, on estime à 1 million de tonnes la quantité d'uranium appauvri issue de l'enrichissement d'uranium à vocation civile. Les experts en attribuent 500 000 tonnes aux Etats-Unis et 150 000 tonnes à la France. Quelque 50 000 tonnes d'uranium appauvri viennent grossir ces stocks chaque année. Depuis les années soixante, cet uranium appauvri « au repos » et bon marché a trouvé des débouchés dans le secteur militaire mais aussi dans le civil. On l'utilise à des fins médicales pour fabriquer des boucliers de protection contre les rayons X, dans les accélérateurs linéaires, dans les conteneurs de navires comme boucliers, dans certains détecteurs de feu, dans des lentilles optiques. Source : Science et Vie, 1er février 2001. 1. Un emploi sur le théâtre par les forces américaines et britanniques désormais établi D'après la fiche n°30/DEF/EMA/ESMG du 12 janvier 2001, rédigée à la demande de la mission d'information, aucune munition à uranium appauvri ne semble avoir été employée par les forces françaises dans le Golfe, car la France n'en possédait pas ; aucune aurait été testée non plus. Seulement 10 obus-flèches tungstène d'AMX 10 RC et 19 obus-flèches tungstène d'AMX 30 B2 ont été tirés contre des chars irakiens (le total de munitions de ce type disponibles sur le théâtre étant d'environ 20 000). Ces éléments confirment les propos suivants, tenus par M. Jacques Céron, Ingénieur en Chef des études et techniques d'armement à la Délégation générale pour l'Armement (DGA), lors de son audition le 5 décembre 2000 : « En 1990-1991, période du conflit dans le Golfe, nous avions des munitions explosives classiques, d'utilisation banalisée, à savoir : la munition charge creuse, qui était la munition antiblindés classique, et les flèches à obus tungstène. S'agissant des munitions à perforateur en uranium appauvri, à la fin de l'année 1991, nous ne disposions en France que de maquettes ». On sait en revanche, d'après les documents accessibles sur Internet24, que l'aviation américaine ainsi que les blindés américains et britanniques ont tiré des obus à uranium appauvri. Or si les chars américains et britanniques n'ont pas été employés aux côtés de la Division Daguet, il n'en a pas été de même pour l'aviation américaine. a) L'intérêt opérationnel des munitions à uranium appauvri « Perforant et incendiaire », un projectile à uranium appauvri est « l'arme antichar idéale puisqu'elle perfore les blindages de chars les plus résistants, provoque un violent incendie entraînant l'explosion des munitions contenues dans le char et, ainsi, sa destruction complète ». Tel est l'argumentaire développé par l'Observatoire des armes nucléaires françaises dans son cahier d'octobre 2000. A en croire le Rapport de l'Institut de politique environnementale de l'armée de Terre américaine (US Army environmental policy Institute), relatif aux conséquences sanitaires et environnementales de l'utilisation de l'uranium appauvri par l'armée de Terre américaine et datant de juin 1994, ce type de munitions a fait l'objet d'études aux Etats-Unis dès les années soixante-dix. D'après M. l'Ingénieur en Chef Jacques Céron, la réflexion a été engagée en France à partir de 1986. Dans les deux cas, il s'agissait de se prémunir contre les blindages de plus en plus résistants des chars des Etats du Pacte de Varsovie, menace importante pour l'Europe en pleine guerre froide. Compte tenu du nombre et de la nature des blindés irakiens (l'essentiel d'entre eux ayant été produits et livrés par le complexe militaro-industriel soviétique), les munitions à uranium appauvri sont apparues comme une panacée. A cet égard, l'extrait suivant de l'audition de M. Jacques Céron, apporte quelques précisions techniques intéressantes quant au mécanisme et à l'efficacité des obus-flèches utilisés. Il apparaît que c'est autant en raison de l'énergie cinétique qu'à cause des propriétés pyrophoriques du métal employé que ces munitions sont aussi dévastatrices : « M. l'Ingénieur en chef Jacques Céron : Qu'est-ce qu'une munition flèche ? On projette une partie métallique d'une forme un peu spéciale à très grande vitesse et on profite de l'énergie cinétique de ce produit pour pénétrer les blindages. Il faut savoir qu'une flèche perfore un blindage réactif avant que ce même blindage puisse faire de l'effet sur elle : la flèche va tellement vite que l'explosion de ce blindage n'a lieu que quand une partie de ce projectile est passée. (...) M. Aloyse Warhouver : Le tir se fait à quelle distance ? M. l'Ingénieur en chef Jacques Céron : On tire sur des chars aux alentours de 1 500 mètres. C'est un point d'efficacité sachant que si l'on s'approche davantage on a des chances d'être l'objet d'un tir ennemi en premier. Quelle est la particularité de la munition flèche ? Vous voyez ici la cartouche, telle qu'elle est introduite dans le char et là, un obus. Le sabot permet de projeter cette flèche hors du tube à très grande vitesse. Le sabot est composé de trois morceaux qui se désolidarisent de la munition et la flèche poursuit sa trajectoire. La forme aérodynamique de la flèche est telle qu'elle ne perd pratiquement pas de vitesse sur toute la trajectoire utile de la munition. Ce sont des munitions qui, perdues dans la nature, vont très loin ». Et M. l'Ingénieur en chef Jacques Céron d'ajouter : « Il est clair que si un char est touché par une flèche, c'est malheureusement l'issue fatale pour tout son équipage. Les seuls cas de blessés que j'ai pu connaître concernent des tirs fratricides américains, où les soldats ont été touchés par des éclats de flèches à uranium appauvri ». Du point de vue strictement opérationnel, les obus-flèches et les munitions antichars des A 10 qui incorporaient de l'uranium appauvri ont donc indéniablement contribué à asseoir la supériorité militaire des alliés sur les Divisions blindées irakiennes. De fait, le succès de la coalition internationale leur est imputable en grande partie. b) Une utilisation massive contre les blindés irakiens L'annexe F du rapport de l'Assistant spécial du Secrétaire américain à la Défense pour les maladies de la guerre du Golfe, relatif à l'exposition des vétérans américains à l'uranium appauvri, mentionné auparavant, donne le détail de la quantité et de la nature des munitions à uranium appauvri employées par les forces américaines au cours des opérations Bouclier et Tempête du Désert. MUNITIONS À URANIUM APPAUVRI UTILISÉES PAR LES AÉRONEFS DE L'US AIR FORCE ET DE L'US NAVY DANS LE GOLFE AU COURS DES OPÉRATIONS BOUCLIER ET TEMPÊTE DU DÉSERT (1)
MUNITIONS À URANIUM APPAUVRI UTILISÉES PAR L'US ARMY
Des tableaux ci dessus, qui synthétisent ces données, il ressort que la grande majorité de ces munitions ont été tirées par l'aviation, et plus particulièrement par les A 10 Thunderbolt, surnommés « Warthog », c'est-à-dire « phacochères ». Toutefois, la masse des munitions employées par ces avions (calibre de 30 mm) était moindre que celle des chars Abrams M1 (obus de 120 mm). En fait, les A 10 et les Harrier, avions qui présentent la caractéristique de pouvoir voler à basse altitude et à vitesse réduite, sont intervenus contre les chars irakiens pendant tout le mois précédent l'offensive terrestre, qui n'a duré que quatre jours. Disposant d'une puissance de feu bien supérieure, les chars Abrams (il est à noter que les Challenger britanniques ont eux aussi tiré des obus-flèches à uranium appauvri : le rapport précité fait état d'une centaine) ont quand même tiré en quatre jours 9 552 obus contenant chacun un perforateur en uranium appauvri de 5,3 kilogrammes. Au total, ce sont près de 300 tonnes d'uranium appauvri qui ont été utilisées au cours du conflit. C'est dire l'intensité du recours à ce genre de munitions contre les colonnes de blindés irakiens. 2. Une exposition incontestable des unités de la Division Daguet Au terme de ses investigations, la mission d'information a acquis la certitude que des militaires français ont pu être en contact plus ou moins rapproché (dans le temps et dans l'espace) avec des sites ou des cibles bombardés par des munitions à uranium appauvri. D'ailleurs, le Général d'armée Bernard Janvier, Commandant la Division Daguet au cours de l'offensive terrestre, a confirmé cet état de fait, comme l'illustre cet extrait du procès-verbal de son audition : « Général Bernard Janvier : S'agissant de l'appui aérien, il existait deux mécanismes : d'une part, une intervention en avant de la ligne de coordination des feux par les appareils A 10, au gré des pilotes, puisqu'on leur ouvrait un espace géographique pour leur intervention. Les troupes étaient forcément en arrière de cette zone d'engagement ; elles étaient situées en-deçà de la ligne de coordination des feux. Je ne peux pas vous indiquer une distance précise, mais elles étaient même assez loin. D'autre part, des avions A 10 ont appuyé des troupes au sol. Ces actions étaient coordonnées par des contrôleurs avancés. Dans ce cas, le périmètre de sécurité était de 400 à 500 mètres environ. M. Claude Lanfranca, co-rapporteur : Les troupes françaises sont donc passées, après les bombardements américains, au milieu de chars détruits. Général Bernard Janvier : Bien entendu ! Nos unités ont traversé les zones bombardées, des points d'appui, des chars, des dispositifs d'artillerie traités par des appareils A 10 ou F 16. Le seul endroit où il n'y a pas eu d'appui aérien avant l'assaut c'est à As Salman, le 25 février dans l'après-midi, pour des raisons météorologiques ». Les développements qui suivent s'appuient sur les documents réunis et examinés à la demande de la mission d'information. Ils mettent en évidence un certain nombre de situations concrètes qui corroborent les propos du Général d'armée Bernard Janvier. En tout état de cause, il ne faut pas exclure que d'autres situations d'exposition des militaires français à des poussières d'uranium appauvri, similaires à celles qui sont décrites ci-dessous, aient existé. a) Des régiments au contact de cibles détruites par les avions A 10 L'aviation américaine a commencé à intervenir à proximité du secteur d'engagement de la Division Daguet dès le 12 février 1991, comme le précise le journal des marches et opérations de l'Etat-major du 1er REC (1er janvier-11 avril 1991) : « 12 février 1991 : Début de traitement par aviation américaine des objectifs se trouvant dans la zone d'engagement de la Division ». Des bombardements d'A 10 américains ont bien eu lieu dans la zone d'intervention de la Division Daguet. Ce fut notamment le cas le 24 février 1991, entre 3 h 00 et 9 h 00. Or, les points de situation DAGUET de ce 24 février ajoutent qu'à 12 h 15, l'attaque des groupements est et ouest de la Division sur l'objectif de « Rochambeau » a été lancée, avec ce commentaire : « appui feu puissant ». Un peu plus de trois heures séparent donc l'entrée en action des militaires du bombardement des A 10 sur le secteur. Au moins deux chars détruits sont mentionnés dans les comptes-rendus d'opérations relatifs au bilan des prisonniers et matériels détruits ou capturés : un T 54, par le message n° 750 du 26 février 1991, et un T 69 par le message n° 664 du 27 février 1991 ; en d'autres termes, deux occurrences de contact des soldats français avec un véhicule potentiellement atteint par des munitions contenant de l'uranium appauvri lors de leur progression vers As Salman. Les différents journaux de marches et d'opérations des unités de la Division Daguet, apportent des informations plus précises. Ils mettent en exergue que lors de l'offensive terrestre et même après, au moins quatre unités de la Division Daguet se sont trouvées au contact, parfois de façon instantanée ou simultanée, de sites ou d'objectifs bombardés par les A 10 américains. Il en résulte une forte présomption d'exposition des militaires de ces unités à des poussières d'uranium appauvri, compte tenu de la nature des munitions employées par ces avions. ● Le 4ème Régiment de Dragons Au nombre des régiments plus particulièrement concernés, on trouve le 4ème RD, au sujet duquel il est indiqué dans le journal des marches et opérations de l'Etat-major de la 6ème Division légère blindée (1er janvier-1er mai 1991) : « 24 février 1991 : reconnaissance offensive du 4ème RD sur Rochambeau à 05 h 45 », soit au moment où les A 10 bombardaient le site selon les comptes-rendus quotidiens mentionnés juste auparavant. Le même jour à 16 h 41 : « les positions d'artillerie repérées par le 4ème RD sont traitées par A 10 en liaison avec l'escadron au contact ». A 17 h 30 : « les conditions météorologiques se dégradent avec la levée d'un vent de sable violent et une visibilité qui se réduit progressivement ». Enfin, le 25 février, à 11 h 00, « le 4ème RD détruit 8 T55, 1 M48 et 1 BRDM (7 chars sont déjà détruits sur la position) », très certainement par des A 10. Le journal des marches et opérations de l'Etat-major du 4ème RD (4 janvier-12 avril 1991) apporte des indications encore plus explicites : « 28 février : le 1er et le 2ème escadrons démarrent en direction de la phase line CHARGER et arrivent en vue de positions d'artillerie sol-sol et sol-air (canons de type I22D30 et ZPU4). Elles seront traitées par les avions américains de type A 10 en coordination avec le 2ème escadron ». Au total, les militaires du 4ème RD ont été exposés à quatre reprises au moins à des poussières d'uranium appauvri issues de tirs d'A 10 américains, dont deux fois de manière quasi instantanée. ● Le 3ème Régiment d'Infanterie de Marine Le journal des marches et opérations de l'Etat-major du 3ème RIMa (21 décembre 1990-18 avril 1991) place ce régiment parmi les quatre unités qui se sont trouvées en contact avec des poussières d'uranium appauvri. Il y est en effet indiqué : « 28 février : Le régiment longe la MSR Texas, une très forte explosion est provoquée par un avion A 10 qui vient de traiter un objectif » ; « 3 mars : le régiment stoppe sa progression, un raid aérien ami va avoir lieu sur des objectifs situés devant nous. Quatre appareils A 10 attaquent des positions de batteries au canon et à la roquette ». Par deux fois, le contact a semble-t-il été direct pour la totalité des membres du 3ème RIMa, « le régiment » étant à chaque fois en cause. ● Les 1er Régiment Etranger de Cavalerie et le 2nd Régiment Etranger d'Infanterie Le journal des marches et opérations de l'Etat-major du 3ème RHC (1er décembre 1990-21 avril 1991) ajoute ces deux régiments à la liste de ceux qui ont été de façon certaine à proximité de cibles détruites ou endommagées par des munitions à uranium appauvri. A la date du lundi 25 février, on lit en effet : « 14 h 20 : Se préparant à intervenir de nouveau pour réduire la résistance sur Bordeaux, la formation reçoit l'ordre de décrocher. Cet objectif sera traité par une intervention d'A 10 américain, puis conquis sans réelles difficultés par le 1er Régiment Etranger de Cavalerie et le 2nd Régiment Etranger d'Infanterie ». Là encore, l'exposition aux poussières d'uranium appauvri paraît avérée, même si le délai entre le bombardement du site par des A 10 et sa conquête par les 1er REC et 2nd REI n'est pas précisé. b) Une absence manifeste de sensibilisation des soldats concernés aux dangers L'absence de mention spécifique sur l'uranium appauvri tant dans les comptes-rendus d'opérations que dans les rapports de fin de mission conforte l'idée que ni le commandement français, ni les hommes du rang, n'étaient informés des précautions à prendre vis-à-vis des aérosols d'uranium appauvri dégagés lors de l'impact de telles munitions sur leurs cibles. En témoigne, cette remarque du Général d'armée Bernard Janvier, Commandant de la Division Daguet au moment de l'offensive terrestre : « Nous n'avions aucune connaissance d'éventuelles nuisances liées à l'uranium appauvri et donc aux munitions utilisées par les Américains. Concernant les avions A 10, je n'ai eu connaissance de ces nuisances potentielles qu'au travers des débats que vous conduisez dans le cadre de votre mission ». Lors de l'audition de M. Laurent Attar-Bayrou, Président de la Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures, M. Christophe Frederitzi, administrateur de cette même association, qui était sous-officier du 1er régiment de Spahis sur le terrain, a apporté un éclairage identique, issus des rangs : « Pour revenir à la question posée sur l'uranium appauvri, n'ayant jamais été informé sur les dangers potentiels de ce qu'utilisaient les Américains, la question ne s'est même jamais posée ». De même, ces propos tenus par Mme Marie-Claude Dubin, au sujet de son « séjour » de quarante-cinq minutes dans un char irakien détruit, laissent entendre l'absence d'information, pour ne pas dire l'impréparation des personnes se trouvant sur le terrain face aux risques sanitaires éventuellement encourus : « Je suis entrée dans un char irakien, un T54, qui, apparemment, avait été atteint par un obus à uranium appauvri. Le char n'étant pas miné, j'avais libre cours pour exercer mon métier. J'ai donc pénétré dans ce char. J'y suis restée un bon moment, environ trois quarts d'heure. Je cherchais un carnet de bord car je voulais comprendre la guerre du côté des Irakiens, étant donné que nous n'avions pas eu la moindre image de ce côté-là, c'est-à-dire quelque chose qui puisse m'expliquer le déroulement de leur guerre. On me dit aujourd'hui que se trouvaient sûrement dans ce char des particules d'uranium appauvri. Ceci explique peut-être cela ». Et Mme Marie-Claude Dubin d'ajouter : « Il est certain que sur le moment, personne ne nous a parlé d'uranium appauvri, le mot même n'a jamais été prononcé. On ne parlait que de danger chimique irakien. [...] Personne ne m'a rien dit lorsque nous sommes arrivés près du char. Je ne suis toutefois pas sûre que l'on était réellement entourés de techniciens. Par ailleurs, je ne sais pas si, dans un tel contexte, on procède à un examen du char permettant de savoir comment il a été détruit. A ce moment, les militaires qui m'accompagnaient ont simplement recherché des mines. Il est vrai qu'un char atteint par un obus à uranium appauvri est plus endommagé que lorsqu'il est percuté par une arme traditionnelle, mais ceux avec qui je me trouvais, n'étaient peut être pas aptes à faire une telle distinction ». Aucune précaution particulière n'ayant été prévue, l'exposition s'en est trouvée d'autant plus importante que les militaires au contact des cibles ou des objectifs atteints par des munitions à uranium appauvri ne s'en sont pas méfiés. A défaut d'être suffisamment informés, ils n'ont pu se prémunir. La mission d'information observe que de nombreux soldats américains se sont trouvés, au moins dans un premier temps, dans la même situation. En effet, le rapport de l'Institut de politique environnementale de l'armée de Terre américaine (US Army environmental policy Institute) relatif aux conséquences sanitaires et environnementales de l'utilisation de l'uranium appauvri par l'armée de Terre américaine, publié en juin 1994, critique notamment l'absence d'information des soldats américains assurant la maintenance des véhicules touchés par tirs fratricides sur les mesures de précaution à prendre. Il semblerait donc que la hiérarchie militaire américaine n'ait informé ni ses alliés, ni ses propres personnels les plus susceptibles de se retrouver en contact avec des aérosols d'uranium appauvri, ce qui a été implicitement reconnu par les officiels auditionnés par la délégation de la mission d'information qui s'est rendue à Washington du 2 au 4 avril derniers. En cela, c'est toute la chaîne de commandement de la coalition internationale qui a failli à son devoir de prévention des risques. 3. Un véritable sujet de préoccupation Si la question de l'exposition des soldats à l'uranium appauvri a été tardivement envisagée en France, il n'en a pas été de même aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, où des programmes d'études épidémiologiques et environnementales ont été lancées, respectivement en 1994 et 1998. Les investigations menées par la mission d'information ont abouti à une amorce de réflexion sur le sujet. Quelques zones d'ombre subsistent encore, mais d'ores et déjà il apparaît que l'emploi d'armes à uranium appauvri peut comporter des risques. a) Les risques afférents à l'inhalation de poussières d'uranium appauvri Au cours de son audition, le 9 janvier 2001, le Médecin général Jean-Yves Tréguier, directeur du Service de Radioprotection des Armées, a indiqué quels sont les risques encourus et leurs conséquences sanitaires pour les personnes en contact avec des particules d'uranium appauvri : « Le devenir biologique de l'uranium est variable selon la voie de transfert à l'homme, et sa forme chimique (métal, oxyde ou sel). Le rein, le squelette, le poumon (en cas d'inhalation) sont les principaux organes cibles. Les voies de pénétration possibles chez le travailleur sont le poumon par inhalation ou la peau par blessure. Le poumon serait la voie d'entrée prédominante pour des soldats qui se trouveraient à proximité d'un char au moment de l'impact d'un obus à l'uranium appauvri. Pour le public, la voie d'entrée habituelle est celle de l'ingestion par les aliments ou les eaux de boisson ». La toxicité de l'uranium appauvri est davantage chimique que radiologique. En effet, lorsqu'elles sont inhalées, les particules de 5 à 10 micromètres de diamètre dégagées au moment de l'impact des munitions sur leur objectif, pénètrent dans les poumons, passent dans le sang et contaminent certains organes ainsi que les os ; ingérées, elles sont en grande partie excrétées par les urines mais peuvent également franchir la barrière gastro-intestinale. Au contact des cellules, l'uranium irradie ces dernières : certaines meurent ; d'autres se régénèrent ; d'autres enfin peuvent dégénérer en cellules cancéreuses. Lors de son audition le 20 mars 2001, le Docteur Abraham Béhar, spécialiste de médecine nucléaire, a quant à lui attiré l'attention sur les symptômes respiratoires, digestifs et hématologiques, qui constituent autant de précurseurs possibles de pathologies découlant d'une inhalation de poussières d'uranium appauvri. Plus que les munitions, c'est donc leur explosion dans les blindages de véhicules, génératrice d'aérosols autour de la cible, qui constitue un facteur d'exposition à un risque sanitaire pour les troupes engagées. Le Médecin général, Jean-Yves Tréguier, a d'ailleurs insisté sur ce point : « Lors de l'impact entre la munition à uranium appauvri et le blindage des chars, on constate l'émission d'un aérosol d'uranium appauvri : un tiers pénètre dans le char, les deux tiers restent à l'extérieur. L'uranium étant un métal lourd, l'aérosol va se déposer assez rapidement sur le sol, dans un cercle d'une dizaine de mètres autour du char ». Entendue par la mission d'information le 19 décembre 2000, Mme la Docteure Anne Flüry-Hérard, chargée de mission au Cabinet du Haut Commissaire à l'Energie Atomique, a précisé la teneur de ce risque d'inhalation d'aérosols : « Au moment de l'impact, le chiffre admis comme celui de la quantité pouvant être plus virulente, car envoyée sous forme de petites particules se mettant à brûler après l'impact, est de l'ordre de 10 milligrammes par m3 et par obus. C'est une concentration très importante se faisant dans un rayon de 4 mètres autour de l'impact. Un phénomène de sédimentation intervient très rapidement après impact, de l'ordre de quelques minutes environ. Tout dépend toutefois du nombre d'obus et de la situation dans laquelle se trouvent chacun des intervenants ». De cet ensemble de données, la mission d'information déduit que le risque lié à l'inhalation de particules d'uranium appauvri sous forme d'aérosols est d'autant plus élevé que, d'une part, les personnes exposées sont proches du lieu d'impact de la munition sur sa cible, et d'autre part, le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée des militaires sur le site et le bombardement de l'objectif est court. On a déjà démontré que certains régiments se trouvaient à proximité de blindés irakiens au moment même où ils étaient bombardés par des avions A 10. Si rien ne prouve que les soldats de ces régiments se soient approchés à moins d'une vingtaine de mètres des blindés détruits, rien ne l'exclut non plus, puisque le témoignage de Mme Marie-Claude Dubin laisse entendre que certaines personnes ont pu pénétrer à l'intérieur de chars irakiens détruits au cours des opérations. De surcroît, la mission d'information observe que les conditions météorologiques ont certainement modifié les circonstances de sédimentation des aérosols d'uranium appauvri. En effet, les comptes-rendus opérationnels font état de vents de sable. De fait, l'aire de sédimentation des aérosols s'est certainement élargie et il n'est pas impossible que des militaires situés à quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres des zones bombardées par les A 10 américains aient pu respirer des poussières d'uranium appauvri. En cela, l'exposition des militaires français aux poussières d'uranium appauvri pourrait avoir été plus étendue que ce que laissent entendre les modèles théoriques. b) Les doutes persistants sur la composition isotopique des munitions employées Les informations concernant la toxicité de l'uranium appauvri qui émanent du ministère de la Défense se veulent rassurantes. A cet égard, la fiche de synthèse du dossier technique sur l'impact sanitaire de l'uranium appauvri, établie par la direction centrale du Service de santé des Armées, affirme que : « La radioactivité de l'uranium appauvri est faible, de l'ordre de celle rencontrée dans certains milieux naturels. Sa toxicité chimique est comparable à celle des autres métaux lourds (notamment en ce qui concerne l'atteinte rénale ». Sa radioactivité alpha serait deux fois moins importante que celle de l'uranium naturel et sa toxicité chimique identique à celle de l'uranium naturel. La toxicité chimique de l'uranium appauvri serait donc comparable à celle du plomb, du cadmium ou du tungstène et sa toxicité radiologique serait liée, quant à elle, à la teneur isotopique du composé. L'étude de la direction centrale du Service de santé des Armées conclut que la surveillance médicale réalisée sur les vétérans de la guerre du Golfe n'a pas, à ce jour du moins, débouché sur un constat alarmant puisque « les analyses effectuées jusqu'à présent chez les travailleurs exposés à l'uranium appauvri, ainsi que les personnels , soit au retour de la guerre du Golfe, soit au Kosovo, se sont toujours situées en dessous (des) limites (de détection indiquées par la Commission Internationale de Protection Radiologique) et n'ont jamais donné de valeurs significatives ». Pourtant, des interrogations subsistent sur la composition isotopique des obus à uranium appauvri utilisés par les forces américaines au moment du conflit. A cet égard, on ne peut ignorer qu'un ancien médecin Colonel des Armées américaines, le Docteur Assaf Durakovic, a exposé, devant le congrès annuel de l'Association européenne de médecine nucléaire qui s'est tenu à Paris le 2 septembre 2000, qu'il avait détecté des traces d'uranium 236 dans les urines de seize soldats américains, canadiens et britanniques qui avaient participé à la guerre du Golfe25. Or, l'isotope U 236 n'existe pas à l'état naturel, de sorte que dans l'hypothèse où les résultats du Docteur Durakovic se trouveraient scientifiquement incontestés, il se pourrait fort que les munitions à uranium appauvri aient présenté un risque radiologique supérieur à celui de l'uranium naturel. Cet élément est d'autant plus troublant que les analyses effectuées par la société industrielle de combustible nucléaire (filiale de Cogema), chargée de l'usinage de l'uranium appauvri importé des Etats-Unis pour la fabrication des obus flèches français, corroborent la présence de traces d'uranium 236 dans les stocks utilisés26, dont la provenance est identique à celle des munitions américaines. M. Frédéric Tona, directeur du pôle mines-chimie de la Cogema, qui accompagnait M. Henri Staeger, Président de la société industrielle de combustible nucléaire lors de son audition le 20 mars 2001, a précisé que des analyses isotopiques avait été effectuées sur les lots de métal importé, et qu'elles avaient révélé une présence d'uranium 236 à hauteur de 31 ppm en moyenne. Il a supposé que ce marquage résultait d'une pollution des filtres de diffusion gazeuse de l'usine de transformation du minerai d'uranium en métal appartenant à NMI. On observera que le relevé de la composition isotopique des lots de munitions à uranium appauvri en possession du ministère de la Défense, établi à la demande de la mission d'information, tend à confirmer cette conclusion27. Interprétant ces analyses, le directeur-adjoint des applications militaires du Commissariat à l'Energie Atomique, M. Alain Delpuech, écrit : « Nous pouvons donc confirmer que, suivant le protocole utilisé, le plutonium 239 n'a pas été détecté. Il ne pourrait donc être présent qu'en quantités inférieures ou égales à celles rencontrées dans l'uranium naturel ». Les résultats transmis sont d'ailleurs partiels puisqu'ils ne concernent que neuf des douze échantillons. Les tableaux qui suivent en présentent la synthèse. COMPOSITION (RAPPORTS MASSIQUES)
RAPPORTS EN ACTIVITÉ
Quoi qu'il en soit, la présence de traces d'uranium 236 atteste qu'une partie de l'uranium utilisé provient d'opérations de retraitement et pas seulement d'uranium naturel employé pour des opérations d'enrichissement. S'agissant de l'uranium appauvri utilisé par les armées américaines, la présomption d'une incorporation d'uranium de retraitement est plus significative. Au cours du déplacement d'une délégation de la mission d'information à Washington, le médecin colonel Abreu, directeur des enquêtes et analyses au Bureau de l'Assistant spécial du Secrétaire de la Défense, a indiqué à propos de l'uranium appauvri des obus antichars américains qu'il s'agissait d'un produit dérivé d'un processus d'enrichissement ou d'une possibilité d'utilisation de l'uranium retraité. Il n'a pas exclu qu'une faible contamination restait concevable au cours d'un tel processus. Cependant, en l'absence de la totalité des éléments d'information demandés, il n'est pas possible de conclure définitivement sur la question de la composition des munitions à uranium appauvri utilisées au cours de la guerre du Golfe, ni même sur leur éventuelle dangerosité. c) Des précautions prises dans le cadre de l'expérimentation qui n'ont rien à voir avec les conditions opérationnelles du Golfe L'analyse des procédures de sécurité appliquées par la direction des centres d'essais de la DGA conforte le sentiment que les soldats en contact avec des cibles ou des sites touchés par des obus à uranium appauvri auraient été exposés à un risque sanitaire réel. Outre le fait qu'elle reconnaît l'existence de « risques (...) dus essentiellement à la toxicité des oxydes d'UA28 qui sont créés lors de l'impact (des munitions testées) sous forme d'aérosols, de poussières, de fragments de projectiles ou de cibles qui vont se disperser et très rapidement s'oxyder à l'air, de dépôts sur les cibles, les protections ou les montages utilisés lors des tirs », l'étude du réceptacle de la position de tir LTAC2 effectuée par la direction des centres d'expertise et d'essais de la DGA à l'établissement de Bourges, dont les conclusions datent du 28 mai 1995, donne des précisions sur la quantité d'uranium appauvri susceptible d'être diffusée sous forme d'aérosols au moment de l'impact de la munition sur sa cible. En effet, on peut y lire : « Au moment de l'impact, le barreau d'UA est partiellement pulvérisé. Il se forme un nuage d'oxydes d'uranium en suspension dans l'air. D'après la note technique n° 14/CT/CdB/83, sur 3,4 kg d'UA, 2,4 kg passeraient sous forme de particules respirables ». De tels développements donnent une idée du degré d'exposition potentielle des personnels en contact avec des cibles touchées, en phase avec ce qu'a déclaré M. le Médecin général Jean-Yves Tréguier, directeur du Service de Radioprotection des Armées. Cette même étude de la direction des centres d'expertise et d'essais de la DGA ainsi que les consignes de sécurité concernant les règles générales d'exploitation du Site de Tir Uranium (STU) de Bourges, en date du 11 mai 2000, recommandent des moyens de protection pour les personnels appelés à travailler dans la « zone contrôlée » qui inclut notamment « les espaces contaminés par les fragments, les aérosols, les poussières d'UA oxydé ou non » : il s'agit d'une combinaison étanche, d'une paire de bottes, d'une paire de chaussettes, d'une paire de gants, d'un masque respiratoire et d'un dosimètre, autant de moyens dont les militaires exposés étaient dépourvus sur le théâtre d'opérations, hormis lors des alertes chimiques (mais celles-ci n'ont pas eu lieu lors de l'offensive terrestre). On a donc tout lieu de s'interroger sur le niveau de protection des soldats de la Division Daguet face à de tels aérosols. On observera enfin qu'en termes de surveillance médicale, l'étude du réceptacle de la position de tir LTAC2 recommande une visite médicale spécifique semestrielle aux personnels travaillant le plus souvent et le plus longtemps dans la zone contrôlée (plus de 200 heures en un an), les autres étant soumis à une visite médicale annuelle dans le cadre de la médecine du travail et orientée sur le risque potentiel d'exposition aux rayonnements ionisants (note de service du 2.01.95 incorporée à l'étude, points II 2.1 et 2.2). Cela ne manque pas de soulever certaines interrogations au sujet du suivi médical réalisé par la direction centrale du Service de santé des Armées auprès des soldats des 4ème RD, 3ème RIMa, 1er REC et 2nd REI, plus particulièrement exposés à ce risque. C. LES FUMÉES DES INCENDIES DE PUITS DE PÉTROLE En soi, les fumées des incendies de pétrole ne constituent pas le danger sanitaire le plus important auquel les soldats français pourraient avoir été exposés. La mission d'information n'a néanmoins pas écarté cette question, de manière à ce que des experts médicaux chargés d'établir un protocole scientifique puissent l'inclure dans leurs paramètres de recherche. A titre incident, la mission d'information s'étonne que l'Institut français du pétrole, dont le directeur de l'environnement, M. Alain Feugier, a reconnu au cours de son audition le 22 novembre 2000, qu'il a une mission d'intérêt général de protection de l'environnement contre les pollutions d'hydrocarbures, n'ait pas effectué, au lendemain de la guerre du Golfe, un certain nombre d'études ayant pour objectif de mieux cerner ce que seraient les conséquences pour l'environnement, et éventuellement pour la santé de ceux qui seraient appelés à intervenir sur place, d'un conflit ou d'une déflagration à proximité d'installations pétrolières dans une région instable. Sans doute une initiative en ce sens, associant les compagnies pétrolières mais aussi les Etats-majors des Armées, serait-elle la bienvenue. 1. Un risque concernant surtout le Détachement Daguet de Koweït City Selon une note de l'Institut français du pétrole sur l'impact écologique de la destruction des infrastructures pétrolières du Koweït datant du 30 janvier 1991, le nombre de puits de pétrole incendiés dans la région du Golfe arabo-persique au cours du conflit, soit par exaction des troupes irakiennes, soit du fait des combats, s'élevait à 493 installations : 343 dans les champs du nord de l'Emirat du Koweït et 150 dans les champs du sud. Le rapport final de la campagne d'analyses du laboratoire mobile régional de mesure de la qualité de l'air au Koweït du 27 mars au 4 avril 1991 (dont le protocole d'expérimentation fait l'objet de l'encadré ci-dessous) a mis en évidence un risque de pollution en ozone, dioxyde de soufre, monoxyde de carbone, monoxyde et dioxyde d'azote pour le cantonnement du Détachement français présent dans la ville de Koweït City, et plus significatif encore aux abords de l'aéroport et des champs pétrolifères. Les opérationnels ont pris ce risque très au sérieux lors du conflit, comme l'illustre ce passage du compte-rendu COMDAGUET du 24 février 1991 : « Au Koweït, les nombreux puits de pétrole incendiés présentent un danger important pour les troupes coalisées en raison de la chaleur dégagée et de la présence de dioxyde de carbone et de dioxyde sulfureux dans les fumées ». Ce risque semble avoir concerné davantage le Détachement de la Division Daguet à Koweït City que le reste des troupes déployées à l'ouest du front. Le message COMDAGUET/OPS, portant compte-rendu du 30 mars 1991, mentionne l'envoi, en nombre non précisé, de personnels du Détachement Daguet en reconnaissance pour des mesures de pollution sur les champs pétrolifères du nord Koweït avec des ingénieurs de la mission environnement (Airparif sans doute). protocole de la campagne de mesure de la qualité de l'air au koweit Compte tenu des problèmes pratiques rencontrés sur le terrain, (...) il n'a pas été possible d'utiliser le camion laboratoire sur de longues périodes en l'absence de surveillance. En conséquence, deux types de campagnes de mesure ont pu être engagées : 1) Campagnes diurnes, soit en ville soit près des champs de pétrole (dans les « panaches » des feux). Ces campagnes n'ont pu avoir qu'une durée limitée et variable, selon les sites, de 3 à 8 heures ; 2) Campagnes nocturnes, organisées en fonction des conditions de sécurité : a) dans les locaux, fermés et gardés de l'EPC koweïtien, lors de la nuit du 27 au 28 mars 1991, b) sur le « parking » militaire de la New English School (quartier SURRA, au sud-est de Koweït City) ; ancien bâtiment scolaire occupé par le Détachement de la Division Daguet. (...) Sur ce site, des campagnes ont été menées toutes les nuits du 28 mars au soir jusqu'au 5 avril au matin, à l'exception de la nuit du 29 au 30 mars. Points de mesure : 1) siège de l'EPC (ouest de Koweït City) ; 2) Cantonnement du Détachement Daguet (sud-est de Koweït City) ; 3) hôpital de Mansouriya (centre ville de Koweït City) ; 4) champs pétroliers à 150 km au nord de Koweït City ; 5) village de Al Ahmadi à proximité de champs pétrolier (30 km au sud de Koweït City) ; 6) locaux de l'hôpital d'Al Ahmadi ; 7) échange autoroutier de l'aéroport international de Koweït City (2-3 km près de champs pétroliers) ; 8) route intérieure des champs pétroliers d'Al Maqwa et Al Ahmadi. [...] Au vu des définitions des sites de mesures (...), il apparaît clairement que, tout au long des 10 jours complets d'étude, deux classes de points de mesures ont pu être définies. Classe A : points de mesures de « pollution de fond » situés en ville ou en banlieue, proches des habitations mais loin de l'impact direct des panaches émis par les puits en feu. Ces point sont caractérisés a priori par des teneurs moindres mais auxquelles la population koweïtienne est directement exposée, pendant de longues durées. (...) Seront considérés de cette classe A (...) les points 1, 2, 3, 5 et 6. Des situations météorologiques particulières peuvent conduire ces sites à être exposés à une forte pollution. Classe B : points de mesure de « pollution de proximité » situés au milieu des champs pétroliers à proximité immédiate des panaches, dans le désert, loin de toute habitation. Les teneurs mesurées en ces points, a priori les plus fortes, représentent le « risque maximum » mais auquel n'est exposé qu'un faible échantillon de la population (par exemple les personnels des compagnies pétrolières travaillant sur les champs ou participant à l'extinction des feux). Les points numérotés 4, 7 et 8 (...) seront considérés comme caractéristiques de cette classe B. Source : rapport final de la campagne de mesure du laboratoire mobile régional de mesure de la qualité de l'Air au Koweït. On ne peut donc exclure d'éventuelles conséquences sanitaires, là encore pour des cas particuliers, étant entendu que le Détachement Daguet est resté dans sa grande majorité à Koweït City où le risque de pollution était plus faible. 2. Une exposition aux effets mal établis mais potentiellement nuisibles A l'occasion de son audition par la mission d'information, M. Alain Feugier, directeur de l'environnement à l'Institut français du pétrole, a présenté les différents polluants résultant de la combustion (imparfaite) des hydrocarbures des champs pétroliers incendiés par les Irakiens ou les bombardements alliés : « Ces combustions de pétrole brut étaient totalement incontrôlées. Pour qu'il y ait combustion, il faut un combustible et de l'air ; si ce dernier est présent en quantité suffisante, tout le combustible brûlera. Or ce n'était pas le cas dans le type de combustion dont il est question. Une grande quantité d'hydrocarbures n'était pas brûlée et se transformait donc en suie ; c'est ce qui a produit ces fumées très noires que tout le monde a pu observer. Ces particules de suie ont la propriété de contenir du carbone et d'absorber, sur ces particules de carbone, un certain nombre d'hydrocarbures imbrûlés qui peuvent présenter des caractéristiques cancérigènes. Traceurs d'une combustion imbrûlée, les suies forment donc un ensemble très complexe qui comprend des particules solides sur lesquelles sont absorbés des hydrocarbures poly-aromatiques, dont certains peuvent avoir un caractère cancérigène. Le second polluant majeur rencontré au cours de ces combustions incontrôlées, était le monoxyde de carbone (CO). Enfin, dans la mesure où l'on trouve du soufre dans le pétrole brut, sa combustion dégageait également des émissions de dioxyde de soufre (SO2) ». a) Le problème majeur des particules de suie La note de l'Institut français du pétrole sur l'impact écologique de la destruction des infrastructures pétrolières du Koweït précitée place au premier rang des risques encourus par les soldats français, dans le cadre de la pollution atmosphérique qui a résulté de ces incendies, l'émission de particules inhalables résultant des rejets de suie. Il y est en effet indiqué : « A titre d'exemple : en matière de rejet de suie, l'incendie d'un puits éruptif de 7 000 barils par jour (1 000 tonnes par jour) peut conduire à la formation de 10 à 50 tonnes de particules par jour, sous réserve évidemment que la mise à feu soit techniquement possible ». En d'autres termes, les particules de suie dégagées par les incendies représentaient de 1 à 5 % du volume quotidien d'extraction des puits de pétrole, ce qui n'est pas négligeable. De même, le Bulletin de liaison du Réseau de surveillance de la qualité de l'Air en Ile-de-France d'avril-juin 1991 a lui aussi insisté sur le problème des particules : « La pollution de l'air par les particules en suspension est à l'évidence le problème majeur au Koweït. Des valeurs exceptionnellement élevées d'indices de fumées noires ont été relevées tant en ville (745 µg/m3 sur 6 heures et 1591 µg/m3 sur 1 heure) que dans les champs pétroliers (818 µg/m3 en moyenne sur 6 heures et 2030 µg/m3 sur 1 heure). A titre de comparaison, la valeur guide de l'OMS définissant un air de bonne qualité est de 125 µg/m3 pour 24 heures ». La note de l'Institut français du pétrole ne considère pas les rejets de gaz carbonique comme le danger principal, notamment en raison de leur dissémination par les vents. En revanche, le niveau de dioxyde de soufre constaté paraît plus préoccupant, comme le souligne ce passage du Bulletin de liaison du Réseau de surveillance de la qualité de l'Air en Ile-de-France d'avril-juin 1991, dont il a déjà été question précédemment : « Des niveaux de dioxyde de soufre très importants ont été relevés dans les lieux sous influence des incendies, soit dans la ville de Koweït City (2 700 µg/m3 sur 5 minutes et 500 µg/m3 en moyenne sur 12 heures dans la nuit du 3 au 4 avril 1991), soit dans les champs pétroliers le 4 avril 1991 (215 µg/m3 en moyenne et maximum à 1 833 µg/m3). A titre de comparaison, les valeurs guides de l'OMS définissant un air de bonne qualité sont de 500 µg/m3 sur 10 minutes et 125 µg/m3 pour 24 heures ». Et le Bulletin de conclure : « Les experts toxicologues du CEA considèrent que seules les teneurs en dioxyde de soufre et en particules peuvent être préoccupantes pour la santé publique en cas d'exposition prolongée ». On ne saurait être plus clair quant aux expositions potentielles dont les quelque 780-80029 soldats du Détachement Daguet présents à Koweït City au moment des analyses du laboratoire mobile d'Airparif (et même avant) ont fait l'objet. L'hypothèse d'une dispersion d'agents chimiques mélangés aux fumées noires a été, un temps, envisagée. Le rapport de l'Assistant spécial du Secrétaire américain à la Défense pour les maladies de la guerre du Golfe relatif à l'exposition des vétérans américains aux fumées des incendies de puits de pétrole, publié le 2 août 2000, semble néanmoins l'écarter. En revanche, ce document pointe l'insuffisante information des soldats du rang vis-à-vis des risques dus à une exposition aux feux de puits de pétrole. Il conclut néanmoins que cette exposition ne saurait expliquer les pathologies dont se plaignent les anciens combattants de la guerre du Golfe. N°3055 - RAPPORT D'INFORMATION - COMMISSION DE LA DÉFENSE -Engagement des militaires français - Guerre du Golfe - Balkans : risques sanitaires spécifiques -M.Bernard CAZENEUVE, Mme Michèle RIVASI, M.Claude LANFRANCA - Rapport - 2eme Partie 1 Professeur Romain Gherardi : « Syndrome de la guerre du Golfe (SGG) et myofasciite à macrophages (MFM) :vers l'identification d'une maladie des adjuvants vaccinaux aluminiques chez l'homme ? », novembre 2000, p. 3 et 4. 2 Syndrome de la guerre du Golfe. 3 Source ouverte de la Central Intelligence Agency (CIA) disponible sur Internet : « CIA Report on intelligence related to Gulf war illnesses (août 1996). 5 Depuis la guerre du Golfe, ces appareils ont remplacé les Detalac dans les unités. 6 Committee on Veterans' Affairs : « Report of the Special Investigation Unit on Gulf War Illnesses » (S. Prt. 105-39, Part I). 8 Rapport n°69/EDNBCAT/603°RDNBC/OE ; 27 mai 1991. 9 Compte rendu du Médecin chef des services Puygrenier, 4 mars 1991, p 4. 10 Rapport n°69/EDNBCAT/603°RDNBC/OE ; 27 mai 1991. 11 Rapport n°69/EDNBCAT/603°RDNBC/OE ; 27 mai 1991, p. 3. 13 National Defense Research Institute RAND. Volume 2 (1999) pages 73 à 77. 14 myosis : rétrécissement permanent avec immobilité plus ou moins complète de la pupille provenant d'un trouble de l'innervation de l'iris (Garnier-Delamare : Dictionnaire des termes de médecine - Maloine Editeur). 15 Il ne relève pas des compétences de la mission d'information de faire état de données à caractères scientifiques et susceptibles d'être couvertes par des brevets déposés par des entreprises privées. 16 Lettre n° 1269/DEF/EMA/PPB4/CD du 29 juin 1982. 17 autoinjecteur à trois compartiments 18 Document transmis au Directeur Central du Service de santé des Armées par le bordereau n° 041 2è RA / DSS / 3 du 4 juin 1991 19 Document figurant en annexe IA du rapport de fin de mission daté du 25 mai 1991, du Médecin en chef Y. F. Cudennec, Professeur Agrégé du Val-de-Grâce, Commandant le 810ème Hôpital mobile de campagne. 20 Document transmis par bordereau EA-SSAA-CERMA/S.DIR.RECH du 10 juin 1991 à la Direction centrale du Service de santé des Armées (à l'attention du Médecin en chef des Services Leterrier). Ce compte rendu a ultérieurement a été intégré en partie au Rapport du CERMA n° 91-30 de septembre 1991 (Division de Neurophysiologie. Laboratoire central de biologie aérospatiale). 21 Le dimanche 24 février 1991 est le jour de l'engagement terrestre (à 5h30) de la Division Daguet, mais le 11ème RAMA avait été sollicité, dès le samedi 23 février, pour qu'une de ses batteries soutienne en appuie-feu des troupes de l'avant, au nord de Raffah. 22 Article rédigé par M. Pierre Bayle, Officier de réserve et journaliste, relatant son « immersion » au sein d'un véhicule de l'avant blindé (VAB) du 1er Régiment de Spahis, du 18 au 26 février 1991. 23 Commitee on Veterans' Affairs, United States Senate : report of the special investigation unité on Gulf war illnesses, 105th Congress, 105-39, Part I, 1998 : p. 45, 46, 47. Gulf war Veteran's illnesses : VA, DOD continue to resist strong evidence linking toxic causes to chronic health effects, second report by the Committee on Government reform and oversight, House of Representatives, 7 novembre 1997, p. 17. 24 Rapport de l'institut de politique environnementale de l'armée de Terre américaine (US Army environmental policy institute) sur les conséquences sanitaires et environnementales de l'utilisation de l'uranium appauvri par l'armée de Terre américaine ; juin 1994 ; Rapport de l'assistant spécial du Secrétaire américain à la défense pour les maladies de la guerre du Golfe relatif à l'exposition des vétérans américains à l'uranium appauvri ; 31 juillet 1998. 25 La proportion d'uranium 236 mise en évidence par spectrométrie de masse dans leurs urines avoisine 0,000046 %. 26 Lors de l'audition de M. Henri Staeger, Président de la SICN, le 20 mars 2001, il a été expliqué aux membres de la mission d'information que l'uranium appauvri sous forme métal qui est incorporé dans les obus flèches français provient de la société américaine Nuclear Metal Inc (NMI), rebaptisée depuis peu Starmet. L'usine française de transformation des minerais d'uranium en métal, situé à Malvési, ayant été fermée, le choix de l'importation se serait imposé tout à la fois pour des raisons de coûts et de spécifications (l'uranium appauvri ne devant pas contenir trop d'impuretés). Ainsi s'explique l'importation par la France d'uranium appauvri d'origine américaine à plusieurs reprises : 102 kilogrammes en 1979, 75 tonnes en 1991 (à destination de la compagnie d'études et réalisations de combustibles nucléaires) et 910 tonnes en 1993 (pour la SICN). 27 La méthodologie qui a été retenue pour ces analyses était la suivante : - pour les isotopes U 234, U 235, U 236, U 238 et Np 237 : mise en solution de 100 mg à 1,3 g d'échantillons en milieu acide chloro-nitrique et mesure directe de la solution, après dilution, au moyen de la technique de spectrométrie de masse Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (appareil utilisé : VG Plasmaquad 2+ à quadripôle) ; - pour les isotopes U 234, U 235, U 236, U 238 et Np 237 : mise en solution de 100 mg à 1,3 g d'échantillons en milieu acide chloro-nitrique et mesure directe de la solution, après dilution, au moyen de la technique de spectrométrie de masse Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (appareil utilisé : VG Plasmaquad 2+ à quadripôle) ; - pour l'isotope U 232 : électrodéposition sur coupelle d'une aliquote de la solution correspondant à 100 µg d'uranium total et mesure de la coupelle au moyen de la technique de spectrométrie alpha (temps de comptage : 4 000 minutes) ; - pour les isotopes Co 60, CS 137, Am 241 : mesure directe au moyen de la technique de spectrométrie gamma Germanium hyper pur de 100 mg à 1,3 g d'échantillon solide ; - pour le Pu 239 : après mise en solution, séparation et purification radiochimiques sur des colonnes anioniques. La moitié de l'échantillon purifié est mesurée au moyen de la technique de spectrométrie de masse. L'autre moitié est électrodéposée sur coupelle. Mesure de la coupelle au moyen de la technique de spectrométrie alpha (temps de comptage 1 000 à 8 000 minutes). La mesure du plutonium a été effectuée au moyen de deux techniques différentes : ICP-MS et spectrométrie alpha. Les deux résultats obtenus sont cohérents. De même, les différences observées dans les limites de détection s'expliquent par la mise en _uvre de masses d'échantillons variables et de temps de comptage différents. 29 Ce nombre variait selon les jours : ainsi au 27 mars 1991 il y avait 804 militaires français au sein du Détachement Daguet ; au 31 mars 1991, ils étaient 787. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

