|
N° 1868 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004. AVIS PRÉSENTÉ AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2005 (n° 1800), TOME I INTÉRIEUR ET LIBERTÉS LOCALES SÉCURITÉ INTÉRIEURE PAR M. GÉRARD LÉONARD, Député. -- Voir le numéro : 1863 (annexe 26).
INTRODUCTION 5 I. - LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE : VERS UNE CULTURE DU RÉSULTAT 9 A. L'EFFICACITÉ CONFIRMÉE DE LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE 9 1. Le reflux continu de la délinquance globale 9 2. Un point fort, la délinquance de voie publique ; un seul point faible, les violences aux personnes 12 3. Le nouveau tassement de la délinquance des mineurs 16 4. Le taux d'élucidation, indicateur de l'efficacité des services 17 B. DÈS 2005, LA LOLF SERA UN OUTIL DE MANAGEMENT ET DE CONTRÔLE 34 1. La victoire du bon sens : une mission interministérielle et deux programmes 34 2. Pour un découplage des actions « sécurité publique » et « ordre public » de la gendarmerie 37 3. Pour des budgets opérationnels de programme (BOP) départementaux 39 4. Pour des indicateurs pertinents et en nombre suffisant 43 II. - BUDGET 2005 : LA DYNAMIQUE DE LA PROGRAMMATION 47 A. UNE ÉVOLUTION GLOBALE TRÈS FAVORABLE 47 1. Un paradoxe : l'évolution maîtrisée des crédits de personnel, qui sont prioritaires 47 2. Les crédits de la police : des moyens encore renforcés 48 3. Les crédits de la gendarmerie : un rattrapage partiel 52 B. LA TROISIÈME TRANCHE DE LA LOPSI 56 1. Une programmation inégalement respectée 57 a) Police : 68 % de l'enveloppe en trois ans 57 b) Gendarmerie : effort sur l'équipement individuel, retard de l'investissement 59 2. Les crédits de personnel 61 a) 1 000 nouvelles créations d'emplois dans la police, stabilisation à 11 300 adjoints de sécurité 61 b) gendarmerie : 440 emplois nets créés, transformation ou repyramidage de 2 200 emplois 64 3. L'équipement courant des unités de police 65 a) Les moyens de fonctionnement : un effort soutenu 65 b) L'informatique et la télématique : une accélération 65 c) L'investissement : rénovation et modernisation du patrimoine immobilier 65 4. La poursuite de l'effort d'acquisition de matériel par la gendarmerie 66 III. - « IL N'EST DE RICHESSE QUE D'HOMMES » : POLICE ET GENDARMERIE À LA POINTE DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT 67 A. RÉFORME DES CORPS ET CARRIÈRES : LA MODERNISATION DE LA POLICE NATIONALE 67 1. Un patient travail de négociation et d'élaboration. 68 a) La préparation interne à la direction générale de la police nationale. 68 b) La phase interministérielle 68 c) La phase paritaire 69 d) Après la signature : la phase de suivi paritaire 70 2. Un renforcement sans rupture 71 3. Un accord général sur les orientations du protocole d'accord 72 a) Rendre plus efficace l'organisation hiérarchique en redéfinissant et en redistribuant les fonctionnalités 72 b) Renforcer les compétences et l'encadrement quotidien 75 c) Mieux motiver en reconnaissant les professionnalismes, les mérites et en redonnant des perspectives de carrière 76 d) Récupérer du potentiel par une gestion du temps de travail plus rigoureuse 77 e) Moderniser la gestion des ressources humaines dans l'intérêt du service public et des personnels 78 4. Un vigoureux effort de formation pour accompagner la réforme 79 a) En formation initiale 80 b) En formation continue. 80 c) Accompagnement des processus d'avancement. 80 5. Le contenu et le coût de la deuxième « tranche », réalisée en 2005. 81 B. LE MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES DANS LA GENDARMERIE 85 1. La poursuite du plan d'amélioration de la condition militaire 86 a) La mobilité géographique 86 b) L'aménagement du temps de travail 86 2. Le plan d'adaptation des grades aux responsabilités exercées (pagre) 87 a) Le premier volet du pagre : renforcer l'encadrement de la gendarmerie nationale 88 b) Le volet indiciaire du pagre : reconnaître à leur juste niveau les fonctions de responsabilités 89 EXAMEN EN COMMISSION 92 DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LE RAPPORTEUR 119 PERSONNES ET ORGANISATIONS ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 122 MESDAMES, MESSIEURS, Grâce à l'action efficace conduite depuis 2002, la sécurité vient de rétrograder au deuxième rang des préoccupations des Français. Ce résultat remarquable doit être pris comme un encouragement. Il confirme que la mobilisation des policiers et des gendarmes porte ses fruits et que la politique menée dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (lopsi) du 22 août 2002 est la bonne. Il faut donc persévérer. Rapporteur, en son temps, de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité (lops) de 1995, le rapporteur pour avis sait d'expérience que la troisième année de mise en œuvre d'une programmation quinquennale est déterminante. Si les engagements pris ne sont pas tenus à ce stade, le temps perdu ne peut plus être rattrapé. Le projet de loi de finances pour 2005 comprend un total de 10,36 milliards d'euros de crédits au titre de la sécurité, dont 5,88 milliards d'euros pour la police nationale sur le budget de l'intérieur et 4,48 milliards d'euros au titre de la gendarmerie nationale au budget de la défense. Leur croissance, portée par la dynamique de la programmation quinquennale, reste supérieure à la norme de 1,7 % pour l'ensemble du budget général. Elle est proche de 2 % pour les crédits de la police nationale - après deux années de forte augmentation - et de 3,4 % pour la gendarmerie nationale, traduisant un rattrapage très bienvenu. En trois ans, les moyens des forces de sécurité auront été relevés de 1 285,3 millions d'euros, soit 14 %. Pourtant, l'essentiel en la matière ne se situe pas dans les taux d'évolution : il est d'ordre qualitatif. Comme chaque année, le rapporteur a souhaité multiplier les rencontres sur le terrain avec les acteurs de la sécurité. Source irremplaçable d'information, ces échanges montrent aussi toute la richesse humaine que gendarmes et policiers savent mettre au service de leurs concitoyens. En 2005 et durant les années suivantes, police et gendarmerie poursuivront une réforme en profondeur de leurs ressources humaines. L'organisation de leur encadrement, encore assez dissemblable, va fortement converger, avec la déflation des corps de commissaires et d'officiers de police, et le plan d'adaptation des grades dans la gendarmerie. Les recrutements se poursuivront à un rythme soutenu, quoiqu'un peu en retrait sur la programmation. Les rémunérations seront améliorées par des revalorisations indiciaires traduisant la reconnaissance par la Nation des responsabilités exercées. Mais, grâce à la culture de résultat, cette rénovation s'accompagnera d'une maîtrise des crédits de personnel, qui augmenteront moins vite que les prix. Cette modération dégage des marges de manœuvre pour les moyens de fonctionnement et d'équipement, qui seront renforcés globalement de plus de 150 millions d'euros, soit 7 % en 2005, dont 6,3 % pour la police et 7,6 % pour la gendarmerie. Il n'est probablement pas d'administration qui ait consenti, depuis une douzaine d'années, autant d'efforts de rénovation pour s'adapter aux demandes de la société. En matière de sécurité intérieure, le management des performances, des crédits, des ressources humaines est à la pointe de la réforme de l'État. Les Français en ont-ils conscience ? Au moins ont-ils le sentiment justifié que la sécurité progresse. Le budget pour 2005 doit consolider ce mouvement. I. - LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE : VERS UNE CULTURE DU RÉSULTAT A. L'EFFICACITÉ CONFIRMÉE DE LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE Conformément aux engagements pris devant les Français par le Président de la République et la majorité, la sécurité se rétablit en France. La nette atténuation du sentiment d'insécurité est pleinement justifiée par les résultats enregistrés depuis les élections de 2002. Après cinq années consécutives de hausse, la courbe d'aggravation de la délinquance a été cassée. Elle est repassée l'an dernier en dessous du seuil symbolique de 4 millions de crimes et délits, et poursuit sa baisse continue, encore confirmée au mois de septembre par les derniers résultats. Le reflux spectaculaire de la délinquance de voie publique est déterminant dans le retour du sentiment de sécurité. Ces succès sont le résultat d'une politique dissuasive pour les auteurs d'infraction, d'une optimisation des moyens disponibles et d'une mobilisation de longue haleine des policiers et des gendarmes, mieux organisés et plus présents sur le terrain. 1. Le reflux continu de la délinquance globale · Depuis dix ans, l'évolution générale de la délinquance constatée par les services de police et de gendarmerie a connu des évolutions très contrastées. Trois époques se sont succédé. De 1994 à 1997, la délinquance a baissé globalement de 10,9 %. Au cours de la précédente législature, elle s'est ensuite fortement aggravée, le nombre de faits s'accroissant de 15,4 % entre 1998 et 2002. · Confirmant la corrélation avec le rythme des alternances, le mouvement de baisse s'est effectué dès le second semestre de 2002, d'où la quasi-stagnation constatée sur l'année : + 1,3 % et 52 090 faits supplémentaires. Le contraste est flagrant avec la dégradation des années 2000 (+ 5,7 % avec 203 985 faits supplémentaires) et surtout 2001 (+ 7,7 % avec 289 943 faits supplémentaires). Durant l'année 2003, la criminalité globale a connu une diminution, en nombre de 139 188 faits et en pourcentage de 3,4 %.
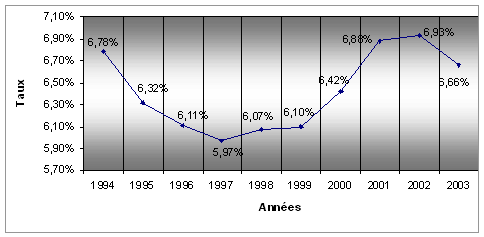 · Ces résultats remarquables seront confirmés en 2004, grâce à une baisse continue des faits constatés au cours des neuf premiers mois de l'année. Au premier semestre 2004, les services de police et de gendarmerie de métropole ont constaté 1 926 733 crimes et délits, soit 74 864 de moins qu'au cours de la même période de 2003. La délinquance a baissé de plus de 3,7 % . Sur deux ans, par rapport au premier semestre 2002, ce sont plus de 160 000 faits de délinquance en moins. Une part appréciable du terrain perdu depuis l'année 2000 a donc déjà été reconquise. Alors que la délinquance avait connu une forte aggravation dans les zones relevant de la gendarmerie nationale en 2002 (+ 8,6 %), son reflux en 2003 touche de façon comparable police et gendarmerie. Cette dernière a constaté 1 140 139 crimes et délits, soit un chiffre en retrait de près de 3,6 % sur 2002. Sa part dans la délinquance totale reste stable, autour de 28,7 %. La police a constaté 2 834 555 faits, en baisse de 3,3 %, prolongeant celle de 2002 (- 1,4 %). Pour une population de 59,6 millions d'habitants au 1er janvier 2003, le taux de criminalité s'établit à 66,66 pour mille habitants en France métropolitaine en 2003, contre 69,32 en 2002. Pourtant, la loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003, afin de lutter contre les violences urbaines, a créé 22 nouvelles infractions, dont rendent compte les statistiques de la délinquance depuis avril 2003. Le rapporteur note avec satisfaction que la baisse de la délinquance n'est pas encore parvenue à un palier, après deux ans de succès des services. C'est ainsi qu'au mois de septembre dernier, la délinquance a diminué de 3,8 % sur douze mois, résultat sans précédent pour cette période de l'année. Il s'agit du neuvième mois consécutif de baisse en 2004, dont - 5,5 % dans les zones relevant de la gendarmerie nationale (85 077 faits) et - 3,1 % dans ces circonscriptions de la police nationale (226 387 faits). Les 311 464 faits constatés au cours du mois correspondent à 12 326 crimes et délits de moins qu'en septembre 2003. S'agissant de l'évolution très favorable enregistrée dans les zones relevant de la gendarmerie nationale, un facteur explicatif intéressant, quoique difficile à quantifier, réside dans la mise en place des communautés de brigade. Les commandants de groupement, de compagnie ou de brigade rencontrés par le rapporteur ont souligné le gain, lié non seulement à la mutualisation des moyens matériels, mais aussi à l'allègement des charges administratives. La création d'une communauté, en dégageant des marges de manœuvre et du temps disponible pour la présence sur le terrain, permet de lutter plus efficacement contre la délinquance. Dans certaines communautés de brigades, l'amélioration se lit de façon flagrante dans les statistiques et a pu être évaluée à 20 % en ordre de grandeur. Afin de garantir l'information de nos concitoyens sur le détail de ces évolutions, les travaux de l'Observatoire national de la délinquance permettent de consulter chaque mois, sur le site Internet du ministère de l'Intérieur, les 107 rubriques de l'« état statistique 4001 » qui recense les crimes et délits. Ces données y sont présentées consolidées, et distinguent notamment les faits et les suites qui leur sont données.
2. Un point fort, la délinquance de voie publique ; un seul point faible, les violences aux personnes
À l'exception de la catégorie des crimes et délits contre les personnes (+ 6,9 %), les trois autres grandes catégories d'infractions sont orientées à la baisse : infractions économiques et financières (- 6,5 %), vols y compris les recels (- 5,8 %) et autres infractions dont stupéfiants (- 0,9 %). ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA DÉLINQUANCE PAR TYPE D'INFRACTIONS
· Les vols, qui rassemblent près de 59 % des crimes et délits, ont baissé de 5 % en 2003. Au premier semestre 2004, leur baisse atteint 5,8 %, soit 70 041 faits de moins. Cette tendance globale résulte essentiellement des baisses affectant les vols liés à l'automobile et aux deux roues à moteur (- 10,6 %, soit 51 538 faits de moins), les cambriolages (- 6,1 %, soit 12 387 faits de moins), les vols avec violences (- 3,6 %, soit 2 170 faits de moins), et les vols à main armée contre des particuliers sur la voie publique (- 8,9 %, soit 104 faits de moins). À l'inverse, les autres vols simples au préjudice de particuliers connaissent une hausse de 3,14 %, soit 5 197 faits supplémentaires.
· Les infractions économiques et financières, après un tassement de 1,7 % en 2003, connaissent au premier semestre un important recul : - 6,5 % (soit 11 331 faits de moins), et elles représentent 8,5 % de l'ensemble des crimes et délits constatés. Cette tendance est liée à la forte baisse de 8,6 % affectant les falsifications, usages de chèques volés, ainsi que les escroqueries et abus de confiance. La délinquance économique et financière proprement dite (infractions à la législation sur les sociétés) diminue de 2,9 %. Les infractions à la législation sur les chèques sont en baisse de 16,4 %, soit 920 faits de moins. Seuls sont en augmentation les faux en écriture privée et les infractions à l'urbanisme, qui portent sur un moindre nombre de faits.
· Les crimes et délits contre les personnes restent orientés à la hausse du 1er semestre : + 6,85 %, soit + 10 898 faits). Ils représentent le seul indicateur préoccupant, après une augmentation de plus de 85 % et 150 000 faits en dix ans. Leur hausse a été de 7,3 % en 2003. L'augmentation enregistrée par cette catégorie d'infraction résulte essentiellement des atteintes aux mœurs (+ 17,3 %, soit + 3 297 faits), des autres atteintes volontaires contre les personnes (+ 8,3 %, soit + 3 965 faits) ainsi que des coups et blessures volontaires non suivis de mort (+ 4,3 %, soit + 2 838 faits) Les infractions contre la famille et l'enfant progressent de 3,4 %, soit 847 faits. Ce résultat est principalement imputable aux défauts de versement de pension alimentaire (+ 9,30 %, soit + 630 faits). Sont en revanche à noter la baisse des tentatives d'homicides (- 8,1 %, avec - 50 faits) et une certaine stabilité des homicides commis (+ 7 faits). Cette évolution est au total le reflet des violences familiales, et singulièrement des violences conjugales. Elle n'est pas sans lien avec les campagnes de sensibilisation et les efforts des forces de sécurité en vue de la dénonciation de ces faits. En ce domaine, la réponse réside à la fois dans la prévention et dans l'implication du Parquet pour apporter une réponse particulièrement rapide et sévère. C'est ainsi que la politique menée par le procureur de la République de Douai illustre l'efficacité d'une réponse judiciaire adaptée.
· Les autres infractions dont celles portant sur les stupéfiants, qui représentent près d'un quart du total des infractions constatées, diminuent de 0,9 %, soit 4 390 faits de moins au premier semestre, après un premier recul de 3,1 % en 2003. L'orientation globale à la baisse de cette catégorie résulte principalement des destructions et dégradations de biens (- 7,7 %, soit -21 851 faits) et sous cette rubrique les destructions et dégradations de véhicules privés (- 8,5 %) ainsi que les autres destructions et dégradations de biens privés (- 7,6 %). À l'inverse, du fait d'une activité renforcée des services de police et de gendarmerie, sont orientés à la hausse : les infractions à la législation sur les stupéfiants (+ 14,7 %, soit + 8 969 faits) et les délits à la police des étrangers (+ 12 %, soit + 3 465 faits).
· L'agrégat de la délinquance de voie publique, très traumatisante pour nos concitoyens, regroupe les infractions qu'une présence policière efficace sur la voie publique est susceptible de faire diminuer. Il porte sur les vols à main armée, les vols avec violences, les vols à la tire, les cambriolages, les vols d'automobiles et de véhicules de transport avec fret, les vols d'accessoires automobiles, les vols de véhicules motorisés à deux roues, les vols à la roulotte et les destructions et dégradations autres que les incendies et attentats. Cette délinquance a reculé de 10,8 % en dix ans, soit 255 519 faits de moins. En 2003, avec 2 107 686 faits constatés, elle a connu le plus fort recul de ces dix dernières années : - 9 %, soit 207 879 faits de moins par rapport à l'année 2002. Elle représente 53 % du total des crimes et délits enregistrés par les services de police et de gendarmerie en France métropolitaine au lieu de 56,3 % en 2002.
Au premier semestre 2004, avec 985 396 faits constatés, cette délinquance enregistre une nouvelle baisse de 8,5 % par rapport au premier semestre 2003. Sa part dans la délinquance globale est en recul à - 51,1 %. Le taux d'élucidation de la délinquance de voie publique est en progression de 10 %, contre + 9,2 % au 1er semestre 2003. 3. Le nouveau tassement de la délinquance des mineurs Au cours des dix dernières années, le nombre de mineurs mis en cause à l'occasion de crimes ou délits s'est accru de + 64,4 %, soit 70 424 mineurs de plus. Leur part dans le total des personnes mises en cause s'est sensiblement accrue : elle est passée ainsi de 14,1 % en 1994 à 18,8 % en 2003. Or les mineurs de 13 à 18 ans ne représentent que 6,5 % de la population totale. S'agissant des catégories d'infractions, l'accroissement du nombre des mineurs mis en cause est de 17,6 % pour les vols (y compris recels), 64,5 % pour les infractions économiques et financières, 166,6 % pour les crimes et délits contre les personnes et 159,5 % pour les autres infractions dont stupéfiants. Ce grave phénomène de société a enfin connu un tournant en 2003. Le nombre total des mineurs mis en cause pour crimes et délits a légèrement diminué : - 0,3 % par rapport à l'année 2002. La part des mineurs dans le total des mis en cause a baissé de plus d'un point, à 18,8 % en 2003. Elle diffère selon les infractions. On relève, par ailleurs, que la part des mineurs dans le total des mis en cause pour des faits de délinquance de voie publique est de nouveau en légère diminution : 34,4 % en 2003, contre 35 % en 2002. La tendance est toutefois encore fragile : au cours du 1er semestre 2004, le nombre des mineurs mis en cause s'est accru de 3,8 %. Cependant, leur part dans le total des mises en cause continue de baisser durant la même période.
4. Le taux d'élucidation, indicateur de l'efficacité des services L'une des évolutions les plus déplorables de la dernière décennie est la dégradation tendancielle du taux d'élucidation. Celui-ci établit le rapport entre les affaires élucidées et les faits constatés par les services de police ou de gendarmerie. Il avait chuté de dix points entre 1994 et 2001, pour atteindre 24,9 %. De plus d'un tiers, la part des faits élucidés par les services est donc passée en deçà d'un quart. Il s'agit d'une dégradation de l'ordre de 4,7 % en rythme annuel sur sept ans. Certes, le taux global d'élucidation agrège des résultats très contrastés, selon la nature des infractions. En matière de vol ou de délit de voie publique, une affaire sur dix est élucidée, alors que les deux tiers des atteintes aux personnes le sont. Mais, comme le montre le tableau ci-joint, les courbes d'évolution, quoique décalées, sont bien parallèles.
En outre, le taux d'élucidation ne reflète pas mécaniquement l'activité des services ou leur succès, ce que soulignent les membres des corps d'inspection auteurs du rapport annuel sur l'exécution de la lopsi.
Ces remarques sont une incitation à la réflexion critique sur la valeur des indicateurs de résultats : ceux-ci doivent être combinés et hiérarchisés pour assurer une exacte appréciation des activités des services. Il reste que l'évolution du taux d'élucidation est très probante. Le rapport d'inspection sur l'application de la lopsi s'appuie, pour juger de l'efficacité des services, sur cet indicateur, pleinement corroboré par celui des infractions relevées par l'action des services. Ses auteurs concluent : « Dans la plupart des missions assignées à la police nationale et à la gendarmerie nationale, les résultats globaux obtenus dans l'année 2003 sont manifestement et incontestablement en progression sensible (1) ». La chute de la part des faits élucidés durant sept ans, puis le brusque redressement dès le milieu de l'année 2002, ne sont pas fortuits. Le recul tendanciel était le signe d'une inadaptation des services, progressivement moins aptes à suivre les évolutions de la délinquance, occasionnant certains découragements. « L'effet Sarkozy » a eu pour traduction immédiate une remobilisation des personnels ; plus profondément, la politique dont la lopsi était porteuse a développé les moyens disponibles et amélioré leur organisation. La culture du résultat commence à porter ses fruits. Globalement, la part des faits élucidés s'est accrue de plus de 2,5 points en 2003, à 28,8 %, soit un gain de 3,9 points en deux ans. L'amélioration se poursuit, voire s'amplifie cette année. Au premier semestre 2004, 607 216 faits parmi les 1 926 733 faits constatés, soit 31,5 %, ont été élucidés par la police et la gendarmerie. Par comparaison, le taux d'élucidation était de 28,15 % au 1er semestre 2003. Ce taux moyen est donc revenu à un meilleur niveau qu'en 1996. Il recouvre comme toujours des résultats très disparates. Certaines infractions graves mobilisent les services de police et des unités de gendarmerie qui bénéficient souvent pour ces faits de l'aide des victimes ou des témoins. Ainsi, les homicides sont élucidés à 78,4 %, les coups et les blessures volontaires à 74,8 %, les viols à 76,3 % et les vols à main armée à 36 %. À l'inverse, des infractions sont portées à la connaissance de la police ou de la gendarmerie par des victimes qui n'ont pas forcément de liens directs avec les auteurs : les cambriolages élucidés à 9,6 % et les vols à la tire à 3,9 %, une plainte pour vol pouvant parfois dissimuler une simple perte. Comme le relève le rapport sur l'application de la lopsi, l'efficacité accrue des services de police et de gendarmerie s'est traduite dans l'évolution des différentes composantes de la criminalité. Si le taux d'élucidation est stabilisé à un niveau élevé pour la criminalité organisée, au voisinage de 81,3 %, il progresse s'agissant de la délinquance de voie publique, de près d'un point entre le premier semestre 2003 et le premier semestre 2004, pour atteindre 9,2 %. L'amélioration est plus rapide encore s'agissant des crimes et délits contre les personnes : en dépit de l'augmentation des faits constatés, le phénomène demeure donc contrôlé. On relèvera enfin que l'ensemble des indicateurs d'activité des services connaissent depuis le milieu de l'année 2002 des augmentations extrêmement vives, qui tendent à accélérer au cours des huit premiers mois de l'année 2004.
Enfin, les résultats présentent de grandes variations locales, comme le confirment les tableaux ci-après. Le premier se rapporte à la situation de la délinquance dans les circonscriptions de sécurité publique, étant rappelé que 71,3 % des infractions sont relevées dans les zones de compétences de la police nationale. Le second fournit, par département, les données analogues concernant la gendarmerie, qui constate 28,7 % des infractions. DONNÉES STATISTIQUES RELATIVES AUX EFFECTIFS DE POLICE
DONNÉES STATISTIQUES RELATIVES AUX EFFECTIFS DE GENDARMERIE
B. DÈS 2005, LA LOLF SERA UN OUTIL DE MANAGEMENT ET DE CONTRÔLE 1. La victoire du bon sens : une mission interministérielle et deux programmes Dans son rapport pour avis sur les crédits de 2004, le rapporteur avait fortement plaidé pour que les moyens budgétaires destinés à la mise en œuvre de la lopsi soient retracés sur une mission interministérielle, regroupant deux programmes, relatifs respectivement à la police et à la gendarmerie nationale. Cette présentation était la seule à même d'assurer le contrôle de l'application de la lopsi de 2002, qui n'était rien moins que l'expression de la politique de la législature en matière de sécurité intérieure. Le risque était, en diluant les crédits de la gendarmerie dans le budget militaire, de perdre toute visibilité sur l'application de la lopsi. L'enjeu était majeur à tel point que, à l'issue d'un débat budgétaire qui avait confirmé les hésitations du Gouvernement, les deux présidents et les deux rapporteurs compétents de la commission des Finances et de la commission des Lois de l'Assemblée nationale ont cru devoir adresser au Premier ministre une lettre pour l'alerter. La concertation interministérielle, arbitrée au plus haut niveau, a été fructueuse, puisque la raison l'a emporté. La nouvelle architecture budgétaire est présentée à titre indicatif cette année conformément au I de l'article 66 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Mais elle s'appliquera à compter du budget pour 2006. Selon cette maquette, la mission « Sécurité » sera l'une des neuf missions interministérielles du budget général. Elle se composera des deux programmes souhaités par le Parlement et qui correspondaient tant à une logique politique qu'à une logique de management. C'est tout naturellement que le directeur général de la police nationale, M. Michel Gaudin, et le directeur général de la gendarmerie nationale, M. Pierre Mutz, ont été désignés responsables de ce programme. Cette architecture reflète bien la nature des choses voulue par la lopsi : la gendarmerie, partie intégrante du ministère de la Défense, est placée pour emploi auprès du ministère de l'Intérieur pour l'exécution de ses missions de sécurité intérieure. La mission Sécurité fait l'objet, en annexe au présent projet de loi de finances, d'un avant-projet annuel de performances des programmes, qui préfigure les futurs « bleus budgétaires ». La présentation d'ensemble, d'une grande clarté, augure bien de son double usage : pilotage de la performance et évaluation par le Parlement de la politique conduite. Il conviendra bien sûr que la mise au point de l'outil lui assure la précision requise. · Les tableaux ci-joints résument, selon cette présentation, les budgets 2004 et 2005, en termes de crédits de paiement. Deux optiques sont utilisées. Les dotations peuvent d'abord être présentées par nature de dépenses, ventilées par titre et par catégorie. Cette présentation est la plus proche du budget actuel. Par rapport aux deux agrégats actuels, elle s'en distingue principalement sur deux points. En premier lieu, le montant des pensions civiles est incorporé dans les crédits de la police. De ce seul fait, les masses financières de ce programme sont majorées de 1,9 milliard d'euros. Quant au programme Gendarmerie nationale, il reprend une part des crédits de l'agrégat, auxquels s'ajoutent les dotations relatives au personnel civil employé par la gendarmerie, également pour un montant de 1,9 milliard d'euros. En sens inverse, une fraction très marginale des crédits de l'agrégat ne serait pas reprise sur la mission « sécurité », mais sur la mission « défense », pour un montant évalué à 14,5 millions d'euros en crédits votés 2004. Ces crédits se rapportent principalement à des rémunérations, et de façon accessoire à des locations immobilières et frais d'alimentation.
Le rapporteur salue l'orientation ainsi retenue, consistant à reprendre la quasi-totalité des crédits de la gendarmerie nationale sur sa mission « Sécurité ». Celle-ci représente, pour la métropole, son cœur de métier et l'immense majorité de ses charges. Le décret organique du 20 mai 1903 ne lui a-t-il pas donné mission de « veiller à la sûreté publique, assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois » ? Il faut donc se réjouir que n'aient pas eu de suite les réflexions qui auraient tendu à inscrire sur la mission « défense », par exemple au titre de la préparation et l'emploi des forces, certaines dotations de la gendarmerie, notamment en matière d'équipement. S'il y a des synergies à développer, ce n'est pas avec l'armée de terre pour l'entretien des chars Leclerc, mais bien plutôt avec la police, du fait de la similarité des missions et des moyens matériels. En plein accord avec l'esprit et la lettre de la lopsi, des réflexions sont en cours sur la mutualisation de plates-formes logistiques et des transports de la gendarmerie et de la police. Le 27 avril dernier, les deux directeurs généraux ont signé un protocole cadre relatif à la mutualisation des moyens de maintenance automobile. Il permet de mutualiser les structures et outillages spécifiques d'entretien et de réparation des deux forces et de fournir des prestations spécialisées (contrôle et expertise). Une lettre d'instruction commune aux préfets sgap et aux commandants de légion de gendarmerie prévoit une mise en œuvre avant la fin de l'année 2004. Ainsi, il importe de faire vivre l'esprit de la loi de programmation, dans le cadre de la nouvelle gestion publique. 2. Pour un découplage des actions « sécurité publique » et « ordre public » de la gendarmerie
· Le tableau qui précède présente la préfiguration des crédits ventilés selon la seconde approche : celle de la destination de la dépense, qui doit être la plus fructueuse en termes de gestion publique. S'agissant tout au moins de la police nationale, la définition des actions est fidèle à celle envisagée l'an dernier. Le programme « police nationale » est divisé en six actions. Sa finalité est de garantir la sécurité des Français en luttant contre toutes les formes de délinquance. L'action « ordre public » finance le renseignement et les compagnies républicaines de sécurité. Celles-ci feront l'objet en 2005 d'une expérimentation de gestion globalisée selon les règles de la lolf. La direction centrale des crs, qui avait été précurseur dès 1990 dans la globalisation des crédits, dispose en test depuis le 1er octobre 2004 d'un tableau de bord mensuel de moyens et de résultats associés à une batterie d'indicateurs. Comme l'a indiqué au rapporteur M. Jacques Lamotte, directeur central, les activités des crs font l'objet d'une comptabilisation dès le premier tour de roue des cars. Par ailleurs, la répartition des moyens entre les actions ne doit pas être vue de façon simpliste. L'activité de maintien de l'ordre ne représente qu'environ 45 % des activités des crs, qui participent à cinq des six actions du programme. L'action « sécurité et paix publiques » concerne les services de police de proximité et de voie publique. L'action « police des étrangers et sûreté des transports internationaux » regroupe l'activité de la police aux frontières, le contrôle des flux migratoires, la lutte contre l'immigration irrégulière et les reconduites à la frontière. Elle contribue en outre à la sûreté des moyens de transports et anime la coopération transfrontalière. Sa particularité est de ne pas avoir de symétrique dans les actions de la gendarmerie. L'action « police judiciaire et concours à la justice » retrace le financement des enquêtes et des surveillances et le concours aux autorités judiciaires. Ces concours aux autorités judiciaires représentent, pour les services de police comme de gendarmerie, une activité absolument considérable. La charge de travail liée à l'escorte et au transfèrement des détenus pèse à hauteur de 1 880 fonctionnaires en équivalent temps plein sur les forces de police et de gendarmerie À titre d'exemple, dans la circonscription de sécurité publique d'Aix-en Provence, ville qui compte notamment la maison d'arrêt de Luynes, une cour d'appel, une cour d'assises et un tribunal de grande instance, les gardes et escortes judiciaires ont mobilisé en 2003 l'équivalent de 55 fonctionnaires à temps plein, soit un policier sur six. Or, ces charges connaissent une croissance très rapide (+17,6 % en 2003 à Aix-en-Provence), et désorganisent les services, car elles ne se programment pas. La charge est particulièrement lourde s'agissant des gardes et escortes des détenus malades dans les huit unités hospitalières de sécurité interrégionales (uhsi). Le ministère de la justice ayant donné un accord de principe à la prise en charge par l'administration pénitentiaire de ces opérations à but médical ou judiciaire, une expérimentation a été envisagée pour en analyser les effets et les conditions de mise en œuvre. Après concertation, l'expérimentation porterait, à compter du 1er janvier 2005, sur les gardes et escortes médicales - et non judiciaires - de l'uhsi de Nancy, ouverte depuis février dernier. Elle mobiliserait une trentaine de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, pour un coût annuel de l'ordre de 1,7 million d'euros. À l'issue de l'année d'expérimentation, les leçons pourront être tirées quant aux modalités de prise en charge de ces missions, afin de recentrer l'activité des forces de l'ordre sur leurs missions prioritaires, comme prévu par la lopsi. En dernier lieu, l'action « commandement, formation et logistique » comprend le logement des fonctionnaires de police, les programmes immobiliers et d'équipement (dont acropol), le corps d'inspection, la formation des policiers et les services de gestion. · Le programme « gendarmerie nationale » serait, quant à lui, décomposé en cinq actions : La première correspond à un pôle général « ordre et sécurité » intégrant différents volets : maintien de la sécurité publique, protection des personnes et des biens, ordre public, protection des institutions et renfort des unités territoriales. A cet égard, la présentation sur un même document des dotations de la police et de la gendarmerie est éclairante. Cette première action, qui représente à elle seule pas moins de 44 % des crédits, est le strict équivalent des deux premières actions de la police (qui, à elles deux, totalisent 34 % des crédits de la police). On comprend mal pourquoi ne sont pas séparés sur deux actions les deux axes « 11-sécurité publique » et « 12-ordre public ». Le document annexe opère clairement la distinction, en précisant que l'ordre public concerne essentiellement la gendarmerie mobile et la Garde républicaine. Toute la présentation du document assure le partage entre les deux « axes », comme il apparaît sur le tableau reproduit en fin de la présente partie, page 44. Il est dommage que l'occasion ne soit pas saisie de permettre des rapprochements avec le programme police. A cet effet, les deux « axes » doivent devenir des actions. La deuxième action prévue se rapporte à la « lutte contre l'insécurité routière ». Elle a son pendant dans le programme police. La troisième englobe la totalité de la « contribution de la gendarmerie au profit des services du ministère de la justice ». La mission de police judiciaire y occupe une place essentielle ; la constatation des crimes, délits, contraventions, le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs d'infractions, mais aussi les transfèrements, représentent en effet près de 40 % de l'activité totale de la gendarmerie. La quatrième action correspond aux « fonctions commandement, recrutement, formation et logistique ». Enfin, la dernière, « exercice des missions militaires » permet de prendre en compte la spécificité de l'institution en matière de missions militaires, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. 3. Pour des budgets opérationnels de programme (BOP) départementaux · Au niveau du projet annuel de performance (pap) associé à chaque programme, l'enjeu est surtout de nature politique : orienter l'action publique et évaluer ses résultats, présentés dans le rapport annuel de performance (rap). À un niveau plus fin de ventilation, ce sont les gestionnaires qui sont d'abord en cause. En effet, la gestion et la mise en œuvre de chaque programme sont déléguées - en l'occurrence par le directeur général - aux responsables d'unités opérationnelles, dans le cadre de budgets opérationnels de programme (bop). Le bop décline, sur un périmètre administratif ou un territoire, des objectifs, des indicateurs et des moyens du programme de rattachement. La grande question en termes d'efficacité de l'action publique est dès lors de définir le territoire de gestion pertinent. Ce découpage peut tenir compte des caractéristiques propres à chaque politique. C'est ainsi que certaines directions spécialisées de la police nationale pourraient relever d'un bop unique national (par exemple la Direction de la sécurité du territoire ou la Police judiciaire), alors que, pour les plus généralistes, un découpage territorial paraît s'imposer, sauf à revenir sur tous les acquis bénéfiques de la déconcentration. Mais quel est l'échelon pertinent : département, région ? L'enjeu n'est pas mince, car la maîtrise du bop implique largement la maîtrise du pilotage de la performance. · En réponse à la question du rapporteur, le ministère de la Défense a apporté les précisions suivantes : « La gendarmerie conduit actuellement une étude relative à la création de bop au sein de son programme. Plusieurs hypothèses ont été envisagées qui présentaient toutes des avantages et des inconvénients. À ce jour, deux restent à l'étude. L'une privilégie la création de bop par action, l'autre, une mise en place de bop au niveau des régions de gendarmerie. C'est cette dernière qui semble, en première approche, la plus pertinente. C'est pour tester cette hypothèse, grandeur nature, que l'expérimentation de globalisation des crédits effectuée en 2005 portera sur la future région Franche-Comté. » Il est rappelé à ce propos qu'à compter du 1er juillet 2005, les légions de gendarmerie seront supprimées, leurs compétences en matière de gestion des moyens étant exercées par les régions de gendarmerie. Le rapporteur relève que, dans la gendarmerie, l'échelon départemental du bop paraît ainsi avoir été écarté. La priorité a implicitement été accordée à la mutualisation des moyens à grande échelle. Pourtant, en termes d'orientation de la politique de sécurité, le niveau du département présente des atouts, comme le montre la situation de la police. · La réponse au questionnaire budgétaire donnée par le ministère de l'Intérieur au sujet des bop du programme police nationale se borne à faire valoir que le sujet n'est pas tranché. Très judicieusement, l'an prochain, trois expérimentation de gestion dans le cadre de la lolf seront conduites : au sein d'une direction centrale, celle des crs, d'une direction départementale de la sécurité publique, celle des Yvelines, et d'un secrétariat général pour l'administration de la police : le sgap de Marseille (mais pour ses propres moyens). Au cours de ses visites, le rapporteur a entendu des plaidoyers très argumentés en faveur de deux options : le bop par sgap et le bop par département. M. Claude d'Harcourt, préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police de Paris, a clairement mis en évidence que deux objectifs apparemment contradictoires sont recherchés : - « un objectif d'essence politique : individualiser à travers les bop les responsables de la mise en œuvre au plan territorial de la politique de sécurité publique ». Cet objectif implique un bop par département ; - « un objectif d'essence gestionnaire : accroître la souplesse de gestion au niveau local en optimisant les modalités de fongibilité des crédits ». Sa conséquence est un bop par sgap, afin d'éviter la multiplication des bop et de bénéficier au maximum de l'effet de taille et de l'effet de la « fongibilité asymétrique » (dans la nouvelle loi organique, tous les crédits sont fongibles, sauf ceux de personnel). Le préfet, sgap de Paris considérait que la Direction de l'administration de la police nationale (dapn) tendrait à faire prévaloir l'objectif de responsabilisation sur l'objectif de souplesse de la gestion, d'où des bop départementaux et un sgap exerçant trois missions : de gestion sur mandat, de plateau technique et de co-gouverneur de crédits. Toutefois, en fonction de son expérience à la préfecture de police, il préconise, afin de concilier les deux objectifs de responsabilisation et de souplesse de la gestion, de découpler le lieu de gestion de la politique de la sécurité publique (les départements) et le lieu de la gestion financière (le sgap). Il s'agirait de responsabiliser l'échelon départemental sur le plan opérationnel tout en optimisant les facilités de gestion résultant de la globalisation des crédits. La traduction concrète de ce schéma serait : « un bop sgapal ». Dans un tel système, les préfets de départements, responsables des deux uo départementales, se fixent leurs objectifs opérationnels et en rendent compte. Le sgap a la capacité de faire jouer la fongibilité asymétrique des crédits. En sens inverse, le directeur départemental de la sécurité publique du Rhône, M. Hubert Weigel, ainsi que plusieurs de ses homologues, a attiré l'attention du rapporteur sur l'importance de bop départementaux. Il a fait valoir que la déconcentration de la gestion au niveau du département avait été un progrès considérable dans le sens de la responsabilité des responsables locaux de la sécurité publique. Ceux-ci sont désormais en mesure d'adapter en permanence leur dispositif à l'évolution de la délinquance. Il a fait remarquer qu'il serait très paradoxal de procéder à une reconcentration à l'occasion de la mise en œuvre de la lolf. Le rapporteur est sensible à cette argumentation. Il souhaite rappeler que l'esprit de la réforme de 2001 était bien de renforcer la responsabilité et la capacité d'initiative des gestionnaires les plus proches du terrain, en contrepartie d'un contrôle sur le respect de leurs objectifs. La logique du bop départemental est simple et forte, en harmonie avec l'esprit de la lolf. Quand au dispositif préconisé par le sgap de Paris, son point fort est l'argument de l'effet d'échelle pour l'affectation des moyens et la vision stratégiques. Mais il comporte trois faiblesses : - il est très complexe dans ses modalités de mise en œuvre, et rend les responsabilités difficilement lisibles pour le citoyen et le Parlement ; - en voulant combiner les avantages des deux systèmes, départemental et régional, il méconnaît l'intention de la lolf. Sur le plan intellectuel, le dispositif confine au détournement de procédure. C'est à l'échelon des responsabilités opérationnelles qu'il faut faire jouer la fongibilité des crédits ; - il est probablement praticable dans le ressort du sgap de Paris, compte tenu des particularités de la préfecture de police, dont notamment la puissance des structures de gestion. Mais le rapporteur est dubitatif sur la capacité des autres sgap - mis à part, peut-être, celui de Versailles - à maîtriser la conduite des budgets opérationnels de programme. Faute de moyens de gestion suffisants, ils ont déjà du mal à faire face à leurs missions actuelles. L'expérimentation conduite en 2005 dans le sgap de Marseille sera sans doute éclairante. Le rapporteur retient néanmoins l'idée que les particularités de la préfecture de police peuvent justifier certains aménagements du régime de droit commun, à condition que l'autonomie de gestion des départements d'Île-de-France ne soit pas obérée. En tout état de cause, la nouvelle architecture budgétaire ne doit remettre en question : - ni la capacité à définir les grandes orientations stratégiques au niveau de la zone de défense ou de la région ; - ni la faculté, pour l'échelon départemental de fixer ses objectifs propres à la situation locale et de réagir avec rapidité aux mutations permanentes de la délinquance. Ces objectifs peuvent être du type de ceux définis en Moselle par le préfet de région, tels qu'ils figurent dans l'encadré ci-joint. En première analyse et sous réserve des enseignements tirés de l'expérimentation, les bop départementaux paraissent les mieux à même de concilier ces deux impératifs.
4. Pour des indicateurs pertinents et en nombre suffisant La vigilance des Français sur les problèmes de sécurité, la diversité et la complexité croissante des missions de la police et de la gendarmerie appelaient une réflexion sur la définition de leurs indicateurs de performance. C'est à la fois une exigence générale de gestion publique et une condition de réussite de la réforme budgétaire. Dans la police nationale, l'évaluation se rapporte prioritairement à l'efficacité. Elle tend à vérifier que le service a accompli sa mission, comme l'a montré le commissaire Véronique Fabron, dans son mémoire de stage de l'École nationale supérieure de police intitulé « Le pilotage de la performance dans la police nationale », en date d'août 2004. Cependant, « la légitimité de l'action de la police réside dans son efficacité mais aussi dans son efficience, c'est-à-dire dans sa capacité à remplir sa mission en optimisant ses moyens ». L'évaluation de l'efficience conduit à une approche managériale de la performance, résumée dans la formule « le résultat plus la manière » (2). En allant plus loin, il est nécessaire de tenter d'identifier l'impact final des politiques sur leur environnement économique et social. Certaines politiques publiques appellent donc la mise au point d'objectifs d'efficacité socio-économique, tels que « faire diminuer le nombre des blessés et tués sur la route », avec les indicateurs associés. La difficulté est que les services de police et de gendarmerie ne sont pas les seuls acteurs de l'évolution du nombre des accidents. Enfin, une dernière série d'indicateurs porte sur l'aptitude du service à satisfaire les utilisateurs ou ses propres agents : ils mesurent la qualité du service rendu. La batterie des indicateurs peut donc porter sur les moyens, le niveau d'activité, l'efficience (quelle économie de moyens ?), l'efficacité socio-économique ultime et la qualité du service rendu. Seuls les trois dernières catégories portent, à proprement parler, sur la performance. Elles supposent d'associer étroitement la mesure de la performance à la gestion du service. Selon les domaines d'action, certains types d'indicateurs pourront prédominer. De plus, les trois notions de performance ne convergent pas spontanément. L'esprit de la lolf conduit à les combiner et à trouver l'équilibre propre à chaque domaine d'action. Par conséquent, il sera souhaitable de ne pas trop limiter le nombre des indicateurs associés à chaque objectif. C'est à la fois une nécessité de qualité de gestion et une exigence démocratique de contrôle. Compte tenu de la globalisation des crédits, le Parlement, recentré sur le contrôle a posteriori, sera privé de contact avec la réalité s'il ne dispose que de trop peu d'indicateurs. Il est rappelé que, pour leur part, les objectifs sont en nombre limité pour faciliter la lisibilité globale de la loi de finances et éviter la dispersion des efforts et des moyens. Le mémento des objectifs et indicateurs de performance diffusé en décembre 2003 souligne qu'à terme un programme ne devrait pas compter plus de 4 à 5 objectifs. Toutefois, dans un premier temps, les objectifs identifiés peuvent excéder ce nombre, particulièrement dans le cas des programmes importants et diversifiés, comme celui relatif à la police nationale. Afin de permettre une appréciation objective de leur réalisation, les objectifs doivent être mesurables. Ils doivent donc être impérativement accompagnés par un indicateur chiffré et une valeur cible à atteindre. Chaque indicateur de performance doit respecter cinq conditions : - présenter un lien logique avec l'objectif fixé ; - permettre de porter un jugement : il doit permettre d'apprécier l'amélioration de la situation visée par l'objectif et de mesurer effectivement la performance ; - être utile, c'est-à-dire disponible à intervalle régulier, se prêtant à des comparaisons et compréhensible ; - être solide, c'est-à-dire pérenne et d'une fiabilité incontestable ; - permettre de déterminer des cibles de résultat que la police ou la gendarmerie nationales proposent à l'avance d'atteindre dans des échéances de temps définies. Le tableau suivant présente, à titre d'illustration, les objectifs et les indicateurs de performance du programme gendarmerie nationale. Mais ces indicateurs budgétaires ne sont que la partie émergée d'un iceberg. Ils représenteront une sélection d'indicateurs nationaux particulièrement caractéristiques, parmi des batteries beaucoup plus complètes utilisées par les acteurs locaux. Le rapporteur a pu constater que, dans les départements, la culture du résultat est assimilée et combien les directeurs et commissaires de police et les commandants d'unités de la gendarmerie se sont emparés des indicateurs de performance pour assurer le pilotage et l'adaptation de leur action. Loin de se plaindre de l'insuffisance de leurs moyens, ils se préoccupent d'en optimiser l'usage. Dans des départements comme les Bouches-du-Rhône ou la Moselle, des cartographies détaillées ont été développées à faible coût par les services informatiques de la ddsp. Elles permettent d'abord au centre de commandement de suivre en temps réel les faits signalés et les réponses apportées. De façon plus prospective, elles donnent un instrument statistique destiné à identifier les lieux, les heures de la journée et les périodes de la semaine où la menace est la plus forte, afin de préparer la mise en place des patrouilles et des moyens d'intervention. Ces exemples confirment que l'échelon départemental est pertinent pour améliorer l'efficience de la lutte contre la délinquance. Sans doute cette pertinence est-elle plus manifeste en matière de sécurité et de paix publiques que s'agissant du maintien de l'ordre.
1 () Rapport précité, page 142. 2 () Bernard Guénaud, membre de l'inspection générale de la police nationale, dans le n° 53 des Cahiers de la sécurité intérieure, « Évaluer la police ? », p. 149. - Cliquer ici pour retourner au sommaire général - Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis budgétaires © Assemblée nationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

