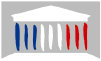N° 2436 _______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juillet 2005 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (1) SUR L'ÉVOLUTION DE LA FISCALITÉ LOCALE
Président M. Augustin BONREPAUX, Rapporteur M. Hervé MARITON, Députés. -- TOME II AUDITIONS (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. La commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale est composée de : M. Augustin Bonrepaux, Président ; MM. Jean-Pierre Soisson, René Dosière, Vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Gorges, Jean-Claude Sandrier, Secrétaires ; M. Hervé Mariton, Rapporteur ; MM. Jean-Pierre Balligand, Joël Beaugendre, Pierre Bourguignon, Charles de Courson, Mme Claude Darciaux, MM. Bernard Derosier, Jean-Jacques Descamps, Michel Diefenbacher, Marc Francina, Alain Gest, Louis Giscard d'Estaing, Mme Arlette Grosskost, MM. Jean-Yves Le Drian, Jean-Louis Léonard, Maurice Leroy, Richard Mallié, Denis Merville, Pierre Morel-a-L'Huissier, Mme Béatrice Pavy, MM. Michel Piron, Michel Raison, Éric Raoult, Camille de Rocca Serra, Pascal Terrasse. TOME DEUXIÈME SOMMAIRE DES AUDITIONS Les auditions sont présentées dans l'ordre chronologique des séances tenues par la Commission. - Audition de M. Robert HERTZOG, Professeur à l'Université de Strasbourg III Robert Schuman (Extrait du procès-verbal de la séance du 8 mars 2005) 11 - Audition de M. Alain GUENGANT, Directeur de recherche au CNRS (Extrait du procès-verbal de la séance du 8 mars 2005) 27 - Audition de M. Dominique HOORENS, Directeur des études et de la documentation de Dexia Crédit Local (Extrait du procès-verbal de la séance du 9 mars 2005) 41 - Audition de M. Philippe LAURENT, Président-directeur général du cabinet Philippe Laurent Consultants, et M. Erwan LE BOT (Extrait du procès-verbal de la séance du 15 mars 2005) 59 - Audition de M. Michel KLOPFER, Président-directeur général du Cabinet Michel Klopfer (Extrait du procès-verbal de la séance du 15 mars 2005) 81 - Audition de M. Claudy LEBRETON, Président de l'Assemblée des départements de France (ADF) et Président du conseil général des Côtes-d'Armor, accompagné de M. Louis de BROISSIA, Président du conseil général de la Côte d'Or, M. Bernard CAZEAU, Président du conseil général de la Dordogne, M. Claude HAUT, Président du conseil général du Vaucluse, et Mme Anne d'ORNANO, Présidente du conseil général du Calvados (Extrait du procès-verbal de la séance du 23 mars 2005) 95 - AUDITIONS (SUITE) 123 - Audition de M. Alain ROUSSET, Président de l'Association des régions de France (ARF) et Président du conseil régional d'Aquitaine, accompagné de M. Jean-Paul HUCHON, Président du conseil régional d'Île-de-France, M. François PATRIAT, Président du conseil régional de Bourgogne Mme Ségolène ROYAL, Présidente du conseil régional de Poitou-Charentes, M. Michel VAUZELLE, Président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Adrien ZELLER, Président du conseil régional d'Alsace, M. Christian BOURQUIN, Premier Vice-président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, M. Jean-François DEBAT, Vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes, et M. François LANGLOIS, Délégué général de l'Association des régions de France 123 - Audition de M. Marc CENSI, Président de l'Association des communautés de France (ADCF) et Président de la communauté d'agglomération du grand Rodez, accompagné de M. Charles-Éric LEMAIGNEN, Vice-président de l'ADCF chargé des affaires financières et fiscales et Président de la communauté d'agglomération d'Orléans Val-de-Loire, M. Nicolas PORTIER, Délégué général de l'ADCF, et Mme Claire DELPECH, responsable de la fiscalité et des finances de l'ADCF (Extrait du procès-verbal de la séance du 6 avril 2005) 167 - Audition de MM. Jean-Marie BERTRAND, directeur général de Réseau ferré de France (RFF), et Jean-Louis ROHOU, secrétaire général de RFF (Extrait du procès-verbal de la séance du 6 avril 2005) 189 - Audition de M. Bernard SINOU, directeur du transport public de la SNCF (Extrait du procès-verbal de la séance du 13 avril 2005) 207 - Audition de M. Georges FRÊCHE, Président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, accompagné de M. Claude COUGNENC, Directeur général des services, M. Gérard BLANC, Directeur général adjoint chargé de la direction de l'action territoriale, de la direction des transports et des communications, de la direction de l'environnement et de la direction de la prospective, M. Thierry CAMUZAT, Directeur général adjoint chargé de la direction des finances et du contrôle de gestion, de la direction des systèmes d'information, de la commande publique, de la documentation et des archives et de la direction de la santé, et M. Christian FINA, Directeur général adjoint chargé de la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage, de la direction de l'éducation, de la direction de la culture et du patrimoine et de la direction sport et jeunesse (Extrait du procès-verbal de la séance du 19 avril 2005) 223 - Audition de M. Jacques BLANC, ancien président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, président du Groupe UMP (Extrait du procès-verbal de la séance du 19 avril 2005) 251 - Audition de M. Georges FRÊCHE, Président de la communauté d'agglomération de Montpellier, accompagné de M. François DELACROIX, Directeur général des services (Extrait du procès-verbal de la séance du 19 avril 2005) 267 - Audition de M. Michel GAUDY, Vice-président du conseil général de l'Hérault, accompagné de M. Georges VINCENT, Président du groupe Démocratie et République au conseil général, M. Bernard ODE, Directeur général des services, M. Jean CROS, Directeur du pôle des moyens, M. Hervé CILIA, Directeur du pôle éducation et patrimoine, et M. Patrick GERMAIN-GÉRAUD, Directeur de la solidarité départementale (Extrait du procès-verbal de la séance du 19 avril 2005) 287 - Audition de M. Alain POULET, Président de la communauté de communes du Pic-Saint-Loup, accompagné de M. Pascal BONNAUD (Extrait du procès-verbal de la séance du 19 avril 2005) 303 - Audition de M. Francis IDRAC, Préfet de la région Languedoc-Roussillon, accompagné de M. Jacky COTTET, Directeur régional de l'équipement, M. Jean-Paul AUBRUN, Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et M. Christian NIQUE, Recteur de l'académie de Montpellier (Extrait du procès-verbal de la séance du 19 avril 2005) 311 - Audition de M. Guy PIOLÉ, Président de la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon (Extrait du procès-verbal de la séance du 19 avril 2005) 325 - AUDITIONS (SUITE) 329 - Audition de M. Jacques PÉLISSARD, Président de l'Association des maires de France (AMF) et Maire de Lons-le-Saunier, accompagné de M. Philippe LAURENT, Président de la Commission des finances et de la fiscalité locale de l'AMF et Maire de Sceaux, M. Maxime CAMUZAT, Maire de Saint-Germain-du-Puy, et M. Pascal BUCHET, Rapporteur général de la Commission des finances et de la fiscalité locale de l'AMF et Maire de Fontenay-aux-Roses (Extrait du procès-verbal de la séance du 3 mai 2005) 329 - Audition de M. Pierre MIRABAUD, Délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, accompagné de M. Jean-Benoît ALBERTINI, Directeur adjoint (Extrait du procès-verbal de la séance du 4 mai 2005) 347 - Audition de M. Patrice RAULIN, Directeur des transports terrestres au ministère de l'Équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (Extrait du procès-verbal de la séance du 4 mai 2005) 367 - Première audition de M. Dominique SCHMITT, Directeur général des collectivités locales (Extrait du procès-verbal de la séance du10 mai 2005) 375 - Audition de M. Gérard BUREL, Président du conseil général de l'Orne, accompagné de M. Charles-Henri BOUVET, Directeur général adjoint des services du département, chargé des finances (Extrait du procès-verbal de la séance du 10 mai 2005) 403 - Audition de M. Michel MERCIER, Président du conseil général du Rhône (Extrait du procès-verbal de la séance du 10 mai 2005) 413 - Audition de M. Dominique ANTOINE, Directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et M. Michel DELLACASAGRANDE, Directeur des affaires financières (Extrait du procès-verbal de la séance du 11 mai 2005) 423 - Audition de M. Pierre MÉHAIGNERIE, Président de la Commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale (Extrait du procès-verbal de la séance du 11 mai 2005) 447 - Audition de M. Patrice PARISÉ, Directeur des routes (Extrait du procès-verbal de la séance du 11 mai 2005) 457 - Audition de M. Adrien ZELLER, Président du conseil régional d'Alsace, accompagné de M. Jacques BIGOT, Président du Groupe socialiste, M. Olivier LIDOYNE, Directeur des transports et déplacements, M. Steven THÉNAULT, Directeur de l'éducation et de la formation, et M. Albert KISTER, Directeur des lycées (Extrait du procès-verbal de la séance du 18 mai 2005) 473 - AUDITIONS (SUITE) 495 - Audition de M. Charles BUTTNER, Président du conseil général du Haut-Rhin, accompagné de M. Joseph SPIEGEL, Président du Groupe socialiste des élus du conseil général, M. Michel CHOCHOY, Directeur général adjoint des services, Mme Nicole FELLY, Chef du service Insertion et développement local, et M. René JACQUES, Directeur des infrastructures routières (Extrait du procès-verbal de la séance du 18 mai 2005) 495 - Audition de Mme Fabienne KELLER, Maire de Strasbourg, et M. Robert GROSSMANN, Président de la communauté urbaine de Strasbourg, accompagnés de M. André THOMAS, Directeur général délégué des services, et M. François KUSSWIEDER, Directeur des finances et de la programmation (Extrait du procès-verbal de la séance du 18 mai 2005) 513 - Audition de M. Michel GUILLOT, Préfet du département du Haut-Rhin, accompagné de M. Michel LOYER, Trésorier payeur général du département du Haut-Rhin M. Alain LORRIOT, Directeur départemental de l'équipement, M. Patrick L'HÔTE, Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et M. Gilles PETREAULT, Inspecteur d'académie du Haut-Rhin 527 - Audition de M. Michel THÉNAULT, Préfet de la région Alsace, accompagné de M. Dominique ABRAHAM, Trésorier payeur général de la région et du département, M. Jean-Claude FESTOR, Directeur régional et départemental de l'équipement, Mme Corinne WANTZ, Directrice départementale des affaires sanitaires et sociales et M. Gérald CHAIX, Recteur de l'académie de Strasbourg (Extrait du procès-verbal de la séance du 18 mai 2005) 545 - Audition de M. Olivier ORTIZ, Président de la Chambre régionale des comptes d'Alsace, et M. Roberto SCHMIDT, Président de section (Extrait du procès-verbal de la séance du 18 mai 2005) 561 - Audition de M. Christian GALLIARD de LAVERNÉE, Directeur de la défense et de la sécurité civiles, accompagné de M. Bertrand CADIOT, Sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours, et M. Philippe DESCHAMPS, Chef du bureau des services d'incendie et de secours (Extrait du procès-verbal de la séance du 19 mai 2005) 567 - Audition de M. Hervé BRAMY, Président du conseil général de Seine-Saint-Denis, accompagné de M. Gildas BARRUOL, Directeur général administratif, et M. Ronan KERREST, Vice-président du conseil général chargé des finances (Extrait du procès-verbal de la séance du 19 mai 2005) 577 - Deuxième audition de M. Dominique SCHMITT, Directeur général des collectivités locales (Extrait du procès-verbal de la séance du 25 mai 2005) 591 - AUDITIONS (SUITE) 611 - Audition de M. Alain PICHON, Président de la 4ème chambre de la Cour des comptes, et M. Jean-Philippe VACHIA, Président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées (Extrait du procès-verbal de la séance du 25 mai 2005) 611 - Audition de M. Jean-Jacques TRÉGOAT, Directeur général de l'action sociale, accompagné de Mmes Annick BONY, Claire DESCREUX et Nicole ROTH et de MM. Philippe DIDIER-COURBIN et Éloy DORADO (Extrait du procès-verbal de la séance du 25 mai 2005) 625 - Audition de M. Jean-Yves CHAMARD, Président de la Commission des finances du conseil général de la Vienne, accompagné de M. Michel GRÉMILLON, Directeur général adjoint chargé des finances et des affaires générales (Extrait du procès-verbal de la séance du 25 mai 2005) 637 - Audition de M. Christian ESTROSI, Président du conseil général des Alpes-Maritimes, accompagné de M. Pierre BAYLE, Directeur général des services (Extrait du procès-verbal de la séance du 26 mai 2005) 653 - Audition de M. Philippe LAVAUD, Premier vice-président du conseil général de la Charente, accompagné de M. Thierry GROSSIN-BUGAT, Directeur général adjoint chargé des finances (Extrait du procès-verbal de la séance du 26 mai 2005) 669 - Audition de Mme Marie-Christine LEPETIT Directrice de la législation fiscale à la Direction générale des impôts, accompagnée de M. Frédéric IANNUCCI, Sous-directeur (Extrait du procès-verbal de la séance du 26 mai 2005) 681 - AUDITIONS (SUITE) 701 - Audition de M. Marcel CHARMANT, Président du conseil général de la Nièvre, accompagné de M. Henri MALCOIFFE, Vice-président chargé des finances, et M. Philippe PARLANT-PINET, Directeur général des services (Extrait du procès-verbal de la séance du 1er juin 2005) 701 - Audition de M. Gilles CARREZ, Président du Comité des finances locales (Extrait du procès-verbal de la séance du 8 juin 2005) 717 - Audition de M. Jean-François COPÉ, Ministre délégué au Budget et à la réforme de l'État (Extrait du procès-verbal de la séance du 14 juin 2005) 731 - Audition de M. Gilles de ROBIEN, Ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Extrait du procès-verbal de la séance du 14 juin 2005) 755 - Audition de M. Brice HORTEFEUX, Ministre délégué aux Collectivités territoriales, accompagné de M. Dominique SCHMITT, Directeur général des collectivités locales (Extrait du procès-verbal de la séance du 15 juin 2005) 765 - Audition de M. Dominique PERBEN, Ministre des Transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (Extrait du procès-verbal de la séance du 22 juin 2005) 799 - Liste des auditions du Rapporteur et du Président de la Commission d'enquête 813 Audition de M. Robert HERTZOG, Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président M. Robert Hertzog est introduit. M. le Président : Mes chers collègues, après la révision constitutionnelle sur l'organisation décentralisée de la République, les relations entre l'État et les collectivités territoriales ont été soumises à des règles du jeu renouvelées. De nouvelles compétences ont été transférées, assorties de modalités nouvelles de compensation. Dans le même temps, l'État s'est désengagé, notamment des contrats de plan. Il est aujourd'hui nécessaire de faire le point sur l'ensemble de ces mouvements et d'assurer la clarté des comptes. C'est non seulement une nécessité de bonne gestion des budgets publics - il faut éviter les dérapages financiers au détriment des contribuables, ménages ou entreprises -, mais aussi un impératif démocratique, car les décideurs publics doivent assumer leurs responsabilités en toute transparence et les citoyens être en mesure d'exercer leur contrôle. Les membres de notre Commission ont des points de vue différents sur les explications les plus probables. Mais ils partagent - je l'espère en tout cas - la volonté de transparence qui anime la démarche de la commission. C'est un objectif et un choix de méthode, et c'est ce qui justifie l'ouverture de nos auditions à la presse. Sans préjuger des choix de notre Commission sur la méthode de ses travaux, le Rapporteur et moi-même avons souhaité ouvrir ses débats par l'audition de personnalités incontestables, dont nous attendons un regard extérieur aux débats politiques et une vision de synthèse. Je souhaite la bienvenue à M. le Professeur Robert Hertzog, qui nous vient de l'université Strasbourg III - Robert Schuman, spécialiste reconnu du droit et de l'administration des collectivités territoriales. M. le Président rappelle à M. Robert Hertzog que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. À l'invitation du Président, celui-ci prête serment. M. le Président : Pouvez-vous, dans un exposé liminaire, nous faire part de votre point de vue sur l'évolution de la fiscalité locale depuis une dizaine d'années, l'évolution comparée de la fiscalité locale et de la fiscalité d'État, l'évolution comparée des bases et des taux, ainsi que de votre appréciation sur l'équité et l'efficacité de la fiscalité locale ? M. Robert HERTZOG : M. le Président, Mmes et MM. les députés, c'est un très grand honneur pour moi d'être auditionné par votre commission sur un sujet aussi important. En reprenant mes notes ce matin, j'ai craint de n'avoir rassemblé qu'une brassée de banalités et de lieux communs... Mais puisque vous avez pris le risque de m'écouter, j'organiserai mon propos préliminaire autour de deux thèmes, en commençant par l'aspect méthodologique, dont dépendront la qualité et la validité des analyses et conclusions ultérieures, avant de passer en revue une série de facteurs qui me semblent être à l'origine de la progression, variable mais généralement à la hausse, de la fiscalité des collectivités territoriales. Mes observations méthodologiques sont tirées de l'expérience que j'ai acquise en siégeant à l'Observatoire des finances locales - les documents de l'administration y avaient été soumis au regard critique des universitaires, ce qui a permis de notables améliorations en termes de présentation - et en participant, dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, à la réalisation d'un « tableau de bord » qui se voulait une radiographie complète des finances des diverses collectivités territoriales de la région Alsace, jusque dans chacune des composantes de leurs budgets. Sitôt que l'on parle de finances, il faut mesurer, et mesurer les finances locales n'est pas un exercice facile. La croissance d'ensemble n'ayant guère de sens, il convient de procéder à des analyses par catégorie d'impôts, mais également par catégorie de collectivités territoriales, afin de connaître l'évolution des types d'impôts par catégorie de collectivités, dans la mesure où la structure même des finances locales s'est radicalement transformée à partir des années quatre-vingt-dix, qu'il s'agisse de la répartition entre les diverses catégories de collectivités, de la structure des financements au sein des budgets, ou encore de la structure de la fiscalité proprement dite. Encore faut-il, au préalable, s'entendre sur ce que l'on appelle la fiscalité locale. Faut-il la limiter aux « quatre vieilles », faut-il considérer l'ensemble des impositions perçues au profit des collectivités territoriales, y compris le versement transports ou la taxe locale d'équipement, voire prendre en compte des ressources qui ne sont pas des impôts au sens juridique du terme, comme la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ? Comment ensuite mener une étude à périmètre constant alors que le régime de ces impôts a considérablement évolué ? Question tout à fait technique, mais importante : la qualification même de l'impôt dans les documents financiers. Ainsi la dotation de solidarité communautaire (DSC), versée par la communauté aux communes membres dans un système de taxe professionnelle unique, est inscrite dans les budgets comme une ressource fiscale, ce qui peut conduire le contribuable communal à croire que les impôts locaux ont augmenté de X points alors que ces X points d'impôts correspondent précisément à la DSC. Faut-il la sortir du périmètre, au risque de devoir procéder à des retraitements discutables ? Enfin, il ne faut évidemment pas raisonner en euros courants mais bien en euros constants, voire par rapport au produit intérieur brut ou à tout autre élément de référence significatif pour apprécier l'évolution d'un impôt déterminé ou de l'ensemble des composantes de la fiscalité locale. Je reste à votre disposition pour revenir sur certains de ces points d'ordre méthodologiques essentiels, la très grande disparité des éléments d'information pouvant conduire, en fonction des données comparées, à des conclusions assez divergentes. Sans prétendre vous énumérer toutes les causes de la progression de la fiscalité des collectivités territoriales, je les classerai en trois grandes séries. La première découle de l'augmentation des charges ; la deuxième est liée à notre fiscalité elle-même et à ses caractéristiques ; la troisième, enfin, tient au système même des finances locales plutôt qu'aux décisions d'une catégorie de collectivités ou au comportement de tel ou tel acteur. Pour mesurer l'évolution des charges, il est essentiel, mais également très difficile, de distinguer trois séries de dépenses : d'abord celles qui découlent des nouvelles charges - autrement dit, pour aller vite, des transferts de compétences, voire, comme le reconnaît désormais la loi organique, de l'apparition de nouvelles compétences attribuées aux collectivités territoriales ; ensuite celles qui tiennent à l'augmentation des coûts, à activité égale ; viennent enfin les dépenses « discrétionnaires », qui sont l'expression d'une politique : si l'on décide de faire plus, il faut mobiliser davantage de ressources. Si les transferts de charges ont été jusqu'à présent compensés d'une manière généralement très correcte, la compensation n'a toutefois pas porté sur la totalité de la dépense effective, du fait que ce transfert s'est accompagné d'un besoin de rattrapage : c'est là un phénomène bien connu, qui ne manquera pas de se reproduire lors des prochains transferts. Mais il existe également, parmi ces facteurs d'augmentation, des causes « institutionnelles » dont on ne parle guère. La prolifération de nouvelles institutions - les différentes communautés, mais également tout ce qui tourne autour, pays et autres - entraîne deux sortes de charges supplémentaires. Non seulement la création d'une nouvelle entité provoque inévitablement, au moins dans un premier temps, un surcoût institutionnel assez facilement mesurable, quand bien même la nouvelle communauté peut utiliser en partie les moyens des communes existantes, mais surtout, la multiplication des « entrepreneurs politiques », comme disent les politologues américains, entraîne ipso facto une multiplication des projets et des initiatives, que l'on ne saurait condamner en elle-même mais qui rend d'autant plus difficile l'arbitrage global, c'est-à-dire l'équilibre entre les finances publiques et l'économie, voire la société. En effet, si on multiplie les acteurs autonomes, que l'on peut présumer rationnels en ce qui concerne l'élaboration de leurs budgets propres, on n'est plus assuré de la rationalité du système dans son ensemble. Ce problème se retrouve dans tous les systèmes financiers complexes. Dans les États fédéraux, on a développé la théorie du fédéralisme financier ; on peut également utiliser les techniques de la subsidiarité, sans pour autant répondre au problème réel qui tient à l'extraordinaire complexité de nos systèmes fiscaux et dont on a le plus grand mal à saisir toutes les implications, tant sur le plan financier que sur celui des techniques budgétaires, des systèmes politiques et de la légitimité politique. Enfin, parmi les facteurs de hausse des charges, nous connaissons tous - je suis également élu local d'une commune de la périphérie de Strasbourg - le coût des procédures, qu'elles découlent d'obligations législatives ou réglementaires ou qu'elles viennent, directement ou indirectement, des instances européennes, ainsi que le coût des normes. Mais nous en savons beaucoup moins sur la façon dont les collectivités territoriales ont usé de leur autonomie politique et financière pour conduire leurs politiques propres. Deuxième série de facteurs qui poussent à l'augmentation des impôts locaux, ceux qui tiennent à la fiscalité elle-même et à ses caractéristiques. Remarquons au préalable que, pour archaïques et critiqués qu'ils soient, ces vieux impôts sont productifs. Incontestablement, les bases progressent, certes plus ou moins vite selon qu'il s'agit de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties - et cela modifie la structure de la fiscalité locale - mais elles progressent et c'est heureux pour les gestionnaires locaux. Deuxième remarque : ces bases ne reflètent pas des données économiques réelles. Pourquoi ? On me permettra de risquer une interprétation : le fait qu'un impôt augmente par le jeu de données artificielles, sans rapport avec le revenu, le bénéfice ou le chiffre d'affaires, en entretenant une certaine opacité, ne crée pas entre celui qui vote l'impôt et celui qui doit l'acquitter une relation comparable à celle qui s'établit lorsque le contribuable en comprend très directement l'impact sur sa situation économique et financière personnelle. Pour simplifier, augmenter la taxe d'habitation, c'est un peu abstrait ; augmenter l'impôt sur le revenu, c'est autre chose... Ajoutons que le mouvement de spécialisation des impôts par catégorie de collectivités observé ces dernières années a rarement reçu l'assentiment des spécialistes des finances publiques. Quel était du reste l'objectif recherché ? Garantir la plus grande transparence politique ? Peut-être. Freiner la progression de la fiscalité ? Peut-être également. Je suis pour ma part très favorable à la taxe professionnelle unique (TPU), fruit d'une réforme assez miraculeuse... Reste que, comme tout impôt unique, la TPU est un impôt dangereux ; et surtout, les communes ayant gardé les fonctions exigeant de gros besoins de personnel, ont une masse salariale qui progresse beaucoup plus vite que dans la communauté alors même qu'elles n'ont pas gardé l'impôt le plus évolutif, ce qui les contraint à des rattrapages sur leur taxe d'habitation ou leur taxe foncière sur les propriétés bâties, d'où une croissance de la fiscalité. Troisième série, les causes qui tiennent au système financier local lui-même. La première, et très bonne cause, découle de la règle de l'équilibre réel, qui oblige à couvrir les charges de fonctionnement, les frais financiers et les amortissements avec, comme seule ressource d'ajustement en section de fonctionnement, l'impôt direct. Il est excellent qu'il en soit ainsi et que les collectivités territoriales ne puissent pas, comme le fait l'État, emprunter pour payer du fonctionnement ou de la dette ! Le deuxième facteur tient à l'évolution contrastée des dotations, qui traduit un certain décrochage par rapport aux charges réelles des collectivités territoriales - « un certain », ai-je dit, dans la mesure où les modifications constantes du régime des dotations ne permettent pas d'en apprécier exactement l'évolution à périmètre et bénéficiaires constants. Quoi qu'il en soit, le phénomène est avéré. On disait à une certaine époque que la DGF devait à peu près couvrir les dépenses de personnel ; nous en sommes loin... Force est de compenser avec les ressources fiscales. Autre effet du système, tout à fait banal mais important : contrairement aux entreprises, les personnes publiques, lorsqu'elles investissent, n'ont que des charges supplémentaires - charges d'emprunt et frais de fonctionnement induits - sans pouvoir espérer aucun revenu. Ceux qui préconisent davantage d'investissement local - et j'en suis - ne doivent pas méconnaître cette réalité. Mentionnons également, parmi les causes liées au système, l'effet institutionnel et bien connu d'entraînement, qui fait que la moindre décision de financement du conseil général est généralement suivie par la communauté, puis par la région : bon nombre d'opérations arrivent ainsi à bénéficier de financements publics sans rapport avec leur utilité marginale. Rappelons enfin que, depuis 1982, de nouveaux acteurs, les départements et les régions, sont arrivés sur le marché des finances publiques, rejoints depuis par les différentes communautés ; à l'effet institutionnel d'entraînement déjà rappelé est venu s'ajouter un effet politique, mais également de système, lié au besoin pour ces nouveaux venus d'affirmer leur place et leur pouvoir, sachant que celui-ci, à défaut d'être normatif - contrairement à certaines de leurs homologues étrangères, nos régions ne peuvent pas influer sur les politiques des autres acteurs par des lois ou des règlements -, ne peut que reposer sur l'instrument financier. D'où le sentiment d'assister à une course vers la taille financière critique, perçue comme un élément de pouvoir. En conclusion, les études empiriques menées tant en France qu'à l'étranger montrent que l'important reste en définitive ce que l'on a fait avec l'argent. L'augmentation des impôts ou autres recettes n'est finalement pas grave, quand bien même ce ne seraient pas de très bons impôts, dès lors que la dépense a été utile et a généré des services, du dynamisme et d'autres effets induits sur l'économie. La situation devient en revanche indéfendable lorsque de mauvaises ressources financent de mauvaises dépenses. Aussi, bien que votre Commission se préoccupe des recettes et de la fiscalité, elle ne peut rester totalement indifférente à la manière dont celles-ci sont utilisées. M. le Rapporteur : Je vous remercie pour cet exposé très complet et très organisé. Dans votre partie consacrée aux augmentations des charges, vous avez distingué les conséquences des compétences nouvelles ou transférées, les augmentations des coûts à activité égale et les dépenses à caractère discrétionnaire, mais vous avez finalement consacré l'essentiel de votre développement à l'analyse des causes institutionnelles. Pourriez-vous reprendre, de manière plus détaillée, les trois catégories de facteurs d'augmentation des charges et préciser leurs poids respectifs ? Les choix diffèrent-ils fondamentalement d'une collectivité à l'autre ? Les évolutions fiscales, particulièrement dans la période récente, sont-elles plus ou moins marquées par tel ou tel de ces facteurs ? Vous n'avez pas fait allusion à la part de l'État, en tant que contribuable, dans l'évolution de la fiscalité locale. Et si vous avez bien décrit comment la multiplication des acteurs pouvait être source de dépenses, vous avez omis de signaler qu'elle permettait parfois de voter l'impôt sans réellement le prélever... Cela aussi méritait d'être pris en considération. Enfin, comment appréciez-vous, sur un plan purement technique, l'effet fiscal des transferts de compétences ou des attributions de nouvelles compétences (APA par exemple) opérés sous la législature précédente, ainsi que des nouvelles compétences en passe d'être dévolues aux collectivités ? La Cour des comptes a aussi consacré une partie de son dernier rapport public annuel à l'organisation des SDIS. À quel type de cause vous paraissent ressortir les évolutions de la fiscalité relevées en 2005 dans les départements et dans les régions ? M. Robert HERTZOG : Tout ce que je n'ai pas dit est immense... J'avoue ne pas avoir analysé l'ensemble des données financières pour l'ensemble des collectivités, ce qui m'aurait permis de vous répondre plus précisément, mais c'est l'un des travaux que vous entreprenez. Je n'ai pas évoqué la part payée par l'État, si ce n'est de façon très allusive en parlant du caractère artificiel des bases des impôts locaux. Revenons à la méthodologie. Qu'appelle-t-on fiscalité locale ? Est-ce ce qui est inscrit dans les budgets ou les comptes administratifs ? Ce n'est pas ce que les contribuables paient. Est-ce ce qui est mis en recouvrement par les services fiscaux, ou ce qui est effectivement payé par les contribuables après recouvrement ? Si l'écart entre le premier et le second n'est pas considérable en Alsace, il peut être beaucoup plus important dans d'autres régions ou départements (notamment une partie de la couronne parisienne), au point de générer de nouveaux systèmes de transferts, dans la mesure où l'État verse 100 là où l'on a voté 100 alors que les contribuables n'ont payé que 70. Des élus locaux peuvent ainsi se dire : quand on augmente les impôts, on augmente la part versée par l'État au profit de la collectivité. Autant de facteurs qui font paraître le système décalé par rapport à la réalité économique et sociale du territoire considéré, ce qu'il conviendrait de mesurer par des analyses à caractère non seulement financier, mais également sociopolitique. Pour en revenir aux facteurs d'augmentation des différentes charges, il est plus facile pour l'universitaire d'énoncer une classification intellectuelle distinguant entre ce qui relève des compétences et fonctions nouvelles, de l'évolution des coûts et de l'augmentation des dépenses à caractère discrétionnaire, que de se lancer dans une description qui ne peut s'envisager qu'à un niveau micro-économique. Prenons un exemple. On peut aménager de nouvelles aires de jeux. On les retrouvera dans le budget : cela correspond à telle dépense, de nature discrétionnaire. Mais voilà qu'une nouvelle règle entre en vigueur, qui impose l'utilisation de certains sols autour des aires de jeux, ce qui, dans ma commune, a entraîné, il y a quelques années, une dépense équivalant à quatre points d'impôts... Autrement dit, voilà deux dépenses sur les aires de jeux, à ceci près que la première découle d'une volonté politique et la seconde d'une charge supplémentaire. Tout cela correspond à des réalités parfaitement visibles sur le terrain, mais beaucoup plus difficiles à classer, fonction par fonction, au niveau macro-économique et à repérer dans les statistiques financières nationales. Sur l'actualité récente, je n'ai rien dit dans la mesure où le débat est déjà bien lancé. Sur la compensation des différentes charges, l'information du Parlement me paraît assurée, grâce notamment aux rapports et aux réponses aux questions écrites. Pour ce qui est de la dynamique en cours, et s'agissant plus particulièrement des régions, je vois plusieurs explications possibles, dont l'une tient précisément à la recherche d'une masse financière critique. Un président de région peut-il raisonnablement supporter d'être financièrement plus petit qu'un de ses départements, voire qu'une communauté urbaine ? Sans doute n'est-ce pas l'élément décisif. Mais il en est d'autres, à commencer par le fait que l'autonomie fiscale des régions a été réduite au point que la part de leurs ressources fiscales propres représente moins de 40 % du total... M. Jean-Pierre BALLIGAND : Moins encore ! M. Robert HERTZOG : ...sinon 37 ou 38 %, alors qu'elle dépasse encore 50 % pour les communes et les départements. Or, plus la part de la fiscalité dans les ressources totales est faible, plus il vous faudra en augmenter le taux pour compenser l'alourdissement des charges pesant sur l'ensemble. On voit donc une relation très claire entre le degré d'autonomie fiscale et la portée des décisions portant sur les taux des impôts ; encore faut-il bien distinguer entre taux et produit. Une étude lancée en Alsace dans les années 1995-96, à la demande du conseil économique et social régional, a visé à mesurer l'impact réel de la politique de la région, l'exécutif régional arguant qu'une augmentation de 7 %, voire 12 %, n'aurait qu'un effet dérisoire compte tenu de la faiblesse des taux alors appliqués. Elle a montré que plus le taux de fiscalité est faible, plus il faut lui appliquer une progression importante : c'est mécanique ! Sans oublier, point n'est besoin d'être agrégé de sciences politiques pour le comprendre, qu'il est plus facile d'augmenter significativement les impôts en début de mandat, quitte à expliquer que c'est la faute des prédécesseurs... Enfin, d'autres considérations politiques entrent en ligne de compte, à commencer par ce que l'on fera de ce supplément d'argent : servira-t-il à financer des missions relevant du « cœur de métier » de la collectivité, ou s'agira-t-il d'intervenir davantage dans le champ de compétences d'autres personnes publiques, collectivités territoriales ou État ? M. Pascal TERRASSE : Les transferts de charges, nous avez-vous dit, ont été dans les dernières années compensés d'une manière généralement satisfaisante, mais il s'est posé en revanche un problème de concomitance : si les moyens transférés ont effectivement correspondu à la dépense antérieure, il n'en a pas été forcément de même pour l'accroissement de la charge résultant du transfert. De ce fait, nous nous trouvons aujourd'hui dans un système intermédiaire, où l'autonomie fiscale reste inaboutie et l'autonomie financière vis-à-vis de l'État très relative, celui-ci transférant des dépenses par essence évolutives - prise en charge du handicap, des personnes âgées, du RMI - alors même que les ressources correspondantes - TIPP, taxe sur les contrats d'assurance - sont passives et que la collectivité locale ne peut en déterminer l'évolution. J'aimerais connaître votre position sur cette problématique. Deuxièmement, quelle appréciation portez-vous sur l'impact, à la fois des dégrèvements et des compensations dont l'État est à l'initiative ? Quelles peuvent en être, sur un plan macro-économique, les conséquences pour les collectivités territoriales ? Ainsi, le transfert de certains personnels aux collectivités territoriales entraînera une profonde mutation du mode de financement des retraites de ces fonctionnaires : il n'existe pas à ce jour de caisse de retraite pour les fonctionnaires de l'État, dont les cotisations sont purement fictives ; les agents transférés, une fois intégrés dans la fonction publique territoriale, dépendront d'une caisse de retraite identifiée, la CNRACL. Or non seulement la ressource correspondante n'est pas affectée, mais nous n'avons pas mesuré les incidences macro-économiques de ce transfert. Troisièmement, les chiffres économiques les plus récents sur l'évolution de la dette publique font apparaître une augmentation très sensible de la dette des collectivités territoriales. Vous avez souligné à juste titre que toute décision d'investissement d'une collectivité locale entraînait forcément des frais de fonctionnement qu'il n'est évidemment pas question de payer par l'emprunt. Or, dans le même temps, les collectivités s'endettent de plus en plus, ce qui, à terme, n'ira pas sans poser des problèmes. Quel est votre sentiment sur ce phénomène qui semble devenir tendanciel ? M. Michel PIRON : Sur les transferts compensés, je partage en partie l'interrogation de M. Pascal Terrasse : lorsque l'on a des charges dynamiques, inévitablement se pose le problème du caractère plus ou moins dynamique des ressources. L'APA est un bel exemple de charge dynamique financée par le transfert de recettes pour le moins statiques... Vous avez également posé la question du coût des procédures et des normes. Pensez-vous vraiment qu'on le connaisse réellement ? Je reste très perplexe à cet égard. Ce sont le plus souvent des coûts induits, très indirects, peu lisibles quand bien même ils sont incontestables, qu'il s'agisse des conséquences de la loi SRU, de la loi sur l'eau, des surcoûts liés aux nouvelles normes de construction, de traitement des ordures ménagères, etc. Comment les connaître exactement, alors que nous manquons cruellement d'études d'impact préalables et de simulations des conséquences financières de ces nouvelles normes ? Quel est votre sentiment sur ce sujet ? M. René DOSIÈRE : Où est structurellement la source de la dépense dans une collectivité locale ? Est-ce la volonté politique de dépenser ou la richesse de la collectivité qui fait que, plus on dispose de ressources, plus on a tendance à dépenser ? Des études ont-elles été menées pour répondre à cette question ? Pensez-vous que l'opacité soit un facteur d'aggravation de la fiscalité locale ? L'opacité peut découler des structures intercommunales dont les conseils votent des impôts dont ils n'ont pas à rendre compte au suffrage universel, ou encore tenir au fait que plusieurs collectivités prélèvent les impôts sur une même assiette en sachant pertinemment que le contribuable sera bien en peine de savoir qui est responsable de quoi... Dans un cas comme dans l'autre, avez-vous connaissance d'études qui aient mis en évidence un rapport de cause à effet entre l'opacité et l'alourdissement de la fiscalité locale ? M. Jean-Jacques DESCAMPS : J'ai cru comprendre que vous aviez déjà mené en Alsace le travail que nous voudrions conduire. Si tel était bien le cas, le modèle alsacien pourrait-il être étendu aux autres régions de France ? Pourrions-nous à tout le moins le consolider pour faire avancer notre propre réflexion ? À vous entendre, sans bien connaître le poids de chacune des raisons que vous avez évoquées, on a l'impression qu'elles vont toutes dans le mauvais sens avec un certain déterminisme... À quoi tient le lien entre l'augmentation ou non de la fiscalité et la mauvaise ou la bonne gestion ? Existe-t-il des paramètres qui permettraient de déterminer ce qui relève du déterminisme et ce qui relève du volontarisme, dans un sens ou dans l'autre ? Contrairement à ce que vous laissez entendre, toutes les dépenses des communes ne sont pas sans résultat : chaque jour, en tant qu'élu local, je me demande si mon investissement est porteur d'augmentation de bases et donc facteur de réduction - ou pour le moins de non-augmentation - de la fiscalité. Dès lors, on peut se poser la question du lien entre fiscalité et endettement. Je fais mienne, à ce propos, la question de M. Pascal Terrasse : quelles conséquences faut-il tirer de la progression de l'endettement des collectivités territoriales ? Se traduira-elle à terme par de la fiscalité supplémentaire ou, à l'inverse, par des investissements propres à la réduire ? Se pose enfin la question du lien entre les différentes collectivités : si l'on accroît sa fiscalité pour arroser les communes, on les aide à ne pas augmenter la leur. C'est un effet cascade, et un choix politique généralement très apprécié par les maires... Le même mouvement peut se concevoir au niveau de l'État - on entend d'ailleurs tenir un discours politique symétrique : l'État ne donnant pas assez aux collectivités territoriales, celles-ci sont bien obligées de se rabattre sur la fiscalité ou sur la collectivité d'en dessous... Dès lors, ne faut-il pas se poser la question de l'effet des subventions accordées par chaque niveau au niveau inférieur ? Avez-vous conduit, en Alsace, une réflexion sur toutes ces questions d'ordre méthodologique, et apporté un peu de clarté dans toute cette complexité ? M. Jean-Pierre GORGES : Vous avez parlé de la multiplication des « entrepreneurs politiques ». Nous assistons effectivement, l'organe créant la fonction, à une multiplication institutionnelle de structures - pays, intercommunalités, régions -, et ce phénomène se double d'une autre dimension, transversale, qui tient au fait que chacun, dans le cadre de sa gestion discrétionnaire, essaie de jouer les compétences de l'autre, tant et si bien que la multiplication du nombre de structures conjuguée à celle du nombre de compétences exercées produit certainement une inflation énorme. Avez-vous déjà réfléchi aux incidences de ces deux effets, le premier institutionnel, le second plus subtil lié à l'envie de tout un chacun d'exercer les mêmes compétences ? Ma deuxième question appelle une réponse plus politique. Nous assistons à deux démarches simultanées, mais en sens opposé : une démarche vers le haut, l'intercommunalité, censée générer des économies, et une démarche de répartition, vers le bas. La conduite de ces deux démarches s'est-elle inscrite dans une cohérence politique ? Les points de recoupement entre l'axe montant et l'axe descendant ont-ils bien été placés aux bons endroits ? Cette organisation administrative n'est-elle pas la première source de l'inflation fiscale en France ? M. Jean-Pierre BALLIGAND : Vos réflexions doivent nous aider à élaborer notre propre méthodologie. Votre présentation a le mérite de sortir des sentiers battus, à commencer par celui du procès systématique de l'État ou du volontariat politique des collectivités. La réalité est effectivement un peu plus complexe : votre approche montre que, au-delà des nouvelles institutions, se pose le problème du pouvoir, des acteurs et de l'assise du pouvoir. Pour le conseil général, par exemple, grand vainqueur des lois de décentralisation de 1982-1983, celle-ci se traduit par des politiques dans de nombreux domaines, y compris celui de la communication, que l'on ne connaissait pas auparavant. De même pour la coopération intercommunale, en phase ascendante depuis 1992, puis 1999. Vous n'avez pas dit un mot sur la clause de compétence générale. Je vous ai bien entendu, ainsi que plusieurs de mes collègues, relever la multiplication des compétences croisées, les lois de décentralisation de 1982 et 1983 n'ayant pas prévu de compétences spécialisées. Mais ce choix n'est-il pas devenu, compte tenu de la multiplication des institutions et des acteurs, une source considérable de renchérissement des coûts ? Quel est votre avis personnel sur cette affaire ? Vous avez parlé d'opacité, rejoint par M. René Dosière et d'autres collègues, et j'ai particulièrement apprécié votre exemple : augmenter la taxe d'habitation et augmenter l'impôt sur le revenu, ce n'est effectivement pas du tout la même chose. Pouvez-vous toutefois le développer, certains d'entre nous connaissant d'ores et déjà les effets quelque peu pervers de certains mécanismes de substitution entre fiscalité d'État et fiscalité locale ? Enfin, vous avez souligné, et nous sommes plusieurs ici à nous en inquiéter, comment les collectivités territoriales sont désormais placées en situation de concurrence dans l'exercice de leurs responsabilités. Ce système concurrentiel découle bien évidemment de la clause de compétence générale : comme il n'existe pas de compétences spécifiques, chacun y va, à plus forte raison lorsque c'est intéressant... Mais pourquoi ne voulez-vous pas faire de catégorisation ? Le département est au cœur d'une problématique difficile ; c'est du reste au niveau du conseil général que je crains le plus une explosion fiscale, d'autant plus qu'il n'existe plus de part régionale de la taxe d'habitation. Prenons l'exemple, douloureux, des handicapés. Le vieillissement de cette population engendre une progression considérable des frais d'hébergement, à tel point que certains conseils généraux se désengagent ou tout au moins ne bougent plus alors que le phénomène ne fait que commencer. De ce fait, les conseils généraux qui s'efforcent d'assumer leur responsabilité en la matière se voient confrontés à des hausses encore plus substantielles. L'action sociale représente déjà 50 % des charges de la collectivité départementale. Et contrairement à ce qui se produit lorsqu'une intercommunalité ou une région construit des routes de desserte de zones industrielles, ouvrir un centre d'hébergement pour personnes handicapées signifie qu'il faudra, année après année, en financer le fonctionnement, sans retour sur investissement... Pour un petit département comme l'Aisne qui compte 500.000 habitants, cela représente quatre points de fiscalité supplémentaires. Il faut distinguer entre les collectivités qui peuvent espérer un retour sur investissement - celles qui « font l'ingénierie » de la taxe professionnelle lorsqu'elles aménagent les zones industrielles et les zones d'activité - et les collectivités telles que les conseils généraux, conduits à investir dans des domaines où l'on ne peut espérer d'autre retour sur investissement qu'une charge de fonctionnement encore accrue, d'autant que l'État, quel que soit le gouvernement, reste assez largement absent de ces problématiques. Mme Arlette GROSSKOST : Ce n'est pas d'aujourd'hui que de nouvelles compétences ont été transférées avec, en principe, les financements correspondants. A-t-on suffisamment de recul pour calculer précisément les charges de fonctionnement induites par ces nouvelles responsabilités ? Quel est l'impact mathématique des compétences transférées ? Ainsi, la gestion de certaines catégories de personnels désormais pris en charge par les collectivités territoriales induira des coûts de fonctionnement supplémentaires. Peut-on les calculer ? Face à cette inflation des charges, la collectivité n'a d'autre alternative que d'« augmenter le gâteau » à partager, en alourdissant sa fiscalité ou de se résoudre à des choix de gestion, qui sont politiques. M. Marc FRANCINA : Ne croyez-vous pas que l'empilement des structures favorise la course à la subvention, laquelle incite par contrecoup à s'endetter ou à alourdir la fiscalité pour financer le reste de l'investissement ? Cet effet pervers risque de poser des problèmes, particulièrement aux petites communes qui veulent à tout prix avoir les mêmes équipements que leurs voisines plus riches. Deuxième question : les villes touristiques, dont la population peut être très faible pendant une partie de l'année, se retrouvent à supporter de gros investissements d'infrastructures dimensionnées pour faire face à la période touristique. Si certaines villes ou stations de sports d'hiver parviennent à assumer cette situation, celle-ci trouve rapidement ses limites, comme le montre l'exemple des Villages vacances familles (VVF) que l'on avait implantés un peu partout il y a vingt ans : ces structures ne fonctionnant guère plus de trois mois, les communes ne parviennent plus aujourd'hui à subventionner la remise à niveau, à tel point que la Caisse des dépôts et consignations se débarrasse de la moitié de son parc de VVF et que même M. Brémond n'en veut pas... M. Robert HERTZOG : S'agissant des compensations des transferts de compétences, la Constitution a prévu un mode de calcul simple : ce sera autant que ce que l'État dépensait. Pour objectif qu'il soit, ce critère n'est pas satisfaisant : rien ne dit que l'État dépensait à un niveau optimal. L'expérience a montré qu'il fallait faire plus pour rattraper les inégalités territoriales, d'où la nécessité d'avoir non seulement le bon chiffre de compensation, mais encore la bonne ressource, ce qui place le Gouvernement et le Parlement devant un choix très difficile. Il est beaucoup plus facile d'assurer la compensation par une dotation, calculée et attribuée en raison du coût, que par un impôt. Mais, outre le fait qu'elle n'évolue pas spontanément, la dotation n'est pas conforme au principe de l'autonomie fiscale - encore que la manière dont on a interprété la notion de ressource fiscale, afin d'y intégrer la part de TIPP, me paraisse assez critiquable : je m'étonne même que le Conseil constitutionnel l'ait accepté. Quoi qu'il en soit, une dépense dynamique suppose que la ressource le soit également. Existe-t-il des gisements de ressources fiscales encore exploitables pour assurer la compensation des nouvelles compétences ? Problème majeur, devant lequel on a jusqu'à présent préféré reculer. Imaginer une véritable fiscalité pour faire face à ce genre de dépenses est tout à la fois très simple et très difficile. Faute de pouvoir trouver une solution du côté de la fiscalité indirecte - la TVA n'est pas une ressource utilisable pour la fiscalité locale - ou par le biais de l'impôt sur le capital ou de taxes sur la pollution, force est de se rabattre sur le revenu. Au demeurant, les impôts locaux ont été historiquement créés comme des impôts additionnels à l'impôt d'État sur le revenu. À ceci près que la bonne assiette ne saurait aujourd'hui être l'IRPP, mais bien cet impôt moderne sur le revenu qu'est la CSG. Il serait assez logique que celle-ci fasse office d'impôt départemental, pour financer des dépenses sociales ; ce serait précisément un excellent moyen de la réserver au social. Malheureusement, les partenaires sociaux ne veulent surtout pas que les collectivités territoriales puissent avoir accès à un impôt qu'ils considèrent comme leur étant réservé. Ce blocage pose un problème fondamental. M. le Rapporteur : La création de la CNSA pour financer l'accompagnement du handicap procède quelque peu de cette logique, en tout cas indirectement. M. Robert HERTZOG : Certes, mais très partiellement. M. Pascal TERRASSE : Il y a effectivement 0,1 point de CSG. M. Jean-Jacques DESCAMPS : C'est un début... M. Robert HERTZOG : Toute solution peut se heurter à des obstacles politiques. Mais tant que l'on n'aura pas une fiscalité locale moderne et évolutive, on en sera réduit à procéder à des ajustements plus ou moins empiriques qui ne feront qu'accumuler des complexités - lesquelles ont des coûts - dans un système déjà extrêmement compliqué et rendre celui-ci encore plus opaque. S'agissant des dégrèvements, la question contient déjà la réponse : l'impôt local n'est pas réellement l'impôt payé par les contribuables. De ce fait, la nature économique comme la pertinence sociale des masses financières mises en jeu par l'État, parfois considérables, deviennent très discutables. La dette des collectivités territoriales a décru à partir de 1993 ; à partir de 1996-1997, les collectivités territoriales ont été en excédent, au sens de Maastricht, de 0,2 ou 0,3 point de PIB. Elles se sont donc désendettées, au prix d'un certain tassement de leurs investissements et d'un recours assez important à l'autofinancement qui a contribué à l'alourdissement de la fiscalité locale, dans des proportions qu'il n'est toutefois pas aisé de déterminer car cela s'est fait en parallèle à l'attribution de nouvelles compétences. Cela dit, la dette des collectivités territoriales reste une dette saine, parce que gagée par des dépenses physiques d'investissement - le problème restant de savoir si l'investissement réalisé est utile, voire générateur de retours de ressources comme, par exemple, les infrastructures d'un lotissement... M. Pierre BOURGUIGNON : Ce n'est pas le cas d'une bibliothèque... M. Robert HERTZOG : Effectivement, ce n'est pas toujours le cas ; il est assez rare, même dans des collectivités présentées comme à vocation économique, de réaliser des investissements producteurs de recettes. La bibliothèque construite par une communauté urbaine aura un coût et surtout générera des frais de fonctionnement énormes, tout comme un conservatoire ou un équipement sportif. N'allez pas croire à ce propos, M. Jean-Pierre Balligand, que j'aie voulu faire de la globalisation, bien au contraire. Il faut regarder tout à la fois les différents impôts et les différentes catégories de collectivités, d'autant que celles-ci changent. Ainsi l'image des communautés ne peut plus se résumer à celle d'une collectivité entrepreneur économique : elles interviennent dorénavant dans le social, dans le culturel, le sport et dans d'autres domaines d'action nouveaux et coûteux, qui réduiront rapidement leur marge de manœuvre en termes d'investissement. Si la dette publique locale augmente à nouveau, c'est parce que l'investissement a redémarré, et elle ne me semble pas atteindre, pour l'instant, un niveau inquiétant. Nous ne connaissons pas globalement le coût des procédures et des normes. On ne peut que les mesurer collectivité par collectivité : je peux savoir ce qu'il en coûte pour ma commune en frais d'avocats et de conseil juridique pour éviter l'annulation de ses marchés, de ses déclarations d'utilité publique ou d'autres procédures ; on peut également connaître les délais, et par la même occasion les coûts, que génèrent les procédures, mais on ne saurait les retrouver dans les statistiques globales. D'où la nécessité de s'en assurer très concrètement au niveau « micro-collectivité territoriale », sinon micro-économique. Certains pays se sont dotés de « budgets de normes » et l'OCDE a développé toute une méthodologie en la matière : l'État ne peut émettre de nouvelle norme que pour autant que celle-ci ne se traduise pas par une dépense supplémentaire excessive pour telle catégorie de personnes ou entreprises. Les normes environnementales aux États-Unis ont ainsi fait l'objet de calculs très précis. Ces études, même sans être scientifiquement très satisfaisantes, pourraient représenter, au moins sur le plan intellectuel, un progrès non négligeable pour le Parlement. Nous ne disposons d'aucune étude scientifique définitive pour déterminer la source de la dépense dans une collectivité locale. D'autant qu'il existe une série de mythes dépensiers : le mythe du développement local, de l'interventionnisme économique local, à l'origine de combien de dépenses économiquement inutiles, et parfois de dépenses sociales socialement inutiles ! La disposition de ressources génère de la dépense. Dans un organisme émargeant à INTERREG, par exemple, on est porté à inventer des choses avec des organismes allemands et suisses dont, franchement, l'utilité ne saute pas toujours aux yeux... M. Marc FRANCINA et M. Jean-Pierre SOISSON : C'est vrai ! M. Robert HERTZOG : Dans son rapport « Le sursaut », M. Michel Camdessus, tout en restant très rapide sur les collectivités territoriales, explique qu'il faudrait les obliger à faire de meilleurs choix dans leurs dépenses... Un directeur général des services d'une collectivité me disait tout récemment la même chose des départements : il y a encore de l'argent - ce qui nous renvoie au problème de la multiplication des subventions et du chevauchement des interventions. Je ne crois pas que l'on puisse définir de manière claire et tranchée les compétences des différentes collectivités. Plus il y en a, plus c'est difficile. Il faut laisser un certain jeu. Les communes sont trop diverses pour que l'on puisse imaginer de leur imposer de ne faire que ceci ou cela, telle compétence, telle ressource. Il en va de même pour les départements. Certains pays de l'Europe de l'Est s'y essaient : c'est infaisable. Il est clair, en revanche, que le processus de contrainte sur les finances locales devrait conduire les collectivités à se resserrer davantage sur les cœurs de métier, sur une certaine spécialité de la dépense. La compétence « génétique » du département, c'est le social : il ne doit plus chercher à faire ce que font les intercommunalités et la région. Mais de là à l'écrire dans un texte... C'est aux différents acteurs de savoir faire preuve de raison. Cela nous amène au problème de la multiplication des entrepreneurs politiques. La question est de savoir s'il y a un pilote dans le système. Où s'effectue la régulation ? Notre système souffre d'un manque et peut-être d'une hypocrisie : un manque de régulateur, l'État ne jouant plus ce rôle, cependant que l'hypocrisie consiste à dire qu'il n'y a pas de régulateur dans le système local lui-même ; et comme il n'y a pas de hiérarchie entre régions, départements et communes, tout le monde peut faire la même chose. Peut-on raisonnablement tenir dans un système sans normes de gestion plus ou moins autoritairement fixées par l'État - le Gouvernement, mais le Parlement a lui aussi un certain pouvoir en la matière -, ni véritable procédure de concertation ? J'entends parfois parler, dans les régions, de la création de conseils de « grands élus » afin que les exécutifs se mettent d'accord sur l'évolution des différents postes de dépenses ou de la fiscalité. L'étude dont j'ai déjà parlé, sur l'Alsace, aurait dû servir de base à cette négociation inter-collectivités ; cela ne s'est pas fait. Il m'arrive d'utiliser la notion de « décentralisation coopérative ». Le système marche parce qu'il y a une coopération. Mais cette coopération se fait-elle sur les grands objectifs ou seulement sur les marges ? S'il ne s'agit que de financer un équipement ou un service supplémentaire, la chose est relativement aisée. Mais la concertation inter-collectivités peut-elle se concevoir sur des objectifs financiers ou sur des grandes politiques, à l'instar de ce que l'on appelle le fédéralisme coopératif en Allemagne ? Je n'irai pas jusqu'à soutenir qu'il y a un modèle politique alsacien, quand bien même les élus et politiques alsaciens et alsaciennes ne manqueront pas de l'affirmer... J'ai toutefois l'immodestie de penser que le travail que nous avons réalisé en Alsace peut avoir valeur de modèle pour ce qui touche à la méthodologie : nous avons systématiquement distingué entre impôt inscrit dans les budgets et impôt prélevé, fiscalité budgétée et fiscalité DGI. À force de collecter des photos, nous avons reconstitué un film et ainsi découvert comment s'était transformé le système de finances locales dans ses structures. La part respective des différentes collectivités a changé, celle des régions a quelque peu augmenté, celle des communes a baissé, le groupe communes-intercommunalité est resté relativement stable, sinon en légère augmentation, alors que les départements n'ont enregistré que des variations conjoncturelles. Au sein de chacune des catégories en revanche, les structures de financement ont beaucoup évolué. Je n'ai effectivement pas parlé de la clause générale de compétence. Peut-on l'abandonner ? Cela supposerait de la remplacer par des clauses spécialisées. Or nous nous orientons plutôt dans une direction où les EPCI auront une compétence générale... S'agissant enfin des compensations, il est presque impossible de voir, après coup, comment cela a marché. La vignette automobile, par exemple, a servi de compensation fiscale à certains transferts de charges. Mais depuis, cette fiscalité, qui avait une certaine élasticité, a été remplacée par une dotation... Comment maintenant s'assurer de la compensation de la compensation par rapport à une charge antérieure ? Les statisticiens se noieront dans les équations ! M. le Président : M. le Professeur, je vous remercie d'avoir répondu à presque toutes nos questions et de nous avoir éclairés sur bon nombre de points. Audition de M. Alain GUENGANT, (Des documents fournis par M. GUENGANT à l'appui de son intervention sont reproduits en page 169 du tome III du présent rapport) Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président M. Alain Guengant est introduit. M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons M. Alain Guengant, directeur de recherche au CNRS et chargé d'enseignement, notamment aux universités de Rennes I et Rennes II. Parmi de nombreux ouvrages et travaux d'expertise, il a cosigné en 2004 un rapport du Commissariat général du Plan sur les effets péréquateurs des concours de l'État aux collectivités territoriales. M. le Président rappelle à M. Alain Guengant que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. À l'invitation du Président, celui-ci prête serment. M. Alain GUENGANT : Du point de vue du contribuable, la réforme de la fiscalité locale apparaît tout à la fois masquée et inachevée. Masquée, en ce sens que l'évolution des taxes locales s'est opérée non par une réforme des assiettes, mais à coup de dégrèvements législatifs : plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu, plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. Ces deux dégrèvements accordés par l'État ont contribué à réformer les deux taxes en profondeur. Inachevée, dans la mesure où ces plafonnements de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ne concernent qu'une partie des contribuables. En zone urbaine, plus de la moitié d'entre eux bénéficient du plafonnement en fonction du revenu ; autrement dit, la taxe d'habitation n'est plus pour eux un impôt local assis sur les valeurs locatives, mais bien un impôt national sur le revenu, à taux progressif qui plus est. Inachevée aussi en ce que ses effets ne sont pas définitivement acquis : ainsi, le plafonnement en fonction du revenu ne vaut que pour autant que les taux de la taxe d'habitation n'augmentent pas. Sinon, on revient à la taxation sur les valeurs locatives et tous les avantages du plafonnement en fonction du revenu sont perdus. Du point de vue des collectivités publiques, c'est une réforme tout à la fois coûteuse et centralisatrice. Coûteuse pour les finances publiques : il n'est que de rappeler l'ampleur des compensations financières versées par l'État en contrepartie des allégements d'impôt, sous forme soit de dégrèvements, soit de compensations d'exonération. Si les concours de l'État aux collectivités territoriales ont considérablement augmenté dans les années quatre-vingt-dix, cette augmentation est uniquement imputable à l'accumulation des compensations venues en contrepartie des allégements des impôts locaux. De ce fait, l'État est devenu le premier contribuable local : la moitié de la taxe professionnelle et le tiers de la taxe d'habitation sont financés par ses compensations. Seule la taxe foncière sur les propriétés bâties reste un véritable impôt local, intégralement acquitté par le contribuable local. La question se pose de savoir comment ont été financées ces compensations. N'ont-elles pas contribué à creuser le déficit du budget de l'État ? Mais cette réforme a également été coûteuse en termes de politiques publiques. Ces allégements d'impôts ont été autant d'occasions perdues de favoriser une véritable réforme de la fiscalité locale. Les compensations ou les dégrèvements ont toujours été accordés en réaction aux échecs des tentatives de réforme, systématiquement rejetées. On aurait pu imaginer une autre stratégie financière, l'État utilisant une partie des dotations budgétaires pour favoriser une réforme à produit décroissant, autrement dit pour réduire par le biais d'allégements les transferts de charges entre les contribuables. La fiscalité locale aurait été rénovée en profondeur si l'on avait accepté d'entrée de jeu une réduction du produit de l'impôt au lieu d'accorder, au prix d'un énorme investissement budgétaire de l'État, des allégements en réaction à l'échec des réformes, de celle de la taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée en 1985 comme de celle de la taxe départementale sur le revenu en 1990-1991. À ce propos, le projet de la commission Fouquet met clairement en parallèle un engagement de l'État d'accorder des allégements supplémentaires et un projet de réforme ; sans discuter du bien-fondé de l'idée de supprimer la taxe professionnelle régionale, cette stratégie est typiquement celle que je décrivais plus haut, qui vise à minorer les transferts de charges entre contribuables - et par le fait entre collectivités, car les deux sont liés. Réforme centralisatrice enfin, dans la mesure où, d'exonération en exonération, les collectivités subissent une érosion de leur autonomie fiscale : en termes de champ d'application du vote des taux, les bases se rétrécissant d'autant, mais également en termes d'effet bases, la politique fiscale des collectivités produisant de moins en moins d'effet de retour à mesure que leur fiscalité propre devient de plus en plus réduite. Précisons pour terminer que cette stratégie de réforme masquée, inachevée, coûteuse et centralisatrice ne concerne que deux des quatre taxes directes locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties, seul pilier intact de la fiscalité directe locale, se retrouve à subir les hausses de taux les plus élevés : ils augmentent en moyenne deux fois plus vite que les taux de taxe d'habitation et de taxe professionnelle... M. le Rapporteur : Pourquoi ? M. Alain GUENGANT : Là est toute la question... Mais s'il reste apparemment intact, la solidité de ce pilier n'est peut-être pas définitivement assurée. La taxe foncière sur les propriétés bâties repose sur des évaluations cadastrales dont vous connaissez tous le caractère inéquitable. M. le Rapporteur : Pourquoi cette augmentation du taux du foncier bâti, d'autant que vous venez de rappeler l'archaïsme de la définition de ses bases ? Vous venez de décrire l'architecture de notre système de fiscalité locale dans une présentation très différente de celle du professeur Hertzog, ce qui est du reste tout à fait bien venu du point de vue de notre information. Alors qu'il s'était attaché à décrire les causes de l'évolution de la fiscalité locale et de ses taux, vous avez axé votre intervention sur la structure et non sur les taux, exception faite du cas du foncier bâti. Pourriez-vous poursuivre votre propos dans ce sens, en raccordant la réflexion « structure » à la réflexion « taux » ? M. Alain GUENGANT : C'est un fait acquis que, depuis la décentralisation, les taux de la fiscalité locale augmentent continuellement, qu'il s'agisse des taux administratifs ou des taux réels rapportés à l'ensemble des revenus créés par les communes. Continue depuis la décentralisation jusqu'en 1999, cette croissance de la pression fiscale locale a par la suite fortement chuté, mais pour une seule raison : l'accumulation des allégements d'impôts locaux accordés tant aux entreprises qu'aux ménages. Pourquoi les taux augmentent-ils ? On peut trouver une multitude de raisons. Pour commencer, les services publics locaux ont tendance à croître plus vite que les revenus. Cette expansion de la consommation publique se retrouve dans de nombreux pays. L'augmentation de la pression fiscale locale en France est également liée, en partie, aux réactions des collectivités territoriales à partir de 1982, sitôt les transferts engagés. Les dépenses associées à ces nouvelles compétences ont progressé nettement plus vite que les ressources - dotations ou impôts - transférées en contrepartie. D'où un effet de ciseaux qui a commencé à apparaître, non pas en 1982-1983, mais au début des années quatre-vingt-dix, et qui s'est, par la suite, considérablement amplifié. La manière dont les collectivités ont géré les compétences transférées a été incontestablement un facteur d'augmentation. L'arbitrage des collectivités territoriales en faveur de l'autofinancement et la réduction de leur demande d'emprunt ont également pesé sur les taux de fiscalité. Aux débuts de la décentralisation, 60 % de l'investissement local était couvert par l'emprunt ; nous n'en sommes plus aujourd'hui qu'à 30 ou 35 %. La diminution, considérable, de la part de l'emprunt en tant que mode de financement des investissements a été intégralement compensée par une hausse de l'autofinancement, autrement dit de l'épargne nette des collectivités, et non par les concours de l'État aux investissements qui sont restés proportionnellement constants. Ajoutez à cela que les dotations de l'État, à périmètre constant, augmentent moins vite que le produit intérieur brut, contrairement aux dépenses des collectivités territoriales. La différence se répercute naturellement sur l'assiette fiscale contrôlée par les collectivités et donc en premier lieu sur les taxes directes locales. Dans le cas plus spécifique de la taxe d'habitation, intervient également un arbitrage explicitement pratiqué par la plupart des collectivités territoriales, et qui consiste à jouer de la variation différenciée introduite par la loi de 1980 pour reporter les hausses de fiscalité directe sur les propriétaires en ménageant les occupants de logements et de facto, sous l'effet du lien entre les taux, les entreprises. L'effet de ce report pratiquement systématique peut s'amplifier ponctuellement, en particulier dans les communes industrielles membres de communautés à taxe professionnelle unique, qui peuvent être tentées de se reconstituer une mini-taxe professionnelle à partir de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont le taux peut littéralement exploser lorsque 80 %, voire 90 % des bases sont des bases entreprises. Certes, les propriétaires résidents supportent également une hausse de leur foncier bâti, mais celle-ci est partiellement atténuée par la taxe d'habitation. On peut également se demander, mais le sujet est très complexe, si les allégements d'impôts de l'État n'ont pas eux-mêmes contribué à stimuler les hausses des taux d'imposition. Les élus savent fort bien que les dégrèvements réduiront l'impact de l'impôt concerné sur les contribuables. Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu en a été l'exemple le plus révélateur : certaines collectivités avaient délibérément supprimé des abattements facultatifs pour augmenter spectaculairement le produit de la taxe en sachant pertinemment que ces augmentations se répercuteraient non sur les contribuables, mais intégralement sur le budget de l'État. Celui-ci a dû prendre dès l'année suivante des dispositions pour empêcher ces comportements opportunistes. M. Pascal TERRASSE : On sait que le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu n'a pas évolué depuis une quinzaine années. De ce fait, bon nombre de contribuables sont sortis du dispositif. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de réformer en profondeur ce plafonnement pour laisser une bouffée d'air complémentaire aux collectivités ? Vous n'avez pas fait référence aux mécanismes de péréquation. Pouvez-vous nous donner votre appréciation sur ce sujet ? Les systèmes actuels vous paraissent-ils suffisants ? Enfin, vous avez évoqué les travaux de la commission Fouquet. Elle a posé la question de l'équité et de l'efficacité économique de l'impôt local. Si vous jugez que cette efficacité est faible, comment l'État pourrait-il à votre avis contribuer à la baisse de l'impôt local ? M. Marc FRANCINA : Dans les années quatre-vingt-dix, la réforme des quatre taxes était toute prête, les estimations préparées par les services de l'État, mais tout a capoté d'un seul coup sur le plan politique, par le fait qu'elle allait faire exploser la taxe d'habitation dans tous les quartiers populaires des grandes villes... Peut-on, quinze ans plus tard, reprendre ces études pour réformer ces quatre taxes ? Bon nombre de collectivités ont effectivement fait supporter, via les dégrèvements, leurs financements par l'État. Est-il vraiment possible de reprendre le travail interrompu en 1992-1993 ? Le problème est réel, mais personne n'a jamais eu le courage de sauter le pas. M. Jean-Pierre BALLIGAND : René Dosière peut vous expliquer... M. René DOSIÈRE : Je ne répondrai pas là-dessus, ayant été rapporteur de la réforme des valeurs locatives... Les études que vous avez conduites ou dont vous avez eu à connaître ne laissent-elles pas à penser que plus une collectivité est riche, plus elle a tendance à dépenser et par le fait à contribuer à la hausse de la fiscalité ? M. Jean-Pierre GORGES : On pourrait croire à un mouvement de dérapage structurellement inflationniste qui, au bout du compte, se retrouverait dans la dette de l'État et finirait en catastrophe annoncée si cette situation ne tenait également à d'autres facteurs, et notamment aux effets de la « loi Chevènement ». Pour une communauté d'agglomération, le passage à la taxe professionnelle unique revient à retirer aux communes membres une manne dynamique en contrepartie d'une dotation de compensation non revalorisée. Vous nous avez expliqué comment certaines communes parvenaient à se recréer une ressource évolutive en jouant sur le foncier non bâti. Mais n'aurait-il pas mieux valu expliquer aux communautés d'agglomération qu'elles avaient d'abord intérêt non seulement à bien définir leurs compétences de départ, mais également à savoir utiliser le mécanisme de dotation de solidarité communautaire (DSC) pour revaloriser les compensations ? On sait que les charges de personnels des communes galopent sous l'effet notamment du glissement-vieillesse-technicité (GVT) alors que la plus grande partie de leurs ressources reste figée. Mécaniquement, la fiscalité a augmenté dans toutes les communes membres de communautés d'agglomération. Ne pensez-vous pas que la multiplication d'acteurs politiques - régions, pays, etc. - jouant dans les mêmes domaines de compétence, parfois en compétition ouverte sur la culture ou le sport, avec une prolifération de financements croisés, soit également un facteur d'inflation non négligeable ? Il est enfin une explication dont on ne parle pas : la création de nombreux emplois aidés entre 1995 et 2000 - emplois-jeunes, CES, CEC et autres appellations. La manœuvre ne coûtait pas cher et tout le monde en a embauché des quantités. L'organe créant la fonction, ces gens sont restés dans les collectivités, élargissant progressivement leurs domaines d'activité. Mais sitôt qu'ont disparu les aides associées, le maintien de ces compétences est devenu un facteur très inflationniste. De la même manière, peut-on préciser l'impact des 35 heures ? On sait que, dans les SDIS, l'effet n'a pas été négligeable. Ont-elles concouru à l'augmentation de la fiscalité dans les collectivités ? M. Jean-Pierre BALLIGAND : Cela n'a pas pu jouer : ils étaient à trente-quatre heures ! M. Jean-Jacques DESCAMPS : Comme Jean-Pierre Gorges, j'aimerais savoir si vous avez pu mesurer l'effet en termes de dépenses publiques supplémentaires de la création de l'intercommunalité - pays compris. Jusqu'à ces dernières années, les collectivités avaient, dans leurs arbitrages, préféré l'autofinancement à l'endettement. Mais depuis quelques années, en raison notamment des taux d'intérêts très bas, ce phénomène ne s'est-il pas inversé ? Cela n'a du reste pas empêché la fiscalité locale de continuer à augmenter. M. Jean-Pierre SOISSON : Que pensez-vous de l'élargissement du champ d'activité des collectivités en dehors des compétences que leur a transférées l'État ? Chacun veut désormais conduire sa politique de l'emploi. Autrefois, chacun voulait avoir sa zone bleue ; aujourd'hui, tout le monde, régions, départements, veut par exemple sa maison de l'emploi, sa politique de formation, alors que tout cela reste à proprement parler du domaine de l'État ! Le coût de ces initiatives nouvelles, qui dépassent le cadre des compétences normalement transférées, n'est-il pas de nature à provoquer une explosion fiscale ? Vous avez très justement relevé que, faute d'avoir eu le courage d'entreprendre une grande réforme fiscale, l'État est allé d'adaptation en adaptation, avec les conséquences financières que l'on sait. Que pensez-vous à ce propos de l'affectation d'une partie du produit de la TIPP aux régions ? M. Jean-Pierre BALLIGAND : J'ai beaucoup apprécié votre présentation, y compris sur le plan sémantique - réforme masquée, inachevée, coûteuse et centralisatrice -, et la façon dont vous avez mis en évidence les effets pervers des systèmes de compensation mis en place par l'État à chaque fois qu'échouait une réforme fiscale... Ne reste plus, et j'en suis d'accord, qu'un seul impôt local au plein sens du terme : la taxe foncière sur les propriétés bâties. Mais quelles perspectives d'avenir pouvons-nous dégager ? Quels pourraient être les grands axes d'une nouvelle fiscalité locale ? M. le Rapporteur : Vous avez cité les divers facteurs d'augmentation de la fiscalité locale. Pouvez-vous situer les ordres de grandeur et de prééminence des uns par rapport aux autres ? M. Robert Hertzog estimait juste avant vous qu'il n'y avait pas de régulation du système, pas de pilote dans l'avion. Est-ce votre avis ? Pensez-vous qu'il existe une possibilité de régulation ? Les engagements de stabilité que la France prend à Bruxelles recouvrent une dimension étatique, une dimension sociale et une dimension locale. Mais qui peut être comptable de cette dimension locale, s'il n'existe pas de régulateur ? M. Jean-Pierre BALLIGAND : À ceci près que ce sont précisément les critères de convergence qui ont conduit petit à petit à rogner l'autonomie fiscale afin de limiter les prélèvements obligatoires locaux, remplacés par des dotations dont l'évolution ne suivait plus la croissance du PIB. M. Alain GUENGANT : Le dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu date de 1999. Le taux administratif a été fixé à 4,6 % ; en réalité, la taxe d'habitation est aujourd'hui plafonnée à 3,4 % du revenu du foyer fiscal, mais seulement pour les contribuables en dessous d'un certain seuil. Ce plafond est assorti d'un abattement forfaitaire, ce qui entraîne un effet de progressivité de la taxe d'habitation en fonction du revenu des contribuables. Pour la première fois, nous avons un impôt local progressif sur le revenu - non pas de jure, mais de facto -, et ce jusqu'au seuil de 3,4 %. Se pose le problème des contribuables qui franchissent ce seuil, s'exposant très probablement à un effet de ressaut très important. Ensuite, la taxe d'habitation continue à décroître en proportion du revenu. De ce fait, les contribuables les plus taxés sont ceux qui se situent au niveau du seuil, autrement dit les catégories moyennes-médianes et non plus les catégories les plus pauvres comme dans l'ancien système. Dans les villes, compte tenu du fait que plus de 50 % des contribuables sont plafonnés, le fameux « électeur médian » se retrouve à bénéficier du plafond. Le rapport du sénateur Yves Fréville a remarquablement fait le point sur cette réforme importante, cette « révolution tranquille » de la taxe d'habitation. Elle a toutefois l'inconvénient de ne concerner qu'une partie des contribuables. Peut-on aller plus loin ? L'État le souhaite-t-il ? Entend-il vraiment faire, explicitement, de la taxe d'habitation un véritable impôt local sur le revenu ? Même si, de facto, plus de la moitié des contribuables urbains sont taxés sur le revenu, il n'est pas dit que l'État soit déterminé à faire de la taxe d'habitation un véritable impôt sur le revenu pour tous. Ce ne serait du reste pas sans poser de sérieux problèmes techniques, liés à l'utilisation de la base « revenus » pour d'autres modes de financement publics, à la fameuse compétition entre notamment la base CSG et une base « revenus » locale. Pour l'heure, la taxe d'habitation est devenue un impôt dual : pour une partie des contribuables, c'est un impôt sur le revenu, national, à taux progressif ; pour l'autre partie, c'est un impôt local assis sur des valeurs locatives dont vous connaissez comme moi l'origine. La question se pose d'ailleurs de la compatibilité de ce système dual avec le principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt. N'étant pas juriste, j'ai beaucoup de mal à y répondre. Reste que, sous le même intitulé, la taxe d'habitation désigne deux impôts fondamentalement différents. Il en est de même pour la taxe professionnelle assise tantôt sur la valeur ajoutée, tantôt sur la valeur des immobilisations. M. Jean-Pierre SOISSON : Poser le problème ainsi amènera forcément le Conseil constitutionnel à réagir. Jamais je n'avais entendu décrire les conséquences de la réforme de 1999 avec une telle clarté. M. Alain GUENGANT : Je ne saurais dire ce qu'il en est sur le plan juridique ; mais sur le plan économique, c'est la conclusion qui s'impose. M. Pierre BOURGUIGNON : Cela remonte à dix ans ! M. Jean-Pierre BALLIGAND : J'en connais qui ont mal rédigé leur recours ! M. Alain GUENGANT : Je n'ai effectivement pas abordé le sujet connexe de la péréquation. Avec mon collègue Guy Gilbert, nous avons réalisé pour le compte du Commissariat général du Plan une évaluation du dispositif de péréquation financière entre les communes, les départements et les régions sur la période 1994-2001. Cette étude a d'abord permis de constater l'efficacité de la péréquation : 40 % de correction des inégalités pour les communes, plus de 50 % pour les départements et les régions. Ajoutons que le taux de correction des inégalités s'améliore de presque un point par an. Du côté des aspects négatifs, force est de reconnaître que la péréquation est inégale selon les collectivités. Tout le monde n'en bénéficie pas dans la même proportion, quand bien même elle reste partout significative et croissante. Incontestablement, la politique de péréquation financière en France, qui remonte aux années soixante, avec la suppression de l'ancienne taxe locale et le passage au versement représentatif de la taxe sur les salaires, a incontestablement donné des résultats. Et si, pour les régions, le taux de correction élevé est en partie liée au sérieux recul de l'autonomie fiscale régionale, la péréquation communale et intercommunale est quant à elle très performante et sa croissance est bien imputable aux mécanismes - DSU, DSR, etc. - mis en place à cet effet. La question reste de savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide : doit-on se satisfaire de 40 % de correction des inégalités ? La Constitution dispose que la loi doit favoriser l'égalité, et non que l'on doit l'atteindre à toute force. Le résultat de la péréquation intercommunale est d'autant plus méritoire que vous connaissez aussi bien que moi l'amplitude, sans équivalent à l'étranger, des inégalités de pouvoir d'achat entre les communes françaises : entre la plus riche et la plus pauvre, le rapport est de un à 8 500 ! La politique de péréquation a permis d'obtenir des résultats, en amélioration croissante qui plus est, conformément au cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution. Elle figure de surcroît parmi les critères de performance de la loi de finances. Les valeurs locatives sont-elles encore réformables ? Disons-le : plus le temps passe, plus la réforme devient impossible dans la mesure où les écarts entre les situations initiales et la situation actuelle ne font que s'amplifier. Elle était déjà difficile en 1990, au point que le Parlement a plusieurs fois reporté sine die l'intégration des nouvelles valeurs cadastrales dans les rôles ; c'est encore plus vrai aujourd'hui, au point d'être devenu politiquement irréalisable compte tenu de l'amplification des transferts de charges. Vous avez posé la question de l'équité et de l'efficacité de l'impôt, ce qui pose également le problème du statut de la taxe professionnelle. Celle-ci présente également la caractéristique d'un impôt dual, assis tantôt sur la valeur ajoutée, tantôt sur la valeur locative des immobilisations. Certaines propositions de la « commission Fouquet » sont déjà appliquées : la taxe professionnelle est déjà devenue un impôt sur la valeur ajoutée pour la moitié de son produit, même si cette moitié n'est fournie que par 150 000 contribuables, soit 5 % du total. C'est le même problème que pour la taxe d'habitation. Le choix de la valeur ajoutée, en tout cas pour un économiste, est certainement le plus pertinent dans le contexte actuel. L'excédent brut d'exploitation aurait trop exposé les collectivités aux fluctuations conjoncturelles des bénéfices. La valeur ajoutée apparaît comme l'assiette moderne que peuvent souhaiter les collectivités territoriales pour réformer en profondeur leur mode de taxation. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Cela réintroduit la part salaires. M. Alain GUENGANT : Effectivement, mais les entreprises plafonnées sont déjà taxées sur les salaires. Le problème est que, entre le plafond et le plancher, l'écart est énorme : 1,5 % au plancher pour tout ce qui est banques et assurances, 3,8 % à 4 % pour tout ce qui est industrie. M. le Président : N'y a-t-il pas un risque de délocalisation des ressources ? M. Alain GUENGANT : Je ne suis pas sûr que la fiscalité soit véritablement un facteur de délocalisation. M. le Président : Je parle des transferts de bases. M. Alain GUENGANT : Très juste, et cela m'amène au problème de la localisation de la valeur ajoutée pour les entreprises multi-établissements. Je ne comprends pas les critères envisagés pour répartir la valeur ajoutée entre les établissements d'une même entreprise. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Il faut prendre des critères physiques. M. Alain GUENGANT : On songe, dit-on, à retenir le critère des emplois, ce qui posera un sérieux problème à toutes les entreprises industrielles. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Évidemment ! M. Alain GUENGANT : Pour l'heure, les bases de la taxe professionnelle sont l'image des immobilisations, essentiellement des machines. Abandonner ce critère pour lui préférer celui de l'emploi reviendra à transférer massivement les bases « valeur ajoutée » de taxe professionnelle vers l'Ile-de-France, là où sont les services et les sièges sociaux, au détriment des endroits où sont installés les appareils productifs. M. Pierre BOURGUIGNON : Exactement ! M. Alain GUENGANT : Je ne comprends pas pourquoi la « commission Fouquet » n'a pas proposé de retenir les dotations aux amortissements comme critère de répartition de la valeur ajoutée multi-établissements, qui permettrait de reproduire fidèlement l'inégale répartition des immobilisations. Retenir exclusivement l'emploi ne peut qu'entraîner des transferts massifs. Comment réglera-t-on le cas d'EDF, appelée à abandonner son régime dérogatoire et à rejoindre le régime général du plafonnement ? Si on répartit sa valeur ajoutée en fonction du nombre d'emplois, ce sera un effondrement des bases dans les collectivités où sont installées les centrales nucléaires... M. Marc FRANCINA : Ce sera dur pour certains de nos collègues ! M. le Président : Il y a pire : songez aux centrales hydrauliques télécommandées, où il n'y a pas un seul emploi ! Les propos de M. Alain Guengant ne font que confirmer mes craintes d'une délocalisation des bases, très dangereuse pour les zones à forte activité industrielle. M. Alain GUENGANT : En effet. Sur le rapport entre la richesse et la dépense, la réponse est claire : si certaines collectivités dépensent plus que d'autres, c'est d'abord et principalement parce qu'elles sont plus riches. Les travaux économétriques sur l'origine de la dépense communale, départementale et régionale ont montré que l'inégalité de la dépense par habitant tient pour les deux tiers à la richesse, le reste tenant aux différences de composition sociologique - à ce que l'on appelle les critères de charges et de besoins - et enfin aux choix politiques. Le comportement des collectivités s'apparente quelque peu à celui du consommateur : plus on a des revenus élevés, plus on consomme. Ont également été évoqués la « loi Chevènement » et le régime de la TPU, ce qui soulève la question de savoir si l'intercommunalité n'est pas également un facteur de hausse de l'impôt. Il est avéré que l'empilement des structures dû à l'intercommunalité favorise l'accumulation des dépenses : lorsque les dépenses intercommunales augmentent de 10 %, les dépenses des communes membres ne diminuent que de 1 à 2 %. Autrement dit, les transferts de compétences dans le cadre de l'intercommunalité amplifient l'effet d'accumulation. On peut du reste se demander s'il n'en est pas de même entre l'État et les collectivités territoriales : toute modification du périmètre de gestion des compétences a comme résultat d'accumuler la dépense ; c'est en tout cas un fait acquis pour ce qui concerne l'intercommunalité. Reste à savoir si cette accumulation de dépenses est justifiée ou non par des contreparties en termes de services. Force est de constater une déperdition non négligeable sous forme de charges de structure au niveau communautaire. Certains affirment que le bonus de DGF accordé par l'État, qui a fait le succès de la « loi Chevènement », a été pour moitié absorbé par des charges de structure supplémentaires. M. Marc FRANCINA : Exactement. M. Alain GUENGANT : Ajoutons que la taxe professionnelle unique, en créant un rapport d'interdépendance très étroit entre communes et communauté, pose un problème de régulation du système. La TPU est certainement le système de fiscalité et de finances le plus complexe que l'on ait jamais construit, qu'il s'agisse de l'attribution de compensation, de la dotation de solidarité communautaire (DSC), des effets de transferts de charges, sans même parler de l'évaluation des charges transférées : si le législateur, par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a jugé nécessaire d'en réformer les critères, c'est bien qu'elle posait problème... Force est d'admettre que l'intercommunalité est plutôt un facteur additionnel d'accumulation des dépenses publiques. Vous m'avez interrogé sur l'évolution de la dette des collectivités. Les taux d'intérêt sont effectivement très bas. La rupture en 2003-2004 de la croissance de l'épargne locale, qui n'avait jusqu'alors cessé d'augmenter, constitue un élément nouveau, et peut-être un peu préoccupant. L'arrêt de ce mouvement témoigne de façon sous-jacente d'un effet de ciseaux entre l'évolution des dépenses et celle des recettes, et pourrait rejaillir sur l'ensemble de la situation financière des collectivités territoriales : l'excédent - modeste - dont elles pouvaient se prévaloir au sens des critères de Maastricht pourrait se retransformer assez rapidement en déficit. Reste que les collectivités ont su remarquablement gérer le choc considérable de la libéralisation du crédit dans les années quatre-vingt et la hausse des taux d'intérêt qui s'en est suivie. Elles ont parfaitement su maîtriser leur dette, aujourd'hui stabilisée à 100 milliards d'euros. N'oublions pas que, jusqu'en 1984-1985, elles bénéficiaient de taux d'intérêts privilégiés, très inférieurs aux taux du marché. Ces bonifications ont été brutalement supprimées, et de surcroît à une époque où les taux d'intérêts réels s'envolaient pour atteindre des chiffres de 10 % à 12 %, contre 1,5 % à 2 % aujourd'hui ! Mais l'efficacité de cette gestion de la dette a contribué à alourdir la fiscalité dans la mesure où l'assainissement financier du secteur public local n'a pu être obtenu qu'au prix d'un recours accru à l'autofinancement. M. René DOSIÈRE : Bercy ferait bien de s'en inspirer ! M. Alain GUENGANT : À quoi tient cette efficacité ? Tout simplement au fait que les collectivités appliquent la règle d'or : elles n'empruntent que pour investir et remboursent sur leurs fonds propres. C'est ce qui explique l'importance de leur épargne - 35 à 40 milliards d'euros - qui elle-même explique la solidité de l'assise financière des collectivités territoriales. Par comparaison, l'État,... M. René DOSIÈRE : Fait exactement le contraire ! M. Alain GUENGANT :... n'aurait plus d'épargne brute si on le soumettait aux mêmes règles budgétaires : il est incapable de payer ses intérêts sur ses fonds propres et a fortiori d'amortir sa dette. M. Jean-Jacques DESCAMPS : Quel héritage ! M. René DOSIÈRE : La faute en revient à Bercy, quels qu'aient été les gouvernements. M. Alain GUENGANT : La question de l'effet inflationniste des transferts de compétences, quoiqu'un peu délicate, est à rapporter à ce que j'ai dit plus haut de la modification des compétences au niveau local : au niveau national également, on peut penser que les transferts ont un effet inflationniste dans la mesure où se pose certainement un problème de coordination des politiques. En acceptant la TIPP comme contrepartie de financement de l'acte II de la décentralisation, les collectivités territoriales n'ont certainement pas fait le meilleur choix. M. le Président : On ne leur a pas donné le choix... M. René DOSIÈRE : On le leur a imposé ! M. Alain GUENGANT : La TIPP aurait été jusqu'aux années quatre-vingt-dix le meilleur impôt dont pouvaient rêver les collectivités territoriales, dans la mesure où son produit augmentait plus vite que le PIB. Mais cette évolution s'est brutalement cassée au début des années 2000, du fait des nouvelles habitudes du consommateur qui privilégie désormais le diesel, mais également des limitations de vitesse qui réduisent la consommation de carburant. Désormais, le produit de la TIPP augmente moins vite que le PIB et devient un choix moins favorable pour les collectivités territoriales. Reste à savoir ce qu'il en sera demain : tout porte à croire que son évolution sera beaucoup moins favorable que par le passé, et même paradoxalement moins avantageuse pour les collectivités que les indexations que pouvait leur proposer l'État dans le cadre du contrat de croissance et de solidarité. Se pose également la question du mode de répartition de la TIPP. Les départements ont en fait reçu une pseudo-dotation de l'État, dans la mesure où leur quote-part n'est qu'une fraction de l'évolution de la TIPP, sans effet taux ni même effet bases. La TIPP départementale n'est donc pas un impôt local, mais bien une pseudo-dotation. Il en va autrement pour les régions puisque, dès l'année prochaine, l'assiette de la TIPP régionale sera localisée - autrement dit, il y aura un effet bases - et, dès 2007, si l'Europe en est d'accord, elles pourront en moduler le taux. La TIPP régionale sera alors devenue un véritable impôt local, contrairement à la TIPP départementale. Pour les régions, le problème de la TIPP se pose en termes d'effet de retour : une politique régionale peut-elle espérer avoir un effet favorable sur le rendement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ? L'autonomie fiscale des collectivités territoriales suppose non seulement qu'elles puissent contrôler les taux, mais également qu'elles puissent influer sur les bases par le biais de leurs politiques propres, ainsi que l'a précisé, et à juste titre, le législateur organique dans sa définition de l'autonomie fiscale. Le paradoxe serait que la TIPP n'ait pas d'effet de retour ou, pire, un effet négatif : en poursuivant leurs politiques de transport ferroviaire, les régions ne concourent-elles pas à réduire la consommation de carburant, dont la plus grande partie est imputable aux déplacements domicile-travail ? M. Marc FRANCINA : Il va falloir expliquer cela aux Verts... M. Jean-Pierre BALLIGAND : On peut en dire autant du développement des transports en site propre dans les communautés d'agglomération. M. Jean-Jacques DESCAMPS : Heureusement que les subventions ont baissé ! M. Alain GUENGANT : M. le Rapporteur a posé la question la plus redoutable, celle des ordres de grandeur des différents déterminants susceptibles d'expliquer la hausse des impôts. Hiérarchiser les facteurs est un exercice très difficile : quelle est la part des transferts de compétences, de la volonté d'autofinancer plutôt que d'emprunter, de l'évolution des allégements ? J'en viens à me demander comment une réponse pourrait être construite avec un argumentaire solide... L'évolution des taux d'impôts locaux est la résultante d'une multitude de facteurs, tout à la fois différents d'une collectivité à l'autre et variables dans le temps. Prendre en compte autant de paramètres simultanés est un défi qu'un économiste aura certainement du mal à relever. M. Jean-Pierre GORGES : À ceci près que lorsque toutes les collectivités du même type modifient les mêmes taux au même moment et dans les mêmes proportions, il doit forcément y avoir un élément générateur. Ce ne peut être une coïncidence. M. Alain GUENGANT : Dans ce cas, on peut supposer qu'il y a un effet national. On l'a déjà observé en 1991 lorsque les départements avaient tous augmenté leurs taux et pratiquement dans la même proportion. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Quelles qu'aient été les couleurs politiques. M. Jean-Pierre GORGES : Sur une période d'observation assez longue, une multitude de facteurs peut conduire à faire déraper la fiscalité - intercommunalité, multiplication des types de collectivités et des compétences, etc. -, mais selon une direction asymptotique. Il en va tout autrement lorsque toutes les collectivités de même niveau, à la même heure, font évoluer leur fiscalité dans les mêmes proportions : il ne peut y avoir dans ce cas qu'un seul phénomène générateur. La question est de savoir s'il est d'ordre politique, économique ou autre. M. le Rapporteur : Et quelle était cette cause en 1991 ? M. Alain GUENGANT : Le mouvement de 1991 est dû à la conjonction de deux phénomènes : l'effondrement du produit des droits de mutation, d'enregistrement et de publicité foncière, lié à l'éclatement de la bulle spéculative, et, un peu plus tard, l'augmentation des dépenses sociales résultant de la crise économique. C'est dans cette période 1990-1993 que s'est clairement manifesté dans les départements l'effet de ciseaux entre le niveau des dépenses transférées et celui des ressources accordées en contrepartie. M. le Rapporteur : Peut-on parler d'un effet de l'APA sur l'augmentation des taux ? M. Alain GUENGANT : Ce n'est pas si net que cela... M. René DOSIÈRE : Vous nous avez à deux reprises parlé d'effet de ciseaux à propos de la compensation des transferts de compétences dans les départements. Or les études de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC) ont clairement montré que, jusqu'en 1996, les départements, contrairement aux régions, ont bénéficié de ressources transférées supérieures à leurs dépenses. M. Alain GUENGANT : Je me réfère aux données publiées dans le dernier rapport de l'Observatoire des finances locales. M. René DOSIÈRE : J'en prends note, mais je vous communiquerai le rapport de la CCEC. Au-delà des cas particuliers - certains ont perdu, d'autres énormément gagné -, il fait apparaître pour les départements un bilan global nettement positif jusqu'en 1996, date à laquelle la ressource a cessé d'être supérieure à la dépense. Pour les régions en revanche, les dépenses ont toujours été supérieures aux ressources transférées. M. Alain GUENGANT : L'Observatoire des finances locales a publié un premier bilan,... M. René DOSIÈRE : Mais ce premier rapport de Paul Girod était très politique. M. Alain GUENGANT :... suivi d'un second, qui présentait également des séries. Précisons que l'effet de ciseaux dont j'ai parlé ne se limite pas à l'aide sociale, mais touche également les lycées, les collèges, etc. M. René DOSIÈRE : Dans ce cas, je veux bien admettre que le bilan soit moins positif. M. Louis GISCARD D'ESTAING : Considérez-vous le versement transport comme un élément de la fiscalité locale ? M. Alain GUENGANT : Le versement transport entre bien dans le champ de l'impôt local, en tout cas au sens de la comptabilité nationale. C'est donc bien un impôt local, qui a une propriété extraordinaire : c'est le seul qui soit également acquitté par l'État. C'est un impôt très intéressant, puisqu'il est calculé sur l'ensemble des salaires versés, traitement des fonctionnaires des administrations compris. Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion ? D'un point de vue global - peut-être celui de Sirius... -, le secteur public local, bien qu'il soit en croissance, n'en est pas moins un secteur financièrement régulé, par la maîtrise de l'épargne. Depuis la fin des années quatre-vingt, les collectivités territoriales ont su maîtriser leur évolution financière. Elles se retrouvent à la tête d'un patrimoine considérable - 700 à 750 milliards d'euros, pour 100 milliards de dettes, autrement dit, s'il s'agissait d'entreprises, plus de 600 milliards d'euros de fonds propres - qui représente 80 % de l'équipement public de la France hors hôpitaux. Par comparaison, le patrimoine en équipement de l'État n'est évalué qu'à 150 milliards d'euros. Les collectivités territoriales apparaissent bien comme les aménageurs, en termes d'équipement public, du territoire national. M. le Rapporteur : Vous avez dit tout à l'heure que les collectivités étaient en excédent au regard des critères de dette publique ; or certaines notes ont tracé des perspectives différentes la semaine dernière. M. Alain GUENGANT : La dette publique regroupe celle de l'État, celle de la sécurité sociale et celle des collectivités territoriales. Sur 1 070 milliards d'euros de dette publique, ces dernières n'en représentent que 100 milliards. M. Jean-Pierre BALLIGAND : En augmentation de trois milliards. M. le Rapporteur : On les a accusées la semaine dernière d'aggraver la tendance. M. Alain GUENGANT : Les années 2003-2004 marquent effectivement une inversion de tendance par rapport à la situation observée depuis la décentralisation. Pour la première fois, l'épargne ne progresse plus ; et comme l'investissement est maintenu, on constate un retour à la demande d'emprunt. Plusieurs simulations prospectives semblent suggérer que les collectivités territoriales se retrouveront face à un besoin de financement au sens des critères de Maastricht. M. Jean-Pierre BALLIGAND : D'autant que les taux d'intérêt sont très bas. M. Alain GUENGANT : En effet. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Les collectivités sont d'autant plus portées à sauter sur l'occasion. M. Alain GUENGANT : La stagnation de l'épargne est à n'en pas douter un élément lourd. M. Pascal TERRASSE : Il y également un « effet de cloche » à prendre en compte. M. le Président : Plusieurs rapports montrent que les collectivités territoriales s'endettent à nouveau depuis 2003. M. Alain GUENGANT : En effet. Cela dit, ce phénomène n'a rien d'une explosion : nous en sommes toujours à environ 12 ou 13 milliards d'euros d'emprunts. M. le Président : Mes chers collègues, je vous remercie de vos questions et vous, M. Alain Guengant, de la précision de vos réponses. Les informations que vous nous avez apportées nous aideront dans la poursuite de nos travaux. Audition de M. Dominique HOORENS, (Les supports graphiques présentés par M. HOORENS à l'appui de son intervention sont reproduits en page 183 du tome III du présent rapport) Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président M. Dominique Hoorens est introduit. M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui M. Dominique Hoorens, directeur des études et de la documentation de Dexia Crédit Local. À ce titre, il dispose d'un poste d'observation privilégié sur l'évolution et les perspectives de la fiscalité locale. La note de conjoncture de Dexia est pour tous les intéressés une mine d'informations. Pour 2005, elle fait notamment entrevoir « un rebond de la pression fiscale locale » ; nous attendons de M. Dominique Hoorens qu'il nous explique pourquoi. J'en profite par avance pour le remercier de ses contributions régulières à l'information des élus locaux, contributions que, personnellement, j'apprécie beaucoup. M. le Président rappelle à M. Dominique Hoorens que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. À l'invitation du Président, celui-ci prête serment. M. Dominique HOORENS : Merci, M. le Président, pour ces mots d'accueil sympathiques. Je dirige, au sein de Dexia Crédit Local, un service d'études tourné uniquement vers les collectivités territoriales, y compris à l'échelon européen, ce qui peut apporter des références utiles. Nous publions deux fois par an une note de conjoncture ; la dernière, celle de février 2005, a eu un peu plus de retentissement que d'habitude dans la presse. Nous y faisons effectivement des projections sur la fiscalité locale pour 2005 - il s'agit de prévisions, toutes les collectivités n'ayant pas encore voté leurs taux, mais j'y reviendrai lors des questions. Dans l'immédiat, je vais décrire l'évolution à long terme de la fiscalité locale et en tirer quelques enseignements. Avant de parler de la fiscalité locale en général, il convient de préciser que les situations sont très diverses d'une collectivité à l'autre, en ce qui concerne tant le niveau de pression fiscale que son évolution. (Graphique 1) De quoi dépend la pression fiscale ? Premièrement, chaque collectivité est sujette à des contraintes spécifiques sur ses ressources, en fonction du niveau des dotations et des bases fiscales. Deuxièmement, chaque collectivité locale a une stratégie financière propre, avec deux arbitrages classiques : entre fiscalité et tarifs d'abord, c'est-à-dire entre le contribuable et l'usager de services publics, entre autofinancement et emprunt ensuite, à savoir dans une perspective pluriannuelle entre fiscalité d'aujourd'hui et fiscalité de demain. Troisièmement, l'étendue et la qualité des services rendus à la population ont évidemment un impact sur les charges et par conséquent sur la fiscalité. Ce troisième facteur, contrairement aux deux premiers, est difficilement quantifiable. Les élus en sont seuls maîtres, à travers leur pouvoir d'apporter les réponses aux besoins de la population, et les données d'ensemble ne permettent pas de rendre compte de la diversité des choix des 36 700 communes, des 18 000 groupements, 100 départements et 26 régions, soit plus de 50 000 acteurs. Or, les situations sont très diverses et cette diversité est difficile à illustrer. C'est sans doute un défaut de notre système de suivi, nous n'avons pas d'informations comparatives chiffrées sur le niveau des services rendus, leur étendue et leur qualité. Je tenais à prendre au préalable cette précaution, qui sous-tend la suite de ma présentation, car je vais maintenant m'attacher à des évolutions globales. (Graphique 2) Quels sont les principaux impôts locaux ? La taxe professionnelle, acquittée par les entreprises, qui a rapporté 23,6 milliards d'euros en 2004 ; la taxe sur le foncier bâti, payée par les propriétaires ; la taxe d'habitation, payée par les habitants ; les droits de mutation, qui sont des droits d'enregistrement ; la taxe intérieure sur les produits pétroliers, instituée en 2004 au profit des départements en compensation de la gestion du RMI ; le versement transport, assis sur les salaires et destiné à financer les systèmes de transport collectif ; la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; les cartes grises ; la taxe sur l'électricité, qui figure sur les factures d'électricité ; la taxe sur le foncier non bâti, qui ne rapporte que 900 millions d'euros. Beaucoup de ces impôts sont partagés, c'est-à-dire qu'ils bénéficient à plusieurs niveaux de collectivités, parfois aux quatre : région, département, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et commune. Et vous noterez que la fiscalité locale ne se résume pas aux « quatre vieilles » ; en particulier, deux autres impôts, le versement transport et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, connaissent une forte croissance ces dernières années. M. Michel PIRON : Et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ? Ne fait-elle pas partie de cet ensemble ? M. Dominique HOORENS : Les redevances ne sont pas considérées comme des impôts ; la distinction n'est pas de nature économique, mais purement juridique. (Graphique 3) On entend très souvent dire que les prélèvements obligatoires augmentent. Or qu'obtient-on en rapportant au PIB la somme des prélèvements levés par l'État et par les administrations publiques locales (APUL) ? Le résultat a légèrement baissé entre 1982 et 2003, puisqu'il est passé de 22,5 % à 20,7 % : le mouvement n'est certes pas énorme mais il n'y a pas eu de dérapage global, c'est un fait, alors que la part propre aux APUL est passée, en vingt ans, de 3,5 % à 5,1 %. Autre constat, il existe une très forte porosité entre les prélèvements de l'État et ceux des collectivités territoriales - tout comme entre les prélèvements sociaux et ceux de l'État, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En effet, les flux financiers entre l'État et les collectivités territoriales évoluent d'année en année. D'autre part, dans le cadre de la décentralisation, l'État leur transfère des ressources nouvelles - celles-ci, depuis quelques années, accusent cependant une très légère baisse, certains impôts locaux ayant été recentralisés. Enfin, on ne parle pas du produit des impôts tels que votés par les collectivités en raison des nombreux mécanismes de prise en charge par l'État. M. Jean-Pierre GORGES : Et les chiffres pour 2005 ? M. Dominique HOORENS : Pour les connaître précisément, il faudra attendre que les comptables nationaux disposent des éléments nécessaires. Nous pourrons, si vous le voulez, en parler ensuite. Le pendant des prélèvements obligatoires, ce sont les dépenses. Rapportées au PIB, celles de l'État enregistrent une légère inflexion à la baisse, tandis que celles des collectivités territoriales suivent un mouvement inverse, qui fut très notable au début de la première vague de décentralisation, puis s'est stabilisé et semble actuellement connaître un regain avec le début de la deuxième vague, pour atteindre 10,2 % du PIB en 2003. M. Michel PIRON : Puisque vous nous parlez là de valeurs relatives, il serait intéressant que vous compariez avec l'évolution du PIB en valeur. M. Dominique HOORENS : Toutes les données présentées sur ce graphique sont calculées par référence au PIB, ce qui signifie donc bien, s'il y a stabilité relative, qu'elles augmentent de manière réelle, d'environ 4 % par an en moyenne. (Graphique 5) Parmi les dépenses évolutives, le poste principal est celui des dépenses de personnel des collectivités territoriales, qui ont davantage augmenté que leurs autres dépenses. Elles devraient représenter 42 milliards d'euros en 2005 et participent à la tonicité de l'ensemble des dépenses, supérieure à la croissance du PIB. (Graphique 7) Comment ont évolué les dépenses de chacune des catégories de collectivités territoriales depuis une dizaine d'années ? Celles des EPCI à fiscalité propre, de création récente, progressent à un rythme très soutenu mais pèsent encore peu : environ 16 milliards d'euros en 2003, hors reversements. La dynamique des dépenses régionales, départementales et communales est bien plus faible mais porte sur des masses beaucoup plus importantes. L'évolution récente dans les régions tient au transfert progressif de la formation professionnelle et des TER. Dans les départements, elle résulte de la création de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prise en charge des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Mais le fait le plus significatif des dix dernières années est bien la montée en puissance des dépenses des groupements de communes à fiscalité propre. M. Jean-Pierre GORGES : D'autant que, dans le même temps, celles des communes n'ont pas été réduites. M. Dominique HOORENS : Oui, mais la croissance de la somme des dépenses des communes et des EPCI est équivalente à celle du PIB. M. Jean-Pierre GORGES : J'en conclus qu'il n'y a pas eu d'économies d'échelle. M. Dominique HOORENS : Entre 1982 et 1992, le développement le plus important concernait les dépenses des régions. M. René DOSIÈRE : Mais les budgets des régions sont équivalents aujourd'hui à ceux des EPCI. M. Dominique HOORENS : Tout à fait. (Graphique 8) Comment les « quatre vieilles » ont-elles évolué depuis 1982 ? L'impôt le plus tonique est la taxe sur le foncier bâti, puisque son produit a été multiplié par presque sept en vingt ans - évolution d'autant plus sensible qu'aucun mécanisme de dégrèvement n'existe. La taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont plus que triplé. La taxe sur le foncier non bâti, moins importante, est stable, compte tenu de la suppression des fractions départementales et régionales. Pour le contribuable, notamment en 2005, l'augmentation de chaque fraction (communale, départementale, régionale) entraîne donc des conséquences différentes selon son poids relatif. La taxe d'habitation profite aux communes et groupements à hauteur de 69 % et aux départements à hauteur de 31 % : l'augmentation de la fiscalité des régions ne touche plus aujourd'hui la taxe d'habitation car la part régionale de cette taxe a été supprimée. La taxe sur le foncier bâti va aux régions pour 7 %, aux départements pour 28 % et aux communes et groupements pour 65 %. Enfin, 8 % du produit de la taxe professionnelle est levé par les régions, 29 % par les départements et 63 % par les communes et groupements. Les dynamiques s'appliquent donc à des masses financières d'importance notablement différente. M. Jean-Jacques DESCAMPS : Les régions font-elles davantage porter les hausses d'impôt sur la taxe foncière ou sur la taxe professionnelle ? M. Dominique HOORENS : Je suis gêné pour répondre sur 2005, car toutes les régions n'ont pas encore adopté définitivement leurs taux. Nous prévoyons cependant qu'un certain nombre d'entre elles useront de la faculté dont elles disposent désormais d'augmenter davantage le taux de la taxe professionnelle que celui des taxes sur les ménages. Il faut dire que l'effet de levier est plus fort en raison des règles de liaison des taux : en augmentant un peu sa taxe foncière, la collectivité dispose alors de plus de marge de manœuvre pour faire varier sa taxe professionnelle. En schématisant, on constate donc que, depuis vingt ans, les dépenses des collectivités territoriales ont augmenté davantage que la croissance économique, tandis que les dotations de l'État augmentaient plus que l'inflation, mais moins que la croissance économique. Le décalage entre l'évolution des dépenses et des ressources a été compensé par la progression naturelle des bases, mais aussi par la hausse des taux. C'est un constat un peu mécanique. Les règles fiscales - bases et taux - étant sans cesse modifiées, il est compliqué de caractériser l'évolution de la pression fiscale par niveau de collectivité territoriale et, pour obtenir des tendances faisant abstraction des réformes, nous devons retraiter l'information disponible pour avoir une approche économiquement équilibrée. (Graphique 9) La fiscalité des communes et des groupements évolue en moyenne entre 0 % et 4 %. Elle est rythmée par des cycles électoraux assez marqués : on constate ainsi que les alourdissements de pression fiscale sont concentrés en début de mandat municipal. (Graphique 10) Pour les départements, les statistiques ne permettent pas d'isoler un lien aussi fort avec le cycle électoral, les renouvellements ayant lieu de manière fractionnée. Les augmentations sont assez significatives, celles de 2002 et 2003 étant imputables à l'apparition de nouvelles charges, relatives aux SDIS ou à l'APA. En 2005, le taux de croissance de la pression fiscale des départements devrait encore avoisiner 4 %. (Graphique 11) Les régions ne votent leurs taux que depuis 1989. Elles les ont fait augmenter en moyenne dans des proportions assez significatives - plus de 20 % la première année. Un rebond a été constaté juste après l'année du premier renouvellement, en 1993, et, pour 2005, nous prévoyons encore une augmentation moyenne de 20 %. Mais le dernier mandat constituait un contre-exemple : la fiscalité a été relativement étale entre 1997 et 2004. M. Jean-Pierre GORGES : C'est toute la différence entre la gauche et la droite... M. le Rapporteur : Je ne pense pas qu'il soit possible de tirer une loi d'une aussi petite série. M. Dominique HOORENS : Il faudrait élaborer une carte retraçant l'évolution de la fiscalité des régions en fonction de leur couleur politique, mais je ne suis pas sûr que cela fasse apparaître des résultats très tranchés. Cela n'a pas été fait, me semble-t-il. (Graphique 13) La taxe d'habitation suit un processus que je qualifie de « nationalisation progressive », qui procède de deux mécanismes, surtout palpables depuis une dizaine d'années. Premièrement, l'État supprime des bases en instaurant des exonérations et en versant des compensations aux collectivités. Deuxièmement, il se substitue au contribuable local en plafonnant la taxe d'habitation en fonction du revenu et en accordant des dégrèvements. Ainsi, quand les dotations manquent de tonicité, outre que les collectivités accroissent leur fiscalité, l'État doit injecter indirectement de l'argent dans le circuit par le biais des dégrèvements, ce qui réduit la part des contribuables dans le produit voté de la taxe d'habitation. Je fais un constat similaire pour la taxe professionnelle : les cotisations des entreprises se sont stabilisées, surtout grâce aux compensations versées par l'État depuis la suppression, en 1998, de la fraction masse salariale et, dans une moindre mesure, aux dégrèvements. Par ailleurs, une partie de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises n'alimente pas les budgets des collectivités territoriales mais celui de l'État, au travers des cotisations minimales notamment : une part de la fiscalité locale est donc payée par l'impôt national, tandis qu'inversement une partie de l'impôt local alimente les caisses de l'État, ce qui contribue à l'illisibilité du système. (Graphique 14) La taxe foncière est celle des taxes directes locales qui a augmenté le plus et elle n'est pas prise en charge par l'État mais par les seuls contribuables détenant du patrimoine bâti - notamment les ménages et les offices HLM -, à quelques petites exceptions près. Ayant tiré ces quelques constats d'une chronique de vingt ans de fiscalité, je rappelle que le rapport d'information du sénateur Yves Fréville constitue une mine d'informations sur la nationalisation - ou centralisation - de la taxe d'habitation et ses impacts. Le rapport de la « commission Fouquet » sur la taxe professionnelle est tout aussi intéressant pour décortiquer ces processus assez complexes. Pour conclure, le handicap principal de notre système fiscal est sa faible lisibilité. La plupart des contribuables, à la lecture de leur feuille d'impôt, éprouvent un sentiment diffus : le service rendu, l'impact des votes du conseil municipal, sont souvent masqués par l'action des autres niveaux de collectivité ou par les dispositifs d'État ; le niveau de fiscalité, dans leur esprit, ne traduit plus la politique réellement mise en œuvre par les élus. Ce phénomène est d'autant plus marqué que les dotations évoluent constamment, ce qui peut entraîner une variation de la pression fiscale. Compte tenu de cette difficulté à lire les responsabilités, notre système mériterait de gagner un petit peu en transparence. La péréquation joue plus ou moins bien son rôle. En effet, nos impôts locaux, très divers, sont de vieux impôts, particulièrement la taxe d'habitation et la taxe foncière. Les valeurs locatives sont aujourd'hui déconnectées de la réalité économique. Quand l'exercice de revalorisation des bases a été testé, il me semble que la hausse moyenne atteignait 70 %, avec des écarts extrêmes (entre deux fois plus et - 40 %). Or ces bases extrêmement anciennes servent aussi indirectement à calibrer les dotations d'État qui participent à la péréquation. Celle-ci s'en trouve donc faussée. M. Jean-Pierre GORGES : Cela ne pose un problème que lorsque des disparités existent au sein d'une commune, mais pas d'une commune à l'autre, si c'est faux partout, ce n'est pas grave... M. Dominique HOORENS : Le problème se pose aussi d'une commune à l'autre car la péréquation ne s'applique pas de façon homogène : dans les collectivités hébergeant 80 % de logement social sur leur territoire, les nouvelles valeurs locatives s'établiraient à un niveau inférieur de 30 %. D'une commune à l'autre, l'impact n'est pas homogène. Les écarts sont très significatifs. Quoique notre système fiscal prête le flanc à des critiques, la gestion des collectivités territoriales est globalement correcte et, d'un point de vue macroéconomique, celles-ci se portent plutôt bien. Vaille que vaille, un service plus que convenable est rendu pratiquement partout à la population et l'investissement local reste assez dynamique. Il ne faut donc pas jeter le bébé avec l'eau du bain : si notre système fiscal présente nombre de limites et d'injustices, s'il appelle certes une rénovation, il a néanmoins permis pendant vingt ans d'alimenter les caisses des collectivités, même si les mécanismes sont parfois farfelus. En somme, le résultat final n'est pas si mauvais. M. le Rapporteur : Lorsque vous avez évoqué la porosité entre les administrations publiques locales et l'État, vous avez décrit des flux réciproques. Mais la porosité n'est-elle pas aussi liée aux choix politiques des différents échelons ? Quand l'État fait des économies, les collectivités territoriales ne sont-elles pas tentées de dépenser plus ? Dans votre méthodologie, communes et groupements de communes sont systématiquement amalgamés. Or il est essentiel, pour nos travaux, que les deux ensembles soient distingués. Vous avez évoqué un léger sursaut des dépenses des collectivités territoriales avec la deuxième vague de décentralisation. À quel élément précurseur pensez-vous ? Vous avez dit ne pas établir de carte liant l'évolution de la fiscalité et la couleur politique des collectivités territoriales. Il ne serait pourtant inintéressant, ni pour la science, ni pour votre business de disposer de cet outil. S'il est vrai que ce travail n'a pas été effectué, pourquoi tant de pudeur ? Vous dites qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, que notre système fiscal permet, somme toute, d'investir. Les précédents intervenants ont bien affirmé qu'il fallait prendre en compte, dans l'arbitrage entre endettement et fiscalité, le fait que l'endettement d'aujourd'hui est la fiscalité de demain mais également les recettes de demain, à condition que les investissements soient judicieux. Qu'en pensez-vous ? Pour l'exercice 2005, nous connaissons déjà certains chiffres, soit que des votes aient déjà eu lieu, soit que des informations publiques aient été communiquées. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Compte tenu des secteurs d'intervention de Dexia, vous disposez sans doute d'éclairages utiles sur la fiscalité locale dans le reste de l'Europe - pour autant qu'il soit possible de comparer les systèmes étrangers avec le nôtre -, à propos du lien avec les cycles électoraux, de l'arbitrage entre endettement et fiscalité, et des causes d'évolution des taux, de la demande locale et du service rendu. M. Dominique HOORENS : Pourquoi ai-je employé le mot « porosité » ? Pour deux raisons. Les sommes prélevées sur les contribuables sont imputées par les comptables nationaux soit aux collectivités territoriales, soit à l'État, et la première source de porosité est liée au fait que la frontière entre les prélèvements obligatoires des collectivités territoriales et ceux de l'État, telle que fixée par la comptabilité nationale, ne correspond pas complètement à celle que l'on imagine. Ainsi, les frais de dégrèvement, qui ne vont pas aux collectivités territoriales, figurent dans les prélèvements pour les APUL. Le deuxième type de porosité intervient plutôt dans le temps : au cours des vingt dernières années, certains impôts nationaux sont devenus locaux, comme la vignette ou les droits de mutation, et, ces derniers temps, le mouvement s'est inversé, avec la suppression de la taxe d'habitation perçue par les régions. Pour parler abruptement, les transferts de compétences sont-ils bien ou mal compensés ? Le problème est infernal. Il est un transfert dont le résultat n'est guère contesté par les Français : celui des lycées et des collèges, lesquels sont aujourd'hui dans un bien meilleur état qu'il y a vingt ans. L'État compense en versant aux collectivités territoriales l'équivalent de ce que lui coûtaient ces équipements, partant du principe qu'il envisageait de ne pas investir davantage. Si celles-ci décident de faire davantage, elles doivent payer car il serait intellectuellement compliqué - et même déresponsabilisant - de faire rembourser l'État. Mais il faudrait que les contribuables soient conscients de l'effort accompli par leur collectivité territoriale et de la mobilisation de ses élus. Or, personne n'est actuellement capable de faire le lien entre une réalisation et son coût : si l'État réduit ses impôts mais que les prélèvements locaux augmentent, personne ne fait le rapport avec le transfert de compétence, ni individuellement, ni globalement. Dans certains pays, les collectivités territoriales perçoivent des impôts additionnels à ceux de l'État, notamment sur l'impôt sur le revenu, ce qui simplifie les transferts et clarifie la feuille d'impôt. En France, on constate le mouvement de décentralisation et de glissement de la fiscalité au niveau macroéconomique, mais pas individuellement : le contribuable ne peut pas le rattacher à la conduite de la politique de telle ou telle collectivité. L'intégration entre communes et groupements étant de plus en plus forte, avec un développement, notamment, de la taxe professionnelle unique (TPU), il devient difficile d'isoler les deux. C'est techniquement possible, mais l'ensemble « communes plus groupements » est économiquement plus pertinent et permet de mesurer les évolutions sur des séries longues. La création des intercommunalités génère-t-elle plus de fiscalité ? Il serait simpliste de répondre : « oui » ou « non ». Si les communes se regroupent, c'est généralement pour créer des services nouveaux, particulièrement en milieu périurbain. M. le Rapporteur : Pour créer des services nouveaux ou pour mutualiser les coûts et accomplir des économies ? M. Dominique HOORENS : Pour les deux ; il faudrait examiner la qualité du service rendu et son coût dans les 50 000 cas d'espèce, avec sa traduction sur la feuille d'impôt. M. le Rapporteur : Une augmentation de dépenses peut certes avoir pour conséquence la création de services nouveaux, mais, en l'occurrence, la question à laquelle j'aimerais obtenir une réponse est double : les dépenses des collectivités territoriales ont-elles augmenté et l'augmentation est-elle justifiée par le financement de services nouveaux ? M. Dominique HOORENS : Isoler les groupements et les communes est délicat car cela reviendrait à imputer la totalité de la TPU aux groupements et à constater une réduction des impôts communaux, sans qu'aucune conséquence puisse être tirée de cette analyse. L'information existe certainement dans les travaux de la Direction générale des collectivités territoriales et de la Direction générale des impôts mais l'interprétation me semble périlleuse. La montée des dépenses des régions en 2003 est imputable au transfert progressif des compétences formation professionnelle et TER, alors que la deuxième vague de la décentralisation, en 2004, a commencé avec le RMI. Nous n'avons jamais croisé les données sur les augmentations fiscales et sur la couleur politique des collectivités. Ce n'est pas de la pudeur. M. le Rapporteur : Vous n'êtes guère curieux ! M. Dominique HOORENS : L'exercice pourrait être fait mais il n'est pas de notre ressort. Notre direction des études se contente d'examiner la situation financière conjoncturelle des collectivités territoriales. Notre direction des engagements procède à une analyse des risques en vérifiant la faculté pour une collectivité territoriale de faire face à sa dette, sans considération aucune de sa couleur politique. Le choix stratégique entre fiscalité immédiate, par le biais de l'autofinancement, ou étalée dans le temps, par le biais de la dette, joue effectivement sur le niveau de pression fiscale. Nous ne disposons pas du recul historique nécessaire pour la totalité des pays européens mais nous avons commencé à effectuer des coupes comparatives sur des périodes assez courtes. Certains dispositifs étrangers montrent leurs limites, comme la taxe professionnelle allemande, assise sur le résultat des entreprises : les ressources des collectivités territoriales varient énormément suivant la croissance économique, ce qui s'avère compliqué à gérer pour les collectivités. Un autre type de prélèvements me paraît au contraire assez intéressant : celui des impôts additionnels à l'impôt sur le revenu, courants en Europe du Nord, et très profitables à la péréquation. En France, la péréquation tend à rapprocher la richesse des collectivités sans prendre en compte celle de leurs habitants, ce système profitant aux contribuables riches des collectivités pauvres à travers leurs bases et pénalisant les pauvres des collectivités riches ; l'idéal est de combiner les deux types de péréquation. M. le Rapporteur : Indépendamment de la structure de l'impôt, y a-t-il une tendance à augmenter les taux à l'étranger ? M. Dominique HOORENS : Bien sûr. L'agrégat des prélèvements obligatoires locaux augmente dans les autres pays, mais je ne dispose pas ici de données plus fines au niveau européen. Elles pourront vous être communiquées. (Graphique 14) M. le Rapporteur : Il serait utile que vous nous fournissiez ultérieurement des données sur l'évolution des taux dans l'ensemble européen. Lorsque les ministres des finances successifs viennent devant notre assemblée rendre compte des programmes triennaux d'évolution des finances publiques, on observe une baisse de la fiscalité d'État, une approche aussi performante que possible des prélèvements sociaux, mais une fatalité de l'évolution haussière de la fiscalité locale, sur laquelle le Gouvernement a relativement peu de prise. Nos voisins sont-ils aussi confrontés à ce problème ? M. Dominique HOORENS : Les instruments de comparaison existants sont pilotés par Eurostat, à partir des éléments fournis par les comptabilités nationales. Mais la difficulté est de trouver des concepts similaires. Le concept français de prélèvements obligatoires, par exemple, recouvre des agrégats très divers, y compris de la fiscalité qui n'entre pas dans les caisses des collectivités. La comparaison des évolutions des grandes masses, en revanche, est d'ores et déjà possible, et je communiquerai à votre commission d'enquête des éléments à ce propos. M. René DOSIÈRE : La remarque du Rapporteur sur le business paraît assimiler Dexia à une sorte de bureau d'études ayant pour but de prêter de l'argent aux collectivités territoriales. M. le Rapporteur : Pour moi, business est un mot positif ! M. René DOSIÈRE : Or on constate que celles-ci, au cours des dernières années, ont davantage financé leurs investissements par la fiscalité que par l'emprunt. Doit-on en conclure que les conseils de Dexia aux collectivités n'ont guère été performants ? Peut-on estimer la contribution des collectivités territoriales à la croissance globale, par le canal de leurs investissements, que met en valeur votre note de conjoncture en 2003 et 2004 ? Vous avez estimé que « notre système mériterait de gagner un petit peu en transparence ». Quel euphémisme ! Pour ma part, je considère qu'il devrait gagner beaucoup en transparence. La correspondance entre les rythmes électoraux et la courbe de l'évolution fiscale est évidente pour les communes, mais en quoi cela joue-t-il pour les intercommunalités, qui ne sont pas responsables devant l'électeur ? M. Michel PIRON : Pourriez-vous nous donner d'autres exemples de systèmes plus lisibles en Europe, susceptibles de nous inspirer ? Par ailleurs, j'aimerais en savoir un peu plus sur le poids, même global, de la fiscalité locale par rapport à l'ensemble des prélèvements chez nos voisins. Êtes-vous en mesure de distinguer entre l'évolution des prélèvements liée au fonctionnement et celle liée à l'investissement ? Cela nous serait très utile, car il y a là des choix politiques majeurs. Plutôt que de vous référer au « contribuable » ou à l'« usager », termes plus anciens, vous avez choisi d'axer votre raisonnement sur la « fiscalité ». Avez-vous opté pour ce vocabulaire parce qu'il est plus technique ou plus neutre ? Enfin, la dernière livraison de votre note de conjoncture porte le titre suivant : « 2004 : accroissement marqué de l'investissement local, 2005 : hausse accentuée de la pression fiscale locale ». Pourquoi n'employez-vous pas les mêmes termes pour 2004 et 2005 ? Entendez-vous par là que la hausse de l'investissement se solde l'année suivante par une pression fiscale plus forte ? M. Pascal TERRASSE : Les éléments qui nous ont été présentés démontrent bien que les évolutions de 2005 sont comparables à celles qui furent constatées en 1993,... M. le Rapporteur : Ah bon ? M. Pascal TERRASSE : ...ce qui constituera à coup sûr l'un des éléments clés de nos conclusions. Je vous rappelle que la fiscalité de certaines régions, en 1993, avait doublé - mais nous aurons l'occasion d'y revenir le moment venu. Vous nous avez dit qu'il existe une causalité entre baisse de la fiscalité de l'État et hausse de la fiscalité locale. M. le Rapporteur : Il a dit cela ? M. Richard MALLIÉ : Ce n'est pas exactement ce que j'ai entendu ! M. Pascal TERRASSE : Je constate seulement que, depuis vingt ans, la fiscalité de l'État diminue tandis que celle des collectivités territoriales augmente. Existe-t-il un rapport de causalité entre ces deux phénomènes ? Cette « porosité » - pour ma part, je parlerais plutôt de « fongibilité » - est-elle due aux transferts de compétences ? La plus forte augmentation concerne sans doute les dépenses de personnel. Au-delà des augmentations sanctuarisées - point d'indice et glissement vieillesse technicité (GVT) -, celles imputables aux transferts soulèvent des questions. Les cotisations sociales payées sur le salaire des fonctionnaires d'État sont fictives : en réalité, elles ne sont pas reversées à une caisse. Or, demain, quand seront transférés des emplois de la fonction publique d'État vers les collectivités territoriales, celles-ci devront s'acquitter des cotisations auprès de caisses identifiées, comme la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL). Avez-vous évalué le montant que cela leur coûtera a priori ? Avez-vous examiné de près la répartition des compensations par territoire géographique et, d'après vous, quelles collectivités bénéficient le plus des allégements de fiscalité locale, concernant la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ? On peut imaginer que l'État compense aussi beaucoup sur les territoires riches, comportant beaucoup d'entreprises. Enfin, puisque vous avez évoqué la « commission Fouquet », quelle appréciation porte l'économiste que vous êtes sur la réforme attendue de la taxe professionnelle ? M. Jean-Pierre GORGES : S'agissant de votre présentation liminaire, je ne vois pas comment la qualité des services rendus peut être distinguée de la stratégie financière. Je suis un peu surpris que vous vous satisfassiez du système fiscal actuel, car les contribuables ne s'y retrouvent pas, et je suis convaincu que les élus eux-mêmes ne comprennent rien, par exemple, aux règlements financiers entre l'agglomération et la commune, ou aux différences entre fiscalité propre et fiscalité globale d'une intercommunalité. Les experts que nous avons entendus jusqu'à présent, vous inclus, ont partagé le constat que le train de vie, tant des collectivités territoriales que de l'État dérapait par rapport au PIB, avec un certain fatalisme. La courbe de la fiscalité locale, qui semble donc croître inexorablement, a-t-elle été déformée par des évolutions structurelles, comme la décentralisation de 1982 ou la création des pays ? Par ailleurs, outre les années consécutives aux élections, des pics sont-ils imputables à des décisions politiques comme la création l'APA, les 35 heures ou les emplois-jeunes ? Enfin, pour régler définitivement les problèmes de fiscalité, je suis partisan, pour ma part, d'un recours beaucoup plus habituel à la fiscalité propre. Pour l'eau, les ordures ménagères ou les transports, cela ne pose pas de problème. Pourquoi ne pas en faire autant, par exemple, pour les SDIS et mettre ainsi de la clarté dans tous ces dispositifs ? M. Jean-Jacques DESCAMPS : Mon interprétation de vos tableaux est plutôt que la fiscalité et les dépenses locales, rapportées au PIB, sont restées stables, tandis que les dépenses de personnel ont fortement augmenté, car il faut bien rémunérer les quelque 500.000 fonctionnaires territoriaux supplémentaires recrutés depuis dix ans. M. René DOSIÈRE : Très exactement 30.000 par an. M. Jean-Jacques DESCAMPS : Mais alors, avec quoi paye-t-on ce personnel supplémentaire ? Je crains que l'investissement ne soit rogné au profit du fonctionnement. Il est donc essentiel que nous disposions de données distinguant l'évolution de l'investissement et celle du fonctionnement. Un banquier ne prête pas à n'importe qui ; il connaît ses bons et ses mauvais clients. Dressez-vous une carte de France des bons et des mauvais clients parmi les régions, les départements et les grandes villes ? M. Jean-Pierre SOISSON : Il ne nous la communiquera pas ! M. Jean-Jacques DESCAMPS : Je souhaiterais simplement savoir si cette carte existe. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Jusqu'à 2003 ou 2004, l'épargne nette et l'autofinancement des collectivités territoriales ont augmenté, ce qui signifie que le recours à l'emprunt s'est réduit. Mais l'on ne saurait exiger d'un banquier qui prête aux collectivités de faire un procès d'intention à celles qui investissent et qui empruntent ! M. Jean-Jacques DESCAMPS : Il serait tout de même intéressant d'établir des moyennes. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Ça, pourquoi pas ? L'accroissement de la population des néo-urbains, comme celui des « rurbains » il y a une dizaine d'années, suscite de nouvelles demandes de services, par exemple des crèches, auxquelles les communes rurales seraient dans l'incapacité de répondre, tandis que les intercommunalités en ont les moyens, et leur création, depuis 1992, n'est certainement pas une régression. Il serait toutefois intéressant de parvenir à découpler les ressources et les dépenses des communes de celles des intercommunalités. Mme Claude DARCIAUX : Je suis tout à fait d'accord. M. Jean-Pierre BALLIGAND : Loin de moi l'idée de faire le procès des EPCI, pour lesquels je me suis tant battu. Si le transfert de compétences comme le développement économique ou le traitement des ordures ménagères ne se sont pas traduits par une baisse de la fiscalité des communes, cela accrédite le fait que ce phénomène a permis d'accroître les marges de manœuvre des communes et ainsi de renforcer les services rendus à la population. C'est pourquoi il serait intéressant, si Dexia ou tout autre organisme a réalisé cette analyse, que nous en disposions. Que signifie le titre de votre dernière note de conjoncture ? Que les investissements d'une année sont payés sur l'exercice suivant ? Ou bien avez-vous décelé un nouveau basculement, les années 2003 et 2004 étant marquées par moins d'autofinancement et davantage de recours à l'emprunt ? M. Alain GEST : Serait-il possible de distinguer les évolutions de fiscalité non seulement entre groupements et communes, mais aussi entre petites et grandes communes ? J'ai le sentiment que, plus les communes sont petites, moins les regroupements sont source d'économies : ils ne les soulagent pas de leurs charges, car ils prennent des compétences qui pesaient surtout sur les grosses communes et, de surcroît, ils créent des services nouveaux. Ne pensez-vous pas que l'évolution de la fiscalité est liée, non seulement à la lisibilité de notre organisation fiscale par l'opinion publique, mais également à celle des politiques publiques ? Si les rythmes électoraux n'ont aucune incidence sur la fiscalité des départements et des régions, contrairement à celle des communes, n'est-ce pas tout simplement parce que les électeurs ignorent tout de l'action de ces deux niveaux de collectivités ? M. René DOSIÈRE : En 1993, la pression fiscale moyenne des régions avait beaucoup augmenté. M. Richard MALLIÉ : Il est très facile de déconnecter la fiscalité des communes et celle des EPCI, que ceux-ci aient adopté le régime de la TPU ou celui de la fiscalité additionnelle. M. le Président : Vous nous avez dit que la fiscalité locale, en vingt ans, est passée de 3,5 % à 5,1 % du PIB. Ce calcul tient-il compte des dégrèvements et des compensations ? D'aucuns recommandent aux collectivités territoriales de s'endetter davantage, mais jusqu'à quel point ? N'est-il pas souhaitable qu'elles conservent une marge d'autofinancement ? Existe-t-il une corrélation inverse entre les bases et les taux ? On a aussi constaté une augmentation de la fiscalité régionale en 1993 mais une quasi-stabilité en 1998. Avez-vous une explication ? Enfin, lorsque la tutelle d'un personnel donné est transférée de l'État à une collectivité locale, son coût augmente-t-il, et si oui, dans quelle proportion ? M. Dominique HOORENS : Je précise que, si Dexia prête de l'argent aux collectivités territoriales, c'est une banque un peu particulière. Nous avons une tradition de mission de service public et les analyses de mon service - qui compte une dizaine de personnes - sont élaborées en toute indépendance. C'est en tant qu'analyste que je m'exprime devant vous. M. le Rapporteur : Vous estimez donc avoir un haut niveau d'indépendance par rapport à la fonction de prêteur de Dexia ? M. Dominique HOORENS : Je vous l'assure à 100 %, et mon patron, Pierre Richard, y veille. M. Jean-Pierre SOISSON : Je le confirme ! M. Dominique HOORENS : Nous nous intéressons à nos clients et nous cherchons à comprendre leurs préoccupations. J'aimerais donc que vous ne m'écoutiez pas en pensant que je cherche ici à défendre les intérêts de la banque Dexia. La fiscalité étant une variable d'équilibre, le débat est infini car il peut être étendu à tout ce qui concerne la gestion des collectivités, le personnel, les normes,... On pourrait parler de l'ensemble du système financier local. Je conviens que la fiscalité locale manque beaucoup de transparence et non pas « un petit peu », avec l'interconnexion de quatre ou cinq niveaux de décision, plus l'État, qui modifie régulièrement les règles du jeu. Il est en effet bien difficile d'expliquer à un contribuable à quoi correspondent tous les chiffres de sa feuille d'impôt, par exemple quand un enfant devient majeur. Je suis un peu surpris que vous réclamiez une distinction entre la fiscalité des communes et celles des intercommunalités, car les élus locaux que nous rencontrons insistent systématiquement pour que les informations des deux entités soient agrégées. M. Jean-Pierre GORGES : Cela n'a rien de contradictoire avec notre demande ! M. Dominique HOORENS : Sans doute faut-il mener les deux analyses de front, sur une certaine durée. J'ajoute que les compétences les plus couramment transférées aux intercommunalités sont celles pour lesquelles les dépenses sont le plus évolutives, comme l'élimination des déchets. M. Jean-Pierre GORGES : La solution consiste à passer en fiscalité propre. M. Dominique HOORENS : Par ailleurs, en collaboration avec la Fédération des maires de villes moyennes, nous avons mené une étude à propos de l'impact de la création d'une intercommunalité sur la politique culturelle locale. Les cas particuliers sont multiples mais il en ressort les éléments suivants : si beaucoup de grands équipements sont transférés de la commune vers le groupement, au cours des années suivantes, la commune diversifie son offre culturelle en direction de sa population en faisant autre chose. M. Jean-Pierre GORGES : Pour quel coût supplémentaire ? M. Dominique HOORENS : Il y a 50 000 cas particuliers ! La mise en place d'un groupement se traduit parfois par une neutralité fiscale, mais il arrive aussi que des services nouveaux soient créés. M. le Rapporteur : Quel est le cas de figure le plus courant ? Peut-on opérer une classification et évaluer la proportion des cas de neutralité fiscale ? M. Dominique HOORENS : À partir des données fournies par la DGI, on peut toujours additionner le taux de la commune et celui du groupement mais cette information, très facilement disponible, ne vous donnera jamais d'indications sur ce qui est accompli sur le terrain. Les données budgétaires ne savent pas refléter l'amélioration du service rendu. Je me dois de le dire, même si, en ma qualité de statisticien, j'aime bien les chiffres ! Généralement, là où les bases sont faibles, les taux sont élevés. C'est effectivement une équation statistique, même si elle n'est pas vérifiée dans tous les cas. Nous n'avons pas réfléchi sur l'évolution du coût d'un emploi suite à sa prise en charge par une collectivité locale, car la grande masse des transferts de personnel est à venir. Pour nous fonder sur des éléments fiables, nous attendons que la commission consultative d'évaluation des charges ait achevé ses travaux. M. Jean-Pierre GORGES : Il n'y a aucune raison pour que la fiscalité augmente. M. Dominique HOORENS : Quant aux dégrèvements de taxe d'habitation, ils sont d'autant plus forts que le produit appelé par la collectivité est élevé et que les revenus des ménages sont faibles. Grossièrement, cela revient donc à une péréquation réalisée par l'État entre contribuables, pas entre collectivités, indépendamment du jugement de valeur sur les choix politiques des collectivités. J'ai été extrêmement surpris par un article paru aujourd'hui dans Les Échos : le maire de Fos-sur-Mer déclare qu'il va réduire de 99,57 % sa taxe d'habitation 2005, grâce à « une saine gestion qui a permis de dégager des excédents ainsi qu'à la hausse de la DGF, qui passe de 140 000 euros à 1,4 million d'euros ». M. Richard MALLIÉ : C'est lié à la DSU. M. Dominique HOORENS : Sans doute. Je souhaitais simplement, à travers cet exemple, vous expliquer que certains phénomènes fiscaux conjoncturels sont extraordinaires, étonnants, résultant de mécanismes divers où n'intervient en rien la décision des élus locaux et il y en a beaucoup d'autres de ce type. M. Michel PIRON : Je répète que nous souhaitons savoir si Dexia dispose de séries de données distinguant l'évolution du fonctionnement et celle de l'investissement. M. Dominique HOORENS : L'épargne brute des collectivités territoriales atteignant 32 milliards d'euros, puisqu'elles remboursent 13 milliards d'euros, il leur reste le solde pour alimenter l'investissement. On peut effectivement considérer que cet excédent correspond aux prélèvements obligatoires destinés à l'investissement. M. Michel PIRON : Pardonnez-moi d'insister, mais je souhaiterais que les courbes globales des vingt dernières années soient scindées en deux, afin que nous puissions distinguer l'évolution des masses affectées aux sections d'investissement et de fonctionnement. M. Dominique HOORENS : Je vous ferai passer un graphique distinguant les deux tendances. (Graphique 6) M. Jean-Pierre GORGES : Ma dernière remarque s'adresse au banquier. Les taux d'intérêt, depuis deux ou trois ans, sont très faibles, ce qui devrait favoriser le recours à l'emprunt et donc augmenter le nombre de vos clients. M. Dominique HOORENS : Je ne peux pas vous dire le contraire mais, quand nous tenons ce discours, on nous regarde en souriant. Il est en effet assez étonnant que les collectivités territoriales, dans ce contexte économique de baisse des taux, aient globalement réduit leur appel à l'endettement. M. le Président : Encouragez-vous les collectivités territoriales à financer la totalité de leur investissement par de l'endettement ? Sinon, quelle part d'autofinancement recommandez-vous ? L'augmentation de la fiscalité locale que vous nous avez décrite tient-elle uniquement compte des impôts acquittés en direct par les contribuables ou bien aussi des dégrèvements, votés par les collectivités mais payés par l'État ? M. Dominique HOORENS : Je répète que, comme le montre le graphique des dépenses rapportées au PIB (Graphique 3) et contrairement à ce qu'a dit M. Jean-Jacques Descamps, les dépenses des collectivités territoriales ont progressé : elles sont passées de 7 % à plus de 11 % du PIB, ce qui, en vingt ans, n'est pas rien. La fiscalité locale votée par les élus locaux intègre bien les montants qui sont pris en charge par l'État sous forme de dégrèvements ; elle ne prend pas en compte les frais de dégrèvement. M. le Président : C'est clair. Nous avons noté que vous nous ferez parvenir une comparaison entre évolution de l'investissement et du fonctionnement des collectivités territoriales. Je vous remercie. Audition de M. Philippe LAURENT, (Des documents fournis par M. LAURENT à l'appui de son intervention sont reproduits en page 193 du tome III du présent rapport) Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président MM. Philippe Laurent et Erwan Le Bot sont introduits. M. le Président : Mes chers collègues, est-il bien nécessaire que nous continuions à travailler puisqu'un texte présenté hier à la presse explique déjà tout ? Faut-il en déduire que le rapport de notre rapporteur est déjà prêt ? J'espère qu'il ne sera pas influencé par ce texte et tiendra seulement compte de ce que nous aurons entendu dans le cadre de la commission d'enquête. Restons sereins et poursuivons nos travaux ! M. le Rapporteur : Un document a effectivement été publié par une formation politique. Le modeste Rapporteur que je suis n'a aucunement participé à sa rédaction, mais il l'a reçu et pense être en droit de le lire. Pendant les travaux de notre Commission d'enquête, les formations politiques ont tout de même le droit d'éditer. Je mets votre remarque sur le compte de l'humour, M. le Président ! M. le Président : J'espère que vous ferez communication de ce texte à notre Commission d'enquête pour que chacun puisse en apprécier le contenu. M. Jean-Jacques DESCAMPS : Les présidents de région ne manqueront pas d'y répondre ! M. le Président : Je souhaite la bienvenue à M. Philippe Laurent, Président-directeur général du cabinet Philippe Laurent Consultants, accompagné de M. Erwan Le Bot. Je leur rappelle qu'il a été confié à notre Commission d'enquête le soin d'évaluer les causes de l'augmentation de la fiscalité en 2005 et les années précédentes ainsi que ses conséquences pour les ménages et les entreprises. Après leur exposé introductif, le rapporteur puis les autres membres de la Commission d'enquête leur poseront des questions, que je souhaite courtes et précises. M. le Président rappelle à MM. Philippe Laurent et Erwan Le Bot que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. À l'invitation du Président, ceux-ci prêtent serment. M. Philippe LAURENT : Tout d'abord je vous remercie de nous faire l'honneur de nous entendre sur ce sujet très important. Notre cabinet, créé en 1991, compte vingt-cinq collaborateurs et son capital est détenu en totalité par ses consultants. Nous travaillons presque exclusivement pour les collectivités territoriales que nous accompagnons dans leur gestion. Nous nous intéressons plus particulièrement aux aspects financiers et aux questions liées à l'intercommunalité. Je me permettrai de vous livrer un « ressenti » de praticien des finances locales, acquis au contact des élus et des fonctionnaires territoriaux, qui me donne aussi quelques idées sur l'évolution prévisible des années à venir. J'aurai d'ailleurs du mal à ne pas formuler des interprétations, tant les questions liées à la décentralisation me passionnent. La hausse des dépenses locales est-elle inévitable ? Si certaines de ses causes sont imputables à la volonté politique des exécutifs locaux, cette hausse est essentiellement due à des décisions exogènes, prises par l'État, que je ne juge pas, mais dont les effets sont immédiats et importants. Je donnerai deux exemples. Premièrement, les dépenses de personnel ont évolué du fait de l'application du statut de la fonction publique territoriale, et par là même, de la hausse des cotisations versées à la CNRACL, des créations de filières, des 35 heures ou encore de la mesure concernant le lundi de Pentecôte, qui coûte d'ailleurs 0,3 point d'impôt aux communes. L'éventuelle augmentation d'un point de l'indice de la fonction publique, dont la presse vient de se faire l'écho, se traduirait par un coût de l'ordre de 800 millions d'euros pour l'État et par 300 millions de dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales, dont 250 millions pour les seules communes, ce qui correspond pour ces dernières, à 20 millions d'euros près, à un point d'impôt. Certaines décisions prises par l'État ont donc d'importantes répercussions sur les budgets locaux. Chacun sait aussi que le développement des normes et des règlements génère des hausses de dépenses parfois considérables. Deuxièmement, les exigences des populations ne cessent de croître en raison notamment du développement de la culture urbaine, c'est-à-dire de la diffusion dans les zones périurbaines et rurales de la demande de services qui n'existaient traditionnellement qu'en milieu urbain. Les services publics locaux sont de plus en plus amenés à remplacer la solidarité de voisinage, qui, sur certains territoires, est en train de disparaître. La généralisation du travail des femmes a également un impact direct sur les services liés à la petite enfance et, même si des moyens sont mis en œuvre, de manière périodique ou sporadique, par l'État ou les caisses d'allocations familiales, ce sont les communes qui agissent au premier chef. L'allongement de la durée de la vie et l'amélioration du niveau de formation, qui rend les administrés plus à même de formuler des critiques et de faire pression sur les élus, sont également des facteurs de hausse de la dépense locale. On constate en outre un repli sur les centres-villes et un essor de la périurbanisation qui accroît la taille des communes ; or il est presque scientifiquement démontré que les dépenses par habitant augmentent en fonction de la taille des communes. Ce phénomène n'est pas dû au gaspillage de l'argent public mais à la demande croissance de services publics locaux. La pression sur les élus locaux se double de la volonté de ces derniers d'aller au devant des attentes des administrés et de fournir des services, notamment dans le domaine culturel, qui n'entrent pas strictement dans leur champ de compétences obligatoires. L'élu local refuse d'être un simple fonctionnaire : il souhaite fournir, par exemple, des places de crèche en nombre suffisant ou de nouvelles prestations culturelles, ces services étant dorénavant considérés comme des droits, en tout cas dans les grandes villes. Face à cette augmentation des dépenses - dont j'ignore si elle est inévitable -, se pose la question des recettes. J'appelle votre attention sur le fait que les collectivités territoriales sont tenues d'équilibrer leur budget, contrairement à l'État, mais que cette règle doit être nuancée : le budget peut être équilibré par de l'emprunt, mais l'emprunt ne peut financer que des dépenses l'investissement. En transposant les règles budgétaires s'appliquant aux collectivités territoriales, M. Jean Arthuis, lorsqu'il était ministre de l'Économie et des finances, avait excellemment démontré qu'il manquait 18 milliards d'euros à l'État pour équilibrer sa section de fonctionnement. Les textes obligent donc les collectivités territoriales à équilibrer la section de fonctionnement de leur budget. Cette obligation d'équilibre est parfaitement intégrée par les élus comme par leurs équipes. Depuis une vingtaine d'années, nous avons pu observer une amélioration remarquable de la qualité et de l'autorité de la fonction financière dans l'administration publique territoriale. Les agents territoriaux spécialisés dans les finances sont devenus très compétents, détiennent un savoir-faire et une expérience, pèsent auprès des élus mais ont une tendance peut-être excessive à la prudence. La fonction financière agit comme un frein. Ainsi, un accroissement des dépenses est généralement équilibré par une augmentation de la pression fiscale plutôt que par une diminution de la capacité d'épargne. La fonction financière semble guidée par un principe qui s'énoncerait de la façon suivante : « la bonne gestion, c'est une épargne importante ». Nous ne sommes pas certains qu'il s'agisse d'une vérité absolue. Les collectivités territoriales ont donc significativement amélioré leurs marges de manœuvre et leurs capacités d'autofinancement, la progression de ces dernières étant due, pour les deux tiers environ, à deux facteurs conjoncturels : la baisse des taux d'intérêt qui, à dette constante, à fait fortement diminuer les poids des frais financiers, et l'élargissement des bases fiscales, notamment de celles de la taxe professionnelle, y compris après la suppression de la part salaires, puisque les bases de taxe professionnelle, qui ont connu une progression égale à deux fois celle du PIB, ont aujourd'hui dépassé leur niveau d'avant la suppression progressive de la part salaires. À l'avenir, les collectivités territoriales ne bénéficieront probablement plus de ces deux facteurs positifs. L'élargissement des bases fiscales des impôts directs locaux semble avoir atteint ses limites. Il est peu probable que l'impôt qui se substituera à la taxe professionnelle soit aussi dynamique que l'a été cette dernière par le passé puisque c'est précisément cette augmentation de la taxe professionnelle qui a motivé sa réforme. Quant aux taux d'intérêt, ils ont sans doute atteint un niveau plancher. Si les taux de fiscalité directe ont connu une hausse limitée, celle des impôts dédiés comme la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et le versement transport a été beaucoup plus rapide. Il faut dire que les élus locaux éprouvent une réticence générale à voir leur capacité d'épargne se dégrader ; c'est à partir de cet indicateur qu'ils mesurent la santé financière de leur collectivité. En effet, en matière de gestion publique locale, l'emprunt a mauvaise presse depuis les affaires d'Angoulême et de Briançon mais aussi en raison du poids de la dette de l'État. Le recours à des ratios et des analyses fondés sur un unique critère peut toutefois induire certains biais dans la compréhension de la situation financière d'une collectivité territoriale : il conduit à une prudence excessive, qui risque de perdurer et de poser problème en entraînant une hausse continue de la fiscalité locale. Il n'en demeure pas moins que les marges de manœuvre des collectivités territoriales se resserrent incontestablement, comme le montrent le rapport de l'Observatoire des finances locales, qui a mis en lumière la stagnation puis la dégradation de la capacité d'épargne des collectivités territoriales ou encore le solde désormais négatif (- 0,1 % du PIB), pour la première fois depuis cinq ans, des finances locales au sens du traité de Maastricht. Les exercices de prospective auxquels les collectivités territoriales recourent de plus en plus souvent sont aussi par essence marqués par le principe de prudence. Il est en effet toujours plus aisé d'annoncer des mauvaises nouvelles et d'être pessimiste que d'émettre des prédictions positives, puisque l'on vous en tiendra rigueur si elles ne se produisent pas. Et cette crainte des experts - y compris nous-mêmes - d'être pris à partie induit parfois des sur-réactions. Les évolutions culturelles et réglementaires en matière de gestion ne sont pas toujours suffisamment maîtrisées, un effort important de remise en cause de la part de l'ensemble de l'administration de la collectivité étant requis, surtout dans les départements et les régions. Je citerai comme exemple le passage au système de gestion en autorisations de programme et crédits de paiement (AP-CP), rendu juridiquement possible par des textes assez récents, qui permet une programmation pluriannuelle. Celui-ci ne peut fonctionner correctement que si la collectivité territoriale dispose d'un outil informatique adapté, mais aussi d'une culture homogène et cohérente en matière de gestion des crédits en AP-CP. Or, nous constatons, notamment dans les départements, que, lorsque les agents proviennent d'administrations différentes - le social, l'équipement, etc. -, la gestion en AP-CP n'a pas la même signification pour tout le monde. Les collectivités sont conscientes du besoin en formation que cette évolution des modes de gestion budgétaire provoque, mais il n'en demeure pas moins qu'il induit des comportements de fuite en avant : nous pensons sincèrement qu'une partie - que l'on ne saurait quantifier - , des hausses fiscales constatées dans les régions et, dans une moindre mesure, dans les départements sont dues à ce phénomène et qu'elles étaient inévitables, car des montants importants d'AP ont été votés dans le passé, des programmes ont été engagés qu'il convient de couvrir par des crédits de paiement aujourd'hui. La prudence est accentuée par une certaine défiance vis-à-vis de l'État pour tout ce qui concerne les questions financières, due à de nombreuses raisons, désormais ancrées en profondeur, à tel point que cela devient un leitmotiv. En effet, plusieurs réformes annoncées, telles que la révision des valeurs locatives ou le projet de création d'une taxe départementale sur le revenu, n'ont pas abouti, et certains glosent même sur le fait que personne ne voulait vraiment de la réforme de la taxe professionnelle - nous verrons ce qu'il en sera puisque des textes sont en préparation à ce propos. Par ailleurs, les charges transférées n'ont pas été compensées intégralement et, parmi les élus locaux et les fonctionnaires territoriaux, rares sont ceux qui croient aux annonces gouvernementales récentes concernant l'APA ou le RMI. L'indexation des compensations fiscales se substituant aux bases exonérées est insuffisante par rapport à l'évolution desdites bases : la compensation la plus exemplaire à cet égard est sans doute la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) qui joue un rôle non négligeable notamment pour les grandes collectivités et qui accuse encore en 2005 une baisse de 10 % ; de même, nombre de collectivités ont le sentiment qu'elles ont été grugées dans l'opération concernant les bases de taxe professionnelle de France Télécom, qui a d'ailleurs fait l'objet d'amendements parlementaires. Les collectivités territoriales estiment de surcroît qu'elles doivent de plus en plus intervenir à la place de l'État sans aucune compensation. Le domaine de la police municipale, même si, de la part des communes, il y a eu une réelle volonté de mettre en place des polices municipales, constitue une illustration particulièrement évidente de ce dérapage. Il s'agit là clairement d'un véritable transfert de charges non compensé. L'État, pour sa part, traite les collectivités territoriales avec une certaine insouciance - le terme n'est pas politiquement correct, mais c'est le bon. Les normes, les règlements, la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle, la réforme des SDIS, la hausse du point d'indice, les annonces systématiques de mesures clés en juillet ou en janvier, tout cela dénote l'absence d'une volonté déterminée de dialogue, quelle que soit la majorité nationale. Au demeurant, ces réformes ont toujours été conduites avec la préoccupation de régler au premier chef les problèmes fiscaux des entreprises (alléger leur fiscalité, soutenir l'emploi, etc.) et certainement pas d'améliorer globalement le système des finances locales. Quant à la nouvelle garantie constitutionnelle, on peut considérer que sa portée n'est pas très claire, le jeu du chat et de la souris pour connaître la signification exacte des expressions « autonomie financière » et « autonomie fiscale » n'ayant abouti à rien. C'est un fait : le lien fiscal s'amenuise - la détérioration, enclenchée en 1980, s'est accélérée depuis 1999 - et je note qu'aucune des mesures responsables de ce phénomène n'a été prise à la demande des élus locaux. Les dégrèvements jouent un rôle dans ce déclin de la responsabilité des élus dans la mesure où ce ne sont plus les contribuables qui payent mais l'État, à ceci près que le mécanisme est amorti depuis que les dégrèvements se calculent à partir de taux figés et sont par conséquent plafonnés : toute variation du taux d'imposition votée par la collectivité est donc désormais ressentie par le contribuable. Du reste, dès lors que l'accord est unanime pour dénoncer l'injustice et le défaut de pertinence des bases locales, il n'est pas illogique que la fiscalité nationale introduise un minimum d'équité en rendant les cotisations plus conformes aux capacités contributives des redevables. Pour évaluer l'impact de la fiscalité locale sur le pouvoir d'achat des ménages, il convient de prendre en considération les effets redistributifs indirects de la fiscalité locale. Par exemple, en permettant le financement de places de crèche, la fiscalité locale entraîne une redistribution des ressources entre les contribuables âgés, propriétaires, redevables de l'impôt foncier et de la taxe d'habitation, et les familles d'âge actif. Afin que la fiscalité locale ait un impact positif et significatif sur le pouvoir d'achat, il faudrait consentir des baisses de taux extrêmement importantes, la masse considérée étant nettement plus faible que celle de la fiscalité nationale - impôt sur le revenu et surtout TVA. Or peu de collectivités peuvent se permettre une baisse d'une telle ampleur de leurs ressources fiscales. Du reste, il n'est pas incongru de préciser que la population est beaucoup plus sensible à une dégradation des services publics locaux qu'à une baisse des taux de fiscalité, qui ne peut être que symbolique. S'agissant des entreprises, si le taux de taxe professionnelle était un déterminant important de leur choix d'implantation, on peut estimer que de nombreuses entreprises s'installeraient en zone rurale, où il est généralement bas. M. le Rapporteur : L'explication n'est-elle pas un peu courte ? M. Philippe LAURENT : Le taux de taxe professionnelle n'est pas un déterminant essentiel de l'implantation des entreprises. C'est une réalité. Quoi qu'il en soit, la taxe professionnelle pose des problèmes d'équité et de répartition de sa charge entre secteurs économiques - nous verrons ce que donnera l'éventuelle réforme -, de lisibilité, de contrôle et d'affichage vis-à-vis des systèmes fiscaux étrangers, mais ces questions relèvent du pouvoir national. Quiconque est amené à analyser les transferts de compétence de l'acte II de la décentralisation observe que les services administratifs des collectivités territoriales anticipent une augmentation forte des dépenses. Ainsi, en début de semaine, un directeur financier de conseil général a rédigé une note tendant à démontrer que le coût du transfert de la compétence des personnes handicapées conduirait à un triplement du budget annuel. Pour certains départements, ce n'est pas impossible, et ce genre d'anticipation suscite des inquiétudes. Les départements et les régions craignent par ailleurs - mais ce n'est pas avéré - de devoir faire face à de nouveaux mouvements de restructuration de services publics, auquel cas, ils estiment qu'ils ne pourront faire autrement que d'accompagner les communes. De même, les maires et les présidents de communautés de communes que nous rencontrons nous disent craindre que les conseils généraux et régionaux ne puissent maintenir les systèmes d'aide existants, dont l'effet péréquateur n'est pas négligeable. En réalité, la hausse de la fiscalité locale, hormis le phénomène observé cette année pour les régions, reste modérée et progressive. De nombreuses collectivités ont choisi de ne pas augmenter leurs taux, ou dans une fourchette allant de 1 à 3 points. Nous considérons que ce processus est acceptable par la population si l'on met en parallèle les services publics ainsi financés : le coût politique des hausses fiscales, pour un élu local, n'est pas aussi élevé que ce que l'on peut penser. Cette hausse de la fiscalité devrait d'ailleurs être plus limitée jusqu'à la fin des mandats en cours, d'abord parce que les augmentations sont généralement concentrées en début de mandat du fait du cycle électoral (dont on ne saurait évaluer l'impact), mais aussi parce que la fiscalité des ménages, en certains endroits, a atteint ses limites, en raison notamment du poids croissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le sujet de préoccupation le plus important, à nos yeux, est le suivant : les communes et communautés de communes semi-rurales doivent faire l'objet d'une attention particulière car si elles maintiennent le niveau de leurs services publics, elles risquent de voir leurs charges s'alourdir considérablement, notamment du fait des dépenses de personnel, alors que leur assiette fiscale se réduit. Ce problème est plus important à nos yeux que l'évolution de la fiscalité régionale en 2005. Je souhaite à présent aborder la question de l'intercommunalité qui a fortement évolué, avec les lois de 1999 et de 2004. S'agissant de son impact sur la fiscalité, notre appréciation est nuancée : selon les cas, nous pensons qu'elle peut être facteur de hausse ou de baisse de la fiscalité, ou plutôt de limitation de la hausse. En effet, la mutualisation des services peut conduire à des économies d'échelle grâce à la mise en commun d'achats ou à la rationalisation. Mais on constate en réalité que le niveau de services offert dans la ville-centre et sa première couronne s'étend à un deuxième cercle géographique, conformément aux attentes de la population. Si ces services publics locaux avaient dû être fournis par chacune des communes membres, cela leur aurait coûté plus cher, mais, d'un autre côté, on peut aussi considérer qu'elles ne l'auraient pas fait ! Lorsque l'on s'intéresse à l'évolution de la fiscalité au sein des structures intercommunales, il convient de tenir compte de ce rapport entre la qualité du service rendu et son coût. De façon plus marginale, l'intercommunalité a aussi conduit à la création de structures administratives qui peuvent temporairement faire double emploi avec l'administration communale qui ne diminue pas ses propres structures à due concurrence des compétences transférées au groupement. Ce facteur a pu contribuer à la hausse de la fiscalité dans le cadre intercommunal. À l'avenir, les finances locales bénéficieront d'un facteur positif : le remplacement, d'ici à dix ans, de 500 000 agents territoriaux en fin de carrière par des jeunes, qui posera cependant un problème d'équilibre des caisses de retraite. Globalement, il est prévisible que l'effet de ciseaux entre recettes et dépenses, qui se manifeste à nouveau aujourd'hui (il était apparu il y a une dizaine d'années et s'était résorbé grâce à la progression des recettes), se poursuivra, et que cela ne pourra que se traduire par une progression, même limitée, de la fiscalité locale. Une autre question difficile se pose : quelle est la nature de l'impôt local ? S'agit-il d'une redevance, qui doit être tarifée en fonction des services offerts, ou bien d'un impôt de solidarité, à l'instar de l'impôt sur le revenu ? Je me permettrais maintenant de formuler quelques conseils. Les collectivités territoriales ont besoin de lisibilité et de stabilité, et l'État, à cet égard, doit évidemment se montrer irréprochable. Les systèmes de contrôle mis en place seront-ils suffisants ? Surtout, la réforme de la fiscalité locale, pour être efficace, doit être globale et non pas, comme aujourd'hui, conduite par petits bouts. Les impôts locaux doivent être stables, modernes, efficaces économiquement et acceptés et ils doivent évidemment avoir un sens politique. Nous pouvons tracer quelques pistes de travail. Il convient d'apporter une solution à un problème important : l'insuffisante indexation des compensations fiscales se substituant aux bases exonérées des impôts locaux, qui est l'un des facteurs explicatifs des hausses de la fiscalité locale. Les différences de produit global par habitant, d'une collectivité à l'autre, se réduisent : même si des écarts importants subsistent en matière de taxe professionnelle, les communes qui en perçoivent peu ont compensé cette faiblesse en renforçant leur fiscalité sur les ménages. Je remarque enfin que les collectivités les plus dépensières sont les plus riches, l'exemple des Hauts-de-Seine étant particulièrement pertinent à cet égard. M. le Rapporteur : À moins que les plus riches ne soient les plus dépensières ? M. Philippe LAURENT : Les deux remarques sont vraies, mais j'insiste sur le fait que certaines communes dépensières, comme Issy-les-Moulineaux, se sont incontestablement donné les moyens de faire face à leurs dépenses. Enfin, en m'excusant d'avoir été trop long, je dirais que la bonne gestion, notion au demeurant extrêmement subjective, n'est qu'un élément parmi d'autres du bilan des élus, et que cet élément est loin d'être déterminant. La comparaison entre le niveau d'évolution des taux et les scores atteints par les maires réélus en 1995 ne met en évidence aucune corrélation ; l'alchimie électorale est bien plus complexe. M. le Président : Merci pour cette intervention très complète. M. le Rapporteur : Cet exposé, quoique concret, n'était guère quantitatif, et je le regrette pour notre Commission d'enquête. Vous identifiez avec précision plusieurs catégories de facteurs de hausse de la fiscalité locale, d'ailleurs assez semblables à celles retenues par les autres spécialistes auditionnés. Pouvez-vous indiquer leur poids respectif et comparer l'importance des facteurs exogènes et endogènes ? Faute de chiffres, ou du moins d'ordres de grandeur, nous en restons aux impressions, certes intelligentes. Vous affirmez que la connaissance du système local par la population s'améliore en raison de l'évolution de l'habitat et de l'élévation du niveau culturel des citoyens. Pensez-vous seulement aux dépenses ou également aux impôts ? Le système de gestion en AP-CP, qui tend à se généraliser, a permis de tirer des traites sur l'avenir. Pouvez-vous donner des exemples de la façon dont joue ce facteur dans telle ou telle collectivité ? Des exemples concrets et précis permettraient de mieux comprendre les effets de ce type de changement. Comment perturbe-t-il le système local ? Que répondez-vous à vos clients pour les faire évoluer et les inciter à céder moins facilement à une prudence ou une défiance excessive ? Sur ce point, quelle est votre approche opérationnelle ? L'intervention croissante des collectivités à la place de l'État n'est pas tout à fait un sujet neuf : en matière d'enseignement supérieur et de recherche, par exemple, Universités 2000, comme son nom l'indique, ne date pas d'hier. Comment ce désengagement a-t-il évolué dans le passé ? Son montant financier s'est-il alourdi ou est-il constant ? Vous soulignez le lien entre la qualité du service et son coût. Pouvez-vous apporter davantage de précisions sur ce thème ? Vous indiquez que la fiscalité des ménages a atteint ses limites en certains endroits. Mais quelle est cette limite ? Intuitivement, je comprends le propos, mais j'attends davantage d'explication de la part de l'expert que vous êtes. Il pourrait être intéressant, en particulier pour répondre à mes questions, que vous transmettiez à notre Commission d'enquête des études de cas, évidemment rendues anonymes, afin de respecter la déontologie. La problématique que nous évoquons suit-elle une logique droite-gauche ? Le représentant de Dexia a prétendu ne jamais s'être posé la question, ce qui paraît curieux. Enfin, pouvez-vous comparer avec la situation constatée à l'étranger ? M. Philippe LAURENT : Je vous rappelle que nous nous bornons à vous livrer un « ressenti », pour la bonne et simple raison que nous n'avons pas les moyens d'effectuer l'analyse complète et chiffrée de l'ensemble des phénomènes que nous vous avons présentés et que nous risquerions, en allant trop vite, de nous tromper et de faire mentir les chiffres. Il est extrêmement compliqué, en particulier, de faire la part des choses entre les causes exogènes et endogènes, sauf peut-être sur des points très précis. Les dépenses de personnel, par exemple, augmentent certes de 4 à 5 % par an : cette évolution est le résultat de causes exogènes mais aussi de choix politiques. On peut bien évidemment faire le choix de diminuer le nombre de recrutements ou de ne pas remplacer les personnes parties à la retraite. Très franchement, je suis incapable de vous dire quelle est la part de chacune de ces deux catégories de causes. De même, les polices municipales ont été mises en place par les communes pour faire mieux respecter les arrêtés municipaux et ont donné lieu à des dérives financières, mais comment isoler la part des dépenses relevant de la volonté politique de développer ce service et celle résultant de la nécessité de pallier les insuffisances de la police nationale ? On peut chiffrer l'impact de certains facteurs particuliers. Je peux vous dire que le lundi de Pentecôte représente 0,3 point d'impôts et que le régime additionnel pour les primes de retraites qui est mis en place cette année représente entre 0,2 et 0,3 point d'impôts. Je sais donc calculer l'impact de telle ou telle mesure mais il est délicat, voire impossible, de l'imputer sur la catégorie des facteurs exogènes ou endogènes. La gestion en AP et CP, en revanche, est plus facile à cerner. Certains dossiers, après des années d'instruction, arrivent au stade de la réalisation et du paiement, ce qui nécessite des montants plus importants de crédits de paiement et partant un accroissement des recettes. Il y a probablement aujourd'hui une progression des crédits de paiement destinés à honorer des engagements qui ont été pris lorsque les programmes ont été mis en place. Universités 2000 n'est certes pas nouveau, mais le moment d'honorer les engagements arrive parfois cinq ou six ans après qu'ils aient été pris. Nous pourrons donc vous fournir une petite étude de cas précise concernant une collectivité anonymisée. Universités 2000, dès l'origine, constituait de fait un désengagement de l'État. Les collectivités avaient accepté cette contractualisation avec l'État, mais elle est objectivement un facteur d'augmentation de la dépense locale, sans lien avec la répartition théorique des compétences. En ce qui me concerne, je n'y suis absolument pas opposé car l'avenir est au développement de la contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales ainsi qu'entre collectivités. Cependant, force est de constater que ces partenariats financiers entre État et collectivités conduisent ces dernières à supporter des charges que l'État assumait jusqu'alors, plus ou moins bien, d'ailleurs. En tant que consultants, nous n'avons bien évidemment aucun pouvoir régalien ou de contrôle. Nous sommes là pour éclairer la décision de nos clients et les conseiller : nous ne leur disons pas si une politique est bonne ou mauvaise, mais nous évaluons ses conséquences et nous élaborons un discours qui leur permette d'assumer leur choix. L'une de causes de l'augmentation de la fiscalité est le fait que certains fonctionnaires territoriaux et élus locaux anticipent les difficultés de façon excessive, et ce phénomène ne peut être évalué qu'une fois le mal fait. Je ne suis pas un expert de la limite fiscale. Ce sont les élus qui perçoivent cette limite, et c'est à eux de la fixer. M. Erwan LE BOT : La limite résulte du cumul de cotisations exigées des propriétaires au profit de différentes strates de collectivités, sur la base de valeurs locatives critiquables, sans aucun dispositif de dégrèvement, cotisations auxquelles s'ajoute la TEOM, ce qui, pour certains ménages, commence à faire beaucoup. Sur l'état fiscal communiqué aux communes, du temps du franc, un encadré indiquait le nombre d'articles par tranche de cotisation. Progressivement, la tranche supérieure a concentré, dans certaines communes, 40 % ou 50 % des contribuables, alors qu'elle était a priori censée constituer une catégorie marginale - de mémoire, elle concernait les contribuables payant plus de 3 000 francs sans plafond. À partir de cet état, nous n'étions donc pas en mesure de savoir combien de contribuables, dans cette catégorie, payaient plus de 7 000 ou plus de 8 000 francs. Cela prouve qu'il y a eu dérive de la fiscalité locale car on n'avait pas prévu de se retrouver dans une telle situation, avec 40 % ou 50 % des contribuables dans la strate supérieure, sans plafond. Avec l'euro, la présentation de l'état fiscal a été modifiée. La strate supérieure est passée à l'équivalent de 7 500 francs et plus, et, dans certaines communes, elle concentre encore 20 % à 25 % des articles : les contribuables appartenant à cette strate peuvent payer jusqu'à la valeur de 10 000 ou 12 000 francs de taxe d'habitation, autant, voire plus, de foncier bâti, auxquels il faut ajouter la TEOM. Il me semble que cela commence à peser lourd, même dans des communes où les contribuables ont des moyens. M. Philippe LAURENT : Une catégorie de contribuables qui commence à trouver la situation très dure est celle des jeunes retraités propriétaires, qui subissent une baisse de revenu importante mais conservent leur logement, voient la pression fiscale progresser en permanence et ont en outre perdu le bénéfice de l'abattement sur la taxe d'habitation. En proportion de leur revenu, ces contribuables ont subi une croissance très forte de la fiscalité locale. Nous observons ce phénomène, même si nous ne savons pas en calculer l'ampleur. Enfin, chez nos clients, je ne constate aucune différence d'approche technique des dossiers et d'élaboration du discours en fonction de leur appartenance politique. M. Erwan LE BOT : En revanche, le rôle de l'acteur public local et la façon dont il intervient diffèrent d'une région à l'autre. En Bretagne, les collectivités territoriales ont un rôle d'animation du territoire plus marqué que dans les régions où les acteurs privés sont plus actifs. C'est pourquoi l'intercommunalité y était pratiquement accomplie avant même l'adoption de la « loi Chevènement », avec des groupements de communes très intégrés, quelle que soit l'étiquette politique des élus. Il s'agit de différences locales, et non d'une problématique droite-gauche. M. Philippe LAURENT : D'ailleurs, suivant les métropoles, travailler à la mairie est perçu soit comme une qualité soit comme un défaut ; tout dépend de la culture territoriale. M. le Rapporteur : Pour préciser ma demande d'une comparaison avec le reste de l'Europe, la demande constante d'amélioration de la qualité du service justifiant l'augmentation de l'impôt est-elle aussi constatée à l'étranger ? M. Philippe LAURENT : Ma réponse ne sera pas scientifique car nous ne travaillons pas avec l'étranger. Je pense seulement que la notion de prélèvements obligatoires est extrêmement dangereuse : ceux-ci sont certes plus élevés en France qu'à l'étranger, mais les prestations correspondantes sont également meilleures dans notre pays que dans la plupart des autres, où il faut les acheter auprès du secteur privé, à un tarif plus cher. On peut toujours porter un jugement politique mais, pour que la comparaison ait du sens, économiquement, il faudrait comparer le niveau des prélèvements obligatoires à service rendu équivalent. Deuxièmement, les collectivités territoriales françaises sont dans un état financier bien meilleur que celles des autres pays, particulièrement les communes allemandes, la situation catastrophique de nombre d'entre elles les conduisant à supprimer ou à réduire des services à la population. Il faut dire que le système de décision est extrêmement lourd et que le système favorise outrageusement les Länder par rapport aux communes et à l'État fédéral. M. Jean-Yves LE DRIAN : Contrairement à ce que répètent les médias, le transfert de compétences aux régions commence dès aujourd'hui, avec les instituts de formation en soins infirmiers, les écoles de formation des travailleurs sociaux et le patrimoine, ce qui constitue un paquet non négligeable. Je suggère à notre Commission d'examiner les modalités de ce transfert. Des dépenses réelles liées à la décentralisation nous sont donc transférées dès 2005. La région que je préside a reçu une dotation de TIPP de 18 millions d'euros. J'ignore comment cette enveloppe a été calculée et aucune information sur le nombre de travailleurs sociaux transférés ne m'a été communiquée. Je vais cependant devoir payer, et je constate - car, ma demande d'audit contradictoire ayant été rejetée, il a bien fallu que je fasse ma propre estimation - que, pour un euro versé, il m'en faudrait en réalité 1,20. Dois-je me tourner vers le Conseil constitutionnel ? La Commission d'enquête serait bien avisée d'examiner ce qui se passe dès à présent et de consulter le ministère des solidarités, de la santé et de la famille pour lui demander comment il compte procéder. La TIPP est-elle une ressource propre ? S'agit-il d'un impôt dynamique ? Et le sujet m'inspire une réflexion philosophique : est-il normal que les régions, chargées des transferts ferroviaires, dont le but est d'éviter que les gens prennent leur voiture, soient rémunérées par la TIPP et aient par conséquent intérêt à son augmentation ? M. Jean-Jacques DESCAMPS : Si vous ne pouvez pas nous donner de chiffres, j'estime cependant, comme M. le rapporteur, qu'il serait peut-être utile que vous complétiez votre analyse ultérieurement. Quelle est l'ampleur de la dérive fiscale qui a directement résulté de la création des communautés de communes ou d'agglomération, en dehors de ses causes endogènes ? Ce chiffre, dont la Commission a besoin, doit tenir compte de la DGF perçue par les groupements. Je souhaite donc connaître le coût de l'intercommunalité. Par ailleurs, vous semblez estimer que le système est condamné à susciter des augmentations régulières. La gestion des communes et communautés de communes ne permet-elle pas potentiellement de réaliser des économies ? Vous avez affirmé que la hausse des taux était le dernier recours de l'élu. Celle que nous constatons actuellement dans les régions, mais aussi dans certains départements et communes, correspond-elle à cette logique de « dernier recours » ou constitue-t-elle une technique budgétaire destinée à se constituer un « matelas » pour l'avenir ? Agir de la sorte est-il justifié ? La situation des collectivités territoriales françaises est-elle meilleure que celle de leurs voisines, à service rendu et à taux de ressources équivalents ? J'ai tendance à penser, à la lumière des exemples des villes jumelles de Loches, situées en Allemagne et en Écosse, que la pression fiscale y est moins forte et que le service n'y est pas nécessairement moins bon. M. René DOSIÈRE : Quelle sera l'incidence concrète de l'augmentation de la fiscalité régionale sur l'ensemble de la fiscalité locale ? À quels montants correspondent les pourcentages faramineux cités ? Dans certaines de vos déclarations écrites, vous vous dites inquiet sur deux points : premièrement, les transferts de compétences qui doivent intervenir dans le cadre de l'acte II se traduiront par des transferts de charges, tout comme ceux de l'acte I, ce qui revient à dire que les nouvelles garanties constitutionnelles n'en sont pas ; deuxièmement, vous exprimez des inquiétudes concernant la suppression annoncée de la taxe professionnelle. Or, si la taxe professionnelle devait disparaître, la réforme constitutionnelle garantit son remplacement par un impôt et non par une dotation. Quel est alors le motif de vos inquiétudes ? Enfin, ma dernière question porte sur la péréquation, notamment entre départements. Une forme de péréquation entre départements riches et pauvres était assurée par le biais de la DGF, dispositif dit « horizontal » supprimé dans le cadre de la réforme de cette dotation. Le nouveau système mis en place en 2005 a-t-il un effet péréquateur entre les Hauts-de-Seine - département le plus riche de France - et l'Ardèche, par exemple ? M. Jean-Pierre GORGES : M. Philippe Laurent est le quatrième consultant à venir nous dire à peu près la même chose, c'est-à-dire, des informations connues de tous ; pour ma part, j'aurais préféré des informations quantifiées. Il existe suffisamment de sources pour déterminer ce qui est endogène et exogène : je l'ai fait pour ma propre commune sur une vingtaine d'années. Des facteurs endogènes comme les investissements et les évolutions de la masse salariale peuvent par exemple être extraits. M. le Rapporteur : Peut-être M. Philippe Laurent pourrait-il nous communiquer quelques exemples anonymisés de communes et d'intercommunalités ? M. Philippe LAURENT : Cela représenterait un gros travail ! M. Jean-Pierre GORGES : Je signale au passage qu'une commune peut financer du fonctionnement par de l'emprunt, via les travaux en régie. J'aurais aimé que soit mis en évidence le poids des décisions exogènes aux collectivités territoriales : la décentralisation de 1982, la création des régions ou des intercommunalités, mais aussi l'instauration des 35 heures, celle des emplois-jeunes ou encore la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle. J'ai pu quantifier pour ma propre commune l'incidence de l'insuffisante indexation de la compensation de la suppression de la part salaires. Je suis surpris que quatre experts réputés nationalement tiennent le même discours et n'entrent pas dans ce niveau de détail. Leurs interventions sont toutefois intéressantes car ils observent tous que le phénomène de hausse de la fiscalité suit une courbe asymptotique inéluctable. Or, le même événement s'est déroulé le même jour à la même heure dans toutes les régions : tous les présidents ont annoncé en même temps les mêmes augmentations concernant les mêmes taxes. En valeur absolue, les masses financières ne sont certes pas importantes ; il faut donc relativiser l'événement. On devrait cependant pouvoir en expliquer très précisément les causes. Avez-vous un avis sur cet événement qui est tout de même le fait générateur de cette Commission d'enquête. D'après vous, pourquoi tous ces présidents de régions ont décidé de telles augmentations au même moment ? M. René DOSIÈRE : Je ne vous le fais pas dire ! M. Jean-Pierre GORGES : Il n'en demeure pas moins que notre Commission d'enquête attend d'obtenir une explication à ce phénomène : qu'est-ce qui a incité tous les présidents de région à faire évoluer leurs impôts exactement au même instant ? M. Jean-Yves LE DRIAN : Arrêtez de dire cela ! C'est totalement faux ! Dites-nous un peu de quel jour et de quelle heure il s'agit ? M. le Président : M. Jean-Yves Le Drian n'a pas la parole, mais je fais remarquer à M. Jean-Pierre Gorges que nous sommes chargés de vérifier les causes de l'évolution de l'ensemble de la fiscalité. Mme Claude DARCIAUX : Exactement ! M. le Président : Les régions ne sont pas les seules à avoir voté des hausses des taux. Des départements, que je ne citerai pas, ont également accru leur fiscalité de 10 % ou de 20 %. Il serait également intéressant que M. Philippe Laurent compare le produit que rapporte à une région et à un département une augmentation des taux de 10 %. M. Jean-Pierre GORGES : Ce n'était pas ma question ! M. le Rapporteur : Notre collègue est seul maître de sa question ! M. Jean-Pierre GORGES : Elle était très précise ! M. le Président : Je suppose que notre intervenant en a pris note, M. Jean-Pierre Gorges. Mais, incidemment, j'en ai posé une autre et j'espère qu'il y répondra. Mme Claude DARCIAUX : Je souhaiterais évoquer le problème de la hausse de la fiscalité dans les communes périphériques situées autour d'une ville-centre au sein d'un groupement à TPU. La ville-centre héberge des zones d'activité dégageant un produit fiscal élevé lié à la taxe professionnelle. La « loi Chevènement » oblige à fixer le montant de l'attribution de compensation à la date de création des communautés d'agglomération. L'allocation de compensation de TP étant figée, leur seule solution pour éviter un effet de ciseaux entre les dépenses et les recettes est d'accroître significativement la fiscalité locale, dans le seul but de couvrir les dépenses de fonctionnement, et elles voient réduire leur autofinancement comme peau de chagrin, ce qui met en péril leur avenir et leur autonomie même. M. Michel PIRON : Mes interrogations font peut-être davantage appel à du ressenti qu'à des chiffres, mais je vais les poser. En dépit de la théorie des économies d'échelle, plus la taille d'une collectivité locale est grande, plus ses dépenses sont élevées. N'est-ce pas, comme disait Hegel, parce que des mutations quantitatives génèrent des mutations qualitatives ? Plus simplement, ne sommes-nous pas en présence d'effets de seuil ? En effet, ce qui est inaccessible pour une petite collectivité devient envisageable pour celle dont les dimensions sont plus importantes et même souhaitable à une échelle encore plus grande. J'admets que la limite à l'acceptabilité de la pression fiscale est difficilement quantifiable - elle n'est d'ailleurs pas uniforme - mais les jeunes retraités ne sont pas les seuls à souffrir. J'aimerais quand même connaître votre sentiment sur le degré d'acceptabilité de la pression fiscale en France. Qu'en pensez-vous ? L'intercommunalité a, dans certains cas, permis de freiner la croissance des dépenses communales, la mutualisation permettant de ne pas multiplier les dépenses redondantes. Mais, en matière de gestion des ressources humaines, intercommunalité n'est pas supracommunalité. N'est-il pas possible d'améliorer la complémentarité des ressources humaines ? Les très petites communes, de moins de 500 habitants, notamment, éprouvent un problème de compétence, le secrétaire de mairie généraliste peinant à accomplir sa tâche. S'agissant des dotations, vous avez beaucoup insisté sur les comportements d'anticipation par rapport aux décisions de l'État. Les dotations versées par l'État sont pourtant considérables - 20 milliards d'euros -, l'évolution de la DGF dépassant celle de l'inflation en moyenne. Compte tenu des marges de manœuvre de l'État, à votre avis, comment évolueront ces dotations et quelles conséquences les collectivités territoriales devront-elles en tirer ? M. Alain GEST : Je remercie tout d'abord M. Philippe Laurent d'avoir évoqué le seuil d'acceptabilité de la fiscalité locale, car certains prétendent qu'une augmentation ne portant que sur les impôts fonciers est acceptable dans la mesure où seuls les propriétaires en subissent les conséquences - cette appréciation me semble d'ailleurs quelque peu approximative. La plupart des régions françaises augmentent considérablement leurs impôts mais cela représente après tout très peu en valeur absolue. De telles augmentations entrent-elle cependant en ligne de compte dans la détermination du seuil d'acceptabilité ? La semaine dernière, on nous a dit que le poids de la fiscalité nationale et locale était globalement stabilisé. Pouvez-vous nous le confirmer ? Ayant été rapporteur de la loi relative aux libertés et responsabilités locales en deuxième lecture, je sais parfaitement qu'il n'a jamais été dit qu'aucun transfert n'interviendrait en 2005. Le problème consiste à évaluer le coût que ces transferts représenteront pour les budgets régionaux. Or, on connaît très bien, par exemple, le coût d'une école de travailleurs sociaux. De fait, les transferts de 2005 représentent un pourcentage assez faible, pour ne pas dire infinitésimal, des budgets régionaux. Je complète par conséquent la question de notre Président : les causes de l'augmentation de la fiscalité départementale sont-elles assimilables à celles de l'augmentation de la fiscalité régionale ? M. Pierre BOURGUIGNON : Les transferts portent essentiellement sur des dépenses de fonctionnement, ce qui va profondément modifier le rapport entre fonctionnement et investissement, particulièrement dans les régions, mais aussi très rapidement, dans les communes. Je souhaiterais obtenir quelques éclaircissements sur la réforme de la taxe professionnelle, le dynamisme relatif des ressources transférées et l'état des équipements transférés. Les collectivités seront-elles en mesure d'entretenir les équipements transférés et de maintenir le niveau de service ? M. le Président : Avant de vous donner la parole, j'ai, moi aussi, quelques questions. L'emploi d'un TOS coûtera-t-il plus cher à une collectivité locale qu'à l'État ? Les crédits actuellement inscrits au budget de l'État seront-ils suffisants dans le nouveau système ? Sinon, à combien s'élève la différence ? Il serait utile que nous connaissions la réponse dès aujourd'hui et non l'année prochaine. La TIPP, sujet d'actualité, est-elle une ressource évolutive pour les départements qui ne pourront pas ne moduler le taux ? Et qu'en sera-t-il de la TSCA, la taxe spéciale sur les conventions d'assurances ? Comment sera-t-elle répartie ? Pour ma part, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'article de la loi qui traite de ce point. Le produit de la taxe professionnelle n'est pas équitablement réparti. La répartition sera-t-elle plus juste dans le cadre de la réforme inspirée par le « rapport Fouquet » ? Ne risque-t-elle pas au contraire d'entraîner des transferts géographiques néfastes ? Comment faire pour les éviter ? S'agissant de la péréquation, est-il normal qu'une commune - un cas nous a été signalé - soit en mesure de supprimer la taxe d'habitation grâce à une augmentation notable d'une dotation de l'État, en l'occurrence la DSU ? Quant à la péréquation départementale, elle ne prend pas en compte l'essentiel, à savoir les dépenses liées à la solidarité, qui représentent 60 % des dépenses de fonctionnement, mais uniquement la longueur de la voirie, pas même rapportée au nombre d'habitants. Que pensez-vous d'un tel critère de péréquation ? Et, selon vous, quel serait le système de péréquation idéal ? D'aucuns ont dénoncé les emplois-jeunes, mais nous pourrions aussi évoquer les CES et les CEC. On propose maintenant des « contrats d'avenir » aux collectivités territoriales et aux associations. Faut-il les encourager à signer des contrats d'avenir ou les en dissuader ? Merci de répondre le plus rapidement et le plus précisément possible à l'ensemble des orateurs. M. Philippe LAURENT : Je constate que ces questions sont classiques, ce qui tend à prouver que le diagnostic est assez largement partagé. Le régime de la fiscalité additionnelle a été, de mon point de vue, un facteur d'alourdissement de la fiscalité car, en général, les groupements ont fixé des taux de fiscalité additionnelle de départ très faibles et la plupart des communes ont jugé inutile de réduire leurs taux en proportion - je signale au passage qu'augmentation de la dépense ne signifie pas toujours simultanément hausse de la fiscalité. L'augmentation de la dépense se traduit in fine par un accroissement de la fiscalité mais pas simultanément : il peut y avoir retard ou anticipation. Pour la TPU, c'est différent : l'on ne touche pas aux taxes sur les ménages et l'on transfère la taxe professionnelle, dont le taux ne peut être modifié si celui des taxes sur les ménages n'a pas été préalablement corrigé. Le système, du point de vue de la maîtrise de la fiscalité, est donc très cohérent et probablement meilleur que la fiscalité additionnelle. La DGF intercommunale, bonifiée pour les communautés en TPU, a permis d'injecter de l'huile dans les rouages en finançant la constitution de l'ossature des équipes administratives des nouvelles intercommunalités et les premières réalisations. Ce système a plutôt bien fonctionné au départ. Aujourd'hui, un problème se pose. Des villes-centres, dont le produit de la taxe professionnelle représentait jusqu'à 70 % des ressources fiscales, souffrent du système du gel de l'attribution de compensation. La situation serait d'ailleurs bien pire avec un taux d'inflation de 5 % ou 6 %. Dans une telle situation, il aurait déjà fallu modifier le système. Par conséquent, on peut considérer que le système a aujourd'hui atteint sa limite. Ici ou là, dans certaines communautés d'agglomération, certaines villes-centres ont même été contraintes, en dernier recours, d'augmenter le taux des impôt sur les ménages, et un nombre croissant de communautés d'agglomérations ou de communautés urbaines ont adopté un système fiscal mixte parce qu'elles ne s'en sortaient plus. Certaines villes résidentielles, qui bénéficiaient de très faibles ressources de taxe professionnelle, à force de transférer des charges au groupement, ne reçoivent même plus une attribution de compensation gelée. Certaines villes ont donc une attribution de compensation négative, ce qui constitue une situation extraordinaire. Le système de la TPU, quoique inconfortable dans certaines configurations, est néanmoins facteur de modération fiscale et surtout conduit la communauté et les communes membres à s'entendre sur une stratégie financière coordonnée ; mais cela mériterait une analyse approfondie. Il existe des pistes d'économies potentielles, déjà à l'œuvre dans beaucoup de collectivités. Les politiques d'achat se professionnalisent, avec des groupements de commandes, produisant des effets sur 20 % à 25 % des dépenses, ce qui ouvre des perspectives d'économies dans les villes moyennes. Sur la partie personnel, à service rendu constant, beaucoup de collectivités ont accompli des progrès en matière de gestion dans les services comptables et administratifs. Cependant, les trois quarts du personnel pour les communes œuvrent sur le terrain, sur la voirie, dans les crèches, les écoles, les centres de loisir, etc. Il est difficile de réaliser des économies dans ce domaine car il s'agit de dépenses normées qui augmentent mécaniquement avec la croissance de la demande. L'effet des 35 heures, de ce point de vue, n'a pas été positif, car la RTT ne peut avoir aucun effet sur la productivité des services normés tels que les crèches, qui ont des heures d'ouverture précises et requièrent, en vertu de normes précises, un certain nombre de personnes par tranche de berceaux. La spécificité des communes, par rapport aux régions et aux départements, est qu'elles fournissent des services quotidiens, et je crains, je le répète, que ce ne soient elles qui subissent l'effet de ciseaux le plus puissant. La fiscalité locale doit-elle être fondée sur un système de redevance ou d'impôt de solidarité ? Je suis convaincu que nous nous acheminons de plus en plus vers un « impôt redevance ». Les tarifs des prestations, dans certains domaines, auront dès lors tendance à augmenter ; ce sera la seule solution pour limiter la pression fiscale. À cet égard, je pense par exemple que les tarifs des cantines scolaires seraient beaucoup plus élevés si leur augmentation n'était pas plafonnée. La hausse des taux constitue certes le dernier recours d'un élu mais les augmentations votées sont différentes d'une région à l'autre. En effet, les régions ne sont pas toutes dans la même situation financière, notamment au regard des engagements de crédits. Les augmentations votées recouvrent essentiellement trois aspects. D'abord, la couverture des engagements pris dans le passé. Cet aspect était prévisible, et j'imagine que l'on peut trouver, dans les services financiers des conseils régionaux, des études montrant que, quelle que soit le résultat des élections, la hausse de la fiscalité en 2005 était inévitable en raison de programmations antérieures au scrutin de 2004. M. Jean-Pierre GORGES : Passez plutôt au deuxième point... M. Philippe LAURENT : Ensuite, il est classique de procéder à des hausses en début de mandat. Ce phénomène est incontestable. M. René DOSIÈRE : M. Jean-Pierre Raffarin avait montré l'exemple ! M. Philippe LAURENT : Enfin, la tendance à la précaution, à la prudence, voire à la « bonne gestion », si j'ose dire, a joué. De nombreux directeurs financiers ont fait le raisonnement suivant : dès lors qu'une ressource risque d'être figée au niveau atteint en 2005, il est logique que les régions se pressent d'accroître leur taux afin de maximiser leur produit et partant, le montant de leur compensation ultérieure. C'est pour contrer ce type de comportement que la plupart des réformes fiscales telles que la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle ont été annoncées en juillet, une fois l'ensemble des budgets locaux votés. M. Erwan LE BOT : J'ajoute que la réforme de la taxe professionnelle revêt une importance particulière car c'est le seul impôt dont la base évolue, sauf accident, au même rythme que les charges de personnel. La pire année, à cet égard, a été l'année 1995, puisqu'en 1993, le PIB a connu une évolution négative : la taxe professionnelle n'a alors augmenté que de 2,6 %. Depuis, la progression a repris, passant à 7 % dans bien des communes ou groupements. M. Jean-Pierre GORGES : Mais cela reste une recette aléatoire. M. le Président : Ne posez pas de questions supplémentaires ; un autre consultant attend d'être auditionné. M. Jean-Jacques DESCAMPS : Il serait intéressant que nous ayons connaissance de la courbe de la taxe professionnelle. M. Philippe LAURENT : On peut donc parler, pour certaines régions, d'un comportement de thésaurisation. S'il existe une limite à l'impôt local, c'est que, par un raisonnement biaisé, il est vécu comme un surplus, une taxation supplémentaire à tous les autres impôts, notamment l'impôt sur le revenu, alors qu'il est tout aussi légitime. Le problème, c'est que son efficacité et sa justice sont beaucoup plus contestées que celles de l'impôt sur le revenu. Alors que la somme globale des prélèvements de l'État et des collectivités territoriales se stabilise, il est d'ailleurs paradoxal que les impôts les plus injustes soient alourdis pour alléger les plus justes. M. Pascal TERRASSE : Jolie remarque ! M. Philippe LAURENT : Je ne vois pas comment nous pourrons échapper à une taxation locale sur le revenu, en contrepartie, évidemment, d'une baisse de l'impôt national. M. le Rapporteur : Vous avez pourtant estimé, il y a un instant, que nous nous rapprochions d'un « impôt redevance ». M. Philippe LAURENT : L'un n'empêche pas l'autre : un « impôt redevance » communal pourrait coexister avec une taxation locale sur le revenu destinée à financer les missions du département et de la région, par exemple ; c'est à vous, mesdames, messieurs les parlementaires, d'imaginer les modalités d'une réforme. S'agissant de l'évolution de la DGF, l'État va vraisemblablement poursuivre sa politique consistant à accroître l'enveloppe globale des dotations. Cependant, selon moi, il convient de nuancer cette affirmation. En effet, cette année, le pacte de stabilité n'a été respecté qu'en apparence puisqu'une partie de l'augmentation de la DGF a été consacrée à la politique de la ville, qui aurait dû être financée par l'État puisqu'il s'agit incontestablement d'une politique d'État, les collectivités bénéficiaires étant déterminées par ce dernier- et cela va encore durer quatre ans. Les montants de DSU perçus par certaines collectivités ont certes nettement augmenté. J'ignore si elles peuvent se permettre de supprimer la taxe d'habitation mais il est certain, et cela me semble assez illogique, que près d'un tiers des communes situées en ZUS, et qui bénéficient à ce titre d'une majoration de leur DSU, présentent un potentiel fiscal supérieur à la moyenne, notamment grâce à leurs bases de taxe professionnelle. S'agissant du transfert des TOS, il est vrai que pour un même personnel touchant le même salaire, les collectivités territoriales devront acquitter des cotisations sociales supérieures à ce que paie l'État, mais seulement en apparence car il faut tenir compte de la retraite. Se pose donc la question du transfert des droits à retraite des personnels, question qui n'a pas encore été tranchée. M. le Rapporteur : Les retraités ne sont pas transférés ? M. Philippe LAURENT : Heureusement ! M. Pascal TERRASSE : Pour la CNRACL, ce serait une charge énorme ! M. Erwan LE BOT : La TIPP, d'après le Conseil constitutionnel, est bien une ressource propre, mais le microcosme estime que cela y ressemble tout de même assez peu... L'assiette, jusqu'à présent, ne s'est pas montrée dynamique, mais elle le sera un tout petit peu plus pour les régions, dont l'assiette est composée du gazole et du supercarburant sans plomb. Il s'agit d'assiettes plus dynamiques, même si elles le demeurent tout de même faiblement. En revanche, pour les départements, la TIPP transférée est calculée aussi sur une quote-part du tarif du supercarburant avec dispositif anti-récession de « soupape » ; or le supercarburant a vu son assiette s'effondrer. S'agissant de la taxe professionnelle, dans le schéma de réforme qui semble devoir s'imposer, les bases du nouvel impôt ne seront pas plus équitablement réparties qu'aujourd'hui, mais elles ne le seront pas moins. Il y aura des transferts, mais ces transferts ne se feront pas au profit d'une meilleure corrélation entre charges et recettes. Ce n'est cependant pas l'aspect le plus critiquable du « rapport Fouquet ». M. le Président : Et quel est donc son aspect le plus critiquable ? M. Erwan LE BOT : Plus fondamentalement, l'aspect le plus critiquable est le choix d'une assiette assez peu physique et peu lisible pour les élus : lorsqu'une usine embauche, sa valeur ajoutée, qui est ventilée sur 45 sites au niveau national peut baisser, alors que les charges générées pour les collectivités par l'entreprise augmentent. Sur le plan macroéconomique, la valeur ajoutée des entreprises évolue comme le PIB mais, territoire par territoire, entreprise par entreprise, elle est très variable. On passe d'un impôt de stock à un impôt de flux, flux qui reste très dynamique sur le plan macroéconomique mais qui sera volatil à l'échelle de la collectivité, et donc facteur d'incertitude pour cette dernière. M. le Rapporteur : Vous avez identifié trois causes expliquant les augmentations votées par les régions mais vous avez oublié les dépenses nouvelles. M. Philippe LAURENT : Elles jouent évidemment un rôle, mais uniquement pour ce qui concerne des dépenses de prestations immédiates comme les emplois tremplins. En revanche, les dépenses d'investissement, compte tenu du délai nécessaire entre leur décision, leur mise en œuvre et la dépense, ont peu d'impact dans l'immédiat. Il peut certes y avoir un phénomène d'anticipation, de thésaurisation. Mais parmi les décisions importantes des conseils régionaux, seule la création des emplois tremplins a pu entraîner un accroissement de la dépense. Je ne vois pas quelle autre décision des conseils régionaux aurait pu se traduire dès 2005 par une dépense importante. J'ajoute que les régions sont les collectivités pour lesquelles une augmentation de fiscalité rapporte le moins, en valeur absolue, mais aussi en valeur relative, proportionnellement à leur budget : les deux taxes sur lesquelles la région Ile-de-France peut voter un taux ne représentent que 20 % du total de ses ressources. M. Erwan LE BOT : Nous avons déjà eu l'occasion de dénoncer cet effet d'affichage dans le cadre d'un rapport rédigé pour l'Association des maires de France en 2000 : les régions ont été les collectivités les plus touchées par le mouvement de substitution de dotations à de la fiscalité du fait de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, de la suppression de la part régionale des droits de mutation à titre onéreux et de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, à tel point qu'il leur aurait fallu multiplier par trois ou quatre le pourcentage d'augmentation de leurs taux pour arriver au même produit avant et après les réformes de 1999 et 2000. Les régions ont donc vu leur taux d'autonomie fiscale considérablement réduit. M. le Président : D'accord. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances est-elle une ressource évolutive ? M. Erwan LE BOT : Sur ce point, je n'ai aucun chiffre. M. le Président : Nous sommes vraiment dans le brouillard ! M. Philippe LAURENT : Quelqu'un, dans un ministère, doit bien connaître les chiffres. M. Erwan LE BOT : Une personne travaille en effet sur ce dossier qui est très compliqué. M. le Président : On a transféré aux départements une part de cette taxe ; il serait tout de même souhaitable que nous sachions comment elle va évoluer. M. Philippe LAURENT : On peut tout de même penser que l'augmentation régulière des primes ne devrait pas être négative. M. le Président : Messieurs, je vous remercie. Audition de M. Michel KLOPFER, (Des documents fournis par M. KLOPFER à l'appui de son intervention sont reproduits en page 217 du tome III du présent rapport) Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président M. Michel Klopfer est introduit. M. le Président : Mes chers collègues, j'accueille en votre nom M. Michel Klopfer, Président-directeur général du Cabinet Michel Klopfer, consultant en expertise financière locale. M. le Président rappelle à M. Michel Klopfer que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête lui ont été communiquées. À l'invitation du Président, celui-ci prête serment. M. Michel KLOPFER : Je commencerai mon intervention en donnant un éclairage historique, car, aujourd'hui encore, certaines décisions politiques trouvent leur source dans les difficultés d'analyse qui ont marqué les premiers temps de la décentralisation. Quelles sont les étapes les plus importantes de la décentralisation depuis la loi du 2 mars 1982 ? Les élus locaux, comme les fonctionnaires territoriaux et nationaux, ont très mal mesuré, au départ, la portée de la liberté budgétaire et de la fin du contrôle a priori. Les dix premières années de la décentralisation, c'était la « loi de la jungle », et les choses ont été mieux cadrées à partir de 1992-1995. La fonction financière était relativement peu présente et ne participait guère à la décision, tant chez les élus que les fonctionnaires. Il est tout à fait légitime qu'une collectivité s'endette, mais les lois de décentralisation ne permettaient pas de distinguer clairement entre l'emprunt et les autres recettes. Entre 1983 et 1985 ont eu lieu d'importants transferts de compétences et de recettes fiscales. En 1986, le marché financier a été ouvert aux collectivités territoriales, ce qui les a exposées au jeu de la concurrence bancaire. En 1990, une région et un département, Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Alpes-Maritimes, ont été notés pour la première fois AAA. L'année suivante, le risque de surendettement émergeait, les banques plaçant sous tutelle des communes fragiles, et l'analyse financière locale naissait. S'en est suivie une période où les impôts transférés, notamment aux départements comme les droits de mutation, ont progressé plus vite que les charges qu'ils étaient censés couvrir, ce qui leur a permis de se lancer dans des dépenses facultatives, devenues depuis politiquement incontournables. Il n'a été question d'effet de ciseaux que quelques années plus tard, à partir de 1992-1993, lorsque la situation s'est retournée, suscitant un resserrement légitime du contrôle de l'État avec la communication des comptes, la comptabilité des engagements ou les annexes consolidées. Le nouveau maire d'Angoulême, en 1989, a menacé de traîner les banques devant les tribunaux pour soutien abusif, ce à quoi le président de Crédit local de France, M. Pierre Richard, a répondu que les comptes de cette commune avaient longtemps été frauduleux, qu'il ne disposait pas des mêmes instruments que l'État pour examiner la comptabilité de ses clients et que, par conséquent, s'il était attaqué, il ne manquerait pas de se retourner contre l'État pour défaut de contrôle budgétaire. C'était évidemment du bluff mais cela a contribué à l'obtention de subventions d'équilibre et, dès l'année suivante, à un resserrement des règles du jeu par l'État. Entre 1992 et 1998, un « coup de barre » a donc été donné sur les budgets locaux : les collectivités ont découvert l'analyse financière et le ravin de la dette, ce qui a donné lieu à quelques excès en matière d'augmentation de l'impôt, dans les régions, les départements et les communes, avec, en plus, l'émergence de l'intercommunalité à fiscalité additionnelle. Le désendettement local s'est poursuivi pendant huit années consécutives, de 1996 à 2003, et on a pu en mesurer les effets en 1998, lorsque l'INSEE a présenté les chiffres de l'endettement du secteur public français en vue de la qualification pour l'euro selon les critères de Maastricht : le solde des comptes de l'État et des administrations sociales représentait moins 3,24 % du PIB tandis que les collectivités étaient à plus 0,22 %, ce qui mettait pratiquement la France dans les clous à 3 % du PIB de déficit public. En 2004, pour la première fois, la dette a recommencé à croître. En 1997 sont mis en place la M14 et de nouvelles obligations budgétaires. Entre 1998 et 2003, les leviers fiscaux se réduisent considérablement (vignette, droits de mutation, taxe d'habitation régionale et part salariale de la taxe professionnelle) et les nouvelles contraintes financières affectent profondément la prise de décision. La loi du 12 juillet 1999 sur l'intercommunalité a marqué une rupture et aurait pu déjà être qualifiée d'acte II de la décentralisation. Jusque-là, chaque collectivité levait ses impôts sans se préoccuper des autres, comme dans un millefeuille, sans tutelle d'une collectivité sur une autre. Avec l'intercommunalité à TPU, les collectivités sont entrées dans un système d'interdépendance financière permanente de structures conservant cependant leur autonomie juridique. Cela se manifeste par une très grande force d'inertie : le 15 mars, on peut encore réunir le conseil municipal pour décider de solliciter un peu plus le contribuable ou l'usager de services publics, alors que, dans une intercommunalité à taxe professionnelle unique, il faut s'y prendre plus tôt. Et l'intercommunalité joue aussi sur les investissements et les reversements de DGF aux communes : on constate également un nivellement à la hausse du service public, car chaque commune essaye de procurer à ses usagers le meilleur service de toutes les communes membres. L'analyse financière du secteur public local, contrairement à celle des entreprises, est trop récente pour constituer une technique mature. Et je m'étonne que le système reste franco-français, sans la moindre tendance à l'harmonisation européenne : comparer les chiffres disponibles de la dette par habitant de Paris et de Francfort ou de Barcelone n'a rigoureusement aucun sens, compte tenu des différences entre systèmes. Jusqu'en 1998, on constate que les ressources de la fiscalité directe locale ont progressé plus vite que les autres recettes de fonctionnement et surtout que l'inflation. Par la suite, les deux premières courbes se sont croisées en 2001 mais restent encore largement au-dessus de celle de l'inflation et du PIB. M. René DOSIÈRE : Votre courbe des recettes fiscales prend-elle en compte les dégrèvements et compensations ? M. Michel KLOPFER : Les compensations et dégrèvements figurent au contraire dans les autres recettes. La capacité de désendettement est un indicateur sensible, sachant que la zone rouge commence à quinze ans. Au début des années quatre-vingt-dix, un quart des villes de 20 000 à100 000 habitants étaient déjà proches du surendettement, même si elles l'ignoraient. Les départements et les régions ont toujours eu une situation financière globalement saine, hormis outre-mer, mais, à partir du début des années quatre-vingt-dix, c'est le « syndrome d'Angoulême » : elles se désendettent toutes, y compris celles pour lesquelles ce n'était pas urgent. Le millésime 2001 est le meilleur : vingt-deux départements sur cent présentaient une capacité de désendettement inférieure à un an, c'est-à-dire une épargne supérieure au solde de la dette. La situation s'est un peu retendue depuis mais nous restons dans des eaux très favorables, et heureusement, si l'on considère les chocs auxquels les collectivités sont actuellement confrontées. La taxe professionnelle (TP) a été l'impôt local le plus dynamique que les collectivités aient jamais connu et donc le plus coûteux pour l'industrie. En 1975, elle a été construite de façon à peser pour moitié sur les immobilisations et, pour l'autre moitié, sur les salaires - je ne parle là que du droit commun, pas des régimes particuliers. En 1982, la fraction imposable des salaires a été réduite de 20 % à 18 %, soit moins 10 points. À structure constante, la base aurait donc dû se situer à 53 % pour les immobilisations et 47 % pour les salaires. Or, en 1998, à la veille de l'adoption de la « loi Strauss-Kahn », la répartition avait évolué vers 66 %/34 % : ainsi, par un effet d'accumulation du stock de capital, l'impôt est devenu beaucoup plus dynamique que le produit intérieur brut. Toutefois, la cotisation réellement acquittée par les entreprises est allégée par diverses évasions fiscales mal contrôlées : les acquisitions d'immobilisations sont fractionnées en vue de les inscrire en charges et de les soustraire à la TP ; les biens totalement amortis sont sortis du bilan quand bien même ils continuent à être utilisés ; des opérations financières de groupe - apports, scissions, fusions, cessions d'établissements - visent à abaisser les bases de référence des immobilisations. À l'inverse, l'assiette salaires est parfaitement contrôlée par les services fiscaux de l'État, car les déclarations des bases ne peuvent pas s'écarter de celles faites aux URSSAF. La TP est un impôt très dynamique, mais la part de l'impôt éludé est préoccupante. Alors que la taxe professionnelle va être réformée, le moment est venu de se pencher sur le problème. Je m'étonne toujours que les élus locaux ne se tournent pas plus vers l'administration fiscale pour le régler. La taxe professionnelle n'est pas complètement pertinente puisque 52 % de son produit est, en fait aujourd'hui, assis sur une base non locale, à savoir la valeur ajoutée. La part nette assumée par l'État dans la taxe professionnelle, au titre des compensations et dégrèvements, atteint 40 % de ce qui est perçu par les collectivités, ce qui est beaucoup trop. Le poids financier du transfert du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'acte II de la décentralisation sur les charges des collectivités s'élève à 16 % pour les départements, 12 % pour les régions et 1 % pour les intercommunalités. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 implique que les ressources propres de chaque strate de collectivités doivent être maintenues au niveau atteint en 2003 : entre 56 % et 57 % pour les départements, les communes et les groupements, et 36 % pour les régions. Mais, comme vous, je m'interroge : qu'est-ce qu'une ressource propre ? On peut répondre que c'est une ressource constatée par un marché, alors qu'une dotation est versée par l'État, mais la frontière n'est pas claire car la DGF obéit à l'inflation et au PIB, lesquels s'ajustent en fonction de l'offre et de la demande. La différence entre une ressource propre et une dotation n'est donc pas si simple que cela, économiquement parlant. Les analyses de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) me semblent extrêmement inquiétantes : si j'avais le choix, je préférerais ne pas en toucher ! M. le Président : Nous aussi ! M. Michel KLOPFER : Entre 1994 et 2003, elle a progressé de 13 %, contre 24 % pour la DGF. Elle apparaît encore moins dynamique à l'examen de la structure de ces 13 % : ils résultent de la hausse de tarif de 20 % décidée par l'État - que celui-ci n'a certainement pas l'intention d'abandonner aux collectivités -, d'un effet volume de carburant positif et d'un effet structure de consommation négatif, compte tenu de la diésélisation du parc. L'Institut français du pétrole indique que le taux de véhicules diesels est passé, entre 1980 et 2003, de 4 % à 39 %, et surtout que 62 % des véhicules achetés en 2003 roulaient au diesel : le stock rattrape le flux, ce qui n'est pas sans incidences fiscales car ce carburant est taxé 29 % de moins que l'essence sans plomb et les véhicules diesels consomment 20 % de moins, même s'ils roulent un peu plus. Ainsi, en 2005, la seule augmentation de ressource de TIPP dont ont bénéficié les départements a été due à la sous-estimation initiale du coût du RMI au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ; le produit de la TIPP n'a aucunement progressé. Quels pourraient être des critères de pertinence géographique de l'impôt local ? Premièrement, l'assiette doit être liée physiquement au territoire : aux salaires, aux effectifs, aux immobilisations, à la superficie, à la puissance électrique, etc. J'insiste particulièrement sur le critère de superficie. Pour rectifier le déséquilibre entre l'Île-de-France et la province, j'avais préconisé, devant la « commission Fouquet », que la valeur ajoutée soit pondérée par la surface des locaux occupés, mais je n'ai malheureusement pas retrouvé l'idée dans le rapport. Deuxièmement, le rendement de l'impôt pourrait être lié à une compétence exercée : vignette pour la voirie ou taxe d'apprentissage pour la formation, par exemple. Cela a moins de sens d'avoir une recette liée à l'automobile quand on veut promouvoir le développement durable ! Troisièmement, le taux pourrait être revu à la hausse ou à la baisse par l'autorité locale. Mais on constate que la « commission Fouquet » a reçu dix-sept contributions d'entreprises ou de groupements patronaux contre seulement quatre de collectivités, et son rapport porte par conséquent la marque de la volonté du monde des entreprises d'encadrer les taux. Leur encadrement peut toutefois être relatif, par rapport aux autres impôts. Pour ma part, je suis partisan de revenir à un ratio de un pour un entre la taxe d'habitation et le foncier bâti, en espérant que le fait de lâcher ce lest permettra d'éviter un encadrement absolu, qui ôterait aux collectivités toute marge de manœuvre. Sinon, comme pour les droits de mutation des départements ou la taxe sur l'électricité des communes, vous n'aurez plus de marge de manœuvre et ce sera le même taux pour tout le monde. M. Jean-Yves LE DRIAN : Très bien ! M. Michel KLOPFER : Quatrièmement, il conviendrait de doter les collectivités d'une capacité à prévoir l'évolution des bases à court et moyen terme. Avec le système de la valeur ajoutée pondérée, cette fonction d'observatoire fiscal sera difficile à mettre en œuvre, car les investissements ou désinvestissements privés, imprévisibles, ont une incidence puissante sur les ressources publiques locales. Comment arbitrer entre fiscalité et emprunt ? Sans parler des augmentations de taux liées au calendrier électoral, face à un investissement additionnel, l'emprunt est préférable si la hausse de fiscalité à laquelle il faudra procéder pour payer l'annuité est moins élevée que si l'on y avait procédé au départ. Si la croissance des bases fiscales excède le taux d'intérêt, il est donc préférable d'emprunter ; sinon, il vaut mieux jouer sur la fiscalité. Cependant, les collectivités territoriales ne suivent pas toujours cette logique : en 1990, elles privilégiaient l'emprunt alors que les taux d'intérêt dépassaient l'inflation de sept points ; en 1998, elles privilégiaient la fiscalité alors que les taux d'intérêt ne dépassaient plus l'inflation que de deux points et que les bases avaient augmenté grâce au dynamisme économique. Enfin, les banquiers ne sont pas forcément experts en analyse financière et se comportent souvent en moutons de Panurge. En 1992, après les premières mises sous tutelle bancaire, il était extrêmement difficile de convaincre les grands établissements financiers des capacités de villes hébergeant un aéroport, et qui en touchaient alors le plein bénéfice puisque la TPU n'existait pas encore ; elles avaient pourtant les moyens de rectifier leur situation en quelques semaines, au prix de petits sacrifices sur leur train de vie. En 2004, tout a changé : l'ensemble des emprunteurs, grands et petits, se financent pratiquement au même prix. Les régions et les départements ont beau être sous les feux de l'actualité, si un cas de surendettement doit survenir avant la fin de la décennie, il touchera une grosse communauté et sa ville centre ; il y aura « du sang sur les murs », car je crains l'attitude qu'adopteront les établissements prêteurs à l'égard de l'ensemble des collectivités du même profil. M. le Président : Je vous remercie pour la concision et la grande clarté de votre exposé. M. le Rapporteur : Pouvez-vous mieux expliciter le type de scénario que vous tracez à travers votre dernière remarque concernant le risque d'explosion financière ? Je regrette que vous ayez parlé de l'évolution de la structure de la fiscalité locale au moins autant que de celle de son niveau. Or notre Commission d'enquête s'intéresse principalement au niveau de la fiscalité locale, son fait générateur étant le débat sur l'accroissement des taux annoncés puis votés par les conseils régionaux en 2005, ainsi que, plus largement, le débat relatif à la décentralisation et à son impact sur les taux de fiscalité locale. Les taux prévus sont-ils justifiés au regard des transferts de compétences ? Ceux-ci sont-ils financés par l'État ? Les décisions prises pour 2005, voire celles annoncées pour 2006, m'inspirent plusieurs questions : ces dépenses supplémentaires sont-elles opportunes ? Est-il plus sage d'y répondre par l'impôt ou par l'emprunt ? Les arbitrages effectués en 2005 par les régions entre impôt et emprunt sont-ils pertinents ? Quelle lecture tendancielle peut-on faire de l'évolution de la dépense des collectivités ? Lors des auditions, nous entendons souvent affirmer qu'il existe une sorte d'évolution naturelle et fatale à l'accroissement de la dépense locale, en partie expliquée par les transferts de compétences et la ligne de pente de la qualité du service public. Les grandes dates de l'évolution financière des collectivités territoriales depuis 1982 permettent-elles de le vérifier ? L'entropie de la dépense locale est-elle imputable à l'amélioration de la qualité du service ? Vous avez évoqué un « nivellement à la hausse du service public » à l'échelle des intercommunalités. Observez-vous le même phénomène pour les communes, les départements et les régions ? Vous ne vous êtes guère penché sur les causes de l'évolution de la fiscalité locale, sujet qui nous intéresse au premier chef. Quelles sont les causes de l'évolution de la fiscalité locale constatée en 2005 et auparavant ? Pouvez-vous tenter d'évaluer l'ampleur respective des causes exogènes et endogènes ? Il est frappant que les divers intervenants entendus jusqu'à présent - universitaires, experts ou conseils - nous aient fait bénéficier d'analyses globales mais que leurs exposés soient restés assez faibles sur le plan quantitatif ; ils ont identifié des catégories mais n'ont pas mesuré les phénomènes, ne serait-ce que sous la forme d'ordres de grandeur. Nous sommes donc un peu frustrés. M. Michel KLOPFER : On peut étudier l'évolution comparée de la fiscalité des régions, des départements et de l'ensemble communes plus groupements entre 1992 et 2003 : pendant les années quatre-vingt-dix, la fiscalité des régions, qui partait de très bas, a augmenté très fortement (+ 44 % en douze ans), et celle de certains départements a aussi connu des taux de progression à deux chiffres (28 %) ; un regain est visible à partir de 2002. Quelles sont les causes de ces augmentations sensibles ? Il faut s'attarder un peu sur la conception de la dépense et sur l'image qu'elle donne. Chacun considère aujourd'hui que la population ne raisonne qu'en pourcentage : un prélèvement, même « assassin », est bien admis dès lors que le contribuable y est accoutumé et que le taux de l'année précédente est purement et simplement reconduit. On atteint donc aujourd'hui un niveau de fiscalité qui aurait été perçu comme « tortionnaire » il y a vingt ans. Comment en est-on arrivé à ce degré d'acceptation ? Dans les années quatre-vingt, les collectivités territoriales, sauf exception, privilégiaient l'emprunt ; elles ne vouaient pas un culte à l'endettement mais ignoraient ses limites. Lorsque le secrétaire général suggérait timidement au maire d'augmenter un peu les impôts, celui-ci lui rétorquait qu'un prélèvement sur recettes de fonctionnement de 0,01 F suffisait vis-à-vis du préfet. Ni l'adjoint aux finances, ni le directeur financier n'avaient voix au chapitre dans ces réunions, à l'époque ! Les banques considéraient les collectivités comme des boîtes noires dans lesquelles on versait de l'argent sans même regarder à l'intérieur, puisqu'on pensait qu'elles avaient la garantie de l'État. On pouvait déjà accéder par Minitel aux comptes de n'importe quelle SA ou SARL de France ou de Navarre, mais certainement pas à ceux des collectivités publiques. En 1992, certaines d'entre elles se sont retrouvé dans des situations inextricables, notamment dans le Midi, où presque toutes les villes moyennes et grandes (sauf celles ayant un casino), ont dû signer des protocoles de redressement avec le Crédit local de France, la Caisse d'épargne ou le Crédit agricole. Puisque toucher aux dépenses de fonctionnement ne semblait politiquement pas possible, réduire les investissements n'aurait même pas suffi à redresser l'épargne brute et les maires se sont résolus à la seule solution : accroître les impôts. Les collectivités n'ont pas de culture de gestion, de recherche du meilleur rapport qualité-coût ou d'achats : les étudiants de l'Institut national des études territoriales (INET) n'ont aucune envie de commencer leur future carrière de dirigeants comme acheteurs dans une grosse collectivité car ces postes ne sont pas valorisés, contrairement à ce qui se passe en entreprise. Et le code des marchés publics ne risque pas d'améliorer la situation : les règlements de consultation font cinquante ou cent pages et les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), se limitent parfois à 10 lignes ! Rares sont les initiatives tendant à abaisser le niveau de la demande, y compris dans des domaines où cela serait relativement commode. Les collectivités ont parfois totalement autofinancé leurs investissements dans des situations où, compte tenu des hausses d'impôts qui avaient été opérées par précaution excessive, la trésorerie explosait littéralement. Aujourd'hui, à quelles conclusions nous amènent nos études prospectives, qu'il s'agisse d'analyses financières ou d'audits ? Les collectivités ont une capacité de désendettement de deux ou trois ans, les nuages noirs s'amoncellent à l'horizon en matière de dépenses et de transferts de charges, le faible dynamisme de la TIPP et même celui de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) sont inquiétants. Mais, puisqu'il ne faut pas vouer un culte au désendettement, on décide de se caler sur une perspective à n + 4, avec une capacité de désendettement de sept ans ; on accepte donc une dégradation des comptes, sans pouvoir pour autant se passer d'une augmentation des impôts parce que les marges de manœuvre fiscales et les capacités à générer de la taxe professionnelle ne sont plus celles de 1995-1998. Sur les trois dernières années, la compensation des droits de mutation encaissée par la région Languedoc-Roussillon a augmenté de 9 % quand le département de l'Hérault, son territoire le plus dynamique, réalisait plus 30 % sur les vrais droits de mutation ! Mais le marché de l'immobilier se cassera la figure dès que les taux d'intérêt repartiront à la hausse et il serait déraisonnable de penser que ce dynamisme va perdurer. Je ne tiens pas un double langage : si j'ai parfois été amené, à la fin des années quatre-vingt-dix, à conseiller à des élus de ne pas augmenter les impôts, je ne le fais plus aujourd'hui car le contexte a changé, en matière de recettes comme de dépenses. M. René DOSIÈRE : Si j'ai bien compris, les collectivités territoriales, grâce à leur qualité de gestion, ont permis à la France de se qualifier pour l'euro. Je propose donc que les fonctionnaires de Bercy, qui ont conduit l'État à la situation financière actuelle, aient l'obligation d'accomplir un stage en collectivité territoriale... Quelle est la situation spécifique des collectivités d'outre-mer ? Je ne parle pas de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, dotées de statuts particuliers, mais des collectivités régionales d'outre-mer. La Chambre régionale des comptes de Guadeloupe vient de faire apparaître que le conseil régional présente un déficit de 54 millions d'euros et recommande à la nouvelle équipe, entre autres issues, d'envisager une augmentation des impôts pour améliorer la situation. L'une des causes des hausses fiscales de 2005 est ainsi la nécessité d'apurer le passif des exécutifs sortants : une équipe de gauche doit apurer le passif d'une équipe de droite. M. le Rapporteur : Pour une fois ! C'est l'exception ! M. René DOSIÈRE : Il m'a semblé, à vous entendre et à vous lire, M. Klopfer, que la définition constitutionnelle des ressources propres vous apparaissait quelque peu virtuelle et ne correspondant pas à la réalité : la TIPP ou la TSCA semblent en réalité assez éloignées de ce qu'est une vraie ressource propre. M. Michel KLOPFER : Cette définition a été adoptée par le Congrès réuni à Versailles. Il est impossible de revenir dessus. M. Jean-Pierre SOISSON : Votre analyse historique est fondamentale. Je partage notamment votre avis sur la nécessité de renforcer la place de la fonction de gestion au sein de l'administration des collectivités territoriales. L'INET, maison que vous connaissez bien, a vocation à jouer ce rôle. Notre collègue René Dosière a évoqué l'intervention d'une Chambre régionale des comptes. Mais, d'un point de vue professionnel, les appréciations des chambres régionales des comptes apportent-elles quelque chose aux consultants ? Vous fondez-vous sur leurs recommandations ? Vous affirmez que l'augmentation de la fiscalité des régions, en 2005, tient au fait qu'elles veulent se constituer des marges de manœuvre car elles anticipent l'arrivée de « nuages noirs ». Pouvez-vous préciser votre pensée ? M. Pascal TERRASSE : Au terme de ces premières auditions, nous percevons bien les problématiques. L'évolution de la fiscalité est liée aux élections, les chiffres le prouvent avec régularité ! J'ai tâché d'étudier plus précisément la fiscalité régionale en fonction des cycles électoraux et je me suis rendu compte que l'augmentation connue des impôts régionaux de 2005, en moyenne, est assez similaire à celle de 1992 ; l'exécutif de ma région, en 1993, avait voté une hausse de 72 %. Mais j'aimerais savoir ce qui se cache derrière ces pourcentages. Les produits collectés en 1992 montrent que le rendement de la fiscalité était faible alors que les compétences grandissaient ; il semblerait toutefois que, en francs - ou en euros - constants, les collectivités régionales avaient alors une masse financière critique supérieure à celle d'aujourd'hui, en raison d'exonérations mais aussi de toute une série d'aides de l'État et de l'existence, encore à l'époque, d'une part salariale de la taxe professionnelle. La comparaison des masses fiscales de 1992 et de 2005 vous inspire-t-elle la même analyse ? Cela pourrait influer sur l'orientation des travaux de notre Commission d'enquête. M. Michel PIRON : M. Michel Klopfer a évoqué la sensibilité des impôts aux habitudes créées dans l'absolu. Quand à notre collègue René Dosière, il a indiqué que sa mouvance politique aurait naturellement vocation à redresser les dérapages outre-mer. La même mouvance aurait-elle une propension naturelle à augmenter les impôts locaux en métropole ? Le mot « naturel » mérite des explications. Quelles sont précisément les causes de ces augmentations ? Je m'interroge aussi sur la pérennité des dotations de l'État, qui constituent le deuxième poste le plus important de son budget. Peut-on imaginer qu'un État de plus en plus contraint financièrement puisse coexister avec des collectivités territoriales de plus en plus à l'aise ? Dans quel sens prévoyez-vous que ces dotations évolueront ? M. Jean-Pierre GORGES : Tous les intervenants font le même constat mais nous peinons à les faire entrer dans le détail. Ce sera sans doute plus facile lorsque nous nous déplacerons sur le terrain. D'un côté, pour accomplir des économies d'échelle, on concentre des activités en créant les intercommunalités - les entreprises sont coutumières de cette méthode -, mais de l'autre, la décentralisation se développe : ces deux mouvements sont opposés. Dans le même temps, le nombre d'opérateurs politiques se multiplie - pays, communes, intercommunalités, conseils généraux et régionaux - leur place étant maintenant reconnue dans la Constitution et chacun d'entre eux s'efforçant d'intervenir sur toutes les compétences, car il est politiquement intéressant de toucher à tout. Il semble difficile de trouver une explication rationnelle à la dérive de la fiscalité locale, qui se révèle similaire quelle que soit la couleur politique de la nouvelle majorité. Le système qui se dessine a quelque chose de monstrueux. Le mouvement enregistré au cours des vingt dernières années conduit inexorablement à créer des emplois dans les collectivités territoriales mais à aussi à alourdir la fiscalité. Ne convient-il pas d'engager une vraie réforme ? Par ailleurs, quels sont, selon vous, les points de convergence possibles entre concentration et décentralisation ? M. le Président : Votre analyse de l'évolution de la TIPP est excellente. Pourriez-vous en faire autant à propos de la TSCA, à moins qu'il ne s'agisse d'un objet non identifié ?... L'objet de notre Commission d'enquête est de rechercher les causes de l'augmentation de la fiscalité. Pouvez-vous répondre à cette question, s'agissant plus particulièrement des hausses prévues pour 2005 ? M. le Rapporteur : Je n'ai pas obtenu de réponse à ma demande de précision concernant votre prévision d'un krach financier avant la fin de la décennie. M. Michel KLOPFER : Si la prospective n'est pas une science exacte, il n'en reste pas moins que l'histoire locale, comme la grande histoire, bégaye. Le premier cas de surendettement s'est produit dans une ville de 42 000 habitants, Angoulême, qui s'est réveillée un beau matin avec soixante-trois prêteurs et un krach de 200 millions d'euros, mais plus personne n'y songe. Un banquier a le droit à l'erreur sur un dossier dès lors que ses confrères sont tombés dans le même panneau : la collectivité qui a rencontré des difficultés est mise à l'index pendant quelques années, même une fois redressée ; en revanche, celle qui n'a jamais fait parler d'elle est réputée digne de confiance. Le prochain gros sinistre sera sûrement intercommunal. En effet, toutes les communes, dépositaires de la légitimité politique, exigent de l'intercommunalité à laquelle elles adhèrent qu'elle se serre la ceinture pour arriver à faire passer leurs propres contingences, jusqu'au moment où elle explosera, comme ce fut le cas de bien des SEM. Mais cela ne se produira peut-être qu'au cours des années 2010. S'inquiéter du mode de fonctionnement entre communes et intercommunalités en 2005, six ans après l'adoption de la « loi Chevènement » de 1999, c'est un peu comme si l'on s'était penché, en 1988, sur les conséquences financières de la loi du 2 mars 1982 : personne ne se mobilise car il ne s'est encore rien passé de sérieux. Les chambres régionales des comptes commencent à s'intéresser aux questions intercommunales mais, suivant le magistrat sur lequel vous tombez, la qualité du rapport varie de l'excellent au médiocre. J'ai en revanche le souvenir d'un colloque, organisé à Marseille en février 1997 pour fêter les quinze ans de la décentralisation, au cours duquel j'ai particulièrement apprécié l'intervention de M. Alain Sérieyx, alors que tous les élus, de droite ou de gauche, se retrouvaient pour dire le plus grand mal de la Chambre qu'il présidait. Je considère que les régions françaises ne pèsent pas suffisamment en France aujourd'hui. Je ne suis pas spécialiste des administrations locales des autres pays européens mais je connais quelques données générales. D'abord, en pourcentage du PIB, le poids du secteur local est plus élevé dans les quatre autres grands pays de l'Union européenne - Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne - qu'en France. Ensuite, chez nous, le niveau communal - incluant les intercommunalités - l'emporte très largement sur le niveau supracommunal, les régions étant le parent pauvre, avec 18 milliards d'euros de budget total contre 45 milliards d'euros pour les départements. Et les moyens des régions disparaissent comme une peau de chagrin, en même temps que leurs marges de décision. Je trouverais dommage qu'elles perdent encore leurs 2,6 milliards d'euros de taxe professionnelle, car elles sont chefs de file en matière économique. Or j'ai bien lu, page 102 du « rapport Fouquet », que la suppression de la part régionale de la taxe professionnelle est considérée comme le « dénominateur commun » de tous les scénarii possibles. S'il se positionne aussi clairement sur ce point alors qu'il reste évasif sur bien d'autres aspects, c'est notamment parce que les banques, en particulier la plus active d'entre elles dans le secteur public local - je le constate simplement, et cela n'enlève rien aux extraordinaires compétences techniques et fiscales dont fait preuve cet établissement, au-delà de son métier de bailleur de fonds -, ont abordé le problème de la taxe professionnelle en tant que banquiers. M. le Rapporteur : Pourquoi les banquiers auraient-ils intérêt à supprimer la part régionale de la taxe professionnelle ? M. Michel KLOPFER : La banque est une société de service, et ces dernières sont celles qui ont le plus à perdre d'une réforme de la TP, si les industries gagnent ! Dans les intercommunalités, il existe évidemment des doublons, mais ce n'est pas à un intervenant extérieur de se prononcer sur le nombre de structures existantes. Je me permettrai simplement une remarque. Les villes-centres de 50 000 habitants ont aujourd'hui treize adjoints, soit 30 % de l'effectif du conseil. Quand elles appartiennent à une communauté à taxe professionnelle unique, ce qui est le cas de 95 % d'entre elles, elles n'ont plus besoin d'adjoint au développement économique, ni d'adjoint à l'habitat, ni d'adjoint à la voirie, ni d'adjoint à la politique de la ville. Les élus tiennent toujours des permanences mais ont moins de parapheurs à signer ; alors pourquoi ne pas réduire le nombre d'adjoints et par conséquent le volume des indemnités municipales ? Personne n'a encore soulevé le problème. Si l'intercommunalité crée des doublons de charges, c'est aussi que, face à la DGF, seule ressource supplémentaire, les économies d'échelle ne compensent pas les éventuels surcoûts ; en effet, dans la pratique, chaque commune conserve des antennes dans toutes les compétences, y compris celles qui ont été transférées, ce qui ne permet pas de concrétiser les économies d'échelle. S'agissant des causes de l'augmentation de la fiscalité, le sujet n'est certes pas épuisé mais je crois tout de même vous avoir répondu. Je constate, sans me laisser aller à un pessimisme excessif, que mes scénarii prospectifs prévoient une dégradation accélérée des ratios de solvabilité, et je n'aime pas dire à une collectivité que sa capacité de désendettement risque d'atteindre dix ans dans quatre exercices. A contrario, il m'est arrivé, en 1998, après une élection régionale, de me faire très mal voir dans un conseil régional dont la capacité financière était excellente mais qui cherchait sans succès à me faire dire et écrire qu'il était aux abois. Les analyses dont je dispose à propos de la taxe sur les conventions d'assurances tendent à montrer que la ressource, ces quatre dernières années, a augmenté de 6 % par an. La taxe sera toutefois moins dynamique en 2005 puisque l'effet volume, plus trois points, sera inférieur à l'effet prix, moins cinq points, compte tenu du succès des campagnes de sécurité routière. Des analogies existent avec des transferts de charges effectués au profit d'intercommunalités. Après tout, soit les compétences sont voisines, soit il s'agit d'un problème d'équipement, auquel il est par conséquent possible d'appliquer la méthode des coûts actualisés - je précise au passage que nous sommes de ceux qui ont suggéré de modifier les textes relatifs à la prise en compte des dépenses d'investissement des intercommunalités. Quand le montant d'un transfert est correctement évalué, passe encore, mais, en l'occurrence, la TSCA doit servir à financer les 900 millions d'euros de surcoût des SDIS et, dans le même temps, les départements vont se voir ôter 890 millions d'euros de DGF, dotation qui progresse de 3 %, ce qui provoquera un effet de ciseaux si jamais il s'avère que la TSCA ne progresse pas, elle aussi, de 3 % par an. L'enjeu est donc très important. Enfin, je ne suis pas certain que le mode de calcul de la TIPP et de la TSCA soit arbitré politiquement. Les bases de ces deux impôts vont être territorialisées : la TIPP pour les régions et la TSCA pour les départements. Le montant des charges transférées correspond à un pourcentage de la recette levée l'année précédente. Soit les collectivités territoriales reçoivent l'équivalent exact des transferts de charges, ce qui signifie que leurs marges de manœuvre fiscales sont différentes - en 2003, le montant des transferts correspondant à l'assiette de TIPP régionale variait approximativement de 7,5 % et 14,7 % -, soit tout le monde est mis au même niveau et perçoit un pourcentage donné de la recette, les ajustements passant par le canal de la DGF. Les collectivités sont alors gagnantes d'un point de vue juridique, au sens de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, puisqu'elles obtiennent un maximum de ressources, mais elles n'en sont pas moins perdantes financièrement car la TIPP progressera moins que la DGF. Il y a trois mois, il était prévu de fixer un pourcentage, mais cela ne semble plus certain. De toute façon, dans les deux cas, les collectivités sont soumises à des contraintes. Pour la TIPP, Bruxelles admet 1,15 et 1,87 euros par hectolitre, ce qui ne représente pas le même pourcentage pour chaque région : plus ou moins 20 % pour certaines, plus ou moins 8 % pour d'autres. M. le Président : On constatera la même chose pour la TSCA, sauf que Bruxelles n'interviendra pas. M. Michel KLOPFER : Absolument, mais j'ignore comment le système fonctionnera. M. le Président : Il n'est pas certain que quiconque le sache ! C'est tout le problème ! M. René DOSIÈRE : Puisque vous intervenez dans de nombreuses collectivités, pouvez-vous nous dire si l'appartenance politique d'un exécutif local est une variable susceptible d'expliquer l'évolution de la fiscalité ? M. Michel KLOPFER : À mon sens, non. Juste avant les élections de 2002, un journaliste m'a soutenu qu'un de mes excellents confrères roulait à droite et m'a questionné sur mes préférences. Je lui ai répondu que j'appréciais beaucoup certains élus, eu égard à leurs compétences de gestionnaires, qu'ils aient en poche la carte du PS ou celle du RPR. Bref, je ne crois pas qu'il existe une corrélation entre appartenance politique et qualité de la gestion. M. le Président : Je vous remercie pour toutes ces réponses, qui nous ont très bien éclairés, notamment sur la réforme de la taxe professionnelle. Audition de M. Claudy LEBRETON, Présidence de M. Augustin BONREPAUX, Président MM. Claudy Lebreton, Louis de Broissia, Bernard Cazeau, Claude Haut et Mme Anne d'Ornano sont introduits. M. le Président : Nous accueillons aujourd'hui M. Claudy Lebreton, Président de l'Assemblée des départements de France, accompagné d'une délégation nombreuse. Je le remercie d'avoir tenu à être entouré de quatre présidents de conseils généraux, représentant la majorité et l'opposition de l'ADF : pour le groupe socialiste, M. Bernard Cazeau, Président du conseil général de la Dordogne, et M. Claude Haut, Président du conseil général de Vaucluse ; pour le groupe UMP, M. Louis de Broissia, Premier vice-président de l'ADF et Président du conseil général de la Côte d'Or ; pour le groupe UDF, Mme Anne d'Ornano, Présidente du conseil général du Calvados. M. le Président rappelle à MM. Claudy Lebreton, Louis de Broissia, Bernard Cazeau, Claude Haut et à Mme Anne d'Ornano que les dispositions législatives relatives aux commissions d'enquête leur ont été communiquées. À l'invitation du Président, ceux-ci prêtent serment. M. le Président : Je rappelle qu'il a été confié à notre Commission d'enquête le soin d'évaluer les causes de l'augmentation de la fiscalité locale en 2005 et les années précédentes ainsi que ses conséquences pour les ménages et les entreprises. Après l'exposé introductif de M. Claudy Lebreton, le Rapporteur interrogera les représentants de l'ADF, puis je donnerai la parole aux autres membres de notre Commission d'enquête pour des questions que je souhaite courtes et précises. M. Claudy LEBRETON : Je vous remercie de permettre à l'Assemblée des départements de France de s'exprimer dans sa diversité. Je voudrais dans un premier temps vous livrer quelques données chiffrées sur le poids financier des départements, émanant d'une analyse conduite sous l'autorité du directeur général de l'ADF à partir des comptes administratifs de l'exercice 2003. Le total des budgets des départements s'élève à 45,427 milliards d'euros, à comparer avec les 16 milliards d'euros des régions, les 78 milliards d'euros des communes et les 39 milliards d'euros des EPCI, dont 24 milliards d'euros pour les EPCI à fiscalité propre. Le total de nos dépenses de fonctionnement selon les comptes administratifs 2003 s'élève à 28,7 milliards d'euros et le total de nos recettes de fonctionnement s'élève en 2003 à 37 milliards d'euros, dont 20,6 milliards d'euros de recettes fiscales. Cela signifie que les départements ont dégagé en 2003 une épargne brute de plus de 8 milliards d'euros, signe d'une gestion financière globalement saine. Cet autofinancement permet d'assurer un bon niveau d'investissement : 13,44 milliards d'euros. Le ratio « endettement sur épargne brute » est de deux ans - on estime que le ratio à ne pas dépasser est de sept ans. Ces indicateurs nationaux masquent des réalités départementales extrêmement contrastées, comme le montre le tableau du potentiel fiscal « quatre taxes » 2003. Si la moyenne nationale s'établit à 265 euros par habitant, la Creuse ne dispose que d'un potentiel de 159,70 euros par habitant tandis que les Hauts-de-Seine affichent un potentiel fiscal de 665 euros par habitant, soit 2,5 fois la moyenne nationale et 4,2 fois le potentiel fiscal de la Creuse. Le secteur social est notre premier poste de dépenses, avec 16,9 milliards d'euros, soit 59 % des dépenses de fonctionnement. Les variations de ce poste sont étroitement liées à la situation économique et sociale de la France et de chaque département. Le deuxième poste est la masse salariale, avec 187 200 fonctionnaires territoriaux titulaires et non titulaires (sur les 1,4 million d'agents au service des collectivités territoriales françaises), ce qui représente une dépense de 5,1 milliards d'euros, soit 18 % du total des dépenses de fonctionnement. Les recettes fiscales des départements étaient en 2003 de 20,6 milliards d'euros, dont 15 milliards d'euros de produit des quatre taxes - 15,3 dans les budgets primitifs 2004. Globalement, entre 2002 et 2004, la part du produit de la fiscalité directe dans les recettes réelles des départements a reculé de 41,4 % à 37,3 %. Dans le même temps, les dotations et compensations de l'Etat sont passées de 12 milliards à 12,95 milliards, mais leur part dans le total des recettes a baissé, passant de 35,2 % en 2002 à 31,5 % en 2004. La pression fiscale départementale moyenne, en 2002 et 2003, a progressé de 4 %, alors qu'elle a été limitée à 1,3 % en 2004. Par comparaison et pour mémoire, les départements avaient voté en moyenne, en 2001, une baisse de 0,5 % de la fiscalité départementale. La baisse avait été du même ordre en 2000. Le produit des quatre taxes se répartit de la façon suivante : près de 45 % pour la taxe professionnelle, avec 6,9 milliards d'euros ; 30,3 % pour le foncier bâti, avec 4,7 milliards d'euros ; 24,7 % pour la taxe d'habitation, avec 3,8 milliards d'euros ; 0,3 % pour le foncier non bâti, avec 39,7 millions d'euros. Les prévisions d'augmentation de la fiscalité pour 2005, établies à partir des données qui nous ont été fournies par soixante départements, permettent de situer la hausse des taux dans une fourchette de 3,8 % à 4,1 %, sachant que les situations sont extrêmement hétérogènes : vingt départements n'augmentent pas leurs taux ; vingt-deux les augmenteront de plus de 4 %, dont neuf de plus de 8 %. Je reviendrai plus tard sur les nouvelles recettes fiscales que constituent la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), et la TSCA, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance. J'en viens maintenant aux compétences récemment transférées aux départements (qui ont déjà un impact sur les budgets 2005) et aux compétences qui seront transférées à partir de 2006 et qui auront une incidence sur les budgets des départements dans les prochaines années. Parmi les compétences récemment transférées, j'évoquerai les conséquences de la gestion du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). S'agissant du RMI, le déficit cumulé de l'ensemble des départements, pour 2004, est de 456 millions d'euros. Il résulte d'une progression de 9 % du nombre d'allocataires par rapport à 2003. Ce déficit implique pour les départements un décalage de trésorerie, décalage qui s'est accru au cours des premiers mois de l'année 2005. Or, je rappelle que le droit à compensation des départements demeure calculé sur la base du montant des dépenses exécutées par l'Etat au titre du RMI en 2003, auquel il convient d'ajouter le surcoût induit par la réforme de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) et la création des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), même si nous avons entendu le Premier ministre annoncer qu'il financerait le dépassement enregistré en 2004, au vu des comptes administratifs 2004 des départements. L'incertitude reste entière sur les modalités de compensation du coût du RMI pour les années suivantes, et sur l'année de référence qui sera retenue pour le calcul du droit à compensation des départements. La loi précise que c'est sur la base des dépenses 2003 que se fait la compensation. Il ne faudrait pas non plus oublier des dépenses secondaires qui n'ont pas été prises en compte dans le périmètre de la compensation, comme celles relatives à la convention passée par les départements avec l'ANPE au sujet des conseillers en insertion sociale et professionnelle. Le montant global de cette « facture » à la charge des départements et non compensée par l'État est de 45 millions d'euros pour l'année 2004, dont 171.000 euros pour le Jura, 324.000 euros pour l'Essonne, 382.000 euros pour la Moselle, 518.000 euros pour le Pas-de-Calais, etc. En ce qui concerne les dépenses au titre de l'APA, elles ont doublé entre 2002 et 2004, passant de l,8 milliard à 3,6 milliards d'euros. La charge nette, pour les départements, est passée de 937 millions d'euros à 2,29 milliards d'euros. Quant à la compensation versée par l'État, via le Fonds de financement de l'APA (FFAPA), elle est passée de 48 % en 2002 à 36,4 % en 2004. Ces chiffres permettent de mieux apprécier quelles peuvent être les difficultés financières de l'ensemble des départements. Il faut savoir que le nombre de personnes de plus de quatre-vingt-cinq ans devrait doubler d'ici à 2025 et que les bénéficiaires de l'APA sont très inégalement répartis entre les départements : ainsi, le financement de l'APA coûte 8,59 euros par habitant dans le Val-d'Oise contre 23,98 euros par habitant dans la Creuse. Les SDIS représentent au total 1,49 milliard d'euros de contributions, dont, en moyenne, 48,5 % de ce coût à la charge de départements. Là aussi, les disparités de coûts entre départements sont considérables : l'Aube consacre 5,90 euros par habitant au financement des SDIS, la Seine-et-Marne dépense 59,20 euros par habitant et la Corse-du-Sud 83,40 euros par habitant. À partir de 2008, la charge du financement des SDIS sera totalement supportée par les départements. Une deuxième catégorie de transferts commencera à produire ses effets en 2005. S'agissant du financement de l'accueil des personnes handicapées, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées s'appliquant à compter du 1er janvier, nous avons commencé un travail estimatif : dans les comptes administratifs 2002 de soixante-dix-huit départements, les dépenses au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) représentaient 700 millions d'euros. Pour le financement de la prestation de compensation du handicap (PCH), nous avons estimé, par extrapolation, qu'il faudra prévoir 1,8 milliard d'euros dès 2006. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dispose de 2 milliards d'euros pour financer, à hauteur de 40 %, l'APA et le reste, notamment la PCH. Le ministre des Solidarités, de la santé et de la famille a, dans une intervention, souligné les difficultés qui seront les siennes pour permettre aux départements d'assumer totalement cette charge financière. Les bénéficiaires du contrat d'avenir créé dans le cadre du plan de cohésion sociale toucheront une rémunération brute mensuelle de 857 euros pendant trois ans, soit 957 euros avec les charges. Elle sera financée par une aide dégressive de l'État atteignant 398,52 euros par mois la première année, par une participation progressive de l'employeur partant de 132 euros pas mois la première année, et par le versement obligatoire à taux plein du RMI par le département, soit 425,40 euros par mois pendant toute la durée du contrat. Or, je rappelle que la moyenne nationale de l'allocation RMI réellement versée est de 270 euros par mois. Avec les contrats d'avenir, la charge supplémentaire, pour les départements, sera de 1 850 euros par an. Si l'on envisage la signature 250 000 contrats d'avenir par an pour atteindre l'objectif d'1 million de contrats, un calcul simple permet d'estimer la charge supplémentaire que cela représentera pour nos départements. Une troisième catégorie de transferts aura des effets financiers à partir de 2006-2007. Il s'agit en premier lieu du transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS). On dénombre pour les départements 43 770 agents TOS dans les collèges publics, soit 42 590 TOS en équivalent temps plein, hors contrats aidés. Sachant que le salaire moyen annuel d'un TOS s'élève à 19 300 euros, nous arrivons à une charge globale de 845 millions d'euros, à laquelle il convient d'ajouter 128 millions d'euros de charges sociales ainsi que d'autres charges, telles que les crédits de suppléance, évalués à 31 millions d'euros, soit un total de 1 milliard d'euros. Des incertitudes demeurent sur plusieurs aspects comme le transfert des personnels sous contrats emplois solidarité (CES) ou contrats emplois consolidés (CEC), les conséquences du passage aux cotisations de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) pour les TOS qui intégreront la fonction publique territoriale, ou l'incidence du passage au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale qui est en moyenne 2 fois et demie supérieur au régime indemnitaire servi pour les mêmes cadres d'emploi dans la fonction publique d'État, sans oublier les besoins en personnels de gestion que suscitera le transfert des TOS, notamment au sein des directions des ressources humaines. À titre d'exemple, les Bouches-du-Rhône comptent 1 251 TOS, 348 CES et 53 CEC exerçant dans les collèges, et le surcoût, pour le département, atteindrait 7,7 millions d'euros dès 2006, soit une dépense supplémentaire moyenne de 6 000 euros par agent. La loi du 13 août 2004 prévoit le transfert aux départements de 20 000 kilomètres de routes nationales et de 30 000 agents de l'équipement. Les départements auront alors à entretenir et à moderniser 385 000 kilomètres de routes et l'État 10 000 kilomètres. Les dépenses de l'État pour l'entretien des routes nationales varient au moins de un à trois d'un département à l'autre et nous avons évalué que l'État consacre, en moyenne, 7 077 euros par kilomètre avec des différences considérables selon les départements - 2 600 euros par kilomètre en Haute-Marne et 950 euros par kilomètre dans l'Yonne. Pour les 30 000 agents de l'équipement, la rémunération brute est estimée à 478 millions d'euros, soit 740 millions d'euros avec les cotisations sociales. Là encore, nos inquiétudes portent essentiellement sur la différence entre le régime indemnitaire de la fonction publique territoriale et celui de l'État, le premier étant plus avantageux que le second, ainsi que sur le financement du décroisement. Sur ces sujets, nous n'avons pas encore obtenu les réponses que nous attendons et une négociation s'est engagée entre l'ADF et le Gouvernement. En conclusion, je souhaite souligner que le taux de prélèvements obligatoires tourne autour de 44 ou 45 % du PIB dont plus de 20 % pour les prélèvements sociaux, un peu moins de 20 % pour les prélèvements de l'État et 5 % pour les collectivités territoriales. Je rappellerai également que les collectivités territoriales doivent faire face à un alourdissement de leurs charges qui résulte de décisions prises par l'État : contraintes environnementales en matière de traitement des déchets, normes de sécurité imposées aux établissements publics dont les collectivités territoriales ont la responsabilité ou de mesures statutaires et indiciaires relatives aux fonctionnaires territoriaux. Nous sommes disponibles, mes collègues et moi, pour répondre aussi précisément que possible aux interrogations de la commission d'enquête. M. le Rapporteur : Nous souhaitons que vos réponses soient aussi précises que possible. Si vous étiez dans l'impossibilité d'apporter aujourd'hui des réponses précises à nos questions, vous voudrez bien nous communiquer ultérieurement tous les éléments complémentaires nécessaires. Je poserai des questions d'ordre général, mais je vous interrogerai aussi sur la situation particulière de telle ou telle collectivité. Certains conseils généraux semblent craindre de devoir préparer dès aujourd'hui l'opinion à une augmentation plus significative des taux de la fiscalité départementale en 2006 : en d'autres termes, après le train régional de 2005, un train départemental s'annonce-t-il pour 2006 ? Les compétences transférées le justifieraient-elles ? En 2005, sur les soixante départements pour lesquels les chiffres sont disponibles, vingt n'ont pas accru leur fiscalité tandis que vingt-deux l'ont accrue de plus de 4 %, dont neuf de plus de 8 %. Les départements étant confrontés à une situation semblable en termes d'évolution de la décentralisation, comment s'expliquent ces différences ? Pouvez-vous nous rappeler comment les droits de mutation à titre onéreux perçus par les conseils généraux ont évolué au cours des dernières années ? En tant que Président de conseil général et Président de l'ADF, vous n'avez pas, je le sais, à vous mêler de la gestion des régions, mais comment analysez-vous l'évolution de leurs taux de prélèvement ? Leurs nouvelles compétences et leurs nouveaux besoins justifient-ils une augmentation du taux de l'impôt régional ? Selon vous, quelles sont ses causes ? À propos de la départementalisation des routes nationales, vous avez insisté sur les charges de personnel. S'agissant de l'investissement sur le réseau national, j'ai des éclairages assez contrastés. Certains conseils généraux craignent que la compensation soit insuffisante. Or, en tant que Rapporteur du budget de l'équipement et des transports, je n'ai pas constaté, depuis deux ou trois ans, de baisse de l'investissement d'État sur le réseau national, et notamment sur le réseau national appelé à être transféré, contrairement à ce qui s'était passé juste avant le transfert des lycées et des collèges. La baisse de l'effort financier de l'État avant le transfert de l'investissement avait alors pu paraître « organisée ». La Direction des routes confirme que l'effort de l'État est maintenu. Or, si les autres collectivités, en particulier les régions, maintiennent leur effort net actuel, la disponibilité nette pour les conseils généraux, après prise en compte des effets de TVA, sera, à effort constant, supérieure. Partagez-vous cette analyse ou la récusez-vous ? Dans les documents de présentation du budget 2005 du département des Côtes-d'Armor, il est indiqué que les transferts de compétences de l'État vers les départements sont mal compensés financièrement. Pouvez-vous préciser davantage ? Vous affirmez que la moyenne d'évolution de la part départementale de vos impôts locaux est de 2,5 % par an, proche de l'augmentation des prix à la consommation. Cette évolution de 2,5 % s'entend-elle hors effet base ou en sus de l'effet base ? Vous affirmez devoir répondre à une augmentation du nombre de personnes bénéficiaires de l'APA et du RMI alors que la participation financière de l'État à ces dispositifs reculerait. Êtes-vous en mesure de prouver et de chiffrer cette baisse ? Sur le dossier des emplois-jeunes, dispositif supprimé par l'État, vous avez décidé de prendre le relais afin de préserver cette année 350 emplois associatifs, des emplois qui, je vous cite, « jouent un rôle essentiel dans l'animation de la vie locale ». Je ne méconnais pas la légitimité d'une assemblée départementale à effectuer un tel choix discrétionnaire, mais je souhaiterais connaître ses conséquences, sur le plan fiscal. Enfin, vous affirmez : « 5 % d'augmentation sur nos feuilles d'impôts locaux, certains disent que c'est encore trop. Si nous avions dû faire payer aux contribuables la seule augmentation des charges, nous aurions dû augmenter l'impôt de 17 %. » Pouvez-vous justifier et décomposer ce taux ? M. Claudy LEBRETON : Je répondrai d'abord en qualité de président de l'ADF car je pensais être auditionné à ce titre uniquement. Si j'avais su que vous me questionneriez sur mon département, j'aurais préparé la réunion avec mes services pour vous livrer des chiffres précis, que je n'ai pas forcément en tête. Concernant les hausse de fiscalité votées par les départements pour 2005 et à prévoir en 2006, nous connaissons très précisément l'impact de lois déjà votées comme la loi portant décentralisation en matière de RMI et créant le RMA, nous pouvons déjà avoir une idée de l'impact financier de la mise en œuvre, dès cette année, de la loi sur les personnes handicapées et de l'application de la loi de programmation sur la cohésion sociale, notamment pour ce qui concerne les contrats d'avenir, mais nous ne possédons pas aujourd'hui de chiffres suffisamment précis pour prédire, pour les années 2006-2007, les conséquences financières exactes des transferts de compétences. Le « cœur de métier » des départements résidant dans l'action sociale et les solidarités, le RMI, l'APA et les contrats d'avenir ont un impact très important sur notre fiscalité. Mais nous attendons encore des réponses, concernant notamment la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) ou la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA). Nous avons reçu 900 millions d'euros dans le cadre du financement des SDIS, dont 880 millions d'euros sont en substitution de la DGF départementale et 20 millions d'euros sont versés aux départements au titre de la PFR - prime de fidélité et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires - pour faire face à une dépense, en année pleine, de 60 millions d'euros. De plus, 126 millions d'euros ont été versés au titre des transferts de compétences de l'année 2005 (FSL, FAJ, CLIC,...). À compter de 2007, l'assiette de la TSCA sera départementalisée et les départements auront le pouvoir d'en moduler le taux, selon des modalités qui ne sont pas encore connues. Je ne lis pas dans le marc de café, M. le Rapporteur, mais l'ADF, qui fait en sorte de préparer au mieux les prochains exercices, anticipe des incidences sur les budgets. La progression moyenne de la fiscalité départementale est d'environ 4 %, mais certains départements n'augmentent pas leurs taux, et d'autres, toutes sensibilités politiques confondues, ont voté des augmentations de l'ordre de 17 ou 18 %. Si les écarts sont importants, c'est que les disparités entre les 102 départements de France sont extrêmes, que ce soit sur le plan de la démographie, en termes de tissu économique et social, de revenu par habitant ou de richesse fiscale et financière. En raison des écarts de potentiel fiscal, tous les départements n'ont pas la même capacité à mobiliser la fiscalité. Il est clair que les départements, compte tenu de la diversité de leur situation économique et sociale, ne sont pas confrontés aux mêmes types de contrainte financière : des départements vieillissants doivent faire face à un accroissement des dépenses en faveur des personnes âgées alors que d'autres sont surtout sollicités pour financer les besoins de la jeunesse, notamment en collèges. Il est par conséquent très difficile de comparer la mobilisation de la fiscalité d'un département à un autre et j'estime même, pour ma part, que toute comparaison fiscale est vaine. Les impôts indirects, de 2002 à 2003, ont connu une croissance de 6,9 % soit un produit de 5,5 milliards d'euros. Les impôts directs ont progressé de 6,7 %. Quant aux droits de mutation, ils représentent un produit de 4,5 milliards d'euros. Entre 2002 et 2003, ils ont augmenté en moyenne de 10,4 %. Il est clair que depuis 5 ans, les droits de mutation représentent pour les départements une ressource extrêmement dynamique. Mais là encore, les différences sont très grandes d'un département à l'autre en raison de la diversité de situation du marché immobilier. Certains départements bénéficient de 20 points d'augmentation depuis plusieurs années. Je ne pense pas être le mieux placé pour parler de la hausse de la fiscalité des régions mais je serais enclin à dire que ce qui vaut pour les départements vaut aussi pour les régions, les communes et les intercommunalités : la disparité se retrouve à tous les niveaux. Ainsi, sur cent euros acquittés par le contribuable, soixante-dix vont à la ville et à l'intercommunalité, vingt-cinq au département et cinq à la région. Lorsque chaque niveau de collectivité veut prélever un euro supplémentaire, cela n'a pas le même impact en termes de taux de fiscalité. En ce qui concerne le transfert des routes nationales et la question du décroisement, il s'agit de déterminer quel était le montant consacré par l'État à l'entretien des routes qui seront transférées aux départements et, inversement, quel était le montant de la participation des départements s'agissant des routes que l'État va garder. On s'est aperçu que les deux montants étaient globalement identiques pour l'ensemble des départements. En revanche, si l'on fait ce calcul département par département, les différences sont importantes. Ainsi, dans le département que je préside, le contrat de plan prévoit d'aménager en deux fois deux voies une route nationale qui traverse la Bretagne d'Est en Ouest. Il reste quatre-vingts kilomètres de travaux à effectuer, ce qui, si le transfert est réalisé, coûtera 160 millions d'euros au département des Côtes-d'Armor, c'est-à-dire dix fois le budget consacré chaque année à la voirie départementale. Comment allons-nous faire demain si cette route est transférée, alors qu'il y avait un engagement de l'État dans le cadre du contrat de plan, notamment parce que cette route était considérée comme une route d'intérêt national et non pas départemental ? S'agissant de la politique de mon département face à la disparition des emplois jeunes, mon département a longtemps favorisé les « emplois de proximité associatifs », dispositif dans lequel le département et la collectivité de référence de l'association apportaient tous deux 33 % de la rémunération, l'association assumant les 34 % restants. Quand il a fallu sortir des emplois-jeunes, nous avons décidé d'utiliser ce dispositif. Chaque collectivité, dans ce domaine, est libre de choisir sa politique. L'augmentation de 17 % de la fiscalité que vous mentionnez, monsieur le rapporteur, résulte notamment à la perte de compensation du FNDAE, le fonds national pour le développement des adductions d'eau, pour l'adduction d'eau potable ainsi que d'autres désengagements de l'État. Tous ces facteurs auraient dû induire une hausse de 17 % de la fiscalité, hausse que nous avons limitée à 5 %. M. Louis de BROISSIA : J'insiste à mon tour sur la diversité des situations départementales, qui peuvent être urbains ou ruraux, à potentiel fiscal faible ou fort, en vieillissement ou en rajeunissement, dotés d'infrastructures nombreuses ou insuffisantes - sans compter les différences entre l'outre-mer et l'hexagone. L'évolution de la fiscalité locale résulte de textes votés par le Parlement, depuis 1982, dans le cadre de la décentralisation. Depuis les premières lois de décentralisation, nous avons connu une évolution importante de la fiscalité locale. Cette augmentation des recettes a été essentiellement consacrée aux collèges et lycées. Ainsi, dans le département de la Côte d'Or, pour mémoire, la dotation générale des collèges ne compense les dépenses qu'à hauteur de 8 %. Si l'État avait compensé intégralement le transfert, la pression fiscale, en 2005, serait inférieure de 17,5 points. Mais le département a fait le choix discrétionnaire d'améliorer l'état des collèges transférés. Les départements ont aussi récupéré l'entretien des routes départementales, soit, pour la Côte d'Or, 5 528 kilomètres, auxquels il conviendra d'ajouter 400 kilomètres supplémentaires. En 1996 et 1997, la fiscalité départementale a augmenté en moyenne plus vite que la fiscalité communale. De 1998 à 2001, au cours de quatre années successives, les départements se sont montrés vertueux en réduisant leurs impôts ou tout du moins en se contentant de la revalorisation des bases. Pourquoi, à partir de 2002, les impôts ont-ils de nouveau augmenté ? Nous avons dû faire face de plein fouet à des mesures nationales, votées par le Parlement, comme la réduction de la durée du travail, qui, en 2001, a coûté 44,998 millions de francs à mon département, soit 6,859 millions d'euros ou encore 5,57 points de pression fiscale supplémentaire. Nous employons en effet 1 695 agents, plus de la main-d'œuvre indirecte, notamment dans les maisons de retraite : il a fallu leur appliquer l'aménagement-réduction du temps de travail (ARTT). La Côte d'Or comptait parmi les départements ayant les plus faibles charges de personnel. L'application de l'ARTT nous a obligés à embaucher du personnel. De même, dans un département moyen comme le mien, le transfert progressif de la charge du SDIS d'ici au 1er janvier 2008 représente chaque année quatre points de pression fiscale. Les charges liées au SDIS représentent donc 11,6 points de fiscalité depuis l'application de la loi relative à la démocratie de proximité. En d'autres termes, nous abordons l'acte II de la décentralisation avec le sentiment que nous avons beaucoup donné et que la prudence s'impose. Voilà l'esprit qui nous anime dans nos conversations avec l'État à propos des routes, des TOS, du fonds de solidarité logement (FSL), du fonds d'aide aux jeunes (FAJ), du comité départemental des retraités et personnes âgées(CODERPA), ou du schéma départemental des déchets, autant de compétences concernées par la loi du 13 août 2004. Le département de la Côte d'Or vient de voter une hausse fiscale de 2,1 %, taux qui ne tient pas compte de la revalorisation forfaitaire des bases inscrite dans la loi de finances, M. le Rapporteur, comme il est d'usage. En 2006 et 2007, nous nous efforcerons de maintenir ce niveau de pression fiscale. Je négocie donc, comme chaque département, pied à pied avec le préfet : ainsi, pour le transfert du schéma départemental des déchets, celui-ci veut me confier 5 % d'un équivalent temps plein d'un cadre de la préfecture. De mon côté j'en réclame 10 % ! Ces négociations sont donc menées poste par poste, ou demi-poste par demi-poste ! J'ignore si nous devrons encore accroître nos impôts en 2006, mais les dispositions contenues dans les lois de décentralisation et dans la loi organique apportent des garanties s'agissant de la compensation qui doit se faire « à l'euro près ». Cette compensation « à l'euro près », nous la constatons pour le RMI. Si le RMI n'était pas compensé, par exemple, la Côte d'Or aurait dû réévaluer ses impôts de 4,5 % et non pas de 2,1 %. Puisque le Gouvernement nous a promis que les 453 millions d'euros nous seront reversés, j'ai considéré qu'il ne fallait pas alourdir inconsidérément la charge pesant sur le contribuable départemental. M. Bernard CAZEAU : Pourquoi certains départements s'inquiètent-ils de la tournure que prend la décentralisation ? Je vous répondrai moi aussi à travers l'exemple de mon département, la Dordogne, relativement pauvre puisqu'il se situe au quatre-vingt-huitième rang en matière de richesse fiscale. Les nouvelles compétences transférées se traduiront, pour mon département, par le transfert de 710 agents de l'État, provenant notamment de l'éducation nationale et de la DDE. La difficulté principale à laquelle nous sommes confrontés est l'insuffisante compensation des charges patronales. En effet, bien que l'État émarge sur la feuille de paie d'un agent à hauteur de 53,14 %, la charge patronale réellement payée par l'État n'est que de 15 %. Sont en effet fictives certaines cotisations, les pensions, la charge de l'État au titre de l'assurance maladie et des accidents du travail ce qui représente 38,14 %. La charge patronale pour le département sera de 47,1 % du traitement indiciaire brut, soit un écart de 32,1 points, qui ne sera sans doute pas compensé par l'État. Compte tenu de la masse salariale brute totale transférée (16,330 millions d'euros), la dépense non compensée s'agissant de la charge patronale atteindra 5.241.930 euros. Je pourrais faire la même démonstration pour la responsabilité civile, la médecine du travail ou le régime indemnitaire. Bref, les dépenses totales liées à des transferts de personnels d'Etat non compensés à l'heure actuelle, pour mon département, s'établissent à 7 115.620 euros. Et je ne parle pas du problème que pose, s'agissant du transfert des TOS, la compensation des emplois précaires, autre motif d'inquiétude. Mon département va se voir transférer l'entretien de la RN 89 et de ses 144,5 kilomètres. Pour l'entretien de ces routes, l'État nous transfère 540 098 euros pour le petit entretien (signalisation...) et 574 420 euros pour le gros entretien (revêtement de chaussées, réparations...). S'agissant de routes nationales à fort trafic, leur renouvellement doit être assuré au moins tous les dix ans. Cela représente 14,5 kilomètres par an, soit, compte tenu du coût annuel moyen du gros entretien des routes départementales qui est de 46 000 euros par kilomètre, une dépense supplémentaire annuelle de 667 000 euros. Or la compensation de l'État se limite à 574.420 euros : la différence, 92 580 euros, restera à la charge du département. Enfin, j'évoquerai la remise en état des routes nationales transférées et la question du décroisement. La RN 89 qui sera transférée est en mauvais état. Une étude de la DDE du 20 septembre 2004 le confirme : 25 % des tronçons sont très dégradés, 14 % dans un état médiocre et 59 % dans un état correct. Voici l'estimation prévisionnelle des dépenses de remise en état : 18,5 millions d'euros de travaux à réaliser, dès le transfert, pour la partie très dégradée (sous la pression notamment des revendications très fortes des populations), plus 6 millions d'euros, sur trois ans, pour la partie en état simplement médiocre, soit une dépense de 20,5 millions d'euros en 2007 puis de 2 millions d'euros en 2008 et 2009, dépense qui, compte tenu du décroisement envisagé, ne serait pas compensée. Sachant qu'un point de fiscalité dans mon département représente environ 1 million d'euros, je vous laisse calculer quel pourrait être l'impact de ces transferts en termes de fiscalité. M. Alain GEST : Que représentent les 210 kilomètres de routes nationales transférées au regard de l'intégralité de votre réseau département actuel ? M. Louis GISCARD d'ESTAING : Et que pensez-vous de la construction de l'autoroute A 89, qui serait parallèle à la RN 89 ? M. le Président : Je consens à ce que M. Bernard Cazeau réponde, mais prenez la parole chacun à votre tour. M. Bernard CAZEAU : Nos 5 000 kilomètres de routes départementales ont été régulièrement entretenus. Là, on nous transfère brutalement quelque 160 kilomètres... M. le Président : Quel pourcentage de réseau supplémentaire cela représente-t-il ? M. Alain GEST : La réponse du président Bernard Cazeau est claire : il ne devra entretenir que 160 kilomètres supplémentaires par rapport aux 5 000 qu'il assumait déjà. M. Bernard CAZEAU : Mais l'état de la voirie transférée est extrêmement dégradé. M. Louis GISCARD d'ESTAING : Confirmez-vous que l'A 89 est parallèle à la RN 89 ? M. Bernard CAZEAU : En partie, oui, mais je ne vois pas le rapport ! Mme Anne d'ORNANO : Le Calvados fait partie des départements qui, cette année, ont accru leurs impôts davantage que les autres : je les ai augmentés de 7,5 %, après une première hausse de 2,5 % l'année dernière. Il faut dire que je ne les avais pas augmentés depuis dix ans ; j'espérais pouvoir continuer ainsi, mais cela n'a pas été possible. Nous étions parvenus à absorber l'impact des 35 heures et le transfert de nouvelles compétences mais nous avons été « plombés », si j'ose dire, par l'APA, que je qualifie d'ailleurs d'« ADPA », car ce sont les départements qui en paient la plus grande part. Il était prévu, au départ, que le nombre de bénéficiaires se stabiliserait à 8 000, mais il a vite atteint 12 000. Les calculs de départ étaient donc erronés, dans mon département comme dans la plupart des départements. En 2004, nous avons dépensé 46,2 millions d'euros sur l'APA. Les recettes versées par le FFAPA s'étant élevées à 15 millions d'euros, il reste à la charge de mon département une dépense de 31,2 millions d'euros, à laquelle j'ôte les 11 millions d'euros que je consacrais à la PSD, ce qui représente au total un surcoût net de 20 millions d'euros. Mon département était en mesure de financer seulement 5 millions d'euros. Il lui restait donc 15 millions d'euros à trouver. Un point d'impôt représente pour mon département 1,5 million d'euros : nous avons par conséquent dû augmenter les impôts de 10 % en deux ans uniquement pour combler le trou de l'APA. Cela étant dit, j'espère pouvoir continuer ainsi. Je fais confiance à l'avenir car la Constitution prévoit que les transferts nous serons remboursés à l'euro près. Pour le moment, s'agissant du RMI, cela fonctionne bien, même si nous devons avancer un peu de trésorerie. S'agissant des routes, chaque département est un cas d'espèce et doit faire l'objet de négociations particulières. Le décroisement, dans l'immédiat, est défavorable à certains conseils généraux, y compris au Calvados, mais je pense que tous ces problèmes pourront être réglés. Quant au transfert des TOS en 2006, le périmètre de la future compensation, qui ne tiendrait pas compte des CES et CEC, suscite en effet de petites craintes. On nous a dit que ces contrats pourraient être transformés en contrats d'avenir mais ces derniers seront financés par les départements. En résumé, l'augmentation des impôts, à laquelle je regrette d'avoir dû procéder, est uniquement imputable à l'APA, pas à la décentralisation. M. Claude HAUT : Il est difficile de comparer l'évolution de la fiscalité dans les différents départements car les situations sont très diverses. Aucun président n'a la volonté farouche de l'alourdir ; lorsque l'un d'eux s'y résout, c'est qu'il s'y voit contraint. Tous les départements n'ont pas les mêmes possibilités de négocier. Certains départements obtiennent des compensations en personnel - venant de l'ANPE, par exemple les personnels qui géraient le FSL au nom de l'État - tandis que d'autres n'y ont pas droit. Je trouve surprenant que l'ensemble des personnels qui s'occupaient des compétences transférées aux départements ne soit pas systématiquement affecté aux départements. Il semble que certains départements parviennent à équilibrer leurs dépenses et leurs recettes de RMI tandis que d'autres en sont loin. Pour mon département, sur la base de 2004, la différence entre la dépense et la recette atteint 8,6 millions d'euros. Or le début d'année 2005 s'avère encore plus inquiétant puisque, si la tendance des mois de janvier et février (un différentiel mensuel de 1,1 million d'euros a été enregistré) se confirmait, la différence atteindrait 13 millions d'euros en année pleine. La réponse du Premier ministre à propos du RMI nous satisfait tout à fait pour 2004 mais j'appelle de mes vœux une vraie réflexion pour les années 2005 et suivantes. En effet, la TIPP ne constitue pas un financement dynamique, et cela risque de nous placer dans des situations délicates. Le nombre de kilomètres de routes transférées à assumer ne sera pas identique dans tous les départements, et celles-ci seront dans un état plus ou moins bon. C'est pourquoi il est, là encore, très difficile de comparer ; il faut donc analyser au cas par cas, département par département, ce qui motive les décisions des élus. M. Pascal TERRASSE : Le département des Hauts-de-Seine dispose de ressources supérieures au total de celles des quinze départements les plus pauvres de France. Pensez-vous qu'un véritable dispositif de péréquation s'impose ? J'ai cru comprendre que le président de l'UMP préconisait un renforcement du rôle des départements en matière d'enseignement secondaire. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous été associés aux travaux de la « commission Fouquet » sur la réforme de la taxe professionnelle ? Jugez-vous utile de réformer cette taxe, considérant qu'elle produit l'essentiel de la ressource départementale ? Je voudrais que vous vous exprimiez à propos des cotisations fictives de l'État au titre des charges payées aux fonctionnaires. Il n'existe en effet pas de caisse propre pour les fonctionnaire s'agissant des cotisations sociales, hormis pour les cotisations salariales. Le transfert des personnels de l'État vers les collectivités territoriales provoquera une augmentation très sensible des cotisations sociales acquittées par les départements. Si la mise en place des 35 heures a entraîné un accroissement de 7 % de la masse salariale, l'augmentation des charges patronales que subiront les départements du fait du transfert des TOS devrait entraîner une augmentation de 28 %de la masse salariale. Qu'en pensez-vous ? Il semblerait que l'État demande à chaque département de délibérer avant fin mars pour savoir s'il accepte le transfert des routes nationales. L'État vous a-t-il transmis des informations concrètes sur ces transferts ? S'il ne l'a pas fait, l'opération est un chèque en blanc ou un marché de dupes. Ayant été le rapporteur du projet de loi relatif à l'APA, je connais bien ce dossier. D'abord, il était prévu que le nombre de bénéficiaires, en régime de croisière, atteigne 800.000 ; or il semblerait que, fin 2005, il se situe à autour de 825.000. Par ailleurs, la loi prévoyait une compensation à hauteur de 50 % du montant global du coût de l'APA. Les informations données par Mme Anne d'Ornano m'étonnent. Alors que le FFAPA va verser 800 millions d'euros au profit des départements, je ne comprends pas pourquoi, cette année en particulier, elle serait obligée d'augmenter ses impôts, alors que l'effort de l'État doit s'accroître cette année précisément. Il serait intéressant que nous nous rendions sur place pour vérifier les dires de Mme Anne d'Ornano, qui font du Calvados un cas d'école intéressant. M. Charles de COURSON : À quoi est due l'augmentation de la pression fiscale locale ? Le président Claudy Lebreton a parlé du RMI, de l'APA et des SDIS, mais a omis de parler de l'impact direct, mais surtout indirect, des 35 heures. Pourrait-il nous fournir, sur la base d'une méthodologie dont nous pourrions convenir avec le Rapporteur, l'analyse de ce que coûtent ces quatre facteurs à chacun des102 départements ? Pour le département de la Marne, le coût du SDIS représente l'équivalent d'un point de fiscalité par an. L'APA est le problème le plus important. Il conviendra de retrancher du montant des dépenses effectives la recette transférée au titre de l'APA ainsi que le coût de la PSD afin d'obtenir le coût net. Le seul problème lié au RMI est le différentiel résultant du délai de compensation. Le surcoût lié au RMI n'est pas très important. Enfin, il serait très intéressant de connaître le coût direct et indirect de l'application des 35 heures pour les 102 départements. On peut facilement mesurer le coût direct : certains départements ont augmenté leurs dépenses de personnel de 11 % ; d'autres, comme le département de la Marne, se sont limités à une augmentation de 5 %, moyennant des redéploiements. Mais c'est surtout l'effet indirect qui est considérable, toutes les structures sociales au sens large (maisons de retraite, foyers de vie...) étant touchées. Face à l'augmentation de ces coûts, il conviendra de voir de combien a augmenté la fiscalité. Nous entrons là dans un problème méthodologique compliqué : avec les compensations et dégrèvements pris en charge par l'État, une partie de l'augmentation de la fiscalité est dissimulée dans la fiscalité nationale et les chiffres de la comptabilité nationale ne sont plus guère éclairants. Un travail aussi sérieux serait-il possible, pour l'avenir, concernant quatre domaines : l'incidence de la compétence handicap, des contrats d'avenir... M. le Président : M. Charles de Courson a raison. Les contrats d'avenir auront-ils un coût pour les départements ? Et, si oui, à combien s'élèvera-t-il ? L'excellent rapport de Mme Christine Boutin démontre qu'il faut s'attendre à un surcoût de 15 à 20 %. M. Charles de COURSON : Outre l'incidence de la compétence handicap et les contrats d'avenir, restent les TOS et le transfert de l'équipement. Celui-ci pose deux problèmes. En fonctionnement, l'État nous transférera des moyens, mais quel sera l'ordre de grandeur du différentiel de coût d'entretien normal ? En investissement, quel montant sera nécessaire pour remettre les routes nationales en état ? Dans la Marne, 700 millions d'euros seront requis alors que le budget consacré aux 4.000 kilomètres de routes départementales s'élevait à 18 millions d'euros. Mettons-nous d'accord sur une méthodologie pour mener à bien cette analyse objective pour le passé comme pour l'avenir, qui coupera l'herbe sous le pied aux chiffres lancés ici ou là. M. René DOSIÈRE : À la liste dressée par M. Charles de Courson, je souhaiterais ajouter les dépenses facultatives. Depuis 1983, les départements ont reçu des compétences nouvelles et ont du mal à affronter leurs dépenses obligatoires mais ils semblent qu'ils ne renoncent pas à leurs dépenses facultatives. Pourront-ils encore longtemps maintenir le même niveau de dépenses facultatives ? La solution ne consisterait-elle pas à resserrer les attributions du département sur ses compétences obligatoires ? Vous nous avez dit qu'il est difficile d'analyser l'évolution de la fiscalité mais il existe un critère très simple : l'appartenance à la droite ou à la gauche est-elle un indicateur pertinent d'augmentation de la fiscalité ? Apparaît-il, par exemple, que les départements de droite ont tendance à accroître ou à réduire la fiscalité ? M. Jean-Jacques DESCAMPS : Je suis très impressionné par la qualité de nos interlocuteurs ; mais vous auriez pu être 102 et nous aurions entendu 102 discours différents. Si vos collaborateurs se sont déplacés si nombreux, c'est sans doute qu'ils envisagent de compléter ultérieurement notre information, et je crois que leur tâche sera rude... Je voudrais moi aussi que nous y voyions plus clair dans l'histoire et les perspectives de la fiscalité locale. Il serait effectivement intéressant que nous obtenions une information précise, par département, de l'évolution de la fiscalité et des dépenses, avec des tris, des classements, selon leur appartenance politique ou leur histoire. Je préconise pour ma part une classification en trois catégories : les dépenses de structure ; les dépenses correspondant à l'exercice de compétences fortes, comme le social, la sécurité civile ou les collèges ; les dépenses que je qualifierai de « politiques », c'est-à-dire ne relevant pas du corpus de compétences du département, comme la culture, le sport, l'aide aux associations, les dépenses personnelles du président du conseil général ou la liste spéciale. Une autre distinction pourrait être opérée entre dépenses voulues et subies. Lorsque l'État a transféré les lycées et les collèges, des retards ont dû être rattrapés, mais certaines collectivités ont aussi fait le choix politique de faire davantage. Le RMI ou l'APA, au contraire, sont vraiment des dépenses subies. Le même type de classifications serait plus aléatoire à établir pour l'avenir, vous l'avez dit, M. le Président, mais il serait particulièrement utile s'agissant des TOS et des routes, les autres transferts étant marginaux. Les TOS seront largement favorisés par le transfert ; si l'incidence du régime indemnitaire se confirme, ils devraient se précipiter dans les départements plutôt que dans la rue ! Notre difficulté est de faire entrer un peu de transparence dans un système bien compliqué, où les compétences s'entrecroisent. L'ADF serait-elle favorable à ce que, dans la foulée des travaux prospectifs de la commission d'enquête, nous émettions des propositions sur l'évolution et la spécialisation des compétences des collectivités territoriales ? Il est toujours question de dépenses supplémentaires et jamais d'économies. Lorsqu'on transfère une compétence, on ne se demande même pas si la gestion de proximité pourra apporter quelque économie. Or, en dix ans, si Mme Anne d'Ornano a évité d'augmenter ses impôts, c'est parce qu'elle a accompli des économies pour couvrir les augmentations de dépenses qu'elle subissait. Peut-on chiffrer l'espérance de productivité qui produirait autre chose qu'une hausse de la fiscalité départementale ? M. le Président : Je vous demande de poser des questions plus courtes car nous sommes là pour écouter les présidents de conseils généraux, pas pour leur faire la leçon. M. le Rapporteur : Il n'est pas incongru que la Commission d'enquête pose des questions ! M. le Président : On peut poser des questions courtes et précises. M. Jean-Pierre GORGES : Je répète, quant à moi, les mêmes questions à chaque audition. J'aurais aimé que l'ADF nous décrive, pour la période 1992-2003, les incidences exactes des événements politiques sur les charges de fonctionnement. Les généralités, j'en ai assez ! Nous attendons des chiffres précis ! J'ajoute à la liste de M. Charles de Courson la réforme de la taxe professionnelle. Je suis arrivé à mesurer son impact ; l'ADF devrait en faire de même. Vous devez aussi disposer de chiffres précis à propos de l'évolution des compétences facultatives : tendent-elles ou non à dériver ? Aujourd'hui, tout le monde, de la région à la commune en passant par le département et l'intercommunalité, s'est emparé des mêmes compétences. Si chacun comprend l'intérêt politique du système, il n'en demeure pas moins que celui-ci génère un surcoût. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait anticiper un dérapage fiscal en 2005 ou 2006. Les régions nous ont servi à peu près le même discours : les hausses fiscales seraient des mesures prophylactiques, opérées en prévision d'augmentations de charges. M. le Président : Les régions ne nous ont servi aucun discours ! Nous n'avons pas encore entendu leurs représentants ! M. Jean-Pierre GORGES : Mais ils ne se sont pas privés de faire des déclarations. Comme chacun sait, les transferts des dernières compétences, en 2006, vont générer des charges nouvelles. Alors pourquoi les départements n'ont-ils pas, par précaution, adopté un mot d'ordre identique et augmenté immédiatement leur fiscalité, par précaution ? M. Michel DIEFENBACHER : La disparité entre départements, sur laquelle le président Lebreton a tant insisté, soulève le problème de la péréquation. À cet égard, quelle appréciation portez-vous sur la réforme des dotations de l'État ? Dans mon département, les dépenses de péréquation progressent ainsi deux fois plus vite que le coût de la vie. À plus long terme, il faut se demander si l'amélioration de la péréquation peut être obtenue par la fiscalité ou par les dotations. Compte tenu de la disparité des bases, la fiscalité est un élément d'injustice. Les dotations peuvent corriger ces écarts mais la récente réforme constitutionnelle ne va pas dans ce sens. Je n'ai pas bien compris la démonstration du président Lebreton concluant à un surcoût pour les TOS. À ma connaissance, nous n'en sommes pas encore à l'évaluation des coûts de cette opération de transfert. Nous n'en sommes qu'à la première étape qui consiste à prendre la photographie des effectifs avec le rectorat. Ce n'est que dans un deuxième temps que l'on en viendra à apprécier le coût de cette opération. Il dépendra évidemment pour partie du statut des nouveaux personnels : s'ils sont versés dans les cadres territoriaux existants, le régime indemnitaire étant plus favorable que celui de l'État, il en résultera un surcoût pour les départements. J'ai pourtant cru comprendre que le président Lebreton se prononçait pour cette formule. Je lui demande par conséquent de confirmer et d'expliquer son analyse. M. Denis MERVILLE : J'ai entendu dire que l'État n'aurait pas payé le dernier mois de 2003 lui incombant pour le RMI. Qu'en est-il ? Toujours à propos du RMI, il serait prévu de distinguer entre insertion et gestion administrative, et de créer des postes de référents. Est-ce une obligation ? Cela entraînera-t-il des charges supplémentaires ? Hier, dans le cadre de la décision modificative numéro un, mon département a enregistré un bonus de recettes par rapport aux prévisions de 1,3 million d'euros, mais on m'a déclaré que celui-ci serait reversé au FSL et au FAJ. Qu'en est-il exactement ? Je souhaiterais qu'une attention particulière soit portée aux évolutions fiscales facultatives, à législation constante, qui résultent de choix politiques. À titre d'exemple, nous accordions des bourses d'étude et nous aidions la restauration dans les cantines. Aujourd'hui, le conseil général décide de majorer les barèmes de 50 %. Cela coûtera plus cher au département mais la décentralisation n'y est pour rien : c'est un choix politique, que je ne juge pas car il relève de la libre administration des collectivités territoriales. Quand les 35 heures ont été instaurées, nous nous sommes efforcés d'améliorer notre efficacité et de ne pas créer les emplois qui s'imposaient mathématiquement. Et voilà qu'aujourd'hui, le département annonce la création de 250 emplois, sous prétexte de décentralisation. J'ai plutôt tendance à penser qu'ils sont imputables aux 35 heures. Tout laisse à penser que la compétence handicap, dans les années à venir, entraînera un surcroît de charges, mais elle résulte d'un changement de législation. Je voudrais que nous raisonnions à législation constante, au moins sur certains départements tests. M. le Rapporteur : Où en est le transfert des personnels nécessaires à la gestion des TOS ? Le président Bernard Cazeau a évoqué un décalage dans l'évaluation du coût d'entretien des routes. Comment expliquer ce décalage ? Globalement, pouvez-vous évaluer les poids respectifs des causes exogènes et endogènes - c'est-à-dire résultant des choix politiques de la collectivité - de l'augmentation des taux de fiscalité locale ? La décentralisation peut effectivement se traduire par une amélioration de la gestion et par des économies, mais cet aspect est trop négligé. Quels travaux l'ADF mène-t-elle à ce sujet et quelles réflexions vous inspire-t-il ? Enfin, d'un point de vue strictement méthodologique, il me semble cohérent d'interroger Mme et MM. les présidents de conseils généraux sur les généralités, mais aussi sur les exemples que constituent leurs collectivités. M. le Président : Certaines questions se recoupant, je vais résumer. Puisque certains ont déclaré que seule l'APA était source d'augmentations d'impôts, je souhaiterais que chacun des présidents nous dise quel est, pour son département, le différentiel entre les recettes et les dépenses de RMI, et comment il le finance. L'État compense-t-il la participation qu'il accordait précédemment à l'ANPE dans certains départements ? Comment était financée l'ANPE l'année dernière, combien d'emplois l'État prenait-il en charge et que compense-t-il cette année ? Certains départements ont mis en place le RMA, revenu minimum d'autonomie. L'évaluation de Mme Christine Boutin - soit un surcoût de 20 %, qui vaut aussi pour les contrats d'avenir - est-elle exacte ? Quels effectifs ont été transférés à chacun de vos départements pour gérer le RMI ? De même, pour le FSL et le FAJ, les crédits transférés vous paraissent-ils correspondre aux dépenses engagées en 2004 et quels personnels vous sont affectés pour gérer ces fonds ? Du personnel est-il transféré pour la gestion des TOS, et avez-vous une idée de la compensation concernant les CES et les CEC ? De même, s'agissant de l'équipement, le personnel des départements n'est pas dimensionné pour absorber les routes transférées. Le personnel transféré vous paraît-il suffisant et adapté aux fonctions qui devront être remplies par les services des départements, notamment en catégorie A ? Avez-vous une idée de ce que recevront les départements en matière de taxe spéciale sur les conventions d'assurance ? Quelle évolution cette ressource suivra-t-elle et son niveau sera-t-il suffisant, dans chaque département, pour compenser les transferts ? Vous avez peu parlé du Fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE). Sa suppression vous contraint-elle à augmenter vos crédits ? Les zones rurales de vos départements ne sont-elles pas défavorisées, dans la mesure où toutes les agences de bassin ne disposent pas des mêmes moyens ? Auriez-vous des propositions tendant à améliorer la péréquation ? Vous évoquez dans certains de vos rapports le problème des demandeurs d'asile et des jeunes étrangers qui, en principe, sont à la charge de l'État. Peut-être notre rapport devrait-il clarifier cette question et inviter chacun à assumer ses responsabilités. La loi prévoit cette année une augmentation justifiée de la rémunération des sapeurs-pompiers volontaires. L'État apportera-t-il la compensation de 50 % à laquelle il s'était engagé ? Le président du conseil général de la Dordogne, département pauvre, se satisfait-il d'une péréquation minimale, adossée aux seules charges de voirie ? Ne serait-il pas justifié de tenir compte, par exemple, de l'APA ou du RMI, comme le préconise l'excellent rapport de M. Jean François-Poncet ? Enfin, quelles sont vos réactions et vos propositions au sujet de la réforme de la taxe professionnelle ? M. Claudy LEBRETON : L'exercice est compliqué dans la mesure où nous découvrons vos questions et que celles-ci appellent des réponses chiffrées. Je précise également que l'Assemblée des départements de France est une tête de réseau qui n'emploie que trente-sept collaborateurs : c'est donc une petite structure administrative. Pour accomplir le travail énorme qu'exigent vos questions, elle peut interroger les services des départements mais les délais de réponse sont parfois un peu longs. Nous nous efforcerons néanmoins d'approfondir notre contribution à la lumière des questions posées par les membres de la Commission d'enquête. Notre deuxième difficulté est de nous exprimer au nom de tous les départements de France, non pas pour des raisons politiques mais compte tenu de l'extrême disparité des situations. Tous les départements ont reçu le questionnaire émanant de votre Commission d'enquête et ils le compléteront. M. le Rapporteur : Ce questionnaire est en voie de transmission aux membres de notre Commission d'enquête. M. Claudy LEBRETON : La péréquation financière est rendue indispensable par la disparité dont je viens de faire état. Que penser de la réforme des dotations de péréquation départementale entrée en vigueur en 2005 ? Alors que mon département présente le quatre-vingt-treizième potentiel fiscal de France et que sa situation était bien plus délicate que celle des vingt-quatre départements bénéficiant de la dotation de fonctionnement minimale (DFM), il n'était pas éligible à cette dotation jusqu'en 2005. Si nous l'avions perçue depuis le début, nous aurions fait d'autres choix fiscaux. Le rapport du sénateur Jean François-Poncet est effectivement remarquable : il démontre que la péréquation va jusqu'à aggraver des inégalités, appauvrissant des départements pauvres et enrichissant des départements riches. Je ne mésestime pas la complexité du système mais il me paraît indispensable que nous le révisions. La notion de péréquation fait certes l'unanimité, mais on ne sait pas clairement quel contenu il convient de lui donner. Si les lycées et les collèges étaient regroupés sous la tutelle des départements, certains d'entre eux n'éprouveraient aucune difficulté à faire face à cette nouvelle compétence, mais d'autres ne le pourraient pas. L'ADF a bien participé à la « commission Fouquet » ; nous aurons l'opportunité d'intervenir sur le sujet dans les semaines à venir. Nous sommes unanimes à demander le maintien d'un impôt économique : les entreprises doivent participer, avec les ménages, au financement local. Concernant le transfert des personnels de l'État aux collectivités territoriales, pour ma part, j'étais favorable à l'idée d'un transfert de ces personnes à partir des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale et notamment, pour les TOS, à l'entrée de ces derniers dans les cadres d'emploi existants de la fonction publique territoriale. Avoir créé un cadre d'emploi spécifique est une erreur - même si les raisons de cette décision sont bien connues. L'État organisera encore les concours en 2005, mais, à partir de 2006, les départements, qui sont aussi des centres de gestion, devront s'en charger. Organiseront-ils alors des concours pour le cadre d'emploi spécifique ou pour le cadre d'emploi territorial ? L'ADF est plutôt favorable à la seconde option. M. le Rapporteur : Quel qu'en soit le prix ? M. Claudy LEBRETON : Mais non. M. le Rapporteur : Pourquoi ne calez-vous pas la situation d'atterrissage en fonction des coûts ? M. Claudy LEBRETON : Les présidents de département sont des élus responsables ; des estimations financières seront effectuées. Le problème sera la cohabitation, dans les départements, entre les agents de l'État transférés et les agents territoriaux, qui ne seront pas soumis aux mêmes règles concernant le temps de travail, les congés. S'agissant des 35 heures, certaines collectivités territoriales étaient déjà passées aux 35 heures avant l'adoption de la loi, voire en dessous, tandis que d'autres étaient encore à 39 heures, et la moyenne nationale se situait à 37 heures. L'impact des 35 heures doit donc être mesuré au cas par cas. On peut aisément calculer la dépense de personnels par habitant pour chaque département. Cependant, les collectivités peuvent choisir de « faire » ou de « faire faire » : soit elles assument directement les services publics, soit elles délèguent des compétences à des associations, et tout calcul doit tenir compte de ce biais. Sur l'APA, je laisserai à notre spécialiste le soin de répondre. L'ADF est disposée à vous apporter des réponses sur l'impact des compétences énumérées par M. Charles de Courson ; elle appliquera la méthodologie qui aura été retenue sous votre autorité. Les départements ont compétence obligatoire en matière de routes, de collèges, d'action sociale, de SDIS, et, dans ces domaines, ils sont seuls financeurs. À côté de l'exercice de ces compétences, ils définissent des politiques d'accompagnement au développement local, d'aménagement du territoire solidaire, notamment dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, de la vie sociale. Ainsi, de très nombreuses réalisations ne verraient pas le jour sans la participation financière des collectivités, pourtant facultative, ou optionnelle. En matière de dépenses obligatoires, les disparités sont également très importantes. Le budget du département des Côtes-d'Armor est égal au triple de la somme des budgets de la commune chef-lieu et de son agglomération, alors que, dans d'autres départements, le budget du département équivaut à la moitié de cette somme. Il incombe par conséquent à mon département une responsabilité particulière de solidarité envers les petites communes, lesquelles ne peuvent assumer bon nombre d'opérations courantes d'entretien du patrimoine. M. le Rapporteur : Au contraire ! Votre ville centre étant moins grosse, votre responsabilité de péréquation est moindre ! M. Claudy LEBRETON : Je pense que mon propos a été suffisamment clair. Y a-t-il une différence de comportements fiscaux entre la droite et la gauche ? Parmi les départements qui ont le plus augmenté leur fiscalité cette année, je retrouve l'Aisne, mais aussi le Loir-et-Cher, département présidé par M. Maurice Leroy, ainsi que la Marne. M. Charles de COURSON : Après vingt ans de baisse ! M. Claudy LEBRETON : Il faut en effet prendre en compte la moyenne pluriannuelle. Dans mon département, de 1996 à 2005, l'augmentation de la pression fiscale a été en moyenne de 1,8 %. J'achève l'énumération des départements ayant le plus augmenté leurs impôts : la Meurthe-et-Moselle (+12,5 %), le Maine-et-Loire (+8,4 %). Il s'agit donc de départements de droite et de gauche, et la même observation pourrait être faite en ce qui concerne ceux qui affichent un taux de progression nul. Une analyse par strates offrirait une autre grille de lecture. M. René DOSIÈRE : Les régions étant toutes à gauche, cela facilite les raccourcis... M. le Président : Les régions ne sont pas à l'ordre du jour ; nous auditionnerons leurs représentants la semaine prochaine. M. Claudy LEBRETON : Nous avons commandé à un cabinet spécialisé une étude sur les impacts financiers de la décentralisation ; ses conclusions nous seront remises lors des assises des conseils généraux, qui se tiendront à Nantes, du 5 au 7 avril. Un département dispose de plusieurs leviers budgétaires : la maîtrise des dépenses de fonctionnement (les dépenses de personnel, d'action sociale, et de SDIS représentent à elles seules 75 % des dépenses des départements) ; le contrôle de l'effectivité des politiques menées à travers des missions d'inspection et de contrôle ; l'emprunt. Les taux n'ont jamais été aussi bas et certaines collectivités ont tort de ne pas en profiter. Pour ma part, je suis partisan d'un mix : plutôt que de procéder par paliers, par à-coups, je préfère anticiper et maintenir une augmentation de la fiscalité proche de l'inflation. M. le Rapporteur : Que signifie « proche de l'inflation » ? Que faites-vous de l'effet bases ? M. Claudy LEBRETON : Les chiffres sont généralement donnés, hors revalorisation des bases décidée par la loi de finances. M. le Rapporteur : Pardonnez-moi, mais la notion « proche de l'inflation », coupée de l'effet base, perd tout son sens. Il n'y a aucune raison de distinguer l'effet taux et l'effet bases, à moins de rechercher des astuces de communication. M. Claudy LEBRETON : Expliquer la complexité de la fiscalité départementale demanderait du temps. Il faudrait aussi prendre en compte dans l'effet bases, au-delà de la revalorisation des bases décidée en loi de finances, l'évolution des bases due par exemple aux constructions nouvelles, aux disparitions d'entreprises ou aux exonérations de taxe d'habitation qui varient considérablement d'un département à un autre. L'État ignore encore comment il va s'y prendre pour transférer dans chaque département les agents des rectorats chargés de la gestion des TOS, sachant qu'ils habitent souvent le chef-lieu régional. Il faudra donc répartir ces personnels dans chaque département. Les modalités du découpage n'ont pas encore été arrêtées. Quelles seront les répercussions dans nos propres DRH ? Nous n'avons pas encore de réponse. Nous sommes actuellement en cours de négociation. L'ADF pourra, me semble-t-il, effectuer une analyse des causes exogènes et endogènes des variations de fiscalité. En 2004, le RMI a coûté 2,7 millions d'euros supplémentaires au département des Côtes-d'Armor. M. le Président : Comment financez-vous ce surcoût jusqu'à présent ? M. Claudy LEBRETON : Sur notre trésorerie. En 2005, si le rythme d'évolution des recettes et des dépenses observé jusqu'à présent se poursuit, les dépenses supplémentaires devraient revenir à 1,7 million d'euros. L'État compensera pour 2004 le différentiel de 2,7 millions d'euros mais seulement à la fin de l'année 2005 au vu des comptes administratifs 2004. S'agissant de l'ANPE, près de 600 emplois de conseillers professionnels intervenaient dans le dispositif d'insertion sociale et professionnelle, ce qui représente 45 millions d'euros. Pour l'anecdote, lorsque les négociations département par département ont commencé, le coût annuel estimatif d'une personne de l'ANPE mise à la disposition du département dans le cadre de l'insertion sociale et professionnelle variait de 47 000 à 97 000 euros par an selon les délégations départementales de l'ANPE ! Nous nous sommes finalement calés sur le chiffre de 47 000 euros mais nous avons tout de même un peu le sentiment que nous payons les frais de structures de l'ANPE. Et une question d'ordre juridique se pose : serons-nous obligés de passer des appels d'offres pour les prestations servies par l'ANPE ? M. le Président : Recevez-vous une compensation de l'État ? M. Claudy LEBRETON : Il n'y a plus de compensation à partir de cette année. Certains départements finançaient déjà des agences ANPE. Mais, à partir de cette année, nous ne percevons plus aucune compensation. Pour la gestion du FSL ou du FAJ, l'État accorde 0,11, 0,27 ou 0,74 agent par département ! Il est difficile de s'y retrouver ! Que signifie concrètement 0,11 agent ? M. le Président : Une règle générale s'applique-t-elle au moins à tous les départements, ou bien la répartition est-elle faite au coup par coup ? M. Claudy LEBRETON : Pour les 7 700 RMIstes de mon département, l'État a transféré huit agents, c'est-à-dire à peu près 1 pour 1 000 mais le taux est variable d'un département à l'autre. Mme Anne d'ORNANO : Je regrette que M. Pascal Terrasse soit parti car il a semblé mettre en doute les comptes de l'APA dans le Calvados. Je lui propose de venir vérifier sur place et je suis prête à communiquer l'ensemble des chiffres à votre Commission d'enquête. S'agissant des routes, les départements sont invités à se prononcer avant le 5 avril. La plupart d'entre eux ont tenu leur session. Nous disposions bien des renseignements. Nous ne disposions pas de l'audit sur l'état des routes transférées, nous ne l'aurons qu'en août, ce qui pose certains problèmes. C'est pourquoi certains départements de la majorité présidentielle de droite, y compris le mien, ont assorti de réserves leur avis favorable. Le montant des charges nettes des départements liées à l'ADPA, entre 2002 et 2004, a progressé de 144 %. D'après les données de l'ADF, le produit du FFAPA - rebaptisé CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie - a couvert 48 % des dépenses en 2002, 42,5 % en 2003, et le taux devrait chuter à 36,4 % cette année. Nous sommes donc loin de la répartition 50-50 dont parlait M. Pascal Terrasse. M. le Président : En 2002, le taux atteignait tout de même 48 %. Mme Anne d'ORNANO : Je crois qu'il était de 30 % sur le coût de l'APA et de 50 % sur le surcoût mais je n'en suis pas totalement sûre. Mais en tout cas, il est tombé à 36,4 %. Mon département a été très touché par le problème des immigrés clandestins. Nous avons longtemps été très généreux en acceptant de prendre en charge les familles avec enfants, ce qui nous coûtait un million de francs par mois. Nous ne le faisons plus depuis trois ans car cette charge incombe à l'État. Seule nous revient la charge des familles avec des enfants de moins de 3 ans et celle des femmes enceintes. Nous avons donc réduit notre effort et invité l'État à prendre dorénavant ses responsabilités. Nous avons sévi en imposant à tous les mineurs une radiographie du poignet pour vérifier leur âge et nous avons réduit les dépenses de façon importante. M. le Président : Que faites-vous quand la juge des enfants vous confie un mineur ? Mme Anne d'ORNANO : Nous exigeons que sa minorité soit prouvée : la radiographie du poignet est réputée infaillible. Je rappelle que la valeur des bases ne nous est pas encore connue lorsque nous votons notre budget, ce qui explique pourquoi nous ne prenons pas en compte les effets bases lorsque nous augmentons nos impôts. M. le Président : Et sur le RMI, quel est le différentiel ? Est-il compensé ? Mme Anne d'ORNANO : Le nombre de RMIstes par référent varie de 120 à 150 selon les départements. Le département du Calvados a soumis des propositions aux CCAS, avec lesquels il gère le système à cinquante-cinquante et nous consacrons un référent à 150 allocataires du RMI. Sur le RMA, le Calvados fait partie des départements qui ont joué le jeu mais ce n'est pas facile, car ce dispositif risque d'être supplanté par celui des contrats d'avenir. Nous avons signé quatre-vingt-quinze contrats de RMA et j'espère arriver à deux cents d'ici à la fin 2005. M. le Président : Avez-vous vérifié si le RMA présentait un surcoût par rapport au RMI ? Confirmez-vous l'avis de Mme Christine Boutin ? Mme Anne d'ORNANO : Je n'ai pas effectué d'étude assez pointue. Je peux seulement dire que le bénéficiaire du RMA a l'espoir de sortir du système RMI, ce qui entraînera une économie pour la collectivité. M. Claude HAUT : Les départements ont toujours consacré une partie de leurs moyens à des opérations facultatives, notamment en faveur de la culture et du sport : le Festival d'Avignon, par exemple, rencontrerait de grandes difficultés si nous lui retirions notre soutien. Il faut être en charge d'un département pour se rendre compte de ce que son action représente pour le milieu culturel. Il est important pour un département d'accompagner la culture. Ils le font tous. Le problème ne doit pas être inversé : on voudrait nous faire abandonner des interventions que nous avons choisies pour nous imposer des compétences sans les assortir des financements nécessaires ! Il ne s'agit pas de développer nos dépenses facultatives mais seulement de maintenir ce qui existe déjà ; à droite comme à gauche, nous en sommes tous d'accord. La gestion du RMI exige un lourd travail de contrôle. Celui-ci a commencé, il se poursuit et des pistes d'économies se profilent déjà. Pour l'ANPE, en 2004, nous partagions la dépense avec l'État (50 % pour l'État et 50 % pour le département) ; en 2005, la totalité de la charge nous incombe. Le Vaucluse doit donc s'acquitter de 300 000 euros au lieu de 150 000 euros. Le RMI, fin 2004, présentait un besoin de financement de 3,2 millions d'euros, que nous avons couvert par une ligne de trésorerie. En ce qui concerne la gestion du RMI, nous avons obtenu de l'État 1,5 poste pour 14 000 bénéficiaires. Le FSL et le FAJ, eux, n'ont pas donné lieu au moindre transfert de personnel de l'État. La somme allouée pour le FSL correspond certes presque à la réalité mais ce fonds représente bien peu de chose par rapport au RMI ou à l'APA. Le problème des demandeurs d'asile se pose également dans le Vaucluse, la préfecture refusant de recevoir les personnes et nous les renvoyant systématiquement : l'État n'assume pas ses responsabilités en la matière. Le département de Vaucluse, en deux ans, a perdu plus d'un million d'euros d'attributions du FNDAE. Le département n'a pas compensé totalement ce manque de financement en provenance du FNDAE. Nous avons donc été amenés à repousser plusieurs dossiers qui auraient dû être achevés en 2005. La péréquation concerne tous les départements et nous en reparlerons lors des assises des conseils généraux de Nantes. Les perspectives pour 2005 ne paraissent pas totalement satisfaisantes, particulièrement pour les départements les plus pauvres. Il faudra remettre l'ouvrage sur le métier. M. Bernard CAZEAU : Ayant participé de près à la mise en œuvre de l'APA, je précise que l'un de ses principes de départ était le partage à parts égales entre solidarité nationale et départementale. Ce principe n'a malheureusement pas été clairement inscrit dans la loi et la participation de l'État, de fait, est passée de 48-50 % à 35 ou 40 % selon les départements. M. le Rapporteur : D'où vient ce principe, s'il n'est pas inscrit dans la loi ? M. Bernard CAZEAU : En visite à Rodez, M. Daniel Vaillant, alors ministre de l'Intérieur, avait posé ce principe, qui n'a finalement pas été inscrit en toutes lettres dans la loi, ce qui permet à l'État de se désengager progressivement. Il ne faut pas négliger le fait que l'APA règle le problème du maintien à domicile, au moins partiellement, surtout en milieu rural, et permet de payer 1 500 emplois équivalents temps plein. Les écarts de trésorerie liés au RMI tendent à se creuser en ce début d'année : mes frais de trésorerie, en 2004, ont atteint 48 200 euros ; pour 2005, le déficit prévisionnel est de 65 000 euros. S'agissant des « petits fonds », le FSL, le FAJ et le FAE - fonds d'aide à l'énergie -, je considère que le compte y est. Par contre, sur les CLIC - centres locaux d'information et de coordination gérontologiques - et sur le patrimoine rural non protégé, dans le département de la Dordogne, l'État fait deux impasses de 77 000 et de 135 000 euros. À propos du handicap, je ne m'avancerai pas, car les chiffres exacts ne sont pas disponibles. Je crains toutefois que, pour les départements, la prestation de compensation du handicap ne soit une seconde APA. En outre, la prestation élargit son assiette à la fois sur les prestations et sur des handicaps supplémentaires, notamment psychiques. Je suis de tempérament optimiste mais j'attends de découvrir les chiffres. N'oublions pas non plus qu'il faut tenir compte de la demande citoyenne émanant des associations, qui demandent des appréciations au cas par cas, et non pas des grilles. M. le Président : Disposerez-vous tout de même d'une évaluation avant deux mois ? M. Bernard CAZEAU : Sur la prestation de compensation du handicap, nous pourrons avoir une appréciation d'ici un mois et demi environ. Sur les assistantes maternelles, tout dépend des départements. M. Claudy LEBRETON : Le FNDAE, dans mon département, représente 4,8 millions d'euros. La question renvoie à la loi sur l'eau, avec, là aussi, un vrai débat, notamment sur la péréquation et les relations avec les agences. Parmi les TOS, mon département récupère sept CES, mais le conseil général du Finistère en aura soixante-treize. S'agissant des demandeurs d'asile, la protection de l'enfance échoit au président du département, mais les demandeurs d'asile adultes relèvent de l'État. Puisque celui-ci reste généralement inactif, ils viennent frapper à la porte du département, qui assume momentanément leur accueil. Sans parler du CADA, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, pour lequel le préfet nous réclame des aides supplémentaires. S'agissant des SDIS, l'État a estimé que la prime de fidélité et de reconnaissance, en fonctionnement normal (puisqu'il y aura une montée en charge progressive) et en année pleine, coûterait 60 millions d'euros par an. Un fonds géré notamment par une entreprise spécialisée sur ce sujet sera alimenté par les départements et par l'État. La participation de l'État s'élève à 20 millions d'euros cette année. Elle sera de 30 millions d'euros l'année prochaine. Il restera donc 30 millions à la charge des départements. M. le Président : Pour cette année, avez-vous des chiffres ? M. Claudy LEBRETON : Pas encore. Nous ignorons quels revenus produiront la TSCA et la TIPP. En 2004, le rendement de la TSCA, toutes branches comprises, a été de 5,380 milliards d'euros, avec une croissance de 4,90 % par rapport à 2003. Celui de la branche qui nous intéresse - les véhicules terrestres à moteur - est évalué à 2,5 milliards d'euros, avec une croissance identique d'environ 4,90 %. Mais comment l'assiette sera-t-elle localisée ? La clé de répartition de l'assiette pourrait s'appuyer sur le nombre de véhicules immatriculés dans le département. Le projet de réforme de l'immatriculation compromet cette solution. Par ailleurs les immatriculations peuvent être déconnectées de la zone de circulation des véhicules. Mais je ne doute pas que les parlementaires sauront répondre intelligemment au problème. Sur la TIPP, la compensation de l'État à l'endroit des départements dépend de l'augmentation des recettes. Les départements doivent consentir des avances de plus en plus élevées. Au cours de l'année 2004, le taux de couverture des dépenses par les recettes se situait autour de 75 ou 80 %. Les compensations sont désormais inférieures à 50 % ! Il sera intéressant de faire le bilan des lignes de trésorerie et de crédit mobilisées. Le choix de l'année de référence sera fondamental car il vaudra pour les exercices suivants. Nous nous en entretiendrons avec le Premier ministre la semaine prochaine. Compte tenu de cette incertitude, les départements sont bien incapables, monsieur le rapporteur, de vous dire ce qu'ils feront en 2007 ou 2008. Rendez-vous fin 2005 ou début 2006 ! M. le Président : M. Claudy Lebreton, mesdames, messieurs, je vous remercie. 1 () Les graphiques présentés par M. Hoorens au cours de son audition sont reproduits dans le tome III du présent rapport. © Assemblée nationale |