

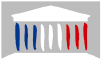 N° 2832 _______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 janvier 2006 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA MISSION D'INFORMATION (1) SUR LA FAMILLE ET LES DROITS DES ENFANTS
Président M. Patrick BLOCHE, Rapporteure Mme Valérie PECRESSE, Députés. -- TOME II AUDITIONS (1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page. La mission d'information sur la famille et les droits des enfants est composée de : M. Patrick Bloche, Président ; M. Pierre-Christophe Baguet, Mme Henriette Martinez, Vice-Présidents ; Mmes Patricia Adam, Jacqueline Fraysse, Secrétaires ; Mme Valérie Pecresse, Rapporteure ; Mmes Martine Aurillac, Christine Boutin, M. Gérard Cherpion, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Patrick Delnatte, Bernard Derosier, Pierre-Louis Fagniez, René Galy-Dejean, Pierre Goldberg, Mmes Claude Greff, Élisabeth Guigou, MM. Sébastien Huyghe, Olivier JardÉ, Mmes Annick Lepetit, Gabrielle Louis-Carabin, M. Hervé Mariton, Mmes Hélène Mignon, Nadine Morano, MM. Jean-Marc Nesme, Yves Nicolin, Bernard Perrut, Mmes Bérengère Poletti, Michèle Tabarot, M. Alain Vidalies.
TOME SECOND SOMMAIRE DES AUDITIONS Les auditions sont présentées dans l'ordre chronologique des séances tenues par la Mission. - Audition de M. Claude Martin, sociologue, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (Procès-verbal de la séance du 15 février 2005) 9 - Audition de Mme France Prioux, directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques (Procès-verbal de la séance du 15 février 2005) 17 - Audition de M. Robert Rochefort, directeur général du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Procès-verbal de la séance du 2 mars 2005) 25 - Audition de M. Michel Chauvière, sociologue, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (Procès-verbal de la séance du 2 mars 2005) 33 - Audition conjointe de Mme Martine Segalen, sociologue, professeur à l'université de Paris X, et de M. André Burguière, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (Procès-verbal de la séance du 9 mars 2005) 41 - Audition de M. Hubert Brin, président de l'Union nationale des associations familiales, accompagné de Mme Marie-Claude Petit, vice-présidente (Procès-verbal de la séance du 9 mars 2005) 49 - Audition de M. Maurice Godelier, anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (Procès-verbal de la séance du 9 mars 2005) 57 - Audition de M. Michel Dollé, rapporteur général du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (Procès-verbal de la séance du 22 mars 2005) 65 - Audition de M. François de Singly, sociologue, professeur à l'université de Paris V (Procès-verbal de la séance du 22 mars 2005) 71 - Audition de M. Maurice Berger, chef de service en psychiatrie de l'enfant au Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, psychanalyste (Procès-verbal de la séance du 6 avril 2005) 77 - Audition de M. Philippe Jeammet, chef de service en psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut mutualiste Montsouris, président de l'École des parents et des éducateurs d'Île-de-France (Procès-verbal de la séance du 6 avril 2005) 83 - Table ronde sur les mutations des modèles familiaux, réunissant M. Gérard Neyrand, sociologue, M. Aldo Naouri, pédiatre, M. Jean-Marie Meyer, philosophe, Mme Marcela Iacub, juriste (Procès-verbal de la séance du 13 avril 2005) 89 - Audition de M. Pierre Naves, inspecteur général des affaires sociales (Procès-verbal de la séance du 13 avril 2005) 105 - Audition de M. Alain Bruel, ancien président du tribunal pour enfants de Paris (Procès-verbal de la séance du 13 avril 2005) 111 - Table ronde ouverte à la presse sur la prévention et la détection de l'enfance en danger, réunissant M. Jean-Christophe Lagarde, député ; M. Gilles Garnier, vice-président du conseil général de Seine-Saint-Denis ; Mme Marie-Colette Lalire, directrice de l'enfance et de la famille du département de l'Isère ; M. Jean-Marie Delassus, chef du service de maternologie de l'hôpital de Saint-Cyr l'École ; M. Michel Andrieux, délégué général de l'Association nationale des professionnels et acteurs de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille ; Mme Catherine Sultan, vice-présidente du tribunal pour enfants d'Évry, secrétaire générale de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille ; M. Bruno Percebois, médecin de la protection maternelle et infantile, membre du bureau du Syndicat national des médecins de la protection maternelle et infantile ; Mme Jeanne-Marie Urcun, médecin conseil à la direction de l'enseignement scolaire ; M. Jean-François Villanné, vice-président de l'Union nationale des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (Procès-verbal de la séance du 4 mai 2005) 119 - Audition de Mme Claire Brisset, Défenseure des enfants, accompagnée de M. Marc Scotto, délégué général, M. Patrice Blanc, secrétaire général, et Mme Muriel Églin, magistrate, conseillère juridique (Procès-verbal de la séance du 11 mai 2005) 139 - Audition de M. Jean-Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny (Procès-verbal de la séance du 11 mai 2005) 149 - Table ronde ouverte à la presse sur la réforme de la protection de l'enfance, réunissant Mme Martine Brousse, directrice de La Voix de l'enfant ; M. Arnauld Gruselle, directeur de la Fondation pour l'enfance ; Mme Marie-Paule Martin-Blachais, présidente de l'Association française d'information et de recherche sur l'enfance maltraitée ; Mme Jacqueline Bruas, membre du Conseil français des associations pour les droits de l'enfant ; Mme Christine Mariet, secrétaire générale d'Enfance et partage ; M. Paul Durning, directeur de l'Observatoire national de l'enfance en danger ; M. Jean-Louis Sanchez, délégué général de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée (Procès-verbal de la séance du 18 mai 2005) 157 - Audition de Mme Marie-Thérèse Hermange, sénatrice (Procès-verbal de la séance du 25 mai 2005) 171 - Audition de Mme Michèle Créoff, directrice de l'enfance et de la famille du département du Val-de-Marne (Procès-verbal de la séance du 25 mai 2005) 177 - Audition de M. Louis de Broissia, sénateur, président du Conseil général de la Côte-d'Or, accompagné de Mme Geneviève Avenard, directrice générale adjointe de la solidarité et de la famille du département de la Côte-d'Or, et de Mme Marie-Paule Martin-Blachais, directrice de l'enfance et de la famille du département de l'Eure-et-Loir (Procès-verbal de la séance du 1er juin 2005) 183 - Audition de Mme Hélène Franco, vice-présidente du Syndicat de la magistrature, accompagnée de M. Côme Jacqmin, secrétaire général (Procès-verbal de la séance du 1er juin 2005) 189 - Audition de M. Philippe Nogrix, sénateur, président du Groupement d'intérêt public Enfance maltraitée (Procès-verbal de la séance du 8 juin 2005) 195 - Audition de M. Dominique Barella, président de l'Union syndicale des magistrats (Procès-verbal de la séance du 15 juin 2005) 201 - Audition de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice (Procès-verbal de la séance du 22 juin 2005) 207 - Audition de M. Martin Hirsch, président d'Emmaüs France (Procès-verbal de la séance du 22 juin 2005) 213 - Audition de M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille (Procès verbal de la séance du 23 juin 2005) 219 - Table ronde ouverte à la presse sur la réforme du droit de la famille réunissant M. Bernard Teper, président de l'Union des familles laïques ; M. Jean-Marie Bonnemayre, président du Conseil national des associations familiales laïques ; Mme Irène Carbonnier, conseillère nationale pour les questions juridiques des Associations familiales protestantes ; M. François Édouard, secrétaire général de la Confédération syndicale des familles (Procès-verbal de la séance du 29 juin 2005) 227 - Table ronde ouverte à la presse sur la réforme du droit de la famille réunissant M. Laurent Chéno, secrétaire de la commission politique de l'Interrassociative lesbienne, gaie, bi et trans ; Mme Martine Gross, présidente d'honneur de l'Association des parents et futurs parents gaies et lesbiens ; M. Eric Verdier, président de Coparentalité ; M. Alexandre Carelle, président d'Homosexualités et socialisme ; M. Stéphane Dassé, président de Gay Lib (Procès-verbal de la séance du 13 juillet 2005) 241 - Table ronde sur la réforme du droit de la famille réunissant M. Paul de Viguerie, président de la Confédération nationale des associations familiales catholiques, accompagné de M. Jean-Marie Andres, vice-président ; M. Thierry Damien, président de Familles rurales et M. Philippe Vaur, vice-président de Familles de France (Procès-verbal de la séance du 28 septembre 2005) 263 - Audition de Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université de Lille II (Procès-verbal de la séance du 5 octobre 2005) 273 - Audition de MM. Jacques Combret et Didier Coiffard, notaires (Procès-verbal de la séance du 5 octobre 2005) 281 - Audition de Mmes Marie-Élisabeth Breton, avocate au barreau d'Arras, membre du Conseil national des barreaux, Béatrice Weiss-Gout, avocate au barreau de Paris, membre du Conseil national des barreaux, Dominique Piwnica, avocate au barreau de Paris, et Andréanne Sacaze, ancien bâtonnier du barreau d'Orléans (Procès-verbal de la séance du 5 octobre 2005) 289 - Table ronde ouverte à la presse sur les formes d'organisation du couple réunissant M. Alain Bénabent, professeur de droit à l'université de Paris X, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; M. Charles Melman, psychiatre et psychanalyste ; M. Xavier Lacroix, professeur d'éthique familiale dans les facultés de philosophie et de théologie de l'université catholique de Lyon ; M. Eric Fassin, sociologue, professeur à l'École normale supérieure ; M. Daniel Borrillo, maître de conférence en droit à l'université de Paris X (Procès-verbal de la séance du 12 octobre 2005) 299 - Table ronde ouverte à la presse sur les mariages forcés, réunissant Mme Edwige Rude-Antoine, juriste et sociologue, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique ; Mme Gaye Petek, directrice de l'association Elele, membre du réseau Agir avec elles ; Mme Clotilde Lepetit, avocate, responsable du pôle juridique de l'association Ni putes ni soumises ; Mme Virginie Larribau-Terneyre, professeur de droit à l'université de Pau et des pays de l'Adour ; M. Jean-Louis Zoël, chef du service des accords de réciprocité à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ; Mme Marie-Thérèse Coulon, vice-procureur près le Tribunal de grande instance de Nantes ; Mme Myriam Bernard, directrice générale adjointe du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (Procès-verbal de la séance du 19 octobre 2005) 319 - Table ronde ouverte à la presse sur l'adoption réunissant Mme Frédérique Granet, professeur de droit à l'université de Strasbourg III ; Mme Janice Peyré, présidente d'Enfance et familles d'adoption ; Mme Martine Gross, présidente d'honneur de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens ; M. Jean-Marie Muller, président de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide aux pupilles et anciens pupilles de l'État ; Mme Nadine Pinget, présidente du Mouvement pour l'adoption sans frontières ; M. Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre ; M. Robert Neuburger, psychiatre (Procès-verbal de la séance du 2 novembre 2005) 339 - Table ronde, ouverte à la presse, « Progrès médicaux et filiation » réunissant M. Pierre Murat, professeur de droit à l'université de Grenoble II ; M. Claude Sureau, membre de l'Académie de médecine ; M. Arnold Munnich, chef du service de génétique médicale de l'hôpital Necker ; Mme Laure Camborieux, présidente de l'association Maia, accompagnée de Mme Laurence Brunet ; Mme Emmanuelle Révolon, membre de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens ; Mme Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste (Procès-verbal de la séance du 9 novembre 2005) 365 - Table ronde ouverte à la presse sur l'accès de l'enfant à ses origines personnelles, réunissant Mme Marie-Christine Le Boursicot, magistrate, secrétaire générale du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ; M. Pierre Verdier, président de la Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines ; Mme Françoise Laurant, présidente du Mouvement français du planning familial ; Mme Françoise Monéger, professeur de droit à l'université de Paris VIII ; Mme Jacqueline Rubellin-Devichi, professeur émérite de l'université de Lyon III ; Mme Corinne Daubigny, philosophe et psychanalyste ; et Mme Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste (Procès-verbal de la séance du 16 novembre 2005) 387 - Table ronde, ouverte à la presse, sur l'exercice de l'autorité parentale dans les familles désunies, réunissant M. Hugues Fulchiron, doyen de la faculté de droit de l'université de Lyon III ; M. Alain Cazenave, président de SOS Papa ; Mme Jacqueline Phelip, présidente de L'enfant d'abord ; Mme Isabelle Juès, vice-présidente de l'Association pour la médiation familiale ; Mme Chantal Lebatard, administratrice de l'Union nationale des associations familiales ; Mme Hana Rottman, pédopsychiatre ; Mme Brigitte Azogui-Chokron, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, chargée des affaires familiales (Procès-verbal de la séance du 23 novembre 2005) 407 - Audition ouverte à la presse de Mme Christine Miallot, présidente de « SOS Grands parents en danger 83 », accompagnée de Mme Annie Le Guyader (Procès-verbal de la séance du 30 novembre 2005) 431 - Table ronde, ouverte à la presse, sur la place du « beau-parent » réunissant Mme Adeline Gouttenoire, professeur de droit à l'université de Grenoble II ; M. Didier Le Gall, sociologue, professeur à l'université de Caen ; Mme Florence Millet, maître de conférence en droit à l'université de Cergy-Pontoise ; M. Mathieu Peyceré, membre de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens ; M. Stéphane Ditchev, secrétaire général de la Fédération des mouvements de la condition paternelle ; Mme Edwige Antier, pédiatre (Procès-verbal de la séance du 30 novembre 2005) 437 - Audition ouverte à la presse de M. Olivier Abel, professeur de philosophie éthique à la faculté de théologie protestante de Paris (Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2005) 453 - Audition ouverte à la presse de M. Joseph Sitruk, Grand Rabbin de France (Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2005) 459 - Audition ouverte à la presse de M. Dalil Boubakeur, président du Conseil français du culte musulman (Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2005) 463 - Audition ouverte à la presse de Son Excellence Monseigneur André Vingt-Trois, Archevêque de Paris (Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2005) 471 - Table ronde, ouverte à la presse, sur l'évolution du droit de la famille, réunissant M. Claude Vaillant, Grand orateur du Grand Orient de France ; Mme Marie-Françoise Blanchet, Grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France ; M. Jean-Pierre Pilorge, Grand secrétaire de la Grande loge nationale française ; M. Jean Eisenbeis, président du Conseil National de la Fédération Française du Droit Humain ; M. Guy Dupuy, membre du conseil fédéral de la Grande Loge de France (Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2005 479 - Audition de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice (Procès-verbal de la séance du 13 décembre 2005) 495 - Audition de M. Hubert Brin, président de l'Union nationale des associations familiales, accompagné de Mme Chantal Lebatard, administratrice (Procès-verbal de la séance du 13 décembre 2005) 507 - Audition de M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille (Procès-verbal de la séance du 14 décembre 2005) 515 - AUDITIONS DU PRÉSIDENT ET DE LA RAPPORTEURE 525 - CONTRIBUTIONS ÉCRITES 527 Audition de M. Claude Martin, sociologue, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous accueillons pour cette première audition M. Claude Martin, directeur de recherche au CNRS, à qui je souhaite la bienvenue. Le champ de notre Mission est très large, et le Président de l'Assemblée nationale m'a confirmé récemment encore que nous devions nous saisir de tous les sujets liés à la famille et aux droits des enfants. Nous avons décidé, avec Mme Valérie Pécresse, Rapporteure, de nous interroger d'abord sur les fondements, l'évolution et l'état actuel de la famille. Avant d'étudier les pistes d'une éventuelle modification du droit de la famille, il nous semble en effet indispensable de disposer de données sociologiques sur les mutations des modèles familiaux. Ainsi qu'il vous a été indiqué, je souhaiterais, monsieur Martin, que vous nous livriez votre réflexion sur trois questions qui servent de trame à nos travaux : le couple, la parentalité, les rapports entre les générations. Et comme vous avez été membre de l'Observatoire européen de la situation sociale, de la démographie et de la famille, il nous serait très utile que vous nous précisiez également les spécificités de la France par rapport à ses voisins européens. Enfin, vous vous êtes plus particulièrement intéressé aux liens entre l'évolution des conditions de travail et les mutations des modes de vie familiaux. Or, nous souhaitons nous pencher sur les difficultés créées aux familles, et donc aux enfants, par la flexibilité accrue de l'emploi. M. Claude Martin : Je vous remercie de l'honneur que vous me faites en m'invitant à votre toute première audition. Le contraste est évident entre la famille que nous avons connue dans l'immédiat après-guerre et celle que nous connaissons aujourd'hui, au point que certains ont cru pouvoir diagnostiquer, au milieu des années 1970, la fin ou la mort de la famille. Aujourd'hui on oppose les « trente glorieuses » aux « trente piteuses » de l'économie et de la famille. De fait, de 1970 à 1995, fécondité et nuptialité ont baissé tandis que se multipliaient divorces et naissances hors mariage. Mais ces transformations ne justifient pas pour autant une telle dramatisation, qui repose sur la vision nostalgique d'un « âge d'or » mythique. Contrairement à une idée reçue, l'évolution de la famille n'est pas la cause d'un certain nombre de problèmes sociaux, tels que la montée de la délinquance ou l'affaiblissement des solidarités familiales, mais la résultante d'une série de transformations sociales, liées notamment à l'évolution du marché du travail, des modes de production et de consommation, à celle des temps sociaux, à celle des conditions dans lesquelles les parents ont à assumer leur tâche d'éducateurs ou à assister leurs parents devenus dépendants. Cette mise au point a son importance, à l'heure où d'aucuns sont volontiers tentés par la restauration d'un ordre familial ancien qui apparaît comme une garantie de stabilité. On ne s'était jamais autant marié, et notamment marié aussi jeune, que durant les « trente glorieuses ». L'institution familiale était alors stable et féconde, d'autant plus stable que le nombre des divorces était onze fois inférieur à celui des mariages, et que régnaient une nette division et une nette complémentarité des rôles entre les sexes, que l'on peut résumer par la formule « M. Gagnepain et Mme Aufoyer ». Par rapport à cette époque, tous les indicateurs semblaient conforter, jusqu'au milieu des années 1990, la thèse d'un affaiblissement, voire d'une crise de l'institution familiale. L'indice conjoncturel de fécondité est passé d'une moyenne de 3 à 1,68 ; l'indice brut de nuptialité est tombé de 8 à 4,1 ou 4,2 pour 1 000 habitants ; et la divortialité n'a cessé de progresser fortement - à cet égard, il est sans doute plus judicieux de rapporter le nombre des divorces au nombre d'habitants qu'au nombre de mariages, car ce ne sont pas les mêmes couples qui se marient et qui divorcent la même année, et le choix de l'indicateur peut avoir un effet de dramatisation excessif -. Depuis le milieu des années 1990, la tendance a changé. La fécondité a connu une reprise assez sensible : 738 000 naissances en 1998, 745 000 en 1999, 775 000 en 2000 Cette progression a amené la presse à parler, sans doute avec quelque excès, de « mini baby-boom ». Certains ont cru y voir l'effet de la célébration du tournant du millénaire. Cette explication me paraît quelque peu fantaisiste. Plus sérieuse est l'hypothèse de l'impact de la reprise économique en 1998-2000, créant un climat de confiance et d'optimisme accrus ; de fait, le moral des ménages était très élevé fin 2000 et début 2001. Mais cette hypothèse demeure assez fragile. En effet, en mars 2003, le pessimisme atteignait son niveau le plus élevé depuis 1996, et on n'a pas observé pour autant de baisse de la fécondité. Il faut ajouter que la reprise économique, marquée par le recul du chômage et du nombre des allocataires du RMI entre 1997 et 2001, n'a pas bénéficié à tous et n'a pas empêché le renforcement des inégalités, du fait de la progression du nombre des « travailleurs pauvres » : l'évolution du marché du travail intervenue à partir de cette époque a conduit au développement des emplois précaires ou à temps partiel non choisi, qui concernaient 12 % des salariés en 2003, soit 3 millions de personnes. Qui plus est, la multiplication des horaires atypiques a provoqué une désarticulation des temps sociaux qui a bouleversé la vie quotidienne de nombreux ménages, rendant difficile l'exercice du rôle de parents. Une troisième hypothèse pour expliquer cette reprise de la fécondité renvoie au rôle des politiques publiques de prise en charge de la petite enfance, nettement plus développées en France que dans les pays d'Europe latine, qu'en Allemagne ou en Autriche, où le taux de fécondité est tombé aux alentours de 1,3. Le désir d'enfant est assez homogène d'un pays d'Europe à l'autre : on souhaite généralement un garçon et une fille, plus un troisième enfant le cas échéant. Mais, à ce désir la France apporte des réponses qui, pour être encore insuffisantes, n'en sont pas moins appréciables, qu'il s'agisse des aides à la garde en crèche, à domicile ou chez une assistante maternelle, des congés parentaux rémunérés, ou de la préscolarisation à partir de trois, voire de deux ans. Tous ces dispositifs évitent à la femme, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, de devoir retarder la naissance de son premier enfant pour n'être pas pénalisée dans sa vie professionnelle, ou d'être confrontée au dilemme : avoir un enfant ou une carrière. On a également constaté une légère reprise de la nuptialité. D'aucuns ont pu y voir un signe de réadhésion des nouvelles générations à l'institution familiale. De 390 000 en 1970, le nombre des mariages était tombé à 254 000 en 1994, mais il est remonté à 280 000 en 1996- sans doute du fait de la suppression d'une disposition fiscale qui favorisait les parents cohabitants non mariés - puis à 298 000 en 2000, pour redescendre légèrement ensuite : 289 000 en 2001, 280 000 en 2002, 273 000 en 2003 et 266 000 en 2004, soit 4,3 mariages pour 1 000 habitants. Le repli du mariage dans les années 1970 et 1980 ne s'est pas traduit par un recul de vie en couple. La montée de la cohabitation a compensé le recul du mariage. Ceci explique aussi la montée des naissances hors mariages qui sont passées de 6 % des naissances en 1960 à 47,4 % en 2004. Quant au nombre des divorces, il n'a cessé d'augmenter, passant de 9 % de celui des mariages enregistrés en 1965 à 22 % en 1980, 36 % en 1990, et près de 45 % en 2002, soit 127 000 divorces prononcés dans l'année. Si l'on y ajoute les ruptures de couples cohabitants, dont le nombre est du même ordre selon l'INED, on comprend que les trajectoires conjugales se soient considérablement complexifiées, et que se soient multipliées les séquences monoparentales - terme préférable, selon moi, à celui de « familles monoparentales » - et les situations où des parents séparés se remettent en couple avec un nouveau partenaire et leurs enfants respectifs ou communs - soit ce qu'on appelle les familles « recomposées » -. Le nombre des ménages monoparentaux a considérablement augmenté : 720 000 en 1968, 1,1 million en 1990, 1,423 million en 2000, 1,6 million en 2002, soit 18 % des ménages comportant au moins un enfant de 25 ans. Aujourd'hui, 15 % des enfants de moins de 25 ans vivent dans un ménage monoparental, et 9 % environ dans un ménage recomposé. Malgré cette instabilité de la vie conjugale, la responsabilité que ressentent les parents vis-à-vis de leurs enfants demeure. On entend couramment parler de la déresponsabilisation des pères, en faisant valoir la proportion de pensions alimentaires non versées... Mais si l'on fait des comparaisons européennes, on constate que le taux de divortialité est plus fort au Royaume-Uni, et que la situation des ménages monoparentaux y est nettement plus difficile. Ce n'est pas que la situation soit satisfaisante en France, elle s'y dégrade même, mais une mère seule sur quatre seulement y vivait au milieu des années 1990 sous le seuil relatif de pauvreté, contre deux sur trois au Royaume-Uni. Cet écart tient au fait qu'au Royaume-Uni, 40 % seulement des mères seules sont présentes sur le marché du travail, et encore le plus souvent à temps partiel, sachant que leur temps moyen de travail à temps partiel est la moitié de ce qu'il est en France. Tout cela est lié, principalement, aux différences entre les deux pays pour les services d'accueil de la petite enfance. À la lumière de ces transformations, nous souhaitons pour conclure évoquer cinq défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. Premier défi : redéfinir le contrat entre les sexes, ou mieux entre les genres. La progression du nombre de ménages féconds à deux salaires interroge le modèle de M. Gagnepain et Mme Aufoyer et pose un très épineux problème, lié à la division des rôles entre les sexes, tant pour le travail rémunéré que pour le travail domestique et pour les soins aux enfants et aux personnes âgées. L'enquête menée en 1999 sur les emplois du temps montre qu'il y a certes eu des évolutions, mais que beaucoup de chemin reste à faire pour atteindre l'égalité. En moyenne, un homme vivant en couple consacre chaque jour deux heures et demie au travail domestique, contre cinq heures pour une femme vivant en couple. Cette durée, entre 1986 et 1999, s'est allongée de quelques minutes pour l'homme, tandis qu'elle se réduisait de vingt minutes pour la femme, sous l'effet conjugué de la robotisation accrue des tâches domestiques et de leur délégation croissante à d'autres femmes employées et rétribuées à cet effet. La refondation du contrat entre les genres doit tendre à un meilleur partage des responsabilités comme des revenus, ainsi qu'à une construction plus valorisante de l'identité de la femme à travers le travail et les réseaux sociaux. Cela passe d'abord par une action du côté du travail rémunéré, et les pays d'Europe du Nord sont riches en bonnes pratiques à cet égard. Lorsqu'on leur offre 80 % de leur dernier salaire pendant six mois et non pas, comme en France, une allocation forfaitaire et modeste, les hommes envisagent de prendre eux aussi un congé parental. Aussi ne faut-il pas s'étonner que le congé parental français soit presque exclusivement choisi par des femmes, et en particulier par des femmes mal positionnées sur le marché du travail. Le système mis en œuvre par l'Islande doit nous faire réfléchir : la femme y a droit à trois mois rémunérés à 80 % de son dernier salaire, l'homme - et seulement lui - à trois autres mois à 80 %, et l'un ou l'autre des deux à trois autres mois encore, également rémunérés à 80 %. Deuxième défi : définir une politique de la jeunesse, pour faire face à la transformation des étapes traditionnelles du cycle de vie. Durant les « trente glorieuses », on distinguait l'enfance, l'adolescence, puis l'âge adulte, auquel on accédait avec le premier emploi rémunéré, le premier logement indépendant et l'accès à la vie de couple et de famille, puis enfin la vieillesse, dans laquelle on entrait à l'âge de la retraite. Depuis, les choses ont profondément changé. La transition entre l'enfance et l'âge adulte est beaucoup plus longue, et les bornes plus difficiles à situer. Vers l'âge de douze ans, on entre avec l'adolescence dans la jeunesse dont le terme est de plus en tardif. Les trois événements qui marquaient naguère l'entrée dans l'âge adulte sont déconnectés, et la jeunesse, si elle est autonome plus tôt qu'avant, n'est pas indépendante pour autant. On utilise de plus en plus l'expression « jeunes adultes », sans qu'une véritable politique publique ait été conçue pour accompagner cette transition. Quant aux autres âges, ils posent évidemment d'autres questions : je pense notamment aux seniors, fragilisés sur le marché du travail à partir de 55 ans. Et, s'il y a toujours un « troisième âge », dont la condition matérielle moyenne s'est considérablement améliorée en dépit de très fortes inégalités, il y a désormais un « quatrième âge », où se conjuguent maladies chroniques et risques d'incapacité et de dépendance. Voilà qui nous amène au troisième défi : renouveler le contrat entre les générations. Il y a de plus en plus de personnes âgées, et même très âgées, et cette situation a un impact considérable sur les ménages et les familles. On oublie trop souvent que les premiers pourvoyeurs d'aide, de soins, de soutien quotidien aux personnes âgées dépendantes sont les membres de la famille, en particulier les épouses, les filles, les brus : il existe une certaine solidarité féminine, qui est très mobilisée. Or, on ne parle pas de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle pour ces femmes de la génération des seniors, qui se battent sur trois fronts - vie professionnelle, aide aux jeunes adultes que sont leurs enfants, aide à leurs parents dépendants -, qui n'ont nulle envie de se retirer du marché du travail et qui doivent souvent sacrifier leur temps personnel, voire leur temps conjugal. C'est un défi considérable, car l'INSEE dénombre 1,2 million de personnes âgées dépendantes, dont 0,8 très dépendantes, ce qui correspond à peu près au nombre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) - 828 000 en juin 2004. L'APA est évidemment une réforme appréciable, mais il faut aller au-delà, trouver une réponse au stress et à la pression qui s'exercent sur les familles, sur les femmes en particulier. Il est urgent de se pencher sur la question, car les projections de l'INSEE font apparaître un déficit d'aidants (« care deficit ») à échéance rapprochée, devant la croissance exponentielle de la demande de soins et la diminution prévisible du nombre de personnes susceptibles de les fournir. Quatrième défi : définir une politique de l'enfance à l'échelle européenne, en pensant la politique sociale dans la logique de la succession des générations. Il s'agit notamment d'améliorer la condition matérielle de l'enfant aujourd'hui, pour ne pas avoir à conduire à grande échelle des politiques de réparation dans vingt-cinq ou trente ans. Investir dans les services à l'enfance, c'est une manière d'éviter une politique de réparation des difficultés sociales. Cela passe par un soutien au revenu des ménages grâce aux allocations familiales, par la promotion du travail des femmes afin d'accroître le nombre des ménages à deux revenus, et par le développement des services à la petite enfance. La pauvreté des enfants n'est pas forcément liée, contrairement aux idées reçues, au fait qu'ils vivent dans une famille monoparentale ; c'est parfois le cas, bien sûr, mais c'est loin de l'être toujours. En Europe du Nord, il y a beaucoup de foyers monoparentaux et peu d'enfants pauvres ; en Italie, c'est le contraire. Or, on a trop souvent tendance à retenir l'interprétation qui domine au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où il y a beaucoup d'enfants pauvres et beaucoup de familles monoparentales. Tout dépend en fait de la façon dont les politiques publiques aident ou non les ménages à sortir de la pauvreté. Cinquième et dernier défi, qui découle des précédents : améliorer l'articulation entre travail et vie familiale. La France apparaît parfois comme ayant beaucoup investi en ce domaine, mais elle l'a fait en pensant surtout aux mères et très peu aux pères, alors qu'il y aurait beaucoup à faire aussi de ce côté-là. Il faut tenir compte à la fois des besoins des ménages de trente ans, qui veulent à la fois des enfants et des conditions de vie favorables pour s'occuper d'eux, et des besoins des ménages de cinquante ans, qui ont aussi à faire face à l'articulation entre les différents temps de la vie, mais dont on parle très peu. L'expérience des pays d'Europe du Nord nous est utile, non pas pour importer en l'état des dispositifs qui s'inscrivent dans des conditions culturelles, économiques, sociales différentes, mais pour faire une autre lecture de la spécificité de la situation française. M. le Président : Je vous remercie de cet exposé très complet et des analyses très riches dont vous nous avez fait part. M. Bernard Debré : Je voudrais, après cet exposé très intéressant, poser plusieurs questions. A-t-on, tout d'abord, des données sur le taux de fécondité en fonction du niveau de vie ? Celles dont nous disposons sont en effet contradictoires. A-t-on, d'autre part, des données sur l'évolution de la fécondité au fil des générations issues de l'immigration ? A-t-on, enfin, des données croisées sur fécondité et habitat, avec des comparaisons entre l'Ile-de-France et les régions, entre la ville et la campagne, ou en fonction de l'accessibilité des services sociaux ? Sur la monoparentalité, d'autre part, a-t-on la possibilité de distinguer entre les enfants dont la mère est seule parce qu'elle a divorcé, ceux dont la mère a toujours vécu seule, et ceux qui vivent dans des familles recomposées ? Ce sont des situations très différentes. A-t-on, enfin, des données sur le lien entre divorce et chômage ? Sait-on quand survient le divorce ? Le chômage peut être la source du divorce, mais le divorce peut aussi entraîner le chômage, notamment lorsque la femme reste seule avec des enfants dont elle doit s'occuper. M. Pierre-Christophe Baguet : Ma première question a trait au divorce chez les seniors. Est-il confirmé qu'on divorce davantage dans les années qui suivent la cessation d'activité ? Ma seconde question porte sur le PACS : a-t-on des données chiffrées ? M. le Président : J'ai deux questions, moi aussi. On a souvent tendance à dire que ce sont les étrangers qui sont les éléments moteurs de la fécondité et de la nuptialité. Qu'en est-il exactement, notamment par rapport aux autres pays de l'Union européenne ? Quant au PACS, a-t-il eu une incidence sur le nombre des mariages ? M. Claude Martin : Sur le rapport entre fécondité et habitat, comme sur celui entre fécondité et milieu social, Mme France Prioux, que vous entendrez tout à l'heure, serait mieux à même de vous répondre. S'agissant du rapport entre fécondité et immigration, il existe un effet d'alignement de toutes les populations d'origine étrangère sur les comportements de la société d'accueil. Cet effet est désormais bien connu et joue dans les deux sens. C'est ainsi que l'on observe ce paradoxe qui veut que les Italiennes ou les Portugaises de France aient une fécondité supérieure à celle de leurs compatriotes restées au pays. Cet alignement se fait soit au fil des générations, soit tout simplement au fil du temps passé en France. Il n'est donc pas vrai que la fécondité relativement élevée que l'on constate en France soit principalement le fait des étrangers. Un facteur déterminant du recul de la fécondité est le décalage du calendrier des naissances. La fécondité des jeunes femmes, mesurée selon l'indice conjoncturel, baisse très fortement, tandis que celle des femmes plus âgées s'élève, mais moins. En Europe du Sud, les femmes reculent tellement la naissance de leur premier enfant qu'il est souvent trop tard, ensuite, pour en avoir un deuxième, ce qui explique que le nombre d'enfants par femme soit finalement très faible. On peut également noter le très faible nombre de naissances hors mariage en Europe du Sud alors que ces naissances hors mariage représentent en Suède plus de la moitié des naissances. Concernant la monoparentalité, la façon de compter, comme le savent tous ceux qui travaillent sur ces questions, fait effectivement problème. L'INSEE tient compte du ménage où l'enfant a sa résidence principale, mais ne tient pas compte du père « intermittent » qui a ses enfants un week-end sur deux et une partie des vacances. En réalité les enfants « circulent » beaucoup. Il en va de même des familles dites « recomposées », dont on peut avoir une vision très large, surtout lorsqu'on y inclut tous les enfants des précédentes unions de chacun des partenaires : il existe ainsi des enfants qui sont à cheval sur trois, voire quatre ménages... C'est pourquoi nous préférons calculer le nombre d'enfants confrontés à la présence d'un parent et du nouveau partenaire de ce parent. Il est important d'appréhender la diversité de ces situations, qui ne constituent pas forcément un isolat. Ce n'est pas parce que les parents sont séparés que les enfants sont entièrement séparés de l'un d'eux. Une vision longitudinale est beaucoup plus à même de rendre compte de la réalité de ces transitions familiales. La question du divorce et du chômage est un peu celle de l'œuf et de la poule. Il est clair que ces deux phénomènes se combinent pour produire des situations d'exclusion sociale. Le divorce peut provoquer l'appauvrissement économique de la femme, surtout si elle a cessé son activité après la naissance du premier ou du second enfant et si elle divorce au bout de quinze ans de mariage ou plus, car la reprise d'activité sera dans ces situations très problématique. À cela s'ajoute l'appauvrissement relationnel, la perte de réseau - belle-famille, amis parfois -. Parfois aussi, le chômage crée au sein du couple des tensions très fortes, qui aboutissent au divorce. Il y a souvent co-occurrence de ces événements, quel que soit l'ordre dans lequel ils surviennent. On commence à disposer de données sur le divorce des seniors, notamment grâce à l'étude qualitative de Vincent Caradec. L'effet « nid vide » après le départ des enfants et la difficulté, à l'âge de la retraite, de se retrouver face à face toute la journée, conduisent parfois à la séparation, pas forcément conflictuelle d'ailleurs, chacun redonnant sa liberté à l'autre, en partageant les biens acquis. C'est un phénomène qui progresse, mais sur lequel on dispose surtout de données qualitatives. Il faudrait que vous demandiez à Mme Prioux s'il y a un pic ou un surcroît de divorces à l'âge de la retraite. Le nombre de PACS signé atteint les 130 000. Il y en avait 30 000 à la fin de 2000, 19 800 de plus à la fin de 2001 - soit une diminution de 16 % -, 25 000 en 2002, 28 000 en 2003 et 27 000 sur les trois premiers trimestres de 2004. Cela correspond donc à une demande très claire de reconnaissance. Ce qui fait problème, c'est qu'on ne puisse pas déterminer la part des couples homosexuels et celles des couples hétérosexuels ; il y a là un obstacle qu'il faut lever, car il n'est pas justifié ; un suivi par sexe n'étant pas, à mon sens, une atteinte à la vie privée. M. le Président : C'est un point qui m'interpelle directement, car, lors de la révision de la loi sur l'informatique et les libertés, j'ai fait adopter un amendement qui permettait d'avoir une telle connaissance. En avez-vous été informé ? M. Claude Martin : À l'heure actuelle, non, mais compte tenu de ce que vous me dites, je m'adresserai au ministère de la justice. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'on a affaire à une demande de reconnaissance publique d'une relation contractuelle, reconnaissance que traduit le PACS. Et je ne crois pas que cela ait fragilisé pour autant l'aspiration au mariage, ni que ce soit une alternative qui menace l'institution matrimoniale. Certaines enquêtes qualitatives, notamment sur le marché des robes de mariée, ont même repéré une progression des rituels matrimoniaux. Ce sont des données fragiles, évidemment, mais intéressantes. Mme la Rapporteure : A-t-on les moyens de savoir si les PACS se transforment en mariages ? M. Pierre-Christophe Baguet : A-t-on une estimation du nombre de « PACS administratifs » ? M. Claude Martin : Je ne suis pas à même de vous fournir ces données. Mme la Rapporteure : Vous avez dit que 15 % des enfants de moins de 25 ans vivaient dans des foyers monoparentaux et 8,7 % dans des foyers recomposés. De quand datent ces chiffres ? M. Claude Martin : De 2001. Mme la Rapporteure : A-t-on des données sur les moins de 20 ans ? M. Claude Martin : L'INSEE retient l'âge de 25 ans. Ailleurs en Europe, c'est généralement 18 ans, parfois 16, parfois même il n'y a pas de limite d'âge du tout. Je crois que c'est même la tendance qui se dessine dans les travaux comparatifs : tenir compte des enfants présents dans le ménage monoparental quel que soit leur âge. Mme la Rapporteure : Ce n'est tout de même pas la même chose. M. Claude Martin : Dans des pays comme l'Italie ou la France, où il y a un nombre croissant de jeunes adultes vivant au domicile parental, il faut tout de même retenir cette limite des 25 ans, qui ne doit évidemment pas être exclusive d'autres limites, ne serait-ce que pour éviter les quiproquos. Au Royaume-Uni, par exemple, les enquêtes évoquent rarement la tranche 18-25 ans, car la monoparentalité concerne proportionnellement beaucoup plus de jeunes femmes avec de jeunes enfants. M. Bernard Debré : Y a-t-il un lien entre l'allongement de la durée de la vie, c'est-à-dire l'apparition de ce que l'on appelle le « quatrième âge », et la fécondité ? Les gens se disent-ils : « J'ai besoin de capitaliser pour ma retraite, donc je fais moins d'enfants » ? M. Claude Martin : Ils peuvent aussi avoir le réflexe inverse et se dire : « J'ai besoin de plus d'enfants pour s'occuper de moi quand je serai très vieux ». Il est déjà difficile d'avoir une idée précise des variables que prennent en compte les ménages à trente ans pour reporter ou non l'enfant qu'ils désirent... M. Bernard Debré : Selon un sondage récent, les jeunes se préoccupent de leur retraite dès vingt ou vingt-cinq ans. M. Claude Martin : On peut le comprendre, car c'est une thématique très présente dans les médias... M. Bernard Debré : Si l'on envisageait d'inciter les gens à faire une seconde carrière après leur retraite, cela favoriserait-il ou non la fécondité ? M. Claude Martin : Je ne sais comment répondre à une telle question. Elle pourrait laisser entendre que le nombre d'enfants est essentiellement lié aux conditions matérielles des générations adultes. Or le baby-boom est la preuve du contraire. Les conditions de logement étaient alors très peu propices, mais l'horizon était dégagé, on pouvait parier sur l'avenir. Toutes proportions gardées, ce même phénomène explique peut-être qu'on ait pu parler d'un « mini baby-boom » entre 1997 et 2000. Mais cette explication a ses limites, car actuellement le moral des ménages est mauvais et la fécondité ne baisse pas. C'est un casse-tête pour les démographes ! M. Sébastien Huyghe : Le troisième défi, avez-vous dit, est le contrat entre les générations. Avez-vous des chiffres sur les familles qui cohabitent avec les grands-parents sous le même toit ? Et sur le nombre des grands-parents qui s'occupent directement de leurs petits-enfants ? M. Claude Martin : Nous disposons sur ce point de l'enquête « Trois générations », que la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et l'INSEE avaient commandée à Claudine Attias-Donfut et André Masson au début des années 1990. Cette enquête a révélé la solidarité sous forme monétaire et aussi celle sous forme de temps consacré aux enfants, qui rééquilibrent les transferts opérés via la protection sociale. Il est difficile de mesurer exactement ces flux, d'autant que plus de dix ans se sont écoulés depuis cette étude, mais l'importance du rôle joué par les grands-parents dans la prise en charge de la petite enfance est certaine, et c'est un rôle que les services publics d'accueil de la petite enfance n'ont pas amenuisé. Dans le sens inverse, c'est-à-dire ascendant, il y a la contribution des filles et des brus, qui, bien qu'elles soient encore sur le marché du travail, sont amenées à faire les arbitrages que j'évoquais tout à l'heure. La tendance a été, bien sûr, à la décohabitation, mais il y a aussi une tendance non négligeable, même si je ne dispose pas ici de chiffres précis, à la recohabitation, soit par réaménagement d'un logement pour accueillir chez soi le parent vieillissant, soit par installation chez lui d'un de ses enfants, afin de retarder au maximum le moment de recourir au placement en établissement. Et l'un des arbitrages dont je parlais consiste à poser la question : « Qui parmi nous dispose des conditions propices pour prendre notre mère ou notre père à la maison ? ». M. le Président : Je vous remercie pour toutes ces informations et ces réflexions très utiles. Audition de Mme France Prioux, directrice de recherche Présidence de M. Patrick Bloche, Président, M. le Président : Madame Prioux, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes directrice de recherche à l'INED, et nous avons justement décidé de commencer nos travaux en nous interrogeant sur les fondements, l'évolution et l'état actuel de la famille. Il nous serait donc très utile de disposer de données démographiques actualisées sur les mutations des modèles familiaux. Comme il vous a été indiqué, je souhaiterais que vous nous livriez les résultats de vos travaux sur trois questions qui servent de trame à notre réflexion : le couple, la parentalité, les rapports entre les générations. Après votre exposé, nous vous poserons quelques questions. Mme France Prioux : Ma présentation portera principalement sur l'évolution du mariage et de la vie en couple, mais je vous apporterai des éléments supplémentaires si vous le souhaitez. Tous les graphiques relatifs à l'évolution du nombre des mariages depuis 1970 montrent une chute importante, puis une stabilisation entre 250 000 et 300 000 par an. On observe également une progression très importante du nombre des naissances hors mariage ; je n'ai pas encore les chiffres de 2004, mais la hausse se confirme à nouveau. Le nombre des divorces progresse également, un peu moins rapidement, mais reste relativement fort. On observe enfin une progression du nombre des PACS. Les nouveaux mariés d'aujourd'hui ressemblent de moins en moins à ceux d'hier. En 2004, un mariage sur quatre unit au moins une personne divorcée, contre moins d'un sur dix en 1970. Dans 28 % des cas, les nouveaux mariés ont déjà un ou plusieurs enfants communs, au lieu de 5 % en 1970. Inversement, il est de plus en plus rare que la femme soit enceinte au moment de la cérémonie : alors que c'était le cas une fois sur quatre en 1970, la proportion est tombée à 8 % en 2002. Enfin, lorsqu'il s'agit d'un premier mariage, l'âge moyen des mariés a augmenté de plus de cinq ans et demi depuis 1970, et ce chez les hommes comme chez les femmes. Le nombre des divorces a plus que triplé, passant de 40 000 en 1970 à 125 000 en 2003, et il y a désormais 42 divorces pour 100 mariages, contre 12 pour 100 en 1970. Les naissances hors mariage ont été multipliées par 5,8, et leur proportion parmi l'ensemble des naissances par 6,3. Enfin, 31 000 PACS ont été conclus en 2003, soit un PACS pour 9 mariages environ. La courbe du nombre des mariages montre que le pourcentage de personnes déjà mariées baisse fortement, quel que soit le sexe et quel que soit l'âge. Parmi les personnes nées en 1970, 3 sur 10 ne se marieront pas, contre 1 sur 10 seulement dans les générations 1945-1950. C'est la proportion la plus élevée jamais observée. Ce déclin du mariage s'explique principalement par le développement de la cohabitation hors mariage : alors qu'au début des années 1970, un couple sur six débutait ainsi son union, c'est le cas de neuf couples sur dix aujourd'hui. Et le phénomène est plus net et plus rapide encore lorsqu'il ne s'agit pas de la première union. M. Hervé Mariton : De quelle durée d'union parle-t-on ? Un mois ? Dix ans ? Mme France Prioux : Les données prennent en compte les unions de plus de six mois, mais on dispose aussi de statistiques toutes durées confondues. Cette cohabitation débouche de moins en moins sur le mariage, et de plus en plus lentement. En 1975, la moitié des unions libres se transformait en mariage dans les deux ans ; ce n'était plus le cas que d'une sur trois en 1985, d'une sur cinq en 1995. Il y a trente ans, l'union libre était considérée comme un test, suivi d'un mariage à échéance assez brève, surtout lorsqu'il y avait désir d'enfant, a fortiori conception. Aujourd'hui, c'est un choix de vie de couple à part entière. La conséquence la plus visible de ce phénomène est la multiplication des naissances hors mariage. En 2002, 44 % des enfants nés le sont de parents non mariés, la proportion s'élevant à 56 % pour les aînés, à 33 % chez les deuxièmes naissances et à 23 % chez les troisièmes naissances. La majorité des mères ont donc leur premier enfant en dehors du mariage. Les enfants nés hors mariage sont reconnus de plus en plus rapidement par leur père. En 1970, seul un sur trois l'était avant l'âge d'un mois. Après la loi de 1970 qui a amélioré le statut des enfants naturels, et avec la diffusion de la cohabitation hors mariage, cette proportion est passée à deux sur trois en 1985, pour atteindre près de neuf sur dix en 2002. Il reste cependant 40 000 enfants non reconnus à l'âge d'un mois, et 30 000 à l'âge d'un an. C'est à peine plus qu'en 1970, car si le nombre des naissances hors mariage était à cette époque plus faible, le taux de reconnaissance l'était aussi. On peut estimer que 95 % des enfants nés hors mariage en 2002 acquerront finalement une filiation paternelle, et que 15 000 en resteront dépourvus, soit autant que dans les années 1960. La fréquence des « légitimations » par mariage diminue, le mariage intervenant de plus en plus tard. On a néanmoins observé un ressaut après le vote de l'amendement Courson en 1996, puis de nouveau en 2000. Parmi les enfants nés hors mariage en 1970, 54 % ont été « légitimés » par mariage, quatre fois sur cinq avant leur sixième anniversaire. Parmi ceux nés dans les années 1990, on estime que seuls 40 % verront leurs parents se marier, et seulement deux fois sur trois avant l'âge de six ans. Et comme les naissances hors mariage sont beaucoup plus nombreuses qu'autrefois, un nombre de plus en plus élevé d'enfants ne verront pas leurs parents se marier. Des données plus récentes, recueillies par l'INSEE, confirment cette tendance : parmi les enfants nés en 1997 et 1998, seuls 26 % ont vu leurs parents se marier avant leur cinquième anniversaire. Mais le nombre des mariages « légitimant » un ou plusieurs enfants est de plus en plus élevé : c'était le cas de trois mariages sur dix en 1996, 1997 et 2000, et la proportion était même d'un sur dix pour deux enfants et plus. M. Hervé Mariton : Avez-vous des précisions sur les contrastes sociologiques ou géographiques ? M. le Président : Je propose que nous attendions la fin de l'exposé pour poser nos questions... Mme France Prioux : Non seulement le nombre des mariages baisse, mais les premières unions sont devenues plus tardives. Pour les hommes, l'âge moyen est passé de 24,6 ans pour la génération de 1954 à 26,1 ans pour celle de 1969, tandis que s'accroissait parallèlement la proportion de personnes n'ayant jamais vécu en couple. Plus tardives, les unions sont également plus fragiles. Ainsi, parmi les femmes ayant débuté leur première union vers 1980, 8 % l'avaient déjà rompue dans les cinq ans, et 17 % dans les dix ans. Parmi les premières unions débutées vers 1990, la proportion de ruptures était de 15 % dans les cinq ans, et de 28 % dans les dix ans. Cela signifie que les risques de rupture se sont beaucoup accrus en début d'union, et sont à leur maximum au cours de la troisième année. La fragilité des unions commencées hors mariage est plus grande que celle des mariages directs. Parmi les premières unions commencées vers 1980, le taux de rupture avant cinq ans est de 11 % dans un cas et de 5 % dans l'autre, et avant dix ans de 22 % et 12 % respectivement. Pour les unions débutées dix ans plus tard, les proportions sont de 17 % et 9 % avant cinq ans, de 30 % et 17 % avant dix ans. La fragilité croissante des premières unions n'est donc pas due uniquement à la généralisation de la cohabitation : l'instabilité conjugale s'accroît dans toutes les catégories d'unions. Parmi les couples mariés en 1950, 11 % seulement ont été rompus par divorce, contre 16 % parmi ceux mariés en 1960 et 30 % parmi ceux mariés en 1970. Cette proportion devrait atteindre 40 % pour les couples mariés en 1990, car, après une stabilisation apparente dans les années 1990, on a observé une reprise de la divortialité en 2003. En résumé, au début des années 1970, il n'était guère envisageable de vouloir vivre en couple sans se marier, et encore moins d'avoir un enfant en dehors du mariage. On se mariait tôt, et peu d'hommes et de femmes restaient célibataires. Mais certains signes avant-coureurs montraient que le mariage était déjà en train de changer : la montée des divorces mettait en cause son indissolubilité, et la fréquence élevée des conceptions prénuptiales prouvait que les relations sexuelles débutaient de plus en plus souvent avant le mariage. Puis c'est la vie en couple qui a précédé le mariage, mais alors on se mariait lorsqu'on désirait un enfant, ou lorsqu'on en attendait un. La maîtrise de la contraception a permis que la cohabitation se prolonge sans risque de grossesse, et le mariage semble alors avoir perdu de son impératif, y compris lorsqu'un enfant s'annonçait. Plus de la moitié des premiers nés et le tiers des deuxièmes enfants naissent aujourd'hui de parents non mariés, et une proportion de plus en plus faible d'entre eux voient ensuite leurs parents se marier. Si certains restent attachés au mariage, pour d'autres il ne semble plus qu'une option dans leur parcours conjugal, et leur décision de convoler dépendra d'un choix rationnel susceptible d'être influencé par des incitations extérieures. Qu'il y ait mariage ou non, les unions sont devenues de plus en plus fragiles : divorces et ruptures sont de plus en plus fréquents et se produisent de plus en plus tôt. Ainsi il deviendra de moins en moins fréquent de faire sa vie avec un seul conjoint ; les parcours conjugaux sont de plus en plus complexes. En conséquence, il y a de plus en plus de personnes seules. De 1990 à 1999, leur pourcentage a beaucoup augmenté, chez les hommes comme chez les femmes de moins de 55-60 ans. Les premières données issues du recensement de 2004 montrent que cette tendance se poursuit. Du fait du retard de l'âge à la première vie de couple et de la fréquence accrue des ruptures d'unions, le nombre des hommes vivant seuls s'accroît plus vite que celui des femmes vivant seules car les enfants restent plus souvent avec leur mère. Puis, après cinquante ou soixante ans, les enfants quittant le foyer maternel, les femmes sont plus nombreuses à vivre seules et le veuvage accentue cette tendance avec l'âge. Les ménages d'une personne seulement représentaient un cinquième du nombre total des ménages en 1968, ils en représentent un tiers en 2004, soit 14 % des hommes et des femmes vivant en France. Cette progression actuelle touche à peu près tous les groupes d'âge. Une autre conséquence est que de plus en plus d'enfants ne vivent pas avec leurs deux parents. En 1999, sur 13,5 millions de mineurs, 15,8 % (soit 2,2 millions) ne vivaient qu'avec un seul de leurs parents, dont 13,9 % avec leur mère et 1,9 % avec leur père, tandis que 0,8 million, soit 6,2 %, vivaient avec leur père ou mère et un beau-parent. Les femmes seules avec un enfant se remettent moins fréquemment en couple, contrairement aux hommes seuls ayant la garde de leurs enfants. Il faut ajouter à cela les enfants vivant avec leurs deux parents et des demi-frères ou demi-sœurs issus d'une précédente union de leur père ou de leur mère. Ces situations sont de plus en plus fréquentes à mesure que l'on avance en âge : si, à l'âge d'un an, un enfant sur dix ne vit pas avec ses deux parents biologiques, la proportion passe à un sur cinq à partir de l'âge de sept ans et à un sur quatre à partir de l'âge de dix ans. Le pourcentage culmine à 27 ou 28 % vers quinze ou seize ans. La grande majorité des familles monoparentales sont constituées de mères célibataires, soit qu'elles aient toujours été seules, soit qu'elles se soient séparées sans avoir été mariées. Mme Henriette Martinez, Présidente : Je regrette qu'il n'y ait pas de statistiques postérieures à 1999. Peut-on penser que les tendances observées se confirment ? Mme France Prioux : Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement. Nos sources d'information sont surtout les recensements. Sur les ruptures, qu'il s'agisse de couples mariés ou non, notre source est l'enquête rétrospective de 1999, mais l'INSEE n'en a pas programmé de nouvelle. Mme la Rapporteure : A-t-on des données sur le nombre d'enfants élevés par leurs grands-parents ? Par des couples de même sexe ? Ou abandonnés par leurs parents ? Mme France Prioux : Sur le premier point, nous n'avons rien, car l'INSEE ne considère pas de lien de parenté autre que celui entre parents et enfants. Tous les autres cas sont regroupés dans la catégorie « hors famille », ce qui représente peu de monde au total. Quant aux couples de même sexe, l'INSEE se refuse à poser la question, et recodifie même les réponses après coup si besoin est. Mme la Rapporteure : Et sur les enfants de couples pacsés ? Mme France Prioux : Nous n'avons rien encore. On ne sait même pas s'il s'agit de PACS homosexuels ou hétérosexuels. On a seulement des statistiques trimestrielles sur le nombre de PACS conclus et rompus. En 2003, le taux de PACS dissous dans les trois premières années était trois fois plus élevé que celui des mariages dissous. Il s'agissait, dans 82 % des cas, de dissolutions d'un commun accord et, dans 10 % des cas, de dissolutions pour cause de mariage d'un des deux partenaires. Mme Henriette Martinez, Présidente, et Mme Claude Greff : Ensemble, ou avec quelqu'un d'autre ? Mme France Prioux : Ce n'est même pas précisé ! Quant aux ruptures unilatérales, elles sont assez rares : environ 5 % du total. Mme Nadine Morano : Et l'adoption ? Et la procréation médicalement assistée (PMA) ? Mme France Prioux : La PMA a concerné, en 2000, quelque 11 000 enfants, plus 1 000 par insémination avec donneur. Les fécondations in vitro progressent constamment, ainsi que l'âge des mères, qui progresse comme dans le cas des naissances naturelles. Quant à l'insémination avec donneur, c'est une pratique en baisse, à cause de l'apparition de l'injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde. M. Bernard Debré : Il s'agit, pour ceux que la précision intéresse, d'une technique de lutte contre la stérilité, qui consiste à prélever directement dans le testicule un spermatozoïde avant maturité. Mme la Rapporteure : A-t-on des données sur l'insémination ou la PMA pratiquées à l'étranger ? Je pose cette question à cause des mères porteuses. Mme France Prioux : Je n'ai pas de statistiques sur les mères porteuses. Sur la PMA, nous sommes à 1,5 % des enfants qui naissent chaque année grâce à ces techniques. Dans les pays du Nord, il y en a beaucoup plus, et bon nombre des autres pays sont au même niveau que nous. Mme la Rapporteure : Et quel est le nombre des adoptions ? Mme France Prioux : C'est un peu plus compliqué d'obtenir des données. Selon les statistiques des tribunaux et des organismes de placement, il y a par an environ 3 500 adoptions plénières et 6 500 adoptions simples, ces dernières pouvant concerner des enfants comme des adultes. Quant au nombre de visas délivrés en vue d'une adoption internationale, il est assez stable : 4 000 environ. S'agissant des enfants français, les placements en vue d'adoption sont au nombre de quelque 1 000 par an, et ce nombre est assez stable. Par contre, le nombre de pupilles de l'État décroît, car il y a moins d'abandons. Parmi les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE), 500 à 600 par an (536 en 2003) le sont parce qu'ils n'ont pas de filiation établie. Un peu plus de 100 (111 en 2003, mais le chiffre était de 250 au début des années 1990) le sont sur déclaration judiciaire d'abandon, et une centaine sont confiés par leurs parents eux-mêmes, mais ils ne sont pas adoptables, car ils sont seulement confiés et non pas abandonnés. Mme Nadine Morano : Vous avez en partie répondu à une question que je me posais. Je ne voyais pas apparaître, en effet, le nombre de familles homoparentales. Selon certaines associations, cela concernerait quelque 400 000 familles qui comprendraient 100 000 enfants... Mme France Prioux : Cela me paraît beaucoup. Le nombre de couples homosexuels était estimé, dans les années 1990, à 30 000 environ, des hommes pour la plupart. Selon l'enquête de 1999, ce chiffre serait constant, compte tenu toutefois de la marge d'imprécision, et le pourcentage de ceux qui élèveraient des enfants serait très faible. Sans doute y a-t-il une sous-estimation, mais il n'y a guère de possibilités à partir des statistiques de l'INSEE pour y voir plus clair... Mme Nadine Morano : Quel est le nombre de naissances sous X ? Mme France Prioux : Ce n'était pas l'objet de l'enquête, et celle-ci, qui plus est, a été auto-administrée. Il a fallu aller en mairies repérer les actes de naissance sous X, au nombre de 1 000 environ au début des années 1990. Selon l'INSEE, il y a actuellement chaque année moins de 700 enfants nés sans filiation, dont 600 répertoriés à l'aide sociale à l'enfance, mais dont une partie sont ensuite reconnus. M. Pierre-Louis Fagniez : Sans doute ne pourrez-vous pas me répondre, mais je serais désireux d'avoir des ventilations par région et par catégorie socio-professionnelle. Mme France Prioux : Je n'ai pas cela sous la main. Cela demanderait un gros travail. Il y a, cela dit, quelques informations sur les familles recomposées, dont il ressort qu'elles sont plus fréquentes dans les milieux ouvriers et employés, où l'on ne divorce pas beaucoup plus, mais où l'on se remet plus facilement en couple. M. Pierre-Louis Fagniez : Deuxième question : comment se fait-il que l'on n'ait pas plus de données sur le nombre de PACS qui deviennent des mariages ? Mme France Prioux : C'est lié à la loi même qui a créé le PACS. Mme Nadine Morano : Malgré l'amendement de Patrick Bloche ? Mme France Prioux : On disposera en effet, fin 2005, de statistiques sur le sexe et l'âge moyen des personnes pacsées, mais moins précises que celles sur les mariages : on ne va pas très loin quand on ne connaît que l'âge moyen des intéressés ! Il est certain, cela dit, que le PACS s'est développé d'abord chez les homosexuels, puis a progressé davantage chez les hétérosexuels. M. Bernard Debré : Peut-on savoir éventuellement ce que deviennent les enfants nés hors mariage ? Se marient-ils moins que les autres ? Ont-ils plus ou moins d'enfants ? Mme France Prioux : Nous avons des enquêtes sur les enfants nés dans les années 1960 et atteignant l'âge du mariage. La différence de comportement n'est pas significative. C'est très difficile à cerner, parce qu'il faut suivre les gens sur une longue durée. M. Bernard Debré : Les enfants nés sous X ou sans père déclaré recherchent-ils leur père génétique ? Mme France Prioux : Nous n'avons pas de statistiques là-dessus. Mme Henriette Martinez, Présidente : Et sur les enfants maltraités ? A-t-on des statistiques sur les retraits d'enfants à leur famille ? Mme France Prioux : Nous n'avons pas de données sur ce point. Mme la Rapporteure : Sur la nuptialité, la fécondité, la divortialité, l'INED fait-il des projections à dix, voire à vingt ans, en extrapolant les tendances actuelles, ou bien les facteurs risquent-ils d'évoluer trop ? Mme France Prioux : Il y a des hypothèses, mais elles portent davantage sur la structure des ménages que sur celle des familles... On ne sait jamais quand les comportements vont se retourner, mais on sait qu'une tendance ne se prolonge jamais indéfiniment, sans qu'il y ait saturation à un moment ou à un autre. Il n'est donc pas très utile de faire des projections lointaines. M. Sébastien Huyghe : Je suppose que l'on ne connaît pas la durée moyenne d'un PACS ? Mme France Prioux : Non. Avec la nouvelle loi, ce sera possible. Mais comme le PACS n'existe pas depuis très longtemps, la rupture se fait, par construction, au bout de peu de temps aussi. Mme Nadine Morano : Que sait-on, sur le plan sociologique, de l'évolution des unions ? La mixité sociale est-elle plus grande qu'avant ? Mme France Prioux : C'est assez difficile à observer, mais il y a toujours une certaine homogamie sociale, liée notamment à la durée des études. Des enquêtes ont été faites sur le choix du conjoint, après celle réalisée au début des années 1990. Il y en a une en cours, mais ses résultats ne seront pas connus avant un ou deux ans. Le problème est que l'on ne connaît que le conjoint actuel des personnes encore en couple, et que l'on n'a donc pas d'informations sur un éventuel conjoint précédent. C'est un biais. Mme la Rapporteure : Y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez ajouter avant que nous ne levions la séance ? Mme France Prioux : Oui. Je voudrais ajouter que la baisse du nombre des mariages serait beaucoup plus forte s'il n'y avait pas une hausse très importante du nombre des mariages mixtes. En 2003, un mariage sur cinq impliquait au moins un étranger, et dans un cas sur dix une femme française épousait un étranger, originaire du Maghreb dans 55 % des cas. Mme Henriette Martinez, Présidente : Et pour quelle durée ? Mme France Prioux : Nous n'avons aucune donnée. On ne sait rien de plus que la nationalité. Il est très vraisemblable que beaucoup de ces femmes sont elles-mêmes d'origine étrangère, mais on ne le sait pas avec certitude. Mme la Rapporteure : Cela signifie donc que 5,5 % des femmes françaises épousent un étranger maghrébin ? Mme France Prioux : Absolument. Mme la Rapporteure : C'est beaucoup plus que le nombre de familles homoparentales... Mme Henriette Martinez, Présidente : Il me reste à vous remercier pour ces données et ces analyses très intéressantes. Audition de M. Robert Rochefort, directeur général Présidence de M. Patrick Bloche, président M. le Président : Nous accueillons M. Robert Rochefort, directeur général du CREDOC. Le CREDOC est un observateur privilégié des modes de vie, des opinions et des attentes de nos concitoyens. Notamment, l'enquête sur les conditions de vie et les aspirations des Français permet de suivre les besoins des familles. Votre témoignage peut donc nous apporter un éclairage précieux. M. Robert Rochefort : Je ne suis pas un sociologue de la famille, mais un économiste et un sociologue des modes de vie. Mon propos liminaire portera donc plutôt sur la question de l'articulation entre la famille et la société. Je crains de ne pouvoir, en quinze minutes, répondre à toutes les questions que vous m'avez fait parvenir. J'ai cru comprendre que la question sur laquelle mon regard vous intéressait le plus était celle de savoir si l'on peut constater des changements significatifs des modes de vie familiaux et si les facteurs de stabilité l'emportent sur les changements. Pour nous orienter dans le maquis des transformations de la vie familiale, le meilleur fil directeur me semble être leur adaptation à la montée de ce que l'on pourrait appeler, au choix, l'individuation ou l'individualisme, voire l'hyper-individualisme. Il me semble important d'être attentif à de petites choses auxquelles on ne prête pas souvent attention. Je pense par exemple à la montée, très significative, de la pratique des comptes bancaires séparés dans les couples, en particulier les jeunes couples, pour qui elle est pratiquement devenue une règle de base. Un autre exemple, peut-être encore plus significatif, est l'évolution du statut de la chambre à l'intérieur du domicile familial. Elle est devenue, au cours des années passées, un lieu de plus en plus privatisé. Elle n'est plus, comme on le disait autrefois, une chambre à coucher mais une chambre à vivre, qui remplit toute une série de fonctions allant du loisir au travail. L'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication contribue à cette évolution. De façon plus générale, la question de l'articulation entre la revendication individuelle et la structure familiale s'illustre assez bien dans le statut de l'adolescent, du jeune adulte, voire de l'adulte un peu moins jeune. Ce statut ne correspond pas à ce que l'on voit dans le film Tanguy. Il s'agit plutôt d'un statut incertain. La question qui partage beaucoup les parents est de savoir s'il faut ou non accepter, et si oui de quelle façon, que le jeune adulte accueille au domicile familial ses compagnons ou ses compagnes successifs. Je parle ici de la famille ordinaire, composée d'un couple qui n'est pas séparé et qui a des enfants : un tiers des familles sont dans ce cas, comme c'était le cas il y a trente ans. Qu'en est-il des deux autres tiers ? Le phénomène majeur me paraît être l'accroissement spectaculaire du nombre de ménages composés d'une personne seule. Ils représentent le tiers des ménages, et 40 % dans les villes de plus de 20 000 habitants. Dans ces 40 %, il n'y a que 8 % de veufs. Le veuvage est donc loin d'être le facteur principal d'une situation qui s'explique surtout par la montée des séparations et des divorces, mais aussi par le nombre important de jeunes adultes vivant seuls. Ces personnes qui vivent seules ne sont pas nécessairement des personnes sans famille. Elles en ont une, avec laquelle elles ont des relations. Parallèlement, le champ familial s'élargit. La famille nucléaire des années soixante avait fini par oublier les grands-parents, les oncles et tantes, ainsi que les cousins. La famille actuelle fonctionne comme un réseau beaucoup plus large. Il n'est pas rare, par exemple, que l'on voie des frères, des sœurs, des cousins ou des cousines monter ensemble une petite entreprise ou s'associer pour rénover une maison de campagne. La famille reste le lieu de sécurisation dans un monde incertain, inquiétant, agressif. À la question : « Êtes-vous d'accord pour dire que la famille est le seul endroit où vous vous sentez libre et détendu ? », 70 % des personnes répondaient oui il y a vingt-cinq ans, et elles restent aujourd'hui 60 % à répondre oui. Cette baisse est à mettre en relation avec l'augmentation du nombre de personnes ayant vécu une ou plusieurs séparations. L'évolution des modes de vie familiaux n'est pas indépendante de l'ensemble des crises institutionnelles. La famille reste au cœur de la vie sociale mais vit de plein fouet la critique institutionnelle, tout comme le mariage n'est plus une institution mais reste une valeur. Tout se passe comme si l'on rejetait la dimension institutionnelle de la famille pour mieux renforcer l'idée qu'elle correspond à des valeurs authentiques que l'institution tendait à masquer. Par exemple, même si le divorce est de plus en plus accepté, 80 % des Français pensent qu'il est possible de vivre une vie entière avec une seule personne. De la même façon, ils sont plus nombreux qu'il y a dix ou vingt ans à estimer que si l'on se marie, c'est que l'on s'aime profondément. La famille est confrontée à une critique de sa fonction institutionnelle. Elle est soumise à une tentation « expériencielle » : nous ne légitimons que ce que nous considérons comme positif après expérience. Puisque les expériences tournent parfois mal au début de la vie adulte, la famille se construit empiriquement, d'une manière chaotique, au cours d'un processus d'essais et d'erreurs. Cette évolution est-elle de nature à fragiliser ou au contraire à renforcer la famille ? Il ne m'appartient pas de répondre à cette question. Cependant, il me semble possible d'affirmer que ce n'est plus le code civil mais la sociologie empirique qui définit les normes de la nouvelle famille. Je crois pour ma part que c'est là quelque chose de dangereux. La sociologie est descriptive. Je ne suis pas sûr que le rôle du législateur soit uniquement de suivre les évolutions qu'elle décrit quand il s'agit de quelque chose d'aussi important que la famille. Au total, il me semble que les facteurs de stabilité finissent par l'emporter sur les facteurs de changement. La plupart des familles sont assez classiques : 85 % des enfants de moins de quinze ans - ou de moins de dix-huit ans - vivent avec leurs deux parents. Les familles résistent donc pour l'instant aux évolutions que l'on annonce parfois en disant qu'une femme sur trois connaîtra au cours de sa vie une logique de rupture familiale la conduisant à vivre seule, ou encore que presque un mariage sur deux se soldera par un divorce. Mme Martine Aurillac : Vous avez dit que 85 % des enfants de moins de quinze ans - ou de moins de dix-huit ans - vivaient avec leurs deux parents. C'est un chiffre assez surprenant, compte tenu du nombre de divorces et de familles monoparentales. M. Robert Rochefort : Beaucoup d'enfants vivent avec leurs deux parents alors que ceux-ci, s'ils divorcent peut-être un jour, n'ont pas encore divorcé. Le chiffre de 85 % correspond à une situation donnée à un instant T. Mme la Rapporteure : Selon l'INED, 25 % des moins de vingt-cinq ans ne vivent pas avec leurs deux parents, soit qu'ils vivent avec un seul d'entre eux, soit qu'ils fassent partie d'une famille recomposée, le pourcentage des familles recomposées étant de 9 %. M. Robert Rochefort : Cela signifie que 75 % des moins de vingt-cinq ans vivent avec leurs deux parents. Il y a une très grande cohérence entre ce chiffre et celui que j'ai cité. M. le Président : Si les enfants restent plus longtemps au domicile familial, vous semble-t-il que cette évolution est due avant tout à des facteurs sociaux liés au choix d'une entrée plus tardive dans le marché du travail ou d'une difficulté à y entrer ? Ou bien pensez-vous qu'elle correspond plutôt au fait que la cellule familiale sécurisante amène les jeunes à rester plus longtemps chez leurs parents ? M. Robert Rochefort : Il est tout à fait clair que les facteurs économiques jouent un rôle primordial dans cette évolution. Les jeunes adultes qui restent au domicile parental nous disent tous que c'est soit parce qu'ils n'ont pas d'emploi, soit parce qu'ils ont un emploi précaire ou mal payé, soit enfin parce que le prix du foncier est tel qu'ils ne peuvent pas trouver de logement. La cohabitation avec les parents n'est pas pour eux une souffrance comme c'était le cas il y a quelques années, mais s'ils en avaient les moyens, ils préféreraient quitter le domicile parental, par exemple sous la forme de la colocation, laquelle ne concerne pas seulement les étudiants mais aussi les jeunes adultes entrés dans la vie professionnelle. M. le Président : Si l'on peut amener le petit ami ou la petite amie à la maison, la cohabitation avec les parents est moins difficile à vivre. M. Robert Rochefort : Le CREDOC a mené une étude sur cette question. Il est plutôt considéré comme normal par les familles qu'un enfant adulte accueille sous son toit son petit ami ou sa petite amie. M. Pierre-Louis Fagniez : Il semble que l'on tende vers une norme de 50 % de mariages débouchant sur un divorce. Vos études ont-elles permis d'établir une relation entre le taux de divorce et l'allongement de la durée de la vie ? Les deux évolutions sont en effet parallèles. Et l'on pourrait imaginer que la décision de divorcer n'est pas sans rapport avec le fait que l'espérance de vie à la date du divorce est suffisamment importante pour qu'il soit encore possible de refaire sa vie. A contrario, on peut supposer qu'autrefois, sachant qu'ils ne vivraient pas très vieux, les couples étaient plus enclins à se supporter un peu plus longtemps. M. Robert Rochefort : Vous avez parfaitement raison. Il y a une relation entre le nombre de divorces et l'allongement de l'espérance de vie. J'ai lu quelque part - la source n'est pas une étude du CREDOC - que malgré la montée du nombre de divorces, la durée des mariages est plus longue qu'au XIXème siècle, précisément en raison de l'allongement de la durée de la vie. Je voudrais insister sur deux autres aspects des choses. Nous constatons un phénomène que certains appellent la peur des jeunes de s'engager. On parle de « l'adultescence » pour désigner cette période de la vie où l'on est dans l'âge adulte tout en étant encore adolescent. Dans sa typologie des modes de vie, le CREDOC parle des « célibataires campeurs ». J'ajoute que, pour un jeune de vingt ans, la perspective de vivre une vie beaucoup plus longue que ses aînés n'est pas nécessairement heureuse. Certains affirment qu'une petite fille sur deux qui naît aujourd'hui sera presque centenaire. Apprendre, à l'âge de vingt ans, que l'on a encore quatre-vingts ans à vivre n'est pas forcément une information facile à recevoir. Il me semble qu'elle est plutôt de nature à faire naître un certain vertige. Mais pour revenir à votre question, monsieur le député, je pense que l'allongement de l'espérance de vie et la possibilité de refaire sa vie avec un autre partenaire jouent un rôle dans les décisions de divorce prises à 40 ans ou à 50 ans. Et je pronostique que nous constaterons dans quelques années un accroissement du nombre des divorces à 60 ans. J'ajoute que l'idée que l'on peut refaire sa vie à 40 ou 50 ans est plus masculine que féminine. Mme la Rapporteure : Les femmes ont plutôt cette idée autour de 35 ans, quand elles peuvent encore faire des enfants. M. le Président : Qu'est-ce que les enquêtes du CREDOC font ressortir quant au rôle des grands-parents dans la famille ? M. Robert Rochefort : Il est incontestable que la figure des grands-parents est aujourd'hui complètement transformée. Ils jouent un rôle beaucoup plus important que par le passé. D'un point de vue économique, ils ont souvent plus d'argent que les parents. À l'âge de 60 ans, 6 % du revenu courant est distribué aux enfants et aux petits-enfants. C'est considérable. Les grands-parents remplissent incontestablement une fonction de suppléance partielle lorsque le couple parental se sépare. Ils remplissent une fonction d'aide économique lorsque la situation des parents est difficile. Ils remplissent une fonction affective incontestable, bien que très ambiguë. Quand on les interroge, ils disent tous qu'ils sont généreux à l'égard de leurs enfants et leurs petits-enfants parce que ceux-ci sont dans une situation plus difficile que celle qui était la leur au même âge. Mais on constate que si cette affirmation correspond à une certaine réalité, elle est aussi un discours de justification. Les grands-parents gâtent les petits-enfants même quand ils ne sont pas dans une situation économique de manque. J'évoquais à l'instant l'ambiguïté de la fonction affective. Pendant les vacances, par exemple, les grands-parents accueillent leurs petits-enfants. Quand ceux-ci sont jeunes, cela convient à tout le monde. Lorsqu'ils ont grandi, la location d'un appartement dans une station de sports d'hiver correspond à une sorte de troc affectif : elle est un moyen pour les grands-parents de s'assurer qu'ils verront leurs enfants et petits-enfants alors qu'ils n'en seraient pas complètement sûrs s'ils ne leur rendaient pas ce service. Pour ma part, cela ne me choque pas. La famille a toujours été un endroit d'échange économique. Mais peut-être serait-il préférable que les grands-parents en soient plus conscients et ne ressentent pas la nécessité de recouvrir cette réalité par un discours de rationalisation. Les grands-parents jouent un rôle important dans la reconstruction des réunions familiales comme dans le renforcement des liens au sein de la famille élargie. J'ajoute que le CREDOC interroge chaque année les parents sur leurs préférences pour la garde des jeunes enfants. Cette année, pour la première fois, la garde par les grands-parents est passée derrière la crèche collective. Le mode de garde le plus apprécié est la nourrice. Ensuite vient la crèche collective, puis les grands-parents, et enfin la garde à domicile par une personne rémunérée. M. Bernard Debré : N'est-ce pas dû au fait que les grands-parents sont plus actifs que par le passé, soit qu'ils travaillent encore, soit qu'ils souhaitent voyager et considèrent la garde de leurs petits-enfants comme un fardeau ? M. Robert Rochefort : Sans doute. Les grands-parents gardent moins souvent leurs petits-enfants pour les raisons que vous dites, mais aussi pour des raisons liées aux révolutions urbaines. Cela dit, les grands-parents sont très souvent inactifs, puisque l'on quitte aujourd'hui la vie professionnelle autour de 58 ans. M. Bernard Debré : L'augmentation du nombre des crèches n'est-elle pas une autre explication ? M. Robert Rochefort : Peut-être. Il reste que les parents préfèrent en général les modes de garde individuels, le choix d'un mode de garde collectif étant corrélé au niveau social de la famille. M. Sébastien Huyghe : N'hésitent-ils pas à faire appel aux grands-parents parce qu'ils souhaitent que ceux qui gardent leurs enfants aient avec eux une relation éducative ? Ne craignent-ils pas que les grands-parents aspirent plutôt à une relation de plaisir avec leurs petits-enfants ? M. le Président : J'entends de plus en plus de jeunes grands-parents se plaindre de ce que leurs enfants ont tendance à abuser de leur disponibilité. On a l'impression qu'ils souhaitent en effet avoir avec leurs petits-enfants une relation affective, mais en préservant leur autonomie et leurs loisirs. Le CREDOC a-t-il mené des enquêtes sur ce point ? M. Robert Rochefort : Beaucoup dépend de la situation des grands-parents. Il y a un grand éventail de situations. Quand les grands-parents sont divorcés ou remariés, leurs rapports avec leurs petits-enfants sont beaucoup plus difficiles et moins fréquents. Certains grands-parents sont ravis de consacrer beaucoup de temps à leurs petits-enfants, ce qui correspond parfois avec leur demande de moindre investissement professionnel en fin de carrière. D'autres aspirent d'abord à jouir de leur temps libre et souhaitent limiter le temps consacré à leurs petits-enfants. D'autres, enfin, organisent leur vie en réservant aux petits-enfants, dans leur emploi du temps, une part qu'ils souhaitent circonscrire de manière précise. D'une façon générale, les grands-parents ont beaucoup plus de relations avec leurs petits-enfants qu'autrefois. Cela est aussi dû aux nouvelles technologies et aux équipements publics. Le TGV, les autoroutes, le fait que les retraités conduisent, tout cela compense largement l'éloignement géographique entre parents et grands-parents. M. Pierre-Louis Fagniez : Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, l'une des grandes caractéristiques de notre société est la solitude. Les grands-parents n'y échappent pas. Ils peuvent être seuls parce que veufs ou veuves. Ils peuvent aussi être éloignés parce que vivant à la campagne. Y a-t-il un lien entre cette solitude et l'accueil des enfants ? Les grands-parents ont-ils tendance à s'organiser pour combler leur solitude par l'accueil des petits-enfants ? M. Robert Rochefort : C'est plutôt le contraire. Plus les grands-parents sont débordés, plus ils souhaitent consacrer du temps à leurs petits-enfants. J'ajoute qu'une étude menée auprès des personnes âgées a fait apparaître que le sentiment d'être heureux est directement corrélé au nombre de leurs petits-enfants, ainsi qu'au temps consacré à l'activité associative. Mme la Rapporteure : Quel est l'impact du travail des femmes sur la famille, sur la répartition des tâches dans la vie quotidienne et sur les solidarités intergénérationnelles ? M. Robert Rochefort : Je voudrais tout d'abord souligner que la question de l'évaluation du rôle parental ne peut pas être dissociée, aux yeux des Français, de la fonction de l'école. Très majoritairement, ils estiment que l'école n'est plus capable d'assumer ses fonctions de formation et d'encadrement, ce qui rejaillit sur la façon dont ils définissent la fonction parentale. Cette fonction parentale est moyennement remplie. Le manque de temps est très souvent invoqué. Mais surtout, les parents affirment que la société ne valorise pas la fonction parentale. Quand on leur demande ce qui pourrait les aider à assumer cette fonction, ils avancent quatre réponses : il conviendrait de développer les équipements et les activités parascolaires ; il faudrait instituer un salaire parental pour le parent qui reste au domicile ; il faudrait condamner les parents dont les enfants commettent des infractions ; il faudrait augmenter les effectifs d'enseignants. La première réponse est avancée en majorité par les jeunes et les catégories socioprofessionnelles « supérieures » ; la deuxième l'est par les femmes au foyer, les ruraux, les indépendants et les familles nombreuses ; la troisième l'est par les hommes et les indépendants ; la quatrième l'est par les ouvriers et les non-diplômés. M. Jean-Marc Nesme : Avez-vous mené des enquêtes sur la perception par les parents du rôle des médias ? Chacun sait que ceux-ci jouent de plus en plus un rôle de magistère, qui correspond à ce que l'on appelle aussi « l'écran social ». Beaucoup de parents ont le sentiment que les médias sont en concurrence par rapport à leur fonction parentale. M. Robert Rochefort : Nous n'avons pas mené d'enquête sur ce sujet. Mais quand les parents disent que la société ne valorise pas suffisamment la famille, ils visent probablement, entre autres, les médias. S'agissant de la répartition des tâches domestiques, l'écart se réduit, mais il se réduit très lentement. Depuis une quinzaine d'années, le temps qu'y consacrent les femmes se réduit d'une minute par jour, celui qu'y consacrent les hommes augmente de moins d'une minute par jour. Cela dit, les Français, quand ils répondent à des enquêtes sur ce point, ont tendance à affirmer que la répartition des tâches domestiques relève de leur vie privée. Entre 80 et 90 % des Français considèrent que les hommes devraient consacrer plus de temps à ces tâches, mais 84 % affirment que la répartition actuelle des tâches est satisfaisante. Il serait faux de croire que les Français seraient favorables à une indifférenciation complète des rôles de l'homme et de la femme. M. le Président : Avez-vous mené des enquêtes faisant apparaître une plus grande implication du père dans les tâches domestiques et dans l'accompagnement des enfants ? M. Robert Rochefort : L'un des acquis de nos études est d'avoir mis en lumière la nécessité de distinguer tâches domestiques et tâches parentales. Aujourd'hui, dans un couple bi-actif, l'homme prend en charge 30 % du temps domestique et la femme 70 %. S'agissant du temps parental, les proportions sont respectivement de 40 % et 60 %. On peut dire que le temps libéré par la réduction du temps de travail a été largement mis au service du temps parental. M. le Président : Avez-vous mené des enquêtes qualitatives sur la valeur des tâches ? L'idée ne prévaut-elle pas que les tâches parentales sont plus valorisantes que les tâches domestiques ? M. Robert Rochefort : Il est clair qu'il existe une hiérarchie entre tâches parentales et tâches domestiques. Il y a même une hiérarchie à l'intérieur des tâches domestiques. Le lavage du linge et le repassage sont des tâches hyperféminines. Le bricolage est très masculin. Mme Christine Boutin : La durée du temps domestique est-elle stable ? M. Robert Rochefort : Le temps moyen consacré aux tâches domestiques au cours d'une journée tend à diminuer, du fait des gains de productivité. Mais au cours de la vie, le temps domestique augmente avec l'âge. Les hommes, quel que soit leur âge, consacrent la même durée au temps domestique. Par contre, les femmes de 45 ans y consacrent 50 minutes de plus que les femmes de 30 ans. D'une part, les tâches domestiques sont beaucoup plus nombreuses à 45 ans qu'à 30 ans ; d'autre part, les hommes de 30 ans participent plus aux tâches domestiques. Il y a sans doute également des tâches domestiques que l'on abandonne. On ne cire plus le parquet une fois par semaine. M. Bernard Debré : La répartition des tâches domestiques a-t-elle une incidence sur le nombre de divorces ? M. Robert Rochefort : Je l'ignore. Intuitivement, je ne dirais pas que le fait de partager les tâches domestiques protège du divorce. Mme Michèle Tabarot : Les statistiques portant sur les couples bi-actifs prennent-elles en compte la durée du travail de l'homme et de la femme ? M. Robert Rochefort : Oui. Dans un couple bi-actif - on entend par là un couple où les deux partenaires travaillent à temps plein -, l'homme occupe 53 % du temps professionnel, et la femme 47 %. Je voudrais vous faire part d'une autre étude, qui fait ressortir qu'à la naissance d'un enfant, 90 % des Français pensent que la famille doit changer son mode de vie. Et 47 % des Français pensent que l'un des deux parents doit s'arrêter de travailler pendant deux à trois ans, période durant laquelle il ou elle devrait, selon eux, percevoir un salaire parental ou une prestation équivalente. J'ajoute que 40 % des Français estiment que l'un des deux parents doit quitter son emploi à temps plein pour choisir un temps partiel. Ce sont plutôt les traditionalistes qui sont favorables à une cessation d'activité alors que les modernistes sont en faveur du temps partiel. Tous pensent que l'arrivée de l'enfant doit conduire à une nouvelle répartition entre activité professionnelle et activité familiale. M. le Président : Avez-vous affiné les enquêtes dans ce domaine ? Combien de femmes cessent de travailler à l'arrivée de l'enfant ? Combien de femmes ont un temps partiel ? Et parmi elles, combien ont un mi-temps ou un trois-quarts de temps ? M. Robert Rochefort : Le problème est d'établir un lien de cause à effet entre l'arrivée de l'enfant et le temps partiel. Or il est difficile de distinguer le temps partiel contraint du temps partiel choisi. Mme Marie-Françoise Clergeau : Il faudrait savoir combien de femmes ne peuvent pas retrouver du travail après avoir cessé leur activité professionnelle en raison de l'arrivée d'un enfant. M. Robert Rochefort : À la sortie de l'allocation parentale d'éducation (APE), une femme sur trois ou près d'une femme sur deux - je n'ai pas en tête les chiffres exacts - souhaite ne pas reprendre d'activité professionnelle. Ce chiffre nous a plongés dans une certaine perplexité. Le lien de cause à effet n'est pas certain. Peut-être certaines femmes ont-elles bénéficié de l'APE alors qu'elles souhaitaient de toute manière arrêter de travailler. Mme Annick Lepetit : Savez-vous si le temps parental est mieux partagé entre le père et la mère dès lors que ceux-ci ne vivent plus ensemble ? M. Robert Rochefort : Nous ne disposons pas d'études portant sur ce point précis. Spontanément, j'aurais tendance à dire qu'il est difficile d'arriver à un meilleur partage du temps parental à la suite d'un divorce. Je peux vous dire qu'à partir de 40 ans, 6 % des femmes vivent seules, contre 13 % des hommes. La différence s'explique par le nombre de femmes qui, après une séparation, ont la garde des enfants et ne sont donc pas comptabilisées parmi les personnes seules. Avant la fin de cette audition, je voudrais vous communiquer quatre chiffres : neuf Français sur dix considèrent que les jeunes ont davantage besoin de leurs parents que les jeunes d'il y a vingt ans ; deux Français sur trois pensent que nos enfants auront demain un niveau de vie inférieur au nôtre, ce qui me semble très préoccupant ; huit Français sur dix pensent que le devoir des parents est d'aider leurs enfants y compris lorsqu'ils sont adultes ; deux Français sur trois, enfin, pensent qu'il est préférable que les parents transmettent une partie de leur patrimoine de leur vivant. M. le Président : Monsieur Rochefort, nous vous remercions très vivement des informations que vous nous avez données sur les modes de vie des Français. Audition de M. Michel Chauvière, sociologue, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Monsieur Michel Chauvière, sociologue et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, vous êtes un spécialiste reconnu, entre autres, des mouvements familiaux. Nous vous demanderons de décrire l'histoire de la notion de politique familiale et de nous éclairer sur la façon dont sa régulation et ses implications sociales ont évolué. M. Michel Chauvière : J'appartiens au Centre d'études et de recherches de sciences administratives, le CERSA, laboratoire commun au CNRS et à l'université de Paris-II qui regroupe des juristes en droit public, des politistes, des sociologues, la plupart d'entre eux étant passionnés par la généalogie de l'action publique. Dans cet ensemble, je m'occupe avec quelques autres du pôle dédié aux politiques sociales, plus particulièrement aux questions familiales. J'ai été amené à travailler sur cette question par deux voies. Ma première entrée a été celle des mouvements familiaux. L'organisation française du champ familial, couronnée par l'UNAF - l'Union nationale des associations familiales -, est très différente de celle que l'on observe en Espagne, en Belgique et surtout en Angleterre. Chacun des deux grands partis politiques espagnols, par exemple, anime son propre réseau d'associations et le système est beaucoup moins institutionnalisé que dans notre pays. Comment cette spécificité française s'est-elle construite ? Il existe au total une soixantaine d'associations fédérées : Familles de France, Familles rurales, la Confédération syndicale des familles, l'Association des familles catholiques, l'Association des familles protestantes, l'Union des familles laïques, etc. Je me suis spécialement penché sur un groupe particulier issu de l'Action catholique, c'est-à-dire de la Jeunesse ouvrière chrétienne - la JOC - et de la Jeunesse agricole catholique - la JAC -. Nées à la fin des années vingt, ces deux organisations se sont déployées au cours des années trente et ont donné naissance, dans les années quarante, à Familles rurales et au Mouvement populaire des familles, avant d'irriguer l'Action catholique ouvrière - la plus engagée sur le plan religieux - la branche ouvrière du PSU des années soixante, ainsi que des mouvements à vocation familiale, syndicale ou culturelle comme Culture et liberté ou l'ADELS, l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale. Plutôt que sur des archives mortes, nous avons travaillé avec des témoins vivants, acteurs de cette époque, ce qui nous aide à comprendre ce qui peut animer un militant familial aujourd'hui, quel rapport il entretient avec la famille et pourquoi elle devient une question publique qu'il faut externaliser, porter dans le champ social. On ne se bat pas pour sa propre famille, mais pour la famille comme principe général d'organisation sociale - c'est surtout évident pour les célibataires, notamment les prêtres -. Cette démarche est légitimée par la loi Gounot de 1942, instituant un dispositif original de représentation officielle des intérêts matériels et moraux des familles, dispositif dont s'inspirera, après la Libération, l'ordonnance de mars 1945. Ma seconde démarche est plus classique. Après avoir travaillé sur l'organisation de l'action familiale à travers les actes fondateurs de la politique familiale - les allocations familiales, les fameuses lois de 1920 criminalisant l'avortement et interdisant la propagande anticonceptionnelle, le code de la famille et de la natalité françaises de 1939, l'installation du Haut conseil de la population et de la famille à la même époque -, j'ai cherché à mieux connaître l'histoire politique de la famille. Cette approche n'est possible que si l'on pose comme hypothèse que la famille est une construction sociale, humaine, qu'elle ne procède d'aucune espèce de naturalité et n'est pas universelle : elle n'a pas d'essence ou du moins de substance propre. La conception de la famille dépend donc des normes portées par divers groupes sociaux en concurrence, comme les États ou les Églises. Lorsque l'on s'intéresse aux familles, on trouve des hommes, des femmes et des enfants, unis par des relations asymétriques. Par ailleurs, les questions matérielles et patrimoniales y sont cruciales. C'est aussi au sein de la famille que se pratique l'essentiel de la sexualité, ce qui amène à s'interroger sur la régulation et les formes acceptables de la sexualité, et sur la sexualité extra-familiale, pré-familiale, ou encore celle des personnes handicapées. La famille est étayée par des normes juridiques issues du droit canon, du droit civil, du droit social, du droit du commerce ou du droit de la consommation. Enfin, la famille suscite de multiples controverses, au point que cette caractéristique semble inséparable de son existence sociale même : aujourd'hui, c'est le PACS ou la parentalité ; pendant la Révolution française, c'étaient l'égalité entre l'homme et la femme, le statut de l'enfant, la liberté contractuelle de s'unir et son double, la liberté de rompre le mariage par consentement mutuel, déjà inscrit dans les projets de 1792. On trouve certes des enfants, des biens patrimoniaux, de la sexualité, du droit et des débats ailleurs que dans la famille, mais c'est en son sein que ces éléments connaissent leur plus grand développement. Comment les différents pouvoirs intéressés par le contrôle de ces enjeux s'y prennent-ils ? Cette approche par les ingrédients, qui disloque l'unité de la famille, ne doit pas faire oublier deux réalités. D'abord, un irréductible biologique semble s'imposer à la famille, même si la médecine de pointe s'y intéresse fortement. La seule méthode de procréation connue est la reproduction sexuée, la rencontre entre un principe mâle et un principe femelle ; la procréation in vitro et même le clonage n'y changent rien puisque le recours au ventre d'une femme demeure nécessaire. Le second irréductible est plus relatif : c'est la durée extrêmement longue de la socialisation de l'enfant et le fait qu'elle soit largement prise en charge par ses géniteurs. Cet accompagnement de l'enfant vers l'âge adulte par ses parents crée d'ailleurs des conflits avec les autres éducateurs ; ainsi, certaines familles résistent à l'école laïque, gratuite et obligatoire mise au service de l'enfant et n'ont de cesse de chercher à constituer une école au service de la famille. Si la question familiale, en France, est autant débattue et controversée, c'est sans doute parce que notre pays se situe au croisement de deux expériences historiques : le catholicisme et la Révolution française. Notre longue tradition catholique n'est évidemment pas sans effets sur les normes transmises et, au-delà, sur la conception générale de la famille et du mariage, notions pratiquement inséparables pour l'Église. La Révolution a fondamentalement affecté cette représentation dominante et la situation actuelle n'est autre que le fruit de ce télescopage. En Espagne, au contraire, les expériences républicaines ont été limitées dans le temps et se sont mal terminées, notamment la seconde. Au demeurant, dans toutes les monarchies, une partie de l'imaginaire familial se légitime dans la vie de la famille royale exposée au peuple. Ainsi, en Angleterre, la famille est consubstantielle à la société puisqu'elle y est incarnée par la famille royale, référence commune en dépit de ses frasques. L'espace religieux et l'espace civil sont moins différenciés - il n'existe d'ailleurs pas d'équivalent à notre code civil -, à tel point que le mariage anglican a valeur civile, tandis que la France, depuis 1792, confère au mariage religieux un statut secondaire, privé, en ne l'autorisant qu'une fois le mariage civil prononcé. Je retiens principalement deux éléments de la culture catholique. Premièrement, le concile de Trente, qui se tient entre 1545 et 1563, érige le mariage en sacrement, tandis que, chez les protestants, ce n'est qu'un contrat. En pleine contre-réforme, c'est un acte politique et stratégique : il s'agit, pour l'Église, d'exercer son pouvoir temporel, au sens où l'entend saint Thomas d'Aquin, en contrôlant la famille et le mariage, chez les grands comme chez les petits. Deuxièmement, l'Église contrôle une grande partie de l'état civil, c'est-à-dire de tous les événements de la vie, donc de l'organisation sociale, et ce n'est pas sans résistance qu'elle cédera cette prérogative. L'œuvre révolutionnaire entreprend de laïciser la société : institution des registres d'état civil pour arracher à l'Église la connaissance de la population qu'elle tenait des registres de baptême ; mariage civil ; démariage à travers le divorce institué en 1792. En outre, la Révolution invente la majorité à vingt et un ans, instaure l'égalité entre héritiers et interdit de déshériter, donne un statut à l'enfant. À ce propos, c'est encore l'étape révolutionnaire qui pose quelques principes essentiels comme l'interdiction du droit de correction paternelle Au xixème siècle, la famille est plutôt un thème exploité par les traditionalistes, nostalgiques de l'Ancien régime, qui veulent restaurer l'ordre déchu et son modèle hiérarchique, dans le gouvernement des hommes comme dans celui des entreprises et de la famille. D'ailleurs, le code civil les y incite puisque Napoléon, dans son travail de compromis, va réintroduire l'inégalité entre l'homme et la femme au sein même de la famille. Je note au passage que le code civil ne définit pas la famille, pas plus qu'aucun autre texte fondamental du droit français. M. Jean-Marc Nesme : C'est faux ! La famille est définie par l'article 213 du code civil, que tous les maires lisent lorsqu'ils célèbrent un mariage ! Mme Hélène Mignon : Mais non ! M. Michel Chauvière : Le code civil évoque bien la famille mais ne la définit nullement. M. Jean-Marc Nesme : Il organise la famille en attribuant l'autorité parentale conjointe au père et à la mère. M. Michel Chauvière : Mais ce n'est pas une définition ! M. Pierre-Louis Fagniez : Si c'était le cas, Christine Boutin n'aurait pas déposé de proposition de loi pour définir la famille, nous pouvons lui faire confiance ! M. Michel Chauvière : Au cours de l'histoire, plusieurs propositions ont effectivement eu pour objet de définir la famille, spécialement sous le régime de Vichy, dans l'optique de lui donner le statut de personne morale, mais toutes ont échoué ; les civilistes maréchalistes eux-mêmes étaient divisés sur l'opportunité d'une telle mesure. La famille existe socialement mais pas juridiquement. Les silences du code civil sont d'ailleurs lourds de conséquences. M. le Président : Le code civil confie aux époux une responsabilité conjointe dans l'éducation des enfants mais ne définit pas la famille. M. Michel Chauvière : Absolument. Prenez la loi de 1901 : elle ne se contente pas d'expliquer comment on constitue une association ; elle précise également que celle-ci est dotée de la personnalité morale. La famille est objet du droit mais pas sujet de droit. M. Jean-Marc Nesme : Je vais vérifier dans le code civil. M. le Président : Ce panorama historique passionnant sera un facteur d'unification pour la Mission d'information, mais il serait bon, monsieur Chauvière, que nous puissions aussi avoir un échange. M. Michel Chauvière : Deux mots encore : les révolutions de 1830 et de 1848 font peu de cas de la question familiale. La Troisième République sera au contraire un moment historique important. Entre 1895 et 1914, en attendant les grandes politiques d'assurances sociales des années vingt et la création de la Sécurité sociale en 1945, se développent toute une série de politiques assistancielles : aide médicale gratuite, protection de l'enfance et des vieillards infirmes, etc. Ces textes sont conformes à l'ontologie républicaine dans le sens où ils s'adressent aux citoyens pris individuellement. L'école obligatoire fait partie du tableau : elle est pensée en fonction de l'enfant et n'est en aucun cas un service à la famille ; l'enfant est sujet du droit à l'instruction et ses parents ont obligation de l'envoyer à l'école. Le dernier de ces textes, celui de 1913, qui innove en créant une allocation au bénéfice des familles nombreuses nécessiteuses, constitue en fait la dernière loi d'assistance et la première loi familiale. En somme, même si tout le monde ne pense qu'à cela, l'idée de famille n'est pas facile pour la République. Vers 1920, au lendemain de la Grande Guerre, pour des raisons natalistes, mais pas seulement, apparaît le ministère des Affaires sociales première manière, en fait chargé des questions familiales. En 1932 sont créées les allocations familiales. Ce sursalaire en faveur de la famille, vieille revendication du mouvement familial, était alors refusé par la CGT et le reste du mouvement ouvrier, qui le percevaient comme un facteur de discrimination entre les travailleurs. C'était en fait une première mesure de discrimination positive, mais elle n'était pas si désintéressée : il s'agissait aussi de fidéliser la main-d'œuvre dans les entreprises. Les allocations seront progressivement déconnectées du travail et, en 1946, avec leur intégration dans la Sécurité sociale, elles deviendront un droit universel, au moins pour ce qui concerne l'allocation de base. Le Front populaire ne s'occupe guère de régulation familiale si ce n'est en utilisant les allocations familiales pour ne pas accroître le salaire direct. Mme Hélène Mignon : Ce n'est pas sa seule mesure. M. Michel Chauvière : Entre le Front populaire et la guerre, en 1938, est instauré le Haut conseil à la population et à la famille, au nom des intérêts démographiques de la France, en phase avec la question de l'immigration et dans un contexte de concurrence avec l'Allemagne M. le Président : Beaucoup de membres de cette Mission d'information appartiennent aussi à une commission permanente de l'Assemblée nationale dont l'intitulé fait référence à la famille : la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. M. Michel Chauvière : Il serait d'ailleurs intéressant, M. le Président, d'étudier la genèse de cette appellation. En juillet 1939, la Troisième République agonisante crée un ministère de la Famille qui reprend toutes les attributions du ministère de la Santé, sous l'autorité de Georges Pernot, et qui sert de « tapis rouge » à la politique familiale du régime de Vichy. Celui-ci, vous le savez, prendra pour devise « Travail, Famille, Patrie ». Son premier acte est de créer un Commissariat général à la famille, innovation administrative, ancêtre de l'actuelle direction générale de l'action sociale. Les chargés de mission du Commissariat général ont une grande capacité d'action dans le cadre du régionalisme vichyste, décentralisation avant l'heure. Ils agissent de façon très moderne avec les universités, les sommités du monde médical et des pédagogues du secteur privé et associatif, aux limites de l'épure traditionnelle, très républicaine, distinguant privé et public. L'État français met aussi à l'étude le projet de personnalité morale de la famille, dont j'ai déjà parlé, et celui du statut des associations familiales nées au début du siècle. Celles-ci revendiquent des prix cassés et des logements pour les familles, mais également le vote familial : il s'agit de prendre au pied de la lettre le concept d'universalité du droit de vote, sans l'accorder aux femmes ni aux enfants mineurs, mais en créditant le chef de famille d'autant de suffrages que sa maisonnée comporte de membres. Cette idée, jamais adoptée, fut néanmoins débattue assez régulièrement jusqu'aux années trente, et Poincaré, à une époque, s'en fit même l'avocat. Mme la Rapporteure : Elle fait encore débat aujourd'hui en Allemagne. M. Michel Chauvière : Cette pratique a d'ailleurs cours au sein de l'UNAF. Le code de l'action sociale et des familles prévoit que ses associations constitutives y sont représentées au prorata de leurs capacités familiales : une voix par adulte, une voix par tranche de trois enfants, une voix par enfant handicapé majeur à charge et même une voix par enfant mort pour la France ! On a ainsi réalisé un lien entre l'unité familiale et la citoyenneté ; mais on sort de la logique « un homme, une voix » pour entrer, d'une certaine manière, dans une sorte de communautarisme. J'en reviens au régime de Vichy. La loi Gounot, je l'ai dit, donne un statut aux associations familiales, mais le système est très contrôlé administrativement et très centralisé. L'idée est reprise en 1945, portée par le MRP et le PCF, à travers des responsables comme Robert Prigent et François Billoux. Ils considèrent avec pragmatisme qu'il faut mobiliser les familles dans la reconstruction et que rien ne serait pire que de faire disparaître purement et simplement l'acquis des droits collectifs contenus dans la loi Gounot ; le texte est seulement nettoyé et républicanisé. Au fait, monsieur Nesme, avez-vous trouvé l'article du code civil que vous cherchiez ? M. Jean-Marc Nesme : La famille n'est pas définie dans le code civil, je vous l'accorde, mais elle l'est dans la Convention européenne des droits de l'Homme. M. Michel Chauvière : Je n'ai jamais dit le contraire ! M. Jean-Marc Nesme : Il n'en reste pas moins que l'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité familiale « appartient aux père et mère ». M. Michel Chauvière : Mais le père et la mère ne constituent pas obligatoirement une famille ! M. le Président : Le code ne contient pas de définition claire de la notion de famille, c'est indéniable. M. Jean-Marc Nesme : Cet article parle tout de même de la famille, pas de l'automobile ! M. Michel Chauvière : En 1946 apparaissent les caisses d'allocations familiales et la caisse nationale, l'UNCAF, qui sera transformée en CNAF en 1957. Avec l'UNAF et l'INED La loi de 1953 finance l'UNAF par le haut, le robinet étant alimenté par les cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales, à hauteur de 0,1 %, je crois, ce qui permet au « lobby familial » - comme disent certains, à tort me semble-t-il - de fonctionner avec des moyens considérables : l'hôtel particulier de la place Saint-Georges ne connaît manifestement pas la crise, alors que le reste de la vie associative française est en déclin. M. Patrick Delnatte : C'est peut-être un bel immeuble, mais certaines parties intérieures sont très anciennes. M. Michel Chauvière : D'une certaine manière, l'existence de l'UNAF et des UDAF permet de contrer l'impossibilité de donner un statut juridique à la famille : si aucune famille n'a de statut propre, l'ensemble des familles organisées a gagné le droit de figurer dans l'organisation institutionnelle française, ce qui lui confère une sorte de personnalité morale collective. L'UNAF est une structure monopolistique, les tentatives concurrentes n'ayant pas abouti, et elle jouit de prérogatives importantes, en particulier le monopole de la représentation des intérêts familiaux en France : ainsi, lorsque son président, M. Hubert Brin, s'exprime, il est investi d'une autorité officielle - il préside de surcroît la section des affaires sociales du Conseil économique et social -. Cette autorité est cependant contestée par les exclus du système : les parents d'élèves de l'enseignement public, qui restent volontairement à l'extérieur, et tous ceux qui sonnent à la porte mais ne sont pas acceptés, la dernière candidate en date étant l'APGL, l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Les parents homosexuels répondent pourtant à la définition de la famille proposée par l'UNAF. En 1989, année du bicentenaire de la Révolution française, son assemblée générale, réunie à Bordeaux en présence du président Mitterrand en personne, avait proclamé une déclaration des droits de la famille, dépourvue de toute valeur réglementaire mais qui définissait ainsi la famille : elle est constituée par le mariage, la filiation légitime ou adoptive, la filiation naturelle ou l'exercice de l'autorité parentale, ce qui ouvre des perspectives assez larges. Mme la Rapporteure : Les conditions sont-elles cumulatives ou alternatives ? M. Michel Chauvière : On peut comprendre qu'il suffit qu'une condition soit remplie. Or l'APGL représente des personnes qui peuvent faire état d'un lien de filiation et qui sont pourvues de l'autorité parentale ; mais son adhésion reste bloquée. M. le Président : Nous demanderons à M. Hubert Brin les raisons de ce blocage. M. Michel Chauvière : Il a donné une explication assez légitime : l'UNAF ne saurait se substituer au législateur. Je dirai un dernier mot à propos de l'adoption. Création du code de la famille de 1939, l'adoption plénière construit de la famille autrement que par la voie naturelle, sans sexualité procréatrice : par la loi. Mme la Rapporteure : Avant 1939, l'adoption n'existait donc pas ? M. Michel Chauvière : Si. Elle s'est développée après la Première Guerre mondiale mais restait peu réglementée ; au xixème siècle, il était surtout courant d'adopter un adulte. L'adoption ouvre même aux célibataires la possibilité de fonder une famille. Pour certains, c'est le degré zéro de la famille, mais cela ne dépasse pas les limites de la définition, curieusement large, de l'UNAF. Et le code civil n'interdit pas une telle interprétation puisqu'il est muet sur le sujet ! M. le Président : Ce fut moins un dialogue qu'un exposé, mais nous avons énormément appris et nous nous permettrons sans doute de revenir vers vous, en fin de mission, pour nous resituer dans une perspective historique. Je vous remercie. M. Michel Chauvière : Je me tiens à votre disposition. Audition conjointe de Mme Martine Segalen, sociologue, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Mme Martine Segalen, sociologue, professeur à l'université de Paris X, et M. André Burguière, historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Il n'était pas concevable que notre Mission d'information sur la famille et les droits des enfants se prive de l'éclairage que vous n'allez pas manquer de lui apporter ce matin, sur un sujet dont vous êtes tous deux d'éminents spécialistes. Vous êtes d'ailleurs coauteurs d'une Histoire de la famille. M. André Burguière : M. le Président, mesdames et messieurs les députés, l'histoire de la famille ne se raconte pas. C'est une histoire sans date, sans événement, et même sans évolution clairement dessinée. En outre, c'est une histoire sur laquelle chacun a son idée. Tous nos jugements sur l'état et les problèmes actuels de la famille - par exemple quand nous parlons de « déclin » ou de « crise » de la famille - se réfèrent à un long passé de stabilité plus ou moins mythique. Je me propose, sans prétendre à l'exhaustivité, de décrire et d'expliquer certaines formes de changement, en me concentrant sur deux thèmes : le mariage et le couple, d'une part, la famille et l'État, d'autre part. Il serait absurde de nier que nous assistons à une crise du mariage. En tant qu'institution validée par le passage devant l'autorité religieuse, il est affecté par un décrochement qui remonte au moins au début du XIXème siècle. En tant qu'institution civile, il traverse une crise récente, apparue au milieu des années 1970, c'est-à-dire, curieusement, au moment même où la natalité cessait de décliner en France. Dans sa forme la plus complète - c'est-à-dire celle comprenant un passage devant le maire puis l'autorité religieuse -, l'institution du mariage était encore une pratique majoritaire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette pratique ne remonte pas à Mathusalem, ni même à l'apparition du christianisme. En tant qu'officialisation d'une alliance entre un homme et une femme, mais surtout entre deux familles, dans le but de faire des enfants reconnus et d'assurer la reproduction du groupe familial, le mariage existe dans pratiquement toutes les sociétés. Cependant, l'Église elle-même considérait à l'origine qu'il s'agissait d'une affaire civile et terrestre, qui concernait les familles. Il en reste d'ailleurs une particularité théologique : le sacrement du mariage, qui est le plus récent des sacrements, n'est pas administré par les prêtres mais auto-administré. Ce n'est en fait qu'au XVème siècle, au moment où la société européenne dépeuplée et désorganisée commençait à se reconstruire, où beaucoup de lignages avaient disparu, que l'Église favorise le mariage pour lui-même, comme moyen d'arracher l'individu à l'insécurité et à la solitude. C'est aussi à ce moment que se fixe le rituel religieux que nous connaissons encore aujourd'hui. L'Église tente de valoriser la donation réciproque et le libre consentement des conjoints. C'est au siècle suivant que l'État, inquiet du développement des mésalliances que favorisaient les « mariages clandestins », décidés par les époux sans l'accord de qui que ce soit, a imposé le retour à un contrôle étroit des familles sur les choix de mariage. Mais au même moment, les autorités religieuses s'efforcent, avec une efficacité sans précédent, de réaliser le vieux rêve de l'Église d'enfermer la sexualité dans la sphère conjugale. Il faut en effet rappeler que, dans la plupart des sociétés anciennes, en particulier dans les sociétés grecque et romaine, l'amour et le mariage sont deux réalités distinctes. L'amour a pour but le plaisir. Le mariage a pour but de donner naissance à des enfants légitimes. Dans le droit coutumier ancien, il en reste d'ailleurs des traces, par exemple le fait de ne reconnaître les droits de l'épouse qu'à partir de la naissance du premier enfant. C'est à partir du XVIème siècle que s'affirme une forte hostilité des autorités et d'une large partie de la société aux formes de sexualité extraconjugale, et en particulier à la bâtardise. Cette pression normative se révèle efficace puisque, à partir de la seconde moitié du XVIIème siècle, les naissances illégitimes disparaissent pratiquement totalement. Ce phénomène, exceptionnel, a duré trois quarts de siècle, ce qui est considérable. L'insistance que l'Église a mise sur le libre consentement et sa stratégie de rechristianisation de la société et de la sphère conjugale ont eu deux effets imprévus. En isolant le couple de son environnement pour mieux le soumettre à l'autorité des parents et non plus au voisinage, l'Église a créé une sphère d'intimité dans le couple, un besoin de secret qui a été sans doute la cause principale de l'apparition précoce, contre la volonté des autorités religieuses, du contrôle des naissances en France, dès le XVIIIème siècle. En outre, l'Église a installé dans l'imaginaire social, dans les lieux communs, le modèle du mariage d'amour. Or, c'est ce modèle qui est à l'origine de la première législation du divorce sous la Révolution. Car si l'amour est le fondement du mariage, quand l'amour cesse, le mariage doit cesser. Nous avons là un bon exemple d'effets imprévus, qui ne sont pas sans analogie avec ce qui s'est passé récemment en Iran. Ce pays a connu en vingt ans la transition démographique la plus rapide que le monde ait vécue depuis celle du Japon après la Seconde Guerre mondiale. La République islamiste n'avait rien prévu de tel, puisqu'elle a rétabli la polygamie, abaissé l'âge du mariage, diminué de moitié le droit d'héritage des femmes. Mais elle a scolarisé massivement la population, y compris les filles, ce qui a été à l'origine d'un mouvement de transformation. Les femmes ont commencé à faire des études, se sont mariées plus tard, ont décidé de leur mariage et l'écart entre les âges des conjoints a diminué. D'où une baisse de la fécondité, qui s'est rapprochée du modèle occidental. L'évolution du mariage en France a donné naissance à un besoin de réalisation affective personnelle dans le couple. Les XIXème et XXème siècles ont été l'âge d'or du couple. La marchandisation de la main d'œuvre et l'essor de la civilisation urbaine ont abouti à une divergence entre la sphère familiale et la sphère individuelle. Ces nouvelles valeurs ont favorisé une poussée individualiste - laquelle n'est certes pas liée uniquement au contexte religieux - qui a fini par réinstaller une séparation entre la sphère de la sexualité et la sphère conjugale. La crise actuelle du mariage est l'aboutissement de cette poussée individualiste, qui ne refuse pas le couple mais ne l'admet que privatisé, soustrait à toute reconnaissance publique. Le couple fondé, non plus sur les enfants, mais sur l'amour, devient aussi éphémère que celui-ci. Un autre facteur important d'individualisation a été la possibilité d'échapper aux contraintes des solidarités familiales. Les rapports de la famille et de l'État se sont ainsi transformés. On ne croit plus maintenant au schéma d'une évolution progressive de la famille ancienne, large, complexe, vers la famille moderne réduite. On tend à penser que plusieurs modèles de structures domestiques et familiales ont sans doute coexisté en France et en Europe jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le modèle nucléaire n'est d'ailleurs pas le plus récent d'entre eux. Mais il reste possible de dégager une évolution : les principales fonctions sociales de la famille ont été progressivement transférées à l'État. La justice, la production et la consommation, l'éducation, la santé, qui, au Moyen Age, étaient presque totalement assurées par le groupe familial, sont désormais confiées à l'autorité publique. Cette évolution a été, dans le cas de la justice, le fruit d'une volonté de l'autorité publique d'étendre ses prérogatives. Mais elle a été le plus souvent le résultat d'une pression de la demande sociale. Cela a été également le cas de la santé : l'hôpital, d'abord réservé aux pauvres, a fini par accueillir tous les patients. Dans le cas de l'éducation, la grande poussée scolaire du XIXème siècle a précédé les lois de Jules Ferry parce qu'elle correspondait à une demande sociale. La maternelle, d'abord créée pour les enfants pauvres, a progressivement séduit l'ensemble de la population. La famille et le couple ont ainsi perdu une large part de leurs fonctions d'assistance, aujourd'hui dévolues à ce que l'on appelle l'État-Providence. En libérant les aspirations individualistes, cette évolution ne doit pas être exclusivement perçue comme une dégradation, dans la mesure où elle se traduit par une promotion des droits de l'homme, par exemple contre la puissance paternelle, ou encore par une affirmation des liens sociaux et nationaux face à l'exclusivisme des liens du sang. Pour conclure, la famille est incontestablement en déclin, du moins du point de vue de son utilité sociale, qui s'est fortement réduite. Mais elle reste un recours dans les situations de danger. Durant les guerres, dans les situations d'oppression par l'État ou de crise économique, elle retrouve son rôle et redevient un bouclier. C'est d'ailleurs peut-être l'une des explications du fait que les pays latins, où la culture familiale est forte, supportent plus facilement que d'autres un taux de chômage élevé. Affectivement, la famille reste forte, mais d'autant plus forte que la fonction affective est la seule qui lui reste. La famille est la seule valeur qui survive. Elle est peut-être la dernière religion - au sens étymologique du terme - du monde sécularisé : elle nous relie, par un lien mystérieux, à d'autres individus, en particulier aux morts. L'attachement profond à la réalité familiale tient aussi à l'idée reçue que la famille est un monde où l'on ne compte pas, un monde qui échappe au marché. C'est bien sûr un mythe. Les querelles familiales au moment des successions suffisent à montrer que l'affrontement des intérêts est au moins aussi important dans la famille qu'ailleurs. Il reste que le lien familial ou plutôt le lien de filiation inspire un sentiment de dette absolue ; l'idée qu'il faut rendre la vie qu'on a reçue. Ce qu'on appelle le désir d'enfant, dont on a longtemps fait une caractéristique féminine avant de s'apercevoir que les hommes désiraient aussi des enfants, correspond à ce besoin fondamental de rendre cette vie reçue. Mme Martine Segalen : Mon exposé sera beaucoup moins brillant que celui de mon collègue et ami André Burguière, avec lequel j'aurai, sur certains points, l'occasion d'exprimer quelques désaccords. La famille est une institution dont on pense toujours qu'elle est en crise. À certaines époques, on a souhaité sa disparition, en raison de l'oppression insupportable qu'elle était censée infliger à l'individu. À d'autres époques, on a parlé, à l'instar de Louis de Bonald, de sa « décomposition ». Frédéric Le Play s'alarmait de la crise qui la touchait à une époque de grande industrialisation et de prolétarisation. Dans les années 1970, on s'est inquiété de la crise de la famille en regrettant l'âge d'or mythique où elle était heureuse et stable. En réalité, cette institution multiple et changeante ne court pas plus de dangers aujourd'hui qu'hier. Tout comme l'image de la famille occidentale heureuse et stable est un mythe, la « réhabilitation » actuelle de la famille est essentiellement un discours médiatique. Notre collègue Louis Roussel, auteur de La Famille incertaine, livre paru en 1989, parle de « désinstitutionnalisation familiale ». Il est vrai que le mariage n'a plus la cote chez les jeunes, bien que 285 000 mariages soient célébrés chaque année. Le couple fondé sur l'amour et l'égalité entre les sexes n'est pas institutionnalisé, mais la naissance de l'enfant opère une réinstitutionnalisation. La filiation est inscrite dans l'état civil, que le couple soit marié ou non. Depuis qu'on en fait moins, les enfants occupent une place croissante dans notre société. Le docteur Sutter disait : « C'est quand les Français ont commencé à faire moins d'enfants qu'ils s'y sont intéressés ». L'enfant est également d'autant plus chéri que les femmes, grâce aux grandes conquêtes féminines, décident du moment de leurs grossesses. Notre pays se caractérise d'ailleurs par le taux de fécondité le plus élevé d'Europe, alors même que le taux de travail des femmes françaises mères d'enfants en bas âge est le plus important. Deux pays seulement sont plus féconds, mais ils ont un taux d'emploi féminin moins fort que celui observé en France. Avec la montée du désir d'avoir une descendance, la famille tend à s'organiser autour des enfants. En outre, le couple qui, même non marié, est réinstitutionnalisé par l'enfant, est entouré de générations plus âgées qui l'aident et qui l'aiment. Peut-on comparer veuvage et divorce ? Je ne le pense pas. Certains tentent de se rassurer devant l'augmentation des divorces, en ramenant ce phénomène à des modèles anciens. Mais on ne peut pas du tout comparer la mort d'un conjoint à un acte volontaire de divorce. Les évolutions de la famille touchent-elles tous les pays européens de la même façon ? Tous les pays européens connaissent des transformations convergentes des modes de vie familiaux, mais la spécificité française tient dans la conjonction d'une fécondité relativement élevée et d'un fort taux d'emploi féminin. S'agissant de l'homogamie, la situation française n'a pas connu de changements significatifs. Les couples continuent de se former majoritairement au sein d'un même groupe social. La répartition des rôles sexuels a-t-elle évolué au cours des années récentes ? Oui et non. Les hommes participent un peu plus aux tâches domestiques. Mais il est très important de distinguer tâches domestiques et tâches parentales. Les premières peuvent toujours être remises à plus tard. Les secondes n'attendent pas. Il me semble que les meilleurs travaux sur cette question sont ceux de Marie-Agnès Barrère-Maurisson, qui montre bien que les mères, même si elles travaillent, continuent d'en faire plus. Vous nous avez posé par écrit plusieurs questions concernant les « formes de parentalité ». Ce mot est apparu récemment, dans les années 1980. Encore aujourd'hui, il s'agit d'un néologisme, et les correcteurs orthographiques de nos ordinateurs le soulignent en rouge... Nadine Le Faucheur a étudié la situation des mères élevant seules leurs enfants à une époque où elles apparaissaient comme des cas sociaux. Elle a contribué, en inventant le concept de monoparentalité, à les réintégrer dans le panorama de la diversité des structures familiales. Est apparu plus récemment le concept de « coparentalité », au moment où tout un arsenal législatif visait à retenir le père dans sa position de père. Il s'agissait de faire comprendre aux pères que le divorce ne les dispensait pas de remplir leur fonction parentale. On a vu arriver ensuite la « pluriparentalité ». L'idée est que plusieurs personnes peuvent partager l'exercice des droits parentaux et des devoirs envers l'enfant. Claudine Attias-Donfut et moi-même avons inventé la « grand-parentalité ». Le concept de parentalité n'est pas toujours neutre. Il tend aujourd'hui à véhiculer une nouvelle crainte concernant la famille. Certains parents sont supposés incapables de remplir leurs fonctions de protection et d'éducation. L'idée que ces parents « démissionnent » me paraît fausse. Nous avons plutôt affaire à des familles très démunies. Quand le père est au chômage, il lui est difficile d'avoir de l'autorité sur ses enfants. Enfin, le concept d'« homoparentalité », mis en avant par les mouvements homosexuels, correspond au souhait de donner au couple sexuel le même statut que les autres couples. S'agissant de la notion de famille recomposée, les travaux d'Irène Théry et ceux qu'elle a inspirés montrent que deux modèles émergent : soit on tente d'effacer la première union à partir de l'idée que le premier compagnon de la mère, défaillant ou absent, doit être remplacé par le second ; soit, et c'est plutôt le cas dans les classes sociales plus aisées, l'enfant circule entre le foyer de son père et celui que forment sa mère et son nouveau compagnon. Quels sont les facteurs déterminants de la taille de la famille ? Sur cette question, je souhaite insister sur le désir d'être jeune mère tout en travaillant. Notre pays, contrairement à ce qui se passe par exemple en Allemagne ou en Autriche, accepte très bien l'idée que l'on peut être mère tout en travaillant. Même dans un pays comme la Suède dont on nous vante tant la politique familiale, des injonctions très fortes pèsent sur les mères, bien plus qu'en France. À cet égard, l'amélioration de notre système de garde d'enfant est réclamée par toutes les familles. S'agissant des liens intergénérationnels, ils sont extrêmement forts dans nos sociétés, même s'ils sont l'occasion de certaines tensions, heureusement apaisées par la disparition de la co-résidence entre générations. Pour la première fois dans l'histoire, quatre, voire cinq générations vivent en même temps. Autrefois, seule la famille pouvait s'occuper des personnes âgées. C'est moins vrai aujourd'hui, mais il reste que beaucoup repose sur la famille, c'est-à-dire, pour être clair, sur les femmes, et notamment sur les fameuses « femmes pivots », celles qui, à cinquante ans, sont grand-mères tout en ayant à leur charge leurs parents. Le filet de protection de l'État-Providence est absolument indispensable, à un moment où certains ont tendance à insister sur le rôle des solidarités familiales. M. le Président : Madame Segalen, monsieur Burguière, je crois traduire un sentiment général en saluant la richesse de vos interventions. S'agissant du désir d'enfant, pensez-vous qu'il se soit modifié ? Veut-on des enfants pour les mêmes raisons qu'on en voulait au XVIIIème ou au XIXème siècles ? Sur quoi le désir d'enfant se fonde-t-il aujourd'hui ? Sur l'idée qu'on a le devoir de jouer un rôle affectif ou éducatif ? Sur la volonté de contribuer à la reproduction de la société dans laquelle on vit ? Sur le désir de transcender l'angoisse de la mort ? Mme Martine Segalen : La notion de « désir d'enfant » est très récente. Pendant longtemps, on ne se posait même pas la question de savoir si on désirait ou non des enfants. Dans les sociétés sans contraception, ils arrivaient naturellement, probablement plus nombreux qu'on ne le voulait. J'ajoute qu'il fallait avoir un enfant pour être adulte. Dans les milieux ruraux, on volait les souliers de la mariée, pour les brûler publiquement si, après quelques années, elle n'avait toujours pas d'enfant. Avoir un enfant allait de soi, puisque c'était le but de la relation sexuelle. La question qui a traversé la société française a été plutôt de savoir comment faire pour limiter le nombre de naissances. Tout a changé à partir du moment où les femmes ont commencé à maîtriser ces naissances. Le couple, qui se construit uniquement sur la notion d'amour, veut désormais se donner une image de lui-même à travers l'enfant. L'idée que l'on prolonge son existence à travers l'enfant joue un rôle, de même que le besoin de rendre aux parents la vie qu'ils ont donnée. Mais je ne pense pas que ce soit pour ces raisons que les couples font des enfants. J'insiste sur le fait que, dans l'esprit des Français, un couple sans enfant n'est pas une famille. Les enquêtes montrent que, lorsque le membre d'une famille vit avec un conjoint hors mariage, il n'est considéré comme appartenant à cette famille qu'à partir de la naissance d'un enfant. Enfin, le désir d'enfant est entretenu par les médias : avoir un enfant, c'est « tendance ». M. André Burguière : On peut difficilement imaginer une société refusant les enfants. Le désir d'enfant est difficile à historiciser. Dans les sociétés paysannes, on avait besoin d'enfants pour deux raisons : ils constituaient une main-d'œuvre en même temps qu'ils représentaient une garantie pour les vieux jours des parents. Avec la valorisation des sentiments désintéressés, on a pour ainsi dire remplacé la quantité par la qualité. Le désir d'enfant s'est récemment individualisé. On veut un enfant pour soi. En outre, la naissance de l'enfant est souvent différée. La femme veut d'abord pouvoir faire des études et s'installer dans la vie active. L'un des problèmes qui me troublent est l'attitude à l'égard de l'avortement. Contrairement à un discours répandu, le maintien d'un nombre important d'avortements ne tient pas au manque d'information sur la contraception. Les femmes qui avortent ont un certain âge et sont très bien averties. La majorité de celles qui avortent sont des femmes qui avaient envie d'avoir un enfant avec leur compagnon et qui ont changé d'avis. Le désir d'enfant est personnalisé, de sorte qu'il est à la fois plus relatif et plus fort que jamais. Mme la Rapporteure : Notre collègue Bérengère Poletti a organisé, dans le cadre de la Délégation aux droits des femmes, une réunion consacrée à l'interruption volontaire de grossesse. Les chercheuses de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) se sont dites scandalisées par cette interprétation du fort taux d'avortements en France, que l'on retrouve dans certains travaux très sérieux, notamment ceux du professeur Nisand. Celui-ci soutient que ce nombre d'avortements est l'expression d'un désir d'enfant qui ne se concrétise pas, les femmes souhaitant revenir sur leur décision. Les chercheuses de l'INSERM soutiennent au contraire que la principale cause du nombre élevé d'avortements repose sur le caractère essentiellement chimique de la contraception en France. La prise quotidienne de la pilule est une contrainte qui provoque une lassitude, de sorte que les femmes ont tendance à l'oublier, ou à ressentir une certaine saturation. M. André Burguière : Cette explication est tout à fait possible. Les études sociologiques auxquelles je pense ont été réalisées à partir d'enquêtes par entretiens. Il se peut que, lorsqu'on raconte sa vie, on arrange l'histoire... M. le Président : Quoi qu'il en soit, il importe de souligner qu'on ne doit pas lier le fort taux d'avortement à un problème d'inculture ou d'éducation insuffisante. M. Pierre Goldberg : Les deux exposés que nous avons entendus étaient passionnants. Ils étaient aussi effrayants, car il sera difficile de traduire en dispositions législatives la richesse des analyses qu'ils nous ont présentées. Vous avez insisté, madame Segalen, sur le fait que la famille est instituée à partir de l'arrivée de l'enfant, en soulignant qu'un couple n'était pas une famille. Or, l'appellation même de notre Mission d'information nous invite à travailler sur « la famille et les droits des enfants ». Est-ce une bonne façon d'envisager la famille et les droits des enfants que de les distinguer, ne serait-ce que dans cette appellation ? L'idée qui m'a semblé percer dans votre propos est que ces deux problèmes n'en font qu'un. D'autre part, votre exposé portait l'empreinte d'un souci humain et social dans l'analyse de la famille. Je me souviens d'avoir reçu à la mairie de Montluçon un couple de jeunes gens à qui j'avais demandé s'ils avaient l'intention d'avoir des enfants et qui m'avaient répondu que leur situation sociale ne le leur permettait pas. Selon vous, une situation économique et sociale difficile peut-elle, dans la France d'aujourd'hui, constituer un frein au désir d'enfant susceptible d'inciter à différer la naissance d'un enfant, voire à ne pas en avoir du tout ? M. le Président : J'ajoute que j'ai souvent l'occasion de constater que les conditions de logement à Paris peuvent constituer un obstacle important conduisant à différer la naissance d'un enfant. M. Patrick Delnatte : Dans la constitution de la famille, que devient le mariage ? D'autre part, pensez-vous que nous assistons à un glissement de la notion de désir d'enfant à celle de droit à l'enfant ? M. Pierre-Louis Fagniez : Vous nous avez dit qu'un couple sans enfant ne constituait pas une famille. Pensez-vous qu'il faut en tirer une conclusion d'ordre législatif, en mettant fin à la pratique consistant à remettre un livret de famille aux couples sans enfant qui se marient ? Mme Martine Segalen : Je vous signale l'existence des travaux qu'Henri Léridon a consacrés au désir d'enfant. Pour répondre à M. Goldberg, je pense qu'un certain nombre de nos concitoyens vivent dans une situation de précarité telle qu'ils peuvent avoir le sentiment qu'il est plus raisonnable de ne pas avoir d'enfant parce que le futur est trop incertain. Dans la petite ville de Fourmies, le nombre d'emplois dans le tissage est passé en l'espace de vingt ans de 25 000 à 200 ! Les contextes générationnels sont très différents selon l'époque. Née en 1940, j'ai la chance d'appartenir à une génération dorée. À ma sortie de Sciences-Po au début des années 1960, j'avais le choix entre 200 postes ! Les enfants nés après 1970, alors même qu'ils ont été mieux éduqués et ont grandi dans des conditions plus confortables, ont beaucoup plus de mal à entrer dans le monde du travail. Je comprends que les jeunes couples en difficulté hésitent à faire des enfants. Les difficultés économiques peuvent expliquer que l'on renonce à se marier. Le mariage représente un surplus symbolique et social qui se manifeste dans une fête coûteuse, que les jeunes couples n'ont pas les moyens d'assumer. Nous ne sommes plus dans les années 1970, où l'on pouvait se marier entre quatre témoins. Le mariage doit aujourd'hui être une grande fête, que l'on prépare longtemps à l'avance. Lorsqu'on n'en a pas les moyens, on ne se marie pas. Cette hypothèse me semble confirmée par la baisse du nombre de mariages à partir de 2000. Le désir d'enfant tend effectivement, comme l'a suggéré M. Delnatte, à devenir un droit à l'enfant. Nous vivons à présent dans une société d'individus qui ont des droits. On n'accepte plus qu'il y ait des discriminations à l'égard des minorités, quelles qu'elles soient. C'est dans ce contexte que s'affirme un droit à l'enfant. S'agissant du livret de famille, il est normal qu'on le remette aux couples au moment où ils se marient, puisque le mariage et la présomption de paternité qui lui est liée ont pour fonction de légitimer les enfants qui vont naître. Remettre aux mariés un livret de famille se justifie d'autant plus que le législateur a récemment prévu, dans la loi du 4 mars 2002, que l'officier d'état civil célébrant le mariage donne lecture aux futurs conjoints de l'article 371-1 du code civil, aux termes duquel « les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». J'ajoute qu'à l'occasion du centenaire du code civil, les parlementaires avaient envisagé d'introduire dans la célébration du mariage une référence à la notion d'amour. Ils y ont renoncé. L'autorité civile ne demande pas aux gens de se marier par amour. En revanche, les époux se doivent toujours mutuellement « fidélité, secours, assistance ». M. le Président : En effet. Fort heureusement, le législateur a supprimé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale les dispositions du code civil selon lesquelles la femme devait obéissance au mari, lequel, en retour, lui devait protection... M. André Burguière : Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet entre la crise économique et le fait de différer une naissance, voire de renoncer à avoir des enfants. Dans l'histoire, les baisses de natalité n'ont pas du tout coïncidé avec des périodes de crise. Le sociologue Arsène Dumont, qui s'inquiétait de la dénatalité, avait montré que, contrairement à ce que pensait le patronat, les ouvriers qui avaient accès à des appartements corrects avaient moins d'enfants. J'ajoute que les démographes ont constaté que les jeunes couples évaluent très souvent leur situation par rapport à celle qu'ils ont connue dans leur enfance. C'est d'ailleurs l'une des explications de l'évolution sinusoïdale de la fécondité en France depuis un siècle et demi. Fort heureusement, il n'est pas nécessaire, pour avoir des enfants, d'avoir de bonnes raisons d'en faire. Mais quand on veut s'en donner, elles relèvent de données plus complexes que l'évaluation immédiate de la situation sociale du couple. C'est d'ailleurs ce qui déprimait au début du XXème siècle les spécialistes d'anthropologie physique, dont les tendances étaient biologisantes et même vaguement racistes. Ils s'inquiétaient du fait que seules les classes populaires se reproduisaient, les classes supérieures étant celles où la natalité baissait le plus. S'agissant du lien entre la famille et l'enfant, l'Église était en désaccord avec les classes populaires, puisqu'elle acceptait que l'on puisse se marier uniquement pour permettre à un homme et à une femme de s'assister. Les couples qui n'ont pas d'enfant, volontairement ou non, ont le droit d'exister socialement. Je ne pense pas que ce serait un progrès de lier uniquement la famille à l'enfant. Je voudrais revenir sur le rôle de la solidarité familiale. Celle-ci est forte, comme l'a souligné Martine Segalen, et en particulier dans les périodes de crise. Cela dit, il serait risqué de faire machine arrière et de revenir sur une évolution ancienne qui a conduit à faire de plus en plus confiance à l'autorité publique. Dans les années 1980, certains ont avancé l'idée qu'après tout, puisque l'assistance apportée par l'État aux personnes âgées ou handicapées coûte cher et fonctionne mal, le mieux était peut-être d'en confier les crédits et la tâche aux familles. L'idée n'est pas absurde en soi. Mais elle comporte d'énormes risques. L'ordre des familles ne connaît pas forcément la justice, il peut être un lieu d'exploitation. L'intervention des pouvoirs publics a indéniablement été un progrès. M. le Président : Madame Segalen, monsieur Burguière, nous vous remercions infiniment pour votre très riche contribution aux travaux de notre Mission d'information. Audition de M. Hubert Brin, président Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : C'est un grand plaisir pour nous d'accueillir M. Hubert Brin et Mme Marie-Claude Petit, président et vice-présidente de l'Union nationale des associations familiales. La Mission d'information engage sa réflexion sur les mutations des modèles familiaux, les dispositifs de protection de l'enfance et le respect des droits de l'enfant avant de proposer, le cas échéant, de faire évoluer le droit de la famille. Elle a tenu à entendre au plus tôt les représentants de l'UNAF, association chargée de promouvoir, de défendre et de représenter les intérêts des familles vivant sur le territoire français, quelles que soient leurs croyances ou leur appartenance politique. Le rôle de l'UNAF n'est plus à démontrer : constituée en réseau de vingt-deux unités régionales et de cent unions départementales, elle est représentée dans quelque 20 000 instances de décision. M. Hubert Brin : J'ai reçu de votre Mission une série de questions dont les premières portent sur le rôle et la représentativité de l'UNAF. J'y répondrai. La publication du rapport de la Cour des comptes a été ressentie d'autant plus durement que les médias, par déformation professionnelle ou par hostilité à la famille, en ont relaté la teneur sans ne rien dire des réponses faites à la Cour par l'UNAF et par le ministre chargé de la famille. La célébration du soixantième anniversaire de la création de l'Union en a été obérée, et je n'ai pu, comme je l'aurais souhaité, mettre l'accent sur le remarquable travail accompli depuis 1945 par les centaines de milliers de militants qui ont fait le choix de l'intérêt général plutôt que celui de leur carrière professionnelle. Faut-il parler de « la » famille ou « des » familles ? Des deux, car les deux notions coexistent, et vouloir imposer un choix conduit à les nier toutes deux. Pour l'UNAF, « la famille », en tant que communauté de personnes, de fonctions, de droits et de devoirs, revêt une fonction générale, cependant que la notion de familles au pluriel renvoie à des histoires personnelles et à des situations économiques, sociales et culturelles multiples. Le législateur, dans sa sagesse, a choisi de ne pas encadrer par un texte les missions de l'UNAF. La Cour des comptes juge ces missions imprécises. Or traiter de la famille, c'est traiter de la société. Il est donc peu surprenant que l'UNAF ait été amenée à s'interroger sur les questions relatives à la prénatalité, à la génétique, à la bioéthique, à la petite enfance, à l'enfance, à l'adolescence, aux jeunes adultes, à la manière de concilier vie familiale et vie professionnelle, aux personnes âgées... Encadrer les missions de l'UNAF par des textes législatifs lui aurait, par exemple, interdit de s'intéresser au mythe implicite de l'homme parfait distillé par le biais de l'évolution des sciences géniques, ou aux relations entre les hommes induites par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le législateur a confié à l'UNAF la mission de donner un avis aux pouvoirs publics sur tous sujets d'intérêt familial et de représenter toutes les familles, françaises et étrangères, vivant sur notre sol - à ce sujet, on observera qu'à la demande du mouvement familial, les étrangers ont pu adhérer aux associations familiales dès 1976, soit avant même la loi de 1983 -. Pour ce qui est de la représentativité de l'Union, sachez que quelque 25 000 militants - bénévoles, j'y insiste - consacrent de douze à soixante demi-journées par an à la défense des intérêts des familles dans diverses instances, sur l'ensemble du territoire. Je rappelle que l'UNAF représente « les » associations familiales, ce qui a une signification politique forte : celle-là même que le Conseil National de la Résistance et le Gouvernement Provisoire de la République Française ont souhaité lui donner en instituant une représentation des familles libre et pluraliste. Ce pluralisme perdure, et il trouve sa traduction dans les instances de l'Union. Le législateur a confié à l'Union la responsabilité d'agréer les associations qui pourraient être considérées comme des associations familiales. S'il n'a jamais défini la famille, il a défini les critères qui doivent être respectés pour qu'une association puisse être considérée comme une association familiale : elle doit regrouper soit des familles constituées par le mariage et la filiation, soit des couples mariés sans enfant, soit des personnes physiques ayant charge légale d'enfants ou exerçant l'autorité parentale sur des enfants. Pour sa part, l'UNAF, lors de son assemblée générale de juin 1989, a défini la famille comme « une communauté de personnes, de fonctions, de droits et de devoirs, fondée sur le mariage ou la filiation ou l'exercice de l'autorité parentale ». De ce fait, l'Union compte en son sein, depuis longtemps, des associations de familles monoparentales ; elle s'est d'ailleurs battue pour que ce terme se substitue progressivement à ceux, péjoratifs, de « fille-mère » ou de « mère célibataire ». Par ailleurs, s'il n'existe pas d'associations de familles recomposées en France, cela n'empêche en rien que nombre de ces familles adhèrent, sans difficulté, à des associations familiales. Dans votre questionnaire, vous nous demandez si la conception de la famille de l'UNAF a évolué pour tenir compte de ce qu'il est convenu d'appeler l'homoparentalité. Qu'en est-il ? Nous avons reçu une demande d'agrément de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), demande à laquelle nous avons opposé un refus. Nous avons expliqué à l'APGL qu'en l'état des textes, une association de parents, biologiques ou juridiques, pourrait être agréée par l'UNAF quand bien même ces parents seraient homosexuels, puisque l'Union n'a pas à connaître de la sexualité des parents, mais de la charge légale d'enfants. En revanche, aucun texte ne dit que l'ami ou l'amie d'un parent homosexuel doive être considéré comme le parent de l'enfant ; rien ne nous permet donc de le reconnaître comme tel. Cette question est de la responsabilité du législateur et non de celle de l'UNAF, ce qui ne l'a pas empêchée, tant s'en faut, de débattre longuement de ce thème depuis 1998. Notre position n'a pas varié depuis notre déclaration sur les droits de la famille, adoptée par 98 % des voix lors de notre assemblée générale de 1998 : nous considérons toujours que ce qui est en jeu, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir un père et une mère qui l'aiment dans la durée. Nous prenons acte que 90 % des jeunes commencent leur vie de couple hors mariage, si bien que celui-ci n'est plus l'acte fondateur de la famille ; mais cette évolution ne les empêche pas d'avoir un projet de vie à long terme ou un désir d'enfant. De plus, l'UNAF estime que l'acte du mariage est plutôt maltraité dans la société française et réaffirme régulièrement qu'il faut valoriser le mariage civil pour en faire autre chose qu'une formalité administrative bâclée en une dizaine de minutes, comme c'est trop souvent le cas. Consciente des drames qui se nouaient pendant les années noires des débuts de la pandémie de sida, l'UNAF a appelé les parents à ne pas rejeter l'homosexualité de leurs enfants et, par ricochet, leurs enfants malades eux-mêmes. Mais la reconnaissance du fait homosexuel ne signifie pas qu'il faille confondre droits de la famille et droits des couples homosexuels, et nous avons clairement pris position aussi bien contre l'adoption par des couples homosexuels que contre leur accès à la procréation médicalement assistée. L'UNAF étant une institution pluraliste, l'objectivité m'impose de dire que cette position ne pas fait l'unanimité ; elle traduit toutefois l'opinion d'une très large majorité. L'Union rassemble des associations familiales catholiques, rurales, urbaines, laïques, protestantes, et de très nombreuses associations spécifiques - de familles monoparentales, avec enfants handicapés, avec jumeaux... -. Voilà ce qui, au-delà de son implantation, confère à l'UNAF sa représentativité. Nous étions conscients, avant que la Cour des comptes n'en parle, des lacunes de notre représentation dans les métropoles sur-urbanisées, mais j'ose dire que je serais content si nous étions le seul corps intermédiaire dans ce cas ! Sur quoi portent aujourd'hui les préoccupations quotidiennes des familles ? Sur le logement, l'école, l'emploi des jeunes, le vieillissement, les relations entre les générations, la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Elles portent aussi sur l'éducation des enfants, car il est de plus en plus difficile de poser des interdits dans une société qui laisse à penser en permanence que tout est permis. Sachant que les enfants passent chaque année 800 heures face à leurs éducateurs et 1 400 heures devant un écran de télévision, comment ne pas poser la question de la co-responsabilité de l'école et des médias dans la construction psychique des enfants ? S'agissant des droits de la famille et des droits de l'enfant, chacun connaît l'apport de l'UNAF dans l'instauration de la médiation familiale, démarche essentielle. Il reste à valoriser, en amont, le conseil conjugal, pour prévenir autant que possible les ruptures dues au silence. De fortes attentes s'expriment par ailleurs quant à la place du parent non-gardien dans notre droit, car si la conjugalité peut s'effacer, un père reste un père, même s'il n'a pas la charge légale de l'enfant. À ce titre, il a besoin d'un logement lui permettant d'accueillir décemment ses enfants, ce qui pose la question de sa solvabilité. Il y a aujourd'hui nécessité de faire quelque chose à ce sujet. Cela suppose de faire doublement appel à la solidarité collective, en aidant à la fois les couples qui ont fait le choix de la séparation ou qui la subissent, et ceux qui choisissent de rester ensemble. On n'échappera donc pas à la redéfinition du contrat social. Les préoccupations des familles conduisent à nous poser une question de fond : comment équilibrer « individualisation » et « familialisation » des droits ? L'ensemble de notre droit de la famille ne doit-il concerner que les individus ? Nous n'en sommes pas convaincus, car nous craignons qu'une telle approche nuise aux solidarités intergénérationnelles. Nos unions départementales font état d'une autre demande récurrente : la définition juridique des beaux-parents dans les familles recomposées. Mais l'UNAF considère qu'il ne saurait y avoir d'évolution du droit sur ce point, tant que n'aura pas été réglée de manière plus satisfaisante la question du parent non-gardien, au risque, sinon, de nier le parent naturel. Je m'en tiendrai là pour l'instant, mais le champ de la famille est si vaste que je souhaite que cette première rencontre soit suivie d'autres auditions, qui permettront aux représentants de l'UNAF de s'exprimer sur des sujets précis. M. le Président : Je vous remercie de nous avoir rappelé les missions de l'UNAF, d'avoir été très précis au sujet de l'agrément des associations familiales et de nous avoir fait part des préoccupations des familles. Ce premier échange pourra bien entendu être suivi par d'autres rencontres. M. Bernard Debré : Vous nous avez dit que l'UNAF comprend des associations de familles étrangères. Cela signifie-t-il que vous comptez dans vos rangs des familles polygames ? M. Pierre-Christophe Baguet : Existe-t-il au sein de l'UNAF des associations familiales juives ? M. Hubert Brin : Il n'y a pas d'associations représentant les familles étrangères au sein de l'UNAF, mais des familles étrangères adhèrent à de très nombreuses associations familiales. Nous ne comptons pas davantage d'associations musulmanes ou juives. La communauté juive a de grandes associations familiales qui répondent aux critères d'agrément de l'UNAF, mais elles n'ont jamais demandé à y adhérer ; nous commençons à prendre contact avec elles. Par ailleurs, il existe deux ou trois associations de familles musulmanes en France, qui se sont constituées après la loi de 1983. Certains mouvements comprennent de nombreuses familles étrangères, dont je suis incapable de vous dire si certaines sont polygames. Mais il est évident pour l'UNAF que ce type de construction familiale n'a pas sa place dans notre pays. M. Pierre-Louis Fagniez : La famille n'est pas définie dans notre droit, avez-vous dit. Est-ce l'expression d'un regret, ou considérez-vous que c'est une bonne chose ? M. Hubert Brin : Pour l'UNAF, je le rappelle, la famille est fondée soit sur le mariage, soit sur la filiation, soit sur l'exercice de l'autorité parentale. Définir par la loi la famille dans toute sa diversité supposerait bien des circonvolutions ! C'est un sujet de débat au sein de l'Union car si la position majoritaire a toujours été contre une définition législative de la famille, certains mouvements souhaitent une telle définition, afin par exemple que le législateur spécifie que le mariage unit un homme et une femme. Comme nous sommes une institution pluraliste, le débat va bon train. Mme la Rapporteure : L'UNAF souhaite améliorer la situation du parent non-gardien. Quelle évolution précise souhaitez-vous ? Convient-il, selon vous, de généraliser la garde alternée ? Avez-vous d'autres propositions à formuler ? Mme Martine Aurillac : J'ai cru comprendre qu'entre le mariage, la filiation et l'exercice de l'autorité parentale, c'est au dernier critère que vous attachez le plus d'importance. Cela signifie-t-il que, pour l'UNAF, l'appellation « famille » s'acquiert à la naissance d'un enfant ou lorsqu'il y a un enfant en perspective ? Ou bien donnez-vous déjà cette appellation à un couple marié, ou à un couple non marié mais qui a un projet - et un comportement - familial ? M. Sébastien Huyghe : Votre conception de la famille se limite-t-elle à la famille nucléaire, fondée sur l'autorité parentale ? Quelle place faites-vous à la famille élargie, aux relations transgénérationnelles et aux grands-parents ? M. Jean-Marc Nesme : Vous vous êtes prononcé en faveur de la « familialisation » des droits, de préférence à une « individualisation » des droits... M. Hubert Brin : Non : nous souhaitons un équilibre entre droits individuels et droits familiaux. M. Jean-Marc Nesme : Vous avez d'autre part rappelé le rôle croissant du magistère des médias dans l'éducation des enfants et des adolescents. Quelles doivent être les relations entre les familles et les médias ? M. le Président : L'UNAF est consultée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). M. Hubert Brin : Mais elle n'y est pas représentée, ce qui serait tout différent... M. Pierre-Christophe Baguet : Je me rappelle qu'un amendement à ce sujet a été rejeté... Mme Marie-Françoise Clergeau : L'UNAF a refusé la demande d'agrément formulée par l'APGL au motif que les textes ne le permettraient pas. Je ne vois pas en quoi les textes ne seraient pas respectés, puisqu'il y a bien, au sein d'une famille homoparentale, exercice de l'autorité parentale. M. le Président : J'aimerais également avoir des éclaircissements sur le point évoqué par Marie-Françoise Clergeau. Il me semble que Ségolène Royal, lorsqu'elle était ministre chargée de la famille, avait demandé à l'UNAF d'agréer l'APGL. Par ailleurs, vous nous avez dit qu'il fallait régler la question du parent non-gardien avant de s'attaquer à la clarification du rôle, des droits et des devoirs du beau-parent dans les familles recomposées. Il me semble néanmoins que de fortes attentes s'expriment à ce sujet. Puisque l'UNAF s'oppose à l'adoption et à la PMA pour les couples homosexuels, donner un statut juridique au beau-parent ne serait-il pas le moyen de régler la situation des familles homoparentales de fait ? Mme Marie-Claude Petit : L'intérêt primordial des associations familiales, c'est l'enfant, et l'enfant entouré d'une famille. Des familles, il en existe de diverses formes, et nous les accueillons dans le respect de ce qu'elles sont, pour les aider. Pour avoir présidé pendant huit ans le mouvement Familles rurales, je peux témoigner que les associations familiales rurales traduisent, peut-être plus encore que d'autres, l'expression de la solidarité transgénérationnelle quotidienne. D'ailleurs, si elles existent, c'est que les services publics font défaut en milieu rural - c'est d'ailleurs pourquoi nous y sommes plus représentés que dans les villes -. Les petites communes manquent de moyens. Elles ne peuvent donc qu'être favorables à ce que les associations familiales mettent en place des services mêlant toutes les générations. Les familles se prennent par la main pour faire ce que les municipalités ne peuvent pas faire. Il peut s'agir de loisirs, de haltes-garderies, d'aide à domicile pour les personnes âgées... En somme, les citoyens se donnent les moyens d'agir. Mais la législation doit évoluer pour permettre aux familles d'aller dans le bon sens et de combattre la solitude. Une association qui ne prendrait pas en considération les intérêts de toutes les générations ne saurait être qualifiée d'association familiale. Cela vaut particulièrement dans le milieu rural, où l'on ne s'occupe pas de politique et où l'essentiel est de laisser le respect s'imposer entre les personnes. M. Hubert Brin : La garde alternée est symboliquement importante, en ce qu'elle marque la permanence d'une responsabilité parentale partagée : elle signifie que l'on ne peut pas divorcer de son enfant. Mais il faut réfléchir avant d'aller plus avant dans la loi, car, aussi intéressante soit-elle, cette démarche ne peut devenir un absolu, même si des pères en grande souffrance le revendiquent au sein d'associations telles que SOS-Papa. Il faut garder à l'esprit le fait que, dans certains pays, les revendications des pères ont abouti à une généralisation des recherches en paternité ou à l'interdiction, pour la mère, de résider au-delà de 50 kilomètres du domicile du père. Ces excès démontrent la nécessité de développer la médiation familiale. Nous reconnaissons comme famille un couple marié sans enfant, mais pas un couple vivant en union libre, même s'il a un projet d'enfant, car, en droit, seul le mariage comporte une présomption de paternité. Il est essentiel de se référer à des repères précis. Une fois encore, je renverrai au droit, non pour me défausser, mais parce que je ne vois pas comment une association qui ne serait formée que de couples non mariés sans enfant pourrait être reconnue comme association familiale. Nous n'avons pas à interdire aux associations familiales d'accepter l'adhésion de personnes qui ne constituent pas une famille. En revanche, nous ne les intégrons pas dans les listes d'adhérents qui participent aux instances décisionnelles de l'Union. Mme Martine Aurillac : Donc, l'UNAF reconnaît comme familles les couples mariés sans enfant, mais pas les couples non mariés sans enfant. M. Hubert Brin : Comment le pourrions-nous ? La famille apparaît quand l'enfant naît. Évidemment, le slogan des années 1990 selon lequel « c'est l'enfant qui fait famille » doit être nuancé, car les choses ne sont pas aussi simples. Le premier enfant, la grossesse ou le désir d'enfant font-ils famille ? Ces questions font débat. De même, on peut légitimement s'interroger sur le point de savoir si un couple non marié qui souhaite un enfant mais qui ne peut pas en avoir forme une famille. Mme Marie-Françoise Clergeau : Et que dire d'un couple qui se marie à soixante ans ? M. Hubert Brin : La situation d'un tel couple est tout autre. Quant à la question de l'« individualisation » et de la « familialisation » des droits, elle participe d'un débat de société. Alors que la tendance est à une individualisation croissante, l'UNAF considère, très majoritairement, que ce n'est pas la voie à suivre et qu'il faut préserver un équilibre entre droits individuels et droits collectifs, notamment pour la famille. Pour ce qui est des relations entre famille, télévision et médias, j'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement, car le secteur audiovisuel public est le seul service public dans lequel les usagers ne sont pas représentés. Pour en revenir à l'AGPL, les futurs parents homosexuels qui, même s'ils désirent un enfant, n'en ont pas, ne constituent pas une famille, et les couples homosexuels élevant de fait des enfants ne peuvent pas être reconnus comme formant des familles, pour les mêmes raisons juridiques qui nous interdisent de donner cette reconnaissance à un couple hétérosexuel sans enfant et non marié. Mme Marie-Françoise Clergeau : Il y a pourtant des parents au sein de l'APGL ! M. Hubert Brin : Si la loi donnait aux deux membres d'un couple homosexuel la qualité juridique de parents, l'APGL serait agréée par l'UNAF. Mais, à ce jour, l'autorité parentale n'a jamais été confiée à l'ami ou à l'amie d'un parent, fût-il homosexuel. On en revient au débat de fond et à la position très largement partagée au sein de l'UNAF, selon laquelle un enfant, pour se construire, a besoin d'un père et d'une mère. Mme Marie-Françoise Clergeau : Qu'en est-il alors des familles monoparentales ou des veufs qui adhèrent à l'UNAF ? M. Hubert Brin : Leur situation n'est pas de même nature que celle des homosexuels. Nous nous sommes battus pour que les femmes élevant seules un enfant se voient reconnaître le statut de famille, et c'est une victoire de l'avoir obtenu. Si aujourd'hui le terme de monoparentalité tend à signifier qu'une famille peut ne comprendre qu'un seul parent, il faut garder à l'esprit que dans 99,9 % des cas, même dans les familles monoparentales, il y a bien deux géniteurs. On peut régler différemment la question du parent non-gardien ou celle du beau-parent, mais il ne faut pas se laisser enfermer dans l'idée que monoparentalité signifie un seul parent. M. Bernard Debré : Mais quelle est alors la position de l'UNAF à propos des enfants nés sous X et qui demandent à connaître leurs géniteurs ? M. Hubert Brin : L'accès aux origines personnelles en cas de naissance sous X doit respecter l'équilibre entre l'impérieuse nécessité du silence et l'impérieuse nécessité du savoir. La difficulté est réelle, mais j'observe que ceux qui veulent supprimer l'accouchement sous X règlent la question de la maternité sans régler celle de la paternité, sauf à rechercher systématiquement la paternité par examen d'ADN. M. Pierre-Christophe Baguet : Il y a également le cas de l'adoption par un célibataire, autorisée par le législateur. M. Hubert Brin : Nous nous mordons les doigts d'avoir ouvert en 1966 l'adoption aux célibataires. À l'époque, la question se posait de manière radicalement différente, et aujourd'hui l'esprit de la loi de 1966 est détourné. Je suis heureux que la Mission d'information existe, car il est nécessaire qu'un débat public serein ait lieu sur les questions du mariage homosexuel et de l'accès des homosexuels à l'adoption et à la PMA. Mais lorsque nous avons accepté l'adoption par un célibataire, il ne s'agissait absolument pas de permettre à une personne homosexuelle d'adopter. J'espère donc que nous prendrons le temps du débat. M. le Président : Nous en resterons là pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir fait connaître, très librement et très directement, vos positions. Audition de M. Maurice Godelier, anthropologue, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Vos publications, monsieur Godelier, font autorité, et votre dernier ouvrage, Les Métamorphoses de la parenté, donne une dimension universelle au questionnement sur les mutations des modèles familiaux. Constituée à la demande du Président de l'Assemblée nationale, notre Mission d'information a décidé d'engager ses travaux en s'interrogeant sur les fondements, l'évolution et l'état actuel de la famille. Elle entendra donc l'anthropologue et le directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales que vous êtes avec un intérêt particulier. M. Maurice Godelier : Pour commencer, je souhaite partir d'une position théorique fondamentale : la famille est toujours un élément d'un système de parenté et, nulle part, la famille et la parenté ne sont le fondement d'une société. Il est faux d'affirmer que la parenté soit le fondement de la société. Votre Mission devra donc se méfier des sirènes qu'elle ne manquera pas d'entendre prétendre devant elle que « la famille, c'est tout ». Non ! Il faut bien situer les enjeux : ce qui fait société, ce sont des rapports politiques et religieux qui forgent une unité et une identité globales, une souveraineté sur un territoire. L'objet de votre Mission, c'est la famille nucléaire occidentale monogame. Si l'on recense les quelque dix mille sociétés dans le monde, pour certaines gigantesques, telle celle des Han (chinois) qui sont plus d'un milliard d'humains, et pour d'autres minuscules, comme ces sociétés amazoniennes qui rassemblent moins de 300 personnes, toutes n'ont pas le même système de parenté. Mais chaque société en a un, qui est une variante de l'un des sept systèmes fondamentaux que les anthropologues ont mis au jour derrière des formes multiples. Le système de parenté européen est non linéaire ; il est patrilinéaire dans la société musulmane, matrilinéaire dans certaines sociétés océaniennes et d'Afrique centrale. La théorie de la conception d'un enfant varie selon la nature du système de parenté. Ainsi, la société matrilinéaire des îles Trobriand considère que la femme seule est génitrice, le sperme ne contribuant pas à la conception de l'enfant, lequel se forme dans le ventre de la mère par la conjonction du sang menstruel et de l'esprit d'un ancêtre qui vient se réincarner dans le ventre de la femme ; le père n'est pas le géniteur, il est le nourricier. Certes, cette vision n'a rien de scientifique, mais jusqu'au 18ème siècle la science n'a pas été à l'origine des représentations et explications de la société ; ce sont des représentations culturelles qui expliquent le christianisme, le bouddhisme... Les anthropologues définissent le système de parenté européen comme non linéaire, c'est-à-dire qu'un enfant « descend » aussi bien de ses parents paternels que de ses parents maternels. En France ce système a une inflexion patrilinéaire, comme en témoignent les règles d'attribution du nom de famille qui était jusqu'à il y a peu celui du père. L'évolution légale récente fait que ce n'est plus automatiquement le cas : un enfant peut choisir de porter le nom de sa mère lorsqu'il devient majeur. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi le même système de parenté se retrouve à des époques et en des lieux différents - en Europe occidentale, chez les Inuit, chez les Garia de Nouvelle-Guinée - sans que ces diverses sociétés aient été en contact. « Père et mère », « father and mother », « Vater und Mutter » : ce sont là autant de transpositions des pater et mater latins, et c'est de la transformation du système de parenté latin que découle le système de parenté européen actuel. Mais l'on ne saurait négliger l'empreinte fondamentale du christianisme, sans lequel une partie du système de parenté occidental ne peut s'expliquer. Le christianisme a en effet remodelé tous les systèmes de parenté méditerranéens en imposant la monogamie ; en transformant le mariage, qui était auparavant l'alliance de lignages, en un sacrement administré par l'Église ; en faisant découler de ce sacrement l'interdiction du divorce et celle du remariage des veufs et des veuves, ainsi que le ralentissement, sinon la disparition, de l'adoption. À cela s'est ajoutée la représentation culturelle devenue thèse théologique selon laquelle l'union charnelle d'un homme et d'une femme fait de leurs deux corps une seule chair - una caro - et de leur enfant la chair de cette chair. La christianisation de l'Occident introduit, avec la monogamie, cette vision culturelle singulière de l'union des sexes. Le système de parenté que nous connaissons a donc traversé les siècles avec une « viscosité sociale » bien supérieure à celle des systèmes politiques et économiques. Sa particularité repose dans la relation entre parenté et famille, relation liée à une représentation politico-religieuse : en imposant l'obligation de baptiser ses enfants, de se marier à l'église et de se faire inhumer en terre chrétienne, le christianisme a abouti à un encadrement complet des individus, de leur naissance à leur mort. Ensuite, la France a connu une évolution particulière avec la séparation de l'Église et de l'État, puis d'autres transformations capitales ont eu lieu. La première fut, il y a une quarantaine d'années, la substitution de l'autorité parentale à l'autorité paternelle, substitution signifiant une égalité de droits entre l'homme et la femme, mais aussi le fait que leur responsabilité vis-à-vis de l'enfant se perpétue après le divorce. La deuxième rupture fut précisément le divorce, et particulièrement le divorce par consentement mutuel, qui signifie que l'union des cœurs n'est pas éternelle et que le mariage n'est pas un sacrement. Et, à partir du moment où le divorce est autorisé, les familles recomposées se multiplient. Par ailleurs, on estime que 2,5 millions de personnes vivent en union libre et ont des enfants, ce qui ne pose aucun problème particulier depuis que le droit français a donné les mêmes droits à tous les enfants, qu'ils soient ou non nés dans le mariage. Les couples peuvent donc choisir de se marier ou de ne pas le faire. Le mariage cependant ne disparaît pas mais il prend place plus tard dans la vie. J'observe par ailleurs une sorte d'obsession de la relation entre parenté et génétique, alors même que l'on constate l'élargissement de la parenté sociale. On attend des parents des familles recomposées qu'ils traitent les enfants du premier lit « comme les leurs ». D'ailleurs, les mots « marâtre » et « parâtre » se sont effacés au profit de « belle-mère » et « beau-père », - termes qui désignaient à l'origine seulement les parents par alliance -, ce qui a introduit une certaine confusion. À ces beaux-parents-là, la société fixe une norme implicite de bonne conduite et de responsabilité. En anglais « father in law » est le beau-père, le père de l'épouse ou de l'époux, et « step father » est le terme utilisé par les enfants d'un premier lit pour désigner le nouveau mari de leur mère (leur parâtre). Autre évolution importante : le couple ne fait plus famille. On vit avec qui l'on veut puis, si on le souhaite, on convole - souvent à la naissance du premier enfant -. La famille commence avec cet enfant ; c'est une grande évolution des mœurs. Mais si le mariage est de plus en plus tardif - on se marie à 29 ans en moyenne -, il ne disparaît pas ; c'est un choix pragmatique qui s'est déplacé dans le temps, et l'autorité parentale partagée n'est pas liée au destin du couple qui a fait l'enfant. J'en viens à l'effet des nouvelles technologies sur les choix des individus. Prenons le cas d'un couple dans lequel la femme est sujette à des fausses couches régulières et qui ne souhaite pas adopter. Il est désormais possible à cette femme de faire féconder un de ses ovocytes par son compagnon, puis de transférer cet ovocyte dans l'utérus de ce que l'on appelle une surrogate mother - mère de substitution -. Cette pratique est autorisée dans certains États américains, alors qu'elle ne l'est pas en France. La maternité est ainsi scindée en deux étapes : la femme de ce couple aura un enfant qui, génétiquement, est le sien, mais qu'elle n'aura pas mis au monde. Quant à la femme porteuse, elle loue son corps après avoir signé un contrat disposant expressément que l'enfant qu'elle porte n'est pas le sien et fixant la rémunération des risques encourus et du service rendu. Cette rémunération est limitée dans un plafond légal pour éviter la « prostitution des utérus », mais cela n'empêche évidemment nullement un couple qui veut un enfant de donner en sous-main à la mère porteuse ce qu'il veut... Une enquête réalisée aux États-Unis montre que les motivations qui poussent une femme à se faire mère porteuse sont variées (désir de donner « la vie » à un autre couple, désir de gagner de l'argent en restant à domicile, etc.). On comprend, par ailleurs, que les membres d'un couple puissent, plutôt que d'adopter, préférer faire porter par une autre l'enfant qu'ils élèveront et qui leur sera génétiquement lié. En outre, un homme stérile peut accepter d'être le père social de l'enfant de sa femme, dont il n'est pas le géniteur, de même qu'une femme peut accepter que son mari insémine une autre femme. Pour se faire inséminer, les lesbiennes de France doivent aller en Belgique. Diverses techniques nouvelles ouvrent donc aux individus des possibilités qui n'existaient pas et qu'ils utilisent, qu'elles soient légales ou non. Pour ce qui est du clonage reproductif, c'est-à-dire la reproduction de soi par soi sans sexualité, j'y suis résolument opposé. Il s'agit d'un fantasme individuel d'immortalité, et la société ne doit pas permettre aux individus la réalisation de tous leurs fantasmes ; c'est un péril pour les êtres sociaux que nous sommes. J'espère donc que les États résisteront, mais je sais qu'il existe déjà des laboratoires en Thaïlande et, surtout, un marché potentiel... J'en viens à la revendication d'un encadrement social, politique et juridique de l'homoparentalité, laquelle existe de facto. On évalue la population homosexuelle en France à 5 % à peine de la population totale, et à 2,8 % au plus la population exclusivement homosexuelle - pourcentages qui montrent que ces populations ont un poids médiatique bien supérieur à leur importance démographique -. Si l'on aborde la question de l'homoparentalité par le biais de l'anthropologie et de l'histoire, sans préjugés sur la sexualité, on se rend compte que la revendication actuelle est le produit de trois mouvements qui n'avaient initialement rien de commun mais qui se sont rencontrés et combinés depuis une vingtaine d'années. Il y a, en premier lieu, le nouveau statut de l'enfance et de l'enfant. À partir du XIXe siècle, l'enfant acquiert une valeur sociale et culturelle nouvelle, qui donne elle-même une valeur aux parents qui l'engendrent. Cette évolution a abouti à l'énoncé de droits universels de l'enfant, traduits dans la Déclaration des droits de l'enfant. On observera que ce cheminement est celui de l'Occident, mais ni celui de l'islam, ni celui de la Chine. Je ne me risquerais d'ailleurs pas à faire de la provocation sur le mariage homosexuel en Chine... Donc, à partir du XIXème siècle, une valorisation nouvelle de l'enfant et de l'enfance structure le désir d'enfant. Puis, au milieu du XXème siècle, vient la « dépathologisation » de l'homosexualité : celle-ci n'est plus considérée en médecine comme une maladie qu'il faut guérir et, bientôt, les associations américaine et française de psychologie ne la tiennent plus pour une perversion. Cela signifie que l'homosexualité est désormais considérée comme une sexualité comme une autre, comme une sexualité normale. À cet égard, on s'interrogera sur la longue cécité des primatologues qui se sont intéressés aux chimpanzés et aux bonobos, c'est-à-dire aux deux espèces de singes dont les chromosomes sont les plus proches de ceux de l'homme. Ces primatologues n'ont pas su voir les multiples pratiques homosexuelles de ces deux populations, où les femelles se frottent la vulve entre elles et les mâles se masturbent mutuellement, la copulation hétérosexuelle se limitant à la période des chaleurs et, donc, à la reproduction. Il a fallu des décennies pour que les yeux se dessillent et que l'on tire de cette observation la conclusion qui s'imposait : il existe une sexualité tournée vers la reproduction et une sexualité tournée vers une certaine jouissance. De même, dans un autre domaine, on a longtemps pensé que les mâles les plus forts avaient davantage de chance de s'accoupler avec les femelles ; il apparaît maintenant que ce sont elles qui le plus souvent choisissent leur partenaire et qu'elles ne choisissent pas forcément le mâle dominant... Le troisième mouvement repose dans le fait que, au sein des sociétés démocratiques européennes, les minorités revendiquent les mêmes droits que ceux de la majorité, à condition, bien entendu, que cette revendication respecte les droits de ceux qui en ont déjà. Si l'on relie ces trois mouvements, qui se sont croisés il y a une vingtaine d'années, on doit admettre que le désir d'enfant d'un homosexuel peut être satisfait sans que la société en soit bouleversée. Je ne vois pas pour quelles raisons, dans le cadre social et culturel qui est le nôtre, ce désir serait interdit, et c'est pourquoi je suis favorable à ce qu'une législation encadre la parenté homosexuelle, qui existe et s'étendra de toute façon. Qu'en sera-t-il des enfants, me dira-t-on ? Je n'ai jamais constaté que les hétérosexuels élèvent mieux leurs enfants que les autres, et il me semble bien avoir entendu parler de femmes et d'enfants maltraités dans des familles hétérosexuelles ; que les parents soient hétérosexuels ne garantit pas que les enfants se développeront au mieux. D'autre part, tous les homosexuels ne veulent pas d'enfants, et ceux qui souhaitent prendre cette responsabilité ne sont pas isolés du monde hétérosexuel. L'enfant aura des oncles, des grands-parents, des voisins, ira à l'école... Il ne sera pas amené à vivre dans un ghetto homosexuel. Des enquêtes menées aux États-Unis et en Angleterre sur l'orientation sexuelle des enfants élevés par des homosexuels, il ressort que le taux d'apparition spontanée de tendances homosexuelles chez ces enfants est soit quasiment identique à ce que l'on constate au sein des familles hétérosexuelles, soit légèrement supérieur - passant de 3 % d'apparition spontanée à 5 % -. On est loin de l'usine à produire automatiquement des homosexuels que redoutent certains. En résumé, en tant qu'anthropologue, je ne vois pas de raison de réprimer la revendication exprimée par les homosexuels, mais je considère qu'il faut l'accompagner, au terme d'un débat public qui ne doit pas céder à l'électoralisme : il ne s'agit pas de préparer une déclaration en vue de la Gay pride ! Je ne vois pas de péril majeur pour la société française dans une décision politique qui, de plus, a déjà été prise tant par l'Espagne catholique que par les calvinistes néerlandais, si bien que la France est désormais encadrée. La législation doit fixer des responsabilités, des droits et des devoirs égaux pour les homosexuels et pour les hétérosexuels, sans discrimination. Le PACS ne permettant pas les adaptations imposées par l'évolution sociale, il faudra, pour être cohérent, définir le mariage comme l'union de deux personnes du même sexe ou de sexe différent. Il faut légiférer, d'autant que les frontières sont poreuses ; si ce n'est pas fait, nous nous trouverons dans la situation qui prévaut en Amérique du Nord, où l'on traverse la frontière pour obtenir au Canada le mariage ou l'insémination refusés aux États-Unis. M. Patrick Delnatte : L'approche anthropologique induit à la fois déterminisme et relativisme. Vous avez dit que la famille ne fonde pas la société ; il n'empêche que la famille se constituant soit par le mariage, soit par la filiation, soit par l'exercice de l'autorité parentale, c'est bel et bien un mode d'organisation sociale. M. Maurice Godelier : Bien sûr. M. Patrick Delnatte : Considérez-vous que les civilisations progressent ou les tenez-vous toutes pour équivalentes ? Mme la Rapporteure : Vous arguez de ce que l'homoparentalité est légale en Espagne et aux Pays-Bas pour dire que ce ne serait pas un drame de l'institutionnaliser en France, d'autant que rien n'empêche les homosexuels qui le souhaitent de se rendre à l'étranger pour y faire ce qui leur est interdit en France. Mais vous n'avez pas usé de cet argument pour les mères porteuses. Je vois bien ce qu'entraîne l'ouverture des frontières, mais l'existence de familles homosexuelles n'impose pas forcément au législateur, pour répondre à la revendication d'homoparentalité, de recourir aux solutions juridiques mises en place à l'étranger. Ainsi, à propos de l'euthanasie en fin de vie, la France a délibérément choisi un autre modèle que celui de la Belgique. L'existence de « familles » homoparentales n'impose pas de faire de l'homosexualité un modèle égal à celui de l'hétérosexualité. La société française est très marquée par le catholicisme. Ne peut-on concevoir que les particularités culturelles ou historiques d'un pays soient telles qu'il puisse ne pas choisir le modèle de ses voisins ? M. Pierre-Louis Fagniez : Vous avez évalué à 5 % la population des homosexuels en France. Comment expliquez-vous l'intolérance si vive et si largement répandue à leur égard au sein des 95 % hétérosexuels ? Peut-on espérer que cette intolérance s'effrite, ce qui permettrait au législateur d'agir de manière plus proportionnée ? M. Jean-Marc Nesme : Vous avez fait référence à des études anglo-saxonnes selon lesquelles l'équilibre des enfants élevés par des couples homosexuels serait préservé. Avez-vous connaissance d'autres études dont les conclusions sont contraires ? M. Pierre-Christophe Baguet : Vous considérez que le mouvement vers l'homoparentalité est lancé, qu'il ne s'arrêtera pas et qu'il faut donc l'encadrer. Mais comment, et dans quel objectif ? Pour lui permettre de prospérer, ou pour éviter de trop perturber le reste de la société ? M. Maurice Godelier : L'intolérance à l'égard des homosexuels n'est pas le fait de 95 % de la population française, et elle n'est pas la même selon les générations puisqu'elle est bien moindre chez les jeunes. Un débat nourri est nécessaire pour faire évoluer les mœurs et reculer l'homophobie - tout comme la xénophobie d'ailleurs, car cette phobie particulière n'est pas la seule qu'il nous faille résorber -. Si l'homosexualité n'est ni une pathologie ni une perversion, les homosexuels qui ont un désir d'enfant doivent pouvoir adopter et élever un enfant. Si je souhaite que l'homoparentalité soit encadrée, c'est pour que des droits et des devoirs clairement définis soient exercés : il ne s'agit pas d'un contre-feu destiné à arrêter une évolution de la société - rien ne pourra arrêter le désir d'enfant exprimé par les homosexuels -, mais d'une loi destinée à donner à une minorité les mêmes droits que ceux dont dispose la majorité. Certes, nous sommes un pays à dominante catholique, qui a pour culture la monogamie - encore que, le divorce aidant, il s'agit plutôt de polygamie passant par des monogamies successives... -, et nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres ; d'ailleurs, je ne suis pas favorable à ce que nous suivions le modèle des États-Unis. Mais le politique doit anticiper, non pour faire contre-feu, je le répète, mais pour demander aux homosexuels d'exercer leur responsabilité parentale. Il est des cas où une décision politique s'impose : c'en est un. Qu'il y ait des progrès de civilisation est une évidence, et l'on ne fait pas de politique si l'on ne veut pas faire avancer les choses. Mais beaucoup reste à faire pour que ces progrès se généralisent à toute l'humanité. Je ne me vois pas me rendre à Bagdad prêcher en faveur de l'homoparentalité, car j'ai le sentiment que l'on n'y sera pas prêt à m'entendre. Oui, les civilisations progressent, mais guerres et massacres se poursuivent ; il n'y a pas de progrès moral, mais il peut y avoir des progrès sociaux et politiques. Mme la Rapporteure : Ne pensez-vous pas difficile pour un enfant de se trouver dans une famille avec deux pères ou deux mères, ce qui est contraire à sa propre origine biologique ? M. Maurice Godelier : J'ai eu l'occasion d'interroger des enfants dans ce cas ; aucun traumatisme n'a transparu. À travers l'homoparentalité, c'est le statut d'une autre sexualité et le droit au désir d'enfant qui sont en cause ; l'enjeu est donc d'ordre philosophique. Mme la Rapporteure : On peut donner l'autorité parentale à l'un des membres du couple homosexuel, sans aller jusqu'à l'autorité parentale conjointe exercée par les deux membres de ce couple. M. Maurice Godelier : Toute sexualité est partagée par les deux personnes du couple. C'est une vie de couple que veulent les homosexuels, car une union homosexuelle, comme une union hétérosexuelle, est fondée sur l'amour. Michel Foucault ne manquait pas de me le rappeler. Les vicissitudes des couples homosexuels sont les mêmes que celles des couples hétérosexuels ; eux aussi divorceront... Mme la Rapporteure : Après quoi, les enfants auront quatre pères ou quatre mères ! M. Maurice Godelier : Le désir d'enfant ne peut être porté par un seul membre du couple, puisqu'il est partagé par les deux membres de ce couple. Si vous voulez dire que la différence des sexes est indispensable à la constitution de l'identité sexuelle de l'enfant, je rappelle que, bien souvent, les familles monoparentales aujourd'hui très nombreuses en France sont des familles de femmes, sans père ni mari, où aucun homme ne passe. C'est la même chose. Il ne faut pas deux parents de sexes différents pour bien éduquer un enfant. Mme la Rapporteure : N'est-ce pas mentir à l'enfant que de lui dire qu'il a deux parents du même sexe ? M. Maurice Godelier : Mais il faut lui dire la vérité ! Il ne s'agit pas d'organiser un complot ! Mme la Rapporteure : D'autres sociétés que la société occidentale contemporaine ont-elles donné ou donnent-elles l'autorité parentale conjointe à deux parents du même sexe ? M. Maurice Godelier : Il n'existe pas encore une véritable analyse comparative, historique et sociologique, de l'homosexualité. À ma connaissance il n'existait pas de société où les unions homosexuelles avaient pour fin de fonder une famille. L'homosexualité existait et existe dans de nombreuses sociétés sans être condamnée, mais elle revêt des significations sociales très diverses comme ce fut le cas à Athènes, à Rome, chez les Anzandé d'Afrique, etc. Chez les Baruya, en Nouvelle-Guinée, parmi lesquels j'ai vécu et travaillé plus de sept ans, l'homosexualité est une pratique sociale imposée à tous les jeunes hommes jusqu'à leur mariage, après quoi elle leur est interdite. En Chine, l'homosexualité masculine était considérée comme l'un des chemins du Dao, la voie de la sagesse... Quant à l'homosexualité féminine, c'est pour l'anthropologue une véritable terra incognita. La revendication d'homoparentalité émane en France d'une classe moyenne bien sage qui souhaite pouvoir élever des enfants, et qui recherche une légitimité. Il s'agit d'intégration et non de subversion. On est à l'opposé des positions subversives défendues dans le passé par certaines communautés homosexuelles étrangères. M. le Président : Je vous remercie. Audition de M. Michel Dollé, rapporteur général Présidence de M. René Galy-Dejean, Président M. le Président : Je vous prie d'excuser M. Patrick Bloche, retenu à l'étranger par un engagement prévu de longue date. Nous accueillons pour cette première audition de l'après-midi M. Michel Dollé, rapporteur général du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC), qui a rendu public en janvier 2004 un rapport sur les enfants pauvres en France. Notre Mission d'information ayant souhaité consacrer une partie de ses travaux à la protection de l'enfance, il nous serait très utile de disposer de données actualisées sur les situations de pauvreté observées chez les enfants et sur les conséquences de cette pauvreté sur le respect des droits de l'enfant. M. Michel Dollé : Si le CERC a choisi de traiter le sujet de la pauvreté des enfants, c'est parce qu'il considère que, si les inégalités sociales peuvent être constatées dans l'instant, elles présentent aussi un caractère dynamique. Par ailleurs, la plupart des courants de la philosophie politique admettent que la société doit s'efforcer de corriger les inégalités dont les victimes ne sont pas elles-mêmes responsables. Tel est manifestement le cas des enfants. Enfin, il apparaît que la pauvreté éprouvée dans l'enfance a de fortes conséquences sur le devenir des adultes. Mais pourquoi parler de la pauvreté des enfants plutôt que de celle des familles ? Tout simplement parce que l'enfant est une personne et non pas seulement un membre d'une famille. Faire vivre un enfant dans des conditions inacceptables signifie donc ne pas respecter ses droits. En 1984, le Conseil de l'Europe a défini la pauvreté comme le fait de disposer de revenus et de ressources à ce point insuffisants qu'ils empêchent d'avoir des conditions de vie jugées acceptables. Les enfants pauvres entrent bien dans cette définition. On peut toutefois distinguer la situation des enfants en bas âge de celle des adolescents. En effet, si tous les enfants sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de leurs familles, de leur environnement, de l'école, il est évident que les plus jeunes sont plus dépendants. Par ailleurs, il existe malheureusement en France un grand nombre d'adolescents et de préadolescents en rupture de liens familiaux, et il faut également penser à ces enfants d'immigrants, sans papiers et souvent sans famille. Il y a aussi un certain nombre de situations dans lesquelles ce sont les relations au sein de la famille qui mettent l'enfant en danger. La pauvreté signifie pour l'enfant, en tant que personne en devenir, l'absence de possibilités de développer son capital de connaissances, de culture, de relations sociales, de santé. C'est pour toutes ces raisons qu'on peut bien parler d'une pauvreté spécifique des enfants, qui doit être envisagée distinctement de celle des familles. Je parlerai d'abord de la pauvreté monétaire, c'est-à-dire du fait de disposer de revenus inférieurs au seuil de pauvreté en raison d'une insuffisance de rémunération, d'emploi ou de transferts. En France, dès lors qu'une personne seule dispose d'un emploi d'une durée suffisante, rémunéré au moins au salaire minimum, elle échappe à la pauvreté ; pour sa part, une famille formée d'un couple avec enfants disposant d'un SMIC et demi à taux plein, complété par les transferts sociaux et les allocations, se situe au-dessus du seuil de pauvreté. Tel n'était en revanche pas le cas au Royaume-Uni, avant l'arrivée des travaillistes au pouvoir en 1997. Mais avec le programme stratégique de lutte contre la pauvreté et l'instauration du salaire minimum en 1999, des progrès sensibles ont été obtenus, comme l'on peut le constater à la lecture des rapports annuels opportunity for all ou à la lecture du rapport d'évaluation de la commission parlementaire compétente (2004). Notamment, le pouvoir d'achat du salaire minimum s'est accru depuis 1999 de 25 %. Aujourd'hui le fait de ne pas pouvoir travailler, de connaître des périodes de chômage et de temps partiel peut conduire ceux qui touchent les plus bas salaires à une situation de pauvreté. Or la présence des enfants peut être un frein à l'emploi, car on sait combien il est difficile de concilier activités professionnelles et responsabilités familiales. C'est pourquoi, en France, le taux de pauvreté des enfants est supérieur au taux général de pauvreté dans l'ensemble de la population. Tel n'est pas le cas dans les pays scandinaves, qui se sont organisés pour permettre de concilier le travail et la vie familiale. C'est un problème d'autant plus important qu'il ne se pose pas seulement pour la petite enfance, la nécessité d'une présence parentale étant ressentie jusque, sans doute, au collège. En outre, si on est amené à interrompre un moment son emploi pour assurer la garde de ses enfants, on a beaucoup plus de mal à retrouver ensuite un travail, surtout si on est peu qualifié. Si l'allocation de parent isolé (API) permet à une famille monoparentale de se situer légèrement au-dessus du seuil de pauvreté, il s'agit malheureusement d'une allocation sans accompagnement social, rien n'étant prévu pour le retour ultérieur de la mère à l'emploi, ni pour son autonomie. Aussi, un grand nombre de femmes passent directement de l'API au RMI, qui, lui, ne suffit pas à dépasser le seuil de pauvreté. Les situations de pauvreté des enfants sont donc liées au positionnement des parents par rapport à l'emploi. En dehors des problèmes d'emploi dont je viens de parler, les transferts qui accompagnent la présence d'un enfant, et qui combinent prestations sociales et allégements fiscaux, ne changent pas le positionnement de la famille. À leur niveau actuel, les transferts liés à la présence d'un enfant ne conduisent ni à sortir de la pauvreté ni à y entrer, si le niveau des revenus d'activité n'est pas modifié par la présence d'un enfant. On peut toutefois s'interroger sur le caractère horizontal de ces transferts, dont les effets sont constants quels que soient les revenus et qui ne permettent donc de procéder à aucune redistribution. M. Hervé Mariton : C'est le principe même de la neutralité de la politique familiale... M. Michel Dollé : Oui : la politique familiale française ne fait aucun transfert vertical. M. le Président : Dans Le Figaro de ce matin, M. Nicolas Baverez donne un nombre d'enfants pauvres qui m'a paru extraordinaire. Pouvez-vous le confirmer ? M. Michel Dollé : Nous avons pris un retard considérable dans les informations disponibles sur les revenus et la pauvreté. On peut toutefois penser que la situation ne s'est guère améliorée depuis les dernières statistiques, qui datent de 2001. Si on retient la définition que donne l'INSEE de la pauvreté - c'est-à-dire le fait de disposer de ressources inférieures à la moitié du niveau de vie médian -, on comptait en 2001 un million d'enfants pauvres. Et si on retient la définition européenne utilisée pour fixer les objectifs des plans nationaux de lutte contre l'exclusion, soit 60 % du niveau de vie médian, on en comptait 2 millions... Mme Christine Boutin : Et quel est aujourd'hui le seuil de pauvreté ? M. Michel Dollé : Il doit être de l'ordre de 650 euros de revenu mensuel disponible pour une personne seule et de 780 euros pour une famille. M. Patrick Delnatte : Je comprends mal comment vous pouvez parler de la neutralité des transferts familiaux, alors qu'un certain nombre d'entre eux sont subordonnés à des conditions de ressources... M. Michel Dollé : Je parle de l'ensemble des transferts. Il faut en effet tenir compte de l'impact du quotient familial qui fait, tout simplement, que l'enfant d'une famille riche procure plus d'avantages que celui d'une famille pauvre. Mme la Rapporteure : Vous mesurez l'effet du quotient familial en valeur absolue, mais non en proportion des revenus de la famille. M. Michel Dollé : Les prestations et les transferts sous condition de ressources jouent davantage en faveur des familles à bas revenus, et la fiscalité directe en faveur de celles à hauts revenus. C'est en prenant l'ensemble des transferts liés à l'arrivée d'un enfant qu'on voit que l'effet de la politique familiale est neutre. M. Hervé Mariton : On a toujours beaucoup insisté sur la différence entre politique familiale et politique sociale. Une des fonctions de la politique familiale est bien que, pour un revenu donné, le choix du nombre d'enfants soit aussi indifférent que possible. Une famille qui dispose de 100 doit disposer, quand un enfant arrive, du même montant de transfert financier qu'une autre famille, et une famille qui dispose de 1 000 ne doit pas non plus être pénalisée dans son mode de vie du fait du nombre de ses enfants. Des présupposés idéologiques peuvent conduire à remettre en cause le principe de neutralité de la politique familiale, mais, de fait, une bonne partie de la politique fiscale française est fondée sur ce principe qui explique que, par construction, le quotient familial est plus fort pour les plus hauts revenus que pour les petits. Enfin, dans la mesure où il existe des aides soumises à condition de revenus et concentrées sur les revenus modestes, on peut bien parler de redistribution verticale des revenus plus élevés vers les moins élevés. M. Michel Dollé : L'orientation de la politique familiale relève bien évidemment de la responsabilité du législateur. Je me contente simplement de signaler un fait : pour respecter le principe de neutralité que vous venez de décrire, celui qui gagne 100 doit gagner 130 avec l'arrivée d'un enfant, alors celui qui gagne 1 000 doit gagner 1 300. Il faut donc donner 30 au premier et 300 au second... M. Hervé Mariton : Donner et ne pas prendre, ce n'est pas la même chose ! M. Jean-Marc Nesme : Disposez-vous d'éléments sur la répartition de la pauvreté des familles et des enfants selon les régions ? Avez-vous par ailleurs pu établir des relations de cause à effet entre la pauvreté monétaire et la situation intellectuelle et affective des enfants ? M. Michel Dollé : Nous ne disposons malheureusement pas de statistiques permettant d'analyser les revenus d'un point de vue géographique. On pourrait toutefois, grâce aux données des caisses d'allocations familiales, comptabiliser par région les enfants vivant sous un régime de RMI ou d'API. S'agissant de votre deuxième question, on connaît les conséquences de la pauvreté sur le phénomène d'échec scolaire. Ce lien est-il strictement un lien de cause à effet ? On sait que les enfants pauvres quittent ou abandonnent plus fréquemment l'école sans diplôme. De même, il est évident que ceux qui vivent dans des familles disposant de faibles revenus habitent plus souvent des logements surpeuplés et disposent plus rarement d'une chambre pour travailler. Mais le problème n'est pas que monétaire : il n'est pas rare que les parents d'enfants pauvres aient un faible niveau de formation initiale qui, combiné à leur situation difficile, les empêche d'accompagner leurs enfants face à l'échec scolaire. Il faut donc se demander comment lutter contre cet échec lorsqu'il est allié à la pauvreté. M. Pierre Goldberg : La pauvreté des enfants me lamine le cœur et votre exposé nous a fait toucher du doigt l'insupportable. À vous entendre, je m'explique mieux pourquoi il n'y a que 10 % d'enfants d'ouvriers à l'université... Dois-je rappeler que la politique familiale remonte au Conseil national de la Résistance ? Il ne s'agissait pas alors de dire qu'un pauvre devait avoir 30 et un riche 300 pour élever un enfant, mais au contraire que l'enfant a le même coût, quel que soit le niveau de salaire de ses parents ! Par ailleurs, je considère pour ma part que, quand on est au SMIC, on est effectivement au seuil de pauvreté. Ainsi, j'ai constaté qu'à la fin du mois il ne restait à une famille avec deux enfants qui percevait deux SMIC que sept euros pour vivre. N'est-ce pas cela, la pauvreté ? J'ai été maire d'une ville moyenne et j'ai participé à la création des missions locales. Je me souviens d'une femme médecin qui faisait observer que la pauvreté nuisait gravement à la santé : la dentition était en perdition, l'audition se dégradait rapidement. J'ai même remarqué que cette pauvreté, qui touche parfois deux générations d'une même famille quand ce n'est pas trois comme à Montluçon et au Creusot, finit aussi par marquer le physique de ceux qui la subissent. Avez-vous fait un constat analogue ? M. Michel Dollé : Je suis incapable de répondre à propos des effets de la pauvreté sur l'apparence morphologique. S'agissant de la santé, il apparaît que l'accès aux soins et à la prévention dépend davantage de l'existence d'une couverture sociale complémentaire que du niveau de vie. On manque toutefois de données depuis la mise en place de la couverture médicale universelle qui a eu un effet positif indéniable, même si elle a fait apparaître un effet de seuil. Je n'ai jamais dit qu'on vivait bien avec le SMIC. J'ai seulement observé que, quand on dispose d'un SMIC à temps plein et des allocations auxquelles donne droit la charge d'enfants, on passe au-dessus du seuil de pauvreté. Je répète donc que les situations les plus difficiles, celles situées en deçà du seuil de pauvreté, sont provoquées moins par l'insuffisance du taux de rémunération que par celle du taux d'emploi. Mme Marie-Françoise Clergeau : Sur les transferts, c'est entre nous que doit avoir lieu le débat politique. Il est vrai que combiner déductions fiscales et quotient familial fait peut-être problème. Par ailleurs, vous avez insisté sur le fait que la pauvreté relevait surtout des problèmes d'emploi et de la difficulté à concilier vie familiale et vie professionnelle. Pouvez-vous sur ce point nous préciser les différences entre la France et les pays scandinaves ? M. Michel Dollé : Le rapport du CERC détaille le cas du Danemark qui a mis en place une organisation pour la garde des enfants jusqu'à quatre ou cinq ans, puis pour les activités périscolaires, avec une véritable offre de services. Toutes les municipalités sont tenues de proposer aux parents, deux semaines après la fin du congé de maternité, une structure d'accueil, collective ou individuelle. Le coût pris en charge par la famille varie de 0 % du coût réel pour les revenus les plus bas à 30 ou 40 % pour les revenus les plus élevés. En France, l'offre de structures publiques est plus faible même si l'on tient compte du rôle de l'école maternelle. Le système d'aide français s'est beaucoup orienté vers l'aide aux parents (allocations et réduction d'impôts) pour que ceux-ci fassent appel directement à des personnes assurant la garde des enfants. Or, on constate que les familles qui sont en bas de l'échelle des revenus n'ont pas et ne peuvent pas avoir recours aux modes de garde payants. Là aussi l'accès à l'emploi joue un rôle déterminant, puisque les modes de garde publics n'acceptent souvent les enfants que quand les deux parents travaillent. Les crèches profitent donc plutôt aux revenus médians et l'ancienne allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) aux plus hauts revenus. Le système ne remédie donc ni au phénomène de trappe à inactivité en bas de l'échelle des revenus, ni aux difficultés des familles monoparentales. La création de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) n'a pas changé grand-chose. En outre, le dispositif français d'aide à la personne reposant sur un système de garde de gré à gré alimente la précarité des emplois, alors qu'au Danemark on a mis en place un véritable service public de l'enfance qui assure la continuité de l'emploi et de la formation professionnelle des salariés assurant ces services. Pour réduire la pauvreté des enfants, il faudrait, en France, changer l'organisation sociale de l'accueil des enfants... M. Hervé Mariton : Disposez-vous de comparaisons entre les situations, à niveau socioprofessionnel équivalent, selon qu'on a ou non des enfants ? Par exemple, si on prend le revenu net d'impôt et les transferts sociaux, de combien dispose un couple de cadre supérieur avec trois enfants par rapport au même couple sans enfant, et de combien disposent deux couples d'employés dans les mêmes situations ? Mme Patricia Adam : S'agissant des familles monoparentales, les politiques familiale et d'insertion ne sont à aucun moment rapprochées. Il n'y a donc pas de dynamique, et les familles monoparentales sont dans l'impossibilité d'accéder aux modes de garde d'enfants. Par ailleurs, vous avez dit que le taux de pauvreté des enfants était supérieur à celui des familles. Disposez-vous d'éléments chiffrés à ce sujet ? Mme la Rapporteure : Vous avez évoqué le plan Blair de lutte contre la pauvreté au Royaume-Uni. Pensez-vous qu'il contienne des éléments qui seraient pertinents pour répondre à la situation de la France, en particulier pour remédier au faible taux d'emploi des familles pauvres ? M. Michel Dollé : Pour calculer le niveau de vie d'une famille en fonction de sa taille, il faut savoir que chaque membre de cette famille ne compte pas pour une unité : le premier adulte « vaut » un, le deuxième 0,5, chaque enfant 0,3 jusqu'à 14 ans et 0,5 au-delà. Ce mode de calcul vise à tenir compte des économies d'échelle qui apparaissent avec l'agrandissement de la famille. Ceci permet d'évaluer les différences entre les situations évoquées par M. Mariton (les statistiques sont mobilisables par l'INSEE). On peut toutefois se demander si les unités de consommation sont ainsi bien calculées pour ceux qui sont en bas de l'échelle des revenus, car les économies d'échelle sont moins importantes quand l'essentiel du budget est consacré à l'alimentation. Il est vrai que l'API est un élément de politique familiale, mais ne participe pas à la politique d'aide à l'insertion. Au Royaume-Uni, le New deal for lone parents est un véritable accompagnement qui offre une aide concrète pour revenir à l'emploi (trouver un mode de garde, rechercher un emploi, etc.). On voit là une volonté politique de prendre en compte l'ensemble des problèmes. La démarche choisie par le gouvernement britannique pour lutter contre la pauvreté des enfants est particulièrement intéressante : à partir d'une analyse approfondie de tous les aspects de la pauvreté, une stratégie d'ensemble a été définie. Elle a conduit à mettre en place un ensemble de dispositifs visant à lutter contre la pauvreté. Il faut citer notamment le salaire minimum instauré en 1999 qui a permis d'augmenter de 30 % en moyenne la rémunération d'un million et demi de salariés. Citons également la création d'une allocation complémentaire aux revenus d'activités, le working family tax credit (WFTC), qui tient davantage compte de la composition de la famille que notre prime pour l'emploi, le relèvement sensible des allocations familiales, la création d'une allocation d'aide à la garde d'enfants : l'accent est véritablement mis sur le passage à l'emploi. Le gouvernement britannique s'est fixé pour objectif de faire disparaître la pauvreté des enfants en vingt ans, avec comme objectifs intermédiaires de la réduire de moitié en dix ans et d'un quart dès 2005. Ce premier objectif est en passe d'être atteint. À travers une batterie d'indicateurs, le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de ce qui est fait sur chaque aspect de la pauvreté. Toutes les politiques sont évaluées par des instances gouvernementales, par le Parlement et par des centres de recherche. La création d'une mesure est souvent annoncée deux ans à l'avance, ce qui permet des consultations, un débat approfondi et une préparation de la mise en œuvre effective du dispositif. Nous sommes à des années-lumière de cette démarche et de ce mode de gouvernance ! Mme Christine Boutin : Je souscris tout à fait à cette proposition car, ayant travaillé sur cette question à l'occasion du rapport que j'ai remis au Premier ministre, je puis témoigner de l'engagement politique très fort du Royaume-Uni dans la lutte contre la pauvreté. Ainsi le premier ministre anglais a demandé à chaque ministre d'étudier quelle mesure de son ressort peut contribuer à réduire la pauvreté. L'ensemble des propositions a fait l'objet d'une concertation exemplaire, et les résultats sont là. Quand j'entends qu'il y a aujourd'hui deux millions d'enfants pauvres en France, je me dis qu'il s'agit d'un enjeu capital. Mme la Rapporteure : J'appuie cette prise de position. M. le Président : Monsieur Michel Dollé, je vous remercie. Audition de M. François de Singly, sociologue, Présidence de M. Pierre Goldberg, Président M. le Président : Je souhaite la bienvenue au professeur François de Singly et je le prie d'excuser M. Patrick Bloche, retenu à l'étranger par un engagement prévu de longue date. Comme il vous a été indiqué, je souhaiterais que vous nous livriez votre réflexion sur trois questions qui servent de trame à nos travaux : le couple, la parentalité, les rapports entre les générations. M. François de Singly : Je crains d'avoir, comme à l'accoutumée, un peu de mal à respecter le délai qui m'est imparti car je suis, depuis trente-cinq ans, véritablement obsédé par mon sujet. Je vous ferai toutefois grâce d'une description de l'évolution de la famille, que tout le monde connaît, et vous proposerai plutôt une interprétation de cette évolution. Je m'inscris dans une des théories de la famille qui a été développée par Anthony Giddens, Ulrich Beck et moi-même, et qui insiste sur le processus d'individualisation comme caractéristique de l'évolution des sociétés modernes. Je distinguerai deux périodes essentielles pour la famille moderne. En effet, ce qu'on appelle couramment la famille traditionnelle est déjà une forme moderne de la famille, la vraie famille traditionnelle ayant disparu depuis longtemps. Il n'y a donc pas vraiment de nostalgiques de cette famille traditionnelle, mais plutôt des gens qui critiquent l'évolution de ce que j'appellerai la « famille moderne 1 », qui va de la fin du XIXème siècle jusqu'à 1960, en une « famille moderne 2 ». La modernité occidentale a imposé à la sphère privée le principe de l'élection, sur un mode similaire à celui qui prévaut dans la sphère publique : on choisit son conjoint et l'amour devient un facteur de déstabilisation de la famille. Vous ne pouvez tomber amoureux parce qu'on vous le demande. Vous ne représentez donc que vous-même, et non votre famille, dans le mariage. C'est cette fiction de l'individu détaché de ses liens qui pose le principe de citoyenneté. Avec l'irruption de la modernité, la IIIème République et l'école de sociologie de Durkheim se sont demandés avec inquiétude ce qu'on allait faire devant une société d'individus. Certains ont même proposé qu'on restaure le divorce par consentement mutuel institué à la Révolution - dont je rappelle qu'elle était éminemment individualiste -. Cette restauration n'a pas eu lieu parce que les républicains, notamment Durkheim lui-même, ont compris que, si l'amour est à l'origine du mariage, les époux deviennent en quelque sorte, à partir du moment où le couple a des enfants, des fonctionnaires soumis à un principe de devoir qui exclut de fait le divorce. On ne peut donc parler de contrat qu'à l'entrée dans le mariage, celui-ci devenant ensuite une institution. Pour le mariage comme dans bien d'autres domaines, la IIIème République n'est donc pas allée jusqu'au bout de la reconnaissance de l'individu. Évidemment, ce système n'a tenu que parce que les femmes étaient alors peu individualisées. En effet, elles étaient « femmes de » en raison du lien de dépendance économique à leur époux, l'individualisme amoureux ne débouchant pas forcément sur l'autonomie. Mes parents se sont mariés en 1936, quand triomphait la « famille moderne 1 » fondée sur le modèle de la femme au foyer, et, s'ils se sont mariés par amour, ma mère a quitté son emploi dès le mariage, sans attendre la naissance de son premier enfant. À partir de 1962, la scolarisation devient massive dans l'ensemble des milieux sociaux, pour les filles comme pour les garçons. Les grandes évolutions ont commencé avant 1968, avec notamment une plus grande attention portée à l'enfant, que consacre la création du journal Pomme d'Api en 1966. Les femmes ont mis du temps à accéder à une individualisation comparable à celle des hommes. Elles ont développé un modèle d'individualisation un peu différent de celui des hommes, en portant davantage attention à autrui et à la psychologisation de la société. Les femmes ont accédé à l'individualisation par l'emploi salarié, par la scolarisation, par le desserrement de leur relation de dépendance vis-à-vis de leurs maris, mais elles ont amené dans le même temps une nouvelle définition de l'individualisation. On vit ainsi dans un compromis entre individualisation au masculin et individualisation au féminin. C'est la combinaison entre la logique amoureuse et la scolarisation qui a donné le « grand bazar » familial. Avec la loi sur le divorce de 1975, la logique de progression conjugale puis familiale saute. J'observe à ce propos que toutes les grandes réformes du droit de la famille ont été plutôt l'œuvre de gouvernements conservateurs, avec le soutien de la gauche. Des transformations analogues sont intervenues dans tous les pays occidentaux : l'individualisation n'est pas d'abord un phénomène politique, elle est liée à l'évolution du monde des idées et à des conditions économiques plus favorables. D'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, on était persuadé que les pays du Sud de l'Europe - Italie, Espagne, Portugal - ne s'engageraient jamais dans cette voie. On a vu ce qui est advenu depuis. Le phénomène touche désormais le Japon et la Chine. La famille prend alors une forme plurielle, ce qui peut prêter à confusion. Mes enquêtes montrent en effet qu'il n'y a pas forcément une grande pluralité des modèles familiaux. Une même personne ne change pas de système de valeurs en étant successivement mariée, divorcée, seule, puis à nouveau en couple. Simplement, l'individualisme est un système qui engendre différentes étapes de notre cycle de vie personnel qui n'a rien à voir avec la modernité : on peut être moderne et n'avoir qu'une seule vie conjugale, et le mariage d'aujourd'hui ne doit pas être catalogué comme « traditionnel » par les statisticiens. Ces idées sont très importantes, car autant il faut mettre en œuvre des politiques différenciées selon les différentes étapes de ce cycle, autant il faut éviter de figer les gens dans des cases. Nombreux sont ceux qui voient le divorce comme une période de pause, et non comme l'arrêt définitif de la vie familiale. Personne n'a une idée de la durée de la relation amoureuse au moment où elle se noue, mais cela ne doit pas conduire à la dévaloriser. Il y a trente ans, on n'avait aucune idée des évolutions que je suis en train de vous décrire. On a ainsi parlé de « cohabitation juvénile » en croyant que seuls les 18-20 ans étaient concernés avant de s'apercevoir que la cohabitation se développait chez les plus de 60 ans... C'est parce qu'on a toujours considéré les femmes comme des êtres faibles qu'on s'est inquiété des effets de leur individualisation. Aujourd'hui, il paraît normal de les traiter comme les hommes. Mais tout se complique avec l'individualisation d'autres membres de la famille. Ainsi une seconde période s'ouvre dans la « modernité 2 », avec l'individualisation de l'enfant, qui conduit à lui reconnaître un certain nombre de droits. En effet, l'enfant a une double nature : il a droit à une protection parce qu'il est petit, mais il a aussi le droit d'exister en tant que personne. La reconnaissance de cette double nature est une transformation essentielle. Quand il était chargé des cours d'éducation morale à la Sorbonne, Durkheim affirmait que la première vertu morale de l'éducation était l'obéissance, l'autonomie ne venant qu'après. Depuis, on est passé de l'idée de transformation par l'éducation, qui consistait à dire qu'on apprenait pendant la période d'éducation et qu'un jour on devenait adulte, autonome et indépendant, à l'idée que l'autonomie doit s'apprendre tout de suite. Ainsi, on a incité les familles à envoyer les enfants observer la pluralité des mondes. On parle beaucoup aujourd'hui du téléphone mobile, mais j'ai vu personnellement apparaître, il y a quarante ans, la « culture jeune » qui est tout simplement faite pour que les adultes n'y comprennent rien. Alors qu'il y a trois ou quatre ans on me trouvait audacieux de parler de préadolescents à onze ans, on a inauguré il y a peu la Maison des adolescents de l'hôpital Cochin, qui accueille des mineurs dès la classe de sixième... De fait, il est évident que les enfants ont accès à l'autonomie de plus en plus tôt. L'individualisation reposant sur la valeur absolue de liberté, on peut difficilement demander que le modèle soit totalement figé. On va même plus loin dans la logique de l'individualisation en adaptant les règles, par exemple en faisant varier l'heure du coucher selon les besoins de chacun des enfants. Désormais on individualise la règle : dans la « famille moderne 2 », les principes d'éducation n'impliquent plus une automaticité des sanctions qui leur sont liées. Cette évolution fait apparaître le besoin d'une politique parentale nouvelle, susceptible d'aider les parents à arbitrer dans l'application des règles. L'individualisation fait en sorte que la famille est de moins en moins autonome. Durkheim l'avait pressenti en affirmant que plus il y aurait privatisation, plus il y aurait socialisation. Avec la « modernité 2 », on a ainsi de plus en plus recours à la psychologie et à la psychanalyse, au motif que chaque famille, chaque individu peut avoir à un moment donné une crise qui nécessitera l'intervention d'un tiers. Par ailleurs, l'individualisation de la femme n'est que relative : certes, elle jouit d'une plus grande liberté qu'avant par rapport à son conjoint, mais des différences subsistent, en termes de salaire par exemple, moins d'ailleurs entre hommes et femmes qu'entre pères et mères. En effet, tant qu'on a affaire à des célibataires, il n'y a pas de différence notable, mais l'écart se creuse après le mariage et, surtout, au fur et à mesure que les enfants naissent. On le voit, nous sommes toujours influencés par l'ancien modèle que le travail des femmes n'a pas déstabilisé : c'est d'abord à l'homme de procurer des revenus. Ainsi, lorsqu'un enfant est malade, le fait que ce soit la mère qui s'arrête de travailler est perçu comme une évidence. De mon point de vue, toute politique bien pensée en faveur des femmes est donc une politique de soutien à la famille. La logique d'individualisation de l'enfant n'en est qu'à son début. L'histoire est donc largement ouverte et nous aurons encore des surprises. M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé passionné et passionnant. Mme la Rapporteure : Comment situez-vous les familles monoparentales par rapport à vos modèles familiaux ? M. François de Singly : La monoparentalité soulève la question du rythme de la vie conjugale et de la stabilité de l'enfant, sur laquelle la France a beaucoup travaillé, en particulier en légiférant sur l'autorité parentale conjointe. Le problème des familles monoparentales tient bien sûr à leur pauvreté, mais aussi au fait que la femme qui se retrouve seule est le plus souvent dépourvue du droit à une vie privée tout au long de sa vie. Mes entretiens montrent bien que l'individualisation n'est jamais perçue comme le rêve de rester seul toute sa vie et qu'elle se place résolument dans la logique conjugale et familiale. Ainsi l'isolement est une étape, un moment, pas un objectif en soi. Les femmes ont davantage que les hommes recours au congé parental car elles veulent profiter de leurs enfants. Élever des enfants est en effet une chose merveilleuse, y compris pour l'épanouissement personnel des parents. C'est donc à tort qu'on parle de « charge des enfants ». Il y a de ce point de vue quelque paradoxe à ce que l'emploi salarié des femmes se soit développé, dans les années 1960, au moment même où on mettait l'accent sur la psychologisation de l'enfant : les femmes obtenaient le droit d'être moins à la maison tandis qu'on affirmait qu'il fallait faire davantage attention au développement de l'enfant... J'observe, s'agissant des familles monoparentales, qu'il est souvent gênant que l'enfant ne soit statistiquement pris en compte qu'une fois, généralement du côté de la mère, alors que la résidence alternée s'est considérablement développée. Or la responsabilité des parents après la séparation me paraît tout à fait essentielle. Je suis d'ailleurs favorable, parce que l'enfant doit avoir en règle générale deux parents, au moins, à un engagement personnel de l'homme comme de la femme, au moment de la reconnaissance de l'enfant, dans ce qui pourrait être un engagement de responsabilité sur le long terme. Mais la question de ces familles me semble relever moins du domaine de la loi que des politiques locales, et notamment municipales, qui permettent aujourd'hui que la famille se porte relativement bien. Par ailleurs, comment une femme peut-elle recommencer sa vie quand elle est au fond d'une banlieue et qu'elle consacre beaucoup de temps à s'occuper de ses enfants ? Les femmes en sont conscientes, et pourtant elles demandent le divorce. Une priorité doit donc être de les soutenir, au sein des familles monoparentales, moins en tant que mères qu'en tant que femmes, en particulier en leur permettant de disposer de temps pour elles. Mme Patricia Adam : Comment définiriez-vous la famille ? N'y a-t-il famille que quand naît l'enfant ? M. François de Singly : Non ! C'est au moment du mariage qu'on délivre officiellement un livret de famille. Il y a donc deux portes d'entrée dans la famille, le mariage et l'arrivée d'un enfant, et il faudrait un grand courage politique pour supprimer la première en considérant qu'elle relève d'une logique privée. J'observe d'ailleurs qu'un couple marié forme une famille, ce qui n'est pas le cas d'un couple de concubins sans enfants. Par ailleurs, avec l'individualisation, des différences sont apparues au sein même des familles. Ainsi, chacun n'entretient pas des relations de même nature avec ses différents frères et sœurs : quand j'interroge mes étudiants, je m'aperçois que certains fêtent Noël à deux et d'autres à soixante ; on voit aussi dans les faire-part que la définition de la famille varie selon qu'on annonce une naissance, un mariage ou un décès. Si, au début de la « modernité 2 », les féministes cherchaient à déstabiliser le mariage dans ce qu'il conservait de la « modernité 1 », aujourd'hui leurs filles et leur petites-filles s'en moquent : mettre, comme leur mère ou leur grand-mère, une robe blanche pour se marier ne leur fait pas peur, car cela ne signifie pas du tout la même chose qu'avant, notamment pas la virginité. Si on réhabilite la famille et le couple, ce n'est pas par nostalgie mais parce qu'ils se sont transformés. Il est évident que si on revenait au mariage sans divorce et à l'autorité du père, on provoquerait des manifestations réclamant le retour de la famille libre et heureuse... À propos de la société moderne, Ulrich Beck parle de la « société du risque » et Anthony Giddens de la « société d'incertitude ». Les individus sont donc de plus en plus en situation d'insécurité. Dans ces conditions, le mariage est perçu comme une forme d'assurance dont on a besoin à un moment donné, même si un tiers des personnes mariées ne le jugent pas indispensable à la vie de couple. Dès lors que le mariage n'est pas obligatoire, je ne vois pas de raison de le supprimer. Pour autant, je pense que le maintien du mariage ne devrait pas interdire ma proposition : l'engagement ferme et à long terme dans la parentalité, pour toutes les personnes, mariées ou non mariées, à titre personnel. M. Jean-Marc Nesme : Pourquoi parlez-vous de parentalité plutôt que de parenté ? Y a-t-il une différence ? M. François de Singly : Cette différence de terminologie n'a pour moi aucune importance. Peut-être l'idée de parentalité est-elle davantage utilisée par ceux qui travaillent sur les familles recomposées. L'intérêt que j'y vois est sans doute de mettre en avant à nouveau le père, alors qu'en 1975 on avait tendance à considérer que la mère suffisait. M. le Président : Je suis désolé que l'heure tardive ne permette pas de prolonger cette audition et je vous remercie beaucoup, monsieur, d'y avoir participé. Audition de M. Maurice Berger, chef de service Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous sommes très heureux d'accueillir le docteur Maurice Berger, chef de service en psychiatrie de l'enfant au Centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et psychanalyste, auteur notamment d'un ouvrage sur l'échec de la protection de l'enfance. M. Berger, quelle appréciation portez-vous sur l'ampleur des dangers pesant sur les enfants et sur l'action des services de protection de l'enfance ? Quelles pistes de réforme des dispositifs de protection des enfants conviendrait-il selon vous d'étudier en priorité ? M. Maurice Berger : Pour mesurer le développement d'un nourrisson, on utilise de petits cubes. À quinze mois, il construit une petite tour de trois cubes et, à dix-huit mois, il en empile cinq. À huit mois, on place un mouchoir sur un cube après avoir fait jouer le nourrisson avec : celui qui a été élevé dans une famille normale tire tout de suite le mouchoir tandis que celui qui a été élevé dans une famille très dysfonctionnelle a oublié l'existence même du cube car il n'a aucune capacité de mémoriser la permanence des objets. Ceci vient du fait que la présence de sa mère n'était suffisamment continue et fiable. Un juge des enfants m'a confié une expertise concernant un petit de dix-huit mois, non vacciné, dont la mère a fait un an de prison pour violences et abandonné ses deux aînés. L'enfant était déjà devenu déficient intellectuel puisqu'il présentait un QD - quotient de développement, équivalent du quotient intellectuel pour les enfants de moins de trente mois - de 68. J'ai considéré qu'il était nécessaire de séparer cet enfant de sa mère, mais le juge ne m'a pas suivi et, quelques mois plus tard, son QD était descendu à 61, ce qui correspond à une déficience irréversible. Ce juge a ainsi laissé des centaines d'enfants devenir handicapés. De fait, 32 % des enfants placés n'atteignent pas le niveau du certificat d'aptitude professionnelle à leur majorité, et 77 % des enfants qui entrent dans mon service ont un quotient intellectuel compris entre 50 et 70 : on les a laissés tomber dans la débilité sans intervenir. Si un médecin se comportait comme le juge que je viens d'évoquer, il serait déféré devant les tribunaux. L'exemple que vous ai cité n'est pas isolé : un service de la taille du mien a traité environ mille dossiers comparables. Jamais le hiatus entre les connaissances et les pratiques n'a atteint un tel niveau : beaucoup de professionnels ont l'arrogance tranquille de l'ignorance assumée. Aucun aménagement de surface n'apportera de changement. Autre exemple : Nicolas et Cerise, âgés de cinq et sept ans, vivent dans une famille d'accueil, mais rejoignent leurs parents tous les week-ends. À leur retour en famille d'accueil, ils dorment mal, s'arrachent les ongles des pieds et des mains jusqu'au sang et ne savent même plus où ils se trouvent. Au total, 26 000 enfants placés en France, c'est-à-dire 20 % d'entre eux, demandent à ne pas retourner chez leurs parents parce qu'ils en ont trop peur. Ce cas illustre trois grands principes. Premièrement, il est illusoire de chercher un équilibre entre les droits de l'enfant et ceux des parents : un enfant est un être vulnérable, en voie de développement, qui dépend de son environnement et ne sait pas émouvoir au cours d'une audience et qui n'est donc pas sur un pied d'égalité par rapport à ses parents. Deuxièmement, il ne faut pas confondre le lien avec la famille et le lien dans la famille. Troisièmement, les adultes ont tendance à s'identifier aux parents plutôt qu'à l'enfant. Une enquête a fait apparaître que 65 % - je n'arrive toujours pas à le croire - des patients chroniques devenus dépendants de l'institution psychiatrique ont été maltraités physiquement ou psychologiquement pendant leur enfance. De même, le docteur Betty Brahmy, médecin chef du service médico-psychologique de la prison de Fleury-Mérogis, m'a alerté sur le fait que « l'immense majorité des jeunes personnes détenues avaient fait l'objet d'un suivi (ASE, PJJ, pédopsychiatrie) durant leur enfance ou leur pré-adolescence ». Les quatre cinquièmes des clochards ont passé deux ans dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance avant de devenir SDF. Notre service est malheureusement spécialisé dans la prise en charge de la violence pathologique extrême - du type Guy Georges - et, dans 85 % des cas, le diagnostic aurait pu être effectué dès l'âge de quinze mois. On constate de plus en plus d'actes de violence dans les crèches et les écoles maternelles : la violence n'a pas d'âge biologique ; elle est déjà structurée dès les premières années de la vie et nous avons les moyens de la dépister. Une grande partie de ces enfants n'ont pas été battus mais, soumis au spectacle de violences conjugales, ils ont intégré le comportement de leurs parents. J'ai soigné un enfant qui avait été retiré treize fois de sa famille où son père tapait sa mère, et renvoyé en son sein à autant de reprises par les juges ; il essayait d'étrangler les autres enfants. Actuellement, entre 5 000 et 8 000 jeunes présentent les symptômes de la violence pathologique extrême et sont donc des violeurs ou des tueurs potentiels. Un enfant né en 1994, qui vient d'être dirigé vers mon service, a passé huit ans de sa vie dans divers internats sans voir ses parents, avant que l'application de la procédure de déclaration judiciaire d'abandon prévue par l'article 350 du code civil soit demandée ; mais, compte tenu de ses troubles de l'attachement, il n'est plus adoptable. C'est l'un des grands scandales méconnus de la Cinquième République : sur les 265 000 enfants suivis, 135 000 sont placés, pour un coût global faramineux de 9 millions d'euros par tête si l'on inclut la prise en charge de l'institution de rééducation, de l'allocation aux adultes handicapés, du revenu minimum d'insertion et des soins. Le coût annuel total est sans doute plus proche de 15 milliards d'euros que des 5 milliards annoncés, et cela pour de mauvais résultats. Il faut être un pays très riche pour se permettre d'avoir un dispositif de protection de l'enfance aussi « dysfonctionnant ». Les exemples que j'ai cités ne sont même pas comptabilisés, par les juges et certains éducateurs, comme faisant partie des cas compliqués. On prétend que les situations graves sont rares. Or, dans mon petit service de pédopsychiatrie, j'ai reçu 179 cas comparables en 2003. La protection de l'enfance est le domaine des beaux parleurs, mais peu sont en mesure de dire comment se portent réellement les enfants. Je vous recommande de demander aux personnes que vous allez auditionner comment elles évaluent le niveau de souffrance d'un nourrisson ou d'un enfant, ses capacités d'apprentissage, sa violence qui conditionnent son autonomie et sa socialisation. Je ne m'oppose pas aux parents. Je suis même l'un des premiers en France à avoir mis sur pied un dispositif d'entretiens familiaux et j'assure la vice-présidence d'un réseau d'aide à la parentalité. La plupart des parents confrontés à ces situations ont eux-mêmes vécu une enfance désastreuse et ne peuvent pas comprendre les besoins de leurs enfants. Comment en sommes-nous arrivés à une telle situation ? Depuis 1979, mon service s'est spécialisé dans la prise en charge des enfants venant des services de la protection de l'enfance et nous avons pu examiner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Bien des progrès ont été accomplis depuis cette époque. Le dispositif de signalement des actes de maltraitance et des abus sexuels instauré par la loi de 1989 est globalement assez efficace, et le groupe de travail constitué par le ministre chargé de la famille sur le signalement va encore améliorer ce fonctionnement. Mais ces problèmes ne représentent que 22 % des cas et, pour les autres, regroupés sous les termes généraux d'« enfants à risques », c'est le règne de l'aléatoire. Sont ainsi qualifiés de « carences » les situations où les parents sont gravement négligents, malades mentaux, paranoïaques, toxicomanes ou régulièrement absents, et le traitement de ces situations est laissé à l'application du juge et de l'éducateur. Le système présente dix défaillances. Premièrement, la France, contrairement à d'autres pays comme l'Italie, la Grande-Bretagne, le Québec, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou même le canton de Vaud, n'a inscrit nulle part dans sa législation que la préséance doit aller à l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire à la protection de sa sécurité et de son développement intellectuel et affectif. La loi, qui date de 1958, n'a pas été réactualisée en fonction des connaissances. Son but est qu'un enfant placé retourne vivre chez ses parents. Or ce n'est pas parce qu'un enfant retourne dans sa famille qu'il va bien et que c'est un succès. Cette loi, comme celle relative à la résidence alternée, a d'abord été pensée pour les adultes. De même, dans la loi du 2 janvier 2002 relative à la rénovation de l'action sociale qui consacre les droits des usagers des services sociaux, le mot « enfant » n'apparaît qu'une fois, et le principal usager est le parent et non l'enfant. Deuxièmement, à cause de la prégnance de l'idéologie du lien familial, spécificité nationale, il est impossible de protéger convenablement des enfants contre des parents atteints de pathologie très grave. Certes, rien n'est mieux pour un enfant que de vivre dans une famille qui fonctionne à peu près normalement, mais le lien familial peut aussi bien être un facteur de consolidation de l'estime de soi qu'une arme de destruction et de désorganisation. Or, en France, le lien parent/enfant est sacralisé. Troisièmement, il n'existe aucun dispositif d'évaluation des situations, alors que plusieurs pays étrangers, comme le Québec, ont mis en place des guides d'évaluation. Quatrièmement, la durée des séjours en pouponnière s'allonge : elle atteint en moyenne 600 jours dans la région parisienne et va au-delà de 1 000 jours dans certains départements. Or un enfant ayant passé autant de temps dans une pouponnière est fichu, car il a vu défiler beaucoup trop de visages et présente des troubles de l'attachement très graves. Ces enfants sont tout bonnement laissés en stand-by en attendant que leurs parents assument éventuellement leurs responsabilités ou adhèrent à un projet de famille d'accueil. Quel gâchis humain ! Cinquièmement, une importance excessive est accordée à la notion de précarité. Certes, la précarité aggrave tout, mais ce n'est pas toujours l'élément essentiel. Dans l'affaire de Drancy, le père qui a laissé vivre ses enfants dans vingt-cinq centimètres d'immondices et d'excréments avait un salaire correct, puisqu'il avait pu acheter un téléviseur à écran plat quelques jours avant que l'affaire éclate. Si tous les pauvres s'abstenaient de tirer la chasse d'eau, la France sentirait affreusement mauvais. L'idéologie du lien familial incite à occulter le fait que des parents puissent présenter des troubles psychiques. Sixièmement, l'aide à la parentalité est systématique alors qu'il ne devrait s'agir que d'une indication parmi d'autres. Pour qu'un tel soutien soit efficace, il importe qu'on évalue son efficacité au bout d'un délai précis, sans prolongation automatique, et qu'on le réserve aux parents qui acceptent de l'aide et reconnaissent leur part de responsabilité. En outre, le suivi se résume à deux heures par mois pour des familles en grande difficulté, alors qu'un enfant sujet à de légers troubles de la personnalité consultera un psychiatre en ville une heure par semaine. Il conviendrait d'aider plus les parents quand ils sont en grande difficulté avec leur enfant. Septièmement, sous l'influence d'ATD Quart-monde, la déclaration judiciaire d'abandon prévue par l'article 350 du code civil n'est plus appliquée et le nombre d'enfants adoptables a chuté de moitié. Les petits passent donc d'institution en institution et vont très mal. Il est évident qu'un parent qui ne s'occupe pas de son bébé pendant un an ou deux est en détresse psychique. J'observe que, en 2003, trente-neuf enfants ont été adoptés en France suite à une déclaration judiciaire d'abandon, contre 3 500 en Angleterre, 273 au Québec ou 1 600 en Italie. Huitièmement, le développement des actions éducatives administratives repousse dans le temps la judiciarisation des situations, lesquelles sont donc souvent très dégradées lorsque le juge est amené à intervenir. Neuvièmement, le corps des juges des enfants est sclérosé : aucun d'entre eux n'est favorable à une modification de la loi, et ils se réfugient derrière la rédaction actuelle de l'article 375 du code civil. Un changement ne sera possible que si le législateur n'a pas peur d'aller à leur encontre. Enfin, dixième défaillance de notre dispositif de protection de l'enfance : la théorie de l'attachement n'est pas intégrée. Pourtant, un enfant de moins d'un an, pour éprouver un sentiment de sécurité et se développer, doit bénéficier d'une figure d'attachement stable, fiable, prévisible et accessible. Quelles sont les solutions envisageables ? Nous avons atteint le fond du trou et le dispositif ne peut plus être replâtré : des mesures lourdes s'imposent. D'abord, il faut abroger l'article 375 du code civil et voter enfin une loi centrée sur la protection et l'intérêt de l'enfant. Il conviendra ensuite de se doter d'outils d'évaluation puis de responsabiliser les acteurs de la protection de l'enfance, qu'ils soient pédopsychiatres, juges, éducateurs ou qu'ils interviennent au titre du conseil général ou de la sauvegarde de l'enfance. L'association La Voix de l'enfant va d'ailleurs porter plainte sur les deux dossiers dont je vous ai parlé en début de séance. Mme Henriette Martinez : Très bien ! M. Maurice Berger : Enfin, pour accompagner la réforme, je préconise à titre provisoire la création d'un groupement d'intérêt public (GIP) recueillant les crédits des conseils généraux et de l'État. En effet, si les enfants sont placés plus rapidement - ce qui ne veut pas dire qu'il faut en placer plus -, le coût immédiat augmentera pour les conseils généraux mais, en contrepartie, les dépenses de RMI et d'allocation aux adultes handicapés reculeront ; la formule du GIP serait adaptée pour gérer ces oscillations. M. le Président : Je salue vos propos, empreints d'une grande force de conviction. Mme Patricia Adam : Les documents que vous m'adressez régulièrement, monsieur Berger, alimentent notre réflexion et devraient nous aider à modifier la législation. Lorsque je vous ai demandé de venir dans mon département, les services du conseil général, dont je préside la commission de l'action sociale, n'étaient pas enchantés. Vous bousculez en effet les habitudes de travail et les concepts, et chacun se sent attaqué. Le débat a tout de même eu lieu, mais je ne parviens pas à mettre en place les outils d'évaluation que vous préconisez. Vos collègues psychiatres et psychologues ne connaissent pas ces outils, et ne sont pas persuadés de la pertinence de la théorie de l'attachement. Je m'efforce aussi de lancer l'étude sérieuse sur le parcours des enfants qui fait encore défaut, afin d'apprécier les dégâts, qualitativement et quantitativement. Mme Henriette Martinez : J'apprécie également beaucoup les travaux, les écrits, la compétence et la détermination du docteur Berger. Je signale que je viens de faire voter par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales la suppression, dans l'article 350 du code civil, de la référence à la grande détresse des parents ; j'espère que nous serons suivis en séance publique. Nous avons tous en tête des jugements rendus contre l'intérêt des enfants : trop d'entre eux, en France, sont victimes non seulement de maltraitances, mais aussi de décisions de justice. Nous avons apprécié les propos du garde des Sceaux reconnaissant la responsabilité de la justice française vis-à-vis des adultes après le procès d'Outreau, mais nous aimerions que cette responsabilité soit également reconnue à l'égard d'enfants. Ma proposition de loi est très largement inspirée de vos travaux sur l'échec de la protection de l'enfance. J'espère vivement que notre Mission d'information aboutira à un grand texte en faveur de la protection de l'enfance, reprenant le dispositif de ma proposition ainsi que celui de la proposition de loi de Mme Valérie Pécresse. Dans la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, nous avons introduit quelques avancées mais nous constatons malheureusement que les juges n'en tiennent pas compte. Plusieurs de nos collègues s'apprêtent à déposer une proposition de loi relative à l'inceste. Compte tenu de la modification de la structure familiale, ce terme est difficile à définir. Estimez-vous que l'inceste doit être traité séparément des autres abus sexuels ? Ne s'agit-il pas plutôt d'un facteur aggravant des abus sexuels ? Enfin, que pensez-vous de l'Observatoire national de l'enfance en danger, l'ONED, mis en place par la loi du 2 janvier 2004 ? Mme la Rapporteure : Prônez-vous la suppression des pouponnières au profit des familles d'accueil, en vertu de la théorie de l'attachement ? M. Maurice Berger : Supprimer les pouponnières serait catastrophique car nous avons besoin d'un lieu d'accueil d'urgence, notamment à la naissance, mais aussi de maisons maternelles, c'est-à-dire de pouponnières hébergeant la jeune maman, pour l'observer pendant trois ou quatre mois et déterminer si elle peut être en mesure de s'occuper de son enfant. Au Québec, où les pouponnières ont été supprimées, des familles d'accueil d'attente reçoivent jusqu'à sept enfants, et un établissement va être reconstruit, dans lequel les séjours seront, de manière stricte, limités à trois ou quatre mois maximum. Mes propos sont souvent qualifiés de révolutionnaires, alors que je ne prône qu'une remise à niveau pour rattraper le retard pris par la France par rapport aux autres démocraties. Les pédopsychiatres et les universitaires en pédopsychiatrie n'ont pas compris la spécificité des dispositifs de prise en charge thérapeutique en protection de l'enfance. Cette spécialité n'existe pas en tant que telle. Aucun professeur de pédopsychiatrie ne se rend aux audiences ; peu suivent des familles d'accueil ou des enfants placés sur le long terme. Faut-il créer un institut universitaire qui fonde la protection de l'enfance comme spécialité ? En tout cas, les processus thérapeutiques sont spécifiques et je déplore que la plupart des pédopsychiatres ne sachent pas les appliquer. Le Québec, depuis septembre 2003, forme tous les professionnels de l'enfance à l'utilisation du guide national d'évaluation. Beaucoup d'enfants sont en effet victimes de la justice. Il existe trois sortes de juges : les vrais juges, qui ont un discours clair, décident dans l'intérêt de l'enfant et parlent aux parents de leur responsabilité... Mme Henriette Martinez : Ils sont rares ! M. Maurice Berger : ...les juges « savonnettes », qui se laissent prendre par l'émotion transmise par les parents ; les juges « modèle 1960 », catégorie dominante, aussi rigides que le conseil de l'ordre des médecins de l'époque, qui refusait la contraception féminine. Deux propositions de loi sont en gestation. Je n'ai pas envie de trancher entre les deux car elles me semblent complémentaires. Celle de Mme Pécresse aborde les questions de la prévention, de la présence du père. Elle a surtout un trait de génie : l'intégration la résidence alternée dans le dispositif de protection de l'enfance. Quant à celle de Mme Martinez, elle tend à abroger l'article 375 du code civil et à rapprocher la situation française de celles des pays les plus avancés. Cela ferait une loi longue, mais celles en vigueur dans d'autres pays font jusqu'à vingt pages. J'observe que la loi régissant le mur mitoyen compte six pages. La protection de l'enfance n'en mérite-t-elle pas autant ? Mme Claude Greff : Très juste ! M. Maurice Berger : L'obligation incombant au juge de répéter aux parents tout ce que l'enfant vient de lui confier ôte toute liberté de parole à ce dernier, et la plupart des juges n'acceptent pas de maintenir le secret. Quant à l'ONED, c'est un nouvel organisme ; à ce stade, je suis incapable de savoir jusqu'à quel point il nous permettra d'avancer. Sur l'inceste, ayant parcouru les différents projets de façon un peu rapide, je ne suis pas en mesure de vous donner un avis intelligent. M. le Président : Merci pour ces réponses d'une grande honnêteté. Nous sommes très sensibles à vos propos et à votre engagement. Audition de M. Philippe Jeammet, chef de service Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Je souhaite la bienvenue au docteur Philippe Jeammet, chef de service en psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut mutualiste Montsouris, ainsi que président de l'École des parents et des éducateurs d'Île-de-France. Nous souhaitons vous entendre pour que vous nous fassiez part de votre expérience et de vos recommandations dans le domaine de l'aide à la parentalité. M. Philippe Jeammet : Je vous remercie de cette invitation, s'agissant d'un sujet qui m'est cher. Je m'occupe essentiellement du comportement des adolescents et des jeunes adultes, révélateur puissant des processus en œuvre au cours de la petite enfance. J'estime qu'il faudrait parler des besoins des enfants au lieu de mettre sans cesse en avant leurs droits. Parler des enfants en se focalisant sur les droits qu'il convient de leur donner revient, au fond, à les traiter comme des adultes, à leur voler leur enfance : il faudrait qu'ils décident des programmes scolaires, des cadeaux qu'ils vont recevoir, de la séparation de leurs parents, alors qu'ils sont déjà submergés par la problématique des adultes en regardant la télévision, facteur important de désorganisation. Nombre de parents affirment ne jamais avoir pris de décision sans l'accord de leur enfant ; ils ne se rendent pas compte des dommages que provoque ce passage d'un excès à l'autre. L'enfant est un sujet à part entière, mais il a des besoins spécifiques : la protection, la continuité affective, la stabilité des relations. Nier ces besoins conduit à en faire un petit paranoïaque, ce syndrome de la persécution étant une forme de lutte contre la dépression. Une grande partie de l'avenir d'un enfant dépend de la confiance qu'il ressent dès les premières années de sa vie envers les adultes qui l'entourent. S'il a confiance, il apprend à attendre et à utiliser ses ressources propres, ce qui lui permet de se libérer des personnes dont il a besoin et de se calmer en ressentant un peu moins sa dépendance à leur égard. L'être humain se caractérise par sa capacité réflexive et il est très tôt pris entre deux exigences de son développement : il a besoin de se nourrir des autres, mais aussi de se différencier et d'être soi. S'il perçoit trop vite sa dépendance à son entourage, sa seule réponse possible est de s'opposer pour marquer son territoire : il s'oppose, essentiellement par la plainte, donc il existe, en luttant contre deux angoisses, celle de l'abandon mais aussi celle de la fusion et de l'intrusion. Cela va des troubles psychosomatiques précoces des nourrissons de quelques mois jusqu'aux comportements d'opposition de l'adolescence, en passant par les caprices de l'enfant de deux ans qui refuse de se séparer de sa mère à l'heure du coucher. L'attachement est nécessaire mais insupportable car il donne à autrui un pouvoir sur soi. C'est le paradoxe central révélé par l'adolescence, mais qui existe toute la vie durant. Ce dont un adolescent a besoin, cette force qui lui manque, ce qu'il lui faut pour se sentir bien et à la hauteur, précisément parce qu'il en a besoin, tout cela menace son besoin d'autonomie. Plus il a besoin de quelqu'un, plus ce lien le menace. S'il s'éloigne, il se sent perdu ; s'il accepte ce qu'on lui propose, il se sent envahi. À cette époque de la vie, tous les liens sont sexualisés, la peur de la pénétration étant à la mesure des attentes, lesquelles sont à la mesure de l'insécurité interne, elle-même à la mesure du manque de confiance. Le malentendu vis-à-vis des jeunes provient de la volonté de leur ouvrir les bras à tout prix et de les comprendre. Mais on ne risque pas de les comprendre en les infantilisant et en montant en épingle un dolorisme très français qui, à force, devient pathogène. De quoi souffrent les jeunes ? De leurs contradictions, de vouloir une chose et son contraire, de ne pas être en mesure de faire la preuve de leur valeur, de traumatismes, certainement pas du non-respect de leurs droits. Puisque la douleur intéresse les adultes, le jeune va mal, ce qui lui permet d'exister, mais les adultes ne parviendront pas à le satisfaire ; il règlera donc ses comptes avec le passé, les déceptions et les traumatismes par des hospitalisations, des scarifications, des crises de boulimie, des tentatives de suicide. Le piège, en cinq ou six ans, s'est refermé sur des parents tétanisés. Ils sont prêts à faire tout ce que veut leur enfant, pourvu qu'il aille bien. Or la seule chose que l'enfant ne peut pas, c'est précisément aller bien ! Ce phénomène ne touche que 20 % des adolescents, mais nombre d'entre eux pourraient aller nettement mieux, car ils ne souffrent pas d'une vraie maladie, mais ont simplement des conduites qui les empêchent de se réaliser, les rendent de plus en plus dépendants et de moins en moins tolérants à cette différence. Ils retrouvent une force et une identité en allant mal. Ces conduites ne sont pas pathologiques mais pathogènes, et rendent les jeunes vraiment malades lorsqu'ils s'enferment dans l'échec et ne conservent que cette seule force. Les interdits peuvent avoir un effet d'inhibition mais sont aussi protecteurs. Or notre société a pris pour adage : « fais ce qui te plaît ». Le problème, c'est que l'être humain a des désirs contradictoires : ne rien faire et réussir ; entretenir tous les liens affectifs possibles et garder un lien préférentiel ; aller travailler le matin et rester au lit. Sans contrainte, on est soumis à la tyrannie du choix, et beaucoup d'adultes s'effondrent face au poids des décisions. Alors qu'il est fatigant de choisir, on fait porter ce poids sur les enfants. Comment un enfant saurait-il s'il veut aller à tel endroit ? C'est en marchant que l'on découvre le paysage ! Une des façons d'intéresser un enfant à quelque chose consiste à lui dire que c'est intéressant, mais que ce n'est pas pour lui. Il faut prendre conscience de cette contradiction propre à l'être humain : quand on lui propose de faire ce qu'il veut, il est non seulement soumis à un choix déchirant, mais aussi confronté à l'angoisse de ne pas avoir les moyens de ses ambitions et renvoyé à ses ressources internes. Le problème est très aigu dans notre société, où le narcissisme est sans cesse sollicité. Dans un environnement plus coercitif, la personne est certes un peu brimée, mais aussi ménagée. La laisser faire ce qu'elle veut, c'est l'obliger à prendre conscience de ses peurs. Tous les adolescents qui vont mal, en particulier ceux qui commettent des actes violents, ont peur. Les prisonniers aussi souffrent et ont peur, parce que leur situation n'est pas un signe de vitalité ; ils doivent faire leurs preuves en permanence car ils sont tenaillés par le doute et le malaise. Les jeunes sont donc piégés et on les renvoie à leur narcissisme. Et quel reflet leur offre le miroir de la société des adultes ? La fatigue d'être soi, car les adultes sont las. C'est la raison pour laquelle tout le monde afflue aujourd'hui sur la tombe d'un homme qui était tonique... On ne se rend pas compte de l'effet délétère de la vie familiale : les repas familiaux, dans tous les milieux sociaux, ne sont pas des moments de plaisir. La famille est sans doute le lieu de dépôt de toutes les doléances dont les enfants sont « gavés ». On leur dit qu'ils doivent aller à l'école, mais, comme c'est présenté comme une obligation, on leur propose de choisir leurs programmes. Quel piège terrible ! Les plus fragiles s'effondrent car ils ne sont pas en mesure d'aboutir. Les enfants et les adolescents sont au contraire en attente de rencontres avec des adultes qui les mettent sur la voie de ce qui est intéressant. Ce dont nous avons besoin est aussi ce qui nous menace. Dans cet état d'insécurité, on est pris dans l'étau de ces deux angoisses humaines : si l'on ne me regarde pas, cela signifie que je n'ai aucune valeur ; si l'on me regarde, c'est que l'on me veut quelque chose. Les adolescents sont dépendants de l'environnement : ils guettent sans arrêt le regard des autres sur leur personne. Dès que l'on s'approche d'eux, ils ont ces mots incroyables : « Tu me gaves, tu me saoules, tu me prends la tête. » Il faut prendre cette image au pied de la lettre : l'adolescent n'est plus lui-même. S'il a la tête prise, c'est justement parce qu'il attend une réponse des adultes, mais dès qu'un regard se pose sur lui, c'en est trop. C'est un peu le syndrome corse : si tu ne regardes pas ma sœur, c'est parce que tu ne la trouves pas belle ; si tu la regardes, qu'est-ce que tu lui veux ? C'est un problème identitaire majeur. Je ne supporte pas le besoin d'être entouré, car celui qui m'approchera se rendra compte que je ne suis pas à la hauteur, que je suis comme un petit garçon qui voudrait être rempli, pénétré. Je me sors de cette situation en allant mal : l'opposition devient un moyen de maîtriser la distance relationnelle avec les personnes dont j'ai le plus besoin. On apprend très vite que réussir et avoir du plaisir ne durera pas, tout comme ne dure pas la santé qui, selon le docteur Knock, est « un état précaire qui ne présage rien de bon ». Les anxieux ont d'ailleurs la hantise de ce qui ne dure pas. Si vous êtes pourvu intérieurement de sécurité et de confiance, vous savez qu'après une perte vous allez retrouver autre chose. Si, en revanche, vous n'êtes pas sûr de vous, la crainte de la perte est la plus forte : mieux vaut ne rien vivre de bon et se complaire dans une plainte continuelle. La société est bien partie pour continuer à se plaindre, à moins qu'une catastrophe ne survienne, ne ressoude les gens et ne leur redonne l'envie d'être actifs. Les adolescents nous renvoient des informations puissantes sur le malaise narcissique de notre société. Celui qui ressent du plaisir et veut réussir dépend des autres. En revanche, l'adolescent comprend très vite que choisir l'échec et faire le mal font de lui le plus fort. Il ne choisit pas de ne pas être heureux, mais le devient en cédant à une contrainte liée à la peur qui l'habite. Plutôt que de devenir dépendant de l'extérieur dont il a besoin pour assurer son narcissisme, plutôt que de profiter du plaisir de l'échange, il sombre dans la destruction. Celle-ci est la créativité du pauvre, de l'impuissant, selon une logique qui peut mener au crime passionnel. De même, l'enfant s'agrippe à sa mère avant d'aller se coucher, car rester seul le met en position d'insécurité ; s'agripper le rendra dépendant et il contrôlera sa dépendance en rendant à son tour sa mère dépendante de lui. Ce cramponnement est la marque d'un attachement insécure qui perdurera la vie durant. Il est fondamental que l'adulte comprenne ce paradoxe, sans quoi il croit qu'il suffit d'être gentil avec l'enfant et de lui donner ce qu'il veut pour tout arranger. Si une relation de confiance n'est pas construite dès le départ, si les déceptions sont trop grandes, une des façons de se protéger sera de provoquer sa propre douleur. Tous les adolescents qui vont mal se font du mal, s'amputent d'une partie de leurs potentialités en se repliant sur eux-mêmes et en refusant d'acquérir les connaissances qui leur permettraient d'arracher un minimum de liberté et de choix. Pourquoi les êtres humains ont-ils besoin de se faire du mal ? Peut-être faudrait-il restaurer des cérémonies d'autoflagellation ? Des adolescents décrètent qu'ils ne travailleront pas parce qu'ils n'aiment pas un professeur. Celui-ci est donc si important à leurs yeux qu'il dicte leur vie. Mais ils ne s'en rendent pas compte puisqu'ils ont l'impression de s'opposer. Parler des droits des enfants sans prendre suffisamment en compte la notion de besoins contribue à aggraver le désordre chez les parents. Nombre d'entre eux, dans tous les milieux sociaux, ne savent plus quoi faire et se contentent d'écouter leurs enfants. J'ai ainsi reçu un adolescent de douze ou quatorze ans, victime de troubles obsessionnels compulsifs, pris dans ses manies et ses contraintes, auquel ses parents n'avaient rien trouvé de mieux, pour se faire pardonner de lui avoir imposé d'aller voir un psychiatre, que de lui promettre un cadeau. Je suis conscient de l'importance des droits de l'enfant, mais celui-ci, depuis quatre ou cinq ans, tend de plus en plus à devenir un adulte qui décide à la place de ses parents de ce qui est bon pour lui : il est « parentifié ». L'École des parents va devoir ouvrir des consultations de « guidance » pour des parents d'adolescents qui ne savent plus comment faire. Ils hésitent même parfois à contraindre leur enfant à venir consulter un médecin, de peur que cela n'ajoute une souffrance supplémentaire à leur progéniture. Ce n'est pas que les parents démissionnent, mais ils ne savent plus comment se repérer. Beaucoup d'entre eux déclarent n'avoir jamais pris de décision, depuis la naissance de leur enfant, sans lui demander son avis. Comment voulez-vous qu'un enfant obligé de supporter le poids de cette responsabilité jetée sur ses épaules se sente sécurisé ? On prétendait que le Prozac était la pilule du bonheur, et un suicide a suffi pour qu'il devienne déconseillé de le prescrire aux jeunes. Où allons-nous si les adultes ne sont plus là pour rappeler que chaque outil présente des risques et qu'il convient d'apprendre à le manier avec précaution ? Le plus grand risque, c'est précisément de vivre ! La télévision montre les cas les plus extravagants. Durant toute une émission sur les troubles alimentaires, une mère et sa fille se sont tenues par la main. Quelle entrave ! Quand on est attaché de la sorte, on dresse des remparts - l'obésité, la maigreur, le mal-être -, et ceux-ci nous appartiennent en propre. Ce que nous possédons, c'est ce qui ne va pas et une partie de nous y tient, mais, en même temps, nous en souffrons et nous voudrions nous en débarrasser. Il faut prendre les droits de l'enfant en considération, mais aussi ses besoins fondamentaux, et, si les parents ne peuvent y répondre, il convient de revoir la théorie selon laquelle rien ne remplace la famille. Certains parents ne peuvent faire face parce qu'ils vont trop mal et peinent déjà à s'occuper d'eux-mêmes. Il faut trouver des formules assez fermes, car rares sont ceux qui diront ouvertement qu'ils désirent abandonner leur enfant. Celui-ci a besoin qu'on le protège, qu'on ne lui vole pas son enfance, qu'on ne lui projette pas tous les problèmes des adultes au travers de la télévision et de l'accès à la pornographie. Pour lui, c'est éminemment déprimant ; mieux vaut dresser des interdits, quitte à ce qu'il les transgresse. À force de défendre la liberté, on oublie que l'être humain, plus encore que les autres animaux, a besoin de défendre son territoire, son individualité, et que cela suppose qu'il perçoive des limites et des interdits, qu'il puisse distinguer entre ce qui est à soi et à autrui. Obtenir quelque chose par l'effort est une façon de se l'approprier. Chacun sait que les enfants paraissent toujours mieux élevés chez les parents d'un copain que chez eux, parce que la proximité dissout l'être humain. J'ai reçu une adolescente de treize ans et demi, déscolarisée, errante, suicidaire, droguée, tombée dans la semi-prostitution. Laisser ainsi des jeunes dans les rues, ce n'est pas les laisser libres, c'est les abandonner. Avant la fin de la consultation, durant laquelle elle m'avait débité des horreurs, je lui ai demandé de citer une de ses qualités ; elle a tourné la tâte, caché ses yeux de sa main comme une petite fille en désarroi qui se protège, et m'a répondu : « Je suis une conne ». C'est son identité et elle s'en moque, car rien n'a de valeur. Chez ces sujets en souffrance, une émotion positive est comme une goutte d'eau sur un morceau de sucre : elle les fait fondre. Et comment se reprennent-ils ? En passant à l'acte. Il serait plus difficile de vouloir aller bien et de réussir, car cela ferait apparaître la difficulté de réussir. Aller bien signifie s'ouvrir ; aller mal est une sorte d'anesthésie. Il ne faut pas laisser les enfants aller mal. Camus, dans Le premier homme, a écrit ces mots merveilleux : « On ne choisit pas la misère, mais on peut la garder ». Il ne faut pas laisser les jeunes s'installer dans une situation d'échec, car ce n'est jamais un vrai choix. Il est indispensable de conseiller aux parents de poser des limites, ce qui ne signifie pas procéder à une « parentectomie ». Je préconise depuis dix ans la réouverture d'internats qui permettent aux enfants de sortir du regard de leurs parents et à un bon nombre d'entre eux d'obtenir de meilleures notes. M. le Président : Je n'ai pas voulu vous interrompre, monsieur Jeammet, car j'aurais couru le risque de me rendre impopulaire parmi mes collègues, mais l'heure tourne et il reste peu de temps pour les questions. Mme Henriette Martinez : Les jeunes dont vous nous parlez sont-ils majoritairement issus de milieux marqués par des difficultés sociales importantes ? Quelle est, parmi les jeunes qui viennent vous voir, la proportion d'enfants qui ont subi des maltraitances physiques ou psychologiques ? À partir de quel âge peut-on détecter l'absence de relation de confiance ou d'attachement ? Selon quels critères ? Est-il possible de soigner un sujet avant qu'il atteigne l'adolescence ? Mme Patricia Adam : Vous avez observé une montée en puissance du phénomène depuis quatre ou cinq ans. Je constate le même phénomène aussi dans ma ville. Comment l'expliquez-vous ? M. Philippe Jeammet : Tous les milieux sont touchés, car plus qu'un phénomène social, c'est un problème de personnalité des parents. Les plus vulnérables sont les personnes anxieuses, dépourvues de repères fixes, sensibles à la pression narcissique à l'œuvre dans notre société. L'anxiété, comme la dépression, est contagieuse et peu digestible, et il faut faire en sorte de ne pas la déverser sur les enfants. Ceux-ci héritent des problèmes de leurs parents qui culpabilisent et tentent de réparer par une abondance de cadeaux, ce qui les disqualifie plus encore. À l'heure où les familles éclatent, le « familialisme », c'est-à-dire le renfermement sur la famille sur elle-même, n'a jamais été aussi fort. Si le phénomène est commun à tous les milieux, son expression varie, certaines formes de délinquance étant liées au contexte social. Il faut dire que les banlieues, à l'instar des prisons, concentrent un grand nombre de personnes qui vont mal sur le plan psychique. Il convient au demeurant de veiller à ne pas réifier le phénomène car il n'a rien de mécanique. Les relations sécures dépendent de l'attachement, mais l'attachement insécure provoque sans doute la créativité. Pourquoi les uns transforment-ils leur faiblesse en une force créatrice, tandis que d'autres optent pour la destruction ? Les rencontres sont souvent déterminantes, comme celle de Camus avec son instituteur, M. Germain. Tous ces gens qui vont mal sont en attente, et cela ne peut pas être codifié. Il faut commencer à intervenir lorsqu'un enfant ne peut plus se nourrir de ce dont il a besoin - c'est-à-dire de connaissances et d'ouverture par rapport à son objet d'attachement principal -, lorsqu'il se replie sur lui-même et refuse d'aller à l'école. Ce n'est pas nécessairement pathologique, mais c'est toujours pathogène. Il importe de ne pas le laisser s'organiser autour de sa conduite, ce qui suppose simplement, dans bien des cas, d'en prendre conscience, de poser des limites, de discuter avec un tiers, l'instituteur, un psychologue scolaire, une assistante sociale ou un psychiatre. Nous avons la chance, en France, de disposer d'une panoplie de moyens assez vaste pour ne pas laisser un enfant s'enfermer dans des conduites d'échec en l'aidant à assumer ses désirs. L'intérêt de la vie, c'est de s'engager dans une démarche volontariste. Le désir ne surgit pas de lui-même et requiert une attitude tenace, ce qui n'a rien à voir avec le harcèlement ou l'emprise. M. Sébastien Huyghe : Vous remettez en cause une certaine permissivité. M. Philippe Jeammet : Sans aucun doute. M. Sébastien Huyghe : Mais vous prônez aussi le dialogue. Dans notre société, la confrontation n'a pas bonne presse et il est mieux vu de faire plaisir. Les parents hésitent à gronder leurs enfants car ils travaillent beaucoup et ne les voient guère. Ne subissons-nous pas aujourd'hui les conséquences de 1968, époque où il était interdit d'interdire ? Quelle réponse convient-il d'apporter ? Comment fixer des limites ? M. Philippe Jeammet : Il est normal que la société évolue, mais les positions médianes sont plus difficiles à tenir que les extrêmes. Elles subissent en effet une tension permanente, comme la vie, siège de confrontation entre des besoins contradictoires : besoin de se nourrir et besoin de se différencier. Il faut apprendre aux enfants à supporter cette tension, en les amenant à prouver leur force, en les valorisant, sans les humilier, mais sans leur voler leur enfance. La pédophilie est aussi une effraction de la problématique des adultes dans l'espace des enfants. Des mères racontent leurs expériences sexuelles à leurs filles alors que celles-ci n'en veulent rien savoir. Ce n'est pas de la maltraitance, mais il est malsain de confondre le plaisir et l'excitation. Cette quête de sensations a pour objet de se protéger des émotions. Il ne faut pas résumer les problèmes de l'enfance aux terribles affaires d'Outreau ou d'Angers et faire la course aux traumatismes en « victimisant » les enfants à problèmes. En réalité, ils sont surtout victimes de la difficulté d'être homme et de trouver la bonne distance. L'important est donc de se préoccuper des besoins profonds de l'enfant. Les émissions télévisées à succès qui ridiculisent des vedettes, porteuses de valeurs importantes en termes d'image, montrent qu'il est nécessaire de fixer des limites. C'est aussi dans ce but que l'École des parents gère plusieurs lignes d'écoute téléphonique. Les personnes qui vont le plus mal éprouvent des difficultés à dire leur souffrance. Ces personnes sont la cible des sectes qui leur proposent de fausses solutions. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit et de traquer les traumatismes, mais de revenir à la notion de besoins fondamentaux des enfants et d'expliquer aux parents qu'ils doivent trouver eux-mêmes la forme de réponse appropriée. M. le Président : Merci, docteur, pour cette intervention passionnante. Table ronde sur les mutations des modèles familiaux, réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Cette table ronde intervient au terme de la première partie de notre réflexion, mais chevauche déjà quelque peu la thématique des droits des enfants, et notamment de la protection de l'enfance en danger. Le premier de nos quatre invités, M. Gérard Neyrand, est sociologue, anime le Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherches en sciences sociales, et a à son actif de nombreux ouvrages et articles. Le docteur Aldo Naouri, pédiatre, n'est plus à présenter, car chacun ici a pu lire nombre de ses publications et interventions, parmi lesquelles je citerai son dernier ouvrage Les Pères et les Mères, qui a obtenu un grand succès de librairie. M. Jean-Marie Meyer, professeur de philosophie en classes préparatoires au lycée Stanislas à Paris, est membre, ainsi que son épouse, du Conseil pontifical pour la famille. Enfin, Mme Marcela Iacub, que la galanterie aurait dû me conduire à présenter en premier, est chargée de recherches au Centre national de la recherche scientifique, et a consacré maints articles et ouvrages aux sujets qui nous intéressent, dont le PACS ; son dernier livre, paru l'an dernier, s'intitule L'Empire du Ventre, pour une autre histoire de la maternité... Je dois enfin excuser l'absence de Mme Geneviève Delaisi de Perceval qui nous a fait connaître son indisponibilité et à qui je souhaite un prompt rétablissement. L'objet de cette table ronde est de confronter les différentes interprétations que l'on peut faire de l'évolution démographique et sociologique de la famille. Afin d'organiser le débat, elle sera centrée sur deux questions. La précarisation des unions traduit-elle un affaiblissement du modèle de la vie en couple ? Les transformations des relations entre parents et enfants traduisent-elles une démission des parents ou une sacralisation des enfants ? Je propose que nous entendions d'abord, sur chacune de ces deux questions, nos quatre invités, après quoi nous aurons un échange avec nos collègues qui sont, et je m'en réjouis, venus en grand nombre. M. Gérard Neyrand : La précarisation des unions traduit-elle un affaiblissement du modèle de la vie en couple ? Je réponds résolument non. J'y vois au contraire un indice de la survalorisation de la vie de couple. C'est parce que la conjugalité est dissociée de la logique patrimoniale et recentrée sur la vie affective, sur le lien amoureux, qu'elle est devenue plus fragile. La place de l'individu est de plus en plus définie par son capital culturel et scolaire, et de moins en moins par les biens matériels hérités de sa famille. Cette évolution, qui remonte à deux siècles, est allée de pair avec la laïcisation, l'industrialisation de la société, le développement de la scolarisation, la valorisation croissante de l'individu et l'affirmation du lien amoureux comme élément de la réalisation de soi - réalisation qui est le leitmotiv de la modernité -. La transmission du patrimoine ne garde son importance que pour certaines catégories sociales, comme la grande bourgeoisie ou les exploitants agricoles. L'ordre patriarcal antérieur est remis en cause par l'autonomisation des femmes, leur accès massif aux études, leur maîtrise nouvelle de la contraception et la reconnaissance de la personne de l'enfant. La désinstitutionalisation de la conjugalité se traduit notamment par le fait que neuf mariages sur dix sont précédés d'une union libre, que plus d'une naissance sur deux a lieu hors mariage, que la fréquence des divorces et des séparations s'accroît fortement. La tendance est davantage à l'individualisme relationnel, avec ce paradoxe que la réalisation de soi en tant que personne passe par un rapport privilégié avec l'autre, le conjoint surtout, mais aussi l'enfant, les deux pouvant d'ailleurs entrer en conflit. Le modèle de la vie en couple n'est pas affaibli, mais transformé. Avec l'affirmation du lien affectif dans la conjugalité, le rapport au conjoint devient plus exigeant, tandis que les limites à l'autonomie de l'individu perdent de leur importance. M. Aldo Naouri : Je suis quelque peu embarrassé par l'ordre des deux questions, car mes réponses à la première dépendent étroitement de celles que j'apporte à la seconde. Mais je m'accommoderai de cette contrainte... Mon point de vue ne sera pas seulement descriptif, mais dynamique, car il se nourrit de quarante ans de pratique, quarante ans durant lesquels j'ai reçu des couples et des enfants. Si la précarisation des unions peut s'expliquer par de nombreux facteurs, tous sont pour moi secondaires, malgré toute leur importance, par rapport à un facteur aussi essentiel que difficile à cerner : la sacralisation de l'enfant. Contrairement à Gérard Neyrand, je dirai que la précarisation des unions traduit bien l'affaiblissement du modèle de la vie en couple - je veux parler, bien sûr, du modèle traditionnel -. Mais faut-il s'arrêter aux faits ou aller rechercher le symptôme ? Pourquoi le modèle qui a si longtemps prévalu dans nos sociétés s'est-il affaibli à ce point, et en un temps aussi bref ? On peut l'expliquer par l'évolution sociale, par la libéralisation des mœurs, par l'exigence plus grande de l'individu vis-à-vis de ses désirs profonds. On ne se fait d'ailleurs pas faute, dans le droit fil d'une certaine philosophie, de se féliciter de la levée des inhibitions qui auraient jusqu'ici entravé la réalisation des individus. On aura compris que je ne partage pas entièrement ce point de vue, et, au nom de la souffrance que j'ai entendue, tant chez les partenaires qui se séparent que chez leurs enfants, je me permets de poser la question : est-ce un progrès ou une régression ? Baisse de la nuptialité, hausse des divorces, hausse du concubinage sont liés non seulement entre eux, mais aussi, et directement, à la sacralisation de l'enfant, à la fois dans sa réalisation et dans la signification qu'il revêt pour la conception que ses parents se font d'eux-mêmes. Le même Brassens qui chantait : « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin », chantait aussi : « Il n'y a pas d'amour heureux »... Pourquoi se marier, peut-on se demander, si c'est pour divorcer quelque temps plus tard ? Je serais tenté de voir dans le concubinage une certaine forme de paresse, une vision adolescente de l'amour, vision nécessaire quand elle surgit, précisément, à l'adolescence, pour quitter le domaine béni de l'enfance, mais qui témoigne, lorsqu'elle subsiste à l'âge adulte, d'un rapport non liquidé à cette enfance. C'est cette même vision qui est responsable de l'accroissement de la divortialité. Notre société de l'image, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous aliène. Nous ne pouvons pas admettre que l'amour puisse évoluer, au fil du temps, dans ses exigences comme dans son expression. Nous refusons que les scènes de ménage fassent partie de la vie à deux, que notre image s'écorne dans le regard de l'autre. Nous refusons de comprendre qu'il s'opère dans cette relation à deux un transfert réciproque dont chaque partenaire est le support, et qui est la seule voie dont nous disposons pour liquider le conflit avec nos parents, et en particulier avec notre mère. Je choque toujours beaucoup mes publics quand je leur dis : « que l'on soit homme ou femme, on n'épouse jamais que sa mère ! ». La vision adolescente de l'amour est liée à la sacralisation de l'enfant, et traduit un assujettissement formel, mais évidemment non conscient et donc immaîtrisable, de l'adulte à ses propres parents. Sur le plan symbolique, qu'est-ce que le mariage ? C'est, dans la tradition judéo-chrétienne comme dans toutes les sociétés, même les plus primitives qui n'avaient jamais vu un blanc jusque dans les années 50, un acte fondateur par lequel on prend à témoin l'environnement pour se définir, non plus comme l'enfant de ses parents, mais comme le partenaire de l'autre. Les concubins, en refusant ce rituel, demeurent quelque peu les enfants de leurs parents, tout comme les divorcés le redeviennent. Voyez avec quel empressement les grands-parents volent au secours de la génération intermédiaire en situation de concubinage ou de divorce... M. le Président : Vous avez, je le pense, contribué fortement à lancer le débat, mais rassurez-vous : rien ne choque plus un député d'aujourd'hui, même pas l'idée d'épouser sa mère... M. Jean-Marie Meyer : Je m'efforcerai de traiter séparément les deux questions posées, et je salue le fait que M. Neyrand ait employé d'emblée le mot « paradoxe », c'est-à-dire ce qui contraste avec l'opinion reçue. De fait, il est assez paradoxal d'observer que le lien amoureux est valorisé alors que la solitude subie ne cesse de croître. Il existe donc un écart entre le désir tel qu'il se dit et le désir tel qu'il se vit. Notre réflexion doit donc prendre en compte tant le désir que la souffrance qui l'accompagne. Un autre paradoxe doit aussi être pris en considération. Parler du couple c'est aussi parler de ce qui l'accompagne, que ce soit l'enfant ou la société. Le couple conçoit sa propre identité en lien avec les valeurs de la société. Qui plus est, un homme et une femme qui font l'expérience, comme couple, d'accueillir un enfant, savent que quelque chose a profondément changé dans leurs relations interpersonnelles. Dans le vécu du couple, ce n'est pas un simple ajout mais une transformation. Ma deuxième remarque a trait à la présence, dans une question portant sur la vie en couple, du mot modèle. On se demande trop peu quel type - quel modèle - d'unité un couple est susceptible de réaliser. S'agit-il d'une union au sens d'une fusion, faisant disparaître la singularité de chacun, telle que la décrit le mythe de l'androgyne dans le Banquet de Platon ? Il y a, dans la communion entre un homme et une femme, un dépassement de l'individu qui fait exister quelque chose de nouveau. J'y insiste car, à la différence des députés, il y a des choses qui me font peur. En pratique il convient de situer exactement la différence sexuelle, car l'homme et la femme possèdent une commune dignité, mais possèdent chacun un rôle distinct comme père et mère. Sur le plan de la citoyenneté on parlera donc de parité, mais dans la vie familiale on assumera, on respectera la différence entre homme et femme, entre père et mère. J'insisterai donc sur ceci : quand un homme et une femme ont un projet stable de vie en commun, il s'agit sans doute pour chacun d'un désir de réalisation de soi, mais, à deux, ils peuvent fonder une famille. Ce dernier enjeu possède des projections morales touchant au bien commun de la société. Cette volonté de fonder une famille est donc une réalité originale qu'il faut valoriser. Elle articule en elle, non sans tensions, les dynamismes corporels, les désirs individuels et la volonté partagée. L'enfant est inscrit dans ce projet au point de pouvoir en devenir le « symbole » et la réalisation. Souvent, aujourd'hui, lorsqu'on réfléchit sur les aléas de la vie amoureuse, on baptise « liberté individuelle » ce qui n'est bien souvent qu'une impuissance partagée. Il ne s'agit pas de récuser le légitime désir d'épanouissement de chacun ; la vraie question est, en revanche, de savoir comment on définit le sens de la liberté, individuellement et collectivement. Une dernière remarque : ne serait-il pas important de revaloriser aux yeux des parents eux-mêmes, c'est-à-dire des amoureux qui éduquent ensemble leurs enfants, le rôle des parents ? Je suis frappé de les voir venir s'adresser au professeur en croyant qu'ils viennent voir un spécialiste, sans se considérer eux-mêmes habilités à parler en tant que parents. Il est important qu'ils reprennent conscience de l'originalité et de la fonction éducative de leur parole. Ils s'aiment et ils transmettent la vie. C'est là une bonne nouvelle que les enfants doivent entendre de la bouche même de leurs parents. M. le Président : Ce n'est pas que les députés n'aient peur de rien, mais qu'ils puissent tout entendre. Chacun de nous tremble évidemment à l'approche d'élections législatives : nous sommes bien des êtres humains... Mme Marcela Iacub : Je suis d'accord avec le diagnostic de Gérard Neyrand : je crois que la précarisation des unions signifie non pas l'affaiblissement du couple, mais l'apparition d'un nouveau modèle de couple. J'ai le sentiment que l'on cherche, comme dans tant d'autres domaines, un projet qui permette de se réorienter en permanence. D'un côté notre société connaît un taux de divortialité accru, et de l'autre l'impression prévaut, tant chez les pouvoirs publics que chez les individus eux-mêmes, que la séparation ou le divorce sont des échecs personnels. Ils devraient plutôt être envisagés comme des expériences liées à notre liberté, qui, comme toute expérience de liberté, peuvent impliquer des souffrances, des désirs obscurs, mais permettent à la fois de nous comprendre et de comprendre les autres. La liberté a un prix qu'il faut être prêt à payer. En tant que parlementaires, vous devez veiller à garantir la liberté des personnes plutôt que de vous intéresser à leur souffrance. En tant que citoyenne, je préfère que l'État propose un cadre préservant la liberté de chacun et s'intéresse moins à ma souffrance. Il y a d'autres espaces pour gérer la souffrance : les églises, les psys, le théâtre, la littérature... J'ai l'impression que le couple, malheureusement, n'est pas encore une école de l'égalité. On n'a pas fini de lever tous les obstacles à la séparation. Il faudrait créer un droit au divorce, unilatéral le cas échéant, tout en veillant à régler les conséquences de ce droit. Il existe encore une hiérarchie des unions : tant que les homosexuels, par exemple, ne pourront pas se marier, un problème d'égalité se posera. Et même entre époux, le système de la prestation compensatoire est trop protecteur des femmes : même s'il peut apparaître comme équitable, il ne contribue pas à ce que les femmes se pensent dès leur jeunesse comme un sujet autonome, y compris économiquement. Je crois qu'il s'agit d'un faux avantage qui, sur le long terme, pénalise les femmes. Enfin, je voudrais dire quelques mots de la proposition de loi relative aux violences conjugales. Il est gravissime, à mon sens, d'y introduire la notion de violence psychologique et d'intervenir ainsi dans la souffrance des personnes pour fonder des droits. Il faut naturellement protéger chacun contre la violence physique, mais il est très dangereux que l'État fasse irruption dans des conflits banals au sein du couple et leur donne une qualification pénale. M. le Président : Merci à tous quatre d'avoir lancé le débat. Je propose que mes collègues vous posent maintenant une première série de questions. Mme Martine Aurillac : Si cela peut rassurer Mme Iacub, nous avons adopté une réforme du divorce qui vise à apaiser celui-ci, sinon à le faciliter, et qui vise surtout à garantir les droits des enfants. Je voudrais que M. Naouri développe davantage son propos sur l'assujettissement permanent des adultes à leurs parents. Je comprends ce qu'il veut dire dans le cas des divorcés, mais beaucoup moins dans celui des concubins. Il y a aussi des gens mariés qui ne sont pas très adultes. Je partage la position de M. Meyer sur la nécessité de revaloriser la parole des parents. Les médecins, les spécialistes peuvent certes donner des conseils, mais il est important que les parents disent à leurs enfants qu'en toute hypothèse ils les aiment et s'occuperont d'eux. Je souhaite cependant que M. Meyer explicite un peu plus ce qu'il entend par « impuissance partagée ». M. Patrick Delnatte : Pour ma part, je demanderai à M. Meyer quel peut être, selon lui, le rôle de l'État dans la revalorisation de la parole des parents. Quant au propos de Mme Iacub selon lequel l'État ne doit pas s'occuper de la souffrance, il me laisse un peu perplexe. L'État est un régulateur, un protecteur, et le monde qui nous est proposé par Mme Iacub me semble un monde terriblement dur, ultra-libéral. J'ai beaucoup de mal à entrer dans cette logique. Mme Henriette Martinez : Je voudrais avoir vos avis sur la question suivante : tous les couples sont-ils capables d'élever un enfant ? La parentalité crée-t-elle chez eux cette faculté ? Mme la Rapporteure : J'ai une question à laquelle Mme Iacub a déjà un peu répondu : le législateur, qui a rendu plus pacifique et plus facile le divorce, doit-il intervenir pour aider les couples à rester ensemble quand ils se déchirent ? La médiation familiale, par exemple, est une piste souvent évoquée mais peu exploitée. Le couple est-il un facteur de stabilité ? Le fait qu'il soit fondé sur l'affection lui donne-t-il un rôle social en tant que tel ? Mme Christine Boutin : Je voudrais que M. Naouri nous précise davantage en quoi, selon lui, le concubinage est lié à la sacralisation de l'enfant. À M. Meyer, je demanderai, ainsi d'ailleurs qu'à nos autres invités, si le couple et la famille sont liés, selon eux, à la présence d'enfants. M. Pierre-Louis Fagniez : Ma question se situe dans le prolongement de ce que vient de dire Mme la Rapporteure sur le divorce qui est vécu généralement comme un échec et que Mme Iacub voudrait nous faire vivre comme une expérience. Pouvons-nous, en tant que députés, suivre Mme Iacub et favoriser une expérience qui consisterait à ne pas chercher à maintenir le couple coûte que coûte ? J'aimerais avoir le sentiment de chacun de vous sur le divorce comme échec et comme expérience. M. Alain Vidalies : L'idée que le législateur ne doit pas se mêler de ce qui ne le regarde pas, qu'il n'est pas là pour sauver les couples, correspond exactement à ce que nous avons fait en votant la réforme du divorce : nous avons pris acte de la situation. L'accélération de la procédure n'est pas faite pour apaiser le couple, mais pour apaiser le divorce. Le rôle du législateur n'est pas d'ignorer la souffrance, mais d'organiser les procédures de façon à ne pas aggraver cette souffrance. Ce qu'a dit Mme Iacub sur la prestation compensatoire est intéressant, mais cela ne concerne que 8 % des divorces. Lorsque des travailleurs pauvres divorcent, il n'y a pas de prestation compensatoire, parce qu'il n'y a personne pour la payer ! L'approche de M. Neyrand est très intéressante : elle fournit le cadre au débat, en rappelant qu'il n'y a pas de crise du couple, mais une sortie des modèles anciens. Toutefois, lorsqu'il dit qu'autrefois la logique du mariage était patrimoniale, est-ce, historiquement parlant, si vrai que cela ? Autrefois, le conjoint était précisément écarté de l'ordre successoral, fondé sur les seuls liens du sang, et n'était là que pour faire les enfants. M. Pierre-Christophe Baguet : Mme Iacub a dit que le couple n'était pas une école d'égalité, tandis que M. Neyrand a évoqué l'individualisme relationnel. Pour lui, l'égalité au sein du couple est-elle une finalité ? M. le Président : J'ajouterai une question personnelle. Y a-t-il, comme certains le font croire, sous couvert de droits des individus, un individualisme croissant qui ferait perdre le sens de l'intérêt général ? Comme on a parlé tout à l'heure d'une société de l'image, je me demande si l'individualisation n'est pas liée à l'infantilisation de la société, notamment par tous ceux qui sont chargés, justement, de la représenter à l'image et qui ont tant d'influence sur nous. M. Gérard Neyrand : Le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne sont pas simples... Je suis d'accord avec Aldo Naouri sur le fait que l'on assiste au déclin d'un certain modèle de couple, qui correspond à l'institution traditionnelle du mariage, avec une fonction patrimoniale liée à une logique patriarcale. En conséquence, c'est de moins en moins l'institution du mariage, et de plus en plus l'enfant, qui fonde la famille. Il y a des gens qui vivent en couple sans former une famille, et c'est à partir du moment où il y a un projet d'enfant qu'il y a famille. Et ce n'est plus forcément inclus dans le contrat de couple comme autrefois. On est donc bien passé à un autre mode de fonctionnement. Le concubinage exprime-t-il une vision adolescente de l'amour ? On peut en discuter, mais prenons garde à ne pas tomber dans le psychologisme qui consisterait à expliquer par la psychologie ce qui relève de déterminismes historiques ou sociaux. Le concubinage était très fréquent au XVIIIème siècle, et le mariage était davantage présent dans les milieux bourgeois pour des raisons bien précises. C'est aller un peu vite que de relier un type de fonctionnement psychique à des choix de vie insérés dans un fonctionnement social, idéologique et politique. M. Aldo Naouri : Certes, mais il reste à savoir pourquoi on adhère à une option plutôt qu'à une autre. Il ne faut pas exclure la dimension psychologique. M. Gérard Neyrand : Il ne faut pas l'exclure, mais c'est une dimension parmi d'autres. Il y a une difficulté à légiférer à partir de paradoxes, car on risque d'aller trop loin dans un sens ou dans un autre. À l'heure actuelle, il y a une confrontation entre différents modèles sociaux de vie, tandis qu'auparavant il y avait un modèle dominant et des modèles périphériques. Il y a une complexification croissante des modèles conjugaux et familiaux, et donc une difficulté croissante à légiférer. M. Aldo Naouri : Le mot assujettissement m'est venu en analysant l'extraordinaire force de l'idéologie amoureuse adolescente, telle que je l'ai constatée dans mon travail. Lorsqu'un père dit de la mère de ses enfants : « Je ne l'aime plus », cela signifie : « Je ne l'aime plus comme je l'aimais quand nous nous sommes rencontrés ». C'est exactement ce que peut dire un adolescent. La modification psychologique de la relation amoureuse n'est plus pensée, ni admise. L'amour est censé n'évoluer que sur la plus haute marche. Les adolescents, lorsqu'ils éprouvent la nécessité de la passion amoureuse, le font pour s'affranchir du lien avec leurs parents. Or il me semble que cette nécessité persiste à l'âge adulte. Ce poids des parents sur leurs enfants a toujours existé, mais le rituel du mariage était justement là pour les en affranchir. On proposait aux individus de créer un transfert interactif pour liquider des processus inconscients. Ce transfert permettait aux générations suivantes de progresser. Ce n'est plus possible aujourd'hui, et il n'est pas question de revenir en arrière : nous sommes jaloux de nos libertés, de ce que nous pensons être nos désirs, sans voir que nous sommes conduits par des forces plus puissantes. Lors d'une formation de pédiatres consacrée à la relation au patient, mes confrères et moi avons demandé aux stagiaires, en fin de session, de nous poser leurs questions par écrit. Ils ont été 138, sur 150, à poser la même question, formulée de la même manière : « Faut-il tuer les grand-mères ? » Cette question montre qu'il y avait assujettissement de la génération dont nous soignions les enfants à la génération précédente. Quand je parle de société de l'image, je veux dire que cet attachement à notre image, qui est un processus narcissique de constitution de la personnalité, est quelque chose dont nous ne pouvons plus faire le deuil. Je suis tout à fait d'accord avec Marcela Iacub pour dire que, si la souffrance est le prix de la liberté, elle est l'affaire de chacun, et que l'État n'a pas à intervenir. Je suis même ravi de l'avoir entendue le dire, car assumer cette souffrance est une manière de devenir adulte. Tous les couples sont-ils capables d'élever des enfants ? Ma réponse est oui. On ne peut dénier à aucun couple le droit de faire des enfants, et notre société permet justement à ceux qui sont dans la difficulté de trouver de l'aide. Cela n'empêche pas qu'élever un enfant est extrêmement difficile, aujourd'hui plus qu'hier. Devons-nous intervenir pour préserver le couple ? Je puis témoigner que la médiation familiale est quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois que j'ai orienté des gens vers une médiation, l'effet a été très positif. Nous sommes si obnubilés par l'autonomie de nos choix, par la pertinence de ce que nous ressentons, que nous avons du mal à concevoir qu'il y ait en nous-mêmes une part que l'on puisse questionner. Dans un couple, il y a deux individus, il n'y a pas un bourreau et une victime, mais deux victimes d'histoires respectives qui cherchent chacune à défendre sa part. Il y a une pathologie de la relation, et la thérapie familiale ou de couple est un traitement pointu que l'on a inventé pour cette pathologie, en posant comme préalable non pas que le couple qui souffre doit tenir à tout prix, mais qu'il doit apaiser son mal, que les conjoints restent ensemble ou qu'ils se séparent. La médiation est à la portée de tout le monde, et fait beaucoup moins peur que les techniques « psy »... M. Gérard Neyrand : Je partage tout à fait votre position sur les deux derniers points, la capacité parentale des couples et la médiation familiale, et je constate que notre degré d'accord croît... M. le Président : Nous sommes heureux d'avoir pu y contribuer... M. Jean-Marie Meyer : J'ai dit que l'on baptisait parfois liberté individuelle ce qui est en fait une impuissance partagée. Dans le cas d'une médiation, quand il y a deux libertés individuelles paralysées, il faut libérer la liberté individuelle pour que chacun puisse assumer ses choix. Je veux revenir aussi sur le sentiment de la liberté individuelle, d'une façon qui sera peut-être évocatrice pour les parents qui sont ici. Certains de mes élèves me disent : « Je ne ferai pas comme mes parents », et sans doute leurs parents tenaient-ils le même discours dans leur enfance. Le sentiment de liberté individuelle est donc très dépendant de la relation à autrui, selon le paradoxe célèbre qui veut qu'on se pose en s'opposant. Ce besoin de s'opposer est tout à fait légitime, car la liberté nécessite d'être éduquée. Mais le discours que tiennent mes élèves peut aussi révéler un phénomène de société où tout bougerait sans que rien ne change. Attention, donc, lorsque l'on parle de nouveauté, car l'on peut être pris dans l'illusion de mouvements radicaux, alors qu'il y a une forme de tradition dans la difficulté. M. Aldo Naouri : C'est la différence entre répétition et reproduction. Chacun est mû par sa propre histoire, et a tendance à la répéter. Mais on passe de la répétition mortifère à la reproduction vivifiante lorsque, pour le bénéfice de l'autre, chacun renonce à répéter. M. Jean-Marie Meyer : Quant aux parents que nous recevons, ils nous disent souvent : « Nous avons du mal à transmettre, à aider nos enfants ». Ils nous appellent à les aider à assumer leur responsabilité. Et je comprends leur blessure lorsque l'enfant s'écrie triomphalement : « Tout commence », tandis qu'eux-mêmes se désespèrent de ne pouvoir leur transmettre leur capital de sagesse. Quel doit être le rôle du législateur ? Sachant que l'échec amoureux n'est jamais voulu mais toujours subi, que faire pour aider les gens sans se substituer à leur liberté ? Il est important de maintenir la dualité entre politique sociale et politique familiale. J'espère ne choquer personne en disant que les représentants du peuple doivent s'autolimiter, reconnaître que la conjugalité, la famille, l'amour humain sont antérieurs au champ politique. Le maire qui célèbre un mariage ne le doit pas d'abord aux personnes qui l'ont élu, il le doit avant tout à ses parents de qui il a reçu la vie. Nous ne sommes pas autocréateurs, et nous devons ne pas oublier que la transmission ne se limite pas à celle dont nous sommes les principes. Nous sommes des êtres biologiques, liés à la vie et à la mort, et il est important que cette dimension apparaisse dans la façon dont l'État parle de la famille. Tous les couples sont-ils capables d'élever des enfants ? Les philosophes se sont penchés de très longue date sur cette question. Platon a considéré qu'il valait mieux que l'État se substitue à certains parents, et, lorsqu'on lit certains de ses écrits, on ne peut s'empêcher de penser, de ce point de vue, à une société totalitaire. Le mieux est parfois l'ennemi du bien, et j'en appelle à la modestie du politique. Sans nier la part de souffrance de chacun, il faut aussi respecter sa liberté. M. le Président : Madame Iacub, peut-être vos réponses nous permettront-elles d'aborder la deuxième question ? Mme Marcela Iacub : J'ai l'impression que la souffrance psychique est devenue, depuis quelques années, une obsession. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi il est question. Des disciplines comme la psychologie ou la psychanalyse sont des pratiques culturelles tout à fait valables, mais ce n'est pas à l'État de jouer le rôle du grand psychothérapeute. On risquerait de revenir aux fonctions de l'État pendant l'Ancien Régime où il assumait une fonction ecclésiale. La souffrance psychique étant incommensurable, comment la mesurer sans arbitraire ? On entre là dans le « psycho-pouvoir ». La loi sur le harcèlement moral est quelque chose d'extravagant, qui va jusqu'à créer un lien de cause à effet entre des paroles ou des regards malveillants et des maux corporels, alors qu'on ne sait presque rien des phénomènes psychosomatiques. Il faut faire très attention à cette pénalisation de la souffrance psychique. La souffrance amoureuse est la plus dure que l'on puisse vivre dans sa vie, mais l'État n'a pas à y intervenir. Je persiste, pour ma part, à considérer la souffrance comme une expérience. Quant à l'idée que le concubinage serait infantilisant... M. Aldo Naouri : Je n'ai jamais dit cela ! Je considère simplement que, si autonomes et si jaloux de notre liberté que nous soyons, nous sommes le produit d'une histoire, dans laquelle le poids de nos parents peut être plus ou moins lourd. Or j'ai observé que, depuis quelques générations, les individus ont de plus en plus de mal à quitter leur histoire et à devenir autonomes. Cette infantilisation se traduit par la progression du concubinage qui consiste à ne pas quitter sa famille d'origine. Je n'ai pas dit que le concubinage était infantilisant, ce qui serait stigmatisant, mais qu'il est la traduction d'un processus en profondeur, qui dure depuis plusieurs générations, qui concerne aussi les couples mariés, et qui intervient peut-être aussi dans la progression du nombre des divorces, ou de celui des gens qui vivent toujours chez leurs parents à trente ou trente-cinq ans. Mme Marcela Iacub : J'ai l'impression que les positions de M. Naouri pourraient conduire à interdire de nouveau le divorce, mais ce débat nous entraînerait trop loin... M. Aldo Naouri : Je n'ai jamais dit cela ! Mme Marcela Iacub : Je réponds maintenant, comme le Président m'y a invitée, à la deuxième question. La transformation de la relation entre parents et enfants n'est ni une sacralisation, ni une démission. La question se pose depuis plus d'un siècle au moins, depuis la fin du modèle napoléonien. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la place impossible qui est faite aux hommes, aux pères. On nous a dit que la libération des mœurs conduisait à l'égalité homme/femme, mais, aujourd'hui, c'est la femme et elle seule qui décide d'avoir ou non un enfant, l'homme n'ayant pas son mot à dire. Pour la plupart, les enfants de divorcés restent avec leur mère. On demande aux hommes de s'engager, mais ils ne jouent auprès de leurs enfants que le rôle de baby-sitter ou de tiers payeur. Je préconise l'institution du géniteur sous X, appelé à donner ou à ne pas donner son consentement dès le début de la grossesse. Les hommes devraient pouvoir choisir de devenir pères et il faudrait, lorsqu'ils le choisissent, leur donner la place qui leur revient. Il faudrait aussi une socialisation plus grande de l'éducation des enfants, un plus grand nombre de crèches, une indifférenciation des rôles du père et de la mère, dont le nom même devrait faire place à celui de « parent ». S'agissant des enfants, il faut les protéger davantage contre la violence, et ce d'autant plus qu'on observe, depuis les années 70, une tendance à privilégier le lien biologique par rapport au lien adoptif. On devrait, lorsqu'il y a maltraitance, rompre plus tôt le lien biologique, pour permettre à l'enfant de refaire sa vie dans une famille où il ait un véritable avenir. Il faut reconsidérer l'importance du lien biologique et privilégier le lien volontaire, en banalisant l'adoption. Il y a une tendance fâcheuse à considérer les enfants adoptés comme des handicapés sociaux et les parents adoptifs comme des malheureux. Peut-être faudrait-il en revenir au droit romain où l'adoption était considérée comme une filiation plus noble que la filiation par le sang. Tout le monde peut-il avoir des enfants ? Je ne crois pas qu'il faille l'interdire a priori. Il faudrait même donner aux parents du même sexe un accès à l'assistance médicale à la procréation et relever l'âge maximal auquel les femmes peuvent recourir à ces techniques. Il faudrait également légaliser les mères porteuses. En revanche, il faut avoir une attitude beaucoup plus stricte a posteriori face aux cas de maltraitance. M. Gérard Neyrand : La montée du concubinage depuis les années 70 est liée aux facteurs dont a parlé Aldo Naouri, mais également au mouvement d'émancipation des femmes, à la démocratisation de la vie privée et à l'autodétermination croissante des choix de vie des individus. Parallèlement, on a assisté à un renversement des valeurs et des représentations de l'union et de la parentalité. La perception du sens du mariage en tant qu'institution a également évolué. Cette évolution peut d'ailleurs expliquer le relatif regain du mariage observé depuis quelques années. En effet, si l'on avait continué à considérer le mariage de la même façon, le nombre de mariages aurait continué à baisser. Il est un peu étrange, pardonnez-moi, d'opposer démission et sacralisation qui relèvent toutes deux d'une valorisation exacerbée du lien avec l'enfant. L'investissement parental reste très élevé chez une grande majorité des parents, et parler de démission serait inadéquat. Tous les parents, par définition, sont en difficulté, mais le mot démission sous-entend qu'ils auraient failli dans leur mission de transmission des normes de vie en collectivité. L'idée de responsabilité des parents dans l'échec de leurs enfants correspond au processus de nucléarisation des familles que l'on connaît depuis le XVIIIème siècle. Cependant, la rapidité et l'ampleur de la transformation des normes et des conditions de vie n'ont pu que créer des décalages, des hésitations, des interrogations sur le contenu de l'éducation. Les parents ne souffrent pas d'un manque de repères, mais au contraire d'une profusion de repères contradictoires, parfois trop difficiles à investir. Ce qui caractérise notre époque, c'est la diversification des repères. La dimension répressive de l'autorité du chef de famille a été remplacée par un modèle plus « relationnel », fondé sur la coparentalité, c'est-à-dire sur l'égalité entre les parents. Ce modèle est promu par les classes moyennes les plus cultivées, mais sa diffusion n'est pas homogène dans tous les milieux. Dans les familles les plus précaires ou d'origine étrangère, les conflits de références peuvent entraîner un désarroi des parents, dont beaucoup s'en remettent à l'école pour inculquer les normes sociales à leurs enfants. C'est peut-être ce qui pousse certains à parler de démission. Pour moi, il n'y a pas démission, mais désorientation. Affirmer l'enfant comme sujet dès son plus jeune âge, dire comme Françoise Dolto que « le bébé est une personne », a pu mettre certains parents en difficulté au moment d'endosser ce nouveau modèle familial. Ces difficultés renforcent la nécessité de poursuivre l'effort de soutien et d'accompagnement des parents, ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire le travail à leur place. Y a-t-il sacralisation de l'enfant ? Le terme mérite réflexion. Il est vrai qu'il y a une survalorisation de l'enfant, produite par les spécialistes de son développement, dans un contexte d'inquiétude sociale sur la « bonne » parentalité. Certains de ces discours très médiatisés participent d'une vision angélique de l'enfance, et oublient les acquis de la psychanalyse et de la psychologie sur la vie affective et la sexualité enfantine. Pour reprendre l'expression de Laurence Gavarini, ces discours traduisent une « passion de l'enfant » dont les excès montrent que l'inquiétude sociale s'est reportée sur la situation de l'enfant. L'enfant devient l'enjeu de la gestion sociale, et notamment législative, tandis que les adultes sont renvoyés à leur libre choix de vie. Cet enfant survalorisé et idéalisé devient le support de l'expressivité parentale. Ainsi, l'enfant vit chez ses parents plus longtemps ; parallèlement, le nombre d'enfants souhaités décroît et l'importance accordée à chacun d'entre eux augmente. L'enfant est de plus en plus une affaire personnelle, l'affaire du couple, au détriment de son inscription dans les lignées antérieures, comme dans le lien social. Cette évolution a une conséquence paradoxale : dans certaines situations, l'enfant devient un objet d'investissement privilégié qui fait concurrence à l'autre parent. Conjuguée à la difficulté d'accepter la démocratisation de la vie de couple, cette concurrence peut alimenter la séparation conjugale et les conflits sur la garde de l'enfant. D'où l'intérêt de la médiation familiale chez les couples qui se séparent parce qu'ils ne maîtrisent pas les enjeux psychiques et sociaux du rapport à l'enfant et du rapport à l'autre conjoint. Les hommes sont peut-être, comme l'a dit Marcela Iacub, le point faible de ce mode de fonctionnement, et la tentation du « monoparentalisme », dans ce contexte, reste forte en cas de séparation. Le primat que la société a longtemps accordé à la mère dans la relation concrète à l'enfant, le surinvestissement dans l'enfant, le climat passionnel dont il fait l'objet sont autant d'obstacles à une coparentalité assumée et à une gestion sereine des enfants après la séparation, comme le montre la difficulté de mettre en œuvre la résidence alternée. M. Jean-Marie Meyer : Gérard Neyrand a mis en évidence la difficulté d'éduquer de façon sereine des individus qui ont du mal à trouver leur place à l'école. Il existe une autre explication, plus rarement proposée : si les parents ont du mal à transmettre, c'est parce que l'enfant est plus souvent seul. Or ici l'école n'est pas en cause ; le mot « fraternité », troisième terme de la devise républicaine, risque de devenir une métaphore vide de sens, si sa signification n'est pas d'abord découverte et vécue en famille, c'est-à-dire si les parents ne sont pas les premiers éducateurs à la citoyenneté par le biais de la fraternité. Le fait qu'on ne choisit pas son frère est une richesse qui invite à une forme de générosité de grande portée sociale. Quand je demandais, il y a quinze ans, à mes élèves de terminale, quels enfants ils voudraient, quatre sur cinq me répondaient : « un garçon en premier », et encore la moitié : « un autre garçon en deuxième ». Prenons garde au pouvoir que nous avons sur la nature, à la menace d'un eugénisme qui, pour être dit « libéral », n'en reste pas moins un eugénisme. Certaines expériences historiques, celle de la Chine en particulier, font penser qu'il s'agit là de dangers bien réels. Trop souvent prévaut l'idée selon laquelle l'enfant est d'abord celui que nous produisons et non celui que nous accueillons. Si la place faite aux hommes pose à certains des problèmes, elle ne me gêne pas. Pourquoi ? Parce que j'ai admiré ma femme lorsqu'elle portait nos enfants. L'expérience amoureuse est celle du manque. Si donc l'homme ne peut pas porter l'enfant, il peut s'émerveiller devant le ventre qui s'arrondit. Il y a là un message, une expérience qui transforme la vie. Il revient à l'homme - rôle à la fois merveilleux et difficile - de porter la femme, c'est-à-dire de porter psychologiquement, affectivement, celle qui porte l'enfant. Dans ce contexte, être attentif à la fatigue de l'autre fait de l'autre l'éducateur de mon propre désir. L'enfant est, sous l'angle psychologique, éthique même, l'éducateur de ses parents. Les parents se demandent : comment allons-nous faire ? Et la réponse c'est l'enfant lui-même qui l'apporte. Telle est, là encore, la richesse anthropologique des relations familiales. Le législateur doit prendre conscience que la vie est plus riche que les considérations générales, fussent-elles bien intentionnées. Dans l'éducation de l'enfant, il n'y a pas de juxtaposition du masculin et du féminin. Il y a une différence entre la main du père et celle de la mère, entre le corps du père et celui de la mère, mais chaque fois que l'un des parents éduque, il éduque au nom des deux. Les deux gestes éducatifs ont chacun leur originalité, mais on éduque à deux. Cependant, l'enfant, aujourd'hui comme hier, même s'il a du mal à le dire, a peur de perdre son papa ou sa maman, et il est important de prendre en compte cette potentialité de souffrance. M. Aldo Naouri : Je suis un peu embarrassé pour répondre, aussi commencerai-je par raconter l'histoire du maharadjah qui demande à des aveugles de naissance à quoi ressemble un éléphant. Celui qui a touché une patte répond : « à une colonne », celui qui a touché une oreille : « à un chou », celui qui a touché la trompe : « à un serpent ». Chacun voit midi à sa porte... Ma vision de l'enfant n'est peut-être pas aussi distanciée que la vôtre, car je l'aborde avec ma propre pratique de médecin. L'enfant est un jalon dans une longue histoire qui commence bien avant sa naissance, et les neuf mois qu'il passe dans le ventre de sa mère ne sont pas une aventure anodine : ils laissent en lui une trace indélébile. L'enfant naît au monde avec un alphabet sensoriel élémentaire qui lui vient du corps de sa mère. Celle-ci est pour lui un être privilégié, au point qu'il la reconnaît sur photo - l'expérience a été faite - à huit heures de vie ! L'aventure se poursuit en accumulant une expérience considérable, une masse d'énergie phénoménale. Le moteur de cette aventure est le plaisir que l'enfant trouve exclusivement dans la relation avec sa mère. Mme Iacub a plaidé pour une paternité volontaire, mais il n'y a aucun lien biologique entre le père et son enfant : ce qui fait le père, justement, c'est le seul fait que la mère le désigne comme tel à son enfant. Si elle ne le fait pas, c'est fichu pour lui ! À quoi sert le père ? À pas grand-chose pour les 790 000 enfants qui vivaient avec leur mère seule en 1979 - ils sont plus de deux millions en 2001 -, et dont l'avenir n'a pas été compromis pour autant, car beaucoup d'institutions sont là pour leur apporter un minimum de fonction paternelle, c'est-à-dire de différenciation par rapport à la mère. Cette différenciation permet de faire face à la propension qu'ont les parents à séduire leur enfant, à ne rien lui refuser. L'éducation ayant pour moteur principal la frustration, cette propension est « anti-éducative ». Sans expérience de la frustration, les enfants auront le sentiment que tout leur est dû, qu'ils ont des droits et pas de devoirs, et que leur frère est haïssable entre tous, puisqu'il vient leur chiper une part de leurs droits. Nous allons certes produire des individus, mais la question du lien sociétal entre ces individus reste entière. Nous voyons se répandre une épidémie d'enfants-tyrans, tandis que s'en annonce une autre, venue d'Outre-atlantique, celle des enfants hyperactifs. Il faut être deux pour passer de la répétition à la reproduction, c'est-à-dire à la créativité. Mais il ne suffit pas de le décider : encore faut-il que les deux soient autorisés à user de leur capacité à produire des effets sur l'enfant. S'agissant des mères, l'expérience de la grossesse est si riche qu'elles ont une propension à tisser autour de leur enfant un utérus virtuel extensible à l'infini, dont il ne sortira pas. D'un point de vue social, le résultat risque fort d'être contre-productif. Quant au père, dans la mesure où, justement, il exerce son « droit » à prendre la femme qui est la mère de l'enfant, il crée chez celui-ci, par ce simple fait, la première et principale frustration. Par cette frustration, l'enfant, en grandissant, pourra relativiser la toute puissance de sa mère et s'en libérer quelque peu, c'est-à-dire à devenir autonome. Pour que le père remplisse cette fonction, il lui faut le soutien de la société. En décidant d'instaurer, et je m'en félicite, la démocratie dans le couple, nous tombons dans une aporie : comment faire fonctionner une démocratie à deux individus, dégager une majorité en cas de dissension ? S'il y a dissension, s'il y a séparation, l'attachement de l'enfant à sa mère, si biologiquement marqué, permet à celle-ci de se passer de partenaire et de vivre avec son enfant une relation sur un mode satisfaisant pour les deux. Dans nos sociétés, le père n'a pas du tout la même relation à son enfant que celle qu'il développe ailleurs : les enfants sont, pour le père africain, le fondement de son prestige, et en droit arabo-musulman, le père est « propriétaire » de ses enfants. Aujourd'hui, l'union de l'homme et de la femme ressemble un peu à celle de la carpe et du lapin. L'État a favorisé cette mutation. En 1945, pour repeupler le pays, on a institué une spécialité de pédiatrie et créé la protection maternelle et infantile. Celle-ci aurait pu s'appeler tout simplement « familiale », comme les allocations du même nom. Par ce choix lexical, l'État a fait comme s'il se substituait au père en l'éjectant de sa fonction, et la loi de 1972, en supprimant la disposition selon laquelle le choix de la résidence de l'enfant appartient au père, a consacré définitivement cette démocratisation. Naturellement, il n'est absolument pas question de revenir en arrière, de rétablir de l'inégalité. J'insiste sur le fait qu'il faut absolument poursuivre l'achèvement du statut des femmes. Mais le fait est que, pour quelques générations encore, l'homme et la femme vont avoir à chercher leur place respective, leur association dans le devenir des enfants. Et, pendant ce temps-là, il faut préserver les enfants et le tissu social. Comme l'insuline pour les diabétiques, il faut trouver les ingrédients qui produisent chez l'enfant le petit morceau de frustration qui lui manque de plus en plus. La seule chose que j'aie jamais proposée en tant que pédiatre, c'est la mise en place d'une certaine forme de rigueur dans le nourrissage. Tous ces éléments sont liés à la sacralisation de l'enfant qui n'est pas survenue par hasard. L'enfant est la valeur refuge sur laquelle nous fondons nos espoirs, et il est fort dommage que l'on sacralise une idole au point de ne pouvoir la soigner pour qu'elle aille le plus loin possible. Mme la Rapporteure : Quel est votre avis sur la résidence alternée, votée sous la précédente législature ? Nous voulons aider les pères à exercer leur rôle, sans pour autant les mettre dans des situations trop complexes. M. Aldo Naouri : C'est une excellente mesure, à ceci près qu'elle est allée jusqu'à produire des décisions ineptes, notamment pour des enfants de deux mois. Il y a un âge, en effet, où l'enfant tire beaucoup plus de bénéfice de la fréquentation de sa mère. Il faut attendre que se mettent en place ses repères temporels et spatiaux. Mme la Rapporteure : Et que répondez-vous à ceux qui vous disent que si l'enfant ne voit plus son père pendant ses deux ou trois premières années, il ne retissera plus jamais les liens avec lui ? M. Aldo Naouri : Cette objection n'a aucun sens, car ce lien, qu'il y ait ou non présence du père, met un temps fou à s'établir. Le père est très longtemps perçu comme un substitut de la mère, au même titre que la nounou ou que les dames de la crèche. Ce discours est très mal reçu par les associations de pères, mais c'est comme ça. Après, le temps se rattrape très vite. M. Gérard Neyrand : J'ai fait, il y a dix ans, une recherche sur la garde des enfants qui a eu un certain écho. La question est complexe et il serait difficile de remettre en cause le principe de la résidence alternée. Alors que des enfants peuvent être très bien éduqués dans les situations les plus diverses, la vie monoparentale s'accompagne de nombreuses difficultés, moins liées à la volonté de la mère d'élever seule son enfant qu'aux conséquences d'une séparation difficile. Il est donc nécessaire d'apaiser la séparation et de favoriser la coparentalité. Une des questions les plus délicates est celle de l'âge de l'enfant. Il est vrai que la résidence alternée peut être difficile à vivre par un enfant de deux mois, mais on peut aussi se demander pourquoi des parents se séparent alors qu'ils ont un enfant si petit... Lorsque l'enfant a deux ou trois ans, je ne suis pas sûr que l'on puisse prendre une position tranchée. Plusieurs pédopsychiatres ont remis en cause le schéma traditionnel d'Aldo Naouri. Il y a, depuis les années 70, des pratiques familiales très diverses dont on n'a pas observé qu'elles créent chez les enfants de troubles psychiques particuliers, ou en tout cas supérieurs à ceux d'enfants élevés dans des conditions plus « classiques ». Instaurer un âge minimum serait illogique, tant les situations sont diverses. M. Aldo Naouri : Certes, mais on peut parler de stade de maturation. Certains enfants peuvent avoir déjà leurs repères psycho-corporels à deux ans et demi, et d'autres ne pas les avoir à quatre ans. M. Gérard Neyrand : Oui, mais l'éducation familiale ne revêt pas forcément la même forme dans toutes les familles. Il arrive par exemple que ce soit le père qui s'occupe de l'enfant parce qu'il est au chômage et que la mère travaille, et que l'attachement de l'enfant au père soit donc très précoce. Interdire la résidence alternée serait dangereux dans un tel cas, et je comprends la mobilisation des associations de pères. M. Sébastien Huyghe : M. Naouri a bien décrit le lien noué entre l'enfant et sa mère avant même la naissance, et Mme Iacub a plaidé pour une plus grande adoptabilité des enfants. Or on s'aperçoit que beaucoup d'enfants adoptés recherchent leurs racines. Je voudrais avoir vos avis sur la nécessité de faciliter l'adoption et l'accès aux origines personnelles. Mme Henriette Martinez : Sur la résidence alternée, le législateur doit tout de même fixer un critère. Ce critère doit-il être l'âge ou le degré de maturité ? Le degré de maturité ne relève pas du législateur, mais de l'appréciation du juge. Celui-ci n'est pas médecin, et devra donc s'adjoindre l'avis d'un pédopsychiatre, mais il faudra bien qu'il juge d'après les textes. Or les textes peuvent-ils permettre qu'un enfant de deux ans et demi partage sa vie entre la France et les États-unis ? Il faut bien fixer un âge minimum, car un enfant n'est pas un animal de compagnie qu'on déplace d'un endroit à un autre. La résidence alternée systématique me fait très peur. Sur la maltraitance, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Mme Iacub. L'enfant maltraité doit être adopté le plus tôt possible. Hier, l'Assemblée nationale a supprimé le critère de « grande détresse » des parents, actuellement en vigueur pour empêcher la déclaration d'abandon, et levé ainsi un obstacle à l'adoptabilité et donc à l'adoption. Il ne faut pas avoir à l'esprit l'intérêt des parents, leur droit à conserver leur autorité sur l'enfant, mais l'intérêt de l'enfant à maintenir ou non le lien biologique. Peut-être faudra-t-il même réviser plus profondément le droit français de la famille, qui reste fondé davantage sur l'autorité parentale que sur l'intérêt de l'enfant. M. Alain Vidalies : Il est difficile d'insérer le droit à l'accès aux origines dans notre débat d'aujourd'hui. Nous avons avancé sur l'assouplissement de l'adoptabilité, mais nous voyons tous, dans nos permanences, des gens qui, des décennies après leur adoption, veulent connaître la vérité biologique de leurs origines. C'est une des questions que se pose le législateur, et nous y reviendrons forcément. Je voudrais donc savoir ce que vous pensez de l'accès aux origines. Faut-il faire droit à cette demande ou l'ignorer ? Est-elle marginale ou non ? M. Aldo Naouri : J'ai du mal à comprendre votre question. Je ne vois pas en quoi le législateur doit intervenir. M. Alain Vidalies : Aujourd'hui, l'adoption plénière est une substitution de parenté : elle efface la filiation biologique pour la remplacer par une filiation adoptive. Or il y a des gens qui, sachant qu'ils ont des parents adoptifs, veulent connaître leurs origines biologiques, notamment quand ils sont nés sous X, et qui ne le peuvent pas. M. le Président : Faut-il que le législateur fasse droit à cette demande ou non ? M. Aldo Naouri : Je ne crois pas nécessaire d'obtempérer devant le terrorisme de la transparence, comme dans les pays nordiques où les femmes inséminées doivent connaître l'identité du donneur de sperme. À quoi cela sert-il ? Il y a des personnes qui ne veulent rien savoir parce que leur relation avec leurs parents adoptifs est excellente. Une demande d'accès aux origines est d'ailleurs souvent le symptôme d'une difficulté relationnelle avec les parents adoptifs. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le législateur devrait dire si c'est nécessaire ou pas. L'adoption est un processus admirable qu'il faut absolument faciliter. Quelle est la proportion des personnes concernées qui voudraient accéder à leurs origines biologiques ? Mme Hélène Mignon : Elle est très élevée. M. Sébastien Huyghe : Vous avez insisté sur la relation que l'enfant noue avec sa mère lorsqu'il est dans le ventre de celle-ci. Cette relation peut expliquer le besoin de connaître son origine. Mme Marcela Iacub : Il faut peut-être replacer cette revendication dans l'histoire : elle remonte aux années 90. J'ai l'impression d'une construction purement idéologique. On dit aux gens : « Vous êtes malheureux parce que vous ne connaissez pas vos parents ». M. Aldo Naouri : Je suis assez d'accord. Mme Marcela Iacub : C'est aussi le résultat de la sacralisation du biologique depuis les années 70. Au lieu de considérer l'adopté comme un pauvre handicapé, avec pitié et commisération, il faudrait revoir le fondement du droit de la filiation, et peut-être en finir avec la distinction entre parent adopté et parent biologique. M. Aldo Naouri : J'ai souvent observé que les parents adoptifs à qui l'on a dit de ne pas cacher la vérité à leur enfant, afin qu'il ne vive pas dans le secret et ne l'apprenne pas par d'autres, passent leur temps à le lui répéter. Une fois, ça va. Tout le temps, non ! M. Gérard Neyrand : On oublie la diversification des formes de parentalité. D'une certaine façon, la fragilisation des unions fait que de plus en plus d'enfants seront adoptés par quelqu'un... Le problème est lié au fait que le droit limite le lien de filiation à deux parents et à deux seulement. La pluriparentalité met en cause cette limitation, notamment à travers la question du statut du beau-parent qui n'a pas de reconnaissance juridique, même s'il a une fonction éducative de fait qui est très concrète. Cela me paraît être l'enjeu principal de la réforme du droit de la famille. S'agissant de la résidence alternée, la question de fond est de savoir si l'intérêt de l'enfant, quel que soit son âge, dépend de la stabilité du lieu de vie ou de celle du lien avec ses deux parents. M. le Président : Je vous remercie tous de votre participation. Elle a permis une table ronde très ouverte qui nous a beaucoup apporté. Audition de M. Pierre Naves, inspecteur général des affaires sociales Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Je suis heureux de vous accueillir, monsieur Naves. Vous avez présidé le groupe de travail sur l'amélioration du système français de protection de l'enfance, installé en 2002 à la demande de M. Christian Jacob, alors ministre chargé de la famille. La synthèse de vos travaux, contenue dans le rapport que vous avez remis au ministre en juin 2003, est d'un grand intérêt. La Mission s'est saisie de cette question et a déjà entendu le docteur Maurice Berger. Nous vous écouterons avec une égale attention nous donner votre point de vue sur le fonctionnement et les éventuels dysfonctionnements du dispositif de protection de l'enfance. Il nous intéresse particulièrement de connaître vos idées sur le signalement des enfants en danger, sur leur prise en charge et sur l'organisation des services. M. Pierre Naves : Je m'intéresse depuis trente ans, à titre professionnel et aussi par des activités bénévoles diverses, à la protection de l'enfance, question sur laquelle je porte toutefois un regard, je pense, plus distancié que celui porté par les personnes directement concernées au quotidien par leur pratique, comme le docteur Berger, ou des magistrats de la jeunesse par exemple. Je suivrai le canevas du questionnaire très complet que vous m'avez adressé. J'évoquerai en premier lieu le signalement des enfants en danger, non sans rappeler que le terme même de signalement pose problème, comme l'a signalé le rapport que j'ai cosigné en juin 2000. La définition du signalement varie selon les professionnels et selon les départements, voire au sein d'un même département, en fonction des protocoles locaux, des habitudes et des personnes. Un signalement consiste en la transmission d'une information au parquet, en vue d'une décision. Deuxième type de problème : l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) a constaté, au cours de missions régulières, que l'informatisation des parquets est très fragile, tout comme celle de nombreux conseils généraux, et que les procédures de signalement sont donc difficiles à bien retracer. Par ailleurs, la circulaire de Mme Ségolène Royal en 1997, parce qu'elle a levé un tabou, a eu des effets positifs, notamment en favorisant les signalements par les enseignants, mais elle a provoqué un engorgement des parquets. Des protocoles ont à la suite été mis en place, mais on constate que certains d'entre eux peuvent être remis en cause, même s'ils fonctionnent bien, à l'arrivée d'un nouveau procureur ou d'un nouveau président de tribunal. Il peut d'ailleurs se produire que, dans un même département, la procédure de signalement fonctionne correctement dans un tribunal mais pas dans un autre... En amont du signalement, il y a la détection des situations à risque. Celle-ci est fragile. Le Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM) reçoit environ 900 000 appels par an, qui n'ont pas tous besoin d'une écoute approfondie. Mais si l'on s'en tient aux 20 % qui font l'objet d'une telle écoute, on constate que 9 000 appels signalent des problèmes manifestes et que 4 500 mettent au jour des situations non connues. Ces statistiques montrent que les procédures de détection et de signalement ne sont pas suffisamment efficaces : de nombreuses situations ne sont pas connues, alors qu'elles mériteraient de l'être. Je signale aussi à l'attention des membres de la Mission la question des sectes qui est d'une particulière complexité en raison de leur mode de fonctionnement et parce que le seul fait d'en parler suscite des craintes. On peut déduire de cet ensemble de facteurs que peut-être plusieurs dizaines de milliers d'enfants sont soumis à des violences et ne font pas l'objet de signalements. Vous me demandez par ailleurs si les moyens actuels permettent de détecter les situations à risques suffisamment tôt « pour éviter des séquelles irréversibles ». Ces termes sont ceux de l'éminent spécialiste qu'est le docteur Maurice Berger. Il est vrai qu'un signalement tardif peut avoir pour conséquence des séquelles irréversibles s'il s'agit d'un jeune enfant, et que les adolescents peuvent également souffrir d'avoir été ballottés de placement en placement. Ces constats regrettables s'expliquent par le fait que les références, notamment scientifiques, permettant un diagnostic précis et des prises en charge adaptées sont très peu utilisées, et souvent même très peu connues. De plus, la pluridisciplinarité est encore insuffisante, et des réticences subsistent chez les professionnels. Je mentionnerai à cet égard la réflexion d'un juge des enfants, expliquant préférer ne pas demander une expertise psychiatrique au motif qu'elle le contraindrait dans sa liberté de choix. S'agissant du partage des informations entre les acteurs de la protection de l'enfance, il s'agit moins, selon la Chancellerie, de problèmes juridiques que de problèmes pratiques et humains. Les facteurs clefs sont à mon avis l'investissement des services des conseils généraux et des magistrats, qui varient, là aussi, selon les départements. L'information peut d'ailleurs plus facilement être partagée dans les petits départements que dans les grands. J'en viens à la prise en charge des enfants en danger. Vous me demandez si la législation tient suffisamment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et s'il y a lieu de définir cette notion dans la loi. J'observe que la notion d'intérêt de l'enfant figure déjà à l'article 375-1 du code civil, mais je sais que celle-ci pourrait d'une part être précisée - l'analyse de jurisprudence à laquelle a procédé Mme Marcelle Bongrain montre le flou dans lequel le juge applique cette notion -, et d'autre part entrer en concurrence avec la notion de danger qui figure à l'article 375 du même code. Il serait donc utile selon moi de faire un choix sur la notion de référence. La référence à l'intérêt de l'enfant a une légitimité juridique internationale et une force logique. Elle devra être précisée via un guide de bonnes pratiques - selon la démarche qui a été utilisée pour lutter contre les différentes formes de cancer -, plutôt que par l'introduction d'une définition trop précise dans la loi. Vous m'interrogez également sur l'équilibre à trouver entre le maintien à domicile et le placement, rappelant que le docteur Berger parle d'une « idéologie du lien familial » qui conduirait à laisser les enfants dans leur famille même s'ils encourent des risques graves. C'est exact, et je connais, comme lui, des cas où l'on a attendu bien trop longtemps pour prendre la bonne décision. Il y a eu un retour de balancier. En effet, pendant de trop nombreuses années, on a séparé les enfants de leur famille, et, en fait, les véritables évolutions datent des années 1980, à la suite du rapport Bianco-Lamy. Par la suite, on a cherché à préserver au maximum les liens entre parents et enfants, mais cela a conduit à laisser des enfants au sein de leur famille, même s'il existe un risque réel de violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Voilà ce contre quoi le docteur Berger s'élève. La simple parole portée par un tiers ou par des messages comme des courriers ou des appels téléphoniques peut en effet suffire à maintenir le lien entre l'enfant et ses parents, et éviter des risques réels qui sont rendus possibles par la rencontre « physique » et qui vont retentir sur le développement de l'enfant. Mais cette réalité psychologique se heurte à des convictions et à des cas de séparation d'enfants de leurs parents qui auraient pu être évités. Les raisons de ces décisions inadaptées sont en partie idéologiques, mais elles sont aussi pratiques. J'appelle incidemment votre attention sur le choix des termes : si la législation évolue, il conviendrait de rompre avec ce qui n'est qu'une habitude, et de saisir l'occasion pour substituer au terme de « placement » celui d'« accueil ». En cette matière, la sémantique a un poids particulièrement lourd. Comment, me demandez-vous ensuite, assurer la continuité des placements ? Vous formulez notamment une question précise sur les pouponnières. Il est vrai que la théorie de l'attachement reste en France mal connue et n'est donc pas assez prise en compte, si bien que les enfants sont dans l'impossibilité de construire des liens solides. Je suis favorable à la suppression des pouponnières comme structures d'accueils de très jeunes enfants pendant des durées trop longues. Il faut privilégier une évolution vers des accueils maternels, tout en conservant ces structures comme « lieux ressource ». Pour ce qui est de la durée des placements, le seul critère qui vaut est ce dont l'enfant a besoin. La réduction de la durée du placement n'est pas, en soi, un objectif. Si l'enfant doit être séparé durablement de ses parents, il faut allonger cette durée, et lui permettre ainsi de construire des liens nouveaux au lieu d'être soumis à des allers et retours chaotiques et blessants pour tous - parents et enfants -, chaque échéance étant vécue dans la perspective de la prochaine décision. Une évolution a effectivement été nécessaire il y a quinze ans, car des enfants étaient alors placés « à vie » sans que leur situation soit jamais revue. L'objectif est bien que les décisions soient adaptées à la situation de chaque enfant. Il est donc indispensable d'instaurer de bons principes d'évaluation. Dans les années passées, il était légitime de limiter le placement à deux ans ; aujourd'hui, une telle limitation, à mon avis, a des effets négatifs, car elle évite aux décideurs de se poser des questions fondamentales : quelles perspectives durables pour les enfants et leurs parents peuvent-elles être construites ? Quels types de plan d'action mettre en œuvre ? Avec quels types d'accompagnement ? S'agissant de la diversification des mesures éducatives, je vous suggère de vous référer au rapport du groupe de travail que j'ai présidé et au sein duquel la nécessité de cette diversification a été soulignée et traduite en termes de propositions de nature législative et réglementaire. À votre question sur les moyens de développer l'adoption, je réponds par référence au rapport de ce même groupe de travail dont l'annexe E montre le très faible recours aux procédures de transfert de l'autorité parentale, notamment à la déclaration judiciaire d'abandon, prévue par l'article 350 du code civil. Le problème tient à ce qu'en France, contrairement à ce qui se passe à l'étranger, l'adoption est essentiellement pensée en termes d'adoption plénière, si bien que les parents premiers sont « gommés ». Si l'on privilégiait l'adoption simple, on pourrait recourir plus souvent aux dispositions de l'article 350 du code civil qui sont très peu utilisées et donc méconnues. Vous m'avez interrogé sur la réorganisation des services de protection de l'enfance. J'observe que le coût du dispositif actuel est très élevé : il atteint quelque cinq milliards, soit un montant considérable. Mais ce montant est bien plus considérable si l'on raisonne à moyen et long terme, et donc si on tient compte des échecs et des effets parfois ravageurs auxquels peuvent mener des erreurs de prises en charge. En laissant des jeunes développer un mal être qui les conduit soit à se droguer, soit à se suicider, soit à aller en prison, le dispositif a un coût social et humain énorme. La réorganisation du système passe par une réforme des conditions de travail des juges, une meilleure formation des professionnels de l'enfance et une harmonisation des pratiques entre départements. S'agissant de l'évaluation du dispositif, je tiens à souligner l'utilité incontestable du puissant levier que va devenir très vite l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED), à la fois par la production d'indicateurs statistiques fiables, mais aussi par la diffusion de bonnes pratiques validées. Depuis la décentralisation, les conseils généraux ont fait au mieux, mais sans disposer d'outils à la hauteur des enjeux. Alors que la Haute Autorité de santé qui a succédé à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé compte un effectif de 300 personnes, le président du Conseil supérieur de l'évaluation sociale et médico-sociale installé ces jours derniers dispose d'une personne et demie... Quel écart entre le domaine sanitaire et le domaine médico-social ! Ne s'agit-il pas, pourtant, dans les deux cas, de répondre à des besoins de même importance ? M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé d'une parfaite clarté. Mme Henriette Martinez : Je me félicite que vous ayez souligné l'intérêt de l'ONED, outil majeur d'évaluation du danger qui pèse sur les enfants. En ma qualité de rapporteure de la loi Jacob, j'avais obtenu l'adoption de deux amendements. L'un portait sur la protection des médecins qui signalent un enfant en danger, et il me donne satisfaction, car il a permis le dénouement de situations jusqu'alors inextricables. L'autre ne me satisfait pas, car, alors qu'il tendait à ce que dans toute décision l'on considère l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'est pas interprété comme le souhaitait le législateur. Certains magistrats considèrent en effet que l'intérêt supérieur de l'enfant consiste à ce qu'il ne soit pas séparé de ses parents, alors que le législateur souhaitait le contraire. C'est une interprétation perverse de la loi. Aussi, définir l'intérêt supérieur de l'enfant comme le fait le docteur Berger serait intéressant, mais cette définition est sans doute trop précise pour figurer telle quelle dans un texte législatif. Alors, que faire ? Ne pourrait-on pas prévoir l'obligation d'une expertise pédopsychiatrique dans tous les cas où un enfant est concerné, expertise dont les juges seraient contraints de tenir compte ? Ne serait-ce pas le moyen de définir l'intérêt supérieur de l'enfant au cas par cas ? Actuellement, certains magistrats demandent cette expertise, mais d'autres n'en demandent pas, et il en est même qui la refusent systématiquement. En conséquence, des enfants dépérissent à la suite de décisions de justice inadaptées. M. René Galy-Dejean : Jusqu'à quel âge considérez-vous que l'on est un enfant ? M. Pierre Naves : Jusqu'à 21 ans. Certes l'âge de la majorité est 18 ans, mais les « contrats jeunes majeurs » qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance sont utiles à des jeunes qui ne sont pas encore pleinement des adultes. Mme la Rapporteure : En matière de protection de l'enfance, j'ai le sentiment qu'il y a des modes et que l'on est passé du placement systématique à la volonté de maintenir le lien avec la famille. Mais peut-on demander aux juges des enfants, qui sont convaincus de bien faire, de modifier leurs pratiques sans paraître remettre en cause leur intégrité professionnelle ? En tant qu'ancienne magistrate, j'imagine ce que des juges peuvent penser lorsqu'ils se voient contraints dans leur décision. La modification législative est-elle le bon instrument pour faire évoluer les comportements ? M. Patrick Delnatte : Que pensez-vous du fonctionnement des conseils de famille ? Mme la Rapporteure : Quel est votre avis sur l'appréciation critique portée par le rapport de la Défenseure des enfants s'agissant des différences observées d'un département à l'autre ? M. Pierre Naves : Si le premier rapport de Mme Claire Brisset, rédigé quelques mois après sa désignation, m'avait paru parfois provocant, le dernier est très étayé et m'apparaît assez objectif. Il rejoint les observations faites par l'IGAS qui a constaté des pratiques très diverses selon les départements où des contrôles ont été réalisés au cours des cinq dernières années. Les conseils de famille se réunissent tous les six mois, et davantage si nécessaire, pour suivre la situation des pupilles dont ils ont la charge. Ils fonctionnent en général bien et permettent donc de construire de véritables projets pour ces enfants. De ce point de vue, j'ose dire, pour utiliser une formule imagée, qu'il vaut mieux être pupille qu'un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance... S'agissant de la meilleure manière de faire évoluer les pratiques, je partage la remarque de Mme la Rapporteure. Pour faire évoluer la prise en charge des enfants en danger, il est vrai que l'on n'aboutira pas en prenant les acteurs de la protection de l'enfance de front. Le rapport du groupe de travail était d'ailleurs rédigé avec une grande gentillesse, pour éviter que les professionnels ne se braquent. Mme la Rapporteure : Peut-on faire changer avec gentillesse ? M. Pierre Naves : Je crois dans les vertus de la gentillesse, de la bienveillance, surtout à l'égard de professionnels qui sont particulièrement dévoués. Il faut savoir que les juges des enfants sont débordés, mais qu'ils ne le diront pas spontanément, aussi haute soit la pile des dossiers qui s'accumulent... Mme Henriette Martinez : ... et qu'ils n'ont pas lu, pas plus qu'ils n'ont demandé l'avis d'un pédopsychiatre ! Les juges doivent admettre qu'ils ne savent pas tout, et en particulier qu'ils n'ont jamais été formés à la psychologie de l'enfant. Aussi longtemps que cette situation perdurera, on continuera de voir des enfants se mourir, littéralement, des suites de décisions de justice erronées. M. Pierre Naves : Sait-on qu'il y a en Allemagne l'équivalent de cinq fois plus de juges des enfants qu'en France où les magistrats ont en portefeuille un nombre considérable de dossiers qui demanderaient tous plusieurs heures d'étude. Le rythme d'audiencement des juges français est si soutenu qu'ils ne peuvent consacrer le temps qu'ils estiment, en leur for intérieur, nécessaire. Il faut beaucoup de tact pour dire à ces juges que, faute de temps, ils travaillent trop souvent de façon approximative parce qu'ils sont sous la pression de l'urgence et sont donc réduits à se passer d'un avis supplémentaire et pourtant très utile : celui d'un psychiatre ou d'un psychologue. En réponse à la question de Mme Martinez, je ne sais si l'obligation d'expertise relève de la loi ou du règlement. Des précisions complémentaires sont de toute façon nécessaires pour aider les responsables. L'ONED va précisément faire l'analyse, lacunaire à ce jour, de la manière dont les juges appliquent la notion de danger et prennent en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Je voudrais ajouter enfin que les avocats auprès des enfants sont très peu nombreux, de même que très peu d'avocats assistent les parents dans les procédures d'assistance éducative. Or, lorsqu'ils sont bien formés, les avocats améliorent la qualité de la justice. De nombreux juges des enfants se félicitent de la présence de ces avocats qui les aident à préparer l'audience. Par ailleurs, le mode de désignation des administrateurs ad hoc soulève une difficulté spécifique, car il n'assure pas leur neutralité par rapport aux intérêts en cause. À mon sens, il conviendrait donc de formaliser davantage le rôle des administrateurs ad hoc et d'accroître celui des avocats pour enfants. Il serait bon, aussi, de lever un tabou et de dire que les juges des enfants sont débordés. Vous l'aurez compris, la nécessité de faire évoluer les pratiques est grande, et je me félicite que la représentation nationale s'empare de cette question qui concerne des millions de personnes dans notre pays. M. le Président : Je vous remercie. Audition de M. Alain Bruel, ancien président Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous accueillons M. Alain Bruel, ancien président du tribunal pour enfants de Paris, auquel je souhaite la bienvenue. Tout en assurant un enseignement universitaire sur la protection de l'enfance en danger, il a été, pendant plus de trente ans, juge des enfants. Son témoignage peut donc nous apporter un éclairage précieux. Je souhaiterais, monsieur, que vous nous livriez votre réflexion sur le fonctionnement et les éventuels dysfonctionnements de notre dispositif de protection de l'enfance et sur les moyens de l'améliorer. Le signalement des enfants en danger, les modalités de la prise en charge de ces enfants et la place donnée aux enfants devant le juge des mineurs sont les volets qui nous intéressent particulièrement. M. Alain Bruel : Comment améliorer la protection judiciaire de l'enfance ? L'assistance éducative traverse incontestablement une crise, ce qui n'est guère étonnant quand on considère les changements institutionnels et humains intervenus depuis une trentaine d'années. À sa création, en 1958, la protection de l'enfance s'inscrivait dans un ensemble relevant de la responsabilité de l'État, qui recouvrait protection administrative, protection des enfants en danger et traitement, sur le plan éducatif, des jeunes délinquants. Du côté judiciaire, il y avait un seul juge qui recevait une formation permanente spécialisée au contact de chercheurs en sciences humaines et de travailleurs sociaux, dans le cadre d'un lieu ouvert à tous, le centre de formation et de recherche de l'éducation surveillée de Vaucresson. Depuis lors, que de vicissitudes ! La loi de décentralisation du 22 juillet 1983, en retirant aux préfets la protection administrative alors que la protection des mineurs en danger et le traitement des délinquants restaient dans le giron de la justice, a privé l'État de la maîtrise complète d'un dispositif à l'origine cohérent sur le plan éducatif. La loi du 10 juillet 1989 en a tiré les conséquences, en conférant au président du conseil général la charge devenue vacante de la protection administrative et de la coordination des interventions. II en est résulté les disparités géographiques dans les moyens accordés par les conseils généraux - relevées dans le dernier rapport de la Défenseure des enfants -, et surtout un clivage d'abord technique, puis idéologique, entre la prise en charge des délinquants dépendant de l'État et celle des mineurs protégés relevant des départements. La loi de 1989, en mettant en exergue la catégorie d'enfants « maltraités », plus restreinte que celle d'enfants « en danger », et en définissant des modalités nouvelles de signalement et de coordination des actions, a augmenté les incertitudes du dispositif. L'expérimentation prévue par la loi du 13 août 2004, qui consiste à priver le juge des enfants du choix de l'établissement ou du service auquel il entend confier un enfant, constitue un nouveau facteur potentiel de détérioration. Il ne faudra pas s'étonner que ce nouveau sacrifice aux prétendus impératifs de la gestion et, surtout, à l'adage selon lequel « qui paie décide » accroisse les insatisfactions des usagers, privés de la possibilité de voir prendre en compte leurs attentes à l'issue du débat contradictoire dans le bureau du magistrat. Parallèlement, on assiste à la dégradation constante de la spécialisation des magistrats de la jeunesse, non par manque de vocations, mais par refus de la hiérarchie judiciaire et des services de la Chancellerie de voir certains collègues se consacrer à ce travail pendant plusieurs années, voire pendant une carrière entière. La formation permanente des juges des enfants a été reprise par l'École nationale de la magistrature de façon moins ouverte aux influences extérieures que ne l'était autrefois le centre de Vaucresson. La mobilité est partout encouragée, et aucune priorité n'est donnée aux plus expérimentés pour accéder aux quelques postes de vice-président existant dans la spécialité. Aussi la rotation est-elle forte, ce qui fait de la plupart des professionnels, quel que soit leur âge, des débutants ou des touristes. Indépendamment de ce morcellement, de ces mutilations, l'assistance éducative est contestée dans son option fondamentale de suivi individualisé des populations en difficulté. La politique de la ville s'est en effet construite sur la disqualification du travail social individuel et de l'approche clinique qu'il présuppose. En insistant sur la responsabilité de l'ensemble des acteurs sociaux dans le traitement des difficultés, on n'a pas manqué de souligner les mauvais résultats des professionnels, et cette appréciation pèse inévitablement sur les moyens qui peuvent leur être attribués. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de l'apparition de critiques concernant l'activité des juges des enfants, phénomène encore rarissime voici quelques années. L'attaque la plus frontale est sans doute celle du docteur Berger. Sans doute avez vous été impressionnés par la pertinence de ses constats, tirés d'une longue pratique pédopsychiatrique. Aussi, je ne m'offusquerais pas de la généralisation outrancière des affirmations que le docteur Berger déduit de certaines décisions contestables, sources d'insécurité pour les enfants, si leur auteur, passant tout à coup du domaine de sa spécialité à celui du droit, n'en déduisait rien moins qu'une réécriture complète et conforme à ses vues des dispositions régissant l'assistance éducative. C'est du moins ce qu'il m'a semblé lire entre les lignes de la proposition de loi déposée par Mme Henriette Martinez... L'exercice est d'autant plus périlleux que le droit des personnes été longuement mûri par des juristes de renom, notamment par le regretté doyen Carbonnier. Or la proposition de loi met à bas une architecture logique dans le seul but, prétendument pédagogique, d'extraire la protection de l'enfance du chapitre consacré à l'autorité parentale. Cette séparation affirmée s'écarte de l'expérience courante d'une parentalité vécue comme indissociable de la recherche de l'intérêt de l'enfant. Elle n'est, de plus, guère conforme à la Convention de New York qui souligne au contraire le rôle primordial des parents, premiers et principaux responsables du devenir de leurs enfants. L'auteur de la proposition s'empresse d'ailleurs de ruiner la portée symbolique de son geste, en rappelant l'importance des parents au début de ses propres développements. La proposition supprime par ailleurs toute référence à la notion de danger qui sert actuellement de critère majeur d'intervention du juge, et lui substitue la notion d'intérêt de l'enfant. Cette dernière, qui figure d'ailleurs dans l'article 375-1 du code civil depuis quelques mois, peut éventuellement servir de principe directeur dans des cas limites, en permettant par exemple de refuser à des parents, malgré les progrès accomplis, la reprise de leur enfant étroitement attaché à son milieu d'accueil. Mais elle n'est pas suffisamment discriminante pour tracer une ligne de partage entre protection judiciaire et protection administrative, et risque donc de créer des incertitudes et des retards dans la saisine du juge, seul habilité à faire échec aux titulaires de l'autorité parentale. L'utilisation de la notion d'intérêt de l'enfant peut même conduire à des interventions judiciaires abusives, car, si seule une minorité de parents met ses enfants en danger, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous puissent se vanter de toujours bien discerner où se trouve l'intérêt de ces enfants. Je ne partage donc pas la confiance manifestée dans la valeur opératoire de ce concept, dont chacun s'empare en l'interprétant à sa façon, ainsi que la sociologue Irène Théry l'a magistralement démontré à propos de la juridiction du divorce. Enfin, je crains que l'intérêt de l'enfant ne devienne un argument d'autorité dispensant de réguler, au sein de la famille, une pluralité d'intérêts respectables. La définition de l'intérêt de l'enfant donnée dans la proposition de loi est certes séduisante, mais elle reste marquée par la perspective pédiatrique, et ne tient compte ni de l'approche systémique qui situe l'enfant comme un élément de l'ensemble familial, ni de la dimension socio-économique qui a déjà conduit l'association ATD-Quart Monde à suspecter la justice des mineurs de recourir à des placements pour cause de pauvreté. Connaissant les ravages du chômage et les difficultés de certaines populations à assurer leur simple survie, il paraît insensé de fixer dans la loi des délais abrupts au-delà desquels il deviendrait nécessaire de définir un projet de vie permanent pour l'enfant placé. Et l'appréciation selon laquelle les parents ne sont pas susceptibles de modifier leur attitude, ou celle selon laquelle le délai pour obtenir le changement paraît trop long et trop aléatoire, me semblent profondément arbitraires et injustes. Le pouvoir donné au juge des enfants de prononcer lui-même des délégations d'autorité parentale constitue également une innovation contestable. Jusqu'à présent, ce magistrat, chargé de faire échec temporairement aux abus et carences des parents sans pouvoir leur enlever leurs droits, peut communiquer le dossier au parquet, lequel est susceptible, si nécessaire, de requérir l'ouverture d'une procédure en délégation. Aller au-delà reviendrait à changer la nature de l'institution et à modifier péjorativement sa perception par le public. Tout au plus pourrait-on, dans certaines circonstances, donner au juge le pouvoir de porter une atteinte ponctuelle à l'autorité parentale, en chargeant les personnes à qui l'enfant a été confié de donner, en se passant de l'accord des parents, certaines autorisations d'opération non urgente, de déplacement ou de pratique d'une activité culturelle ou sportive. Enfin, la proposition de loi passe sous silence l'importante question du détachement des liens. Il ne suffit pas de procurer à l'enfant un milieu de vie meilleur dans lequel il puisse nouer de nouveaux attachements. Encore faut-il prendre garde aux liens d'origine et à l'importance qu'ils conservent, sous peine de voir échouer des placements chez des gens dont le seul tort est de ne pas être les parents. L'appréciation de la persistance des liens antérieurs est, selon mon expérience personnelle, une difficulté importante. En tout cas, je ne vois pas l'intérêt qu'il pourrait y avoir à remplacer une vigilance permanente, nourrie par une connaissance continuellement actualisée du contexte, par l'instauration rigide d'étapes irréversibles dans le processus de séparation. Je comprends bien le besoin de continuité des soins et de stabilité affective chez l'enfant placé, et je donne volontiers acte à Mme Henriette Martinez et au docteur Berger des failles existant dans la pratique juridictionnelle et dans le fonctionnement de certains services d'aide à l'enfance. Cependant, je ne pense pas qu'une amélioration réelle soit principalement du domaine de la loi. La qualité des hommes et des institutions, leurs pratiques, leurs manières de collaborer sont beaucoup plus déterminantes, alors même qu'elles ne se décrètent pas. À la différence de celle de Mme Henriette Martinez, la proposition de loi déposée par Mme Valérie Pécresse ne prévoit pas un bouleversement institutionnel, mais contient une série de mesures qui emportent mon adhésion. S'agissant du titre premier, je maintiens bien sûr l'avis exprimé précédemment : la mention de l'intérêt de l'enfant dans l'article 375-1 du code civil est amplement suffisante pour tenir compte des légitimes critiques du docteur Berger. En revanche, l'article 4 sur la consultation du Défenseur des enfants me paraît indispensable, et je croyais même, naïvement, que des demandes d'avis étaient déjà spontanément pratiquées, conformément à l'esprit de l'institution. Pour ce qui est du titre II, je suis tout acquis aux propositions concernant la préparation à la parentalité et la solennisation de la déclaration de naissance à l'état civil. Elles figuraient d'ailleurs en bonne place dans les conclusions du rapport déposé en 1998 par le groupe de travail sur la paternité que j'ai eu l'honneur de diriger. La prévention des difficultés liées à la naissance par l'accompagnement à domicile de certaines jeunes mères et le dépistage précoce des maltraitances lors de l'entrée en maternelle me paraissent aussi très utiles. On retrouve là les propositions du groupe de travail réuni en 1998 sous la houlette du professeur Didier Houzel à la demande de M. Hervé Gaymard. Je me rallie volontiers à la constitution d'un groupe de travail sur le partage des informations afin d'améliorer une prise en charge commune. La difficulté vient de ce que les professionnels doivent tenir compte non seulement des règles du secret professionnel, mais aussi de la déontologie particulière à leur corps. Certaines conditions, telles l'information préalable de la personne concernée ou les précautions à prendre quant au moment et au lieu de la divulgation, sont déjà des garanties intéressantes. Mais la meilleure proposition en la matière ne pourra avoir d'effet sans un décloisonnement de la formation des différents intervenants. Sur le terrain, la règle du secret n'est évoquée qu'en l'absence d'un climat de confiance. À propos des titres III et IV, je suis pleinement d'accord avec les propositions concernant le développement de l'aide psychologique aux enfants et le renforcement de l'efficacité des dispositifs de protection de l'enfance, ainsi, bien sûr, qu'avec la possibilité donnée au Défenseur des enfants de saisir l'inspection générale des affaires sociales. Au titre V, la rédaction proposée pour l'article 388-1 du code civil me paraît claire et complète. Dans ma pratique, il m'est quelquefois apparu inutilement traumatisant de convoquer certains mineurs très fragiles ou perturbés, mais je ne parviens pas à imaginer de raisons me permettant de refuser une demande d'audition émanant d'un mineur. À l'inverse, celui-ci ne doit jamais être contraint de sortir d'un silence qui est pour lui un refuge. S'agissant, au titre VI, de la limitation de la garde alternée pour les très jeunes enfants, je ne me reconnais pas la légitimité de prendre position, n'ayant pas eu à appliquer cette possibilité au cours de ma vie professionnelle. Le principe du placement unique doit, à mon avis, être posé, même s'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur la possibilité de l'appliquer, en raison des problèmes de recrutement de familles d'accueil, mais aussi de la difficulté fréquente qu'éprouvent certains enfants, même maltraités, à se détacher de leurs référents parentaux, malgré les insuffisances de ces derniers, difficulté qui conduit à de nombreux rejets. Enfin, l'évaluation des effets de la scolarisation précoce me paraît une excellente précaution à prendre, de nature à éviter que se multiplient les mauvais départs. Je souhaite, pour conclure, insister sur quelques points à mon avis capitaux. En premier lieu, ne confondons pas les échecs de la protection de l'enfance avec l'échec de l'institution. Changer les textes ne résout pas toujours les difficultés du terrain et introduit même parfois la confusion. Les erreurs constatées résultent à l'évidence d'une formation permanente des juges insuffisamment ouverte, et surtout d'une gestion a minima de la spécialisation. Il ne faudrait pas que les critiques du docteur Berger fassent oublier l'information précoce et le soutien à la parentalité qui sont longs à porter leurs fruits, mais qui sont sans doute plus efficaces. Les travaux convergents du groupe Houzel et de celui que j'avais animé ont relevé la fréquence d'une déformation, consistant à ne voir chez les parents que les insuffisances que l'on cherche à combler et non les compétences positives qu'il faudrait développer dans l'intérêt bien compris de l'enfant. Nous savons bien que l'aptitude parentale n'est pas un tout insécable, et que certains ne sont capables d'assumer qu'une parenté partielle ou à éclipse. Cette constatation conduit à envisager une autre critique possible du système actuel, celle que lui fait Mme Claire Neyrinck, professeur de droit à l'Université de Toulouse, et à laquelle j'adhère : en cas de placement, le partage entre les droits conférés à la personne ou au service auquel l'enfant est confié et ceux qui demeurent entre les mains des parents n'est pas suffisamment clair, ni suffisamment souple. Ce manque de clarté et de souplesse est source d'hésitations, parfois d'abus et, en tout cas, d'appréhensions difficiles à calmer. Nous sommes les héritiers d'une tradition de déchéance des « mauvais parents » et de remise des enfants à l'assistance publique. Petit à petit, nous avons progressé dans le respect des droits des parents, et encore récemment dans leur information sur le contenu des dossiers. Une plus grande précision des textes sur la répartition des éléments de l'autorité parentale dans les cas de séparation est maintenant nécessaire. Parallèlement, il conviendrait de faciliter et de reconnaître dans la loi les formules intermédiaires de séparation « à la carte » : internats de semaine, placements de week-end et de vacances, prises en charge de jour, et même la pratique, paradoxale mais apparemment positive, du « placement sans déplacement » expérimenté dans le Gard depuis plusieurs années. Mme Henriette Martinez : Vous avez largement critiqué une proposition de loi que je revendique comme étant la mienne, et non celle du docteur Berger. Je me suis, certes, inspirée de ses travaux, mais aussi de ceux d'autres pédopsychiatres et d'associations de protection de l'enfance avec lesquelles je travaille depuis de longues années. J'ai bien compris que vous ne souhaitez pas voir la loi bouleversée. Aussi aimerais-je savoir comment, au long de votre pratique professionnelle, vous avez défini l'intérêt de l'enfant, selon quels critères vous avez jugé de la manière dont l'enfant devrait être traité, comment vous avez envisagé la vie qu'il aurait après votre décision, et comment vous avez pu avoir une connaissance actualisée de sa situation sans expertise médicale. Comment avez-vous tenu compte de tous ces éléments fondamentaux dans les jugements que vous avez rendus ? M. Pierre-Louis Fagniez : J'ai été très impressionné par votre description de l'état de votre profession. Je suis médecin, et s'il me fallait décrire ainsi la situation de la médecine, je dirais tout net à mes confrères : « Arrêtez tout » ! Ne faut-il pas évoquer en priorité l'état dramatique de la justice des mineurs, dont tout découle ? Mme la Rapporteure : J'ai appris que Mme Claire Brisset, Défenseure des enfants, compte faire porter son prochain rapport sur les juges des enfants. J'ai par ailleurs entendu, lors de la rentrée judiciaire à Versailles, une juge des enfants laisser transparaître son malaise. Quelle évolution considérez-vous possibles, sachant que les juges des enfants ont manifestement du mal à tout faire ? On parle de créer un juge à la famille. Qu'en pensez-vous ? M. le Président : Vous avez évoqué la question, décisive, de la formation des juges des enfants. Quelles améliorations suggérez-vous ? M. Alain Bruel : Je me vois mal prendre des exemples dans une pratique professionnelle qui s'éloigne. Je n'ai jamais dit que le juge doit se passer de l'expertise des médecins, mais au contraire qu'il doit avoir une ouverture d'esprit et une formation aux sciences humaines, et être vigilant et attentif à ceux qui ont des connaissances dans ce domaine. C'est là toute la difficulté de la définition de l'intérêt de l'enfant. Un systémicien dira qu'il est établi lorsque le système familial fonctionne harmonieusement et de façon qui n'est pas défavorable à l'enfant. Il y a la définition du pédopsychiatre. Pour ATD-Quart Monde, il faut que la famille ait un logement et les parents un travail, ce qui n'est pas faux non plus. En d'autres termes, il ne s'agit pas que le juge ait une vision supérieure à celle des autres de ce qu'est l'intérêt de l'enfant, mais qu'il parvienne à faire une synthèse. Bien qu'étant à la retraite depuis cinq ans, je demeure membre de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, et je suis positivement épouvanté parce que l'on est en train de faire de notre profession. Les projets en préparation reposent sur l'idée que ce qui compte, c'est la rapidité plus que la profondeur de l'analyse. Comme il y a largement matière à se spécialiser, j'ai toujours défendu l'idée de la spécialisation des juges et je l'ai pratiquée à titre personnel. Si j'avais été médecin, j'aurais sans doute choisi d'être pédiatre. Personne n'envisage de supprimer cette spécialité. Pourquoi faudrait-il en revanche supprimer les juges des enfants, au bénéfice d'un magistrat chargé de toutes les affaires concernant la famille, c'est-à-dire d'un généraliste ? J'ai certes connu, lorsque j'étais auditeur de justice, des spécialités ridicules - il existait par exemple un magistrat spécialisé pour les affaires de mœurs - dont on conçoit qu'elles ne puissent prêter à une carrière complète. Mais quand il s'agit d'enfants, une spécialisation par tranche d'âge me paraît tout à fait respectable. Or la hiérarchie judiciaire n'en tient pas compte. Jeune magistrat, je me suis entendu dire : « Ah, vous êtes juge des enfants... j'espère que vous ne le resterez pas ! ». Et pourquoi donc ? Parce qu'on considère que ces postes échoient aux femmes, et que c'est une voie de garage. À cela s'ajoute une politique de mobilité que l'on peut comprendre, et qui ne vient pas spontanément, c'est vrai. On pourrait, cependant, donner un minimum de perspective de carrière aux juges des enfants, au lieu de charger de ces questions certains vice-présidents de tribunaux alors qu'ils n'y connaissent rien ! Enfin, les syndicats de magistrats, affectés du « syndrome Pic de la Mirandole », sont eux-mêmes très méfiants à l'idée de la spécialisation des juges. Selon moi, la formation des magistrats devrait être beaucoup plus spécialisée, et celle des juges des enfants ne devrait pas se faire dans le cadre de l'École nationale de la magistrature, mais par des séquences pluri-professionnelles de formation centrées sur la personne. Mme Martinez m'a demandé quelle a été ma pratique. Si je ne suis pas sûr d'avoir toujours bien fait, je suis certain que les formations que j'ai suivies m'ont aidé, particulièrement celles qui étaient centrées sur la dynamique de groupe. En permettant de prendre conscience des nos qualités et de nos défauts, ces formations nous évitent de nous mettre dans des situations où nos insuffisances l'emporteraient. J'y ai appris, par exemple, que j'avais tendance à un excès d'indulgence plutôt qu'à un excès de sévérité, et j'en ai tiré les conclusions. J'aurais pu changer d'affectation tous les trois ans, mais je ne suis pas sûr que les justiciables y auraient beaucoup gagné. Le problème de la formation est donc manifeste, et il faut faire passer le message politique de l'importance de la spécialisation. Mais, dans l'intervalle, il nous faut lutter d'arrache-pied pour survivre. Mme la Rapporteure : L'appréciation portée sur les juges des enfants ne s'explique-t-elle pas par le fait que nos concitoyens attendent de la justice le même « zéro défaut » qu'ils attendent de la médecine, et que les juges des enfants subissent, eux aussi, cette pression ? Sans connaître le dossier, on s'estime fondé à déclarer que le magistrat aurait dû juger différemment... Par ailleurs, ne pensez-vous pas que l'expertise pédopsychiatrique est nécessaire en matière d'assistance éducative, comme l'enquête sociale l'est en matière de délinquance des mineurs ? M. le Président : La responsabilité des juges des enfants pouvant être mise en cause plusieurs années après qu'un jugement a été rendu, estimez-vous leur statut suffisamment protecteur ? M. Alain Bruel : Il n'y a pas eu, jusqu'à présent, de mise en cause. Il me paraît toutefois qu'il s'agit davantage d'un problème d'hommes que d'institution. Définir l'intérêt de l'enfant serait, à mes yeux, problématique : pourquoi choisir telle définition, et notamment celle du docteur Berger, alors qu'il en existe plusieurs ? Je ne voudrais pas que l'on se retrouve dans des difficultés comparables à celles apparues après la promulgation de la loi de 1989 qui, en mettant en exergue la catégorie des enfants maltraités, a restreint le champ de l'enfance en danger. Il existe d'autres circonstances dans lesquelles des enfants peuvent être en danger, comme le montre, par exemple, le sort des mineurs étrangers isolés qui ne peuvent aller nulle part, ni faire valoir aucun droit. Il faut qu'un juge puisse au moins prendre des mesures conservatoires concernant ces enfants qui ne sont pas maltraités par leurs parents mais par la société ! Au demeurant, la notion d'intérêt de l'enfant figure déjà dans la loi. Mme Henriette Martinez : Parce que j'ai obtenu qu'elle y soit introduite par voie d'amendement ; mais je regrette de ne pas l'avoir définie davantage. M. Alain Bruel : Je me suis trouvé dans une position difficile face à des parents à qui l'on avait d'abord assuré que leurs enfants leur seraient rendus à telles conditions, pour ensuite leur dire que, même ces conditions remplies, leur rendre leurs enfants serait catastrophique. C'est une situation très gênante qui risque de se généraliser si la loi définit l'intérêt de l'enfant. Mme la Rapporteure : Pensez-vous qu'il faille développer l'adoption simple ? M. Alain Bruel : Je préfèrerais que l'on développe les parrainages qui évitent toute compétition et tout jeu de pouvoir, et qui apportent beaucoup aux enfants. Quant à l'adoption simple, tout dépend de la manière dont elle se met en place et des liens entre l'enfant et le parent d'origine. M. le Président : Je vous remercie. Table ronde ouverte à la presse Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Je souhaite la bienvenue aux participants à cette table ronde, ouverte à la presse, consacrée à la prévention et à la détection de l'enfance en danger. La Mission a souhaité, en partant d'un cas précis, confronter les expériences des acteurs de la protection de l'enfance pour faire apparaître les moyens d'améliorer le dispositif. Après que notre collègue Jean-Christophe Lagarde aura dit les enseignements qu'il a tirés de l'affaire de maltraitance qui a secoué Drancy, commune dont il est le maire, M. Gilles Garnier, vice-président du conseil général de Seine-Saint-Denis, donnera le point de vue du département. Je vous inviterai ensuite à répondre à trois questions : à partir de quel âge et selon quelles modalités faut-il faire débuter les mesures de prévention et de détection ? Comment instituer un partage des informations respectant le secret professionnel, les droits des enfants et ceux des parents ? Comment améliorer le suivi des familles pour prévenir la récidive ? M. Jean-Christophe Lagarde : J'observe en premier lieu que l'affaire à laquelle je ferai référence, et qui a fait grand bruit, a éclaté le 4 août 2004 et que, depuis cette date, personne n'a jamais cherché à interroger la commune de Drancy pour connaître les informations dont nous pourrions disposer sur la famille concernée. En résumé, l'information n'avait pas circulé avant cette dramatique affaire et elle n'a pas circulé davantage ensuite. Ce cloisonnement persistant est, pour moi, le dysfonctionnement le plus éclatant. Je rappelle brièvement que cinq enfants, âgés de quatorze mois à sept ans, ont été trouvés dénutris et vivant dans des conditions d'insalubrité et de manque d'hygiène extrêmes, au point que le plus jeune ne pesait que quatre kilos. Le fait le plus marquant, c'est que la famille n'était pas dans une situation de misère sociale, mais que les parents et la grand-mère employaient une stratégie constante d'évitement de tous les dispositifs sociaux, alors même qu'ils résidaient à proximité des services compétents. Le parquet, l'éducation nationale, les services sociaux départementaux et ceux de la municipalité avaient, chacun, des bribes d'informations, mais nul n'était en mesure de reconstituer le puzzle dont ils avaient certains morceaux en mains. Personne n'a imaginé le drame vécu par les enfants. Dix-huit mois plus tard, l'échange d'informations n'a toujours pas eu lieu. Il serait pourtant simple, aussitôt qu'un problème concernant un enfant apparaît, d'informer obligatoirement tous les partenaires concernés : la justice, l'éducation nationale, les services sociaux départementaux et, évidemment, la commune. Dans les petites communes, le maire est instantanément prévenu. Pour ma part, j'ai demandé aux services municipaux de signaler systématiquement les anomalies, comme, par exemple, les cas où la police municipale doit raccompagner plusieurs fois chez lui un enfant que ses parents ont oublié de venir chercher à l'école maternelle, au mépris du suivi familial élémentaire. Je le répète : le mot clé, en cette matière, c'est le décloisonnement. La prévention doit, bien sûr, s'exercer dès la naissance. Dans l'affaire considérée, on a découvert dans l'appartement un enfant de quatorze mois inconnu des services municipaux. C'est une erreur de la part de l'État que d'avoir supprimé « la visite des neuf mois », contrôle médical auparavant obligatoire qu'il ne serait pas très onéreux de rétablir ; aurait-il existé que ces inadmissibles cas de malnutrition auraient été repérés. Il faut aussi recouper les informations dont disposent les différents services par un secret professionnel partagé, et en finir ainsi avec un système où chaque service garde pour lui ce qu'il sait d'une famille, si bien que chacun connaît un morceau de vie, mais que tous demeurent incapables de détecter les signes d'alerte. Il convient encore de s'interroger sur l'interdiction d'entrer dans les logements en cas de refus de ceux qui y résident. Dans l'affaire citée, les voisins s'étaient plaints de la présence de cafards à l'étage de la famille considérée. L'office HLM a bien envoyé une équipe de désinsectisation, mais l'accès à l'appartement lui a été refusé. Pourtant vivaient là des enfants signalés à la justice, qui étaient suivis par l'éducation nationale et par la protection maternelle et infantile (PMI), mais la famille a constamment déployé une stratégie d'évitement des services sociaux. Cette stratégie s'est poursuivie lorsque le comportement de l'aîné a conduit le directeur de l'école dans laquelle il était scolarisé à demander qu'il soit suivi par un éducateur spécialisé. La mère, voulant éviter que son fils soit placé, a conditionné l'enfant de telle manière que celui-ci a accusé, à tort, l'éducateur d'agression sexuelle. Pour autant, la justice qui est la principale faille du système n'a pas estimé nécessaire de pousser les investigations plus loin. Lorsque l'on a finalement pénétré dans l'appartement, on y a découvert une accumulation inouïe d'immondices ; il aurait suffi de pouvoir entrouvrir la porte pour comprendre la situation. Comment, dès lors, ne pas s'interroger ? À partir de quand a-t-on le droit d'évaluer les conditions dans lesquelles les enfants sont hébergés ? Pourquoi ce qui vaut pour les familles d'accueil n'est-il pas accepté pour les familles d'origine ? Une autre difficulté tient au manque de moyens du tribunal pour enfants de Bobigny. Je crois savoir que, pour l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, ce tribunal ne dispose que de cinq juges ! Pourtant, Drancy n'est certainement pas la seule commune où de tels faits se produisent, et j'ai en mémoire le cas d'un enfant repéré à moitié nu sur un balcon en plein Paris, que le parquet a restitué à ses parents le soir même, sans qu'aucun suivi n'ait été décidé alors que la situation sociale de la famille s'est avérée dramatique par la suite. Comment prévenir la récidive et mieux détecter les enfants en danger ? Il faut en premier lieu rétablir la visite médicale obligatoire pour tous les enfants de neuf mois, et prévoir une autre visite avant l'âge scolaire. Il faut aussi accepter l'idée du recoupement des informations et du partage du secret professionnel et, pour l'appliquer, instituer des rendez-vous mensuels entre tous les services concernés ; ce serait un grand progrès, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait pour la prévention de la délinquance. Il faut en outre lever un tabou en revenant sur l'interdiction de pénétrer dans les logements lorsque les familles pratiquent une stratégie d'évitement manifeste. Ainsi peut-on espérer mieux détecter les enfants en danger et éviter que se reproduisent des cas comme celui de Drancy où les parents poursuivis ont pleuré au tribunal, avant de sabrer le champagne, dans un appartement remis à neuf par l'office HLM, pour fêter la légèreté de la peine à laquelle ils ont été condamnés. M. Gilles Garnier : Je remercie la Mission d'avoir invité le conseil général à donner son opinion sur un cas particulier dont il faut tirer un enseignement général. En effet, au moment où l'affaire décrite a été révélée à Drancy, d'autres étaient mises au jour à Montbéliard et dans le Sud-Ouest. De tels drames, médiatisés à l'extrême lorsqu'ils se produisent en banlieue dans le désert journalistique du mois d'août, se répètent partout en France, comme le montrent aussi les sinistres affaires jugées dans le Maine-et-Loire et dans le Pas-de-Calais. Ces coups de projecteur sont salutaires en ce qu'ils contraignent à s'interroger sur la validité des actions de prévention. Je pense, comme M. Lagarde, qu'il est juste de s'interroger dès la naissance sur le risque de maltraitance, et le conseil général de Seine-Saint-Denis a défini avec la protection judiciaire de la jeunesse un schéma de protection de l'enfance en ce sens. Il a aussi signé un protocole avec l'éducation nationale. Le travail du département a d'ailleurs été donné en exemple par Mme Claire Brisset, Défenseure des enfants. Notre préoccupation est d'autant plus vive lorsque certains passent au travers des mailles du filet. Il est vrai que la famille considérée n'était pas - ou peu - connue, et qu'aucun dossier n'avait réellement été ouvert à son sujet. Mais, lorsque le tour des services a été fait, on s'est rendu compte de l'existence de plusieurs indicateurs d'alerte. Toutefois, aucun de ces éléments pris séparément ne pouvait justifier que l'on appuie sur le bouton rouge du signalement avant mars 2004, date à laquelle cela a été fait sans obtenir de réponse de la justice. Je ne mets pas en cause le tribunal pour enfants de Bobigny, présidé par M. Jean-Pierre Rosenczveig dont l'action est un élément moteur. Mais, je note que, après la visite du garde des Sceaux, une inspection générale a été diligentée par la Chancellerie au tribunal de Bobigny qui est systématiquement sous-doté, ce qui peut expliquer que les signalements ne soient pas tous suivis d'effet. Le conseil général de Seine-Saint-Denis a installé deux groupes de travail. Le premier est interne, même si l'éducation nationale y a été associée. Pour des raisons historiques, les services sanitaires et sociaux du département sont scindés en trois entités. Le président Bramy souhaite rendre leurs liens plus étroits pour renforcer la cohérence de leurs actions. Une incompréhension a fait qu'en août 2004 nous ne sommes pas allés au bout de la démarche, car nous aurions souhaité que la ville de Drancy contribue à la réflexion. Par ailleurs, un groupe d'experts externes au département a été constitué. On constate que les recommandations des deux groupes convergent : à leurs yeux, l'essentiel est de parvenir à concilier droits des familles et protection de l'enfance, et cette conciliation est possible. La parole de l'enfant a été d'abord niée, puis si bien entendue qu'elle est parfois surévaluée, de sorte qu'il y a désormais un retour de balancier. Où placer le curseur ? Les groupes de travail suggèrent d'évaluer la prise en compte du droit des familles dans les procédures, ainsi que les pratiques de la justice et des acteurs sociaux. S'agissant de la conservation et du partage des informations, ils suggèrent une mutualisation et la constitution d'une « mémoire » consultable par tous les professionnels concernés. Cela suppose des réunions de coordination régulières comme il en existe dans les cas de signalement. Il faut en outre organiser le partage des informations entre les institutions et les partenaires et, à ce sujet, les travailleurs sociaux sont très préoccupés à l'idée que leur mission, qui est d'accompagner des familles grâce à une relation fondée sur la confiance, puisse être désormais perçue comme une mission d'injonction. Il est vrai que, dans le cas décrit, il y a eu stratégie d'évitement. Une telle stratégie peut être pathologique, mais il existe aussi un évitement que l'on pourrait qualifier d'institutionnel, par exemple lorsque les individus cessent d'aller chercher les courriers recommandés à la poste car ils savent que chaque lettre signifie un souci nouveau. Et c'est ainsi que la situation de certaines familles n'est découverte qu'au moment où le commissaire de police vient procéder à l'expulsion locative : elles ne se sont jamais manifestées auparavant pour bénéficier des aides possibles. Il y a un décrochage, une perte de confiance dans les institutions comme dans les élus. Je ne serais d'ailleurs pas surpris s'il apparaissait que la cartographie de l'évitement recoupe celle de l'abstention. Dans les départements où la crise est plus marquée qu'ailleurs, où il n'y a ni emplois, ni logements, les gens renoncent à solliciter les institutions parce qu'elles n'ont plus de solutions à leur proposer. En matière de formation, les deux groupes de travail suggèrent la création d'un cycle commun de formation pour tous les acteurs de la protection de l'enfance. Cela vaut particulièrement pour un département comme la Seine-Saint-Denis dans lequel la rotation des personnels d'État est très rapide et le personnel très jeune. Ils proposent également le renforcement des liens avec les maternités, les cliniques, la médecine de ville et la médecine scolaire. Dans la famille décrite par M. Lagarde, si deux enfants sont nés à domicile, les trois autres accouchements ont eu lieu dans des maternités. Le département compte 120 centres de PMI, où sont examinés 70 % des enfants de Seine-Saint-Denis. Qu'en est-il des 30 % restant, sachant qu'il n'y pas assez de médecins et aucune installation de pédiatres ? Les sorties de plus en plus précoces de la maternité - deux jours après l'accouchement en général - entraînent dans le même temps un surcroît de consultations dans les centres de PMI par de jeunes mères en plein désarroi. Quant à la visite médicale pour les enfants scolarisés en maternelle, elle ne peut pas toujours avoir lieu, en raison du manque de coordination entre l'éducation nationale et la PMI et de la surcharge de travail de cette dernière, si bien que de 30 à 40 % seulement d'une classe d'âge est examinée dans ce cadre, ce qui est insuffisant. Nous avons décidé de renforcer nos efforts dans cette direction. Enfin, les deux groupes de travail concluent qu'une réflexion s'impose sur la visite à domicile. Le travailleur social, dont l'action est fondée sur la confiance, ne peut être amené à faire de la police sociale ou à travailler par injonctions. En revanche, un renforcement des moyens de la police et une meilleure coordination entre services sociaux, justice et police en cas de signalement sont nécessaires. Les missions de chacun des intervenants doivent être soigneusement distinguées au risque, sinon, que les stratégies d'évitement se multiplient. M. Bernard Debré : Nul ne peut se retrancher en permanence derrière le secret professionnel. Je rappelle que toute personne, médecin compris, a le devoir, sous peine d'être accusé de non assistance à personne en danger, de signaler au procureur ce qu'il tient pour une mise en danger de la vie d'autrui. M. Jean-Marc Nesme : La question des moyens est abordée de manière récurrente mais, selon moi, le problème tient essentiellement au manque de coordination. Je ne mets nullement en cause les compétences et le sérieux des différents intervenants, mais l'exemple de Drancy, et bien d'autres malheureusement, témoignent d'un défaut de coordination que l'augmentation des ressources ne règlerait pas. M. Patrice Delnatte : Je perçois fort bien la différence entre accompagnement et injonction, et je comprends le dilemme des travailleurs sociaux. Mais ces derniers ont une hiérarchie. Pourquoi celle-ci ne prend-elle pas ses responsabilités ? M. le Président : J'observe que le maire de Drancy et le vice-président du conseil général s'accordent sur les inconvénients du cloisonnement des informations. M. Jean-Christophe Lagarde : En matière de secret professionnel, ce qui vaut pour le médecin devrait valoir pour les services sociaux. S'il y avait eu obligation d'informer, il aurait été impossible que l'éducation nationale, la justice, les services sociaux départementaux et les services communaux ne se rendent pas compte de ce qui se passait. Il est donc indispensable d'en venir au secret partagé. J'ai donné pour instruction aux services compétents de la mairie de Drancy qu'ils écrivent systématiquement à toutes les institutions concernées aussitôt qu'une anomalie est constatée. Mme la Rapporteure : Les propositions avancées rappellent fortement le dispositif institué pour la protection judiciaire de la jeunesse et je constate que les propositions de M. Lagarde ne semblent pas susciter de réticences au conseil général, qui a la charge de l'aide sociale à l'enfance. Ne peut-on imaginer de réunir tous les acteurs concernés, selon une démarche similaire à celle qui a été mise en place en matière de prévention de la délinquance ? Mme Patricia Adam : La décentralisation a fait du département le chef de file en matière d'action sociale. En prévoir un autre créerait une confusion dommageable. En revanche, l'Association des départements de France estime qu'il convient de repenser l'action sociale. Les services doivent être complètement réorganisés, mais les problèmes sont multiples : insuffisance réelle de moyens d'une part, graves difficultés de recrutement d'autre part. C'est d'ailleurs parce que l'on ne parvient plus à recruter de médecins que 30 à 40 % des enfants sont pas examinés, et la désertification médicale touche autant les campagnes que les banlieues. N'aggravons pas les difficultés en multipliant les instances, alors que reste posé le problème du suivi de la prise en charge des enfants. Il n'y a pas obligation d'échanges entre PMI et santé scolaire, ce qui entraîne une déperdition d'informations éminemment regrettable ; tout repose sur la bonne volonté des parties, ce qui n'est pas satisfaisant. Enfin, compte tenu de ses effectifs, la médecine scolaire est souvent dans l'impossibilité de remplir ses missions, si bien que les instituteurs, démunis, se tournent vers les services du conseil général. C'est illogique. Mme Christine Boutin : Je comprends les préoccupations exprimées par Mme Adam qui souhaite éviter la création d'une nouvelle structure. Cependant, le souci de proximité conduit à se demander s'il ne serait pas préférable de faire remonter les informations vers les maires plutôt que vers les conseils généraux. M. le Président : Les croisements d'informations au niveau institutionnel se font souvent lors des crises. Mieux vaudrait qu'ils soient permanents ; la prévention en serait améliorée. Mme Bérengère Poletti : Certes des moyens supplémentaires peuvent améliorer la situation, mais, dans l'affaire citée, il y a eu deux alertes : l'absentéisme scolaire d'une part, le refus de présenter les enfants à des rendez-vous pédiatriques d'autre part. Cela aurait dû conduire à ce que des mesures soient prises. Lorsque des éléments sont connus, une responsabilité doit s'exercer. Mme Marie-Colette Lalire : S'agissant des mesures de prévention et de détection, trois périodes doivent être distinguées : la période périnatale, le suivi des enfants jusqu'à 6 ans et la période scolaire. Pour la période périnatale, le plan « périnatalité » a été accueilli avec un vif intérêt. Il contient en effet des dispositions importantes tendant à améliorer le suivi des grossesses, et notamment l'institution de l'entretien du quatrième mois qui doit servir à préparer la sortie précoce de la maternité. Il faut renforcer le rôle des sages-femmes et l'indispensable articulation, en amont, entre tous les services médicaux et sociaux pour prévenir les difficultés et veiller à ce qu'au retour au domicile une relation de confiance se soit créée avec les différents intervenants. À cette fin, le département de l'Isère a développé le travail en réseau entre maternités, sages-femmes libérales, médecins de ville et PMI par exemple. Concernant le suivi des enfants jusqu'à 6 ans, l'obligation de la visite des 9 mois paraît en effet souhaitable, tout comme la formation des professionnels au repérage des signes de maltraitance. Il convient aussi de sensibiliser les assistantes maternelles et les structures d'accueil de la petite enfance à ces questions. Comme l'a souligné M. Garnier, il faut mieux articuler le passage de relais entre la PMI et l'éducation nationale pour garantir la continuité du suivi. À cette fin, le département de l'Isère souhaite que le bilan organisé en maternelle par la PMI ait lieu plus tôt. Il faut enfin mener des actions de soutien à la fonction parentale, en étant particulièrement attentif à l'isolement de nombreuses familles, par exemple dans les zones dites « rurbaines ». Pour ce qui est de la période scolaire, je déplore l'inexistence du service social dans le cycle primaire et la faiblesse du nombre de médecins scolaires rapporté au nombre d'élèves. De manière générale, j'insiste sur la nécessité d'un travail en réseau, sur la mise en commun des compétences à tous les niveaux et sur l'élaboration d'une culture commune. S'agissant de l'organisation des services, les départements sont désormais les chefs de file de l'action sociale et notamment de l'aide sociale à l'enfance ; il convient de conforter cette mission qui leur est dévolue par la loi. Il leur appartient de regrouper les informations et de coordonner les services concernés, en respectant les fonctions de chacun. À cet égard, il faut créer des lieux d'échange dans le respect du secret professionnel, mais on ne peut demander aux travailleurs sociaux d'exercer des fonctions qui ne sont pas les leurs, et de communiquer des informations nominatives concernant les familles auprès desquelles ils interviennent. S'agissant du dépistage, des circuits d'évaluation et des procédures écrites sont nécessaires, et, comme la loi le prévoit, un référent de l'aide sociale à l'enfance responsable de la saisine du parquet doit être désigné sans que cela dédouane quiconque de ses responsabilités propres. On notera les difficultés éprouvées par tous les professionnels à penser, repérer et établir l'existence réelle des abus sexuels et des maltraitances psychologiques ; il faut donc une formation permanente à ces questions. Enfin, certaines mères atteintes de psychopathologies mettent leur enfant en danger. Ce risque est difficile à évaluer avant la naissance, mais il faut veiller à l'anticiper par un diagnostic précoce et, si nécessaire, par une bonne articulation avec l'autorité judiciaire. S'agissant de la prévention de la récidive, on constate une multiplication des problèmes psychologiques et un isolement croissant des familles, et la nécessité d'un appui par les services de santé mentale. Or ces services, et particulièrement les services de pédopsychiatrie, sont submergés. Il serait souhaitable aussi de diversifier les mesures éducatives en faisant figurer dans la loi la possibilité de mettre en place des aides intermédiaires entre la mesure d'action éducative en milieu ouvert et le placement, comme, par exemple, l'expérience menée dans le département du Gard. Une aide doit également être apportée aux victimes pour prévenir la répétition. Des moyens médico-psychologiques sont nécessaires pour cela. Il est par ailleurs indispensable de revoir les pratiques professionnelles. Se rend-on bien compte qu'il n'y a presque plus de visites à domicile ? Les médecins de famille n'en font pour ainsi dire plus, pas plus que les assistantes sociales, en charge de problématiques nombreuses. Parce qu'elles sont organisées par catégorie de profession, les formations ne correspondent plus aux besoins : il faut impérativement instituer un socle de connaissances commun à tous les intervenants, et multiplier les passerelles. Mais le problème des moyens est patent. Pour l'assistance éducative en milieu ouvert décidée par le juge, un travailleur social suit trente enfants et ne peut donc passer qu'une demi-journée par mois dans une famille. Comment, dans de telles conditions, s'attendre à un suivi satisfaisant ? Pour ce qui est enfin du secret partagé, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé contient une amorce de réponse qui pourrait être étendue au secteur social et médico-social. M. Jean-Marie Delassus : Les problèmes évoqués prennent à la gorge, si bien que l'on risque de voir émerger le « syndrome du delta » et, avec lui, la demande de multiplication de moyens, lesquels ne résoudront pas tout, tant s'en faut, étant donné l'évolution des mœurs et de la parentalité. Celle-ci n'est pas un lien inné ; c'est un affect qui ne s'impose pas d'emblée à tous, mais qui, lorsqu'il est ressenti, garantit que les enfants seront aimés par leurs parents. La maltraitance étant une maladie de la parentalité, il faut agir pour que s'instaure une parentalité humaine et valable. Cela suppose d'accorder toute son importance au proto-regard du nouveau-né, ce regard particulier, d'une très grande force, qui passe en général inaperçu parce qu'il peut être très vite empêché par une « mise en peau à peau » immédiate ou par une prise en charge néonatale. Ce regard, qui doit être distingué du « lever des yeux » ultérieur, est d'une telle intensité qu'il bouleverse profondément celle ou celui qui le reçoit ; ignoré, voire inconnu de la clinique obstétricale, il a pourtant un effet « parentalisant ». Le personnel des maternités doit être formé à l'importance du proto-regard, et laisser le temps nécessaire à l'établissement de ce lien « yeux à yeux », car l'expérience montre que, pour une bonne part, les mères en difficulté n'ont pas vécu ce moment et se sentent dépossédées d'un moment crucial de la naissance. Il faut, ensuite, comprendre la possibilité de l'effondrement maternel précoce. Ne pas avoir vu et reçu le proto-regard crée une période de trouble et d'angoisse qui peut aboutir à la difficulté maternelle, rarement avouée tant elle est culpabilisante. Il se produit alors un effondrement du soi qui, s'il n'est pas pris en charge dans les meilleurs délais, persiste sans être davantage énoncé ni confié. Un sillon se creuse alors jusqu'à l'instauration d'une dépression maternelle, dont l'une des conséquences peut être que l'on se met à considérer son bébé comme un « mauvais bébé ». La prévention de la maltraitance commence donc au moment même de la mise au monde, et la vigilance du personnel soignant doit favoriser le proto-regard en salle d'accouchement. Il faut, d'autre part, s'attacher à percevoir très tôt l'échec éventuel de l'installation de ce lien et de l'effondrement maternel qui s'ensuit, et le prendre en charge immédiatement, au besoin par des soins en service de maternologie. De telles mesures assurent la résilience, et plus de la moitié des cas de maltraitance peuvent être ainsi évités. En somme, la qualité de la naissance paraît le meilleur moyen de prévenir la maltraitance. Il faut immédiatement donner aux parents les moyens de ne pas être maltraitants ; sinon, tout sera ensuite beaucoup plus long, plus aléatoire, plus coûteux et plus risqué. M. Michel Andrieux : D'une recherche réalisée en 2000 par l'Association nationale des professionnels et des acteurs de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille sous la direction du docteur Jacques Dayan, il ressortait que 60 % des enfants accueillis en foyers de l'enfance ou en maisons d'enfants à caractère social avaient été victimes de maltraitances avérées ; que 30 % de ces enfants victimes avaient bénéficié de soins ; que pour les 40 % d'enfants qui, selon les informations connues, n'avaient pas été maltraités, le symptôme assez flou de carence éducative pouvait être avancé. Ces données semblent toujours pertinentes, même si le nombre de placements a diminué et si le maintien dans la famille, estimé hautement souhaitable par tous, s'est accentué, sans que ce choix soit toujours objectivé par un diagnostic partagé. Comme les intervenants qui m'ont précédé, je pense que la prévention primaire et la détection des risques de maltraitance doivent commencer dès la période périnatale. C'est dire l'importance du suivi psychologique de la grossesse, et particulièrement de l'entretien du quatrième mois. Les instances créées pour prévenir la délinquance constituent des exemples intéressants, mais, très souvent, elles manquent de personnel et les personnes qui siègent dans ces instances ne sont pas clairement mandatées. Il faudrait, dans le cas qui nous occupe, créer une « tête de réseau » chargée de coordonner la prévention médico-sociale de la grossesse, développer les accueils séquentiels dans les crèches et les haltes-garderies en assouplissant les horaires, repenser le service social scolaire, décider d'une intervention psychosociale systématique dans les écoles maternelles et primaires et mobiliser des équipes de prévention spécialisées. Il faudrait également proposer un soutien dès la grossesse et durant le post-partum et, si besoin est, imposer des mesures de suivi et d'aide en mobilisant la PMI et les travailleuses familiales. Lorsque les risques apparaissent très élevés, il conviendrait d'envisager une hospitalisation, afin de proposer des mesures d'évaluation qui, à l'image de ce qui est fait au Royaume-Uni, permettraient de conduire à une séparation préventive. La détection des risques de maltraitances suppose une coordination entre la PMI, les services sociaux et hospitaliers et les lieux de garde et d'enseignement, avec des réunions régulières. Elle suppose aussi une amélioration de la cohérence entre les mesures administratives et les mesures judiciaires, ainsi qu'une formation spécifique transdisciplinaire aux signes de reconnaissance des enfants victimes, sans pour autant faire des travailleurs sociaux des policiers - les indices et les présomptions ne constituent pas des preuves -. Elle suppose enfin l'élaboration de référentiels communs, permettant à chaque professionnel de faire face à des situations de danger ou pressenties telles. Je plaide d'autre part en faveur d'un « secret social partagé », selon les dispositions calquées sur la circulaire santé-justice du 21 juin 1996 applicable aux médecins. Le secret partagé doit être restreint au partage exclusif des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'action. L'accord de principe des intéressés doit être obligatoirement recueilli, sauf en cas de mise en danger d'un mineur. En outre, un modèle de charte entre les institutions doit définir le cadre de ce partage obligatoire de l'information qui n'existe pas actuellement. La protection de l'enfance doit devenir véritablement pluridisciplinaire, et des formations communes faciliteront l'instauration du secret professionnel partagé. Le « risque zéro » n'existe pas. Malgré tout, on doit s'interroger pour savoir comment éviter les récidives et améliorer le suivi des familles. Il faudrait commencer par financer les mesures que je viens de proposer et les mettre en application. Il faudrait surtout mieux articuler les institutions qui participent du dispositif de protection de l'enfance, afin d'améliorer la continuité du suivi. Il convient également de renforcer le travail avec les parents, en proposant une aide et une évaluation psychologique systématiques aux parents ayant commis des actes de maltraitance. Il faudrait encore repenser les missions de la protection de l'enfance et s'interroger en particulier sur l'intérêt de conserver systématiquement les liens entre l'enfant et sa famille. Au cas où ce lien apparaît devoir être conservé, il faut revoir totalement le dispositif des visites dites « médiatisées », auxquelles le personnel doit être formé. Il faudrait aussi développer les visites d'équipes techniques à domicile, qui devraient pouvoir intervenir en permanence et non plus seulement aux heures de bureau. Il faut encore assurer le suivi des mesures consécutives aux saisines du parquet des mineurs, dont on sait le rôle essentiel, puisqu'il peut décider de classer ou de ne pas classer un signalement ; développer l'obligation de soins pour les parents maltraitants qui sont également en souffrance ; multiplier les solutions d'accueil temporaire pour parents et enfants ; soigner systématiquement les enfants, adolescents et jeunes majeurs victimes de maltraitances pour que les maltraités d'aujourd'hui ne soient pas les maltraitants de demain. Il faut également alléger le nombre des prises en charge par les travailleurs sociaux, particulièrement ceux de l'aide sociale à l'enfance. Comment pourraient-ils assurer un suivi véritable quand ils ont chacun la charge de 35, voire de 50 familles, et que la situation de ces familles devient de plus en plus complexe ? Il faut donner enfin les moyens au travail social de se construire comme un savoir à part entière, et le reconnaître comme une discipline au lieu d'en faire un outil idéologique. Je ne saurais conclure sans observer qu'il y a vraisemblablement un lien entre le fonctionnement de notre société et la maltraitance, et qu'il est plus facile de s'occuper de ses enfants quand on est riche et bien portant... Mme Catherine Sultan : La justice est interpellée par les questions de votre Mission, auxquelles il est sain de réfléchir. Pour autant, on ne parviendra jamais au « risque zéro », car on intervient dans un domaine pathologique et, aussi grande soit la proximité, la complexité des situations demeure. La justice des mineurs porte tant sur la protection de l'enfant en danger que sur le suivi de la délinquance des mineurs. Notre droit considère donc l'enfant dans sa globalité, en proposant des réponses différentes selon les causes qui sont à l'origine de sa rencontre avec la justice. La société affirme son engagement à le protéger et à l'éduquer, et le juge des enfants, qui incarne ce choix, assume une double compétence, sur l'enfant en danger et sur l'enfant auteur d'un délit. L'intervention du juge se construit dans la durée pour permettre des réponses souples, spécialisées, pensées en complémentarité avec les professionnels socio-éducatifs. Il s'agit donc d'une justice ambitieuse et, de ce fait, complexe et exigeante. L'autorité parentale est constituée d'un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité la protection et l'épanouissement de l'enfant. Les parents exercent cette responsabilité librement selon leurs choix et valeurs propres, et il revient au juge d'en contrôler les abus et les errements quand ils exposent l'enfant à un danger ou qu'ils compromettent gravement ses conditions d'éducation. Il s'agit d'un critère à la fois ouvert, car les situations sont très diverses, et exigeant, car il ne doit pas aboutir à un contrôle abusif des comportements individuels. En cas de danger, le juge décide des mesures de protection qui s'imposent. Il porte ainsi atteinte à l'autorité parentale, dont les parents conservent l'exercice dans les limites conciliables avec la mesure de protection. Le juge des enfants n'est pas l'arbitre entre les droits parentaux et ceux de l'enfant : il assure prioritairement la protection de l'enfant en tenant compte du respect des droits des parents. Les règles du secret professionnel et leur compatibilité avec l'obligation de dénoncer reposent sur la même recherche d'équilibre. Il s'agit de respecter la vie privée et de préserver la confidentialité indispensable à la relation de confiance, fondamentale au travail social, tout en rappelant l'obligation de porter secours et de signaler à l'autorité compétente les situations d'enfants en danger. Le droit est clair et cohérent, mais son application est semée d'embûches. Elle implique en effet des professionnels d'horizons différents dont les représentations ne sont pas identiques, et porte sur des situations toujours chargées d'implications personnelles. Il est donc essentiel de faciliter une culture commune. Cela suppose une concertation locale continue et volontariste entre les différents acteurs et responsables du dispositif de protection de l'enfance, dans le respect des missions de chacun. Cela suppose aussi un effort soutenu de formations transversales réunissant des professionnels des secteurs concernés. Cela suppose enfin un cadre législatif clair, avec des échelons de responsabilité cohérents et identifiables ; c'est d'ailleurs la ligne directrice de la réflexion relative au secret partagé, qui ne doit concerner que les intervenants chargés d'une mission en la matière. Les enjeux de la protection judiciaire de l'enfance en danger ne sont pas exclusivement juridiques. En effet, les mesures décidées par le juge tendent à être intégrées par les enfants et les parents pour avoir une influence positive sur leurs trajectoires. C'est cette finalité qui justifie la spécialisation de la justice des mineurs. Elle s'appuie sur la procédure d'assistance éducative à partir de laquelle le juge travaille avec d'autres professionnels pour élaborer des stratégies d'intervention et suive le déroulement des mesures dans le temps et jusqu'à leur échéance, sans se contenter d'arbitrer ponctuellement un conflit d'intérêts. À cet égard, l'expérimentation prévue par la loi de décentralisation d'août 2004 pourrait remettre en cause cette garantie. La protection judiciaire de l'enfance en danger requiert également un engagement individuel : le juge des enfants est un juriste, en capacité de mesurer et de comprendre les effets concrets de ses décisions ; il doit posséder des connaissances dans le domaine de l'enfance qui dépassent ses convictions personnelles en matière d'éducation. La formation doit être renforcée et la stabilité dans la fonction doit être défendue, alors qu'aujourd'hui la mobilité est importante et les carrières de juges des enfants peu encouragées. La fonction d'encadrement des présidents de tribunaux pour enfants doit être reconnue en instaurant des postes à profils. Il faut enfin renforcer le contrôle des pratiques : affirmer l'obligation pour le juge des enfants de maintenir une concertation avec les partenaires ; augmenter, dans le domaine de l'assistance éducative, la disponibilité des parquets qui ont trop tendance à négliger le suivi des dossiers, happés par le nombre des dossiers au pénal ; mieux contrôler les dysfonctionnements judiciaires. En ce qui concerne la détection, la prévention et le suivi des enfants en danger, la réalité est contrastée. Le juge des enfants statue à partir des informations portées à sa connaissance et se trouve dépendant des moyens existants. Il est saisi par un signalement et les mesures de protection qu'il instaure sont mises en œuvre par des services départementaux, associatifs ou publics. S'agissant du signalement judiciaire, la détection des situations d'enfants en danger s'appuie sur les moyens et la qualité de l'implantation locale des acteurs de la prévention et sur les outils d'observation à disposition. La situation est très diverse selon les départements. Ainsi, les unités d'hospitalisation mère-enfants sont encore rares. Dans les quartiers en grande difficulté, l'assistante sociale ne semble plus perçue comme un recours de proximité, et elle est surtout requise par des tâches administratives. La question centrale de l'opportunité de signaler à l'autorité judiciaire dépend également de l'organisation et des moyens des services, ainsi que de la capacité de l'aide sociale à l'enfance à maintenir une dynamique de réflexion et d'analyse. Elle est le révélateur et le pilier des choix d'une politique départementale de protection de l'enfance. Améliorer le suivi des enfants en danger est essentiel pour prévenir la récidive. Prendre en charge un enfant en danger, accompagner ses parents dans l'exercice ou la limitation de leurs responsabilités exigent des savoir-faire particulièrement élaborés, des projets individualisés, une réflexion continue. Ce corpus de connaissances existe, mais il n'est pas généralisé dans la pratique ce qui conduit à pratiquer l'« à peu près » là où il faudrait du « sur-mesure ». On manque aussi de services spécialisés en matière éducative ou thérapeutique, dès la petite enfance. Nombre d'enfants attendent six mois, voire un an, pour bénéficier d'une orientation ou d'un suivi psychologique. Les référents éducatifs doivent assumer des responsabilités démesurées à l'égard d'un trop grand nombre de familles. Comment dès lors maintenir la priorité éducative et individuelle sans céder à une logique administrative ou gestionnaire ? Plus de quinze ans après la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, force est de constater que le niveau d'exigence est inégalement compris, faute d'une impulsion nationale dans un domaine pourtant crucial. Des projets de réforme sont débattus, des réflexions sont engagées, des critiques sont portées dans un certain désordre, mais nous avons besoin d'un grand débat national, à partir d'une évaluation et d'un bilan des pratiques. M. Bruno Percebois : Après avoir été longtemps un service d'État, le dispositif de la PMI est devenu départemental avec la décentralisation du début des années 1980. Elle est donc sous l'autorité des conseils généraux, mais reste régie par des textes propres du code de la santé publique : loi de décembre 1989 et décrets de 1992. Si ces textes encadrent l'action des départements, il faut signaler qu'environ la moitié d'entre eux n'appliquent pas les normes minimales légales, notamment en ce qui concerne les normes de personnels, puéricultrices, sages-femmes, ou les consultations de jeunes enfants. Le service de PMI doit organiser des consultations prénatales, prénuptiales, pour les femmes enceintes, des activités de planification familiale, ainsi que des consultations et des actions de prévention en direction des enfants de moins de six ans, notamment en école maternelle. Sur ce point, il faut corriger ce qui a été dit précédemment : il y a des liens entre le service de PMI et les services de santé scolaire avec la transmission prévue par la loi des dossiers réalisés à l'occasion de ces bilans. Enfin le service de PMI mène des actions médico-sociales préventives à domicile « assurées à la demande ou avec l'accord des intéressés ». Notre intervention se fonde sur une base de confiance avec les familles en lien avec le médecin traitant ou l'hôpital, dans le cadre d'une coordination de soins ou de suivi quel que soit le motif de cette coordination. L'évitement de certaines familles qui a été abordé précédemment renvoie à la question de la perte de confiance dans les services sociaux dont a parlé M. Garnier en introduction. Le service de PMI est donc chargé d'offrir à la population des prestations à caractère préventif dans le cadre de la politique de santé publique. Il s'appuie pour cela sur des équipes pluridisciplinaires, ce qui me paraît très important, car on sait que les médecins libéraux se sentent souvent très seuls face aux problèmes de maltraitance que nous abordons ce matin. Enfin, si nous nous adressons à l'ensemble de la population, nous sommes aussi capables d'offrir des prestations adaptées à des sous-populations : enfants handicapés, familles précarisées, familles d'origine étrangère. Notre objectif est de contribuer à créer des conditions de développement harmonieux des enfants. Nous disposons à cette fin d'un certain nombre de leviers : connaissances, compétences, formation. Mais il faut hélas constater que nous ne pouvons intervenir sur bien des aspects des conditions de vie des familles qui ont bien sûr une forte influence sur les enfants, comme les ressources ou les conditions de logement. Nous menons des actions de prévention primaire, comme, par exemple, les vaccinations contre les maladies infectieuses. À cette occasion d'autres difficultés peuvent être dépistées - terme qui appartient au champ médical et que nous préférons à « repérées » -. Pour nous, la vraie question qui se pose c'est : que faire, comment parler à la famille de cette difficulté ? La question de savoir à qui transmettre cette information vient après. Cela renvoie au problème de la formation qui d'ailleurs était prévue par la loi du 10 juillet 1989 et qui ne s'est pas vraiment mise en place. Notre dispositif est un véritable atout et de nombreux pays s'intéressent à notre PMI. S'agissant plus spécifiquement de la prévention de la maltraitance infantile, l'existence de centres de PMI dans le quartier, « au pied de la tour », constitue en soi un lieu où, en confiance, des familles peuvent venir chercher de l'aide. Je souhaitais aussi dire quelques mots des facteurs de risque. Il s'agit de notions statistiques concernant des populations qui ne sont pas opératoires face à des êtres humains dans une relation clinique. Pour une personne, ce sera zéro ou cent pour cent... Par ailleurs, ces facteurs sont multiples, se situent dans une dynamique, et interagissent ensemble : le proto-regard dont nous a parlé M. Delassus n'en constitue qu'un parmi de nombreux autres. Enfin leur identification est largement soumise à la subjectivité de ceux qui l'effectuent, qui ont eux-mêmes leur propre histoire, leurs représentations, leurs projections. C'est un sujet sur lequel il faudrait travailler en développant des lieux de parole pour les professionnels sur le modèle des groupes Balint. Il faut faire attention aux phénomènes de reconstruction d'une histoire familiale a posteriori, et surtout ne pas confondre prévention et prédiction, comme l'a fort bien dit Bernard Golse à propos de la pédopsychiatrie. Pour répondre à votre question sur les mesures, il est donc difficile de répondre à la question telle qu'elle est formulée : le service de PMI n'exerce pas de mesures comme cela existe dans le domaine éducatif, mais répond à la demande ou fait des propositions à la population sur la base d'actions librement consenties. Cette question est essentielle car elle engage la confiance. On trouve encore des familles qui ont du mal à aller vers une assistante sociale, parce que celle vue il y a vingt ou trente ans a « placé les enfants ». S'agissant de l'âge, c'est bien sûr dès la période prénatale que de la prévention peut se mettre en place, ou autour de la naissance qui est une période qui peut révéler des fragilités de tout ordre et voir surgir des difficultés. Le service de PMI a aussi des missions de protection de l'enfance : il est amené à traiter des signalements, par exemple ceux qui sont faits par l'intermédiaire du numéro vert 119. Dans mon département, une équipe locale de PMI peut contribuer à l'évaluation. Dans votre deuxième question concernant le partage d'informations, vous paraissez faire une distinction entre secret professionnel, droits des parents et droits des enfants. Pour moi, le premier est partie intégrante de deux autres. Le secret n'est pas une prérogative des professionnels destinée à les protéger, mais une garantie donnée aux usagers de pouvoir se confier et aux professionnels de pouvoir exercer leur métier correctement. Il organise un espace de confiance qui permet les confidences nécessaires à l'exercice de notre métier. Nous sommes là sur le terrain des libertés publiques et des droits de l'homme. Nous sommes surpris de la manière dont cette question du partage d'informations pour protéger les enfants est posée. Pour nous, le partage d'informations est déjà une réalité, comme le montrent tous les dispositifs d'évaluation en place. Le récent rapport de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS) recense les signalements de 18 000 enfants maltraités et 89 000 enfants en risque pour 2003, ce qui prouve bien que les professionnels partagent des informations et signalent quand cela paraît nécessaire. L'ODAS observe d'ailleurs que ce dernier chiffre est en constante augmentation, parallèlement à l'accroissement du nombre de familles fragiles souvent trop isolées pour offrir à leurs enfants des conditions de développement satisfaisantes, ce qui renvoie à la situation économique de notre pays. Pour nous, la loi a déjà fixé un cadre pour ce partage, et, de ce point de vue, nous sommes surpris de voir apparaître dans plusieurs départements des chartes ou protocoles de partage d'informations qui ne font pas référence à la loi. Rappelons ici l'article 226-14 du code pénal qui permet la levée du secret, sans risque d'être condamné, en cas de privations ou de sévices infligés à un mineur. Dans le code de la déontologie, le médecin doit être le défenseur de l'enfant. L'application de cet article pose la question du curseur du danger : à partir de quel moment est-il nécessaire de défendre un enfant ? En matière sociale, il y a la circulaire interministérielle d'août 1996 qui pose un cadre assez clair, notamment l'information de l'usager et le contrôle du devenir des informations partagées par le professionnel. La loi sur le droit des malades est également explicite : les professionnels de santé peuvent échanger des informations à condition que le malade en soit informé et ne s'y oppose pas. Il faut également que ces informations soient utiles et pertinentes. La circulation d'informations est donc possible, mais pas auprès de n'importe qui et pas à tout vent : elles doivent être destinées à des personnes susceptibles d'intervenir et auxquelles la loi a assigné des missions. Dans le cas des enfants en danger ou maltraités, le signalement doit être adressé soit auprès des services du conseil général, soit auprès des procureurs du parquet des mineurs. Je suis donc surpris qu'il y ait ce débat alors que les dispositifs existent et qu'ils fonctionnent. Mais peut-être sont-ils mal connus, ce qui renvoie aux problèmes de la formation dans nos métiers. Nous sommes favorables à un partage d'informations contextualisé, c'est-à-dire qui répond à un problème dans un contexte donné. L'usager doit être associé à cet échange : il faut d'abord parler avec la famille, car c'est la seule manière de faire avancer les choses. Nous sommes en revanche hostiles à l'idée d'un partage d'informations obligatoire. Je me réjouis que, dans sa sagesse, le législateur, lors de la réforme du code pénal de 1994, n'ait pas rendu obligatoire le signalement des enfants en danger, car, sans parler du probable embouteillage des tribunaux, qui existe d'ailleurs déjà, il aurait fallu définir précisément à partir de quel stade d'inquiétude l'obligation commençait, ce qui est strictement impossible. Surtout, une telle mesure aurait considérablement gêné la mise en œuvre de toutes les autres manières de porter assistance à un enfant ou une famille en difficulté. Faites confiance aux professionnels en les laissant apprécier la situation ! Nous sommes également hostiles à un partage d'informations qui consisterait à alimenter une base de données sur les familles dont on ne sait ni par qui, ni dans quelles conditions elle pourrait être consultée. Aux termes de la circulaire de 1996 et de la loi sur le droit des malades, il faut que celui qui « donne » une information puisse contrôler ce qu'elle devient. Tel ne serait pas le cas si on créait le fichier préconisé par certains, qui pourrait s'apparenter à un « casier social » sans les garanties dont est entouré le casier judiciaire. Il nous paraît indispensable de cloisonner et de protéger les données, c'est une question de démocratie au même titre que la séparation des pouvoirs. Un mot enfin pour signaler la grande insuffisance des moyens. On a parlé de la médecine scolaire qui, en offrant un médecin pour 8 000 élèves, doit faire face à de grandes difficultés. La pédopsychiatrie est un secteur sinistré où il faut plusieurs mois d'attente parfois pour obtenir un rendez-vous. De même, les sorties précoces de maternité directement liées aux fermetures de lits ne facilitent pas la prévention autour de la naissance, évoquée précédemment. Mme Jeanne-Marie Urcun : En 2002-2003, onze académies, qui représentent 4 millions d'enfants, ont fait remonter par le service médical et social de l'éducation nationale des signalements pour 8 094 élèves, dont 2 000 au titre de l'enfant maltraité et 6 000 au titre de l'enfant à risque. Ces chiffres ne reflètent que l'activité professionnelle des médecins, des infirmières et des assistantes sociales : bien d'autres intervenants au sein de l'éducation nationale participent à la protection de l'enfance, en signalant eux-mêmes les situations qu'ils rencontrent, soit aux conseils généraux, soit aux procureurs. L'attention que l'éducation nationale porte à ce problème depuis de nombreuses années a permis de mettre en place une prévention primaire qui permet de former les enseignants à apprécier la réalité des faits, l'existence des signes d'appel et les modalités d'accompagnement des enfants dont ils ont remarqué les difficultés. Ces formations sont maintenant systématiques dans les instituts universitaires de formation des maîtres. Le ministère a organisé en 2001-2002 cinq séminaires rassemblant des inspecteurs de l'éducation nationale pour les mettre au fait des obligations légales. Je rappelle à ce propos que les enseignants ou non enseignants et les fonctionnaires ont obligation, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale, de signaler tout délit ou crime qui serait porté à leur connaissance. Cette prévention primaire en direction des adultes s'accompagne d'une sensibilisation des enfants qui doivent savoir ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas accepter, et où ils doivent s'adresser quand ils rencontrent des difficultés. Conformément à la loi du 6 mars 2002, ces actions sont destinées aux enfants de tous âges : j'ai personnellement participé à la prévention des violences sexuelles auprès d'enfants de cinq ans. Dans le cadre de la prévention secondaire, en application de la circulaire du 26 août 1997, les académies disposent des centres de ressources départementaux, afin que les personnes qui doivent faire un signalement puissent être entendues et accompagnées. Ces centres de ressources sont également destinés à aider les personnels à distinguer entre enfant maltraité et enfant à risque. Les signaux d'alarme doivent être connus de tous, enseignants, non enseignants, mais aussi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Partager l'information peut être utile pour permettre d'évaluer et de suivre un enfant et sa famille. Cependant, si les enseignants regrettent parfois de ne pas savoir ce que deviennent les enfants qu'ils ont signalés, il faut trouver un équilibre entre la nécessité de faire circuler l'information auprès des professionnels et une diffusion trop large de cette information, pour éviter une stigmatisation trop rapide et préserver l'espace privé pour l'enfant et pour sa famille. Il est vrai aussi que le nomadisme médical empêche de faire l'addition des signes. Peut-être le dossier médical partagé sera-t-il une bonne réponse. Il convient par ailleurs d'avoir à l'esprit que les difficultés peuvent être présentes quelles que soient les catégories socio-professionnelles : il peut y avoir autant de difficultés et de souffrances non dites en ville qu'au fond d'une campagne paisible, et les enfants des milieux aisés ne sont pas à l'abri de la maltraitance. C'est d'ailleurs l'une des difficultés qu'on rencontre pour repérer les enfants en danger. M. Jean-François Villanné : Comme les autres participants à cette table ronde, nous pensons, à l'Union nationale des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (UNASEA), que la prévention et la détection des situations mettant en danger des enfants doivent être les plus précoces possibles, et intervenir, si de telles situations sont prévisibles, voire seulement soupçonnées, avant même la naissance. Même s'il arrive que l'actualité mette en évidence des drames que nous n'avons pu éviter, des moyens de détection existent et ils sont efficaces dans la plupart des cas : prévention spécialisée, PMI, assistance éducative en milieu ouvert et unités spécifiques pour mères ou futures mères adolescentes lorsque s'impose un hébergement ou une mise en sécurité. Il est évidemment nécessaire d'accroître les moyens en ciblant davantage les situations à risque. Je prendrai comme exemple ces jeunes adultes, connus pour la plupart d'entre eux par les services sociaux, qui se mettent en couple en cumulant souvent leurs handicaps personnels et qui connaissent des problèmes de chômage, des difficultés de logement, la solitude et l'exclusion. Même s'il faut se garder de toute stigmatisation, il est évident que leurs enfants courent des risques majorés, bien souvent avant même leur naissance. La présence sur le terrain d'équipes socio-éducatives et de prévention spécialisées, renforcées par des psychologues intégrés à ces équipes, permettrait de rassurer, de conseiller ces jeunes parents, éventuellement de signaler aux services sociaux ou judiciaires les situations de grands dangers. Encore faut-il, bien entendu, qu'il s'agisse d'interventions dynamiques réalisées sur les lieux de vie des personnes avec un partage de leurs temps quotidiens. Car nous savons bien que diriger un jeune, qui plus est un couple de jeunes, submergé de problèmes, vers un spécialiste auprès duquel il faudra prendre rendez-vous, parfois longtemps à l'avance, et qui recevra en consultation derrière son bureau, est une démarche pratiquement vouée à l'échec. Je vous ai remis les actes des journées d'étude organisées en novembre 2004 par l'UNASEA et l'Association des consultations et de thérapies individuelle et familiale (ACTIF) sur le thème « Secret professionnel, éthique et bonnes pratiques », qui sont un précieux outil de travail. Ce document est trop long pour être commenté ici, mais il répond entre autre aux questions suivantes : qu'est-ce qui fait qu'une information est secrète ? Qui est tenu à ce secret ? Dans quel cas les travailleurs sociaux peuvent-ils opposer le secret professionnel ? Quand parle-t-on de violation du secret et quelles sont les conséquences professionnelles et pénales ? Dans le travail en réseau, quelle est la place du secret partagé ? Quelles sont les personnes qui peuvent faire partie du réseau ? L'UNASEA considère que l'éthique professionnelle requiert du travailleur social une grande compétence technique, car éthique, technicité et expérience sont indissociables si on veut respecter la vie privée de l'usager et agir avec un maximum d'objectivité. Cela pose bien évidemment la question de l'adéquation des formations initiales et continues aux réalités du terrain. Elle considère également que, dans un réseau, la totalité des intervenants, y compris les financeurs et les élus, doit être soumise aux mêmes exigences de déontologie, sinon la notion de secret partagé n'a plus aucune raison d'être. Les compétences et responsabilités de chaque intervenant diffèrent en fonction de leur spécialité et doivent être strictement respectées. L'UNASEA estime enfin qu'il n'y a pas, dans les domaines de la confidentialité et du secret, des règles universelles, transférables d'une situation à une autre. C'est en respectant ces trois exigences qu'il est possible de partager des informations tout en respectant le secret professionnel, le droit des parents, le droit et l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans votre troisième question, la notion de récidive nous a posé problème : ce mot a une connotation pénale et s'applique généralement à des individus, alors que la question concerne la famille. Nous pensons que le suivi évoqué ici a pour finalité la résolution des problèmes qui ont amené à un passage à l'acte, afin que celui-ci ne se reproduise plus. Il semble qu'un meilleur partage des connaissances entre travailleurs sociaux et entre organismes chargés de la protection de l'enfance peut permettre une meilleure prévention de la récidive. Cette dernière peut être la conséquence de l'isolement des professionnels et d'une absence de secret partagé. II nous semble également indispensable de renforcer les équipes pluridisciplinaires, car psychologues et pédopsychiatres font cruellement défaut. Ces équipes doivent aller vers les usagers au lieu d'attendre d'eux des démarches volontaires que certains sont bien incapables d'engager. Bien évidemment, cette politique a tout intérêt à se développer au plan local, si besoin, sur la responsabilité du conseil général, en associant de la façon la plus judicieuse, en fonction des équipements, les moyens du secteur public et ceux du secteur associatif. M. Pierre-Louis Fagniez : La très bonne synthèse de M. Villanné montre que tout le monde doit s'occuper de cette question, y compris les médecins. On a beaucoup parlé du manque de médecins. S'il est vrai que cette profession n'est guère menacée par le chômage, on ne manque pas en revanche de psychologues. Ne conviendrait-il donc pas de mieux définir ce que chacun doit faire ? Ne faudrait-il pas parler moins du manque de médecins que du manque de recours à un professionnel ? Mme Bérangère Poletti : Je me souviens que, en tant qu'élue locale chargée des dossiers de prévention de la délinquance dans le cadre du contrat de ville, je me demandais souvent pourquoi on n'était pas intervenu bien plutôt, avant même la naissance, pour éviter un parcours qui était prévisible à l'avance. En tant que sage-femme, je savais fréquemment, dès l'hôpital, qu'il y aurait ensuite des problèmes. J'ignore si on est là dans le cadre du proto-regard, mais il est clair que la situation au moment de la naissance est révélatrice du lien qui va se construire par la suite, mais qui a en fait commencé à se construire dès la conception. La grossesse, les relations entre les parents, l'arrivée de l'enfant, les suites de couches, le retour à la maison sont tous des moments importants. Sans doute les professionnels devraient-ils être mieux formés à appréhender l'ensemble des aspects de l'accession à la parentalité. Nous devrions aussi nous interroger sur le fait que les cours de préparation à la naissance ne sont fréquentés que par les femmes qui s'inscrivent dans une démarche positive, et qu'ils laissent de côté toutes celles qui en auraient vraiment besoin. Pour ma part, je n'ai jamais été formée à la détection des risques de maltraitance au cours de mes études de sage-femme, alors que j'aurais aimé, quand je constatais des problèmes lors des consultations prénatales, disposer d'outils et savoir à quels professionnels m'adresser. Car un des principaux problèmes est en effet que les professionnels ne se parlent pas. Il faut vraiment s'intéresser, dès le départ, à tous ceux qui ne savent pas ce que signifie être parents, qui ignorent que c'est difficile et qui découvrent qu'un enfant peut être malade et pleurer la nuit. Car c'est souvent ainsi que les choses commencent à déraper, par méconnaissance. N'oublions pas non plus, quand nous accueillons des jeunes en difficultés, que ce sont de futurs parents qui vont probablement reproduire les carences dont ils ont souffert. Mme Patricia Adam : Je remercie tous les participants pour leurs interventions empreintes de bon sens, et qui s'appuient sur des réflexions partagées. Les propositions n'ont pas manqué, et c'est à nous qu'il appartient maintenant de les mettre en pratique. Estimez-vous, madame Sultan, en tant que juge pour enfants, que les outils d'observation et les rapports qui vous sont faits sont suffisamment précis et objectifs pour vous permettre de prendre les bonnes décisions ? Par ailleurs, même si je suis consciente qu'il n'y a pas suffisamment de magistrats, je me demande s'il est possible qu'un juge pour enfants travaille seul, sans conseiller. J'ai été choqué, monsieur Percebois, de vous entendre parler de « casier social » à propos des connaissances partagées. Comment pourrons-nous partager les informations si nous ne disposons pas des outils nécessaires ? Il nous faut bien analyser les besoins à partir d'éléments objectifs, donc de dossiers. Aujourd'hui, les conseils généraux manquent d'informations quantitatives pour savoir quels moyens ils doivent affecter à leurs missions. J'ajoute que ces informations sont d'autant plus nécessaires que les services sociaux et médicaux s'inscrivent désormais eux aussi dans une culture du résultat. Enfin, les outils informatiques permettent aujourd'hui de garantir la confidentialité. Je crois donc qu'il faut vraiment que les professionnels fassent confiance à leur hiérarchie et aux élus. S'agissant enfin de la santé scolaire, je m'interroge sur son maintien au sein de l'éducation nationale. Il ne s'agit nullement pour moi de dire que le travail est mal fait, mais de chercher à être le plus efficace possible compte tenu du faible nombre d'intervenants. Je m'interroge aussi sur le nombre de signalements : ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'on est efficace, un nombre élevé de signalements pouvant au contraire signifier qu'on ouvre le parapluie mais qu'on est incapable de traiter les problèmes. Pouvez-vous, madame Urcun, nous dire quel est le nombre de médecins et d'infirmières dans les établissements scolaires ? Pour ma part, j'ai fait le calcul dans mon département, et je ne vois pas comment, avec les effectifs actuels, la santé scolaire pourrait remplir sa tâche... M. Pierre-Christophe Baguet : Vos interventions montrent la complexité du dossier et la difficulté de mettre en place les procédures de prévention de la maltraitance les plus efficaces possible, tout en respectant les libertés individuelles. J'ai entendu une forte demande pour un échange des informations. Je suis donc un peu gêné des réticences que j'ai senties chez M. Percebois, de sa référence à un « casier social » et de sa volonté de cloisonner les données. Il m'a semblé aussi percevoir quelques réserves du côté de l'éducation nationale... Il y a de quoi être inquiet puisque la PMI est l'acteur majeur pour les enfant de moins de trois ans et l'éducation nationale pour les enfants plus âgés ! Je suis par ailleurs, comme Patricia Adam, quelque peu surpris par l'isolement du juge, d'autant que Mme Sultan nous a dit que la décentralisation l'empêcherait de suivre les dossiers. Je crains, là encore, que cela n'aille pas dans le sens de l'harmonisation souhaitée. Mme la Rapporteure : On a beaucoup parlé de stratégies d'évitement des familles. Je souhaiterais donc savoir comment une famille qui change de département peut être suivie, aussi bien par la justice que par l'éducation nationale. L'équipe éducative de l'établissement de départ ne pourrait-elle pas utiliser une sorte de livret scolaire pour mentionner que l'enfant semble présenter un certain nombre de difficultés sociales ? Cela permettrait peut-être d'éviter un effet pervers de la décentralisation. M. Jean-Marie Delassus : Je veux simplement insister pour que vous preniez en considération le proto-regard qui, s'il ne dure que trente secondes, est désormais un fait clinique établi. Je souhaite que vous admettiez, au moins à titre d'hypothèse, qu'il y a là un moment différent des autres et d'une importance capitale pour l'enfant. Mme Catherine Sultan : On ne peut pas parler de solitude du juge : il est très entouré, et il prend ses décisions à partir des informations qui lui sont apportées par les services sociaux et éducatifs. Il doit se montrer curieux et toujours en alerte, afin de voir s'il manque des informations. Parce qu'il fait un travail difficile, qu'il est soumis à de fortes pressions et qu'il lui est souvent malaisé de prendre une distance par rapport à l'émotion, il me semble qu'il devrait être mieux formé, davantage accompagné et plus souvent supervisé. Il est vrai que le déménagement des familles fait courir un risque, le code de procédure civile obligeant à un dessaisissement au profit du juge des enfants territorialement compétent. Il va de soi qu'on ne peut se contenter de transmettre les dossiers qui risqueraient d'être ainsi enterrés, et qu'il faut les accompagner d'avertissements et de recommandations. Cela vaut aussi pour les services administratifs. Mme Jeanne-Marie Urcun : Les chiffres que j'ai donnés semblent avoir eu un effet inverse de celui que j'escomptais... En pourcentage, le nombre de signalements ne correspond qu'à 0,20 % des enfants scolarisés. Le suivi et l'examen des enfants maltraités sont une priorité de notre service. Les médecins travaillent bien sûr en étroite collaboration avec les infirmières et les assistances de service social qui traitent tout particulièrement ces dossiers. Pour revenir sur le partage des informations, si en dehors de l'école chaque enfant est perçu comme différent des autres, à l'école il doit être considéré dans la mesure du possible comme un élève identique à tous ses semblables. Cela ne veut pas dire qu'on ne doive pas prendre en considération son histoire personnelle, mais la question est de savoir qui a le droit de tout savoir de l'enfant. Or, de ce point de vue, il me semble que nous avons à trouver un équilibre entre la nécessité d'accompagner, d'aider et de protéger un enfant et le fait qu'il soit en permanence identifié à travers son histoire personnelle. Ce n'est pas parce qu'une équipe éducative a travaillé sur la situation d'un enfant en primaire qu'il doit être, quand il arrive au collège, catalogué comme celui qui a fait l'objet d'une protection depuis le cours préparatoire. Mais cela ne veut bien sûr pas dire que sa situation ne doit pas être connue par certains. S'agissant des déménagements, pour inscrire un enfant dans une école, la famille doit produire un certificat de radiation de l'école précédente. Ce peut être, comme le dossier médical partagé, un moyen, au moins administratif, de repérer un nomadisme alarmant. M. Bruno Percebois : Je rappelle que le dossier médical partagé ne concerne pas les enfants. Mais nous disposons déjà d'un instrument, le carnet de santé, qui, même s'il n'est pas toujours bien rempli - par manque de temps mais aussi parfois parce qu'on ignore qui y a accès -, peut permettre de repérer des déménagements fréquents qui témoignent de soucis ou du moins d'instabilité. S'agissant de la nécessité pour le département de disposer de données afin d'évaluer les besoins, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a déjà répondu, en 1998, qu'il n'y avait aucun problème pour permettre l'accès à des données agrégées, mais qu'on n'avait pas besoin de faire figurer le nom et l'adresse des personnes concernées. Pour ma part, en parlant de casier social, je faisais référence au partage d'informations nominatives. Or la CNIL a préconisé, pour le recueil d'informations sociales, que les données soient anonymisées, sous le contrôle du travailleur social. La divulgation d'informations nominatives sur des épisodes touchant l'enfant poserait un véritable problème en termes de libertés publiques. Je ne suis vraiment pas certain qu'il soit nécessaire que tout le monde connaisse ces informations. N'oublions pas que l'administration rencontre quelques problèmes de confidentialité, notamment avec le système de traitement des informations constatées de la police nationale... J'ai aussi posé la question de la subjectivité des critères. Que va-t-on faire figurer dans un tel casier ? Devra-t-on par exemple y entrer tous les proto-regards malveillants ? Compte tenu des risques de stigmatisation, je crois vraiment qu'il faut y réfléchir à deux fois. Quant au cloisonnement, je veux simplement dire que les informations doivent être partagées entre personnes compétentes et susceptibles d'intervenir. Que je sache, un directeur d'hôpital n'a pas accès au dossier des malades. Dans le même ordre d'idées, la CNIL a considéré qu'un inspecteur de l'éducation nationale n'avait pas à connaître le nom et l'adresse des enfants d'une école suivis par le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté. Tout cela relève de la protection la plus élémentaire de la vie privée. M. Jean-François Villanné : Pour répondre à la question de M. Fagniez : il est vrai qu'il y a beaucoup de psychologues, même si l'on en trouve moins quand il s'agit d'intervenir, sur le terrain, directement au contact des adolescents en très grande difficulté. Par contre, nous manquons cruellement de pédopsychiatres, d'autant qu'il est bien difficile d'amener les jeunes à les rencontrer. Enfin, nous n'avons pratiquement aucune structure permettant de prendre totalement en charge et d'héberger les jeunes pendant une courte période afin de poser simplement un diagnostic. Mme Marie-Colette Lalire : Je crois qu'il faut faire très attention à éviter le clivage entre le social, qui relève du département, et la santé, qui est de compétence régionale. Je souhaite vivement qu'il soit recommandé aux deux secteurs de continuer à travailler ensemble de façon étroite. M. le Président : Je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde. Audition de Mme Claire Brisset, Défenseure des enfants, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Au moment où nous nous interrogeons sur les moyens d'améliorer le dispositif de protection de l'enfance, nous sommes heureux d'accueillir la Défenseure des enfants. Dans votre dernier rapport annuel, vous avez porté un regard parfois critique sur la manière dont la France applique la Convention internationale sur les droits de l'enfant (CIDE), ainsi que sur l'action menée par les départements en faveur de la protection de l'enfance. Nous serons donc très attentifs à votre réflexion. Mme Claire Brisset : Dans le questionnaire que vous m'avez adressé, vous m'interrogez en premier lieu sur l'appréciation que je porte sur le respect de la CIDE par la France. Il ressort des cinq rapports annuels successifs que j'ai remis au Président de la République et au Parlement que, globalement, la France n'a pas à rougir de la manière dont elle traite ses enfants et respecte leurs droits. Toutefois, certains textes sont imparfaits et certaines pratiques pêchent. Quelques exemples : le juge aux affaires familiales peut toujours se dispenser assez facilement d'entendre les enfants dans les procédures de séparation et, de plus, sa décision n'est pas susceptible de recours. Autre exemple : il n'y a pas de tutelle aux prestations familiales dans les DOM-TOM. On note aussi que les enfants peuvent, théoriquement, bénéficier de l'assistance d'un avocat devant le juge des enfants, mais encore faut-il qu'ils le sachent et qu'ils puissent le faire ! Or, le juge ne peut saisir d'office un avocat. Il serait pourtant bon que les enfants soient assistés. Je ne saurais enfin passer sous silence certaines applications funestes qui ont été données à la loi relative à la résidence alternée. S'agissant des pratiques, je me dois de souligner qu'en France les enfants sont souvent scolarisés trop tôt : ils ne devraient pas l'être avant l'âge de trois ans. Il n'est pas judicieux non plus de considérer que la pédiatrie s'entend, à l'hôpital, jusqu'à 15-16 ans seulement, car il n'est pas bon que des adolescents soient hospitalisés avec des adultes dans certains services tels que la cancérologie ou la psychiatrie. Nous avons d'autre part d'immenses progrès à faire dans la manière dont nous prenons en charge les enfants handicapés - qui subissent, pour certains, un véritable déni de leur droit à l'éducation -, mais aussi les mineurs étrangers. Enfin, les différences de politique de l'enfance selon les départements sont patentes. Certains textes sont donc à revoir et certaines pratiques à modifier, mais l'on constate aussi des violations « en creux » des droits des enfants. Je classerai dans cette catégorie la pénurie chronique dans laquelle s'est enfoncée la pédopsychiatrie, les lacunes dans la formation pédagogique des enseignants, l'insuffisante protection des enfants contre la pornographie par le biais d'internet ou de la télévision, pour citer quelques exemples. En ratifiant la CIDE, la France s'est engagée à rendre des comptes au Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Or, c'est au Quai d'Orsay qu'il revient de procéder à la collecte des données, tâche qu'il délègue à d'autres administrations, en bonne logique, si bien que les rapports présentent des faiblesses, par manque de coordination. Certes, il est légitime que ce document soit transmis aux Nations unies par le canal du ministère des affaires étrangères, mais il devrait à mon sens être élaboré par le ministère chargé de la famille et des enfants. J'ajoute qu'en quatorze ans la France n'a présenté au Comité que deux rapports au lieu des trois requis par la Convention. Il est impératif que le prochain rapport de la France prévu pour 2007 soit transmis sans retard et que la procédure soit revue. Nous ne pouvons continuer de donner l'impression de traiter le sujet à la légère. Vous me demandez ensuite quelles mesures adoptées récemment marquent un progrès pour le respect des droits de l'enfant. Je citerai, pour la période des cinq dernières années, la pénalisation des clients de prostituées âgées de 15 à 18 ans ; le très bon texte sur l'autorité parentale, qui consacre la co-parentalité et permet de mieux tenir compte de la parole de l'enfant ; le décret qui autorise l'accès des intéressés à leur dossier dans le cas d'une procédure d'assistance éducative ; la loi de janvier 2002 sur le renforcement des droits de l'usager des institutions médico-sociales ; la distinction entre assistantes familiales et assistantes maternelles et l'amélioration de leur statut ; l'indispensable relèvement de l'âge légal du mariage pour les filles. La proposition de loi sur l'adoption que l'Assemblée a adoptée en première lecture va aussi dans le bon sens. En se penchant avec attention sur la situation des adolescents, la conférence de la famille de 2004 a, d'autre part, témoigné d'une prise de conscience des difficultés de cette tranche d'âge. La protection des professionnels qui font des signalements et la création, dans la loi Perben, d'établissements pour les mineurs qui doivent être incarcérés sont d'autres mesures qui me semblent aller dans une bonne direction. Comment rendre la CIDE directement applicable par les tribunaux de l'ordre judiciaire ? Passer par la loi me semble une solution plus simple que d'attendre une décision de la Cour de cassation dans ce sens. Le Comité des droits de l'enfant de Genève estime la parole de l'enfant insuffisamment prise en compte dans notre pays. À l'école, il m'apparaît en effet que la parole des délégués des élèves n'est pas assez entendue et qu'il faudrait revoir le fonctionnement des conseils de discipline, où la voix de l'enfant est écrasée par la parole des enseignants. Je déplore la persistance de cas de maltraitance de très jeunes enfants par des instituteurs. J'avais suggéré qu'il soit écrit, dans la loi sur l'école, que la violence n'a pas droit de cité à l'école « quels qu'en soient les auteurs », et je regrette que cette formulation n'ait pas été retenue. Enfin, l'école doit réformer un style de pédagogie par trop verticale, de l'enseignant vers l'élève, dont les enfants se plaignent en permanence, et renforcer l'interactivité. Dans les procédures de divorce et de séparation, le juge devrait informer l'enfant qu'il peut être entendu mais qu'il peut aussi garder le silence, et expliquer aux enfants les décisions prises. Plus généralement, il serait bon que les juges aux affaires familiales deviennent des juges spécialisés, comme le sont les juges des enfants. S'agissant de la responsabilité pénale des mineurs, il est bien difficile de fixer un âge minimal, mais l'on pourrait retenir l'âge de 10 ans. Pour ce qui est de la politique pénale à l'égard des mineurs, la pénurie de moyens de la justice est telle que le problème se pose de l'exécution des décisions prises par les juges ; or une décision de justice se vide de tout sens si elle ne devient effective que trois ans après. Vous me demandez si la politique menée par la France face à la délinquance des mineurs me paraît respecter les droits de l'enfant. Je le pense, même si nous avons sans doute excessivement privilégié le répressif au détriment de l'éducatif. Conformément à la CIDE, l'incarcération ne doit intervenir qu'en dernier recours, mais il ne suffit pas de le déclarer. Nous n'avons pas suffisamment développé les alternatives à l'incarcération parce qu'elles coûtent cher et supposent la modification des habitudes. Pourtant, les réponses pénales modulées sont infiniment plus utiles que des incarcérations abruptes. Vous m'interrogez sur les mesures les plus urgentes susceptibles d'améliorer la situation des mineurs isolés étrangers. Permettez-moi d'abord de rappeler que l'on oublie trop souvent qu'il y a aussi en France des mineurs étrangers non isolés : les enfants des demandeurs d'asile, par exemple. Pour ce qui est des mineurs étrangers isolés, la première chose devrait être de considérer qu'ils sont tous en danger. Malheureusement, toutes les juridictions n'ont pas ce point de vue. La deuxième mesure devrait être, comme le préfet Landrieu l'avait demandé Puisque vous m'avez également demandé comment l'on peut concilier les deux principes apparemment contradictoires que sont la laïcité et la liberté religieuse, je me dois de dire que je faisais partie de la minorité qui s'était, à l'époque, prononcée contre le fait de légiférer, considérant que la loi n'était pas le bon instrument de l'action en l'espèce. J'aurais préféré la voie réglementaire. Je n'ai pas changé d'avis et je continue de penser que les jeunes filles sont mieux protégées à l'école, fût-ce avec un voile, que dans leurs familles, où elles ont à faire face à leur père, leurs frères, leurs oncles, et où les conditions de leur instruction ne sont pas assurées. J'en viens à la législation française sur la protection de l'enfance et, en premier lieu, à la prévention et la détection de l'enfance en danger. Comme certains d'entre vous, je pense que, pour prévenir la maltraitance, le soutien à la parentalité, lorsqu'il est nécessaire, doit commencer pendant la grossesse. Je déplore que la durée de l'hospitalisation après la naissance soit devenue si brève. Lorsque des problèmes particuliers ont été perçus, les femmes en difficulté devraient pouvoir rester plus longtemps à la maternité. Il conviendrait aussi d'instituer pour toutes les nouvelles accouchées, comme cela est fait en Grande-Bretagne, des visites à domicile systématiques, qui permettent de repérer la défaillance éventuelle du lien entre la mère et son bébé. Il faudrait aussi étendre les compétences de la protection maternelle et infantile (PMI) à tout le cycle primaire, ce qui permettrait de concentrer sur les adolescents les moyens squelettiques de la médecine scolaire. Il faut, enfin, revoir la formation des travailleurs sociaux, et ce serait leur rendre un grand service que de renforcer des compétences juridiques qui leur font notoirement défaut, alors qu'ils en ont le plus grand besoin. Cette formation devrait comprendre un volet théorique, mais aussi un stage dans un tribunal. Faut-il, me demandez-vous, légiférer pour instituer un secret professionnel partagé ? Oui, il le faut, en s'inspirant de ce qui a été fait pour le secret médical, et en faisant du conseil général le pivot du système. Pour ce qui est du signalement, la question en suspens est de savoir que faire lorsqu'une famille refuse obstinément d'ouvrir sa porte. Si l'on décloisonnait, si l'État et le département œuvraient davantage de concert, si tous les acteurs de la protection de l'enfance avaient plus l'habitude de travailler en équipe et de se parler, un travail en amont serait possible. L'affaire qui a défrayé la chronique l'été dernier concernait une famille de cinq enfants dont certains étaient nés à domicile. L'existence d'un référent unique pour cette famille aurait peut-être permis de dénouer la situation. D'évidence, il faut, pour chaque enfant placé, un interlocuteur unique. Pour prévenir la récidive, il faut améliorer la coordination au sein même des tribunaux entre juges pour enfants et juges d'application des peines. Sait-on qu'à Angers le juge d'application des peines devait suivre 2 000 situations ? Sait-on que, parfois, différents juges d'une même juridiction s'occupent d'une même famille, mais qu'ils ne se rencontrent jamais sinon, dans le meilleur des cas, à la cantine du tribunal ? De plus, la décentralisation a créé de nouvelles frontières de compétences entre l'État et les collectivités ; des passerelles sont indispensables, sans quoi les difficultés s'aggraveront. S'agissant de la notion d'enfance en danger, je souhaite que l'on s'en tienne à la définition qu'en donne l'article 375 du code civil. Elle est vague, et c'est bien ainsi. Plutôt que de la préciser, mieux vaudrait modifier les pratiques, et que les professionnels parviennent mieux à travailler ensemble ! De même, le code civil ne doit pas, à mon sens, définir exagérément l'intérêt de l'enfant. Il faut laisser une latitude d'interprétation. Pour autant, il n'est pas mauvais que cette latitude soit guidée. En Grande-Bretagne par exemple, les personnes qui sont chargées d'évaluer si un enfant est en danger sont tenues de remplir un questionnaire, rédigé de manière à faire apparaître des signaux d'alerte d'une grande utilité. Pour ce qui concerne l'équilibre entre le maintien à domicile et le placement, je connais la théorie du docteur Maurice Berger que j'ai rencontré. Il considère que certains enfants sont placés trop tard, et qu'ils en gardent des séquelles irréversibles. Le docteur Berger dit un grand nombre de choses justes, mais il faut être prudent, car on connaît aussi des cas d'enfants placés dans des familles d'accueil elles-mêmes maltraitantes. On ne peut pas classer les familles en deux catégories : d'un côté, les « mauvaises » familles biologiques, de l'autre les « bonnes » familles d'accueil. Si une famille est pathogène, lui enlever l'enfant ne règle pas le problème définitivement. L'objectif doit rester que l'enfant puisse revenir dans sa famille, à la condition bien sûr que ce soit possible. On ne peut donc pas se contenter de le soustraire à sa famille et s'en tenir là. Si aucun travail n'est fait avec cette famille, comment le rendre à ses parents après un placement temporaire ? Il faut donc soutenir les familles d'accueil, certes, mais aussi les familles d'origine, et sur ce point le système actuel est défaillant. Il convient par ailleurs de faciliter les adoptions simples. S'il y a si peu d'enfants placés en Grande-Bretagne, c'est que les adoptions simples y sont beaucoup plus nombreuses qu'en France. Or celles-ci présentent l'avantage indéniable de renforcer la sécurité psychique des enfants, et cette formule présente en ce sens de très grands avantages. Pour ce qui est de la continuité des placements, on comprend aisément que les placements successifs s'apparentent à la fabrication expérimentale de psychose. La règle doit être le placement unique, et il ne doit y avoir changement qu'en cas de problème. Que répondre à cette jeune fille de 14 ans qui a été successivement placée dans cinq familles et qui m'écrit pour me dire que son rêve est de retourner dans la première de ces familles ? Quant à savoir s'il faut supprimer les pouponnières, je suis circonspecte. Tout dépend des situations. S'il s'agit des quelque 600 enfants nés sous X chaque année, qui seront adoptés après quelques semaines, pourquoi ne pas les conserver ? Mais si le séjour des bébés doit être plus long, mieux vaut un placement familial. S'agissant du retrait de l'exercice de l'autorité parentale, je suis évidemment favorable, en cas d'abandon de fait d'un enfant, au recours accru à la déclaration judiciaire d'abandon, si celle-ci conduit à favoriser l'adoption simple des enfants en danger. Je suis aussi favorable à l'élargissement des délégations d'autorité parentale. J'appelle votre attention sur le fait que la kafala, seule procédure reconnue par le droit musulman, pose en France des difficultés inextricables, alors qu'elle ressemble comme une jumelle à notre adoption simple. Pourquoi ne pas assimiler la kafala à une adoption simple ? Il conviendrait par ailleurs de multiplier les parrainages qui ont fait la preuve de leur utilité et leur donner un statut. Mme Royal avait constitué un groupe de travail à ce sujet, sous la présidence de Mme Vergez, magistrate, qui depuis préside le comité national du parrainage, chargé d'élaborer une charte que nous attendons avec intérêt. Vous m'avez interrogée sur l'organisation des services de protection de l'enfance. Sur un plan général, si l'on décentralise une compétence, la responsabilité se partage, mais un contrôle doit permettre à l'État d'évaluer les mesures adoptées par les collectivités territoriales. Or, en matière d'aide sociale à l'enfance, les disparités entre les départements sont importantes, comme le montrent les différences constatées dans l'effort financier consenti ou dans les taux d'agrément préalables à l'adoption, par exemple. Je ne suis pas favorable à l'uniformité et je ne méconnais pas les particularités locales, mais j'observe que le principe sacré de l'égalité devant la loi n'est pas toujours respecté et qu'il doit être préservé. La question est de savoir par qui. L'IGAS compte au total 150 inspecteurs, dont l'équivalent de quinze temps plein seulement pour contrôler les instances qui s'occupent de 270 000 enfants dans les départements. Dans le même temps, leurs 150 homologues anglais s'occupent, tous à temps plein, de 100 000 enfants. Si l'on souhaite que l'IGAS soit investie de cette tâche, cela supposerait que l'on modifie son statut, puisque ce corps est placé sous l'autorité du Gouvernement. La politique de protection de l'enfance étant du ressort des départements, ceux-ci devraient être partie prenante de cette évaluation. Je plaide donc en faveur d'un contrôle qui serait quadripartite, associant l'État - par le biais de l'IGAS -, les départements, les associations spécialisées et le Défenseur des enfants, autorité indépendante. L'objectif n'est pas de construire une usine à gaz, mais de permettre une évaluation efficace des politiques départementales de protection de l'enfance. On ne peut se satisfaire plus longtemps d'un contrôle effectué seulement par une inspection d'État, si performante soit-elle, et qui ne porte actuellement que sur deux départements chaque année. Enfin, les rapports de cette autorité de contrôle devraient être systématiquement rendus publics. Il me semble qu'un tel schéma devrait pouvoir recueillir l'assentiment général. M. le Président : Je vous remercie, madame, pour la richesse de votre exposé. Nous avons récemment réuni une table ronde dont les intervenants, et notamment M. Christophe Lagarde, député-maire de Drancy, et M. Gilles Garnier, vice-président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, ont souligné, en partant du cas auquel vous avez brièvement fait allusion, le cloisonnement que la décentralisation a peut-être aggravé. La Mission, qui se rendra à Londres le 9 juin, se rapprochera de vos services pour préparer son voyage. Mme Claire Brisset : Puisqu'il n'y a pas encore, malheureusement, de délégation parlementaire aux droits des enfants, il serait judicieux, comme l'a proposé Mme Pécresse, d'inscrire dans la loi que le défenseur des enfants doit être systématiquement consulté sur les textes concernant les enfants ou leurs droits. Pour l'heure, c'est acrobatique : nous n'avons été consultés qu'in extremis à propos du projet de loi sur le divorce et, à propos du projet de loi sur l'école, il m'a fallu insister pour être reçue par le ministre. Ce n'est pas intentionnel ; c'est qu'il n'est pas encore dans les habitudes de consulter notre institution pour les textes relatifs à l'enfance. M. le Président : Il est vrai qu'après avoir entendu le docteur Berger et un juge des enfants exprimer des points de vue contrastés, il était intéressant de connaître le vôtre. Mme Henriette Martinez : Vous avez déclaré que le placement doit être temporaire, l'idéal étant que l'enfant rentre dans sa famille d'origine. Mais les textes sont-ils suffisants pour le suivi des familles pathogènes ? Mme Claire Brisset : Le fil rouge, c'est la notion de danger. Il faut examiner si l'enfant est en danger et s'en tenir là. Les textes ne sont pas difficiles à interpréter, et un juge est en mesure d'évaluer si la situation familiale présente un danger réel et permanent pour l'enfant et si le retrait de l'autorité parentale est nécessaire. Mme Henriette Martinez : Mais n'a-t-on pas aussi, peut-être, privilégié l'idéal du retour dans la famille parce que cela coûte moins cher aux conseils généraux ? Pourtant, certaines décisions de justice ne sont pas à la hauteur des dangers qui pèsent sur l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant est souvent soit ignoré, soit interprété comme signifiant le retour au sein de la famille. Les esprits ne devraient-ils pas évoluer ? La conception selon laquelle il ne faudrait à aucun prix couper l'enfant de sa famille d'origine a quelque chose d'archaïque : elle méconnaît l'intérêt de l'enfant qui reste, en droit français, la propriété de ses parents qui gardent sur lui un droit absolu. Mme Claire Brisset : Le problème tient plus aux pratiques qu'aux textes, et je ne suis pas persuadée qu'il faille les modifier. On ne peut pas, en effet, se limiter à enlever un enfant à sa famille d'origine sans rien faire de plus. Mme Muriel Églin : En parlant d'idéologie familialiste, le docteur Berger dénonce l'idée selon laquelle la place de l'enfant est au sein de sa famille. Cette idée est très solidement ancrée dans la société française. Toutefois, les textes, en l'état, permettent tout, y compris de trouver une solution pour les cas les plus graves. Les travailleurs sociaux et les juges disposent donc des outils adéquats, mais ils ne sont pas toujours appliqués. Notamment, la délégation de l'autorité parentale est méconnue. Il faut mieux mesurer combien le maintien du lien familial peut être douloureux, et aussi mieux évaluer les pratiques. Substituer à la notion de danger celle d'intérêt supérieur de l'enfant conduirait à doubler, sinon à tripler, le nombre de saisines des juges. Les équipes des conseils généraux étant actuellement à peine suffisantes, il est illusoire de penser que l'élargissement du critère améliorerait la prise en charge des enfants. De surcroît, nous n'en sommes pas encore au stade où un placement apporte forcément à l'enfant le bien-être qui lui est nécessaire. Il faut donc aider à la fois la famille d'origine et la famille d'accueil. Il faut laisser une place à la famille d'origine, et il existe des solutions où l'enfant garde un lien avec sa famille, tout en restant protégé. Plus que les textes, c'est la pratique qui doit être questionnée. Mme Claire Brisset : Voilà qui conduit à s'interroger sur les moyens de la justice. Pour avoir passé une semaine au sein du tribunal de Bobigny, j'ai pu constater qu'un juge français ne peut consacrer que quelques heures à un enfant, alors que son homologue allemand dispose de plusieurs jours pour traiter une situation. La France a sous-investi le domaine de la justice dont le budget est extrêmement faible. J'en reviens à l'exemple emblématique d'Angers : comment un seul juge d'application des peines peut-il faire face, lorsqu'il est chargé de surveiller l'évolution de 2 000 situations ? Il faudrait, aussi, se pencher sur la formation des juges ; il y a là un chantier d'envergure. M. Pierre-Christophe Baguet : Vous considérez qu'il faut légiférer sur le secret partagé et que le conseil général doit être le pivot du système. Mais le souci de proximité et de décloisonnement ne devrait-il pas nous conduire à donner un rôle au maire ? Quelle doit être la place des élus dans ce dispositif ? Ne pourrait-on imaginer de créer des contrats locaux de l'enfance sur le modèle des contrats locaux de sécurité ? Mme la Rapporteure : Que faire quand une porte reste obstinément fermée aux travailleurs sociaux ? L'intérêt supérieur de l'enfant ne commande-t-il pas que cette porte soit ouverte ? Mme Claire Brisset : Si, bien sûr. M. Pierre-Christophe Baguet : Les services sociaux ne le font pas. Mme Claire Brisset : Ils peuvent le faire par le biais d'une décision judiciaire, si le juge des enfants pense qu'un enfant est en danger. M. Pierre-Christophe Baguet : La difficulté tient aux stratégies d'évitement. M. le Président : Ne faut-il pas prévoir, dans de tels cas, une autorisation administrative de pénétrer dans le domicile ? Mme Muriel Églin : Dans l'affaire de Drancy que chacun a à l'esprit, c'est la compilation des informations qui a fait défaut. Si l'on avait mis en regard ce qui était connu, de manière parcellaire, par la PMI, par la police, par l'école et par l'office HLM, on aurait réuni un faisceau d'indices qui pouvaient justifier la saisine du juge. Mme la Rapporteure : Cette affaire met en évidence de manière emblématique les failles du dispositif. Il y avait eu signalement, mais l'enfant, conditionné par sa mère, a accusé à tort l'éducateur d'attouchements sexuels. Il a été remis à sa famille, et il n'y a plus eu aucun suivi. Autrement dit, tous les services sont coupables. Mme Muriel Églin : S'il existait une autorisation administrative de pénétrer dans le domicile, aurait-elle une influence sur le décloisonnement des services ? Mme Claire Brisset : La loi doit prévoir que, comme en Angleterre, les visites à domicile sont obligatoires après une naissance. D'autre part, les travailleurs sociaux ont souvent peur d'enfreindre les textes en disant ce qu'ils savent. Il faut donc, comme je l'ai proposé dans mon dernier rapport, établir une définition juridique du secret partagé, inspirée de ce qui vaut pour le secret professionnel dans le domaine médical. Pour ce qui est de la place dévolue aux maires, qu'y a-t-il de commun entre le rôle joué par le maire de Strasbourg et celui joué par le maire d'un village de la Sarthe ? La ville de Strasbourg, pour prendre cet exemple, remplit des missions qui relèvent théoriquement du conseil général, ce qui serait impossible ailleurs faute de personnel. Confier le rôle de chef de file de la politique de protection de l'enfance aux maires serait introduire une très forte inégalité entre les citoyens. Le législateur, par souci de proximité, a confié cette compétence aux départements plutôt qu'aux régions. Notre pays comptant des communes microscopiques, il serait inapproprié d'aller plus loin. M. Patrice Blanc : Le conseil général est le principal employeur des travailleurs sociaux. Si l'on confiait aux maires la responsabilité de gérer les réunions de partage du secret, cette relation hiérarchique mettrait les personnes concernées en porte-à-faux, et l'on peut craindre des situations inextricables. Par ailleurs, il faudra définir strictement dans la loi les raisons pour lesquelles le secret doit être partagé, à qui il doit être divulgué, dans quelle mesure - les médecins, quand ils doivent parler, ne disent que le nécessaire - et selon quelles modalités. Il faudra aussi déterminer si le secret peut être partagé sans que la famille considérée en soit prévenue ; pour ma part, je ne le pense pas. Des règles sont nécessaires... Mme Claire Brisset : ... car les familles ont besoin d'un cadre. M. Patrice Blanc : Des contrats de veille éducative ont été élaborés, ce qui montre que des outils existent déjà. Mais pourquoi un tiers des départements n'ont-ils pas encore adopté de schéma départemental de l'enfance ? Essayons d'appliquer les dispositions prévues dans les textes avant de créer de nouveaux dispositifs ! Mme Muriel Églin : Lorsque des échanges d'informations ont lieu actuellement, ils se font hors du cadre légal. Il en résulte une insécurité juridique et, de plus, le partage du secret n'est pas toujours fait de la manière la plus adéquate. L'objectif commun étant d'améliorer la situation des enfants, il faut redéfinir les règles du secret professionnel pour permettre un échange fructueux tout en prévenant les dérives éventuelles. M. le Président : En d'autres termes, le département doit demeurer le garant de l'égalité territoriale, d'autant que, dans les communes les plus petites, il peut être extrêmement contraignant pour un maire de signaler une famille qu'il connaît personnellement. Mais les conseils généraux, gages de neutralité et de proximité, doivent gagner en efficacité. M. Pierre-Christophe Baguet : N'oublions pas que, dans les petites communes, les maires sont toujours informés des situations particulières. Mme la Rapporteure : Ne convient-il pas de désigner un responsable clairement identifié M. Pierre-Christophe Baguet : Les enfants passent en moyenne 143 jours à l'école et 100 jours dans les centres de loisirs municipaux. Les animateurs de ces centres connaissent bien les enfants et ont un rôle à jouer. Mme Claire Brisset : La question de fond est celle de la coordination entre des structures qui ont des tutelles variées. Un chef de file autonome est indispensable, car les familles qui utilisent des stratégies d'évitement jouent sur le fait que les élus se succèdent. La prudence devrait imposer que le chef de file soit un fonctionnaire. M. Pierre-Louis Fagniez : Je ne suis absolument pas d'accord. Les maires sont au courant de tout et l'on voudrait désigner un fonctionnaire qui ne sera au courant de rien ! Le conseil général doit se saisir de ces questions et désigner un vice-président responsable. La mission de défenseur départemental des enfants doit être reconnue dans la loi et remplie par un élu du conseil général. Mme Claire Brisset : Je me suis mal fait comprendre. On peut imaginer que le vice-président du conseil général qui coiffe les services sociaux travaille main dans la main avec un fonctionnaire territorial chargé de ces questions. Mme Henriette Martinez : Je suis favorable à la coordination des services, et l'exemple québécois montre que cela peut bien fonctionner. S'agissant des signalements, le problème est grave, même si le dispositif a été amélioré, tant sont grandes les disparités entre les départements. Ainsi, certains conseils généraux, dont le mien, refusent de tenir compte des signalements anonymes. La loi doit imposer que tous les signalements soient pris en compte, sans quoi l'on continuera de passer à côté de très grandes détresses. La protection de ceux qui signalent doit être réglementée. Il n'est pas tolérable que le maire, le député et l'instituteur sachent tous qu'un enfant est en danger, mais que le conseil général puisse considérer que tout va bien. Or, de graves dysfonctionnements de ce type se produisent, en tout cas dans les Hautes-Alpes. On sait, aussi, que les familles qui se sentent surveillées déménagent, ce qui a des conséquences dramatiques pour les enfants. Mais puisqu'elles perçoivent souvent des allocations familiales, ne pourrait-on mettre au point un dispositif de coordination avec les caisses d'allocations familiales, de manière à ce que, en cas de déménagement, l'information passe d'un conseil général à l'autre ? Mme la Rapporteure : Peut-être pourrait-on aussi utiliser, à cette fin, le certificat de radiation de l'école donné aux familles qui déménagent, même si je sais que cette idée ne suscite pas d'enthousiasme à l'éducation nationale. De même, je voudrais être sûre que, en cas de déménagement, le juge des enfants transmettra bien les informations au nouveau tribunal compétent. Je sais d'expérience que la procrastination est la règle. Que l'on se rappelle la fusillade de Nanterre : l'homme avait été signalé dans deux départements... Mme Bérengère Poletti : Pour ce qui est du chef de file, ne pourrait-on prévoir de coupler le conseil général, qui a la surface nécessaire, et le maire, dont on a souligné l'excellente connaissance qu'il a de ce qui se passe sur le territoire de sa commune ? Mme Gabrielle Louis-Carabin : Le maire a un rôle à jouer, mais ce qui fait principalement défaut, c'est la coordination. La responsabilité de la politique de protection de l'enfance doit revenir à un élu du conseil général, puisque c'est l'instance qui alloue les moyens. Il peut, s'il le souhaite, déléguer à un fonctionnaire, mais il faut s'en tenir là. M. le Président : Nous ne trancherons pas cette question aujourd'hui. J'observe que les maires ont un rôle irremplaçable en matière de signalement. Quant aux fonctionnaires, ils sont toujours sous la tutelle des élus. Mme Claire Brisset : Mme Roig a installé deux groupes de travail : l'un, présidé par le sénateur Philippe Nogrix, a été chargé de proposer des aménagements aux procédures de signalement des mineurs en danger ; l'autre, présidé par le sénateur Louis de Broissia, a traité des modalités de prise en charge de ces mineurs. Il sera très utile d'analyser leurs conclusions. Je sais en tout cas que les auteurs de signalements se plaignent de manière récurrente à la justice de ne pas être tenus informés de ce qu'il advient. Mme Muriel Églin : En matière de signalement, il convient de distinguer qui est en mesure de repérer les difficultés et qui est en mesure d'agir, car c'est l'articulation entre ces deux interventions qui pose problème. Pour ce qui est des déménagements, un référent unique pourrait faire connaître ses préoccupations à son homologue d'un autre conseil général, tout comme le juge transmet les informations au nouveau tribunal compétent. Mais la transmission n'est possible que si la nouvelle adresse de la famille considérée est connue. Si tel n'est pas le cas, rien n'est possible aussi longtemps qu'il n'y a pas contrôle d'identité et que le parquet ne diligente pas une enquête, sauf à prévenir toutes les écoles. On comprend que ce type de repérage ne puisse être envisagé que pour les cas particulièrement graves. Les caisses d'allocations familiales peuvent, en effet, être un autre canal de transmission d'informations inquiétantes. M. Marc Scotto : La déscolarisation non argumentée est un signal négatif qu'il faut faire signaler à la personne chargée, au conseil général, de la coordination des informations. De nombreux signalements sont faits par des enseignants qui se plaignent de l'absence de retour. Je crois savoir que les inspecteurs d'académie sont informés du suivi donné aux signalements ; peut-être le secret professionnel empêche-t-il que l'information ne redescende. Mme Claire Brisset : Je rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire un signalement à la justice, et que les signalements administratifs, moins effrayants pour les familles, contribuent à désengorger les tribunaux. Mme Annick Lepetit : Pourquoi estimez-vous néfaste la scolarisation avant l'âge de trois ans ? Mme Claire Brisset : J'ai longtemps pensé que la scolarisation à deux ans avait du bon, jusqu'à ce que les pédiatres, les pédopsychiatres et nombre d'enseignants m'alertent de manière répétée. Ils insistent sur l'agressivité du comportement de ces très jeunes enfants, et M. Cyrulnik parle même de stress post-traumatique chez certains enfants de six ans qui arrivent au cours préparatoire écœurés par quatre années de maternelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas bon de constituer des groupes de vingt-cinq enfants que l'on confie à deux adultes non formés. L'année des deux ans est celle où l'enfant cherche à nouer avec l'adulte les relations qui lui permettront de faire des acquisitions fondamentales, et il n'y parvient pas dans un tel contexte. Il ne peut pas, non plus, dormir suffisamment, et son alimentation est inadaptée à son âge. La France est le seul pays au monde qui scolarise ses enfants si jeunes, et j'en suis venue à la conclusion que cette pratique peut être néfaste pour certains enfants. Mme Annick Lepetit : Votre description ne traduit-elle pas surtout un manque de moyens ? Mme la Rapporteure : Ne peut-on admettre que, si des classes et des locaux de l'éducation nationale sont libres, on puisse s'en servir pour créer des structures intermédiaires entre crèche et école, où travailleraient des puéricultrices, pour de jeunes enfants qui n'ont plus besoin de tous les équipements d'une crèche ? Mme Claire Brisset : L'optique sera bien sûr différente si l'éducation nationale sait et veut former des enseignants ad hoc, constituer des groupes de moins de dix enfants et ne pas les contraindre à faire la sieste dans des dortoirs de quarante lits. Il faut savoir que la scolarisation précoce est faite par défaut, parce qu'elle ne coûte rien et que la société s'est défaussée de cette classe d'âge sur l'école. Il est impératif d'offrir aux familles des structures d'accueil adaptées aux besoins des enfants. Je le répète : le temps du bébé doit absolument être respecté. Mme la Rapporteure : Êtes-vous d'accord sur le fait que la tranche d'âge des deux à trois ans n'a pas vraiment besoin des normes imposées aux crèches, qui coûtent 1 000 euros par mois et par enfant ? Mme Claire Brisset : Il faut réunir sur ce sujet une conférence de consensus. Cet âge est celui de l'individuation du petit enfant ; ce moment doit être respecté. M. le Président : Madame, je vous remercie. Audition de M. Jean-Pierre Rosenczveig, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Notre Mission d'information réfléchit aux moyens d'améliorer notre dispositif de protection de l'enfance. Les fonctions que vous occupez, l'action que vous menez depuis près de quinze ans dans le département de Seine-Saint-Denis et votre engagement personnel en faveur de la défense des droits de l'enfant font, monsieur Jean-Pierre Rosenczveig, que votre témoignage est très attendu, singulièrement sur le signalement des enfants en danger, sur les modalités de prise en charge de ces enfants et sur la place donnée aux enfants devant le juge des mineurs. Mme la Rapporteure : J'aimerais aussi vous entendre expliquer les raisons de votre appel en faveur de la rénovation de la protection de l'enfance. Il nous serait utile de savoir quelles dispositions vous sembleraient nécessaires, si c'est bien une nouvelle loi que vous appelez de vos voeux. M. Jean-Pierre Rosenczveig : Nous sommes quelques-uns à constater que beaucoup de choses se font dans le domaine de la protection de l'enfance et que beaucoup d'argent est dépensé à cette fin : avec 4,65 milliards d'euros, le budget de l'aide sociale à l'enfance est cinq fois supérieur à celui de l'Unicef. Cependant, de grandes améliorations sont possibles. Or, si de nombreux groupes de travail ont été réunis au cours des dix dernières années, leurs propositions, dans leur immense majorité, n'ont pas été appliquées. Le temps est donc venu d'un véritable débat national sur ce sujet essentiel. Je ne saurais trop insister sur l'urgente nécessité de clarifier les responsabilités en matière de protection de l'enfance. Dans le champ public, les choses sont compliquées, avec cinq niveaux de responsabilité : européenne, nationale, régionale, départementale et communale. Dans son rapport, la Défenseure des enfants a dit, de façon provocatrice, que les collectivités territoriales n'en font pas assez. Ce faisant, elle disait surtout que l'État doit en faire plus, et elle soulignait à juste titre qu'il n'est pas, à l'heure actuelle, garant de la politique nationale de protection de l'enfance. Or, la décentralisation ne signifie pas la constitution de fiefs, mais celle d'espaces où des techniques différentes sont mises en œuvre pour réaliser les mêmes objectifs. Dans le champ privé, les choses ne sont guère plus simples. On entonne facilement l'hymne à la famille et aux responsabilités parentales, mais qui sont les parents ? Il peut s'agir d'un père et d'une mère dont certains n'ont pas reconnu l'enfant mais s'en occupent ; interviennent aussi les beaux-parents que les textes ignorent, et les grands-parents qui vivent plus longtemps et ont un pouvoir d'achat plus important que par le passé. Autrement dit, il y a d'un côté des gamins qui débordent de parents et qui se trouvent placés au cœur de conflits de propriété, et, d'un autre côté, tous les enfants qui n'ont pas de parents ou un seul. Ainsi, 50 000 à 70 000 enfants sont-ils orphelins de père, au nom du droit des femmes à disposer de leur corps et à être mère quand elles le souhaitent, mais pas au nom de l'intérêt de l'enfant. Ensuite, la question de l'articulation des responsabilités publiques et privées ne peut manquer d'être soulevée. Lorsque l'on traite de l'excision ou des mariages forcés, des règles d'ordre public peuvent pénétrer l'ordre familial. Une fois les responsabilités, dont celles de l'État, précisément définies, les outils d'intervention pourront être élaborés, qu'il s'agisse d'une loi ou des schémas départementaux. On n'a pas, je l'ai dit, tiré la substantifique moelle des travaux menés ces dernières années et il serait temps qu'une programmation ait lieu, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une loi alibi. Il faut réfléchir aux objectifs que l'on se donne et instituer un mécanisme d'évaluation régulière du dispositif. Pour ne donner qu'un exemple, à quoi sert-il d'adopter la loi sur l'autorité parentale que nous avons appelée de nos vœux si aucun effort pédagogique n'est conduit pour expliquer son contenu aux familles et aux enfants ? Il ne suffit pas d'adopter la loi, il faut l'expliquer, et c'est pourquoi j'en appelle à une campagne de communication télévisée. On ne peut ignorer que les parents issus de l'immigration sont déroutés par les règles de la démocratie française, qu'ils ne connaissent pas. Certains pensent, par exemple, que les enfants ont tous les doits et que les parents sont bons pour le commissariat s'ils font quoi que ce soit. Il est important de leur faire comprendre qu'ils ont une parfaite légitimité à faire preuve d'autorité sans violence, et que l'exercice de l'autorité des beaux-parents, dans les mêmes conditions, est également légitime. Il faut aussi que le contenu de l'enseignement soit bon et que les parents protègent leurs enfants. Dans ce domaine, c'est à la puissance publique que revient la responsabilité de diffuser des normes sociales qui ne se transmettent plus comme par le passé : non seulement la vie des enfants n'est plus linéaire, mais les représentations du bien et du mal ont évolué. De plus, le rapport à la violence n'est pas le même si l'on vient d'Afrique ou d'Haïti. On ne peut laisser le docteur Berger et certains parlementaires mettre en doute la pertinence des dispositifs en vigueur, alors que les professionnels dont l'implication est unanimement reconnue ont le sentiment de ne pas être entendus. Il faut mettre autour d'une table tous les gens de bonne volonté, se fixer, à partir des acquis du dispositif actuel, des objectifs conformes à la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), et se donner les moyens de les tenir. Mais je constate, comme M. de Broissia, que le décret de mai 2001 sur les conférences départementales consacrées à la protection de l'enfance n'a jamais été appliqué, et qu'il n'y a ni débat local, ni débat national. Voilà pourquoi il est temps d'engager une démarche de fond. Avant d'en venir aux questions que vous m'avez posées, permettez-moi d'observer, à propos de l'intitulé de votre Mission d'information, que la protection de l'enfance est un ensemble et que les droits des enfants ne se résument pas au dispositif de protection. La première ligne de protection, c'est la famille ; la deuxième, c'est la protection médico-sociale ; la troisième, l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; la quatrième, la justice ; et la cinquième, l'enfant lui-même qui peut être acteur de sa propre protection. Je fais partie de ceux qui, tel M. Paul Bouchet, considèrent que, comme celle des femmes, la protection des enfants passe, en premier lieu, par le statut et la considération qui leur sont donnés, car on ne casse pas ce que l'on respecte. Je rappelle que la CIDE reconnaît expressément le droit des enfants à participer à leur propre protection, à s'exprimer et à être entendus en toutes circonstances, et notamment en justice. Si ce droit leur était réellement reconnu, comme le propose Mme Pécresse, il y aurait là un progrès historique. Pour l'heure, il ne l'est pas, et pour cause : si les enfants s'expriment, il faut leur répondre et, comme on ne sait que leur dire, on préfère les faire taire... Une évolution de la représentation et du statut de l'enfant est donc nécessaire dans la société française et, dans ce domaine, notre marge de progression est grande. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a d'ailleurs formulé, en juin 2004, des recommandations précises au gouvernement français. Votre Mission d'information devrait demander au Président de la République, garant de l'application des traités, comment le Gouvernement compte se conformer à ces observations ; l'association Défense des enfants international-France que je préside n'a pas obtenu de réponse à ce sujet. La France devra, en 2007, présenter un nouveau rapport sur son action au Comité des droits de l'enfant, et je puis vous assurer qu'il est fort peu plaisant, pour les représentants de la patrie des droits de l'homme, de se faire rabrouer. Cela ne coûte pourtant pas cher de respecter ses engagements ! Je ne suis d'ailleurs pas certain qu'un rapport soit transmis chaque année au Parlement comme la loi du 27 janvier 1993 l'exige. La question de la portée de la CIDE a une importance capitale. Les arrêts de la Cour de cassation ont un très fort impact à l'étranger. Aussi son arrêt selon lequel la Convention n'est pas d'application directe et ne donne donc pas aux enfants des droits directs a-t-il été ressenti comme un coup de poignard. La jurisprudence du Conseil d'État étant plus nuancée, il faut trancher et, pour cela, suivre les conclusions de la commission d'enquête présidée en 1998 par M. Laurent Fabius, qui avait prévu une loi interprétative. Sur un autre plan, et sauf à récuser la distinction entre droits formels et droits réels, on ne peut pas parler de protection de l'enfance en passant sous silence les problèmes économiques. Un travail de fond doit être conduit contre la pauvreté. Le droit au logement et le droit de vivre décemment ne figurent-ils pas dans la Convention ? J'en viens aux questions que vous m'avez adressées. S'agissant du signalement des enfants en danger, de grands efforts ont été faits pour améliorer le dispositif : depuis qu'a été connue, en 1980, l'histoire de David, l'enfant du placard, le champ du signalement a été élargi, notamment aux violences sexuelles ou psychologiques. J'observe cependant que la loi du 10 juillet 1989 sur l'enfance en danger a fait du président du conseil général le destinataire des signalements des seuls enfants maltraités. On ne peut s'en tenir là : il faut étendre le rôle du président du conseil général à tous les risques qui pèsent sur l'enfant. La loi de 1989 est donc techniquement perfectible. Elle a néanmoins eu le très grand mérite politique de remobiliser les acteurs de la protection de l'enfance, et la procédure de signalement est à présent globalement satisfaisante. Les difficultés tiennent à la rotation des personnels - elle est d'environ 30 % chaque année en Seine-Saint-Denis -. Autant dire que la formation et les consignes hiérarchiques sont plus importantes que la loi. Le nombre des signalements a augmenté, mais on ne peut affirmer que cette progression traduit une augmentation des faits ; il faudra attendre les premières conclusions de l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED) pour le savoir. Le président du conseil général doit donc être chargé d'une mission de centralisation des informations pour l'ensemble des situations à risque - et non pour les seules maltraitances - et cette mission doit être confiée à l'inspecteur de l'ASE. Ainsi évitera-t-on la répétition de l'affaire de Drancy, à propos de laquelle on s'est rendu compte a posteriori que des informations existaient, mais qu'elles n'avaient pas été collectées. Mais il ne s'agit là que d'une méthode de travail qui ne rendra pas plus intelligent : il faudra toujours savoir décrypter et interpréter, car il y a, malheureusement, des enfants qui continuent de souffrir parce que la maltraitance qu'ils subissent n'a pas été repérée ou parce que, pour des raisons qui leur appartiennent, ils la taisent. Comment vous dire mon accablement le jour où une jeune fille m'a expliqué, des années après les faits, qu'elle était violée dans la famille d'accueil où j'avais pensé de mon devoir de la faire héberger pour l'éloigner de sa famille d'origine, dangereuse pour elle, et qu'elle avait tout fait pour que je ne le sache pas ? Comment repérer au plus tôt les enfants en danger ? En implantant des « palpeurs » sociaux dans ces carrefours démocratiques que sont les structures de santé et l'école. Il faut pour cela rompre l'isolement dans lequel se trouvent les médecins de ville, dans un travail commun avec les hôpitaux publics. Il faut aussi installer un service social et de santé scolaire dans le primaire - le Parlement des enfants a d'ailleurs demandé la présence d'une infirmière dans chaque école -. En 2003, le transfert des personnels sociaux et médicaux de l'éducation nationale aux départements a échoué. La solution passe aujourd'hui par des conventions entre l'État et les collectivités territoriales. Mme la Rapporteure : Étant donnée l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, Mme Claire Brisset suggérait d'étendre les compétences de la protection maternelle et infantile (PMI) à tout le primaire et de réaffecter les effectifs de la médecine scolaire vers les adolescents. Qu'en pensez-vous ? M. Jean-Pierre Rosenczveig : Peut-être a-t-elle raison. En tout cas, un interlocuteur social et médical est nécessaire, d'autant que, souvent, les gens ne vont pas voir les travailleurs sociaux, dont ils pensent qu'ils n'auront rien à leur proposer. C'est donc aux travailleurs sociaux d'aller vers la population en difficulté. Voilà pour le principe ; on trouvera les techniques. Pour ce qui est du secret professionnel, je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un droit mais d'une obligation imposée à certaines personnes. Il ne vise pas à garantir la vie privée des parents ou des enfants, mais à crédibiliser une profession. Le travail social étant de plus en plus complexe, aucune équipe seule ne peut régler tous les problèmes d'une famille. L'échange d'informations est donc nécessaire, ce qui suppose la reconnaissance légale d'un secret partagé en matière sociale, comme il l'est en matière médicale. Mme Pécresse a fait une proposition en ce sens, que nous espérons voir adoptée. Toutefois, le débat ne porte pas seulement sur le droit pénal : pratiques professionnelles, morale, déontologie et éthique personnelle entrent aussi en jeu. Il faut donc rappeler à chacun que la priorité est de faire cesser le danger, et qu'il y a une possibilité, et non pas une obligation, de parler. Les personnes soumises au secret professionnel doivent garder le choix entre parler et se taire, et aucune loi ne pourra leur dire ce qu'elles doivent faire. En outre, ce n'est pas parce que l'on peut parler que l'on peut dire n'importe quoi à n'importe qui. En d'autres termes, ce sera un soulagement de voir le secret partagé en matière sociale reconnu dans la loi, mais une formation déontologique des personnels sera nécessaire. S'agissant de la notion d'enfance en danger, la définition qu'en donne l'article 375 du code civil doit rester suffisamment large pour permettre d'agir de manière opérationnelle. Lorsque j'étais jeune magistrat, on enlevait un enfant à sa mère au seul motif qu'elle se prostituait ; maintenant, en s'appuyant sur le même texte, on s'interroge avant de trancher. En Allemagne, les textes sont plus précis et doivent être contournés, la perception du danger pesant sur l'enfant étant par nature évolutive. Le problème n'est donc pas la définition de l'enfance en danger, mais de comprendre pourquoi les services sociaux transfèrent vers la justice des situations qui pourraient demeurer de leur ressort. Vous m'avez demandé si, selon moi, la législation française et les services chargés de l'aide sociale à l'enfance tiennent suffisamment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je vous répondrai qu'à mon sens la proposition de loi sur l'adoption que l'Assemblée nationale vient de voter n'a pas été faite dans l'intérêt de l'enfant, mais dans celui des adultes qui veulent adopter. Pour le reste, nous ne pourrions qu'être d'accord pour que la loi fasse référence à l'article 3 de la CIDE. Mais il ne faut surtout pas définir la notion d'intérêt de l'enfant. Quel équilibre établir, me demandez-vous, entre le maintien à domicile et le placement ? Il faudrait commencer par rayer définitivement le mot « placement » de notre vocabulaire, car les enfants ne sont pas des objets mais des personnes pour lesquelles on doit prévoir un « accueil ». Je vois, dans mon cabinet, parents et enfants se recroqueviller lorsqu'ils entendent le terme « placement » qui évoque pour eux la déchéance de l'autorité parentale, alors que l'expression « accueil en internat » passe bien. Déterminer, ensuite, si à la séparation physique doit correspondre une séparation juridique, c'est une autre paire de manches. Parfois le retour dans la famille ne sera pas possible et la question de la séparation juridique se posera. L'équilibre consiste à dire : dans certains cas, il faut séparer parents et enfants. En un siècle, nous sommes passés de 150 000 pupilles pour 28 millions d'habitants à 2 000 pupilles pour 60 millions d'habitants. Ce n'est pas une régression, c'est un acquis. Sans doute y a-t-il parmi ces pupilles des enfants qui auraient pu faire l'objet d'une déclaration d'abandon, mais ils sont très peu nombreux et ne réunissent pas forcément les conditions, notamment d'âge, pour être adoptables. En favorisant la séparation juridique, un nombre croissant d'enfants risque d'être maintenu dans le statut de pupille, parce qu'ils ne sont pas adoptables. Vous m'interrogez sur ce que le docteur Maurice Berger qualifie d'idéologie du lien familial et sur ses conséquences. Mais de quoi s'agit-il, sinon d'un principe posé par la loi de la République et les conventions internationales et d'une évolution qui est le fruit de l'histoire ? Ainsi, depuis la loi de 1984, les parents dont les enfants sont confiés à l'ASE conservent l'autorité parentale. Je ne conteste pas le constat fait par le docteur Berger sur les pathologies qu'il a diagnostiquées. Mais il faut garder à l'esprit que ces constats ne font que révéler des dysfonctionnements, comme il en existe ailleurs. Nous devons, certes, repérer les dysfonctionnements du dispositif, mais attachons-nous aussi à en comprendre les raisons et, surtout, ne nous arrêtons pas aux seuls dysfonctionnements. Contrairement à une idée très largement répandue, 4 % à 6 % seulement des enfants confiés à l'ASE sont issus de parents qui lui avaient eux-mêmes été confiés dans leur enfance. Voyez comme les préjugés sur cette institution ont la vie dure, même parmi vous ! Quant à laisser penser que des travailleurs sociaux et des magistrats laisseraient sciemment des enfants encourir des risques, je ne peux laisser accréditer une telle appréciation ! Le docteur Maurice Berger, dites-vous, souligne l'absence de prise en compte de la théorie de l'attachement. Je rappelle que la loi de 1984 prend en compte l'attachement entre parents et enfants, car il ne peut y avoir de stratégie de rupture : il faut protéger l'enfant tout en lui permettant de faire le lien avec son histoire. Pour autant, le placement unique ne peut être qu'une orientation : l'enfant sera confié à une famille, mais il faut admettre qu'un accueil puisse ne pas fonctionner, car les familles d'accueil ne sont pas des hôtels. On s'interroge depuis vingt ans pour savoir si l'accueil provisoire peut devenir l'accueil définitif, et l'on s'est rendu compte qu'une telle évolution ne peut être généralisée, car certaines familles peuvent accueillir provisoirement un enfant en danger pour rendre service sans pouvoir faire davantage. Voilà pourquoi le placement unique est un mythe. Il renvoie à l'idée que l'on ne peut déplacer les enfants comme des pions. Or justement, on ne le fait pas ! Si cela advient, c'est pour des raisons liées à la personnalité de l'enfant ou à sa situation particulière. On peut donc faire figurer dans le texte une recommandation invitant à veiller à assurer la stabilité de l'accueil, mais l'on ne peut pas en faire une obligation. À cet égard, je rappelle que nous nous sommes battus pour qu'une adoption puisse succéder à une autre : l'adoption est une alchimie entre les êtres et il faut admettre qu'elle puisse ne pas fonctionner. Faut-il supprimer les pouponnières ? Certes, les familles d'accueil sont certainement préférables aux pouponnières de Ceausescu, mais il faut préserver la diversité des structures d'accueil pour tenir compte de l'évolution des besoins des enfants. De même, s'agissant de la durée des placements provisoires, votre question donne à penser qu'on laisserait pourrir la situation, ce qui est faux. Il faut simplement prévoir un dispositif qui laisse le temps nécessaire pour prendre une décision dite définitive. La loi de 1984 a mis fin au « placement jusqu'à autrement décidé » qui signifiait parfois placement jusqu'à la majorité. Tout dispositif est perfectible, mais il y aura toujours des accueils provisoires. Vous rappelez ensuite que la déclaration judiciaire d'abandon est une mesure assez rare et vous me demandez s'il faudrait y recourir plus souvent pour favoriser l'adoption des enfants en danger. Je serai abrupt : ceux qui croient qu'il y a là une source d'enfants à adopter trompent leurs électeurs. Or, à chaque fois que l'on parle d'adoption, on crée de l'espoir ; cette annonce décevra. Pour ce qui est d'élargir les délégations de l'autorité parentale, on peut l'envisager à la marge, mais mieux vaudrait, surtout, faire un usage plus fréquent des dispositions d'ores et déjà en vigueur. Je rappelle que le juge des enfants protège la personne de l'enfant tandis que le juge aux affaires familiales décide du pouvoir sur l'enfant. Cette distinction que je tiens pour essentielle explique pourquoi il ne doit pas revenir au juge des enfants de déléguer tout ou partie de l'autorité parentale, exception faite des droits usuels utilisés par la vie courante de l'enfant, tels que l'autorisation d'opérer ou l'autorisation de sortie du territoire. Pour ce qui est des relations entre l'enfant et le juge, vous rappelez, dans le questionnaire que vous m'avez adressé, que la CIDE reconnaît à l'enfant le droit d'être entendu dans toute procédure administrative ou judiciaire le concernant, que la loi du 8 janvier 1993 prévoit que le mineur capable de discernement peut être entendu dans toute procédure judiciaire et que, s'il en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Selon moi, s'il ne faut rien modifier à la condition de discernement en vigueur, il faut, évidemment, donner à l'enfant, quel que soit son âge, la possibilité de demander à être entendu. Cette modification est fondamentale et devrait être faite depuis longtemps. Nous la demandons depuis vingt ans. Il faut donc consacrer le droit pour l'enfant d'être entendu sans possibilité de refus du juge. De même, nous militons depuis fort longtemps pour qu'un avocat assiste l'enfant lorsqu'il est entendu dans une affaire le concernant ou pour qu'il intervienne dans la procédure d'assistance éducative. C'est indispensable, et votre Mission ne peut, à ce sujet, se limiter à une pétition de principe. Il faut donc réunir une conférence de consensus pour dégager les moyens nécessaires à la rémunération des avocats chargés de défendre les enfants, sans quoi rien ne se fera. Comment recueillir la parole d'un enfant victime d'une infraction pénale et comment l'accompagner jusqu'au procès ? Les conclusions du rapport Viout sur l'affaire d'Outreau sont éclairantes. Elles démontrent l'emprise des blocages psychologiques qui font que, dans certains départements, 20 % seulement des enfants sont entendus sous vidéo, alors qu'ils sont 80 % ailleurs. Pourquoi ? Parce que les policiers les en dissuadent, soit qu'ils estiment l'enregistrement vidéo inutile - le juge ne visionnera pas la cassette -, soit qu'ils redoutent d'être eux-mêmes jugés dans leur pratique d'interrogatoire. La loi du 17 juin 1998 est pourtant une bonne loi, et votre Mission pourrait utilement interroger la Chancellerie pour savoir quelle suite sera donnée au rapport Viout. Quant aux règles de désignation des administrateurs ad hoc, elle ne garantissent évidemment pas leur indépendance, puisque le parquet est à la fois juge et partie. Il faut donc constituer un corps autonome, et prévoir pour ses membres une formation et une rémunération. Vous me demandez, pour finir, s'il faut revenir sur la spécialisation des juges pour enfants et ce que je pense du projet de création d'un juge de la famille, compétent pour toutes les affaires concernant la famille. C'est un véritable big bang que cette réforme propose. Il faut veiller à ce que l'on n'en revienne pas au XIXème siècle. L'idée d'un grand juge de la famille est séduisante, et elle s'est d'ailleurs concrétisée avec la création en 1993 du juge aux affaires familiales. Certains, considérant que les compétences de ce juge sont insuffisantes, proposent de faire basculer vers lui l'adoption, l'assistance éducative - et avec elle les quelques 200 000 situations suivies -, la tutelle et l'émancipation. Dans un tel schéma, les juges des enfants deviennent juges d'instance. Pourtant, leur travail n'est pas le même que celui des juges aux affaires familiales qui fait la loi dans la famille, mais n'assure pas le « service après vente ». Le juge des enfants, quant à lui, travaille avec les services sociaux pour revoir régulièrement la situation de l'enfant et modifier ses décisions en fonction de l'évolution des besoins. Ce qui est proposé, c'est l'absorption du juge des enfants par le juge de la famille qui travaille sur la rupture du lien et non sur le suivi de ce lien. Est-ce une bonne chose de détruire un siècle de progrès ? Je n'ai pas le sentiment que cela corresponde aux besoins du moment. Je constate, en revanche, que démanteler l'institution du juge pour enfants, à la fois juge pour la délinquance et juge pour la protection de l'enfance en danger, rétablirait la conception de l'enfant délinquant qui prévalait avant 1912, et reviendrait sur la réforme voulue par Charles de Gaulle en 1958. L'évolution de notre droit a consisté à dire que l'enfant délinquant est d'abord un enfant en danger, qu'il ne faut pas attendre un délit prétexte pour intervenir, et que, si dans une famille un frère est atteint d'anorexie et que l'autre vole, c'est qu'ils sont confrontés au même problème familial. En d'autres termes, on souhaiterait à nouveau dire que les enfants sont délinquants parce qu'ils sont nés dans une famille délinquante et qu'ils le resteront. Il y aurait donc 13,5 millions d'enfants qui se portent bien, 500 000 familles « fragiles » à faire protéger par l'ASE et 200 000 délinquants à faire protéger par l'État... Si c'est cette répartition verticale par symptôme que l'on veut instaurer, ce serait une régression majeure. Notre arsenal législatif est bon, et il n'est pas besoin de le modifier pour changer de politique, nous l'avons démontré à Bobigny. Surtout, il ne faudrait pas modifier la loi sans attendre que l'ONED ait eu le temps de rendre ses conclusions et qu'aient été rendues publiques et analysées celles, passionnantes, des deux groupes de travail installés par Mme Roig lorsqu'elle était ministre chargée de la famille. Avant de casser les tribunaux pour enfants, l'un des rares dispositifs qui fonctionnent à peu près bien au sein de la justice, avant de voter une réforme aussi fondamentale que celle qui vous est proposée, notamment par Mme Martinez, prenez le temps de l'analyse. Pour conclure, je voudrais insister sur l'importance de garantir à chaque enfant un père et une mère légaux, et je constate que la proposition de Mme Pécresse va en ce sens. Si vous souhaitez réellement travailler à l'attachement, faites que l'adoption plénière crée un lien fort et irréversible mais ne nie pas le passé de l'enfant, et soyez cohérents : permettez à tout enfant qui veut accéder à ses origines de le faire, ce que la loi de 2002 n'autorise pas. Exigez du Gouvernement qu'il clarifie les responsabilités de l'État à l'égard des enfants étrangers isolés en tenant compte des conclusions du rapport de M. Bernard Landrieu et décidez - mais sans doute une circulaire suffirait-elle - que, lorsqu'un de ces enfants a été pris en charge par un conseil général à la demande de l'État, il faut à sa majorité lui accorder un titre de séjour provisoire afin qu'il puisse poursuivre ses études. Ne pas le faire, c'est à la fois se tirer une balle dans le pied et fabriquer des clandestins. Par ailleurs, si vous voulez éviter que la France soit condamnée par la justice européenne, demandez la constitution d'une commission d'enquête sur les centres éducatifs fermés. Demandez également la création d'un ministère de l'enfance et de la famille ou, au moins, d'une délégation interministérielle. Enfin, donnez un coup de pied dans la fourmilière, rappelez l'État à ses engagements et obtenez du Gouvernement qu'il relance la journée nationale des droits de l'enfant, le 20 novembre, pour promouvoir la CIDE. Il faut s'assurer que l'enfant a des droits, car on ne peut exiger des jeunes qu'ils respectent le droit que s'ils sont eux-mêmes reconnus comme sujets de droit. M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé extraordinairement complet, sous-tendu par l'idée qu'une loi serait peut-être utile, mais qu'il faut plus sûrement modifier les pratiques. Table ronde ouverte à la presse sur la réforme de la protection de l'enfance, réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Je vous souhaite la bienvenue. Notre Mission, qui examine depuis plusieurs semaines le fonctionnement du dispositif de protection de l'enfance, souhaite, au cours de cette deuxième table ronde, entendre le point de vue et les propositions de réforme des associations de défense des droits des enfants et des organismes chargés de suivre l'évolution des risques qui pèsent sur eux. Je donne, pour commencer, la parole à Mme Martine Brousse. Mme Martine Brousse : Je représente La Voix de l'enfant, fédération d'associations qui travaillent à la protection et à la défense des enfants en France et dans le monde. Je serai directe : prenons le temps d'appliquer les lois avant d'en élaborer d'autres. Au fil des ans, on a assisté à la multiplication des rapports et des propositions, puis des textes qui, pour la plupart, sont peu ou très mal appliqués, notamment parce que certains décrets ne paraissent pas ou parce que les moyens d'application ne sont pas réunis. De ce fait, on ne peut mettre en œuvre une véritable protection de l'enfance. La France s'est dotée de ce qui est, sans doute, l'une des meilleurs législations au monde pour protéger ses enfants, mais, faute de moyens et de cohérence, il y a un fossé immense entre le droit et la manière dont il est appliqué. Ainsi, la loi du 17 juin 1998 prévoit que le recueil de la parole de l'enfant victime doit être enregistré ; or, dans 80 % des situations, ce n'est pas le cas. Pourtant, la disposition est obligatoire, et elle a fait la preuve de son utilité là où elle est mise en œuvre. Mais les personnels ne sont pas formés et les équipements audio-visuels manquent. Où est la cohérence ? Une véritable politique de protection de l'enfance suppose que l'enfant soit au cœur des priorités. Or certains départements ferment des services indispensables, pour donner la priorité à la construction d'une autoroute ou d'autres infrastructures. La représentation nationale doit absolument se prononcer sur la priorité à donner à l'enfance dans nos politiques. Que l'on veuille bien se rappeler que la loi de 1998 prévoyait l'audition des enfants victimes de violences sexuelles. Qu'en est-il ? Plus de 80 % des auditions des enfants ne sont pas enregistrées. La Voix de l'enfant a initié en 1999 les premières permanences et unités d'accueil médico-judiciaires. Aujourd'hui, huit unités seulement ont été ouvertes et dix sont en projet. Toutes sont, en grande partie, financées par des fonds privés. Le garde des Sceaux a beau appeler à l'ouverture de telles unités dans tous les départements, rien ne se fera si des moyens publics ne sont pas alloués. À Carpentras, nous avons constaté que le financement de l'unité d'accueil médico-judiciaire pour les mineurs victimes proviendrait en grande partie de financements privés ; que se passera-t-il s'ils viennent à manquer ? Quant au dispositif de signalement puis de prise en charge des mineurs victimes, il présente des dysfonctionnements réels, faute de cohérence d'ensemble et surtout d'une formation adéquate qui permettrait à tous les professionnels de la protection de l'enfance de prendre en charge tous les enfants en danger. Une réflexion de fond s'impose, tant sur la formation initiale que sur la formation continue. Nous n'avons pas davantage de réelle politique de prévention ; elle n'est qu'effet d'annonce. Enfin, il faut aussi relever les carences de protection et de prise en charge des mineurs étrangers isolés, non-accompagnés. La France a l'obligation impérieuse de définir dans les meilleurs délais une politique en direction des mineurs étrangers isolés, car il est intolérable de trouver au petit matin, avenue Foch à Paris, des enfants d'une douzaine d'années qui ont passé la nuit dehors. C'était le cas encore ces jours-ci. M. Arnauld Gruselle : La Fondation pour l'enfance est un organisme privé créé en 1977 par Mme Giscard d'Estaing pour améliorer la défense de l'enfance en danger et pour promouvoir la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). Depuis quelques années, nous nous préoccupons plus particulièrement des disparitions d'enfants et des risques qu'internet présente pour leur sécurité. À ce titre, nous participons à la campagne de sensibilisation qui vient d'être lancée : des tapis de souris vont être distribués à 800 000 élèves de CM2, où figurent des conseils de précaution destinés aux jeunes internautes. Comme vous le savez, Mme Roig, lorsqu'elle était ministre chargée de la famille, avait installé deux groupes de travail, dont l'un a été chargé de formuler des propositions tendant à améliorer la procédure de signalement de l'enfance en danger. Bien que le rapport n'ait pas encore été remis au ministre, le sénateur Philippe Nogrix, président de ce groupe de travail dont je suis le rapporteur, m'a autorisé à vous faire part de certaines de nos propositions. La première tend à renforcer l'encadrement et la formation initiale et continue des intervenants. Dès la formation initiale, devrait être instauré un module commun, obligatoire et non optionnel, de sensibilisation à la protection de l'enfance, pour tous les professionnels. Les formations continues sur l'enfance maltraitée devraient s'adresser à toutes les professions concernées et être pluridisciplinaires, locales, régulières, théoriques et cliniques, et soumises à évaluation. Il faut d'autre part parvenir à des évaluations partagées en suscitant des échanges interdisciplinaires, afin de confronter l'ensemble des signaux d'alerte. Cela suppose de clarifier la notion de secret professionnel telle que définie par l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, et d'envisager une nouvelle définition du secret partagé, en s'inspirant des dispositions en vigueur pour le secret médical. Il convient encore d'offrir, dans tous les départements, un soutien psychologique aux professionnels confrontés à la maltraitance. Il faudrait aussi, en amont du signalement, élaborer des « indicateurs de souffrance » permettant de repérer des signes évoquant des difficultés. Un tel outil de référence, établi de manière concertée, garantirait une objectivité accrue, et constituerait le socle d'une évaluation partagée et pluri-professionnelle. Son élaboration pourrait être coordonnée par l'ONED en se fondant sur les travaux déjà conduits, notamment par l'ODAS. De même, il serait bon de se fonder sur les travaux de l'ODAS pour construire, dans le respect de la vie privée, un dispositif de collecte, quelle que soit l'administration concernée, des informations préoccupantes concernant des enfants résidant en famille ou en établissement. Un tel dispositif permettrait de réunir ces informations en faisceaux, et ainsi de les identifier précocement comme des signaux d'alerte, voire comme des indices de mauvais traitements. Il convient encore d'affirmer le rôle pivot du conseil général comme passage obligé des signalements ou des informations préoccupantes permettant l'évaluation globale des situations. Enfin, il faut faire du groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée (GPIEM) l'outil d'une meilleure collaboration entre les différents acteurs. Sa composition en fait un forum idéal pour traiter des questions liées à la protection de l'enfance, si ce n'est que les conseils généraux n'y sont actuellement pas représentés ; les textes devront impérativement y remédier. En conclusion, améliorer la procédure de signalement et donc la situation des enfants en grandes difficultés, voire en grande souffrance, ne demande pas de bouleversements institutionnels. II convient néanmoins de réaffirmer le rôle pivot du conseil général et de créer des outils d'aide à la décision, définis par l'ensemble des professionnels de la protection de l'enfance. Mme Marie-Paule Martin-Blachais : L'Association française d'information et de recherche sur l'enfance maltraitée, créée par le pédiatre Pierre Straus, rassemble depuis 1979, dans un cadre pluridisciplinaire et pluri-institutionnel, des personnes concernées à titre professionnel par l'ensemble des champs contribuant à la protection de l'enfance. Les propositions que je vous présenterai découlent de la réflexion de ces professionnels. La protection de l'enfance devrait, en premier lieu, s'articuler avec la prévention médico-sociale, en tenant compte de ce qui se fait dans le champ de la périnatalité, de la pédiatrie sociale, de l'accompagnement des séparations et du divorce et des réseaux de soutien à la parentalité. Il faut aussi améliorer les outils d'évaluation et les référentiels de bonnes pratiques par le biais de conférences de consensus et rendre le dispositif plus compréhensible en définissant strictement son organisation, les limites de compétence et de responsabilité, les lieux de décision, d'exécution et de recours. Il faut aussi articuler la protection de l'enfance avec les structures d'éducation et de soin, la formation professionnelle et les dispositifs d'insertion, pour permettre une prise en charge transversale. Enfin il faut aussi réactiver la pédiatrie sociale et la psychiatrie de liaison, car, si le principe d'unités médico-judiciaires peut apporter certaines améliorations, la question reste posée de la prise en charge de l'enfant victime après la période de crise et, faute de suivi longitudinal, on ne peut mesurer l'efficacité et l'efficience de la réponse apportée. Le toilettage du code de l'action sociale et des familles est nécessaire pour tenir compte de l'évolution législative et réglementaire, et pour renforcer une cohérence défaillante même du point de vue sémantique. J'ajoute que, si l'ODAS a eu le mérite de réfléchir à la définition des publics, sa typologie doit se mettre en conformité avec le code de l'action sociale et des familles et le code civil. Il est tout aussi nécessaire de clarifier les critères de danger et de judiciarisation, car, pour l'heure, ceux-ci relèvent davantage des us et coutumes. Il faut prendre en compte les prérogatives de l'autorité parentale et la capacité à l'exercer, telle que définie par les travaux du professeur Houzel, et articuler l'autorité parentale avec la notion de l'intérêt de l'enfant introduite dans le code civil. Il importe encore de clarifier les compétences et donc les responsabilités. On sait que la décentralisation a confié la protection de l'enfance aux départements mais, sur le plan pratique, plusieurs interrogations persistent : qui est le mandant ? Qui est le mandataire ? Quels sont les champs d'action respectifs des juges des enfants, des conseils généraux, des services publics et privés de prise en charge ? En outre, le temps judiciaire ne doit pas faire perdre de vue le critère de protection de l'enfant. Le secret professionnel étant transgressé dans chaque réunion de professionnels, il faut sécuriser le travail pluridisciplinaire en institutionnalisant le secret partagé. Il faut aussi mettre au point un dispositif approprié pour traiter les pathologies familiales dysfonctionnelles pendant les périodes de placement ; l'accompagnement des familles est indispensable pour évaluer et accompagner le retour de l'enfant quand il est possible. Enfin, il ne faut pas perdre de vue la nécessité de diversifier les modes de prise en charge, ni se priver de la possibilité d'expérimentations, au lieu de s'en tenir au « tout ou rien » actuel. J'insiste pour finir sur la nécessité de recherches longitudinales qui seules permettront d'évaluer la pertinence du dispositif retenu par la qualité de l'insertion des enfants et familles pris en charge. Mme Jacqueline Bruas : Le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant est une fédération de 80 associations dont chacune défend l'application de l'un des articles de la CIDE. Nous observons qu'il est facile de parler d'un enfant en danger, mais plus difficile de parler d'un mineur qui a basculé dans la délinquance. Pourtant, tous ont des droits et tous doivent être aidés. En définissant la résilience, M. Boris Cyrulnik a décrit en creux les failles de la parentalité et souligné l'importance d'un adulte référent sur lequel l'enfant peut s'appuyer pour construire une personnalité équilibrée. L'enfant doit être au cœur du processus de ce que l'on fait pour lui. Il est difficile d'être parent, et la Défenseure des enfants a montré quels sont les risques du basculement vers la maltraitance. Il faut aider les familles prémaltraitantes en formant les futurs parents à leur nouveau rôle, en leur expliquant qu'élever un enfant constitue un ensemble de bonheurs et de contraintes. Il faut, d'autre part, favoriser la parole de l'enfant, qui doit pouvoir dénoncer les abus et dire les manques, afin de l'aider à redevenir maître de son destin. Notre arsenal juridique est excellent, mais il reste à informer l'enfant et la famille sur les choix retenus, à multiplier les espaces d'expression de la parole de l'enfant et à élaborer un protocole de prévention de la maltraitance, tout en veillant à respecter la vie privée de l'enfant. De nombreux textes ont déjà été adoptés ; tous doivent tendre à faire de l'enfant un acteur de sa propre protection et à aider la famille à assumer son rôle protecteur. Mme Christine Mariet : En quelque trente années d'existence, Enfance et partage a constitué un réseau de 32 comités locaux, et créé un numéro vert destiné au signalement et à la prise en charge psychologique et judiciaire des mineurs victimes de violences. Forte de ma propre expérience de bénévole au sein du comité local des Hauts-de-Seine, je traiterai de la situation à l'école. J'observe que 70 % des enfants maltraités ont entre trois et onze ans. Dans cette tranche d'âge, les adultes qui, après les parents, sont le plus longtemps au contact des enfants sont les instituteurs. Ils sont donc les mieux à même de dépister un enfant en souffrance. La question de la formation des maîtres est donc centrale : les instituteurs sont très désemparés quand ils soupçonnent des mauvais traitements à enfant et expriment une très forte demande d'aide. Une formation spécifique est faite dans certains instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), mais on constate qu'elle est dispensée de manière très inégale selon les académies. Cette disparité est d'autant plus regrettable qu'une circulaire de 1997 rend obligatoire la formation au dépistage de la maltraitance pour tous ceux qui travaillent en milieu scolaire. Pour ce qui est de la médecine scolaire, il y a beaucoup à faire. Il n'y a ni médecin ni infirmière à l'école ; ils viennent à la demande des chefs d'établissement, et il n'y a souvent qu'un médecin pour deux ou trois établissements. De ce fait, un enfant peut sortir du système scolaire primaire sans avoir jamais été soumis à un examen médical qui serait pourtant une occasion de dépistage. Nous le déplorons. Je partage l'opinion exprimée par Mme Brousse : ce ne sont pas les textes qui pèchent, mais leur application et le manque de moyens. J'insiste d'autre part sur la nécessité d'une prévention précoce. La maltraitance découle d'une grande souffrance des parents, qui peut se manifester dès la grossesse. Là encore, le dépistage est très difficile faute de moyens de formation, ce que je regrette profondément, d'autant que le séjour des femmes à la maternité a été réduit à trois ou quatre jours. Comment détecter quoi que ce soit en un temps aussi court ? Le dépistage devrait être fait beaucoup plus tôt. On éviterait ainsi d'imputer au baby blues ce qui est en réalité une dépression profonde, grand facteur de risque de maltraitance. Les femmes dans cet état ne devraient pas être laissées à elles-mêmes après leur sortie de la maternité, mais suivies comme le sont les femmes toxicomanes ou alcooliques. M. Paul Durning : Deux institutions récentes sont chargées de l'étude du système de protection de l'enfance et peuvent donc, avec d'autres, fonder des modifications législatives ou réglementaires : le Conseil national d'évaluation des institutions et des services sociaux et médico-sociaux, qui vient d'être installé, et l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED), qui rendra son premier rapport au Parlement et au Gouvernement avant la fin de l'année civile. Encore conviendrait-il de laisser à ces deux organismes un minimum de temps pour formuler un diagnostic et des propositions. De très nombreuses initiatives ont été prises en 2004 et 2005 : deux rapports avaient été demandés par Mme Roig, qui doivent être remis au Gouvernement dans les jours qui viennent ; un autre, sur la sécurité du mineur, a été élaboré sous l'égide de Mme Hermange et de M. Rudolph à la demande de M. de Villepin ; d'autres réflexions ont eu lieu sur la protection des enfants confrontés à internet et sur la vigilance à l'égard des sectes. À cela se sont ajoutés les appels publics de personnalités, les propositions de lois, les groupes de travail parlementaires, sans parler de votre Mission, dont nous attendons beaucoup. Si les remises en cause sont nombreuses, les propositions sont multiples et souvent disparates. C'est pourquoi je ne proposerai ni de renforcer les formations pluri-professionnelles, ni de situer plus clairement le 119 comme instance de conseil pour les professionnels non spécialistes que sont, par exemple, les enseignants ou les moniteurs de sport, ni de clarifier tel ou tel aspect du circuit de signalement ou des dispositifs d'accueil des victimes, ni de créer une « troisième mesure » autre que le placement d'une part, l'aide éducative à domicile et l'aide éducative en milieu ouvert d'autre part. Je suis en effet convaincu que l'on ne peut se limiter à créer de nouveaux dispositifs, à imaginer de nouvelles procédures ou à replâtrer ponctuellement le cadre institutionnel complexe de la protection de l'enfance et des droits des enfants. Il faut conduire un travail législatif de fond pour rendre cohérents des dispositifs et des concepts d'origines différentes. Des questions fondamentales doivent trouver une réponse : doit-on remettre en cause la « double entrée » dans le système - la voie judiciaire d'une part et la voie administrative d'autre part - et lui préférer un portail unique, chaque institution étant ainsi systématiquement informée ? Jusqu'à quel point convient-il d'imposer des procédures et une organisation aux conseils généraux ? Ne faut-il pas mettre en cohérences les textes de 1958-1959 et de 1970 avec la loi de 1989 ? Enfin, doit-on penser en termes de protection de l'enfance, dans le cadre de l'autorité parentale, ou en termes de droits des enfants et d'opposition auteurs-victimes, ce qui fragiliserait les liens avec l'organisation actuelle, construite autour de la notion d'autorité parentale ? Un travail législatif d'une telle ampleur requiert du temps. Deux ans me semblent une durée raisonnable au vu de l'importance des enjeux, sachant qu'il faut réellement coordonner l'action gouvernementale et définir des modalités d'intégration des conseils généraux et des associations de protections de l'enfance à ce travail. Puis-je rappeler que le comité interministériel de l'enfance maltraitée, créé par un décret du 12 mars 1997, n'a jamais vu le jour ? Il faut utiliser le très important travail d'analyse et de propositions déjà conduit, que l'ONED contribuera à renforcer. M. Jean-Louis Sanchez : L'Observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS), créé sous forme associative en 1990, est le lieu politiquement œcuménique - l'observatoire est actuellement présidé par M. Pierre Méhaignerie, mais il aura sous peu une coprésidence gauche-droite - de la réflexion commune des principaux décideurs et acteurs de l'action sociale. L'amélioration de la protection de l'enfance doit s'appuyer sur les travaux existants, particulièrement quand ils ont été validés par des partis politiques qui s'opposent. À cet égard, quels sont les constats de l'ODAS ? D'abord, la décentralisation a été une réussite : le dispositif n'a pas été politisé ; en quinze ans, les moyens, en francs constants, ont doublé alors que le nombre d'enfants placés a reculé ; enfin, on constate une réduction des inégalités entre les départements. Il arrive donc que la proximité régule mieux que la norme. On observe également un souci d'évaluation que l'on aimerait trouver ailleurs, et on mesure l'ampleur des résultats obtenus au fait que le Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM) n'a révélé que de 3 % à 5 % de situations non connues des services. Pour autant, le dispositif est encore très perfectible, et l'affaire d'Angers a montré les défaillances des mécanismes de repérage. De plus, le nombre de familles en difficulté augmente, et avec lui les risques, car la précarité économique, relationnelle et identitaire est la première source de maltraitance. Il ressort ainsi des analyses d'une étude ODAS-SNATEM que, lorsqu'elles sont liées, monoparentalité et inoccupation sont des facteurs de risque très aggravants. C'est pourquoi le maintien de la famille dans l'assistance présente un danger pour l'enfant ; on voit tout l'intérêt du renforcement du lien entre RMI et insertion pour sortir l'enfant de son isolement. Par ailleurs, un travail considérable est nécessaire pour formaliser le suivi des enfants. Enfin, l'absence de coordination entre les différents acteurs est indiscutable. Sur ce point, l'Observatoire préconise une clarification des responsabilités, qui pourrait aboutir à renforcer la compétence des départements sur les enfants en risques tandis que la justice ne serait plus saisie que des enfants présumés maltraités. Il faut d'autre part repenser le travail social. Les professionnels ont du mal à appréhender une démarche collective. Leur formation doit être revue et leur mission repensée entièrement. En outre, le travail social devrait être ouvert à des gens plus âgés et plus expérimentés. Les travailleurs sociaux pourraient alors pénétrer dans certains quartiers, et éviter ainsi que d'autres y jouent leur rôle, avec les risques que cela comporte. Il est grand temps aussi de renforcer la prévention primaire car les politiques en vigueur sont trop orientées vers la réparation. Une réflexion doit être menée sur le rôle des communes, l'implication des politiques municipales étant essentielle. Une plus grande ouverture de l'école, par la décentralisation du service social scolaire, aurait été nécessaire ; le recul du Gouvernement sur ce point a été contreproductif pour les enfants. Il est regrettable que l'on n'ait pas retenu le principe d'un service social dans chaque école, ouvert sur le quartier. C'est donc un vaste chantier qui s'ouvre, et l'ODAS y consacrera son prochain congrès, en juillet 2005, avec le souci d'interpeller sur diverses propositions les représentants des grandes institutions nationales et de l'État. M. le Président : Je vous remercie pour ces interventions croisées. Peut-être les législateurs que nous sommes seront-ils déçus que certains d'entre vous n'attendent pas une grande loi, mais vous nous avez expliqué que nous pouvions néanmoins faire œuvre utile de toilettage et de mise en cohérence des textes existants. Vous avez aussi insisté sur les aspects institutionnels qui nous intéressent en tant qu'élus nationaux et locaux. Vous avez enfin mis en avant un certain nombre de points importants, et fait plusieurs propositions. M. Bernard Debré : J'ai été frappé par le fait que vous soyez nombreux à souligner que les lois existaient, mais qu'il fallait les appliquer. C'est un mal que nous connaissons hélas bien. S'agissant des causes de la maltraitance, vous avez parlé de monoparentalité, de chômage, d'économie, d'enfants isolés. Tout cela paraît évident, mais ne conviendrait-il pas d'y faire figurer aussi la violence que l'on voit chaque jour à la télévision, dans les informations comme dans les fictions, et dans les jeux vidéo ? Le risque n'est-il pas aussi plus fort lorsque les enfants de onze ans regardent des films pornographiques ? Je n'ai nulle envie de jouer les censeurs, mais j'aimerais que vous nous en disiez davantage sur ces causes que je qualifierai de sociétales. Même s'il faut faire attention à ne pas s'immiscer en permanence dans la vie des couples, à vous entendre il est évident qu'on souffre d'un manque de dépistage des adultes à risques avant la maltraitance. Comment faire pour repérer les parents à risques ? Vous n'avez pas abordé la question de l'usage des drogues, dures comme douces, qui peut aussi perturber les parents. J'ai bien compris ce qui a été dit à propos du dépistage à la maternité. J'observe toutefois que garder les mères trop longtemps dans les maternités peut leur faire courir le risque d'infection nosocomiale. Il est vrai que les mères, une fois rentrées chez elles, sont plus difficilement accessibles, et que leur fragilité aggrave le risque. Il serait donc utile de procéder à un dépistage non seulement lors des consultations avant la naissance, mais aussi après la naissance, par exemple chez le pédiatre. Comment ne pas s'inquiéter du manque d'infirmières et de médecins scolaires quand vous nous dites que certains enfants ne sont jamais examinés au cours de leur scolarité ? En dehors du sujet qui nous occupe aujourd'hui, ce manque de suivi médical peut poser des problèmes de vaccins ou de dépistage tardif des addictions. Il est quand même incroyable que la loi ne soit pas appliquée, faute de professionnels de santé. M. Francis Delnatte : La proposition de M. Sanchez de réserver l'exclusivité de l'accompagnement des familles en difficulté au travailleur social ne paraît pas compatible avec la grande diversité des situations. Il y a notamment un certain nombre de cas où le courant ne passe pas et où le travail en réseau est particulièrement utile. De même, l'idée de confier au département tout ce qui relève de l'enfance en danger et à la justice tout ce qui a trait à l'enfance maltraitée me paraît difficile à mettre en œuvre, car la distinction n'est pas toujours très nette. De quoi relèvent, par exemple, les problèmes de nutrition ou d'hygiène ? M. Alain Vidalies : S'agissant du rôle des conseils généraux, je m'étonne du discours consensuel qui a été tenu sur la réussite de la décentralisation, car les pratiques ne sont pas du tout unifiées. Serait-il donc interdit de relever que la déclinaison locale d'une politique nationale prioritaire fait l'objet de disparités de traitement dans le cadre de la décentralisation ? Je crois pour ma part que le législateur doit aller au-delà de cette présentation idyllique et s'emparer de cette question. S'agissant des mineurs étrangers isolés, on ne peut apporter une réponse sans prendre en compte la diversité des situations. La présence de ces mineurs à Marseille tient presque d'une habitude culturelle, alors que les jeunes Roumains qu'on trouve à Paris dépendent de réseaux mafieux, à tel point que ce sont ceux qui pillaient les horodateurs qui sont devenus des prostitués lorsque ces appareils ont été sécurisés. Enfin, personne n'a traité la question de la sacralisation de la parole de l'enfant. Devant certaines affaires récentes, nous devons pourtant nous demander pourquoi les droits attribués par le législateur au nom du principe de sacralisation de la parole de l'enfant ont entraîné des réponses judiciaires qui ne sont pas satisfaisantes du point de vue de la justice. M. le Président : Je suis soucieux comme vous de l'égalité territoriale et je pense que seul l'État peut la garantir. M. Pierre-Christophe Baguet : Nous avons en effet travaillé, au sein de la mission parlementaire sur l'esclavage moderne que présidait Alain Vidalies, sur la situation des mineurs étrangers, dont nous avions le sentiment qu'elle variait en fonction de situations géographiques et sociales disparates. Pensez-vous, madame Brousse, que cette situation s'est dégradée depuis lors ? Je me réjouis du plaidoyer de M. Sanchez en faveur de la proximité et du rôle que doivent avoir les communes dans la politique de la ville et la création du lien social. Je crois en effet que le département est une grosse machine et que, si le conseil général a compétence en matière d'action sociale, nous, élus de proximité, sommes mieux informés et mieux placés pour coordonner les interventions. Je souhaite par ailleurs savoir comment M. Gruselle envisage cette évaluation partagée qui permettrait de croiser les signaux. Pense-t-il que cela devrait se faire au niveau local, en s'inspirant par exemple des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ? L'idée d'un protocole de prévention de la maltraitance évoquée par Mme Bruas me paraît excellente, mais je souhaite avoir des précisions sur son contenu. Comment serait-il compatible avec la protection de la vie privée de l'enfant ? Mme Mariet nous a dit pour sa part que la formation obligatoire dans les IUFM, bien qu'instituée par une circulaire de 1997, n'est pas systématique. Cela me choque. Peut-elle nous donner des chiffres à ce propos ? M. le Président : Je crois comprendre que vous privilégez le maire par rapport au président du conseil général... Mme la Rapporteure : On a parlé de prévention, de suivi de la grossesse et de la maternité, l'entretien du quatrième mois pouvant être un élément essentiel du dépistage. Mais que pensez-vous de la systématisation du suivi à domicile des accouchées ? Selon quels critères y aurait-on recours ? Faudrait-il le généraliser pour éviter de stigmatiser certaines femmes ? Ne conviendrait-il pas également de remettre à l'honneur le certificat du neuvième mois ? Il est vrai par ailleurs qu'on n'est pas allé au bout de la décentralisation pour la médecine scolaire. Que pensez-vous de la proposition qui nous a été faite de donner à la protection maternelle et infantile (PMI) compétence pour la médecine scolaire dans le primaire, ce qui lui permettrait d'étoffer ses moyens, de toucher davantage de familles et d'avoir accès à plus d'informations ? Pour répondre à la nécessité de clarifier les responsabilités, ne serait-il pas nécessaire d'identifier, au sein du conseil général, un correspondant chargé de la protection de l'enfance ? On a vu dans l'affaire de Drancy que les trois services compétents du conseil général de Seine-Saint-Denis avaient chacun des informations, mais qu'ils ne les ont pas partagées. Certains conseils généraux sont énormes, ce sont de véritables États dans l'État, c'est pourquoi disposer d'un référent unique me paraîtrait utile. Cela nous ramène d'ailleurs au secret partagé et à la question de M. Baguet sur l'implication du maire. Vous nous dites également que, à bien des égards, il suffirait d'appliquer la loi. Pouvez-vous, à partir de vos expériences de terrain, nous indiquer quelles sont les dispositions qui ne sont pas appliquées ? Enfin, on a très peu parlé de pédopsychiatrie. Que préconisez-vous pour améliorer le suivi psychologique des enfants ? Faudrait-il rembourser les consultations chez les psychologues cliniciens de l'enfance qui exercent en libéral, à condition que le traitement fasse l'objet d'une prescription psychiatrique ? M. le Président : Nous avons déjà eu un débat sur la pédopsychiatrie et la protection de l'enfance, au cours duquel on a parlé d'expérimentation, de recherche et d'autres solutions qui permettraient peut-être de sortir de la crise actuelle par le haut. Beaucoup des personnes que nous avons précédemment auditionnées nous ayant dit qu'on manquait de moyens, pensez-vous que la dépense sociale est suffisante ? Et, si elle est mal utilisée, comment proposeriez-vous de l'utiliser mieux ? M. Jean-Louis Sanchez : Je plaide pour la décentralisation, mais elle ne peut vivre que dans le respect du principe de cohésion nationale, ce qui ne signifie toutefois pas le retour de l'étatisme. M. le Président s'est déclaré soucieux de l'égalité, mais qui produit l'égalité ? Si on compare les conditions dans lesquelles l'État finance l'allocation aux adultes handicapés et celles du versement de l'allocation personnalisée à l'autonomie par les départements, on s'aperçoit que ces derniers respectent bien davantage le principe d'égalité. Il est cependant vrai que le conseil général n'est pas forcément le plus efficace. En région parisienne, par exemple, la taille des départements n'est guère compatible avec la proximité. Pour autant, des progrès considérables ont été faits. Dans la récente affaire d'Angers, les dysfonctionnements sont largement imputables à la justice et bien moins aux services sociaux. Je crois qu'il faut amplifier le rôle du conseil général, car on observe aujourd'hui une judiciarisation des signalements. En effet, au lieu de conserver la responsabilité du dossier, le travailleur social préfère se dédouaner en alertant la justice qui est elle-même si embouteillée qu'elle ne peut traiter la question. Ainsi, à Angers, en dépit de leur bonne volonté, les services judiciaires n'ont pas pu constater la montée de la barbarie. La coordination, tout le monde en parle, mais nous ne la voyons pas, d'autant que la justice ne parvient pas toujours à coordonner en son sein le parquet et le juge des enfants. Qui plus est, la jeunesse et la mobilité des juges sont telles que, paradoxalement, la continuité de l'État n'est finalement assurée que par les collectivités locales. Bien évidemment, il ne saurait être question de renforcer le rôle des travailleurs sociaux tel qu'il est rempli aujourd'hui. Ils sont les seuls en Europe à entretenir un rapport exclusivement individuel avec les familles, alors qu'il faudrait impliquer le travail social dans le suivi de groupes d'habitants. Inspirons-nous des exemples étrangers : alors qu'en France le travailleur social est essentiellement axé sur la réparation, ailleurs il anime et travaille en réseau autour des familles. Les départements ne traverseront dans de bonnes conditions l'acte II de la décentralisation que s'ils réussissent à mener une réflexion stratégique sur l'articulation de leurs compétences avec celles des communes. Il faut préserver la responsabilité des départements en matière de solidarité organisée et confier aux communes la prévention primaire et le développement social. On pourrait notamment réfléchir sur les possibilités de déléguer aux grandes villes à titre expérimental la protection maternelle et infantile, les services sociaux spécialisés et la médecine scolaire. M. Paul Durning : Après neuf ans d'activité sur le terrain, je partage pleinement le sentiment de M. Sanchez sur l'importance du territoire dans la prévention. Je suis en revanche plus réservé à l'idée de compliquer le système institutionnel en créant des comités de pilotage plus lourds qui intègreraient les responsables municipaux. S'agissant des pratiques de prévention, le bilan que prépare l'ONED pourrait donner l'occasion de faire le point sur la formation dans les IUFM. Mais je crains que ce bilan ne soit maigre et qu'il ne varie en fonction de la personnalité du directeur de l'IUFM et des enseignants concernés. Dans les recherches sur l'enfance en danger, il est très difficile d'isoler les variables et nous ignorons donc largement le poids réel de la violence à la télévision. Ainsi, je dirais qu'on ne trouve pas de familles où les jeunes enfants regardent des films pornographiques et où il n'y ait pas d'autres problèmes. On se trouve face à des dysfonctionnements familiaux qui relèvent de la prévention ainsi que du soutien et de la formation des parents. Je crois que la séparation entre la maltraitance, qui serait de la responsabilité de la justice, et le risque, qui serait de celle du département, ne peut pas fonctionner, car on se heurte au problème de la coopération des familles. Le partage entre les parquets et les départements se fait en fonction de trois critères : s'agit-il d'une situation « pénalisable » ? Y a-t-il urgence ? Y a-t-il coopération de la famille ? En outre, il existe une très grande disparité entre les départements et entre les substituts du procureur. Je crois donc qu'il conviendrait surtout de s'interroger sur les concepts de maltraitance et de danger tels qu'ils ont été définis dans la France de 1958, à un moment où le premier était presque absent du vocabulaire. M. Arnauld Gruselle : En réponse à M. Baguet sur l'évaluation partagée et sur les signes indicateurs, le groupe de travail présidé par M. Philippe Nogrix fait trois propositions complémentaires : partager les signes indicateurs de souffrance en élaborant un outil de référence ; recueillir ces informations grâce à un dispositif adapté, en respectant strictement les règles de confidentialité ; créer, pour recueillir ces données, une cellule départementale de signalement. Mme Marie-Paule Martin-Blachais : Je rappelle, à propos du dépistage précoce, que, dans le cas d'un dysfonctionnement intrafamilial, en particulier de passage à l'acte de maltraitance, il y a un faisceau concordant de facteurs d'origines multiples. On est à la rencontre entre un contexte, des personnes qui se sont construites à partir de ce qu'a été leur propre enfance, et une relation conjugale particulière où on est parfois plus proche du cumul des différences que du soutien mutuel. Dès la naissance, on confronte la parentalité réelle avec l'idée qu'on s'en faisait, l'enfant de la réalité avec l'enfant idéal. Ce sont toutes ces données qui vont produire à un moment donné, dans un contexte donné, l'impossibilité d'apporter une réponse adaptée aux besoins exprimés par l'enfant, et instituer des attitudes inappropriées à l'instauration de liens structurant parents-enfants. Il est vrai que les conduites addictives sont parfois des facteurs aggravants, mais on est là dans une problématique multifactorielle, dont on ne peut faire une lecture linéaire. C'est donc la convergence des éléments qui permet de comprendre la situation de vulnérabilité ou les événements qui se produisent. S'agissant de la prévention, il est évident que l'examen prénatal du quatrième mois, si on parvient à le généraliser, aidera à accompagner la femme pendant sa grossesse, et favorisera des échanges sur la façon dont elle la vit, ce qui peut permettre d'identifier des fragilités et de mettre en œuvre un processus d'accompagnement. Il est vrai qu'il n'est parfois pas nécessaire de maintenir très longtemps les femmes à la maternité après l'accouchement. Mais nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour permettre aux professionnels d'identifier les signes de fragilité. Or, plus le séjour est court, moins ce travail d'observation fine peut être fait, et moins on anticipe les problèmes. Remplacer ce travail par un suivi à domicile, pourquoi pas ? Mais cela relèvera-t-il du secteur hospitalier ou d'un système d'hospitalisation ou d'intervention médico-sociale à domicile ? Le certificat de santé au neuvième mois de l'enfant est toujours obligatoire, mais ne conditionne plus le versement des prestations familiales. Motivée par un souci d'économie de gestion, cette évolution n'a pas favorisé la surveillance médico-sociale. M. Pierre-Christophe Baguet : Mais, bien que la visite reste obligatoire, elle n'a pas eu lieu dans l'affaire de Drancy... Mme Marie-Paule Martin-Blachais : Toute la question réside dans la sanction réservée à l'obligation de visite. De fait, le contrôle par le versement des prestations familiales a disparu. Les difficultés du secteur pédopsychiatrique empêchent les enfants en danger de bénéficier de soins dans des délais favorables. Ces difficultés relancent le débat sur la reconnaissance de la capacité de soins à des psychothérapeutes qui ne sont pas médecins de formation initiale. Les enfants dont nous parlons ont besoin d'un travail d'équipes pluridisciplinaires, et il serait dommage de devoir externaliser une prise en charge qui doit être, selon moi, médico-psycho-sociale. M. Jean-Louis Sanchez : Cette vision très spécialisée de la prévention risque de faire l'impasse sur la nécessité d'impliquer les habitants dans la consolidation du système de protection de l'enfance. À Angers, tous les dysfonctionnements trouvent leur origine dans l'indifférence des habitants. La société a le devoir de rappeler aux populations les limites de la solidarité de délégation. Il faut aujourd'hui réinventer les formes d'une solidarité d'implication. C'était le point de vue de Marceline Gabel, quand elle disait que la protection de l'enfance est l'affaire de tous. Mme Jacqueline Bruas : Le protocole dont j'ai parlé est un vœu pieu. Il faudrait rassembler les critères qui permettent de repérer qu'un couple est fragile et qu'un enfant éduqué par ce couple sera fragilisé et risque de passer à l'acte, sous la forme de prise d'alcool ou de drogue, d'abus sexuels, de pornographie. Je forme donc le vœu que nous parvenions à établir, tous ensemble, les critères qui font qu'un enfant se développe à peu près normalement. Je crois beaucoup au recueil de la parole de l'enfant. Les enfants mentent peu, mais leur parole n'est pas toujours recueillie dans le bon contexte, par les bonnes personnes, dans une bonne ambiance. Pour autant, il faut respecter l'intimité de l'enfant, ne pas tout étaler sur la place publique, ne pas détruire son avenir. Mme Christine Mariet : La sacralisation de la parole de l'enfant est une formule que n'utilisent pas les associations de défense des droits des enfants et qui devrait disparaître. Le problème n'est pas dans une tendance à la sacralisation, mais tient aux conditions dans lesquelles cette parole est recueillie. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Nous ne disposons malheureusement d'aucune étude relative à l'application de la circulaire de 1997 qui impose l'obligation de former les maîtres à repérer les dangers pesant sur l'enfant. Il serait utile de vérifier comment les académies s'en acquittent. Prolonger la compétence de la PMI jusqu'à la fin de l'école primaire est une excellente idée qui devrait permettre un meilleur suivi médical des enfants. Les dispositions de la loi du 17 juin 1998 relatives à l'équipement des brigades des mineurs en matériel audiovisuel donnent un bon exemple de réformes législatives non appliquées. Cet équipement n'est toujours pas installé, et les enfants sont encore interrogés dans de mauvaises conditions. Mme Martine Brousse : La maltraitance physique, sexuelle ou psychologique touche tous les milieux, mêmes si les actes de violence sont davantage cachés quand ils se produisent dans des familles aisées. Ainsi, une tournante qui s'est déroulée à Versailles lors d'un rallye a-t-elle été tue. Elle ne le restera toutefois pas, puisque la jeune fille est désormais majeure et qu'elle veut porter plainte non seulement contre ses agresseurs, mais aussi contre sa famille qui lui a demandé de se taire au nom de son honneur... Si on veut s'inspirer des exemples des autres pays, il faut en particulier mieux protéger les enfants pendant le temps de l'enquête, dès qu'on a un doute. Pour cela, il est important de disposer de lieux d'accueil d'urgence où les professionnels puissent intervenir. Parmi les causes de maltraitance, la télévision, les cassettes vidéo-pornographiques et les jeux violents sont sans doute des facteurs aggravants. Mais c'est aussi un domaine où la loi n'est pas appliquée. Je siège à la commission de classification des films et je m'étonne que des journaux de télévision comme Télérama ne reprennent pas dans leurs programmes la mention des interdits aux moins de 12 ans ou de 16 ans. De même, alors que les jeux sont de plus en plus violents, il est très difficile de trouver une indication d'âge sur les boîtiers. Une interdiction pourrait être appliquée pour la vente des jeux aux mineurs, comparable à celle en vigueur pour la vente d'alcool. Enfin, il est important de souligner les effets néfastes d'internet, bien que ce dernier soit un outil extraordinaire quand il est bien utilisé. Il ne faut pas négliger les phénomènes d'accoutumance : installer un bébé de trois mois devant la télévision aura bien sûr des conséquences sur son développement. On commence d'ailleurs à y voir une des causes de l'hyperactivité. Sur toutes ces questions très importantes, nous attendons beaucoup des politiques. Parler de causes sociétales doit conduire à poser la question de l'adaptation de la protection de l'enfance aux évolutions des valeurs familiales, à se demander ce qu'est un enfant dans une famille, ce que signifie être parents aujourd'hui. Je crois vraiment que l'origine du mal être des enfants est avant tout dans la société et dans les familles. Nous sommes tout à fait d'accord pour que les enfants soient suivis par la PMI pendant toute leur scolarisation en école primaire, et nous demandons même que la médecine scolaire soit renforcée au collège et au lycée. En ce qui concerne la question de la parole de l'enfant, aucune association de protection de l'enfance n'a jamais voulu sacraliser la parole de l'enfant. Ce sont les professionnels qui ont cherché à le faire. Nous, nous parlons de la souffrance qu'exprime cette parole. Quand on va chez le médecin parce qu'on a mal à l'estomac, le fait que les analyses ne montrent rien ne signifie pas qu'on n'avait pas mal... L'enfant met sur sa souffrance des mots et des gestes qui peuvent être mal interprétés par les adultes parce qu'ils ont été mal recueillis. Si La Voix de l'enfant a initié et créé, dès 1999, des permanences et unités d'accueil en milieu hospitalier pour les enfants victimes, c'est parce qu'elle est partie de l'idée que l'enfant était souffrant avant d'être plaignant, et que ce ne sont ni les policiers ni les magistrats qui sont les mieux à même de comprendre cette souffrance. Le corps médical a un rôle à jouer dans la recherche de ces causes : l'intervention d'un médecin permet d'éviter qu'une affaire ne dérape avant même de s'engager dans le circuit judiciaire. J'insiste donc particulièrement sur l'importance des unités d'accueil médico-judiciaires. Concernant la situation des enfants étrangers, isolés et non accompagnés, La Voix de l'enfant intervient dans ce secteur depuis des années, en soutenant les programmes de ses associations membres, notamment en Roumanie ou au Maroc. Nous travaillons en Roumanie pour lutter contre la venue des mineurs non accompagnés en France et nous avons donc quelques difficultés à admettre qu'on parle de réseaux mafieux à leur propos. La plupart de ceux qu'on trouve en région parisienne ne sont pas sous la coupe d'une mafia, ils viennent de la région de Satu Mare. Or, alors que 150 à 200 d'entre eux sont accueillis par l'aide sociale de Paris pour un coût de 150 à 200 euros par jour, les associations qui, sur le terrain, par exemple à Negreşti, Satu Mare dans le pays d'Oaş, cherchent à développer la scolarisation et la formation, ne reçoivent pas un centime, au motif, nous dit-on, que cette intervention n'est pas imputable sur la même ligne budgétaire. Notre premier devoir n'est-il pourtant pas de tout mettre en œuvre pour qu'un enfant grandisse et s'épanouisse dans sa famille, et de faire en sorte pour cela qu'il soit scolarisé dans son propre pays ? Quand on va à Satu Mare où 100 euros représentent plus d'un mois de salaire, on voit les maisons superbes construites grâce à l'argent que procurent ces enfants... C'est pour cela que nous cherchons à favoriser le retour de l'enfant, mais la tête haute, avec un projet professionnel et avec un accompagnement sur place. C'est aussi ce que nous faisons en accompagnant le retour au Maroc par une formation professionnelle en France. Enfin, donnons à ces mineurs, quand ils sont prostitués, la possibilité d'être représentés en justice, ce qui n'est souvent pas le cas lors d'une comparution directe qui empêche même qu'ils soient présents et défendus. S'agissant de la pédopsychiatrie, je crois en effet qu'il conviendrait qu'une consultation devant un psychologue clinicien puisse être remboursée. Il est inadmissible que les enfants victimes attendent trois mois une consultation, alors que, pendant ce temps, leur situation continue à se dégrader. Ensuite, les enfants ont surtout besoin d'un accompagnement psychologique plutôt que d'une prise en charge pédopsychiatrique. D'ailleurs ils nous disent souvent : « le malade, ce n'est pas moi, c'est lui »... Je partage l'enthousiasme de M. Sanchez concernant la décentralisation. Cependant, tout ne se passe pas aussi bien que ce qui vient de nous être présenté. Il faut reconnaître que des enfants ont la malchance de naître dans certains départements et qu'il n'y a pas d'égalité en matière de protection de l'enfance. C'est pour cela que, si de nouvelles lois ne sont pas nécessaires, il me semble en revanche qu'une loi d'orientation serait utile, car elle favoriserait un grand débat national sur la protection de l'enfance, comme celui qui a eu lieu sur la grande pauvreté. Elle permettrait aussi de s'interroger sur les moyens qu'il convient de mettre en œuvre pour une véritable protection de l'enfance. M. le Président : Je vous sais gré de terminer sur cette notion éminemment républicaine d'égalité que nous essayons de porter. Merci à tous pour la qualité de vos interventions et pour la richesse de vos propositions qui contribueront grandement à notre réflexion. Audition de Mme Marie-Thérèse Hermange(1), sénatrice Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous accueillons Mme Marie-Thérèse Hermange, sénatrice. Comme vous le savez, la Mission d'information réfléchit depuis plusieurs semaines sur les moyens d'améliorer notre dispositif de protection de l'enfance. Vous avez réalisé des travaux importants sur l'application de la Convention internationale de droits de l'enfant et les modalités de prise en charge des enfants. Nous avons tous à l'esprit le rapport que vous avez remis en 2002 au Président de la République, intitulé : « Les enfants d'abord : cent propositions pour une nouvelle politique de l'enfance ». Nous avons également noté que vous avez récemment remis au Premier ministre et au ministre de l'intérieur un rapport sur la sécurité des mineurs, rédigé en collaboration avec M. Luc Rudolph, inspecteur général de la police nationale. De ce fait, nous attachons beaucoup d'importance à votre témoignage et nous souhaiterions que vous nous fassiez part de votre réflexion et de vos propositions sur les moyens de renforcer l'efficacité et la coordination des services chargés de la protection de l'enfance, ainsi que sur l'accompagnement des familles en difficulté. Mme Marie-Thérèse Hermange : J'ai en effet été conduite à essayer d'opérer une synthèse sur la politique de sécurité des mineurs ou de protection de l'enfance, d'abord en 2002 et, tout récemment, dans le rapport que j'ai co-rédigé avec M. Luc Rudolph. Les propos et recommandations formulés dans ces deux rapports proviennent aussi de mon expérience vécue à Paris, où, durant la mandature 1995-2000, j'avais en charge l'Assistance publique. Lorsqu'il existe une volonté politique, il est possible de coordonner les différentes institutions pour conduire des actions au profit des personnes âgées ou de l'enfance. Compte tenu de la décentralisation, nous formulons tous, notamment dans les domaines sanitaire et social, cette nécessité de coordination, mais elle n'intervient qu'au niveau administratif et de façon anonyme. Or toutes les politiques de prise en charge des personnes les plus vulnérables doivent être conduites dans une volonté de partenariat au plus près de l'homme - y compris pour régler des problèmes comme celui du secret professionnel partagé -. La protection de l'enfance est l'affaire de tous ; elle ne peut être assurée sans la participation de l'ensemble de la population et des acteurs qui côtoient des enfants : parents, milieu éducatif, collectivités territoriales, État et secteur associatif. Tous, à un titre ou à un autre, ont des forteresses à faire tomber. Je pense que la problématique de la protection de l'enfance n'est pas le manque de dispositifs, mais la nécessité de changer de regard pour conférer à cette politique une approche multidisciplinaire. Il faut solliciter les institutions de la transmission que sont la famille et l'école, grâce à des politiques ambitieuses visant à apporter un soutien adapté au mineur et à son environnement avant qu'une situation de crise n'advienne. C'est aussi, en termes de champs d'action, s'attacher à une approche multidisciplinaire, seul moyen d'appréhender et de répondre à la complexité des situations. Cela m'a conduite à recommander des actions ordonnées autour de six grands axes. Il faut pouvoir se faire une meilleure idée de la réalité en généralisant les outils statistiques et de connaissance. J'ai été frappée de constater que le ministère de l'intérieur connaissait très mal les politiques conduites par l'aide sociale à l'enfance (ASE). Compte tenu de la diversité des dispositifs, les outils statistiques sont éparpillés. Le ministère de l'intérieur dispose des statistiques de la police et de la gendarmerie sur les faits touchant des mineurs, mais il est incapable d'adjoindre à ces statistiques les données sur l'enfance en danger issues des travaux de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée ou d'autres organismes. Il est fondamental de mettre en place un axe préventif permettant d'agir au plus tôt, avant que le cancer ne se propage, c'est-à-dire de substituer une politique de prévenance à une logique de réaction. Cette action doit être conduite dès le plus jeune âge, voire dès le stade de la grossesse. Comment se fait-il que, dans une ville comme Paris, 10 000 enfants - 5 000 dans nos établissements et 5 000 soutenus par des dispositifs d'aide à domicile - soient pris en charge par l'ASE ? Comment se fait-il qu'ils soient 4 000 dans les Hauts-de-Seine et environ autant dans le Nord ? Bref, pourquoi au total 150 000 enfants, dans notre pays, ont-ils besoin d'un soutien de l'ASE, et pourquoi sont-ils pris en charge aussi tard ? Un gynécologue du Var a créé, dans son service, un staff de parentalité pour essayer de regarder la grossesse autrement qu'à travers sa dimension physiologique, en écoutant la mère afin de détecter les déliaisons familiales. Il a emprunté cette voie le jour où il a appris qu'une femme qu'il avait suivie pendant sa grossesse avait défenestré son enfant. Ce staff de parentalité regroupe des équipes hospitalières qui offrent un service pédiatrique, gynécologique et social, ainsi que des professionnels issus d'institutions extérieures. Lorsqu'il perçoit un dysfonctionnement, il peut délivrer une ordonnance, afin d'accélérer l'obtention d'une prestation, d'un logement ou d'une prise en charge psychiatrique ou psychologique. À partir de cette expérience, nous avons initié à Paris des politiques pour soutenir les parents dès la naissance après une observation pendant la grossesse, et nous nous sommes efforcés d'assurer le suivi à la sortie de la maternité. Les 2 500 femmes qui accouchaient chaque année à l'hôpital Lariboisière disposaient ainsi d'un suivi à domicile pendant quinze jours. Ce suivi s'effectuait en partenariat entre trois acteurs : la caisse primaire d'assurance maladie intervenait pour le suivi médical, la caisse d'allocations familiales pour le suivi social, le département de Paris pour le suivi psychiatrique. Cette politique de coordination, pour mieux prévenir, requiert un référent. J'estime que celui-ci est à trouver là où évolue l'enfant : la démarche de reliance, de coordination, de dialogue entre les partenaires, doit se faire à la maternité autour du gynécologue, à la crèche ou à l'école autour de la directrice d'établissement, au collège autour du principal. Le référent est à chaque fois différent, mais c'est lui qui porte la problématique. Dans l'affaire de Drancy, le médecin scolaire et celui de la PMI étaient au courant, mais ils se sont échinés à travailler séparément, sans lisibilité d'ensemble. J'en arrive à la problématique du partage du secret professionnel. Il existe des secrets utiles. Lorsqu'une équipe, tel un staff médical, s'installe pour mieux environner l'enfant, nul n'est besoin de raconter tout à l'ensemble des professionnels. Chaque professionnel ne peut pas tout comprendre de la situation d'un enfant. Il s'agit simplement d'exposer les situations préoccupantes pour que la directrice de crèche, la travailleuse sociale et le médecin se communiquent les bonnes informations, par exemple sur une fratrie. Le maire n'a pas les moyens d'assurer la coordination et, de surcroît, dans certaines communes, il est trop proche des problèmes. En revanche, il doit se mettre à la disposition du président du conseil général pour mettre en place des politiques complémentaires. Quand le président du conseil général veut conduire telle politique de prévention, celle-ci ne sera pas efficace si le maire n'ouvre pas les portes de sa crèche. Vous m'avez demandé si je partageais l'analyse de Mme Claire Brisset sur les inégalités observées entre départements. Ceux-ci sont évidemment très inégaux en taille, en ressources et en moyens humains, et des différences existent aussi au sein de chacun d'entre eux. L'objectif est de tendre à assurer l'égalité de traitement, et ce qui me paraît fondamental n'est pas tellement les écarts de coût, mais la façon dont un enfant est pris en charge : bénéficie-t-il d'un cadre de vie adapté ? A-t-il les mêmes droits scolaires que les autres enfants ? Les familles dont les enfants sont pris en charge par l'ASE sont-elles bien suivies par le département ? En somme, il faut que les droits des enfants et des familles soient respectés partout. S'agissant de l'accompagnement des familles en difficulté, j'ai proposé, pour éviter les placements d'urgence, de créer des relais d'accueil et de prévention de la petite enfance, situés à la lisière de la commune et du département. Ces structures sont difficiles à monter parce qu'elles relèvent à la fois de l'aide sociale à l'enfance et de l'action sociale municipale qui appliquent des prix de journée différents. À Paris, nous avons créé une structure pour accueillir les enfants vingt-quatre heures sur vingt-quatre et écouter les problèmes de la famille. Cette structure assure une prise en charge globale, et permet d'apprécier si l'enfant doit ou non être confié à l'ASE. Il est impératif que chaque département dispose d'une structure de ce type et, pour faciliter sa constitution, les réglementations appliquées par les conseils généraux et les caisses d'allocations familiales doivent être harmonisées. La nécessité de faire de la sécurité des mineurs et de la protection de l'enfance l'affaire de tous devrait conduire à un grand débat national permettant à l'ensemble de la population de compléter les propositions déjà émises sur le sujet. Nous réfléchissons dans des cénacles relativement fermés, alors que nous ne détenons pas la vérité. D'autres idées peuvent émerger, d'autant que des départements et des communes ont aussi mis en place des innovations susceptibles d'être généralisées sur l'ensemble du territoire. Dans mon rapport, pour chaque axe, sont détaillés l'objectif général, le plan d'action, la modalité de mise en œuvre, les acteurs concernés, le délai et le coût. Vous trouverez donc facilement ce qui, parmi ma cinquantaine de propositions, ressort du domaine législatif. M. le Président : Nous avons beaucoup engrangé, ces dernières semaines, à travers des tables rondes et des auditions d'acteurs variés, ce qui nous a donné accès à des avis très divers. À propos de la législation, les avis divergent fortement : certains, rares, préconisent de modifier la loi en profondeur, d'autres proclament qu'il ne faut que la toiletter, les derniers demandent surtout l'application des dispositions en vigueur. Pensez-vous qu'il faille produire une grande loi, ajouter des mesures aux textes existants pour les adapter à l'évolution des réalités sociales ou s'appuyer sur la législation en vigueur ? Vous avez parlé de « forteresses », d'institutions qui communiquent mal et se coordonnent peu, ce qui fait que des situations graves sont souvent décelées tardivement, empêchant tout travail préventif. Les communes, qui ne sont pas les institutions référentes, revendiquent un rôle plus important. Faut-il leur confier de nouvelles missions ? Vous recommandez que le signalement de l'absentéisme scolaire auprès des caisses d'allocations familiales relève des proviseurs et non des inspecteurs d'académie. Quelle est la genèse de cette proposition ? Enfin, vous émettez l'idée de dispositifs spécifiques, notamment pour éviter l'engorgement de l'ASE. Au-delà de ce souci de régulation, quelles solutions envisagez-vous pour essayer de répondre à ce problème ? Mme Martine Aurillac : J'ai été extrêmement intéressée par l'exposé de Mme Hermange, avec laquelle je suis d'accord sur bien des points, notamment sur le choix de l'institution référente. Il faut que le maire intervienne, d'une façon ou d'une autre, en complément du président du conseil général, dans un souci de coordination mais aussi de proximité avec les familles et les enfants. Les staffs de parentalité sont certes difficiles à mettre en place, mais particulièrement efficaces. Naturellement, il est crucial de coordonner les moyens qui sont à notre disposition. Nous avons en main tous les outils ; ce qui manque, c'est de pouvoir les faire jouer ensemble puis d'instaurer une évaluation cohérente. Ces outils sont très nombreux. Estimez-vous certains d'entre eux superflus ? Certaines structures ne font-elles pas double emploi, ne se contredisent-elles pas ? Mme Marie-Thérèse Hermange : Mon témoignage est inspiré par mon expérience d'élue parisienne. C'est au moment où j'ai été chargée de l'assistance publique, en plus de la politique sociale, que j'ai compris pourquoi tant d'enfants arrivaient à l'aide sociale à l'enfance. J'ai en effet pu mesurer l'absence d'échanges entre trois institutions chargées de la politique sociale, à savoir les structures chargées des personnes âgées - pour lesquelles nous avons dû inventer les plates-formes gérontologiques, que Mme Martine Aubry a reprises -, les centres locaux d'information et de coordination, et les structures d'accueil des enfants. Si j'ai pu impulser une politique de coordination et de complémentarité, c'est parce que je disposais d'une délégation du maire, tout en étant conseillère générale. J'avais la volonté politique de faire tomber ces forteresses, mais j'ai dû me donner du mal : il m'a fallu organiser pas moins de 200 réunions pour impulser les staffs de parentalité dans chaque maternité, car personne n'en voulait. Je ne pense pas qu'il faille modifier le dispositif national pour faire du président du conseil général le responsable de la prévention et du maire le référent. Le maire doit se mettre à la disposition du conseil général dans un rôle de complémentarité, et le référent doit être le chef du staff de parentalité, là où se trouvent les enfants, à l'intérieur de la crèche ou du collège, tout en étant environné par d'autres intervenants. Pourquoi déplacer cette responsabilité vers le maire, dont le rôle n'est pas forcément d'examiner des situations individuelles ? Le maire de Paris, de Marseille, de Dijon ou d'Angers n'aura jamais la faculté d'aller au plus proche de ce qui se vit dans l'intimité. La coordination, la reliance, le dialogue doivent intervenir là où vit l'enfant. Et la transmission peut s'opérer dans deux espaces : l'école et la famille. Avant que l'inspecteur d'académie ne prenne connaissance de la situation préoccupante de l'enfant, il peut se passer des mois au cours desquels des drames se fomentent. Certains enfants arrivent à l'ASE au bout de huit ans, après avoir rencontré près de vingt intervenants, chacun connaissant leurs drames familiaux. De même, il est inadmissible que des enfants restent en placement provisoire pendant quatre ans. Confier le signalement de l'absentéisme social au directeur d'école ou au principal de collège donnera au dispositif plus de proximité, de rapidité d'intervention, et améliorera la connaissance de ce qui se passe à l'intérieur du foyer familial et du foyer scolaire. Je ne crois pas qu'il faille créer des structures supplémentaires. En tout cas, les outils existants ne sont pas suffisamment utilisés. Il faut avant tout commencer le suivi dès la naissance : une structure de PMI doit donc être installée dans chaque maternité. C'est ce que nous avions fait à Paris : nous avons permis chaque année à 1 700 femmes de recouvrer des droits sociaux qu'elles ignoraient, en améliorant leur suivi médical. Toutes les institutions ne jouent donc pas pleinement leur rôle, parce qu'elles ne sont pas exploitées au mieux, et parfois parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Sur l'opportunité de modifier la loi, je suis très dubitative. La difficulté de notre politique vient du double système judiciaire et administratif, avec des forteresses conséquentes au sein même de chaque circonscription administrative. Une mise à plat, tous ministères confondus, est nécessaire et, sur cette base, nous pourrons peut-être, comme au Canada, élaborer une grande loi d'orientation établissant des normes sur la protection de l'enfance et le signalement. Si l'ensemble des ministères parviennent à établir des liens, les professionnels de terrain suivront. M. Bernard Debré : Je suis frappé par la multiplicité et le chevauchement des structures, et je serais moi-même assez favorable à une grande loi d'orientation, ce qui permettrait d'y voir plus clair. Mme Marie-Thérèse Hermange : Cette idée m'est venue après avoir lu la loi d'orientation élaborée au Québec. Il serait intéressant que vous la consultiez pour comprendre son esprit : c'est une charte qui décrit moins des mécanismes que des grands principes. Peut-être une telle démarche ouvrirait-elle un nouveau départ pour la protection sociale, domaine dans lequel les professionnels sont quelque peu déboussolés ? C'est l'affaire de tous. Mme la Rapporteure : Qui accomplirait le suivi de l'accouchement à domicile ? La PMI ? Les maternités ? Et comment les accouchées seraient-elles sélectionnées ? Mme Marie-Thérèse Hermange : Dès lors qu'une structure de PMI existe dans chaque maternité et que l'équipe médicale et sociale suggère un suivi, celui-ci peut être assorti d'aide psychologique ou encore matérielle. En Hollande, toute femme, pendant un mois après son accouchement, bénéficie d'un suivi à domicile. À Paris, nous avions dû nous contenter de douze jours qui est la durée maximale de suivi prévue par le code de la santé publique pour les femmes ayant subi une césarienne. Dans deux maternités parisiennes, nous avions créé une maison des bébés et des parents, sur le modèle des maisons vertes de Françoise Dolto. Il s'agit d'un lieu ouvert, intermédiaire entre l'espace public et l'espace privé, où toute femme pouvait se rendre une demi-journée par semaine, de façon anonyme et gratuite, avant, pendant ou après la grossesse, pour recevoir un conseil. J'ajoute que de telles structures ne coûtent pas cher, car elles peuvent occuper des locaux sous-utilisés. Elles requièrent simplement de la volonté. Ce qui est très difficile, dans la politique de protection de l'enfance, c'est de manifester à la fois une autorité suffisante et une certaine souplesse dans le suivi, en faisant la part de l'espace public et de l'espace privé. M. Bernard Debré : Il faut toujours se méfier des généralisations : toutes les femmes n'ont pas besoin d'un suivi à domicile ; chacune d'entre elles doit en avoir la possibilité, c'est différent. Mme Marie-Thérèse Hermange : Vous avez raison. Le département du Loiret offre un espace de débat préalable aux décisions relevant de la protection de l'enfance, et a modifié la culture du signalement en faisant en sorte que celui-ci soit perçu par les familles comme un soutien plutôt que comme une menace. Quiconque place son enfant risque en effet d'être catalogué toute sa vie comme mauvais parent. J'ai voulu témoigner devant vous d'une expérience d'adjointe au maire et conseillère générale de Paris. Le principal enseignement que je tire de cette expérience est qu'il est important que le législateur essaie de relier les politiques nationales et les actions menées localement. M. le Président : Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir fait part de vos observations, dont nous nous efforcerons de faire le meilleur usage. Audition de Mme Michèle Créoff, directrice de l'enfance et de la famille Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : J'ai le plaisir d'accueillir Mme Michèle Créoff, directrice de l'enfance et de la famille du département du Val-de-Marne. Inspectrice de l'aide sociale à l'enfance en Seine-Saint-Denis pendant huit ans, vous avez ensuite été chargée du dossier de l'enfance maltraitée à la direction générale de l'action sociale et vous travaillez depuis décembre 2001 au conseil général du Val-de-Marne. Vous avez par ailleurs écrit plusieurs ouvrages relatifs à la protection de l'enfance. Votre expérience nous intéresse tout particulièrement et je souhaiterais que vous nous fassiez part de vos réflexions sur la détection des enfants en danger et les modalités de leur prise en charge, ainsi que sur l'organisation de notre dispositif de protection de l'enfance. Mme Michèle Créoff : Je suis très honorée de votre invitation. Après avoir analysé le dispositif actuel, je tracerai quelques pistes de propositions qui rejoindront sans doute des propositions qui vous ont déjà été soumises. Notre dispositif est complexe. Depuis la première décentralisation, la compétence est partagée entre les conseils généraux et les autorités judiciaires spécialisées. De surcroît, chaque conseil général, sur son territoire, organise son action comme il l'entend, et celle-ci se superpose avec d'autres prises en charges - en matière psychiatrique, hospitalière, pédiatrique, de handicap et évidemment dans le champ pénal. Cette complexité est particulièrement préjudiciable, car elle dessert la lisibilité et la sûreté du dispositif, et notamment la traçabilité du signalement. En définitive, chacun s'organise comme il le souhaite alors que la commande publique appelle au contraire un dispositif lisible et sûr. Ce paradoxe se traduit par l'absence de certains maillons et un manque de moyens, par des incompréhensions et parfois par des drames. Cette complexité a été aggravée par les lacunes des dispositifs d'évaluation. Les situations étant de plus en plus complexes, les outils d'évaluation des professionnels demandent de plus en plus de spécialisation et de coordination. Or, depuis quinze ans, les outils de référence sont en panne : il n'y a pas de concepts partagés et par conséquent pas de coordination. C'est un travers très français : chaque équipe réfléchit dans son coin et tire une généralité des cas qu'elle traite, sans jamais les mettre en cohérence avec les analyses des autres intervenants. La protection de l'enfance est aussi l'un des rares champs de connaissance dépourvus de reconnaissance universitaire. On demande donc à nos professionnels d'évaluer ensemble les situations, alors qu'ils ne disposent pas de glossaire commun, ce qui peut conduire à de l'incompréhension, des rivalités institutionnelles et des incohérences. Les usagers, déjà en grande difficulté, sont dans l'incapacité de comprendre l'attente que nous avons vis-à-vis d'eux, puisque nous ne pouvons pas l'objectiver et l'expliciter clairement. Pour ne rien arranger, la commande publique n'est pas claire non plus. On déclare publiquement - et on écrit dans le code civil - que l'objectif de la protection de l'enfance est le maintien ou le retour en famille : les magistrats doivent donc s'efforcer de recueillir l'avis des familles et de grandes campagnes publiques sont régulièrement organisées sur les droits des parents, au risque de stigmatiser le dispositif de protection de l'enfance, dénoncé comme illégitime et « rapteur » d'enfants. En réalité, nous élevons des enfants - 20 à 30 % de ceux qui nous sont confiés - et personne ne parle de cette deuxième partie de la commande publique, qui reste par conséquent désorganisée, comme si elle était un peu honteuse, secondaire, à la marge. Elle est donc privée de moyens et risque d'être exercée au détriment de la stabilité affective des enfants. Cela provoque des remous importants sur le terrain, le malaise des professionnels les empêchant de laisser libre cours à leur créativité et de se doter d'outils d'évaluation objectifs. Pour chaque enfant confié à l'aide sociale à l'enfance, il faudrait pourtant clairement demander s'il faut privilégier un retour en famille ou au contraire prévoir l'organisation d'une co-éducation, d'une suppléance parentale. Or personne n'ose poser la question et les choix se font par défaut. Enfin, les politiques territoriales étant très diversifiées, l'État a limité son pilotage. Cela peut se comprendre au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales, mais la protection de l'enfance requiert de la sécurité. Le dispositif de protection de l'enfance est le seul, avec celui de l'enfance inadaptée, à ne suivre aucune norme d'encadrement, aucune norme de composition d'équipe, aucun référentiel national, alors qu'il s'agit de la population la plus vulnérable. Un département peut parfaitement monter un foyer de l'enfance sans aucun éducateur. Quelles mesures seraient susceptibles de pallier cette complexité ? Pour l'instant, le problème a toujours été abordé par petits bouts, sur des thèmes très techniques, sans vision d'ensemble, alors qu'il est important que les propositions s'élaborent dans le cadre d'un large débat public. Il faudrait s'attacher à organiser le circuit du signalement, de façon à ce qu'il soit compréhensible et utilisé par tous. Il convient de préciser la commande publique en affirmant que notre mission première est la protection de l'enfant, la défense de son intérêt. Il n'est pas question de définir l'intérêt de l'enfant en opposition aux droits de parents : l'enjeu, pour la représentation nationale, est de trouver un équilibre démocratique entre deux droits fondamentaux, celui des enfants à être protégés et celui des parents à exercer leur autorité parentale. Il importe ensuite de produire des normes nationales, autour d'engagements précis. Cela appelle, de la part de la puissance publique nationale et territoriale, un contrôle et par conséquent une animation du dispositif, à partir de référentiels partagés et construits dans le cadre d'un consensus entre les professionnels et les pouvoirs publics. M. le Président : Merci pour la richesse de votre propos. Nous avons effectivement pris conscience de cette complexité à travers les auditions et les tables rondes auxquelles nous avons procédé. Je retiens votre souci de retrouver de la cohésion à l'échelle nationale et votre vœu de voir l'État s'investir davantage dans la définition de normes, y compris pour garantir l'égalité territoriale, enjeu républicain de première importance. Vous avez aussi parlé d'évaluation ; de fait, les dispositifs, pour être sûrs, doivent être validés. M. Pierre-Louis Fagniez : Vous déplorez l'absence de normes et vous faites appel à l'État. Mais demandez-vous au législateur qu'il intervienne, comme pour l'école, en définissant des normes, des programmes, une évaluation, une reconnaissance universitaire, chaque conseil général - celui du Val-de-Marne est très en pointe à cet égard - étant ensuite libre d'agir de son mieux ? Mme Michèle Créoff : Si on laissait les conseils généraux libres d'agir de leur mieux, un manque d'investissement pourrait très rapidement déboucher sur des drames. C'est pourquoi j'en appelle à l'édiction de normes nationales. Quand la protection de l'enfance a été décentralisée, en 1983, les enjeux ont été clairement affichés : il s'agissait de ne pas la couper de la protection maternelle et infantile ni des services sociaux, dans un souci de cohérence dans la prévention et de prise en charge globale de la famille. Mais il s'agit d'une compétence très spécialisée, qui requiert de surcroît un effort financier énorme au regard du nombre limité d'usagers concernés dans chaque département Il ne faut donc pas se contenter de demander aux collectivités territoriales de faire de leur mieux, mais fixer au niveau national le minimum pour que la sécurité des enfants soit garantie, chaque collectivité territoriale pouvant ensuite mettre son supplément d'âme. M. le Président : Si le dispositif est visible, c'est surtout eu égard à ses lacunes... Mme Henriette Martinez : Pensez-vous qu'une grande loi de protection de l'enfance soit nécessaire en France ? Si oui, celle-ci devrait-elle définir des règles, des outils d'évaluation, des moyens éducatifs et prévoir les modalités de coordination entre services ? Ne faudrait-il pas que cette loi s'adresse également à la justice en imposant une évaluation de l'enfant appuyée sur une expertise scientifique ? Ne convient-il pas d'inverser la logique, prédominante parmi les travailleurs sociaux et les magistrats, consistant à considérer que l'autorité parentale est sacro-sainte et inviolable ? Il arrive qu'un enfant soit retiré à sa famille d'accueil au motif qu'ils se sont trop attachés l'un à l'autre ! Comment modifier les mentalités si ce n'est par le biais de la loi ? Les mêmes règles doivent s'imposer partout en France. Or la protection de l'enfance n'est qu'un volet parmi d'autres de la politique sociale des départements, et les problèmes sont souvent traités en urgence. Les enfants sont parfois moins bien protégés que les animaux - en tout cas, dans les Hautes-Alpes, on prête davantage attention aux loups -. Mme Michèle Créoff : Une loi-cadre précisant et rationalisant la commande publique est impérative pour que nous nous y retrouvions. À la suite d'une campagne d'ATD-Quart Monde, relayée par Libération, qui laissait entendre que les enfants étaient retirés de leur famille parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter de baskets Nike, j'ai reçu des témoignages de travailleurs sociaux totalement désabusés. Ces professionnels n'ont pas coutume de s'exprimer dans la presse par respect du secret professionnel et de l'intimité des familles, mais ils attendent une précision de la commande publique. Quelles sont les limites de la protection des enfants au regard de l'autorité parentale ? Qu'est-ce qui prime en cas de conflit ? Quel est l'intérêt supérieur de l'enfant ? Seule la représentation nationale peut répondre. Cette problématique s'applique d'ailleurs autant au champ médico-social qu'à l'autorité judiciaire. La définition du danger est trop étroite, trop sujette à caution pour demeurer le seul concept de base de l'organisation de notre dispositif. Mais une loi sera efficace et cohérente à condition qu'elle ne se contente pas de poser des cadres : elle doit se soucier de la mise en œuvre, des normes, des référentiels et de l'évaluation, et être régulièrement questionnée en toute transparence. Mme la Rapporteure : Je suis très sensible à l'idée d'imposer des normes nationales, applicables sur tout le territoire : l'État doit donner un sens à la protection de l'enfance. La commande est complexe car la pratique est réputée honteuse : le placement est perçu comme un échec et le retour dans la famille comme l'objectif permanent. Cela dit, comme pour l'accueil de la petite enfance ou les assistants familiaux, produire des normes beaucoup trop strictes conduit à fixer des objectifs inatteignables et restreint la souplesse. Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de fixer par une loi-cadre les grands principes, puis de confier à des conférences de consensus le soin de se pencher sur les bonnes pratiques ? Autour de qui organiser ces conférences ? Autour du ministère ? De la Défenseure des enfants ? Des conseils généraux ? Mme Michèle Créoff : J'ai longtemps pensé comme vous et œuvré, avec d'autres, pour tenter d'organiser des conférences de consensus et d'élaborer des référentiels partagés. Mais, après quinze ans, vous me voyez un peu désabusée, car je constate que les champs professionnels sont de plus en plus spécialisés, éclatés sur le territoire et déconnectés. Je me résous par conséquent à penser que, pour donner un signal fort, il faut fixer des normes précisant des conditions minimales en dessous desquelles la sécurité de l'enfant n'est pas assurée. Dans certains foyers de l'enfance, le seul éducateur en titre est le chef du service éducatif, alors qu'un minimum de qualification devrait tout de même être requis pour s'occuper des enfants les plus vulnérables. L'existence de normes minimales n'empêche pas qu'il faut produire des référentiels et des bonnes pratiques. J'attends beaucoup du nouvel Observatoire national de l'enfance en danger, même si les moyens mis à sa disposition sont nettement insuffisants. Lorsque j'étais chargée du dossier de l'enfance maltraitée au ministère, j'ai voulu lancer une enquête sur le nombre d'enfants maltraités signalés au juge, mais je n'ai jamais pu trouver l'opérateur susceptible de réaliser cette étude. Cette expérience montre la nécessité de créer une structure capable de piloter la recherche sur l'enfance en danger. Il faut se doter de moyens pour connaître les publics, les parcours, et ainsi organiser les politiques publiques. M. le Président : Seriez-vous favorable à une réforme du dispositif institutionnel, et en particulier à une modification du rôle central du conseil général ? La question a été abordée lors d'une table ronde sur le cas de Drancy. Il ne s'agit pas d'introduire une complexité supplémentaire, mais de profiter d'une réforme pour, le cas échéant, redistribuer les cartes institutionnelles pour donner davantage de place aux maires. Par ailleurs, quel regard portez-vous sur le secret professionnel partagé ? Mme Michèle Créoff : Les certificats médicaux que reçoit en principe la PMI du département sont des outils de vigilance précieux. Or le taux de réponse, qui atteint 90 % pour le huitième jour, tombe à 50 % pour le neuvième mois et à 30 % pour le vingt-quatrième. Il ne serait tout de même pas trop compliqué de bâtir un lien entre la caisse d'allocations familiales et la PMI pour que les enfants non suivis soient signalés par la première à la seconde et qu'une visite à domicile soit diligentée. Avec un tel dispositif, les enfants de Drancy auraient été repérés beaucoup plus tôt. Il faut un clapet de sécurité pour sonner l'alarme. Dans certains départements, les signalements sont organisés territorialement ; dans d'autres, au contraire, ils sont centralisés. Dans le Val-de-Marne, le nombre de situations signalées est passé de 900 à 1 800 en l'espace d'un an, simplement parce que nous avons instauré un système départemental centralisé, offrant une écoute au voisin, au médecin traitant, à l'agent de la crèche, à l'animateur de centre de loisir. Il faut centraliser les informations pour garantir la sécurité de l'enfant. Mme la Rapporteure : Des familles évitent le suivi de leurs enfants en déménageant avant l'intervention de la justice. Le seul fil rouge est finalement la déclaration des enfants à la caisse d'allocations familiales ou leur inscription à l'école. Le ministère de l'éducation nationale montrent une certaine réticence à assurer la continuité du signalement, les caisses d'allocations familiales ne sont-elles pas bien placées pour l'exercer efficacement ? Mme Michèle Créoff : La PMI informe la caisse d'allocations familiales de toutes les suspensions d'agrément d'assistante maternelle pour faire cesser les versements d'allocation. En retour, la caisse devrait informer la PMI de l'absence de production des certificats de santé obligatoires. Mais encore faut-il que les caisses soient clairement investies de cette mission. Reste à définir un chef de file pour éviter la dilution de la responsabilité et distinguer entre les cas nécessitant de la prévention, de l'accompagnement, et ceux appelant une intervention de l'autorité judiciaire : cet auteur institutionnel est très clairement le conseil général. Dès que nous évaluons une situation, nous opérons sans le dire dans le secret partagé. Une restriction de son champ d'application est peut-être nécessaire car l'intimité des familles et des individus est en cause : il faut y recourir exclusivement dans l'intérêt de l'enfant. Et seules les informations nécessaires à l'évaluation doivent être partagées. Pour une synthèse sur une famille, vingt partenaires sont parfois réunis autour de la table ! La gestion du secret partagé devient alors très compliquée, alors que, faut-il le rappeler, près de deux enfants décèdent chaque semaine de maltraitance. Je voudrais dire quelques mots sur les missions dérogatoires du droit commun confiées aux professionnels. Sans autorisation des parents, ni le médecin scolaire ni celui de la PMI n'est habilité à regarder si l'enfant porte des traces de coups. Ils le font quand même en catimini. Si l'on veut vraiment confier une mission de protection de l'enfance aux médecins de santé publique, il faut les autoriser à examiner l'enfant sans autorisation parentale. Il n'est pas question de faire la traque aux bleus, mais d'autoriser certains professionnels spécialisés à constater la souffrance de l'enfant. Mme Henriette Martinez : Dans le même ordre d'idée, ne faudrait-il pas faire en sorte que l'enfant en danger puisse être interrogé hors de la présence de ses parents et sans leur autorisation ? Mme Michèle Créoff : Je suis réservée sur les révélations d'un enfant. Nous intervenons peu à la suite de telles révélations : lorsqu'il n'est pas en confiance, l'enfant ne révèle rien et donne à penser que tout va bien car il se sent en danger immédiat. Plutôt que de convoquer l'enfant à la parole, il conviendrait de former les professionnels pour qu'ils sachent décrypter ses signes de souffrance. À l'hôpital de Flandre, à Lille, les professionnels suspectant une situation de souffrance peuvent négocier une hospitalisation en pédiatrie, afin qu'une équipe pluridisciplinaire effectue un diagnostic partagé. Un sas neutre de ce type sécurise la famille : une hospitalisation est moins stigmatisante que l'intervention de l'assistante sociale. Il est au demeurant très rare que les parents refusent cette expertise intermédiaire et, en cas de refus, il faut immédiatement saisir le procureur. Mme Henriette Martinez : Il arrive qu'un enfant parle spontanément à sa maîtresse, par exemple après une leçon sur les droits de l'enfant, qu'une enquête sociale soit ouverte, mais que l'enfant, soumis aux pressions de ses parents, déclare ensuite qu'il a tout inventé et se rétracte. Les violences continuent jusqu'au moment où la maman craque et signale les faits. Mme Michèle Créoff : Je ne suis pas certaine que le problème serait réglé si un autre professionnel s'entretenait avec l'enfant. Mme Henriette Martinez : Le problème, c'est que l'enfant retourne à la maison. Mme Michèle Créoff : Faut-il tenir compte d'emblée de la parole de l'enfant et prendre des mesures de protection immédiates, au risque de se tromper, ou bien se donner le temps de l'évaluation, confronter les approches des uns et des autres, au risque de rejeter l'enfant dans un milieu dangereux ? Le choix est crucial et c'est pourquoi je préconise de dédramatiser l'accueil de l'enfant en l'organisant dans un lieu sécurisé, acceptable pour la famille, l'enfant et les professionnels. Le service de pédiatrie me semble le plus à même de remplir cette fonction. M. Pierre-Louis Fagniez : L'enfant maltraité est malade ; or le lieu adéquat pour accueillir les personnes malades est l'hôpital. De surcroît, on dit toujours, en médecine, que les interrogatoires sont toujours très instructifs, mais que le médecin doit d'abord savoir regarder. Mme Michèle Créoff : Absolument. Le but de la protection de l'enfance est de prendre soin de l'enfant, dans la globalité de l'expression, c'est-à-dire sur les plans physique, psychique et somatique. À cet égard, l'espace de soin constitue un bon intermédiaire. Mme Henriette Martinez : S'il fallait prendre exemple sur un pays, lequel serait-ce ? Mme Michèle Créoff : Nous pourrions nous inspirer de plusieurs expériences. S'agissant de la production d'un référentiel, nos collègues du Québec ont particulièrement bien avancé, mais, dans ce petit pays, les enjeux institutionnels et organisationnels ne sont pas aussi lourds que chez nous. En Angleterre, la protection de l'enfance est confiée aux communes, mais l'État contrôle les placements chaque année. Et puis, du côté de l'Italie, les réseaux de soins entre la psychiatrie, la protection de l'enfance et la prévention familiale sont remarquables. Bref, nous avons l'avantage de réfléchir à une loi-cadre après d'autres pays et de pouvoir par conséquent en tirer des leçons. J'ajoute que notre dispositif judiciaire est pertinent. La question de la protection de l'enfance ne saurait être traitée sans considération pour l'intimité des familles, pour l'autorité parentale, pour les libertés individuelles, et je ne souhaite pas que les collectivités territoriales soient dotées de tous les pouvoirs. Le juge doit garder la main, car c'est lui qui offre les garanties procédurales qui s'imposent. M. le Président : Nous avons effectivement programmé des visites à Londres et à Québec. Je vous remercie de votre contribution. Audition de M. Louis de Broissia, sénateur, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous avons le plaisir d'accueillir M. Louis de Broissia, sénateur, président du Conseil général de la Côte-d'Or. Comme vous le savez, notre Mission réfléchit aux moyens d'améliorer le dispositif français de protection de l'enfance. En votre qualité de président de conseil général, vous avez, monsieur de Broissia, la responsabilité de la protection de l'enfance dans un département et, à la demande de Mme Roig, vous avez présidé un groupe de travail sur les modalités de prise en charge de l'enfance en danger, dont les rapporteures étaient Mme Avenard et Mme Martin-Blanchais. Votre réflexion sur ces questions nous intéresse donc tout particulièrement. M. Louis de Broissia : Mme Roig a constitué deux groupes de travail chargés de missions complémentaires. Celui dont elle a confié la présidence à M. Philippe Nogrix devait étudier les aménagements à apporter aux procédures de signalement des mineurs en danger, et il nous revenait d'analyser les modalités de prise en charge de ces mineurs. J'ai remis notre rapport au directeur de cabinet de M. Douste-Blazy jeudi dernier, ce qui explique pourquoi je ne l'ai pas encore diffusé. Nous devions travailler sur trois sujets : la mise en place d'un adulte référent, la diversification des prises en charge et la diversification du soutien aux familles. Plutôt que de procéder à des auditions en nombre, nous avons préféré nous appuyer sur le corpus de rapports existant pour compiler les mesures préconisées et, parmi celles-ci, choisir celles qui nous paraissaient appropriées. Nous avons formulé, soit à l'unanimité soit à une très large majorité, trente-quatre propositions : quinze de nature juridique, huit portant sur les pratiques professionnelles et neuf ayant trait aux partenariats indispensables, dont les lacunes sont à la base des dysfonctionnements repérés. En ma qualité de praticien, j'insiste sur le fait que, si les départements ne devaient conserver qu'une seule mission, ce devrait être celle de la protection de l'enfance. Le rôle majeur des départements sur ce dossier est unanimement reconnu, ne serait-ce qu'à travers les budgets qui y sont consacrés. Ainsi, la protection de l'enfance constitue le premier budget de la Côte-d'Or, loin devant l'accompagnement du handicap et celui du vieillissement. Le dispositif français n'est sans doute pas le meilleur, mais ce n'est pas non plus le plus médiocre, et les résultats obtenus sont à la hauteur des sommes dépensées et de l'engagement des professionnels. Mme la Rapporteure : À quelles conclusions êtes-vous parvenus à propos de la notion d'adulte référent ? Mme Geneviève Avenard : La ministre avait souhaité que le groupe travaille particulièrement sur les modalités pratiques de la mise en place d'un adulte référent, capable d'assurer une coordination efficace entre les différents acteurs pour améliorer la cohérence des interventions auprès du mineur. Cette coordination doit être assurée au niveau institutionnel entre les services déconcentrés de l'État et ceux des conseils généraux, et au niveau individuel auprès de l'enfant et de sa famille. Étant donné la pluralité et la grande hétérogénéité culturelle et professionnelle des intervenants, c'est une question centrale. Notre groupe, constatant que la notion d'adulte référent figure déjà dans une circulaire de 1981, a cherché à comprendre pourquoi cette disposition n'était pas ou mal appliquée. Il nous est apparu que, si le principe de l'adulte référent est reconnu dans tous les départements, il ne fait pas l'objet d'une définition nationale commune. Il en résulte que la compréhension du rôle de l'adulte référent varie notablement selon les services et que l'évaluation pertinente des dispositifs est très difficile. Au niveau individuel, la pratique est largement répandue d'identifier un adulte référent dès l'arrivée de l'enfant et d'en faire l'interlocuteur privilégié du mineur et de sa famille ; tout le monde s'accorde sur ce point. Mais par la suite, l'adulte référent est utilisé dans des situations différentes, soit qu'il s'agisse d'une gestion directe par l'ASE, soit que la fonction soit confiée à un établissement habilité. On note en outre des chevauchements tant avec le « référent éducatif » au sein de l'ASE qu'avec les équipes éducatives des établissements ; cet entrecroisement nuit à la lisibilité du dispositif et à la continuité de l'action. Par ailleurs, le contenu même des interventions des adultes référents varie considérablement selon les départements, et le taux de rotation de ces professionnels est très important, ce qui vaut d'ailleurs pour tous les personnels chargés de la protection de l'enfance, travailleurs sociaux ou juges des enfants. Tout cela nuit également à la continuité de l'action. S'ajoute le fait que les services départementaux sont à la fois les autorités de tutelle, de contrôle, de tarification et de gestion directe, et aussi les gardiens de l'enfant. Le manque de lisibilité de l'ensemble du dispositif est certain. Le groupe de travail considère que l'adulte référent, « fil rouge » de l'action menée, doit être défini dans le cadre d'un projet global pour l'enfant et la famille, élaboré par une équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle en tenant compte du lien construit avec la famille. Au niveau institutionnel, il s'agit de désigner un « référent de continuité », garant de la cohérence du parcours de protection et des mesures éducatives prises, tant pour l'enfant que pour la famille, afin d'éviter que les ruptures éventuelles ne pénalisent l'enfant et le projet éducatif. M. Louis de Broissia : Plusieurs médecins et pédiatres membres du groupe de travail ont signalé que l'absence d'adulte référent « fil rouge » avait aussi pour conséquence des lacunes dans le suivi sanitaire et scolaire des enfants. Par ailleurs, chaque département compte quelques dizaines d'enfants en danger particulier, qui relèvent soit du secteur socio-éducatif soit du secteur psychiatrique. Or, on se « repasse » ces enfants qui sont suivis par les services psychiatriques en semaine et confiés aux services socio-éducatifs le dimanche. Il y a là une source de grand trouble qui concerne quelque 7 000 cas sur l'ensemble du territoire. Mme Geneviève Avenard : Le groupe de travail a mis l'accent sur la particularité des décisions judiciaires d'aide éducative en milieu ouvert (AEMO), dispositif dans lequel le conseil général n'a pas sa place alors qu'il le finance. Il y a là une discontinuité de fait, d'autant qu'il n'y a aucune articulation entre les services d'AEMO d'une part, la PMI et les autres services sociaux départementaux d'autre part. Mme Marie-Paule Martin-Blachais : La mesure d'AEMO, décidée par le juge des enfants dans le cadre d'une mission d'assistance éducative, peut éviter le placement, mais peut parfois y conduire. Or, l'ASE auquel le placement sera demandé n'a pas connaissance du travail qui aura été mené dans ce cadre. Il serait donc souhaitable de poser dans la loi le principe de la coordination. M. Louis de Broissia : Il faudrait pour cela compléter l'article L. 221-4 du code de l'action sociale et des familles en disposant que, lorsqu'une mesure d'AEMO a été prise par le magistrat, un rapport circonstancié doit être fait au conseil général sur l'action menée. C'est l'objet de deux de nos propositions. M. Patrick Delnatte : Je comprends qu'une coordination soit souhaitable, mais le référent doit-il être le même lorsque l'enfant est maintenu dans sa famille et lorsqu'il est placé, alors que les pratiques sont différentes ? Mme Marie-Paule Martin-Blachais : Nous avons constaté qu'il existe plusieurs niveaux d'adultes référents. Pour notre part, nous considérons que l'adulte référent doit avoir un peu de recul, qu'il doit être le garant du projet arrêté et mis en œuvre par les intervenants de proximité chargés au quotidien de l'exécution de la décision d'assistance éducative. Il doit être l'« articulateur ». M. Patrick Delnatte : Mais un enfant placé a bien un référent en dehors de l'établissement. Mme Marie-Paule Martin-Blachais : Quatre-vingt pour cent des décisions de justice confient l'enfant à l'ASE qui devient le service « gardien », notion qui doit d'ailleurs être clarifiée. Dans 20 % des cas, le juge opte pour un placement direct. Il s'établit alors un lien direct entre le magistrat et un tiers, mais la responsabilité du président du conseil général demeure. Mme Patricia Adam : Qu'en est-il du lien avec la famille ? D'autre part, avez-vous eu connaissance d'une étude sur les parcours des enfants, dont je sais l'existence mais que je cherche en vain ? Mme Geneviève Avenard : Le terme d'adulte référent est utilisé indifféremment pour désigner le suivi de l'enfant, celui de la famille d'origine et celui de la famille d'accueil. C'est une situation paradoxale, car on comprend bien qu'il ne peut être l'interlocuteur privilégié de tous. Il faut donc clarifier les niveaux d'intervention afin de mieux coordonner l'action entre des intervenants qui doivent tous exercer une mission précise. Je sais que le département de Paris a réalisé une étude, d'ampleur limitée, sur les parcours des enfants. L'Observatoire national de l'action sociale décentralisée en a lancé une autre, pour laquelle certains départements recueillent les données dans la durée. Mme Marie-Paule Martin-Blachais : Il s'agissait de conduire une étude prospective fondée sur des constats rétrospectifs. On cherchait à établir si, à partir des dossiers, on pouvait reconstituer le parcours d'un enfant et retracer les interventions. Il apparaît que cette reconstitution n'est pas possible, car on ne retrouve ni la trajectoire complète des enfants, ni celle des aides dont les familles ont bénéficié. Mme Geneviève Avenard : Le ministère des affaires sociales a diffusé dans certains départements un « album de vie » qui doit permettre à chaque enfant de conserver par devers lui les documents correspondant aux moments forts qu'il a vécus. Le département de la Côte-d'Or a repris cette initiative qui est de nature à améliorer la continuité du suivi. M. le Président : S'agissant de l'articulation entre mesures administratives et mesures judiciaires, peut-on mieux déterminer la ligne de partage entre les compétences du juge et celles de l'ASE ? Etes-vous d'avis qu'il faudrait pour cela modifier la loi ? M. Louis de Broissia : Plusieurs modifications législatives mériteraient d'être décidées. La tendance à une forte judiciarisation des mesures de protection de l'enfance, dont je crois savoir que votre Mission s'est émue, est évidente. Nous proposons donc de modifier l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles pour définir de manière précise les missions de l'ASE, en faisant référence à la protection de la santé, de la sécurité, de la moralité et de l'éducation de l'enfant. Nous souhaitons en outre que l'ASE soit investie d'une mission de saisine de l'autorité judiciaire en cas de mise en danger d'un enfant, et que soit clairement posé le caractère subsidiaire de l'intervention du juge : celui-ci n'interviendrait que pour les cas où il y a impossibilité, pour le conseil général, d'évaluer la situation ou refus de la famille de coopérer. M. Pierre-Louis Fagniez : Je me félicite que vous ayez procédé à une analyse approfondie du dispositif de protection de l'enfance. Je ne doute pas que, ce faisant, vous ayez mis en évidence des éléments négatifs qu'il conviendrait d'éliminer. Quels sont-ils ? Avez-vous formulé des propositions en ce sens ? M. Louis de Broissia : Le constat des carences et des dysfonctionnements du dispositif a été établi, et on trouve dans notre rapport de nombreuses critiques des pratiques en vigueur. C'est pourquoi j'appelle de mes vœux une réforme législative, mais également une réforme des pratiques professionnelles. J'observe aussi que l'on ne peut créer de référents si l'on n'a pas mis au point une formation conjointe. Mme la Rapporteure : Nous comptons sur vous pour faire prospérer la proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits de l'enfant, adoptée par notre Assemblée mais que le Sénat ne semble pas avoir le temps d'examiner. M. Louis de Broissia : Je m'y évertuerai. Les critiques de Mme Claire Brisset relatives à l'inégalité des efforts consentis par les départements en matière de protection de l'enfance ont agacé. Sur ce point, une délégation parlementaire serait légitime pour procéder aux comparaisons nécessaires ; ce serait son rôle davantage que celui des services de la Défenseure des enfants. M. le Président : Mme Claire Brisset a pointé le risque d'inégalités dans la protection de l'enfance. À cet égard, quel regard portez-vous sur les premiers effets de la loi du 13 août 2004 qui a donné un plus grand rôle aux conseils généraux ? M. Louis de Broissia : Plusieurs départements se sont portés candidats aux expérimentations prévues par cette loi. Celles-ci n'ont cependant pas commencé. Il serait pourtant utile d'accélérer leur mise en place pour créer les référents de continuité qui font aujourd'hui défaut. Ainsi éviterait-on les lacunes du suivi sanitaire et scolaire des enfants déjà signalés. Mme Geneviève Avenard : L'idée que le département est le chef de file de l'action sociale n'a reçu qu'un faible commencement d'exécution. En 1982 et 1983, les départements se sont vu confier la responsabilité de la protection de l'enfance, sans qu'il y ait eu un débat sur la manière de rendre complémentaires l'intervention du juge et celle de l'ASE. Ce débat n'a toujours pas eu lieu. En Côte-d'Or, sous l'impulsion de notre président, la concertation est engagée, mais encore faut-il passer à la pratique. M. Louis de Broissia : Il faudra, dans ce domaine, un signal législatif clair. On ne peut pas laisser perdurer les retards constatés dans la nomination des juges pour enfants, la rotation importante de ces magistrats, leur manque de spécialisation et de coordination avec les tribunaux de grande instance. Que dire de ces postes de greffier qui restent non pourvus et de ces présidents de tribunal qui, après mûre réflexion, refusent, invoquant l'indépendance de la justice, l'aide technique que le département leur propose pour combler ces vacances de postes ? Pendant ce temps, rien ne se fait ! Nous souhaitons donc procéder à une expérimentation sur les modalités de prise en charge des enfants, car nous avons fait un appel à actions innovantes qui ont suscité de nombreuses réponses : accueil de jour, accueil séquentiel, accueil de fin de semaine... La loi du 13 août 2004 nous permettrait de mener ces initiatives à leur terme. Mme Marie-Paule Martin-Blachais : Les membres du groupe de travail ont recensé 48 fiches-actions de dispositifs innovants dans 27 départements, dont les trois quarts émanaient d'associations et un quart des services départementaux. Au nombre de ces initiatives figurent les interventions éducatives précoces auprès des parents en amont de l'aide éducative à domicile, pour permettre aux familles de solliciter spontanément un soutien. Il serait également utile de développer le soutien à la parentalité par le biais des parrainages assurés par des bénévoles et celle des AEMO « renforcées », mesures intensives dans un temps ramassé. Rien ne s'oppose par ailleurs à l'accueil de jour par la prise en charge du temps périscolaire, pendant que s'opérerait en parallèle un travail avec les parents. Rien ne s'oppose non plus aux accueils séquentiels assortis d'interventions renforcées auprès de la famille, ni aux dispositifs progressifs. Ainsi, des expérimentations sont déjà en cours, mais la question du financement - et donc de la pérennisation - de ces projets n'est pas résolue. Pourtant, ceux qui ont fait leurs preuves devraient pouvoir se poursuivre, et tous témoignent de la richesse et de la complexité des réponses à apporter à des situations très diverses. M. Louis de Broissia : J'ajoute que ces expériences découlent de longues observations. Le docteur Maurice Berger a parlé, on le sait, de l'idéologie du lien familial. Il est vrai qu'après avoir privilégié le placement, on a donné la priorité au maintien dans la famille. Mais on observe à présent une tendance à l'application de formules très diverses, et la loi du 13 août 2004 permettra aux départements, s'ils y sont encouragés, de se doter d'un dispositif plus souple. Chacun conviendra que la Seine-Saint-Denis puisse vouloir se doter d'un dispositif adapté à sa situation propre qui n'est pas identique à celle de la Corse. Seuls les cas lourds que j'ai évoqués précédemment mériteraient un système d'accueil spécifique qui, à ce jour, n'existe pas. M. le Président : Je vous remercie vivement de nous avoir fait part de vos propositions dynamiques et intéressantes. Nous lirons votre rapport avec une grande attention. Audition de Mme Hélène Franco, vice-présidente Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous poursuivons nos auditions en accueillant Mme Hélène Franco, vice-présidente du Syndicat de la magistrature, accompagnée de M. Côme Jacqmin, secrétaire général. Comme vous le savez, notre Mission d'information réfléchit depuis plusieurs semaines aux moyens d'améliorer notre dispositif de protection de l'enfance. Au cours de nos auditions, nous avons été interpellés sur le respect par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant, sur le rôle joué par le juge des enfants dans le dispositif de protection de l'enfance et sur la place réservée aux mineurs confrontés à la justice. Sur ces trois points, nous souhaiterions connaître la position du Syndicat de la magistrature. M. Côme Jacqmin : Je veux rappeler tout d'abord notre attachement au caractère global du dispositif de prise en charge des enfants, compétent à la fois pour les mineurs en danger et les mineurs délinquants, dans un équilibre institutionnel qui fait intervenir plusieurs partenaires et dont aucune modification n'est jamais neutre du point de vue des intérêts de l'enfant. À ce titre, nous avons regretté la façon dont a été posé le débat à l'occasion de l'examen de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, dont l'article 59 aborde la justice des mineurs exclusivement sous l'angle institutionnel des relations entre l'État et les collectivités territoriales, sans qu'on se soit vraiment intéressé à la façon dont on allait mieux protéger les enfants. S'agissant des équilibres existants, j'aborderai d'abord la problématique de l'intérêt de l'enfant dans le cadre de la séparation des parents. La réforme du 4 mars 2002 est parvenue à un équilibre relativement satisfaisant pour ce qui concerne l'exercice en commun de l'autorité parentale, notamment en consacrant la possibilité d'instaurer une résidence alternée, afin de maintenir une relation entre l'enfant et ses deux parents. II serait cependant utile d'évaluer précisément les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la possibilité pour les mineurs d'être auditionnés dans le cadre des procédures relatives à l'exercice de l'autorité parentale. En effet, les pratiques judiciaires paraissent en ce domaine assez hétérogènes, sans qu'il soit aisé de faire la part entre les difficultés matérielles et les réticences de principe. J'appelle par ailleurs votre attention sur l'importance des points-rencontre pour maintenir les liens entre parents et enfants, conformément à l'article 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ces points-rencontre se heurtent à de graves difficultés, faute d'un financement pérenne, mais aussi d'un cadre juridique précis et d'une définition claire des objectifs assignés à un dispositif qui est perçu à la fois comme une mesure d'instruction, destinée à renseigner le juge pour lui permettre de prendre une décision, et un soutien à la relation parentale. S'agissant de la justice des mineurs, nous pensons qu'il faut préserver l'équilibre français, car l'intervention d'un juge dans le cadre de ces procédures a un aspect protecteur des droits des enfants, mais aussi des parents, conformément aux dispositions tant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que des articles 5, 9 et 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant. La loi institue moins un équilibre entre les droits de l'enfant et ceux de ses parents titulaires de l'autorité parentale, qu'elle ne prend en compte l'importance des liens des enfants avec leur entourage familial. Considérer que le juge doit arbitrer entre le droit des enfants et celui des parents serait une erreur. Ce n'est pas parce que l'article 375 du code civil insiste sur la notion de danger, que le juge des enfants ne prend pas en compte l'intérêt de l'enfant, comme l'y oblige d'ailleurs la récente réforme de l'article 375-1 par la loi du 2 janvier 2004. S'il prend en compte la situation et les droits des parents, c'est comme composante de l'intérêt de l'enfant. Nous restons attachés à l'intervention du juge des enfants parce qu'il nous semble que le processus judiciaire présente des garanties que l'intervention administrative n'offre pas. Nous croyons à la vertu de la procédure judiciaire qui offre un débat contradictoire, une décision motivée et des voies de recours. Sur ce point, nous avons accueilli très favorablement le décret du 15 mars 2002 qui a formalisé un certain nombre de droits des familles et des enfants. Si notre système privilégie le maintien des liens de l'enfant avec sa famille naturelle, cela ne signifie pas qu'il faille s'interdire d'aller vers une rupture de ces liens ou vers l'intervention d'un tiers qui se substitue aux détenteurs de l'autorité parentale. Les solutions juridiques existantes - déclaration judiciaire d'abandon dans la perspective d'une adoption, retrait d'autorité parentale, délégation totale ou partielle d'autorité parentale - permettent de répondre à cette nécessité. Il ne faudrait d'ailleurs pas tirer des conclusions hâtives du fait que ces procédures sont relativement peu utilisées. Nous sommes toutefois ouverts à certaines simplifications. Ainsi, dans le cadre de mesures d'assistance éducative dont le juge des enfants est saisi, on pourrait très ponctuellement lui permettre de prononcer des délégations partielles d'autorité parentale, pour vaincre, dans l'intérêt de l'enfant, certaines réticences des détenteurs de cette autorité, lorsqu'elles subsistent en dépit du dialogue avec la famille. Il serait peut-être également utile de compléter la palette des interventions du juge des enfants dans le registre du soutien à l'autorité parentale. Outre le renforcement des dispositifs de prévention et de soutien parental, on pourrait notamment développer les lieux d'accueil mère-enfants, qui permettent d'éviter le placement, ou envisager que le juge des enfants puisse ordonner lui-même l'intervention de travailleurs en intervention familiale et sociale, en complément de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert. C'est ce que nous pratiquons déjà, mais en accord avec les conseils généraux et sans en avoir véritablement le pouvoir, afin d'offrir aux familles un soutien qui permette d'éviter le recours au placement ou la dégradation de la situation. Au-delà de ces mesures ponctuelles, nous ne pensons pas que l'équilibre existant doive être modifié. Pour autant, nous nourrissons quelque inquiétude quant à la fragilisation du dispositif actuel. De nombreux partenaires déplorent un problème d'acculturation chez les juges des enfants, qui leur paraissent moins spécialisés et moins en prise avec les problématiques de l'enfance. Il est certain que la réforme des carrières de juin 2001 a entraîné une forte mobilité, et amené dans des fonctions de juge pour enfants, en particulier de vice-président, des magistrats peut-être moins préparés. Il reste toutefois difficile de mesurer si cette évolution a des causes conjoncturelles, ou s'il s'agit d'un phénomène structurel. Dans ce contexte, nous avons été surpris par les propositions du rapport Cabannes sur la déontologie dans la magistrature : limiter à sept ans la présence dans des fonctions spécialisées, notamment pour les juges des enfants, accentuerait les faiblesses actuelles. Si nous voyons dans la polyvalence des magistrats une source de richesse, nous pensons toutefois qu'une attention toute particulière devrait être apportée à la formation des juges des enfants, en particulier à l'occasion des changements de fonction. Une formation d'une semaine et un stage très hypothétique de deux semaines dans le cabinet d'un collègue ne suffisent probablement pas à préparer à l'exercice de ces fonctions, d'autant que ces formations sont essentiellement tournées vers la procédure, plutôt que vers les problèmes auxquels le juge des enfants est confronté. II est par ailleurs nécessaire de donner aux tribunaux pour enfants les capacités de participer aux différents partenariats, en particulier avec les conseils généraux. Cette nécessité ne nous paraît pas suffisamment prise en compte dans l'évaluation des charges de travail. Nous savons que vous avez reçu l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, qui propose de donner un rôle prépondérant à un vice-président qui présiderait le tribunal pour enfants. Le Syndicat de la magistrature a une vision plus large et s'intéresse à l'ensemble des fonctions spécialisées. De ce point de vue, il serait erroné de croire que tout le travail de partenariat puisse être mené par un seul magistrat du tribunal pour enfants. On ne réglerait pas le problème en instituant un hiérarque au sein de ce tribunal. Tout au plus pourrait-il y avoir un porte-parole, mais il convient vraiment que l'ensemble des magistrats soit impliqué dans ce partenariat. Nous nous préoccupons par ailleurs du poids croissant pris par les dossiers pénaux dans l'activité des juges des enfants, en particulier dans le cadre des procédures rapides qui se multiplient dans des juridictions importantes, comme Marseille et Bobigny. Le grand nombre des présentations réduit fortement la disponibilité des magistrats. Les orientations données à la politique pénale en vue d'une réponse systématique à tous les actes empêchent également les juges des enfants de s'impliquer dans de véritables suivis éducatifs en matière pénale. En tant que juge des enfants, j'ai parfois l'impression de passer plus de temps à des mises en examen qu'au suivi. C'est un sujet qui mérite réflexion, en particulier du point de vue de l'intérêt des enfants, qui doit animer notre action en matière pénale comme en matière civile. Le juge des enfants a souvent le sentiment d'être un juge isolé : même si les partenaires sont nombreux, c'est lui qui prend la décision et qui peut alors se sentir bien seul. De ce point de vue, la justice des mineurs souffre d'une présence tout à fait insuffisante du parquet, qui se préoccupe essentiellement de son activité pénale et qui, surtout, manque de moyens, notamment pour s'engager dans l'assistance éducative. Les parquets sont maintenant largement mobilisés au stade du signalement, mais il est vraiment dommage qu'ils n'interviennent plus ensuite, dans le suivi de l'assistance éducative. Peut-être pourrait-on proposer que, pour certains dossiers très lourds d'assistance éducative, le juge puisse renvoyer une affaire à une formation collégiale. Nous sommes également inquiets de la situation de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). La qualité du travail du juge des enfants dépend évidemment des outils d'évaluation dont il dispose. La chancellerie a fait part de son souhait de spécialiser la PJJ dans le traitement des dossiers pénaux et la prise en charge des mesures d'orientation. Le directeur de la PJJ reconnaît lui-même que ses services sont mal équipés pour prendre en charge ces mesures d'IOE (Investigation et orientation éducative). Nous pensons également que la spécialisation de la PJJ sur le pénal risque d'appauvrir ses savoir-faire en cette matière. Nous sommes aussi inquiets du fonctionnement de la décentralisation. Nous rejoignons largement les observations faites par Mme Claire Brisset sur l'insuffisance des outils de pilotage et de l'évaluation par l'État de la situation dans les différents départements, qui se traduit par une hétérogénéité de l'offre. Nous regrettons aussi que soit supprimé, par le dispositif d'expérimentation prévu par la loi du 13 août 2004, le caractère conjoint Vous l'aurez compris, à nos yeux le dispositif actuel ne nécessite pas tant un bouleversement juridique que la mise en place d'outils d'évaluation des pratiques et des dispositifs existants. M. le Président : Je vous remercie pour cet intéressant exposé. Les règles d'audition des enfants prévues par le code civil vous paraissent-elles conformes à la Convention internationale des droits de l'enfant ? Faut-il donner à l'enfant la possibilité de demander à être entendu et même faire en sorte qu'un juge ne puisse refuser sa demande de parole ? Mme Hélène Franco : Il s'agit d'un droit majeur au regard de la Convention internationale. Peut-être faudrait-il unifier les pratiques des juges des enfants et des juges aux affaires familiales. Pour ma part, en tant que juge des enfants à Bobigny, il est très rare que je n'entende pas un enfant, surtout quand il le demande. En règle générale, les juges des enfants entendent ceux qui sont en capacité de s'exprimer. Et je ne parle ici que des procédures civiles puisqu'au pénal la question ne se pose même pas. Les juges aux affaires familiales sont beaucoup plus réticents : ils tiennent compte de critères d'âge et ils ont même la possibilité de refuser l'audition d'un enfant qui le demande. Sans doute conviendrait-il d'inverser cette logique en posant pour principe le droit à être entendu tout en tenant compte d'un critère qui serait moins celui de l'âge, car nous connaissons tous des enfants de moins de 13 ans qui sont tout à fait capables de s'exprimer, que celui du discernement. J'observe d'ailleurs que, en autorisant les poursuites pénales contres les mineurs capables de discernement, notre droit est en contravention avec la Convention internationale qui exige que soit fixé un âge plancher pour la responsabilité pénale. Un toilettage des textes semble donc nécessaire pour inciter le juge aux affaires familiales à avoir davantage recours aux auditions des enfants, en l'absence des parents et dans des conditions adaptées de sérénité. Mme la Rapporteure : Que pensez-vous de la proposition qui est faite de créer des magistrats spécialisés dans la famille au sens large, c'est-à-dire regroupant les affaires familiales et la protection des enfants ? Certains membres de la Mission pensent qu'il faudrait que la justice travaille en lien avec des équipes pluridisciplinaires capables, dans la procédure civile comme pénale, d'évaluer l'état psychologique, intellectuel et affectif des enfants. Quel est votre sentiment ? M. Côme Jacqmin : Les débats qui ont suivi l'affaire d'Outreau ont montré que la question du renforcement de la formation des magistrats aux questions de l'enfance ne se pose pas seulement pour les juges des enfants et les juges aux affaires familiales... Il n'y a pas de position de principe du Syndicat de la magistrature sur la création d'une chambre de la famille. À titre personnel, il me semble qu'on risquerait ainsi de mélanger des problèmes qui ne sont pas de même nature. Un grand nombre des situations qui viennent devant le juge aux affaires familiales concernent l'exercice de l'autorité parentale et la situation des enfants. Elles sont essentiellement axées autour du conflit parental, sans que les éléments faisant peser un danger sur les enfants soient excessivement importants. On n'a donc pas besoin d'outils aussi lourds que ceux utilisés par le juge des enfants. On risquerait en outre de faire perdre de vue la nécessité d'assurer le suivi de la famille, qui est une des justifications de la spécialisation du juge des enfants. Mais il est vrai qu'il est parfois dommage que le juge aux affaires familiales ne puisse pas, dans le cadre d'une procédure, se mettre dans la même position que le juge des enfants. Ainsi, statuant récemment en qualité de juge pour enfants du tribunal de Nice, j'ai regretté de ne pas pouvoir faire jouer, par une mesure d'instruction, le dispositif des points-rencontre pour qu'un père puisse garder un contact avec un très jeune enfant qui déménageait en Bretagne avec sa mère. C'est sans doute pour régler des situations de ce type que des solutions devraient être recherchées. Mme la Rapporteure : Nous avons abordé, lors de nos auditions, la question de la place de la médiation familiale. Est-il possible qu'un accord conclu dans le cadre d'une médiation familiale soit validé par le juge ? Mme Hélène Franco : Oui. Mme la Rapporteure : Vous avez dit que les dernières réformes législatives obligent le juge des enfants à traiter beaucoup de comparutions rapides de mineurs délinquants, au risque de faire passer au second plan la protection des enfants. Ne faudrait-il pas prévoir des délais de jugement pour les affaires d'enfants en danger, avec obligation pour les tribunaux de publier en fin d'année leurs délais moyens ? Nous aurions besoin d'un tel outil statistique pour mesurer à quel point les juges des enfants sont débordés. Mme Hélène Franco : Parmi les partenaires dont nous avons parlé, figurent les pédopsychiatres. Or, à la différence de pays voisins, nous manquons cruellement de structures permettant l'hospitalisation des enfants et, éventuellement de leur mère, voire de toute une famille. Le problème est le même pour le suivi en milieu ouvert, et il n'est pas rare que les listes d'attente dépassent plusieurs mois. Pour un enfant de quinze ans, c'est très, très long ! Cela nous amène donc à la question des délais. Selon les statistiques du ministère de la justice, 58 % des procédures au pénal sont des procédures accélérées. Nous avons, dans des grosses juridictions comme Bobigny, un traitement pénal en temps réel qui se traduit par un nombre de défèrements colossal : 4 à 5 par jour ! On a ainsi une machine qui tourne souvent à vide : il n'est pas rare que je doive recevoir un enfant pour qui j'ordonne une mesure de suivi éducatif, souvent à sa demande ou à celle de ses parents, et que je revois ensuite, dans le cadre de nouveaux défèrements, sans qu'il ait encore pu rencontrer son éducateur. À Saint-Denis, le délai d'attente est de huit à neuf mois pour une mesure de liberté surveillée ou de liberté surveillée préjudicielle. Six mois d'attente pour une place en centre médico-psychologique, neuf mois pour un suivi éducatif, c'est insupportable, et on imagine les effets sur des enfants qui sont déjà en situation de fragilité, enfermés hors de chez eux et hors de l'école. Depuis le décret du 15 mars 2002, des délais s'imposent déjà en matière de placement provisoire et font l'objet de sanctions. Les 8 jours imposés au parquet pour saisir le juge des enfants en cas d'ordonnance de placement provisoire et les 15 jours imposés au juge des enfants pour organiser l'audience sont évidemment nécessaires pour préserver les droits des familles et des enfants. Mais, compte tenu du manque de moyens, certains juges ont du mal à tenir ces délais. Si on m'impose des délais supplémentaires en matière de jugement civil, je m'efforcerai de les respecter. Mais que se passera-t-il après mon jugement ? Aujourd'hui, si on a un traitement en temps réel en matière pénale, ce n'est pas le cas en matière éducative. Pour une mesure d'investigation et d'orientation éducative censée durer six mois, il faut déjà attendre six mois pour que la famille soit reçue une première fois. Dans de telles conditions, il est évident que des délais supplémentaires ne seront pas très efficaces... Mais sur cette question, il serait sans doute intéressant de préciser dans la loi qu'un juge ne peut renouveler une mesure sans avoir reçu la famille, car il arrive que des juges des enfants omettent cette « formalité ». M. Côme Jacqmin : Je crois que la procédure en vigueur permet déjà d'établir des statistiques, et qu'il ne servirait donc à rien de prévoir de nouveaux délais. En effet, dès à présent, rien n'interdit d'être attentif à ce que les mesures soient reconduites dans les délais prévus par la loi, et que les délais qui viennent d'être rappelés soient respectés. M. Pierre-Louis Fagniez : Les postes de juge pour enfants sont souvent occupés par de jeunes magistrats. Observe-t-on le même phénomène chez nos voisins ? Peut-on dire qu'en France les magistrats considèrent que la justice pour enfants est moins intéressante que les autres activités judiciaires ? Mme Hélène Franco : L'âge des magistrats n'est pas en cause. Ce qui pose problème, c'est l'inexpérience des personnes nommées aux postes de vice-président, qui ne sont pas des fonctions exercées par des jeunes magistrats. Par ailleurs, depuis que la Belgique a récemment modifié sa législation, il n'existe plus, dans d'autres pays européens, d'équivalent de nos juges des enfants. Le Syndicat de la magistrature est attaché à cette exception française. En Italie, la séparation entre pénal et civil est très claire, avec une intervention au civil qui est parfois brutale et définitive de la chambre de la famille, laquelle a la possibilité de retirer totalement l'autorité parentale. Ce n'est pas ce que nous préconisons et, de ce point de vue, la philosophie de la proposition de loi de Mme Martinez nous paraît assez dangereuse. S'agissant par ailleurs du placement, nous manquons de structures souples, permettant qu'il n'excède pas un week-end ou une journée par semaine. Sans doute les expérimentations en ce sens mériteraient-elles d'être encouragées, ce qui n'exclut évidemment pas le contrôle du juge des enfants. Je souhaite enfin dire un mot du problème très important des mineurs isolés en zone d'attente. Chaque semaine, un ou deux enfants arrivent dans des conditions épouvantables, et il s'agit souvent de mineurs isolés. Ils se trouvent dans une insécurité juridique préjudiciable à leur protection. En décembre dernier, un arrêt de la cour d'appel de Paris a reconnu explicitement, sur le fondement du danger prévu à l'article 375 du code civil, la compétence du juge des enfants pour les mineurs en zone d'attente, dont il est ainsi admis qu'elle fait partie du territoire français. Pourtant, alors même que ces mineurs sont détenus, je l'ai dit, dans des conditions déplorables, on assiste à un véritable bras de fer entre l'autorité judiciaire représentée par le juge des enfants et le ministère de l'intérieur. Ainsi, la semaine dernière, une mineure qui avait bénéficié d'un placement décidé par un juge des enfants a été reconduite au Nigeria. Un tel mépris d'une décision de justice est intolérable dans un État de droit ! Sans doute serait-il utile, par conséquent, que la loi rappelle clairement que le juge des enfants est compétent et que le danger est prioritaire sur toutes les autres considérations. M. le Président : Nous nous sommes déjà intéressés de près à la question des mineurs étrangers isolés et votre propos enrichira notre réflexion. Je vous remercie vivement d'avoir participé à cette audition. Audition de M. Philippe Nogrix, sénateur, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir l'un de nos collègues sénateurs, M. Philippe Nogrix, président du Groupement d'intérêt public Enfance maltraitée. Vous venez de diriger, à la demande de Mme Roig, un groupe de travail sur le signalement des enfants en danger, problème qui nous a vivement interpellés à l'occasion de plusieurs tables rondes et auditions. C'est dire l'intérêt que nous portons à votre réflexion sur l'évolution des dangers qui pèsent sur les enfants, ainsi que sur les moyens d'améliorer la prévention et la détection. Il est arrivé en effet que plusieurs institutions aient eu connaissance de cas d'enfants en danger sans que les informations se croisent, sans qu'un dispositif transversal rende possible une action efficace. Peut-être la notion de secret professionnel pourrait-elle évoluer de façon à rendre possible le partage de certaines informations. M. Philippe Nogrix : L'enfance en danger est un sujet chargé d'émotion, qui nous interpelle tous. Nous ne pouvons pas rester inactifs devant ce qui se passe, et qui nous oblige à poser d'abord quelques questions de fond. Qu'est-ce qu'une maltraitance ? Quand commence-t-elle ? Quand finit-elle ? D'où vient-elle ? Quels en sont les acteurs ? Quelles en sont les victimes ? La société évolue rapidement et les règles du jeu sont en train de changer. Au cours des trois ou quatre dernières années, on a constaté de grands changements dans les rapports de couple et dans les rapports entre parents et enfants. Nous avons à notre disposition un arsenal de moyens et la loi fixe les compétences de chacun des acteurs. Mais il faut se demander si l'ensemble est cohérent et adapté. À cet égard, je suis heureux que Mme Roig ait demandé à mon collègue Louis de Broissia et à moi-même de conduire chacun un groupe de travail sur la maltraitance. Le législateur a compris qu'il devait intervenir. Il me semble essentiel d'analyser attentivement les textes existants qui ne sont peut-être pas appropriés. Les professionnels ne savent pas toujours à qui s'adresser, sous quelles formes, comment intervenir et quelles sont leurs véritables responsabilités. Le 119 est un plateau d'écoute chargé de transmettre aux professionnels compétents les cas qui lui sont signalés. Les personnes qui assurent la permanence téléphonique doivent établir un lien de confiance avec les personnes qui appellent. Beaucoup de gens se livrent parce qu'ils ont au bout du fil une personne qu'ils ne connaissent pas. Mais comment traiter des appels qui restent anonymes ? C'est un vrai problème. L'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED), créé par la loi du 2 janvier 2004, était réclamé par tous les intervenants, afin de mettre en cohérence des statistiques provenant de diverses sources. Il y a maintenant un équilibre entre la permanence du 119, qui peut être un lieu d'information sur l'évolution des phénomènes, et l'ONED, qui peut être un lieu de réflexion et de recherche de solutions. Les deux grands responsables du suivi de l'enfance sont les départements et l'État. Il nous semble que les compétences acquises par les conseils généraux désignent ceux-ci comme les instances les plus adaptées pour apporter des réponses rapides à des difficultés qui se posent localement, même si les départements correspondent à des territoires très différents dans lesquels les pratiques ne sont pas unifiées. Par ailleurs, l'articulation entre l'action des départements et celle de la justice pose problème. À cet égard, vous m'avez demandé si le conseil général doit être le point de passage obligé des signalements, et s'il faut aller jusqu'à supprimer la possibilité de s'adresser directement à la justice. C'est une question qu'il est délicat de trancher, et qui mérite débat. Dans une démocratie comme la nôtre, la justice est indispensable. Une articulation est nécessaire et doit être mise en place le plus rapidement possible. Le troisième partenaire du groupement d'intérêt public, ce sont les associations. Elles jouent un rôle déterminant. Cela dit, il est important de disposer des capacités d'analyse nécessaires pour connaître les véritables compétences exercées par ces associations, ainsi que les dangers éventuels de l'intervention de bénévoles non formés. M. le Président : Notre propre réflexion nous a conduits comme vous à la conclusion que le conseil général jouait un rôle pivot. Il est une plateforme de coordination, de mutualisation qui permet de mettre en place un dispositif efficace. S'agissant du signalement, pourriez-vous nous faire part des résultats de la réflexion menée par votre groupe de travail ? M. Philippe Nogrix : Notre groupe de travail a pu mesurer le rôle essentiel des conseils généraux. Ils ont acquis une telle expérience que l'on voit difficilement à quoi il servirait de construire d'autres dispositifs. Ils disposent des compétences nécessaires et couvrent l'ensemble du territoire. Pour les aider à être plus efficaces, il convient de faire en sorte qu'ils puissent s'appuyer sur des textes clairs et adaptés. S'agissant du signalement, je pense qu'il n'est pas possible de se passer d'une transmission des cas détectés à la justice. En amont du signalement, il convient d'aider à la restructuration de certaines professions, voire de définir de nouvelles professions. Des formations appropriées et cohérentes doivent être mises en place. Beaucoup trop d'intervenants ne se connaissent pas, ne se rencontrent pas, ne confrontent pas leurs informations. C'est pourquoi il arrive que l'on découvre une situation qui a évolué durant cinq, six, parfois dix années, sans que personne n'intervienne, parce que chacun n'était informé que de certains aspects du problème, chacun pensait que c'était l'autre qui intervenait. Une formation particulière est donc nécessaire, qui implique des rencontres interprofessionnelles autour de modules communs qu'il nous appartient de définir. M. Bernard Derosier : Je me réjouis que notre collègue Nogrix souligne le rôle essentiel des conseils généraux. Je n'en attendais pas moins de lui, puisque l'organisme qu'il préside vit pour moitié grâce aux départements. Je suis davantage préoccupé par ce qui se passe en aval du signalement. J'ai vécu personnellement un drame en 1986 : une petite fille est morte « à bas bruit » - notion bien connue des médecins que pour ma part j'ignorais -, parce qu'il a fallu quinze jours entre le signalement par les services du département et la décision de justice. Depuis ce drame, je me suis employé à mieux coordonner les services et à lutter contre le cloisonnement que l'on constate trop souvent. La loi qui a créé l'ONED n'a pas rendu obligatoires des observatoires départementaux. J'en ai créé un, dès 1986, dans le département que je préside. Il permet de réunir régulièrement autour d'une même table l'éducation nationale, la police, la gendarmerie, la justice, les services sociaux, bref, tous ceux qui peuvent être concernés par la maltraitance à enfant, avant et après signalement. C'est un moyen indispensable si nous voulons être efficaces. Il apparaît souvent que la survenue de drames est la conséquence de dysfonctionnements dans l'articulation entre les différents services. Pas plus tard que la semaine dernière, un bébé d'un mois et demi est mort dans une famille parce que la relation entre justice et services sociaux n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. C'est là que le législateur devrait intervenir, plutôt que de s'en remettre à des rapports plus ou moins médiatisés. Mme Brisset, Défenseure des enfants, a pris les services sociaux départementaux comme boucs émissaires sous prétexte que les choses ne se passent pas de la même façon selon les départements. Comme si la justice était rendue de la même façon de Marseille à Lille ! La proximité a des avantages, qu'il faut utiliser, à condition de créer des dispositions obligatoires, visant notamment l'institution d'observatoires départementaux. M. Philippe Nogrix : L'existence d'observatoires départementaux ne remet pas en cause le bien-fondé d'un observatoire national. Les départements ont des pratiques qui leur sont propres. Nombre d'entre eux ont mis en place des observatoires. Tant mieux. Mais nous savons précisément que le problème essentiel est la mise en cohérence. C'est pourquoi les expériences relevées dans les observatoires départementaux nous aideront à définir de meilleures procédures au niveau national. En outre, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par observatoire. Dans les départements, les observatoires sont des conférences de mise en cohérence : on y réunit les services, on discute avec eux, et l'on tente de déterminer les relations qui doivent exister entre eux. Il ne s'agit pas d'observatoires au sens d'une instance où des analyses scientifiques puis pratiques conduisent à élaborer des solutions. L'ONED et les observatoires départementaux ne sont nullement contradictoires, de même que l'ONED et l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée (ODAS) sont complémentaires, les travaux de l'un ne pouvant qu'aider l'autre à approfondir ses propres travaux. S'agissant des propos de Mme Brisset, les mots qu'elle a employés ont en effet été maladroits et ont pu être ressentis par certains comme une forme de stigmatisation. M. le Président : Je voudrais aborder ici le problème des enfants victimes des sectes. Pensez-vous que nous pourrions formuler des propositions spécifiques les concernant, ou estimez-vous qu'il s'agit là de situations qui s'inscrivent dans le cadre général de l'enfance en danger ? M. Philippe Nogrix : Les sectes agissent de manière sournoise et savent très bien adapter leur stratégie à chacune de leurs cibles. On a dit beaucoup de choses sur l'infiltration des sectes dans les services de l'ASE. Je n'ai aucun élément me permettant de confirmer ces dires. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème, mais le mieux est sans doute de laisser les instances les plus compétentes, comme les Associations de défense des familles et de l'individu (ADFI), s'en occuper. Les commissions d'enquête parlementaires sur les sectes ont fait un travail important qui a permis de débusquer certaines associations nocives. Les présidents de conseils généraux ont mis en garde leurs personnels. Il y a incontestablement une augmentation des violences psychologiques, augmentation à laquelle les sectes ne sont pas étrangères. Nous devons rester vigilants, notamment en ce qui concerne les familles d'accueil. Mais encore une fois, la lutte contre l'influence des sectes est une affaire de spécialistes. C'est pourquoi j'insiste toujours sur la nécessité de la formation des professionnels, qui doit être continue. M. le Président : En ce qui concerne la formation continue et les évaluations partagées, il me semble qu'il s'agit moins d'adopter de nouveaux textes que d'appliquer ceux qui existent. M. Philippe Nogrix : Il est tout de même un sujet sur lequel le législateur doit absolument se pencher. Il s'agit de la définition du secret professionnel. Il est fréquent que des situations dangereuses évoluent sans que nous le sachions parce que le travailleur social est bridé par cette notion de secret professionnel qu'on lui a inculquée dans sa formation de base. Le devoir de respecter le secret professionnel peut être un refuge, même si c'est aussi une nécessité. Le secret partagé doit être défini par le législateur. M. le Président : Le partage des informations, qui est en effet un élément crucial, doit-il être soumis à l'accord préalable des familles ? M. Philippe Nogrix : C'est une question délicate. Étant par ailleurs membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), je suis aussi sensible à la nécessité de respecter l'intimité des familles. Si le recueil des informations relatives aux enfants permettait, vingt ans après les faits, d'apprendre que telle personne a été victime de viol par ses parents ou par un oncle, ce serait une stigmatisation qui ne servirait à rien. Cela dit, il est absolument nécessaire d'avancer. Il ne faut pas que, à cause de la CNIL, à cause du secret professionnel, on ne fasse rien. Ce serait catastrophique. Nous pouvons sortir de cette difficulté par une définition exacte du secret partagé. Jusqu'où peut-il aller ? Pendant combien de temps peut-il être partagé ? Quand doit-il s'effacer ? L'information de la famille est une question qu'il faudra examiner avec les membres de la CNIL. Au niveau local, comme l'a fait le président Derosier dans son département, des conférences doivent réunir tous les acteurs, afin de confronter les informations et les pratiques. Toutes les affaires qui ont été jugées montrent à quel point le cloisonnement des services peut être préjudiciable aux enfants. Il s'agit de mettre en place des recueils d'informations davantage que des fichiers. Les conseils généraux sont les mieux armés pour le faire, car le département forme le territoire le plus adapté à l'action sociale. L'ONED va tirer les enseignements des diverses expériences menées au niveau départemental. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan de son action, mais il est certain que son regard sur les pratiques départementales est essentiel. Il peut également analyser les expériences étrangères : l'exemple canadien est souvent mis en avant, même s'il faut se méfier des effets de mode, et analyser les choses en détail avant d'importer sans discernement les méthodes suivies à l'étranger. M. Pierre-Louis Fagniez : Le secret partagé devrait être une notion universelle. N'avons-nous pas intérêt à recenser tout ce qui a été fait dans les pays qui se sont intéressés au sujet, sans sacrifier aux effets de mode ? M. Philippe Nogrix : C'est ce que nous faisons. L'ONED a conduit une première mission d'étude au Canada. Les exemples italien et britannique seront également analysés. M. Patrick Delnatte : S'agissant du partage des informations, je vois mal les départements mettre en place des fichiers. Il me semble que nous devons nous orienter vers la définition d'un fichier judiciaire, dont les règles d'accès devront être fixées avec rigueur. Pour les délinquants sexuels, des fichiers ont été mis en place. Mme la Rapporteure : Un fichier judiciaire ne concernerait que les personnes condamnées et serait centré sur la prévention de la récidive. Il ne me semble pas qu'on ait déjà créé des fichiers judiciaires pour des personnes suspectes, ni même pour les affaires ayant fait l'objet de classement sans suite. M. Patrick Delnatte : Je préfère des fichiers judiciaires, avec toutes les précautions nécessaires, que des fichiers administratifs. M. Bernard Derosier : Le problème des fichiers, c'est l'usage qu'on peut en faire. Sur quelle base ces fichiers seraient-ils constitués ? Sur la base d'une déclaration d'un travailleur social ? On voit bien les dérives auxquelles de tels fichiers pourraient conduire. Un ancien ministre de l'intérieur avait envisagé d'obliger les travailleurs sociaux à signaler à la mairie les familles à problèmes. On voit bien l'exploitation qui peut être faite de cette pratique, au point que les travailleurs sociaux s'en sont émus, et ont été rassurés par le successeur de ce ministre de l'intérieur, dont une collaboratrice m'avait expliqué que les enfants de cinq ans qui commettent de petites bêtises étaient des délinquants en puissance et qu'il fallait pouvoir les suivre... Il n'est pas nécessaire de mettre en place un fichier pour savoir dans quelles familles il peut y avoir des problèmes. Tout travailleur social le sait forcément, car il connaît bien le territoire dans lequel il exerce. Mme Michèle Tabarot : Je suis surprise par ce que vient de dire notre collègue. Que des fichiers puissent aider les municipalités à anticiper, cela ne me choque pas. Si certains travailleurs sociaux ne réagissent pas à temps, et nous savons tous que cela peut arriver, le maire doit pouvoir intervenir à bon escient. L'idée d'un fichier ne peut pas être écartée d'un revers de main. M. Bernard Derosier : Je n'ai rien écarté d'un revers de main. J'ai posé un problème et décrit les dérives possibles. Mme Michèle Tabarot : Mais vous avez évoqué ce qu'un ministre de l'intérieur avait envisagé. C'est une réaction qui me paraît quelque peu partisane. Tout le monde s'accorde pour reconnaître que notre dispositif est perfectible, et il me semble que notre Mission devrait plutôt s'employer à examiner les moyens de l'améliorer. M. le Président : Le mot fichier est très connoté. Il me semble préférable de parler de recueil d'informations. M. Philippe Nogrix : Il existe une distinction très nette entre le problème de la délinquance et celui qui nous occupe. L'objet de notre réflexion est de dessiner les contours d'un dispositif permettant de porter assistance à des personnes en danger. Il ne s'agit pas de ficher les gens. Il s'agit de donner aux intervenants des outils d'information. Ceux-ci n'étant pas centralisés, il est nécessaire de trouver un lieu de collecte d'informations qui, prises séparément, peuvent apparaître comme étant anodines, alors qu'elles correspondent à une situation très grave. Un retard scolaire, par exemple, peut être la manifestation d'une situation dangereuse pour un enfant. En tout état de cause, la question de la collecte d'informations doit être abordée avec la CNIL. Je tiens à ajouter un mot au sujet de l'éducation nationale. Elle ne doit pas être une citadelle et, si un enfant est en danger, ce n'est pas à elle seule de régler le problème. On ne règle pas un problème en déplaçant un enseignant, ni en cachant les choses pour éviter qu'elles se sachent. L'école est le lieu où les signalements peuvent se faire le plus rapidement. S'agissant, enfin, du 119, je souligne qu'il y a chaque année 2 millions d'appels, pour 8 000 transmissions. Ce sont des chiffres qui m'interpellent. M. le Président : Ils nous interpellent aussi. Je vous remercie, cher collègue, pour votre contribution aux travaux de notre Mission. Audition de M. Dominique Barella, président Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous avons le plaisir d'accueillir M. Dominique Barella, président de l'Union syndicale des magistrats (USM). Notre Mission d'information, qui réfléchit depuis plusieurs semaines aux moyens d'améliorer notre dispositif de protection de l'enfance, s'est intéressée au respect par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant, au rôle joué par le juge des enfants dans la protection de l'enfance et au traitement des mineurs confrontés à la justice. Sur ces trois points, nous aimerions connaître la position de l'USM. M. Dominique Barella : Je vous transmettrai une note de l'USM recensant les difficultés jurisprudentielles rencontrées par nos collègues. De fait, les contradictions de jurisprudence entre les différents ordres de juridiction sont un mal français et, sans aller jusqu'à l'unification des juridictions réclamées par certains, laquelle éviterait bien des problèmes en tous domaines, je pense qu'il appartient au législateur, lorsqu'il a repéré une de ces contradictions, de prendre sa plume pour dire quelle orientation doit être retenue, afin que les professionnels et les citoyens sachent quels textes sont applicables. Cette nécessité de clarification s'impose tout particulièrement lorsque des mineurs sont en cause. Il n'appartient pas à l'USM de commenter les diverses décisions prises par les juridictions suprêmes, mais j'insiste sur le fait que le législateur doit intervenir. S'agissant du fonctionnement des juridictions, il y a beaucoup à dire, puisque les mineurs peuvent se trouver, selon les situations, soit devant le juge des tutelles, soit devant le juge des enfants, soit devant le juge aux affaires familiales. L'USM a longuement réfléchi à l'amélioration du dispositif et préconise une solution géographique et technique globale. Depuis des années, le Parlement réclame une modification de la carte judiciaire pour tirer les conséquences de la nouvelle répartition de la population sur le territoire et des différences de charge de travail entre les tribunaux. D'ailleurs, un rapport de la Cour des comptes et un autre du Conseil de l'Europe pointent l'inadaptation de la répartition des juridictions. Pour ce qui concerne la vie courante, c'est-à-dire les questions de séparation et de divorce, les mesures de tutelle, la justice des mineurs, il faudrait regrouper le contentieux familial au niveau de l'arrondissement. On parviendrait ainsi à une plus grande proximité, souhaitée par beaucoup. De plus, une telle organisation permettrait de maintenir les juridictions d'instance en leur garantissant un niveau d'activité suffisant. Elle assurerait aussi la cohérence des interventions à l'égard des familles et éviterait leur démultiplication. Elle permettrait qu'un regard « systémique » soit posé sur l'enfant, envisagé dans son contexte familial et son réseau affectif par des juges compétents. Un tel cadre autoriserait l'instauration d'une formation continue des magistrats aux enjeux psychologiques des dossiers qu'ils ont à traiter. Ces enjeux sont en effet communs aux affaires de séparation de couple, de protection des mineurs et de tutelle. Cette organisation permettrait enfin d'unifier le niveau d'intervention des associations de protection de la famille et des droits de l'enfant. S'agissant du fonctionnement des juridictions pour enfants, les procureurs chargés des mineurs doivent faire face à une concentration des signalements, par fax, le vendredi, entre 16 heures et 17 heures. Pourquoi tant de mineurs sont-ils en danger en France ce jour-là à cette heure-là ? Parce que le week-end arrive, et qu'il y a un problème de permanence du personnel chargé de la protection des mineurs, notamment au niveau départemental. Il en résulte des difficultés considérables pour faire procéder à des évaluations, et les services se couvrent en signalant systématiquement les cas à la justice. Ces signalements sont parfois apocalyptiques, sans pour autant être toujours précis. Il est fréquent que les services chargés de la protection des mineurs saisissent le parquet par fax de cas d'adolescents qualifiés de suicidaires, sans donner d'indice permettant de trouver ces adolescents... Le placement en urgence soulève des difficultés de la même importance. En cette matière, l'exercice tient malheureusement de la « patate chaude ». Considérons le cas d'un mineur qui commet un acte grave et pour lequel se pose la question du type de placement ou de la détention. Bien que la protection judiciaire de la jeunesse considère qu'il présente un profil psychiatrique grave, aucun établissement adapté ne peut l'accueillir, faute de place. Le parquet se tourne alors vers un service de pédopsychiatrie, afin qu'un spécialiste puisse, en urgence, procéder à l'expertise nécessaire dans les délais requis par la loi. Or, dans la plupart des cas, le psychiatre consulté déclare que le mineur ne présente pas du tout le profil psychiatrique initialement décrit, et qu'il n'a donc pas sa place dans un service de pédopsychiatrie. On se trouve alors avec un mineur en garde à vue, pour lequel la seule « solution » qui reste est la prison. C'est une modalité de choix inacceptable, d'autant que la prison n'est pas toujours une solution juridiquement possible. Quoi que l'on ait pu vous dire à ce sujet, le problème des placements en urgence par les parquets constitue une difficulté majeure. En outre, pour que le dispositif fonctionne, on charge le ministère public de donner l'autorisation de placement en urgence, alors que cette décision devrait revenir au juge des enfants. Les types d'établissements chargés d'accueillir les mineurs ont évolué, au cas par cas, selon les ministres et les années. Nous avons besoin d'établissements clairement identifiés selon la typologie des mineurs considérés, et de centres d'accueil ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre, où l'on puisse procéder aux évaluations indispensables à la prise de décision. Les deux types de structures sont absolument nécessaires, et il faut y penser lorsque l'on travaille au maillage territorial des établissements, publics et privés. S'agissant des auditions de mineurs, des règles générales doivent être définies, car on ne peut se satisfaire d'un système dans lequel les obligations - l'enregistrement par exemple - diffèrent selon le juge devant lequel l'enfant se trouve. Si l'on estime que, pour des raisons psychologiques et juridiques, un type d'audition est meilleur qu'un autre, il doit être généralisé à tous les mineurs. Il est inconcevable qu'une certaine manière de conduire une audition soit privilégiée dans un cas mais pas dans un autre. En revanche, il faut impérativement laisser aux juges une certaine souplesse d'appréciation, surtout s'ils ont affaire à des enfants en très bas âge. Les théories psychologiques, psychiatriques et neuropsychiatriques changent très vite ; il faut donc éviter de figer le dispositif, qui courrait, sinon, un risque d'obsolescence accélérée, avec les dégâts que cela peut produire chez les enfants. À titre d'exemple, sur la résidence alternée en cas de divorce, on aura tout entendu, philosophes, psychologues et éducateurs disant tour à tour tout et son contraire. Ce seul exemple montre que le législateur doit avoir la main prudente et laisser au juge la faculté d'apprécier la situation. En matière pénale, la très perturbante affaire d'Outreau a conduit à aborder la question de la parole de l'enfant. Si l'audition par la police ou par le juge est enregistrée et que le mineur n'est plus réentendu ensuite, sa parole est sacralisée. Cette sacralisation risque de mettre en cause certains droits de la défense et contrarie le principe de l'oralité du débat. En effet, les débats d'assises prennent très souvent un tour imprévu, différent de ce que contient le dossier ou de ce que les enquêteurs ou le magistrat ont entendu pendant l'instruction. Figer les choses en décidant que la parole de l'enfant est enregistrée une fois pour toutes, c'est limiter les débats d'audience, avec les inconvénients que présente cette interférence. Inversement, certains psychologues considèrent que l'on risque de déstabiliser gravement les mineurs victimes s'ils doivent être entendus plusieurs fois pour répéter des faits douloureux, ce qui peut les empêcher de surmonter leur traumatisme. De même, faire du mineur une victime ou un témoin comme un autre conduit à le confronter à des avocats pénalistes pour qui tous les « coups » juridiques sont permis, leur objectif n'étant pas la rééducation de l'enfant mais la défense de leur client. Les magistrats s'interrogent en permanence sur ces questions, et savent d'expérience que les paroles d'un mineur recueillies lors d'un enregistrement sont à prendre avec d'infinies précautions. On notera enfin que, lorsque le législateur décide une orientation M. le Président : Je vous remercie. Mme la Rapporteure : Quelle est la position de l'USM sur l'éventuelle généralisation de l'aide juridictionnelle à tous les mineurs ? M. Dominique Barella : C'est une idée généreuse de vouloir assurer la présence d'un avocat auprès de tout mineur entendu, sans condition de ressources des parents, pour éviter les éventuels conflits d'intérêts, mais elle suscite de grandes difficultés. S'agissant des mineurs en danger, l'État et les départements ont des services qui mènent une politique de défense globale et réfléchie. L'expérience montre que les interventions d'un avocat vont souvent à l'encontre de cette politique, et parfois même de l'intérêt du mineur considéré. La réflexion collective est beaucoup plus protectrice des personnes vulnérables ou en danger que ne peut l'être une prise en charge individuelle par le biais d'un avocat. J'ai assisté à de véritables collisions lorsque j'étais juge des tutelles, et l'on entend parfois des interventions très contre-productives de la part de l'avocat chargé de défendre l'enfant. Habitués à défendre une personne accusée par une institution, les avocats sont mal formés à la défense d'un mineur. Si l'on décidait malgré tout d'instituer un tel dispositif, il faudrait créer un corps d'avocats spécialisés dans la défense des mineurs. En tout état de cause, on est plus intelligent à plusieurs, et mieux vaudrait travailler à des orientations globales, au risque, sinon, d'un éclatement des positionnements. À titre d'exemple, certains avocats appelés à défendre un mineur sont favorables sans réserves à la résidence alternée, d'autres y sont résolument hostiles. Compte tenu de ces différences de positions, le problème de l'enfant sera-t-il toujours réglé au mieux ? Systématiser la défense du mineur par un avocat conduira à l'isoler et à faire de son cas un problème strictement individuel, alors que la défense des mineurs relève aussi de l'État et de la collectivité. Mme la Rapporteure : Votre opinion est-elle la même s'agissant, au pénal, des enfants victimes ? M. Dominique Barella : Autant, en matière d'assistance éducative, la présence d'un avocat ne me semble pas s'imposer, autant, dans le cas des enfants victimes, un avocat est non seulement utile mais très nécessaire, car il fera en sorte que le mineur soit écouté et respecté et qu'il puisse éventuellement percevoir des dommages et intérêts. M. Pierre-Louis Fagniez : Vous avez indiqué que, selon le Conseil de l'Europe, la France occupe le vingt-troisième rang pour ce qui est du budget de la justice rapporté au nombre d'habitants. Sous-entendez-vous par là que la qualité de la justice est proportionnelle aux moyens qui lui sont alloués ? Si c'est le cas, ne faut-il pas commencer par imiter ce que font les pays placés en tête de ce classement et procéder aux modifications structurelles nécessaires, avant de modifier le budget de la justice. M. Dominique Barella : La modestie nous impose de regarder ailleurs, mais il n'empêche que l'on ne pourra suivre les exemples étrangers avec un budget inférieur de moitié. D'excellents travaux parlementaires ont décrit les problèmes de la justice ; l'analyse a été faite et les solutions sont connues. Je me permettrai donc seulement de citer un ancien député, M. Pascal Clément, qui considérait que la France, en matière de justice, était en train de payer ses choix budgétaires, qui expliquait que 250 juges d'application des peines sont chargés de suivre 170 000 personnes, et qui citait le nombre stupéfiant des affaires - dont celle d'Outreau - suivies par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai. Si l'on veut assurer le suivi cohérent et correct des mineurs et, dans un autre domaine, des libérations conditionnelles, il faut s'en donner les moyens. On nous dit que le budget de la justice progresse. Il est certes un peu plus important qu'il y a dix ou quinze ans, mais le bateau de la justice française demeure un caboteur quand l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont des croiseurs. Que la carte judiciaire doive être restructurée, c'est certain, mais les élus terrorisent les gardes des sceaux successifs, et aucun n'osera la modifier car les résistances locales sont plus grandes encore qu'elles ne l'ont été pour la répartition des casernes. Pour autant, lorsqu'il est question de prolonger la garde à vue d'un mineur, la loi impose que le parquetier se déplace. Mais quand vous êtes procureur, que vous avez un ou deux substituts, que tout le monde est en audience, vous ne pouvez tout simplement pas consacrer une heure et demie à l'aller et une heure et demie au retour pour traverser le département. Dans une telle situation, le manque de moyens et de l'inadaptation du maillage territorial conduisent à ne pas appliquer la loi. M. Pierre Goldberg : Votre position sur la restructuration de la justice à l'échelon cantonal m'a d'autant plus intéressée qu'elle pourrait valoir pour d'autres administrations. La réorganisation de la carte judiciaire que vous appelez de vos vœux devrait-elle, selon vous, se traduire par davantage de proximité ? Dans l'Allier, il n'y a plus qu'un seul juge des enfants, et il est à Moulins. On imagine les difficultés que cette concentration soulève, notamment pour les familles modestes de Vichy, de Montluçon et d'ailleurs. M. Dominique Barella : Pour la carte judiciaire, on a toujours raisonné en termes de départementalisation, et calé la réforme sur le pénal alors qu'il est exceptionnel de se trouver victime au pénal. Au contraire, le citoyen ordinaire a très souvent affaire à la justice en matière matrimoniale ou en matière de tutelle, notamment lorsque ses parents vieillissent. Pour ces affaires, il devra voir le juge à de multiples reprises, tout comme lorsqu'il s'agira de traiter des petits litiges de la vie quotidienne. À effectifs constants, il faudrait, en bonne logique, concentrer les moyens nécessaires à la politique pénale et à la coordination avec les services de police et de gendarmerie. Pour leur part, les services nécessaires à la justice des mineurs, aux tutelles et aux affaires familiales sont très coûteux en personnels. Mieux vaudrait les regrouper et s'attacher à rendre une justice de qualité, au plus près des familles, au lieu de s'adresser à trois juges différents qui, chacun, statuent sur les mêmes familles. A-t-on assez conscience qu'un juge des tutelles et un juge des mineurs suivent une famille pendant des années, sinon des décennies ? La proximité est indispensable. Il en va de même en cas de divorce, car les litiges durent jusqu'à la majorité du dernier enfant. Mieux vaudrait donc instituer un grand juge de la famille que procéder à une nouvelle réforme parcellaire. On maintiendrait ainsi les tribunaux d'instance et l'on pourrait former de bons juges professionnels au lieu de former des juges de proximité travaillant deux après-midi par semaine, qui ne sont d'ailleurs pas chargés des affaires touchant la famille. Quant aux maisons de la justice, elles tiennent plus du gadget que d'autre chose. La justice est un service public et nos concitoyens ont droit à leur tribunal ; ce n'est pas un luxe mais un facteur de paix sociale. M. Pierre Goldberg : À quoi attribuez-vous l'explosion de la demande de justice et d'expertises ? Cela tient-il, selon vous, à l'évolution de la situation sociale, à l'augmentation du chômage et de la précarité ? La courbe est-elle semblable pour ce qui concerne la protection de l'enfance ? M. Dominique Barella : La fragilisation sociale créée par les licenciements conduit à des difficultés de paiement croissantes, notamment des loyers, et les difficultés s'aggravent continûment depuis quinze ans au pénal. Mais l'on constate une grande disparité dans le nombre des saisines de la justice selon les départements. Elles varient du simple au double, le contentieux se concentrant dans le sud de la France, très procédurier. En cette matière, pays d'oc et pays d'oïl ont conservé des traditions spécifiques. D'autre part, la République laïque a développé un discours sur les droits qui est tout à son honneur, mais il serait pédagogique de parler également des devoirs. Ainsi substituerait-on à la confrontation la conciliation, qui n'est pas dans la tradition française. Sur ce point, les élus ont un grand rôle à jouer. Pour ce qui est de l'évolution du nombre d'affaires judiciaires concernant les enfants, la protection judiciaire de la jeunesse vous dira sans peine le nombre de dossiers suivis. Mme Henriette Martinez : Si nous sommes ici, c'est que des problèmes touchant à l'intérêt de l'enfant perdurent. Pensez-vous que cette notion doive être définie par la loi ? Elle est en effet appréciée selon des considérations différentes. L'intérêt de l'enfant est-il d'être entendu dans telles conditions ou dans telles autres ? D'être placé périodiquement sans pouvoir construire une stabilité affective, mais en maintenant la possibilité du retour dans sa famille ? D'être placé plus longuement, afin de permettre un attachement à la famille d'accueil ? De pouvoir systématiquement retourner dans sa famille d'origine, ou de ne jamais la revoir lorsqu'elle est pathogène ? L'enfant doit-il disposer d'un avocat auprès de lui pour l'aider à se défendre ? Il serait, me semble-t-il, de l'intérêt de l'enfant d'avoir un avocat personnel, car ce que vous avez dit des avocats vaut aussi pour les juges, dont les critères d'appréciation dépendent également de convictions morales personnelles. Certains magistrats pensent sincèrement que l'intérêt de l'enfant est de retourner dans sa famille, d'autres estiment qu'il consiste à rester dans sa famille d'accueil, et nous avons tous à l'esprit des jugements rendus qui ne nous paraissent pas conformes à l'intérêt de l'enfant. Nous aimerions que tous soient rendus avec la sagesse qui a caractérisé vos propos. M. Dominique Barella : Les juges doutent. Ce sont des citoyens chargés de missions extrêmement difficiles, qui doivent être formés au mieux et sanctionnés lorsqu'ils commettent des erreurs, mais c'est une folie de les prendre pour des demi-dieux. Le juge a, statutairement, l'obligation perpétuelle d'œuvrer en faveur de l'intérêt général. C'est pourquoi il est amené à suivre une formation continue tout au long de sa carrière, obligation que l'on peut difficilement imposer à un avocat. Pour ce qui est de la variété des analyses faites par les juges, on observera que les services de l'État doivent garantir que, dans l'intérêt général, l'enfant soit protégé. Le fait que l'État ne joue pas pleinement son rôle de garant a été, de façon sans doute exagérée, mais non sans raison, rappelé par la Défenseure des enfants. Reste à savoir s'il existe des familles définitivement pathogènes et des délinquants définitivement délinquants. Aucun criminologue, aucun psychiatre, aucun psychologue n'est en mesure de répondre à de telles questions. Cependant, le juge retrouve ces interrogations au moment où il prend une décision. Le législateur doit définir des règles tout en laissant au magistrat la possibilité d'une souplesse d'analyse suffisante pour s'adapter à l'évolution constante des connaissances scientifiques en matière de pédopsychiatrie, de psychanalyse et de neuropsychiatrie. Ne constate-t-on pas qu'actuellement, le « tout psychiatrie » propre à la France évolue, au point que l'on se demande si certaines maladies psychiatriques ne sont pas d'origine génétique, ce qui expliquerait certains dérèglements psychologiques ? En résumé, les hésitations ne pourront que demeurer, la justice ayant à traiter de comportements humains, par définition évolutifs. Quant aux mineurs, ce sont des citoyens en devenir qui doivent être défendus, mais ce ne sont pas des enfants-rois juridiques. Ne prenons pas les enfants trop au sérieux, et laissons leur rôle aux parents, à l'État et aux éducateurs. Si les mineurs étaient déjà des majeurs, cela se saurait ! M. le Président : Je vous remercie. Audition de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : C'est pour nous un grand plaisir d'accueillir l'ancien président de notre commission des lois, aujourd'hui garde des Sceaux, ministre de la justice. Notre Mission a consacré ses premiers travaux à la protection de l'enfance. Nos auditions successives ont montré que, faute d'objectifs clairs, notre dispositif est peu efficace et son organisation coûteuse, complexe et peu compréhensible. Nous souhaitons donc examiner aujourd'hui avec vous le rôle de la justice et la place du juge pour enfants dans le dispositif de protection de l'enfance. Le deuxième volet de nos travaux portera sur le droit de la famille proprement dit, et, si vous en êtes d'accord, nous serons amenés à vous entendre à nouveau. M. Pascal Clément : Comme vous le savez, mon arrivée à la Chancellerie est fort récente et, s'agissant des problèmes de la famille et des droits de l'enfant, mon expérience principale est celle du vice-président de conseil général chargé des affaires sociales que je fus il y a plus de dix ans. Je souhaite, avant de répondre à vos questions, rappeler quelle est la place du juge dans le dispositif de protection de l'enfance, puis traiter de l'applicabilité de la Convention internationale des droits de l'enfant, et notamment des questions relatives à l'audition des enfants. Les critères d'intervention du juge sont le danger et l'intérêt de l'enfant, notions établies par trois textes. Le fondement de la compétence du juge des enfants est la notion de danger, telle que définie par l'article 375 du code civil. En matière d'assistance éducative, l'exigence de la prise en compte de l'intérêt de l'enfant est inscrite à l'article 375-1 alinéa 2 du code civil qui, depuis la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance, impose au juge des enfants de « se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ». Enfin, la Convention internationale des droits de l'enfant dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Le principe de l'applicabilité directe de cette stipulation de la Convention vient d'être reconnue par la Cour de cassation. L'intérêt de l'enfant est une notion plus imprécise que celle de danger, limitativement conçu par la loi par référence à la santé, la sécurité, la moralité ou l'existence de conditions d'éducation gravement compromises. Une définition trop précise de l'intérêt de l'enfant limiterait le juge des enfants dans son action. C'est pourquoi la Cour de cassation n'a jamais voulu définir précisément la notion de danger, estimant qu'elle relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond. Je partage cette opinion. Une amélioration est-elle possible ? Elle consisterait à encourager la démarche d'évaluation du danger, engagée notamment par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, et qui correspond aux préconisations de la Convention. L'élaboration de recommandations de bonnes pratiques est en cours ; les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et les associations chargées de l'exécution des mesures administratives et judiciaires y sont associés. Par ailleurs, l'évaluation du danger dans certaines situations particulièrement difficiles incombe essentiellement aux professionnels intervenant auprès de l'enfant. C'est pourquoi il semble urgent de rendre systématique le recours à des équipes spécialisées en santé mentale juvénile, en coopération avec les travailleurs sociaux. La notion d'intérêt de l'enfant apparaît ainsi comme relevant davantage d'une compétence technique, qui peut être médicale, que d'une compétence juridique. Il pourrait donc être utile de réunir, d'ici la fin de l'année, les professionnels représentatifs des principales tendances pour parvenir à une conférence de consensus sur les techniques d'évaluation des situations de danger en matière de protection de l'enfance. La Chancellerie pourrait s'en occuper si votre Mission le souhaite. L'articulation des interventions administrative et judiciaire, sujet bien connu des élus départementaux, est l'une des conditions de la cohérence du dispositif de protection de l'enfance. Se posent ici la question de la décentralisation et celle de la subsidiarité. L'expérimentation prévue dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales tend à clarifier le partage des compétences entre les conseils généraux et la justice pour améliorer l'efficacité d'ensemble du dispositif. Elle traduit une démarche pragmatique et, à mes yeux, de pur bon sens, en permettant aux cinq départements retenus de se voir confier la mise en œuvre des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en matière d'assistance éducative. Dans le même temps, le dispositif accorde une compétence subsidiaire au juge des enfants. Actuellement, cinq départements sont candidats à l'expérimentation, par des délibérations prises à l'unanimité. Il s'agit de l'Aisne, de la Haute-Corse, de l'Indre-et-Loire, du Loiret et du Rhône. Une circulaire rédigée conjointement avec le ministère de l'intérieur précisera les conditions de l'expérimentation qui conduira d'évidence à plus de cohérence. J'observe que les départements peuvent d'ores et déjà être responsables de l'assistance éducative en milieu ouvert lorsqu'un juge décide de leur confier les enfants. En outre, les conseils généraux financent déjà l'ensemble des mesures d'assistance éducative prises en charge par le secteur associatif habilité, et notamment par le secteur de la sauvegarde de l'enfance qui existe dans presque tous les départements. Ce secteur est généralement plus important que l'ASE elle-même, pourtant service du département, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Une réflexion commune avec le ministère chargé de la famille a permis l'installation de deux groupes de travail consacrés respectivement à l'amélioration du signalement et à l'amélioration de la prise en charge des enfants protégés, qui devraient rendre leurs rapports très prochainement. La Chancellerie a participé à ces groupes de travail et préconisé certaines modifications du code civil et du code de l'action sociale et des familles pour clarifier la répartition des compétences entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, et rendre ainsi le dispositif plus compréhensible. S'agissant de l'organisation judiciaire de la protection de l'enfance, la répartition des compétences entre les juridictions qui prennent des décisions concernant les enfants est complexe. Elle est fondée sur la notion d'autorité parentale, si bien que juge aux affaires familiales, juge des enfants et juge des tutelles peuvent intervenir au même moment dans des domaines différents. Je m'efforcerai de faire en sorte que les magistrats de ces différentes juridictions travaillent au mieux ensemble et partagent les informations, mais je souhaite aussi marquer une pause législative et ne pas bouleverser l'architecture actuelle, par une réforme qui nécessiterait de mettre en cause les fondements de notre droit civil. La création d'un juge de la famille irait dans le sens de la simplification, mais ne correspondrait pas aux tendances actuelles de notre droit, qui vont au contraire dans le sens de la spécialisation de certaines fonctions juridictionnelles. On en a un exemple avec la loi du 9 mars 2004 qui a transféré au juge des enfants la compétence en matière d'application des peines. De plus, la Convention internationale des droits de l'enfant recommande la spécialisation de la juridiction des mineurs. J'en viens à l'applicabilité de la Convention pour ce qui a trait à l'audition de l'enfant par le juge et à l'assistance d'un avocat. S'agissant de l'audition par le juge, la Convention prévoit que l'enfant doit pouvoir exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant « s'il est capable de discernement ». Le caractère obligatoire de l'audition du mineur par le juge a donc été clairement écarté, dans le souci de protéger l'enfant. Une telle obligation pourrait en effet avoir des conséquences néfastes, par exemple dans les cas de divorce conflictuel. Quant à l'assistance de l'enfant par un avocat, elle est facultative en matière civile. Toutefois, elle peut être ordonnée d'office par le juge, et elle est obligatoire si l'enfant la demande dans le cadre de son audition (articles 338-5 et 338-7 du code de procédure civile) ou d'une procédure d'assistance éducative (article 1186 du même code). Il ne paraît pas opportun de la rendre obligatoire dans tous les cas, parce qu'elle n'est parfois pas souhaitée par les mineurs eux-mêmes, notamment quand ils sont adolescents. Par ailleurs, la récente réforme de la formation professionnelle des avocats a institué un cadre légal favorisant leur formation, notamment en matière d'assistance éducative. De plus, les créations de « permanences mineurs » - qui permettent l'assistance systématique des mineurs par un avocat en matière pénale ou d'assistance éducative - ont été accélérées dans le cadre des protocoles conclus entre les barreaux et les juridictions. Elles figurent dans trente-neuf protocoles en cours d'exécution. M. le Président : Monsieur le garde des Sceaux, je vous remercie de cet exposé très complet qui reprend les thèmes que nous avons abordés lors de nos précédentes auditions. Mme Martine Aurillac : Des événements récents ont montré combien la dispersion et le fractionnement des informations peuvent nuire au signalement des enfants en danger. La définition et l'entrée en vigueur d'un secret professionnel partagé ne seraient-elles pas de nature à renforcer l'efficacité de la procédure ? Mme la Rapporteure : Quelle est votre position sur l'extension de l'aide juridictionnelle à tous les enfants victimes, quels que soient les revenus des parents ? S'agissant de l'audition des enfants par le juge, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas qu'elle soit rendue obligatoire. Mais seriez-vous favorable à une rédaction qui permette qu'elle le devienne dès lors que l'enfant en fait la demande ? Aujourd'hui, le juge peut, sur décision motivée, rejeter la demande d'audition faite par un enfant, s'il pense, par exemple, que le mineur est manipulé par ses parents. Ne vaut-il pas mieux que l'enfant soit, dans tous les cas où il le demande, reçu par le juge, plutôt que de lui laisser croire que la justice est partiale ? M. Pascal Clément : L'obligation de secret professionnel ne s'applique pas lorsque des travailleurs sociaux transmettent les informations dont ils disposent au conseil général. Tout ce qui touche au secret professionnel partagé est d'une législation difficile. Je n'ignore pas que Mme Pécresse est l'auteur d'une proposition de loi qui tendait en particulier à constituer un groupe de travail chargé d'étudier les conditions du partage éventuel d'informations... Mme la Rapporteure : On peut considérer que notre Mission en fait office... M. Pascal Clément : Le fait qu'un travailleur social fasse part d'un « secret de famille » à l'un de ses collègues dans l'intérêt de l'enfant ne constitue pas une violation du secret professionnel. Mais je ne suis pas certain que toutes les pratiques se limitent à ce cas simple. Plutôt que de légiférer, je suggère que le groupe permanent interministériel pour l'enfance maltraitée se saisisse de cette question pour préciser dans quels cas le secret professionnel est opposable. J'observe cependant que jamais, en vingt-cinq ans, un scandale n'est remonté jusqu'à moi à ce sujet. M. Pierre-Christophe Baguet : Nous sommes partis de l'affaire bien connue de Drancy, qui a montré que, en dépit de signalements successifs d'administrations et de services différents, des enfants n'avaient pas été protégés comme ils auraient dû l'être. Pourtant, lorsque nous avons abordé ce problème au cours d'une table ronde, les représentants de la PMI et de l'éducation nationale nous ont fait comprendre qu'il n'était pas question de partager les informations, certains allant jusqu'à évoquer un « casier social » et expliquant que les enfants avaient droit à l'oubli. Dans ces conditions, comment espérer faire circuler les informations ? Ces verrous doivent céder, quand il s'agit de l'enfance en danger, comme on a su les faire céder pour la prévention de la délinquance. Si l'on ne légifère pas, comment venir à bout des réserves des différents services ? Mme la Rapporteure : Nous sommes en effet partis de cas dramatiques qui se sont produits ces dernières années, et nous avons constaté des caractéristiques communes, la première étant le cloisonnement des services. À chaque fois, des bribes d'information étaient connues, mais ceux qui savaient ne se parlaient pas, même à l'intérieur des services des conseils généraux, au sein desquels les informations ne circulaient pas entre la PMI, l'ASE et l'aide sociale. Par ailleurs, nous avons constaté un recours abusif à la justice, qui traite à délai différé. Nous souhaitons, en vertu du principe de subsidiarité, mettre le conseil général au cœur du dispositif, décloisonner les informations et simplifier les missions. Dans un tel schéma, le secret professionnel partagé nous paraît être une nécessité, et il doit pouvoir jouer entre les mairies et le conseil général. Nous avons constaté que, dans l'affaire de Drancy, le maire n'a jamais été informé de la situation des enfants, alors même que la commune gère l'office HLM et de nombreuses activités périscolaires. Nous réfléchissons donc à une modification du code de l'action sociale et des familles qui, en s'inspirant des règles applicables au secret médical, donnerait un fondement législatif au partage d'informations en matière de protection de l'enfance. M. Pascal Clément : Le problème tient à ce que les travailleurs sociaux de l'ASE, qui exercent un métier spécifique, considèrent que les autres travailleurs sociaux ne sont pas familiarisés avec les problèmes de l'enfance en danger. Aussi, je veux bien que l'on dise que le secret doit être partagé par toute personne ayant à connaître de l'enfant, mais je doute que les habitudes soient faciles à faire évoluer. Par ailleurs, ces personnels qui travaillent régulièrement avec les magistrats de la jeunesse redoutent d'éventuelles poursuites en cas de dégradation d'une situation qu'ils n'auraient pas été en mesure de dénoncer. Ces travailleurs sociaux vivent donc dans une sorte de crainte révérencielle. Enfin, même dans de grandes villes comme Saint-Etienne, les travailleurs sociaux de l'ASE n'ont pas d'homologues dans d'autres services, et on peut comprendre qu'ils n'estiment pas nécessaire de partager des informations avec une assistante sociale chargée de distribuer des prestations. En bref, vos observations sont sans doute fondées, mais il sera difficile de faire évoluer les mentalités. Je suis de ceux qui pensent qu'ils ont largement raison, car ce sont des métiers différents que de distribuer des prestations sociales et de protéger l'enfance en danger. Penser qu'ils sont équivalents et que les informations circuleront, c'est se méprendre. Mme la Rapporteure : Il ne s'agit pas que l'ASE donne des informations aux autres administrations, mais que les autres administrations lui communiquent celles dont elles disposent. Or, elles ne le font pas : elles les donnent au juge. M. Pascal Clément : Je rappelle qu'en cas de suspicion de maltraitance, l'éducation nationale doit saisir le parquet. Mme la Rapporteure : Quels sont les délais de jugement pour les mesures civiles de protection de l'enfance? M. Pascal Clément : Je n'ai pas les chiffres pour le civil. Des travaux sont actuellement en cours pour permettre le recueil de ces données, et la mise en place de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances accélèrera ce processus. M. le Président : Je reviens sur le respect de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ne faudrait-il pas donner à l'enfant le droit d'être entendu par un juge dans toute affaire qui le concerne ? Faut-il aller plus loin, et imposer au juge l'obligation de l'entendre ? M. Pascal Clément : Il est bon d'établir pour principe que l'enfant doit être entendu et qu'il faut faire droit à sa demande, et de laisser au juge la possibilité d'écarter cette audition par décision motivée si, par exemple, il devait s'agir pour l'enfant de choisir entre son père et sa mère lors d'un divorce. Je ne suis pas favorable à ce que l'on rende les auditions automatiques. Mme la Rapporteure : Seriez-vous favorable à ce qu'obligation soit faite à l'autorité judiciaire d'expliquer aux enfants victimes les décisions qui les concernent, y compris en cas de classement sans suite ou de relaxe au bénéfice du doute, ainsi qu'au civil dans les cas de divorce conflictuel ? M. Pascal Clément : Il est actuellement prévu que classement sans suite, non-lieu, relaxe et acquittement doivent être motivés et notifiés. Cela étant, doit-on légiférer pour dire qu'il faut expliquer ? Je ne peux imaginer qu'entre administrateur ad hoc, avocat et familiers, il ne se trouve pas quelqu'un pour expliquer au mineur les décisions prises. Mme la Rapporteure : Le problème est réel, particulièrement en cas de décision de relaxe ou de classement sans suite. M. Pascal Clément : C'est le rôle de l'administrateur ad hoc que d'expliquer quand on l'interroge. Il me paraît inconcevable que l'on n'explique pas à un enfant qu'il va être retiré de sa famille et placé dans une famille d'accueil ou dans une institution. Les juges le font, et ils le font avec beaucoup de pédagogie. J'ajoute que les textes prévoient une motivation systématique en cas de relaxe ou de classement sans suite. Mme la Rapporteure : Je n'en suis pas si sûre. M. Pascal Clément : Peut-être n'est-ce pas expliqué, mais c'est en tout cas porté à la connaissance des intéressés. M. le Président : La Défenseure des enfants a relevé la discordance de jurisprudence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation sur l'applicabilité directe de la Convention, sujet à propos duquel la France est régulièrement interpellée. Comment mettre un terme à cette divergence jurisprudentielle ? Faut-il légiférer ? M. Pascal Clément : Votre Mission sait-elle que par un arrêt du 18 mai 2005 la Cour de cassation a reconnu l'applicabilité directe de la Convention, ce qui lève la contradiction jurisprudentielle ? M. le Président : Cet arrêt, qui clarifie la jurisprudence de la Cour, porte uniquement sur les articles 3 et 12 de la Convention. Or précisément, s'agissant de l'article 12, le Conseil d'État, en refusant de reconnaître l'applicabilité directe de cet article, n'a pas le même point de vue que celui de la Cour. Mme la Rapporteure : La divergence porte toujours sur l'article 12, et donc sur le droit de l'enfant à être entendu par un juge. M. Pascal Clément : Le droit d'être entendu est la règle, mais la dérogation est possible. M. le Président : Précisément, la Convention ne prévoit pas la possibilité de refus du juge. M. Pascal Clément : Dans notre droit, cette possibilité est prévue, mais doit être motivée soit par l'absence de discernement soit par l'équilibre de l'enfant. Mme la Rapporteure : Les administrateurs ad hoc sont souvent ressentis comme étant à la fois juge et partie. Êtes-vous favorable à la professionnalisation de la fonction, qui garantirait leur indépendance, et à l'amélioration de leur indemnisation ? M. Pascal Clément : Le juge fait appel aux proches de l'enfant ou à l'ASE. Le critère de l'indépendance est intéressant et il pourrait être utilement inséré, dans la mesure où l'indépendance de l'administrateur ad hoc est la condition sine qua non de son intervention, afin de représenter les intérêts de l'enfant dans les situations où ceux-ci apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux. S'agissant des moyens, mon prédécesseur avait souhaité que le problème de l'indemnisation soit examiné par les directions compétentes de la Chancellerie dans la perspective d'une refonte du système actuel, en tenant compte de manière réaliste des missions accomplies par les administrateur ad hoc. Mais l'augmentation des frais de justice pose problème au ministère de la justice : ils ont progressé de plus de 20 % en un an, et sont passés en quelques années de 80 à 400 millions d'euros, dévorant le budget de la justice. Cela étant, je suis persuadé que le problème n'est pas uniquement un problème d'argent. M. le Président : Monsieur le garde des Sceaux, je vous remercie. M. Pascal Clément : Je vous ai répondu fort de mon expérience d'élu départemental plutôt qu'en ma qualité de ministre de la justice. C'est un sujet passionnant et sérieux, mais je ne suis pas de ceux qui croient que l'on pourra faire bouger les choses très facilement. Pour avoir constaté par moi-même, chaque fois que j'ai voulu déplacer le curseur, à quel point cela a été mal ressenti, je vous conseillerais volontiers d'expérimenter tout nouveau dispositif dans quelques départements avant de le généraliser. Audition de M. Martin Hirsch, président d'Emmaüs France Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous sommes heureux d'accueillir M. Martin Hirsch, président d'Emmaüs France, auquel je souhaite la bienvenue. Vous venez, monsieur Hirsch, de présider un groupe de travail sur la pauvreté et la vulnérabilité des familles. Les conclusions de votre rapport rejoignent nombre des préoccupations de notre Mission, qui a consacré ses premiers travaux à la protection de l'enfance et qui s'est notamment rendue en Grande-Bretagne pour examiner la mise en place du plan de lutte contre la pauvreté des enfants. En France, malheureusement, un million d'enfants vivent au dessous du seuil de pauvreté et notre dispositif de solidarité rencontre des difficultés croissantes pour faire sortir les familles de la pauvreté. Comment, selon vous, améliorer la combinaison entre les revenus du travail et les revenus de solidarité ? Comment améliorer l'accueil des jeunes enfants ? M. Martin Hirsch : La commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté » a réuni, en un temps très bref pour traiter d'un sujet très large, une trentaine de participants - représentants des partenaires sociaux, des associations familiales et de lutte contre l'exclusion, des collectivités territoriales, des services de l'État, ainsi que des personnalités qualifiées - qui avaient des points de vue très différents sur la pauvreté des familles. Mais dès le départ, l'unanimité s'est faite pour dire qu'elle s'aggrave et combien il est préoccupant de voir réapparaître un phénomène que l'on pensait disparu : les familles à la rue. L'association Emmaüs a été créée dans un contexte où il y avait de nombreuses personnes âgées dans le dénuement et beaucoup d'hommes seuls cabossés par les accidents de la vie. Depuis lors, la généralisation des retraites d'une part, la création des minima sociaux d'autre part ont amélioré la situation de ces deux catégories de population, mais réapparaît la pauvreté des familles, sous des formes que l'on croyait disparues. En effet, les repères mêmes de la pauvreté sont brouillés. Auparavant, si l'on avait un logement ou un emploi, le reste suivait. Ce n'est plus le cas : même un travailleur peut vivre sous le seuil de pauvreté, et il peut se trouver des gens qui ont un logement mais qui sont sans travail. L'INSEE a corroboré ce constat, en indiquant dans une étude qui a fait grand bruit qu'à Paris, 30 % des personnes sans domicile fixe ont un travail. Autre sujet de préoccupation : la situation actuelle suscite un antagonisme entre pauvres et très pauvres, entre travailleurs et non-travailleurs, entre les classes moyennes et les autres. On assiste donc à un mouvement de désolidarisation sociale. Cette évolution a une forte incidence sur les politiques publiques, puisque selon qu'on les cible sur les classes moyennes ou sur les plus faibles, on ne répond pas aux mêmes besoins. Or, les politiques publiques aggravent les clivages au lieu de les réduire. Face à ce contexte nouveau, la commission a pensé devoir s'écarter des réponses traditionnelles et traiter le problème dans tous ses aspects. On ne peut passer son temps à expliquer les liens entre le surendettement, l'accès au logement, l'emploi et l'éducation, puis saucissonner ! Nous avons donc pris le parti de formuler une palette de propositions en éclairant les articulations entre ces différents volets. Nous avons aussi décidé de nous intéresser au point clef qu'est la connexion entre prestations sociales et revenu du travail. Cette démarche nous a conduits à recommander une nouvelle approche de la combinaison entre revenus du travail et revenus de la solidarité. On entend souvent déplorer la faiblesse de l'écart entre ces deux types de ressources. Mais une fois cela dit, que faire, puisque l'on ajoute aussitôt que l'on ne peut augmenter les salaires sous peine d'accroître concomitamment l'exclusion du travail des non-qualifiés ? Quant à réduire les minima sociaux, c'est aggraver les difficultés sans rien résoudre : il y a deux ans, la réforme du dispositif de l'allocation spécifique de solidarité s'est traduite par l'augmentation du nombre des bénéficiaires du RMI, sans effet favorable sur l'emploi. À la différence d'autres pays, la France d'aujourd'hui se caractérise par l'augmentation des dépenses sociales, du chômage et de la pauvreté. Il faut donc agir autrement. Si l'on observe la double courbe des dépenses sociales et du risque de pauvreté dans les quinze plus anciens pays membres de l'Union européenne, on se rend compte que l'idée qu'il serait possible de couper dans les dépenses sociales pour réduire la pauvreté est un mythe. À une extrémité de la courbe, on trouve les pays scandinaves où les dépenses sociales sont très élevées et la pauvreté faible. À l'autre extrémité sont les pays du Sud, caractérisés par un niveau faible des dépenses sociales et un niveau élevé de pauvreté. Au milieu de la courbe sont l'Allemagne, la Grande-Bretagne qui est en train d'augmenter le niveau de ses dépenses sociales et réduire la pauvreté, et la France, un peu décalée car l'évolution s'y fait dans le mauvais sens. Comment lui faire regagner le peloton de tête ? Les statistiques montrent que, dans certains cas, retrouver un emploi peut faire perdre de l'argent. Nous avons donc cherché à combiner les deux catégories de revenus, ceux du travail et ceux de la solidarité. Ce faisant, nous avons mis en lumière plusieurs situations types. Premier cas de figure : le seul travail proposé est un emploi à temps partiel. C'est la situation, par exemple, des caissières de supermarché, et notamment de celles qui du fait du changement de leur situation familiale ne peuvent plus se satisfaire d'un salaire d'appoint. Deuxième cas de figure : les bénéficiaires des contrats aidés qui ne font pas sortir de la pauvreté. C'est le paradoxe d'une politique publique qui apporte une réponse inadaptée à la difficulté qu'elle souhaite résoudre. Enfin, troisième cas de figure : des salariés peuvent se voir proposer un emploi à temps plein, mais situé si loin de chez eux, quoique dans le même département, que les frais d'essence, de nourriture et tous les frais annexes leur feraient aussi perdre de l'argent par rapport à l'indemnisation du chômage qui leur est allouée. Dans ces trois cas, le retour à l'emploi signifie une diminution des ressources. D'où notre souci de trouver une nouvelle équation sociale, en mettant au point ce que nous avons intitulé le « revenu de solidarité active », calculé de manière à ce que les revenus du travail et les revenus de la solidarité, globalisés, s'ajustent selon la durée du travail accompli, sans jamais d'effet de seuil et en maintenant une hiérarchie entre travail et non travail. Ainsi, tout salaire supplémentaire déclencherait une diminution des prestations inférieure d'environ 50 % au gain provenant du travail, dès la première heure travaillée. On aboutit par cette mesure à ce que le retour à l'emploi paye systématiquement. Ce mécanisme a suscité deux critiques. La première a été formulée, au sein de la commission, par certains représentants du monde syndical craignant que cela favorise le travail à temps partiel et permette aux employeurs de se dédouaner. L'objection a suscité un débat très vif. Mais faut-il ne rien faire devant une situation dramatique, ou faut-il prendre le risque et essayer de le conjurer en instituant un engagement contractuel ? De même que nous avons préconisé un engagement de tous les acteurs, avec l'État, autour d'un objectif partagé de réduction de la pauvreté, nous avons envisagé un engagement contractuel sur l'évolution des comportements de travail pour accompagner le revenu de solidarité active sans permettre une croissance de temps partiel subi. Le marché du travail est organisé en trois compartiments : ceux qui, titulaires de minima sociaux, ne travaillent pas ; les précaires et les travailleurs pauvres, dont font partie les travailleurs à temps partiel subi ; les salariés de droit commun, qui peuvent travailler à temps complet s'ils le souhaitent. Comme on sait mesurer ces trois compartiments, on peut se fixer des objectifs pour chacun - par exemple, réduire le premier de 10 % et augmenter le troisième d'autant - et contractualiser en prévoyant des contreparties systématiques. Ainsi pourrait-on proposer des allégements de charge à condition qu'il n'y ait pas de temps partiel. De même pourrait-on, préalablement à la baisse de la TVA dans la restauration, faire prendre des engagements à un secteur dont on sait combien de gens il emploie, à quel niveau de salaire et pour combien d'entre eux à temps partiel, et moduler les avantages consentis en fonction des résultats atteints. De cette manière, on préviendrait toute dérive vers le temps partiel. Je souligne que notre commission n'a pas prétendu définir la politique de l'emploi, mais faire en sorte que reprendre un emploi signifie toujours avoir davantage de ressources, préalable indispensable à une politique de l'emploi efficace. La deuxième critique qui nous a été faite porte sur le coût de notre proposition. Nous aurions pu dire que le mécanisme est « auto-finançable », en ce qu'il va pousser des gens vers l'emploi, mais nous l'avons chiffré de manière très honnête, sans tenir compte de cet effet bénéfique. Nous en avons évalué le coût dans une fourchette comprise entre 4 et 8 milliards d'euros. Pourquoi une estimation aussi large ? Parce que les différentes administrations n'étaient pas disposées à faire des simulations, et qu'il a fallu se battre pour faire tourner leurs ordinateurs. La représentation nationale doit connaître ces difficultés de collaboration, qui pénalisent le travail d'une commission comme la nôtre et favorisent les conservatismes ! Toutefois, l'ordre de grandeur auquel nous sommes finalement parvenus est assez cohérent avec les estimations du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale et du Conseil économique et social. Les sommes qui, dans le dispositif social actuel, seraient nécessaires pour faire franchir le seuil de pauvreté à de si nombreuses familles, ne se chiffrent pas en dizaines de milliards, mais à moins de dix milliards. Ainsi, si l'on se limitait à une politique passive, consistant à augmenter les prestations pour qu'il n'y ait plus d'enfants pauvres, le coût en serait de 5,5 milliards d'euros, à reconduire l'année suivante, sans avoir toutefois la garantie que, même une fois franchi le seuil de pauvreté, tous les problèmes seront réglés. Comment trouver ces sommes, équivalentes au produit de la privatisation intervenue il y a quinze jours ? Contrairement à ce que l'on pense, notre système de prestations sociales n'est pas particulièrement redistributif. On pourrait améliorer la redistribution, par exemple, en fiscalisant les allocations familiales, comme le Secours catholique vient de le suggérer. Nous avons nous-mêmes évoqué cette hypothèse, mais sans la retenir comme une proposition parce que l'Union nationale des associations familiales, membre de la commission, y est officiellement opposée. Un deuxième mode de financement consisterait à mobiliser une partie des crédits prévus pour la politique de l'emploi. Notre proposition de revenu de solidarité active participe de la politique de l'emploi, dans le schéma contractuel que j'ai évoqué. Une réforme de la prime pour l'emploi permettrait-elle d'atteindre le même résultat ? Je ne le pense pas, car en cette matière, la bonne politique consiste à supprimer les seuils et non à les déplacer, et je ne crois pas que l'on y parviendra avec la seule prime pour l'emploi. Voilà pourquoi il faut mettre au point quelque chose de plus ambitieux. J'en viens à votre deuxième question, relative au service public d'accueil des jeunes enfants. Le diagnostic de l'insuffisance des modes de garde est incontesté. Après mûre réflexion, nous avons proposé de créer un service public, car l'organisation actuelle est très disparate et personne ne se sent responsable ; il faut un chef de file. Il faut, aussi, augmenter l'offre de garde car elle est faible, peu accessible aux familles modestes, et ainsi conçue qu'un cercle vicieux se forme : son insuffisance fait qu'elle est réservée en priorité aux parents qui ont du travail, ceux qui en cherchent rencontrant des difficultés insurmontables pour garder leurs enfants, et donc pour trouver un emploi. Évidemment, une fois encore, un service public d'accueil des jeunes enfants coûte cher. Mais, dans ce cas aussi, il existe un clivage. On constate que l'allocation parentale d'éducation, qui coûte 2,7 milliards d'euros, a pour effet pervers d'éloigner durablement de l'emploi. Il faut donc la réformer, voire la supprimer. Là encore, certains y sont prêts, d'autres ne le veulent pas. Nous avons insisté sur la nécessité de privilégier une organisation structurée des modes de garde, plutôt qu'un système de gré à gré qui conduit à ce que des assistantes maternelles aient plusieurs employeurs. Mieux vaut sécuriser le dispositif par le biais d'un intermédiaire entre les familles et ceux qui sont disposés à garder les enfants. C'est par lui que le paiement de la garde devrait passer. Ainsi l'emploi sera-t-il structuré, ce qui n'empêchera pas que la souplesse puisse jouer. Notre commission a également évoqué la question du logement et celle de l'école, car on sait l'influence de la taille du logement sur les résultats scolaires. Mieux vaut, à notre sens, lutter contre les discriminations négatives plutôt que mettre en place des discriminations positives. Il n'est pas admissible que des inégalités en matière de santé, notamment pour ce qui est de la vue ou de l'état de la dentition, soient déjà repérables dans la tranche des 3 à 10 ans, enfants pour lesquels joue aussi la qualité de la nutrition. En conclusion, il est très frappant de constater que les politiques publiques sont chères, mais que loin d'éliminer les inégalités sociales, qui s'installent dès le très bas âge, elles les pérennisent. M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé très complet sur les problèmes politiques a M. Patrick Delnatte : Dans la pauvreté qui touche des familles avec enfants, quelle est la situation des immigrés ? Mme Marie-Françoise Clergeau : J'aimerais quelques précisions sur le service public d'accueil des jeunes enfants que vous proposez. D'autre part, avez-vous réfléchi à des pistes permettant de faire sortir les familles monoparentales de la pauvreté ? Mme la Rapporteure : J'allais vous poser la même question. Nous avons constaté que la Grande-Bretagne privilégie le retour à l'emploi des parents seuls, et vous évoquez dans votre rapport les familles monoparentales et les familles nombreuses. Recommandez-vous un traitement particulier pour les femmes seules ? Doivent-elles, selon vous, en rester au temps partiel ? M. Martin Hirsch : Parmi les familles pauvres, les familles monoparentales sont surreprésentées et, lorsque notre commission a été installée, tout le monde s'attendait à ce que nous proposions des solutions spécifiques pour elles. En préférant une approche globale, qui vaut pour tous les types de famille, dont les familles monoparentales, nous n'avons pas choisi d'amplifier le traitement spécifique réservé à celles-ci, pour préférer une combinaison des revenus du travail, des prestations sociales et des modes de garde, c'est-à-dire une politique générale avec un impact plus marqué par les familles monoparentales. Ainsi évite-t-on la stigmatisation. Le revenu de solidarité active que nous proposons n'est pas une mesure fléchée vers les familles monoparentales, mais il aura une forte incidence pour elles, tout comme aurait une forte incidence le renforcement du service public d'accueil des jeunes enfants. Quant à l'impact de l'immigration, il doit être appréhendé dans deux dimensions. De manière générale, être d'origine immigrée peut constituer un facteur de pauvreté, et les familles immigrées en situation régulière sont surreprésentées parmi les familles pauvres. D'autre part, on trouve dans les familles à la rue beaucoup d'étrangers en errance, pour lesquels il y a des obstacles administratifs à l'emploi et au logement, en plus des obstacles économiques. Plus largement, nous avons intitulé l'un des chapitres du rapport « Appréhender la pauvreté sans frontières », parce que nous sommes convaincus que l'on ne vaincra pas durablement la pauvreté dans les pays riches aussi longtemps qu'elle perdurera dans les pays pauvres. Autrement dit, quand la pauvreté diminue en Chine, en Inde ou en Afrique, c'est une bonne nouvelle pour le combat contre la pauvreté en France. Pour éviter que les établissements d'accueil d'urgence soient, comme c'est le cas actuellement, engorgés par les demandeurs d'asile en attente que l'on décide de leur sort, nous proposons que ces derniers soient de nouveau autorisés à travailler. Ce n'est pas une position franchement gauchiste : elle reprend les conclusions de rapports de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale de l'administration. De fait, par crainte d'un « appel d'air » virtuel, la circulaire Rocard de 1991 a eu cet effet pervers de faire vivre des familles dans une misère bien réelle, confinées dans des centres d'accueil saturés et dans des hôtels, les demandeurs d'asile étant contraints de travailler au noir pour des raisons administratives. Tout cela va nous exploser à la figure. M. Pierre-Christophe Baguet : Avez-vous étudié la question de la maltraitance dans les familles pauvres ? M. Martin Hirsch : Non. M. Pierre-Louis Fagniez : J'ai beaucoup entendu parler de votre rapport, que je regrette de ne pas encore avoir lu, et j'ai été frappé par la très belle phrase qui l'ouvre : « Au possible nous sommes tenus ». M. Martin Hirsch : Nous la devons à Etienne Grass, l'un de nos brillants rapporteurs. M. Pierre-Louis Fagniez : Elle résume bien ce que vous nous avez dit. Il est vrai que nous, les politiques, sommes tenus au possible. Pour ma part, je suis membre du conseil général du Val-de-Marne et député de Créteil, ville qui compte un peu de riches, un peu de pauvres, un peu de classes moyennes. Mais, dans la rue piétonne de Créteil, une dizaine de personnes créent le spectacle de la pauvreté et un problème social considérable. Certains disent que la faute en revient au maire, et je m'interroge moi-même sur ce que je pourrais faire. À supposer que vous soyez premier ministre, quels objectifs réalistes inciteriez-vous le conseiller général de base que je suis à viser ? Mme la Rapporteure : Le graphique qui, dans votre rapport, décrit les courbes conjointes de la pauvreté et des dépenses sociales est impressionnant, car il donne à penser que la France a un ratio assez important de dépenses sociales inefficaces. M. le Président : S'agissant de la création, dans des délais assez brefs, de places supplémentaires pour l'accueil des jeunes enfants, on ne peut ignorer le contentieux politico-administratif sur le point de savoir qui fait quoi, de l'État ou des collectivités territoriales, dans la zone grise qui s'étend entre le temps de la crèche et celui de l'école maternelle, car les conséquences financières ne sont pas les mêmes pour les deux parties selon la solution retenue. Le problème a-t-il été abordé par votre commission où siégeaient des élus locaux ? M. Martin Hirsch : Nous ne sommes pas allés jusque là, faute de temps mais aussi faute de combattants, car nous avons eu de mal à impliquer l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France dans nos travaux. Mais le problème auquel vous venez de faire allusion existe dans de nombreux domaines, et nous avons été frappés aussi bien par la complexité des procédures que par le renvoi de balle permanent. Lorsque je suis allé présenter le rapport au congrès de l'Assemblée des départements de France, qui avait organisé une table ronde sur l'insertion, on a parlé deux minutes quatorze secondes des familles en difficulté, et une heure et demie de la bataille entre les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les conseils généraux... C'était caricatural. Cette situation ne peut pas durer. Nous sommes au milieu du gué, car dans le secteur social, chacun a des compétences, mais aussi le moyen de bloquer l'autre. Le sort des familles pauvres concerne l'État, l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), l'UNEDIC, les CAF, les conseils généraux, les CCAS, la région, éventuellement les fonds européens... Cette multiplicité de guichets n'est plus admissible, ni pour les familles ni pour les travailleurs sociaux. Il ne s'agit pas de remettre à plat l'ensemble des compétences, mais de faire que chacun puisse travailler pour le compte des autres et, pour cela, il faut simplifier les prestations servies. Le revenu de solidarité active est une étape vers une prestation combinée et à la carte qui permettra ensuite de contractualiser avec les familles de manière satisfaisante. Au lieu que chaque instance soit en concurrence avec les autres, il faut faire jouer la théorie du mélangeur : un interlocuteur unique polyvalent verse une prestation globale et l'on facture ensuite à chaque entité ce qu'il lui revient d'assumer. Au conseiller général, que dire ? Ne pourrait-il y avoir un lieu d'expérimentation ? Nous ne prétendons pas détenir la vérité, mais on peut imaginer que certains départements expérimentent en mettant au point des projets consistants et en demandant à l'État de jouer le jeu. On pourrait alors mutualiser les moyens du conseil général, des communes qui ont un CCAS, de la CAF et de l'ANPE au service d'un projet commun, celui, par exemple, de faire sortir de la pauvreté 20 % des familles qui y vivent. Il reviendrait alors à l'État de déléguer les crédits nécessaires sans qu'il faille au préalable mettre les gens dans des cases - les moins de 26 ans, les plus de 26 ans, ceux qui sont au RMI depuis plus d'un an, au chômage depuis plus de deux ans... Les pouvoirs publics gagneraient parfois à s'inspirer du pragmatisme des associations. Il est délirant que, faute de statistiques au niveau départemental, un président de conseil général ne puisse savoir combien d'enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté dans son département. Dans de telles conditions, comment se fixer des objectifs ? Comment évaluer les améliorations, et donc l'efficacité des politiques suivies ? M. Patrick Delnatte : L'Observatoire national de l'action sociale décentralisée y travaille. M. Pierre-Louis Fagniez : Et que faire à propos des personnes qui cristallisent les problèmes sociaux dans un canton ? M. Martin Hirsch : Je n'ai pas de vérité toute faite et je me trouve aussi démuni que vous devant des cas apparemment insolubles, mais je sais d'expérience que peu de gens ne sont véritablement pas employables. En prenant le temps, on peut faire bouger toute une partie de la population. M. le Président : Je vous remercie. Audition de M. Philippe Bas, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le Ministre, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, notre Mission, dont le Président de l'Assemblée nationale a souhaité la création, arrive au terme de la première partie de ses travaux, consacrés à la protection de l'enfance. Nous avons entendu des personnes venant d'horizons professionnels différents : élus nationaux et locaux, médecins, responsables administratifs, dirigeants d'association, universitaires. Il ressort de ces auditions et des deux tables rondes que nous avons réunies que notre dispositif a besoin d'être plus efficace, et nous souhaiterions donc examiner avec vous les pistes d'amélioration possibles, notamment sur deux points qui concernent directement votre ministère : la détection des enfants en danger et les modalités de leur prise en charge. M. Philippe Bas : Je suis heureux de cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui de pouvoir répondre à vos questions, sur un sujet sensible, qui nous concerne tous. J'attends les propositions de votre Mission avec beaucoup d'intérêt, et suis à sa disposition pour aborder avec elle d'autres thèmes. Parce qu'ils sont vulnérables dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur corps, nos enfants doivent être protégés du monde des adultes. La violence infligée aux mineurs, qu'elle soit sexuelle, physique ou psychologique, est pour notre société une défiguration. Elle brise l'éveil des plus jeunes, elle compromet leur vie d'adulte en devenir. Sans cesse alimenté par l'actualité, ce thème figure au cœur de nos priorités. Je porte cette priorité au nom de l'ensemble des parents qui vivent dans notre pays. Je la porte aussi pour les 300 000 enfants qui bénéficient aujourd'hui d'une mesure de protection administrative ou judiciaire. Deux groupes de travail ont été constitués en novembre 2004. Leurs présidents, les sénateurs Philippe Nogrix et Louis de Broissia, se sont respectivement engagés à travailler sur l'amélioration des procédures de signalement de l'enfance en danger et sur la prise en charge des mineurs protégés. Je recevrai tout prochainement leurs rapports. D'ores et déjà, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de leurs propositions. Elles offrent un point de départ solide pour notre action. Dans le domaine de la protection de l'enfance, la prévention est essentielle. Elle permet que des drames soient évités, par une meilleure coordination de tous les acteurs et par des réflexes d'alerte plus précoces. C'est le premier mode d'action que je veux renforcer dans les prochains mois. Permettez-moi d'en énumérer rapidement les outils. L'entretien du quatrième mois de grossesse est un moment privilégié pour repérer les difficultés des femmes et des couples. Il faut évidemment saisir l'opportunité qu'il représente. C'est le sens de la nécessité de renforcer la formation des professionnels de santé qui mènent ces entretiens, et plus généralement de l'ensemble des professionnels de l'enfance. Elle doit leur donner des clés de compréhension pour repérer, en toutes circonstances, les difficultés des familles et prévenir ainsi les risques de violence. Des référentiels permettant de dépister les mères à risque ont été mis en place, à titre expérimental, dans certains départements. L'entretien du quatrième mois pourrait être complété par l'action des sages-femmes qui viennent consulter à domicile, après la naissance, et soutiennent la formation des liens parents-enfants. C'est aussi le sens de l'information qui doit être régulièrement offerte aux professionnels. Un guide intitulé Le praticien face aux violences sexuelles a été édité. Rédigé par une équipe d'experts pluridisciplinaires, il propose un protocole de prise en charge qui favorise la reconstruction de l'identité de l'enfant victime de telles violences. La prévention et le signalement des situations à risque passent aussi par le partage des informations, actuellement insuffisant. Devant une situation familiale préoccupante, chaque professionnel peut disposer d'informations, mais il les garde trop souvent pour lui, sans les transmettre à ceux qui pourraient intervenir utilement. Il faut donc susciter des échanges interdisciplinaires et inter-institutionnels. Dans ce domaine, nous devons faire face à un vide juridique, celui du « secret partagé ». Il est donc nécessaire de définir un cadre formalisé qui précise le sens des responsabilités de chacun. L'exemple du partage du secret médical, clarifié par la loi du 17 janvier 2002, montre que l'on peut aller plus loin. Un médecin peut désormais révéler des faits de violences physiques, psychiques ou sexuelles de toutes natures, sans encourir de sanctions. Mais on s'aperçoit que, sur le terrain, des progrès sont encore possibles pour favoriser le partage de l'information. Dernier axe d'action dans ce volet préventif : le suivi des mesures de détection. Les caisses d'allocations familiales (CAF) n'ont pas d'attributions reconnues dans le champ de la protection de l'enfance. Il est, à mes yeux, important d'améliorer la transmission des informations entre les départements. La transmission du volet CAF relatif aux certificats médicaux, qui ponctuent la vie du nourrisson et du petit enfant - à 8 jours, 9 mois et 24 mois -, pourrait constituer un moyen de suivi. Or on constate que le deuxième n'est pas exploité, et que le troisième n'est généralement pas rempli. Nous avons donc décidé de rationaliser cette procédure devenue obsolète. Un groupe de travail formé autour de la direction générale de la santé, de la direction de la sécurité sociale, des caisses d'allocations familiales et des services de protection maternelle et infantile s'est réuni à ce sujet. Il a jugé plus pertinent que les services de la protection maternelle et infantile soient les destinataires d'informations ciblées, afin de mettre en place un suivi médical efficace. Participent de cette même démarche les vingt visites médicales obligatoires prévues par le code de la santé publique entre zéro et six ans. Il s'agit d'accompagner les parents à travers un partenariat entre les acteurs de santé, les acteurs sociaux et les acteurs éducatifs. Le nouveau carnet de santé, actuellement en cours de réalisation, offrira aux parents un outil supplémentaire de dialogue et de suivi pour le bien-être de leurs enfants. Il sera disponible dès le 1er janvier 2006. Au-delà de la prévention, il nous faut veiller à une prise en charge plus efficace des enfants en danger. De nombreux acteurs interviennent dans ce domaine délicat, et leurs actions doivent être mieux articulées. La part des enfants confiés à l'aide sociale sur décision judiciaire atteignait les trois quarts en 2003, celle des enfants séparés de leur famille sur décision administrative, en accord ou à la demande des parents représentant le quart restant. Il en va de même des actions éducatives à domicile : les trois quarts d'entre elles sont exercées en vertu d'un mandat judiciaire. Les travaux du groupe de travail présidé par le sénateur Louis de Broissia ont mis en évidence le caractère discontinu des critères d'intervention, selon la voie de recours mise en œuvre, administrative ou judiciaire. Des formulations différentes sont en outre utilisées dans le code de l'action sociale et dans le code civil. Seul le domaine de l'enfance maltraitée - qui ne constitue qu'une partie de l'enfance en danger - bénéficie de critères d'intervention judiciaire clairement définis par le législateur dans la loi du 10 juillet 1989. C'est un sujet très important, et je suis ouvert à la réflexion sur les moyens d'améliorer cette situation. D'autre part, les modes de prise en charge doivent être diversifiés et améliorés. Les prestations classiques définies dans le code de l'action sociale et des familles répondent à une logique binaire : il s'agit d'une action éducative à domicile ou d'un hébergement à temps complet. Or il existe des formules intermédiaires plus souples, plus évolutives, mieux adaptées aux besoins spécifiques de l'enfant. Certains départements ont ainsi mis en place des prises en charges innovantes, comme l'accueil séquentiel ou l'accueil de jour. Celui-ci offre un soutien éducatif sans hébergement : c'est un service de proximité, qui permet d'accueillir l'enfant hors des périodes scolaires. L'idée de l'inscrire comme prestation nouvelle d'aide sociale à l'enfance me paraît judicieuse. Mais la prise en charge n'est pas une fin en soi. Il faut aussi préparer le retour éventuel de l'enfant dans sa famille d'origine. C'est le sens de l'accompagnement des parents : les aider à recouvrer leurs fonctions parentales, c'est offrir aux enfants un nouvel espace d'épanouissement, c'est leur donner une chance de retrouver leurs racines dans un milieu apaisé et serein. Bien sûr, ce retour ne peut avoir lieu qu'au terme d'une évaluation de la situation familiale et requiert l'avis de professionnels formés à cette procédure. Il arrive cependant que le retour soit inenvisageable. Il faut alors trouver la solution la plus appropriée à la situation de l'enfant. Le Sénat a adopté hier la proposition de loi relative à l'adoption, et j'ai été frappé, au cours du débat, par le nombre des pupilles reconnus en France et en Grande-Bretagne : 1 700 et 5 000 respectivement. Un tel écart laisse supposer que nos procédures ne permettent pas de rendre adoptables assez tôt les enfants délaissés définitivement par leurs familles. Nous devons défendre une exigence de continuité de l'accueil des enfants. Cette cohérence est essentielle à leur équilibre psychologique, elle offre un point d'ancrage à ceux qui, trop souvent, n'ont plus de repères, et atténue leur mal-être. C'est le sens du projet de loi sur les assistants maternels et familiaux. Accorder un agrément à des personnes diplômées et revaloriser leur métier contribue à assurer la continuité de l'accueil pour ces enfants. La continuité de l'accueil doit s'appliquer aussi aux pouponnières à caractère social, où les enfants sont majoritairement accueillis sur décision de justice. Il faut du temps pour leur porter secours. La durée du séjour doit donc être fixée au cas par cas, pour permettre à l'enfant de se reconstruire physiquement et psychiquement à travers une relation affective stable avec la personne qui prend soin de lui au quotidien, de tenter de renouer une relation plus sereine avec ses parents, ou de se préparer à entrer dans une famille d'adoption ou d'accueil. Aussi est-il inopportun de fixer une durée de séjour maximale. Je voudrais terminer cet exposé en soulignant la nécessité de disposer de meilleurs outils statistiques et épidémiologiques. MM. Nogrix et de Broissia recommandent d'élaborer des indicateurs d'évaluation individuelle et familiale, validés par des conférences de consensus. Ces indicateurs fourniraient une aide appréciable aux professionnels dans leur prise de décision. Je veux aussi réfléchir à la formulation de normes sur le modèle de celles qui régissent les services de la protection maternelle et infantile. Je pense que cela répond à une vraie attente des professionnels. M. le Président : Je vous remercie d'avoir abordé de façon très précise les sujets qui nous préoccupent, au point de nous donner l'impression d'avoir participé à nos travaux depuis le début... M. Pierre-Christophe Baguet : Les auditions se suivent et ne se ressemblent pas... M. le Président : Je donne maintenant la parole à mes collègues, Monsieur le Ministre, pour qu'ils vous posent leurs questions. M. Pierre-Christophe Baguet : Vous avez évoqué le nouveau carnet de santé qui doit être mis en place au 1er janvier prochain. Qui réfléchit à son élaboration, et dans quel cadre ? Les associations familiales y seront-elles associées ? Il ne serait pas mauvais que des mères de famille « de base », souvent pleines de bon sens, donnent leur avis. M. Philippe Bas : Il est vrai qu'il serait utile de les consulter afin que le document soit le plus clair possible. Le carnet de santé des enfants est déjà l'un des plus grands succès de notre politique de prévention, et un outil très précieux, à la différence de celui des adultes, très vite relégué au fond d'un tiroir de la commode... Il faut cependant poursuivre encore son amélioration, et c'est pourquoi un groupe de travail a été constitué autour de la direction générale de la santé. Je retiens la suggestion de recueillir le sentiment des associations familiales sur le document avant que celui-ci soit diffusé, afin de le rendre aussi maniable et facile d'accès que possible. M. Patrick Delnatte : Vous avez ouvert des pistes sur le secret partagé, qui pose des problèmes délicats. Doit-on, selon vous, établir un recueil de données accessibles à certains professionnels, ou se contenter d'un échange d'informations dans le cadre d'une structure organisée réunissant différents intervenants dans le domaine de l'enfance en danger ? M. Philippe Bas : Dans la mesure où les droits des personnes sont en cause, il faut faire preuve de beaucoup de discernement, et toute dérogation au principe du secret doit être justifiée par son utilité. Il y a un intérêt majeur au partage de l'information, mais il ne faut pas que celle-ci soit diffusée au-delà de cette utilité particulière. Je souhaite donc qu'on définisse les procédures strictement, afin de permettre à ceux qui sont en situation de prévenir les maltraitances de le faire. Mme Martine Aurillac : Votre réponse me laisse un peu sur ma faim, mais je reconnais que la question est difficile. S'agissant d'autre part des mineurs étrangers isolés, ceux qui ne sont pas pris en charge avant seize ans ne peuvent accéder à une formation professionnelle digne de ce nom, faute d'un droit de séjour régulier. Êtes-vous prêt à faire sauter ce verrou ? M. Philippe Bas : Je voudrais, si vous le permettez, compléter ma réponse à la question précédente. Le sujet est en effet complexe et appelle une réflexion plus approfondie, c'est pourquoi je n'ai pas été plus précis. Il est nécessaire de réunir un groupe de travail, peut-être dans le cadre du groupe permanent interministériel sur l'enfance maltraitée, créé par le décret de 1997. Je souhaite être saisi de propositions très précises, que j'examinerai sans a priori. Quant aux mineurs étrangers isolés, c'est l'une des questions les plus difficiles qui soient. Nous nous trouvons face à une situation de fait - la présence de mineurs en situation irrégulière sur le territoire national - et nous nous demandons comment améliorer leur sort sur le plan social et professionnel. Une réflexion est en cours pour leur donner accès à l'apprentissage, mais cela suppose, dans la mesure où il s'agit d'un contrat de travail, que leur situation soit régulière. Nous sommes donc dans un cercle vicieux dont il est difficile de sortir, car un employeur qui accepterait de signer un contrat d'apprentissage ne pourrait le faire avec quelqu'un en situation illégale. Je comprends donc qu'on cherche à répondre, dans l'intérêt des enfants concernés, à cette difficulté concrète, mais il faut aussi intégrer à notre réflexion le souci de ne pas susciter de nouveaux flux d'immigration irrégulière. Il s'agirait certes d'une voie d'accès très limitée, mais beaucoup de gens, dans les pays d'origine, sont à l'affût de telles possibilités. Avant de prendre des mesures entièrement dérogatoires, il nous faut bien mesurer l'incitation possible à l'immigration clandestine. Je ne peux donc vous répondre qu'une seule chose : la réflexion se poursuit, et la conclusion n'est pas évidente. M. le Président : Nous en sommes conscients, mais il faut essayer de trouver un bon équilibre. M. Patrick Delnatte : Les conseils généraux se plaignent, car ce sont eux qui doivent prendre en charge ces mineurs. La solution ne résiderait-elle pas dans un système spécifique, qui éviterait de les mettre dans le droit commun des enfants placés en foyer ? M. Philippe Bas : Si j'ai bien compris, les enfants arrivés seuls avant l'âge de seize ans sont pris en charge et ont accès à l'apprentissage, mais ceux qui sont arrivés après seize ans n'ont pas cette possibilité. Faut-il déplacer le curseur ? Je mets simplement en garde contre des dérives possibles. Mme la Rapporteure : Vous avez parlé de redonner consistance aux examens médicaux obligatoires. Envisagez-vous des sanctions en cas de non-respect de l'obligation de produire un certificat médical ? S'agissant des pouponnières, la Mission s'interroge sur leur éventuelle suppression, à l'instar de ce qu'ont fait d'autres pays, au bénéfice du placement dans des familles d'accueil. Les pédopsychiatres considèrent en effet que l'enfant ne peut pas se reconstruire en pouponnière, le trop grand nombre d'intervenants ne lui permettant pas de nouer de liens affectifs. Certains proposent un compromis, une sorte de cote mal taillée, qui consisterait à limiter à six mois la durée du séjour en pouponnière. C'est une des questions qui ont cristallisé l'attention de la Mission. Par ailleurs, la Défenseure des enfants a fait un rapport assez sévère sur l'inégale qualité de l'action des conseils généraux, et déplore de ne pouvoir diligenter d'enquêtes sur le fonctionnement des structures de protection de l'enfance. Seriez-vous d'avis de lui permettre de saisir l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) dès lors qu'elle aurait reçu des plaintes ? Enfin, vous nous dites que les trois quarts des mesures éducatives sont prononcés par les juges. Ne pourrait-on, afin que ceux-ci prennent les mesures les plus adéquates en toute connaissance de cause, centraliser les signalements au niveau des départements ? Nous n'avons de statistiques sur les délais de jugement des juges pour enfants qu'au pénal, qui montrent que les affaires sont jugées dans un délai moyen de 15 mois, soit une durée qui n'est pas satisfaisante. M. Philippe Bas : Comment faire respecter par les parents l'obligation de faire examiner régulièrement leurs enfants ? Pour ma part, je ne suis pas partisan de sanctions financières, qui seraient contre-productives et socialement pénalisantes pour les familles les plus en difficulté. M. le Président : Très bien ! M. Philippe Bas : L'approche de ces sujets complexes suppose, de la part des médecins, beaucoup de pédagogie, de temps consacré aux familles, lesquelles sont souvent de bonne volonté, pour les amener, à partir du premier entretien, à entrer volontairement dans un processus qui sera de ce fait plus efficace. Je ne crois pas à la coercition en la matière. Les familles qui, actuellement, sont à l'écart du dispositif resteront à l'écart s'il est rendu coercitif. Mme la Rapporteure : Pour tout vous dire, nous avons imaginé que les caisses d'allocations familiales puissent envoyer des travailleurs sociaux dans les familles qui n'auraient pas produit de certificats. Mais les caisses ne sont pas d'accord, notamment pour une question de moyens... M. Philippe Bas : Votre question rejoint celle de la convention d'objectifs et de moyens (COG) de la Caisse nationale des allocations familiales, sur laquelle je me penche en ce moment... La COG qui s'est achevée au 31 décembre 2004 a permis de mettre en œuvre les plans petite enfance, avec des dépenses en progression de 10 % par an en moyenne. Cet effort très substantiel va devoir se poursuivre, puisque 57 000 places de crèche ont été programmées sur la période 2002-2007, auxquelles s'ajoutent les 15 000 places annoncées par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. La COG en cours de négociation doit impérativement permettre de tenir tous les engagements pris. Les moyens destinés aux autres missions des CAF font également partie de la négociation, mais dans un cadre financier dont chacun doit mesurer à quel point il est contraint : la commission des comptes de la sécurité sociale vient en effet de mettre en évidence, pour la première fois, un déficit important de la branche famille, lié notamment au succès de la prestation d'accueil du jeune enfant, qui sera servie à 250 000 familles en 2007 au lieu des 200 000 attendues, mais aussi à la croissance des prestations versées sous condition de ressources, dans une conjoncture économique qui affecte négativement l'évolution de la masse salariale. Nous sommes à l'œuvre sur ce dossier, avec un impératif absolu : respecter les engagements pris en matière de petite enfance. M. Pierre-Christophe Baguet : S'il est contre-indiqué de priver les parents de toute aide financière, un gel provisoire des prestations familiales en cas d'absence de visite médicale n'aurait-il pas un effet incitatif ? M. Philippe Bas : Si vous voulez une réponse claire, non. Je réponds maintenant à la question sur les pouponnières. La continuité du lien affectif est évidemment essentielle, et les familles d'accueil jouent très bien ce rôle que la loi sur les assistants maternels et familiaux va encore renforcer. Pour autant, peut-on dire que les pouponnières n'ont pas leur place ? Je ne dirais pas cela, car elles sont justement là pour assurer une forme de continuité, mais il est vrai que le turnover doit y être surveillé de très près. Je souligne cependant qu'il y a, dans les pouponnières, des personnes référentes qui garantissent la permanence du lien avec l'enfant. J'ai lu le rapport de Mme Brisset sur le contrôle et l'évaluation de l'action des conseils généraux. Il faut bien distinguer deux choses : l'existence et l'efficacité des contrôles, d'une part ; le rôle institutionnel de la Défenseure des enfants, d'autre part. Ce rôle n'est pas de conduire et de diligenter des enquêtes : celles-ci le sont sous la responsabilité de l'État, auquel l'article L. 221-9 du code de l'action sociale et des familles confie une mission explicite de contrôle, assurée par l'IGAS. Cette dernière a d'ailleurs engagé, depuis 1999, un programme de contrôles, à raison de deux départements par an, auxquels s'ajoutent des contrôles ponctuels en tant que de besoin. Enfin, je suis ouvert à une réflexion sur la question de la centralisation des informations sur les mesures préventives, notamment dans les cas où des enfants sont déplacés d'un département à un autre. M. le Président : S'agissant des processus de détection, nous nous interrogeons sur l'idée d'étendre la compétence de la PMI jusqu'à la fin de l'école primaire, afin de rendre son action plus efficace. Qu'en pensez-vous ? D'autre part, vous avez abordé très franchement la question du partage des informations, et constaté l'existence d'un vide juridique. J'ai cru en déduire que vous étiez ouvert à l'idée de légiférer. Si tel est bien le cas, peut-on aller jusqu'à se passer, dans l'intérêt même des enfants, de l'accord préalable des familles ? Quelle est enfin, dans la perspective de la conférence annuelle de la famille M. Philippe Bas : L'extension de la compétence de la PMI jusqu'à la fin de l'école élémentaire aurait évidemment l'intérêt d'assurer la continuité de la prise en charge d'enfants qui, passé six ans, ne sont plus suivis sous prétexte qu'ils ont franchi un certain cap. Ma réponse, cependant, ne saurait vous surprendre : cela demanderait des moyens nouveaux, sans doute assez importants... Quant à transmettre des informations relevant du secret professionnel sur la situation de l'enfant sans l'accord de la famille, nous sommes là au cœur du dilemme. Il faudra bien prévoir des exceptions à la règle normale, mais dans le souci de préserver les droits des enfants. Vous me pardonnerez de me garder de trancher aujourd'hui une question aussi délicate, qui requiert une réflexion préalable de la Chancellerie, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du législateur lui-même afin de trouver le point d'équilibre, ce qui exigera sans doute bien des tâtonnements. Il serait vain de parler de partage de l'information si l'on ne pouvait pas, dans certains cas, lever les obstacles de principe. Les dérogations devront naturellement être circonscrites, mais il faudra bien en prévoir ; reste à les définir. Mme la Rapporteure : Nous sommes très heureux de vous entendre tenir ce discours, car le garde des Sceaux, hier, s'est montré très réticent. Lorsqu'il s'agit de mineurs délinquants, on n'a pourtant guère de réticence à partager l'information, quitte à faire moins de cas des libertés publiques au motif que l'ordre public est en cause. Mais lorsqu'il s'agit d'intervenir en amont pour protéger ces mineurs, il n'en est plus question. Il y a là une certaine forme de schizophrénie... M. Philippe Bas : Pour répondre à la dernière question du président, si je partage beaucoup des ambitions portées par le rapport de mon ami Martin Hirsch, je suis très réservé sur certaines des solutions qu'il préconise, en particulier sur la recombinaison d'un certain nombre de prestations et d'allocations très utiles aux familles, et dont le rôle d'amortisseur social explique une partie du surcroît de dépenses de la branche famille. La fiscalisation des allocations familiales, la remise en cause de la prime pour l'emploi dans le cadre d'un dispositif plus global, la remise en cause de l'allocation parentale d'éducation appellent des réserves de ma part et de la part du mouvement familial. Le débat est ouvert, pour autant, sur ce rapport qui est à la fois utile et d'actualité. Dans le cadre de la préparation de la conférence de la famille, qui se tiendra début septembre, la situation des familles vulnérables a fait l'objet de rapports particuliers : celui de M. Didier pour le Conseil économique et social et celui de M. Hubert Brin. La réflexion se poursuit donc. M. le Président : Je vous remercie de cet échange rendu tout à fait passionnant par la qualité de votre intervention et de vos réponses, sur des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations. Table ronde ouverte à la presse sur la réforme du droit de la famille réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous accueillons pour cette table ronde consacrée à la réforme du droit de la famille quatre intervenants : Mme Irène Carbonnier, conseillère nationale pour les questions juridiques des Associations familiales protestantes ; M. Jean-Marie Bonnemayre, président du Conseil national des associations familiales laïques ; M. François Édouard, secrétaire général de la Confédération syndicale des familles, et M. Bernard Teper, président de l'Union des familles laïques. Je leur souhaite à tous la bienvenue. Trois autres associations familiales avaient été invitées à cette table ronde, à savoir Familles rurales, Familles de France et la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Les présidents de ces associations m'ont fait savoir hier, par une lettre dont la copie a été adressée à tous les membres de la Mission d'information, qu'ils étaient au regret de ne pouvoir répondre à l'invitation qui leur était faite. Nous ne pouvons que déplorer l'absence de ces trois associations, d'autant que deux d'entre elles nous avaient fait connaître, dès le 15 juin, leur intention de participer à notre table ronde. Notre Mission a organisé au cours des dernières semaines une série d'auditions et de tables rondes sur la protection de l'enfance. Elle vient d'adopter à l'unanimité une note d'étape dans laquelle elle formule cinquante-deux propositions. Nous abordons maintenant la réforme du droit civil de la famille, afin d'examiner la manière dont notre législation pourrait répondre aux évolutions de la famille. Dans cet esprit, il est naturel que nous commencions par recueillir le point de vue du mouvement familial et ses préconisations sur ces questions. M. Bernard Teper : Je voudrais tout d'abord souligner à quel point l'organisation de cette table ronde me semble utile. Je le dis d'autant plus que ce type de démarche n'est pas chose fréquente. L'Union des familles laïques (UFAL) estime avant tout qu'il est important de réviser les dispositions régissant les associations familiales, inchangées depuis la loi du 11 juillet 1975. Depuis cette date, des évolutions de la famille et du droit de la famille sont intervenues. Le PACS a été instauré. Les naissances hors mariage ont connu une forte augmentation et concernent plus d'un enfant sur deux dans la région parisienne. La loi de 1975, qui est à nos yeux le texte de référence en matière de droit de la famille, mériterait d'être mise à jour, notamment en ce qui concerne la définition de la famille. Il n'est plus possible de considérer que le couple marié, avec ou sans enfant, et la famille monoparentale sont les seuls types de famille reconnues. La deuxième proposition que nous faisons est de s'appuyer sur l'article 515-8 du code civil, qui porte reconnaissance légale du concubinage, pour ouvrir la voie à une augmentation des droits des couples concubins. Je parle de ceux qui ne sont pas pacsés, c'est-à-dire la grande majorité d'entre eux. Notre troisième proposition est la reconnaissance légale du beau-parent. Nous avons recueilli plusieurs témoignages montrant à quel point elle serait utile. Un exemple récent, parmi bien d'autres : un enfant handicapé est élevé par sa mère biologique et par son beau-père. Celui-ci, qui n'a pas d'enfant, veut adopter l'enfant handicapé pour faciliter sa succession. Il se heurte à toute une série de difficultés liées au fait que cette adoption nécessite un changement de l'état civil de l'enfant. Ce changement d'état civil pose problème, parce que le père biologique existe. La constitution d'un groupe de travail pourrait opportunément faire avancer la réflexion sur la reconnaissance légale du beau-parent, pour examiner aussi bien les problèmes liés à l'autorité parentale que ceux ayant trait à la succession. Quatrièmement, s'agissant de l'accouchement sous X, nous estimons que la dernière loi s'arrête au milieu du gué. Elle a le mérite de prévoir la conservation du dossier. Mais, en nous plaçant du point de vue de l'enfant, nous pensons que deux conditions doivent être remplies pour qu'un enfant vive bien : la première est d'être aimé par ceux qui l'élèvent ; la seconde est de connaître ses origines. Il est extrêmement traumatisant pour un enfant de ne pas savoir d'où il vient. Nous proposons, tout en maintenant le droit d'accoucher sous X qui protège la mère, de donner à l'enfant le droit d'accéder à son dossier dès sa majorité. Un ou deux ans avant la majorité de l'enfant, nous souhaitons que le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui conserve le dossier avertisse la mère biologique de la possibilité donnée à son enfant d'y accéder. Cinquièmement, nous avons toujours demandé la suppression du divorce pour faute et son remplacement par un divorce pour cause objective. Au vu des statistiques, soit on considère que la grande majorité de nos concitoyens commettent énormément de fautes, soit on considère que le divorce est souvent la moins mauvaise des solutions et que caractériser la faute n'est pas souhaitable. Le Parlement a récemment diminué le nombre de cas de divorces pour faute. Il doit aller plus loin. Sixième point : les mariages forcés. Leur nombre est extrêmement important. Il faut prendre des mesures contre ces mariages, qu'ils soient réalisés sur notre territoire ou dans un pays étranger, à la suite d'un enlèvement. Il nous semble nécessaire de constituer un groupe de travail en vue d'étudier les dispositions législatives et les mesures diplomatiques qui permettraient de renforcer la lutte contre cette pratique. Récemment, une jeune fille a été enlevée, séquestrée et envoyée à l'étranger, et tout cela s'est fait extrêmement facilement. La représentation nationale se grandirait en ne fermant pas les yeux sur ce problème. Enfin, la manière dont la sécurité sociale traite la polygamie pose également problème. Il importe de mettre en adéquation la législation sociale avec les principes républicains qui sont les nôtres. Voilà les propositions de l'UFAL dont je souhaitais vous faire part. De manière plus générale, nous souhaitons une plus grande concertation avec la représentation nationale sur la définition de la famille et sur la politique familiale. À cet égard, cette table ronde initiera peut-être une autre façon de travailler. D'autre part, il serait bon d'avoir une vision globale du droit de la famille. Jusqu'ici, peut-être en raison de certaines crispations, on a « saucissonné » le débat sur la famille. Je cite souvent l'exemple de la loi de 1966 qui autorise l'adoption par un célibataire de plus de 28 ans, alors qu'on interdit l'adoption par des couples homosexuels. En vérité, seules deux positions sont cohérentes : abroger la loi de 1966 ou autoriser, sous certaines conditions, l'adoption par les couples homosexuels. Aujourd'hui, plusieurs milliers d'enfants sont élevés par des couples homosexuels. Ceux-ci ont donc le droit d'élever des enfants, mais pas d'en adopter. Voilà un exemple des contradictions que comporte notre droit civil et familial. Nous souhaiterions que s'ouvre un grand chantier visant à redonner de la cohérence à ce droit. Ce serait une bonne chose pour entrer de plain-pied dans le XXIème siècle. M. Jean-Marie Bonnemayre : Le Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL) estime qu'il est important de dialoguer sur le droit de la famille. C'est une matière délicate, où il est toujours possible de heurter certaines sensibilités ou mentalités. Il est important que la discussion progresse, précisément parce qu'il y a des contradictions dans l'application de la loi. Nous souhaitons d'abord nous situer sur le plan des principes moraux et philosophiques. Le fait familial est quasi universel, mais la notion de famille a considérablement varié au cours des époques et varie sous nos yeux, d'une manière continue depuis trente ans. L'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie nous enseignent que les formes familiales et les structures de la parenté sont diverses, à l'image de la diversité de la vie. Dans les années 1970, il était de bon ton de dire que la famille était en crise. C'était le modèle patriarcal qui s'effondrait. Aujourd'hui, nombre de spécialistes soulignent sa vitalité, sa plasticité, ses facultés d'adaptation face à un monde en mutation et à un environnement qui bouge en permanence. La famille est peut-être le facteur essentiel de l'adaptation de notre société au monde qui vient. C'est pourquoi le CNAFAL, depuis sa fondation en 1967, ne se reconnaît pas dans un type de famille standard et reconnaît toutes les formes familiales. La famille est le miroir de toutes les mutations : celles générées par les nouveaux comportements à travers le divorce, les familles monoparentales, les familles recomposées, les familles homoparentales, les familles adoptives ; celles générées à travers la maîtrise de la contraception et de la fécondation in vitro ; celles, enfin, qui sont induites par les échanges et la communication. Quelles que soient leurs formes, les familles regroupent un nombre variable d'enfants, d'adultes, de générations réunies par des liens d'alliance, de filiation, des liens affectifs, consentis ou pas, institutionnalisés ou pas. Quoi qu'il en soit, ces liens confèrent à tous les individus ainsi réunis des droits et des devoirs, des responsabilités mutuelles ou partagées. Enfin, pour continuer à tracer le cadre de notre réflexion ou du moins ses contours, il est indispensable de prendre en compte les évolutions et aspirations en cours depuis trente ans dans la vie des couples : la vérité des sentiments, liée à l'autonomisation de plus en plus prononcée des individus ; la quête du bonheur et de l'épanouissement personnel, qui fragilise la durée des unions en même temps qu'elle rend celles-ci plus exigeantes ; la dissociation de la procréation et de la sexualité ; la permanence du désir d'enfant comme accomplissement du couple et l'émergence du désir d'enfant chez les hommes, à ne pas confondre avec le désir de paternité ; l'ambivalence des attentes familiales entre la demande d'institutionnalisation des nouvelles formes parentales et ce qui peut être considéré, par certains, comme une intrusion insupportable dans la vie privée ; la dissociation émergente entre alliance et filiation ou entre les parents biologiques et les parents sociaux. Pour le CNAFAL, les fils conducteurs de la réforme du droit de la famille doivent partir de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Toute discrimination est génératrice, à terme, d'exclusion et de stigmatisation, y compris celles qui s'appuient sur l'orientation sexuelle, avérée ou supposée, d'un membre de la famille ou de la future famille. Avant de condamner telle ou telle forme de parentalité, il est nécessaire de prendre en compte l'intérêt de l'enfant, ainsi que le principe d'égalité de protection de tous les enfants, quel que soit le mode de constitution de leur famille. Soyons également attentifs au fait que ce sont la culture, l'éducation, la transmission des valeurs qui font l'homme, la femme et l'enfant. Il ne peut plus y avoir « un formatage par le biologique ». C'est peut-être là la grande leçon de ces cinquante dernières années. La réalité d'aujourd'hui exige que l'on considère l'ensemble des liens qui unissent les différents membres d'une famille. Les institutionnaliser, c'est leur attribuer une force symbolique, et donner à l'enfant un repère qui fait sens mais aussi qui évite stigmatisations et discriminations. Ces trois points sont à nos yeux un préalable à l'instauration d'une responsabilité fondée sur l'engagement et l'autorité parentale partagés. Ils impliquent bien sûr des modifications du droit de la famille, qu'il s'agisse du code civil, du code de l'action sociale et des familles ou des lois sur la bioéthique. Le CNAFAL a soutenu sans réserve, au cours des dernières années, tout ce qui allait dans le sens d'une laïcisation du droit de la famille, de la mise en adéquation du droit avec la réalité vécue. Il s'est en particulier félicité de la reconnaissance du concubinage dans le code civil, de l'instauration du PACS, de l'allocation de présence parentale, du congé de paternité, mais aussi de l'accès aux origines personnelles pour les enfants nés sous X, ou encore de l'extension du concept de coparentalité, de l'amélioration des droits du conjoint survivant et de la réforme du nom patronymique. Aujourd'hui, il est sans doute possible d'avancer dans un certain nombre de domaines et d'aller jusqu'au bout de la logique qui s'est progressivement développée depuis six ou sept ans. On a en effet l'impression d'un certain inachèvement. Nos priorités sont les suivantes : - il faut autoriser l'adoption aux couples de concubins ; - il faut permettre l'égal accès aux techniques de l'assistance médicale à la procréation pour toute personne ou tout couple présentant un projet parental cohérent, ce qui implique la modification du code de la santé publique ; - il faut mettre fin à la discrimination exercée sur des candidats à l'adoption, au seul motif de leur orientation sexuelle. Comme l'a rappelé M. Teper, il n'est pas normal qu'un célibataire homosexuel âgé de plus de 28 ans puisse adopter, alors que l'agrément lui est refusé s'il se présente en couple, non pas à cause de sa moralité ou de ses capacités à éduquer un enfant, mais au seul motif de son orientation sexuelle ; - il faut donner un statut aux parents sociaux ; - il faut obtenir la possibilité de l'adoption plénière par le second parent, qui protège l'enfant en cas de décès du parent légal ; - il faut donner à tout couple, quelle que soit son orientation sexuelle, accès aux formes d'organisation de la vie commune, y compris le mariage ; - il faut obtenir la reconnaissance de la multi-parentalité et de la co-éducation ; - enfin, certaines associations qui ont déjà frappé à la porte de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) en lui demandant un agrément doivent pouvoir y entrer. Je pense notamment à SOS Papas et à l'Association des parents et futurs parents gais et lesbiens (APGL). Ces associations seraient à même de faire progresser le droit de la famille, dans le cadre d'un dialogue constructif entre les différentes associations familiales. C'est par le dialogue et non par l'exclusion que nous pourrons faire avancer les choses dans ce domaine où le poids des mentalités est important. Si l'enfant est une personne à part entière, il n'est en aucun cas un adulte en miniature. Les adultes, et plus particulièrement les parents, sont responsables des enfants. C'est pour chaque génération un devoir que d'accueillir l'enfant dans un monde dont il ignore tout et de l'accompagner dans une société où il doit construire sa place, de garantir les droits de l'enfant, lesquels doivent être les mêmes pour tous. L'enfant a droit à la vérité, car il a besoin de repères clairs pour se construire, et rien n'est pire que la dissimulation, le non-dit qui condamne à la solitude. Si la vérité est parfois source de souffrance, cette souffrance peut être surmontée par la parole. L'enfant a également droit au choix et au respect du choix en cas de rupture du couple, car il n'appartient à personne, pas même à ses parents, et ce droit doit s'accompagner du droit à revenir sur sa décision. L'enfant a enfin droit à ses deux parents, quel que soit le devenir du couple, la désunion exigeant que l'on renforce le lien de filiation. Reconnaître un enfant comme sien est un acte fort qui engage un lien particulier que rien ne saurait dissoudre. Cet engagement ne doit être remis en cause ni par la séparation des parents, ni par leur remariage. C'est en effet l'acte qui situe l'enfant dans une généalogie, dans une histoire, qui lui permet de se repérer, de s'identifier, de se distinguer par rapport à l'autre en se positionnant dans le temps et dans l'espace, mais aussi d'avoir une reconnaissance pleine et entière. Ce lien indissoluble est l'élément de sécurité et de certitude qui doit être garanti à tout mineur. Voilà les principes qui guident l'action du CNAFAL et qui doivent pouvoir, à un moment ou à un autre, trouver une traduction législative concrète. Mme Irène Carbonnier : Les Associations familiales protestantes constituent un ensemble d'associations extrêmement diverses. Je ne vous proposerai donc pas une vision d'ensemble de la famille selon le protestantisme. Je peux vous dire, en revanche, que les conceptions divergentes qui se manifestent dans le code civil sont plutôt à nos yeux une richesse qu'une difficulté qu'il faudrait résoudre. Nous voyons dans ces dispositions législatives différentes une possibilité pour la société d'évoluer. Comme juriste, j'ai tendance à penser qu'il faudrait évaluer chaque situation d'une manière approfondie. Sur le fond, je partage beaucoup des positions relatives à la prise en compte de l'intérêt de l'enfant qui ont été exprimées par les deux intervenants qui m'ont précédée. Pour autant, je ne suis pas sûre que tous les problèmes appellent une réponse législative. Le seul texte que le législateur devrait réviser de manière importante est la loi du 11 juillet 1975. Ce texte est obsolète, mal utilisé et peu utilisable par les praticiens du droit. Il y a là un chantier auquel il faudrait s'atteler dans les années à venir. M. François Édouard : La Confédération syndicale des familles (CSF) est implantée dans les quartiers populaires, dans les milieux urbains. Elle représente plus de 40 000 familles, et agit sur le terrain. La CSF a été la première organisation à constituer en son sein, en 1967, un mouvement visant à faire reconnaître le rôle des femmes élevant seules leurs enfants, qu'elles soient divorcées, séparées ou « filles-mères », comme on disait à l'époque. À travers plus de 100 réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents présents dans les quartiers, nous pouvons mesurer concrètement les difficultés auxquelles se heurtent les familles pour élever leurs enfants. Il est important d'agir pour donner une réalité effective à l'exigence de coparentalité. Plus celle-ci est développée avant que ne surviennent les accidents de la vie, meilleures seront les conditions dans lesquelles se déroulera, après ces accidents, le dialogue entre les parents et les enfants. Il ne faut pas attendre le moment du divorce pour mettre en avant la coparentalité. Des avancées législatives ont été réalisées et méritent d'être saluées. Le congé de paternité, en particulier, nous paraît fondamental. Peut-être serait-il opportun d'allonger sa durée. C'est en effet au moment de la naissance de l'enfant que la coparentalité s'exerce pleinement. Certains doutaient du succès du congé de paternité. Or, il est utilisé de manière massive. C'est à nos yeux une grande avancée. La durée du congé de maternité devrait également être allongée, pour être portée à 28 semaines. Le congé parental est aussi un élément fondamental de la coparentalité. Or il est regrettable qu'il soit peu utilisé par les femmes, et presque pas par les hommes. Une rémunération proche de 80 % du salaire serait de nature à augmenter les demandes. L'âge du mariage des femmes doit être porté à dix-huit ans. C'est là une mesure dont il nous semble évident qu'elle contribuerait à renforcer la lutte contre les mariages forcés, même si nous ne disposons pas de chiffres précis en la matière. Les couples vivant en concubinage avec enfants ont les mêmes obligations et les mêmes droits que les autres. Mais n'étant ni mariés, ni pacsés, ils vivent le moment de la séparation de manière particulièrement difficile, ce qui conduit parfois à des situations dramatiques pour les enfants. Je ne crois pas qu'un renforcement de l'encadrement législatif du concubinage soit de nature à régler les problèmes de ces couples. En tout état de cause, la médiation familiale devrait pouvoir jouer un rôle plus important. Au sein des couples non mariés, il n'est pas rare que le père reconnaisse l'enfant sans avoir pleinement conscience de l'engagement que représente cet acte de reconnaissance, vis-à-vis de l'enfant comme de la mère. Quand la démarche de reconnaissance n'est pas portée par les deux parents, nous pensons que l'intervention d'un médiateur familial serait opportune. S'agissant des familles recomposées, sans aller jusqu'à définir un statut du beau-parent, il nous paraît important de clarifier la position de cet adulte qui, dans la vie quotidienne, joue un rôle de repère pour l'enfant. La place occupée par les grands-parents doit aussi retenir toute l'attention du législateur, car ce sont souvent eux qui recréent du lien dans des situations d'éclatement. Notre travail de terrain nous a conduits à nous pencher sur un problème concret touchant aux cartes de réduction SNCF : dans les familles recomposées, seul le parent qui a la garde des enfants a droit à la réduction, alors que l'autre parent n'y a pas droit. Il convient de renforcer l'effort d'information sur le PACS qui offre une organisation de la vie commune, quelle que soit l'orientation sexuelle du couple. Nous pensons qu'il devrait être mentionné sur les actes de naissance. En outre, les dispositions du code de travail applicables aux personnes mariées devraient être étendues aux personnes pacsées. Le cas particulier des personnes sous tutelle ou sous curatelle a également retenu notre attention. A priori, dans la mesure où elles peuvent se marier, on ne voit pas pourquoi elles ne pourraient pas aussi se pacser. Mais ce sujet mérite réflexion. La CSF regroupe toutes sortes de familles, et considère que tout groupement d'adultes qui élèvent des enfants constitue une famille, et mérite une reconnaissance. Des personnes de même sexe élevant un enfant forment donc une famille, ce qui ne pose à nos yeux aucun problème particulier. En revanche, c'est un autre débat que de reconnaître à tout couple, hétérosexuel ou homosexuel, le droit à l'adoption ou à l'assistance médicale à la procréation. M. le Président : Madame, messieurs, merci pour la clarté de vos interventions. J'ai noté que vous êtes favorable à une modification des dispositions régissant le mouvement familial, issues de la loi du 11 juillet 1975. M. Pierre-Louis Fagniez : Ma première question s'adresse à madame Carbonnier. J'aimerais, madame, que vous nous disiez ce qui peut vous séparer des familles catholiques. Ma deuxième question s'adresse à monsieur Édouard. Pourriez-vous préciser le rôle que vous voudriez voir jouer à la médiation familiale s'agissant des couples concubins qui ont un enfant ? Qu'attendez-vous du législateur ? Mme Irène Carbonnier : Je ne connais absolument pas les associations familiales catholiques. Je ne saurais vous dire ce qui nous différencie. J'ai simplement voulu souligner que le protestantisme recouvre beaucoup de familles différentes. Je me réfère pour ma part au protestantisme historique, qui est à mes yeux avant tout une religion laïque. Il est plus que vraisemblable que ce qui doit séparer les associations familiales protestantes des associations familiales catholiques doit être, d'abord, la primauté du mariage civil sur le mariage religieux : le mariage civil, le mariage du code civil, est le mariage des protestants avec toutes ses conséquences en termes de droits et obligations des personnes, et notamment le démariage. Je précise par ailleurs que je suis magistrate. Étant donné mon expérience de praticienne du droit, je peux témoigner que les situations concrètes concernant le sort des beaux-parents ou des parents non mariés qui se séparent sont déjà traitées par les tribunaux. La médiation familiale, par exemple, peut être mise en œuvre aussi bien pour une séparation de parents non mariés que pour celle de parents mariés. Un texte législatif nouveau n'est pas forcément nécessaire pour répondre à tous les problèmes qui peuvent se poser. M. François Édouard : Lorsque les couples mariés divorcent, la situation est systématiquement examinée par un juge. Ce n'est pas le cas pour les couples concubins qui se séparent : ceux-ci peuvent fort bien se séparer sans l'intervention d'un juge. Que peut-on attendre du législateur ? Je n'ai pas de proposition législative précise à formuler, mais il me semble qu'il faut réaffirmer avec force que tout citoyen qui donne la vie a par là même une responsabilité vis-à-vis de la société, et ne doit pas s'y soustraire. Mme Christine Boutin : S'agissant de la carte de réduction SNCF, la remarque de M. Édouard rejoint tout à fait mon expérience d'élue. Cela dit, le problème ne se limite pas aux parents séparés. Je pense au cas d'un parent qui a la garde quotidienne de six enfants mais qui ne peut bénéficier d'une réduction de 50 % parce que seuls trois de ces enfants sont les siens. M. François Édouard : Il faut en effet se pencher sur ces cas, d'autant que les réductions SNCF ne sont pas des offres commerciales. Les pertes de recettes pour la SNCF sont compensées par l'État. Mme Christine Boutin : D'autre part, vous avez souligné, monsieur Édouard, la nécessité de responsabiliser tout adulte qui donne la vie. C'est là une observation à laquelle je suis sensible. M. Jean-Marie Bonnemayre : On voit bien que le mariage est en perte de vitesse. Un certain nombre de couples se constituent sans souhaiter la sacralisation ou la symbolisation de leur union par la loi. La naissance d'un enfant crée de ce point de vue une difficulté. Il serait bon que l'enregistrement de cette naissance à l'état civil soit accompagné d'une cérémonie solennelle qui attire l'attention sur les droits de l'enfant qui vient de naître et sur les devoirs et responsabilités des géniteurs, ou au moins de la génitrice si le père ne reconnaît pas l'enfant. Les couples qui vivent en concubinage ne sont pas, par définition, connus de l'autorité publique. Les choses se compliquent quand ils ont des enfants et se séparent. Ces séparations, qui ne se règlent pas toujours par les tribunaux et que l'on peut qualifier de « sauvages », produisent parfois des dégâts considérables. Il serait bon que les enfants puissent avoir recours à l'autorité judiciaire, et que les grands-parents puissent eux aussi, éventuellement, saisir un juge pour faire respecter les droits des enfants. M. Bernard Teper : La préoccupation qui s'est exprimée s'agissant de la responsabilité des adultes ayant mis au monde un enfant est tout à fait légitime. Mais on ne peut pas uniquement mettre en avant les devoirs des concubins, sans accroître leurs droits. La France est l'un des pays européens qui accordent le moins de droits aux concubins. Je rappelle à ceux qui ont suivi les débats sur le PACS que la position initiale de l'Assemblée nationale était le PACS sans la reconnaissance légale du concubinage, après quoi le Sénat a adopté la reconnaissance légale du concubinage sans le PACS. Finalement, notamment grâce à l'intervention du sénateur Badinter, nous avons eu et l'un et l'autre. Quoi qu'il en soit, l'augmentation des droits des concubins non pacsés, dont le nombre croît dans des proportions massives, est un chantier très important. M. le Président : Je voudrais faire une petite correction. En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté le PACS. Mme la Rapporteur : Sans la reconnaissance légale du concubinage. M. le Président : Nous n'avions pas parlé du concubinage en première lecture. Nous n'avons pas adopté « le PACS sans la reconnaissance légale du concubinage ». Nous avons adopté le PACS. Le Sénat a répondu par la reconnaissance légale du concubinage, sans le PACS. C'était la position du rapporteur du texte au Sénat. C'était aussi la position de M. Badinter. C'est quand la proposition de loi est revenue en deuxième lecture à l'Assemblée nationale que les députés ont adopté un texte instituant le PACS et incluant la reconnaissance légale du concubinage. M. Patrick Delnatte : Je précise qu'en cas de conflit au moment de la séparation entre des concubins ayant des enfants, le juge peut être saisi pour déterminer qui exercera l'autorité parentale. Le juge peut intervenir en matière d'autorité parentale pour les personnes mariées qui divorcent comme pour les concubins qui se séparent. De même, la médiation familiale s'applique aussi bien quand les parents étaient mariés que quand ils étaient concubins. Faut-il systématiquement déposer une convention devant le juge par laquelle les concubins manifestent d'emblée un accord sur la manière de traiter à l'avenir le problème de l'autorité parentale lors d'une éventuelle séparation ? C'est une piste que l'on pourrait explorer. S'agissant de l'accouchement sous X, si j'ai bien compris votre position, monsieur Teper, l'accouchement anonyme devrait selon vous être totalement interdit, et le secret automatiquement levé à la majorité de l'enfant, la mère biologique étant simplement informée de la levée de ce secret. L'Assemblée s'est longuement penchée sur le problème. Si nous entrions dans cette logique, des problèmes beaucoup plus graves pourraient se poser. D'autres pays, en particulier la Belgique, sont en train de réfléchir à la possibilité de se rapprocher de la solution d'équilibre que nous avons adoptée. Troisièmement, je remarque qu'aucun d'entre vous n'a évoqué le mal-vivre des jeunes. Ce mal-vivre ne tient-il pas, entre autres causes, à la façon dont les parents organisent leur vie ? Il me semble gênant de considérer que tous les modes de vie se valent et que les problèmes ne doivent être réglés que quand ils se posent. Mme Marie-Françoise Clergeau : Vous avez souligné, monsieur Édouard, l'importance de la coparentalité, et appelé de vos vœux un allongement de la durée du congé de paternité et du congé de maternité. S'agissant du congé parental, vous avez uniquement évoqué l'augmentation de l'indemnisation. Mais est-ce le père ou la mère qui prend le congé parental ? Quelle durée proposez-vous ? On sait très bien que les femmes qui prennent un congé parental rencontrent des difficultés à retrouver leur emploi. Mme Annick Lepetit : Vous avez tous souligné l'importance des mutations de la famille. Ne pensez-vous pas qu'il serait bon, afin de reconnaître que la famille est devenue plurielle, de parler « des familles » plutôt que de « la famille », de la même manière que l'on parle aujourd'hui des droits des femmes, et non plus des droits de la femme ? D'autre part, je partage l'idée selon laquelle, si l'on demande plus de devoirs aux parents, quelle que soit la forme de leur union, il faut aussi leur accorder davantage de droits. Mais cette responsabilité à l'égard des enfants doit apparaître très tôt, dans le cadre de l'éducation. S'agissant de la maîtrise du corps et de la procréation, il me semble qu'il y a moins de prévention depuis quelques années. Les éducateurs, les principaux de collège et les proviseurs insistent sur ce point. Vous avez dit, monsieur Édouard, que tout groupement d'adultes élevant un ou des enfants était une famille, en ajoutant que cela n'impliquait pas nécessairement la reconnaissance d'un droit à l'adoption ou d'un accès à l'assistance médicale à la procréation pour les couples homosexuels. Pourriez-vous préciser votre position sur ce point ? Mme Christine Boutin : J'entends bien les propos des uns et des autres. Vous avez dit, monsieur Teper, pourquoi il vous semblait nécessaire d'augmenter les droits des concubins. Votre raisonnement est logique. Il reste que, peu à peu, nous nous dirigeons vers une situation dans laquelle, le mariage disparaissant, les devoirs et les droits du couple ne seront plus formalisés par un passage devant le maire, et le contrat entre la société et l'État n'existera plus ou deviendra virtuel. Les individus auront des droits et des devoirs du seul fait qu'ils appartiennent à la collectivité, et non pas parce qu'ils se seront engagés vis-à-vis de celle-ci. Une posture philosophique et politique très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui tend ainsi à s'imposer peu à peu, sans en avoir l'air. Mme la Rapporteure : Les droits des concubins qu'il faudrait selon vous accroître, monsieur Teper, ce sont en réalité des avantages financiers, ou des droits très liés aux conditions matérielles de vie. Ils sont accordés aux couples mariés parce que ceux-ci sont très stables et parce qu'ils ont une mission sociale, celle d'élever les enfants. Le mariage crée des obligations importantes, en particulier l'obligation de secours, et il constitue un lien dont la force se mesure à la difficulté de se séparer, laquelle difficulté est précisément ce qui protège la famille. Je m'inquiète quelque peu d'une tendance des concubins à revendiquer les mêmes droits que les couples mariés, sans prendre les mêmes engagements vis-à-vis de la société, comme vis-à-vis de leur propre couple. M. le Président : Comme vous l'avez rappelé, monsieur Teper, la loi de 1966 donne à une personne seule de plus de 28 ans la possibilité d'adopter. Cette disposition sera différemment appliquée selon que cette personne dit ou non son orientation sexuelle. On observe en outre une inégalité territoriale dans l'application de cette position : certains conseils généraux ont adopté des règles de non-discrimination ; d'autres, sans le dire, peuvent être amenés à avoir des pratiques plus discriminatoires. Je suppose, monsieur Teper, que vous ne proposez pas de revenir sur la possibilité de construire un projet familial porté par une personne seule. Pourriez-vous nous préciser ce point ? Je pose cette question parce que j'ai eu l'occasion de voir s'exprimer ici ou là la tentation de supprimer cette disposition qui est maintenant présente dans notre code civil depuis une quarantaine d'années. M. Bernard Teper : S'agissant de l'accouchement sous X, M. Delnatte me dit que nous allons un peu loin. Mais le fait d'aller un peu loin ne nous gêne pas particulièrement. L'UFAL allait loin quand elle était favorable, et elle l'a été depuis le début, à l'égalité entre enfants légitimes et enfants naturels et adultérins. Que n'a-t-on entendu à l'époque de la part de certains que je ne nommerai pas ? De même, quand nous proposions qu'il soit possible de donner à l'enfant le nom de son père, celui de sa mère, ou les deux noms accolés, on nous accusait de vouloir détruire la famille ! Petit à petit l'oiseau fait son nid, et les évolutions sociales sont tellement fortes que ce qui semblait anormal il y a dix ou quinze ans paraît normal aujourd'hui. Pour revenir à l'accouchement sous X, il faut tenir compte des droits de l'enfant. Or, deux conditions minimales doivent être remplies pour éviter le mal-vivre des jeunes : ils doivent être aimés et ils doivent connaître leur origine. Ne pas connaître ses origines est un traumatisme terrible. Contre le mal-vivre des jeunes, l'UFAL a toute une série de propositions, que je ne peux pas exposer ici, car elles sortent du champ de votre Mission. Je dirai simplement que nous avons négligé, collectivement, de défendre suffisamment les intérêts de l'enfant. S'agissant de la loi du 11 juillet 1975, la représentation nationale se grandirait en l'adaptant aux nouvelles formes d'organisation de la vie familiale. À nos yeux, il faut reconnaître comme famille tout groupement qui élève des enfants. Cela implique une modification des dispositions régissant les associations familiales. J'ajoute qu'on ne peut pas à la fois critiquer l'UNAF et ne pas réviser le texte qui fonde son fonctionnement. L'UNAF n'est pas une association à caractère privé : elle est parapublique dans la mesure où elle est régie par l'ordonnance du 3 mars 1945, modifiée par la loi du 11 juillet 1975. C'est la représentation nationale qui a la responsabilité de fixer le cadre dans lequel elle travaille. Pour notre part, nous sommes attachés à l'UNAF. En ce qui concerne les droits des femmes, il faut que celui de choisir librement le mode de garde des enfants devienne une réalité. Les droits des femmes, et notamment des femmes appartenant aux couches populaires, ne seront pas respectés tant qu'une politique nationale de la petite enfance n'aura pas été mise en œuvre, à l'instar de la politique des « trois claquements de doigt » adoptée par nos amis finlandais. Premier claquement de doigt : je demande une place de halte-garderie et je l'ai. Deuxième claquement de doigt : je demande une place de crèche et je l'ai. Troisième claquement de doigt : je veux aller au cinéma demain soir, je téléphone au service public de garde d'enfant à domicile et une personne formée viendra garder mon enfant, à un prix cinq fois inférieur à celui d'une baby-sitter en France. D'une certaine façon, l'avancée du droit civil et familial ne peut pas être complètement séparée de l'avancée sociale pour les familles. Il manque 40 000 places de crèche en France. C'est une politique sociale en direction des familles qu'il faut mettre en œuvre, et notamment en direction des femmes des couches populaires, ce qui permettra à celles-ci d'être élues. Car même après l'adoption d'une loi sur la parité, elles n'ont toujours pas la possibilité effective d'être élues. S'agissant des concubins, madame Boutin, vous avez posé le problème tel qu'il se pose, même si je suis convaincu que nous ne serons pas d'accord sur les réponses qu'il convient de lui apporter. Votre position est cohérente, la nôtre l'est également. Qui va trancher entre ces deux cohérences ? Je pense que c'est l'évolution du peuple. Peu à peu, la représentation nationale sera bien obligée de tenir compte des réalités. Madame Pécresse, vous avez eu raison de souligner qu'il y avait des avantages financiers au mariage. Or, malgré cela, des millions de personnes refusent de se marier. Cela veut dire que le concubinage n'est pas une forfanterie. C'est un autre choix de vie. Il y a, comme le disait Mme Lepetit, « des » familles. Étant laïque, et donc favorable à la séparation de la sphère publique et de la sphère privée, je n'émets pas de jugement de valeur sur la façon dont vivent les uns et les autres. Je dis simplement que la représentation nationale doit prendre en compte les évolutions des différentes formes de vie familiale. Le mariage n'a plus l'importance qu'il avait au XIXème siècle ou même au début du XXème siècle. Cette évolution inéluctable va se poursuivre. Ce n'est pas en donnant beaucoup plus d'avantages financiers aux personnes mariées que l'on y mettra un terme. Le nombre de naissances hors mariage, faut-il le rappeler, augmente considérablement : plus de 50 % en région parisienne. M. Patrick Delnatte : C'est vrai pour le premier enfant. La proportion baisse énormément pour les naissances suivantes. M. Bernard Teper : Bien sûr, mais je parle du chiffre global. Le problème n'est pas que telle association veuille sacraliser le mariage et telle autre non. Il faut respecter ceux qui veulent vivre un mariage sacralisé comme ceux qui font le choix du concubinage. Les inégalités en droits entre ces couples doivent diminuer. S'agissant de la loi de 1966, M. le Président, des débats ont eu lieu à l'intérieur de l'UNAF. Une association familiale, que je ne nommerai pas, a souhaité l'abrogation de la loi de 1966. Je reconnais que sa position est cohérente, dans la mesure où elle estime que l'adoption doit être réservée aux couples mariés. L'UFAL, quant à elle, est favorable au maintien de la loi de 1966 et, par conséquent, à l'accès des couples homosexuels à l'adoption sous certaines conditions. Il y a là deux positions qui ont leur cohérence. Toute autre position est incohérente, comme l'est le droit actuel, lequel entraîne en outre une inégalité territoriale puisque les conseils généraux ont des pratiques différentes. Il faut sortir de cette hypocrisie. Le droit n'a pas à tenir compte de l'inclination sexuelle, pas plus qu'il n'a à tenir compte de la religion, de la couleur de peau, ou des revenus. Nous sommes favorables à une renationalisation du droit de la famille. M. Jean-Marie Bonnemayre : S'agissant de l'accouchement sous X, deux droits se télescopent : le droit de connaître ses origines, et le droit des femmes qui, en grande difficulté psychologique ou sociale, souhaitent accoucher sous X. Il me semble que maintenir le secret pendant 18 ans, c'est suffisamment long pour permettre à la personne de se reconstruire, et qu'il faut laisser la possibilité à l'enfant devenu majeur d'avoir accès à son dossier, mais en exigeant un consentement mutuel. S'agissant de la reconnaissance de la pluralité de la famille, il est incontestable que nous allons de plus en plus vers une diversification des formes familiales. Cela implique une modification de la loi du 11 juillet 1975, et notamment du statut des associations familiales. Pour ce qui est du concubinage, l'expérience montre que nombre de couples commencent par le concubinage et régularisent leur situation, soit par la mariage, soit par le PACS, afin de préciser les droits des partenaires ou ceux des enfants. Il serait bon que nous puissions disposer de données beaucoup plus précises sur le nombre résiduel de couples qui demeurent en concubinage. Ceux-ci effectuent un choix en toute connaissance de cause. Ma position est qu'ils doivent pouvoir continuer à l'assumer. On ne peut pas contraindre les couples à faire le choix de l'institutionnalisation s'ils le refusent. S'agissant de l'adoption, il faut respecter le principe de non-discrimination. La Cour européenne des droits de l'homme a renvoyé le règlement de ce problème aux législations nationales. Mais il n'est pas douteux que d'autres recours seront déposés devant la Cour. Nous sommes favorables à l'introduction dans le code civil d'une disposition indiquant très clairement que le refus d'agrément ne peut pas être motivé par l'orientation sexuelle. Le mal-vivre des jeunes est une réalité indéniable, comme le montre le nombre de suicides. Nous sommes là au cœur du problème. Il doit être envisagé en s'inscrivant dans une perspective historique. La reconnaissance des droits de l'enfant est tout à fait récente. L'évolution de la filiation et de l'autorité parentale n'en est qu'à ses débuts. Les situations nouvelles auxquelles les membres de la famille sont confrontés se règlent, ou parfois ne se règlent pas, à travers une négociation permanente. Les repères de la filiation se sont déplacés, puisqu'elle est de plus en plus sociale et de moins en moins biologique. La question est de savoir comment réinstitutionnaliser ces repères et comment leur donner une force symbolique. Cette réflexion mérite d'être approfondie. Tout discours tendant à culpabiliser les parents est contre-productif, parce qu'il ne correspond pas du tout aux aspirations des uns et des autres, ni à ce qui se passe réellement à l'intérieur de la cellule familiale. Les femmes doivent pouvoir retrouver leur emploi après un congé parental. Le choix de la maternité ne doit en aucun cas être pénalisé. Peut-être même faudra-t-il un jour récompenser un choix qui va dans le sens de l'intérêt collectif. Mme Irène Carbonnier : Certaines interventions ont pu laisser penser que les parents non mariés avaient moins de devoirs à l'égard de leurs enfants que les parents mariés. Cela est inexact : ils ont exactement les mêmes obligations. C'est là un point qu'il me semble important de souligner. M. François Édouard : Je dois d'abord dire que j'ai du mal à comprendre pourquoi certains ont parlé de l'UNAF, qui n'est pas le sujet de cette table ronde. S'agissant du mal-vivre des jeunes, il me semble que ceux-ci ressentent les difficultés qu'éprouvent les adultes à s'impliquer collectivement dans la société. Les comportements sont de plus en plus individuels, et les adultes ont du mal à définir des repères dans l'espace public. Il est donc important de responsabiliser les adultes, ce qui ne signifie pas qu'il faut leur demander d'assumer des devoirs sans leur accorder des droits. Le congé parental concerne à notre sens aussi bien la mère que le père. Il est d'ailleurs possible d'envisager qu'il soit partagé entre eux. On peut débattre de la durée du congé parental, mais l'essentiel est qu'il soit réellement utilisé. Trop de parents hésitent à le prendre parce qu'ils craignent de ne pas retrouver leur emploi. Les textes ne sont pas suffisamment contraignants pour les employeurs. Pourquoi ne pas instaurer un congé parental plus court, mieux rémunéré et partagé entre le père et la mère ? La reconnaissance de la pluralité des familles ne pose aucun problème à la CSF. S'agissant des familles homoparentales, nous avons consulté un certain nombre de psychologues et d'anthropologues. Plusieurs d'entre eux ont souligné que, si certaines sociétés humaines ont pu accepter l'homosexualité, aucune n'a jamais été organisée autour de l'homosexualité et de l'homoparentalité. Peut-être une organisation de ce type va-t-elle s'organiser au cours du XXIe siècle, mais cela n'a jamais été le cas par le passé. Les enfants ont toujours été élevés par des groupes composés d'hommes et de femmes. C'est pourquoi nous sommes assez prudents. Une chose est de reconnaître l'existence de fait des familles au sein desquelles deux personnes de même sexe élèvent des enfants, autre chose est de reconnaître de manière systématique, par un texte législatif, à deux personnes de même sexe le droit d'adopter, d'avoir recours à la procréation médicale assistée. Voilà quelle est notre position actuelle. Cela dit, le débat reste ouvert. M. le Président : Madame, messieurs, nous vous remercions d'avoir participé à ce débat riche d'enseignements. Table ronde ouverte à la presse sur la réforme du droit de la famille réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Merci aux intervenants de cette table ronde et aux représentants de la presse écrite et audiovisuelle d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que notre Mission a été créée en décembre 2004 à l'initiative de M. Jean-Louis Debré, Président de l'Assemblée nationale, qu'elle a été mise en place début février 2005 et qu'elle a d'abord eu des échanges avec un certain nombre de personnalités sur la famille, les modèles familiaux et leur évolution. Elle s'est ensuite intéressée au dispositif de protection de l'enfance ce qui lui a permis d'établir, fin juin, une note d'étape comportant 52 propositions pour réformer ce dispositif. Nous sommes désormais engagés dans la deuxième partie de notre travail, relative à la réforme du droit de la famille, que nous reprendrons à l'automne. Nous avons tenu une première table ronde le 29 juin avec les associations familiales, du moins celles qui ont répondu à notre invitation. Aujourd'hui, nous recevons les associations de défense des droits et des revendications des gays et des lesbiennes, notamment sur les questions d'homoparentalité. Cette table ronde fait suite à trois déplacements à l'étranger, le dernier ayant fait l'objet d'un article sur lequel notre Rapporteure reviendra dans un instant. Nous nous sommes rendus à Londres, dans le cadre de notre réflexion sur la protection de l'enfance, afin d'analyser le plan du gouvernement Blair de lutte contre la pauvreté des enfants. Nous étions préalablement allés à Madrid et nous revenons de Bruxelles et de La Haye. Notre prochain déplacement nous conduira au Canada, notamment au Québec. Mme la Rapporteure : Les propos qui me sont prêtés dans l'article du Monde de la semaine dernière ont été tenus par une de mes collègues et ne reflètent pas ma position. On peut y lire que le mariage homosexuel ne bute que sur la filiation, ce qui laisse penser que j'y serais favorable dès lors qu'on retirerait toute possibilité de filiation. Or, je reviens de Belgique et des Pays-Bas convaincue que le mariage entre personnes de même sexe et la filiation sont indissolublement liés, d'autant que ces pays, qui avaient voulu séparer les deux sujets, sont en train de modifier les règles de la filiation deux ou trois ans après avoir légiféré sur le mariage. Pour moi, le mariage est avant tout un statut destiné à protéger les gens qui veulent élever des enfants. Je suis très attachée au modèle « un père, une mère, un enfant », ce qui explique mes réserves quant au mariage entre personnes du même sexe. M. le Président : Je m'associe totalement à ces propos, car je suis, comme notre Rapporteure, persuadé qu'il ne faut pas séparer mariage et filiation. Pour le reste, nos opinions divergent... Mais revenons à cette table ronde et à nos invités. M. Laurent Chéno est secrétaire de la commission politique de l'Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans (LGTB), collectif représentatif qui organise la marche des fiertés. Beaucoup d'entre nous ont déjà rencontré Mme Martine Gross, présidente d'honneur de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), dont l'engagement militant et la connaissance des dossiers sont unanimement reconnus et que nous serons sans doute amenés à revoir à la rentrée. M. Éric Verdier est président de Coparentalité. Enfin, nous accueillons deux représentants d'associations liées à des organisations politiques : M. Alexandre Carelle, président d'Homosexualités et socialisme, qui est associée au parti socialiste, et M. Stéphane Dassé, président de Gay Lib, mouvement associé à l'UMP. M. Laurent Chéno : Je vous remercie d'avoir organisé cette audition et je salue l'initiative du Président de l'Assemblée nationale, qui a su ouvrir un débat qu'il a voulu sans tabou, ce que n'a pas pu faire le Gouvernement, qui se montre toujours très réticent sur ces questions. Je vous prie par ailleurs d'excuser l'absence d'Alain Piriou, porte-parole de l'Interassociative LGBT. Comme vous venez de nous le demander, je vais dresser un tableau des revendications que porte la soixantaine d'associations que je représente ici. S'agissant de la conjugalité, nous jugeons important de maintenir le choix actuel entre trois modes d'union : le mariage, le PACS et le concubinage. À nos yeux, le PACS n'est ni un mariage au rabais ni un mariage bis, et nous souhaitons non seulement le conserver mais aussi l'améliorer. Je sais qu'un projet de loi est en préparation, mais son examen a été repoussé et le Gouvernement ne nous a pas informés de son contenu. J'espère que les points que nous avons évoqués à plusieurs reprises seront pris en considération. Nous demandons en particulier qu'on respecte la nature, la liberté et la souplesse du PACS, en particulier au moment de la rupture du contrat ; qu'on améliore les droits liés au décès d'un des partenaires, notamment en matière de succession et de pension de réversion ; qu'on réduise la durée arbitraire de mise à l'épreuve sans droit au séjour, qui rend si difficile la vie des couples binationaux. Je rappelle que le concubinage a été reconnu, à l'initiative du Sénat, lors de la discussion de la proposition de loi instituant le PACS. S'agissant du mariage, vous ne vous étonnerez pas que nous revendiquions, en application du principe d'égalité des droits, son ouverture aux couples du même sexe. Que les choses soient claires : nous ne revendiquons pas le mariage homosexuel mais l'ouverture du mariage, que nous ne voulons pas voir caractérisé par une sexualisation des partenaires. Il ne s'agit pas de créer un deuxième mariage. À l'évidence, puisque tel est déjà le cas avec le mariage actuel, l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe aura des répercussions sur la filiation et nous considérons donc que le débat sur l'adoption est bien indissociable de celui sur le mariage. Dans le même esprit d'égalité des droits, nous souhaitons une adoption conjointe et plénière, ouverte à tous les couples quel que soit leur statut, indépendamment du fait qu'ils unissent des personnes de même sexe ou de sexe différent. Mais nous avons conscience que cette réforme ne concerne qu'un faible nombre d'enfants puisque sont rares ceux qui peuvent être adoptés en France et que les accords internationaux risquent de faire obstacle à l'adoption internationale. Ouvrir la possibilité au sein d'un couple d'adopter l'enfant du conjoint, du partenaire ou du concubin aurait donc sans doute plus d'effets et répondrait à la situation de nombreuses familles recomposées. Par ailleurs, il nous semble que la reconnaissance du parent social permettrait de répondre à de nombreuses situations et serait facile à mettre en œuvre. Cela pourrait passer par une extension de l'article 377 du code civil relatif à la délégation d'autorité parentale, qui ne serait plus soumise à des circonstances exceptionnelles, mais liée au commun accord des parents. Une délégation totale ou partielle de l'autorité pourrait ainsi être prononcée en faveur du conjoint, du partenaire ou du concubin d'un des parents. Une telle délégation irait tout à fait dans l'intérêt de l'enfant en lui offrant une meilleure protection. Notre réflexion est guidée par le principe d'égalité des droits dont j'ai déjà parlé, par le principe d'universalité - nous ne nous plaçons pas dans une perspective communautariste et nous souhaitons que les améliorations que nous demandons profitent de façon égale à tous les couples -, et par le principe de réalité, car on ne peut plus ignorer ni le nombre d'enfants qui naissent hors mariage ni celui des enfants qui sont élevés par des familles monoparentales, homoparentales ou recomposées. Mme Martine Gross : Je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui et je serai ravie d'être entendue une seconde fois, plus longuement. Avant de vous présenter les propositions de réforme du droit de la famille élaborées par l'APGL, je souhaite vous fournir quelques repères sur l'homoparentalité et l'APGL. Les familles homoparentales sont une réalité. Même si l'INSEE ne les comptabilise pas, compte tenu des sondages concernant le nombre de parents parmi les homosexuels et de l'évaluation du nombre d'homosexuels dans la société française, on obtient une fourchette de 100 000 à 500 000 enfants élevés par des parents gays ou lesbiens. Créée en 1986, l'APGL regroupe aujourd'hui environ 1 500 adhérents répartis sur toute la France et parents de près de 500 enfants. On peut donner de l'homoparentalité une définition simple : il s'agit d'une situation familiale où un parent au moins s'assume comme homosexuel et élève au moins un enfant. Mais les familles homoparentales regroupent en fait les situations très différentes de pluriparentalité et de biparentalité. Les situations de pluriparentalité se caractérisent par la présence d'un père et d'une mère, et de parents sociaux à leurs côtés. II s'agit d'une part de familles recomposées dans lesquelles un père ou une mère vit avec un beau-parent de même sexe, d'autre part des situations dites de coparentalité où deux à quatre personnes sont autour du berceau de l'enfant : une mère lesbienne et un père gay, et leurs éventuels compagne et compagnon respectifs, qui ne forment pas une famille recomposée mais une famille composée. Les situations de biparentalité concernent les couples de personnes de même sexe dont l'une seulement a un statut de parent légal. Elles couvrent les cas où les enfants sont adoptés par une personne seule et ceux dans lesquels ils ont été conçus à l'étranger, par insémination artificielle ou par recours à une « mère pour autrui ». La réforme du droit de la famille que nous appelons de nos vœux est une réforme pour un droit ouvert sur la pluralité des formes familiales, un droit qui accepte que la réalité ne fasse pas toujours coïncider le biologique, le juridique et le social, un droit respectueux de ces trois volets de la filiation et de la transparence. Ces propositions ne sont en rien réservées aux familles homoparentales, elles tiennent compte de toutes les familles contemporaines et de leur pluralité. Elles s'appuient sur deux grands principes : une égale protection de tous les enfants, quel que soit leur environnement familial, et l'égalité de tous les citoyens. Vous en trouverez le détail dans le document De la famille au singulier aux familles plurielles qui vous a été remis. L'égale protection de tous les enfants concerne la définition de la famille, la connaissance des origines, la protection des liens noués avec les enfants et l'adoption. La définition de la famille doit être fondée sur la responsabilité. Nous souhaitons que les liens de filiation ne reposent pas uniquement sur la vérité biologique, mais également sur l'engagement et la responsabilité. Un parent n'est pas nécessairement celui qui donne la vie, il est celui qui s'engage par un acte volontaire et irrévocable à être le parent pour toujours d'un enfant. Nos propositions reposent sur la nécessité de respecter les trois aspects de la filiation : biologique, juridique et social. Tout enfant a une histoire et des origines, c'est le volet biologique, qui doit être distingué de la filiation juridique, qui a des conséquences en termes de droits et de devoirs. L'aspect social concerne l'environnement et le quotidien de l'enfant. Si ces aspects coïncident dans la plupart des cas, pour les familles recomposées, adoptives, homoparentales et celles qui ont eu recours aux techniques de procréation médicalement assistée, ils coexistent et sont incarnés dans des personnes différentes. Nous proposons donc un qu'un « livret de famille de l'enfant » lui soit attribué dès son arrivée, où seraient matérialisés ses liens avec son environnement familial. Y seraient indiqués les trois aspects de sa filiation : ceux qui se sont engagés dès sa naissance pour le conduire vers l'âge adulte - le juridique -, ceux qui lui ont donné la vie - le biologique -, ceux avec lesquels il a tissé des liens - le social -. Le respect des trois aspects de la filiation implique en premier lieu des mesures relatives à la connaissance des origines. Qu'il s'agisse des donneurs de gamètes ou de l'accouchement confidentiel, un conservatoire des origines devrait être organisé afin que l'enfant qui le souhaite puisse accéder à la connaissance de ses origines. L'histoire de ses origines appartient à l'enfant. Nous souhaitons que la filiation soit fondée sur l'engagement, mais les origines ne doivent pas être niées pour autant. Les trois aspects de la filiation impliquent en outre des mesures visant à la protection des liens tissés entre les enfants et leurs parents sociaux. Les liens parents-enfants doivent perdurer au delà des vicissitudes de la vie des adultes. Séparation et décès ne doivent pas priver brutalement un enfant des liens qu'il a pu tisser avec ses parents sociaux. Nous souhaitons que soit autorisée l'adoption d'un enfant par le compagnon ou la compagne de son père ou de sa mère. La loi garantit à un enfant né dans une famille hétéroparentale l'accès à ses deux parents : depuis la loi du 4 mars 2002, un parent ne peut empêcher un enfant de maintenir des liens avec son autre parent, mais cette disposition ne s'applique pas aux familles homoparentales, ce qui constitue une inégalité pour les enfants. La loi permet également le partage de l'autorité parentale entre les parents légaux et un tiers : lorsqu'un enfant vit avec un parent légal et un parent social, ce partage autorise le parent social à exercer légalement des fonctions parentales au quotidien. Cette mesure est cependant laissée à l'appréciation du magistrat, et les enfants de familles homoparentales ne sont absolument pas assurés de pouvoir en bénéficier. Nous demandons donc que les décisions s'appliquent sans discrimination. L'APGL réclame un statut de parent social pour les beaux-parents - dans le cas de familles recomposées - et pour les co-parents - dans le cas de familles composées en coparentalité -, qui s'obtiendrait par déclaration de possession d'état, avec l'accord du ou des parents légaux. Ce statut devrait couvrir les questions d'autorité parentale, de protection des liens avec l'enfant en cas de séparation ou de décès, d'obligations alimentaires, de succession et de legs. L'APGL préconise aussi de rendre possible l'adoption simple par le parent social. Dans les familles pluri-parentales, l'adoption simple permet l'addition de parents adoptifs aux parents de naissance, mais actuellement l'autorité parentale est intégralement transférée aux seuls parents adoptifs. Un aménagement de ce dispositif, avec autorité parentale partagée de manière consensuelle entre parents légaux et sociaux, permettrait à l'enfant d'avoir une filiation cohérente avec son environnement familial. Pourquoi en effet ne donner qu'un seul parent à l'enfant quand plusieurs personnes sont prêtes à s'engager ? Enfin, le respect des trois aspects de la filiation implique l'ouverture de l'adoption plénière aux couples non mariés, laquelle a l'avantage d'apporter à un enfant privé de famille des parents prêts à s'engager. La filiation ne devrait se fonder que sur l'engagement et la responsabilité vis-à-vis des enfants quels que soient les aléas de la vie des parents. C'est pourquoi nous préconisons l'ouverture de l'adoption plénière à tous les couples, qu'ils soient mariés ou non mariés. L'APGL recommande aussi de rendre possible, lorsqu'il n'y a qu'un seul parent légal, l'adoption plénière par le concubin. Un tel dispositif, appelé « adoption par le second parent », permet d'offrir à l'enfant une protection de ses liens avec ses deux parents en cas de décès ou de séparation, et d'être assis sur deux branches plutôt que sur une seule. Aujourd'hui, l'adoption plénière par le second parent n'est possible que pour les enfants du conjoint, c'est à dire dans le cadre du mariage. J'en viens à nos propositions pour l'égalité de tous les citoyens, qui tournent autour de quatre axes : l'égalité de traitement devant la loi en cas de conflit parental, l'égalité de traitement pour la délivrance des agréments en matière d'adoption, la procréation médicalement assistée et le mariage. S'agissant de l'égalité de traitement devant la loi en cas de conflit parental, juges et experts considèrent encore trop souvent qu'une orientation homosexuelle d'un parent est un problème pour l'éducation de l'enfant. Bien qu'aucune étude n'ait jamais confirmé un tel préjugé, il n'est hélas pas rare de trouver des marques de discrimination dans certaines décisions où on peut lire par exemple que « le père est autorisé à voir son enfant à condition qu'il le protège de sa vie privée » ou « s'il ne lui fait pas rencontrer son compagnon ». En renforçant les préjugés anti-homosexuels et en disqualifiant les relations entre personnes de même sexe, une telle discrimination peut accroître les difficultés de l'enfant à maintenir des relations avec son parent homosexuel. Lors des conflits liés au divorce ou à la séparation d'un foyer hétéroparental, nous préconisons que la résidence alternée soit privilégiée lorsque les parents ont un domicile à proximité, et qu'à défaut la résidence principale de l'enfant soit confiée à celui des deux parents qui est le plus à même de le prendre en charge. Nous souhaitons également que soit privilégiée la médiation familiale comme première alternative à la judiciarisation des conflits. La loi du 4 mars 2002 a créé la possibilité d'homologuer les conventions réglant l'organisation de la vie de l'enfant lorsque les parents ne vivent pas ensemble. Encore faut-il que les magistrats soient familiarisés avec toutes les formes de familles contemporaines et que ces conventions puissent s'appliquer sans discrimination lorsque les parents sont de même sexe. En ce qui concerne l'égalité de traitement pour la délivrance des agréments en matière d'adoption, la loi permet depuis 1966 à toute personne de plus de 28 ans de solliciter un agrément en vue d'adopter un enfant. Elle n'indique ni que le candidat ou la candidate doive vivre seule, ni que la personne doive avoir une vie sexuelle en conformité avec une norme majoritaire. Nous souhaitons donc qu'un décret d'application vienne interdire d'alléguer l'orientation sexuelle pour refuser l'agrément. J'en viens à l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) ainsi qu'au débat sur la maternité pour autrui. Le fait d'autoriser l'accès aux techniques de PMA aux seuls couples hétérosexuels et de l'interdire aux couples homosexuels et aux célibataires constitue une discrimination. Pourquoi l'État doit-il se mêler de l'accès à des techniques médicales et exclure a priori une catégorie de personnes ? Nous souhaitons que les techniques de PMA soient dorénavant ouvertes à toute personne en âge de procréer, aux couples lesbiens comme aux célibataires, sur la base d'un projet d'engagement parental. C'est l'existence d'un projet parental cohérent, c'est-à-dire engageant une ou plusieurs personnes envers l'enfant et la société, qui nous semble constituer le critère déterminant pour être parent et non la vraisemblance biologique. S'agissant des maternités pour autrui, je rappelle que l'article 16-7 du code civil rend nulle toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Mais certains pays encadrent légalement cette pratique afin de garantir le respect et la dignité de chacun des protagonistes. On peut citer le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, certains États des États-Unis, Taiwan, l'Île Maurice, Israël, mais aussi, plus près de nous, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, la Hongrie, la Roumanie, la Grèce, la Finlande, la Grande Bretagne. Au lieu d'être totalement interdite, ce qui favorise les transactions à l'étranger, cette pratique devrait être en France encadrée légalement, pour éviter les dérapages. Actuellement un enfant né du recours à une mère pour autrui ne peut être adopté par la compagne de son père - ne parlons même pas de son compagnon... Comment prétendre qu'on se préoccupe de l'intérêt de l'enfant ? J'en viens enfin à l'accès au mariage pour les couples de même sexe qui ont le choix entre l'union libre et le PACS, alors que les couples hétérosexuels ont une possibilité de plus. L'argument opposé à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe est celui de la filiation. Comme le dit Françoise Dekeuwer-Défossez, le mariage est la structure juridique « permettant de relier les enfants d'une femme à un homme par le biais de la présomption de paternité, permettant ainsi à cet homme de transmettre son nom, ses biens, sa situation sociale ». Pour être cohérente avec notre proposition de fonder le droit de la filiation sur une éthique de l'engagement et de la responsabilité, je dirais qu'il n'y a rien à changer au mariage pour qu'il devienne un mariage universel, ouvert à tous. La présomption de paternité c'était l'engagement d'un homme à être le père des enfants qui naîtraient dans le cadre du mariage. Eh bien, elle doit devenir une présomption d'engagement parental, qui sera la structure juridique apte à relier les enfants nés ou adoptés dans le cadre du mariage par le biais de l'engagement parental et permettant ainsi aux membres d'un couple, qu'ils soient de même sexe ou de sexe différent, de transmettre leur nom, leurs biens et leur situation sociale. II nous semble nécessaire d'appliquer sans limitation le principe de non-discrimination. La réalité des familles homoparentales est telle aujourd'hui qu'elles ne peuvent plus être laissées dans le non-droit. Leurs enfants doivent bénéficier de la même protection que les autres. Il appartient à la loi de donner une place à ceux qui ont rendu possible la venue au monde de l'enfant, à ceux qui s'engagent auprès de lui. La filiation juridique doit être cohérente avec l'environnement familial afin que l'enfant se sente en sécurité. Elle doit être fondée sur une éthique de la responsabilité et non sur le primat du biologique. Je vous invite enfin, pour approfondir cette réflexion et pour prendre connaissance des travaux scientifiques réalisés tant en France qu'au Québec, aux États-Unis et dans d'autres pays d'Europe, à vous rendre les 25 et 26 octobre 2005 à la conférence internationale sur l'homoparentalité organisée avec le soutien du Centre national de la recherche scientifique, de I'Institut national d'études démographiques, de l'École des hautes études en sciences sociales. Je vous prie de m'excuser d'avoir été si longue. M. le Président : Si mes collègues n'ont pas encore répondu à l'invitation à ce colloque, c'est que l'organisation de l'agenda parlementaire nous empêche de nous engager aussi longtemps à l'avance, mais je les invite à y participer nombreux. Quant à la durée de votre intervention, elle se comprend fort bien car vous avez abordé des questions très complexes, comme nous avons pu nous en rendre compte en Belgique et aux Pays-Bas. M. Eric Verdier : Je vous remercie de m'avoir invité à vous présenter les principales revendications de Coparentalité. J'ajouterai à la présentation que vous avez faite tout à l'heure que je suis aussi co-auteur des ouvrages Homosexualité et suicide et Petit manuel de gayrilla à l'usage des jeunes. Je suis également chercheur à la Ligue des droits de l'homme et il m'est donc difficile de distinguer la compréhension de la situation des familles aujourd'hui, l'analyse des rapports de sexe et de genre et l'évolution des identités masculines et féminines d'une part, de mon positionnement associatif d'autre part. Pour nous, la coparentalité n'est pas uniquement un contexte qui relie des gays et des lesbiennes, mais un concept d'équité parentale, quel que soit le sexe des deux parents, qu'il s'agisse d'un homme et d'une femme, de deux hommes ou de deux femmes. Nous comptons d'ailleurs désormais parmi nos adhérents une majorité de personnes qui se disent hétérosexuelles. Nous nous intéressons donc globalement à ce qui, dans les avancées sociales, transforme profondément la famille et la façon dont elle est traitée par la loi. J'ajouterai, ce qui vous semblera peut-être un peu provocateur, que le mot « homoparentalité » nous paraît homophobe car il entretient l'idéologie véhiculée par des personnes qui sont opposées à ce que les parents homosexuels aient les mêmes droits que les autres parents et que les enfants soient protégés dans leurs liens avec leurs parents. En effet, il laisse à penser qu'il s'agit de familles à part, alors que nous considérons qu'il y a autant de diversité dans les compositions familiales lorsqu'il s'agit d'hétérosexuels. Il est donc plus judicieux de parler de familles adoptives ou recomposées que de les distinguer selon qu'un des parents est ou non homosexuel. Le non-respect du lien entre un enfant et un de ses parents est un acte d'une grande violence, qui a des effets catastrophiques pouvant aller jusqu'au suicide. C'est donc sur la protection de ce lien que nous concentrons nos efforts. Face à la diversité des compositions familiales contemporaines, nos repères et nos lois sont inopérants. La caution que les magistrats donnent presque systématiquement, malgré la réforme de 2002, à la toute-puissance d'un seul parent sur l'enfant a des conséquences dramatiques, comme le montrent le taux record de suicide chez les parents exclus de leur relation à l'enfant et la recrudescence de l'aliénation parentale. Pourtant, la conjugalité concerne deux individus qui vivent, quel que soit leur sexe, une relation de couple, par définition soumise aux aléas de la vie. Si la parentalité, fondée sur la relation à l'enfant, est éternelle, tel n'est pas le cas de la conjugalité. Mais jusqu'à présent, la confusion des deux registres ne permettait pas de sortir d'un jeu de dominations croisées entre les hommes et les femmes, dans lequel l'enfant était symboliquement le clone du parent de même sexe et la propriété du parent de sexe opposé. Les enfants passaient du monde des mères à celui des hommes, prisonniers des stéréotypes de la maternité pour les filles et de la virilité pour les garçons. À aucun moment dans l'histoire, ils n'ont été conjointement co-éduqués par leur père et leur mère. Ce n'est pas la famille qui est menacée aujourd'hui, mais des repères d'un autre âge, devenus obsolètes et discriminants. Toutes les formes contemporaines de la famille ont toujours existé, certaines opprimées et cachées. Il faut désormais les comprendre et les reconnaître pleinement. Par exemple, si un enfant a toujours deux parents biologiques, la loi bafoue cette primauté puisqu'un père ne peut pas engager une action en recherche de paternité. En outre, un enfant peut avoir un parent « de substitution », pas forcément du même sexe que le parent manquant, ou un parent « additif », le plus souvent conjoint d'un parent. Chacun d'eux devrait pouvoir compter sur la protection du lien avec l'enfant et se voir reconnus des droits et des devoirs codifiés. Car la coparentalité, c'est aussi reconnaître que deux parents valent mieux qu'un et que disqualifier un parent au profit de l'autre est destructeur pour l'enfant, mais aussi pour le parent qu'il sera. La notion de coparentalité est en train de devenir une nouvelle norme, avec, comme outil principal, la résidence alternée, incluant tous les modèles pour n'en bannir qu'un : celui de l'objétisation de l'enfant au profit d'un seul adulte, sa mère le plus souvent. Aussi pensons-nous qu'il est prioritaire de modifier le code civil afin de : - renforcer le principe de la résidence alternée, sur le principe de la parité, dès qu'un parent en fait la demande, hormis pour des motifs graves - une récente étude a montré que cette disposition de la loi de mars 2002 n'est pratiquement jamais appliquée - ; - permettre l'accès aux origines à chaque fois que c'est possible, via le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, et lever l'impossibilité pour un homme d'engager une action en recherche de paternité sans le consentement de la mère ; - permettre l'adoption pour les parents de substitution, quel que soit leur sexe et leur sexualité, et l'extension des droits et des devoirs parentaux aux parents additifs sans exiger l'accord de l'autre parent. Cette mesure bénéficierait au parent social qui est le second parent de l'enfant, ou à celui qui en est le troisième ou le quatrième lorsqu'il y a déjà un père et une mère. Mais on peut aussi envisager le cas de la séparation d'un couple homosexuel avec l'arrivée d'un troisième ou d'un quatrième parent qui serait également de même sexe ; - modifier la définition de « conjoints » pour considérer comme tels deux personnes liées par un contrat de mariage, pacsées, ou qui vivent en concubinage depuis au moins deux ans ; - remplacer le mot « époux » par le mot « conjoint » et les mots « père » et « mère » par le mot « parent ». Vous trouverez dans les documents qui vous ont été remis les références précises aux articles qu'il conviendrait de modifier. Y figurent également, pour étayer cette présentation : mon intervention dans le cadre du « Printemps des Assoces » en avril 2005 ; les statuts de notre association et la liste des membres d'honneur ; un article paru dans la revue de la Fédération des médiateurs familiaux, dans lequel nous remettons en cause la notion d'homoparentalité et nous posons celle de coparentalité comme socle de la parentalité aujourd'hui ; ma contribution en tant que chargé de mission à la Ligue des droits de l'Homme et président de Coparentalité, dans le cadre de la phase préparatoire à la conférence de la famille ; mes propositions, en tant que membre de la commission genre et violence du nouveau plan de santé publique « Violence et santé », incluant des recommandations pour lutter contre les discriminations dont sont victimes des parents, notamment pour prévenir la forte prévalence du suicide parmi ces derniers, tout particulièrement chez les pères. Vous trouverez enfin, en annexe, ma pré-étude sur cette question. M. le Président : Je vous remercie, comme l'ensemble des associations, de tous les documents que vous nous avez fournis ce matin, qui nous seront fort utiles. M. Alexandre Carelle : Homosexualités et socialisme a été créée il y a plus de vingt ans, au moment de la dépénalisation de l'homosexualité par Gaston Defferre et François Mitterrand. L'association est proche du parti socialiste sans en être pleinement membre, car elle rassemble des militants de gauche bien au-delà de ce seul parti. Elle réfléchit à l'ensemble des problématiques lesbiennes, gaies, bi et trans. Elle s'est beaucoup battue pour la création d'un statut pour les couples homosexuels et pour le PACS, et travaille maintenant sur l'ouverture du mariage aux couples de même sexe ainsi que sur toutes les questions de parentalité et d'adoption. Le contexte français se caractérise par la création du PACS et l'ouverture du concubinage, qui ont permis, depuis 1999, une reconnaissance sociale des couples homosexuels. Désormais, le principe d'égalité doit permettre que l'ensemble des couples, quelle que soit leur sexualité, aient accès à toutes les formes de conjugalité. S'agissant de la parentalité, la jurisprudence relative à l'application de la loi du 4 mars 2002 n'est pas stabilisée en matière de délégation d'autorité parentale, on l'a vu avec l'affaire Carla Boni. Dans le contexte international, je relève l'exemple de la Belgique, qui a ouvert le mariage mais en créant un mariage restreint et en faisant une différence entre couples hétérosexuels et homosexuels, les derniers n'ayant pas accès aux mêmes droits, en particulier à l'adoption. Aux Pays-Bas, il existe plusieurs statuts : partenariat, concubinage et mariage, ce dernier étant totalement ouvert, avec les droits qui y sont liés en termes de parentalité. En Espagne, le 30 juin dernier, en vertu du principe d'universalité, le mariage a été ouvert quelle que soit la sexualité du couple. Nous assistons donc à un véritable mouvement européen d'affirmation de l'égalité des droits. Sur le fond, il semble très important de distinguer les différentes formes de conjugalité : nous souhaitons conserver à la fois le concubinage, le PACS et le mariage, qui représentent des conceptions différentes de la construction du couple. Nous préconisons un certain nombre d'améliorations du PACS, qui nous semble une forme moderne et originale du couple : enregistrement en mairie ; publicité par inscription en marge des registres d'état civil ; alignement de la fiscalité des successions sur celles des couples mariés ; possibilité de désigner le partenaire comme héritier réservataire ; extension aux partenaires successifs des dispositions relatives au logement temporaire et au viager ; toilettage des dispositions relatives aux droits sociaux dans les différents codes afin de mentionner le PACS partout où il n'est pour l'instant fait référence qu'au mariage ; ouverture du contrat aux détenus ; droit à une pension de réversion après deux ans de contrat ; amélioration de la situation des couples bi-nationaux. L'égalité des droits doit conduire à ouvrir le mariage aux couples de même sexe, et nous avons conscience que c'est un véritable choix de société qu'il vous est ainsi demandé de faire. Il convient en effet d'aller vers une reconnaissance complète des couples, sans discrimination et quelle que soit leur orientation sexuelle. Pour cela, il suffirait de remplacer, dans un certain nombre d'articles, l'expression « mari et femme » par le mot « époux » et de procéder à un fastidieux mais indispensable toilettage des textes. S'agissant de la parentalité, je dirai qu'il n'y a pas plus d'homoparentalité qu'il n'y a de mariage gay : il y a des familles, sous des formes différentes mais sans spécificité liée à l'orientation sexuelle des parents. Nous demandons que tous les couples, qu'ils soient concubins, pacsés ou mariés, puissent adopter, sans discrimination en fonction du sexe des membres du couple. L'adoption par un célibataire ne doit pas faire l'objet d'une discrimination sexuelle et l'adoption de l'enfant du conjoint doit être ouverte à tous les couples, afin d'aller plus loin dans l'application de la loi du 4 mars 2002. Je rejoins ce qu'a dit Laurent Chéno sur la nécessité de modifier l'article 377 du code civil pour qu'il soit possible aux parents, en cas de commun accord, de saisir le juge afin de déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale. Il conviendrait aussi de modifier la liste des tiers susceptibles de bénéficier d'une telle délégation pour y intégrer le partenaire d'un PACS et le concubin. Il est également important que le changement d'identité de genre du parent biologique ne puisse plus être un motif de retrait d'autorité parentale. Un certain nombre de femmes, hétérosexuelles comme homosexuelles, ont recours à la procréation médicalement assistée dans des pays voisins. La légaliser sur le territoire français permettrait à l'évidence un meilleur contrôle et un meilleur suivi. Je l'ai dit, c'est à un véritable choix de société que vous êtes confrontés. Présent il y a quelques jours à Madrid à l'occasion du vote de la nouvelle loi, j'ai rencontré un conseiller municipal de Saint-Sébastien qui m'a dit que, s'il avait longtemps espéré que l'Espagne devienne la disciple de la France, pays des droits de l'homme, il lui apparaît aujourd'hui que l'élève a dépassé le maître. J'ai bien été obligé de reconnaître qu'il avait raison... M. Stéphane Dassé : Je vous remercie de nous recevoir, et je remercie le Président Jean-Louis Debré qui, en décidant la constitution de la Mission d'information sur la famille et les droits des enfants, a souhaité qu'elle se saisisse notamment du volet relatif à la parentalité dans les couples de même sexe. On n'est plus dans le registre du fantasme, puisque la parentalité chez les gays et les lesbiennes concerne au moins cent mille enfants, voire le double, car l'INSEE requalifie les données en attribuant les enfants concernés à des célibataires. La réalité étant celle-là, des réponses fiables sont nécessaires pour garantir l'égalité de traitement entre toutes les familles. De plus, un mouvement de libération et de reconnaissance est enclenché, qui touche les gays et les lesbiennes après avoir touché les femmes et les minorités ethniques et religieuses, et l'histoire enseigne que rien ne peut arrêter les mouvements de libération, particulièrement lorsqu'ils sont fondés sur des revendications égalitaires. Ce mouvement traduit de fortes attentes, notamment le besoin légitime de créer une famille, mais aussi une profonde aspiration à la « normalisation » : ce qui s'exprime, c'est l'envie pure et simple de vouloir vivre comme « Monsieur et Madame Tout-le-monde ». Depuis trois ans, Gay Lib fait avancer ce dossier au sein de l'UMP. Des progrès significatifs ont déjà été obtenus grâce à la collaboration avec le groupe parlementaire et avec le Gouvernement : l'aggravation des sanctions pénales encourues à la suite d'agressions homophobes ; la création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ; la pénalisation des propos homophobes, qui réprime le fait d'injurier gratuitement. L'association Gay Lib a aussi apprécié que la loi de finances pour 2005 ait prévu l'amélioration des dispositions fiscales relatives au PACS, et se félicite que le président de la République ait annoncé en 2002 le processus d'amélioration du PACS, dispositif qui ne tient aujourd'hui qu'à moitié debout. S'agissant de la famille, nous considérons que toute proposition est recevable à condition qu'elle respecte l'intérêt de l'enfant, notion qui n'est cependant pas opposable au désir, naturel, de parentalité. Il s'agit d'une question de responsabilité et d'engagement plus que d'un simple droit. C'est dire que la capacité éducative des parents doit primer sur la composition de la famille et l'orientation sexuelle des parents. Le cadre étant ainsi tracé, quelles modifications législatives seraient souhaitables ? Gay Lib place au premier plan l'amélioration du PACS. Le chantier a été ouvert lorsque M. Dominique Perben, alors garde des Sceaux, a installé en 2004 un groupe de réflexion, auquel Gay Lib a participé. Dans le rapport qu'il a rendu, le groupe recommande l'amélioration du régime primaire du PACS dans son volet relatif à l'aide mutuelle et au devoir d'assistance et la modification du régime des biens. Le régime obligatoire est actuellement celui de l'indivision, à la fois contraignant et dangereux. Le groupe a proposé que la séparation de biens devienne le régime par défaut, quitte à ce que les personnes pacsées qui le souhaitent choisissent l'indivision. Il a encore recommandé l'allégement des droits de succession dus par le partenaire survivant, ainsi que le bénéfice d'une pension de réversion. Le groupe n'a pas abordé la question de l'adoption éventuelle de l'enfant de la personne pacsée décédée par le partenaire survivant au cas où il n'y aurait pas d'autre parent légal. S'agissant du mariage, les attentes considérables qui se manifestent sont renforcées par l'évolution internationale, qui s'arrête à nos portes. Gay Lib espère que la France, patrie des droits de l'homme, ne sera pas la dernière à adopter le principe de l'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe. Ses militants et ses élus, porteurs des valeurs de la droite, considèrent que l'accès au mariage civil est conforme aux valeurs d'engagement et de responsabilité qui sont les leurs. Lors d'un divorce, il arrive encore fréquemment qu'un parent soit pénalisé, soit qu'il assume son homosexualité, soit que la partie adverse, pas forcément bienveillante, se charge d'en informer le juge. En aucun cas l'orientation sexuelle ne doit être motif à priver un enfant de l'un de ses parents ; seule la capacité éducative doit être prise en compte au moment de la détermination de l'autorité parentale et du lieu de garde. S'agissant de l'adoption, on sait que les personnes pacsées ne peuvent adopter et qu'un gay ou une lesbienne qui souhaite le faire doit se faire passer pour un célibataire hétérosexuel. Contraindre à de tels mensonges n'est pas acceptable dans un pays moderne. Les seules questions qui vaillent demeurent sans réponse : pourquoi les gays et les lesbiennes auraient-ils des capacités éducatives inférieures à celles des hétérosexuels ? Quelles études montrent un déséquilibre chez les enfants élevés par des couples du même sexe ? Comment expliquer que les enfants des foyers monoparentaux ne souffriraient pas du manque d'altérité si souvent opposé aux couples homosexuels qui souhaitent adopter ? La procédure d'agrément doit être fondée sur les capacités éducatives et sur les conditions de vie offertes à l'enfant et non sur l'orientation sexuelle des personnes qui souhaitent adopter. Cela dit, il est inutile de se voiler la face : à ce jour, faute d'enfants adoptables en nombre suffisant en France, quatre enfants sur cinq sont adoptés à l'étranger et, en raison d'une homophobie persistante, les gays et les lesbiennes qui se présentent dans ce but sont relativement mal accueillis. Aussi convient-il de traiter des autres modes de conception et de l'évolution législative qui pourrait les accompagner. Pour ce qui est de l'assistance médicale à la procréation, on connaît les « bébés Thalys », nés des milliers de femmes parties se faire inséminer en Belgique, la législation française ne reconnaissant pas ce droit aux lesbiennes. Il est intéressant de constater que, dans les hôpitaux bruxellois, on accorde plus d'intérêt aux demandes de procréation qui émanent de couples de femmes qu'à celles formulées par les femmes seules, car on considère que les premières présentent plus de garanties pour l'enfant. Gay Lib souhaite qu'en France également l'accès à l'assistance médicale à la procréation soit fondé sur la solidité du projet parental du couple et non sur sa composition. Cette évolution est nécessaire dans un pays moderne. Je ne cacherai pas que la maternité pour autrui est un sujet qui nous met mal à l'aise à cause des risques d'instrumentalisation du corps de la femme et de mercantilisme qu'elle peut présenter dans certains pays. Il n'empêche que l'on peut légalement être mère porteuse dans une trentaine de pays. La question concerne autant les gays que les hétérosexuels, et de nombreux couples ont recours à cette technique aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Nous souhaitons qu'au retour en France, le juge ne puisse retirer à ces couples l'autorité parentale, ce qui serait monstrueux et contraire à l'intérêt de l'enfant. Gay Lib propose donc que la loi considère qu'il y a eu adoption à l'étranger lorsque les couples, hétérosexuels ou homosexuels, ont eu recours à ce mode de conception dans le respect des lois du pays de résidence de la mère de substitution. Pour ce qui est de la coparentalité, l'important est de stabiliser la situation. Ceux qui décident de devenir parents s'engagent pour vingt-cinq ans au moins. Il convient donc d'instituer le statut du beau-parent, statut qui doit valoir pour tous dans un pays où un mariage sur deux s'achève par un divorce. Les modalités régissant la délégation d'autorité parentale doivent donc être modifiées. Le beau-parent participe aux actes de la vie quotidienne de l'enfant, mais son implication peut varier. Aussi, Gay Lib propose des contrats à géométrie variable, tenant compte du fait qu'être beau-parent est un statut évolutif et qu'un parent est susceptible d'avoir plusieurs partenaires au cours de sa vie. Il convient d'assouplir les conditions de la délégation d'autorité parentale en instituant un contrat entre le parent, le beau-parent et l'enfant s'il a plus de treize ans, contrat signé devant un notaire chargé de vérifier sa conformité avec la loi et l'ordre public. La délégation viserait essentiellement les actes de la vie quotidienne. Toute personne ayant un intérêt auprès de l'enfant, les grands-parents par exemple, pourraient demander que le contrat soit examiné par le juge aux affaires familiales, juge dont l'intervention serait systématique en cas de désaccord. Le nouveau statut de coparentalité permettrait également d'aménager les règles de succession. Cette innovation de très grande portée toucherait un grand nombre de foyers. Gay Lib demande, ni plus ni moins, l'égalité des droits et des devoirs pour toutes les familles. On évalue à une fourchette comprise entre quatre et cinq millions de personnes le nombre de gays et de lesbiennes en France. Il faut les reconnaître et leur apporter la garantie de l'égalité de traitement. Ce sont des électeurs et des contribuables, et ni eux ni les enfants concernés ne comprendraient pourquoi ils devraient continuer à ne pas être considérés comme des citoyens à part entière. M. le Président : Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à ceux de mes collègues qui souhaitent poser des questions. M. Jean-Marc Nesme : J'ai écouté avec beaucoup d'attention les exposés qui viennent d'être faits et dont la teneur était déjà connue, puisqu'elle fait l'objet de nombreux communiqués, sur l'Internet notamment. Je reconnais la cohérence redoutable de votre démonstration, ce qui ne signifie pas que je partage votre point de vue. Vous partez en effet d'un postulat que je n'approuve pas : l'idéologie du genre, venue d'Amérique du Nord, et selon laquelle on devrait substituer à la différence sexuelle la différence des sexualités. Nous sommes là pour écouter tout le monde, mais nous devons savoir que vos revendications, qui ont la même légitimité que d'autres, ont pour finalité, si l'on accédait à vos demandes, une révolution anthropologique, culturelle, juridique, et donc politique. Cette idéologie nord-américaine est fondée sur l'idée que le genre est une construction indépendante du sexe, un artifice. De ce fait, le terme « homme » pourrait désigner indifféremment un corps féminin ou un corps masculin. Cette conception, que je n'accepte pas, induit l'idée de la neutralité du mariage et des relations familiales, qui peuvent réunir un homme et une femme mais aussi deux femmes ou deux hommes. Dans une telle construction intellectuelle, il n'y a plus lieu de distinguer le père et la mère ; il faut s'en tenir à un terme neutre, celui de « parent ». En niant ainsi des différences morphologiques évidentes, on prétend que la distinction entre l'homme et la femme serait une simple construction culturelle, sociale et politique qui a eu cours dans toutes les sociétés de la planète, depuis des millénaires. À partir de ce postulat, on s'emploie à construire une société de fiction dans laquelle tout est possible. Or, l'homosexualité est une réalité privée, qui ne fonde pas le lien social et qui ne peut donc devenir une norme parmi d'autres. La présenter comme telle, c'est révolutionner la société, qui ne serait plus organisée en fonction du bien commun mais fondée sur des singularités qui finiraient pas desservir la cohésion sociale. On constate d'ailleurs que toutes les sociétés de l'histoire ont buté sur le statut à donner à l'homosexualité. Et pour vous montrer que mes propos ne sont pas inspirés par mon opinion politique, je me limiterai à citer les propos tenus le 16 mai 2004 par l'ancien Premier ministre : « Le mariage est, dans son principe et comme institution, l'union d'un homme et d'une femme. Cette définition n'est pas due au hasard. Elle renvoie non pas d'abord à l'inclination sexuelle mais à la dualité des sexes qui caractérise notre existence et qui est la condition de la procréation et donc de la continuation de l'humanité ». Je considère que ni l'État ni le législateur n'ont à prendre en charge la vie sentimentale des citoyens ou à reconnaître leurs attirances affectives et sexuelles. Leur rôle, c'est de mettre en valeur des distinctions fondamentales. Nous sommes, Dieu merci, dans un État de droit, et le droit existe pour mettre de la clarté dans les faits et pour hiérarchiser les valeurs. Or, en vous entendant, je me demandais : qu'en est-il de l'enfant ? Vous parlez d'égalité des droits, mais ce sont les personnes qui sont sujets de droits, droits dont certains dépendent de la situation dans laquelle chacun se trouve. Pourquoi désirer se marier quand on n'est pas dans l'altérité sexuelle ? Pourquoi vouloir adopter des enfants quand on vit dans une situation contraire à la procréation ? Pourquoi demander à la société un « droit à l'enfant » qui est contraire à son intérêt et à la lisibilité de la filiation ? Demandons-nous plutôt si les enfants ont le droit de ne pas avoir des adultes homosexuels qui se présentent comme des parents. L'enfant n'est ni un droit Quant à l'antienne de l'« égalité d'accès aux droits », elle finit, à force d'être invoquée, par souffrir de ce que les lexicologues qualifient de surcharge sémantique : à trop vouloir signifier, elle risque de ne plus signifier rien. À force de répétitions, on risque d'effacer le respect des différences. Je respecte les personnes homosexuelles comme toutes les autres personnes, mais je ne souhaite pas que l'on détruise, que l'on déstructure et que l'on déstabilise ce que les sociétés ont mis des milliers d'années à construire, et je fais appel au principe constitutionnel de précaution. Équilibre de tous devant la loi ? Certes, mais devant une loi qui définit différemment des réalités différentes et qui fixe des interdits, comme c'est le rôle du législateur. J'ajoute que les revendications qui viennent de s'exprimer sont non seulement contraires à la législation française, bien sûr, mais aussi à une jurisprudence européenne constante, que ce soit celle de la Cour de justice des Communautés européennes ou celle de la Cour européenne des droits de l'homme qui, toutes deux, définissent le mariage comme liant deux personnes de sexe différent. Elles sont également contraires à l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme je l'ai rappelé dans l'hémicycle, le 12 avril dernier, pour m'opposer à des amendements favorables à l'adoption par des homosexuels. Ainsi, non seulement vos revendications bousculent l'organisation anthropologique, sociale, culturelle et politique de la société française et des sociétés en général, mais elles sont en contradiction avec notre législation, avec la jurisprudence européenne et avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certains d'entre vous ont fait référence à des études nord-américaines censées consolider vos thèses en déterminant que l'intérêt de l'enfant est pris en compte. J'ai eu la curiosité de les consulter, et j'ai constaté que ce sont des études orientées, pour ne pas dire des études alibis. À la question : « Constate-t-on une différence selon qu'un enfant est éduqué par un père et une mère ou par deux personnes du même sexe ? », toutes répondent qu'il n'y en a aucune. Mais ces conclusions reposent sur un échantillon singulièrement restreint, qui s'échelonne de onze à vingt-et-une réponses, exception faite d'une étude qui porte sur trente-huit cas. Quant à la thèse de médecine que M. Stéphane Nadaud a consacrée au même sujet, elle fait allusion à neuf pères homosexuels mariés. Comment prétendre sérieusement tirer la conclusion péremptoire qu'il n'y a « aucune différence » d'un échantillon aussi restreint ? M. Nadaud admet quand même que 41 % des enfants ayant fait partie de son enquête sont l'objet d'un suivi spécialisé. On n'en sait pas davantage sur les raisons de ce suivi, mais il y a lieu de s'interroger. Le deuxième motif d'étonnement, c'est l'âge des sujets sur lesquels les enquêtes ont porté : aucun adolescent ni aucun adulte n'a été interrogé, et ce sont seulement les « parents » d'enfants en très bas âge qui ont répondu. L'inimaginable raison invoquée pour expliquer cette procédure, c'est qu'il est très difficile de rencontrer les enfants en raison de la stigmatisation dont souffrent les « parents », qui tiennent à les protéger... Troisième sujet d'étonnement : ces études, très peu nombreuses et portant sur un échantillon très faible, vont dans le même sens, ce qui me conduit à les dire orientées. C'est l'intérêt de l'enfant qui m'intéresse, et non celui de l'adulte. Pour y voir clair, je souhaite que des études scientifiques sérieuses soient mises à notre disposition qui permettent de répondre à la seule question qui vaille : comment pouvons-nous prendre en compte l'intérêt des enfants ? La jurisprudence communautaire et le droit international ont déjà répondu à cette question : en leur donnant pour parents un homme et une femme. M. le Président : Je suis désolé de ne pas avoir prévenu la Mission qu'elle auditionnerait une sixième personnalité ; c'est maintenant chose faite... M. Pierre-Louis Fagniez : Je n'ai pas de déclaration à faire, mais seulement à dire à nos invités qu'en les entendant je pensais au général de Gaulle « s'envolant vers l'Orient compliqué avec des idées simples »... J'avais eu la même sensation lorsque la Mission Leonetti s'interrogeait pour savoir s'il convenait de légaliser l'euthanasie. Que l'on remplace le mot « euthanasie » par les mots « mariage homosexuel » et l'on comprend l'ampleur de la réflexion nécessaire. Certains orateurs viennent de faire valoir que nous devrions agir sous la pression de nos voisins. Le même argument a été utilisé lorsque nous traitions de la fin de vie et, à ce moment déjà, certains nous expliquaient que nous devions suivre l'exemple belge ou néerlandais. Finalement, c'est une loi considérée comme exemplaire qui a été adoptée, mais c'est un texte unique au monde, et c'est un texte français. Je suis dans le même état d'esprit pour le sujet qui nous occupe maintenant. En vous entendant parler de l'assistance médicale à la procréation, j'ai pensé que c'est une très bonne idée d'en appeler à la création d'un conservatoire des origines, et il n'est pas impossible que nous y revenions quand nous réviserons la loi de bioéthique. En revanche, je déconseille d'utiliser le terme « maternité pour autrui » lorsqu'il faudrait dire « gestation pour autrui », car ce sont choses très différentes et j'imagine que tous ceux qui sont attachés, avec raison, aux nuances sémantiques, percevront qu'en cette matière tous les mots comptent. Il me semble avoir perçu un dénominateur commun à toutes les déclarations : les gens de même sexe qui vivent ensemble aimeraient pouvoir adopter des enfants sans tricher. Votre proposition n'est-elle, en fait, pas d'ouvrir la possibilité d'adoption aux personnes pacsées ? M. Patrick Delnatte : Les droits de l'homme ont été évoqués plusieurs fois, mais les droits de l'enfant sont, eux aussi, reconnus par le droit international, et notamment le droit à un père et à une mère. Il est de la responsabilité des adultes de les faire respecter. Le principe de réalité leur permet-il de s'exonérer de cette responsabilité ? Mme Nadine Morano : La Mission d'information sur la fin de vie s'est déroulée de manière exemplaire, et l'on a constaté l'évolution progressive des esprits. Pour ce qui concerne la présente Mission, j'y participe en ma qualité de députée, bien sûr, mais aussi de mère de trois enfants, et sans a priori. Pour moi, parler des droits de l'enfant, c'est dire que tous les enfants doivent avoir les mêmes droits, quelle que soit la famille dans laquelle ils vivent. On nous parle de cent mille enfants : leurs droits aussi doivent être respectés, qu'il s'agisse de leur protection, des droits de succession ou de l'autorité parentale. Je ne considère pas avoir à juger leurs parents, mais je me rappelle que l'arrêt du 2 juillet 2004 conférant à deux femmes l'autorité parentale conjointe sur leurs trois filles a suscité une grande émotion dans l'hémicycle. Ce jour-là, je me suis posée des questions simples, celles d'une mère : qui s'occuperait des enfants si leur mère biologique disparaissait ? Qui laverait leur linge, qui irait les chercher à l'école ? Une réflexion sur l'autorité parentale s'impose, avec l'idée que tous les enfants ont les mêmes droits et que ces droits doivent être respectés, et je félicite les associations pour la réflexion juridique minutieuse à laquelle elles se sont livrées. S'agissant de l'adoption, on peut se poser la question de l'effectivité de mesures éventuelles, considérant qu'il n'y a pas assez d'enfants adoptables en France pour les familles traditionnelles. Pour ce qui est du livret de l'enfant, je suggère d'en rester au livret de famille classique, justement pour éviter tout risque de stigmatisation. Je considère aussi qu'il faut réfléchir au statut du beau-parent ainsi qu'à la possibilité d'une dévolution de succession à l'enfant s'il vit avec un parent co-accompagnant. Enfin, j'ai été très sensible à l'importance attachée au vocabulaire utilisé, très respectueux de tous. J'ai reçu une éducation traditionnelle, j'ai été élevée chez les sœurs, et je suis convaincue que pareil sujet exige une ouverture d'esprit de la part des parlementaires, dont la mission est d'observer l'évolution de la société et de prendre des mesures tenant compte à la fois de la réalité et de l'intérêt de l'enfant. Mais, comme l'a souligné Jean-Marc Nesme, il serait important que nous disposions d'études reflétant l'opinion personnellement exprimée par les enfants concernés. M. Pierre-Christophe Baguet : Je remercie les différents intervenants de la manière dont ils ont présenté leurs revendications. Je la préfère à la profanation scandaleuse dont Act Up s'est rendue coupable à Notre-Dame-de-Paris, procédé qui dessert profondément votre cause. M. Stéphane Dassé : Procédé que certains d'entre nous ont condamné. M. Pierre-Christophe Baguet : Pour moi, ce qui fait une famille, c'est un homme, une femme et un ou des enfants. Je ne suis donc pas très favorable au mariage homosexuel et à l'adoption par des homosexuels. En revanche, je pense que d'autres pistes doivent être explorées, et j'ai noté que plusieurs associations sollicitent l'amélioration du PACS. Cette demande fait-elle consensus ? Quelles sont vos priorités ? J'ai entendu une demande récurrente, qui me semble légitime, d'ouverture de droit à une pension de réversion. Je pense également qu'il faut creuser la question du statut du beau-parent, et j'aimerais savoir si cette revendication est également consensuelle. Mme Annick Lepetit : La portée des questions abordées suppose l'approfondissement de la réflexion, qui aura lieu, puisque la Mission est loin d'avoir achevé ses travaux. Je remercie les représentants des associations invitées d'être tous venus, ce qui n'a pas été le cas lors d'une précédente table ronde réunissant les associations familiales. M. Pierre-Christophe Baguet : Il n'y a pas lieu de polémiquer sur ce point, car les conditions n'étaient pas les mêmes. Mme Annick Lepetit : Je souhaiterais un peu de tolérance, mais je sais que c'est difficile pour certains. Je persisterai donc à remercier les personnalités que nous avons entendues, qui ont conduit des travaux fouillés et qui nous ont apporté une importante documentation. Je souhaite que certains sujets soient encore approfondis, et singulièrement ce qui a trait aux formes de la parentalité et de la coparentalité. Je retiens que les associations ont insisté sur la pluralité des familles. Cela rejoint les propos des associations familiales qui ont daigné répondre à l'invitation de la Mission, et qui considèrent que la définition de la famille prévue par la loi régissant le mouvement familial ne tient pas compte de l'évolution de notre société. Le fait que l'on parle désormais « des » familles est d'ailleurs, en soi, la traduction de cette évolution. M. Sébastien Huyghe : Je suis favorable à une évolution, mais pas forcément à une révolution. Je suis d'ailleurs convaincu que si l'on souhaite faire aboutir des réformes, il faut procéder pas à pas, au risque, à vouloir aller trop vite, d'une montée de l'homophobie, résultat inverse de celui espéré. Il n'est pas nécessaire de pointer ceux qui ont une façon différente de vivre leur sexualité. L'urgence est de modifier le PACS et ses dispositions relatives à la succession, à la fiscalité et à la protection sociale, afin que chacun puisse vivre comme il le souhaite de manière harmonieuse. Mme la Rapporteure : De son voyage d'information en Belgique et aux Pays-Bas, la Mission a retenu qu'un dernier tabou n'a pas sauté : un enfant ne peut avoir plus de deux parents. Pourtant, dans bien des cas de coparentalité, il y a en réalité trois ou quatre parents au cœur du projet parental. On constate un blocage complet à ce sujet tant dans la législation belge que dans la législation néerlandaise. Ainsi, nous avons rencontré aux Pays-Bas deux homosexuels mariés qui ont construit un projet de « coparentalité » avec deux lesbiennes, mais qui, bien que l'un d'entre eux soit le père biologique, n'exercent pas l'autorité parentale. Quels seraient les droits de ces hommes en cas de désaccord avec le couple de femmes ? Lorsqu'un projet parental se fait à plusieurs, comment s'établissent les relations juridiques ? M. le Président : Je remercie celles et ceux qui, par leurs interventions, ont restitué le débat qui agite la Mission et l'Assemblée dans son ensemble. Notre collègue Jean-Marc Nesme nous avait déjà fait connaître son opinion lors de l'examen du projet de loi relatif à la HALDE. Pour ce qui me concerne, je suis sensible au discours républicain sur la revendication de l'égalité des droits, et à une démarche qui s'inscrit dans un mouvement plus large tendant à faire tomber une à une les discriminations, dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Charte des droits sociaux et de l'article 13 du Traité d'Amsterdam. Si j'insiste sur l'aspect républicain de la question, c'est parce que, lorsque les discriminations persistent trop longtemps, il arrive que les personnes discriminées se replient sur elles-mêmes, ce qui alimente le communautarisme. En d'autres termes, combattre les discriminations, c'est lutter contre le communautarisme. Je ne peux d'autre part m'empêcher de penser que ce qui est aussi revendiqué, c'est le droit, non à la différence, mais à l'indifférence quant à la vie privée. Je précise d'autre part que la table ronde organisée aujourd'hui et celle qui s'est tenue le 29 juin ont été préparées dans des conditions rigoureusement identiques. Pour ce qui s'est passé à Notre-Dame-de-Paris, j'ai tenu à rappeler, à titre personnel, que depuis 1905 c'est fort heureusement à l'Assemblée nationale que se fait la loi et non dans une cathédrale ou dans tout autre lieu de culte. Comme l'a indiqué Mme la Rapporteure, le voyage accompli par la Mission aux Pays-Bas et en Belgique a été d'un grand d'intérêt et source de nombreuses interrogations. Dans ces pays qui ont adopté le principe de l'adoption conjointe par deux personnes de même sexe, nous avons constaté que la législation demeure fondée sur le principe d'une famille de deux parents, alors qu'il y en a quatre. La Mission s'est donc interrogée sur les modalités de délégation de l'autorité parentale, question cruciale pour qui s'intéresse à l'intérêt supérieur de l'enfant. Si l'on part de la situation de fait, qui est que des dizaines de milliers d'enfants sont élevés par des couples de même sexe, et si l'on veut rendre leur situation stable, c'est sur ce point qu'il faut intervenir. Il faut donc traiter les questions dans l'ordre : partir de la situation de fait, aborder ensuite la question de l'adoption conjointe par des parents de même sexe en sachant qu'elle relève du symbolique car peu d'enfants seront concernés, et peut-être arriver, in fine, à la question de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe. S'agissant des questions pratiques, faudrait-il, selon vous, supprimer l'expression « enfant né de..... et de.... » actuellement utilisée pour désigner les parents adoptifs ? Et comment adapter la formule à partir du moment où l'adoption conjointe serait ouverte aux couples de même sexe ? Par ailleurs, je m'adresserai particulièrement à M. Stéphane Dassé qui, de par ses relations privilégiées avec le Gouvernement, dispose peut-être d'informations sur le calendrier envisagé pour la réforme du PACS dont la présentation au conseil des ministres a été retardée. Les modifications envisagées correspondent-elles à ce que vous souhaitiez ou les jugez-vous insuffisantes ? M. Stéphane Dassé : M. Jean-Marc Nesme, l'accès des gays et des lesbiennes à la parentalité et au mariage civil ne détruira pas les fondements de la société française. Mme Nadine Morano a d'ailleurs opposé le principe de réalité, qui nous anime, au principe de précaution que vous avez évoqué. L'idéologie à laquelle vous avez fait allusion existe peut-être, mais pour ce qui nous concerne, nous partons du constat de la réalité, qui est que plusieurs millions de citoyens français sont concernés par l'homosexualité. Nous n'avons pas choisi cette situation, mais elle existe et, loin de ne concerner que la vie privée, elle a toutes sortes de conséquences sociales. Aussi, pour que chacun puisse vivre bien et pour que nous puissions bien vivre tous ensemble, le législateur doit trouver des réponses pertinentes. Que des enfants soient adoptés par des couples homosexuels ne fera pas vaciller la société. Quant à la hiérarchie des valeurs, elle est éminemment évolutive. Faut-il rappeler que le droit de vote a longtemps été refusé aux femmes pour des raisons plutôt scabreuses ? Faut-il rappeler qu'au XIXème siècle, on refusait les mariages interreligieux, au motif, justement, que cela mettrait la société en danger, ce que plus personne n'oserait faire ? Il faut prendre du recul, car la hiérarchie des valeurs n'est pas gravée dans le marbre. Notre société bouge beaucoup, et elle est ouverte à son environnement international. Mme Nadine Morano : Il n'y a pas si longtemps, on montrait encore du doigt les enfants de divorcés ! M. Jean-Marc Nesme : Ce n'est pas du même domaine. M. Stéphane Dassé : M. Pierre-Louis Fagniez a demandé si l'une des revendications des associations est l'ouverture de l'adoption aux partenaires d'un PACS : oui, bien sûr. C'est d'ailleurs une incohérence que cette possibilité soit ouverte aux concubins, libres de tous liens, et interdite aux personnes pacsées, qui ont pourtant des liens contractuels. Mais, même en cas d'ouverture de l'adoption aux couples pacsés, l'attente restera forte pour que les couples du même sexe accèdent au mariage civil. On notera à cet égard que 61 % des Espagnols se sont déclarés favorables à cet accès. L'Espagne n'est pourtant pas précisément une société nordique. M. René Galy-Dejean : Puisque vous évoquez l'Espagne, imaginez-vous un seul instant que vos revendications puissent enrayer le suicide démographique qui guette l'Espagne ? M. Stéphane Dassé : Que le mariage et la parentalité suscitent des attentes fortes parmi les gays et les lesbiennes n'a que peu à voir avec le déclin démographique constaté dans les pays voisins - mais pas en France -. Nous sommes au contraire très attachés à l'idée de la famille, et notre accès à la parentalité la consoliderait, tout en tordant le cou à l'homophobie chronique, en démontrant que gays et lesbiennes peuvent, comme les hétérosexuels, élever des enfants dans des familles reconnues comme telles. En quoi cela pourrait-il nuire à la natalité ? S'agissant du calendrier, le Gouvernement avait prévu l'inscription de l'examen de la réforme du PACS à l'ordre du jour du conseil des ministres du 15 juillet, mais, étant donné l'encombrement du programme de travail du Conseil d'État lié à la promulgation des ordonnances, la présentation du texte au conseil des ministres a été différée à fin septembre. Nous ne disposons pas d'informations particulières sur sa teneur, mais le groupe de réflexion installé par M. Dominique Perben avait repris nos priorités qui portent, je l'ai dit, sur le régime des biens, la pension de réversion et des aménagements fiscaux dans le cadre des successions. Et même si la suggestion ne figurait pas dans le rapport du groupe, Gay Lib se rallierait bien sûr à l'idée qu'un PACS puisse être conclu en mairie, car faire signer un tel engagement dans un tribunal, lieu de résolution des conflits et du prononcé des divorces, va à contre-courant de ce qui serait souhaitable dans un pays respectueux de ses citoyens. Pour ce qui est enfin de la coparentalité, Gay Lib considère qu'institutionnaliser le statut du beau-parent, qui prendrait par contrat un engagement légal quel qu'ait été le mode de conception de l'enfant, apporterait aux enfants une garantie pour tous les actes de la vie quotidienne bien supérieure au flou qui prévaut actuellement. Mme la Rapporteure : La question juridique de fond demeure, puisque même les législations qui ont ouvert le droit à l'adoption et élargi le statut du beau-parent considèrent toujours qu'il n'y a que deux parents. Que faire ? Il s'agit de questions très complexes, et je suis favorable à un droit civil limpide. M. Alexandre Carelle : Je souhaite préciser mon propos pour répondre à M. Pierre-Louis Fagniez. La création du PACS a montré que la France a sa spécificité législative ; j'ai simplement voulu dire que le mouvement général d'évolution vers l'égalité des droits en Europe nous oblige à réfléchir. L'éventualité d'une régression de la natalité avait déjà été évoquée au cours des débats sur le PACS ; sept ans plus tard, on constate que la France est le pays européen dont le taux de natalité est le plus satisfaisant. Ces questions doivent être dissociées car elles n'ont rien à voir. Pour ce qui est de la coparentalité, nous estimons qu'il faut restreindre l'appellation « parent » à deux personnes, le cas des autres personnes intervenant dans l'éducation quotidienne de l'enfant relevant de la délégation d'autorité parentale. Nos propositions d'amélioration du PACS figuraient déjà dans le rapport Bloche-Michel rédigé en 2001. Aujourd'hui, toutes les associations présentent des suggestions d'amélioration qui figurent dans les documents que nous vous avons remis. Je pense que le groupe de réflexion installé par M. Dominique Perben et qui poursuit ses travaux sous une autre forme, moins marquée par la concertation, tient compte de ces propositions, qu'il s'agisse de la succession, de la signature du PACS en mairie, de l'inscription en marge de l'état-civil ou de la pension de réversion. M. Laurent Chéno : Je souhaite revenir sur les propos de M. Jean-Marc Nesme pour m'étonner du procès fait à une idéologie par celui dont le discours fut, de tous les propos tenus lors de cette table ronde, le plus idéologique. Je verrais à la rigueur un lien entre la théorie du genre que vous avez complaisamment détaillée et la transsexualité, mais il y a quelque chose d'hallucinant à prétendre l'appliquer à la question qui nous occupe. Nous ne devons pas bien nous comprendre... M. Jean-Marc Nesme : Non ! M. Laurent Chéno : Ce que je cherchais à expliquer, en réfutant le terme « mariage homosexuel », c'est l'idée qu'il devrait y avoir un mariage hétérosexuel d'une part, un mariage homosexuel d'autre part. Pour nous, il devrait y avoir un seul mariage, ouvert à tous. Mais, s'agissant toujours de terminologie, j'ai noté que M. Sébastien Huyghe a parlé d'une « manière différente de vivre sa sexualité », comme si l'homosexualité était un comportement. S'exprimer ainsi, c'est refuser d'admettre, ou nier de façon détournée, que la notion d'orientation sexuelle a un sens. Aussi longtemps que ce problème de fond n'aura pas été réglé, on ne pourra avancer sur des bases raisonnables. J'ai été très sensible aux propos du Président Patrick Bloche, car il est vrai qu'à refuser l'égalité des droits on aboutit nécessairement à des formes de communautarisme. Or, s'il est un discours que nous refusons, c'est le discours communautaire. Je précise à ce sujet que Act Up ne fait pas partie de l'Inter-LGBT et que nous n'avons jamais approuvé ses pratiques ni ses méthodes, car nous avons toujours privilégié le dialogue institutionnel. L'ouverture de l'adoption aux personnes pacsées fait, bien sûr, partie de nos revendications car elle aurait une forte valeur symbolique. Mais elle serait d'une portée relativement limitée étant donné le faible nombre d'enfants adoptables en France. Il est donc évident que la réponse pratique à apporter aux familles passe également par l'assouplissement des conditions de délégation d'autorité parentale. Mme Martine Gross : Nous ne souhaitons pas que l'on s'en tienne à l'ouverture de l'adoption aux personnes pacsées car nous considérons que ni la parentalité ni la filiation, fondées sur l'engagement et sur la responsabilité parentale, ne doivent dépendre des aléas de la vie d'un couple d'adultes. Cet engagement et cette responsabilité doivent perdurer que les parents soient concubins, pacsés ou mariés. Pour ce qui est du vocabulaire, il nous paraît nécessaire de ne faire figurer la mention « né de... » ou « née de... » que dans l'acte de naissance intégral, et de lui substituer le terme « fils de ... » ou « fille de... » dans tous les autres documents administratifs. M. Pierre-Christophe Baguet : Ce n'est pas ce qui ressort du projet de « livret de l'enfant » que vous nous avez communiqué. Mme Martine Gross : Les mentions « né de... » ou « élevé par... » doivent aussi apparaître par souci de transparence et de préservation de l'accès aux origines, mais ces informations sont sans conséquence juridique : il s'agit de respecter l'existence séparée des aspects de la filiation qui, actuellement, ne coïncident pas toujours. Jusqu'à présent, le législateur a voulu faire coïncider ces aspects. J'en donnerai un seul exemple : on aurait pu, par souci de clarté, choisir l'adoption pour les pères stériles qui ont recours à l'insémination artificielle de donneur, mais on a préféré construire une fiction et faire croire que le père social est le père biologique. On demande en effet au père de ne jamais contester sa paternité biologique. Dans le dispositif que nous appelons de nos vœux, les droits et les devoirs ne sont dévolus qu'aux personnes engagées. Dans les situations de coparentalité, nous préconisons un statut de parent légal pour deux parents, parties prenantes du projet parental avant la naissance de l'enfant, et un statut de parent social pour leurs éventuels compagnon ou compagne respectifs, également parties prenantes du projet parental. Ceci est différent de la situation du beau-parent dans un foyer recomposé, car le beau-parent n'était pas partie prenante. Si, dans un second temps, un beau-parent souhaite s'engager et prendre le statut de parent social, il le pourra, avec l'accord des parents légaux. L'argument selon lequel les études seraient suspectes parce qu'elles vont toutes dans le même sens est un peu surprenant. Nous attendons toujours des études montrant que les enfants élevés dans les familles homoparentales ne vont pas bien. Les échantillons sont très faibles, c'est vrai, mais la population considérée est elle-même très peu nombreuse. Quant aux 41 % d'enfants suivis dont Stéphane Nadaud fait état, c'est un taux à rapprocher du taux d'enfants suivis dans les familles adoptives ou atypiques, où les parents, particulièrement vigilants, consultent à la moindre inquiétude. Par ailleurs, il est faux de dire que les enquêtes n'auraient porté que sur des enfants en bas âge. En particulier, l'étude de Fiona Tasker et Susan Golombok, Grandir dans une famille lesbienne, porte sur une cohorte d'enfants suivis du jeune âge à l'âge adulte. M. Pierre-Christophe Baguet : La Mission peut-elle espérer se faire communiquer le rapport du groupe de travail installé par M. Dominique Perben et l'avant-projet de loi portant réforme du PACS, dont on peut imaginer qu'il est prêt, puisqu'il devait initialement être présenté au conseil des ministres dans deux jours ? M. Eric Verdier : J'ai été très choqué et très irrité par la manière dont M. Jean-Marc Nesme a présenté ses arguments, lesquels, quoi qu'il en dise, traduisent une homophobie de détournement, celle qui tolère les homosexuels mais ne les accepte en aucun cas comme citoyens. Ma colère vient surtout de ce que ce discours nie la situation des enfants. Je suis tout prêt à approfondir la question en faisant référence à M. Maurice Godelier, par exemple. À M. Pierre-Louis Fagniez, je répondrai que c'est le pragmatisme qui nous guide. Ces questions sont complexes ; soyons humbles, et formulons en premier lieu des propositions visant à limiter les dégâts, qui sont nombreux. Pour répondre à la question de M. Patrice Delnatte, il faut d'abord poser le principe de l'égalité entre le père et la mère d'un enfant, ce qui ne signifie pas mettre en position inférieure les autres formes familiales. On ne pourra combattre l'homophobie si l'on ne lutte pas, conjointement, contre le sexisme. Et, en matière de parentalité, les hommes en sont les principales victimes. Voilà pourquoi la résidence alternée doit être le principe de base, et la loi précisée à ce sujet. On constate qu'au Québec, où des progrès significatifs ont eu lieu dans la lutte contre l'homophobie, on a eu le tort de ne pas s'attaquer conjointement au sexisme anti-hommes. Il en résulte que les 65 enfants dont la filiation est désormais reconnue comme étant de personnes de même sexe sont des enfants de couples de femmes. Mme la Rapporteure : Nous avons effectivement été frappés de constater qu'aux Pays-Bas les nouveaux droits ont bénéficié aux couples lesbiens et sont restés théoriques pour les couples d'hommes. C'est l'un des problèmes qui se posent : vous demandez l'égalité des droits, mais ce à quoi l'on aboutit en fait, c'est à des couples de lesbiennes qui ont complètement évacué les hommes, qui risquent ainsi d'être victimes de discriminations. M. Eric Verdier : La parentalité biologique doit primer, quitte à ce que, si l'un des parents biologiques ne peut pas ou ne veut pas assumer ses responsabilités, la parentalité de substitution soit possible ; mais elle est refusée aux hommes. On comprend qu'en s'attaquant de front à l'édifice de la filiation et de la conjugalité, on produirait l'effet inverse à celui recherché. Voilà pourquoi nous privilégions la théorie du « grain de sable », qui consiste à promouvoir de petites modifications dont l'effet rejaillira sur tous. Ne me sentant pas en mesure de répondre immédiatement aux questions de fond posées par M. Patrick Bloche et Mme Valérie Pécresse, je souhaite pouvoir, au cours d'une audition complémentaire, approfondir la réflexion, mais je ne conclurai pas sans souligner qu'on ne règlera rien en opposant parents juridiques et parents sociaux. Un socle juridique doit être construit qui fasse sens pour tous, y compris pour les familles polygames, puisqu'elles existent. Là encore, une réalité est niée : celle du lien de l'enfant avec la co-épouse. Il faut tenir compte de ce qui est. M. le Président : Je vous remercie. Table ronde sur la réforme du droit de la famille Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Je souhaite la bienvenue à M. Paul de Viguerie, président de la Confédération nationale des associations familiales catholiques, à M. Thierry Damien, président de Familles rurales, et à M. Philippe Vaur, vice-président de Familles de France, réunis pour une table ronde consacrée à la réforme du droit de la famille. Je rappelle que nous avons voulu vous entendre en juin, dans le cadre d'une audition publique ouverte à la presse, mais que vous ne l'avez pas souhaité. Notre Mission a adopté en juin une note d'étape sur la protection de l'enfance, dans laquelle elle a avancé cinquante-deux propositions. Nous nous penchons à présent sur la réforme du droit de la famille, pour examiner comment notre droit peut répondre aux évolutions constatées. En abordant ce volet de nos travaux, nous avons souhaité recueillir les points de vue des associations familiales. Je vous donnerai donc successivement la parole pour que vous nous disiez comment il conviendrait, selon votre mouvement respectif, de modifier les règles applicables au couple, à la filiation et à l'autorité parentale, dans le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant et donc de l'intérêt supérieur de l'enfant. M. Paul de Viguerie : Je vous remercie de votre accueil et de votre écoute. Les positions de notre mouvement vous sont connues, comme nous sont connues celles que vous représentez ici. Au-delà de notre contribution juridique écrite à vos travaux, dont nous vous laisserons quelques exemplaires, il est bon ainsi qu'un dialogue s'instaure. Nous nous interrogeons en premier lieu sur la question de savoir si nous avons avec vous une vision exacte de l'état actuel du droit de la famille et de son évolution, ainsi que sur les objectifs de votre Mission. En deuxième lieu, nous reconnaissons que la diversité des situations familiales est réelle, et que le droit doit certes en tenir compte. Mais si l'on considère l'intérêt de l'enfant, que vous venez d'évoquer, M. le Président, toutes les formes de conjugalité sont-elles indifférentes, et équivalentes pour l'enfant, de la petite enfance à l'âge adulte ? Quelle que soit la réponse à cette question, l'évolution du droit doit en tenir compte, mais comment ? Enfin, les choix affectifs, qui sont par essence d'ordre personnel et privé, ont des conséquences sur le comportement économique, social et civique des citoyens ; par là, ils intéressent la société politique et donc le législateur. Telles sont les questions dont il faut débattre. Depuis trente ans, le droit de la famille a évolué pour tenter de tenir compte au mieux de l'évolution des comportements et des mutations économiques et sociales - particulièrement de l'accroissement du travail féminin -, afin d'assurer l'égale dignité des personnes, leurs droits fondamentaux et la protection des plus faibles. Le droit de la famille a été entièrement refondé en partant de deux postulats : la prise en compte de chaque individu dans la famille et l'intérêt de l'enfant. L'enfant ne doit pas souffrir des divers modes de conjugalité des parents. Or, le droit de la famille s'est attaché à codifier toutes les situations de vie conjugale (divorce, concubinage, union libre, PACS, adoption par une personne...) sans que la question semble s'être posée de savoir si les choix des parents influent sur la situation de l'enfant et sur sa protection. Un ensemble de dispositions fiscales et sociales a suivi, de manière quelque peu brouillonne et sans qu'il y ait toujours de corrélations précises. Les gouvernements successifs ont poursuivi sans relâche ces réformes, si bien que le divorce a été « apaisé », l'adoption réformée, le PACS instauré, le droit de la filiation revisité, le droit du patronyme revu et l'ensemble des règles fiscales adaptées ; ce cycle se terminera par la réforme des successions, qui sera soumise sous peu à votre examen. On peut donc estimer que la première étape est achevée et que toutes les situations « conjugales » ont maintenant la même valeur et se traduisent en droit par la conclusion d'un contrat. Le mariage civil peut ainsi apparaître discriminant, puisque c'est le seul contrat qui prévoit une procédure, celle du divorce, destinée à garantir les droits et devoirs des personnes en cas de rupture. Mais ces réformes ont-elles une cohérence interne ? Sont-elles sous-tendues par une philosophie, une conception de la personne et de la famille précise et explicite ? Le sujet que votre mission aborde à présent vous amènera-t-il à considérer que l'altérité des sexes, principe universel que nous tenons pour fondateur de toute société et constitutif de la structuration de la personnalité de tout enfant, doive être remise en cause ? L'évolution décrite n'a-t-elle pas privilégié le droit des adultes par rapport au droit de l'enfant ? L'intérêt de l'enfant est-il véritablement indépendant du mode de constitution de la famille, tout au long de la vie ? En termes de prévention, l'intérêt de l'enfant est-il plus particulièrement encouragé par l'union stable d'un homme et d'une femme dans la durée ? Peut-on faire l'impasse sur l'institution du mariage quand on parle de protéger l'enfant, alors que la situation conjugale des parents biologiques peut varier et que l'enfant subit ces fluctuations éventuelles ? En d'autres termes, le droit ne doit-il pas, dans l'intérêt de l'enfant, privilégier la forme de contrat que nous appelons « mariage » et que la société appelle encore « mariage civil », contrat qui favorise la prévention, sécurise la situation de l'enfant et construit sa personnalité ? Ce sont d'ailleurs ces caractéristiques qui, depuis deux siècles, donnent sa légitimité à l'institution républicaine du mariage civil en mairie. Enfin, le législateur, en faisant évoluer le droit relatif aux formes de conjugalité, n'a-t-il pas oublié de prendre en compte sa corrélation avec certains phénomènes de société ? N'a-t-on pas omis de parler du coût social de la non-famille et du non-mariage ? Au-delà des a priori politiques et des sensibilités, chacun sait que les diverses situations conjugales des parents biologiques ne sont pas indifférentes au regard des politiques publiques, nationales et locales, qu'il s'agisse du logement, des loisirs ou de l'éducation nationale. Si, donc, le mode de constitution d'une famille est une affaire publique, le législateur doit s'attacher à privilégier dans le temps celle des situations conjugales qui favorise l'égalité professionnelle, l'engagement dans la cité, la motivation dans les entreprises et les solidarités intergénérationnelles. Le droit de la famille ne doit-il pas, alors, favoriser, parmi les différents contrats de conjugalité, le contrat particulier qu'est le mariage, et lui redonner son statut institutionnel au sein de la nation ? Telles sont les réflexions qu'a suscitées, au sein de notre confédération, l'évolution progressive du droit de la famille. Nos positions sont connues mais, depuis un an, nous les avons reprises entièrement, en menant une étude anthropologique qui nous a fait entrer en contact avec les intellectuels les plus divers, de Maurice Godelier à René Girard, Guy Coq et Charles Melman. Quant à notre analyse juridique, elle a abouti au dossier que je vous remets. Pour nous, l'altérité des sexes est un principe universel dans toute civilisation, et nous considérons que tout enfant a besoin d'un père et d'une mère, comme le présuppose la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais il fallait aller plus loin que la seule énonciation de ces principes. C'est ce qui nous a conduits à engager une recherche scientifique relative au coût du non-mariage. Je rappelle qu'en France 60 % des couples ont choisi de se marier à la mairie. Ils tiennent au mariage, institution dont ils estiment qu'elle donne des repères sociaux aux enfants issus de leurs différentes unions. Pour nous, le mariage civil continue d'être, non de façon absolue mais de façon relative, le meilleur garant juridique pour conforter les parents dans leur triple mission de don et d'assistance mutuelle entre époux, d'éducation de leurs enfants et d'engagement civique au sein de la société. Nous considérons le mariage comme un préalable à toute politique familiale, et tous les autres contrats comme des méthodes d'accompagnement de situations diverses, qui participent plutôt d'une politique sociale. M. Thierry Damien : Comme vous nous l'avez demandé, j'aborderai successivement la question du couple, celle de la filiation et enfin celle de l'autorité parentale. Dans son projet de société, Familles rurales aborde le couple, le mariage et la famille en ces termes : « La famille se fonde sur le couple formé d'un homme et d'une femme qui s'aiment, qui ont des enfants ou la volonté d'en avoir, et qui s'engagent dans la durée à assumer conjointement leur responsabilité éducative. Pour le Mouvement, le père et la mère portent ensemble cette responsabilité éducative. Ils sont complémentaires l'un de l'autre. Pour Familles rurales, l'acte civil du mariage constitue le contrat entre les conjoints et entre le couple et la société. Il concrétise cette volonté du couple d'assumer conjointement et dans la durée sa responsabilité parentale et familiale. Tout en affirmant la valeur du mariage civil, le Mouvement respecte les couples qui n'en font pas le choix et accueille toutes les formes de familles. Par ailleurs, le Mouvement considère que la personne homosexuelle vivant seule ou en couple doit être respectée dans sa différence et aidée comme tout parent quand elle assume une responsabilité parentale. Mais pour construire sa personnalité, l'enfant a besoin de son père et de sa mère, et à travers eux de différencier les sexes. Cette différentiation est essentielle pour son développement et c'est pourquoi Familles rurales est fondamentalement attaché au droit de l'enfant à avoir un père et une mère. » Ainsi, Familles rurales distingue le couple destiné à fonder une famille, qu'il considère composé d'un homme et d'une femme, et auquel, par souci de protection de chacun de ses membres, il recommande le mariage civil, du couple dont le projet de vie serait une simple aspiration à vivre à deux, solidairement. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de faire état du sexe des personnes, ni même d'assimiler cette union à un mariage. Toutefois, Familles rurales s'interroge sur la finalité de la formalisation des différentes formes d'union. L'union hétérosexuelle peut trouver son plein épanouissement dans le mariage, dans la mesure où ce contrat invite à constituer une famille ; et même si la capacité de procréation est désormais dissociée des rapports sexuels, l'union d'un homme et d'une femme reste la condition naturelle de la conception d'un enfant. Quant à l'union de deux personnes de même sexe dont le projet serait de fonder une famille, elle pose la question de l'intérêt de l'enfant à être élevé dans un contexte qui, pour l'heure, demeure singulier. Familles rurales a toujours placé l'intérêt de l'enfant au-dessus de tout autre. C'est pourquoi notre mouvement se donne le temps de la réflexion, pour que soit analysée le plus objectivement possible l'incidence sur un enfant d'une éducation dispensée par un couple homosexuel. Dans le même temps, Familles rurales continue de défendre des formes d'union respectueuses des choix de vie de chacun, mais qui garantissent aussi l'évolution harmonieuse de notre société. Notre mouvement défend le mariage civil parce qu'il garantit aux époux une sécurité patrimoniale et affective et qu'il offre aux enfants un cadre de vie équilibrant, mais aussi parce qu'en instituant des solidarités horizontales et verticales, il contribue à la régulation de la vie sociale. Nous approuvons la proposition de loi déposée au Sénat le 3 mars dernier et qui tend à relever l'âge minimal du mariage des femmes de 15 à 18 ans. Le double souci de protéger les jeunes femmes, notamment celles issues de l'immigration, menacées de mariage forcé, et d'instituer un traitement égalitaire des hommes et des femmes, nous fait considérer importante cette évolution législative, qui correspond à l'esprit de la Convention internationale des droits de l'enfant, répond aux préconisations de Mme Claire Brisset, Défenseure des enfants, et rejoint les dispositions adoptées par la plupart des États membres de l'Union européenne. Il paraît toutefois souhaitable de permettre que le procureur autorise les dispenses d'âge pour motifs graves : en cas de grossesse précoce par exemple, un jeune couple doit pouvoir accéder au mariage et faire bénéficier l'enfant à naître de cette protection. La nouvelle forme de conjugalité qu'est le PACS, introduite il y a cinq ans dans le droit français, est aujourd'hui entrée dans les mœurs. Le PACS répond indiscutablement à une demande en constante progression, mais il est appelé à évoluer. C'est en effet un contrat de nature essentiellement patrimoniale, mais l'on tend à lui conférer une dimension plus conjugale, voire familiale. Conformément à son projet, Familles rurales considère que le PACS n'a pas vocation à être un « mariage bis » mais, dans le respect des choix de vie individuels et dans un souci de non discrimination, notre mouvement soutient plusieurs évolutions. Nous appuyons ainsi le principe de l'inscription de la mention « PACS » en marge de l'état civil sans, toutefois, que figure le nom du partenaire, afin de ne pas stigmatiser les couples homosexuels. Cette annotation officielle justifierait d'un statut auprès des banques et des organismes de prêt et contribuerait à une forme de reconnaissance symbolique. Nous sommes aussi favorables au fait d'offrir aux personnes pacsées, qui n'ont actuellement d'autre choix que celui de l'indivision, la possibilité d'opter pour le régime de la séparation des biens. Nous considérons encore qu'il faut limiter la notion d'aide mutuelle à la durée de l'union, afin qu'en cas de rupture l'une des personnes n'ait pas à supporter les dettes contractées par l'autre antérieurement à la signature du PACS. Pour Familles rurales, il faut aussi tendre à faire bénéficier les couples pacsés d'avantages légaux acquis aux couples mariés en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, qu'il s'agisse, par exemple, du bénéfice de l'application du code du travail pour le conjoint collaborateur, de l'extension aux personnes pacsées de la pension de veuf ou veuve invalide, l'alignement des droits en matière d'accident du travail ou encore l'ouverture du droit à pension de réversion aux partenaires pacsés depuis au moins deux ans. Quant au concubinage, c'est une forme de conjugalité reconnue par notre système juridique au titre du libre choix accordé à chacun d'organiser sa vie comme il l'entend. Si le concubinage n'accorde aucun statut véritable, quelques règles sociales et fiscales lui sont appliquées. Familles rurales respecte cette forme d'engagement, mais tient à ce qu'elle ne pénalise pas l'enfant qui en est issu. En résumé, Familles rurales estime nécessaire de conforter l'acte civil du mariage comme élément constitutif de l'union d'un homme et d'une femme ayant le projet d'élever des enfants, de conforter le PACS comme élément constitutif d'une communauté de biens entre deux personnes désirant vivre solidairement, et de conserver le certificat de concubinage, qui offre à chacun des concubins la possibilité de garder son indépendance tout en reconnaissant leur vie commune. J'en viens à notre position sur la filiation, et je traiterai en premier lieu de la filiation naturelle. Je rappelle que la filiation est le lien de droit qui, en rattachant un enfant à ses parents, fonde la parenté. Depuis toujours, Familles rurales défend le principe d'égalité de traitement de tous les enfants. C'est pourquoi nous approuvons l'ordonnance promulguée en juillet dernier qui supprime la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle. En indiquant le nom de la mère dans l'acte de naissance, ce texte établit la filiation à l'égard de l'enfant naturel, évitant ainsi à la mère non mariée de devoir accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de l'enfant dont elle a accouché. Enfin, cette ordonnance simplifie les actions relatives à l'établissement ou à la contestation de la filiation. Familles rurales reste attaché au droit à l'accouchement secret, tout en déplorant que les pères soient toujours exclus de ces procédures. S'agissant de l'adoption, nous soutenons les réformes engagées pour simplifier et harmoniser les procédures d'agrément et nous approuvons la création d'une Agence nationale de l'adoption, propre à garantir aux candidats à l'adoption des procédures plaçant l'intérêt de l'enfant au dessus de toutes tractations. Pour ce qui est de la filiation par procréation médicalement assistée, Familles rurales reste fondamentalement attaché à une assistance médicale à la procréation destinée à remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou à éviter la transmission à l'enfant d'une maladie grave. Nous considérons que l'accès à ce type de procréation doit être réservé aux couples hétérosexuels mariés ou justifiant d'au moins deux années de vie commune, et que l'homme et la femme doivent être vivants et en âge de procréer au moment du recours à l'assistance médicale. Nous considérons enfin qu'en cas de recours à un tiers, aucun lien de filiation ne peut être établi entre ce tiers et l'enfant, et que la filiation doit être établie à l'égard du couple ayant bénéficié de l'assistance médicale. Cependant, compte tenu du contournement de la loi française par des personnes qui utilisent des réglementations étrangères différentes de la nôtre pour mener à bien leur désir d'enfant, Familles rurales souhaiterait la diffusion d'une information préventive sur les risques encourus. En effet, ce type de démarche peut avoir des répercussions d'ordre juridique lorsqu'il s'agit de faire reconnaître par l'état civil français un enfant conçu grâce à une procédure interdite en France, et d'ordre psychologique lorsque l'enfant découvrira les circonstances de sa conception. Le manque de recul sur le développement des enfants nés de ces « arrangements » invite notre mouvement à la plus grande prudence. Pour ce qui est enfin de l'autorité parentale, la position de Familles rurales est, une nouvelle fois, motivée par l'intérêt de l'enfant. Nous défendons le principe selon lequel les parents doivent pouvoir exercer ensemble les droits et devoirs qui leur reviennent, y compris en cas de séparation, situation dans laquelle chaque parent doit pouvoir maintenir des relations personnelles avec son enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Le statut conjugal des parents ne doit pas avoir d'incidence sur l'exercice de l'autorité parentale : l'enfant est en droit d'attendre la même protection de ses parents, que ceux-ci soient mariés, « pacsés » ou concubins. Toutefois, nous nous interrogeons sur les effets de la résidence alternée, mode de garde présenté comme offrant aux couples séparés un partage équitable de l'autorité parentale. Pour les enfants les plus jeunes, cette alternance peut être un facteur supplémentaire de déstabilisation. Aussi conviendrait-il de ne pas présenter cette modalité de garde comme la réponse adaptée à l'exercice de l'autorité parentale, et de veiller à ce qu'elle soit mise en pratique de façon à servir l'intérêt de l'enfant. Dans le même temps, il convient de veiller à ce que le parent qui n'assume pas l'essentiel de l'hébergement - et qui est encore souvent le père - ne soit pas disqualifié mais, au contraire, systématiquement associé aux décisions importantes concernant l'enfant. Par ailleurs, lorsque la séparation du couple entraîne une séparation géographique importante, des aménagements pourraient être proposés pour faciliter le maintien des liens entre les enfants et le parent éloigné, à travers des lieux de rencontre ou des tarifs préférentiels dans les transports. Enfin, devant l'augmentation du nombre des familles dites « recomposées », Familles rurales estime qu'il conviendrait de penser la place des « beaux-parents » qui, souvent, jouent un rôle éducatif, voire affectif, prépondérant. Tout en réservant l'autorité parentale aux parents, ne pourrait-on envisager de reconnaître au beau-parent la qualité de co-éducateur ? Cette reconnaissance pourrait se faire sous certaines conditions de durée de vie commune, de volonté partagée et surtout avec l'accord de l'enfant. On pourrait, dans ce cas, imaginer une forme allégée de procédure d'adoption simple. M. Philippe Vaur : Notre mouvement représente des individus et des familles dont les choix philosophiques, les choix de vie et les modes de conjugalité sont très disparates, puisque nous ne nous référons à aucune philosophie ou spiritualité particulière. Aussi, nous nous sommes fixés une doctrine d'une extrême simplicité : la défense du plus faible. Or, lorsque l'on traite des familles, le plus faible, c'est fréquemment l'enfant, ou, moins fréquemment, la femme, qu'elle soit ou non l'épouse. La question du mode de conjugalité ne vient qu'ensuite. Tel est le prisme au travers duquel nous apprécions toute réforme du droit de la famille. Pour nous, l'organisation de la famille est une question d'ordre privé, un arrangement entre deux êtres que, selon nous, la République permet plus qu'elle n'autorise. Ce point de vue n'empêche pas que nous demeurerons d'une particulière vigilance quant au respect de l'intérêt de l'enfant, de l'épouse, puis du couple. Dans cette optique, nous tenons principalement au mariage républicain civil qui est pour nous la base de tout système familial, mais nous restons ouverts aux autres formes d'union, à condition qu'elles ne nuisent pas aux plus faibles. Mme la Rapporteure : Chacun le sait, l'accroissement du nombre des ruptures conjugales est continu, et les enfants qui les subissent en sont fragilisés. Auriez-vous des idées sur les dispositions propres à renforcer les droits des couples mariés pour revaloriser et promouvoir le mariage ? M. Philippe Vaur : L'une de nos commissions s'est penchée sur cette question dans le cadre de ses travaux sur l'« union durable », axés sur la prévention. On peut aider nos concitoyens à comprendre que la séparation des membres du couple ne doit pas impliquer une séparation en tant que parents. C'est dire la grande importance des médiateurs familiaux, qui doivent enseigner à conserver la qualité parentale. Un tel enseignement devrait être fait dès le lycée, pour expliquer aux adolescents qu'il existe une différence entre un couple et des parents et pour leur faire comprendre que ce n'est pas parce que l'on se sépare qu'il est nécessaire d'« assassiner » l'autre en sa qualité de parent. M. le Président : Comme il arrive souvent lorsque l'on traite de telles questions, des avis divers s'expriment. Ainsi, le pédopsychiatre Marcel Ruffo fait valoir qu'il n'est pas bon pour un enfant que ses deux parents séparés s'entendent trop bien, car, dans ce cas, le mineur ne comprend pas la séparation. Autrement dit, l'agressivité doit être évitée, mais une entente parfaite ne serait pas une bonne chose non plus... Le débat est passionnant, mais il est bien difficile de se faire une religion... M. Philippe Vaur : Voilà qui me fait insister une nouvelle fois sur l'importance des médiateurs familiaux. M. Paul de Viguerie : La création du PACS nous a conduits à réfléchir sur l'institution du mariage au sein de la République. Pour nous, outre qu'il unit un homme et une femme, le mariage est fait pour durer. Il convient donc, comme nous l'avons proposé, de donner du mariage civil une définition qui le rende plus visible, afin qu'il soit mieux reconnu par la société. Les couples attendent cette reconnaissance sociale. De fait, on parle beaucoup des ruptures parce que l'on sait leurs conséquences pour les enfants, mais l'on dit moins que 60 % des couples sont mariés, et que beaucoup des individus qui se sont séparés une première fois se remarient. C'est qu'ils attendent cette reconnaissance sociale non seulement pour leurs enfants, mais aussi pour être confortés dans leur rôle d'éducateur, et parce qu'ils ont le sentiment de prendre ainsi un engagement public. Jamais un élu local ne m'a dit qu'il n'aimait pas célébrer des mariages ! Il convient donc, je le répète, de faire que le mariage civil soit explicitement reconnu et qu'on lui redonne sa valeur intrinsèque. Mais l'on peut aller plus loin, et prendre des mesures fiscales qui encourageaient la durée du mariage. J'observe que les couples qui se séparent ont tous les mêmes problèmes, qu'ils soient mariés ou non. La question qui se pose est de savoir comment encourager le type particulier de contrat qu'est le mariage par des dispositions juridiques, mais aussi fiscales et sociales. Mais si le PACS et le concubinage donnent droit aux mêmes avantages que le mariage, je ne vois vraiment pas quel intérêt les couples trouveront à se marier civilement, d'autant que s'ils veulent ensuite se séparer, ils doivent divorcer, procédure qui reste difficile même si elle est désormais pacifiée. En résumé, attribuer les mêmes droits à tous les contrats régissant les liens familiaux met en péril le mariage dit « civil », dont les modalités institutionnelles en France constituent une irrégularité en Europe. Toutes les grandes religions se contentent d'un mariage religieux et, ailleurs en Europe, les mariages religieux sont consignés à l'état civil, comme le sont les mariages qui ont lieu en mairie. Mais jamais la dimension sociale du mariage dans la durée n'est remise en cause. Il faut donc réfléchir en premier lieu au fait de savoir si l'on souhaite maintenir, en France, l'institution républicaine du mariage. Si l'on décide de la maintenir, il faut définir ce qu'elle apporte à l'enfant et à la société, puis décliner le droit fiscal et social en conséquence. Or, depuis trente ans, le droit de la famille d'une part, le droit fiscal et le droit social d'autre part ont connu une évolution inverse à cette orientation. On en est arrivé à désinstitutionnaliser le mariage, à individualiser tous les droits, le droit des adultes primant sur celui des enfants. Ainsi l'on ne crée plus de lien social. Une réflexion s'impose car, en l'état, je ne vois pas pourquoi maintenir le mariage civil. M. le Président : Je retiens votre suggestion de proposer la suppression du mariage civil. Voilà qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre... Mme Christine Boutin : Au delà de la boutade, c'est une question de fond qui se pose à la société française, et notre mission ne doit pas la prendre à la légère. J'aimerais entendre M. Thierry Damien nous dire quelles modifications du PACS Familles rurales, qui réaffirme la valeur du mariage, serait prêt à accepter. M. Thierry Damien : Pour nous, seul le mariage peut avoir des conséquences automatiques en matière de filiation et impliquer le divorce en cas de séparation. Voilà où nous fixons la limite. Mme la Rapporteure : Le législateur belge réfléchit actuellement à la possibilité d'instituer « l'accouchement dans la discrétion » qui, tout en permettant l'accouchement anonyme, donne à l'enfant la possibilité d'avoir connaissance, à sa majorité, du nom de sa mère biologique. Qu'en pensez-vous ? M. Philippe Vaur : Je suis assez favorable à une telle évolution, car il en va de l'intérêt de l'enfant. Il faut toutefois vérifier que la demande émane bien de lui et qu'il ne subit pas de pressions. Il convient donc d'éviter tout automatisme, que la justice soit garante du processus, et qu'un entretien préalable soit institué. Sous ces conditions, il est bon de donner à un enfant né sous X la possibilité de connaître l'identité de sa mère biologique. M. Thierry Damien : Je partage cette opinion. La question se pose dans les mêmes termes pour l'adoption dans les pays étrangers qui amène souvent à connaître l'identité des parents biologiques, qui doivent signer un acte d'abandon. Les enfants ainsi adoptés ont donc la possibilité matérielle de connaître l'identité de leurs parents. Mais, comme M. Vaur, je pense qu'un encadrement juridique est nécessaire. M. Paul de Viguerie : Nous tenons beaucoup à l'accouchement sous X, procédure qui donne aux femmes en détresse un temps de réflexion bienvenu. Pour autant, il est bon qu'un enfant puisse rechercher ses origines biologiques, à condition que toutes les précautions aient été prises. Cela ne doit donc pouvoir se faire qu'à partir d'un certain âge, et sous le contrôle d'un juge. Sous ces conditions, nous serions d'accord. Mais cette question m'amène à évoquer le sujet de l'adoption en général. Parce que nous considérons qu'un enfant a droit à un père et à une mère, l'adoption par une personne seule nous a toujours semblé une incongruité. Dans le contexte actuel, cette disposition nous pose de plus en plus problèmes. Mme Annick Lepetit : J'aimerais comprendre pourquoi vous avez refusé d'exprimer la position de vos associations respectives en audition publique et devant la presse, lorsque nous vous y avons invités une première fois. Je reviens par ailleurs sur la question de la fin potentielle du mariage que vous avez évoquée, M. de Viguerie. Cette hypothèse me semble bien improbable, puisque vous avez vous-même indiqué que 60 % des couples se marient, proportion qui m'a surprise, car je ne l'imaginais pas aussi élevée. Étant donné ce taux, la crainte que vous avez exprimée de la disparition du mariage est étonnante. Alors que l'union libre est totalement acceptée par la société française et que plus de la moitié des enfants naissent hors mariage dans notre pays, le fait que plus de la moitié des couples continuent de se marier est un argument qui va plutôt dans votre sens, puisqu'il montre que la majorité des couples choisissent le mariage traditionnel. Dans ce contexte, PACS et concubinage mettent-ils réellement le mariage en danger ? La question est d'importance car elle suscite une crainte pour beaucoup ; mais le chiffre que vous avez cité montre que cette crainte est infondée. Sur un autre plan, vous avez expliqué, à juste titre, que les enfants ne doivent pas souffrir de la situation conjugale de leurs parents. Nous en sommes tous d'accord, mais il faut prendre en compte l'augmentation du nombre des séparations. Quelle est, à ce sujet, votre opinion sur l'évolution du divorce ? Enfin, pourriez-vous expliciter ce que vous entendez par « coût d'une famille » et « coût d'une non-famille » ? M. Paul de Viguerie : La proportion de 60 % de couples mariés peut paraître encourageante, mais elle est susceptible de se modifier, car l'évolution du droit français de la famille est elle-même encore relativement récente. J'ai constaté cet été, sur les plages, que de nombreux grands-parents gardent leurs petits-enfants. Ce mode de garde se répand à mesure que se développe le travail féminin. Actuellement, ces grands-parents, très majoritairement mariés, continuent de donner des repères éducatifs et sociaux à ces jeunes enfants, et contribuent à structurer leur personnalité. Mais, si l'on continue à faire du mariage un contrat égal à tous les autres, que seront les grands-parents de demain ? Comment convaincra-t-on les jeunes qui vivent en union libre de se marier s'ils peuvent « zapper » entre mariage, PACS ou concubinage en fonction des avantages fiscaux et sociaux associés à ces différents contrats ? Je crains fort qu'ils ne voient pas pourquoi ils devraient passer à la mairie. S'agissant de la séparation, le législateur doit avoir pour priorité le droit de l'enfant. Or, actuellement, il s'agit davantage d'assistance sociale à des personnes en difficulté que de politique familiale à proprement parler. On voit bien que toutes les politiques familiales entreprises au cours de la dernière décennie, telles qu'elles ressortent des conférences de la famille, se heurtent aux évolutions juridiques précédentes qui ont eu pour objet essentiel de remédier à la séparation des parents. Jamais elles n'ont posé la question de la politique familiale, c'est-à-dire du coût de la non-famille et du non-mariage. Voilà pourquoi nous avons décidé d'engager une étude avec l'aide de scientifiques de différentes disciplines. Nous entendons ainsi évaluer ces coûts sans a priori idéologique et sur une base objective. Nous n'ignorons pas que l'on nous pense inféodés à la hiérarchie catholique, alors que ce n'est pas le cas. Nous n'avons aucun lien avec elle, et, par exemple, nous ne lui avons pas demandé l'autorisation de répondre à votre invitation ! Il n'empêche : il faut mesurer les avantages du mariage, et l'étude que nous avons lancée le permettra. M. le Président : La Fédération des associations familiales catholiques de Paris appartient-elle à votre confédération ? M. Paul de Viguerie : Oui. Nous sommes un mouvement confédéral, mais nous ne sommes pas un parti, et je ne peux donc garantir l'homogénéité parfaite des thèses avancées par le représentant de telle ou telle association appartenant à notre confédération. En revanche, je connais la cohérence d'ensemble des positions de nos adhérents. M. le Président : Pour ce qui est de l'aspect fiscal, considérez-vous que l'imposition commune serve l'institution du mariage ? M. Paul de Viguerie : Il s'agit là d'un problème très complexe. Ni l'Union nationale des associations familiales, ni notre confédération n'ont de position officielle à ce sujet, mais mon opinion personnelle est que l'on ne peut dissocier cette question de celle du quotient familial et de la fiscalité familiale dans son ensemble. Le rapport Godet-Sullerot incite d'ailleurs à une réforme fiscale au bénéfice des familles, ce qui supposerait en particulier de réduire légèrement le nombre de parts fiscales dont bénéficient les couples sans enfant. Je le répète, ces questions ne peuvent, à mon sens, être dissociées. M. Jean-Marie Andres : Croire que nous essayons de faire la promotion du mariage pour des motifs religieux serait faire une lecture simpliste de nos positions. Simplement, nous constatons que 60 % des couples accomplissent en se mariant une démarche positive à laquelle ils donnent un contenu social. Il paraît donc judicieux qu'ils aient en contrepartie une reconnaissance de cet engagement. En outre, le mariage souffre d'un manque de visibilité, et, dans la mesure où il représente un apport objectif pour les enfants, pour le couple et pour la société, il est nécessaire que ces apports soient rendus plus explicites. Tels sont les objectifs que nous poursuivons en cherchant à promouvoir le mariage républicain. M. Thierry Damien : Si on interroge les couples, on s'aperçoit que ce n'est pas l'aspect fiscal, l'idée de bénéficier d'une demi-part de plus ou de moins, qui les pousse vers le mariage. Celui-ci est l'aboutissement d'une réflexion de deux personnes sur le sens qu'elles donnent à leur vie, sur leur envie de construire quelque chose ensemble, sur la façon dont elles voient la famille, sur ce qu'elles souhaitent transmettre. En fait, ceux qui se marient aujourd'hui sont ceux qui ont reçu le plus d'informations sur le mariage, et sans doute est-ce dans ce domaine qu'un effort doit être fait. M. le Président : Ces réflexions sont pertinentes. On observe d'ailleurs qu'un nombre croissant de jeunes couples se « pacsent » avant de se marier, dans un engagement progressif. Aujourd'hui, le mariage est un acte plus réfléchi, ce qui fait qu'on voit de plus en plus souvent se marier des gens qui ont déjà un ou plusieurs enfants. J'ajoute que tous les élus aiment célébrer des mariages : il est agréable de partager un moment de bonheur. M. Philippe Vaur : Il y a, me semble-t-il, une difficulté sémantique dans l'expression « union libre », qui laisse entendre que le mariage ne le serait pas... Mieux vaudrait dire « libre de contrat ». M. Paul de Viguerie : Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à Mme Lepetit sur notre attitude vis-à-vis de la précédente réunion. En fait, nous voulions simplement parler sereinement de ces choses-là, hors de la présence des médias qui ont trop tendance à catégoriser les personnes et les institutions. Le temps de la presse viendra peut-être, ensuite, mais nous avons jugé que sa présence n'était pas opportune lors de cette première rencontre. M. Thierry Damien : Qui plus est, la réunion en question était prévue à quelques jours de la Gay Pride, qui est une manifestation très médiatisée. Or la médiatisation peut servir les intérêts des uns et desservir ceux des autres, et c'est pour cette raison que nous n'avons pas souhaité nous exprimer alors devant la presse. Mme la Rapporteure : Vous ne couriez pas grand risque, car l'intérêt médiatique pour nos réunions est assez faible... M. le Président : Je remercie les représentants des mouvements familiaux. Ayant déjà eu l'occasion de les auditionner il y a sept ans, dans un autre cadre, je me réjouis que ce débat ait pu avoir lieu aujourd'hui. Audition de Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous sommes très heureux d'accueillir Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université de Lille II. Notre Mission d'information commence une série d'auditions sur le droit de la famille. Nous avons en effet décidé d'examiner l'organisation juridique de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, afin de vérifier si les droits de l'enfant sont suffisamment garantis par notre législation. Vous avez participé à plusieurs missions de réflexion sur le droit de la famille, domaine dans lequel vous faites référence. Vous avez notamment présidé, en 1999, le groupe de travail du ministère de la justice qui a initié les importantes réformes intervenues au cours des cinq dernières années. Avant d'organiser des tables rondes thématiques, nous avons donc souhaité vous entendre pour que vous nous donniez votre appréciation sur la manière dont les règles applicables au couple, à la filiation et à l'autorité parentale respectent les droits de l'enfant. Mme Françoise Dekeuwer-Défossez : Je suis saisie par l'ampleur des questions posées et la brièveté du temps qui nous est imparti pour les survoler. S'agissant du respect par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant, le Comité des droits de l'enfant s'est saisi des questions qui opposent la France à l'ONU. Deux points au moins méritent réflexion. Premièrement, la question de l'audition obligatoire de l'enfant se pose depuis près de quinze ans et il est désormais temps de vaincre la réticence de juges. Deuxièmement, j'estime - mais je reste assez minoritaire dans cette opinion - qu'il convient de lever un tabou : la possibilité pour les enfants d'ester en justice contre leurs parents dans les litiges relatifs à l'autorité parentale. Les enfants n'étant habilités à agir contre leurs parents que s'ils se trouvent en danger, dans le cadre de l'assistance éducative. Cela conduit nombre d'entre eux à se placer délibérément dans une situation de danger pour être entendus. D'autre part, la France a signé la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants mais ne l'a pas ratifiée. Le problème ne peut plus être esquivé. Les réformes intervenues depuis 2002 reposent sur l'idée que la vie commune des parents n'a aucune espèce d'incidence juridique pour les enfants : leurs droits sont strictement identiques quel que soit le mode de vie de leurs parents, que ceux-ci vivent en couple ou pas. Aborder la question des formes d'organisation de la vie commune par le biais des droits de l'enfant serait par conséquent revenir sur une politique législative récente mais solide, fondée sur la non-discrimination entre les enfants. L'équilibre entre les devoirs et les droits induits par les différentes formes d'union résulte des choix du législateur. La création du PACS a renvoyé l'union libre dans les limbes du non-droit. S'il est logique que les personnes vivant en union libre ne bénéficient plus d'avancées supplémentaires, cette évolution ne va pas sans poser de problèmes, en particulier dans les cas de séparation : le droit de la séparation des couples pacsés ou vivant en union libre est d'une indigence consternante. Les concubins ont beau être aussi violents que les époux, lorsqu'ils sont colocataires ou co-indivisaires du logement, ou, pire, lorsque le concubin est locataire ou propriétaire en son nom propre, aucun juge ne peut statuer sur l'occupation séparée du logement - l'article 220-1 du code civil ne joue que pour les époux -, et la victime n'a d'autre issue que de partir. Les juges des affaires familiales ont soulevé le problème, mais sans succès. Le fait que les concubins soient pacsés ne change rien. Il faut sortir de cet irénisme dangereux selon lequel la séparation de personnes non mariées ne poserait pas de problèmes. La question de l'égalité de l'accès au mariage ne se pose pas en termes d'orientation sexuelle, mais d'identité des sexes. J'y vois une analogie avec la philosophie chinoise du yin et du yang : si les deux parties du cercle sont blanches ou noires, c'est toujours un cercle, mais plus tout à fait le même. On peut aussi proposer une comparaison avec une société commerciale unipersonnelle : ce n'est pas la même chose qu'une société associant plusieurs personnes. On a beau donner le qualificatif de « société » à une personne seule, elle reste une personne seule, ce qui n'induit pas pour autant une hiérarchie morale entre les sociétés unipersonnelles et les sociétés pluripersonnelles. Je veux dire par là que, les catégories de couples n'étant pas identiques, chacune d'entre elles mérite un régime juridique approprié et que ce n'est pas une discrimination. Reste à définir ces régimes juridiques. En tout cas, réduire la différence entre couples homosexuels et hétérosexuels à leur orientation sexuelle, c'est présupposer la réponse que l'on souhaite apporter à la question. Le régime des biens prévu dans la loi relative au pacte civil de solidarité doit être profondément modifié, tout le monde en convient : il faut sortir du carcan de l'indivision afin de tenir compte des volontés des parties. Peut-être serait-il également utile d'introduire quelques règles concernant la séparation - à l'heure actuelle, on ne sait même pas vraiment quelle est la juridiction compétente et on se contente de supposer que c'est le tribunal de grande instance -. Ajouter une présomption de paternité ne serait pas cohérent avec le principe de base selon lequel le PACS est un contrat pécuniaire sans obligation de fidélité. Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité peuvent souhaiter y inclure des obligations personnelles et une communauté de biens, mais cela devient alors un clone du mariage : plus le PACS sera enrichi, plus il se rapprochera du mariage. La société a-t-elle besoin d'un mariage bis ? L'urgence est plutôt de préserver les conditions de vie des personnes qui vivent ensemble sans avoir souscrit ni PACS ni mariage. Rappelons-nous que le mariage n'est pas une invention abstraite de l'Église catholique dans une intention totalitaire, mais une structure juridique qui a été construite au cours des siècles pour organiser la préservation des intérêts des conjoints et de la cellule familiale, pour assurer un certain équilibre, une certaine justice, une certaine harmonie dans les relations matrimoniales. L'absence de règle juridique peut être très dangereuse en livrant le faible à la merci du fort. Comment définir l'intérêt de l'enfant ? C'est à la fois l'intérêt concret de tel enfant dans telle famille et une notion abstraite justifiant une politique publique donnée. Que l'intérêt de certains enfants, dans certaines situations familiales, soit de se voir adoptés conjointement par des couples de pacsés ou de concubins, hétérosexuels ou homosexuels, c'est certain. Que l'intérêt général de l'ensemble des enfants soit l'ouverture de l'adoption à tous les couples, c'est moins évident. Il n'en demeure pas moins que l'adoption traverse une crise profonde et que beaucoup reste à faire, notamment en ce qui concerne les agréments, délivrés de façon trop laxiste : les conseils généraux, craignant de s'exposer à des recours, en accordent à des couples qui ne devraient jamais adopter. L'adoption a d'abord pour objet de donner une famille à un enfant et subsidiairement de donner un enfant à une famille. Il ne s'agit pas de trouver des enfants pour les familles en manque, mais de trouver la meilleure famille possible pour chaque enfant abandonné. Or les choses ne fonctionnent pas ainsi car on dénombre 15 % de couples stériles et seulement 5 000 à 6 000 adoptions par an pour 800 000 naissances. Devant ce déséquilibre, des pressions sont exercées pour accroître le nombre d'enfants adoptables, alors qu'il est à espérer que leur nombre diminue, en France comme à l'étranger, car un enfant adoptable est un enfant abandonné, c'est-à-dire maltraité. D'autres personnes beaucoup plus compétentes que moi pourraient également vous parler des dérives financières caractérisant les adoptions à l'étranger, le premier acte à accomplir par les adoptants étant d'aller voir leur banquier. Au demeurant, les pays étrangers ne nous enverront pas indéfiniment des enfants dans les conditions douteuses actuelles. Il faut ouvrir les yeux sur le malaise qui entoure l'adoption : énormément d'enfants adoptifs sont malheureux, et les statistiques de l'aide sociale à l'enfance sur la proportion d'entre eux qui doivent être placés sont assez effarantes. Dans ces conditions, pourquoi étendre encore le champ de l'adoption ? Mais le problème est délicat car, d'un autre côté, certains enfants vivent des situations familiales qui justifieraient peut-être l'adoption. L'adoption simple, sous certaines hypothèses, peut constituer une solution, mais plusieurs de ses caractéristiques sont très critiquables, en particulier sa révocabilité, notamment après séparation des parents. Peut-être faudrait-il interdire sa révocation, en tout cas à la demande de l'adoptant. Une autre piste consisterait à réunifier les deux régimes d'adoption, comme dans la plupart des autres pays, afin de trouver un juste milieu entre, d'une part, l'adoption plénière, étouffante par le mensonge et l'absence d'ouverture sur les origines, et, de l'autre, l'adoption simple, qui ne confère pas suffisamment de garanties à l'enfant. Je reviens sur l'adoption à l'étranger. Celle-ci doit être mieux contrôlée car c'est vraiment la pression de la demande qui gouverne : des enfants sont adoptés par des familles où ils ne peuvent pas s'épanouir, pour des raisons de caractère ou d'habitudes. J'ai en mémoire le cas d'une petite Roumaine qui n'a pas pu s'adapter à un couple très bien mais trop rigide, et a fini par tuer indirectement son père, terrassé par une crise cardiaque. Il m'a toujours paru bizarre qu'une femme ait besoin de l'autorisation de son concubin pour avoir accès à la procréation médicalement assistée, car, d'un point de vue juridique, il n'a aucune autorité sur elle. L'objectif est certes de donner un père à l'enfant, mais chacun sait qu'il est extrêmement aisé, pour un compagnon, de ne pas tenir ce type d'engagement... Du reste, si le concubin ne reconnaît pas l'enfant, la mère peut bien agir en justice, mais cela n'arrive jamais car elle préfère le garder pour elle... Ce n'est donc qu'en apparence que la procédure actuelle protège l'enfant : l'autorisation du concubin n'est qu'un faux-semblant, de même que le médecin ne vérifie pas le délai de vie commune, ni le fait que la femme puisse être mariée avec un autre homme. Il serait plus simple de supprimer ces dispositions, mais le législateur renoncerait alors au dogme officiel selon lequel la PMA doit garantir une filiation. Comment savoir où est l'intérêt de l'enfant ? Vaut-il mieux ne pas naître, ou naître d'une mère célibataire ou lesbienne ? Personne ne saurait répondre à ces questions. Du point de vue de l'intérêt de l'enfant, les problèmes de l'adoption et de la PMA sont très différents. Dans le premier cas, l'enfant est déjà né, et la société qui le confie à un couple a la responsabilité de lui garantir la meilleure vie possible. C'est pourquoi le principe de l'agrément et le contrôle des capacités adoptives me paraissent justifiés et essentiels. Quant à la PMA, il s'agit essentiellement d'un acte médical. Dès lors que la France n'a pas pris le parti de la réserver aux couples mariés, il est relativement logique de finir par l'autoriser à toutes les femmes, qu'elles vivent seules ou en couple. L'interdiction absolue de la gestation pour autrui est tenable à condition que l'on ait envie de la tenir. On cesse d'interdire une pratique non pas lorsqu'elle se développe, mais lorsqu'on ne sait plus pourquoi elle est interdite. Si l'interdiction est justifiée, il faut la maintenir. Si l'on considère que la gestation pour autrui est contraire à la dignité humaine, en particulier à la dignité du bébé, si l'on souhaite s'opposer à la vente de bébés sur l'internet ou ailleurs, on n'est pas du tout embarrassé par l'interdiction de cette pratique. Si l'on estime au contraire que les choses sont plus compliquées et que c'est la seule solution pour pallier la stérilité, bref, si l'on pose la question, c'est que l'on y a déjà répondu dans sa tête et que l'on ne veut pas poursuivre les personnes qui sont allées chercher aux États-Unis ce que la France leur refusait. Mais il n'appartient pas au juriste de se prononcer : c'est un choix politique. Dans l'état actuel des choses, les pouvoirs publics ne veulent pas résoudre les problèmes rencontrés par les couples français ayant eu recours à ces pratiques à l'étranger, pour éviter qu'elles ne se diffusent. La façon la plus honnête et la plus simple de résoudre ces problèmes, à supposer que cela soit souhaitable, serait de créer un statut juridique de la mère porteuse. Reste que des parents, en pleine connaissance de cause, se livrent à des pratiques à l'étranger parce qu'ils savent qu'elles sont interdites en France ; ils ne doivent dès lors pas s'étonner de rencontrer quelques soucis juridiques lorsqu'ils reviennent en France. Les dégâts collatéraux ne sont pas minces. La sauvegarde de la dignité humaine les justifie-t-elle ou non ? En résumé, la situation actuelle me paraît logique mais un changement est parfaitement envisageable. Les Britanniques et les Américains ne respectent pas moins la dignité humaine que les Français ; ils le font autrement. L'équilibre de la loi de 2002 sur la reconnaissance des origines ne tiendra pas longtemps car le conflit s'exacerbe. Lorsqu'elles se rendent compte que leur dossier peut être ouvert, nombre de mères refusent de donner le moindre renseignement, l'immense majorité d'entre elles refusant même que leur nom soit divulgué après leur mort. Les associations d'enfants abandonnés, quant à elles, se plaignent des faibles résultats du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. Enfin, certaines personnes connaissant leurs origines ne comprennent pas que celle-ci ne puisse se transformer en filiation, ce qui entraîne des contestations d'héritage. La loi de 2002 s'imposera vraisemblablement au fil du temps comme une loi intermédiaire, une loi de transition. L'état d'esprit général et la tendance médiatique sont plutôt à l'abolition de l'accouchement sous X, et, étant lilloise, je suis inquiète devant le débat parlementaire belge sur l'instauration dans ce pays d'une mesure similaire. Actuellement, les femmes françaises vont se faire inséminer en Belgique et les femmes belges viennent accoucher sous X en France. Viendra peut-être un jour où émergera un « droit Thalys », une législation européenne de la famille. Quoi qu'il en soit, pour ma part, je défends une position mal comprise : l'accouchement sous X devrait rester de l'ordre du fait, et non du droit. Les femmes se présentant à la maternité sans pièce d'identité doivent pouvoir accoucher sans questions. Pour autant, le système juridique bâti pour encadrer ces situations de détresse a créé un monstre : la règle civile de l'accouchement sous X est incohérente avec tous les autres principes du droit de la filiation. L'accouchement sous X est parfaitement justifié en tant que pratique sociale et médicale, mais pas comme règle civile. Il arrivera forcément un jour où l'anonymat des donneurs de gamètes sera levé, mais pas tout de suite, car la majorité des enfants issus d'une PMA avec tiers donneur ne le savent même pas. Ce secret va à l'encontre du droit à connaître son identité, inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme. Ces enfants ne sont absolument pas protégés contre des révélations brutales qui peuvent intervenir, par exemple, au cours d'un divorce conflictuel. Ils sont alors tentés de connaître le nom du tiers donneur, lequel figure dans un fichier bouclé dans un coffre-fort. Pourra-t-on indéfiniment leur dire que le nom de leur père biologique est écrit quelque part mais qu'ils ne le connaîtront jamais ? Je n'en suis pas sûre. Heureusement, la médecine fait des progrès et l'insémination artificielle avec donneur est en repli au bénéfice d'autres techniques, délicates mais moins dangereuses au regard des droits de l'enfant. S'il est un domaine dans lequel le principe de précaution est négligé, c'est bien celui des droits de l'enfant : on invente de nouvelles pratiques médicales sans guère d'évaluation. Les responsabilités sont pourtant très lourdes et il est possible que l'on demande un jour des comptes à la société pour tout ce qu'elle a laissé faire aux médecins. Mais j'espère me tromper. Le juriste est par nature pessimiste ! Il faut laisser en l'état le texte sur la résidence alternée. Les juges sont investis d'une grande liberté, qu'ils utilisent en fonction de leur grande sagesse. Le texte actuel semble privilégier cette formule, mais les juges ont bien compris qu'elle était indicative et non impérative. Résultat, les pratiques évoluent doucement, en fonction de paramètres comme les habitudes des parents et leur milieu social ; il faut que les juges s'adaptent. La médiation familiale pourrait être favorisée par deux mesures : la rendre obligatoire, comme au Québec, et lui donner des moyens financiers. Dans le système actuel, les époux rechignent à payer, d'autant qu'ils n'ont aucune envie de cesser de se faire la guerre. Les taux de réussite de la médiation sont faibles : ne croyez pas qu'il s'agisse de la solution miracle, surtout si elle reste facultative. Il est irréaliste de vouloir tout et son contraire : la revalorisation du statut du père est inconciliable avec son remplacement par le beau-père. Des systèmes très élaborés de pluriparentalité pourront toujours être imaginés, si les mères ont la possibilité d'ériger leur nouveau compagnon en père à la place de l'ancien, elles ne s'en priveront pas. Privilégier à la fois les pères et les beaux-pères, c'est impossible, les associations de pères vous le confirmeront ! En outre, la diversification des modes de vie familiale ne pose guère de problème pour l'accomplissement des actes essentiels concernant les enfants. De ce point de vue, les familles recomposées comme les familles homoparentales sont dans la même situation, et les outils existant offrent des solutions adaptées, notamment pour l'accomplissement des formalités scolaires. Pour qu'un beau-père puisse aller chercher l'enfant de sa compagne à l'école, il suffit que celle-ci prévienne l'institutrice. Je n'ai jamais observé le moindre problème, hormis lorsque le « parent social » se retrouve seul en charge de l'enfant, après un décès ou une séparation, par exemple. Je vois derrière cette idée une entreprise des mères pour remplacer leur ancien compagnon par le nouveau - j'inclus évidemment les nouveaux compagnons de même sexe, les familles recomposées homoparentales étant des familles recomposées comme les autres, soumises aux mêmes règles -. Les outils juridiques actuels sont tout à fait flexibles et permettent de répondre au problème, si ce n'est qu'ils ne permettent pas de faire d'une autre femme le père de l'enfant. Mais cela serait-il souhaitable ? C'est une autre question. L'adoption simple donne déjà à un enfant deux pères et deux mères : ses parents biologiques et adoptifs. Vous soulevez la question de l'adoption simple par le partenaire pacsé d'un père ou d'une mère, qui se pose notamment pour les couples homoparentaux. Encore une fois, je ne vous donnerai pas mon sentiment personnel car il ne s'agit pas d'une question de droit mais de société. Il peut être bénéfique, pour un enfant élevé par l'un de ses parents et le concubin de celui-ci, d'être adopté par ce dernier. Cela peut toutefois ouvrir droit à des revendications en faveur de l'adoption d'enfants étrangers aux couples, ce qui me paraît beaucoup plus problématique, y compris du point de vue international. Les dispositions actuelles sur le maintien des liens entre grands-parents et petits-enfants ne sont pas respectées parce que les juges, dans l'intérêt des enfants, préfèrent nettement les préserver des situations de conflit entre les parents et les grands-parents. Les grands-parents ont évidemment envie de voir leurs petits-enfants, mais, s'ils profitent du droit de visite pour dénigrer les parents, c'est évidemment contraire aux intérêts des petits. Ne créez donc pas un texte législatif supplémentaire que les juges, dans l'intérêt des enfants, n'appliqueront pas. L'élévation à dix-huit ans de l'âge minimum du mariage pour une jeune fille ne contribuerait à combattre les mariages forcés que dans une faible mesure. Si cette mesure a été proposée, c'est plutôt dans un souci d'égalité des sexes et parce que le mariage est une décision grave qui ne saurait être prise sérieusement avant dix-huit ans. Si la lutte contre les mariages forcés peut la faire passer, tant mieux, mais elle ne réglera pas ce problème. Je vois en revanche deux dispositions qui seraient efficaces. Le code civil précise que la crainte révérencielle envers les parents n'est pas une violence susceptible de constituer un vice du consentement ; il est temps de supprimer cette restriction. Et puis pourquoi se priver d'une disposition pénale, d'un délit de contrainte exercée envers autrui ? Sur la liberté matrimoniale, je n'hésite pas à être répressive. C'est un problème d'affichage. Chacun sait désormais que l'excision est un crime. De même, si le mariage forcé était un délit, puni en France même lorsqu'il a été commis à l'étranger - à l'instar du tourisme sexuel -, des parents pourraient être mis en cause sur dénonciation, à leur retour en France, même en l'absence de leur fille, avec la menace de se voir refuser un renouvellement de titre de séjour. M. le Président : Je vous remercie d'avoir répondu de façon si complète à notre questionnaire, en croisant votre compétence de juriste avec des considérations indispensables sur les réalités de la vie. M. Pierre-Louis Fagniez : Le don de gamètes s'inscrit dans le cadre plus général du don d'organes, de tissus ou de cellules, toujours anonyme, sauf lorsque le donneur doit être vivant, pour le rein ou le foie, par exemple. C'est un principe général : le don est gratuit et anonyme. Vous plaidez donc pour une exception. Mme Françoise Dekeuwer-Défossez : Je ne plaide pas pour la levée de l'anonymat ; je pense qu'elle viendra inéluctablement. Si je reçois du sang, mon identité ne s'en trouve pas modifiée. En revanche, les gènes dont je suis composée touchent à mon moi le plus intime. Les greffés du cœur s'interrogent déjà beaucoup sur l'identité de la personne à qui cet organe a appartenu : incorporer un cœur étranger n'est pas facile, même si celui-ci ne change pas l'identité du receveur. Mais suis-je moi si j'ignore qui est mon père ? Des dizaines de milliers d'enfants adoptifs nous renvoient cette question. Le système est bâti ainsi et, si l'anonymat du don n'avait pas été garanti, les enfants nés d'une PMA avec tiers donneur n'auraient jamais existé, mais certains d'entre eux répondront qu'ils auraient préféré ne pas exister plutôt que d'ignorer leurs origines. Mme Patricia Adam : Vous avez affirmé à plusieurs reprises que les juges connaissent les dossiers dont ils sont saisis et sont en mesure de juger correctement. Or une juge aux affaires familiales que je viens de rencontrer m'a fait deux révélations : elle accorde systématiquement un droit de visite au père, même lorsqu'elle estime que ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, car la cour d'appel, de toute façon, accéderait forcément à la requête ; elle n'auditionne jamais l'enfant car elle s'estime non tenue de souscrire aux opinions que celui-ci exprimerait. Peut-on laisser un juge statuer seul sur les affaires familiales, sujet à la dimension affective toujours si pesante ? La formation des magistrats spécialisés leur donne-t-elle les moyens de juger en bonne connaissance de cause ? M. Patrice Delnatte : Je vous indique que la Commission des lois a adopté un amendement à la proposition de loi sur la récidive, instaurant une mesure d'éloignement du domicile pour les concubins violents. L'adoption comporte deux phases : l'agrément et l'attribution. Le choix de la meilleure famille possible ne peut être effectué qu'au moment de l'attribution de l'enfant et le travail effectué sur ce point par les conseils de famille me semble tout de même intéressant. Je ne comprends donc pas bien votre remarque sur l'agrément, hormis pour l'adoption internationale. Mme la Rapporteure : Le texte de 2002 relatif à l'accès aux origines est en effet une loi de transition qui institue une usine à gaz. Que pensez-vous du projet de loi belge instituant un « accouchement dans la discrétion », avec levée automatique du secret à la majorité de l'enfant ? Par ailleurs, je suis un peu surprise par votre virulence contre le statut du beau-parent. Pour les familles recomposées, il serait utile de pouvoir organiser de façon plus rationnelle les pouvoirs du beau-père sur les enfants, afin qu'il puisse réagir, par exemple, quand un accident survient et que la mère est au travail ou à l'étranger. Actuellement, il n'est pas habilité à prendre des décisions engageant la vie de l'enfant. M. le Président : Il ressort des missions que nous avons effectuées en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Canada que le nombre de mariages homosexuels et des procédures d'adoption y est extraordinairement minoritaire au regard du nombre de mariages et de naissances : il s'agit, pour les personnes homosexuelles, de ne plus se voir interdire un droit, pas forcément de l'utiliser. Mme Françoise Dekeuwer-Défossez : L'adoption par les couples homosexuels pose en effet un problème de fond démesuré par rapport à l'ampleur pratique qu'elle prendrait. L'adoption simple pose peu de difficulté, car le parent biologique est présent. En revanche, lorsqu'un enfant est adopté de manière plénière par un couple homosexuel, il a deux pères ou deux mères, ce qui pulvérise l'ensemble de notre système de filiation. La demande n'étant pas énorme, la question mérite d'être longuement mûrie avant de sauter le pas. N'oublions pas que la conception occidentale de la famille est à des années-lumière de celle qui a cours dans les pays d'origine des enfants, comme l'Inde, le Vietnam, Haïti, la Chine ou les pays africains. Quelle sera la réaction, là-bas, lorsque arriveront des couples homosexuels dotés de l'agrément ? Je crains un véritable choc culturel. La délégation d'autorité parentale ne semble pas encore suffisamment souple pour les familles recomposées, qui recouvrent des réalités extrêmement diverses selon le temps de vie commune entre le beau-parent et l'enfant, et l'attachement qu'ils se portent. On ne peut pas donner un statut à des situations si différentes. Il faudrait imaginer un système souple pour conférer un titre juridique aux beaux-parents qui s'occupent de leurs beaux-enfants, mais sans oublier le père, car la délégation d'autorité parentale est accordée par les deux parents. Cela vaut aussi pour les enfants élevés par leurs grands-parents. La collégialité existait en droit de la famille et a été supprimée pour deux raisons incontournables : d'une part, un souci d'économie ; d'autre part, la volonté de garantir une justice de proximité, la confrontation à trois personnes étant plus intimidante qu'un dialogue avec celui que l'on considère comme son juge. Par ailleurs, il est immensément souhaitable que les juges aux affaires familiales soient mieux formés. J'en profite pour revenir sur un sujet qui me tient à cœur : la préparation décalée des élèves de l'École nationale de la magistrature (ENM) aux fonctions qui les attendent. Ces juristes pointus, dotés d'une culture générale brillante, sont appelés à intervenir comme pompiers des ménages en perdition. Quelle erreur de casting ! Souvent très jeunes, n'ayant jamais élevé d'enfants et dépourvus d'expérience de vie de couple, ils s'accrochent tant bien que mal à quelques stéréotypes et normes. C'est pourquoi le droit de visite du père n'est supprimé qu'en cas de nécessité absolue. L'ENM devrait cesser de former des magistrats pour la Cour de cassation et penser davantage aux besoins des tribunaux de grande instance « de base ». Le système de l'agrément préalable à l'adoption ne fonctionne pas mal mais repose sur une certaine hypocrisie : l'agrément, c'est bien connu, est souvent accordé à des personnes auxquelles les services sociaux n'ont absolument pas l'intention de confier d'enfant, ce qui les pousse à se tourner vers l'étranger. Une attribution plus rigoureuse des agréments provoquerait certes des problèmes sociaux considérables, mais n'oublions pas que l'adoption internationale entraîne des dérives inacceptables. Enfin, il faudra évaluer la possibilité de lever le secret des origines aux dix-huit ans de l'enfant. Mais il ne faut pas sous-estimer la réaction des mères : il est clair que, quand elles choisissent le secret, elles le font pour l'éternité. M. le Président : Merci pour votre disponibilité et pour la façon directe, précise et passionnante avec laquelle vous avez abordé ces questions. Audition de MM. Jacques Combret et Didier Coiffard, notaires Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Je souhaite la bienvenue à M. Jacques Combret, notaire à Rodez et membre de l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat, ainsi qu'à M. Didier Coiffard, notaire à Oyonnax, qui a participé au groupe de travail sur l'amélioration du PACS mis en place en 2004 par M. Dominique Perben. Notre Mission d'information commence une série d'auditions sur le droit de la famille. Nous avons en effet décidé d'examiner l'organisation juridique de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, afin de vérifier si les droits de l'enfant sont suffisamment garantis par notre législation. Avant d'organiser des tables rondes thématiques, nous avons souhaité recueillir le point de vue des praticiens du droit que sont les notaires, en vue d'apprécier la manière dont les règles applicables au couple, à la filiation et à l'autorité parentale respectent les droits de l'enfant. M. Jacques Combret : Les notaires ont la chance immense de former la seule profession juridique qui rencontre les citoyens sur toute l'étendue du territoire et, dans l'immense majorité des cas, en dehors de toute situation conflictuelle. Pour les praticiens que nous sommes, la diversité des situations rencontrées dans la vie de tous les jours, leur richesse, leur complexité, leur lot de cas exceptionnels, sources d'injustice ou de révolte, ne peuvent qu'amener à des analyses mesurées : nous nous méfions des certitudes. Par ailleurs, dans notre vie de tous les jours, nous sentons parfois un décalage entre certains sujets de préoccupation passionnant les médias et les questions que nos clients se posent. Plusieurs réformes importantes adoptées ces dernières années dans le domaine du droit de la famille sont à nos yeux excellentes, comme celles relatives à l'autorité parentale ou à la connaissance des origines, sans oublier le texte sur la filiation. La matière est sans doute perfectible, mais vous avez déjà accompli beaucoup de bon travail et nous tâcherons de vous apporter des éléments susceptibles de vous aider à compléter votre réflexion. Didier Coiffard et moi-même allons répondre à votre questionnaire en nous répartissant les sujets. M. Didier Coiffard : L'évolution de la conjugalité a constitué l'une des transformations sociales les plus marquantes depuis la naissance du code civil. Le recentrage de la famille sur le couple parental, premier maillon de la cellule familiale, s'est accompagné, depuis un quart de siècle, d'un changement inattendu : l'essor du concubinage ou plus exactement des concubinages. En effet, à côté du concubinage prénuptial ou juvénile, s'est développé un concubinage durable conçu comme un mode d'union stable, plus simple, plus pratique, parfois considéré comme plus moderne que le mariage. Celui-ci n'est plus le modèle unique de vie à deux : en 2001, 2,5 millions de couples sur 14,5 millions vivaient en concubinage, et c'est le plus souvent au sein d'un couple de concubins que naît le premier enfant. En droit, cette diversité des modes de conjugalité se traduit par un traitement juridique différencié. D'un côté demeure le mariage, fondé sur le principe d'engagement et dont l'utilité sociale n'est pas à démontrer. Il bénéficie d'un statut complet, stable et protecteur, offrant aux couples mariés et aux enfants des garanties, contreparties des obligations acceptées par les époux vis-à-vis de la société. Du côté des obligations, les certificats prénuptiaux, la protection de la liberté du consentement et les interdits matrimoniaux constituent autant de contrôles de l'entrée en mariage. De même, les devoirs de fidélité, d'assistance, de secours, la contribution aux charges du mariage, la protection du logement de la famille et la solidarité pour certaines dettes constituent des obligations structurantes du couple marié et par voie de conséquence des enfants. Enfin, quand le démariage survient, le contrôle de la dissolution de l'union, la protection du plus faible et le sort des enfants appartiennent en dernier ressort à l'institution judiciaire. Du côté des droits, les époux accèdent à la liberté de choisir leur régime matrimonial, à la présomption de paternité, à l'alliance des familles et à des droits successoraux, revalorisés par la loi de 2001. Tout cet environnement, fondé sur un engagement dont on espère qu'il durera toute la vie, est de nature à structurer le couple et les enfants. À côté du mariage s'est développé le concubinage libre, fondé sur le principe de liberté, et qui se caractérise par sa précarité. Faut-il imprimer un statut légal au concubinage durable ? Cette voie, nous semble-t-il, serait attentatoire à la liberté car elle priverait les couples d'une liberté fondamentale : celle de choisir de se marier ou de refuser tout engagement et tout statut. « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main », chantait Georges Brassens. Toutefois, derrière la diversité apparente se profile un rapprochement entre le mariage et le concubinage. Le concubinage se normalise et accède à la vie juridique en même temps qu'il accède à la vie sociale : la jurisprudence octroie des droits au concubin délaissé ; les droits périphériques comme le droit social ou le droit du logement intègrent le concubinage ; le droit civil, enfin, reconnaît les concubins, l'autorité parentale étant traitée de façon strictement identique quelle que soit la conjugalité et le concubinage étant désormais défini dans le code civil. De son côté, le mariage se libéralise : la loi du 26 mars 2004, qui crée un véritable droit au divorce, en est l'illustration la plus voyante. Mais c'est dans le mariage que notre code civil consacre expressément la dimension parentale, notamment par son article 203, qui fait obligation aux époux de « nourrir, d'entretenir et élever leurs enfants », et son article 213, qui leur impose de pourvoir ensemble à l'éducation des enfants. Enfin, avec le PACS, le législateur a créé le premier statut légal mais volontaire du concubinage, et consacre ainsi un troisième mode de conjugalité. Le PACS constitue la démonstration du rapprochement entre les deux régimes préexistants car il crée un statut intermédiaire, tout en appartenant au concubinage puisqu'il reste fondé sur le principe de libre rupture. Bien que le PACS soit un contrat, les partenaires ne disposent pas d'une liberté contractuelle totale puisqu'il offre un statut minimal garanti. Au plan personnel, les pacsés ne peuvent déroger ni aux empêchements à contracter un PACS, ni à l'aide mutuelle et matérielle, ni à l'obligation de cohabitation. Au plan patrimonial, ils ne peuvent écarter les présomptions d'indivision que dans des conditions limitées, et ne peuvent se soustraire à l'obligation de certaines dettes. Le PACS est toutefois dépourvu de tout statut successoral, lequel reste le privilège exclusif du mariage. La question de l'enfant au sein du concubinage, qu'il soit libre ou réglementé, ne se situe plus au niveau de la filiation. La loi du 3 décembre 2001 a mis fin à la plupart des distinctions entre les filiations au plan successoral, et l'ordonnance du 4 juillet 2005 a consacré une égalité parfaite entre les enfants, détachée de toute conjugalité. La difficulté qui nous semble subsister se situe au niveau de la rupture du concubinage. Aucun contrôle judiciaire sur le sort de l'enfant n'existe. Pour le concubinage libre, cela peu se comprendre car la rupture n'est pas formalisée. Mais l'information de la dissolution du PACS ne déclenche aucune réaction judiciaire non plus, alors même qu'elle est reçue par le tribunal d'instance. La libre rupture imprime sa marque au concubinage et justifie selon nous une proportionnalité des devoirs et des avantages entre les différentes formes de conjugalité. Si la liberté doit demeurer au concubinage ordinaire, il nous paraît néanmoins que le PACS doit faire l'objet de réformes indispensables pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique. Au fond, les réformes successives de l'autorité parentale et de la filiation parachèvent un statut de l'enfant détaché de la conjugalité de ses parents. M. Jacques Combret : Avant de répondre séparément à vos questions sur l'adoption et la PMA, je souhaiterais faire quelques remarques générales en liant les deux points car ils me semblent difficiles à isoler. On a pu lire que c'était différent car, dans un cas, des parents sont donnés à un enfant et, dans l'autre, un enfant est donné à des parents. Je n'en suis personnellement pas certain : dans les deux cas, il y a création d'un lien entre des parents et un enfant ; ce qui peut justifier l'un doit pouvoir justifier l'autre. Cela dit, notre système juridique actuel est incohérent et le législateur doit avoir le courage d'y remédier, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire en élargissant ou en restreignant. Avant d'expliquer pourquoi, je précise que la distinction entre adoption plénière et adoption simple est plus que jamais indispensable ; si, en droit, les différences sont importantes, c'est encore plus flagrant en pratique. Dans les débats, trois questions reviennent toujours. D'abord, l'intérêt de l'enfant : toute création d'un lien se fait pour son bien. Or un lien d'amour fort existe dans presque tous les cas au moment où le lien se crée ; personne n'adopte ou ne recourt à une PMA pour satisfaire son plaisir personnel. Ensuite, la nécessité d'un père et d'une mère : c'est un argument majeur pour ceux qui veulent écarter l'adoption par des parents homosexuels. Enfin, le mariage : c'est la nécessité du mariage qui est principalement avancée par ceux qui contestent la possibilité d'adopter par un couple de concubins. Mais que constate-t-on ? Premièrement, si l'intérêt de l'enfant rend nécessaire la présence d'un père et d'une mère, cela ne condamne-t-il pas l'adoption par une personne seule ? Deuxièmement, si l'intérêt de l'enfant rend nécessaire le mariage pour l'accueillir, cela ne condamne-t-il pas le recours à une PMA par un couple de concubins ? Faut-il alors revenir en arrière et donner de la cohérence en supprimant à la fois l'adoption par une personne seule et la PMA par les concubins ? On peut penser que non, toujours au regard de l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où, dans l'immense majorité des situations, cela semble ne pas trop mal marcher. Et n'oublions pas que des situations difficiles peuvent aussi survenir dans les schémas classiques. Je pense aux traumatismes vécus par beaucoup d'enfants à l'occasion de la séparation de leurs parents, qu'ils aient été mariés ou concubins, ou encore aux échecs de certaines adoptions. En un mot, nous sommes des hommes, avec nos faiblesses, et aucune configuration ne saurait garantir l'intérêt de l'enfant en toutes circonstances. Par ailleurs, la baisse du nombre de mariages, le nombre important de remariages, le fait que plus d'un enfant sur deux naisse hors mariage et le nombre élevé de divorces démontrent que la société actuelle est plus que jamais complexe. Mais, si rien n'est fait, l'incohérence de notre système subsistera. Tentons donc de répondre aux questions posées. Les concubins hétérosexuels pouvant avoir recours à une PMA, pourquoi ne pas leur ouvrir droit à l'adoption, au nom de la cohérence ? Peut-on aujourd'hui encore prétendre que l'adoption serait en pareil cas un danger pour l'enfant, alors que plus de la moitié des enfants naissent hors mariage et qu'une personne seule peut adopter ? Pour les couples homosexuels, la réponse est beaucoup plus délicate, même si l'acceptation de l'adoption par une personne seule contient en germe une source de contournement. Reconnaissons que le nombre de cas est encore marginal. Il faut se montrer prudent avant d'instaurer une règle qui, en résolvant quelques situations difficiles, viendrait bouleverser les fondements de notre droit. Il n'empêche que des questions se posent et qu'une réflexion autour de l'adoption simple peut se concevoir dans quelques cas extrêmes. Il arrive que des couples hétérosexuels ayant eu des enfants se séparent parce que l'un d'entre eux part vivre avec une autre personne de même sexe ; il peut alors se créer des liens affectifs forts entre les enfants et le partenaire. Ne peut-on imaginer en pareil cas une possibilité d'adoption simple à l'âge où les enfants sont à même de donner leur consentement ? De la même manière, ne peut-on envisager l'adoption simple de l'enfant adoptif de l'autre membre du couple en cas d'adoption antérieure ? L'intérêt de l'enfant serait de consacrer juridiquement un lien affectif fort et d'éviter ainsi de se retrouver orphelin en cas de décès de son père ou de sa mère. D'ailleurs, en pareil cas, l'enfant devenu orphelin pourrait être adopté par le membre survivant du couple homosexuel. Ce qui serait possible après ne pourrait-il pas l'être avant ? Je rappelle cependant qu'il convient d'être prudent, que ces solutions ne sont envisageables qu'en cas d'absence de conflit et que l'intérêt de l'enfant appelle une évolution des mentalités. S'agissant des agréments délivrés par les conseils généraux, les parents désireux d'adopter considèrent que le parcours du combattant qu'on leur impose est à la fois trop long et trop complexe. Nous sommes très présents dans ce domaine, surtout pour les adoptions d'enfants étrangers : il faudrait simplifier, raccourcir et coordonner les procédures, notamment pour les parents qui changent de département. Si le champ de la PMA devait être ouvert, il ne devrait pas y avoir de limite, sous peine de créer de nouvelles discriminations, par exemple entre couples homosexuels féminins et masculins. Si le recours à une PMA pour une femme homosexuelle avec tiers donneur devait être admis, il faudrait également accepter la gestation pour autrui afin qu'un couple d'hommes puisse avoir un enfant. Mais notre société est-elle prête à tout cela ? Quelle place conserve la recherche de l'intérêt de l'enfant ? Cela ne confine-t-il pas très vite à la simple satisfaction des intérêts du couple ? Débuter sa vie au milieu de deux personnes de même sexe, tout en étant issu du sperme ou du ventre d'une tierce personne est-il souhaitable pour un enfant ? Ne serait-ce pas là une loi générale destinée à régler une question marginale ? La loi du 23 janvier 2002 sur la connaissance des origines est un texte d'équilibre qui constitue pour l'instant un palier à ne pas déplacer. Il ne nous paraît pas utile non plus de modifier la règle relative à l'anonymat des donneurs de gamètes dans le cas de PMA avec tiers donneur. L'expérience suédoise a eu un effet négatif, avec une baisse sensible des dons : on veut bien aider quelqu'un à avoir un enfant, mais sans prendre le risque de créer un lien juridique. La loi du 4 mars 2002 règle beaucoup de problèmes concernant l'autorité parentale. En tant que praticiens, nous nous demandons si le changement de formulation de l'article 373-2-9 du code civil changerait grand-chose. Là encore, le vécu sur le terrain démontre que toutes les situations se rencontrent, surtout quand règne la mauvaise foi. La médiation, en matière familiale, ne peut qu'être encouragée, qu'il s'agisse d'ailleurs d'autorité parentale ou d'autres questions. Un professionnel unique étant rarement capable de tout régler, il convient de la favoriser au sein de structures regroupant divers spécialistes. Cette proposition se heurte malheureusement à un obstacle budgétaire ; peut-être faut-il envisager un effort de la part de chaque profession concernée. La place des beaux-parents est effectivement très importante dans la vie de tous les jours, mais il faut prendre garde à la protection des parents biologiques et plus particulièrement du père, qui est le plus facilement évincé. La recherche d'accords amiables est possible au sein des recompositions familiales, plus fréquemment apaisées qu'on ne le croit. Les notaires avaient suggéré, en 1999, la possibilité de conclure de façon amiable des délégations partielles de l'autorité parentale pour les actes usuels de la vie courante ; cela pourrait également se concevoir avec un partenaire de PACS ou un concubin. Mme Patricia Adam : Cela existe déjà. Mme la Rapporteure : Mais la délégation ne vaut que pour un acte précis ; elle n'est pas générale. M. Jacques Combret : Dans l'état actuel des choses, les délégations, ponctuelles, ne permettent pas de répondre aux situations d'urgence. Dès lors que les parents ne sont pas en conflit, pourquoi ne concluraient-ils pas un accord à ce sujet sans aller devant le juge ? Ce mandat conventionnel présenterait en outre l'avantage de pouvoir être annulé, limité ou adapté. Les problèmes concernant les grands-parents apparaissent principalement à la suite du divorce des parents. Une modification législative ne serait pas forcément de nature à régler tous les conflits, l'imagination de l'homme étant sans limite lorsque la passion est en jeu. M. Didier Coiffard : Votre délicate question sur les différences entre les couples hétérosexuels et homosexuels appelle une réponse plus philosophique que notariale. La véritable problématique qui se profile là est celle du mariage homosexuel. En tant que notaires, ce n'est pas une question dont nous avons à traiter fréquemment, tant les situations sont marginales et hors de proportion avec le débat qui s'instaure. Néanmoins, dans notre pratique, la question se pose en droit international privé, quand nous recevons un couple belge, néerlandais - demain espagnol - procédant à une acquisition en France. Doit-on reconnaître ces couples comme mariés ? Lorsque l'un des deux décédera, quelles dispositions successorales s'appliqueront ? Concernant les formes de conjugalité, un consensus semble s'instaurer sur deux points : le PACS doit demeurer un contrat conjugal ouvert à tous, homosexuels comme hétérosexuels ; il ne doit pas devenir un mariage bis, mais rester un statut intermédiaire entre le mariage et le concubinage. Partant de ces deux points, nous arrivons vite dans une impasse. Deux solutions s'offrent au législateur. Première solution, l'ouverture du mariage aux homosexuels bousculerait la plus vieille institution juridique, dont la conception a évolué au travers des siècles, mais qui est toujours restée l'union d'un homme et d'une femme pour accueillir des enfants. L'acceptation d'une telle revendication constituerait un bouleversement complet de l'institution, surtout dans sa dimension parentale, tant parentalité et mariage sont étroitement liés, et quand bien même le mariage n'est plus depuis longtemps le lieu d'accueil exclusif des enfants. La question de l'enfant est fondamentale : dissocier le mariage homosexuel de la parentalité, comme l'a fait la Belgique, ne semble pas une solution tenable. L'absence de recul et d'étude objective sur les conséquences psychologiques et sociologiques de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe nous incite à conseiller l'application du principe de précaution. La deuxième solution consisterait à ouvrir un régime secondaire du PACS, réservé aux couples homosexuels, donnant des droits sensiblement équivalents à ceux découlant du mariage, mais découplé de la parentalité, à l'instar du PACS catalan. Cette solution, pour séduisante qu'elle soit, ne satisfera pas la communauté homosexuelle, aux yeux de laquelle le droit au mariage est d'abord le droit à l'indifférence et au bonheur. À la fin du quatrième trimestre 2004, plus de 130 000 PACS étaient recensés, avec un rythme annuel de 30 000 à 40 000 nouveaux contrats. Il était initialement voulu comme un contrat indépendant de l'état des personnes, mais le Conseil constitutionnel en a changé la dimension en précisant qu'il supposait une vie de couple. Ce faisant, il a consacré un nouveau mode de conjugalité, entre le mariage et le concubinage ordinaire. Le PACS déchaîna nombre de passions aujourd'hui retombées, et le texte en garde les stigmates. Des solutions juridiques complexes, un régime patrimonial à parfaire, une publicité restreinte ont amené la profession notariale à se pencher sur la question. Sur la forme, les futurs partenaires ignorent dans la majorité des cas que le PACS est un contrat. Une fois arrivés au greffe, ils écrivent sur un coin de table : « Nous déclarons nous pacser sous les conditions du code civil ». Un document d'information devrait être remis aux futurs partenaires, comme c'est le cas pour les époux. Par ailleurs, l'exigence de l'enregistrement d'un double original prive les partenaires de la conservation et de la sécurité juridique attachées à l'acte notarié, puisque, par définition, les originaux sont conservés par les études. La possibilité de produire une copie authentique permettrait aux couples de conserver l'accès au document de référence établi devant le notaire. Enfin, le système de publicité est complexe puisque deux ou trois registres sont nécessaires pour enregistrer un PACS. Ce formalisme excessif entraîne une surcharge de travail aux greffes, inondés de demandes de certificat de non-PACS. Le PACS étant un mode de conjugalité à part entière, il nous semble nécessaire de faire figurer, en marge de l'acte de naissance, qu'un PACS a été conclu et, le cas échéant, dissous. Plusieurs points de fond appellent également des améliorations. Les contours de l'aide mutuelle et matérielle sont extrêmement mal définis, et ses modalités doivent être fixées dans le pacte, formalité que les partenaires oublient souvent ou remplissent mal. La loi devrait y suppléer en précisant que l'aide mutuelle intervient à proportion des facultés contributives de chacun. Le texte actuel ne comporte pas de précisions concernant la solidarité des dettes, et engage les partenaires de manière plus importante que des époux pour l'achat à tempérament, les dettes excessives ou les emprunts, ce qui n'est pas cohérent. Il conviendrait de limiter la solidarité aux seules dettes de la vie courante qui ne seraient pas excessives. Le régime des biens est complexe. Les meubles meublants sont indivis, sauf déclaration contraire. Les autres biens sont présumés indivis par moitié à défaut d'indication contraire dans l'acte d'acquisition ou de souscription. Il est donc impossible d'écarter cette présomption dans la convention de PACS elle-même. Cette indivision est un véritable mode d'acquisition pour le compte des deux, quand bien même un seul d'entre eux financerait ce bien, et les partenaires n'en ont évidemment pas conscience. Le PACS peut donc s'avérer plus communautaire que la communauté légale, aucun mécanisme correcteur n'existant pour les deniers acquis avant le mariage ou reçu par donation ou succession. Voilà qui est source d'une grave insécurité juridique. C'est pourquoi le régime légal du PACS nous semble devoir être celui de la séparation des biens, avec possibilité pour les partenaires d'opter pour une indivision clarifiée et corrigée de ses excès. Le PACS comporte bien des améliorations du point de vue fiscal, mais ne confère aucun statut successoral aux partenaires. Le principe d'humanité devrait permettre à une personne pacsée de bénéficier d'un droit temporaire au maintien dans le logement commun, pendant trois mois, par exemple, après le décès de son partenaire. M. le Président : Un problème se pose lorsque l'un des partenaires est propriétaire du logement. Par contre, en cas de location, le maintien dans le logement est garanti. La propriété entraîne paradoxalement davantage de précarité que la location. M. Didier Coiffard : Absolument. Ne faut-il pas ouvrir un droit au logement sur testament ? M. Jacques Combret : Sur la Convention internationale des droits de l'enfant, les universitaires vous apporteront des précisions plus intéressantes que nous car nous sommes des hommes de l'amiable et non du contentieux. Nous avons cependant observé les évolutions jurisprudentielles récentes de la Cour de cassation. M. le Président : Il ne s'agit effectivement pas de faire du PACS un mariage bis en l'alourdissant à l'excès, ce qui le dénaturerait. Il n'en demeure pas moins que, au moment de l'examen du texte, la direction des affaires civiles et du sceau est intervenue sur certaines questions, et notamment sur le régime des biens. Au départ, Jean-Pierre Michel et moi avions prévu d'assortir le PACS d'un régime de communauté de biens, et c'est la Chancellerie qui nous a forcés à opter pour le régime de l'indivision : les positions conservatrices ont donc abouti à une logique plus communautaire que celle régissant le régime matrimonial. De la même façon, nous avions souhaité que le PACS soit considéré comme une sorte de volonté testamentaire, mais certains ont répété à satiété qu'il ne s'agissait pas d'un testament en tant que tel. Quoi qu'il en soit, vos propositions concernant l'amélioration du PACS seront très précieuses. Mme la Rapporteure : J'ai été très intéressée par votre proposition de délégation amiable d'autorité familiale. Mais où préconisez-vous qu'elle soit enregistrée ? M. Jacques Combret : Nous avons proposé qu'elle soit établie par acte authentique - il s'agit ni plus ni moins d'une procuration -. Vous pourriez nous opposer que cela tend au monopole. Mais il s'agit en priorité de déterminer quel est l'outil le plus commode pour le public. L'acte authentique unique permet de délivrer des copies authentiques en nombre illimité. Quant à notre rémunération, elle est fixée par l'État et, rassurez-vous, une procuration nous rapporte moins de quinze euros. Avec la suppression du droit de timbre et le nouveau régime des droits fixes, qui entreront en vigueur le 1er janvier prochain, un mandat pourra être établi devant notaire pour un montant extrêmement modeste. C'est un choix stratégique ; je ne cherche pas à faire passer quoi que ce soit en faveur des notaires, lesquels, au demeurant, ne m'ont rien demandé. M. Didier Coiffard : Nous sommes favorables au relèvement à dix-huit ans de l'âge du mariage pour les jeunes filles afin de supprimer une discrimination et de retenir l'âge de maturité plutôt que celui de puberté. Mme la Rapporteure : Sans trahir le secret professionnel, pouvez-vous nous dire si vous êtes amenés à traiter beaucoup de successions de familles recomposées ? M. Didier Coiffard : Bien souvent, les membres de la famille s'entendent bien et décident par exemple de répartir le produit de la cession de la maison commune à parts égales entre les enfants nés de deux mariages. Mes confrères suisses établissent des pactes successoraux pour aider les familles recomposées à gérer ces situations. Je les ai interrogés sur ce sujet et, à 98 %, ils répondent que cela fonctionne. M. Jacques Combret : N'oublions les ménages les plus modestes, pour lesquels il est difficile de trouver des bonnes solutions de répartition du patrimoine. Quiconque n'a qu'un enfant, par exemple, ne peut consentir à une donation-partage. Le projet de réforme de successions porte en germe la formule qui nous conviendrait, l'adoption des enfants du conjoint étant une extrémité à laquelle il n'est pas évident de se résoudre pour un simple motif successoral. M. Didier Coiffard : L'adoption n'est effectivement pas la bonne réponse. Se faire adopter est parfois souvent interprété comme une trahison envers sa famille d'origine, et il ne faut pas négliger non plus le risque de séparation du couple. Il convient en définitive d'aligner le statut fiscal des beaux-enfants sur celui des enfants, ou du moins de l'en rapprocher, comme en Allemagne ou en Suède. Sans volet fiscal, toute réforme sera inopérante. M. Jacques Combret : En cas d'adoption simple, il faut, pour faire bénéficier son enfant du régime fiscal parent-enfant, l'avoir élevé pendant six années de sa minorité ou dix années de sa minorité et de sa majorité. Par contre, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, aucune règle n'est imposée. M. le Président : Consacré à la situation des personnes vulnérables, le 102ème congrès des notaires de France, que vous présiderez, monsieur Combret, traitera, si je ne me trompe, de toutes ces questions. Audition de Mmes Marie-Élisabeth Breton, avocate au barreau d'Arras, membre du Conseil national des barreaux, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous accueillons maintenant Mmes Marie-Élisabeth Breton, Béatrice Weiss-Gout, Dominique Piwnica et Andréanne Sacaze, représentant le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers. Comme vous le savez, notre Mission commence une série d'auditions sur le droit de la famille. Nous avons en effet décidé d'examiner l'organisation juridique de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, afin de vérifier si les droits de l'enfant sont suffisamment garantis par notre législation. Avant d'aborder sous forme de tables rondes les thèmes d'investigation que nous avons retenus, il nous a semblé indispensable de recueillir la position des praticiens du droit, et tout particulièrement des avocats. Les questions que nous nous posons sont souvent complexes et votre expérience peut nous apporter un éclairage précieux. Comme il vous a été indiqué, je souhaiterais que vous nous donniez votre appréciation sur la manière dont les règles applicables au couple, à la filiation et à l'autorité parentale respectent les droits de l'enfant. Mme Béatrice Weiss-Gout : Nous n'arrivons pas en ordre dispersé : le discours que nous allons tenir, en veillant à suivre la trame du questionnaire que vous nous avez adressé, résulte d'un travail de concertation. Mme Marie-Élisabeth Breton : S'agissant de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est surtout, de notre point de vue, l'audition de l'enfant qui peine à être respectée. Le premier problème concerne la formation des magistrats et, sans doute, aussi des avocats, pour les sensibiliser à la nécessité d'entendre l'enfant lorsqu'il le demande. L'enfant est sujet de droit dans le cadre de l'assistance éducative, avec la possibilité d'accéder à son dossier et d'être défendu. En matière pénale, l'assistance d'un avocat est même obligatoire. Malheureusement, dans le quotidien de l'enfant, c'est un véritable no man's land. On constate une absence d'harmonisation des pratiques, au sein même d'un tribunal donné, certains juges acceptant d'auditionner les enfants quand d'autres, pour des motifs d'âge ou de discernement, le refusent et bottent en touche vers les expertises psychologiques, les enquêtes sociales et autres médiations, lesquelles ne font parfois qu'envenimer le conflit et empêchent en tout cas les enfants de s'exprimer véritablement. Le système devient donc pervers, avec un coût relativement élevé : alors que le juge devrait prendre ses responsabilités, il multiplie les interventions de tierces personnes. Au-delà du problème de l'information et de la sensibilisation du juge, il s'avère donc nécessaire d'intégrer dans notre réglementation interne la nécessité d'auditionner l'enfant. Le système en vigueur au barreau de Paris m'apparaît exemplaire. Les auditions sont menées par un psychologue cumulant deux fonctions : l'écoute des enfants et l'information sur leurs droits ; le souci de se faire une idée sur leur discernement et de vérifier s'ils ne sont pas dans un conflit de loyauté avec leurs parents. Les magistrats craignent en effet toujours les instrumentalisations. Lorsque l'audition est sollicitée par l'un des parents, le juge doit désigner une tierce personne - c'est la fonction de nos psychologues - ainsi qu'un avocat pour l'enfant, distinct de celui du père ou de la mère, car il serait injuste que l'enfant soit en situation d'inégalité de droit par rapport aux adultes. La formation des avocats sur le droit des mineurs s'organise et leur qualité d'écoute est remarquable, mais ils devraient avoir la possibilité d'intervenir en amont de la procédure afin de déterminer si l'enfant dispose du discernement nécessaire et de l'informer sur ses droits. En 1998 déjà, nous insistions sur l'importance de l'audition de l'enfant, et Mme Claire Brisset souligne que de plus en plus d'enfants demandent à être entendus pour s'exprimer sur la manière dont ils souhaitent organiser leur vie. C'est crucial non seulement dans la procédure, mais aussi postérieurement à celle-ci. Mme Dominique Piwnica : Cela implique une modification de l'article 373-2-11 du code civil. Je précise que le barreau de Paris se caractérise par une pratique pilote, avec deux psychologues rattachés au tribunal qui délivrent leur rapport dans le bureau du juge, oralement, en présence des parents et de l'enfant, ce qui rend le dispositif moins lourd, moins onéreux et plus facile d'accès pour les familles et les magistrats. Mme Patricia Adam : Par qui ces psychologues sont-ils payés ? Mme Dominique Piwnica : Par le ministère de la justice, sur le budget du tribunal. Nous avons failli en perdre une partie mais, miracle de la Chancellerie, le président du tribunal m'a assuré lundi qu'il avait obtenu le renouvellement du budget attaché à ce poste. Mme Marie-Élisabeth Breton : Cela revient toujours moins cher que les enquêtes sociales, dont le prix unitaire s'élève à 1 000 ou 1 500 euros. Mme Béatrice Weiss-Gout : S'agissant des formes d'organisation du couple, il n'est pas de notre compétence de répondre à votre seconde question. Nous attirons par contre votre attention sur un point très important, eu égard à l'intérêt de l'enfant. Si deux personnes pacsées ou vivant en concubinage ont des enfants et si elles possèdent en indivision le domicile de la famille, ou si elles en détiennent en commun le bail de location, deux juges sont compétents lorsqu'elles se séparent : le juge aux affaires familiales (JAF) pour l'organisation de la vie des enfants, le juge ordinaire pour l'attribution du logement. Pour les locataires, la situation est relativement simple, mais, pour les co-indivisaires, la procédure peut prendre deux à trois ans et aboutit souvent à une solution insuffisante, dans la mesure où elle ne prend pas en compte la détermination du lieu de résidence des enfants. Les conséquences de cette situation sont parfois terribles et se traduisent par des violences à l'encontre du plus faible : des femmes partent avec leur enfant sous le bras, tandis que des hommes se trouvent privés de l'usage du bien indivis et dépourvus de moyens pour se reloger. Nous souhaiterions par conséquent que le JAF ait le pouvoir de statuer de manière provisoire, le tribunal restant évidemment compétent pour statuer définitivement sur les conditions de vente du bien indivis. Sur l'adoption par des couples non mariés, la position des avocats est partagée, comme celle de la société. La plupart d'entre nous considèrent cependant que l'intérêt de l'enfant est toujours mieux protégé lorsque le couple est stable, et que l'accès à l'adoption doit par conséquent être subordonné à une certaine durée de vie commune. Notre groupe de travail a retenu la fourchette de deux à cinq ans, certains de ses membres préconisant même la nécessité de l'existence d'un PACS. En tout cas, l'adoption par un couple homosexuel stable serait préférable à celle par une personne seule, comme c'est souvent le cas actuellement. Je signale que nous ne nous prononçons pas d'un point de vue éthique, mais du point de vue du praticien. Mme Marie-Élisabeth Breton : Les conditions de délivrance des agréments sont catastrophiques : elles obéissent à avec des critères subjectifs, et nous nous interrogeons parfois sur la capacité et la formation des personnes désignées pour s'en occuper. La dernière loi relative à l'adoption va introduire des améliorations, et ouvrir une réflexion, en amont puis en aval, sur les problèmes de l'adoptant et de l'adopté. En matière d'adoption internationale, reste le problème des listes transmises par les conseils généraux aux personnes ayant l'intention d'adopter : elles sont mal vérifiées et certaines associations sont davantage enclines à faire de l'argent qu'à défendre l'intérêt des enfants. Malheureusement, une fois qu'ils ont la liste en main, les futurs adoptants se retrouvent abandonnés, et entrent dans une spirale financière discutable. De surcroît, les enfants sont très souvent dépourvus de livret médical et les adoptants n'ont aucune connaissance de leur histoire. Mme Béatrice Weiss-Gout : Nous sommes favorables au développement de l'adoption simple, sous la réserve d'en élargir l'accès. Si vous êtes marié et que votre enfant est adopté par votre conjoint, vous ne perdez pas l'autorité parentale. En revanche, si vous vivez en concubinage ou si vous êtes pacsé, vous perdez l'autorité parentale et vous ne pouvez la récupérer que par un mécanisme compliqué de délégation, ce qui est absurde. Nous suggérons donc au législateur d'élargir la disposition de l'article 365 du code civil aux concubins et aux pacsés. Nous nous sentons incompétents pour déterminer si les couples homosexuels doivent avoir accès à la procréation médicalement assistée ; nous renvoyons la question aux pédopsychiatres. Cela dit, en cas de conflit entre les deux valeurs que sont l'intérêt de l'enfant et la non-discrimination entre couples hétérosexuels et homosexuels, en toute hypothèse, c'est la première qui doit primer. S'agissant de la gestation pour autrui, la question ne doit pas, nous semble-t-il, être abordée de manière exclusivement pragmatique en cherchant des solutions pour les enfants nés à l'étranger grâce à cette pratique. Le problème est d'abord éthique et appelle de ce fait une réponse éthique. S'il apparaît qu'il faut maintenir l'interdiction de cette pratique, il convient de déterminer des sanctions. Cela dit, nous souhaitons absolument que les enfants nés de cette pratique puissent bénéficier d'un statut, à travers l'adoption. Mais le fait que l'on puisse aller à l'étranger procéder à une gestation pour autrui ne justifie pas en soi d'autoriser cette pratique en France. Mme Marie-Élisabeth Breton : Nous sommes assez favorables à une meilleure information de l'enfant sur ses origines, comme c'est le cas dans d'autres pays, mais cette information ne doit pas ouvrir d'autres droits, par exemple celui d'exiger une pension alimentaire du donneur. Le décret d'application de la loi du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille pourrait avoir des conséquences sur l'accès de l'enfant au nom de sa mère. Mme Patricia Adam : Comment l'enfant pourrait connaître le nom de sa mère si l'accouchement est anonyme ? M. Patrice Delnatte : Pour les accouchements sous X, aucun nom n'est déclaré. Mme Marie-Élisabeth Breton : Justement, nous nous interrogeons sur les conséquences du décret d'application de la loi de 2002. Mme Béatrice Weiss-Gout : Le dispositif de l'accouchement sous X nous paraît assez bon. En réalité, nous nous sommes davantage interrogés sur la question plus originale de la connaissance des origines des enfants nés grâce à un don de gamète, et nous avons estimé qu'une solution consisterait à mettre en place un système proche de celui de l'accouchement sous X. Nous restons néanmoins réservés, compte tenu notamment du risque de voir les donneurs se raréfier. L'idée générale est de préserver la possibilité d'accoucher sous X ou de donner des gamètes, tout en permettant à l'enfant d'accéder à des informations sur ses parents biologiques, sans pour autant que cela ne lui confère des droits sur eux. Mme Dominique Piwnica : L'accès à l'information, oui, mais il convient d'être prudent en raison des conséquences juridiques : demandes de pension alimentaire, d'un droit de visite et d'hébergement ou prétention à des droits réservataires sur les successions. Sur la résidence alternée, notre groupe est arrivé à deux constats, certains de ses membres ayant toutefois émis des réserves. Premièrement, compte tenu de la rédaction de l'article 373-2-9 du code civil, en cas de désaccord des parents, les juges statuent systématiquement pour un partage égalitaire du temps, à un jour près. Notre groupe de travail a estimé qu'il serait souhaitable de préciser que la résidence alternée n'implique pas nécessairement un partage égalitaire. Deuxièmement, beaucoup de résidences alternées à l'essai chez des enfants tout petits ont produit des catastrophes et aujourd'hui les magistrats, alertés par les pédopsychiatres, reviennent un peu en arrière. Plusieurs membres de notre groupe de travail préconisent de compléter l'article 373-2-11 du code civil afin que le magistrat prenne en considération l'âge de l'enfant lorsque celui-ci a moins de trois ans, ce qui correspond à l'âge de la scolarisation, l'âge de l'autonomie. Certains d'entre nous allaient jusqu'à souhaiter l'interdiction de la résidence alternée en dessous de cet âge, mais nous sommes convenus que ce serait peut-être excessif. L'idée est d'attirer l'attention du juge sur l'impossibilité de statuer sur un mineur de trois ans de la même manière que sur un enfant un peu plus grand. Mme Henriette Martinez : L'âge de l'autonomie est de six ans et non de trois. Mme Dominique Piwnica : C'est vrai, mais un enfant est scolarisé à trois ans. En tout cas, nous avons constaté que la résidence alternée, avant trois ans, conduisait souvent à des catastrophes et exacerbait les conflits. Mme Patricia Adam : Et elle rend les enfants tyranniques. Mme Béatrice Weiss-Gout : Parmi les avocats, les avis sont nuancés selon les générations : les plus jeunes sont moins réticents à appliquer la résidence alternée aux petits. Mme la Rapporteure : Même ceux qui ont des enfants ? Mme Béatrice Weiss-Gout : Absolument. Quand les deux parents sont d'accord, il est évident qu'il faut privilégier cette solution. Mme Henriette Martinez : L'intérêt des parents doit donc selon vous primer sur celui des enfants. Mme la Rapporteure : Quand les parents se mettent d'accord, on peut présumer que c'est dans l'intérêt de l'enfant. Mme Béatrice Weiss-Gout : Exactement : pour l'enfant, le plus important est que ses parents soient en accord sur le mode d'organisation de leur vie. Mme Henriette Martinez : C'est une idée tendancieuse. Mme Dominique Piwnica : Même si le projet d'organisation des parents ne nous satisfait pas, ils parviendront toujours mieux à l'appliquer s'ils l'ont choisi eux-mêmes que si on leur en impose un autre. En revanche, lorsque la résidence alternée est imposée par le juge, le conflit ne s'apaise pas ; au contraire, il s'aggrave. Mais Mme Weiss-Gout n'est pas du même avis. Mme Béatrice Weiss-Gout : En cas de désaccord, les résultats sont très contrastés. Par contre, en cas d'accord, l'effet apaisant est clair. Mme Henriette Martinez : Sur les parents ! Mme la Rapporteure : Sur les enfants aussi. Mme Béatrice Weiss-Gout : Cela se répercute sur les enfants car les déchirements des parents leur sont très pénibles. Mme Henriette Martinez : Ce que décident les parents n'est pas forcément bon pour les enfants. Mme Béatrice Weiss-Gout : Le plus grave, pour un enfant, est que ses parents soient en conflit sur le mode d'organisation de sa vie, nous en parlons d'expérience. Le divorce par consentement mutuel évite tous les débats devant le juge. Mme Dominique Piwnica : Les experts le disent : les enfants veulent avant tout que leurs parents cessent de se déchirer à leur sujet. Mme la Rapporteure : Cela signifie peut-être qu'ils sont prêts à payer de leur personne. Mme Béatrice Weiss-Gout : Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'ils attendent. Mme Andréanne Sacaze : Je ne partage pas tout à fait l'analyse selon laquelle les enfants en résidence alternée deviendraient tyranniques. J'ai beaucoup privilégié cette formule, le plus souvent sur accord des parents, et je puis vous dire que, lors de l'analyse médico-psychologique souvent menée par précaution, nombre d'enfants affirment qu'ils souhaitent vivre avec leurs parents à parts égales parce qu'ils les aiment autant l'un que l'autre. C'est presque de la casuistique et il faut en juger au cas par cas. Je suis très réservée sur la possibilité d'imposer ce mode d'organisation aux parents mais, dès lors qu'un accord se dégage, il faut le privilégier. Mme Marie-Élisabeth Breton : Il existe cependant un autre problème : les parents ne passent qu'une seule fois devant le juge, et peu de temps après avoir commencé d'expérimenter la résidence alternée, ce qui les prive de tout recul. Mme Andréanne Sacaze : Se pose également le problème de la responsabilité civile des parents, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil, dont la Cour de cassation a une vision très extensive, puisque les seules exceptions qu'elle admet sont les cas fortuits ou de force majeure. Si l'enfant est confié à une institution, c'est l'article 1384, alinéa 1er, qui s'applique. En revanche, lorsque l'enfant commet une faute préjudiciable à un tiers, le parent chez qui il ne se trouve pas est tout de même responsable, solidairement avec le parent chez qui il réside. Dans la pratique, la question est récurrente : je suis responsable de mon enfant même lorsqu'il est chez sa mère ou son père, et alors même que je n'adhère pas à ses pratiques éducatives. Nous n'avons pas de solution magique à proposer, mais il serait bon de se pencher sur le sujet. Votre question sur la médiation familiale induit la réponse : le système ne s'est effectivement pas bien développé en France. Le problème est d'abord philosophique : il s'agit de privilégier le dialogue sur le conflit et l'action judiciaire, en persuadant les parents de reprendre leur destin en mains, ainsi que celui de leur enfant. Les pouvoirs publics, dans notre pays, n'ont pas accordé à la médiation les moyens financiers nécessaires. Ayant présidé la Fédération nationale des centres de médiation, je vous assure que j'ai bataillé sans succès pour obtenir trois francs six sous, contrairement aux associations diverses et variées d'assistants sociaux. Notre groupe de travail estime que la médiation exige une pluridisciplinarité. Les personnes titulaires du diplôme de médiateur devant être formées sur les plans juridique, sociologique et psychologique ; il convient donc de mettre sur pied des formations spécifiques à l'université, dans les écoles d'avocats, à l'École nationale de la magistrature, comme à la faculté de médecine. Par ailleurs, on entend souvent dire que la médiation, pour marcher, ne doit pas être imposée. Je considère au contraire, avec Mme Breton - mais nous avons des contradicteurs -, qu'elle devrait être obligatoire avant toute saisine du juge, afin de reconstruire le dialogue ; le juge ne devrait être là que pour homologuer l'accord. En amont, il faut que nous balayions devant notre porte et que nous soyons parfaitement formés à la consultation des couples séparés en conflit au sujet de l'enfant. Combien de couples viennent nous confier qu'ils éprouvent des difficultés à éduquer leurs enfants et qu'ils vont divorcer alors qu'ils s'aiment encore ! Cette problématique se traduit par un divorce par consentement mutuel, alors que leur avocat - mais encore faudrait-il que nous soyons tous formés aux problèmes familiaux - devrait les inviter à entrer dans un espace de dialogue pour retrouver des relations compatibles avec l'éducation d'un enfant. Cela poserait des difficultés budgétaires à l'État, car les médiations doivent être possibles pour tous, ce qui pose le problème de leur gratuité à travers l'aide juridictionnelle. Enfin, il faudrait que chaque État membre de l'Union européenne se dote d'un service spécialisé dans la médiation internationale, impliquant tous les départements ministériels concernés. Si les mesures prévues par le règlement communautaire dit « Bruxelles II bis » concernant les enlèvements internationaux d'enfants amélioreront un peu la situation, il n'en demeure pas moins que les professionnels du droit ayant à traiter de dossiers internationaux se sentent un peu exclus, et aimeraient être mieux informés par les pouvoirs publics, afin de mieux conseiller leurs clients. Mme Marie-Élisabeth Breton : Le système international qui a été mis en place est un peu compliqué. J'étais pour ma part favorable à l'accès à des informations en amont du système judiciaire, ce qui aurait permis de parvenir à des médiations pour des problèmes comme l'organisation de la vie des enfants ou les pensions alimentaires. Mme Béatrice Weiss-Gout : Les avocats, loin de se cramponner aux solutions judiciaires, sont très intéressés par tous les modes alternatifs de règlement des litiges. En matière familiale, le poids de l'ordre public s'atténue et nous nous orientons également vers des démarches contractuelles. Mme Dominique Piwnica : Lorsque des grands-parents entament des procédures judiciaires à l'encontre de leurs beaux-enfants ou de leurs enfants, que ceux-ci soient divorcés ou non, les conflits s'en trouvent aggravés. Le groupe de travail estime donc unanimement qu'aucune modification ne doit être apportée au code civil sur ce sujet. Faut-il instaurer un statut de « parent social » applicable aux beaux-parents, marâtres et parâtres ? L'arsenal juridique actuel permet aux parents de déléguer leur autorité parentale ou aux beaux-parents de recourir à l'adoption simple - je rappelle sur ce dernier point que nous demandons une modification de l'article 365 du code civil afin que le père ou la mère biologique non marié conserve l'autorité parentale -. Ces deux formules répondent à des types de situations différents et doivent être maintenues. Une autre solution existe, prévue par l'article 373-2-7 du code civil, issu de la loi du 4 mars 2002 : les parents peuvent demander au juge aux affaires familiales d'homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution nécessaire à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Nous suggérons qu'ils puissent également proposer au juge d'autoriser le « parent social » à intervenir pour les actes usuels. Mme la Rapporteure : Cela supposerait de connaître son futur conjoint lors du divorce. Mme Dominique Piwnica : Je parle du dispositif prévu par la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, et non pas de celle relative au divorce. Une convention homologuée par le juge peut toujours être révisée si, après la séparation des parents, il est nécessaire de faire intervenir le beau-parent. D'ailleurs, beaucoup de conventions concernent des couples qui n'ont jamais été mariés, et sont donc homologuées indépendamment de toute procédure de divorce. Mme la Rapporteure : Quelle serait la différence par rapport au droit actuel ? La délégation d'autorité parentale est déjà possible. Mme Béatrice Weiss-Gout : Mais elle est lourde. Mme Dominique Piwnica : Il s'agit de permettre aux beaux-parents d'intervenir pour les actes usuels comme aller chercher les enfants à l'école ou autoriser une intervention chirurgicale. Ce serait une procédure moins lourde que la délégation d'autorité parentale. Mme la Rapporteure : Une délégation soft, homologuée ou non par le juge ? Mme Dominique Piwnica : Effectivement, car les parents peuvent également passer une convention sous seing privé. Il s'agit d'offrir une sécurité aux deux parents. Mme la Rapporteure : Quel serait le régime de responsabilité ? Mme Dominique Piwnica : La responsabilité resterait imputable aux parents. Tant que la Cour de cassation n'aura pas réglé le problème de l'article 1384, alinéa 4, il sera impossible d'aller au-delà. Mme Béatrice Weiss-Gout : Le système de la délégation de l'autorité parentale peut aboutir à une autorité conjointe à quatre, alors qu'elle est déjà compliquée à deux. Les conventions sont beaucoup plus souples, et, même non homologuées, elles sont opposables s'agissant de l'organisation de la vie des enfants. Mme Dominique Piwnica : L'adoption simple serait la solution adaptée pour les successions. Elle ne me paraît en revanche pas envisageable pour faciliter la vie quotidienne et les actes usuels. Mme la Rapporteure : Que penseriez-vous d'un pacte successoral sans adoption ? Mme Dominique Piwnica : Nous sommes favorables à tout ce qui facilitera la vie quotidienne des enfants et des couples remariés. De fait, pour les parents biologiques, l'adoption simple est symboliquement lourde de sens. Mme Marie-Élisabeth Breton : L'expression « parent social » qui, au départ, ne nous convenait pas, nous a finalement séduites car elle correspond bien au vécu quotidien des enfants. Mme Béatrice Weiss-Gout : Nous sommes très favorables à la proposition de loi sur les mariages forcés qui a été votée au Sénat. Interdire le mariage de jeunes filles avant dix-huit ans ne sera pas la panacée, mais mettra un outil supplémentaire à leur disposition pour les aider à résister. Des mesures d'accompagnement resteront toutefois indispensables car les jeunes filles poussées à refuser un mariage forcé se retrouvent à la rue. Il conviendrait également de faire purement et simplement disparaître l'article 1114 du code civil, en vertu duquel la crainte révérencielle envers l'un de ses parents ne saurait constituer un vice du consentement. Mme Andréanne Sacaze : Je souhaite soulever une autre problématique : lors de l'inscription des enfants, les établissements scolaires demandent toujours l'identité du chef de famille. Mme la Rapporteure : Pourtant, depuis peu, les deux parents votent pour les conseils de parents d'élèves. Mme Dominique Piwnica : Beaucoup d'établissements scolaires, oubliant que l'autorité parentale est exercée en commun, ne se préoccupent pas de solliciter l'accord des deux parents. Mme Andréanne Sacaze : « Ce n'est pas notre problème », nous répondent-ils. Mme la Rapporteure : Avez-vous des remarques à formuler concernant les divorces impliquant des parents étrangers ? Mme Andréanne Sacaze : Nous n'avons pas suffisamment approfondi le sujet. Mme Béatrice Weiss-Gout : Nous nous sommes contentées de répondre à vos questions ! Pour des avocats, nous avons fait preuve de beaucoup de discipline ! M. le Président : Je vous en sais gré ! Mme Patricia Adam : J'approuve vos propositions sur la médiation, mais elles reviennent pratiquement à transférer aux avocats une compétence du juge. Peut-être constatez-vous, tout comme moi, que les avocats sont mieux formés à cet effet ? Mme Andréanne Sacaze : L'obligation de réserve m'empêche de m'exprimer sur ce point ! Mme Béatrice Weiss-Gout : Dans le domaine contractuel, le juge est démuni, c'est un fait. M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé à quatre voix, particulièrement vivant et dynamique, inspiré par votre pratique. Table ronde ouverte à la presse sur les formes d'organisation du couple réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous débutons aujourd'hui une série de tables rondes thématiques consacrées au droit de la famille, en examinant les formes d'organisation du couple. Nous avons le plaisir d'accueillir cinq intervenants : - M. Alain Bénabent, professeur de droit à l'université de Paris X, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; - M. Charles Melman, psychiatre et psychanalyste, directeur de l'Association freudienne internationale après avoir été responsable de l'école de Lacan, auteur de nombreux ouvrages et notamment de L'Homme sans Gravité ; - M. Xavier Lacroix, professeur d'éthique familiale dans les facultés de philosophie et de théologie de l'universisté catholique, qui vient de publier La Confusion des Genres ; - M. Eric Fassin, sociologue, professeur à l'école normale supérieure, qui vient de publier L'inversion de la question homosexuelle ; - M. Daniel Borrillo, maître de conférence en droit à l'université de Paris X, responsable du séminaire du DEA Droits de l'homme et libertés publiques sur le thème « droit et sexualités ». Messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vais vous inviter à répondre, par un exposé d'une dizaine de minutes, à une question simple : les trois formes d'organisation du couple - mariage, PACS et concubinage - créent-elles une gradation de droits et de devoirs satisfaisante ? Vous êtes évidemment libres d'aller au-delà. M. Alain Bénabent : En englobant les trois formes d'organisation du couple, mariage, PACS et concubinage, votre question prend pour parti que le PACS, présenté lors de son adoption comme un contrat purement patrimonial, est bel et bien une forme d'organisation du couple. Ce parti n'est du reste qu'un constat : quelles qu'aient été les affirmations faites à l'époque, il était clair, dès la décision du Conseil constitutionnel, que la « matrimonialisation » du PACS l'avait emporté. La Cour de cassation l'a consacré dans un arrêt peu remarqué, où elle a clairement énoncé que les partenaires de PACS sont liés par un lien de famille - il s'agissait de savoir si les dispositions d'un article du code électoral subordonnant des délais d'inscription à la qualité de membre de la famille étaient applicables en la circonstance -. En cassant une décision qui refusait d'appliquer ce texte au bénéfice d'un partenaire, la Cour a bel et bien considéré qu'un lien de famille était finalement attaché au PACS. Votre question est donc parfaitement pertinente : nous nous trouvons effectivement en présence de trois cadres juridiques. La gradation de droits et de devoirs ainsi créée est-elle ou non satisfaisante ? Encore faut-il la mesurer. Or la mesure est un peu différente selon qu'on envisage les rapports entre les membres du couple ou leurs rapports avec les tiers. Si l'on se place sous l'angle des rapports réciproques, il y a à l'évidence une gradation très nettement marquée. Entre les concubins, il n'y a rien. Les quelques conséquences juridiques attachées au concubinage sont exclusivement destinées à l'usage de tiers - les organismes sociaux notamment -. Mais il n'existe aucun droit ou devoir réciproque, ni pendant le concubinage, ni lors de la rupture. À l'extrême inverse, dans le mariage, on trouve tous les engagements réciproques. Le PACS se situe quant à lui à mi-chemin : il comporte certains engagements réciproques calqués sur ceux du mariage - devoir de solidarité, devoir de cohabitation -, mais ne comprend ni le devoir de fidélité - il n'y a donc pas de présomption de paternité dans le PACS -, ni de régime successoral. La gradation se trouve ainsi dans l'intensité, dans la « durabilité » de l'engagement, mais également dans la notion d'engagement elle-même. Le concubinage n'existe qu'autant que l'union dure ; mais il n'y a aucun engagement. Dans le PACS, il y a un engagement et des obligations, mais avec un caractère non pas éphémère - un PACS peut durer longtemps -, mais bien précaire au sens juridique du terme, autrement dit susceptible de s'interrompre à tout moment. Dans le mariage au contraire, l'engagement est durable - ce qui ne signifie pas définitif -, en ce sens que, pour en sortir, il faut passer par une procédure. Le maintien de la procédure judiciaire dans la loi du 26 mai 2004 a bien montré que l'on était attaché non à mettre des obstacles au divorce, mais à souligner le caractère solennel et nécessairement un peu formaliste de la sortie du mariage. Sur le plan des rapports personnels, la gradation entre les trois formes d'uniformisation du couple est donc très nettement marquée. Sur le plan des rapports entre le couple et les tiers, elle apparaît en revanche beaucoup plus disparate : cela dépend des tiers, mais aussi des matières, et les rapprochements ne sont pas les mêmes. À l'égard des enfants, l'égalité est à peu près totale, notamment depuis l'ordonnance de juillet dernier, à deux différences près : la présomption de paternité n'est attachée qu'au mariage, et, s'agissant de la procréation médicalement assistée, une durée de vie commune de deux ans est exigée des concubins et des pacsés, obligation qui n'existe pas dans le cas d'époux. Mais, pour ce qui est des enfants, les trois formes d'organisation du couple sont indifférentes et produisent des effets quasiment identiques. Il en est de même à l'égard de la sécurité sociale où les trois formes d'union emportent les mêmes conséquences. En revanche, la gradation se retrouve sur le plan fiscal. Le droit fiscal, au réalisme brutal - cela n'étonnera personne -, n'attache aucune conséquence au concubinage, mais attache une conséquence maximale au mariage et des conséquences intermédiaires au PACS. Sur ce point, le rapport du groupe de travail constitué par M. Dominique Perben, alors garde des Sceaux, propose de rapprocher le régime applicable aux pacsés de celui des époux. Pour ce qui concerne enfin les créanciers - les bailleurs notamment, mais également tous les fournisseurs -, le régime du PACS apparaît assez proche de celui du mariage ; le concubinage en revanche ne produit pas de conséquences, hormis pour le bail dans le cas où l'un des deux concubins décède. Ainsi, il existe bel et bien une gradation, un peu inégale selon les matières. Est-elle satisfaisante ? Cette question, subjective, dépend évidemment du point de vue selon lequel on se place. On remarquera d'abord que la véritable opposition se situe entre, d'un côté, le concubinage, union de fait seulement constatée, et, de l'autre, le mariage et le PACS, deux véritables formes d'organisation entre lesquelles la différence tient essentiellement à la durabilité, donc à l'intensité de l'engagement. Cela dit, force est de reconnaître que, entre le mariage et le PACS, la comparaison est faussée, en ce sens que, contrairement aux hétérosexuels, les homosexuels n'ont pas de choix possible. Sur ce point, les améliorations du régime juridique du PACS telles que proposées par le groupe de travail apparaissent tout à fait séduisantes et de nature à assurer un équilibre satisfaisant. M. Charles Melman : Essayant tout comme vous de m'orienter dans cette difficile question, je n'ai évidemment pas le point de vue du juriste, mais seulement celui de l'anthropologue. Rappelons d'abord que l'institution sur laquelle nous sommes en train de nous pencher, l'institution familiale, n'est pas une création du droit et n'a pas été décidée par un vote d'assemblée : elle semble caractéristique de notre espèce en ce sens que, bien avant que notre histoire n'ait commencé à s'écrire, et du fait d'une autorité dont nous ignorons tout, elle a réuni un homme et une femme afin qu'ils maintiennent ensemble une liaison stable dans le but de produire et d'élever des enfants. Là est l'aspect fondamental de cette institution, par ailleurs constitutive du groupe social, qui n'a jamais rassemblé des individus, mais des familles. Il conviendrait donc au préalable de mesurer - ce que j'essaie de faire - ce que signifie l'introduction du droit dans cette organisation. La famille humaine a cette caractéristique majeure - qui la distingue des familles animales - d'impliquer cet absurde qui consiste en une restriction de l'activité sexuelle de ses partenaires, les parents renonçant à l'usage sexuel de leurs enfants, et ceux-ci n'accédant eux-mêmes à l'activité sexuelle qu'à la condition de choisir dans leur classe d'âge. Cette organisation, bien que non écrite, a pu relever d'un droit particulièrement complexe. Les anthropologues ont ainsi souligné la sophistication des règles d'échange des femmes, non écrites, mais fort efficaces, actives et précises. Si l'on retient cette perspective, force est de constater que l'organisation horizontale de la famille, autrement dit le rassemblement synchronique de ses membres, est traversée par un axe vertical régi par le souci d'assurer la poursuite des générations. La famille est ainsi organisée comme si, loi étrange, l'activité sexuelle devait « se payer » de l'obligation d'une transmission des générations... Ce rappel peut éclairer les questions que nous sommes en train de nous poser, en montrant qu'il faut séparer ce qui touche au mariage de ce qui touche à l'organisation du couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel. Ce point m'amène à me distinguer de ce que M. Bénabent remarquait à l'instant concernant la position du droit : le mariage est un mariage à trois, car il implique inévitablement la présence de cet axe vertical, de cette dimension tierce. Dès lors, la cérémonie qui l'accompagne, qu'elle soit civile ou religieuse, marque bien la présence, voire la prévalence de cet axe, chacun des partenaires acceptant implicitement cette restriction à ses satisfactions pour assurer ce devoir de transmission des générations. La religion a donné figure paternelle à cette autorité prescriptrice qui relève du droit dit naturel. L'évolution des mœurs a conduit à mettre en cause cette figure et cette autorité, en les tenant pour responsables de ces abusives restrictions de satisfaction. C'est là, à mon sens, une erreur, malheureusement entretenue par Freud lorsqu'il a centré l'organisation psychique autour du complexe d'Œdipe et désigné la figure paternelle comme celle qui s'oppose à la réalisation de nos satisfactions. Je suis donc amené à distinguer le mariage, qui suppose que, en s'engageant à produire et à élever des enfants, les partenaires acceptent de restreindre leurs satisfactions, de l'organisation du couple, lequel fonctionne, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel, dans le cadre d'un contrat passé entre les deux partenaires et dont la durée sera liée à celle du bénéfice qu'ils trouveront à son accomplissement. Le mariage renvoie à un champ qui n'est primordialement ni juridique ni culturel, mais qui n'en est pas moins essentiel dans la mesure où il touche à une question dont je crains qu'elle ne devienne de plus en plus actuelle : la perpétuation de la vie. Notre législation serait donc adaptée si elle tenait compte de cette distinction dans laquelle il ne faut voir aucune signification péjorative, mais qui me paraît en tout cas économiquement valable : tout en protégeant l'intérêt de chacun des partenaires, elle doit reconnaître la spécificité du droit des époux qui prennent l'engagement de se marier et dont les intérêts, notamment patrimoniaux, ont besoin d'être préservés. M. Xavier Lacroix : L'intitulé de la question posée parle de formes d'organisation du couple et non de la famille. S'il s'agissait de famille, l'idée de « gradation » me paraîtrait contestable. En effet, ces trois réalités ne sont pas du même ordre : le mariage est une institution, le PACS un contrat sous seing privé, et le concubinage n'est pas à proprement parler une organisation. Ma thèse sera qu'il faut préserver la spécificité de l'institution. À cet égard, l'idée de gradation me paraît insuffisante, elle peut même être trompeuse. Entre PACS et concubinage d'une part, et mariage d'autre part, il y a un saut qualitatif. Et cela pour deux raisons : premièrement, on passe d'une conception du droit à une autre, d'un droit libéral, centré sur les individus, à un droit instituant, garant d'un modèle ; deuxièmement et surtout, avec le mariage, c'est non seulement un couple, mais une famille qui est fondée. Il n'est pas fait mention de l'enfant dans la loi définissant le PACS. Cela est heureux, pour au moins trois raisons : l'enfant ne peut pas être objet de droits, encore moins objet de relation contractuelle ; son intérêt est de pouvoir compter sur un lien stable et institué entre ses deux parents, autrement dit sur un engagement de fidélité, absent du PACS ; plus encore, son intérêt est de voir instituée une double filiation, paternelle et maternelle, autrement dit la présence de la différence sexuelle entre ses deux parents. On objecte parfois ici que le mariage n'est pas la seule façon de fonder une famille. L'établissement de la filiation, par la reconnaissance de paternité et maternité, en est une autre, et de plus en plus fréquemment. Reste que l'existence de cette alternative n'enlève rien au fait que le mariage soit, de fait et en droit, le commencement d'une famille. Le doyen Jean Carbonnier a pu affirmer que la présomption de paternité demeurait le cœur du mariage. Par ailleurs, force est d'affirmer que la filiation est un fondement incomplet de la famille : reconnaître un enfant, c'est bien s'engager envers lui, mais que vaut cet engagement en l'absence de tout engagement à la fidélité envers l'autre parent, c'est-à-dire si délibérément reste ouverte l'hypothèse que l'un des deux parents quitte le foyer familial ? Contrairement à ce qu'affirment certains, il existe une définition anthropologique du mariage, qui vaut universellement : il s'agit de l'institution qui articule l'alliance entre l'homme et la femme avec la succession des générations. Si d'aventure le terme de mariage était étendu à des unions entre personnes du même sexe, nous assisterions à la perte d'un signifiant majeur : nous ne disposerions plus dans notre vocabulaire de terme pour dire spécifiquement l'union socialement instituée d'un homme et d'une femme. Or il est difficile de nier que cette union, et toute la symbolique qui s'y rattache, soit un bien pour la société. Par ailleurs et surtout, est en jeu ici l'intérêt de l'enfant. Prétendre promouvoir l'idée d'un mariage homosexuel en excluant l'adoption est hypocrite : on crierait tôt ou tard à la discrimination. La filiation homosexuelle, que ce soit par le mariage, l'adoption ou l'accès aux procréations médicalement assistées, priverait l'enfant de trois biens élémentaires. Premièrement, elle priverait l'enfant de la différence entre deux repères identificatoires, masculin et féminin, dans l'univers de sa croissance intime. Qu'il soit garçon ou fille, l'enfant a besoin, pour la découverte de son identité, d'un jeu subtil d'identifications et différenciations avec ses deux instances paternelle et maternelle. Cela a été étudié avec minutie par une littérature scientifique surabondante. Mais, par un étrange phénomène d'amnésie, certains discours militants font froidement table rase de tout cet acquis. Le second bien élémentaire pour l'enfant est, lorsque cela est possible, la continuité entre le couple procréateur et le couple éducateur. La quête douloureuse de leur origine par les enfants nés sous X, les difficultés propres à l'adoption indiquent bien que les ruptures dans l'histoire familiale, les dissociations entre les différentes composantes de la parenté sont autant de complications dans la vie de l'enfant. Dès lors, il est souhaitable qu'à la discontinuité liée à l'adoption ne vienne pas s'ajouter une seconde discontinuité, à savoir la perte de l'analogie entre le couple d'origine et le couple éducateur. C'est a fortiori parce qu'il est adopté qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Le troisième bien élémentaire pour l'enfant sera une généalogie claire et cohérente, lisible. Nous sommes dans un système généalogique cognatique, c'est-à-dire à double lignée, ce qui ne manque pas de sens. Or on ne change pas un système de parenté millénaire par petites touches. Il forme un tout cohérent. Les bricolages de la filiation proposés par certains lui ôtent toute lisibilité. Dans tel lexique militant, on ne trouve pas moins de sept termes pour désigner les différentes personnes qui exerceraient une fonction parentale autour de l'enfant, la fonction généalogique étant totalement occultée... Prenons conscience de l'embrouillamini généalogique auquel les enfants concernés seraient légalement condamnés. Je le redis donc, il y a un écart, une différence éthique entre accompagner toutes les situations - pour lesquelles il est faux de dire qu'il n'existe pas de cadre juridique - et institutionnaliser a priori une confusion, une privation, une série de carences. Sous prétexte de lutter contre une prétendue discrimination entre les adultes, on en créerait une autre, bien plus réelle et bien plus grave, entre les enfants. Il serait en effet codifié par le droit que certains enfants pourraient a priori bénéficier de ce bien élémentaire qu'est la différence sexuée entre leurs parents, et d'autres non. L'adoption, je le souligne, n'a pas pour objet la seule éducation, mais également la filiation. Elle ne définit pas seulement par qui l'enfant sera élevé, qui aura sur lui l'autorité parentale, mais de qui il est fils ou fille. Nous n'avons pas le droit d'instituer le brouillage de la filiation. Il nous faut dénoncer la confusion délibérément introduite dans le vocabulaire lorsque l'on parle de « deux mamans » ou « deux papas » pour un enfant. Clarté et cohérence : voici deux qualités de l'institution que la loi doit viser, tout spécialement en matière de filiation. Le mariage est la seule institution qui lie, noue et unifie a priori les trois dimensions de la filiation ou de la parenté : biologique, juridique et sociale. Or certains discours militants visent délibérément à dissocier ces trois dimensions. Cela est rappelé avec insistance dans le livre de Martine Gross sur l'homoparentalité - un exemple parmi bien d'autres - : « La filiation biologique doit être distinguée de la filiation légale et de la filiation sociale ». Le but de ces dissociations est clairement de déconnecter ce que l'on appelle maintenant la parentalité Il faut savoir que derrière des revendications apparemment anodines, c'est en fait une véritable révolution dans la conception de la famille qui est explicitement recherchée. Plusieurs auteurs, telle Martine Gross, emploient ce mot : « La révolution envisagée est que la parenté, et la filiation légale qui s'y rattache, soit dévolue à ceux qui s'engagent à exercer des responsabilités parentales, tout en n'escamotant pas l'homme et la femme qui ont donné la vie ». Mais que signifie ce « tout en n'escamotant pas » ? Ne pas escamoter suffit-il ? En réalité, l'articulation entre le don de la vie et l'éducation est au cœur de la parenté. Il y va de la continuité de l'histoire des sujets. La cohérence entre les différentes dimensions de la filiation est a priori un bienfait pour l'enfant. Toute organisation de l'incohérence irait à l'encontre de son intérêt. N'oublions pas que la Convention internationale des droits de l'enfant, en son article 7, reconnaît à celui-ci « dans la mesure du possible le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ». II suffit de prendre conscience des devoirs pour les adultes qu'implique ce droit pour l'enfant. M. Éric Fassin : Si le pacte civil de solidarité marque une étape importante dans l'évolution du droit et de la société en France, c'est qu'il s'inscrit au croisement de deux logiques démocratiques. D'un côté, il participe d'une logique d'égalité : c'est la raison pour laquelle il est ouvert également aux couples de même sexe et de sexe différent. Cette logique d'égalité entre les sexualités vient ainsi prolonger l'évolution des lois et des normes portant sur l'égalité entre les sexes. D'un autre côté, le PACS relève d'une logique de liberté : non seulement le mariage s'assouplit, et devient moins contraignant, mais aussi, en même temps, la conjugalité se résume de moins en moins au seul mariage. C'est ainsi que notre société et notre droit renoncent progressivement à stigmatiser le divorce, mais aussi le concubinage, et même les naissances hors mariage. Entre le concubinage et le mariage, le PACS marque un degré intermédiaire dans les droits et les devoirs conjugaux. Si ce progrès de liberté bénéficie seulement aux couples de sexe différent, l'avancée de l'égalité concerne au premier chef les couples de même sexe : tandis que ces derniers ont conquis une option plus formelle que la cohabitation qu'ils pratiquaient déjà, les premiers y gagnent une option plus informelle que le mariage qui leur était déjà ouvert. Toutefois, la loi valide ainsi une double évolution de la société : d'un côté, une certaine reconnaissance de la diversité des sexualités ; de l'autre, une manière de privatisation quant aux modes d'organisation de la conjugalité. Le législateur ne propose donc pas un simple reflet de la transformation des normes. Il ne se contente pas d'enregistrer cette évolution, puisqu'il la légitime. Ainsi, le droit est tout autant producteur de normes : il appelle à plus d'égalité, et aussi à plus de liberté, dans l'ordre sexuel dont le couple et la famille sont des figures centrales. Dans quel sens convient-il de poursuivre cette évolution ? Notons que nul ou presque ne propose plus d'abolir le pacte civil de solidarité : c'est bien que nul ou presque ne prétend récuser cette double logique démocratique. La question est donc bien : comment améliorer les formes d'organisation de la conjugalité pour aller dans le sens d'une plus grande démocratie sexuelle ? En réponse aux demandes d'égalité entre les sexualités, sans doute certains proposent-ils de renforcer les droits et les devoirs du PACS, pour le rapprocher du mariage. Mais formaliser davantage le PACS, n'est-ce pas démentir la logique de liberté qu'ouvre la pluralité des modes d'organisation conjugale ? En outre, fût-ce au nom de l'égalité, n'est-ce pas contredire le principe d'égalité, puisqu'en alignant le PACS sur le mariage, on reviendrait subrepticement au projet de créer un mariage bis en ne laissant au mariage lui-même qu'une caractéristique en propre : l'exclusion des couples de même sexe ? Si notre société poursuit la double évolution démocratique du PACS, il lui faudra, non pas réduire, mais préserver, voire développer la pluralité des formes d'organisation conjugale : c'est une question de liberté. On ne saurait pourtant s'arrêter là : il conviendra aussi d'ouvrir le mariage, à l'exemple du PACS et du concubinage, indifféremment aux couples de même sexe et de sexe différent : c'est une question d'égalité. Il y a quelques années encore, une telle idée paraissait impensable à beaucoup : il en allait, nous disait-on alors, de « l'ordre symbolique », et des « fondements anthropologiques de la culture ». Aujourd'hui, l'évolution de nos voisins, de plus en plus nombreux - néerlandais, belges, espagnols, mais aussi canadiens, sans oublier le Massachusetts et désormais la Californie -, nous montre clairement que l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, ce n'est pas la fin du monde, mais seulement la fin d'un monde. L'ordre sexuel n'a rien d'intemporel : il est traversé par l'histoire. L'impensable d'hier, en devenant pensable, s'est révélé comme l'impensé de notre société. C'est donc ce qu'il nous faut penser aujourd'hui. Voilà l'éclairage que je souhaiterais apporter, en tant que sociologue. En effet, les sciences sociales - et la remarque vaut bien sûr pour l'ensemble des savoirs - ne peuvent pas, ne doivent pas vous dire ce qu'il faut faire. Répétons-le une fois encore : si le politique ne doit pas être sourd à la science, et si la science ne peut pas être muette face au politique, l'expertise ne saurait substituer aux valeurs politiques les vérités de la science. Aucun savoir n'a le pouvoir de trancher les délibérations démocratiques. Ce ne sont pas les savants qui disent la loi, mais les représentants du peuple. En revanche, les sciences sociales peuvent nous aider à appréhender le sens de ce qui se joue autour de ce qu'on appelle familièrement le « mariage gay », et qui, à mon sens, excède largement la question des unions de même sexe, puisqu'il en va de la démocratie sexuelle. Qu'est-ce qu'une société démocratique ? C'est une société qui définit elle-même ses lois et ses normes. Autrement dit, nul principe transcendant ne s'impose a priori, en surplomb de la délibération démocratique - ni Dieu ni la tradition ; ni la science ni la Nature. Aucune « Loi » à majuscule ne détermine nos « lois » en minuscules. De même, les normes sont immanentes, et non pas transcendantes. Dans une société démocratique, nous nous accordons à penser que les lois et les normes sont humaines : elles sont sujettes au changement, et ouvertes à la négociation, bref, elles sont historiques. Ce qui est vrai de la fiscalité, de la sécurité sociale, de l'école ou de l'immigration, ne l'est pas moins de l'ordre sexuel, du couple et de la famille, de l'alliance et de la filiation, et même de la reproduction : nous pouvons changer les règles du jeu On comprend dès lors l'enjeu du débat passionné qui s'est ouvert, depuis quelques années, à la faveur du PACS. En prolongeant les logiques de liberté et d'égalité, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, offrant à tous, également, le libre choix entre les trois options que sont le concubinage, le PACS et le mariage, marquera l'extension du domaine démocratique : même l'ordre sexuel sera pensé comme social, et non comme naturel. Ce n'est donc pas un hasard si l'enjeu porte sur des sexualités naguère encore réputées contre nature : l'hostilité au « mariage gay » signifie un refus de la dénaturalisation de l'ordre sexuel. Face à la démocratisation des mœurs, la réaction s'exprime tantôt au nom de la science, tantôt au nom de la religion - l'une empruntant parfois le langage de l'autre -. Mais au fond, c'est toujours en vertu de la Nature, c'est-à-dire d'un principe qui échapperait à l'histoire. À l'inverse, revendiquer la logique démocratique, ce n'est pas adopter une vision dénaturée de la société, mais plutôt dénaturalisée. La société n'est pas fondée sur un ordre naturel : elle n'est pas contre nature, mais simplement historique. La question qui se pose aujourd'hui est donc : sur quelles valeurs voulons-nous fonder les lois et les normes qui régissent la vie en société - non seulement l'organisation économique, ou la définition de la nationalité, mais aussi l'ordre sexuel ? Les normes apparaissent de moins en moins comme des évidences naturelles, et de plus en plus comme des constructions sociales. Et parce que nous comprenons qu'elles résultent d'une histoire, nous prenons conscience qu'elles sont susceptibles de changements. Elles ne disparaissent pas pour autant. La conscience des normes ne suffit pas à nous en affranchir ; elles continuent de nous traverser et de nous définir. La dénaturalisation n'implique donc non pas la fin des normes, mais un rapport aux normes différent, plus critique, mais aussi plus libre. Privée de transcendance, la société n'est pas condamnée à l'anomie, ou à l'atomisation. La société ne s'effondre pas, elle ne se dissout pas en une poussière d'individus amoraux ; elle se démocratise. Le PACS s'inscrit bien dans cette logique de démocratisation, et donc de dénaturalisation des normes. En revanche, c'est le mariage qui demeure aujourd'hui par contraste l'ultime refuge d'une logique pré-démocratique, voire antidémocratique, en réaction contre l'évolution actuelle. En effet, tout se passe comme si la loi faisait du mariage, en dépit de la contradiction manifeste dans les termes, une « institution naturelle ». Pourquoi, sinon, fermer la porte à l'homosexualité ? Ne s'agit-il pas de calquer le mariage sur la reproduction biologique, pour lui donner un fondement supposé naturel ? On comprend dès lors pourquoi le PACS n'ouvre aucun droit en matière de filiation (l'adoption à deux requiert le mariage, et l'assistance médicale à la procréation est réservée aux couples de sexe différent). Ouvrir le mariage aux couples de même sexe, ce sera reconnaître que la filiation est sociale et non naturelle. Enfin, on comprend mieux pourquoi les droits conjugaux en matière de nationalité privilégient le mariage, aux dépens du PACS : l'enjeu n'est-il pas, comme l'attestent les débats sur le droit du sang et le droit du sol, de savoir si la nation est fondée en nature ou pas ? Ainsi, le refus de dénaturaliser le mariage, c'est aussi la volonté de fonder en nature la filiation et la nationalité. Ainsi, c'est tout un système, articulant à la conjugalité la filiation et la nationalité, qui définit aujourd'hui l'opposition entre PACS et mariage : tant que le second, à la différence du premier, sera fermé aux couples de même sexe, nous pourrons entretenir l'illusion qu'ils s'opposent comme l'artifice à la nature. Mais l'illusion paradoxale d'une « institution naturelle », c'est aussi la réalité sans ambiguïté d'une institution non démocratique. Telle est donc l'alternative à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui : poursuivre dans la voie du PACS, c'est-à-dire, non seulement préserver la pluralité des formes de conjugalité, mais aussi ouvrir le mariage aux couples de même sexe ; ou bien, contre la démocratisation des mœurs, refonder en nature le mariage, pour mieux rejeter le PACS dans l'artifice. Ce choix de société ne concerne pas seulement le mariage : on l'a vu, qu'il s'agisse de filiation ou de nationalité, nous sommes bien confrontés à la même alternative. Or, pour sa part, la société a déjà choisi : les normes se démocratisent. Reste à savoir si le législateur choisira d'accompagner cette démocratisation, ou s'inscrira en réaction. M. Daniel Borrillo : Dans ses décisions récentes, le juge français est en train de construire un système matrimonial plus proche, sur certains points, du sacrement religieux que de la loi civile. Face à cette entreprise prétorienne, l'intervention du législateur est doublement nécessaire. D'une part, pour répondre aux exigences de l'égalité et à l'évolution des mœurs, comme le souligne le Tribunal de grande instance de Bordeaux. D'autre part, pour éviter une dérive herméneutique qui subordonne le mariage à la capacité reproductive du couple. À la différence des juridictions des États-Unis et du Canada, les tribunaux français sont unanimes à se prononcer contre l'ouverture du droit au mariage pour les couples de même sexe. Comme par le passé par rapport au concubinage, les juges justifient, s'agissant du mariage, la différence de traitement entre les couples de sexe opposé et les couples de même sexe. Cette justification « objective et raisonnable » se trouverait, selon les juges, « dans la fonction traditionnelle du mariage, communément considéré comme constituant la fondation d'une famille ». Pour le Tribunal de grande instance de Bordeaux, « en droit interne, mariage et famille sont indissociablement liés ». Pourtant, on enseigne à nos étudiants dans les premières années de droit que la famille peut être légitime - fondée sur le mariage -, naturelle - fondée en dehors du mariage -, ou adoptive - fondée exclusivement entre deux individus -. Par ailleurs, à la différence du droit canonique, le code civil ne fait pas de la filiation la finalité du mariage. Outre qu'elle est traitée dans un chapitre à part, renvoyant donc à des régimes juridiques distincts, la reproduction ne fut jamais une condition du mariage. Les couples stériles et les femmes ayant atteint la ménopause sont pleinement aptes à contracter mariage. De plus, la loi du 28 décembre 1967 concernant la dépénalisation de la contraception - à laquelle ont également accès les personnes mariées - confirme qu'il n'existe aucune obligation de se reproduire ni même d'avoir un projet parental. Plus encore, la reconnaissance fort ancienne du mariage posthume de l'article 171 du code civil est la preuve rédhibitoire d'une telle dissociation. Il est vrai que la présomption de paternité - article 312 du code civil - est souvent invoquée pour démontrer l'interdépendance entre mariage et filiation. Cependant, comme le soulignent Mme Huet et M. Hauser dans leur manuel de droit de la famille, celle-ci est devenue une règle de forme et non plus un principe de fond. Confirmant l'interprétation du Tribunal de grande instance, la Cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 19 avril 2005, développe l'argument de la tradition afin de justifier la nécessaire « qualité » hétérosexuelle du mariage : « La spécificité, et non discrimination, provient de ce que la nature n'a rendu potentiellement féconds que les couples de sexe différent ». Compte tenu de cette réalité biologique, on déterminera une différence de traitement : « Les couples de même sexe, et que la nature n'a pas créés potentiellement féconds, ne sont en conséquence pas concernés par cette institution. En cela leur traitement juridique est différent, parce que leur situation n'est pas analogue ». En réalité, l'essentiel n'est pas que les couples de même sexe ne puissent pas se reproduire - après tout, les techniques d'assistance médicale à la procréation (AMP) peuvent venir en aide à la stérilité « phénoménologique » des couples homosexuels -, mais plutôt qu'ils ne doivent pas le faire. En effet, les lois de 1994, dites bioéthiques, permettent l'accès à l'AMP uniquement aux couples hétérosexuels. Le mariage est d'abord et surtout un engagement réciproque entre deux personnes qui, en raison de leurs volontés, à certains effets et sous certaines conditions, entendent devenir une unité vis-à-vis des tiers et de l'État. La filiation peut bien évidemment être une conséquence, mais en aucun cas le mariage ne se voit subordonné à une exigence quelconque de procréation. C'est dans la fiction juridique et sociale faisant de deux individus une seule personne que le mariage trouve son caractère transcendantal et non dans un quelconque prolongement biologique. Après avoir affirmé que le mariage « découle directement de l'histoire, des religions, des coutumes » et qu' « il est socialement très largement accepté », la Cour d'appel de Bordeaux fonde son argumentation sur le Discours préliminaire de Portalis, écrit en 1800-1801, selon lequel le mariage est un « acte naturel » au sein duquel « la femme devient mère », comme par vocation naturelle ! En l'absence de texte de droit positif, les juges recourent à une source historique contestable. À cette époque, l'esclavage était légal et le principe de l'incapacité de la femme mariée allait de soi... Un autre argument utilisé par les juges pour justifier la négation du droit au mariage pour les couples de même sexe est celui de l'existence du PACS en tant que contrat qui viendrait régler les problèmes auxquels sont confrontées les unions homosexuelles. Il existe en France trois formes de conjugalités : le mariage, le PACS et le concubinage. Toutefois, les droits ne sont pas les mêmes. Ainsi, le PACS, à la différence du mariage, ne permet pas d'établir un lien de filiation biologique ou adoptive. Les partenaires ne sont pas héritiers l'un de l'autre et ne peuvent donc pas succéder ab intestat. Leur état-civil ne change pas, non plus que leur nationalité. Ils n'ont pas droit à la prestation compensatoire, ni à la pension de veuvage, ni à la faculté de représentation du conjoint. L'usage du nom du partenaire est impossible au sein du couple pacsé. Le partenaire pacsé n'est pas exempt de témoigner contre son compagnon dans un procès pénal. Les abattements fiscaux, les délais pour accéder à certains droits ne sont pas non plus les mêmes selon que le couple est pacsé ou marié. Le Gouvernement lui-même a reconnu les insuffisances du PACS au point de mettre en place une commission pour étudier sa réforme. Si ces trois catégories doivent être maintenues pour donner le plus grand choix aux individus, la condition de différence de sexe pour l'une d'entre elles rend la situation française discriminatoire à l'égard des couples de même sexe. Ainsi, il semble plus judicieux d'ouvrir le droit au mariage que de donner aux couples pacsés les mêmes droits qu'aux couples mariés. L'intérêt du PACS se trouve aussi dans sa plus grande souplesse. Lorsque l'on propose de nouveaux droits, s'ajoutent aussi des nouvelles obligations qui vont nécessairement rendre le PACS plus contraignant. Les arguments contre l'ouverture du droit au mariage pour les couples de même sexe ne résistent à la moindre analyse rationnelle. Seule la tradition judéo-islamo-chrétienne permet de maintenir le statu quo. Mais la République doit-elle suivre cette tradition ? Face à la conception conservatrice du mariage, fruit d'une interprétation prétorienne, il semble urgent que le législateur puisse aborder la question en tenant compte d'une autre tradition plus proche de nos valeurs communes : celle qui découle des principes de liberté, d'égalité et surtout de laïcité. Depuis la Révolution, le mariage cesse d'être conçu comme un sacrement au profit d'une vision contractualiste de l'union. Ce qui est pertinent, c'est la volonté des cocontractants : « II n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Ainsi, la sécularisation des noces achevée, la consommation- fusion de deux chairs - propre au sacrement religieux sera remplacée par le consentement, union de deux volontés. L'accord de volonté et non point la copula carnalis constituant désormais la substance du mariage, la condition sine qua non de son existence ne peut plus continuer à tenir à la différence de sexes des co-contractants. En autres termes, ce qui compte pour le droit laïque n'est pas tant la dimension physique de l'institution que sa dimension psychologique. À la chair sexuée de la règle canonique, le droit moderne oppose une volonté abstraite, libre et consciente. Si l'ouverture du droit au mariage pour les couples de même sexe suscite encore des réactions négatives, c'est parce que ses adversaires font référence non pas au mariage dans sa dimension civile, mais aux aspects qui relèvent de son passé canonique. On peut lire l'actualité politico-juridique du « mariage gay », comme l'approfondissement du droit moderne fondé sur la libre élection de l'état civil - célibataire ou marié - et sur la volonté abstraite des conjoints. Pour le droit moderne, la volonté n'a pas de religion, de race, de couleur politique ni philosophique ; pourquoi devrait-elle avoir un sexe ? Le droit au mariage pour les couples de même sexe signifie le triomphe d'une vision individualisée, contractuelle et désacralisée de la vie familiale, conçue désormais au service de l'individu et non point celui-ci au service de celle-là. La famille trouve aujourd'hui sa légitimité dans la volonté et la négociation des parties et non plus dans une imposition statutaire. Comme le notait le doyen Carbonnier : « La famille est moins une institution qui vaudrait par elle-même qu'un instrument offert à chacun pour l'épanouissement de sa personnalité (...) C'est une forme de droit au bonheur implicitement garanti par l'État ». Ou encore, comme le souligne Alain Bénabent, « l'évolution individualiste suivie par notre droit des personnes depuis la fin du siècle dernier a entraîné un déplacement de l'angle de vision sous lequel est examiné le mariage. On tend à le considérer moins du point de vue de l'institution familiale dont il est le pivot que du point de vue de la personne des époux ». Cet approfondissement de la vision moderne des liens familiaux se produit aussi bien au niveau du couple qu'à celui de la filiation. La dimension contractuelle se voit ainsi valorisée au détriment de l'ancienne conception sacramentale. Le choix individuel est l'élément principal du contrat, le droit devant seulement garantir cette liberté. En ce sens, le mariage apparaît comme le contrat intuitu personae par excellence. De plus, tout individu devrait avoir le droit de choisir son état civil. Imposer le célibat à une partie de la population semble contraire aux exigences de l'État démocratique. Depuis la réforme de 1972, le code civil ne fait plus référence au mari et la femme mais aux conjoints, terminologie plus adaptée à l'exigence d'égalité entre les partenaires, dont les droits et obligations ne se trouvent plus déterminés par le sexe des co-contractants. Cette conception égalitaire, bien que conçue en faveur des femmes, aurait dû s'appliquer aussi aux homosexuels. Ouvrir aux couples homosexuels la possibilité d'adopter des enfants, d'accéder aux techniques d'assistance médicale à la procréation et même de jouir de la présomption de paternité comme c'est déjà le cas dans la loi canadienne, suppose d'assumer pleinement la différence capitale entre reproduction et filiation. Il est évident que pour qu'il y ait engendrement, la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule est indispensable ; mais il faut davantage pour qu'il y ait filiation. Il se peut que le biologique et le culturel coïncident, mais il se peut aussi qu'ils ne se superposent pas. L'adoption, par exemple, est une forme de filiation légitime sans aucun lien avec une quelconque réalité biologique. Si, contre le droit romain et tout au long du Moyen Âge, l'Église interdisait l'adoption, c'est précisément parce que pour elle le biologique devait primer dans la constitution du lien filial. Ainsi, ce n'est pas tant la capacité reproductive qui fonde la filiation juridique mais plutôt la volonté individuelle ou partagée dans le cadre d'un projet parental. Enfin, le mariage entre personnes de même sexe s'inscrit dans un mouvement qui a commencé avec la fin du monopole catholique en matière matrimoniale. La désacralisation du sacrement en 1789, l'affirmation de la nature civile et laïque de l'institution en 1804, l'adoption par une personne célibataire en 1966, la contraception en 1967, l'abandon de la notion de chef de famille en 1970, l'égalité des conjoints et l'égalité des filiations en 1972, le divorce par consentement mutuel en 1975, l'accès pour les concubins à l'assistance médicale à la procréation en 1994, la transmission du nom patronymique de la mère en 2002 sont autant d'étapes d'une évolution auxquelles se sont également opposés les défenseurs de la vision - résiduelle - de la famille de type canonico-sacrementale. Le refus du droit au mariage pour les couples de même sexe n'est souvent que l'hostilité envers la modernité politique, juridique et sociale. Le refus de l'homoparentalité est proportionnel à la peur de fonder la règle de droit sur des valeurs immanentes et non pas sur une métaphysique naturaliste. Mme Nadine Morano : Pour faire évoluer leur législation, les Canadiens se sont fondés sur leur Charte des droits et libertés qui garantit une parfaite égalité de tous devant le droit, qu'il s'agisse de l'union civile, du mariage et même de la procréation médicalement assistée (PMA). Au cours de notre déplacement au Québec, nous avons cependant été surpris devant les filiations qui peuvent découler de cette législation, un enfant pouvant avoir deux mères. Ce qui m'intéresse, c'est l'égalité de tous les enfants. Certains d'entre vous ont brossé un tableau de la famille traditionnelle source d'équilibre. Encore faut-il que le père et la mère s'entendent. Il ne faut en effet pas oublier le nombre des suicides d'enfants ou d'adolescents dans les familles traditionnelles, hétérosexuelles, mais en situation conflictuelle. On trouve sur notre territoire des enfants conçus au sein d'un couple homosexuel par PMA dans des pays voisins. Je rappellerai le cas de ce couple de femmes homosexuelles qui ont trois enfants nés d'une PMA dont l'aîné a quinze ans, et qui ont obtenu l'« autorité parentale partagée » par un jugement qui a fait grand bruit, jusque dans l'hémicycle où le garde des Sceaux a été interpellé. Les enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui ont les mêmes droits que les autres. Il faut trouver une solution pour ces enfants nés hors du droit afin que leur vie quotidienne soit assurée, comme celle des autres enfants. Comme l'a remarqué M. Lacroix, le PACS ne fait pas état des enfants. N'y a-t-il pas là matière à réfléchir pour prendre les enfants nés de parents pacsés en considération ? Après tout, les enfants des familles monoparentales non plus ne connaissent pas leur père. Or notre préoccupation première est de travailler à l'égalité des droits. M. Fassin a rappelé ce qu'était une société démocratique. Quelle évolution la société française, compte tenu de ses traditions, peut-elle se permettre ? La population en cause ne représente qu'une très faible minorité, et ce n'est pas une amélioration du PACS ou la création d'une union civile qui multipliera le nombre d'homosexuels... Se pose en revanche la question de leurs droits, notamment en matière patrimoniale ou de garde des enfants. N'oublions pas non plus le cas des familles recomposées, dans lesquelles règne souvent une très bonne entente. En cas de décès des parents biologiques, pourquoi ne pourrait-on pas transmettre l'autorité parentale aux beaux-parents ? M. Jean-Marc Nesme : J'aimerais que M. Fassin nous précise un peu mieux ce qu'il entend par « démocratie sexuelle »... J'aurais ainsi appris quelque chose ce matin ! Si l'on suivait son raisonnement jusqu'au bout, on pourrait se demander pourquoi le législateur ne légaliserait pas l'inceste au motif que l'on en compte beaucoup en France... Vos théories, entendues mille fois, reposent sur l'égalité des droits, laquelle découle de la vieille théorie marxiste des rapports dominants-dominés : naguère, c'étaient les hommes qui dominaient les femmes ; depuis quelque temps, ce sont les hétérosexuels qui dominent les homosexuels... Partant de cette égalité des droits, on peut s'interroger, notamment pour ce qui touche aux enfants : au motif de lutter contre une éventuelle discrimination entre hétérosexuels et homosexuels, ne risque-t-on pas d'en créer une nouvelle chez les enfants, entre ceux qui ont un père et une mère et qui connaissent leur filiation, et ceux qui sont issus en dehors de la relation d'un homme et d'une femme, par le biais notamment d'une mère porteuse ? Je suis très étonné que l'on ne porte pas plus de respect à notre droit, mais également au droit international. Vous avez beau soutenir que tout cela résulte d'une construction culturelle, religieuse, dogmatique, etc., il n'en reste pas moins que tous les pays du monde, sans exception, ont ratifié des traités et conventions qui reconnaissent que l'humanité repose sur le mariage, la famille, la filiation et la transmission des générations. Que faites-vous du respect du droit international dans vos propositions ? M. Patrick Delnatte : J'ai le sentiment que l'enfant est pratiquement absent de l'analyse de M. Fassin et de M. Borrillo. Je m'interroge également sur le terme de « démocratie sexuelle ». S'il faut entendre par là égalité entre l'homme et la femme, la chose est parfaitement admise, même si elle reste un combat quotidien ; mais s'il s'agit de poser le principe de l'égalité de toutes les orientations sexuelles, il faudra m'expliquer où sont les limites dans ce domaine. Enfin, M. Fassin nie l'idée de droit et d'ordre naturels, alors que M. Melman parle d'anthropologie. L'anthropologie n'est-elle pas une donnée indispensable ? N'y a-t-il pas une différence entre l'ordre animal et l'ordre humain ? M. Pierre-Louis Fagniez : Je tiens à remercier notre président et notre rapporteure du choix de nos invités : j'ai été comblé par ces cinq exposés. Cela dit, je m'adresserai plus particulièrement à l'anthropologue, M. Melman, et au sociologue, M. Fassin. À les entendre, tout les sépare : le premier soutient que l'institution du mariage est spécifique à notre espèce, cependant que le second en appelle à une intéressante double logique démocratique. Je note enfin que tous deux reconnaissent le dernier mot aux représentants du peuple. J'ai peut-être trouvé un point sur lequel vous pourriez vous réunir : M. Melman a décrit le papa, la maman et les petits enfants autour, et M. Fassin a parlé du mariage et du PACS, mais ni l'un ni l'autre n'ont parlé des concubins. Or non seulement celui-ci a toujours existé, mais c'est devenu la forme d'organisation du couple la plus banale, celle que pratiquement tout le monde emprunte pendant un temps, et quelques-uns toute leur vie : nous connaissons autour de nous des familles tout à fait constituées, où le papa et la maman sont ensemble, font quelquefois le même métier, élèvent des enfants et restent ainsi jusqu'au terme de leur existence. Qu'est-ce qui les distingue alors d'un couple tout à fait banal ? Ils sont exactement comme les autres. Les droits de l'enfant peuvent être parfaitement respectés dans le concubinage, même si cela pose question aux juristes. Mme la Rapporteure : Ma première question rejoint celle de M. Fagniez, mais je la précise. Hormis la question du mariage des couples de même sexe, cette table ronde m'a paru finalement assez conservatrice : vous n'avez en rien critiqué l'institution du mariage et ses points fondamentaux - solidarité, fidélité, droit de secours, fiscalité, etc. -, ni proposé de la changer ou de l'améliorer, et vous n'avez pas davantage critiqué le concubinage, lequel repose sur la liberté totale et l'absence de droits afférents. L'union libre offre-t-elle à votre avis une protection suffisante au concubin le plus faible - notamment à la femme qui parfois abandonne son emploi pour élever des enfants -, et aux enfants des concubins ? Pensez-vous que certaines dispositions applicables aux époux pourraient s'appliquer aux concubins ? Faudrait-il par exemple donner aux juges, sous certaines conditions - durée de vie commune, fortes différences de revenu -, la possibilité d'ordonner le versement de prestations compensatoires en cas de séparation ? Au-delà des positions de principe, force est de reconnaître que naissent hors mariage 56 % des premiers-nés, 40 % des deuxièmes enfants et 25 % des troisièmes... Autrement dit, le concubinage est devenu une forme durable d'organisation de la vie familiale qui dure parfois toute la vie. L'idée selon laquelle le concubinage n'emporte aucune obligation peut-elle survivre à l'évolution de la société ? Sur le mariage, j'ai cru vous sentir assez unanimes pour le considérer comme une institution et donc comme l'endroit qui préserve le mieux la stabilité familiale et les intérêts de l'enfant. En dehors de l'ouverture aux personnes de même sexe, voyez-vous des moyens d'améliorer cette stabilité ? La réforme du divorce a constitué une grande avancée. D'autres améliorations pourraient-elles rendre plus attractive cette institution qui, de votre propre avis, garantit le meilleur épanouissement et le meilleur engagement sur le long terme ? Enfin, j'avoue ne pas avoir compris la réflexion de M. Borrillo sur l'absence d'obligation de procréation dans le mariage. Le refus d'un des deux partenaires d'avoir un enfant n'est-il pas un motif de divorce pour faute, autrement dit une rupture grave des engagements ? M. Pierre-Christophe Baguet : Dans certaines familles recomposées, le conjoint se retrouve parfois à assumer de véritables responsabilités juridiques, éducatives, économiques. Que pensez-vous d'un éventuel statut du beau-parent ? Nos collègues belges sont en train d'y réfléchir. Ne pourrait-on songer à leur donner un certain nombre de droits, ciblés et définis ? Que pensez-vous notamment d'un assouplissement de l'adoption simple ? Mme la Rapporteure : Faut-il à votre avis améliorer le PACS ? M. Lacroix parlait de l'accompagnement d'une situation de fait. Certains d'entre vous craignent de créer un mariage bis. Mais la véritable différence entre le PACS et le mariage ne tient-elle pas au fait que le PACS ne parle pas de filiation ? M. le Président : Je remercie Mme la Rapporteure de me voler ma question... Le PACS mène sa vie depuis maintenant six ans ; il a visiblement répondu au désir de certains d'organiser leur vie de couple dans un cadre fixé par la loi, qu'il s'agisse évidemment des couples homosexuels, mais également des couples hétérosexuels parmi lesquels il connaît, remarquons-le, un incontestable succès. M. Bénabent a très rapidement classé le concubinage, union de fait, d'un côté, le PACS et le mariage, unions de droit, de l'autre. Jusqu'à quel point peut-on satisfaire à la revendication sur l'égalité des droits et améliorer le PACS sans le dénaturer, autrement dit sans le faire ressembler au mariage au point qu'il perdrait une bonne partie de l'attrait qu'il présente aujourd'hui ? Comment résoudre cette contradiction ? M. Alain Bénabent : Je croyais que cette table ronde serait consacrée à l'examen des formes d'organisation du couple et non à la confrontation de plaidoiries pour l'extension ou au contraire la restriction de tel ou tel droit... Est-il souhaitable de protéger les concubins ? La question se pose en cas de rupture : faut-il imaginer un mécanisme comparable à la prestation compensatoire ? Dans l'état actuel du droit, l'absence d'engagement se traduit en jurisprudence par l'impossibilité de prétendre à une indemnité, dans un sens ou dans l'autre. L'expression « rupture abusive » est d'ailleurs impropre car, pour un concubin, la rupture n'est rien d'autre que l'exercice d'un droit. Une indemnité n'est éventuellement accordée qu'au regard du caractère de cette rupture, si elle a été brutale, mais en aucun cas du simple fait de la séparation elle-même. La question, par contrecoup, se pose aussi pour le PACS. Les améliorations proposées, notamment celles figurant dans le rapport du groupe de travail, sont excellentes Je ne vois pas, en droit, de différence entre les enfants selon que leurs parents sont mariés, pacsés ou concubins, sinon une différence purement psychologique : les enfants peuvent avoir l'illusion que les parents non mariés se sépareront plus facilement, mais, dans les faits, les couples de deux catégories peuvent être aussi stables ou au contraire aussi sécables. Les dérives de toutes sortes, de la mésentente à l'inceste, s'épanouissent aussi bien dans les familles où les parents sont mariés que dans celles où ils vivent en concubinage. Enfin, la séparation de parents mariés est tout aussi inconfortable que celle de parents concubins, voire plus douloureuse encore dans la mesure où le divorce peut donner lieu à un combat très long. M. Pierre-Louis Fagniez : Pour les concubins, en cas de décès, la retraite n'est pas reversée au survivant. M. Alain Bénabent : Pour les couples divorcés, la pension de retraite n'est pas allouée aux enfants mais au parent survivant. M. Pierre-Louis Fagniez : Elle participe néanmoins à l'éducation des enfants. M. Alain Bénabent : Quoi qu'il en soit, il conviendrait de réfléchir au versement d'une compensation pour les couples non mariés - pacsés ou concubins - qui se séparent. Il s'agirait d'un simple mécanisme d'équité, sans effet sur la responsabilité civile, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. La place du beau-parent est aussi délicate pour les concubins que pour les époux, car le remariage ne crée absolument aucun lien juridique entre le second conjoint et les enfants du premier lit, l'obligation alimentaire s'appliquant envers les ascendants du conjoint mais nullement envers ses descendants. Si une disposition doit être prise, je ne suis pas sûr qu'il faille établir une distinction entre beaux-parents mariés, concubins et pacsés. En outre, une difficulté se poserait pour le parent séparé de son enfant mais conservant des liens avec lui : il pourrait avoir le sentiment que la nouvelle compagne ou le nouveau compagnon de son ex-conjoint ou de son ex-conjointe opère une « OPA » sur son enfant. Il convient de se montrer très prudent, car dissoudre le lien parental serait une erreur. Lorsque, pour une raison ou une autre, le parent est défaillant, le beau-parent doit pouvoir intervenir juridiquement, mais le divorce ne vaut pas rupture du lien entre l'un des parents et ses enfants. M. Charles Melman : Nos idées nous viennent souvent du monde anglo-saxon et de l'Europe du Nord. Je serais ravi si le Parlement parvenait à dégager une option fidèle à notre tradition culturelle propre, enrichie par la pensée de sociologues éminents comme Durkheim, Mauss et Lévi-Strauss. Ce serait l'honneur de notre pays que de refuser le suivisme et de tracer une voie. Il ne me semblerait pas infondé, en particulier, de distinguer le mariage du contrat susceptible de lier et de protéger les couples de concubins ou d'homosexuels, tout en s'efforçant de résoudre, pour ces deux catégories, les problèmes juridiques de protection et de transmission des biens. Je me permettrai une remarque sacrilège à propos de l'apologie du pouvoir de la démocratie, en espérant que cela ne suscitera aucun doute sur mon adhésion sans réserve à cette forme de régime politique. Il me semble utile de rappeler que, depuis l'invention de la démocratie, il y a deux mille cinq cents ans, les décisions sont forcément animées par le court terme sinon, dans le meilleur des cas, le moyen terme ; il est en effet extrêmement compliqué de faire démocratiquement valoir les mesures d'intérêt public dont les bénéfices ne se font sentir qu'à long terme. À l'évidence, dans cette affaire, les passions personnelles se heurtent au bon sens ou à l'intérêt public. Dans la mesure où le statut dont vous débattez concerne le très long terme, il faut savoir prendre des positions politiquement incorrectes mais justes. M. Xavier Lacroix : Le manifeste d'octobre 2004 en faveur de l'adoption homosexuelle s'inquiétait du fait que des enfants, à la suite du décès de leur parent légal, puissent se retrouver orphelins. Or, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le vide juridique n'est pas si béant, puisque le compagnon survivant peut entamer trois démarches vis-à-vis de l'enfant : soit obtenir une délégation d'autorité parentale du vivant du géniteur, soit, après le décès, demander à être désigné comme tuteur par le juge des tutelles ou à être déclaré parent adoptif. Les cas particuliers sont si minoritaires qu'ils ne justifient pas une modification des règles générales actuelles. Le PACS ne doit pas ouvrir de droit à la filiation car il ne contient pas l'engagement de fidélité que l'enfant est en droit d'attendre de ses parents. Au-delà des réserves que j'ai déjà exprimées à propos de la filiation homosexuelle, il serait fort contestable que la loi laisse délibérément ouverte l'hypothèse de la séparation, qu'elle prévoie par avance, encadre, institutionnalise une filiation sans engagement de fidélité entre les parents. Faut-il codifier davantage le concubinage ? Celui-ci ressemble de plus en plus au mariage mais à condition que les partenaires restent ensemble. Or, dans la plupart des cas, le concubinage est beaucoup plus fragile que le mariage : d'après des sources convergentes, les couples concubins sont en moyenne six fois plus instables que les couples mariés et, même lorsqu'ils ont des enfants, ils le sont encore deux fois plus. Si je suis partagé entre la logique de l'égalité et celle du soutien, il me semble qu'un appui social à une forme de couple si fragile serait contestable. La puissance publique doit continuer de montrer sa préférence pour la solution matrimoniale, qui repose sur l'engagement explicite à la fidélité, et de lui accorder des droits spécifiques, sans quoi les individus ne comprendraient plus le message. Je suggérerai deux améliorations concernant le mariage en vous laissant le soin de les décliner juridiquement. Nous sommes tributaires d'une tradition très consensualiste du mariage qui laisse peu d'espace aux tiers. La place des tiers pourrait être renforcée à l'entrée et à la sortie. À l'entrée du mariage, un appui à la réflexion et au discernement pourrait être offert aux fiancés. À l'heure actuelle, la préparation au mariage est réservée aux unions religieuses, hormis quelques dizaines d'initiatives associatives s'adressant aux unions civiles, comme celle de Cap Mariage, à Bordeaux. À la sortie du mariage, les divorçants ont également très peu d'interlocuteurs pour prendre la mesure du poids de leur décision, l'audience de conciliation durant dix minutes en moyenne et la médiation étant souvent conçue comme une sorte de liquidation plutôt que comme une aide à la décision. L'égalité, aussi importante soit-elle - je suis un démocrate convaincu -, ne suffit pas à penser l'institution. Il convient d'établir juridiquement une différenciation, une structuration entre des fonctions, des places, des responsabilités. L'ancrage du mariage dans l'hétérosexuation n'est pas simplement un héritage judéo-chrétien ; il est universel parce qu'il prend sa source dans le corps. Je ne suis pas naturaliste, car j'ai conscience de la dimension culturelle et historique des choses, mais je ne suis pas non plus antinaturaliste en ce sens que je ne nie pas l'ancrage de la parenté dans la naissance - le mot « nature » vient du latin naturus, ce qui doit naître -. Que l'homme et la femme soient féconds ensemble n'est pas un accident ; il y a une portée anthropologique à leur union, à leur complémentarité. Prêter attention à la naissance, ce n'est pas être naturaliste primaire mais s'intéresser à la vie. M. Éric Fassin : Je ne pense pas que l'invocation de la démocratie sexuelle puisse être assimilée à une référence à Marx, qui, à bien des égards, critiqua les droits formels. La source serait plutôt à rechercher du côté de Tocqueville, qui, dans De la démocratie en Amérique, s'étend beaucoup sur la démocratie dans la famille. Cela ne participe donc aucunement d'une volonté de démantèlement de la société, mais d'une réflexion sur les processus en cours. Le débat sur les limites de la démocratie doit être pris au sérieux, mais il convient de réfléchir aux fondements des limites que nous voulons poser. Sont-elles fondées en nature ou bien sur des valeurs politiques ? L'inceste, vous le savez, n'est pas interdit par la nature, mais, pour Lévi-Strauss, l'interdit qui pèse sur cet acte constitue la seule universalité sociale. C'est pourquoi nous devons réfléchir aux valeurs politiques au nom desquelles nous voulons interdire ou permettre telle ou telle chose. Pourquoi la société est-elle plus vigilante face à la pédophilie qu'elle ne l'était auparavant ? Parce que la logique démocratique a conduit à imposer l'idée que les enfants ne sont pas des sujets sexuels libres. Ma vision de la démocratie est optimiste : plus de démocratie ne signifie pas tout autoriser mais donner des fondements aux libertés. Je m'inscris pour ma part dans une tradition de sciences sociales qui se refuse à distinguer sociologie et anthropologie : Émile Durkheim, pour la tradition française, est fondateur des deux disciplines à la fois. M. Melman a dit s'exprimer du point de vue de l'anthropologue, mais j'imagine qu'il l'a fait aussi en qualité de psychanalyste et de psychiatre. M. Lacroix a parlé du point de vue anthropologique mais aussi, j'imagine, avec un regard informé par la philosophie et la théologie. Je vous rappelle que le mot anthropologie revêt deux acceptions fort différentes : l'anthropologie religieuse ou philosophique, spéculation sur la nature de l'homme, et l'anthropologie comme science sociale, travail empirique sur la réalité de sociétés. Les textes du Vatican sur les rapports entre les hommes et les femmes n'ont rien à voir avec l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss. Or l'anthropologie en tant que science sociale, qu'elle soit américaine ou de langue française, réfute l'existence d'une définition universelle du mariage ou de la famille. N'allons donc pas invoquer une exception française en matière d'anthropologie pour sauver l'universalité anthropologique... Claude Lévi-Strauss, en 1983, dans Le Regard éloigné, évoquait déjà la possibilité du « mariage gay ». La science, aujourd'hui, n'impose pas de voie à suivre ; elle met en lumière la diversité des choix selon les sociétés. La prétendue universalité est démentie empiriquement : tous les hommes, en tous moments et en tous lieux, ne définissent ni le mariage ni la famille de la même façon. Il suffit de prendre le train jusqu'à Bruxelles pour entrer dans un autre univers « anthropologique » où le mariage est ouvert aux couples de même sexe. Lorsque j'ai déclaré que ces questions relevaient de choix démocratiques, j'ai vu des sourires se dessiner, comme si cela allait de soi. Je n'en suis malheureusement pas si sûr, car d'aucuns ne manquent pas une occasion de prétendre que vos décisions doivent obéir à des lois naturelles. Vos sourires laissent entendre que nous partageons la même conception de la démocratie, mais il n'est pas évident que celle-ci fasse l'unanimité... À propos du concubinage, j'ai été attentif à ne pas asséner des vérités mais à mettre en évidence qu'une logique est déjà à l'œuvre non seulement dans les pratiques sociales, mais aussi, avec le PACS, du côté de la loi : au lieu de réduire les options conjugales, pourquoi ne pas les laisser ouvertes, voire les ouvrir davantage encore ? Il ne s'agit pas de formaliser davantage le concubinage, mais de maintenir les options existantes en les modulant. La logique de liberté est inscrite dans les mœurs : les parents ont des enfants hors mariage, ce qui constitue une forme de liberté. Mme la Rapporteure : Vous parlez des droits des adultes. Et les enfants ? M. Éric Fassin : J'y viens. Les adultes se font les porte-parole de l'intérêt des enfants qui, en démocratie, n'ont pas la parole. Mais qui peut légitimement se prononcer sur l'intérêt des enfants ? Le divorce leur est-il nuisible ou profitable ? En tout cas, si certains enfants vivent avec des parents de sexes différents, mariés et résidant ensemble, beaucoup de situations ne correspondent pas à cette figure classique. Ces dernières sont-elles moins légitimes ? Affirmer que le mariage, c'est mieux, que l'hétérosexualité, c'est mieux, ce serait aller contre une évolution du droit qui met à égalité les enfants nés dans le mariage et hors mariage. Décider qu'il existe un bon modèle, c'est sous-entendre que ceux qui ne le suivent pas en ont choisi un mauvais, et par conséquent insinuer que certains enfants sont moins bien que d'autres. Et considérer qu'une famille doit nécessairement comporter un père et une mère aura des effets sur les couples de même sexe, mais aussi sur les enfants adoptés à titre individuel et sur les enfants des familles monoparentales. Est-il préférable, pour un enfant, de naître dans le mariage ? Je n'ai aucune compétence pour répondre à la question, mais je me demande si c'est à la loi de le faire, car celle-ci a un effet stigmatisant, sans quoi le droit ne servirait à rien. M. Daniel Borrillo : Si je n'ai guère parlé des enfants, c'est que le thème de la table ronde portait sur « les formes d'organisation du couple ». Depuis 1972, le traitement des enfants selon qu'ils naissent dans le mariage ou hors mariage est devenu plus égalitaire, en France comme dans le reste du monde, et une norme générale peut être dégagée : si l'intérêt de l'enfant est sauvegardé, peu importe l'agencement familial, qu'il soit nucléaire, recomposé, concubinaire ou monoparental. Cet engagement relève de la vie privée et doit être respecté et protégé par le droit avec la même vigueur. Or un type d'agencement induit encore une différence pour les enfants : les familles homoparentales. Dans le cas de ce couple de femmes qui a eu accès à la procréation médicalement assistée, il a fallu, pour créer une relation stable entre l'enfant et la compagne de la mère biologique, passer par un bricolage juridique : adoption simple, puis délégation de l'autorité parentale. Il n'y a effectivement pas de vide juridique, mais résoudre chaque problème prend quatre ou cinq ans, ce qui ne donne pas suffisamment de garanties à l'enfant. Il est crucial de tenir compte de la réalité concubinaire. Les concubins sont étrangers l'un envers l'autre du point de vue du droit mais, concrètement, la jurisprudence a créé un véritable droit prétorien qui, en cas de contentieux, génère une certaine protection, y compris à l'égard des enfants. Il convient cependant de se garder de toute évolution qui mettrait en cause l'autonomie de la volonté, et de ne pas suivre l'exemple de la loi catalane, qui, au bout de deux ans de vie commune, donne aux concubins des obligations, en particulier vis-à-vis des tiers. Je désapprouve les juristes qui ont proposé que le concubinage, en France, produise lui aussi des effets juridiques à partir d'une durée de deux ans de vie commune. Le PACS doit être suffisamment souple pour permettre aux concubins, en cas de séparation, de bénéficier d'une protection sans pour autant être soumis à un système trop contraignant. Je suis évidemment favorable à l'évolution du mariage. Je suis d'accord avec l'idée de divorce administratif - qui fit l'objet d'un débat très vif - notamment en l'absence d'enfant, c'est-à-dire lorsque les enjeux patrimoniaux sont moindres. L'obligation de fidélité est à revoir. Quant à la faute, cette catégorie me semble relever plutôt du droit canonique que du droit civil. Compte tenu de l'accroissement du nombre de familles recomposées et du développement des liens avec les beaux-parents, il convient effectivement de doter cette catégorie d'un statut. Je suis en phase avec MM. Patrick Bloche et Jean-Pierre Michel, qui, deux ans après la création du PACS, avaient émis l'idée d'un partage de l'autorité parentale entre partenaires. Les réflexions et propositions de réformes remises à M. Dominique Perben en 2004 sont également tout à fait justes. Je préconise simplement que le législateur ne donne pas davantage d'obligations aux couples pacsés au moment de la rupture du contrat, ce qui dénaturerait cette forme de conjugalité. La question de la biparentalité masculine ou féminine nous renvoie à celle de la possibilité offerte aux enfants de connaître leurs origines. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'accouchement sous X aboutit à un équilibre tout à fait décent entre respect du secret et possibilité d'accès aux origines. Mme Nadine Morano : Les enfants ont droit à un peu de sécurité dans leur vie de tous les jours et il est en effet dommage que, en l'absence de législation, la seule solution soit souvent le bricolage juridique et la judiciarisation. M. Jean-Marc Nesme : Je vous remercie, M. Fassin, de m'avoir appris l'existence de la « démocratie sexuelle ». Je vous informe en contrepartie qu'il existe bien une définition universelle du mariage. Je vous invite à relire l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui a inspiré les deux grands pactes de l'Organisation des Nations unies, le Pacte international des droits civils et politiques, en son article 23, et le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, en son article 10. Je cite ces deux articles : « La famille est l'élément fondamental et naturel de la société » ; « Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme ». M. Éric Fassin : Il n'est pas précisé « l'homme et la femme ensemble ». M. Jean-Marc Nesme : Allons ! Vous jouez sur les mots ! M. Éric Fassin : Allons voir en Belgique. M. Jean-Marc Nesme : Si la Belgique et l'Espagne ne respectent pas les traités qu'elles ont ratifiés et signés, c'est leur problème. M. Éric Fassin : Une universalité démentie dans un pays n'est plus guère universelle. M. Jean-Marc Nesme : Une majorité n'est pas près de se dégager à l'ONU pour obtenir une modification de ces traités. M. Éric Fassin : Si les pays que vous incriminez n'ont pas été condamnés, c'est bien que la définition du mariage ne fait pas l'objet d'un accord. M. le Président : La Belgique et l'Espagne ne sont d'ailleurs pas les seuls pays concernés. M. Jean-Marc Nesme : Mais plusieurs de ces pays commencent à regretter de ne pas avoir suivi le principe de précaution et d'avoir mis le doigt dans l'engrenage. Mme Henriette Martinez : Partout dans le monde, même dans les pays en voie de développement, des textes à portée internationale reconnaissent désormais les droits sexuels des personnes ; la France s'honorerait à en faire de même. Pour garantir les droits des enfants, il faut tenir compte des situations de fait. Les enfants qui vivent dans des familles ne correspondant pas au schéma classique - un papa et une maman -, familles homoparentales incluses, méritent toute notre attention, non seulement au plan du droit mais aussi en ce qui concerne leur développement personnel. Il n'y a aucune raison de les clouer au pilori de la société et de les regarder comme des marginaux. Il convient par conséquent de distinguer les géniteurs des parents qui accompagneront l'enfant dans la vie. Cette distinction est très utile dans bien des situations. Par ailleurs, les juges et les travailleurs sociaux divergent souvent dans l'interprétation de l'intérêt de l'enfant. Je rappelle qu'au Québec, dans toutes les procédures qui le concernent, il a droit à un avocat. Pour éviter toutes les interprétations possibles et imaginables, j'insiste sur la nécessité de définir l'intérêt de l'enfant, à travers ses besoins physiques, intellectuels, affectifs, médicaux, psychologiques, par le biais de grilles d'évaluation de la situation. Les couples mêlés à toutes les affaires à scandale qui ont défrayé la chronique ces dernières années étaient hétérosexuels, et de surcroît parents biologiques. Toutes les familles biologiques ne sont pas maltraitantes, loin de là, mais 85 % des maltraitances se produisent au sein de la famille. Il importe par conséquent de désacraliser la famille et de regarder les réalités telles qu'elles sont : l'enfant peut être heureux et épanoui dans des familles différentes ; la seule chose qui mérite d'être prise en compte est son épanouissement. M. Xavier Lacroix : Je ne pense pas que l'intérêt de l'enfant puisse être défini uniquement d'après un référentiel scientifique, ni sur la base d'une séparation entre géniteurs et parents. La distinction peut évidemment être opérée d'un point de vue intellectuel et constatée dans les faits, mais la dissociation entre les deux notions me paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, qui doit toujours bénéficier de la continuité de son histoire. Mme Henriette Martinez : Et les enfants adoptés ? M. Xavier Lacroix : L'adoption n'est pas un long fleuve tranquille. Quant à la PMA, c'est toujours une solution de recours très douloureuse et onéreuse. M. Éric Fassin : La distinction entre géniteurs et parents existe non seulement dans les faits, mais également en droit : ainsi dans l'adoption et l'assistance à la procréation. En outre, les deux peuvent coexister à travers l'adoption simple. L'idée selon laquelle le seul fondement de la famille serait biologique est donc démentie par, à la fois, la pratique sociale, les représentations et le droit. M. le Président : Je vous remercie pour votre participation à cette table ronde, qui a permis de confronter des points de vue bien différents. Table ronde ouverte à la presse sur les mariages forcés, réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous accueillons pour cette table consacrée aux mariages forcés sept intervenants : - Mme Edwige Rude-Antoine, vous êtes juriste et sociologue, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique et vous avez participé à l'élaboration du rapport que le Conseil de l'Europe vient de consacrer aux mariages forcés ; - Mme Gaye Petek, vous êtes directrice de l'association Elele et membre du Haut Conseil à l'intégration, et vous avez, parmi de nombreuses fonctions, vice-présidé le Conseil national pour l'intégration des populations immigrées ; - Mme Clotilde Lepetit, vous êtes avocate, responsable du pôle juridique de l'association Ni putes ni soumises ; - Mme Virginie Larribau-Terneyre, vous êtes professeur de droit à l'université de Pau et des pays de l'Adour, spécialisée dans le droit de la famille ; - M. Jean-Louis Zoël, vous êtes chef du service des accords de réciprocité à la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, et vous nous donnerez donc le point de vue du ministère des affaires étrangères ; - Mme Marie-Thérèse Coulon, vous êtes vice-procureur près le Tribunal de grande instance de Nantes et, à ce titre, vous êtes destinataire des demandes de vérification de la réalité du consentement au mariage qui vous sont adressées par les agents consulaires ; - Mme Myriam Bernard, vous êtes directrice générale adjointe du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, chargée des programmes et des interventions. Notre attention a été attirée sur l'ampleur de la pratique des mariages forcés, qui concernerait en France 70 000 femmes. Le sujet est à l'intersection du droit de la famille et de la protection de l'enfance. Il était donc logique que notre Mission d'information s'en saisisse. Mme Edwige Rude-Antoine : La réflexion que je porte s'appuie sur une recherche comparative concernant 28 pays du Conseil de l'Europe. La lutte contre les mariages forcés nécessite d'abord des mesures d'information, de sensibilisation, d'éducation et de formation. Ainsi il serait bon de renforcer l'information des femmes et des enfants sur leurs droits en matière de prévention et de lutte contre les mariages forcés, et de développer à cette fin des actions de formation dans les écoles auprès des filles et des garçons. Les agents diplomatiques et consulaires, les juges, les policiers et les travailleurs sociaux doivent être sensibilisés à ces questions et aux difficultés rencontrées par les femmes dans le domaine juridique, culturel et familial. La formation des professionnels sur la question des droits civiques des femmes doit aussi être renforcée. Elle nécessite ensuite des mesures juridiques additionnelles concernant les mariages forcés. L'un des problèmes que l'on rencontre tient à la façon de gérer au plan de notre droit international privé la situation des familles concernées, qui sont de nationalité étrangère et résident sur notre sol, notamment lorsque ces familles n'envisagent pas de retourner vivre dans leur pays d'origine. Actuellement, la règle de rattachement est, s'agissant du statut personnel, la loi nationale. La loi du lieu de résidence habituelle serait sans doute mieux adaptée à la réalité de ces familles, mais il faut savoir qu'elle ne règlerait pas toutes les difficultés. Sur le plan du droit civil, repousser à dix-huit ans l'âge minimum légal du mariage des filles ne saurait suffire à prévenir ces mariages forcés. En Inde, pour ne citer qu'un exemple, cet âge est de dix-huit ans pour la fille et de vingt et un ans pour le garçon mais, dans les faits, les familles continuent de pratiquer les anciennes coutumes, en « régularisant » civilement le mariage par la suite. Reste qu'une telle mesure abolirait la discrimination existant en France entre les filles et les garçons, où, faut-il le rappeler, l'âge minimum légal est de quinze ans pour les premières et de dix-huit ans pour les seconds. Sur le plan pénal, la question est de savoir s'il faut ou non créer une infraction spécifique de « mariage forcé » ? Peu de pays ont posé une telle infraction : seules la Norvège et l'Allemagne ont introduit cette catégorie dans leur code pénal. Je considère, pour ma part, qu'une telle infraction pose des difficultés, notamment concernant la qualification du mariage forcé. Qu'est-ce qu'un mariage forcé ? Comment l'évaluer et comment apprécier la notion de consentement ? Certes, la qualification d'un délit spécifique de « mariage forcé » est plus facile lorsqu'il y a eu violence et séquestration. Mais la législation française permet déjà de poursuivre pour viol lorsqu'il y a pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui par menaces, violence, surprise. Elle punit aussi les enlèvements d'enfants. Si l'on édictait malgré tout une infraction spécifique, il faudrait réfléchir à une qualification du mariage forcé et prévoir des peines différentes suivant les circonstances. Selon la législation suédoise, les mariages d'enfants et les mariages forcés pratiqués dans d'autres pays ne sont pas reconnus en Suède. En raison des conséquences que peut avoir le mariage forcé sur le plan juridique et sur la trajectoire personnelle des intéressés, la France pourrait adopter une position similaire qui aurait cependant l'inconvénient d'imposer notre conception du mariage aux pays étrangers. Il conviendrait sans doute d'allonger les délais de prescription et de développer la mise en œuvre des actions civiles par les parquets, car les jeunes filles et les jeunes garçons qui subissent ces unions ont des difficultés à déposer plainte et à engager des procédures à l'encontre de leurs familles. De la même façon, il faudrait sans doute étendre les possibilités de déclenchement des poursuites pénales. Enfin, il est nécessaire de développer des moyens d'action plus adaptés à la réalité de ces mariages forcés : les lieux d'écoute, d'assistance, de prise en charge et de conseil mériteraient d'être plus nombreux. Il faut créer des lieux d'hébergement spécifiques, ceux qui existent en France n'étant pas forcément adaptés aux situations d'urgence. Il serait souhaitable également de soutenir les associations de défense des droits des femmes. Les relais associatifs doivent être davantage aidés financièrement, car les jeunes qui rompent avec leur famille vivent une culpabilisation très forte à laquelle s'ajoutent des besoins d'ordre financier pour leur formation, leurs études. Les politiques de la ville et les politiques d'intégration doivent développer des actions spécifiques en direction des femmes. Il faut également mettre en place des programmes d'action pour les familles auteurs de ces mariages forcés. Il faut aussi se donner les moyens d'évaluer l'efficacité des politiques et des actions proposées. Enfin, il semble urgent de créer un groupe d'études et de réflexion pour réaliser un certain nombre d'enquêtes. Le nombre de 70 000 mariages forcés en France, qui est parfois avancé, ne repose sur aucune étude fiable. Il en est de même dans l'ensemble des pays d'Europe, où les données sont très anecdotiques. Il faut améliorer la connaissance des difficultés rencontrées par les victimes et leurs familles et, surtout, analyser les pratiques judiciaires, les politiques et les moyens d'action au niveau local. Mme Gaye Petek : Je souhaiterais préciser que l'association Elele que je représente est membre du réseau Agir avec elles, qui s'occupe de jeunes filles et de femmes de diverses origines. Je ciblerai mon propos sur trois points : les aspects juridiques, les aspects liés à la prévention et les aspects liés à l'accompagnement social. Les associations pensent qu'il faut poursuivre pénalement les auteurs de mariages forcés. Il faut cependant garder à l'esprit qu'une pénalisation excessive peut conduire les jeunes majeures à se taire. C'est déjà le cas des mineures qui sont, par exemple, exclues de l'école à seize ans pour être mariées de force dans leur pays et qui ne souhaitent pas dénoncer leurs parents. Elle peut également amener les parents à adopter de nouvelles postures et à envoyer les jeunes filles dans leur pays, où elles resteront. Il faut certes faire jouer la force de la loi, mais, face à des pratiques archaïques, celle-ci ne fait pas forcément peur, ni ne dissuade vraiment. Nous ne sommes pas pour la pénalisation des parents de jeunes majeurs. Quant à la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers, elle prévoit des amendes à l'encontre des auteurs de mariages forcés. Cette loi permet également à des femmes victimes de violences, qui ont rompu la communauté de vie avec leur époux avant deux ans de mariage, de ne pas être renvoyées dans leur pays d'origine, d'où elles sont venues au titre du regroupement familial. Mais les violences dont ces femmes pourraient arguer pour obtenir un titre de séjour durable ne sont pas toujours visibles. En outre, nombre de conjoints contournent la loi en dénonçant le mariage avant la rupture. Ainsi, la situation se retourne contre la victime, qui s'engage dans un véritable parcours du combattant. On punit davantage les victimes plutôt que les coupables. Les consulats de France refusent de donner des visas aux mineures bi-nationales nées en France qui sont mariées de force dans le pays d'origine de leurs parents et qui n'ont pas encore la nationalité française. Lorsque les jeunes filles sont majeures, certains consulats les renvoient à leur double nationalité, voire aux conventions bilatérales - avec l'Algérie, le Maroc ou certains pays d'Afrique -. Les associations n'ont pas les moyens financiers et humains d'aider ces jeunes filles à revenir en France. Il faudrait donc modifier la loi sur la nationalité pour permettre le retour en France des enfants, nés en France, qui ne sont pas français avant treize, seize ou dix-huit ans. La situation des jeunes filles en cours de naturalisation crée également des difficultés lorsque celles-ci se marient ou sont mariées par procuration, leur dossier de naturalisation étant interrompu par les préfectures. On a même vu des cas de retrait de nationalité, du fait que le mariage n'avait pas été déclaré pendant l'examen de la demande de naturalisation. Il faut garder à l'esprit que l'annulation du mariage au sens du droit français n'est pas forcément une annulation du mariage au sens du droit étranger. Une telle annulation prononcée en France n'aboutit pas forcément à l'annulation, dans l'autre pays, du mariage de la jeune fille bi-nationale. Nous rencontrons fréquemment dans nos associations des situations très complexes, où des personnes considérées comme célibataires en droit français sont considérées comme mariées par le droit de leur pays. Il faut alors qu'elles y entament une procédure de divorce pour se dégager des liens du mariage. La notion de mariage forcé devrait être intégrée dans les dispositions réprimant le viol, en créant un délit de complicité de viol à l'encontre de toute personne ayant participé à la conclusion d'un mariage contraint. Si nous faisons cette proposition, c'est parce que nombre de mariages forcés sont des viols, voire des viols aggravés. Il faudrait créer une cellule de veille interministérielle chargée de coordonner les informations et les interventions afin de permettre aux victimes, aux associations, aux écoles, aux travailleurs sociaux d'agir. Les associations ont non seulement beaucoup de mal à gérer l'accompagnement des situations auxquelles elles doivent faire face, mais elles se heurtent au nombre des interlocuteurs et à leur manque de coordination. Il serait bon de réunir en un même lieu des personnalités désignées par les ministères compétents. La formation des acteurs est pour nous un élément essentiel, qu'ils soient travailleurs sociaux, magistrats, policiers, enseignants. Je donnerai un exemple pour illustrer mon propos. Une responsable des services sociaux du Val-d'Oise, que nous avions saisie à propos d'une jeune fille forcée de quitter l'école à seize ans et renvoyée en Turquie, nous a répondu, sans même connaître la réglementation concernant l'obligation scolaire, que, de toute façon, la jeune fille aurait été déscolarisée encore plus tôt en Turquie ! Ceci pose avec acuité la question de la formation des personnels de l'éducation nationale et des services sociaux. En outre, l'école ne signale pas toujours l'absence de la jeune fille et il arrive parfois qu'elle attende deux mois pour le faire lorsqu'il s'agit d'une jeune majeure. Il faudrait réfléchir à la création de commissions départementales d'évaluation des mariages forcés qui, pour chaque cas signalé, déclencheraient systématiquement un suivi de la fratrie, avec évaluation pluridisciplinaire. Cette procédure est actuellement mise en place en Seine-Saint-Denis et il conviendrait de profiter de cette expérience pour la généraliser. La loi ne dissuade pas forcément. Il faut faire de la « pédagogie de la loi » pour que les attitudes changent. Ces pratiques archaïques et coutumières sont réprimées pénalement dans certains pays. C'est le cas de la Turquie, qui inflige, depuis de nombreuses années, de lourdes sanctions en cas de viol aggravé après mariage forcé. Or ces peines n'ont changé ni les habitudes, ni l'attitude de certains qui vont jusqu'au « crime d'honneur ». Il faut donc savoir que la pénalisation, sans pédagogie d'accompagnement, ne réussira pas. Cette pédagogie doit se faire dans les établissements scolaires. Nous le faisons, de notre côté, avec certaines associations du réseau Agir avec elles, dans le département de Seine-Saint-Denis. Depuis quatre ans, nous faisons de la prévention dans les classes auprès des élèves du secondaire afin de les informer et de discuter. Ces interventions ont beaucoup de succès et sont très écoutées. Il serait bon de les généraliser. Malheureusement, l'éducation nationale a beaucoup de mal à prendre en compte de telles problématiques. La pédagogie de la loi doit également se faire auprès des familles, dans les services de la protection maternelle et infantile ou, lorsqu'elles sont primo-arrivantes, dans le cadre du contrat d'accueil d'intégration. La question des mariages arrangés et forcés a été intégrée dans la formation civique. Mais il faudrait former davantage les intervenants sur ce sujet, profiter des actions menées dans les centres d'action sociale pour intervenir auprès des parents et au sein des écoles lorsqu'il y a médiation scolaire auprès des parents. Lorsque les auteurs font l'objet de poursuites pénales, il faut aussi déclencher une médiation familiale avec une obligation de suivi et une prise en charge sociale et psychologique. Certains magistrats le font. S'agissant des mesures d'accompagnement, les associations n'ont pas les moyens de faire face aux difficultés. En matière de logement, par exemple, les associations sont débordées et les hébergements spécifiques n'existent pas en France, contrairement à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Pourtant, nous demandons depuis une dizaine d'années aux pouvoirs publics d'y réfléchir. Mais nous ne sommes pas entendus, alors que ces hébergements nous paraissent indispensables, surtout s'agissant de jeunes filles. Les associations reçoivent des subventions pour prendre en charge, dans la durée, l'accompagnement de certaines femmes et jeunes filles victimes de mariages forcés. Il s'agit de les aider dans leurs démarches administratives, pour trouver un logement, un emploi, si nécessaire pour apprendre le français. Les victimes ont besoin d'aide matérielle et les moyens des associations sont insuffisants, bien qu'elles jouent un rôle d'accompagnement indispensable. Les services sociaux ferment leurs portes à cinq heures de l'après-midi, alors que les associations peuvent rester ouvertes jusqu'à dix heures du soir... Pour les acteurs de terrain que nous sommes, on ne peut pas appliquer la loi si des mesures d'accompagnement bien pensées ne sont pas prises. Pour régler rapidement les problèmes de papiers des femmes victimes de mariage forcé, il faudrait désigner un interlocuteur spécifique dans les services des étrangers des préfectures et du ministère de l'intérieur, à défaut de disposer de la cellule de veille que j'évoquais antérieurement. La détention de papiers favoriserait en effet l'autonomie des intéressées. Au-delà de l'application de la loi, nous avons besoin de prévention, d'information et de moyens. Il faudrait penser à modifier le code de l'action sociale et des familles afin de permettre à une jeune fille qui atteint sa majorité et change de département de continuer à être prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en bénéficiant d'un contrat « jeune majeur ». Mme Clotilde Lepetit : L'association Ni putes ni soumises est opposée à la pénalisation du mariage forcé. En effet, le mariage forcé est une réalité sociale, mais ne constitue pas une réalité juridique qui puisse être définie. Or le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale s'impose, et une infraction pénale doit être définie juridiquement. Par ailleurs, il existe tout un panel d'infractions comme le viol, les menaces sous condition, le harcèlement, la séquestration, qui peuvent être utilisées pour réprimer les mariages forcés. En fait, la difficulté qu'on rencontrera toujours, quelle que soit l'infraction retenue, tient à l'administration de la preuve. En outre, je ne pense pas qu'on puisse définir juridiquement la différence entre un mariage arrangé et un mariage forcé, et il ne nous appartient pas de juger de la pertinence d'un mariage arrangé. Comment en effet apprécier un consentement contraint, surtout lorsqu'il s'est matérialisé par un « oui » au moment du mariage ? Comment établir un « non » intérieur ? Pénaliser un mariage forcé aboutirait à culpabiliser d'autant plus les jeunes filles qui n'oseront plus parler, et à montrer du doigt leur famille. Il faut, en revanche, améliorer la procédure de demande en nullité des mariages en arguant du fait que le consentement a été vicié par la violence. On doit pouvoir agir plus facilement sur ce fondement-là. L'article 181 du code civil ne facilite par l'annulation d'un mariage forcé, notamment en raison de la brièveté du délai de prescription, fixé à six mois à partir du moment où l'époux a acquis sa pleine liberté. D'une part, le point de départ de ce délai me semble difficilement appréciable ; d'autre part, la durée de six mois est trop brève. Il convient donc d'aligner ce délai de prescription sur celui de la nullité relative, qui est de cinq ans. Une femme mariée de force, qui se sent coupable, qui est anéantie psychologiquement et matériellement, n'aura pas le temps, en six mois, d'agir en nullité. Le vice de consentement doit pouvoir fonder une action en nullité, car la violence, même psychologique, porte atteinte à l'ordre public, au-delà même de l'atteinte subie par la femme. On pourrait donc admettre une exception au régime des nullités relatives, en permettant au ministère public d'agir pour vice de consentement. Cette action ne serait pas limitée à la victime, comme c'est actuellement le cas, mais ouverte au procureur. Il s'agirait donc de prévoir explicitement, à l'article 184 du code civil, que le ministère public peut attaquer le mariage pour vice de consentement. Par ailleurs, les articles 170 et suivants du code civil prévoient des formalités spécifiques aux mariages célébrés à l'étranger. Il ne s'agit pas de les réformer, mais de les appliquer. Les agents diplomatiques et consulaires doivent être très vigilants et utiliser les procédures dont ils disposent pour s'assurer de la liberté du consentement des époux. La liberté de se marier ou de ne pas se marier est une liberté constitutionnelle. Nous recommandons aussi la ratification par la France de la convention des Nations unies du 10 décembre 1962 qui proscrit les mariages forcés. Une telle ratification aurait un caractère symbolique et agirait sur les consciences. Il conviendrait néanmoins d'émettre une réserve sur le deuxième alinéa de l'article 1er, qui donne la possibilité de contracter des mariages par procuration. Nous aimerions que l'article 63 du code civil et les articles 170 et suivants permettent d'auditionner les futurs époux en cas de suspicion sur la réalité du consentement. On pourrait aller jusqu'à systématiser ces auditions préalables. Cette mesure me semble matériellement impossible pour l'instant, mais elle aurait l'avantage de ne pas jeter une suspicion permanente sur les populations d'origine immigrée. Il ne s'agit pas de montrer du doigt, mais de dénoncer une atteinte à une liberté fondamentale. Il faut évidemment renforcer les mesures d'éducation et de sensibilisation des élèves, par exemple en instruction civique, mettre en place des structures d'accueil adaptées avec un suivi des personnes menacées ou victimes de mariages forcés, organiser des aides matérielles et psychologiques, un accueil d'urgence, un accompagnement social visant à une réelle insertion professionnelle et, surtout, à l'autonomie des femmes subissant les mariages forcés. Il serait bon également que le mariage forcé soit pris en compte par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Commission de recours des réfugiés, pour que les victimes puissent obtenir le statut de réfugié. Enfin, nous demandons bien entendu un renforcement des actions de prévention, d'information et de formation sur les problèmes liés aux mariages forcés auprès des officiers d'état-civil, des magistrats, des policiers, des instances compétentes en matière d'asile, des avocats, des travailleurs sociaux et du monde enseignant. Mme Virginie Larribau-Terneyre : J'aborde pour ma part la question du mariage forcé en tant que juriste et théoricienne, car je ne connais pas directement cette pratique, si ce n'est à travers les rapports du Conseil de l'Europe et les témoignages d'associations. Si les chiffres donnés sont préoccupants et si le phénomène semble avoir de l'ampleur et de la gravité, une recherche informatisée sur le contentieux des cours d'appel et de la Cour de cassation couvrant les années 1989-2005 ne révèle pourtant que douze décisions concernant des mariages forcés, dont une seule de la Cour de cassation(1), avec six annulations du mariage pour violence, alors que, parallèlement, on trouve soixante-dix-huit décisions concernant des mariages de complaisance. La seconde pratique paraît donc a priori mieux sanctionnée. Il faut évidemment se garder de tout amalgame entre les situations de mariage de complaisance (ou mariage blanc ou mariage fictif) et celles de mariage forcé, d'enfants ou de jeunes majeurs, même si elles ont en commun de concerner dans une large mesure les mêmes populations issues de l'immigration et si un mariage forcé peut aussi parfois être un mariage blanc. La différence reste néanmoins fondamentale : la problématique des mariages de complaisance met en cause le contrôle de l'immigration et un ordre public territorial contingent ; celle des mariages forcés concerne les droits fondamentaux de la personne, les droits de l'homme et les droits de l'enfant. Ce qui est en cause, dans le mariage forcé, c'est la liberté de la personne qui se voit contrainte à un mariage dont elle ne veut pas ; plus techniquement, du point de vue du droit civil, c'est la liberté du mariage qui est concernée, dont le Conseil constitutionnel a fait une composante de la liberté personnelle(2) et la protection du consentement, condition essentielle de validité du mariage. Si le mariage de complaisance est sanctionné sur le fondement de l'inexistence du consentement, il y a bien quand même consentement à un mariage, mais qui ne porte pas sur le contenu du mariage : les conjoints (ou l'un d'entre eux) n'ont pas l'intention de vivre un vrai mariage et ils se servent de l'institution pour atteindre un autre objectif (titre de séjour, permis de travail, acquisition de la nationalité française). Dans le mariage forcé, en revanche, la personne dont le consentement est atteint est une victime qu'il faut protéger. Contrairement à ce qui pu être dit, il me semble que le mariage forcé peut être défini juridiquement : c'est un mariage dans lequel le consentement n'est pas donné librement. Cette absence de liberté correspond soit à une absence totale de consentement, compte tenu de la gravité de l'atteinte à la liberté et du degré de contrainte exercé, soit, plus fréquemment, à un vice du consentement, atteint plus ou moins gravement (il y a possibilité de prendre en compte quantité de situations) en raison de menaces, de pressions, de violences qui peuvent être d'ordre physique, mais aussi moral. Le droit civil a en effet une conception large (beaucoup plus que le droit pénal) de la violence, sanctionnée par la nullité du mariage(3) parce qu'elle génère une crainte et une contrainte qui altèrent la liberté du consentement. Malgré la différence entre le mariage forcé et le mariage de complaisance et sans amalgame, il me semble que la lutte contre les premiers pourrait utilement s'inspirer au plan juridique de la lutte contre les seconds. On pourrait appliquer aux mariages forcés le dispositif qui a été développé par les lois sur la maîtrise de l'immigration du 25 août 1993, 30 décembre 1993 et, en dernier lieu, 26 novembre 1993, pour lutter contre les mariage de complaisance. Cependant, pour être efficace dans la lutte contre les mariages forcés, ce dispositif doit pouvoir être étendu pour s'appliquer non seulement dans l'hypothèse d'inexistence totale du consentement(1), mais aussi en cas de vice du consentement(2). En l'état actuel du droit, ce n'est pas le cas. Le dispositif civil se déploie en amont et en aval du mariage : on peut intervenir avant pour empêcher le mariage ou après pour l'annuler. Les moyens offerts sont assez nombreux : en amont, audition en principe obligatoire des époux par l'officier d'état civil avant la publication des bans(3) ou par l'agent diplomatique ou consulaire (lors de la demande de publication des bans ou lors de la délivrance du certificat de mariage ou en cas de demande transcription du mariage(4)). En cas d'indices sérieux laissant présumer que le mariage est susceptible d'être annulé pour absence de consentement, possibilité de saisir le procureur de la République, qui peut lui-même surseoir à la célébration du mariage dans l'attente des résultats d'une enquête ou faire directement opposition au mariage. Enfin, le procureur peut agir en nullité contre le mariage qui a été célébré. Mais, toutes ces possibilités d'agir sont actuellement limitées à l'hypothèse d'une absence de consentement, cause de nullité fondée sur l'article 146 du code civil, au terme duquel il n'y a pas de mariage s'il n'y a point de consentement. On laisse complètement de côté l'article 180 alinéa 1 du code civil, aux termes duquel les époux doivent donner un consentement libre, à défaut duquel le mariage peut être annulé. Or, l'hypothèse d'un vice du consentement obtenu par la violence est, on l'a dit, fondamentalement adaptée à la situation de mariage forcé, bien davantage que celle de l'absence de consentement. Il faudrait donc étendre l'ensemble du dispositif à l'hypothèse d'un vice de violence, en visant non seulement l'article 146 mais aussi l'article 180 alinéa 1 du code civil et en donnant ainsi pouvoir à l'officier d'état civil, à l'officier consulaire ou au ministère public d'intervenir chaque fois que le mariage semble avoir été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux. Bien que le vice de violence soit actuellement seulement cause de nullité relative, nullité de protection, il nous semble qu'il atteint l'ordre public car il touche aux droits fondamentaux et à la liberté. Il ne serait donc pas choquant, chaque fois qu'il y a, par l'exercice d'une violence physique ou morale sur une personne, une contrainte pesant sur son consentement, de permettre aux différents acteurs et au ministère public d'intervenir. Ainsi, ne serait-ce que symboliquement, on attirerait l'attention des acteurs sur le phénomène du mariage forcé, et, parce que toute situation de violence pour faire consentir au mariage relève de l'ordre public, on devrait étendre systématiquement ce dispositif qui permettrait de généraliser, si on le souhaite, un contrôle en amont et en aval sur tous les mariages célébrés en France, mais également sur les mariages mixtes célébrés à l'étranger selon les formes locales qui pourraient être contrôlés lors de leur transcription. Resterait néanmoins le problème des mariages d'étrangers à l'étranger qui n'ont pas à être transcrits sur les registres d'état civil et qui échapperaient au contrôle. En cas d'extension du dispositif aux situations de vice de consentement, qu'en serait-il cependant du régime de l'action en nullité et notamment de la prescription ? La nullité pour vice de violence deviendrait-elle automatiquement du fait de l'ouverture de l'action au ministère public une nullité absolue assortie d'une prescription de trente ans ? Faut-il laisser planer l'incertitude sur le mariage aussi longtemps ? Je précise que la prescription actuelle de six mois prévue par l'article 180 alinéa 1 du code civil ne court qu'à partir du moment où la contrainte et la violence ont cessé et à la condition d'une cohabitation continue des époux depuis ce moment. S'il y a eu rupture de la cohabitation pendant cette période, la prescription redevient la prescription habituelle de cinq ans prévue pour les actions en nullité relative. Par ailleurs, pourrait-on imaginer d'aller jusqu'à poser une présomption de contrainte ou de violence en cas d'action en nullité fondée sur ce vice du consentement ? C'est peut-être séduisant, compte tenu de la difficulté d'obtenir des preuves, mais à mon avis extrêmement dangereux. Si cette présomption était généralisée (alors que le principe est celui de la présomption de bonne foi et de la présomption d'innocence), de nombreux époux, au lieu de divorcer, demanderaient la nullité du mariage et le juge serait débordé. Et si l'on pose des conditions pour faire jouer cette présomption, on risque de tomber assez vite dans la discrimination. Au-delà de l'extension du dispositif civil existant aux hypothèses de vice du consentement par violence, je suis évidemment favorable à l'alignement de l'âge légal du mariage des femmes sur celui des hommes. La disposition (entraînant la modification de l'article 144 du code civil) a été adoptée par le Sénat par la voie d'un amendement lors de la discussion de la proposition de loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple. Il devrait être débattu ensuite à l'Assemblée nationale. M. le Président : Il n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ! Mme Virginie Larribau-Terneyre : C'est dommage, car il semble qu'il y ait urgence. Enfin, faut-il une incrimination pénale spécifique ? Depuis 2003, la loi pénale sanctionne celui qui contracte un mariage de complaisance, comme tous ceux qui l'ont organisé ou y ont participé. Faudrait-il procéder de la même façon pour les mariages forcés ? L'intérêt serait d'abord pédagogique, même si les populations concernées n'ont pas toujours peur de la loi pénale. Par ailleurs, je ne suis pas sûre que les infractions actuellement existantes puissent être appliquées aux mariages forcés, le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale s'opposant à des applications larges. Ainsi, le harcèlement moral ne concerne que les relations de travail ; quant au harcèlement sexuel, il ne correspond pas aux situations de mariage forcé. Les violences prises en compte dans le droit pénal sont toujours des violences physiques. Le code pénal rend difficile la prise en compte des violences morales qui, bien souvent, sont commises en cas de mariage forcé, sans avoir immédiatement de répercussions physiques sur la victime. La séquestration pourrait être utilisée, mais elle n'existe pas toujours. Les incriminations existantes ne sont donc pas adaptées, et il serait intéressant de définir un délit spécifique de contrainte au mariage. M. Jean-Louis Zoël : La lutte contre les mariages forcés interpelle particulièrement le ministère des affaires étrangères, dans la mesure où nombre d'entre eux sont célébrés à l'étranger. Nous participons activement à tous les travaux interministériels tout en développant, à droit constant, nos capacités d'action au sein de notre réseau. Nous ne le faisons pas seulement par la formation et les instructions. Nous l'avons fait aussi cette année lors de la conférence des ambassadeurs au cours de laquelle, sans faire l'amalgame, les deux thématiques des mariages de complaisance et des mariages forcés ont été abordées. Je consacrerai l'essentiel de mon propos aux réformes normatives. Ce sont en effet les normes juridiques qui délimitent l'action de l'État, comme les comportements des acteurs, et je crois qu'il faut déplacer le curseur. Mais je voudrais, en introduction, expliquer l'action menée par le ministère des affaires étrangères contre les mariages forcés et la manière dont il appréhende cette pratique. Nous n'avons, pas plus que les autres, aucune statistique précise sur les mariages forcés. Cette pratique s'inscrit dans le contexte très général des mariages mixtes - définis par le fait qu'un seul des époux a la nationalité française - célébrés à l'étranger qui sont au nombre de 45 000. 95 % d'entre eux sont célébrés par les autorités étrangères, et nous en prenons connaissance à l'occasion des transcriptions. Le nombre de ces mariages a doublé en dix ans, avec des pics dans certains pays. Cette évolution est liée surtout à la démographie des populations issues de l'immigration, mais aussi à l'intérêt de plus en plus grand que présente le mariage avec une personne de nationalité française. Cet intérêt survalorise, non seulement le mariage de complaisance, mais aussi le mariage forcé, pour le mari comme pour la famille qui entend échanger le « bien » que représente la jeune fille. Il existe un autre indicateur : les signalements aux parquets civils par nos postes consulaires, à l'occasion des demandes de transcription des actes de mariage, ont triplé en trois ans, passant de 500 en 2001 à 1 500 en 2004. La plupart sont des mariages de complaisance, mais une vingtaine de dossiers par an concernent des suspicions de mariages forcés. À Paris, la mission « Femmes françaises » traite, en liaison avec nos consulats, les situations d'urgence que sont les menaces de mariage forcé à l'étranger, sur lesquelles nous sommes alertés de manière diverse, par les jeunes filles elles-mêmes, leurs camarades ou leur véritable petit ami. Il faut alors localiser la victime, la mettre en sécurité - toujours relative à l'étranger -, l'exfiltrer vers la France et y organiser son arrivée discrète. À l'étranger, nos possibilités sont très limitées, car tout dépend de la réceptivité des autorités locales, en général faible s'agissant de jeunes femmes bi-nationales. Souvent, nos postes doivent faire sans l'aide des autorités locales, mais la médiatisation d'une affaire peut aider à rendre celles-ci et les familles plus souples. En dix ans, la lutte contre les mariages forcés est devenue l'activité presque exclusive de cette mission, qui a eu à connaître de cinquante-cinq cas de menaces de mariages forcés en deux ans. Exception faite de deux Françaises, il s'agissait à chaque fois de bi-nationales, dont un quart étaient mineures. Un peu plus de la moitié de ces jeunes filles ont échappé au mariage. Un quart d'entre elles sont rentrées en France après le mariage, et sont hors d'atteinte, une procédure d'annulation étant en cours. Le reste correspond soit à des dossiers en cours, soit pour sept jeunes filles à des cas où nous avons malheureusement perdu le contact. Le ministère des affaires étrangères préconise une réforme normative, destinée à étendre nos moyens de prévention ou de sanction et à limiter les comportements coupables des familles. Je citerai quatre mesures, dont certaines sont déjà connues. La première mesure, évidente, consiste à harmoniser l'âge légal minimal du mariage, à dix-huit ans pour les femmes comme pour les hommes. C'est d'ailleurs sur un amendement d'une sénatrice représentant les Français de l'étranger que le Sénat a adopté, le 29 mars dernier, cette modification de l'article 144 du code civil, acceptée par le Gouvernement. Le ministère des affaires étrangères est depuis longtemps favorable à l'abrogation d'une discrimination qui nous distingue à tort des autres pays européens et désormais de trois pays du Maghreb, et qui est indéfendable dans les enceintes internationales. Même si nombre de mariages forcés ont lieu après dix-huit ans, l'harmonisation sera utile, et tout ce qui est utile est à prendre. L'accord du procureur serait désormais requis pour les dispenses concernant les jeunes filles âgées de quinze à dix-huit ans ; actuellement, le consentement de l'un des parents suffit à ce qu'une mineure puisse se marier. Il conviendrait aussi d'élargir l'action en nullité absolue par le ministère public aux cas de vice de consentement. Selon certaines lectures de notre code civil, le mariage forcé ne relèverait que de la nullité relative et l'action ne serait ouverte que pour les conjoints, dans des délais d'ailleurs brefs. La doctrine étant mal établie, les pratiques diffèrent selon les tribunaux et les parquets. Le ministère des affaires étrangères est très favorable à ce que l'on permette expressément l'action du ministère public en cas de mariage contracté sans le consentement libre des époux ou de l'un d'eux. Accessoirement, nous préconisons aussi de modifier l'article 63 du code civil pour permettre qu'enfin l'officier de l'état civil puisse exiger la preuve de l'identité des conjoints ; car il arrive, même en France, que soient célébrés des mariages où le conjoint physiquement présent n'est pas celui dont l'identité figurera sur l'acte... Le ministère est aussi favorable à la création d'une incrimination spécifique, le délit de « contrainte à mariage ». Cette proposition figure dans le rapport du groupe de travail « Femmes de l'immigration » constitué en son temps par le ministre de la justice et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, et auquel nous avons participé. Et si pénalisation il y a, il faut naturellement que la loi pénale française soit applicable aussi lorsque la victime est une femme étrangère résidant en France. La complicité doit également être abordée. La loi du 26 novembre 2003 a déjà créé un délit pour les mariages de complaisance. Or, le mariage forcé est une atteinte beaucoup plus forte à notre ordre juridique, même s'il est sans doute moins fréquent : il touche aux droits fondamentaux de la personne et viole des principes à valeur constitutionnelle. Certes, cette nouvelle incrimination sera difficile à définir, mais je sais que d'éminents juristes de la Chancellerie s'y sont attelés. Le ministère est d'autre part attaché à l'aspect symbolique de la loi et à son effet pédagogique ; il considère donc qu'il serait bon d'inscrire explicitement dans le code pénal que le mariage forcé est interdit. Cela peut donner plus d'atouts aux jeunes filles dans leurs « négociations » familiales, et aussi aider l'administration. Nous sommes en effet consternés de voir que sur notre sol, par exemple à l'aéroport d'Orly, qui n'est pourtant pas un lieu où la police pénètre avec difficulté, il faut ruser, avec l'aide de la police aux frontières, pour éviter le contact des jeunes filles rapatriées avec leurs familles. Autrement dit, l'État doit se cacher devant les coupables ! Si répression il devait y avoir, elle devra être médiatisée. Enfin, ce qui est interdit doit être sanctionné, et les peines doivent pouvoir déstabiliser les calculs économiques, patrimoniaux et migratoires qui sous-tendent les mariages forcés. Car l'on ne peut taire que, s'il y a de l'identitaire et du culturel dans les mariages forcés, de sordides considérations matérielles entrent aussi en jeu. La quatrième mesure préconisée par le ministère est le renforcement du contrôle de la sincérité et de la liberté des intentions matrimoniales pour les mariages célébrés à l'étranger. Nous disposons actuellement de deux outils de lutte contre les mariages simulés et les mariages forcés : d'une part les auditions, d'autre part les signalements au parquet lors des demandes de transcription des actes étrangers de mariage. Les auditions séparées, voire répétées, après mise en confiance de la jeune fille, en cas de suspicion de mariage forcé, constituent un moment critique pour détecter un tel mariage. Cette faculté créée par la loi du 26 novembre 2003 a eu des effets dans certains consulats, mais tout porte à croire que les stratégies se sont adaptées à ce nouvel obstacle. Pour tirer les conséquences des auditions, le deuxième outil à notre disposition est l'article 170-1 du code civil qui prévoit, à l'initiative du consul, un sursis à la transcription et le signalement au parquet. Le ministère des affaires étrangères n'est pas entièrement satisfait de la rédaction de cet article et, jusqu'à un passé récent, il ne l'était pas de son application. En effet, le ministère public dispose de six mois pour se prononcer et, s'il ne le fait pas, la transcription est de droit. Or, cette disposition était diversement appliquée par les parquets de métropole qui, dans un nombre important de cas, ne se prononçaient pas. Nos consulats en retiraient l'impression de n'être pas soutenus. En fait, la situation était plus complexe, comme l'a montré l'atelier sur les mariages simulés organisé lors de la conférence des ambassadeurs. Le problème, dû à l'absence de centralisation, a été réglé après que le parquet de Nantes a été rendu compétent pour tous ces contentieux et que ses moyens ont été renforcés. Cependant, le problème juridique de la charge de la preuve demeure. Nos consuls peuvent avoir des soupçons, voire des convictions, mais il reste à savoir si le tribunal jugera le dossier assez probant pour annuler le mariage, qu'il faudra du reste avoir transcrit pour pouvoir l'annuler. On constate, en pratique, un faible taux à la fois de poursuites en annulation et d'annulations elles-mêmes. Il faudrait aller plus loin, notamment en instituant des contrôles préalables au mariage à l'étranger, afin de mieux s'opposer ultérieurement aux transcriptions d'unions douteuses. Un projet très avancé est en cours, préparé en collaboration avec la Chancellerie. Pour intervenir avant même le mariage étranger et procéder à des auditions dissuasives ou préventives, il convient de réactiver l'exigence faite à tout Français désirant se marier devant une autorité étrangère de détenir un certificat de capacité matrimoniale, dont la délivrance doit être subordonnée non seulement à la remise d'un dossier complet sur son projet de mariage et à la publicité des bans, mais aussi à la tenue d'auditions des futurs époux, entendus ensemble ou séparément. Ces dispositions existent déjà, mais notre droit ne les assortit d'aucune sanction ou conséquence, sauf preuve établie de fraude à la loi. Le non-respect de ces formalités n'empêchera pas, en général, le mariage devant l'autorité étrangère. La nouveauté pourrait être que, si ces formalités préalables au mariage n'ont pas été respectées, notamment les auditions, et en particulier celle de la future épouse, la transcription ne serait plus de droit. Sur saisine du consulat, le défaut de réponse du procureur ou son opposition dans les six mois interdirait la transcription, sauf à ce que les époux prennent eux-mêmes l'initiative de saisir le tribunal pour qu'il statue sur la validité du mariage ; on renverserait ainsi la rédaction actuelle de l'article 170-1, dont j'ai dit en quoi elle ne nous satisfait pas. Enfin, pourrait aussi être affirmé dans le code civil le principe que le mariage à l'étranger d'un Français doit être transcrit pour produire des effets en droit français. Je me dois de souligner en conclusion que l'action à l'étranger contre les mariages forcés et les réformes normatives ne seront jamais suffisantes. C'est en France - où, d'ailleurs, des mariages forcés se produisent aussi -, auprès des populations concernées, que se trouvent les enjeux décisifs de la lutte contre les mariages forcés menaçant les jeunes filles, françaises ou étrangères. Les mariages forcés ne sont pas un nuage dans un ciel serein. Ils participent d'un « continuum » de violence, d'exclusion, de négation des droits, de repli communautaire. Là est le vrai champ de bataille, qui met en jeu la politique d'intégration, l'institution scolaire - seul vrai espace de liberté, mais aussi acteur -, les travailleurs sociaux et leur formation, les mesures de protection, d'hébergement, d'éloignement et de prise en charge, le soutien aux associations, les campagnes d'information ou de prévention, la redécouverte de ce que devient en réalité le pays d'origine - qui n'est peut-être ni tel qu'on le rêve, ni tel qu'on le cauchemarde -. On pourra rêver de faire toujours mieux pour traiter les risques de mariages forcés et les conséquences de ces mariages pour les victimes, mais ces « missions de pompiers » seraient plus efficaces s'il y avait moins de pyromanes. Mme Marie-Thérèse Coulon : Le parquet de Nantes est particulièrement concerné par la question des mariages forcés, puisque le procureur de la République près le tribunal de grande instance a une compétence nationale spécifique, liée à la présence à Nantes du service central d'état-civil qui relève du ministère des affaires étrangères. Y sont conservés notamment les actes d'état-civil concernant les Français qui sont nés, se sont mariés ou sont décédés à l'étranger, ainsi que les actes d'état-civil des étrangers nés à l'étranger et qui ont acquis la nationalité française. En tant qu'autorité de tutelle des postes consulaires à l'étranger, puisque les consuls sont officiers de l'état-civil, le procureur de la République de Nantes est amené à vérifier la régularité des actes et décisions étrangères en matière d'état-civil qui peuvent avoir des effets juridiques en France et être transcrits sur les registres français d'état-civil. Il en est ainsi des mariages célébrés à l'étranger devant l'autorité locale compétente lorsque l'un des conjoints est français. Le procureur de la République de Nantes peut donc être informé de l'existence de mariages forcés. L'une des premières difficultés sera, pour l'autorité judiciaire, de définir ce qu'est un mariage forcé, puisque la notion n'existe pas dans le code civil, non plus que les notions de mariage simulé, de complaisance, blanc ou arrangé. Derrière le mariage forcé, je perçois deux types de mariages : le mariage extorqué par violence, contrainte ou menace de la part du futur conjoint ou de la famille, et le mariage imposé à une adolescente, parfois très jeune, que son immaturité rend incapable de comprendre la signification de l'engagement du mariage. Selon ce dont il s'agit, deux notions juridiques distinctes se font jour. Dans le premier cas, il existe un consentement, mais il est vicié en raison de la violence exercée pour l'obtenir ; dans le second cas, il y a absence de consentement, faute de discernement chez celle ou celui qui est réputé avoir consenti. Je rappelle que ce qui permet d'affirmer la validité d'un mariage, c'est le libre échange des consentements donnés en vue d'une communauté de vie affective et matérielle au cours d'une cérémonie publique, l'officier de l'état-civil étant chargé de veiller à ce que les consentements soient librement échangés. Comme il n'y a pas de définition de ce qu'est le consentement au mariage, il est nécessaire de se référer à la théorie des consentements dans le droit des contrats, car le mariage est aussi un contrat. Selon cette théorie, le consentement est valable lorsque il n'est pas vicié par la violence, la fraude ou l'erreur. En matière de mariage, le ministère public peut poursuivre 1'annulation de mariage lorsqu'il y a absence de consentement, l'article 146 du code civil établissant qu'« il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Mais la poursuite de l'annulation du mariage en cas de vice du consentement ne peut être engagée que par les époux ou par l'un d'eux, puisque, en application de l'article 180 du code civil, le ministère public n'est pas fondé à agir d'office. La frontière entre l'absence de consentement et l'existence d'un consentement qui n'est pas libre est ténue, si bien que, en l'état des textes, il n'est pas exclu qu'un tribunal déboute le ministère public d'une action dont il aurait seul pris l'initiative pour faire annuler un mariage imposé par violence à l'un des conjoints. Une réforme législative autorisant expressément le ministère public à agir au titre de l'article 180 permettrait donc une action plus efficace de la justice civile contre ces mariages. Le ministère public prenant rarement l'initiative de faire annuler le mariage, le mariage forcé demeure mal connu de l'institution judiciaire, et en tout cas peu repérable par celle-ci. Très peu nombreux sont les dossiers qualifiés de mariages forcés, et je suis surprise que l'on avance le nombre de 70 000 mariages forcés en France. Cependant, le ministère public n'est quand même pas dépourvu de moyens juridiques, puisqu'il peut agir d'office pour ce qui concerne les causes objectives de nullité absolue du mariage. Il en est ainsi, conformément à l'article 146-1 du code civil, lorsque le conjoint français n'a pas comparu à la célébration du mariage et y était représenté par un mandataire. En effet, l'absence de comparution lors de l'échange des consentements ne permet pas de s'assurer de l'existence de celui-ci. J'ai ainsi délivré, hier, une assignation tendant à faire annuler un mariage célébré en Egypte auquel l'épouse franco-égyptienne, âgée de seize ans et domiciliée dans la région parisienne, était représentée par son père. Il n'est pas exclu qu'un tel mariage puisse être un mariage forcé, mais il est attaqué sous l'angle du défaut de comparution. Toutefois, un tel mariage reste valable à l'étranger même s'il n'a pas d'effet en France, et, s'il s'agit effectivement d'un mariage forcé, une action pour protéger l'épouse sera très difficile à mener si celle-ci ne réintègre pas le territoire français. Il faut aussi noter que la représentation du conjoint étranger par un mandataire lors du mariage, lorsque sa loi personnelle en prévoit la possibilité, n'affecte pas la validité du mariage. Je rappelle qu'au nombre des autres causes « objectives » pour lesquelles le parquet peut agir d'office en nullité figure le non-respect de l'âge minimum requis pour se marier. À ce sujet, je suis favorable au relèvement de l'âge légal du mariage des filles, proposé aussi bien par le Sénat que par le Médiateur de la République et la Défenseure des enfants. Une question se posera : faut-il en faire une obligation d'ordre public et interdire le mariage d'un Français avec un étranger âgé de moins de dix-huit ans ? D'autres causes de nullité sont le non-respect des empêchements au mariage en raison de liens familiaux, ou encore la bigamie que ferait naître le nouveau mariage de l'un des conjoints. La loi du 26 novembre 2003 peut, d'une certaine manière, faciliter la détection des mariages de complaisance ou des mariages imposés à l'un des conjoints puisque le Parlement a modifié les articles 63 et 170 du code civil et prévu le principe d'une audition préalable, commune ou séparée, des futurs conjoints soit par les officiers de l'état-civil qui doivent célébrer le mariage en France, soit par les agents consulaires à l'étranger lors du dépôt du dossier de mariage, de la délivrance du certificat de capacité à mariage - en principe obligatoire pour tout Français désirant se marier à l'étranger - ou de la demande de transcription d'un acte de mariage étranger sur les registres français de l'état-civil. L'objet de l'audition est de pouvoir détecter le défaut d'intention matrimoniale, qu'il découle de l'absence de discernement ou de ce que l'objectif recherché est autre que l'union matrimoniale - par exemple, un but migratoire -. L'officier de l'état-civil ou l'agent consulaire peut toutefois se dispenser de cette audition lorsqu'elle est impossible pour des raisons matérielles ou lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire au regard de l'article 146. L'objet de l'audition apparaît donc strictement limité au cadre fixé par cet article. Mais si, lors de l'audition, commune ou séparée, l'officier de l'état-civil ou l'agent consulaire s'aperçoit que l'un des époux fait l'objet de pressions, il pourra tenter de le dissuader de poursuivre le projet de mariage et, s'il a connaissance d'un délit, le dénoncer au parquet compétent. Deux difficultés empêchent que ces auditions aient une action réellement efficace au regard des mariages forcés. En premier lieu, leur objet est limité à vérifier si les conditions prévues par l'article 146 sont réunies ; à ce sujet, peut-être faudrait-il rechercher non seulement l'existence d'un consentement, mais vérifier si celui-ci n'est pas vicié. Par ailleurs, l'audition par un officier de l'état-civil particulièrement vigilant - et qui ait le temps d'y procéder, ce qui conduit à se demander s'il ne serait pas judicieux, en effet, de permettre la délégation de la réalisation des auditions à des agents municipaux - peut dissuader des candidats au mariage de poursuivre leur projet dans la commune. Tout aspirant au mariage un peu astucieux peut alors fixer sa résidence dans une autre commune pendant un mois et déposer un nouveau projet de mariage. En l'absence de fichier national des projets de mariage et surtout des oppositions à mariage, l'officier d'état-civil du lieu de la nouvelle résidence n'aura connaissance ni du précédent projet, ni des raisons pour lesquelles il a été suspendu. En l'état, je peux vous indiquer que les auditions sont réalisées à l'étranger par les consulats lorsqu'ils ont un doute sur l'intention matrimoniale, notamment dans les pays où les mariages à but migratoire sont les plus fréquents. Des instructions ont été données aux postes consulaires par le ministère des affaires étrangères, en liaison avec le parquet de Nantes, pour inviter les agents consulaires à obtenir des informations détaillées sur le mariage projeté. L'expérience progressivement acquise par les agents consulaires et les officiers de l'état-civil au cours de ces auditions pourrait utilement être mise à profit pour repérer tout mariage susceptible d'annulation et notamment les mariages forcés. Mais je n'ignore ni les moyens considérables dont il faudrait doter les postes consulaires et les services municipaux pour permettre le déroulement de ces auditions, ni les difficultés d'ordre juridique que pourrait poser l'accroissement du contrôle des pouvoirs publics sur la liberté de se marier, liberté affirmée par l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, garantie par notre Constitution et réaffirmée par le Conseil constitutionnel. Encore faut-il aussi que, si ces auditions deviennent systématiques, le conjoint qui subit une contrainte morale ou physique se sente suffisamment en confiance pour la révéler. On peut faire ici le parallèle avec les difficultés rencontrées pour recueillir la parole des enfants maltraités ou des femmes battues. Il convient aussi de rechercher des moyens adaptés pour garantir la protection des jeunes femmes mariées à l'étranger et entendues dans les postes consulaires à l'étranger, et au besoin pour faciliter leur rapatriement si elles sont bi-nationales. De retour en France, le mariage, non transcrit, fera l'objet d'une enquête civile en vue de la saisine du tribunal de grande instance à fin d'annulation, et éventuellement d'une enquête pénale sur les infractions susceptibles d'être reprochées à l'entourage : violence, séquestration, enlèvement, agressions de nature sexuelle, menaces sous condition, organisation d'un mariage à finalité migratoire. Il convient donc de prévoir des structures pour protéger, mettre à l'abri en cas d'urgence et aider des femmes souvent très jeunes qui, pour avoir osé parler, se trouvent isolées et risquent de se retrouver en grande précarité dans une société souvent peu encline à reconnaître leur différence. En conclusion, il me parait nécessaire de donner au parquet les moyens juridiques de mieux agir en annulation des mariages forcés en lui permettant d'agir au titre de l'article 180 du code civil. Par ailleurs, les auditions dans les mairies ou les consulats doivent permettre de mieux détecter des projets de mariage forcé et éventuellement révéler des comportements pénalement répréhensibles. Ne conviendrait-il pas de créer un fichier national des oppositions à mariage ? Enfin, la meilleure protection des jeunes filles, particulièrement exposées à ce type de mariage, passe par un travail d'information sur leurs droits et de prévention auprès de leurs familles. Mme Myriam Bernard : L'approche du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), que je représente, est d'ordre sociologique. Je souhaite pour commencer revenir sur le nombre avancé de 70 000 mariages forcés, sur lequel chacun s'est interrogé à juste titre. Je puis vous en donner l'origine exacte : une association, le Groupe des femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles, s'étant penchée sur le comportement de trois ethnies originaires d'Afrique subsaharienne relatif aux mariages forcés, a obtenu ce nombre en extrapolant ses découvertes aux mineures issues de ces trois ethnies présentes au sein de l'éducation nationale... Autant dire que cette évaluation est sans aucune valeur scientifique. Il faut absolument améliorer la connaissance du phénomène, car on parle de ce sujet en fonction de représentations, et ces représentations font problème, car elles contribuent à stigmatiser le « mauvais étranger », le « mauvais immigré », en l'occurrence le « mauvais musulman » et singulièrement le « mauvais homme musulman », puisque la pratique du mariage forcé est pour beaucoup celle de familles du Maghreb, de pays d'Afrique subsaharienne de confession musulmane et de Turquie. La plus grande prudence s'impose donc, comme le montrent les conclusions de deux études subventionnées par le FASILD. L'une, conduite par M. Altan Gökalp, porte sur des jeunes gens originaires notamment de Turquie qui, par le biais du regroupement familial, rejoignent des jeunes femmes d'origine turque nées et installées en France. L'autre traite des mariages arrangés dans la communauté maghrébine de Bretagne. Les deux études montrent que, certes, le phénomène du mariage forcé existe, mais que son interprétation demande de multiples précautions, les stratégies matrimoniales étant complexes. Elles obéissent très souvent, c'est vrai, à des considérations économiques - faire venir des jeunes gens pour qu'ils bénéficient de meilleures conditions de vie -, mais il est troublant de constater qu'il peut aussi s'agir d'une stratégie décidée par des jeunes filles qui, ne se sentant pas bien intégrées dans la société française, préfèrent prendre un conjoint dans le pays d'origine de leur parents, dont elles considèrent qu'il a « la même identité » qu'elles. C'est ce qui ressort en particulier de l'étude d'Altan Gökalp : beaucoup des jeunes filles interrogées expliquent qu'elles ne sont pas victimes de mariages forcés, mais qu'il s'agit de mariages arrangés auxquels elles ont consenti. Il faut donc prendre garde à toujours distinguer mariage forcé et mariage arrangé. Par ailleurs, il faut agir en formant tous les acteurs concernés : personnels de l'éducation nationale et travailleurs sociaux, mais aussi les associations qui ne sont pas toujours sensibilisées à ces questions. Tous doivent apprendre à détecter les signes qui peuvent faire penser à un vice de consentement au mariage. Une rupture scolaire et un absentéisme doivent particulièrement appeler l'attention. Il convient aussi d'informer les parents et les jeunes eux-mêmes. À cet égard, le contrat d'accueil et d'intégration est une bonne mesure, mais il pourrait être renforcé de manière que, dès leur arrivée sur le territoire français, les immigrants comprennent la valeur du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'éducation nationale et les associations doivent aussi s'attacher à informer les jeunes filles de leurs droits. Pour ce qui est précisément des mariages forcés, je me dois de souligner le risque que constituent les « vacances au bled » : des jeunes filles partent prétendument en congé, mais on éprouve ensuite des difficultés extrêmes à les rapatrier. Certaines associations ont rédigé un fascicule où sont rappelés les droits de ces femmes, et répertoriés différents numéros d'urgence qui peuvent leur être d'une grande aide lorsqu'elles se retrouvent à l'étranger isolées et démunies. Cela m'amène à dire le rôle irremplaçable des associations, et à souligner d'un même élan que l'action qu'elles mènent trouve assez vite ses limites. En effet, lorsqu'une jeune fille souhaite rompre avec sa famille - ce qui est un acte de grand courage qui aura pour conséquence qu'elle se trouvera ensuite seule dans une société qui n'est pas toujours ouverte à la différence -, elle éprouve des difficultés considérables pour se loger et trouver un emploi. J'observe enfin que près de 70 % des signataires des contrats d'accueil et d'intégration sont des conjoints de Français. Si l'on veut que ces jeunes gens vivent selon les valeurs de la République, ils doivent pouvoir quitter leurs parents et, en particulier des belles-mères qui peuvent être oppressives, pour mener une vie de couple autonome. Cela suppose aussi des aides au logement et à l'emploi. M. Pierre-Louis Fagniez : J'ai constaté que les orateurs ne partagent pas tous le même point de vue. Pour ce qui me concerne, il m'est indifférent de savoir quel est le nombre exact des mariages forcés recensés ou évalués, car un seul mariage forcé est un mariage en trop. Aussi, j'aimerais savoir quelle définition du mariage forcé vous voudriez voir figurer dans le code civil. M. le Président : Pourquoi la France n'a-t-elle pas ratifié la Convention de 1962 sur le consentement au mariage, l'âge minimum au mariage et l'enregistrement des mariages qu'elle a signée en décembre 1962, qui est entrée en vigueur deux ans plus tard et à laquelle 51 États sont aujourd'hui parties ? M. Jean-Louis Zoël : Selon moi, le seul obstacle à la ratification vient de ce que ce texte reconnaît le mariage par procuration, fondamentalement contraire à notre ordre public. Cela étant, il convient d'apprécier avec la Chancellerie si la France ne pourrait pas, comme l'ont fait d'autres États, ratifier la convention en exprimant une réserve sur le deuxième alinéa de l'article 1er. M. le Président : Nous pourrions peut-être proposer que la France ratifie la Convention de 1962 en exprimant cette réserve, comme l'ont fait d'autres États dont le droit n'admet pas le mariage par procuration. Mme la Rapporteure : Afin de lever les difficultés pratiques auxquelles se heurte la réalisation des auditions, notamment lorsque l'un des futurs époux est en France et l'autre à l'étranger et que le mariage doit être célébré en France, vous semble-t-il souhaitable d'assouplir la compétence exclusive de l'officier de l'état-civil chargé de célébrer le mariage ou de l'agent diplomatique ou consulaire chargé de le transcrire ? Que pensez-vous des propositions de la Défenseure des enfants et du Médiateur de la République, tendant d'une part à permettre à l'officier de l'état-civil compétent de demander la réalisation de l'audition à un agent consulaire français dans le pays de résidence du futur époux, d'autre part à autoriser les officiers de l'état-civil et les agents consulaires à déléguer la réalisation de l'audition à un fonctionnaire de leur service ? Par ailleurs, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a évoqué devant notre Mission toute l'importance symbolique et pédagogique qu'il y aurait à abroger l'article 1114 du code civil selon lequel « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat ». Qu'en pensez-vous ? Mme Marie-Thérèse Coulon : Pour ce qui est des auditions, il est vrai qu'il est difficile aux officiers de l'état-civil de tout faire ; il serait donc bon qu'ils puissent déléguer cette tâche lorsqu'ils reçoivent les dossiers de mariage. Il est vrai aussi que si le futur époux demande un visa, il n'est pas certain qu'il l'obtienne. Mais, d'autre part, il est préférable que la même personne puisse recevoir les deux futurs conjoints, car il est intéressant de pouvoir apprécier leur comportement lors des auditions communes et séparées. Quoiqu'il en soit, en règle générale, mieux vaudrait permettre des délégations que d'invoquer l'impossibilité géographique ou matérielle pour ne pas procéder à des auditions fort utiles. M. Jean-Louis Zoël : Le ministère des affaires étrangères partage l'opinion du parquet de Nantes : il faut prévoir une possibilité de délégations croisées entre officiers de l'état-civil et agents consulaires, à condition de ne pas en abuser. Il est en effet important de pouvoir recouper les auditions. Mais nous serions d'accord sur l'assouplissement de la législation, d'ailleurs envisagée avec la Chancellerie. Mme Edwige Rude-Antoine : Je partage l'avis exprimé par M. Fagniez : peu importe le nombre de mariages forcés, il n'en faudrait aucun. Mais le phénomène n'est pas une pratique limitée à une région du monde : il touche l'ensemble des pays industrialisés et, en tout cas, les vingt-huit pays que j'ai étudiés. Je souligne que la question concerne également les garçons, et que le phénomène n'est pas en lien direct avec l'islam : on trouve des mariages arrangés en Asie, en Inde, dans des familles venues de pays non musulmans. Des enquêtes quantitatives sur ce phénomène sont difficiles à réaliser. Ce qui est nécessaire, en revanche, c'est de connaître les politiques, les dispositifs et les actions mises en place, qui ne sont pas les mêmes selon les pays, de connaître les motivations poursuivies qui diffèrent selon que les familles sont issues de la campagne ou des grandes villes. Il faut aussi apprécier les conséquences des mariages forcés, par exemple sur la santé. En résumé, il faut connaître les pratiques juridiques, sociales, sans ignorer par exemple que les différents parquets et les différents consulats ne procèdent pas tous de la même manière, si bien que, sur un même territoire, il n'y a pas d'unité de traitement d'un même problème. Il est impératif d'approfondir le phénomène dans ses aspects politiques, sociologiques et économiques. J'ai observé par ailleurs qu'aucun pays étudié n'a donné de contenu juridique à la notion de mariage forcé. S'il n'y a aucun problème de définition lorsqu'il existe une atteinte à la liberté du consentement par la violence physique, dans les autres situations toute la difficulté est d'apprécier la volonté interne, les phénomènes psychologiques, parce que la volonté déclarée au moment de l'acte de mariage ne consiste pas seulement dans les termes qui l'expriment mais dépend des circonstances ambiantes d'où elle est issue et auxquelles elle se rattache. Comment mesurer la crainte, qui peut neutraliser toute velléité de résistance à un mariage forcé ? Quelles preuves peut-on avoir de la menace morale, aussi fourni que soit l'arsenal juridique ? Comment apprécier la maturité psychologique des adolescentes ? Comment une toute jeune fille peut-elle s'opposer à sa famille ? Chacun comprendra la difficulté de l'exercice, qui consiste à s'interroger sur la volonté et la liberté réelles du choix du conjoint. La législation française traite désormais du mariage de complaisance par référence à l'intention matrimoniale. Mais, en pratique, les juges se réfèrent à des critères qui diffèrent très fortement d'un tribunal à l'autre et, trop souvent, on met en avant la notion de mariage de complaisance sans tenir compte du fait qu'un mariage de complaisance peut masquer un mariage forcé. Il y a là une vraie difficulté. Mme Clotilde Lepetit : Il ne peut y avoir de définition juridique du mariage forcé, notion qui découle uniquement des articles du code civil existants, à savoir l'article 146 - absence de consentement - et l'article 1111 - vice du consentement -. On ne peut le définir mieux. Mme Virginie Larribau-Terneyre : Il appartient au juge d'apprécier, au cas par cas, en fonction des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont fournis, s'il y a eu ou non atteinte à la liberté ou inexistence du consentement. Il faut faire confiance au juge, gardien des libertés individuelles. Je peux ainsi citer une décision où l'on a retenu la violence parce que l'épouse avait été soumise à une pression familiale, à une contrainte morale dont elle ne pouvait s'affranchir du fait de sa culture et de sa religion. On apprécie ainsi un climat qui peut peser sur le consentement. J'aimerais répondre également à propos de la crainte révérencielle envers père et mère, qui renvoie à la théorie générale des contrats, alors qu'il existe un article spécifique pour le mariage : l'article 180 du code civil. Ce texte ne parle d'ailleurs pas directement de violence, mais de liberté du consentement. Toutefois, l'atteinte à la liberté du consentement renvoie bien au vice de violence de la théorie générale des contrats. Comme on dispose d'un texte spécifique, le juge peut ne pas tenir compte de la règle générale. Mais il peut aussi se référer à la crainte révérencielle mentionnée par le code civil pour apprécier ce qu'est une violence de nature à porter atteinte à la liberté du consentement. Autant ôter cette disposition désuète. M. Alain Vidalies : Les avis divergent sur la possibilité ou non de créer une infraction pénale autonome. Pourtant, nous sommes tous d'accord : même s'il n'y avait qu'un seul cas de mariage forcé, il mériterait de recevoir une réponse adaptée. À partir du moment où nous nous trouvons dans l'incapacité de trouver une définition, on ne saurait édicter d'incrimination, même s'il est tentant de le faire. En outre, la frontière avec le mariage de complaisance étant ténue, on peut craindre que des poursuites pénales soient engagées dans un sens qui ne correspondrait pas à l'objet de notre discussion. Mme la Rapporteure : J'ai un avis radicalement opposé à celui d'Alain Vidalies. Plutôt que de se concentrer sur la définition du mariage forcé, ce qui semble très difficile, ne vaudrait-il pas mieux, comme l'a suggéré la Défenseure des enfants, se focaliser sur le délit spécifique de pression en vue du mariage ? Cette forme de violence, non spécifiée dans le code pénal aujourd'hui, ne serait pas nécessairement brutale, ne serait pas forcément constituée par une séquestration ou un viol. Et il serait inutile de préciser l'auteur de cette pression, dans la mesure où il peut s'agir des parents ou de l'époux. L'expression « pression en vue du mariage » semble avoir l'avantage de ne pas être stigmatisante et de refléter assez bien la réalité. Mme Clotilde Lepetit : Est-ce que cela ne rentre pas déjà dans l'incrimination de menace sous condition ? Mme la Rapporteure : La notion de menace sous condition est floue. Mme Gaye Petek : Il existe bien une définition du mariage forcé, même si elle est vague. On y prend en compte la contrainte et le consentement sous contrainte. L'exercice ne me semble pas si difficile. Je suis tout à fait d'accord avec M. Fagniez s'agissant du chiffrage. Le nombre de 70 000 était celui que les associations avaient produit, notamment devant le Haut conseil à l'intégration. Je peux vous dire que l'association que je dirige reçoit à peu près cinq à six cas par semaine, et qu'il s'agit uniquement de Turques. Mais, quel que soit le nombre, il faut traiter le phénomène. J'ai envie de réagir aux propos de Mme Bernard : nous avons perdu douze ans depuis le moment où les associations ont commencé à parler des mariages forcés aux pouvoirs publics, notamment au service des droits des femmes ou au FASILD, structures plus proches des associations s'occupant de femmes issues de l'immigration. Pendant douze ans, on nous a dit : attention, ne stigmatisez pas ! Et il a fallu que le sujet soit mal traité par une presse plus soucieuse de sensation que d'analyse pour qu'on commence à s'y intéresser. Pourtant, s'il y a souffrance, je n'hésite pas à stigmatiser ! Nous autres, qui sommes des associations issues de l'immigration, moi-même qui suis d'origine turque, ne sommes pas dérangées de stigmatiser des parents ou des conjoints qui font souffrir des individus. Nous avons beaucoup parlé des femmes et des jeunes filles. J'admets que l'affaire est plus complexe. Dans la communauté turque, par exemple, de nombreux garçons sont tenus d'épouser quelqu'un qu'ils n'ont pas choisi. Vous parlez des sociologues. Mais ceux-ci font des constats sur la base d'enquêtes dont les échantillons ne sont pas représentatifs. J'ai lu une enquête sur des Turcs, qui étaient originaires, pour 60 % d'entre eux, du groupe alevi, branche hétérodoxe de l'islam turc. Cela ne pouvait que fausser les données. Par ailleurs, la façon de construire les échantillons ne me paraît pas toujours très efficace. On a vu ce que cela a donné dans les études consacrées aux banlieues. Bref, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Ce ne sont pas des pratiques liées à l'islam, mais l'islam renforce ces pratiques coutumières archaïques. Ensuite, il faut tout faire pour tenter de changer les mentalités, et pas uniquement le droit. Dans le droit, ce qu'il faut, c'est que les choses soient écrites. C'est pourquoi tout traitement au cas par cas me laisse dubitative. Un énoncé juridique est seul à même de nous aider à informer les personnes et à mener des actions pédagogiques vis-à-vis des auteurs de ce type de pratiques. M. Jean-Louis Zoël : J'ai indiqué que le ministère des affaires étrangères était favorable à la pénalisation du mariage forcé. J'ai cité une proposition qui consistait à créer un délit de contrainte au mariage, mais pas à définir le mariage forcé. J'ai eu connaissance d'une proposition rédigée par la direction des affaires criminelles et des grâces, qui semble penser qu'on peut définir un tel délit. Il ne s'agissait pas de plus que cela. Quant à savoir si c'est opportun, c'est au Parlement d'en décider. Il conviendrait, éventuellement, d'auditionner les personnes qui prétendent avoir pu définir le mariage forcé. Je ne suis pas pénaliste et je ne peux pas m'avancer au-delà. Mme Edwige Rude-Antoine : D'autres pays ont pénalisé le mariage forcé et en ont donné une définition. La Norvège et l'Allemagne ont créé une infraction spécifique. La définition adoptée par la Norvège est intéressante : « Quiconque force quelqu'un à conclure un mariage en ayant recours à la violence, à la privation de liberté, à des pressions indues, ou en ayant un autre comportement illicite ou en menaçant d'avoir un tel comportement, est condamné pour mariage forcé ». Ce mariage forcé est puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six ans. Et le complice encourt la même peine. En Allemagne, le code pénal vient d'être modifié, le 19 février 2005. Le mariage forcé est considéré comme un cas de contrainte particulièrement sérieuse « pour entrer dans le mariage ». Tous les autres pays font appel à des infractions de droit commun pour sanctionner pénalement le mariage forcé. Mme Virginie Larribau-Terneyre : On n'est pas forcé d'appréhender la réalité du mariage forcé de la même façon en droit civil et en droit pénal. Pour créer une infraction pénale, on n'est pas forcé d'utiliser le terme de mariage forcé et d'en trouver une définition, la réalité étant très nuancée. Au civil, on peut sanctionner en s'appuyant sur le manque de liberté du consentement et, au pénal, on peut décrire une série de comportements qui consistent à faire pression sur un individu pour qu'il donne son consentement : pressions, menaces, violence physique, abus d'autorité. Les concepts du droit civil ne sont pas les mêmes que ceux du droit pénal, les deux matières étant autonomes. Mme Gaye Petek : J'ai oublié tout à l'heure de revenir sur la question du mariage de complaisance, notamment tel qu'il est présenté dans la loi de novembre 2003. Il faut être très vigilant, et ne pas utiliser de manière arbitraire ces notions de mariage de complaisance, de mariage blanc ou de contournement de la réglementation des étrangers. Dans la très grande majorité des mariages contraints, il n'y a pas de problématique de contournement de la réglementation des étrangers, sauf lorsque certaines familles marient leur fille pour qu'un neveu, par exemple, puisse obtenir un titre de séjour. Cela existe, mais ce n'est absolument pas la majorité des cas. On a tendance à confondre les notions de mariage contraint et de mariage de complaisance. Cela nous désole, car c'est donner une fausse image aux Français. Chacun d'entre nous doit pouvoir travailler sur le sujet en toute conscience et en toute connaissance de cause. Les mariages forcés visent davantage à contraindre la liberté de certains individus, en empêchant leur intégration en tant que futurs citoyens français, qu'à contourner la réglementation des étrangers pour obtenir un titre de séjour. M. le Président : Définir ou ne pas définir, telle est la question qui nous est posée... Merci à tous pour ce débat riche et passionnant. Table ronde ouverte à la presse sur l'adoption réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous avons le plaisir, dans le cadre de cette table ronde consacrée à l'adoption, d'accueillir six intervenants : - Mme Frédérique Granet, vous êtes professeur de droit à l'université de Strasbourg-III, et spécialiste du droit des personnes et de la famille ; - Mme Janice Peyré, vous présidez l'association Enfance et familles d'adoption, qui fédère 90 associations départementales regroupant 10 000 familles ; - Mme Martine Gross, vous êtes ingénieur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, vous avez présidé l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'homoparentalité, dont Fonder une famille homoparentale qui vient de paraître ; - M. Jean-Marie Muller, vous présidez la Fédération nationale des associations départementales d'entraide aux pupilles et anciens pupilles de l'État, qui est l'un des interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics en matière de droit de l'adoption ; - Mme Nadine Pinget, vous êtes présidente du Mouvement pour l'adoption sans frontières ; - M. Pierre Lévy-Soussan, vous êtes pédopsychiatre et vous assurez des consultations au Centre médico-psychologique pour l'enfant et la famille à Paris ; - M. Robert Neuburger, vous êtes psychiatre, thérapeute du couple et de la famille à Paris, et membre de la Société française de thérapie familiale. Comme vous le savez, notre Mission organise une série de tables rondes thématiques sur le droit de la famille. Nous avons en effet décidé d'examiner l'organisation juridique de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, afin de vérifier si les droits de l'enfant sont suffisamment garantis par notre législation. Je vais donc vous inviter à répondre à la question suivante : l'intérêt de l'enfant justifie-t-il de modifier les conditions requises pour adopter ? Mme Frédérique Granet : Je vais tenter de répondre à la question centrale que vous nous avez posée, en me situant uniquement du point de vue de l'intérêt de l'enfant. J'avais envisagé de confronter l'état actuel du droit positif français, d'une part, aux revendications de certains couples ou de personnes seules souhaitant fondant une famille, et, d'autre part, aux réalités des législations en vigueur dans les autres pays européens. Dans un souci de brièveté, je n'aborderai ici que le premier aspect. Faut-il revenir sur l'ouverture de l'adoption aux célibataires, ou faut-il au contraire prévoir des dispositions spécifiques pour autoriser l'adoption par un célibataire homosexuel ? Je précise tout d'abord que l'adoption par une personne seule ne vise pas seulement une personne célibataire, mais aussi bien un époux qui adopte seul un enfant, un veuf ou une veuve, ou encore une personne divorcée. Dans ce contexte, je pense que l'adoption par une personne seule mérite d'être maintenue dans les textes, dans la mesure où elle peut servir l'intérêt d'un enfant, y compris, mais pas seulement, dans le cas d'une adoption intra-familiale. Le tribunal saisi d'une requête apprécie souverainement l'opportunité de l'adoption pour l'adopté. Il peut ainsi écarter une requête qui ne lui paraîtrait pas être dans l'intérêt de l'enfant. Il y a là des garanties suffisantes. À la question de savoir s'il faut prévoir des dispositions spécifiques pour autoriser l'adoption par un célibataire homosexuel, je répondrai encore négativement, pour des raisons juridiques auxquelles on peut joindre des raisons d'opportunité. La règle de droit est par définition générale et impersonnelle. Il existe déjà en droit français une disposition Je pense donc qu'il n'y a pas lieu de modifier l'article 343-1 du code civil, ni pour supprimer la possibilité pour une personne seule d'adopter un enfant dans l'intérêt de ce dernier, ni pour l'accorder spécifiquement à un célibataire homosexuel. En revanche, la véritable question de droit se pose en amont : c'est celle de savoir si une personne seule peut se voir refuser l'agrément en vue de l'adoption en raison de son orientation sexuelle. Cette question se trouvait précisément au cœur du débat dans l'affaire Fretté sur laquelle la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée le 26 février 2002. L'intérêt d'un enfant adoptable, considéré in abstracto, justifie-t-il d'interdire l'adoption à un homosexuel en ne délivrant pas l'agrément à ce dernier ? Sur ce point, la Cour européenne juge qu'il convient de laisser aux autorités nationales compétentes des États parties à la Convention européenne des droits de l'homme une large marge d'appréciation, en l'absence actuelle de consensus entre eux. La Cour de Strasbourg interprète l'article 8 de la Convention comme garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, mais elle considère que cela implique une vie familiale préexistante, et que l'article 8 ne saurait être utilement invoqué au soutien du désir de fonder une famille grâce à l'adoption. Aucune violation des articles 8 et 14 combinés n'a été retenue contre la France. Il faut également tenir compte des réalités de l'adoption internationale. Mis à part quelques États, les enfants sont plus volontiers confiés aux couples hétérosexuels mariés. S'agissant de l'adoption conjointe, un couple de concubins de sexe différent peut, au bout de deux ans de vie commune, recourir à la procréation médicalement assistée, mais il ne peut pas adopter. Faut-il supprimer l'obligation d'être mariés pour pouvoir adopter conjointement ? Peut-on ouvrir l'adoption conjointe à un couple de même sexe ? S'agissant de la première question, je rappelle que lorsqu'un concubin envisage, d'un commun accord avec son partenaire, de créer un véritable lien de parenté avec l'enfant de celui-ci, sachant que l'enfant n'a pas de second lien de filiation par le sang légalement établi, on recourt à des reconnaissances de complaisance. Si le couple vient à se séparer, elles sont généralement contestées à la demande de leur auteur ou à la demande de la mère. Si l'action est exercée dans le délai légal, une reconnaissance de complaisance est rétroactivement annulée et le lien de filiation réputé n'avoir jamais été établi. Lorsqu'un couple hétérosexuel non marié souhaite ainsi établir un lien de filiation entre l'un de ses deux membres et l'enfant de l'autre, ce qui traduit un projet de parenté commune, l'adoption plénière est assurément préférable a priori à la pratique des reconnaissances de complaisance. L'ordonnance du 4 juillet 2005 réformant le droit de la filiation a substantiellement réduit le délai de prescription de telles actions en contestation, afin précisément de stabiliser et de sécuriser le lien de filiation, mais l'adoption plénière est préférable pour l'enfant, du fait qu'elle est irrévocable. Lorsqu'il s'agit d'un enfant qui n'est pas celui de l'un des deux membres du couple, il me semble qu'il serait préférable de réserver l'adoption plénière aux époux. En effet, le mariage présente un certain nombre de garanties, en particulier en cas de séparation du couple, puisqu'un juge est nécessairement amené à intervenir pour prononcer le divorce, et que l'un des aspects des conséquences du divorce que le juge vérifie en premier lieu, et qui n'est pas librement négociable comme le sont les questions d'argent, est précisément les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Dans le cas d'un couple hétérosexuel, autant je pencherais pour l'adoption plénière de l'enfant de l'autre, parce qu'elle a le mérite d'être irrévocable, ce qui n'est pas le cas des reconnaissances de complaisance, autant je serais portée à réserver aux époux le projet d'adoption d'un enfant biologiquement étranger aux deux membres du couple. S'agissant des concubins qui sont de même sexe, qu'ils vivent en union libre ou qu'ils soient pacsés, comment peut-on justifier de permettre l'adoption conjointe à ces couples si cette possibilité n'est pas accordée à un couple hétérosexuel non marié ? S'agissant enfin de l'adoption de l'enfant de l'autre quand les deux concubins sont de même sexe, il faut faire un choix. Soit on admet la création d'un lien de filiation contraire à l'ordre naturel, et on admet l'adoption simple, comme cela a pu être fait par la jurisprudence. Une femme a été admise à adopter les trois enfants de sa compagne, qui avaient été conçus par procréation assistée avant les lois de 1994. Une délégation d'autorité parentale a ensuite été admise par le juge, uniquement pour les besoins éducatifs des enfants. La mère par le sang s'est vu réattribuer, par voie de délégation, des prérogatives d'exercice de l'autorité parentale dont elle avait été privée du fait de l'adoption simple. Cet exemple pourrait être une piste, sans modifier les textes, à ceci près que les lois de bioéthique ont modifié le cadre juridique de la procréation médicalement assistée. Il faudrait, en ce cas, fermer les yeux sur la manière dont les enfants ont été conçus, mais tenir compte de la réalité concrète du cadre de vie des enfants qui sont éduqués par les deux membres du couple. Soit on ne fait pas le choix de créer un lien de filiation parce que la solution paraît excessive, et, dans ce cas, il faut déplacer la réflexion sur le terrain de l'exercice de l'autorité parentale, et exploiter les possibilités qu'offre la délégation. Il est en effet possible de confier certaines prérogatives à un tiers proche, digne de confiance, qui serait, en l'occurrence, le deuxième membre du couple. Mme Janice Peyré : J'aborderai la question posée du point de vue des enfants qui attendent, en France ou à l'étranger, de trouver une famille. Mesure de protection sociale, l'adoption est trop souvent instrumentalisée par des lobbies diplomatiques, politiques, électoraux ou autres. Ce constat du Service social international, organisme indépendant de veille sur l'enfance privée de famille, relaie le sentiment de nombreux pays d'origine, qui réfléchissent aux moyens de résister à la pression que tentent d'exercer sur eux certains candidats adoptants étrangers, certains organismes d'adoption ou les autorités de certains États d'accueil. Votre évaluation sereine d'une éventuelle réforme et de sa portée sera donc cruciale pour l'enfant adoptable, dans la mesure où elle engage son avenir, ainsi que pour la crédibilité de la France comme pays d'accueil. Mon intervention s'inscrira dans le cadre de la préoccupation qui est la nôtre, celle de parler vrai. De parler vrai aux enfants, aux pays, aux institutions, aux candidats à l'adoption. Mon objectif sera donc de replacer l'adoption dans la réalité du quotidien, et non d'échafauder des configurations certes intellectuellement fascinantes pour des adultes, mais qui peuvent s'avérer difficiles à vivre pour un enfant. Depuis plus d'un demi-siècle, Enfance et familles d'adoption s'organise autour du droit de tout enfant à grandir dans une famille : une famille par adoption quand la famille de naissance est dans l'impossibilité de jouer pleinement son rôle ; une famille d'accueil ou « parrainante » quand l'adoption n'est pas la meilleure réponse aux besoins spécifiques d'un enfant donné. Ce droit s'inscrit dans la reconnaissance et le respect des droits de l'enfant, notamment son droit à l'insouciance et à la stabilité. La famille doit être pensée pour lui, à partir de lui et autour de lui. Si cela peut sembler une évidence, il n'est pas inutile de la rappeler dans un monde où l'on attend de l'enfant qu'il s'adapte aux adultes, à leurs choix relationnels et de mode de vie parfois mouvants, davantage que l'on n'exige de ces derniers qu'ils s'adaptent à lui. L'élargissement salutaire des libertés individuelles dans les sociétés occidentales s'accompagne, si l'on n'y prend garde, d'une quête de l'enfant instantané. Le pays d'accueil que nous sommes doit donc se porter garant de la qualité des parents, sur les plans matériel, éducatif, moral et psychique, et de leur capacité à inscrire l'enfant dans une filiation où il deviendra le fils ou la fille de son père et de sa mère, lesquels seront les grands-parents de ses propres enfants. L'information contenue dans le dossier des candidats doit donc refléter la réalité des conditions d'accueil qu'ils proposent. La vérité que l'on doit à son enfant et à son pays - à qui reviennent le droit, la responsabilité et la liberté de nous choisir ou non comme parents - commence là. Cette exigence de vérité vaut évidemment aussi pour les pupilles de l'État. On voit donc par là comment la stérilité, l'absence de procréation possible, quelle qu'en soit la cause - maladie, âge, célibat, configuration sexuelle du couple - n'ouvrent aucun « droit à l'enfant ». Nous entendons cette souffrance profonde, difficile à vivre, encore plus à formuler, et que beaucoup de nos adhérents vivent. Apolitiques, non confessionnelles, nos associations, dont les membres viennent d'horizons personnels très divers, ont pour mission d'accueillir sans les juger tous ceux qui s'adressent à nous. Le cheminement permet d'avancer, depuis ce désir d'enfant, vers un désir d'être parent, puis vers une réflexion sur la capacité ou non à être parent d'un enfant qu'on n'aura pas mis au monde. Car l'adoption n'est pas une réponse à une absence d'enfant. Pour certains, elle sera une réponse impossible, impossibilité qu'il convient de juger lors de la procédure d'agrément pour que le candidat puisse, sans se sentir jugé ni humilié, renoncer au projet, et pour que l'enfant ne se trouve pas, un jour, confronté à un nouvel abandon. Ce cheminement ne peut que s'inscrire dans la légalité et la vérité. C'est là toute l'éthique de l'adoption : « parler vrai » à l'enfant de ce qui nous a conduits vers lui, comme de ce qu'on nous a dit sur lui. Pour qu'un parent puisse aller vers son enfant dans la vérité, il faudra au préalable lui avoir « parlé vrai » à lui aussi, lui avoir fait mesurer que l'adoption échappe à la sphère privée, que ses droits individuels ont pour seule limite l'intérêt de l'enfant, lui avoir parlé des réalités, parfois difficiles, de l'adoption, du fossé croissant entre le nombre de candidats adoptants et celui des enfants majoritairement souhaités. On compte 40 000 adoptions internationales en 2004 tous pays confondus, alors qu'il y avait, cette même année, en France uniquement, 25 000 candidats agréés pour 5 000 adoptions. Il faudra également avertir le candidat des conditions requises par l'immense majorité des pays : les pays parties à la Convention de La Haye exigent des adoptants mariés ou célibataires. Par mariés, ils entendent un homme et une femme, et vérifient de plus en plus que c'est effectivement le cas. Rares sont les pays non parties à la Convention de La Haye qui admettent des couples non mariés. En France, en dehors de quelques rares cas, ce sont les mêmes critères. Dans ces circonstances, quelles modifications peut-on envisager ? Elles doivent viser à renforcer la protection et l'intérêt de l'enfant, à adopter mieux. Il conviendrait donc, comme l'a proposé le Conseil supérieur de l'adoption (CSA), où j'ai l'honneur de siéger, de revoir le rôle du président du conseil général dans l'attribution de l'agrément. Celui-ci devrait notamment motiver sa décision lorsqu'il ne suit pas l'avis de la commission d'agrément, ne serait-ce que dans l'intérêt de l'adoptant. Autre proposition faite par le CSA : instaurer un écart d'âge maximum, de quarante-cinq ans par exemple. Un écart d'âge maximum est appliqué de fait dans la grande majorité des conseils de famille en France, et existe dans un certain nombre de pays. Cela permettrait notamment, lorsque la notion fait l'objet d'une réflexion avec les candidats, l'adoption d'enfants plus grands. Une fois de plus, c'est l'intérêt de l'enfant qui justifie de telles mesures : les enquêtes sur le devenir des enfants adoptés montrent qu'ils ont souvent besoin de plus de temps pour acquérir une autonomie affective et sociale, ainsi qu'un niveau de formation proche de la moyenne. Surtout, ils ont peur d'être de nouveau abandonnés, et ressentent une véritable angoisse quand ils voient leurs parents vieillir alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore quitté le nid. Un agrément au rabais, accordé par le président du conseil général alors que l'enquête sociale - qui restera dans le dossier - est désastreuse, ou un écart d'âge trop important, ferment la plupart des portes à l'adoption. Les candidats découvrent, désabusés, qu'on les a induits en erreur, qu'on n'a pas osé leur dire la vérité. Pire, ils risquent de se voir entraînés dans certaines dérives, notamment dans des pays fragiles, où le risque que des enfants soient conçus en vue de l'adoption est réel. Or la prévention des abus de l'adoption est de la responsabilité partagée des pays d'accueil et des pays d'origine. Elle figurera notamment dans le guide de bonnes pratiques que le bureau permanent de la Convention de La Haye prépare actuellement. Des frustrations et des risques analogues existeront si l'on élargit les conditions requises pour adopter à des catégories autres que celles reconnues par la Convention de La Haye, et notamment aux concubins, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. C'est dans ce contexte que se pose la question de savoir si l'extension de l'adoption aux couples homosexuels est conforme à l'intérêt de l'enfant. Au Royaume-Uni, des enfants ont été confiés à des couples homosexuels ayant été pour eux, au préalable, une famille d'accueil. La place de ces accueillants s'inscrit dans l'intérêt de l'enfant, et il y aurait sans doute là une piste intéressante à explorer : leur sont souvent confiés des enfants grands, ou conservant des liens avec leur famille d'origine, des enfants auxquels leur histoire et leur origine ne posent pas question - de la même façon, aux États-Unis, des enfants sont confiés à des religieuses ou à des prêtres -. Dans les cas où l'adoption est prononcée, elle l'est au nom de l'un des deux accueillants, l'autre bénéficiant d'un partage des responsabilités parentales. Ailleurs, dans les pays d'accueil ayant élargi la possibilité d'adopter aux homosexuels, très peu d'enfants leur sont confiés en adoption nationale. Ils se tournent vers l'étranger, où ils se heurtent au refus des pays d'origine. À ce jour, selon le Service social international, aucun pays d'origine ne confie sciemment des enfants à des personnes homosexuelles. Ce n'est donc que sur la base d'un agrément taisant la vie en couple que l'adoption est possible : on adopte en célibataire, on revient dans son pays, et l'adoption peut ensuite être prononcée au nom du partenaire. Qu'en est-il de la préparation du second partenaire, du rôle et de la déontologie des enquêteurs dans cette vérité à demi-dite ou escamotée, de la relation de confiance avec les pays d'origine, de cette désinformation que l'enfant découvrira un jour dans son dossier ? Alors que l'on pouvait espérer que l'autorisation pour les homosexuels d'adopter ou de se marier aurait eu pour mérite de permettre une enquête plus transparente, on voit que, pour les pays qui ont fait ce choix, la vérité reste tue dans la mesure où les pays d'origine n'accepteraient pas les dossiers. La relation avec les pays d'origine continue donc d'être fondée sur des non-vérités, avec l'aval désormais du pays d'accueil. Alors qu'on ne peut mentir sur son état-civil, autoriser ce type de « montage » ouvrirait la porte au droit pour tout adoptant de taire tout élément de sa vie susceptible d'être important pour les pays d'accueil, par exemple une information relative à sa santé ou à d'autres aspects de son mode de vie. Autant les parents par adoption sont ouverts à l'idée d'étendre celle-ci, dans la légalité et dans la transparence, aux homosexuels, autant ceux qui sont adoptés, adolescents ou adultes, expriment de réelles réticences. Ils témoignent de ce sentiment intime de différence avec lequel ils ont grandi, et qu'accompagne une aspiration très profonde à la normalité. Avoir des parents homosexuels viendrait à leurs yeux ajouter une différence et une curiosité supplémentaires à celles que suscite déjà l'adoption, voire, dans certains cas et dans certains milieux, un rejet. La question de l'intégration des enfants adoptés est une question réelle. Faire entrer l'enfant adopté dans une société où il aura les mêmes droits, la même place que les autres enfants - ce qui est prévu par la Convention de La Haye - suppose qu'il soit accueilli au sein de schémas familiaux préexistants, déjà reconnus comme tels, et non qu'il soit instrumentalisé pour obtenir la reconnaissance de nouveaux schémas familiaux. Enfin, autant il n'y a absolument aucune raison de douter des qualités éducatives et affectives de parents homosexuels, autant on ne connaît pas encore aujourd'hui tous les effets sur la construction de l'identité psychique de l'enfant adopté. Tant qu'un doute persiste, aussi infime soit-il, n'est-il pas dans l'intérêt de l'enfant d'appliquer à l'adoption le principe de précaution, comme on l'applique dans d'autres domaines ? Mme Martine Gross : Au nom de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL), je remercie votre Mission de l'invitation qu'elle m'a faite à participer à cette table ronde. Répondre à la question que vous nous avez posée exige évidemment de définir l'intérêt de l'enfant. Pour l'APGL, l'intérêt de l'enfant signifie qu'il peut accéder dans la mesure du possible à une information sur ses origines ; qu'il bénéficie d'une filiation sûre, qui ne puisse pas changer au gré de la vie des adultes ; enfin, que les liens tissés avec les personnes qui l'élèvent soient protégés, quelles que soient ces personnes. On retrouve là les trois aspects de la filiation auxquels l'APGL souhaite que le droit fasse place : être « né de » ; être « fils de » ; être « élevé par ». La filiation juridique doit être fondée sur la responsabilité et sur un engagement irrévocable, et non plus sur la seule vraisemblance d'un acte procréatif entre les parents. S'agissant de l'adoption par une personne seule, je rappelle que, en 2001, l'APGL avait fait circuler une pétition, dont voici le texte : « Nous, signataires de ce texte, pensons que la décision du 21 décembre 2000 de la Cour administrative d'appel de Nancy donnant raison au conseil général du Jura qui avait refusé à Mlle B. son agrément pour adopter, au seul motif de son homosexualité, est une discrimination. « Nous pensons que personne n'a de droit à l'enfant. Nous pensons que la société a le devoir de donner une famille à tout enfant qui en est privé. L'aptitude d'une personne à adopter un enfant doit s'apprécier individuellement et non en fonction de préjugés qui, même partagés par un grand nombre, n'en tirent pas pour autant une quelconque validité. « Nous demandons que les investigations permettant de décider si une personne est susceptible d'offrir des qualités d'accueil satisfaisantes du point de vue familial, éducatif et psychologique pour adopter un enfant, soient menées conformément à l'esprit de la loi, « - sans position de principe excluant à l'avance une catégorie de citoyens ; « - au cas par cas, cherchant à apprécier les compétences parentales ; « - en motivant les refus. « Dans la mesure où la loi permet à une personne seule d'adopter, l'absence de référent paternel ou maternel ne saurait être un défaut rédhibitoire ni un motif de refus. « Nous pensons qu'il n'appartient pas aux travailleurs sociaux ni aux tribunaux de renforcer les préjugés homophobes encore présents dans notre société. » De nombreuses personnalités universitaires et politiques avaient signé ce texte. Où en est-on aujourd'hui ? À peu près au même point. À ceci près que le cas dont cette pétition faisait mention, tout à fait semblable à celui de Philippe Fretté, est porté devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui modifiera peut-être sa jurisprudence. Rappelons, que c'est à une très courte majorité - quatre juges contre trois - que la différence de traitement dans le cas qui opposait Philippe Fretté à la France avait été jugée légitime. À l'exception de deux ou trois départements, une personne qui ne dissimule pas son homosexualité se voit refuser l'agrément sans que ses compétences parentales soient mises en cause le moins du monde. La plupart du temps, les rapports concluent aux qualités indéniables du candidat ou de la candidate, mais son mode de vie, sous-entendu homosexuel, est évoqué sans démonstration comme préjudiciable à l'intérêt de l'enfant. Or, ce qui se passe lors des investigations est pour le moins paradoxal : si le candidat est vraiment seul, on craint pour l'intérêt de l'enfant que ce dernier porte sur ses épaules la charge d'avoir à combler un manque affectif de son parent. Aussi les travailleurs sociaux se préoccupent de savoir si le candidat à l'adoption est suffisamment entouré, et en particulier s'il a une vie affective et amoureuse. Or, comment un gay ou une lesbienne qui vit en couple peut-il rassurer les travailleurs sociaux sur son vécu affectif ? Comment, alors que les investigations sont, pour les candidats à l'adoption, l'occasion de préparer l'accueil d'un enfant, les travailleurs sociaux peuvent-ils aider les candidats homosexuels à se poser les questions indispensables préalables à l'adoption, si une relation de confiance ne peut pas s'établir ? L'approche qui consiste à invoquer l'argument de la nécessité d'un double réfèrent masculin-féminin remet fondamentalement en question la légitimité des familles monoparentales. Je suppose que c'est la raison pour laquelle la Mission se pose la question de revenir sur l'ouverture de l'adoption aux célibataires. Tous les États ne considèrent pas que l'homosexualité soit préjudiciable aux enfants, ou que la présence des doubles référents masculin et féminin soit indispensable : Les Pays-Bas, la Suède et l'Espagne permettent l'adoption par un couple et l'adoption de l'enfant par le compagnon ou la compagne. Il en est de même pour l'Angleterre, le Pays de Galles, le Québec et la Colombie-Britannique. Quelques temps après que la loi de 1966 permettant à un célibataire d'adopter a été votée, les refus d'agréments liés à l'état matrimonial ont nécessité que soit pris un décret interdisant d'alléguer l'état matrimonial du candidat comme motif de refus d'agrément. Nous proposons qu'un décret similaire soit publié, stipulant qu'il est interdit d'alléguer l'orientation sexuelle du candidat comme motif de refus d'agrément. S'agissant de l'adoption conjointe, je souligne que l'intérêt de l'enfant est d'être adopté par deux personnes si deux personnes se présentent pour s'engager en tant que parents auprès de lui. L'adoption, en tant qu'institution, ne doit pas continuer à imiter la nature, elle doit montrer la voie d'un droit de la famille basé sur l'engagement. Pourquoi ne donner qu'un seul parent à un enfant lorsque deux sont prêts à s'engager, et ce au seul motif que deux personnes de même sexe ne peuvent faire semblant d'avoir procréé ? Rappelons que donner deux parents, c'est éviter qu'un enfant soit orphelin en cas de décès de l'un, c'est permettre une double transmission des biens, c'est donner quatre grands-parents à l'enfant, et ainsi de suite. Aujourd'hui l'adoption par un couple n'est possible qu'aux personnes mariées. Nous considérons que la filiation ne doit pas être basée sur le type d'union des parents. Si, comme nous le souhaitons, la filiation se fonde sur l'engagement d'un adulte à être le parent d'un enfant, peu importe que les deux parents soient mariés, concubins ou pacsés. Au-delà de leur union, et quelle que soit cette union, le lien à l'enfant devra perdurer. Ne faisons pas dépendre ce lien du type d'union des adultes. C'est pourquoi nous souhaitons l'ouverture de l'adoption aux personnes non mariées. L'APGL propose de faire place à un droit de la filiation qui fonde celle-ci sur la volonté et l'engagement parental plutôt que sur la nature ou la vraisemblance d'un acte procréatif. Je le répète, nous distinguons les trois aspects : le biologique - être « né de » -, le juridique - être « fils de » -, le social - être « élevé par » -. Seul l'aspect juridique s'accompagne de droits et de devoirs. La filiation, c'est à dire l'aspect juridique, découlant de l'engagement parental peut être différente des origines. Dans un système de filiation qui reconnaît un écart possible entre la nature et la filiation, où cette dernière est fondée sur la volonté et l'engagement d'être parent, rien n'interdit a priori l'existence d'une filiation adoptive plénière par deux parents non mariés, fussent-ils de même sexe, s'ils présentent de bonnes conditions d'accueil et de développement pour un enfant. L'union des adultes n'est pas un critère de pérennité. L'adoption par deux personnes non mariées est ainsi possible au Québec, en Colombie Britannique, en Espagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Angleterre et au Pays de Galles. J'en viens maintenant à la question de l'adoption de l'enfant du compagnon ou de la compagne. Il convient de distinguer les situations où il n'a qu'un seul parent légal de celles où il a déjà deux parents. Dans les familles où l'enfant n'a qu'un seul parent légal et est élevé par deux personnes, l'adoption plénière par le second parent doit être possible afin de protéger les liens de l'enfant avec les personnes qui l'élèvent. Cette solution existe dans d'autres pays. Fondée sur une éthique de la responsabilité et sur la coparentalité, cette disposition protège l'enfant en cas de décès du parent légal ou en cas de séparation, et lui offre deux branches filiatives plutôt qu'une seule. Lorsqu'un enfant a déjà deux parents, l'adoption simple par le beau-parent ou le « coparent » avec partage de l'autorité parentale entre les parents d'origine et les parents adoptifs - à condition, bien sûr, que les parents d'origine soient d'accord -, donnerait une possibilité aux parents sociaux de témoigner de leur engagement et aux enfants d'avoir une filiation cohérente avec leur environnement. M. Jean-Marie Muller : Bien qu'étant membre du Conseil supérieur de l'adoption, je n'exprimerai que la position de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide aux pupilles et anciens pupilles de l'État, que je représente ce matin. Nous représentons les pupilles de l'État au sein des conseils de famille sur l'ensemble du territoire, et nous en assumons la présidence dans vingt-cinq départements. J'ai moi-même exercé cette fonction de président de conseil de famille pendant douze années. Je n'aborderai aujourd'hui que quatre thèmes de réflexion : l'adoption des enfants nés sous le secret en risque de reconnaissance anténatale ; l'adoption des pupilles de l'État, revendiquée par des couples homoparentaux ; l'adoption des enfants en situation de « délaissement » sous statut de tutelle d'État ou de délégation d'autorité parentale ; l'amélioration du fonctionnement des conseils de famille des pupilles de l'État. En ce qui concerne l'adoption des enfants nés sous le secret en risque de reconnaissance anténatale, l'affaire « Benjamin », où le tribunal de grande instance de Nancy s'est prononcé en première instance en faveur de la reconnaissance d'un père biologique dont l'enfant venait d'être placé en vue d'adoption, a mis en échec les textes en vigueur. Certes la cour d'appel a ordonné l'adoption de l'enfant ainsi que le rejet de la reconnaissance anténatale. Il n'en demeure pas moins que la loi concernant l'accès aux origines personnelles, que nous appelions de nos vœux, crée un vide juridique qui expose les enfants nés sous le secret et leur famille adoptive à un conflit de droit, aucun enfant né sous le secret n'étant aujourd'hui assuré de la stabilité de son placement. Nous proposons que, pour tout enfant né sous le secret, soient diligentées par le tuteur toutes les recherches nécessaires pour garantir qu'il n'existe pas, le concernant, une reconnaissance anténatale. À l'expérience des recherches tentées sur notre insistance par le préfet de Meurthe-et-Moselle auprès du procureur de la République, il apparaît que ce dernier ne s'est pas saisi du problème et qu'il ne répond à aucune sollicitation. Le conseil de famille reste donc face à ce risque de placer un enfant en situation extrêmement délicate. Nous proposons également que si cette reconnaissance anténatale existe, la loi permette d'ester en contestation de paternité, pour s'assurer que le demandeur est véritablement le père biologique et qu'il en fasse la preuve. Nous proposons enfin que l'effet de la reconnaissance soit limité à la durée du délai de rétractation accordé à la mère de l'enfant. En tout état de cause, nous considérons que des réformes législatives sont nécessaires en ce domaine, car à ce jour aucune suite n'a été donnée à nos demandes rappelées ci-dessus, ni à nos auditions par l'inspection générale des affaires judiciaires et celle de l'action sociale. S'agissant de l'adoption revendiquée par les couples homoparentaux, nos représentants sont opposés à l'adoption des pupilles de l'État, déjà en situation d'assumer une histoire douloureuse, par des couples homoparentaux. L'enjeu de société qu'en font les demandeurs est trop important pour que l'enfant pupille de l'État en devienne un instrument. Il est bon de rappeler que, en matière d'adoption, il n'y a pas de droit à l'enfant, mais un droit de l'enfant à trouver une famille. Le modèle parental reste pour nous celui qui consiste à offrir à un enfant un papa et une maman, un papa de sexe masculin et une maman de sexe féminin. Je ne ferai pas état des différentes recherches sur l'intérêt de cette double référence, pour un enfant abandonné comme pour tout enfant : d'autres intervenants sont plus compétents que moi pour développer ce point de vue. Nous-mêmes, placés en situation de pupilles de l'État à la suite d'abandon ou de défaillance de couples hétéroparentaux, nous ne cédons pas aux effets de la modernité en pensant qu'une ouverture aux couples homoparentaux n'exposerait pas les enfants aux mêmes risques. Devront-ils, en plus de leur situation personnelle et de leur souffrance d'origine, supporter le débat de société qui ne manquera pas de se faire jour autour de leur nouvelle condition ? Le statut de pupille de l'État est en soi un statut d'exception. Il nous semble justifié que soit introduite, pour lui, une véritable exception dans la législation. Si la législation devait évoluer sous la pression sociale, nous demanderions à ce que les pupilles de l'État ne puissent être adoptés que par des couples hétéroparentaux. Le bon sens commande que soient satisfaites les demandes d'adoption des couples actuellement agréés et en attente. Nous restons vigilants, en conseil de famille, pour que l'adoption par des célibataires reste une mesure d'exception, permettant par exemple, comme la loi l'avait prévu au départ, l'adoption par des assistantes maternelles vivant seules afin de poursuivre des liens d'attachement avec l'enfant qu'elles ont élevé. Mais nous sommes favorables à ce que l'adoption puisse être ouverte à des couples pacsés ou en concubinage. J'en viens maintenant à la situation des enfants délaissés par leurs parents. Cette question est importante, car, pour qu'il y ait adoption, encore faut-il que les enfants soient adoptables. Peut-être faut-il même commencer par là. Beaucoup d'enfants - près de 10 000 recensés pour 3 000 pupilles de l'État - ne peuvent accéder au statut de pupille de l'État qui pourrait leur ouvrir la voie à une éventuelle adoption si la législation actuelle était véritablement appliquée. Le statut de pupille de l'État est souvent réduit, dans les représentations culturelles, juridiques et professionnelles, à un statut d'adoptabilité, alors qu'en fait il est avant tout un véritable statut de protection de l'enfance. Ce statut a souvent été présenté, par des pupilles de l'État elles-mêmes, comme un statut de déshonneur et de malheur. Les pratiques d'aide à l'enfance ont beaucoup évolué, et nombre de personnes ayant été protégées sous ce statut se félicitent de la stabilité et des alternatives qu'elles ont trouvées auprès d'autres familles. Nous devons constater que l'article 350 du code civil n'est pratiquement plus utilisé que pour des maltraitances très graves. Le délaissement et la violence morale ne sont que trop rarement pris en compte. La récente révision de cet article, qui a supprimé les mots « sauf en cas de grande détresse », ne changera rien sur le fond et ne réglera en rien le sort de nombreux enfants. Nous nous inscrivons trop souvent - et les professionnels de l'enfance plus que d'autres - dans un schéma très judéo-chrétien opposant la « bonne famille » à la « mauvaise famille », amenant à n'envisager la question de la relation d'un enfant avec sa famille d'origine qu'en termes de rupture. Cette politique du « tout ou rien » avait déjà été dénoncée par Myriam David, lorsqu'elle affirmait qu'il convenait de ne pas confondre maintien des liens familiaux et maintien de l'enfant dans sa famille. Nous demandons une évolution de la législation vers une véritable loi pour la protection de l'enfant, où le droit de l'enfant ne se lirait pas en miroir de celui de ses parents. Pour nous, les parents sont les obligés des enfants qu'ils ont mis au monde. Notre position en ce domaine est très proche de celle du docteur Maurice Berger, membre d'honneur de notre fédération. Il convient, dès l'écriture de la loi, de mettre en place des prises en charge - stabilisation des placements, repérage des parcours, travail du lien avec la famille d'origine - qui favorisent un véritable processus de résilience, tel que l'a défini Boris Cyrulnik. Nous proposons que les enfants dont la situation de délaissement est constatée par la délégation d'autorité parentale ou la tutelle d'État bénéficient, dès que cette situation est patente, du statut de pupille de l'État. Le délai imparti à ce constat et la définition des conditions de délaissement méritent toutefois débat. Nous proposons également qu'un nouveau statut d'adoption, intermédiaire entre l'adoption plénière - qui a pour défaut de rompre la filiation d'origine, en particulier avec la fratrie - et l'adoption simple - qui n'est pas suffisamment sécurisante -, soit élaboré et étudié par le Conseil supérieur de l'adoption, en vue d'une réforme législative. Enfin, la question de l'obligation alimentaire doit être réexaminée dans son ensemble, au-delà des récentes modifications législatives qui nous paraissent insuffisantes. Pour nous, aucun enfant en situation de délaissement, quel que soit son statut, ne devrait être soumis à l'obligation alimentaire, et aucun enfant adopté soumis à une double obligation alimentaire, dans le cas de l'adoption simple. Nous demandons à participer activement aux travaux qui pourraient aboutir à cette évolution. D'ores et déjà, nous sommes en mesure d'engager le débat, lorsque le temps sera venu, avec les membres de votre Mission qui ont récemment déposé des propositions de loi. J'en viens, enfin, à la question du fonctionnement des conseils de familles des pupilles de l'État. La représentation des usagers est actuellement au cœur des textes définissant les bonnes pratiques en matière de prise en charge sociale et médico-sociale. Il convient que le conseil de famille reste sous la tutelle du préfet et que son fonctionnement, dans son rôle de conseil auprès du tuteur, apporte toute garantie d'une révision objective et critique de la situation du parcours de l'enfant lorsque sa prise en charge par la protection de l'enfance s'installe dans la durée. Cette fonction de révision de situation doit être assurée dans le cadre d'un débat contradictoire. Nous proposons qu'il soit recommandé, par voie réglementaire, que les conseils de famille des pupilles de l'État soient présidés en priorité par les représentants des pupilles de l'État, ou, à défaut, par des membres qualifiés, représentant la société civile, en veillant à ce qu'ils ne soient pas eux-mêmes issus des services de la protection de l'enfance. Il n'est pas convenable, en droit comme sur le plan moral, que nombre des conseils de famille soient présidés par des conseillers généraux, qui deviennent dans les faits, en qualité de gardiens des enfants, le conseil du tuteur. Il faut également mettre fin à la pratique qui consiste à nommer, en qualité de membres qualifiés, les membres de la protection de l'enfance lors de leur départ à la retraite, car le conseil de famille y perd cette fonction de tiers que lui a attribuée la loi. En conclusion, seuls une véritable politique de protection de l'enfant et l'accès au statut protecteur de pupille de l'État peuvent garantir à l'enfant une mise en œuvre de son projet personnel, de son projet de vie ou d'un projet d'adoption qui préserve son intérêt supérieur. Cela ne peut se faire sans une évolution législative d'envergure, équilibrée, qui préserve le droit à une famille stable et le droit à connaître ses origines. Les travaux engagés récemment par le Conseil supérieur de l'adoption nous semblent aller dans le bon sens. Mme Nadine Pinget : Je vous remercie d'avoir convié à cette table ronde le Mouvement pour l'adoption sans frontières. Parmi ses trois principes fondateurs, notre mouvement prône celui de l'adoption « sans discrimination », tant pour les enfants que pour les parents. Ainsi, l'enfant privé de ses parents biologiques doit pouvoir retrouver un nouveau cadre familial propice à son épanouissement personnel. La procédure d'agrément a pour but d'évaluer le projet parental des postulants, et nous pensons que tout célibataire, tout couple marié ou vivant en concubinage doit pouvoir y prétendre. Il revient alors aux services sociaux des départements d'en apprécier la solidité, indépendamment du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des futurs parents. Il ne s'agit pas de faire de l'obtention de l'agrément un droit absolu, mais de l'adapter à notre évolution sociale. Nul ne peut en effet ignorer les bouleversements structurels de notre société : le nombre croissant d'enfants nés hors mariage, celui des divorces et donc de familles monoparentales ou recomposées, la reconnaissance des couples homosexuels. Le mariage n'apparaît plus comme gage de stabilité ou de longévité de la famille. Ne nous voilons pas non plus la face, et mettons un terme à cette forme d'hypocrisie qui conduit à ce que les membres de couples de concubins présentent en tant que célibataires des demandes d'agrément, allant jusqu'à éliminer toute trace de la présence du partenaire dans les enquêtes sociales et psychologiques. Reconnaissons à l'enfant, lorsque c'est effectivement le cas, le droit d'être attendu, élevé, choyé, aimé par ses deux parents, et accordons au parent de fait la reconnaissance juridique, pleine et entière, de son implication auprès de cet enfant. L'intérêt de l'enfant n'est-il pas de pouvoir porter les noms de ses deux parents ? L'intérêt de l'enfant n'est-il pas que ses deux parents soient autorisés à prendre pour lui les mêmes décisions ? L'intérêt de l'enfant n'est certainement pas d'être reconnu sans filiation après le décès de son parent adoptif, alors même que dans les faits il conserve son autre parent. L'intérêt de l'enfant n'est-il pas d'être reconnu héritier direct de son second parent ? Et en cas de séparation des parents, l'intérêt de l'enfant n'est-il pas de rester en lien avec le parent non reconnu par la loi ? Dans le cas des familles monoparentales sans autre filiation, l'intérêt de l'enfant ne serait-il pas d'être adopté par le nouveau membre du couple ? Ces cas de familles tronquées sont bien réels, et nous en connaissons tous au sein de nos associations respectives. Il y a donc urgence, dans l'intérêt de l'enfant, à rétablir l'équité avant d'être confrontés à trop de cas douloureux. Cela dit, la reconnaissance des parents concubins ne doit en rien remettre en question l'adoption par des célibataires. La Convention européenne des droits de l'homme garantit d'ailleurs dans son article 8 le respect de la vie familiale. Le postulant célibataire doit être évalué sur son projet parental et les conditions d'accueil qu'il offre à l'enfant, et non sur son choix de vie. En outre, il serait tout à fait injuste d'envisager la suppression de l'adoption par des célibataires à seule fin de régler le problème de l'adoption par des concubins. Enfin, chaque enfant, quelle que soit la particularité de sa filiation adoptive L'intérêt de l'enfant justifie donc que soient modifiées les conditions requises pour adopter, sans pour autant remettre en cause les dispositions existantes qui confèrent à l'enfant le total respect de ses droits, mais bien pour permettre à tous les enfants adoptés de bénéficier sans discrimination de la même protection. M. Pierre Lévy-Soussan : Je vous remercie de m'avoir invité pour apporter un éclairage de clinicien. La participation d'un pédopsychiatre et psychanalyste à ce débat est fondée, dans la mesure où elle permet de témoigner de problématiques inconscientes et conscientes dans les questions touchant à l'enfantement, à la parenté et à la filiation. Nous avons pu élaborer nos réflexions à partir d'échecs dans des situations adoptives et tenter d'en comprendre les différentes raisons, qui constituent autant de risques à repérer dans une perspective préventive plus que prédictive. Plus simplement, cela conduit à s'interroger sur les risques que l'on est prêt à faire courir à un enfant lorsqu'il s'agit de modifier les lois sur la situation adoptive. L'adoption est une institution de filiation, présentant des risques qui lui sont propres. En nous situant du côté de l'enfant adopté, nous pourrions répondre à la question que vous avez posée en rappelant que son intérêt est au moins quintuple. Son premier intérêt est d'entrer dans une famille nucléaire déjà acceptée socialement, afin qu'il ne lui incombe pas la tâche supplémentaire, par rapport à son histoire d'abandon, de s'ajuster à une famille « hors normes », quelles qu'en soient les raisons. Son deuxième intérêt est d'entrer dans une famille susceptible de le transformer en fils ou fille de l'un et de l'autre parent d'une façon stable et définitive. C'est la réponse la plus forte face à son abandon : à l'interruption volontaire de filiation qu'il a subie répond une nouvelle création filiative. Mais cette transformation ne va pas de soi. Elle repose sur les trois axes de la filiation : biologique, juridique et psychique. La filiation biologique est celle de la procréation, par intervention des « produits du corps » de l'un et de l'autre sexe aboutissant à l'engendrement d'un enfant. Le lien biologique ne suffit pourtant pas pour « être parent » En revanche, les autres données naturelles - reproduction sexuée, différence des générations, différence du mort et du vivant - serviront de base aux productions juridiques et psychiques de la filiation. La filiation juridique est celle du cadre législatif qui définit les règles de filiation. Elle relève de la convention et s'élabore toujours à partir des données biologiques, en fonction des données culturelles de la société. Aucune famille, selon ce principe, ne peut s'inventer un système de parenté, pratiquer l'inceste, ou réfuter à loisir ses parents ou ses enfants en dehors de procédures strictes qui ne dépendent pas de son bon vouloir et qui le dépassent. La loi est donc essentielle à l'intériorisation des repères symboliques propres à définir, pour l'enfant, sa parenté et sa filiation. La filiation psychique, enfin, représente une construction subjective de sa propre vérité qui permet de se considérer comme père, mère, fils ou fille. L'axe psychique de la filiation permet le nouage des trois éléments qui sont à la base de toute société : le biologique, le social, et la dimension subjective propre à l'humain. La solidité psychique de cette construction dépasse le lien purement biologique de la filiation et permet de donner une sécurité à celle-ci. La sécurité et la « vérité » de cette filiation reposent sur l'enfantement, sur une relation potentiellement ou réellement procréatrice entre un homme et une femme, permettant la fiction filiative par la rencontre avec l'autre sexe, de même génération et vivant. La fiction filiative peut alors être vécue comme vraie, cohérente et raisonnable. La situation adoptive est un véritable défi pour la famille eu égard à sa capacité à soutenir ce qui est délié, disjoint, dissocié, en l'occurrence les liens biologiques d'une part et les liens juridiques et psychiques d'autre part. La famille adoptive ne peut soutenir une telle dissociation avec sa volonté propre, son désir ou les seules données conscientes de son discours. La loi, par la fiction juridique qu'elle instaure, permet de définir la place de chaque membre dans un scénario symbolique cohérent pour l'enfant. C'est grâce à cela que tout enfant, adopté ou non, peut se dire « fils ou fille de » l'un et l'autre sexe, pour reprendre la formule antique. Le troisième intérêt de l'enfant est de jouer avec les différentes identifications qui lui sont proposées : à son père, à sa mère, au deux à la fois. C'est son « droit aux différences », ou son droit à l'asymétrie parentale. Son quatrième intérêt est d'éprouver les limites physiques et psychiques de ses parents, afin d'intérioriser un sentiment de confiance dans le monde qu'il n'a pas toujours eu auparavant. Il faut souligner la nécessité de l'importance de la cohérence filiative. Dans la situation d'un parent seul, il est parfois difficile de faire face à l'immense quantité de surcharge de travail, de soins, d'encadrement dont a besoin un enfant adopté, et ce d'autant plus qu'il vient d'un pays étranger ou qu'il présente des carences affectives. La clinique nous montre que l'enfant devra effectuer un travail d'adaptation supplémentaire pour accepter cette réalité « hors normes » classique. Même si ce manque de l'autre parent est assumé par choix, cette absence n'en demeure pas moins redondante par rapport à son histoire d'abandon. Son cinquième intérêt est de ne pas être instrumentalisé en « expérience filiative », en « objet de bonheur », ou en « objet de reconnaissance ». La filiation adoptive est une filiation vulnérable, en raison du travail psychique nécessaire plus important requis pour construire sa parentalité et sa filiation. La faillite de la famille à soutenir la fiction filiative adoptive apparaît immédiatement dans la clinique des échecs de l'adoption. L'enfant est alors remis à l'aide sociale à l'enfance définitivement ou placé en famille d'accueil, ou logé dans un studio à l'écart de sa famille. Parmi les facteurs de risque, nous détaillerons ceux susceptibles d'intéresser aujourd'hui la Mission d'information. Ils sont de quatre ordres : les facteurs liés aux parents, tels que l'âge ou le célibat ; la modification ou non des lois sur la filiation ou le concubinage ; l'accès à l'adoption par les couples qui ont un agrément mais où naît un enfant pendant la période de validité de l'agrément ; enfin, la possibilité donnée au juge de faire des « injonctions d'agrément » à un conseil général qui a rejeté à plusieurs reprises une demande d'agrément. S'agissant des facteurs liés aux parents, un couple âgé ou une personne seule âgée peuvent rapidement être épuisés par un enfant qui présente, en raison de son passé carentiel, des attitudes de défi, d'agressivité, de rejet. À titre d'exemple, dans notre consultation spécialisée dans les filiations, nous observons 20 à 30 % de célibataires venant pour des difficultés avec leur enfant adopté. C'est cinq à huit fois plus que le pourcentage d'adoption par les célibataires au niveau national - 4 % du total des adoptions -. Il est important de souligner que ce n'est pas seulement la situation de célibataire qui est déterminante, mais sa capacité à récuser psychiquement tout tiers, tout « autre » entre lui et l'enfant. La clinique montre comment l'enfant en vient alors à exclure violemment l'autre, en tant que différent. L'adoption au-delà de cinquante ans n'est en rien comparable à l'adoption à trente ou quarante ans : l'épuisement physique et psychique vient beaucoup plus vite, et s'accroît au fil du temps. S'agissant des modifications d'ordre législatif, les trois questions qui nous ont été posées - adoption par un célibataire, adoption conjointe, adoption de l'enfant du compagnon - reposent sur la distinction entre la filiation, d'une part, et la pratique de la parentalité, d'autre part. En effet, la question de fond n'est pas abordée : voulons-nous conserver la filiation dans ses fondements symboliques tout en construisant un nouveau statut filiatif de parents ? Autrement dit, un enfant peut-il venir, au sens à la fois juridique et psychique, de deux personnes de même sexe ? Dans ce cas, remettre en cause l'universalité de la différence des sexes et le passage obligatoire par l'autre sexe pour engendrer reviendrait à supprimer pour l'ensemble de la population les interdits symboliques découlant des lois de la filiation. La suppression de la différence des sexes conduirait à établir des livrets de famille pour un enfant avec deux personnes du même sexe. Elle invaliderait la notion de couple : la notion de parent pourrait être étendue à trois, quatre ou cinq personnes. La suppression de la différence des générations conduirait à accepter des unions intra-familiales telles que mère-fils, père-fille, frère-sœur. En effet, le caractère incestueux serait caduc pour désigner ces unions, l'inceste ne se définissant qu'à travers des liens filiatifs symboliques. La suppression de la différence entre vivant et mort conduirait à accepter les demandes de fécondation par insémination artificielle post mortem. Sommes-nous prêts à envisager ces évolutions ? Faut-il remettre en cause une institution telle que la filiation pour répondre aux demandes parentales d'aujourd'hui ? L'absence de réponses à ces questions préalables a conduit la Mission à vouloir interroger l'intime, à statuer sur la sexualité des personnes. Ainsi, il est très surprenant de voir apparaître un comportement sexuel comme déterminant dans l'évaluation d'une demande d'agrément pour l'adoption. Les questions sur l'intime et la sphère privée ne regardent pas l'État, tant que l'enfant est respecté. En revanche, l'État est concerné lorsque sont remis en cause les fondements symboliques de la filiation qui définissent notre humanité commune. Il nous paraît essentiel de reposer toutes ces questions en distinguant toujours les fondements symboliques actuels propres à l'enfantement et l'axe éducatif-affectif propre à l'exercice de la parentalité. Rien ne nous empêche d'être créatifs pour cela et de définir un statut non filiatif mais éducatif et responsable, qui respecte une dissociation de la filiation et de l'exercice de la parentalité auprès de l'enfant. Le troisième facteur de risque tient à l'accès à l'adoption des couples qui ont un agrément et où naît un enfant pendant la période de validité de l'agrément. Cette situation pose de réels problèmes aux enfants et aux parents quant à leurs places respectives. Il serait souhaitable d'étudier la possibilité soit d'un arrêt de validité de l'agrément, soit d'une remise en cause de l'agrément afin de l'adapter à un nouveau projet filiatif. Quatrièmement, la possibilité pour un juge de faire des « injonctions d'agrément » à un conseil général qui a rejeté à plusieurs reprises une demande d'agrément ne nous semble pas tenir compte de l'intérêt de l'enfant. L'adoption n'est en effet pas un droit et certaines personnes s'étant vu refuser l'agrément à plusieurs reprises n'hésitent pas à choisir une démarche procédurière. En conclusion, l'adoption ne repose ni sur un droit à l'enfant, ni sur un désir fondé sur la compassion. Aucun État, aucune convention internationale ne reconnaît un droit à l'adoption. L'adoption ne vient pas réparer une injustice, suppléer un manque ou authentifier un besoin. Il ne nous semble pas dans l'intérêt de l'enfant de faire reposer sur lui la validation filiative de toutes les situations de vie des adultes, indépendamment du sexe, de l'âge ou du nombre additionnel des « volontaires » s'engageant auprès de lui. L'inventivité est nécessaire pour répondre à la demande actuelle d'un statut éducatif, affectif, correspondant aux demandes d'adultes exprimant une volonté d'engagement auprès de l'enfant. Nous sommes à la disposition des députés pour fournir un rapport complet qui réponde à l'ensemble des questions soulevées par notre présente communication. M. Robert Neuburger : Je vous remercie de cette invitation à présenter quelques arguments qui proviennent très modestement d'un homme de terrain, c'est-à-dire d'un thérapeute familial, au contact avec les difficultés dont lui font part les parents à propos de leur enfant entré dans leur famille par adoption. Je rappelle tout d'abord que la famille humaine est culturelle, donc susceptible d'évolution. La famille actuelle, la famille « conjugale », selon le terme de Lévi-Strauss, et que j'appelle la famille « PME » - père, mère, enfant -, est une exception culturelle. Plus on remonte dans le passé, moins on trouve ce type de famille, y compris dans le passé français, puisque, en France, le modèle a longtemps été celui de la famille paysanne, structurée autour d'un patriarche et s'élargissant par foyers. L'enfant était élevé au sein d'un groupe élargi, et non pas par deux parents. Il me semble également important de souligner que certaines nouveautés sociologiques paraissent irréversibles. Nous assistons à une coupure très nette entre le couple et la famille. Tout un chacun souhaite et se souhaite une famille. Mais si le couple est insatisfaisant, il n'hésitera plus à se séparer, même s'il a des enfants. Une séparation est d'autre part apparue entre le rôle parental et l'identité sexuelle. Les femmes peuvent être aujourd'hui des pères de famille, sans que cela pose problème. De même, des hommes se comportent en mères de famille tout à fait convenables, ce qui n'était pas le cas il y a quarante ans. La troisième évolution repose dans la fragilisation du lien conjugal, le divorce étant banalisé et facilité. Quant aux familles monosexuées, on ne peut pas parler de nouveauté. Il y a toujours eu des familles monoparentales, ainsi que des familles matrifocales, l'enfant étant élevé par un couple formé de la mère et de la grand-mère. Le sexe des parents est-il déterminant pour l'évolution des enfants, et en particulier en ce qui concerne leur identité sexuelle ? Il n'est pas attesté qu'il ait une influence directe. Plusieurs travaux, notamment ceux de Robert Stoller, montrent que la structure communicative entre les parents joue un rôle beaucoup plus important, sans oublier le poids de la fratrie dans l'orientation sexuelle. Ce qui me semble déterminant pour un enfant entré dans sa famille par adoption - et qui n'est plus, je le souligne, un « enfant adopté » -, ce sont les qualités éducatives des parents, plus que leur sexe. Une qualité éducative est quelque chose que tout le monde n'a pas, c'est un goût, un investissement, un intérêt. La réussite de l'adoption implique de donner à l'enfant une identité filiative, de l'inscrire dans une filiation de transmission, d'où l'importance des grands-parents, qui est un facteur trop souvent sous-estimé lors de l'évaluation en vue de l'adoption. Il faut donner à ces enfants une « affiliation », c'est-à-dire leur permettre de devenir les enfants de leur famille, avec des droits, certes, mais aussi des devoirs, comme tout enfant. Ils ne doivent pas rester d'éternels accueillis. Une famille adoptante n'est pas une famille d'accueil. Beaucoup d'échecs sont liés au fait que les parents ont été tellement culpabilisés par le fait qu'on leur ait confié un enfant que celui-ci reste toujours à la porte de la famille, comme quelqu'un dont on doit s'occuper mais qui n'a aucune responsabilité dans le maintien de l'identité familiale. Il importe de donner à ces enfants les moyens d'entrer dignement dans la société une fois qu'ils auront grandi, qu'il s'agisse de leur permettre de fonder à leur tour un couple, une famille, ou de réussir leur insertion socioprofessionnelle. Il me semble, donc, que c'est ce critère éducatif qui devrait être déterminant pour permettre à une personne ou à un couple d'adopter un enfant. Je souligne à mon tour que si tout enfant a droit à une famille, aucun individu, aucun couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, n'a droit à un enfant. Mme Nadine Morano : Tous les exposés qui nous ont été présentés ont été extrêmement intéressants. Des divergences se sont manifestées, ce qui est l'un des intérêts de cette table ronde. L'existence de familles homoparentales est une réalité qu'on ne peut pas nier. La question est donc de savoir quel statut donner au concubin dans le but de permettre à l'enfant d'être en sécurité, y compris lorsqu'il s'agit de léguer des biens. La sécurité intègre en effet le problème de la succession, car le parent social, pour reprendre le terme employé par l'APGL, souhaite lui aussi transmettre ses biens à l'enfant avec qui il vit, et à l'éducation duquel il contribue. La question de l'adoption par le parent social des enfants vivant au sein de familles homoparentales se pose. Elle se pose également dans les familles recomposées en cas de décès du parent biologique qui n'avait pas la garde de l'enfant. Je note avec intérêt les propos de M. Neuburger, qui considère que l'essentiel n'est pas l'identité sexuelle des parents mais leur qualité éducative. À cet égal, je rappelle que 85 % des viols et des maltraitances ont lieu dans des familles traditionnelles. M. Yves Nicolin : L'homoparentalité semble être le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je pense que nous devons distinguer entre des situations très différentes. Lorsque des personnes de même sexe vivent ensemble, et que l'une d'elles a un enfant, il nous faut faire en sorte qu'il ait toutes les chances de s'épanouir et de construire sa vie familiale. Autre chose est la question de l'adoption par des couples homosexuels. Mme Peyré a eu raison de rappeler les chiffres : 40 000 adoptions par an dans le monde, pour plusieurs centaines de milliers de couples hétérosexuels candidats à l'adoption. Nous n'arrivons déjà pas à satisfaire le besoin de filiation de ces couples, ni à donner une famille aux enfants abandonnés. En France, 25 000 couples sont candidats à l'adoption, et nous n'arrivons à faire adopter que 5 000 enfants. Je suis tenté de dire que la priorité est de donner aux enfants un cadre familial le plus sécurisé possible, qui leur donne le plus de chances d'assumer le fait qu'ils ont été des enfants abandonnés. S'agissant de la revendication des couples gays et lesbiens, la question qu'il faut d'abord se poser est celle de l'intérêt de l'enfant, notion qu'il ne serait pas inutile de définir. Vous avez évoqué, M. Lévy-Soussan, l'arrivée d'un enfant biologique pendant la procédure d'agrément. Je rappelle qu'en cas de modification de la capacité de la famille à adopter, celle-ci doit en faire part au conseil général, lequel peut remettre en cause l'agrément. Je ne vois pas à quelle modification législative vous songiez. Il me semble que les choses sont suffisamment claires sur ce point. M. Patrick Delnatte : On entend beaucoup parler de l'intérêt de l'enfant, qui est une préoccupation primordiale pour tout le monde. On n'entend pas beaucoup parler de la voix de l'enfant. Il me semble que nous manquons d'analyses portant sur les conséquences pour les enfants des situations familiales extrêmement contrastées qui existent actuellement. Elles ont d'ailleurs également des conséquences pour la société, qui peut avoir à souffrir des carences éducatives constatées au sein des familles. S'agissant du conseil de famille, M. Muller, je souligne qu'il représente la société. La diversité actuelle de sa composition n'est peut-être pas satisfaisante, mais je ne suis pas convaincu par la réforme que vous semblez préconiser. M. Jean-Marc Nesme : Je voudrais faire un peu de droit. Jusqu'à nouvel ordre, la loi n'a pas vocation à refléter l'air du temps, et encore moins une mode. Le droit appartient à une société, et, plus généralement, à l'humanité. À la question de fond, celle de savoir quel est l'intérêt de l'enfant, le droit international répond. La Convention internationale des droits de l'enfant, qui a fait l'objet de plusieurs dizaines d'années de travaux, la Convention de La Haye de 1993, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous ces textes, sans contestation aucune, considèrent que l'intérêt bien compris de l'enfant est d'avoir un père et une mère, c'est-à-dire de pouvoir grandir dans l'altérité. Certains parmi vous souhaitent que le législateur inscrive dans la loi la possibilité pour des personnes homosexuelles d'adopter des enfants ou d'en avoir au moyen de techniques telles que la procréation médicalement assistée. En admettant que le Parlement français accède à ces revendications, comment notre pays pourrait-il résoudre le conflit juridique entre une loi qu'il adopterait et les textes et conventions internationaux qu'il a ratifiés ? Certains intervenants ont avancé comme argument, voire comme alibi, que certains autres pays ont déjà franchi le pas. C'est le cas de cinq ou six États sur les 191 que compte l'ONU. Sommes-nous à même de convaincre une majorité d'États siégeant à l'ONU de la nécessité de rejoindre la position qui serait éventuellement adoptée par la France ? Mme Michèle Tabarot : Les contributions de nos invités ont été passionnantes et ont clairement posé les problèmes. Je souscris à l'idée qu'il faut distinguer entre les situations de fait de personnes de même sexe vivant avec un enfant et l'adoption d'un enfant extérieur par un couple de même sexe. Quoi qu'il en soit, l'intérêt de l'enfant doit être au centre de nos préoccupations. À cet égard, on n'écoute peut-être pas suffisamment les enfants. Certains vivent l'adoption de manière douloureuse, même quand ils sont accueillis dans des familles aimantes. Quant aux études portant sur les enfants élevés par deux parents de même sexe, elles sont très contradictoires. L'adoption correspond à un abandon, qui l'a précédée, mais aussi à un déracinement quand il s'agit d'une adoption internationale. Peut-on, en plus, demander à l'enfant de supporter les mutations de notre société ? Enfin, le témoignage de M. Muller est important : 10 000 enfants ne sont pas adoptables alors que l'adoption serait pour eux une bonne solution. Notre législation n'a peut-être pas suffisamment évolué. Ne vaut-il pas mieux permettre l'adoption d'un enfant plutôt que de le faire passer de famille d'accueil en famille d'accueil ? M. Yves Nicolin : Sur ce point, je rappelle que la loi de juillet 2005 portant réforme de l'adoption, issue d'une proposition de loi dont Michèle Tabarot et moi-même avions été signataires, a permis de modifier l'article 350 du code civil. Celui-ci dispose que « l'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance ». Mais il est vrai que la question se pose régulièrement de savoir si ce délai d'un an est pertinent ou pas. Je souhaiterais connaître le point de vue de nos invités sur ce point précis. Mme la Rapporteure : S'agissant de la question de l'échec de l'adoption, pouvez-vous confirmer les chiffres publiés par l'hebdomadaire La Vie, selon lequel 20 % des enfants adoptés finissent à l'aide sociale à l'enfance ou font l'objet de mesures de protection ? D'autre part, M. Lévy-Soussan a longuement abordé les causes de l'échec de l'adoption. Nos autres invités ont-ils des témoignages ou des données sur ce sujet ? Certains de nos invités ont mis en cause le pouvoir du président du conseil général de revenir sur la décision de la commission d'agrément. J'imagine qu'il s'agit, dans leur esprit, d'éviter que des candidats à l'adoption puissent faire appel et obtenir satisfaction en faisant jouer leurs relations. Je souhaiterais obtenir des précisions sur ce point. Il a aussi été évoqué le fait que le juge peut annuler la décision de refus d'agrément du président du conseil général. Le droit de recours est un principe général du droit. Peut-on faire une exception pour les décisions d'agrément ? Le juge n'est-il pas impartial ? La commission d'agrément ne peut-elle pas se tromper ? M. le Président : J'ai été pour ma part très interpellé par des propos que l'on entend régulièrement et qui, à force d'être répétés, pourraient apparaître comme une évidence, selon lesquels un enfant adopté a déjà connu une situation difficile et qu'il faudrait éviter de le confier à un couple de même sexe au motif que cela constituerait un « handicap » supplémentaire. Cette idée a l'air de passer comme une lettre à la poste, et ce dans une société où l'image des couples homosexuels a pourtant beaucoup évolué ces dernières années. D'autre part, notre Mission a eu l'occasion de constater à l'étranger qu'un certain nombre de pays ont su faire faire évoluer leur droit de l'adoption - et apparemment sans craindre d'être isolés sur le plan international -. Nous avons recueilli des témoignages, notamment celui d'un jeune homme qui insistait très fortement sur le fait que son orientation sexuelle, hétérosexuelle en l'occurrence, n'avait en rien été influencée par le fait d'avoir été élevé dans une famille homoparentale. Dans les pays qui ont fait évoluer leur législation, c'est à partir d'une ouverture du mariage aux couples de même sexe que s'est faite l'ouverture de l'adoption par ces couples. Pensez-vous que c'est un passage obligé, ou qu'au contraire la question de l'adoption par des couples de même sexe peut être traitée indépendamment de celle du mariage ? Mme Frédérique Granet : Sur les questions relatives au droit international, j'abonde dans le sens de M. Nesme. J'ajoute qu'un autre texte insiste sur le droit qu'a l'enfant de faire entendre sa voix : il s'agit de la Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants, adoptée par le Conseil de l'Europe, mais non ratifiée par la France. Il a été évoqué le fait que quelques États étrangers ont permis l'adoption par un couple homosexuel. Mais nous n'avons aucun recul, car ces lois sont extrêmement récentes : aux Pays-Bas, cette disposition n'est entrée en vigueur que le 1er avril 2001. Aucune statistique n'est disponible, ni sur l'adoption par des partenaires enregistrés de même sexe, ni par des époux de même sexe. En Espagne, la législation en ce domaine est beaucoup trop récente, et il y aurait eu une vingtaine de mariages, mais pas encore d'adoptions. Au Royaume-Uni, les modifications législatives nouvelles ne sont pas encore entrées en vigueur. Ce sera le cas, en Angleterre et au Pays de Galles, en 2006. En Belgique, le code civil a été modifié par la loi sur le mariage homosexuel, mais l'adoption a été expressément réservée aux époux de sexe opposé. J'ajoute que, dans les pays où l'adoption par des couples de même sexe est possible, il est précisé que l'enfant doit avoir été abandonné sur le territoire national, parce que les pays étrangers, à l'exception de quelques-uns, ne remettraient pas un enfant à des couples de même sexe. Il ne me paraît donc pas possible de brandir sans nuance aucune l'argument des législations étrangères, et il serait imprudent de les copier sans avoir eu le temps d'évaluer les réalités concrètes de l'adoption. Faut-il modifier à nouveau l'article 350 du code civil ? Il me semble que le délai d'un an se justifie par le fait qu'il correspond au temps nécessaire pour assurer d'une coordination des informations entre les différents intervenants. Enfin, j'insiste à nouveau sur la nécessité de distinguer entre l'arrivée d'un enfant biologiquement étranger au couple de même sexe, et l'éventuelle adoption par le partenaire de l'enfant de l'autre. Mme Janice Peyré : S'agissant du délai au terme duquel un enfant peut être déclaré adoptable, il me semble qu'il serait intéressant, plutôt que de modifier la législation, d'envisager de manière plus audacieuse la politique de protection de l'enfance. Au Royaume-Uni, la création d'un registre national des enfants adoptables s'inscrit dans toute une politique de suivi des enfants, d'évaluation et de réévaluation régulière des situations dans lesquelles ils se trouvent. S'agissant des chiffres avancés par l'hebdomadaire La Vie, ils résultent de fuites très malencontreuses à propos d'une enquête qui était en cours. Cette enquête avait été bricolée sur un coin de table avec quelques crédits d'un ministère, sans travail préparatoire portant sur les questionnaires, et reposant manifestement sur des a priori : on avait déjà décidé à quels résultats l'enquête devait aboutir. Cet article de La Vie reposait sur des hypothèses, et non sur des résultats. Je crois me souvenir que les départements qui ont répondu à l'enquête ont pu trouver une soixantaine de cas où l'on pouvait parler d'échec de l'adoption, une soixantaine parmi tous les enfants adoptés au cours des dix-huit années précédant l'enquête. S'agissant du handicap supplémentaire que représenterait l'adoption par des parents de même sexe, c'est un fait que les enfants réagissent souvent de manière épidermique à tout ce qui peut ajouter au sentiment de différence qu'ils ressentent tout au long de leur vie. Il convient en outre de distinguer entre les enfants adoptés et les enfants conçus de diverses façons par l'un des membres du couple. S'agissant des décisions du président du conseil général, nous ne sommes pas opposés à la possibilité de recours. Ce qui nous gêne, c'est que la décision est parfois prise en raison de considérations locales. Accorder un agrément pour faire plaisir à quelqu'un, alors même que l'enquête sociale a été désastreuse et qu'elle restera dans le dossier, ce n'est pas lui rendre service. Mme Martine Gross : Certains ont rappelé l'écart entre la faiblesse du nombre d'enfants adoptables et l'importance du nombre de candidats à l'adoption. Mettre en avant ce fait lorsqu'il s'agit de légiférer au sujet des catégories de citoyens qui peuvent accueillir ou non un enfant, c'est établir une hiérarchie entre les « bons parents » et les « moins bons parents ». L'idée sous-jacente est que des parents homosexuels sont forcément moins bons que les autres. Mme Michèle Tabarot : On ne peut pas vous laisser dire cela. Ce qui a été dit, et c'est un simple constat, c'est que la majorité des pays où des enfants peuvent être adoptés refusent de les confier à des couples homosexuels, et qu'il ne faudrait pas que la France se coupe de ces pays. Cela étant, il n'y a pas à mes yeux, pas plus qu'aux yeux de mes collègues, des catégories de parents. Mme Martine Gross : On peut se borner à constater qu'il y a peu d'enfants adoptables. On peut se borner à constater que peu de pays accepteraient l'adoption par un couple de même sexe. Mais si ce constat devient un argument dans une discussion autour de l'ouverture de l'adoption aux personnes de même sexe, cet argument implique une hiérarchie entre diverses catégories de parents. D'autre part, certains disent qu'un enfant né au sein d'une famille homoparentale doit être protégé, mais qu'un enfant extérieur à un couple de même sexe ne doit surtout pas lui être confié. Je souhaite répondre à cet argument. En France, l'adoption par une personne seule qui ne dissimule pas son homosexualité est très difficile ; l'adoption par un couple non marié est interdite ; la procréation médicalement assistée est interdite pour un couple homosexuel. Au total, cet argument revient à dire que si les couples de même sexe arrivent à se débrouiller pour avoir un enfant, on fera en sorte que celui-ci soit protégé, mais qu'il ne faut surtout pas leur donner la possibilité d'avoir un enfant. En ce qui concerne les conséquences de l'homoparentalité sur le développement des enfants, on ne dispose que de peu d'études sur les enfants adoptés, car l'adoption par des couples de même sexe n'a été ouverte que récemment dans un certain nombre de pays. Cependant, à l'occasion du colloque que l'APGL a récemment organisé, un psychologue américain a fait état d'une étude sur des enfants adoptés vivant au sein de familles homoparentales américaines, les États-Unis disposant du recul suffisant. S'agissant des textes internationaux, il ne me semble pas qu'il y soit indiqué que l'intérêt des enfants est de vivre avec un père et une mère, mais avec ses deux parents. Tout dépend de la définition que l'on donne du mot parent. Les parents sont-ils ceux qui ont conçu l'enfant, ou ceux qui s'engagent à l'élever ? Quant à l'idée que nous serions isolés par rapport à la communauté internationale si nous introduisions dans notre législation la possibilité de l'adoption par des couples de même sexe, je rappelle que la France a adopté des dispositions relatives à l'accouchement sous X qui ne correspondent pas à la pratique dominante dans le monde. Les textes internationaux mentionnent que, dans la mesure du possible, les enfants doivent pouvoir accéder à leurs origines. Nous sommes l'un des rares pays à transgresser ces textes. Mme Frédérique Granet : Non. Si, dans l'affaire Odièvre, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas condamné la France, c'est précisément en raison de la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État. Mme Martine Gross : Nous espérons que la Cour européenne des droits de l'homme condamnera bientôt la France pour d'autres discriminations. Enfin, j'ai le sentiment que l'on parle assez peu des difficultés qu'un enfant peut éprouver devant des parents qui considèrent qu'il y a des hiérarchies entre différents types de filiation. L'idée qu'il est mieux de concevoir un enfant que d'en adopter un, que la seule « vraie » filiation serait celle du sang, me semble présente dans certains esprits. M. Jean-Marie Muller : S'agissant du délai d'un an prévu par l'article 350 du code civil, tout le monde serait très heureux s'il était respecté. Le problème est que, dans les faits, le délai réel est compris entre un et dix-huit ans. J'appartiens à une génération qui a connu la culture du retrait abusif. Les enfants d'aujourd'hui subissent le maintien abusif dans leurs familles d'origine. Entre ces deux extrêmes, il convient de rechercher une position médiane. En ce qui concerne l'échec des adoptions, je rappelle que les parents adoptifs ne sont pas meilleurs parents que les autres. L'adoption n'est pas une science exacte, et l'on n'y peut rien. S'agissant de la constitution de la famille, il est clair que des carences dans le repérage de la constellation familiale ont des effets directs et perturbateurs sur les enfants. Le conseil de famille, M. Delnatte, doit rester un lieu de débat contradictoire, où la question de la révision de la situation est toujours ouverte. Pour ce qui est de sa composition, je crois que nous pourrons trouver assez facilement un accord. Mme Nadine Pinget : Je voudrais rassurer Mme Gross sur le statut que les parents adoptifs reconnaissent à leurs enfants. Dans les familles où il y a des enfants adoptés et des enfants biologiques, ils ont tous le même rang. Il est tout à fait impossible d'imaginer l'inverse. M. Pierre Lévy-Soussan : Ce qui permet de répondre aux demandes actuelles concernant le statut de deux adultes de même sexe vivant ensemble, c'est bien la distinction entre ce qui relève de la filiation et ce qui relève de l'éducation. Ce qui est structurant pour un enfant, c'est un appareillage symbolique lui permettant de se définir comme fils ou fille de deux parents de sexe différent. L'adoption risque d'échouer lorsque l'enfant n'a pas pu identifier cette filiation psychique. Un autre facteur de risque réside dans le fait d'hypertrophier les origines biologiques de l'enfant. Bon nombre de couples adoptants se sentent fragilisés parce qu'ils sont persuadés de ne pas être les « vrais parents ». En toute rigueur, le terme « homoparentalité » ne renvoie à aucune réalité. Ce qui existe, ce sont des situations « homoéducatives », où des enfants ont un parent filiatif qui a un compagnon. Ces situations ne posent pas de problème d'un point de vue filiatif car les choses sont claires pour l'enfant, qui a un seul père ou une seule mère. La question est de savoir quel statut donner au compagnon de ce père ou de cette mère. Une chose est de s'interroger sur ce statut, autre chose est de remettre en cause l'institution filiative. D'autre part, et pour répondre à M. Nicolin, il arrive que des couples aient un agrément, engagent une procédure d'adoption à l'étranger, mais arrivent finalement à procréer durant le déroulement de cette procédure. Il arrive souvent, dans ces cas, qu'ils ne remettent pas en cause cette procédure. Il m'est arrivé de voir arriver simultanément un bébé et un enfant venant de l'étranger, que les parents n'avaient pas refusé alors qu'il leur était tout à fait possible d'arrêter la procédure d'adoption. S'agissant des échecs en situation adoptive, il est très difficile de les quantifier. Il importe, me semble-t-il, de distinguer ce qu'on appelle l'échec total, c'est-à-dire l'abandon de l'enfant qui a été adopté, et ce qu'on appelle un équivalent d'échec, qui correspond au cas où l'enfant est abandonné à lui-même. En Loire-Atlantique, une femme qui présentait tous les facteurs de risques - son âge, sa motivation humanitaire, son statut de célibataire, sa considération de l'enfant comme objet à posséder - a laissé l'enfant chez elle, a rempli le réfrigérateur et est partie. L'adoption n'est pas un handicap. C'est une chance qu'a un enfant d'intégrer une famille par l'adoption plénière, laquelle présente les meilleures garanties pour l'enfant. S'agissant de l'article 350 du code civil, le problème ne tient pas tant au délai qu'à l'idéologie dans laquelle cet article est appliqué. Bon nombre de personnes qui sont prisonnières d'une vision exclusivement biologique de la filiation retarderont les choses en refusant de couper les liens avec la famille d'origine. Concernant les études portant sur les enfants en situation homoparentale, je souligne qu'aucune étude n'existe portant sur un enfant dont le livret familial indique qu'il a deux pères ou deux mères. Il existe par contre des études portant sur des situations « homoéducatives », mais il est difficile d'en tirer des conclusions quant aux différences entre les enfants élevés par deux parents de même sexe et ceux élevés par deux parents de sexe différent. On constate que les enfants qui présentent le plus de différences par rapport à ceux qui ont été élevés par des parents de sexe différent sont les enfants que les adultes ont décidé de mettre dans l'intimité de leurs choix sexuels. On sait qu'une confrontation à une intimité trop vive avec la sexualité des parents, quelle que soit cette sexualité, a des conséquences sur l'enfant. Mme Gross a dit que les couples de même sexe ne souhaitent pas « faire semblant » d'avoir mis au monde des enfants. Dans ce cas, précisément, pourquoi retenir les termes de père et de mère ? Ces termes n'auraient aucune validité dans ce cas de figure. Il faut distinguer le statut de père et celui de compagnon du père. M. Robert Neuburger : Mon expérience de thérapeute familial m'a amené à rencontrer des familles hétérosexuelles. Depuis quelque temps, je rencontre des familles homoparentales. La première fois qu'une famille homoparentale a pris rendez-vous, j'étais persuadé que j'allais rencontrer une situation sortant de l'ordinaire. J'ai été affreusement déçu. Les problèmes que rencontrent les familles homoparentales sont d'une banalité totale. Mon expérience est certes limitée, et n'a pas de valeur statistique, mais il me semble important de souligner ce point. Je pense comme M. Lévy-Soussan que l'adoption n'est pas un handicap. C'est un mode d'entrée dans une famille comme un autre. À Tahiti, l'adoption est totalement banalisée. Dans l'archipel des Tuamotu, on peut trouver jusqu'à 60 % d'enfants adoptés par famille. S'agissant des causes de l'échec, j'ai été parfois confronté à des situations dramatiques dans les relations entre les parents et les enfants qu'ils avaient obtenus par adoption. À l'adolescence, il arrive que des enfants soient « normalement anormaux », tandis que d'autres sont « anormalement normaux ». Dans certaines situations adoptives, il arrive que des enfants soient « anormalement anormaux », en éprouvant des poussées de violence contre les parents qui obligent ceux-ci à se réfugier ailleurs. Dans ces familles, je n'ai rien trouvé d'anormal. Mais la greffe mythique n'avait pas pris : ces familles avaient continué à considérer cet enfant comme un enfant accueilli. Elles avaient fait passer le mythe de la vérité avant la greffe. Boris Cyrulnik a d'ailleurs bien montré que les choses peuvent très bien se passer dans les familles où l'on a caché aux enfants leur filiation adoptive, et plutôt mieux que dans celles où l'on a un peu trop parlé. Il faut que l'enfant se sente membre de sa famille. M. le Président : Connaissant l'importance des mots, je tiens à souligner que si j'ai employé le mot de « handicap », cela n'a pu être que par inadvertance, ou faute d'en trouver un plus adéquat. Mais à mes yeux, le fait d'être adopté n'est pas un handicap, pas plus que ne le serait le fait de l'être par une famille homoparentale. M. Yves Nicolin : Avant que vous ne concluiez cette table ronde, M. le Président, je tiens d'abord à formuler un regret. Alors que table ronde devait être consacrée à l'adoption, le débat s'est presque exclusivement concentré sur la question de l'adoption par les couples homosexuels. M. le Président : J'ai le sentiment exactement contraire. Il me semble que nous avons traité l'adoption dans tous ses aspects. M. Yves Nicolin : C'est une divergence entre nous. D'autre part, je voudrais revenir à la question des études portant sur les enfants élevés par des couples homosexuels. Il est trop facile d'invoquer ces études alors que j'ai plutôt le sentiment qu'elles sont extrêmement rares et peu élaborées. Dans son édition du 27 octobre dernier, le quotidien Le Monde faisait état d'une étude conduite par des psychologues de l'université de Séville. Il était rappelé que cette étude était fondée sur une enquête conduite auprès de seize jeunes. Voilà un échantillon qui me paraît assez limité. Le même article évoquait les travaux de M. Scott Ryan, professeur à l'Institut du travail social de l'université de Floride, qui a mené une enquête sur les familles adoptives homoparentales. Il précise être lui-même hétérosexuel, et affirme avoir tenté de dissiper un certain nombre de mythes sur l'homoparentalité et ses conséquences sur les enfants. Le journaliste rapporte les propos de M. Ryan : « Les homosexuels ayant adopté des enfants ne sont pas répertoriés aux États-Unis. J'ai donc passé des annonces dans les journaux, visité les associations gays ou lesbiennes, fait fonctionner le bouche-à-oreille. Dans ce contexte, mon échantillonnage n'est sûrement pas représentatif ». Je souhaiterais que notre Mission puisse disposer d'études. On nous en parle, mais on ne nous en montre aucune. M. Pierre Lévy-Soussan : Je vous ai fait parvenir les articles que j'ai écrits sur ce sujet, en particulier sur les études qui ont été réalisées. Je signale en particulier qu'une thèse de doctorat en psychiatrie a été faite sur ce sujet, dont l'auteur n'a pas rencontré les enfants, mais s'est contenté d'envoyer une lettre aux parents pour leur demander si les enfants se portaient bien. M. le Président : Je ne souhaite pas qu'au terme de cette table ronde, à un moment où il est trop tard pour engager un débat, on dévalorise toute étude faite sur ce sujet. Mais je lance une petite annonce : mission d'information parlementaire cherche étude désespérément... Mme Martine Gross : En 1997, l'APGL, devant le constant criant de l'absence d'études, du moins en France, en avait recensé plus de deux cents menées à l'étranger. Je puis faire parvenir à la Mission le petit livre qui les recense, avec leurs titres et leurs références bibliographiques. Je souligne que ces études sont régulièrement critiquées, soit parce qu'elles seraient biaisées, soit parce qu'elles reposeraient sur un échantillon non représentatif, soit parce que leur méthodologie serait insuffisamment rigoureuse. Je précise tout de même que l'étude de Stéphane Nadaud, puisque c'est à elle qu'il vient d'être fait allusion, a suivi un protocole tout à fait reconnu et validé au sein de la communauté scientifique, en dehors des milieux psychanalytiques. Je complèterai l'annonce faite par M. le Président : recherche étude qui montrerait le contraire de ce que nous avançons... Les études auxquelles nous nous référons ont au moins le mérite d'exister. M. le Président : Je vous propose d'en rester là sur ce point. Je préciserai seulement que, s'il n'est pas inutile que le législateur prenne en compte des études, il n'en reste pas moins qu'on ne légifère pas à partir d'études. Légiférer, c'est poser des normes en fonction de principes et de valeurs, donc à partir de critères différents de ceux utilisés par des travaux scientifiques. Table ronde, ouverte à la presse, « Progrès médicaux et filiation » réunissant M. le Président : Pour cette nouvelle table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir six intervenants : - M. Pierre Murat, professeur de droit à l'université de Grenoble II, spécialisé en droit civil et en droit médical ; - le professeur Claude Sureau, membre de l'Académie de médecine et du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; - le professeur Arnold Munnich, chef du service de génétique médicale de l'hôpital Necker ; - Mme Laure Camborieux, professeur agrégée de biochimie-génie biologique et présidente de l'association Maia chargée d'apporter aux personnes confrontées à l'infertilité un lieu de parole, d'échanges et de soutien ; - Mme Emmanuelle Révolon, membre de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens ; - Mme Geneviève Delaisi de Parseval, psychanalyste, consultante en bioéthique et spécialiste de la famille. Notre Mission est entrée depuis quelques semaines dans une deuxième phase de ses travaux, qui vise à organiser une série de tables rondes thématiques sur le droit de la famille. Nous avons décidé d'examiner l'organisation juridique de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, afin de vérifier si les droits de celui-ci sont suffisamment garantis par notre législation. Je vais donc vous inviter à répondre aux questions suivantes : faut-il modifier le droit de la filiation pour tenir compte des progrès scientifiques ? Faut-il élargir l'accès à la procréation médicalement assistée ? Faut-il faire évoluer la législation sur la gestion pour autrui ? Quelles solutions préconisez-vous pour les enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui ? M. Pierre Murat : J'ai pris les questions qui m'ont été posées comme point de départ d'une réflexion sur de nouvelles formes de parentalité. Le droit ne peut évidemment pas ignorer totalement le poids des faits, mais il ne peut pas non plus s'aligner purement et simplement sur ceux-ci. Aujourd'hui, un nombre non négligeable d'enfants sont conçus à l'étranger par le recours à des mères porteuses, pour vivre éventuellement dans un foyer homosexuel, ou naissent tout simplement de relations sexuelles « classiques » pour être éduqués dans un tel foyer. Faut-il aligner nos règles de droit sur ce fait ? La question n'est pas scientifique, elle est d'abord morale, même si elle ne se pose qu'en raison du développement de ces techniques, qui ont mis une certaine distance entre la relation sexuelle et la conception d'enfants. Le terme de parentalité, qu'on entend fréquemment, renvoie au rôle qu'un adulte peut avoir auprès d'un enfant. Il se distingue de la parenté qui renvoie à une généalogie et à des liens croisés, qui entraînent des contraintes juridiques. Bien sûr, ils peuvent se superposer dans la mesure où la fonction de parentalité est le plus souvent remplie par les parents au sens étroit du terme et, donc, par la parenté. Dans le contexte qui nous intéresse, il n'est pas sûr que la filiation soit le lien le plus approprié pour les nouvelles formes de parentalité. Pour autant, on ne saurait se contenter de l'absence actuelle de lien. L'homoparentalité risque de dénaturer les conceptions actuelles du lien de filiation, qu'elle soit biologique ou élective. En outre, si on élargit la procréation médicalement assistée en admettant, par exemple, les inséminations de convenance, on risque de conforter l'inégalité naturelle entre les hommes et les femmes, lesquelles sont les seules à pouvoir porter un enfant, et donc entre les couples d'hommes et les couples de femmes. Afin d'établir un lien juridique entre l'enfant et le membre d'un couple de femmes qui n'est pas la mère, on pourrait, à l'instar du droit québécois, admettre une présomption de co-maternité. Mais, si l'on veut qu'il y ait égalité entre les types de couples homosexuels, il faut accepter alors de faire jouer un rôle à la gestation pour autrui, appelée également maternité de substitution. Or la Cour de cassation en 1991, puis la loi en 1994 l'ont prohibée. De fait, ce type de maternité porte atteinte à deux valeurs essentielles, protectrices de la dignité humaine : d'une part, l'indisponibilité du corps humain, plus précisément l'indisponibilité de la faculté de procréation de la femme ; d'autre part, l'indisponibilité de la filiation. Accepter de telles maternités, c'est mettre dans l'échange, fût-ce à titre gratuit, les facultés gestatrices de la mère. C'est permettre qu'on puisse transférer des liens de filiation en dehors de processus jusqu'à présent contrôlés - socialement, en cas d'adoption -. C'est introduire dans le droit de la filiation, qui est actuellement accordée de l'extérieur, une possibilité de contractualisation. On quitterait ainsi le terrain de la filiation institutionnelle pour entrer dans celui des filiations par convention. Il existe en outre un risque de dénaturation de l'adoption. Actuellement, la loi française ne permet l'adoption qu'à des couples mariés. La Cour européenne des droits de l'homme, appelée à trancher en raison de certaines réticences à accorder l'agrément pour des raisons d'homosexualité, a estimé que les autorités françaises avaient pu raisonnablement considérer que l'adoption trouvait sa limite dans l'intérêt des enfants susceptibles d'être adoptés, nonobstant les aspirations légitimes du requérant, et sans que soient remis en cause les choix personnels de ce dernier. L'adoption a été conçue, au moins depuis le XXème siècle, comme une institution de protection de l'enfance, destinée à donner une famille de remplacement. La Convention internationale des droits de l'enfant, visant l'adoption dans son article 21, stipule qu'on doit s'assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière. Permettre l'adoption à un couple homosexuel est-il compatible avec l'intérêt de l'enfant ? Aujourd'hui, les données dont nous disposons en matière psychologique nous incitent à la prudence, ce qui ne signifie pas qu'il ne faille rien faire. L'enfant d'un des partenaires homosexuels peut-il être adopté par l'autre partenaire ? Le cas s'est déjà présenté. En l'occurrence, le tribunal de grande instance de Paris a admis l'adoption simple de l'enfant d'une femme homosexuelle pacsée. On a un peu l'impression d'un montage destiné à contourner le droit français. L'adoption simple n'est pas faite pour répondre à des situations d'homoparentalité. J'en veux pour preuve que, dans ce cas précis, une deuxième décision portant sur le partage de l'autorité parentale a été nécessaire. Cela dit, la création d'un lien juridique entre la seconde personne du couple et l'enfant qui lui était étranger n'était pas inintéressante pour leur vie quotidienne. On peut par ailleurs se demander si la filiation qui découle de l'adoption simple n'a pas un caractère excessif. Elle est valable toute la vie et emporte, au-delà de la majorité de l'enfant, des droits alimentaires et successoraux. Or, d'ici là, il peut se passer bon nombre d'évènements. L'adoption ouvre l'accès à la filiation et à un statut familial qui peuvent paraître surdimensionnés par rapport à ce que souhaite le couple homoparental. Il conviendrait peut-être de réfléchir à des statuts loco parentis, pour reprendre l'expression utilisée chez les Anglo-Saxons, où des tiers sont traités comme des parents par analogie, mais ne sont pas juridiquement des parents au sens plein. Ces tiers jouent auprès de l'enfant un rôle très important, qui a besoin d'être reconnu socialement et juridiquement, mais ils ne sont pas désignés comme des parents. Ce statut correspond à la notion de parentalité. Dans notre législation, la tendance existe. Elle a été renforcée en 2002 par la réforme de l'autorité parentale, dont elle permet le partage par jugement. Ce partage n'a pas été fait pour les couples homosexuels mais pour les familles recomposées classiques. Pour autant, rien n'interdit aux couples homosexuels d'utiliser cette possibilité. La piste mériterait d'être creusée. Un parallèle peut être fait avec les pays qui ne connaissent pas l'adoption et qui utilisent, de ce fait, des substituts comme la kefala. Dans notre système juridique, existait dès 1804, avant que l'adoption soit ouverte pour les mineurs, la tutelle officieuse, qui permettait de s'attacher à un enfant pendant sa minorité par un titre légal ; elle emportait l'obligation de nourrir le pupille, de l'éduquer et de le mettre en état de gagner sa vie ; elle permettait au tuteur d'administrer ses biens ; enfin, le passage à l'adoption pouvait être facilité. Une solution de ce type présente certains avantages : c'est une réponse mesurée à la pression des faits. On ne peut pas continuer à se voiler la face et à refuser d'imaginer des situations qui apparaîtront tôt ou tard. Je prendrais l'exemple d'un enfant conçu à l'étranger mais se trouvant en France : s'il perd un de ses parents, il risque de se trouver dans une situation inextricable. Or il n'a pas à faire les frais de l'ordre public et de la défense de certaines valeurs fondamentales. Quand il s'agit de choisir entre l'ordre public et l'intérêt de l'enfant, il n'y a aucune hésitation possible. La réponse doit-elle pour autant être placée sur le terrain de la filiation ? Personnellement, je n'en suis pas sûr, car cela reviendrait à faire pencher la balance de la filiation du côté de la volonté. Or, si la filiation ne se réduit pas aux liens biologiques, l'ancrer dans la volonté, dont on connaît le caractère délétère, est tout aussi problématique. L'avantage du lien biologique, c'est qu'il est définitif. N'oublions pas non plus que les couples homosexuels ne sont pas davantage définitifs que les couples hétérosexuels. En cas d'échec, l'enfant sera encombré par une filiation qui ne sera plus du tout vécue. De telles situations existent au sein des couples hétérosexuels, mais l'ancrage biologique de la filiation préserve son caractère définitif. Cela dit, les cas de réussite sont possibles. Les statuts fondés sur une délégation de l'autorité parentale auraient alors l'avantage d'amener de façon préférentielle vers l'adoption. On pourrait même imaginer que ce soit l'enfant qui, au moment de sa majorité, prenne la décision de transformer ce lien de tutelle en un lien de filiation. Cela permettrait de ne pas lui imposer une filiation qui se ferait sans son avis et sous une forme encore très expérimentale. Enfin, sur le plan législatif, et si l'expérience s'avère positive, il sera toujours temps de modifier les structures de la parenté, c'est-à-dire le droit de la filiation. M. le Président : Merci de nous avoir rappelé avec force l'esprit du code civil. Cela dit, nous avons déjà organisé une table ronde sur l'adoption. Je demande aux autres intervenants de centrer leur propos sur les questions liant progrès médicaux et filiation. M. Claude Sureau : Je tiens à préciser que je m'exprime en mon nom personnel, et que mes propos n'engagent ni l'Académie de médecine, ni le Comité consultatif national d'éthique, sauf sur un point que je développerai ultérieurement. En tant que praticien, j'aborderai des cas concrets. M. Murat a rappelé la situation juridictionnelle de la gestation pour autrui, notamment depuis l'arrêt de la Cour de cassation de 1991. Je considère pour ma part qu'il est probablement temps de mener une réflexion sur le sujet. Mon co-rapporteur au sein du Comité national d'éthique, Mme Gaumont-Prat, a écrit un article remarquable sur l'opposition entre l'intérêt de l'enfant et le respect de l'ordre public. En cas de maternité de substitution, si l'adoption continue d'être refusée à la mère d'acceptation, on peut se demander où seront envoyés les enfants si le père décède. Dans le cas soumis au tribunal de grande instance de Créteil, les jumelles nées en Californie et élevées en France risquent d'être remises à l'aide sociale à l'enfance. Qu'en est-il alors de l'intérêt des enfants ? Cela dit, il faut entrer un peu plus avant dans le phénomène biologique et technique. On parle en général de maternités de substitution. Il en existe en fait plusieurs formes. En particulier, la gestation pour autrui permet à un couple dont la femme est dans l'incapacité de mener une grossesse à terme mais a des ovaires, et dont le mari a des spermatozoïdes, de procéder à une fécondation in vitro, avec transfert de l'embryon dans l'utérus d'une femme porteuse, puis récupération de l'enfant par les parents génétiques. Cette situation diffère de la gestation pour autrui associée à une procréation pour autrui. Dans ce cas, en effet, il peut y avoir don d'ovocytes par la porteuse ou une personne étrangère, et don de spermatozoïdes par le père ou une personne étrangère. Ainsi, en partant de la situation simple et très cadrée de la gestation pour autrui avec trois intervenants, on pourrait aller jusqu'à quatre ou cinq intervenants : le couple commanditaire, une mère porteuse, une donneuse d'ovocytes et un donneur de spermatozoïdes. Il devient donc diaboliquement incertain de déterminer les origines biologiques de l'enfant. En tout état de cause, il me semble qu'à l'heure actuelle, dans le droit français, l'intérêt de l'enfant n'est pas suffisamment pris en considération. S'agissant du double don de spermatozoïdes et d'ovocytes, je regrette qu'une telle possibilité n'ait pas été incluse dans les lois de 1994 et de 2004. Il me semble paradoxal d'accepter le don ou l'accueil de l'embryon, et de récuser le double don. Car on peut penser qu'il s'agit dans les deux cas d'un acte généreux, destiné de permettre à un couple stérile d'avoir un enfant. Sans présumer de ce que dira le Comité national d'éthique, il est clair qu'une réflexion s'exerce en ce sens. La connaissance des origines et la levée de l'anonymat pour les dons de sperme et d'ovocytes est une question très délicate. Faut-il pousser les couples qui recourent à ces dons de gamètes à informer leur enfant sur les modalités de sa procréation ? Faut-il aller jusqu'à la levée totale de l'anonymat ? Personnellement, je suis très réservé, et j'ai très peur des conséquences psychologiques qui pourraient en découler. Je signale à votre attention l'expérience du double gate, menée en Nouvelle-Zélande : le couple demandeur peut recourir à des gamètes d'origine connue ou inconnue ; les donneurs de gamètes peuvent quant à eux choisir entre un don anonyme et un don non anonyme. Un tel processus a l'avantage de garantir la liberté de choix des individus. Cela dit, je ne sais pas exactement où en est la Nouvelle-Zélande, et je dois reconnaître que le système du double gate a été abandonné en Hollande. J'ai été choqué par le fait que la procréation médicalement assistée (PMA) ait été limitée, par les lois de 1994 et de 2004, aux couples mariés ou vivant en concubinage depuis deux ans, comme si le mariage était une garantie de pérennité ! Pour quelle raison la loi française interdit-elle le recours à la PMA à une célibataire ? En tant qu'accoucheur ayant vécu toute sa vie au contact des femmes, patientes ou personnels féminins des services dans lesquels je travaillais, je ne compte plus le nombre d'enfants merveilleusement élevés par des femmes célibataires. D'ailleurs, la loi française autorise l'adoption par une personne seule. Comment, dans ces conditions, résoudre le problème de la célibataire stérile ? Dans certaines circonstances, je crois qu'il faut assouplir la loi française et autoriser, en l'encadrant, le recours à la PMA pour les célibataires. Franchement, je ne sais pas s'il faut autoriser la PMA chez les homosexuels. Les expériences dont nous avons connaissance, notamment en Belgique, semblent être positives. Mais ces expériences sont relativement récentes et je me rallierais volontiers à l'opinion de M. Murat, selon laquelle il est prudent d'attendre d'y voir plus clair. La situation des transsexuels est différente. Elle est simple sur le plan juridique : une fois que le transsexuel a changé de sexe, il peut adopter. Mais si le transsexuel avait déjà eu des enfants avant de changer de sexe, j'imagine mal la cohabitation entre les premiers enfants et les autres. Je dois pouvoir dire d'emblée que le Comité consultatif national d'éthique s'opposera à la possibilité pour une personne, née après accouchement sous X, de retrouver ses origines en s'adressant, après le décès de sa mère, au Conseil national d'accès aux origines personnelles. Si la mère biologique a refusé le contact avec son enfant, le processus est évidemment bloqué. Mais si elle meurt sans avoir fait savoir qu'elle maintient son opposition à la levée du secret, le droit en vigueur permet à l'enfant d'accéder à son identité, et on risque d'assister à une violation de la confidentialité mettant en péril l'équilibre de la famille secondaire de la mère. Personnellement, cela me choque. Enfin, mesdames et messieurs les parlementaires, s'il y a dans les lois de 1994 et dans la loi de 2004 un point qui, en matière de filiation, est profondément choquant, à mes yeux inadmissible et humainement tragique, c'est le refus du transfert posthume d'embryon ! Nous en avons eu un exemple tristement célèbre à Toulouse où un couple, vivant au moment de la procréation, avait conçu un enfant par fécondation in vitro. Le père est mort et la loi française a interdit à la mère procréatrice d'accepter cet embryon dans son utérus, de mener la grossesse à son terme et d'élever cet enfant. Un certain nombre d'institutions, et non des moindres, l'Académie des sciences morales et politiques - l'Académie de médecine, le Comité consultatif national d'éthique, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Conseil d'État par le rapport Théry-Salat-Baroux, l'Assemblée nationale elle-même en première lecture - ont reconnu la légitimité de la levée de l'interdiction du transfert posthume. Or, pour des raisons que je crois comprendre et que je trouve perverses, les assemblées ont rétabli cette interdiction, en condamnant un orphelin de père à devenir un orphelin de père et de mère. Imaginez ce que vous direz aux enfants s'ils vivent après avoir été transmis à un autre couple : vous étiez désirés par vos parents, notamment par votre mère après la mort de votre père ; votre mère voulait vous porter et vous élever ; mais par un étrange respect de l'ordre public, on a décidé que vous seriez élevés par un couple d'accueil ! Je souhaite bien du plaisir au président de la chambre civile de la Cour de cassation et au ministre qui a été à l'origine de cette disposition, lorsqu'ils auront à expliquer à ces enfants pourquoi ils n'ont pas été élevés par leur mère ! M. Arnold Munnich : Je vais parler ici en professionnel de terrain. Je dirige un service de génétique médicale, qui a pour mission de reconnaître les bases génétiques des maladies. On essaie d'apprécier la maladie dont un patient est porteur, pour en optimiser la prise en charge et rendre éventuellement possibles la prévention, le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire. À ce titre, nous rencontrons environ 5 000 couples par an à l'hôpital Necker qui est le plus grand centre de génétique médicale en France. Nous avons observé que 10 à 15 % des couples font l'expérience de l'infécondité au cours de leur vie commune. La stérilité devient un problème numériquement important, et de moins en moins bien toléré par les couples, qui considèrent comme un droit d'avoir un enfant biologique. C'est à peine si, lors des consultations, on peut prononcer le mot « adoption »... L'échec de la science est de moins en moins bien supporté, et l'opinion est fascinée par elle. À ce propos, M. le Président, je dois dire que j'ai été surpris par la formulation suivante : « Faut-il modifier le droit de la filiation pour tenir compte des progrès scientifiques ? ». Cette question laisse penser qu'il existe un droit à géométrie variable, en fonction de l'évolution des connaissances. Pour moi, le droit est le droit. On ne saurait modifier la loi, qui doit être universelle, en fonction de situations particulières et parfois transitoires. Quoi qu'il en soit, pour résoudre ces problèmes d'infécondité, on recourt davantage à la PMA, aux dons de sperme et d'ovocytes, et le diagnostic génétique préimplantatoire dans le cadre des PMA est de plus en plus fréquent. Dans un tel contexte, les demandes d'accès aux informations sur les origines sont exceptionnelles. En revanche, on rencontre de telles demandes dans le cadre de l'adoption. Je vous précise que la loi ne nous autorise pas à recourir aux techniques de la génétique moléculaire pour établir la filiation. Ce qui signifie que tout ce qui est techniquement possible n'est pas nécessairement applicable, souhaitable et légal. Les personnes déçues pratiquent le nomadisme médical. Elles vont chercher dans les pays limitrophes la réponse que le droit nous interdit de donner aux problèmes qu'elles rencontrent. Cela dit, nous ne nous contentons pas de fournir des réponses négatives. Nous offrons un espace d'écoute et de dialogue dans le cadre de la consultation, le plus souvent avec des psychologues et des psychanalystes, afin de déterminer quelle est la véritable question derrière la demande immédiate. Le don de gamètes est anonyme, et cet anonymat est absolu. Je le comprends car le principe de gratuité doit prévaloir, ne serait-ce que pour des raisons kantiennes. Par ailleurs, l'anonymat encourage le don. Sa levée pourrait dissuader les donneurs et donneuses potentiels qui craindraient d'être poursuivis en vue d'établir une filiation et de devoir répondre à toutes sortes de revendications. À mon sens, il n'est donc pas souhaitable d'amender la législation et de lever l'anonymat qui prévaut s'agissant des dons de gamètes. Ne cédons pas à la fascination scientifique qu'on voit poindre dans l'énoncé de votre question. Encore une fois, le droit est le droit, il n'est pas à géométrie variable et les méandres de la science ne devraient pas le modifier. Dans cette recherche de filiation, faire abstraction de tout ce qui fait le sujet - de son environnement et du processus d'adoption qui existe dans toute naissance - pour le réduire à un produit biologique est une manière de céder à cette fascination scientifique. Or le sujet ne se limite pas à quelques molécules d'ADN. Ce serait avoir une bien piètre image de l'être humain. Si la question de la filiation et de la recherche des origines se fait de plus en plus aiguë, c'est parce que tout ce qui composait l'humain en termes de culture, d'éducation et de religion s'est effrité et qu'il ne reste plus qu'une réalité : la réalité biologique. Amender la loi pour ne voir dans le sujet qu'un produit de la fécondation du donneur constituerait une régression. Je souhaite que le législateur ne revienne pas sur les dispositions actuelles, qui donnent toute sa noblesse au don et permettent le plein essor de la parentalité. J'aimerais revenir sur l'extension de la PMA, dans le cadre du diagnostic génétique préimplantatoire. J'ai perçu dans la façon dont on a représenté le typage HLA dans le cadre du DPI une certaine dramatisation, une mise en scène contraire à une réflexion sereine. Si l'embryon - ou ses annexes, comme le sang du cordon - peut aider à soigner un frère ou une sœur qui lutte contre une maladie, on a non seulement le droit, mais le devoir d'intervenir. Certes, il est inutile de modifier la loi universelle pour régler des cas particuliers qui sont très rares. Mais il faudrait que le dispositif réglementaire nous autorise à typer les embryons qui pourraient être des donneurs de sang, dès lors qu'il y a un bénéfice pour le sujet. Le fait que les décrets ne soient toujours pas parus atteste de la frilosité des ministères. Cette disposition n'a pas encore bonne presse, parce qu'on craint son extension à d'autres pratiques. Or le nombre de centres est très limité, les indications très réduites et les cas de figure encore plus rares. Comme M. Sureau, je pense que trop d'éthique tue l'éthique. M. le Président : Permettez-moi d'observer que, loin de s'être montré frileux, le législateur a été volontaire, comme le montre l'amendement déposé par Mme Pécresse et M. Fagniez. Mme Laure Camborieux : Beaucoup a déjà été dit à propos de la gestion pour autrui. Si l'association Maia préfère ce terme, c'est que celui de « mère porteuse » était utilisé lorsque, dans les années 1980, des couples stériles entraient en relation avec des femmes et que celles-ci, inséminées avec le sperme du père intentionnel, portaient un enfant puis lui donnaient naissance et le confiaient ensuite au père, la mère intentionnelle l'adoptant. En général, la « mère porteuse » n'avait aucun contact ni avec le couple ni, ensuite, avec l'enfant ; aucune procédure ne permettait de s'assurer ni de son consentement éclairé ni de son suivi médical et psychologique après la naissance. Cette pratique, que nous jugeons inhumaine, a suscité une grande réprobation ; elle a été condamnée par la Cour de cassation en 1991 et interdite par la loi de bioéthique de 1994. La gestation pour autrui telle qu'elle est actuellement pratiquée dans d'autres pays que la France n'a que bien peu à voir avec celle des mères porteuses de jadis. Elle se déroule dans un cadre législatif protecteur qui garantit le consentement éclairé de la gestatrice et du couple intentionnel. Dans la presque totalité des pays qui ont légalisé cette pratique, elle n'est admise que si au moins un des parents est le parent génétique. L'hypothèse d'une gestation mettant cinq personnes en relation n'est possible qu'en Californie. De même, tous les pays n'autorisent pas que la gestatrice puisse aussi être la mère génétique de l'enfant, comme cela se pratique en Angleterre, et, sur ce point, nous émettons nous-mêmes des réserves. Aux États-Unis, les médecins le déconseillent et préconisent, si la mère intentionnelle n'a pas d'ovocyte, le recours à une donneuse, de manière à séparer la fonction de génitrice et celle de gestatrice. Actuellement, dans tous les pays où la gestation pour autrui est légalisée - sauf en Russie, où un strict anonymat est de rigueur -, les contacts entre le couple intentionnel et la mère gestationnelle sont encouragés pour favoriser la création de liens antérieurs à la naissance et humaniser la pratique. Le plus souvent, ces relations sont de très bonne qualité et se poursuivent bien au-delà de la naissance. C'est très important, car l'enfant grandissant cherchera peut-être à savoir pourquoi une femme a décidé de le porter et dans quel contexte ; il n'est pas souhaitable de l'empêcher de trouver les réponses à ces questions. Les contacts au cours de la gestation pour autrui se passent généralement bien, sous réserve que d'indispensables précautions préalables aient été prises. Il faut en effet s'assurer que la gestatrice est apte, médicalement et psychologiquement, à suivre ce parcours, et il faut qu'elle ait été conseillée sur le plan juridique. Quant aux parents intentionnels, ils doivent se trouver confrontés à une infertilité avérée entraînant l'impossibilité pour la femme de mener une grossesse, et non choisir cette méthode par convenance personnelle. Mme la Rapporteure : Qu'advient-il si l'enfant naît handicapé ? Mme Laure Camborieux : Les législations les plus intéressantes sur ce point sont celles par lesquelles les parents intentionnels sont tenus de prendre l'enfant en charge dès la conception, la gestatrice étant dégagée de tout devoir et de toute responsabilité. Ce n'est pas le cas en Angleterre, pays dans lequel le parental order, procédure spécifique, opère le transfert de responsabilité au père, puis à la mère intentionnelle après l'accouchement, la gestatrice n'étant dégagée de sa responsabilité qu'à ce moment. Mais en Grèce et en Afrique du Sud, rien ne peut être entrepris sans qu'un dossier complet ait été soumis à un juge, qui doit donner son accord au traitement médical tendant à une gestation pour autrui. À partir du moment où l'équipe pluridisciplinaire a accepté de lancer le traitement médical, les parents intentionnels sont désignés comme responsables de l'enfant, quoi qu'il arrive. Ce modèle nous semble être le plus sécurisant. Quelle est la situation actuelle dans notre pays ? Les couples qui ne peuvent bénéficier d'une gestation pour autrui en France y ont recours dans les pays où la pratique est légale. Dans ce cas, l'enfant naît à l'étranger et la filiation, reconnue par un juge compétent selon la législation du pays considéré, est établie au bénéfice des parents intentionnels. Mais cette filiation n'étant pas reconnue dans notre pays, que se passerait-il si les parents décédaient ? Grands-parents, oncles et tantes n'auraient aucune légitimité juridique leur permettant de recueillir les enfants et de les élever. Fort heureusement, nous n'avons pas connaissance de tels cas à ce jour, mais il ne faut pas attendre d'avoir à en connaître pour sécuriser ces filiations et ces familles. En outre, tous les couples ne disposent pas de ressources suffisantes pour partir à l'étranger et bénéficier de ces législations protectrices. Certains se lancent donc dans l'aventure en France même. Dans le cas le plus favorable, le couple et la gestatrice potentielle se rendent en Angleterre ou en Belgique pour procéder à une fécondation in vitro, ce qui leur permet au moins de bénéficier d'un encadrement psychologique et juridique préalable au traitement médical qui, en cas d'accord de l'équipe pluridisciplinaire, se fera dans le pays considéré. Mais la grossesse et l'accouchement auront lieu en France, si bien que le couple aura les plus grandes difficultés pour faire établir la filiation au bénéfice de la mère intentionnelle. Sur le plan juridique, l'enfant aura, au mieux, un père ; il aura aussi une mère « sociale » qui l'élèvera et qui, souvent, sera sa mère génétique, mais avec laquelle il n'aura aucun lien juridique. Il se produit aussi que la future gestatrice soit inséminée de manière « artisanale », à domicile, par le sperme du père intentionnel. Cela ne laisse pas d'inquiéter, car il n'y a alors aucun encadrement médical, psychologique ou juridique. Qu'en est-il, dans de tels cas, du consentement éclairé ? Le développement du réseau internet a rendu extraordinairement faciles les contacts entre des femmes qui se proposent de devenir gestatrices pour des raisons plus ou moins saines et des parents intentionnels dont les motivations ne sont pas toujours limpides. Tout cela est extrêmement dangereux et, même si ce n'est pas une raison suffisante pour légiférer, il faut en tenir compte. Aussi bien, quand une solution aura été trouvée pour les enfants déjà nés, il faudra réfléchir à l'élaboration d'une législation permettant à l'État de contrôler ce qui se passe et d'apporter aux gestatrices et aux parents intentionnels le soutien et les informations nécessaires. M. Pierre Murat a exposé que, si on légalisait, on changerait de registre, entrant dans une filiation fondée sur la volonté qui empêcherait tout contrôle. Ce n'est manifestement pas le cas à l'étranger, où les systèmes juridiques mis au point permettent le contrôle. On doit pouvoir, en combinant les acquis des expériences étrangères, trouver une solution acceptable avant que de graves problèmes surgissent. Chacun a en mémoire l'affaire de Créteil dans lesquelles des jumelles à présent âgées de six ans n'ont toujours pas de filiation établie. Une telle instabilité n'est souhaitable pour aucun enfant ni pour aucune famille. Je souhaite revenir sur les questions du secret, de l'anonymat au moment du don et de l'accès aux origines, questions souvent confondues alors qu'elles sont distinctes et doivent être dissociées. M. Claude Sureau a semblé douter de la pertinence de la levée du secret, et M. Arnold Munnich a exposé que très peu d'enfants cherchent à savoir. Or, des études étrangères estiment que de 10 à 15 % seulement des enfants issus de PMA par don ont été informés du moyen de leur conception. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'ils ne demandent pas d'informations sur leurs origines ! Mais les contacts quotidiens que nous entretenons avec les familles nous ont convaincus que, plus le temps passera, moins ces secrets pourront être gardés. Quels que soient les efforts d'appariement réalisés pour choisir des donneurs aux caractéristiques physiques proches de celles des parents intentionnels, des différences se manifestent que nul ne sait expliquer à l'enfant. Il peut aussi arriver qu'ayant à traiter une pathologie particulière, un médecin pose des questions sur les antécédents médicaux familiaux. Je ne pense pas que le secret puisse être gardé, et je ne pense pas non plus que garder le secret contribue à la construction sereine d'une famille. Les parents qui s'engagent dans un processus d'adoption savent dès le départ que l'enfant qu'ils adopteront pourra éventuellement demander l'accès à ses origines lors de sa majorité. Ils le projettent et l'acceptent. Pourquoi en irait-il autrement en cas de don ? Il faut, à mon sens, dissocier la question de l'anonymat au moment du don et celle de l'accès aux origines. En effet, je ne considère pas comme une priorité l'idée de revenir sur l'anonymat au moment du don, car le don de gamète est un mécanisme personnel complexe ; cela étant, il faudra réfléchir sur la possibilité d'opter ou non pour l'anonymat au moment du don, choix qui est d'ores et déjà offert aux donneuses en Belgique. En revanche, il me semble important d'avancer dans la voie de l'accès aux origines, possibilité donnée par la Suède, le Canada, la Nouvelle-Zélande et, récemment, la Grande-Bretagne. Dans ces pays, l'anonymat du don a été conservé mais, à sa majorité, l'adolescent qui le souhaite a accès à des données identifiantes, et il peut rencontrer le donneur si celui-ci le veut bien. La France ne pourra faire l'économie d'une réflexion sur ce point. De nombreux parents ne souhaitent pas garder le secret sur le mode de conception de leur enfant, mais ils le font parce qu'ils craignent que, faute d'explications sur les motivations du donneur, la révélation des origines soit perturbante. En d'autres termes, c'est parfois l'impossibilité de lever l'anonymat du don qui pousse les parents à maintenir le secret. Il faut y réfléchir, d'autant que les exemples néo-zélandais et suédois montrent que la levée de l'anonymat du don ne fait pas chuter le nombre des donneurs. Enfin, certaines publications font état de donneurs ayant donné sous le régime de l'anonymat et qui, vingt ans plus tard, souhaitent eux-mêmes revenir sur cet anonymat. Mme Emmanuelle Révolon : L'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) souhaite la reconnaissance des trois volets de la filiation - biologique, légale et sociale - indépendamment des progrès scientifiques. Cette reconnaissance vise à garantir l'intérêt de l'enfant afin qu'il puisse accéder, dans la mesure du possible, à une information sur ses origines, qu'il bénéficie d'une filiation sûre et indépendante des choix de vie des adultes et que les liens tissés avec les personnes qui l'élèvent soient protégés. Vous nous avez demandé s'il faut élargir l'accès à la procréation médicalement assistée. L'APGL voit dans la formulation de la question une source d'espoir, à la fois parce que le débat est ainsi posé, mais aussi parce qu'il est fait référence à la procréation médicalement assistée (PMA) et non à l'assistance médicale à la procréation (AMP). Rappelons qu'en 1994, dans la loi de bioéthique, le législateur a remplacé le terme « procréation médicale assistée » par « assistance médicale à la procréation », affichant clairement sa préférence pour la reproduction du schéma traditionnel du couple dans lequel l'assistance à la procréation sert à surmonter l'infertilité naturelle. Il a justifié cette position par son souhait « de donner à l'enfant à naître l'environnement affectif le plus naturellement susceptible d'assurer son épanouissement et de rejeter corrélativement toute reconnaissance d'un quelconque droit à l'enfant ». Pour notre part, nous ne sommes pas convaincus que l'environnement affectif le plus susceptible d'assurer l'épanouissement d'un enfant soit uniquement celui qui reproduit le schéma traditionnel. Voilà pourquoi nous demandons l'élargissement de l'accès à l'AMP à toute personne pouvant justifier d'un projet parental cohérent. Nous souhaitons que toute technique de procréation proposée, pour l'instant, exclusivement aux couples de sexe différent qui ne peuvent concevoir un enfant ensemble soit permise à tous les couples et à toute personne en âge de procréer. Si certaines techniques pour concevoir des enfants sont autorisées, elles doivent l'être à toute personne justifiant d'un projet parental cohérent et s'engageant à devenir parent. Autrement dit, nous souhaitons que le critère déterminant ne soit plus le concubinage hétérosexuel, c'est à dire la vraisemblance biologique du projet, mais l'engagement des personnes, qu'il s'agisse de personnes seules, de couples de même sexe ou de sexe différent, ou encore de paires constituées d'un père gay et d'une mère lesbienne. Nous préconisons le respect de toutes les personnes concernées et la transparence à l'égard de l'enfant. C'est pourquoi nous sommes favorables à la levée de l'anonymat du don. Actuellement, la discrimination est manifeste entre les hétérosexuels, qui ont accès à l'AMP, et les homosexuels à qui elle est, de fait, interdite. Le recours aux techniques d'assistance médicale devrait être permise dans le cadre de la coparentalité afin d'offrir aux futurs parents un cadre médical et sanitaire au processus de procréation, qu'ils soient en couple ou non. Interdire l'accès à l'AMP aux lesbiennes en France ne les empêche pas d'y avoir recours en Belgique, aux Pays-Bas ou en Angleterre, car la législation de ces pays ne précise pas à quels types de femmes s'adressent ces techniques. La décision est prise soit par les ordres professionnels, soit par les établissements spécialisés, et, contrairement à ce qui se passe en France, un couple d'homosexuelles peut recourir à ces techniques si son projet parental est sérieux et cohérent. En Belgique, l'accès à l'AMP est ouvert aux lesbiennes depuis près de vingt ans ; contrairement à ce qui a été avancé, on dispose donc d'un recul suffisant. Le protocole est similaire d'un hôpital à l'autre : un ou plusieurs entretiens psychologiques visant à évaluer la cohérence du projet parental sont suivis d'entretiens d'ordre médical. Les Pays-Bas sont l'un des seuls pays qui proposent un donneur semi anonyme, donnant ainsi la possibilité à l'enfant, lorsqu'il atteint l'âge de seize ans, de connaître son donneur si ce dernier en est d'accord, et sans que cela établisse de lien de filiation entre lui et l'enfant. Au Québec, la loi va plus loin en prévoyant des règles de filiation pour les enfants nés par AMP et issus d'un projet parental, que le couple soit de même sexe ou de sexe différent. La France est donc très conservatrice en cette matière, et sa législation a un effet doublement discriminatoire : non seulement les lesbiennes sont traitées différemment des autres femmes, mais la loi a pour conséquence indirecte que seuls les couples de lesbiennes les plus aisés peuvent se rendre à l'étranger pour recourir à l'AMP. II n'y a aucune raison objective pour qu'il en soit ainsi, car leur projet parental est tout aussi valable que celui d'un couple hétérosexuel, et les études réalisées par des psychologues et des sociologues dans tous les pays occidentaux depuis plusieurs dizaines d'années montrent que les enfants élevés par des homosexuels ne se portent ni mieux ni moins bien que les autres enfants. Cent soixante-dix pages de références bibliographiques sont disponibles à ce sujet. Je citerai plus particulièrement les études de Flaks, Brewaeys et Golombok : toutes montrent que l'absence de père ne semble avoir aucune incidence ni sur le développement de l'identité sexuelle, ni sur le développement psychologique de l'enfant. Élargir l'accès de l'AMP aux couples de lesbiennes et aux co-parents permettrait à la France de définir son propre cadre juridique, sans laisser ce soin aux pays dans lesquels se rendent actuellement les lesbiennes. J'en viens à la gestation pour autrui, interdite en France depuis 1994 alors que de nombreux pays l'autorisent. Nous demandons, dans ce cas aussi, l'encadrement légal d'une pratique qui doit être fondée sur l'engagement des parents demandeurs, qu'il s'agisse de personnes seules ou de couples de sexe différent ou de même sexe. La gestation pour autrui ne doit pas être considérée comme une instrumentalisation du corps de la femme. Produire cet argument, c'est faire abstraction des raisons personnelles qui poussent certaines femmes à porter et à mettre au monde un enfant pour autrui en considérant cet acte comme positif, même en l'absence de rétribution financière. Je rappelle que, dans les pays où la pratique est autorisée, les gestatrices doivent déjà être mères. Il n'y a pas là instrumentalisation du corps de la femme, mais au contraire une forme de liberté à disposer de son corps, ce que sont aussi les droits à la contraception ou à l'avortement. Une femme doit avoir le droit de concevoir un enfant pour autrui si bon lui semble. Sur un plan financier, les pratiques sont diverses selon les pays considérés. Certains, la Grande-Bretagne notamment, interdisent toute forme de rétribution, d'autres l'autorisent. Dans ce dernier cas, il s'agit bien de rémunérer le service consistant à porter l'enfant à naître. La rémunération compense généralement le fait de devoir arrêter de travailler ou les coûts médicaux dans des pays où la couverture sociale est plus que limitée. Mettre en exergue l'aspect financier, c'est jeter un voile pudique et hypocrite sur les pratiques douteuses facilitées par internet, c'est oublier le coût d'une adoption internationale qui est, elle, autorisée, et, dans une moindre mesure, celui d'une insémination avec donneur pour les homosexuelles obligées d'aller à l'étranger. Enfin, le mariage n'est-il pas le plus fréquent des contrats permettant à deux lignées de se mélanger ? Pourquoi choisir la gestation pour autrui plutôt que l'adoption ? Parce que les hommes qui y recourent disent tous leur souhait fondamental d'avoir un enfant issu de leur chair. En outre, l'adoption est extrêmement difficile pour les homosexuels en raison des discriminations dont ils font l'objet et du nombre réduit d'enfants adoptables, en France et à l'étranger. La gestation pour autrui conduit-elle à priver l'enfant de sa mère ? Il faut distinguer la privation de la mère par accident de celle qui est organisée et réfléchie dans le cadre d'un projet parental. L'APGL estime que, si la présence de l'autre sexe est indispensable au développement et à l'épanouissement de l'enfant, sa représentation n'a pas forcément besoin d'exister au sein du couple, l'enfant étant en contact avec des personnes d'un sexe différent dans son environnement familial, amical et social. En outre, l'idée selon laquelle les gestatrices pour autrui risquent de vouloir garder l'enfant est une idée fausse : une étude a montré que ce risque ne se manifeste que dans 0,6 % des cas, et il est vraisemblable que la proportion baisserait encore si, un cadre législatif étant défini, les parties pouvaient passer un contrat entre elles. Qu'en est-il de la filiation dans le cadre de la gestation pour autrui ? En l'état actuel de la législation, si la gestation pour autrui était autorisée en France, la gestatrice devrait abandonner l'enfant pour qu'il puisse être adopté par le couple demandeur. Or le don direct à des parents, sans intervention des services sociaux, est interdit. Cela semble paradoxal dans le cas de la gestation pour autrui, la prise en charge et l'avenir de l'enfant étant assurés, contrairement à ce qui se passe en cas d'abandon pur et simple, notamment lorsque l'enfant est né sous X. Peut-on parler d'abandon dans le cas de gestation pour autrui, alors que le transfert de parentalité est prévu bien en amont de la naissance de l'enfant ? L'interdiction de la gestation pour autrui en France revient à établir une hiérarchie entre les citoyens. En effet, certaines femmes souffrant de troubles de la fertilité peuvent recourir à l'AMP, alors que les homosexuelles ou les femmes pour lesquelles cette technique n'est pas suffisante se voient interdire l'accès à la gestation pour autrui. Pour toutes ces raisons, l'APGL demande que l'accès à la gestation pour autrui en France soit autorisé pour les couples hétérosexuels et homosexuels ayant un projet parental construit et cohérent, et qu'il soit organisé et strictement encadré, pour éviter toute dérive marchande et pour que les demandeurs bénéficient d'un suivi médical et psychologique approprié. S'agissant enfin des enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui, on sait que leurs parents peuvent être poursuivis. Plus grave encore : la mère ne peut adopter l'enfant de son mari et, dans le cadre d'un couple homosexuel, le conjoint du père n'a aucune reconnaissance légale. Le fait est que les dispositions juridiques françaises actuelles vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. En effet, quelle que soit l'opinion que chacun peut avoir sur la gestation pour autrui, personne ne peut nier que ces enfants existent et ont été désirés. En prenant des dispositions contre les couples ayant recours à la gestation pour autrui à l'étranger, le législateur affaiblit la protection de ces enfants, puisqu'ils peuvent être privés de leurs parents ou ne bénéficier que d'un seul lien de filiation. Si la justice semble avoir évolué dans certains cas, comme le jugement rendu à Créteil l'a montré, le législateur reste frileux. Interdire les gestations pour autrui revient à nier ce qui se pratique sous le manteau avec des conséquences parfois tragiques. Ces cas dramatiques qui défraient régulièrement la chronique montrent qu'il est du devoir de l'État d'encadrer la gestation pour autrui, comme il a encadré l'adoption, plutôt que de l'interdire et de créer ainsi une situation propre à favoriser les dérives. Il faut notamment interdire toute directive empêchant la transcription sur les actes de l'état civil français des enfants nés par maternité pour autrui à l'étranger, et abroger toutes les circulaires adressées aux consulats français tendant à opérer une véritable chasse à la maternité pour autrui, comme c'est, semble-t-il, le cas dans certaines de ces administrations. Pour l'APGL, la politique française actuelle va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, qui doit pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la double filiation du couple demandeur et disposer de tous les documents d'état civil afférents à cette filiation sur le territoire national. Mme Geneviève Delaisi de Parseval : En ma qualité de psychanalyste, j'écoute, dès 1976, dans le cadre des centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humains, et, depuis, dans ma pratique clinique tant hospitalière que libérale, des couples qui engagent ou qui ont réalisé une insémination artificielle avec donneur. Je commence à recevoir les enfants dont j'avais suivi les parents. Je tiens à dire qu'il ne se passe pas de semaine sans que je reçoive des demandes de gens en souffrance, qu'il s'agisse des parents ou des enfants. Ils ne sont pas en souffrance à cause du nom du donneur, puisqu'ils connaissent la législation française à ce sujet, mais à cause de la situation de l'insémination avec donneur elle-même ; je suis donc sur ce point d'un avis différent de ce qu'a dit M. Arnold Munnich. Au fil des années, les techniques se sont multipliées : insémination avec donneur, don d'ovocytes, don d'embryons, gestation pour autrui... S'agissant de gestation pour autrui, je reçois quelques couples dont l'un a des enfants, à présent âgés de onze ans, nés ainsi en Californie, et quelques couples homosexuels. Je m'exprimerai en tant que psychanalyste, mais surtout en ma qualité d'anthropologue de la parenté. Le professeur Jean Bernard, alors président du Comité consultatif national d'éthique, m'a confié une mission qui m'a conduite à passer un trimestre dans l'État de Victoria, en Australie, peu de temps après l'entrée en vigueur la loi de 1988 instaurant l'anonymat optionnel du don. Je suis d'autre part correspondante de plusieurs centres de bioéthique dans le monde. La gestation pour autrui qui, dans sa forme moderne, constitue une des plus récentes indications de l'AMP, se situe au carrefour des bouleversements récents du lien de parentalité que sont l'efflorescence des familles recomposées, les diverses déclinaisons d'assistance médicale à la procréation avec dons de gamètes et d'embryons, et la montée en puissance des familles homoparentales. À ce titre, elle pose toutes les questions à la fois. Il y a là une question de justice, de dignité et d'intérêt de l'enfant. J'ai approuvé sans réserve la décision par laquelle la Cour de cassation, en 1991, a condamné ce qui était une fraude à l'adoption, laquelle m'avait choquée et indignée. Mais l'invention de la fécondation in vitro a constitué un formidable progrès pour de nombreux couples stériles, et la gestation pour autrui en est une forme très intéressante, car elle permet de pallier une forme irréversible de stérilité féminine, une absence d'utérus ou une hystérectomie accidentelle. Son interdiction est ressentie d'autant plus douloureusement par les couples qu'ils constatent que, dans le cas de stérilité par insuffisance ovarienne, la loi permet le don d'ovocytes, processus qui est pourtant sans doute plus compliqué que ne le sont les gestations pour autrui uniquement gestationnelles - selon la distinction exposée par Mme Camborieux -, au cours de laquelle une « nounou » porte un enfant qui lui est complètement étranger, y compris sur le plan fantasmatique. Dans quinze jours se tiendra au Collège de France un congrès européen d'anthropologie de la parenté, spécialité qui, à mon sens, permet pour l'instant de mieux penser les choses. En effet, au-delà de la gestation pour autrui, c'est une nouvelle forme de parenté qui se construit sous nos yeux en Occident, au terme de laquelle la famille coïncide de moins en moins avec le couple procréateur. On sait que la parenté se fonde sur le principe, universel en anthropologie, selon lequel les parents ne se définissent pas forcément comme ceux qui « fabriquent » les enfants avec leurs corps ou avec leurs substances corporelles, mais comme les adultes qui les nourrissent et les élèvent. Les familles multi-composées, devenues très habituelles et dans lesquelles j'inclus évidemment les familles adoptives, avec des co-parents et des co-géniteurs, en fournissent autant d'exemples. Ce sont des familles comme les autres, avec des « suppléments de père et de mère », selon l'expression de Jacques Derrida, familles dans lesquelles les vrais parents ne sont pas forcément les engendreurs. Dans le droit fil d'une évolution largement commencée, la procréation du futur risque à mon sens d'être de plus en plus médicalisée : on recourra de plus en plus souvent à la fécondation in vitro, surtout si l'on continue de retarder l'âge du premier accouchement et si la société était amenée à prendre en compte l'indication de gestation pour autrui pour les couples homosexuels. Mais la parenté sera, elle, de plus en plus sociale. Ce qui continuera, en tout cas, à traverser l'histoire, c'est le fait qu'il y ait du « lien social » organisé autour de la procréation. Or, ce lien ne me paraît pas particulièrement menacé par la gestation pour autrui. Il l'est sans doute davantage lors du don de gamètes anonymes et surtout lors du don d'embryon. Soyons humbles et écoutons ce que disent les patients, véritables métaphysiciens empiriques qui nous donnent l'occasion de réfléchir à une nouvelle métapsychologie des substances et des gènes. Les formes de pluri-parentalité montrent que, à côté des parents par le sang, il existe d'autres sujets qui éduquent et prennent soin de l'enfant. Encore faut-il leur trouver un statut. Pour suivre depuis vingt-cinq ans de nombreux couples et leurs enfants dans les différents cas de clivage du lien maternel et paternel, je puis vous dire que l'interdiction du recours à une gestation pour autrui uniquement gestationnelle, dans laquelle une femme qui a déjà des enfants assure seulement un rôle de « nourrice », me paraît à la fois injuste et illogique. Injuste car, je l'ai dit, la législation française ne prend en considération que la souffrance liée à l'absence de fonction ovocytaire et ignore l'indication médicale symétrique, celle liée à une pathologie utérine. Illogique car le don de gamètes, et plus sûrement d'embryon, risque de peser plus lourd dans la vie de l'enfant que le fait d'avoir été porté par une autre mère, éventuellement proche de sa mère. La législation néerlandaise par exemple repose sur la confiance entre personnes qui se connaissent, et favorise la gestation par la mère, la sœur ou une amie de la mère intentionnelle, tandis que la législation britannique repose sur la confiance entre personnes étrangères l'une à l'autre. Ma pratique me fait dire que la gestation pour autrui uniquement gestationnelle ne présente pas davantage de risque pour le devenir psychique de l'enfant que le don d'ovocyte. Je pense, ce disant, à une patiente enceinte grâce à un don d'ovocyte et qui me disait, non sans humour : « Au fond, je suis la mère porteuse de mon propre enfant ! ». Cette boutade donne beaucoup à penser, a contrario, de la gestation pour autrui... Rappelons en outre que, s'agissant de gestation pour autrui, il n'y a ni problème de secret ni problème d'anonymat, questions qui sont les plus épineuses de l'AMP. Les choses sont parfaitement transparentes en gestation pour autrui : il n'est évidemment pas question de garder le secret - d'ailleurs, les gestatrices ne le souhaitent pas -, et il n'y a aucun anonymat puisque le bébé ainsi porté est celui des parents d'intention. L'interdiction est illogique aussi parce que le don d'organes entre vifs est admis en France. Pourquoi, alors, ne pas admettre qu'une mère ou une sœur puisse porter l'enfant d'une femme qui, pour des raisons médicales, ne peut assurer la gestation ? Il ne s'agit certes pas de sauver une vie mais d'en créer une, ce qui n'est pas moins important. Et si le risque médical pris par la mère gestationnelle existe, il ne me semble pas plus grand que celui pris par les donneurs d'organes. J'observe que les gestatrices pour autrui emploient les mêmes mots que ceux du comédien Richard Berry qui vient de donner un rein à sa sœur, et qui explique se sentir, grâce à ce don, « quelqu'un de bien ». Le contre-don est tout entier contenu dans le don, et la question outrepasse celle de la compensation financière - même si celle-ci est indispensable dans le cas où la gestation pour autrui ne se passe pas dans la famille - car les donneurs se payent par leur don en bénéfices que nous appelons « secondaires ». La loi récemment votée par le Parlement grec est intéressante à citer : elle dispose que l'aide médicale à la procréation peut être mise à la disposition de toute patiente reconnue stérile par le corps médical, à condition qu'elle soit strictement encadrée et que le consentement éclairé de la gestatrice ait été soigneusement recueilli. Le texte règle de manière éthique et sans hypocrisie la question de la compensation financière versée à la gestatrice, en stipulant que tout accord de gestation avec une autre femme doit être conclu sans échange, mais que les frais afférents au suivi de la grossesse et à l'accouchement ne sont pas considérés comme un échange, pas plus que le manque à gagner de la mère enceinte si elle arrête de travailler pendant la grossesse. Le montant de l'indemnisation est fixé par l'autorité compétente, évitant ainsi que le consentement éclairé de la mère gestatrice ne soit vicié par une incitation financière trop importante. La loi espagnole de 1999 relative au don de gamètes proscrit, comme la loi française, le paiement des donneurs, mais, en pratique, une sorte de pretium doloris est prévu et les donneuses d'ovocytes reçoivent des hôpitaux, publics et privés, une compensation financière d'environ 1 000 euros par cycle de don, somme que pouvoirs publics et donneuses considèrent raisonnable. Moyennant quoi, deux cliniques catalanes travaillent à plein temps pour des couples français... Comment en serait-il autrement ? Qui peut souhaiter faire un don d'ovocyte gratuit alors que l'intervention est coûteuse sur les plans psychique et physique ? Prendre une telle décision sans recevoir cette compensation serait faire appel à des motivations masochistes de mauvais augure, alors que le geste du don, et plus particulièrement du don de gamète, est un geste profondément humain, qui permet de se dépasser et de se valoriser soi-même. Je suis depuis une dizaine d'années des enfants issus d'une gestation pour autrui, et je n'ai constaté chez eux aucun trouble clinique spécifique. Susan Golombok, psychologue britannique qui fait autorité sur ces questions, a émis les mêmes observations à propos d'une cohorte d'une soixantaine de mères gestatrices et d'enfants nés d'une gestation pour autrui. Il me semble temps que la France encadre le recours à la gestation pour autrui, en autorisant la gestation uniquement gestationnelle dans le cadre d'indications médicales strictes. À cette fin, comme le suggère Mme Valérie Sebag-Depadt, maître de conférences en droit privé, l'article 16-7 du code civil pourrait être complété par un alinéa ainsi rédigé : « Seul l'acte de gestation pour autrui est admis, à condition que l'enfant soit génétiquement rattaché à la femme qui sera reconnue comme la mère ». Ainsi, dès lors que la gestation pour autrui ne contredit aucun de nos droits fondamentaux, on ne peut que regretter que des couples français soient contraints à un désolant tourisme procréatif dont, de plus, sont scandaleusement exclus ceux qui ont peu de moyens. On ne peut que déplorer une interdiction dont la conséquence est aussi une grave stigmatisation des enfants ainsi conçus, qui n'ont ni relation de filiation avec leur mère, ni livret de famille, ni liens juridiques avec leurs frères et sœurs nés antérieurement - avant l'hystérectomie de la mère par exemple -. Ce serait un geste d'humanité de la part du législateur que de réparer cette injustice, et d'entendre ainsi non seulement les spécialistes mais aussi les protagonistes de ces histoires douloureuses. M. Pierre-Louis Fagniez : M. Murat, vous avez déclaré que les faits ne pouvaient pas être ignorés par le droit. De votre côté, M. Munnich, vous avez dit que la science ne pouvait pas influencer la loi, tout en reconnaissant que certains faits découlaient directement de la science. J'aimerais savoir si vous considérez vos positions respectives inconciliables ou s'il y a un point de convergence possible entre vous. M. Sureau, vous avez évoqué l'AMP et son application aux célibataires. Je suppose que vous visiez les célibataires femmes. Pensez-vous qu'on puisse élargir le problème aux célibataires hommes ? M. Munnich, vous avez parlé avec horreur du « bébé médicament ». Vous avez néanmoins noté que Valérie Pécresse et moi avions fait la proposition du « bébé du double espoir ». Il s'agissait d'étendre le diagnostic préimplantatoire dans un double but : donner naissance à un enfant qui ne soit pas atteint de la maladie génétique qui risque de faire mourir un des enfants de la fratrie et guérir, grâce à cet enfant qui va naître, celui qui est en train de mourir. Êtes-vous d'accord avec cette proposition ? Mme Camborieux, vous avez dénoncé la pratique clandestine de la gestation pour autrui en France. Pourrions-nous avoir un accès à des données, chiffrées ou non, qui nous permettraient de bien apprécier la situation ? Je demanderai la même chose à Mme Révolon et à Mme Delaisi de Parseval. Mme la Rapporteure : M. Murat, vous avez critiqué le recours à l'adoption simple de la part d'un parent social. Le droit français reconnaît le recours à l'adoption simple de l'enfant du compagnon. Mais si le couple vit en union libre, elle aboutit à une aberration, dans la mesure où elle prive le père ou la mère biologique de toute autorité parentale, sans possibilité de prévoir un partage de celle-ci, sauf à recourir, dans un second temps, à une délégation. Pourquoi estimez-vous que l'adoption simple n'est pas un mode adapté dans les cas qui nous intéressent ? Parce que le droit existant ne la prévoit pas ? Ou parce qu'elle crée des liens de filiation contraignants, davantage qu'une délégation de l'autorité parentale ou d'un tutorat ? Vous avez soulevé à cette occasion les problèmes que risquait d'entraîner la séparation du couple, et votre remarque m'a paru très pertinente. C'est un sujet que nous n'évoquons que rarement dans nos tables rondes. Mais j'ai pu apprécier, au moment de la loi sur le divorce, les difficultés qui en découlent. Lors de son audition, Mme Dekeuwer-Défossez nous a dit que, si on maintenait l'interdiction de la gestation et la procréation pour autrui, tout en donnant un état civil aux enfants nés à l'étranger grâce à ces techniques, on encouragerait les personnes les plus riches à s'adresser à l'étranger. D'où une maternité « à deux vitesses », régie par l'argent. La possession d'état ne pourrait-elle pas constituer une solution satisfaisante, si cette interdiction était maintenue ? En effet, elle permet de reconnaître la filiation d'un enfant, à l'égard duquel quelqu'un aura eu pendant au moins cinq ans le comportement d'un père ou d'une mère. Mme Révolon, vous avez évoqué le coût du nomadisme médical, pratiqué notamment par les célibataires femmes pour bénéficier d'une PMA. Comme cela se passe souvent en Belgique, la presse parle de « bébés Thalys ». Une telle PMA est-elle remboursée en Belgique ? Si tel était le cas, de par les conventions franco-belges, le coût de cette pratique se limiterait, pour la femme, à un billet Paris-Bruxelles. Je pose la même question à Mme Delaisi de Parseval, qui a évoqué les dons d'ovocytes à Barcelone : est-ce la femme qui en supporte le coût, ou est-ce la sécurité sociale espagnole ? Professeur Munnich, j'ai été troublée par le paradoxe de votre discours. Vous avez dit qu'il ne fallait pas changer la loi en fonction des progrès de la science, tout en demandant que soit ouvert le diagnostic préimplantatoire pour le « bébé médicament ». J'ai d'ailleurs été sensible à votre plaidoyer en faveur de ce dernier, dans la mesure où nous avions bataillé, M. Fagniez et moi-même, pour faire prendre conscience aux parlementaires que c'était un devoir, que les cas étaient très peu nombreux et que l'éthique n'avait pas à l'emporter sur le bon sens. Pour autoriser ces techniques médicales, nous avons bien été obligés de changer la loi qui les interdisait, et ainsi d'adapter notre législation aux progrès de la science. M. le Président : Les couples hétérosexuels mariés ou vivant en concubinage depuis deux ans peuvent avoir accès à la PMA. Mais seuls les couples hétérosexuels mariés peuvent adopter. Quant à une femme seule, elle peut adopter, alors qu'elle ne peut pas avoir accès à la PMA. J'ai du mal à voir la logique qui préside à ces différences de traitement, et il me semble qu'il faudrait au moins introduire une certaine cohérence dans notre législation. Je ne vous poserai qu'une question : l'ouverture de la PMA à une femme seule vous paraît-elle possible ? Mme Geneviève Delaisi de Parseval : Sur la question du remboursement de certains actes par la sécurité sociale, je laisserai la parole à Mme Camborieux. Je reconnais qu'il y a une certaine incohérence dans la loi française. Le problème est d'autant plus sérieux que ce sont souvent les mêmes couples qui font des demandes d'agrément en vue de l'adoption et qui, faute d'obtenir cet agrément, recourent à l'AMP. Il me semble, quitte à paraître rétrograde, que le mariage est pour l'enfant une sécurité beaucoup plus grande que ne l'est le concubinage ou, a fortiori, le célibat. En tant que psychanalyste, je pense que la filiation d'un enfant né dans les liens du mariage est beaucoup plus solide. J'ai assisté, dans ma pratique, à plusieurs cas de désaveu de paternité après insémination avec donneur dans le cas de couples non mariés. Je suis également très réservée s'agissant de la filiation vis-à-vis d'une personne seule. Les Belges pratiquent depuis quinze ans des inséminations pour des célibataires et pour des couples hétérosexuels ou homosexuels - ce sont les « bébés Thalys » dont vous parliez -. Avec le recul, ils pensent que les cas qui posent le moins de problèmes sont les cas de couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Ils ont d'ailleurs quasiment arrêté l'insémination des femmes seules : à sept ou huit ans, les enfants ont tendance à « faire couple » avec leur parent. Ce n'est pas une critique à l'égard des femmes célibataires en tant que telles, mais c'en est une à l'égard de la loi qui autorise à créer ex nihilo une filiation plénière vis-à-vis d'une personne seule. En tant que psychanalyste, je considère qu'il vaut mieux qu'un enfant ait deux parents, si possible mariés. M. le Président : Dois-je déduire de votre propos que vous êtes favorable à ce que le mariage soit ouvert en France aux couples de même sexe ? Mme Geneviève Delaisi de Parseval : J'ai beaucoup évolué sur ce point. Ce qui me semble important, c'est que les parents soient mariés, en raison de la sécurité de la filiation qui en résulte pour l'enfant. En conséquence, je suis maintenant favorable au mariage des couples homosexuels. M. le Président : Merci de votre sincérité. Mme Emmanuelle Révolon : Le coût des « bébés Thalys » est variable. Il dépend du nombre d'essais nécessaires pour concrétiser une grossesse. Il dépend aussi des hôpitaux. Aujourd'hui, 250 femmes environ sont sur liste d'attente dans les hôpitaux bruxellois ; il en résulte une raréfaction du sperme en Belgique, ce qui conduit certains d'entre eux à doubler les prix. Le coût dépend aussi des médecins français, qui peuvent accepter de contourner la loi en permettant à ces femmes de faire leurs examens en France. Sinon, elles devront les faire en Belgique. Je précise qu'il n'y a pas de convention entre la France et la Belgique. Le coût engendré par les actes médicaux en Belgique n'est donc pas remboursé par la sécurité sociale française. Ce coût n'est pas négligeable. Il faut compter à peu près 1 000 euros pour trois inséminations, plus 100 euros de frais médicaux à chaque fois, plus, éventuellement, les examens qui ne sont pas faits en France et le coût du transport et de l'hébergement. Cela revient à 400 à 500 euros par tentative, non compris le coût des examens préalables lorsqu'ils ne sont pas faits en France. Il est difficile de donner des indications chiffrées sur des pratiques clandestines. Je peux néanmoins vous indiquer que L'Express du 15 septembre 2005 a donné sur le sujet quelques exemples assez intéressants. À propos de la filiation, certains ont utilisé le terme de « tuteur » pour désigner ce que nous appelons le parent social ou le second parent dans un couple ayant un projet parental. De notre point de vue, le projet parental se construit à deux. Il ne se mène pas avec le parent biologique d'un côté, et le deuxième parent de l'autre. Pour nous, un enfant a deux parents, et non un parent et un tuteur, lequel ne serait qu'un parent de seconde zone. Mme Laure Camborieux : Pour ce qui est du don d'ovocyte, il en coûte au couple demandeur 6 000 euros par essai en Espagne et parfois beaucoup plus cher en Grande-Bretagne. Cette somme comprend le dédommagement versé à la donneuse, qui est d'environ 900 euros mais qui peut varier selon les cliniques. Rien n'est pris en charge par la sécurité sociale française. Toutefois, la Cour de justice des Communautés européennes pourrait en décider autrement, en considérant que le don d'ovocyte est légal en France, que, compte tenu de la pénurie de donneuses, le délai d'attente y est de trois à quatre ans, et que la procédure suivie en Espagne est conforme à la législation française. Nous avons entrepris des actions en justice en ce sens, et nous entendons mener cette démarche à son terme en nous tournant vers les tribunaux des affaires de sécurité sociale. J'ajoute que, si les cliniques espagnoles et belges sont des établissements sérieux et contrôlés par l'État, des cliniques s'ouvrent dans les pays de l'Est à propos desquelles nous formulons les plus vives réserves. Nous informons les couples du danger que présentent ces officines. Pour ce qui est de la pratique clandestine de la gestation pour autrui, elle est par nature difficile à quantifier, mais nous pouvons témoigner recevoir assez fréquemment des appels de sœurs ou d'amies qui souhaitent se faire gestatrices pour autrui. Soucieux du respect de la législation, nous nous en tenons aux informations minimales que la loi nous permet de donner. Mais nous entendons parfois une de ces femmes nous dire : « Maintenant que je suis enceinte de deux mois, que fais-je ? ». Selon les responsables de deux cliniques belges que j'ai interrogés, une trentaine de couples français seraient actuellement concernés - et il s'agit de deux cliniques seulement -. Chacun sait qu'il existe des forums spécialisés sur internet, utilisés aussi pour publier des annonces. Malgré nos mises en garde périodiques et l'intervention des modérateurs de ces forums, les annonces sont toujours là, et, même si des sanctions étaient prises contre les hébergeurs français, les sites spécialisés canadiens et belges continueraient de fleurir. En dépit de nos rappels à la loi, la réalité est que des couples nous appellent pour nous dire « On l'a fait ! », ce qui est pour nous une source de vive inquiétude. Et je ne suis pas certaine que, même si une réponse pénale était décidée, ces pratiques illégales cesseraient. Mme Laurence Brunet : Sur le fond, la possession d'état paraissait la solution à envisager pour régulariser la situation des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger et dont la transcription des actes d'état civil était refusée. Mais l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est très préoccupante puisqu'elle exige que la possession d'état soit désormais « paisible, publique et non équivoque ». Cette rédaction devrait faire obstacle à ce qu'un juge délivre un acte de notoriété établissant la possession d'état. Ce qui était possible il y a encore trois mois ne l'est donc plus aujourd'hui et, comme il s'agit d'une ordonnance, il n'y a pas de travaux préparatoires susceptibles d'expliquer le choix de la Chancellerie. Seule demeure donc la voie de la délégation d'autorité parentale, mais, comme un pourvoi est en suspens devant la Cour de cassation à propos d'une famille homoparentale, il n'est pas dit que l'on ne nous opposera pas le détournement d'institution. M. le Président : Je vous suis reconnaissant d'avoir souligné que le recours aux ordonnances n'est pas une bonne chose... M. Pierre-Louis Fagniez : Cela dépend sans doute des années... Mme la Rapporteure :... et des gouvernements... M. le Président : Quels que soient les gouvernements - mais certains y recourent plus que d'autres -... Mme la Rapporteure : Je me suis entretenue de la rédaction de l'ordonnance avec le directeur des affaires civiles et du sceau, qui m'a indiqué avoir envisagé surtout les séparations conflictuelles et les conflits de paternité. Mais il est exact que les dispositions de l'ordonnance s'appliqueraient également dans le cas des enfants nés d'une gestation pour autrui. Dans un autre domaine, seriez-vous choqués si, tout en maintenant la gratuité du don d'organe, un défraiement était prévu en cas de don d'ovocyte, dont chacun a conscience qu'il n'est pas aussi facile qu'un don de gamètes masculins ? Mme Laure Camborieux : Il faudra reprendre avec calme la question du principe de l'indisponibilité du corps humain. Je n'en nie pas la valeur, mais j'observe qu'en plusieurs occasions on a su mettre au point des textes qui, sans le remettre en cause, permettent d'avancer. Le don d'organe entre vifs et celui de gamètes ne vont-ils pas à l'encontre du principe de l'indisponibilité du corps humain ? On doit, de même, travailler sur la gestation pour autrui sans remettre en cause ce principe fondamental de notre droit. Mme Laurence Brunet : Les affaires concernant des transsexuels ont également montré que ce principe n'est pas aussi intangible qu'il y paraît. M. Arnold Munnich : Un défraiement ne me choquerait aucunement. Je tiens à dire que l'amendement de M. Fagniez m'avait tout à fait satisfait. À Mme la Rapporteure, je ferai observer que, s'il a fallu légiférer à nouveau, c'est que l'on avait légiféré de manière trop restrictive une première fois. Mme la Rapporteure : Ou qu'un cheminement a eu lieu... M. Arnold Munnich : À trop vouloir encadrer, à trop se méfier des spécialistes, on a trop légiféré alors que l'on ne prenait aucun risque, et il a fallu faire marche arrière. Le droit ne pourra jamais coller aux caprices de la science car, à peine une loi promulguée, les données changent. On connaît cent exemples mais je n'en donnerai qu'un : il est désormais possible de savoir, en analysant les cellules fœtales présentes dans le sang maternel, si un fœtus est ou non indemne, ce qui a entièrement bouleversé le cadre du diagnostic préimplantatoire. À vouloir absolument coller à la science, on court vers un mur ! Dois-je rappeler que la polémique sur le « bébé médicament » portait sur trois couples en quatre ou cinq ans ? C'est beaucoup trop de temps perdu pour tout le monde, et, si l'on avait fait confiance aux professionnels, ils auraient traité ces cas dans le cadre du colloque singulier avec leurs patients, même sans loi ! L'expérience clinique de Mme Delaisi de Parseval semble différer de la mienne. Je reçois peu de demandes de recherches en filiation, mais je ne doute pas qu'elle ait beaucoup de demandes de consultation de la part d'enfants qui souhaitent parler. La recherche en filiation est une autre quête. Mme Geneviève Delaisi de Parseval : Il ne s'agit pas, pour les enfants concernés, de créer des liens personnels avec les donneurs de gamètes, mais de s'inscrire dans une histoire, de savoir d'où ils sont issus, si leur géniteur est blond, s'il jouait du violon, si leur grand-père était menuisier... M. Arnold Munnich : J'observe pour ma part qu'en matière de génétique, les individus ont besoin de parler mais pas forcément d'en savoir plus. Ainsi, 88 % des personnes que nous recevons dans le cadre des entretiens préalables aux tests génétiques établissant la prévalence de la chorée de Huntington abandonnent la démarche qu'ils ont eux-mêmes engagée, et renoncent ainsi à connaître leur situation au regard du risque. Mme Geneviève Delaisi de Parseval : Dans l'exemple que vous donnez, le pronostic est particulièrement lourd. Pour ce qui est du don de gamètes, on souhaite connaître une histoire. M. le Président : Je suis sensible à ce qui a été dit : le législateur doit intervenir quand cela est nécessaire et notamment en cas de vide juridique, mais il est vrai que dans certains domaines il est souhaitable de ne pas trop encadrer. M. Claude Sureau : Je suis tout à fait favorable à un défraiement que j'estime parfaitement légitime. Avant la parution des décrets d'application de la loi de 1994, il fallait se livrer à toutes sortes d'acrobaties pour faire prendre en charge le prélèvement d'ovocyte par l'assurance maladie, mais ces temps sont révolus. Si j'ai parlé des célibataires femmes, c'est que j'en ai l'expérience. J'ai une légère divergence d'opinion avec Mme Delaisi de Parseval, qui semble privilégier la présence d'enfants issus de couples, hétérosexuels ou homosexuels, à celle d'enfants issus de femmes ou d'hommes seuls. Je ne suis pas convaincu de la validité d'une telle distinction, car j'ai l'expérience concrète d'enfants, y compris d'enfants adoptés, merveilleusement élevés par des femmes seules. Dispose-t-on d'études sur l'état psychologique des enfants élevés par un parent seul ? Mme la Rapporteure : Certains pédopsychiatres entendus par la Mission lors de la table ronde sur l'adoption ont fait état de critères de difficulté mis en évidence statistiquement, citant l'âge de l'adoptant et le fait que l'adoption soit faite par un parent seul. L'adolescence est une période particulièrement ardue. M. Claude Sureau : Ces difficultés éventuelles sont-elles suffisantes en nombre et en intensité pour motiver l'interdiction ? M. Pierre Murat : Il faut garder en mémoire que, initialement, l'ouverture de l'adoption à une personne seule tendait à éviter que les enfants ne restent en institution et ne soit privés d'une famille. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu cette ouverture qu'il n'existe pas une hiérarchie implicite, dans la loi, entre l'adoption par un couple et l'adoption par une personne seule. Revenir sur cette ouverture aurait pour effet de se priver de cette subsidiarité qui peut rendre quelques services. Comme l'a dit M. Munnich, une loi cohérente ne peut être fondée sur des cas particuliers. Mme Geneviève Delaisi de Parseval : On doit tenir compte du nouveau contexte dans lequel se font les fécondations in vitro. Il s'agissait, à l'origine, de remédier à un problème médical, l'obstruction des trompes. Maintenant, le problème médical est second : le comportement social prime, celui de femmes qui font carrière, qui se décident à avoir un premier enfant quand elles ont 38 ans. C'est pour ces raisons que je pense que l'on recourra de plus en plus à fécondation in vitro. M. le Président : Je rappelle les termes de l'interrogation de notre Mission : actuellement, en France, une femme seule peut adopter mais elle ne peut avoir accès à la PMA, alors que c'est, dans les deux cas, une personne seule qui élèvera l'enfant. Dans mon esprit, la question est bien de savoir s'il faut lever cet interdit, certainement pas d'en créer d'autres. En tout cas, il n'est pas question de priver les personnes seules du droit d'adopter. M. Pierre Murat : Ce point a été très sérieusement évoqué dans différents rapports. Sur le fond, la question de la filiation peut être abordée par de multiples biais, notamment par celui de l'opposition entre filiation volontaire et filiation adossée à la biologie. Comme l'a justement dit M. Munnich, tout ce qui est possible ne doit pas nécessairement être fait. Toutefois, les possibilités scientifiques nouvelles induisent de facto des questions pour le droit. De plus, au motif que certaines pratiques ont cours ailleurs, le législateur est contraint de s'interroger pour savoir si elles doivent être introduites chez nous. Deux options sont alors possibles : soit l'on décide que nos choix culturels se font ailleurs et l'on s'aligne sur eux, soit l'on décide que nos choix culturels diffèrent de ceux de nos voisins, le prix à payer étant le risque du « tourisme procréatif », avec les inconvénients qui ont été soulignés. Mais, derrière ce choix, il y a aussi la détermination de ce à quoi l'on adosse le lien de filiation. En effet, la filiation est un lien culturel, et l'adossement à la biologie n'est qu'un lien causal, la volonté en étant un autre. Actuellement, les textes régissant ces deux modes de filiation sont distincts, ceux relatifs à la filiation élective - l'adoption - ayant pour seule finalité de trouver une famille de remplacement à une première famille défaillante. Ce dont il a été question tout au long de notre débat, c'est du fondement de la filiation. Et la question qui nous est posée est la suivante : peut-on créer une filiation à double entrée, c'est-à-dire fondée à la fois sur la biologie et la volonté ? Il est évident que la filiation des enfants de convenance, des enfants dans un couple homosexuel, ou des enfants nés par gestation pour le compte d'autrui sera adossée à la volonté. Tout dépend de ce que l'on souhaite. Mais il ne faut pas oublier que notre droit repose actuellement sur la filiation biologique, et que c'est ce fondement qui a présidé à la rédaction de l'ordonnance de juillet dernier. En faisant entrer dans la filiation les maternités de substitution, on donne un tout autre éclairage et une toute autre finalité aux liens de filiation. On provoque une interférence entre le pan de filiation qui est adossé au charnel et le pan de filiation élective. Dès l'origine, notre droit a été écartelé entre le volontaire qui relève de l'adoption et le biologique. En introduisant des filiations volontaires, on fait voler le système en éclat. Voilà pourquoi je pense qu'on ne peut pas légiférer en se contentant d'intervenir à propos de la maternité pour autrui, ou en réglant des cas particuliers. Il faut rechercher une cohérence d'ensemble du droit de la filiation. J'observe que, si l'on admet la gestation pour autrui ou les inséminations de convenance, il faudra aller jusqu'au bout et admettre les filiations homosexuelles. Tout nous amène donc à nous prononcer, auparavant, sur les assises de notre droit de la filiation. Sur l'adoption simple, je me suis peut-être mal fait comprendre. Je remarque que cette adoption simple, utilisée dans les familles recomposées, est parfois trop lourde à gérer et que la reconnaissance d'un lien de filiation basé sur la volonté a inévitablement un prix : on discute des volontés, et on peut, à tout moment, les remettre en cause. Je ne suis pas foncièrement hostile à l'ouverture des volontés mais je crains qu'on n'aboutisse à un « droit de la consommation » de la filiation. Celui-ci surgira au moment des séparations, au moment de l'éclatement de la famille. Les révocations d'adoptions simples le montrent bien : tout ce qu'on construit sur la volonté présente une certaine laxité. L'adoption simple est un très bon outil, dont je comprends le symbole. Mais, pour y recourir, il faut être sûr de la situation. C'est d'ailleurs pourquoi les notaires ne la conseillent pas aux familles recomposées quand les enfants sont jeunes, mais plutôt quand les parents qui les ont élevés sont vieillissants et que tout va bien. Il faut être très prudent quand il s'agit de rattacher un enfant à quelqu'un, car le lien de filiation dure toute la vie. Je précise que la personne que j'ai qualifiée de « tuteur » serait autre chose qu'un parent. Pour moi, d'ailleurs, ce terme n'a rien de péjoratif. On pourrait en trouver un autre, mais la question qui se pose est en fait de savoir ce que la société veut faire du lien de filiation, et ce qu'elle veut faire d'adultes qui prendront une part très importante dans l'éducation d'un enfant. M. le Président : Je propose que nous en restions là et je vous remercie. Table ronde ouverte à la presse sur l'accès de l'enfant à ses origines personnelles, réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : J'ai le plaisir d'accueillir : - Mme Marie-Christine Le Boursicot, magistrate, secrétaire générale du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles depuis août 2002 ; - M. Pierre Verdier, président de la Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines, dont il est le fondateur ; - Mme Françoise Laurant, maître de conférence à l'université de Grenoble, et qui préside depuis 2000 le Mouvement français du planning familial ; - Mme Françoise Monéger, professeur de droit à l'université de Paris VIII, spécialiste du droit de la famille ; - Mme Jacqueline Rubellin-Devichi, professeur émérite de l'université de Lyon III, présidente de l'Association française de recherche en droit de la famille ; - Mme Corinne Daubigny, psychanalyste, qui a publié plusieurs ouvrages et articles relatifs à l'adoption et à l'accès aux origines ; - et Mme Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste, qui assure au sein du centre hospitalier de Nantes des consultations en direction des femmes souhaitant abandonner leur enfant à la naissance. Notre attention a été attirée à plusieurs reprises sur la question de l'accès de l'enfant à ses origines personnelles, qui est un droit reconnu par la Convention internationale des droits de l'enfant. Je vais donc vous inviter à répondre à la question suivante : le droit de l'enfant à connaître ses origines est-il selon vous suffisamment garanti par notre législation ? Mme Marie-Christine Le Boursicot : Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP) a été créé par la loi du 22 janvier 2002, votée à l'unanimité pour tenter de sortir du débat idéologique sur la question des origines, apparu en France au milieu des années 1980. Ma réflexion s'appuie sur une expérience professionnelle de trois ans et sur l'étude des situations concrètes dont le CNAOP a été saisi. L'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant affirme le droit de l'enfant « de connaître ses parents et d'être élevé par eux, dans la mesure du possible », la notion d'origines personnelles s'appuyant en réalité sur l'intitulé de la loi créant le CNAOP. Celle-ci consacre en effet l'émergence d'un droit de la personne - et non pas d'un droit de l'enfant - de connaître son histoire à partir de sa conception, ainsi que ses antécédents biologiques. La notion d'origines personnelles est elle-même imprécise : elle n'a pas été définie par la loi qui se contente d'énoncer les conditions auxquelles l'identité des parents de naissance peut être communiquée aux personnes adoptées et pupilles de l'État. L'obstacle majeur à la connaissance des origines personnelles, en France, semble être le secret de l'identité opposé par les parents biologiques. Pour la mère biologique, il existe une dimension affective liée à la gestation, aux circonstances de la naissance et de l'abandon. Quant au père, le plus souvent, il a conçu dans l'ignorance ou a fui devant ses responsabilités. Ce secret est hérité de deux traditions distinctes que l'on confond trop souvent. La première est celle du secret entourant la remise de l'enfant, apparue au VIIIème siècle dans toute l'Europe chrétienne et qui s'est traduite par l'installation des « tours », ces petits berceaux de pierre ou de bois, situés notamment à l'extérieur des couvents, que l'on pouvait faire pivoter à l'intérieur du bâtiment de façon à recueillir le nourrisson. Elle s'est perpétuée, en 1904, avec l'instauration de bureaux ouverts de jour comme de nuit où l'on pouvait déposer un enfant paraissant âgé de moins de sept ans sans décliner son identité. Cette possibilité de remise dans le secret, restreinte en 1996 aux enfants de moins d'un an, a été définitivement abrogée par la loi du 22 janvier 2002. La seconde tradition de secret, celle de la maternité secrète, est plus récente puisqu'elle est apparue, en France, au XVIIème siècle : il s'agissait d'autoriser la femme enceinte à accoucher gratuitement sans décliner son identité, afin de préserver la santé de la mère comme celle du nouveau-né. L'accouchement secret, appelé communément « accouchement sous X » en vertu de la pratique hospitalière, est l'héritier de cette tradition et a été maintenu par la loi du 22 janvier 2002. À cette occasion, le législateur a cependant voulu instaurer un équilibre entre le droit de la personne adoptée ou pupille de l'État de connaître l'identité de sa gestatrice et le respect de la volonté de cette dernière de ne pas dévoiler son identité. La loi a voulu instituer une symétrie pour les situations du passé, mais il convient de souligner que le père de naissance est rarement présent au moment de la naissance. Après trois ans de fonctionnement du CNAOP, il est possible d'esquisser un premier bilan de l'application de la loi pour savoir si cet objectif d'équilibre a été atteint. À cet égard, le CNAOP est à la fois héritier du passé et bâtisseur de l'avenir. Le CNAOP reçoit et instruit les demandes individuelles d'accès aux origines personnelles. La loi lui donne mission de rechercher la mère de naissance - éventuellement le père si des renseignements le concernant existent - et de vérifier sa volonté, à un moment ultérieur de sa vie. Ces trois années de pratique professionnelle sont riches d'informations, à la fois sur les motivations des personnes qui demandent la levée du secret et sur les réactions des femmes que nous contactons pour les informer de la requête. Au 31 octobre 2005, le CNAOP avait reçu 2 199 demandes et clos 1 143 dossiers, ce qui signifie que dans plus de 50 % de cas, nous avons apporté une réponse au demandeur, positive ou négative, après avoir mené toutes les investigations autorisées par la loi. Dans 40 % des cas, le dossier est clos après communication au demandeur de l'identité de sa mère de naissance, pour trois motifs différents : absence de secret dans 16 % des cas ; décès de la mère de naissance sans opposition à la levée du secret de son vivant dans 13 % des cas ; accord donné par cette dernière à la levée du secret de son identité dans 9 % des cas. En revanche, dans 43 % des cas, la mère de naissance n'a pu être identifiée et, dans 14 % des cas, elle a refusé de lever le secret, comme la loi lui en réserve expressément la possibilité. Voici quelques paroles d'adoptés, qui sont autant d'histoires de vie. Charles, vingt-huit ans : « Pour moi, la rencontrer n'est pas le plus important ; mon fantasme était d'être né d'une violence faite à ma mère, et elle vous a expliqué que j'étais né d'une histoire d'amour mal terminée, ce qui change tout ». Après une rencontre sans communication d'identité avec sa mère de naissance qui a eu lieu en ma présence, Viviane, trente-huit ans, me donne de ses nouvelles régulièrement ; elle a renoué le lien avec ses parents adoptifs. Il y a aussi les histoires plus tristes des pupilles de l'État non adoptés, celle de ces jumelles de cinquante ans qui expriment leur regret de n'avoir jamais pu souhaiter la fête des mères à qui que ce soit ; avec l'aide du CNAOP, elles ont pu rencontrer leur mère de naissance, qui habitait à quinze kilomètres de chez elles. Il y a enfin ces personnes qui, au tout dernier moment, renoncent, alors qu'elles ont saisi le CNAOP dans ce but, à rencontrer leur mère de naissance, laissant cette dernière dans un grand désarroi. Et puis il y a ces destins de femmes qui ont donné la vie mais n'ont pu faire davantage ; ils montrent combien la condition féminine a été bouleversée au cours des années soixante-dix par la légalisation de la contraception, de l'interruption volontaire de grossesse, et plus généralement le changement des mentalités. Marie, placée comme petite bonne chez un artisan à l'âge de seize ans et à qui son patron, marié et père de famille, va faire un enfant tous les ans, huit au total, qu'elle abandonnera dans le secret ; elle aura un neuvième enfant d'un ouvrier vernisseur, qu'elle abandonnera également et qui, devenu adulte, saisira le CNAOP. Hélène, qui a abandonné deux enfants, m'a raconté avoir gardé pendant des années un petit papier avec leurs dates de naissance et l'avoir jeté lorsque les services sociaux lui ont dit qu'elle ne pouvait pas savoir ce qu'ils étaient devenus. Certaines femmes refusent tout échange, en disant : « Je suis mère et grand-mère ; comment expliquer cela à mes petits enfants ? », ou bien : « J'ai refait ma vie et je ne veux pas qu'on la détruise », ou encore : « Quand elle est venue au monde, je ne l'ai pas vue ; on ne peut pas aimer quelqu'un après tant d'années ». D'autres demandent si l'enfant qu'elles ont mis au monde a été « bien adopté », s'il est heureux. Quant aux témoignages de pères, nous n'en avons pas beaucoup, et je retiendrai celui-ci : « Des enfants, madame, j'ai pu en faire cent cinquante ! ». Certaines de ces femmes ont pu reconstruire leur vie. Pour d'autres, au contraire, le traumatisme alors vécu les en a empêchées. En tout cas, il apparaît que les circonstances de la conception et de l'accouchement ne permettent pas de présumer de leur position, vingt, trente ou quarante ans plus tard, quand elles sont contactées par le CNAOP, ce qui montre bien l'importance de l'écoulement du temps. Pour répondre à votre question sur la révélation après le décès, il a pu sembler choquant de ne pas respecter la volonté d'une femme après sa mort, de porter atteinte à sa mémoire, alors qu'elle n'a pas eu l'occasion d'exprimer sa volonté à cet égard auprès du CNAOP lors d'une demande d'accès aux origines personnelles. Nous avons déjà été confrontés à des situations d'usurpation d'identité : la maîtresse accouche sous le nom de l'épouse de son amant. Mais l'expérience du CNAOP semble montrer que la révélation après la mort ne cause pas de drame. Les autres enfants s'étonnent, mais comprennent et ne portent pas de jugement. Cela les éclaire même parfois sur leur propre destin et il arrive qu'ils expriment le souhait de rencontrer ce « frère » ou cette « sœur » qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, les demandeurs s'en trouvent apaisés : ils peuvent choisir de retrouver des membres de la famille de leur mère de naissance ou seulement d'aller se promener sur les lieux qu'elle a fréquentés. Il serait inopportun de faire machine arrière en interdisant la levée du secret après le décès de la mère, alors que celle-ci n'a pas exprimé sa volonté de le maintenir. Il ne faut pas non plus revenir, à travers une disposition pour le coup clairement rétroactive - la loi de 2002 l'est déjà à certains égards -, sur le respect de la volonté de secret réitérée par les femmes contactées par le CNAOP, d'autant que 86 % de celles qui refusent de communiquer leur identité souhaitent expressément qu'il en soit de même après leur décès. En revanche, je pense que la loi pourrait être révisée en ce qui concerne la possibilité offerte aux représentants légaux de l'enfant de saisir le CNAOP en son nom, car la demande d'accès aux origines personnelles est éminemment personnelle. Que penser de la saisine du CNAOP par les parents d'un enfant de trois ans ? Il serait préférable de prévoir que la personne adoptée ou pupille mineure ne peut demander la communication de l'identité de ses parents de naissance qu'à partir d'un certain âge. Cet âge pourrait être treize ans, c'est-à-dire l'âge requis pour consentir à l'adoption, mais je préfèrerais qu'il soit fixé à seize ans. Entre seize et dix-huit ans, la demande requerrait l'accord du représentant légal de l'enfant ; dans l'hypothèse d'une opposition de ce dernier, un administrateur ad hoc pourrait être désigné pour accompagner le mineur dans sa démarche. Les mineurs qui nous saisissent sont rares - 2 % des dossiers - et le plus jeune était âgé d'une dizaine d'années. Une exception à cette limite d'âge pourrait être envisagée en cas de problèmes médicaux graves avérés. Il conviendrait également d'autoriser le CNAOP à accéder au fichier INSEE des actes de naissance, comme pour les actes de décès. Je n'insisterai pas sur les manques de moyens criants du CNAOP. Nous avons fonctionné sans secrétariat pendant trois semaines, de sorte que le président du Conseil, M. Bernard Golse, a décidé de suspendre tout enregistrement entre le 15 novembre 2005 et le 1er janvier 2006. Les relevés semestriels adressés au CNAOP en 2003 et 2004 sont en cours d'exploitation. En 2004, nos correspondants départementaux, qui accomplissent un travail remarquable, ont rencontré 95 % des femmes accouchant dans le secret, contre 80 % en 2003. Sur soixante-cinq départements, nous avons décompté 394 situations d'enfants nés sous le secret et non repris par leur mère. Dans 30 % des cas, la mère a déclaré ouvertement son nom, soit à l'état civil, soit dans le dossier de l'enfant. Dans 30 % des cas, elle a déposé un pli fermé. Il reste 40 % de mères restées anonymes, avec une disparité entre la province et Paris, où la proportion de femmes étrangères en situation irrégulière, incapables de justifier de leur identité, est élevée. Je précise qu'il n'est pas certain que les plis renferment la véritable identité de la mère. La possibilité accordée à la mère de naissance de rester anonyme se justifie-t-elle encore aujourd'hui ? Seules des considérations sanitaires et médicales relatives à la mère et à son bébé pourraient encore légitimer le secret absolu. À titre personnel, je pense que le principe, sur ce point, pourrait être renversé, tout en sachant qu'il devrait souffrir des exceptions, notamment si la mère de naissance est en situation irrégulière sur le sol français. L'accouchement ne peut pas justifier une enquête de police. Il me semble possible de garantir à toute accouchée la confidentialité de la naissance et le respect de sa volonté. Mais demander à toute femme qui accouche de décliner son identité et d'en justifier ne me paraît pas de nature à la mettre en péril ni à mettre en péril l'enfant à naître. Cela suppose de considérer que nous sommes parvenus au terme d'une évolution et que le secret absolu peut être remplacé par le secret relatif. Mais il importe bien entendu de continuer à garantir à ces femmes que leur volonté continuera d'être respectée dans dix, vingt, trente ou quarante ans. Il conviendrait aussi, parallèlement, d'abroger les dispositions de l'article 341-1 du code civil pour redonner à l'accouchement secret sa place dans le code de l'action sociale et des familles. La possibilité de demander le secret de l'accouchement est une mesure d'ordre sanitaire et social, et la fiction juridique qui consiste à nier la réalité de l'accouchement peut être ressentie par les personnes concernées comme un déni de leur propre naissance. L'identité devrait être consignée sous pli fermé, avec la photocopie de la pièce d'identité, et stockée au niveau national. S'agissant des difficultés posées par la reconnaissance anténatale du père, je considère que le dispositif de recherche des dates et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant par le procureur de la République (article 62-1 du code civil) est une solution efficace. Tout autre dispositif serait trop lourd. Quoi qu'il en soit, la situation des pères est moins empreinte d'affectif que celle des mères. S'agissant des enfants nés d'une procréation médicalement assistée, la recherche des origines ne me semble pas être d'ordre affectif : ce n'est pas la recherche d'une histoire, ni des causes de l'abandon, mais bien celle d'antécédents biologiques. Le problème posé n'est donc pas le même et la réponse à y apporter peut être différente. M. Pierre Verdier : J'ai été directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pendant vingt ans, et j'ai créé la Coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines (CADCO), il y a une douzaine d'années. Je parle donc à partir d'une expérience de terrain. Il nous est arrivé d'organiser des rencontres, avec moins de moyens que le CNAOP, mais quelquefois avec autant de résultats. Contrairement à celle de la plupart des pays du monde, notre réglementation organise le secret et ne garantit aucun droit à la connaissance des origines personnelles. Premièrement, en effet, la filiation résulte de la volonté des adultes : la déclaration de naissance est certes obligatoire mais l'indication du nom des parents est facultative ; s'ils ne sont pas désignés, aucune indication ne sera portée sur les registres d'état civil. Deuxièmement, la mère peut accoucher dans l'anonymat : c'est ce qu'on appelle communément « l'accouchement sous X ». La France traîne donc derrière elle une longue tradition de secret. Pendant longtemps cette question est restée dans l'ombre. Les personnes abandonnées vivaient dans la honte de leur abandon, et ce sentiment n'a d'ailleurs pas disparu. Il n'est pas rare que des personnes n'osent pas prendre la parole dans les débats que nous organisons, de peur que l'on comprenne qu'elles sont des enfants abandonnés. De plus, la parole était portée par des spécialistes, psychiatres ou juristes, qui parlaient à la place des intéressés. C'est la prise de parole publique des personnes concernées qui a fait évoluer la question, essentiellement depuis la loi de 1978 sur l'accès aux dossiers administratifs. Aujourd'hui existent plusieurs associations d'enfants nés sous X, adoptés ou non, ainsi que de mères ayant accouché sous X. La CADCO, que nous avons créée en 1992, regroupe des personnes adoptées, des mères, des adoptants et des professionnels, car nous considérons que les droits des uns et des autres doivent s'articuler. De fait, les personnes concernées nous disent que la mère comme l'enfant sont victimes du secret : aucun des deux ne s'en remet jamais complètement. Les uns et les autres vont s'épuiser et épuiser leur entourage, en démarches souvent vaines : une d'entre elles me disait : « ma vie n'aura été que cette quête ». Le secret de la filiation ampute l'enfant de son identité, il crée deux catégories de citoyens, certains qui ont droit à une origine, une généalogie, un nom de famille ; d'autres qui en sont privés en raison des conditions de leur naissance. C'est une discrimination en raison de la situation de naissance. Ce n'est pas un droit des mères : peu l'ont choisi, mais elles y ont été acculées, et beaucoup ne peuvent faire le deuil de cet enfant sur lequel la loi a posé un déni. Enfin, vous le savez, ce système permet toutes sortes de trafics : fausses reconnaissances, suppositions d'enfants, éloignement du père, même s'il a reconnu l'enfant. La loi du 22 janvier 2002 a mis en place un dispositif qui recherche l'équilibre, à travers quatre points : la possibilité pour les futures mères de demander le secret de l'admission, et même l'anonymat, est maintenue ; la femme est cependant informée de l'importance pour toute personne de connaître son origine et son histoire ; elle est invitée à laisser des renseignements sur sa santé, celle du père, les origines de l'enfant, ainsi que, sous pli fermé, son identité ; elle est informée que cette identité ne sera communiquée que si elle lève le secret. Il résulte de ce dispositif que l'enfant ne dispose pas du droit de connaître ses parents, mais qu'il en a seulement la possibilité si la mère l'accepte. Le titre de la loi du 22 janvier 2002 ne contient du reste aucune ambiguïté : il ne fait référence à aucun droit. Sur plusieurs points, cette loi porte objectivement des reculs ; j'en citerai deux. En premier lieu, jusqu'à la loi du 22 janvier 2002, le secret reposait sur une demande expresse de la mère. La nouvelle loi instaure une présomption de secret : sans manifestation expresse de la volonté de le préserver, le CNAOP doit vérifier la volonté de la mère. C'est un recul considérable car la mère, lorsqu'elle est contactée par une administration quarante ou cinquante ans après l'abandon, refuse dans 60 % des cas, ce qui est compréhensible. Je précise que, si elle est contactée directement par son enfant avec l'aide d'une association, elle ne refuse généralement pas le contact, y compris lorsqu'elle avait dit non au CNAOP. Deuxième recul : si la mère a refusé, le secret sera éternel, y compris après sa mort. Ainsi, tous les délais de prescription sont dépassés, même ceux des secrets intéressant la défense nationale ou la sûreté de l'État, qui ne sont que de soixante ans... Vous savez, l'éternité, c'est long. Le nouveau dispositif ne crée donc pas un droit de connaître son histoire, ce qui met la France en porte-à-faux par rapport à ses engagements internationaux, qui vont au-delà de la Convention internationale des droits de l'enfant. La recommandation du 26 janvier 2000 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe invite les États membres, dont la France fait partie, « à assurer le droit de l'enfant adopté de connaître ses origines au plus tard à sa majorité et à éliminer de leur législation nationale toute disposition contraire ». De même, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale dispose que les États vérifient que la mère a donné librement son consentement à l'adoption dans les formes légales requises et que celui-ci a été donné ou constaté par écrit. La France n'applique donc pas elle-même ce qui est exigé des pays du tiers-monde. Mais ce n'est pas le plus grave. Des milliers de Français sont privés d'identité et des milliers de mères ne peuvent faire le deuil de cet enfant qu'elles sont censées ne pas avoir eu, alors que des aménagements sont possibles. Les quatre questions que vous avez bien voulu nous transmettre ont été soumises à nos adhérents sur notre forum de discussion et nous avons reçu près de deux cents réponses. Faut-il, tout en maintenant le droit pour la mère d'accoucher de manière anonyme, instaurer un droit pour l'enfant d'accéder à ses origines à sa majorité ? Cette question contient une confusion sémantique entre secret et anonymat : le secret est un savoir protégé ; l'anonymat est l'absence de savoir. Quoi qu'il en soit, cette proposition rejoint celle de la Commission d'enquête parlementaire présidée par M. Laurent Fabius en 1998. Les associations pour le droit aux origines sont favorables à cette idée, qui pourrait se concrétiser par trois dispositions : le recueil obligatoire de l'identité avec éventuellement demande de secret ; la communication à l'enfant mineur avec l'accord de la mère ; la communication de droit à l'enfant majeur. Le secret doit-il être parfaitement garanti près le décès de la mère ? Vous l'avez compris, nous sommes favorables au secret mais opposés à l'anonymat, qui est irréversible. À un moment de leur vie, certaines femmes ont besoin de discrétion et de secret mais celui-ci ne peut qu'être limité dans le temps. Que protège-t-on cent ou deux cents ans après la mort ? Ce droit sur autrui est totalement inconcevable et exorbitant : il faut s'en tenir aux délais des secrets sur la vie privée, limités à soixante ans. Une adhérente nous a écrit : « Nous sommes les grands maudits de l'époque ; même les archives militaires ne prévoient pas cette clause ». Les psychologues pourraient d'ailleurs gloser sur le mot « maudits », qui, étymologiquement, signifie « non reconnus ». Lorsque l'enfant est mineur, ses représentants légaux peuvent demander en son nom l'accès à ses origines. Faut-il faire de cette requête une démarche exclusivement personnelle en la réservant au mineur lui-même ? La commission Fabius recommandait que la demande de communication ne soit ouverte qu'à l'intéressé, en la soumettant à un âge minimum ou à la capacité de discernement. Elle ne pourrait être exercée que par l'enfant et non par ses représentants légaux, mais sous réserve de leur information. Plusieurs membres des associations suggèrent que l'enfant soit alors accompagné par un adulte de son choix, comme cela se fait pour des soins ou pour l'interruption volontaire de grossesse, lorsqu'il ne veut pas que ses parents soient au courant. Faut-il prévoir, pour tout enfant né sous X, que le tuteur ait l'obligation de diligenter les recherches nécessaires afin de s'assurer qu'il n'a pas été l'objet d'une reconnaissance anténatale ? Cela me paraît évident. Plusieurs affaires récentes rappellent l'injustice et les dangers de la situation actuelle. Certains proposent même que les grands-parents soient avertis, voire les oncles et tantes. Commençons au moins par l'évidence : mettre au courant le père. Les modifications de la loi du 22 janvier 2002 ne seraient que des « replâtrages » pour tenter d'améliorer une usine à gaz qui fonctionne très difficilement. Les parlementaires devraient faire preuve de davantage d'ambition, en adoptant trois mesures : établir que la filiation découle automatiquement de la naissance ; aménager le recueil de l'enfant qui ne peut être élevé par ses parents, de manière à préserver l'équilibre des droits ; instaurer un mode unique d'adoption qui respecte les deux filiations. L'ordonnance du 4 juillet 2005 prévoit que l'indication du nom de la mère vaudra reconnaissance à partir du 1er juillet 2006, mais cette indication reste facultative. Le droit français doit exiger, comme c'est le cas en Belgique, que la mère indique son nom et celui du père, ce qui serait conforme à une certaine éthique de la responsabilité et de la filiation. L'établissement automatique de la filiation éviterait des confusions de la part de femmes qui ont accouché sous X et se croient mères mais ne le sont pas juridiquement. En l'absence de reconnaissance paternelle, celui que la mère aura désigné comme le père en serait informé par lettre recommandée et pourrait faire opposition s'il estime ne pas l'être. Le seul fait de déclarer son nom, de déposer un acte légal et de savoir que c'est inévitable oblige les parents à se projeter en tant que parents. En effet, comme l'a bien montré le docteur Delassus, le sentiment maternel se construit, il ne se présume pas, et la négation de la mère dans l'accouchement sous X empêche cette construction. La possibilité d'une remise secrète, c'est-à-dire avec indication du nom de la mère et demande de secret, serait maintenue. Cette identité pourrait ensuite être transmise à l'enfant qui en fait la demande dans les conditions exposées ci-dessus. Enfin, je vous suggère d'instituer un mode unique d'adoption, respectant les deux filiations et combinant les avantages des deux régimes actuels, de la même façon que les filiations naturelle et légitime ont été fusionnées en un chapitre unique. La personne adoptée a en effet des parents de naissance, des parents d'éducation, des parents juridiques, et le droit doit ménager et concilier toutes les parentés et toutes les filiations. La filiation d'origine ne peut être niée par une fiction juridique. Prétendre que la mère qui accouche n'existe pas est un non-sens. On peut refuser les conséquences d'une maternité, mais non son existence. Le rôle de la loi est d'organiser la réalité, pas de la travestir au point d'en faire un non-sens. Il faut donc concevoir un type d'adoption qui respecte cette réalité. Ce nouveau mode d'adoption n'entraînerait pas de rupture avec l'origine. Il serait révocable, pour motif grave, à la seule demande de l'adopté, et reprendrait les avantages de l'adoption plénière actuelle, notamment en matière de nationalité et d'inscription sur le livret de famille. Mme Françoise Laurant : Le Planning familial n'est pas une association spécialisée dans l'accouchement sous X ou dans l'accès aux origines personnelles. Cependant, ces questions mettent en cause les droits des femmes en matière de maternité, de grossesse, et plus généralement de maîtrise de leur corps. Ces droits sont trop souvent abordés sous un angle particulier, et par conséquent réducteur, alors que nous souhaitons en discuter globalement pour lutter contre la culpabilisation. La loi de 2002 est un texte d'équilibre entre le droit de l'enfant à accéder à ses origines et le droit des femmes à accoucher sous X, toute naissance impliquant deux individus. Elle unifie les pratiques en matière d'accès aux origines mais apporte bien peu de précisions sur l'accouchement sous X. Celui-ci a déjà fait l'objet, en 1996, d'une loi spécifique, dont les décrets d'application n'ont jamais été publiés. Trois associations de femmes sont représentées au sein du CNAOP : le Planning familial, le Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles et l'association Solidarités mères d'origine. Cette représentation montre le souci légitime de voir les droits des femmes défendus au sein du Conseil. Les femmes contraintes d'accoucher sous X demandent l'anonymat non seulement au moment de l'accouchement mais également après. Si les femmes sont si angoissées au moment de l'accouchement, c'est qu'elles ont peur de voir leur nom extorqué. Et les femmes qui accouchent sous X ne peuvent pas en parler, ni s'organiser en associations. Les conséquences concrètes de la loi de 2002 n'ont pas été étudiées. Trois ans après son entrée en vigueur, nous commençons à peine à pouvoir en mesurer les effets, les dysfonctionnements et les limites, du côté des enfants comme de celui des femmes. Nos associations sont confrontées à des situations graves - heureusement rares - de femmes dont la grossesse est très avancée - trop avancée pour recourir à une interruption volontaire en France - et qui veulent à tout prix obtenir des adresses en Grande-Bretagne, en Hollande et en Espagne pour interrompre cette grossesse. Nous leur rappelons qu'elles peuvent recourir à l'accouchement sous X, mais elles n'y croient pas car elles pensent que le secret sera bientôt levé. Les femmes, face à la moralisation et à la dramatisation, se sentent coupables. On leur demande constamment de penser à l'enfant alors que, justement, elles ne veulent pas y penser. Avant le débat préparatoire à la loi de 2002, quelques structures existaient où les femmes étaient prises en charge deux mois avant l'accouchement, parfois hébergées, ce qui leur offrait un environnement plus serein, plus pacifique, propice à la bonne décision. Aujourd'hui, nous regrettons que rien ne soit fait pour que les femmes aient le droit d'accoucher secrètement, et pour que cela soit affirmé publiquement. Certaines femmes, vous le savez, ne mettent rien du tout dans l'enveloppe, ou mettent de fausses informations. Et la proportion de celles qui refusent de lever le secret est élevée. Avant de procéder à une modification législative, il faudrait évaluer quelles sont les conséquences psychologiques pour une personne qui est amenée à redire « non » plusieurs décennies plus tard, et pour l'enfant qui, d'une certaine façon, subit un second abandon. En 1999, le service des droits des femmes avait organisé un audit sur les femmes ayant accouché sous X, et recueilli leur parole. J'ai le sentiment que la réalité, aujourd'hui, a changé : peut-être serait-il utile d'organiser une initiative identique. Comment et par qui les femmes sont-elles informées ? Par une assistante sociale ? Un médecin ? L'école ? Il faut leur dire que l'accouchement sous X n'est ni « ringard », ni en voie de disparition : il existe toujours en France, et d'autres pays européens envisagent de mettre sur pied des mesures similaires. Il serait intéressant de savoir ce qui se passe entre ces femmes et les administrations, et pas seulement avec l'aide sociale à l'enfance et le CNAOP. Quel est le degré de confiance ? Parviennent-elles à s'exprimer ? Comment vivent-elles la situation ? Nous avons le sentiment que le travail qui était mené avec ces femmes a été complètement abandonné. En tout cas, il serait inopportun de réduire les droits des femmes en supprimant le secret : on leur demanderait de donner leur nom, on en vérifierait l'exactitude, tout en prétendant garantir le secret ! Qui pourrait y croire ? Le recensement d'informations tendrait à supprimer tout accouchement secret. Par ailleurs, en l'état actuel du droit, une mère qui demande le secret n'a aucune garantie que son nom ne sera pas communiqué après son décès. Je trouve cela incorrect car la mort d'une personne ne modifie pas sa volonté. Mme Françoise Monéger : La loi ne définissant pas les origines personnelles, il est fondamental de commencer par savoir ce que l'on entend par cette expression. S'il s'agissait de garantir à tout enfant l'accès à ses géniteurs, il faudrait bouleverser complètement notre droit de la filiation, car celui qui est nommé père ou mère peut ne pas être le géniteur. Peut-être y viendrons-nous pour des motifs de santé, et toute cette discussion paraîtra alors anecdotique. Il faut considérer l'accès aux origines personnelles comme un droit de l'homme plutôt que comme un droit de l'enfant. Si l'on voulait garantir à chacun le droit de connaître ses origines, il faudrait faire à la naissance de tout enfant une analyse génétique. Une jurisprudence allemande a obligé une mère à nommer le père de sa fille : elle a cité les noms de trois amants, et des recherches génétiques ont été effectuées pour déterminer l'identité du père de façon incontestable. Le droit actuel ne garantit pas à l'enfant la connaissance de ses origines personnelles car le père et la mère peuvent ne pas être les géniteurs, notre droit de la filiation, confirmé par l'ordonnance de juillet 2005, étant fondé sur la présomption. S'agissant des cas d'abandon d'enfants, le secret ne concerne que les enfants nés sous X, à l'exclusion de ceux abandonnés dans d'autres conditions, qui conservent leur identité de naissance. Contrairement à Mme Jacqueline Rubellin-Devichi, je suis radicalement opposée à l'anonymat. En effet, pour garantir à l'enfant majeur la connaissance de ses origines, il importe d'exiger la conservation d'une trace, laissée par la mère au moment de la naissance. Il est incohérent de garantir à la fois l'accouchement sous X et le droit d'accès aux originelles personnelles. Si on privilégie le droit de l'enfant, il faut obliger la mère à laisser son identité. En outre, les textes sur le régime de l'accouchement secret ne sont pas clairs : dans le code de l'action sociale et des familles, il n'est pas fait référence à la femme demandant le secret. La loi de 2002 portant création du CNAOP n'a pas repris les dispositions de 1996 et n'a fait que compliquer les choses. Une affaire récente mettant en cause une Irlandaise est révélatrice : cette femme n'avait pas compris les articles du code de l'action sociale et des familles et l'affaire est allée jusque devant la Cour de cassation. Deux solutions existent : maintenir l'anonymat ou organiser réellement le recueil d'éléments identifiants. Vous l'avez compris, je suis favorable à la seconde option. Je considère par ailleurs que la question ne se pose qu'à la majorité de l'enfant. J'estime enfin que le secret peut être levé une fois que la mère de naissance est décédée. Mais ce point soulève une autre question de droit, tenant à l'application de la loi dans le temps. Il faut raisonner en fonction de l'environnement juridique en vigueur au moment de l'accouchement, faute de quoi la loi serait rétroactive. Le problème de la procréation médicalement assistée est complètement différent, mais une personne née grâce à cette technique a aussi le droit de connaître ses origines personnelles. Dans des pays comme la Suède ou l'Allemagne, l'identité du donneur de sperme est communiquée. Si la réglementation française prenait la même direction, il serait absolument indispensable de respecter le droit au secret des hommes ayant effectué leur don antérieurement à la nouvelle législation. En conclusion, j'insiste sur le fait que la rédaction du code de l'action sociale et des familles n'est pas claire et doit être revue dans le sens que souhaitera lui donner le législateur. M. le Président : Une controverse juridique est donc ouverte entre deux professeures de droits, Mmes Monéger et Rubellin-Devichi. Mme Jacqueline Rubellin-Devichi : Ce n'est pas une controverse mais une opposition totale ! Je pointerai trois questions en relation étroite avec notre sujet. Jusqu'en 2002, le secret était à peu près organisé, selon les textes de 1940 appliqués tant bien que mal par les travailleurs sociaux. La loi de 2002 n'est pas parfaite mais présente le mérite non seulement d'exister, mais surtout d'apporter une garantie aux femmes. Je tiens donc à réhabiliter le CNAOP. J'appuie la position défendue par Mme Laurant selon laquelle les femmes ne peuvent pas avoir confiance dans un dispositif qui les obligerait à écrire leur identité au moment où elles se présentent pour accoucher sous X. Je désapprouve la proposition consistant à ouvrir un droit à lever l'anonymat : les femmes qui le souhaitent doivent pouvoir maintenir le secret. Quoi qu'il en soit, critiquer systématiquement la loi de 2002 et l'institution du CNAOP est une erreur, car les résultats sont là. Certaines femmes ayant accouché sous X prétendent que leur enfant leur a été arraché par l'aide sociale à l'enfance et qu'elles n'ont pas pu savoir où il allait. C'est impossible ! Une enquête menée par M. Dominique Ferrière, actuellement président du tribunal de grande instance de Troyes et lui-même enfant abandonné, a démontré que les agents de l'aide sociale à l'enfance ne sont pas des fous ; au contraire, ils font tout ce qu'ils peuvent. Je recommande donc la plus grande prudence dans l'élaboration de la législation, car le risque est bien que les femmes, demain, se voient contraintes de revenir sur leur secret. En tout état de cause, le droit de la femme à accoucher sous X figure aujourd'hui dans le code civil ; en attendant que la loi soit modifiée, il doit être garanti à tout prix. Il convient aussi de lever une équivoque. L'abandon peut intervenir bien après la naissance : des enfants sont ainsi déposés dans la rue ou dans des maisons de l'enfance. Dans l'adoption plénière, l'acte de naissance de l'enfant est déclaré nul et remplacé par un nouveau document qui fait référence aux adoptants, avec le délibéré du jugement en marge. Il est question aujourd'hui d'ouvrir l'adoption aux couples homosexuels, mais il ne serait pas sérieux d'essayer de faire croire à un enfant qu'il est issu de deux hommes ou de deux femmes, d'autant que tous les petits, avant même de savoir lire, cherchent à savoir comment se font les bébés. Il conviendrait donc de ne plus annuler l'acte princeps, mais de se contenter d'y spécifier la filiation adoptive. Lorsqu'une femme accouche sous X, l'hôpital lui demande de remettre son identité sous pli scellé à l'entrée, pour que l'administration sache que faire du cadavre si elle décède, mais son nom n'apparaît nulle part ailleurs. Je crois que la formule du pli cacheté est mauvaise, car les mots écrits par la mère peuvent être ravageurs. La déclaration d'accouchement sous X ne peut être effectuée que sous trois jours, hormis dans certains cas, comme celui des enfants trisomiques : lorsque les parents se rendent finalement compte qu'ils n'auront pas le courage de les garder, le personnel médical et social a l'humanité d'accepter des déclarations différées. Mme Françoise Monéger : Si l'adoption plénière est irrévocable, cela n'empêche que l'enfant doit être en mesure de connaître sa filiation. Je suis donc d'accord avec l'idée de revoir le contenu de l'acte de naissance. Le problème ne se pose d'ailleurs pas dans la plupart des cas puisque, de nos jours, la majorité des enfants adoptés sont nés à l'étranger. Un consensus est donc réuni sur ce point. Mme Marie-Christine Le Boursicot : Je siège également au Conseil supérieur de l'adoption, et je ne pense pas qu'il existe un consensus sur ce point. Mme Corinne Daubigny : La loi garantit-elle le droit de l'enfant à connaître ses origines ? Ma réponse sera également négative, et la formulation de la question posée me semble un peu tendancieuse. Si la loi reconnaissait ce droit, il serait soumis aux seules conditions de ne causer aucun préjudice. Or ce n'est pas le cas, la mère pouvant tout simplement invoquer le « droit à la vie privée ». La sexualité fait partie de la vie privée, mais certainement pas la naissance d'un enfant. La procréation et la naissance, chez l'être humain, ne sont pas réductibles à de pures données biologiques ou à de simples exercices de gymnastique ; ce sont des comportements sociaux qui engagent la pérennité du genre humain à travers chaque enfant qui vient au monde. Le maintien du secret après le décès de la mère prouve qu'il s'agit non pas de protéger la personne elle-même mais sa réputation, l'argument confinant par conséquent à la sauvegarde de la « paix des familles »... Ainsi la loi « protège » les parents du désir des enfants vivants de savoir qui leur a donné le jour. Quelles sont les entraves à la reconnaissance du droit des personnes, y compris des mineurs, à connaître leurs origines personnelles ? J'ai identifié deux réponses qui tiennent, d'une part à la logique juridique, et de l'autre à la méconnaissance de données cliniques. Premièrement, la logique juridique entre en jeu, car une modification de la situation nécessiterait de bouleverser notre droit. Le législateur protège actuellement l'anonymat des procréateurs, hommes et femmes - les paternités anonymes sont bien plus nombreuses que les maternités anonymes et d'ailleurs bien souvent à l'origine des maternités anonymes -, mais la recherche en paternité, au moins, n'est pas interdite. Ce faisant, le législateur protège la formulation de l'adoption plénière comme filiation substitutive et non comme transfert de droits. Un tel transfert serait pourtant plus conforme à la Convention de La Haye. L'adoption confine donc dans certains cas à son propre déni, les parents adoptifs étant censés se substituer aux parents d'origine. Le législateur encourage ainsi, sans doute inconsciemment, des pratiques d'adoption privilégiant la recherche de bébés supposés sans histoire, sans passé, issus de pays qui organisent l'abandon anonyme à plus grande échelle que chez nous. Il protège par ricochet les abandons anonymes, au risque de dérives criminelles. Ces pratiques ne permettent pas de s'assurer du consentement des mères et couvrent, hélas, les trafics d'enfants aiguisés par le déséquilibre économique planétaire et banalisés par la mondialisation. La formule de l'adoption plénière substitutive protège les représentations de notre code de la nationalité, qui s'articule autour du droit du sol et du droit du sang, de sorte que l'accès à la nationalité française ne se déduit de l'adoption plénière que si elle crée un « lien de sang » fictif. Enfin, l'anonymat des parents procréateurs protège d'une remise en cause de l'anonymat du don de gamètes, et l'idée d'une sélection doucement eugénique, horizon d'un pouvoir absolu des États sur l'avenir de l'espèce humaine. Le système de représentations qui sous-tend cette logique semble devoir beaucoup, d'abord aux préjugés issus du catholicisme, qui a longtemps interdit l'adoption, stigmatisé les « enfants du péché », tout comme la stérilité, et protégé la toute-puissance paternelle. Il tient également à la forme française du nationalisme républicain, qui repose sur l'arrachement des sujets à leurs origines naturelles autant que culturelles. Il est enfin révélateur de l'avancée d'une idéologie néolibérale qui appuie le pouvoir de l'État sur le consentement du citoyen. Mais tout le monde peut comprendre que les trafics d'enfants constituent une instrumentalisation intolérable des parents procréateurs, des enfants et des adoptants. Cette seule remarque devrait suffire à nous déterminer à rendre notre législation conforme à la Convention de La Haye (que la France a signée) en supprimant l'accouchement sous X et en définissant l'adoption plénière comme transfert de droits. Voyons les données cliniques : du point de vue de la construction de l'enfant, les parents procréateurs ne peuvent, en droit, rester totalement irresponsables de l'enfant qu'ils ont conçu, ni au regard de l'interdit de l'inceste, ni au regard de l'hérédité qu'ils transmettent, et donc pas non plus au regard de la vérité sur leur identité. Leur donner un statut juridique et les faire ainsi apparaître responsables serait d'abord les protéger des pratiques de trafiquants vénaux ou bien-pensants, en veillant à ce que leur consentement à la remise de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance soit toujours recueilli dans des conditions juridiques sûres. Ce serait ensuite leur épargner la honte dans laquelle on veut les enfermer, mais aussi leur ôter la part de toute-puissance qu'on leur laisse. Du côté des parents adoptifs, il s'agit de garantir le fondement éthique de leur acte, qui assoit une grande part de leur autorité parentale. Du côté des enfants, il s'agit de les préserver d'une instrumentalisation originaire et de leur donner un droit à la santé physique et psychique égal à tous, de les délivrer de la hantise de l'inceste et de leur donner des chances égales au plan médical. Mais le droit à connaître ses origines personnelles reste peut-être, dans l'esprit du législateur, un luxe et non un véritable besoin. Les risques psychopathologiques liés aux procréations et abandons anonymes ne sont pas suffisamment connus, y compris de trop nombreux cliniciens, qui ont conforté l'organisation étatique de la forclusion des origines, bien que ces risques aient été en partie rendus sensibles à tous, depuis l'Antiquité, par des mythes comme ceux d'Œdipe ou de Moïse. Bien sûr, des personnes peuvent se construire de manière satisfaisante dans l'ignorance de l'identité de leurs parents d'origine, et à leur tour éduquer leurs enfants de manière saine. Cette ignorance n'est pas à elle seule source de troubles psychopathologiques ; d'autres facteurs contribuent à leur apparition. L'intérêt des adolescents pour leurs origines témoigne sans doute de leur curiosité pour la sexualité, l'amour et la génétique, sans compter la réactivation des angoisses d'abandon, voire des attitudes provocatrices. La gêne qu'ils éprouvent face à l'ignorance témoigne d'angoisses accrues par cette situation, mais il est possible de les rassurer et ils peuvent le plus souvent différer leur quête jusqu'à leur majorité. Les retrouvailles ne sont pas sans danger non plus pour les enfants mineurs ou majeurs - ni d'ailleurs pour les parents -, tant du côté des effets traumatiques et de la dépression que du côté des bouleversements de l'identité subjective. C'est pourquoi les parents - de naissance ou adoptifs - comme les enfants doivent pouvoir bénéficier d'un suivi psychosocial gratuit à leur demande. Il faut comprendre que les angoisses des enfants sont aussi le produit de celles des adoptants, qui craignent leur déloyauté. Aussi l'action prophylactique s'impose-t-elle, ce qui conduit à penser la préparation à la parentalité adoptive et la préparation des parents procréateurs à leurs responsabilités dans le cadre des retrouvailles. À partir de ma longue expérience en hôpital de jour, en institut médico-éducatif, dans le suivi des prises en charge par l'aide sociale à l'enfance, j'ai analysé les risques psychopathologiques encourus par les enfants rendus vulnérables du fait de l'ignorance de leurs origines personnelles. Cette première vulnérabilité se double souvent d'une seconde, produite par la rupture précoce avec la mère de naissance et par la prise de conscience plus tardive du probable abandon du père procréateur. Ces risques psychopathologiques, qui vont de la banale angoisse névrotique aux psychoses graves en passant par les troubles de l'identité, découlent de l'accumulation de facteurs dans une série d'« après-coups » qui jalonnent la vie de l'enfant puis de l'adulte, de sorte que les retrouvailles éventuelles ne règlent évidemment pas à elles seules tous les problèmes. Néanmoins, le simple fait de les rendre possibles peut limiter les ravages des contenus imaginaires projetés sur les trous de la symbolisation et les perturbations dans l'image du corps qui s'ensuivent. La conservation de l'identité des parents d'origine peut ainsi limiter les risques psychopathologiques. L'examen des troubles des enfants et des adultes privés de la connaissance de leurs origines personnelles m'a conduite à forger le concept de « noyau symbolique de l'identité », constitué par la nomination de parents procréateurs de l'enfant. L'enfant qui ignore l'identité de ses parents d'origine les vit comme des hôtes internes, incorporés, dès qu'il apprend leur existence. L'anonymat des origines compromet la construction de ce noyau symbolique et ouvre une véritable potentialité psychotique, plus ou moins bien compensée selon le parcours ultérieur des personnes. Seuls le repérage de l'identité des parents d'origine dans la réalité, l'ouverture à une rencontre possible et la symbolisation des liens et des ruptures qui découlent de leur existence permettent au sujet de s'en différencier véritablement. Il faut donc comprendre que, parmi les facteurs qui accroissent les risques de troubles graves de l'identité subjective et de décompensation psychotique, entrent la forclusion des noms des parents d'origine, les représentations inquiétantes véhiculées par la société mais aussi par les professionnels, voire par le discours juridique, sans compter le discrédit et l'angoisse suscités par les histoires récurrentes de trafics d'enfants. Parmi les risques psychopathologiques graves, il faut compter les troubles de la parentalité, notamment le risque de psychose puerpérale, et il n'est pas anodin que les femmes soient plus nombreuses que les hommes à rechercher leurs origines personnelles, surtout autour de leurs propres projets de maternité. Le droit à la connaissance des origines personnelles est fondé par le droit à la dignité. Il permet de se dégager de figures procréatrices stigmatisées et de les mettre à distance. La reconnaissance de ce droit est une nécessité éthique et prophylactique. Si des exceptions peuvent être discutées, son principe ne saurait être remis en cause au gré de chacun, et certainement pas au nom du respect de la vie privée. La révision du code civil qui doit suivre la suppression des filiations anonymes conduira à retravailler des notions fondamentales comme celles de filiation et de nationalité. Elle incite aussi à penser des mesures psychosociales de prévention, d'accompagnement et de soin. La loi du 22 janvier 2002, malgré ses défauts, a constitué une avancée partielle. Le secret de l'identité, autrefois irréversible, n'était pas un secret mais une forclusion organisée, un anonymat déguisé, car le secret est par nature réversible. Le secret réversible donne aux parents procréateurs le temps de s'émanciper des contraintes sociales et des tabous, pour assumer une mise au monde responsable mais dégagée des contraintes éducatives, parfois quelques décennies plus tard. Cette loi réduit le nombre de dossiers vides ou forclos et répond à la demande de nombreux enfants ; elle donne l'occasion de mieux comprendre ces parents qui ne peuvent élever leur enfant et de subvertir les discours stigmatisants qui les atteignent et, à travers eux, leurs enfants. Elle change aussi le regard des adoptants, jugulant une bonne part des délires sociaux sur l'hérédité morale ou sociale et de l'angoisse de voir les enfants quitter leurs adoptants pour renouer avec des parents de naissance. Le pire, dans la forclusion organisée des origines, était l'imaginaire infamant insufflé dans les trous de la symbolisation. Les parents adoptifs prennent aussi conscience du fait que leurs enfants ont une histoire et qu'il est nécessaire d'en tenir compte. Le législateur a compris que la rencontre entre parents procréateurs et enfants peut demander une médiation, un accompagnement, et a créé un organisme ad hoc. Enfin, cette loi a fait entendre que la recherche des enfants éprouvant le besoin de connaître leurs origines personnelles était, la plupart du temps, totalement inoffensive. La suppression de l'accouchement anonyme et la lutte contre la procréation anonyme amèneront à modifier d'autres dispositions importantes du code civil. Un enfant ne devrait plus pouvoir naître sans filiation, sauf impossibilité matérielle de trouver ses parents procréateurs. Le secret de l'identité des parents doit pouvoir être institué, mais rester dans tous les cas réversible, dans un délai ne dépassant pas vingt-cinq ans - c'est-à-dire, grosso modo, l'âge auquel les enfants sont censés devenir eux-mêmes parents -, ou, au plus tard, à la mort des parents de naissance. Il faudra donner un statut juridique aux parents de naissance qui ont renoncé à élever leurs enfants. Autrement dit, la reconnaissance à la naissance fonderait la filiation légitime et, dans un second temps, les droits et devoirs des parents d'origine seraient limités pour certains et délégués à d'autres. L'adoption plénière devra être définie comme transfert de droits et non comme substitution, ce qui la rapprochera de l'adoption simple ; la « rupture de liens » devra être remplacée par une rupture de droits précisément définis. Rien ne s'opposera plus à ce que l'adoption plénière devienne révocable en cas de maltraitance avérée, ce qui donnera une vraie égalité de droits aux enfants adoptés. Il faudra également introduire dans notre conception de la nationalité l'idée d'une réelle assimilation des enfants adoptés, sans recours à un lien de sang fictif. On admettra aussi que la nationalité est le produit d'un processus d'acculturation. La claire conscience du fait que la famille adoptive doit accepter de prendre en compte une histoire de l'enfant souvent traumatique devrait amener à des dispositions préventives, reconnaissant les spécificités des familles adoptives et leur rôle thérapeutique. Il est donc nécessaire d'instaurer une véritable préparation à la parentalité adoptive et un droit à un accompagnement psychosocial gratuit pour les parents, comme pour les enfants, et non limité à la recherche des origines personnelles. La recherche des origines personnelles doit pouvoir être ouverte aux mineurs capables de discernement, sous réserve que les représentants de l'autorité parentale en soient informés, en limitant peut-être toutefois cette démarche à des éléments non identifiants. Cela suffirait à limiter les ravages de l'imaginaire et éviterait que les parents de naissance puissent faire intrusion dans l'éducation de l'enfant. Des impératifs thérapeutiques doivent permettre à des mineurs accompagnés d'avoir accès à leurs origines personnelles, avec les mêmes réserves. L'identification peut être nécessaire cependant pour des raisons médicales, notamment pour réaliser des greffes. Ces recherches doivent pouvoir être engagées par l'enfant avec l'accord des représentants de l'autorité parentale à titre préventif, avant que des troubles ne surviennent, par exemple pendant la période de latence précédant la puberté. L'idée que des parents de naissance ne sont pas nécessairement de bons éducateurs devrait aussi mener le législateur à promouvoir une éducation à la parentalité pour tous durant les études secondaires. Le droit des enfants à connaître leurs origines personnelles n'a en effet pas pour objet de nuire à qui que ce soit, ni aux parents de naissance, ni aux parents adoptifs. Mme Sophie Marinopoulos : Mon parcours de psychanalyste est un peu particulier, puisque depuis 1986 je travaille au centre hospitalier universitaire de Nantes où consultent des parents qui se séparent de leurs enfants à la naissance, et, en centre médico-psychologique, je reçois des parents et leurs enfants dont 60 % sont des familles adoptives. Là, les parents se questionnent sur la construction de leur parentalité et les enfants interrogent leurs histoires d'abandon et d'adoption, qui créent leurs origines. En réponse aux observations de Mme Daubigny, je tiens à dire qu'il ne faut pas juger avec sévérité les mères qui abandonnent un enfant handicapé, car les histoires personnelles appellent la plus grande humilité ; nous ne savons absolument pas de quoi notre propre histoire sera faite demain. J'ai fait un tour du monde pour explorer les différentes pratiques de renoncement à l'enfant à travers les cinq continents. Je vais vous rendre compte de deux situations, que j'ai vécues dans deux pays où l'accouchement sous X n'existe pas. La première se passe en Nouvelle-Zélande, avec deux jeunes filles, leur mère adoptive et leur mère de naissance. La première témoigne de son bien-être tandis que la seconde déclare ne pas aller bien et ne pas comprendre son histoire ; cette confrontation serait impossible en France. La deuxième situation se passe en Suisse, où j'ai suivi un groupe de personnes adoptées devenues adultes et souhaitant réfléchir à la question des origines. Une personne militante précise son engagement, pose d'emblée les bases de ce qui le fonde, accusant l'accouchement sous X de la priver de l'accès à l'identité de sa mère de naissance. Puis une jeune femme raconte qu'elle est allée récupérer son dossier et qu'il était presque vide : « un nom et c'est tout ». Ainsi, pour certains, avoir un nom, c'est tout avoir, tandis que, pour d'autres, c'est ne rien avoir. Où se situe la vérité des origines ? C'est vraiment le travail des psychanalystes que d'accompagner ces histoires toujours singulières. Est-il possible de légiférer sur ces cheminements individuels ? Je tire de ces deux expériences un premier enseignement : il convient de se montrer extrêmement prudent sur la biologisation des origines, ces dernières ne se réduisant pas à la biologie. Les personnes concernées le savent bien elles-mêmes puisque, sur les 400 000 personnes annoncées, le CNAOP n'a enregistré que 2 200 demandes. Deuxième enseignement : il ne faudrait pas que la législation crée des impostures en faisant croire que la filiation se résume à l'identité biologique, ce qui risquerait de conduire à des scénarios de science-fiction, l'admission à la maternité ne se faisant plus avec la carte de sécurité sociale mais avec le code ADN. Je rappelle que les personnes adoptées adultes sont à la source du questionnement sur les origines. Troisième enseignement : au-delà de l'identité biologique, il faut prendre en compte la construction psychique. Se construire parent ou enfant de quelqu'un se fait dans le temps, dans le partage, avec de bons et de mauvais moments, parfois des naufrages et des douleurs. Il existe des filiations à risque ; la filiation adoptive en fait partie. Les parents adoptifs doivent intérioriser l'enfant comme s'il était le leur, et celui-ci doit faire la même chose vis-à-vis d'eux. Quatrième enseignement : quand ce processus psychique de parentalité ou de filiation n'est pas à l'œuvre, avec ou sans biologie, la construction est impossible et l'enfant ne peut s'« originer » dans le désir parental. Quand des parents biologiques rencontrent des problèmes avec leur enfant, ils consultent ; les parents adoptifs, eux, se plaignent devant l'État, celui-là même qui les a fécondés par son accord d'agrément. De même, les personnes adoptées demandent à l'État d'être porteur de la responsabilité de leur échec en accusant la « fécondation législative », c'est-à-dire l'adoption plénière. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2002, les changements constatés dans les maternités sont énormes, que ce soit pour la mère, le père ou l'enfant. Quand une femme arrive pour accoucher, on lui ouvre un dossier médical à partir de sa carte de sécurité sociale. Ce dossier est personnel et soumis au secret médical. Si la mère renonce à garder son enfant, elle peut laisser son identité ou non. Dans cette seconde hypothèse, elle se fait inscrire sous un prénom - c'est ce qu'on appelle le « prénonymat » -. Quant aux pères accompagnants, on ne leur ouvre pas de dossier médical, mais ils sont accueillis et informés de leur droit propre de reconnaître l'enfant, même si la mère ne le veut pas. Encore faut-il qu'il soit présent ; la victimisation de la paternité, de ce point de vue, a des effets extrêmement néfastes. Si sa mère et son père décident d'abandonner le bébé, trois prénoms lui sont donnés, prioritairement par sa mère et son père de naissance, et le troisième devient son patronyme. Dans les trois jours qui suivent l'accouchement, un procès-verbal de remise de l'enfant en vue d'adoption est rédigé ; ce procès-verbal devient le dossier de l'enfant. La mère de naissance peut laisser tous les éléments qu'elle souhaite dans son dossier, y compris son identité. Ce qui a changé, depuis 2002, c'est le système du nom glissé dans une enveloppe. Sur le plan de la construction psychique, cette nouvelle pratique ne constitue pas un progrès et devrait être remise en cause. Les mères sont très mal informées de leurs droits. Si les femmes sont accueillies humainement, dans le respect de leur dignité, et reconnues dans leur souffrance, elles transmettent leur histoire de vie, notamment leur identité. Mais certaines demandes d'informations administratives, formulées à un moment qui se caractérise par des douleurs abdominales extrêmes, dénotent une méconnaissance de la mise au monde d'un enfant. Pardonnez ma colère mais pour nous, soignantes, cela constitue une atteinte à la dignité de femmes et un recul par rapport aux pratiques antérieures. Par ailleurs, dans les maternités, les mères renonçant à leurs enfants subissent des pressions de toutes sortes. Les tentatives d'influence sont fréquentes, cherchant à inciter la mère à garder l'enfant ou au contraire à l'abandonner. Les influences interviennent aussi au niveau de l'enregistrement administratif, pour ou contre l'anonymat. Si les femmes n'ont pas été accompagnées en amont, elles méconnaissent leurs droits. Or les mères, mais aussi les pères, sont les grands oubliés. Nous devons prendre cette question à bras-le-corps, tous ensemble, et changer notre regard collectif sur la parentalité en général : être parent ne va pas de soi ; c'est une grande aventure, un sacré défi. Tout le monde, à un moment ou un autre, vit des moments difficiles ; là, ils sont dramatiques. L'effet néfaste de la loi de 2002 a été immédiat : le repli du suivi est catastrophique. La consultation de Nantes est une consultation hospitalière, avec du personnel soignant. Nous suivions avant la loi de 2002 les femmes pendant la grossesse, dans la plupart des cas. Aujourd'hui, les suivis sont très rares, les femmes accouchent et quittent la maternité quelques heures plus tard. Seuls les services ayant des pratiques de suivi peuvent témoigner de ce changement. Croyez-moi, il n'est simple pour personne d'accueillir une femme, un homme ou une famille qui souhaite se séparer d'un enfant à la naissance. Nous commençons par dire aux femmes que nous allons nous occuper d'elles car, depuis 2002, elles ont peur que nous ne cherchions à les faire changer d'avis. Je vous demande vraiment à tous, militants inclus, d'y réfléchir. Ces parents sont des parents comme les autres ; l'enfant qui naît de leurs histoires et va être adopté est un enfant comme les autres, qui doit être respecté. L'accouchement sous X n'a jamais empêché la mère à dévoiler son identité : c'est un choix parental. Mais les sujets seront-ils encore libres, vivrons-nous toujours en démocratie si nous obligeons un être humain à dire quelque chose ? Piera Castoriadis-Aulagnier a écrit : « Si le droit de tout dire est la forme même de la liberté humaine, l'ordre de tout dire impliquerait pour le sujet auquel on l'imposerait un état d'esclavage absolu, le transformerait en un robot parlant. Se préserver le droit et la possibilité de créer des pensées et plus simplement de penser, exige que l'on s'arroge celui de choisir les pensées que l'on communique et celles que l'on garde secrètes : c'est là une condition vitale pour le fonctionnement du je ». Quel sens donner à votre question sur le maintien du secret après le décès de la mère ? L'État envisage-t-il définitivement de s'arroger le droit de s'infiltrer dans l'intimité de l'histoire de la personne au-delà de sa vie ? Si oui, quelles seront nos limites ? Cette question ne peut en aucun cas faire l'économie du fantasme de rendre la mort vivante, afin de superposer et de confondre ces deux états. La mort n'arrêterait plus la vie. D'ailleurs les demandes de fécondation post mortem trouvent là tous leurs échos. Mort ou vivant, ce serait du pareil au même : on pourrait procréer, rechercher, déterrer, inventer des origines, de la maternité, de la paternité ; les cellules, mortes ou vivantes, devraient parler ! Laissez l'enfant vivre sa minorité et aller à la recherche de lui-même dans une quête personnelle et introspective, laissez-le grandir, laissez-lui l'âge de l'enfance et des questions de l'enfance ! Plus tard, peut-être cherchera-t-il. Les droits de l'enfant et son intérêt sont en train de tuer l'enfance et ses processus psychiques, car les adultes ne cessent d'interférer dans ses pensées. La polémique sur la question des origines est une création des personnes adoptées adultes, en colère, sans doute légitimement, mais il ne s'agit pas de paroles d'enfants. La question de la reconnaissance anténatale est difficile. Je constate que le père ne s'autorise pas à devenir père tant que la mère ne l'a pas nommé. En tout cas, il est crucial de renforcer l'information en direction des pères. De même, pour la procréation médicalement assistée, donner un gamète ne suffit pas à ériger une construction filiative : il faut être capable de se comporter comme si cette cellule venait de soi, sans quoi l'enfant ne pourra pas s'« originer » dans l'histoire de la famille. Ce qui devrait retenir notre attention, ce n'est pas l'anonymat du donneur de gamète mais les aptitudes psychiques du receveur à faire sienne cette cellule. Instaurer un double gate pour donner le choix entre un don anonyme et un don personnalisé serait un simple aménagement destiné à éviter la question des origines. Je vous demande donc de réviser la loi de 2002, car sa rédaction hâtive n'a pas permis de prévenir les dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui, en donnant une place excessive à la biologie dans la construction filiative. Ces dérives nous conduisent à maltraiter certaines femmes qui mettent au monde. Respectons-les dans ce qu'elles sont. Les origines sont devenues un tel objet de contestation ou d'enquêtes que les protagonistes mêmes de ces questions, c'est-à-dire les mères, les pères et les enfants, sont oubliés. Je préconise enfin la création, dans chaque département, d'un service de prévention spécifique pour organiser l'accueil des femmes vulnérables et prendre ainsi soin de l'enfant à naître. Cette prise en charge médico-psychosociale est une affaire de santé publique : il convient de soigner les mères et donc les nouveaux-nés sans exception. Ces services pourraient être intégrés à une maternité ou être constitués d'une équipe ambulatoire spécialisée. Mme Patricia Adam : Je n'ai pas compris les explications de Mme Marinopoulos concernant la constitution du dossier des femmes accouchant sous X. Mme Sophie Marinopoulos : Un agent du CNAOP vient à la maternité rencontrer la mère, et éventuellement le père, pour enregistrer leur renonciation à l'enfant. Dans ce procès-verbal, conservé par l'aide sociale à l'enfance, ils peuvent laisser des éléments d'information sur leur histoire et, s'ils le souhaitent, leur identité. Aucun recoupement n'est effectué avec le dossier médical d'accueil à la maternité : une mère peut donc être anonyme au regard de l'accueil à la maternité, mais confier ensuite son identité dans le procès-verbal de renonciation. Les praticiens spécialistes le savent bien, il est pour le moins difficile de traiter de problèmes administratifs au moment de l'accouchement. Je suis choquée par le manque d'humanité et la prééminence de la dimension administrative. Ce sont tout de même des histoires d'hommes, de femmes et d'enfants ! Nous devons humaniser, soigner, prendre soin de toutes les mères ! Mme Marie-Christine Le Boursicot : Les 250 correspondants départementaux du CNAOP accomplissent un travail considérable. Il s'agit de personnels de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection maternelle et infantile, travailleurs sociaux désignés par président du conseil général pour appliquer la loi du 22 janvier 2002. Dans le département du Nord, par exemple, les correspondants et les personnels des maternités se réunissent tous les deux mois environ pour mieux accompagner, ensemble, ces mères de naissance. La responsabilité de cet accompagnement incombe désormais aux départements, mais je ne peux laisser dire que les correspondants accomplissent leur mission dans un esprit administratif et sans humanité. Ce n'est pas vrai ! Par ailleurs, j'affirme que les textes sont clairs et ont levé toute ambiguïté. Le cas de cette femme irlandaise cité par Mme Monéger est antérieur à 2002. Le texte destiné à informer les mères de naissance et le modèle d'attestation à établir par le correspondant du CNAOP, fixé par arrêté ministériel du 14 février 2005, sont peut-être perfectibles, mais ils existent et ils sont mis en œuvre par les correspondants départementaux, qu'il serait intéressant d'entendre également. M. Pierre-Louis Fagniez : L'enjeu consiste à concilier les droits des femmes et ceux des enfants. Dans la loi sur la bioéthique, s'agissant du don d'organe, il n'est pas question de secret mais d'anonymat. Mme Laurant préconise que les femmes aient le droit de cacher leur identité. Mais comment pourraient-elles être sûres de ne jamais être saisies par le remords ? Il ne s'agit pas de culpabiliser les femmes, mais elles peuvent en effet être amenées à vouloir revenir sur leur décision. Quoi qu'il en soit, comment garantir juridiquement la conciliation entre les droits de la mère et ceux des enfants ? Mme Hélène Mignon : Les enfants qui recherchent leurs origines parlent de la mère mais jamais du père. J'imagine que les pères, dans les cas d'abandon, ne se manifestent guère. Mme la Rapporteure : Mme Laurant a évoqué les femmes qui, craignant une modification des règles du jeu législatives, partent à l'étranger pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG). Les délais de recours à une IVG ne sont-ils pas semblables dans la plupart des pays européens ? Mme Françoise Laurant : Dans certains pays, les établissements privés pratiquent des IVG à des stades avancés de la grossesse ; d'ailleurs de nombreuses françaises ayant dépassé les délais légaux dans notre pays utilisent ces possibilités. Le droit attaché à l'accouchement sous X est essentiel pour que la parole se libère. C'est un peu comme l'IVG : lorsque les mineures viennent nous voir, nous leur confirmons qu'elles ont le droit de ne pas prévenir leurs parents, mais les trois quarts d'entre elles, lorsqu'elles reviennent une semaine plus tard, leur en ont finalement parlé. L'existence d'un droit n'incite pas forcément à en faire usage ; il libère la parole, contrairement à la culpabilisation. C'est parce qu'elles auront la garantie que leur droit au secret sera respecté que les femmes parleront. Effectivement, en France, les femmes qui changent d'avis et souhaitent lever le secret ne le peuvent pas, à moins que l'enfant n'entame une démarche, ce qui crée une sorte d'inégalité. Il convient de réfléchir à cette question. Mme Marie-Christine Le Boursicot : Les femmes, trente, quarante ou cinquante ans après, ne sont évidemment plus dans le même état d'esprit que le jour de l'accouchement. Je constate que nous leur apportons une forme d'apaisement et que certaines d'entre elles nous contactent régulièrement : même si elles refusent de rencontrer l'enfant qui a saisi le CNAOP, même si elles ne le considèrent pas comme leur enfant, elles nous demandent comment il va, s'il a été bien adopté. C'est une façon, pour elle, de justifier leur choix du passé. Je ne donnerai qu'un exemple : une mère de naissance a refusé de voir son fils de trente ans, mais lui a adressé une lettre de neuf pages et des photos, qu'il a prises comme un cadeau extraordinaire. Tout cela doit être mis au crédit du CNAOP ; entendez-le avant d'envisager de modifier la législation. Le Conseil national réfléchit aux points sur lesquels l'expérience nous incite à évoluer, mais j'estime, pour ma part, que la loi actuelle est claire et qu'elle va dans le bon sens. Mme Françoise Monéger : Il existe en effet un conflit de droit entre l'enfant, la mère et aussi le père. Il arrive, dans les cas extrêmes dont sont saisis les tribunaux, que la mère ayant accouché dans le secret, qui n'est plus la mère puisqu'elle y a renoncé, considère que son consentement a été vicié et souhaite revenir sur sa décision. Or l'article L. 224-1 du code l'action sociale et des familles ne précise pas clairement qu'elle ne dispose que de deux mois. Mme Jacqueline Rubellin-Devichi : Dans l'affaire à laquelle vous faites référence, le père avait téléphoné à la mère lorsqu'elle était à l'hôpital ! Il ne faut pas prendre les personnels de l'aide sociale à l'enfance pour des imbéciles ! Mme Françoise Monéger : Lorsque la femme décide du secret, le père qui voudrait assumer et reconnaître l'enfant ne sait pas à quoi raccrocher sa paternité, car il n'y a plus de mère. L'article 62-1 du code civil appelle une amélioration. Mais je répète que les cas soumis au juge sont toujours exceptionnels. Mme Sophie Marinopoulos : Les mères peuvent à tout moment adjoindre des informations au dossier. C'est intéressant compte tenu des processus psychiques qui peuvent les amener à évoluer vis-à-vis de leur histoire. Au lieu d'attendre trente, quarante ou cinquante ans, il faudrait organiser le recueil de la parole à la naissance et même avant la naissance. Mme Corinne Daubigny : Pourquoi les mères ne sont-elles pas autorisées à savoir ce que sont devenus leurs enfants ? En principe, le secret de l'adoption n'existe plus, mais, avec la formule française de l'adoption plénière, certains des parents adoptifs se croient encore dans l'obligation morale de tenir cette réalité secrète. La banalisation des origines inconnues amène aussi certains parents à faire comme s'ils ignoraient l'identité des parents d'origine, même quand un travail de prévention s'impose, nombre d'enfants souffrant de la pathologie des secrets de famille. Revenir sur le caractère substitutif de l'adoption plénière rendrait plus clair, pour les parents adoptifs, le fait que les enfants ont une histoire avant l'adoption et qu'il ne faut pas la garder secrète. Il ne s'agit pas de réduire les origines aux origines biologiques mais de prendre en compte l'histoire première de l'enfant, le chapitre premier de son histoire. Pourquoi les parents de naissance n'ont-ils pas pu élever l'enfant ? Voilà ce que les enfants ont besoin de savoir. Il serait ainsi possible aux parents de naissance d'avoir connaissance du devenir de leur enfant et de le rencontrer adulte, sans que cela contrevienne à son développement puisqu'il aurait toujours été au courant de son adoption. Enfin, les mentalités avanceraient si les parents de naissance étaient dotés d'un statut juridique, avec des devoirs et des droits : d'un côté, l'interdiction de s'immiscer dans la vie de leur enfant durant son éducation, mais, de l'autre, le droit au secret, avec une possibilité de réversibilité. M. le Président : Je vous remercie pour ce dialogue animé, qui a grandement éclairci nos idées sur le sujet. Table ronde, ouverte à la presse, sur l'exercice de l'autorité parentale dans les familles désunies, réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Je souhaite la bienvenue aux intervenants que nous accueillons pour cette table ronde consacrée à l'exercice de l'autorité parentale dans les familles désunies. La réforme votée en mars 2002 a posé le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale et prévu des dispositions en cas de séparation des parents, comme la résidence alternée ou le recours à la médiation familiale. Notre mission s'interroge sur l'application de ces dispositions. Faut-il faire évoluer notre législation pour améliorer l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ? Pour répondre à cette question, nous avons réuni : - M. Hugues Fulchiron, doyen de la faculté de droit de l'université de Lyon-III, qui dirige le Centre du droit de la famille et qui a été membre, en 1999, du groupe de travail du ministère de la justice qui fut à l'origine des importantes réformes intervenues au cours des cinq dernières années ; - M. Alain Cazenave, président de SOS Papa, et qui représente donc les 13 000 membres de cette association ; - Mme Jacqueline Phelip, présidente de L'enfant d'abord, association qui a pour objet de diffuser l'information et les réflexions sur l'intérêt de l'enfant tout en aidant les parents dont les enfants vivent difficilement la séparation parentale ; - Mme Isabelle Juès, médiatrice familiale et vice-présidente de l'Association pour la médiation familiale, chargée de promouvoir la médiation en matière familiale, notamment auprès des pouvoirs publics ; - Mme Chantal Lebatard, administratrice de l'Union nationale des associations familiales et membre du Conseil économique et social, qui a également présidé la Fédération d'entraide des parents de naissances multiples ; - Mme Hana Rottman, pédopsychiatre, qui a participé en 1999 au groupe de travail sur les enjeux de parentalité dirigé par M. Didier Houzel et qui a fondé l'association Enter - L'arbre vert, lieu d'accueil préventif traitant des problèmes de séparation entre les parents et les jeunes enfants ; - Mme Brigitte Azogui-Chokron, vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris, chargée des affaires familiales, qui nous donnera le point de vue des magistrats. M. Hugues Fulchiron : Faut-il faire évoluer le droit de l'autorité parentale ? La loi du 4 mars 2002 est l'aboutissement d'une longue évolution, ponctuée d'interventions multiples du législateur. En consacrant la garde alternée, le législateur entendait traduire dans les pratiques judiciaires un principe qui lui paraissait essentiel : la coparentalité. Pour tenter de déterminer s'il est préférable de s'en tenir au statu quo ou s'il faut faire évoluer le texte, il faut pour commencer dresser un bilan de l'application de la loi, ce qui est assez difficile sur le plan statistique. À l'évidence, l'alternance ou le partage de l'hébergement ne sont pas devenus le modèle dominant, mais supposent, à chaque fois, le respect de l'intérêt de l'enfant, et imposent par conséquent des contraintes aux parents. L'étude de l'application jurisprudentielle montre que le dispositif ne suscite pas un contentieux important, dans la mesure où les magistrats semblent user de la résidence alternée avec une extrême prudence, en vérifiant particulièrement trois points. Ils souhaitent tout d'abord l'existence d'un projet parental commun et d'un dialogue minimal entre les parents, ce qui ne signifie pas qu'il y ait accord entre eux, la résidence alternée pouvant être imposée à titre expérimental. Ils examinent ensuite les conditions matérielles dans lesquelles le partage de l'hébergement peut être organisé, et notamment la proximité des domiciles et de l'école. À ce sujet, tout dépend du rythme de l'alternance, selon qu'elle a lieu chaque semaine ou, ce qui est plus rare, un an sur deux ; mais, quelle que soit la périodicité retenue, l'idée qui sous-tend le projet est toujours celle de l'exercice de la coparentalité. Les juges tiennent enfin compte, élément décisif, de la personne de l'enfant, de son âge, de son état psychique et de sa parole, et refusent la résidence alternée s'ils considèrent que l'enfant est déjà perturbé par la violence du conflit qui a parfois accompagné la séparation parentale. C'est à propos de l'âge de l'enfant que la jurisprudence paraît surtout partagée. La loi ne disant rien à ce sujet, la question est ouverte. Mais qu'il y ait peu de jurisprudence sur ce point peut laisser penser qu'en pratique l'alternance est rarement envisagée pour les enfants en bas âge. Quelques décisions refusent l'alternance au nom de la stabilité de l'enfant, mais d'autres sont inverses. Faut-il faire évoluer le droit de l'autorité parentale ? Je serais tenté de répondre : « Non et oui ». S'agissant de la résidence alternée, je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de retoucher la loi. Il me semble préférable de laisser le juge faire usage de son pouvoir d'appréciation souverain, dont il use d'ailleurs de manière modérée. En particulier, l'interdiction de principe de l'alternance pour les enfants en bas âge présenterait deux inconvénients. Le premier serait d'introduire une grande rigidité alors que l'intérêt de l'enfant s'apprécie au cas par cas. Et si l'on pose une interdiction de principe, quel seuil fixer ? On s'engagerait dans des débats d'une grande complexité. Par ailleurs, une telle interdiction remettrait en cause le principe essentiel de la coparentalité, et augmenterait l'instabilité législative en donnant l'impression que le législateur intervient au coup par coup, au gré des opinions changeantes des spécialistes de l'enfance. Mieux vaudrait éviter tout dogmatisme et laisser les magistrats procéder avec tact et mesure. En revanche, une réforme touchant à l'autorité parentale est nécessaire, afin de donner un statut au beau-parent. En 2002, le législateur, avant tout soucieux d'affirmer la place des deux parents après la séparation, a en quelque sorte sacrifié le beau-parent sur l'autel de la coparentalité. Le temps est venu de lui reconnaître toute sa place. Mme Jacqueline Phelip : Notre association a pour singularité de représenter les enfants. Cette position charnière entre décisions judiciaires d'un côté et enfants de l'autre permet de donner un autre éclairage que celui des seuls magistrats ou des seuls pédopsychiatres. De toutes les régions, des mères nous appellent pour nous dire les symptômes de leurs enfants. Ils peuvent varier en nombre ou en ampleur d'un enfant à l'autre, d'un âge à l'autre, mais sont toujours identiques. Nous voyons par exemple des bébés de moins d'un an qui sont soumis par le pouvoir judiciaire à des résidences alternées paritaires ou à des droits de visite élargis très complexes. Tous ces enfants présentent des symptômes de mal-être qui peuvent varier en nombre et en ampleur, mais qui sont identiques. Pour les jeunes enfants, le nombre de nuits passées à l'extérieur du foyer maternel est déterminant ; parfois, il suffit de le réduire d'une seule nuit pour que l'enfant aille mieux. La grande difficulté est de faire la preuve de ces symptômes, qui se manifestent au foyer maternel parce que ce sont encore les mères qui, massivement, s'occupent des enfants et représentent pour eux la référence affective, ce qui ne signifie aucunement que leur père ne les aime pas ou qu'il les maltraite. On a, de ce fait, les plus grandes difficultés à faire comprendre la souffrance des enfants. Les magistrats eux-mêmes sont mis en difficulté par la loi du 4 mars 2002, car ils n'ont reçu aucune formation spécifique, ne sont pas pédopsychiatres et ne disposent d'aucun outil fiable pour faire la lumière sur chaque cas. Or, dans la moitié des cas de séparation, les jeunes femmes ont quitté le domicile conjugal en raison de violences parfois physiques mais plus souvent encore psychologiques. Il arrive aussi qu'elles partent car elles n'en peuvent plus d'être dominées, mais le fait de partir les pénalise. On vient ainsi de nous rapporter le cas d'un bébé de huit mois dont la mère n'a la garde que huit jours par mois pour s'être éloignée d'un homme très dominant qu'elle voulait fuir, et nous avons eu connaissance récemment du cas de deux enfants de moins d'un an confiés chacun quinze jours à leur père et quinze jours à leur mère. Ces situations sont plus fréquentes qu'on ne le pense, et ni les mères, ni les médecins n'ont les moyens d'intervenir, car les pères portent plainte contre eux. On sait que la loi du 4 mars 2002 a donné au juge la possibilité de prononcer la résidence alternée à l'essai, et il arrive en effet que des magistrats imposent un essai d'un semestre. Imagine-t-on ce qu'une telle durée représente pour un bébé de six mois par exemple ? Il n'est pas étonnant que, au terme de cette période d'essai, la mère comme le père constatent que le bébé ne va pas bien et saisissent le juge qui, ne sachant que faire, ordonne une enquête sociale qui ne donne aucun résultat, puis une expertise psychologique qui n'en donne pas davantage. Après quoi, une année ou dix-huit mois s'étant écoulés, le juge entérine la solution initiale. Dans ces conditions, soit l'on maintient le système actuel, triomphe de l'arbitraire puisque le sort des enfants diffère en fonction du lieu du domicile de leurs parents et du juge des affaires familiales dont ils dépendent ; soit on remplace les juges aux affaires familiales par des voyantes extralucides, ce qui semble improbable ; soit on institue des garde-fous. Notre association ne demande pas le retrait d'un texte qu'il n'y a aucune raison de supprimer, mais considère que, lorsqu'un conflit existe entre les parents, des garde-fous sont nécessaires. Cela ne signifie pas qu'il faut revenir au système antérieur - un week-end sur deux et la moitié des vacances avec le parent qui n'a pas la garde de l'enfant -, car, en imposant une séparation avec leur mère, ce type de garde pose le même problème pour les bébés que la résidence alternée, alors que dans le même temps ils retrouvent tous les quinze jours un étranger en retrouvant leur père. Mais il importe de remplacer les résidences alternées ou les droits de visite élargis au-delà du vraisemblable par une périodicité plus raisonnable. La médiation familiale devrait être développée, à condition qu'elle ne coûte pas trop cher. Cependant, elle ne peut avoir lieu s'il y a eu des violences conjugales ou si s'est instauré dans le couple un rapport dominant-dominée. D'ailleurs, dans ce cas, les jeunes femmes la refusent car elles ont peur. D'autre part, les médiateurs doivent être convenablement formés, neutres et sans a priori. L'exemple me vient en effet à l'esprit d'un médiateur, avocat de son état, qui poussait la mère à accepter la résidence alternée pour son bébé de sept mois ; c'est inacceptable. Quant aux pensions alimentaires, c'est un réel problème, qui vire à l'obsession chez les jeunes pères. Les dossiers qui nous parviennent laissent parfois rêveur, car ces pensions sont souvent peu élevées, au point que l'on en vient à se demander si les pères savent véritablement ce que coûte le fait d'élever un enfant. Mais l'on peut comprendre que, si un père se trouve au chômage ou que ses revenus baissent alors qu'il doit continuer de verser une pension alimentaire qui grève son budget, cela puisse poser problème. Il est important qu'un enfant puisse rencontrer régulièrement son père, mais, quand les parents vivent éloignés l'un de l'autre, les pères n'ont pas les moyens financiers suffisants pour accueillir leurs enfants, les frais de transport s'ajoutant au versement de la pension alimentaire. C'est regrettable pour eux, et surtout pour les enfants. Aussi conviendrait-il de fixer un mode de calcul de la pension alimentaire, ce qui éviterait le sentiment d'être livré à l'arbitraire des diverses juridictions. Si la pension était calculée en fonction d'un barème, la question du partage des temps de garde pourrait être résolue plus facilement, au plus grand profit des enfants. Quant à l'aide à la parentalité, elle est très importante, mais le moment de la séparation n'est sans doute pas le meilleur pour l'exercer. Étant donné l'explosion du nombre de séparations de couples qui ont des enfants très jeunes, la généralisation de la médiation est indispensable. Mme Isabelle Juès : L'Association pour la médiation familiale se félicite de l'intérêt que votre Mission porte à la médiation familiale et de votre souci d'adapter la législation à l'évolution des mœurs, dans le respect du bien commun et de la liberté individuelle. Elle représente à la fois les médiateurs familiaux, d'autres professionnels concernés et des personnalités attachées à la promotion de ce mode de régulation des conflits familiaux. Médiatrice familiale moi-même, je puis vous faire part des réflexions qui sont menées dans cette instance et des constatations qui nous sont rapportées par nos adhérents. Au cœur des conflits familiaux, les médiateurs sont engagés dans un travail de prévention qui relève d'une vraie mission de service public puisque, particulièrement lorsqu'il s'agit de ruptures conjugales, le médiateur est au premier rang pour évaluer avec ses clients les causes, les objets et les effets de la crise familiale. Vous vous interrogez sur l'application de la résidence alternée, possibilité introduite dans le code civil en mars 2002. Trois points nous semblent essentiels : l'alternance est un principe de réalité pour l'enfant dans les familles désunies ; son rythme doit être adapté aux besoins des enfants et de leurs parents ; il conviendrait, en s'appuyant sur la compétence des parents, de donner la prééminence à l'accord construit sur la décision imposée. Vous nous demandez aussi comment favoriser le développement de la médiation familiale : j'indiquerai en quoi elle est un acte de prévention et comment faciliter son accès. Sur la question des pensions alimentaires, je dirai pourquoi, de préférence à l'instauration de normes, nous préconisons un travail sur mesure. Pour finir, je développerai l'idée de responsabilité parentale et je reviendrai sur la nécessaire simplification administrative que suppose le principe d'autorité parentale conjointe. Notre action est, en premier lieu, fondée sur le principe d'altérité qui est à la base même du lien social. Pour les médiateurs familiaux, l'objectif à atteindre est avant tout de faire prendre conscience aux parents qui se séparent qu'ils ont à compter avec l'autre parent, qui lui aussi a des droits et des devoirs. Nous avons aussi la certitude que, en matière d'accueil de l'enfant chez ses parents, aucune solution n'est idéale, la résidence alternée pas plus qu'une autre ; c'est avant tout la séparation des couples qui pose problème. En troisième lieu, nous insistons sur le droit des enfants à conserver des liens avec chacun de ses parents ; mettre à l'écart un des parents, c'est mettre à l'écart l'enfant dans son identité même. Le premier devoir de chaque parent est de préserver l'accès à l'autre parent. Nous soulignons enfin la compétence des parents, lorsqu'ils se sont dégagés de leur conflit de couple ; nul, en effet, n'est mieux placé que les parents pour savoir ce qui convient à un enfant. C'est d'ailleurs le sens de la formule « sauf meilleur accord des parents » portée au bas des décisions de justice. Les débats qui entourent aujourd'hui la notion de résidence alternée en font un nouvel objet de conflit, mais les médiateurs savent bien, pour travailler chaque jour avec les familles, que les enjeux sont ailleurs et que c'est par le dialogue que passe d'abord la résolution de ces conflits. C'est bien le conflit dans son escalade qui met l'enfant en danger. Que penser, alors, de la faculté offerte au juge d'imposer la résidence alternée à l'essai ? L'imposer risque d'exacerber le conflit, mais peut aussi obliger à la réflexion ; dans ce cas, il est essentiel de ne pas laisser les parents face à leur conflit. Quelle autre signification ont les mesures provisoires décidées par un magistrat, lorsque les parents ne sont pas d'accord, sinon celle d'imposer un mode d'accueil à l'essai ? La résidence alternée, au sens où elle est couramment - et mal - comprise, c'est-à-dire une alternance égalitaire, n'est qu'une manière parmi d'autres d'organiser le temps de l'enfant. Il convient donc, d'abord, d'encourager le recours à la médiation familiale chaque fois que des mesures provisoires sont imposées, pour permettre aux familles de clarifier les enjeux sans escalade judiciaire. Mais il faut aussi modifier des pratiques judiciaires, afin de faire en sorte que les mesures provisoires ne deviennent pas des mesures définitives. L'alternance est inhérente à la séparation : dès lors que ses parents se séparent, l'enfant est amené à partager son temps entre ses deux maisons. Se pose alors pour lui, comme pour ses parents, la question du rythme et des conditions de l'alternance, qui appelle des réponses à l'infini, chacune adaptée à une réalité singulière mais toutes rendues acceptables et applicables par l'accord des parents. Voilà pourquoi nous proposons que soit explicitement inscrit dans la loi le principe de la double résidence de l'enfant dès lors que ses parents sont séparés, et celui de l'alternance. Cependant les magistrats doivent préciser que le temps passé par l'enfant chez chacun de ses parents n'est pas obligatoirement égalitaire, mais déterminé au cas par cas. Toute latitude doit être laissée aux parents dans l'élaboration du rythme et des conditions de l'alternance, quel que soit l'âge de l'enfant. Enfin, le recours à la médiation familiale doit être favorisé pour construire du « sur mesure » plutôt que du « prêt-à-porter », en tenant compte des besoins de chacun, à commencer par ceux des enfants. Le développement de la résidence alternée n'est pas tant freiné par la question du partage des allocations familiales que par l'inégalité d'accès aux allocations logement et aux bons-vacances, qui influe sur l'aménagement de l'alternance pour l'enfant. Gardons-nous de tout dogmatisme, laissons aux familles leur créativité et ne nous empêchons pas d'inventer avec elles de nouvelles manières de construire le lien. Quant à la médiation familiale, elle s'exerce principalement en dehors du champ judiciaire, la médiation sur injonction ou sur ordonnance ne représentant pas plus de 15 % de notre activité. D'ailleurs, la médiation familiale a d'autant plus de chances de succès qu'elle intervient plus tôt dans la naissance du conflit et avant sa cristallisation judiciaire. L'injonction d'aller s'informer sur la médiation, prévue dans la loi de 2002, n'a de sens que si elle est suivie d'effets ; or, actuellement, les personnes se rendent en général séparément aux consultations, et rien n'est prévu lorsqu'elles ne se soumettent pas à l'obligation qui leur est faite. Comment, alors, continuer de favoriser le recours à la médiation familiale ? Il faut rendre obligatoire un entretien d'information sur la médiation familiale au début de chaque procédure concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Cet entretien devrait se faire en couple, afin que les personnes puissent amorcer la reprise d'un dialogue sur la perspective de la médiation familiale. Si l'entretien devient obligatoire, il serait logique qu'il soit gratuit pour les participants, ce qui rend nécessaire une prise en charge institutionnelle. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, il faudrait orienter systématiquement les époux vers une médiation familiale lorsqu'il y a refus d'homologation de la convention, et garantir la gratuité de l'entretien d'information et du premier entretien de médiation lorsqu'ils sont imposés par un magistrat. Sans proposer la gratuité des autres séances de médiation - le paiement, aussi minime soit-il, participe de l'engagement des personnes dans le processus -, nous insistons sur le fait que le coût des entretiens ne doit pas être un obstacle à l'accès à la médiation familiale pour les familles les moins aisées. L'aide juridictionnelle peut prendre en charge les frais de médiation, mais uniquement dans le cadre d'une procédure juridiciaire. Nous sommes favorables à l'instauration d'un mécanisme comparable à l'aide juridictionnelle, mais plus simple et plus rapide, et intervenant en amont de la procédure judiciaire. Nous souhaitons également que soit développée, auprès des professionnels de la justice, l'information sur la médiation familiale, et notamment que celle-ci soit intégrée dans les programmes de formation des magistrats, des avocats et des greffiers. Gardons à l'esprit que la médiation familiale est un espace de prévention, outil de pacification des relations qu'il convient de mettre à la disposition du plus grand nombre. S'agissant des pensions alimentaires, la médiation familiale s'appuie sur l'idée de responsabilité et d'engagement. Le travail fait avec les parents autour des questions de contribution financière est d'abord un travail de clarification de l'engagement affectif et éducatif. Lorsque les parents établissent ensemble le budget de leur enfant, ils raisonnent autour de cette interrogation : que voulons-nous dépenser pour notre enfant ? Mais il faut d'abord poser la question en ces termes : quels valeurs voulons-nous lui transmettre ? C'est ensuite un travail sur l'équité : comment allons-nous nous répartir les dépenses ? Sur la base de quels critères ? C'est enfin une prise de conscience des réalités financières de la famille et donc des choix qu'il faudra poser. Cette manière de faire s'accommode mal de la notion de barème, d'une sorte de norme qui s'imposerait à tous. L'idée de norme tue la créativité, elle déresponsabilise dans la mesure où elle écrase encore davantage les volontés. Les parents s'attendent souvent à ce qu'on leur en propose une. Ils sont en général surpris et heureux de découvrir que ce sont eux les maîtres en la matière. On remarque d'ailleurs que les pensions alimentaires calculées et décidées dans le cadre de la médiation familiale sont honorées dans 96 % des cas. En revanche, les moyens actuels mis en œuvre pour obtenir le recouvrement des pensions alimentaires sont loin d'être satisfaisants. Ils sont de nature à envenimer les conflits et ne permettent pas toujours le recouvrement des sommes dues. La médiation pénale est une voie de régulation efficace. Cependant, elle ne peut être proposée que dans le cadre d'une plainte pour abandon de famille. L'idée d'un fonds spécifique qui assurerait l'avance du paiement des pensions alimentaires nous semble pertinente. Pourquoi ne pas assortir le recours à ce fonds d'une proposition de médiation familiale ? En effet, le passage en médiation familiale diminue significativement le nombre des cas de non-paiement. Nous parlons plutôt de soutien que d'aide à la parentalité, et plutôt de responsabilité parentale que de parentalité. Certaines mesures pourraient aller dans le sens d'une coresponsabilité : favoriser, dans les décisions judiciaires, le parent qui est le plus à même de reconnaître l'autre parent ; rappeler le devoir de chaque parent de prendre en charge son enfant, à défaut de quoi il pourrait être sanctionné financièrement ; encourager toute initiative tendant à restaurer ou à établir un dialogue entre les parents. La reconnaissance de la coresponsabilité des parents vis-à-vis de leur enfant passe aussi par une reconnaissance administrative. Trop d'institutions n'ont pas encore mis en application les principes de la loi du 8 janvier 1993 sur l'autorité parentale conjointe. Les écoles inscrivent encore les enfants sans l'accord d'un des parents. Les bulletins ne sont pas systématiquement adressés aux deux parents. Il est toujours demandé, dans les écoles ou les centres de loisirs, le nom « du » responsable légal. Certains centres de sécurité sociale n'ont pas encore intégré non plus la possibilité, pour l'enfant, d'être ayant droit de chacun de ses parents. Nous souhaitons également que les aides au logement et les aides aux vacances soient systématiquement ouvertes aux deux parents. Trop de parents sont encore coupés de leurs enfants faute de place pour les loger décemment. L'accès aux logements sociaux est d'ailleurs rendu difficile aujourd'hui par les exigences des organismes qui les gèrent. Il faut, par exemple, présenter un jugement de divorce pour y prétendre. Une simple déclaration commune de décision de séparation devrait pouvoir suffire. L'autorité parentale se construit dans l'enfance. C'est dans la famille que se font les premiers apprentissages. Sait-on vraiment les violences que l'on fait subir à nos enfants en cas d'escalade des conflits familiaux ? Comment leur assurer sécurité et repères ? Au moment où montent les incivilités, où trop d'adolescents se trouvent sans repères, où des pères trop souvent absents laissent leur enfant dans un déséquilibre total, il est urgent de réaffirmer le droit de l'enfant à ses deux parents. La médiation familiale permet de mettre des mots sur ce qui, autrement, ne peut s'exprimer que par la violence. Les problématiques qu'elle aborde et dont nous discutons ce matin sont d'abord la conséquence d'un travail qui n'a pas été fait auparavant. Il serait peut-être important de s'intéresser, en amont de la crise parentale et conjugale, à l'avenir des futurs parents que seront nos enfants. Comment les préparer aujourd'hui à la rencontre, aux choix amoureux, à la vie conjugale et à la construction parentale ? Que penser de l'idée d'une préparation à la vie de couple ? Le chantier reste ouvert. Mme Chantal Lebatard : L'Union nationale des associations familiales (UNAF) est très attachée à la médiation familiale et elle a joué un rôle promoteur en ce domaine. Vous ne serez donc pas étonnés de certaines convergences de vue avec Mme Juès. Je ne reprendrai pas ses propos auxquels je m'associe et insisterai plutôt sur d'autres points. Je voudrais faire observer en préalable que nous ramons à contre-courant, dans une société de l'éphémère : en effet, nous essayons de nous préoccuper des liens familiaux et d'engagements qui s'inscrivent dans la durée, alors que la vie ne va pas sans changements. Lorsque l'on réfléchit sur les relations familiales, toute la difficulté consiste à prendre à la fois en compte la durée et le changement. S'agissant de l'autorité parentale, plutôt que de modifier la loi, il serait plus intéressant de la faire vivre et de s'assurer que tous les moyens correspondant à sa mise en application, dans l'esprit qui est le sien, sont bien accessibles. Or la diversité des observations de terrain et des décisions de justice prouve que le changement culturel qu'impliquait cette loi n'est pas effectif. Pour l'UNAF, le principe est clair : l'enfant a besoin de ses deux parents, il a le droit d'être élevé par eux deux, même s'ils ont choisi de se séparer. Il ne faudrait pas que la construction d'une résidence alternée conduise à l'idée d'une alternance affective. L'enfant a besoin, quelles que soient les modalités choisies par les adultes pour sa résidence, de vivre dans une relation continue avec ses deux parents. Il faut donc assurer aux parents séparés les moyens de construire une telle relation. Il faut éviter tout déséquilibre entre les engagements que les parents ont pu prendre à l'égard de leur enfant. Les deux parents ont certes des droits, mais ils ont aussi le devoir d'accompagner l'enfant dans son développement. Tels sont les principes qui doivent guider toute réforme ou tout aménagement du dispositif. On ne saurait accepter des modalités qui aboutiraient à une sorte de jugement de Salomon, sans prendre en compte les moyens nécessaires à la construction de la relation avec chacun des parents, ni les besoins affectifs de l'enfant. Lorsque des parents vivent ensemble, leurs différences créent une certaine complémentarité qui permet à l'enfant de se construire. Lorsque les parents se séparent, cet effet de cohérence n'opère plus. Les différences s'accentuent avec l'éloignement et les parcours de vie, surtout si les foyers se recomposent. Dans la séparation, la coéducation devient difficile. Le déséquilibre matériel des situations pose également des problèmes. Mais il faut accepter de l'inscrire dans l'accord, parce que l'enfant doit vivre avec de telles données. Il ne doit pas être amené à choisir celui de ses parents qui lui assurerait les meilleures conditions matérielles. Cela n'empêche pas de tout faire pour mettre au point un dispositif limitant ces distorsions et permettant à chacun des parents de pouvoir accueillir l'enfant. Il convient également de prendre en compte l'évolution de l'enfant. Nous ne nous attarderons pas sur le cas du très jeune enfant, sinon pour répéter que celui-ci a besoin de temps pour construire un lien avec chacun de ses parents. Nous nous intéresserons à la parole, aux demandes et aux besoins de l'enfant. L'enfant a d'abord besoin d'une certaine stabilité, ne serait-ce que pour construire avec ses pairs, avec l'école, avec son environnement, des relations essentielles à sa socialisation. Nous ne sommes pas choqués à l'idée que le juge puisse imposer une résidence alternée, naturellement entourée de toutes les garanties, dans la mesure où il peut être bon de créer un électrochoc pour que chacun des deux parents comprenne qu'il a des devoirs à l'égard de son enfant et ne peut s'en exonérer ou en être exonéré, sauf décision de justice. Il faudrait donner au juge les moyens d'accompagner ses décisions dont l'application dépend d'abord des parents, afin de tendre vers une vraie coparentalité. Il est bon de rechercher les accords entre les parents, d'éviter de brider les initiatives, de favoriser l'adaptabilité des solutions adoptées. Cela passe par un renforcement de la médiation familiale. Les prestations familiales sont des outils donnés aux familles pour compenser la charge effective des enfants. Les parents doivent pouvoir les intégrer dans leurs accords et en disposer avec toute la souplesse nécessaire. De nombreux accords intègrent cette répartition. Reste que certaines aides, notamment l'aide au logement, mériteraient de faire l'objet d'une réflexion et d'être aménagées. S'agissant du versement de la pension alimentaire, il ne faut pas oublier que chaque parent doit contribuer, à la mesure de ses moyens, à la prise en charge de l'enfant, et qu'il ne saurait s'en exonérer ni en être exonéré. L'idée d'un fonds qui viendrait pallier la défaillance d'un parent nous semble bonne, sous réserve qu'il puisse ensuite aider le parent défaillant à reprendre ses versements. L'important serait qu'il fasse disparaître la crispation et le conflit que génère la défaillance du parent débiteur. Cette crispation rejaillit évidemment sur la relation de l'enfant avec le parent débiteur. En cas d'abandon de famille par le père, la mère n'a pas d'autre possibilité que de porter plainte. Je pense qu'on pourrait rendre cette démarche moins difficile et moins traumatisante. En effet, beaucoup de mères hésitent à porter plainte, justement dans l'intérêt de la relation entre le père et l'enfant. Un dernier aspect technique : il existe une prestation spécifique, servie par les caisses d'allocations familiales, qui vient pallier l'absence de contribution de l'un des parents. Bien que modeste, cette prestation est nécessaire à l'équilibre de la vie quotidienne de l'enfant. Dans le cas où la pension alimentaire est inférieure à cette prestation, il serait donc utile que celle-ci soit versée sous la forme d'un différentiel. On pourrait en effet considérer que la prestation de soutien qui est versée dans ce cas-là constitue la base de ce que doit recevoir un parent élevant seul un enfant. Enfin, je soulignerai le besoin d'information, d'accompagnement et l'importance de tout dispositif d'aide à la parentalité. Mme Hana Rottman : Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en me demandant de contribuer à votre réflexion. En cas de séparation parentale, en quoi l'alternance entre les deux logis va-t-elle dans le sens - ou à l'encontre - du développement de l'enfant ? Tout ce qui vient d'être dit suppose, de la part des parents, une certaine capacité à surmonter la violence de la rupture pour se centrer sur ce qui relève du bien de l'enfant. Il importe de trouver un aménagement qui pallie la séparation parentale et de permettre à l'enfant et à chacun de ses parents de maintenir un lien significatif. Les deux parents sont en effet indispensables à l'enfant, ils sont coauteurs de l'enfant. Chacun d'entre eux a une place importante à tenir dans son développement, même si cette place n'est pas la même. L'alternance des séjours de l'enfant chez l'un et l'autre parent semble une organisation de vie incontournable pour que l'enfant et chacun de ses parents puissent, au fil du temps, se connaître au quotidien, dans une relation de proximité et d'intimité qui maintienne la force du lien. Reste à déterminer fréquence, rythme et durée de cette alternance. J'ai eu à connaître de ces situations. Travaillant depuis maintenant quarante-cinq ans en psychiatrie, en particulier autour de la problématique de la séparation dans le cadre de la protection de l'enfance ou de l'adoption, j'ai eu l'occasion de recevoir des enfants amenés par un ou les deux parents pour des troubles apparus à l'occasion de la mise en place de la résidence alternée. Il s'agissait aussi bien de très jeunes enfants que d'enfants ayant atteint l'âge de latence, entre sept et dix ans, ou de jeunes adolescents. Beaucoup de choses ont déjà été dites par les précédents intervenants. J'ajouterai tout de même qu'il est essentiel de considérer que les besoins de l'enfant évoluent en fonction de son âge, qu'ils sont marqués par la temporalité et que le temps de l'enfant n'est pas le temps de l'adulte. Une mesure de justice peut prendre dix-huit mois, ce qui est énorme pour le développement d'un enfant ! En dix-huit mois, un enfant s'est différencié de sa mère, il a acquis la marche, il acquiert le langage et des étapes fondamentales de sa construction ont pu se réaliser, ou échouer. Si on parle d'autorité parentale partagée, il faut savoir que l'enfant n'est pas partageable. Au contraire, tout son travail de développement psychique va dans le sens de la liaison et de l'unification, alors que la coupure, le morcellement et la discontinuité limitent sa capacité de grandir. Il est donc difficile, en cas de séparation parentale, de mettre en place un mode de vie pour l'enfant, dont le besoin est de lier les deux images qui le constituent, alors que celui de chacun de ses parents est de mettre l'autre à distance. Les parents ont alors besoin de faire preuve de beaucoup de maîtrise de soi et de maturité, et d'un minimum de connaissance ou d'intuition des besoins de développement de l'enfant. Voilà pourquoi il serait nécessaire qu'une loi serve d'indicateur et de garde-fou dans ce type de décision. Car la question ne concerne pas seulement la sphère privée, mais aussi l'espace public : la garde d'un enfant et son épanouissement conditionnent, à terme, son avenir et celui de la collectivité dont il est membre. J'ai rencontré cliniquement des situations extrêmes, où l'enfant, par son mode de garde, devenait otage et enjeu dans le conflit parental qui se poursuivait à travers lui. J'ai vu des enfants aller alternativement à deux écoles maternelles ; des bébés changer quatorze fois de lit dans le mois ; être déshabillés sur le trottoir pour être dépouillés de tout vêtement qui porte la marque de l'autre parent. J'ai même vu un bébé posé dans son couffin dans l'ascenseur pour être récupéré à un autre étage par l'autre parent, prévenu par téléphone ! Certes, ce sont des dérives. Mais cela prouve qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la capacité des parents à trouver par eux-mêmes la solution la plus juste pour eux-mêmes et pour le développement de leur enfant. N'oublions pas que les exigences du développement de l'enfant peuvent aller à l'encontre de ce que chaque parent considère comme son intérêt. Une petite fille de deux ans avait des troubles du sommeil et était inapaisable. Les parents, séparés, avaient imaginé, de leur propre chef, un moyen d'alternance qui leur permettait à chacun de suivre leur entraînement de sportifs professionnels. L'enfant changeait ainsi de domicile toutes les quarante-huit heures. Les parents n'avaient pas réalisé que l'imprévisibilité et la discontinuité empêchent un enfant de construire sa capacité à penser et à anticiper, ce qui constitue une étape fondamentale du développement. Quels sont les besoins fondamentaux de l'enfant, qui soutiennent son développement ? L'enfant a d'abord besoin d'une figure d'attachement principal. Actuellement, malgré l'évolution de la société et l'entrée en scène des nouveaux pères, c'est encore généralement la mère. Le lien doit être fiable et continu dans ce qu'on appelle une relation d'objet, qui est indispensable à l'enfant. C'est le cas de la relation à sa figure d'attachement principal, en l'occurrence la mère. Son absence entraîne la dépression, voire la mort. L'enfant se construit dans les premiers mois de sa vie dans un rapport étroit à cet objet d'attachement et de sécurité : soins corporels, sens donné aux émotions, transformées en sentiments et habillées en mots, sens donné aux choses et aux personnes qui l'entourent, etc. Tout ce travail de construction demande un lien et un échange entre l'enfant et son objet principal d'attachement, et nécessite de durer au moins les trois premières années de la vie. Ensuite, le temps passe, l'enfant construit ses capacités de représentation symbolique et peut plus facilement se séparer d'un parent en n'ayant pas le sentiment de l'avoir perdu pour toujours. Cette construction suppose une relation triangulée, où il existe un tiers entre l'enfant et la mère. C'est là qu'intervient le père, même si une instance symbolique peut tout à fait remplir ce rôle d'interposition. Dire que la mère est la figure d'attachement principal ne nie pas l'importance de la place du père. Cette place, compte tenu des besoins de proximité de l'enfant avec la mère, est particulière et reste à définir. Elle fait l'objet du travail de très nombreux auteurs, comme Martine Lamour en France. La relation entre l'enfant et le père est plutôt une relation motrice de stimulation, d'encouragement à l'exploration. Elle se développe très tôt et prend de plus en plus de place au fur et à mesure que les capacités motrices et représentatives de l'enfant se développent. L'alternance entre les deux domiciles permet de « faire du lien ». Cela suppose que les deux parents soient capables de s'entendre, qu'on ne fasse pas les poches de l'enfant quand il rentre, qu'on accepte de téléphoner ou de recevoir un coup de téléphone, qu'on puisse donner des informations sur l'état de santé de l'enfant, etc. La position psychique d'un parent vis-à-vis de l'autre va conditionner son attitude et ses paroles. Celles-ci seront absorbées par l'enfant comme une éponge. Si elles sont marquées par la conflictualité, elles risquent de détruire l'enfant qui a besoin de l'accord de ses deux objets d'attachement pour que son monde n'explose pas. La violence exprimée au moment de la petite enfance risque de réapparaître au moment de l'adolescence. J'ai vu des adolescents éprouver une haine incroyable vis-à-vis de l'autre parent, au point de menacer de le tuer. Dans certains cas, il suffisait d'accéder à leur demande, qui était de renoncer à l'alternance, pour les choses rentrent dans l'ordre. Je souhaiterais maintenant parler des mécanismes de défense, en particulier de deux d'entre eux, qui mettent en péril les possibilités d'évaluation de la situation. Une séparation, avec un double attachement, dans un contexte conflictuel, voire traumatique, pousse l'enfant à se défendre en adoptant une attitude de clivage : l'enfant montre des aspects très différents de lui-même dans l'une ou l'autre famille. Cette attitude amène des conflits entre les deux parents, qui se soupçonnent mutuellement de mentir, alors qu'ils ne font qu'exprimer ce que l'enfant leur montre de son désir de s'adapter à chaque milieu. Outre le clivage, on constate souvent une hypermaturité défensive qui peut donner à penser, à tort, que l'enfant va très bien, alors qu'elle traduit fréquemment un défaut de construction affective. Le cadre de la loi est donc nécessaire pour fixer des garde-fous et imposer un rythme à l'alternance. Je souligne à mon tour l'importance des lieux de médiation et j'invite à réduire la judiciarisation du processus. Très peu nombreux sont les pédopsychiatres qui acceptent actuellement de suivre les enfants au cours d'une procédure de divorce, car ils craignent de faire l'objet d'attaques, voire de plaintes devant le Conseil de l'ordre, ce qui a un effet dissuasif certain. Le cinéaste Aleksandar Petrović, on s'en souvient, avait « même rencontré des Tsiganes heureux »... Dans le cas qui nous occupe, une réflexion doit se poursuivre sur la séparation et ses suites, pour déterminer s'il y a « même des résidents alternés heureux », et à quelles conditions. Mme Brigitte Azogui-Chokron : Instituée par la loi du 4 juin 1970 aux lieu et place de la puissance paternelle, l'autorité parentale a fait ensuite l'objet de plusieurs réformes. Les lois du 22 juillet 1987, du 8 janvier 1993 et du 4 mars 2002 œuvrent toutes à une plus grande égalité entre les parents - qu'ils soient mariés ou non, qu'ils mènent une vie commune ou qu'ils soient séparés - en même temps qu'à la prise en compte de l'intérêt de l'enfant. Désormais définie par l'article 371-1 du code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant », l'autorité parentale est exercée en commun par le père et la mère, ainsi qu'il est disposé à l'article 372. L'apport essentiel de la loi du 4 mars 2002 réside dans la proclamation solennelle selon laquelle « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ». Elle implique que l'exercice partagé de l'autorité parentale reste de mise en dépit de la séparation des parents, que le couple parental se perpétue au delà de la dissolution du couple conjugal. Elle implique aussi, comme la loi l'énonce expressément, qu'après leur séparation, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ». Cette pétition de principe, qui pouvait apparaître quelque peu théorique, voire utopique, s'est révélée porteuse d'effets bénéfiques, constatés dans notre pratique judiciaire. Invités par la loi à maintenir en tout état de cause leur lien parental, nombre de parents sont incités à se responsabiliser et à décider eux-mêmes, en bonne intelligence, des conséquences de leur séparation pour leurs enfants, si bien que le juge aux affaires familiales est saisi d'un nombre non négligeable de requêtes conjointes aux fins d'homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Ces conventions sont du reste de bonne facture, même quand elles sont établies par les parties sans l'assistance d'un avocat, et les cas de refus d'homologation à raison de l'intérêt de l'enfant sont exceptionnels. Saisi par un des parents pour statuer sur les conséquences de la séparation, le juge constate très rapidement au cours des débats que les parents ont des points d'accord que sa décision entérinera, et lui-même ne tranchera que le point litigieux résiduel, qui concerne le plus souvent la fixation du montant de la prestation compensatoire d'entretien et d'éducation des enfants. Confortés par la loi dans leurs droits et prérogatives de parent, les pères qui, craignant d'être dépossédés de leur paternité par suite de leur séparation d'avec la mère, se montraient parfois vindicatifs et virulents, se présentent aujourd'hui plus rassurés, plus sereins, ce qui contribue à apaiser le débat judiciaire et à le centrer davantage sur l'intérêt de l'enfant. En effet, la loi donne les moyens de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Ainsi, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Ce mode d'organisation a la faveur du législateur, qui le propose, en tout premier lieu, à l'article 373-2-9 du code civil, avant d'envisager la possibilité de fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents. Il n'est toutefois pas permis d'observer à ce jour la pleine réalisation du vœu du législateur. De fait, la pratique de la résidence alternée reste marginale. Nous la rencontrons assez peu dans les conventions qui nous sont soumises pour homologation, qu'il s'agisse des conventions de divorce par consentement mutuel ou des conventions relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Elle reste peu demandée dans le cadre des divorces contentieux, d'autant qu'à l'issue de la tentative de conciliation l'un des époux devra quitter le logement familial et rechercher un autre logement, et que dans cette hypothèse les parents se montrent heureusement soucieux de préserver la stabilité des enfants en les maintenant dans leur cadre de vie habituel. Il faut souligner que les parents sont dans l'ensemble parfaitement conscients des conditions à réunir pour obtenir l'agrément du juge à une résidence alternée. Les pères de nourrissons ou de très jeunes enfants reconnaissent spontanément que leur enfant a besoin de sa mère et qu'il convient de le laisser à la résidence de la mère ; le ou les parents qui demandent la résidence alternée feront valoir que les résidences respectives sont assez proches pour que l'environnement scolaire et social de l'enfant soit préservé, et feront en outre observer qu'ils partagent les mêmes principes éducatifs et parviennent à communiquer. En tout état de cause, le juge saisi d'une demande de résidence alternée veillera à ce que ces conditions soient remplies, et prêtera une attention particulière à la périodicité de l'alternance. La plus fréquemment retenue est celle d'une semaine, mais l'intérêt de l'enfant, eu égard à son jeune âge notamment, peut justifier une période plus courte tandis que, s'agissant d'un adolescent, une alternance tous les six mois, voire tous les ans, est admissible. Il doit être précisé que la loi n'impose nullement un partage strictement égalitaire de l'hébergement de l'enfant ; toutes les répartitions sont possibles en fonction de l'intérêt de l'enfant, lequel doit être apprécié dans chaque cas. Ma pratique judiciaire ne me permet donc pas de constater un engouement des parents pour la résidence alternée, pas à ce jour en tout cas. Mais le champ d'observation du juge n'est que partiel : certains parents, surtout dans les familles naturelles, organisent leur séparation, et peuvent parfaitement mettre en place une résidence alternée selon les modalités de leur choix sans en référer au juge, lequel n'est saisi que plusieurs années après la séparation, en raison du déménagement de l'un des parents par exemple. La demande des parents pourrait évoluer vers un partage plus égalitaire du temps d'hébergement. Déjà, même si la résidence de l'enfant est le plus souvent établie chez la mère, les plages d'hébergement chez le père se sont étendues très largement au-delà du droit de visite et d'hébergement classique. La loi du 4 mars 2002 prévoit d'autre part que le déménagement de l'un des parents doit donner lieu à une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qui peut saisir le juge en cas de désaccord. Cette innovation répondait à un besoin manifeste, tant étaient fréquentes les situations dans lesquelles le parent attributaire de la résidence habituelle de l'enfant partait s'établir dans une autre ville, voire un autre pays, sans aviser l'autre parent qui se trouvait mis devant le fait accompli. Désormais, les parents sont astreints à plus de loyauté. Saisi d'un désaccord parental à raison du déménagement de l'un des parents, le juge vérifiera que l'autre parent a été informé en temps utile, appréciera les motifs qui président au déménagement et s'assurera que l'éloignement n'a pas été recherché pour soustraire l'enfant à l'autre parent ; si tel était le cas, un changement de résidence serait justifié dès lors que la loi invite le juge à fixer la résidence de l'enfant chez le parent le plus apte à respecter les droits de l'autre. Pour prévenir les risques de déplacement illicite d'enfant, le juge peut ordonner la mention, sur le passeport des parents, de l'interdiction de sortir l'enfant du territoire national sans l'accord écrit des deux parents. Cette disposition répondait à un besoin, et l'exigence nouvelle d'un accord écrit des deux parents pour sortir l'enfant du territoire national permet de rassurer le parent qui craint un déplacement de l'enfant et de rendre plus effectif le droit de rencontre et d'hébergement de l'autre parent. Par ailleurs, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est présentée par la loi comme un moyen de garantir l'effectivité du maintien du lien parental. L'article 373-2-2 dispose que, en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. C'est l'hypothèse la plus fréquente, mais la loi a diversifié le mode de contribution, qui peut prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ; cette formule, plus gratifiante pour les pères, connaît un succès certain. La contribution peut aussi prendre les formes d'un droit d'usage et d'habitation, de l'abandon de biens en usufruit, de l'affectation de biens productifs de revenus. Même si ces formules sont peu usitées, elles sont utiles aux parents et au juge, notamment quand le débiteur de la contribution n'a pas de revenus du travail mais dispose d'un patrimoine immobilier. L'institution d'un barème pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant paraît difficilement compatible avec la diversité des formes que cette contribution peut prendre, diversité dont le maintien est souhaitable. Elle pourrait pénaliser les débiteurs qui ne vivent que des produits de leur travail au profit de ceux qui ne disposent que de faibles revenus mais sont propriétaires d'actifs immobilisés, et elle pénaliserait certainement les salariés dont les sources de revenus sont transparentes au profit des commerçants, artisans, professions libérales qui exigent du juge de faire une étude approfondie des documents fiscaux relatifs aux recettes et aux charges professionnelles comparés aux éléments de train de vie. Mais, en dépit des moyens déployés par la loi et des progrès enregistrés, le maintien du lien parental après la séparation des parents continue de rencontrer des limites. L'exercice commun de l'autorité parentale, qui implique que les père et mère prennent ensemble les mesures nécessaires à l'éducation et à la protection de leur enfant, reste illusoire quand les parents, aux prises avec leur conflit conjugal, sont incapables d'instaurer le dialogue minimum requis pour se tenir informés et se concerter. Il peut même, en cas de persistance et de multiplication des conflits, s'avérer préjudiciable à l'enfant, ce qui imposera au juge, dans des cas extrêmes, de confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des parents. Le rétablissement du dialogue parental après la rupture du lien conjugal est dès lors indispensable. Parmi les moyens d'y parvenir, le législateur a institué la médiation familiale, disposant que le juge saisi du conflit parental peut, « à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord désigner un médiateur familial pour y procéder ». Le juge peut aussi « leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure ». Faut-il modifier ces dispositions, notamment en obligeant les parents à suivre une réunion d'information sur la médiation avant de pouvoir saisir le juge ? La question a été débattue à l'occasion de la réforme du divorce mais, en définitive, la loi du 26 mai 2004 reproduit mot pour mot les dispositions de la loi du 4 mars 2002 en ce qui concerne la médiation. Dès lors qu'un conflit oppose les parents, il ne paraît en effet pas souhaitable, dans l'intérêt de l'enfant, de retarder ou de supprimer l'accès au juge aussi longtemps que les parents ne se seront pas rendus à une réunion d'information sur la médiation. Ce l'est d'autant moins que les parents qui saisissent le juge sont déjà bien informés sur la médiation, et en ont parfois même entrepris une sans succès. On notera que les mairies, les maisons du droit et les services de la Caisse nationale d'allocations familiales contribuent à la diffusion de l'information sur la médiation familiale. C'est néanmoins en amont de la procédure judiciaire que la médiation est la plus efficace et qu'elle présente les plus grandes chances de succès. Aussi, sans être imposée, elle gagnerait à être mieux connue par de plus amples mesures d'information et de promotion qu'il conviendrait de favoriser. Par ailleurs, l'intérêt de l'enfant justifie dans certaines situations de limiter ses relations personnelles avec le parent qui n'est pas en mesure d'assurer sa sécurité. Le parent alcoolique ou toxicomane, le parent maltraitant, le parent violent à l'égard de l'autre parent, le parent imprévisible, instable ou présentant une pathologie mentale, enfin le parent en situation de précarité qui ne dispose pas de capacités d'hébergement verront leurs rencontres avec l'enfant organisées dans un lieu d'accueil. Mais ces « points rencontre », qui tiennent un rôle essentiel dans le maintien des relations parents-enfants et dans la reprise de relations qui ont pu être rompues, sont aujourd'hui en nombre très insuffisant, mal répartis, et y accéder demande de longs délais d'attente qui, ajoutés à l'éloignement géographique, découragent les parents. Le désintérêt ou le désinvestissement du parent, qui se traduit essentiellement par le refus ou la négligence de rencontrer et d'héberger l'enfant, le manquement à l'obligation alimentaire constituent d'autres limites au maintien du lien parental après la séparation des parents. Force est de constater que nombre de pères s'abstiennent d'exercer pleinement et régulièrement le droit de visite et d'hébergement organisé à leur intention par la décision de justice, laissant la mère et les enfants dans l'attente d'une hypothétique venue en fin de semaine. Dans ces cas, la saisine du juge par la mère aux fins de suppression du droit de visite et d'hébergement du père est souvent un appel au père pour qu'il exerce ses droits. Il arrive même que la mère demande tout simplement au juge, qui se trouve du reste très démuni, d'enjoindre au père d'exercer ses droits. Se pose alors la question de l'opportunité de sanctionner pénalement l'inobservation de l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le parent qui en est titulaire. En revanche, le non-paiement de la pension alimentaire est constitutif du délit d'abandon de famille et sanctionné pénalement. Faut-il prévoir des sanctions autres que la sanction pénale ? Elle paraît suffisamment efficace, d'autant que les médiations pénales entreprises par les parquets incitent le débiteur au paiement, s'il veut éviter d'avoir à comparaître en correctionnelle. Au côté de la sanction pénale, des moyens sont mis à la disposition du créancier pour obtenir le paiement de la pension alimentaire. Le plus simple et le moins onéreux est le paiement direct, pratiqué par huissier de justice par prélèvement sur les salaires du débiteur. La création d'un fonds spécifique qui assurerait l'avance du paiement des pensions alimentaires en cas de carence du débiteur présenterait des avantages certains pour le créancier, mais favoriserait-elle la responsabilisation des parents, si sollicitée aujourd'hui ? N'est-elle pas susceptible, au contraire, d'accentuer les tendances de l'individu à déléguer ses obligations à la collectivité ? Ne risque-t-elle pas, enfin, d'être perçue par l'opinion publique comme une charge indue à raison du non-respect de l'obligation alimentaire dans les milieux aisés, dès lors que, dans les milieux plus défavorisés, les caisses d'allocations familiales assurent au créancier le versement de l'allocation de soutien familial, qui peut soit être récupérée auprès du débiteur défaillant, soit rester non recouvrée si le débiteur est hors d'état de payer la pension car impécunieux, insolvable, ou introuvable ? M. Alain Cazenave : Si l'on considère que de 30 à 40 % des familles éclatent et que la proportion atteint même 50 % à Paris et dans les grandes métropoles, on comprend toute l'importance du sujet que vous avez choisi d'aborder aujourd'hui. Quels problèmes pose la résidence alternée imposée par le juge ? Dans la majorité des cas, toute limitation ou interdiction des résidences alternées en cas de conflit parental ou d'enfant en bas âge ne semble ni souhaitable ni réaliste, et encore moins compatible avec l'intérêt de l'enfant. En effet, l'intérêt de l'enfant est d'avoir des relations avec ses deux parents. Ce n'est pas parce que l'un des parents exprime son désaccord qu'il faut supprimer la résidence alternée. Cela ne peut qu'encourager les conflits en donnant une « arme » imparable au parent qui souhaite couper l'enfant de l'autre parent. La cause du passage d'un enfant d'un lieu à un autre est le divorce ou la séparation des parents : en se séparant, ceux-ci prennent la responsabilité d'imposer deux résidences à l'enfant, deux résidences auxquelles il fallait donner un statut juridique. Au lieu que l'enfant soit chez lui lorsqu'il est chez l'un de ses parents et à l'hôtel chez l'autre, en cas de résidence alternée il est chez lui chez son papa et chez lui chez sa maman. La loi ne précise pas la périodicité de l'alternance ; le rythme en étant laissé à l'appréciation des parents et du juge, toutes les solutions peuvent être envisagées. Je redis donc à tous ceux qui évoquent des traumatismes, des difficultés ou des inconvénients que ceux-ci ne sont pas dus à la résidence alternée, mais au divorce et à la distance qui s'est installée entre les parents. La résidence alternée présente l'avantage considérable de placer les deux parents sur un plan d'égalité juridique dans leurs relations avec l'école, la sécurité sociale, le fisc et les autres administrations. Elle signifie que les parents sont tous deux parents à part entière alors que, lorsqu'un droit de garde est alloué, celui qui ne l'a pas n'est, dans les faits, qu'un demi parent. Il nous a par exemple été relaté le cas dramatique d'un père qui, au cours d'un week-end pendant lequel il recevait son fils, s'est entendu répondre par celui-ci, auquel il faisait des observations à propos de résultats scolaires peu satisfaisants : « De toute façon, maman m'a dit que tu n'es plus tout à fait mon père ». La résidence alternée fait comprendre à l'enfant que ses parents ont beau s'être séparés, ils n'ont pas divorcé de lui. Conserver des liens avec ses deux parents, ce n'est pas seulement voir l'un des deux une fois de temps en temps, mais le considérer comme un parent à part entière, qui a l'autorité du parent. Par ailleurs, il est très perturbant pour les enfants de ne pouvoir parler à l'un de ses parents de l'autre sans susciter des remarques assassines ; dans de tels cas, l'enfant se ferme. La coparentalité suppose des relations apaisées, telles que chacun respecte l'autre. La difficulté vient de ce qu'aucune sanction n'est prévue à l'encontre de celui qui ne respecte pas l'autorité parentale ou l'image de l'autre. La seule sanction possible, on l'a dit, est le transfert par le juge de la résidence de l'enfant. On peut considérer que c'est une excellente solution ; malheureusement, elle n'est pas forcément dans l'intérêt de l'enfant si le parent auquel le magistrat envisage de transférer la résidence n'est pas en mesure de l'accueillir, soit qu'il n'en ait pas les moyens matériels, soit que sa profession l'en empêche. Il est alors confronté à la toute-puissance de l'autre parent. Il faut absolument pacifier les conflits entre les parents pour permettre aux enfants de vivre sereinement. Le législateur doit les y inciter. S'agissant de l'opportunité d'interdire la résidence alternée pour les enfants en bas âge, je souligne que, quel que soit l'âge de l'enfant, la question ne varie pas : faut-il lui permettre d'aller d'un de ses parents à l'autre ? Comme chacun le sait, l'évolution de l'enfant est très rapide et ses besoins sont entièrement différents selon qu'il a quelques mois, trois ans ou six ans. Or, les habitudes juridiques actuelles ne tiennent pas compte de cette évolution. La règle du jeu est parfois définie lorsque l'enfant a six mois et elle n'est plus modifiée. Le droit français précise bien que tout fait nouveau permet de remettre le jugement en cause mais, le plus souvent, on entend par là un fait matériel, par exemple un déménagement. Or, l'enfant est en soi un fait nouveau permanent. Le droit doit donc dire qu'un jugement le concernant ne peut être définitif. Il faut préciser dans les textes qu'un juge doit intégrer un calendrier dans son jugement. Comment peut-il en être autrement lorsqu'une séparation intervient alors que le couple a un bébé de trois mois ? D'autres difficultés interviennent par la suite, car le couple parental ne saisit le juge qu'en cas de conflit, ce qui est le pire moment pour le faire. On pourrait donc envisager que les couples qui ont des enfants comparaissent périodiquement devant le juge ; ce serait justifié dans tous les cas puisque, de par l'évolution de l'enfant, la situation aura forcément changé. Enfin, la justice de la famille est celle qui, actuellement, concerne le plus grand nombre d'individus. Mais ceux-ci ont affaire au juge des affaires familiales pour la dévolution de l'autorité parentale, au juge des enfants dans les cas de mesures éducatives et au juge pénal en cas de non présentation d'enfants. On voudra bien admettre que ce dispositif est un peu compliqué. Pour qu'il fonctionne correctement, les magistrats devraient recevoir une solide formation en psychologie et en sociologie. Plus largement, il serait peut-être intéressant de prévoir l'installation, au sein des juridictions, d'un pôle « famille » regroupant le juge aux affaires familiales, le juge pénal et le juge des enfants. Cela faciliterait les choses. Un autre sujet particulièrement grave est celui de l'échelle des temps. Chacun a conscience qu'une année n'a pas la même valeur pour un adulte que pour un enfant en bas âge, pour lequel un an est une vie. Or, pour qu'un jugement soit rendu au civil, huit mois sont nécessaires si une enquête sociale ou psychologique est demandée et, s'il y a appel, une nouvelle année est nécessaire avant qu'une décision soit rendue. De tels délais sont inconcevables lorsque le sort d'enfants de trois, quatre ou cinq ans est en jeu, d'autant que si l'un des parents décide de se pourvoir en cassation, une année et demie supplémentaire sera nécessaire. Le fonctionnement du système judiciaire est incompatible avec la vie des enfants. Cela vaut particulièrement lorsqu'un parent comparaît devant un juge parce qu'il est soupçonné d'agression sexuelle sur son enfant. On sait désormais que ces accusations sont infondées pour la moitié d'entre elles ; pourtant, si le droit de visite est suspendu et s'il y a appel, les relations entre le parent accusé et l'enfant seront totalement coupées pendant au moins un an, et le lien sera rompu. Le seul outil dont disposent les juges dans pareil cas sont les « points rencontre », mais ils ne fonctionnent que si le parent gardien de l'enfant est favorable à la reconstruction du lien avec l'autre parent. Très souvent, il ne l'est pas, bien au contraire : l'autre parent est diabolisé pendant quinze jours, au terme desquels l'enfant se trouve seul face au parent qu'il n'a cessé d'entendre vilipender. On imagine combien ce système peut être traumatisant. Il faut mettre au point un autre dispositif dans lequel les « points rencontre » seraient envisagés comme des sas entre les changements de résidence de l'enfant. Une telle solution serait adaptée lorsque les parents n'arrivent pas à dépasser leurs conflits, devant lesquels la justice semble démunie. Mme Nadine Morano : Je suis d'accord avec Mme Juès, Mme Lebatard et Mme Rottmann, mais pas avec Mme Azogui-Chokron, s'agissant de l'aliénation parentale dans le cadre des conflits familiaux. Ce processus consiste à manipuler l'enfant pour détruire l'image de l'autre parent. Notre Mission s'est rendue au Canada où, dès le début du processus judiciaire, il est obligatoire de suivre, non pas une médiation, mais une présentation de la médiation, avec ses différentes composantes. Cela permet aux parents de comprendre l'impact financier, psychologique, social de la séparation, notamment vis-à-vis de l'enfant. Nous devrions mettre en place une telle obligation et en garantir la gratuité. On pourrait d'ailleurs, dans ce but, recourir à l'aide juridictionnelle. Mme Azogui-Chokron a déclaré que la médiation était assez connue. Or de nombreux concitoyens nous disent ne pas savoir où se tourner. Au Canada, en revanche, des plaquettes sont diffusées. Mme Juès a raison de souligner qu'il faut assurer une meilleure formation aux magistrats comme aux médiateurs. Nos citoyens doivent savoir où s'adresser. Un stage de guidance parentale, en amont, permettrait de désamorcer les conflits, et notamment tous les propos qui constituent des blessures pour les enfants. Mme Henriette Martinez : Après vous avoir entendus, je me rends compte que nous parlions tous de l'intérêt de l'enfant, mais que nous n'en avions pas une définition exacte. Nous en avons une interprétation différente selon qu'on se situe du côté des parents, des pédopsychiatres ou des magistrats. Je pense donc, même si je sais que je ne serai pas suivie par tous les membres de la Mission, qu'il conviendrait de définir ce qu'est l'intérêt de l'enfant et d'inscrire cette définition dans la loi. Nos textes permettent en principe d'adapter les décisions aux situations, mais ils sont interprétés par des juges sans que ceux-ci disposent d'une connaissance suffisante de ce qu'est l'intérêt de l'enfant. Certains font même passer l'intérêt des parents avant celui de l'enfant, en application du sacro-saint principe de l'autorité parentale. Je souhaiterais qu'à l'instar de ce que nous avons vu au Canada, on forme les juges spécialisés dans les affaires familiales aux problématiques de la protection de l'enfance. L'autorité parentale est un principe ancien, qui renvoie à la notion de pater familias. Aujourd'hui, sans nier ce principe, il me semble qu'il faut tenir compte de celui de responsabilité parentale. Deux intervenantes ont rappelé que, depuis 2004, le Conseil de l'ordre ne peut plus sanctionner les médecins qui signalent un enfant maltraité dès lors qu'ils sont de bonne foi. Cette disposition est issue d'un amendement que Patricia Adam et moi-même avons fait voter, lors de la discussion du projet de loi Jacob, dont j'étais la rapporteure. Ce qui me préoccupe le plus, lorsque l'on parle de résidence alternée, c'est l'âge de l'enfant. En effet, pour être à même d'accepter cette résidence alternée et d'être associé à la décision des parents pour la vivre de façon positive, il ne saurait être trop petit. Le petit enfant a en effet besoin d'une stabilité affective et matérielle. Ne vous paraîtrait-il pas opportun d'associer l'enfant aux décisions de résidence alternée - ce qui nous renvoie à ce que disait M. Cazenave sur la possibilité de revoir les jugements - dans la mesure où la situation de l'enfant et ses besoins affectifs évoluent dans le temps ? Il me semble que l'enfant petit doit avoir une résidence principale et une résidence secondaire, qui peut être chez le père ou la mère, et qu'ensuite, lorsqu'il est en âge d'accepter un changement, il pourrait être associé à une décision modifiant sa situation. On fait vivre à des enfants tout petits des situations que des adultes ne seraient pas capables de vivre. Lorsque l'un des deux parents déménage et que l'autre ne souhaite pas remettre en cause la résidence alternée, il arrive que les enfants se retrouvent dans deux écoles différentes. Comment le juge peut-il en être informé ? Que pensez-vous de ce type de dérive ? De nombreux intervenants ont souligné l'importance de la médiation familiale. Mais dans les faits elle n'existe pas, pas plus que n'existe une réelle possibilité d'accélérer les décisions de justice. En conséquence, les conflits s'enveniment. En cas de décès des parents ou de l'un d'eux, la résidence de l'enfant peut être fixée, non pas par un juge aux affaires familiales, mais par un juge des tutelles qui risque de décider n'importe quoi. Je viens d'avoir l'exemple d'enfants de six mois et de trois ans qui ont perdu leurs parents à la suite d'un accident. Comme il y avait une recomposition de la famille, trois couples de grands-parents se sont disputés la résidence des enfants, qui se sont trouvés confiés alternativement à chacune de ces couples, à raison d'une semaine par couple ! Lorsque l'autorité parentale disparaît, ne faudrait-il pas que la responsabilité du placement des enfants soit confiée à quelqu'un d'autre qu'au juge des tutelles, et de préférence à un juge aux affaires familiales formé à ce genre de situation ? Mme Patricia Adam : Nous sommes plusieurs à avoir admiré l'exemple que le Québec donne en matière d'application de la loi. Je remarque que la médiation n'est pas effective en France, dans la mesure où la loi n'en fait pas une obligation et ne la finance pas. Tant que la question ne sera pas résolue, je ne vois pas comment nous pourrons continuer à prôner cette solution. Le recours à l'aide juridictionnelle pourrait être une réponse. Mais je remarque aussi que la plupart des séparations sont des séparations de couples non mariés, qui se font à l'amiable, sans qu'il y ait intervention du juge, sauf en cas de conflit. On ne résoudra donc pas tous les problèmes qui ont été soulevés par le biais de l'aide juridictionnelle. Nous observons de plus en plus souvent dans nos circonscriptions que les décisions concernant des enfants sont prises d'abord par un juge aux affaires familiales, ensuite par un juge pour enfants quand on estime qu'il y a danger et que les services sociaux ont demandé à ce qu'il intervienne, puis éventuellement par un juge des tutelles. Un seul juge spécialisé devrait pouvoir régler toutes les questions concernant les enfants. Aujourd'hui les affaires de famille représentent 60 à 70 %, voire davantage, des contentieux. Enfin, je pense que les décisions concernant des enfants demandent beaucoup de souplesse pour s'adapter à l'évolution de ceux-ci. On pourrait réfléchir à la possibilité de donner une délégation à une instance autre que le juge, pour parvenir à une décision conjointe des parents, raisonnée et raisonnable, dans l'intérêt des enfants. M. Pierre-Louis Fagniez : Personne n'a parlé du cas de parents, mariés ou non, qui quittent la France. L'un des parents peut ainsi se retrouver à New York et l'autre à Joinville-le-Pont. Or ce genre de situation va se multiplier dans l'avenir. J'ai beaucoup aimé, Mme Lebatard, vos propos sur la durée et le changement, et sur la nécessité d'adaptation et de souplesse. Mais je voudrais savoir ce que vous pensez de ces problèmes d'éloignement. M. Patrick Delnatte : Je suis un peu déçu : nous ne disposons pas d'analyses, même quantitatives, sur la résidence alternée. Le ministère de la justice a bien fait une étude, mais elle portait sur un échantillon très réduit. Or voilà pratiquement trois ans que la loi est en application. Nous aurions besoin d'un diagnostic partagé sur la question, et qui soit précis sur le plan géographique. En matière d'autorité parentale, les décisions de justice sont en effet très différentes d'un tribunal de grande instance à l'autre, certains s'engageant en faveur de la résidence alternée et d'autres y étant totalement fermés. Nous avions travaillé, notamment lors de l'examen du projet de loi sur le divorce, sur la médiation familiale. Une information gratuite a été mise en place, mais j'ignore sous quelle forme. Si cela ne fonctionne pas, qu'on nous le dise. Il me semble néanmoins qu'un effort a été fait en la matière. Mme la Rapporteure : Avez-vous rencontré des difficultés concernant le partage des prestations familiales en cas de partage de la résidence ? Le Médiateur de la République a été saisi de problèmes de cet ordre. D'autre part, lorsqu'un des parents fait obstacle à l'exercice, par l'autre parent, de son droit de garde ou de visite, on dispose d'une arme extrême, à savoir l'emprisonnement. Je ne suis pas sûre que, lorsque le conflit est exacerbé, cela constitue une réponse adaptée. Je vois bien l'intérêt de la peine de prison en cas d'enlèvement d'enfant, notamment à l'étranger, mais pas en cas de refus de présentation de l'enfant. Cela ne peut qu'aggraver le conflit et placer l'enfant dans une situation difficile. Ne pourrait-on pas créer un délit spécifique d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale, qui pourrait être puni de peines spécifiques ? S'agissant du non-versement de la pension alimentaire, si le père est salarié, il n'y a pas de problème. Sinon, la situation devient très complexe, même si l'on peut saisir le procureur de la République, et même s'il existe de nombreuses procédures. Par ailleurs, je ne suis pas convaincue de l'intérêt de la création d'un fonds destiné à palier la carence du parent débiteur. Je considère que le fait d'être parent constitue une responsabilité individuelle, qu'il convient de réaffirmer, et je ne vois pas pourquoi la solidarité nationale s'exercerait en cas de non-versement de la pension alimentaire. Je ne vise bien sûr pas l'hypothèse où le père se trouverait dans des difficultés financières extrêmes, mais celle où il échapperait à ses responsabilités. Je me demande s'il ne serait pas possible de mettre en place des systèmes plus rapides et plus coercitifs. Je précise que la saisie par huissier est coûteuse et nécessite une avance de frais, ce qui, en cas de petites pensions alimentaires, peut être dirimant. M. le Président : Pendant longtemps, nous avons voté la loi sans nous préoccuper de la manière dont elle était appliquée. Mais nous ne devons pas tomber dans l'excès inverse : modifier la loi sans attendre d'avoir le recul nécessaire. On nous demande fréquemment d'instituer des dispositifs de sanction civile ou pénale. Nous y avons été confrontés tout récemment lorsque nous avons étudié les moyens de lutter contre les mariages forcés. S'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, je souhaiterais donc vous interroger sur la manière de sanctionner l'absence de respect de la loi. Peut-on instituer de nouvelles sanctions civiles, afin d'éviter une démarche pénale dans un contexte familial déjà compliqué ? Mme Jacqueline Phelip : Mme Morano a parlé du syndrome d'aliénation parentale. Je pense qu'il est préférable de parler de manipulation des enfants par l'un des parents. Le syndrome d'aliénation parentale correspond à des situations extrêmes, et j'ai eu l'exemple de ravages qu'il a provoqués chez certains enfants. La manipulation est une pratique plus courante, qu'il s'agisse du père ou de la mère. On a évoqué le problème de non-présentation d'enfants. Il arrive qu'une mère refuse de remettre son enfant à son ex-conjoint parce qu'elle sait qu'il boit, ou qu'il ne le surveille pas suffisamment. Essayons donc de voir ce qu'il y a derrière cette non-présentation. Mme la Rapporteure : Il s'agit tout de même de respecter les décisions de justice ! M. Alain Cazenave : Le syndrome d'aliénation parentale existe. Il est omniprésent dès qu'il y a un conflit. Il est donc nécessaire que tous les intervenants suivent une formation en la matière. Il est exact que, à l'heure actuelle, l'intérêt de l'enfant n'est pas défini. Il en est de même des violences à enfant, qu'elles soient psychologiques ou physiques. Je pense d'autre part qu'il faudrait un juge unique. En centralisant les compétences, on faciliterait la gestion des dossiers. Je vous livre un scoop : le ministre de l'éducation nationale est en train de mettre en place une immatriculation des élèves, qui permettra de référencer les inscriptions sur un fichier central. Il ne pourra plus y avoir un enfant inscrit dans deux écoles. Cela me semble très important. On a beaucoup parlé de la résidence alternée pour les enfants jeunes. Encore faut-il définir ce qu'est un enfant jeune. N'oublions pas que le docteur Fitzburgh Dodson, comme d'ailleurs tous les autres spécialistes, dit que la personnalité d'un enfant est constituée à six ans Je rejoins les propos de M. Delnatte sur le manque d'analyses quantitatives relatives à la résidence alternée. Un audit apparaît en effet indispensable, au bout de trois ans d'application de la loi. Il ne devrait pas concerner uniquement les cas pathologiques, mais l'ensemble de la population concernée. Le partage des prestations familiales est à la fois un vrai et un faux problème. Les prestations familiales doivent être touchées par les deux parents, dans la mesure où l'enfant vit chez les deux. Mais il faut raisonner globalement, et je ne serais pas choqué que ces prestations soient touchées par un seul des parents, si le juge aux affaires familiales prend en compte cette situation dans le calcul de la pension alimentaire, des trajets entre les deux domiciles, etc. Faut-il instituer des délits spécifiques ? On ne peut pas résoudre un problème de conflit sans qu'une sanction ne soit prévue. Mme Brigitte Azogui-Chokron : Je n'ai pas dit que tout avait été fait sur la médiation, mais qu'il fallait la développer, notamment en amont de la procédure judiciaire, là où elle est la plus efficace. Il y a cinq ou six ans, on en parlait à peine. Aujourd'hui, les parents qui viennent dans mon cabinet en ont déjà été informés ou en ont suivi une. Certes, mon champ d'observation peut être limité. Il n'en reste pas moins que des progrès ont été fait en ce sens. Lorsque le juge est saisi par les parents, il doit rapidement décider. Imposer aux parents de suivre une information sur la médiation et retarder ainsi a décision du juge ne me paraît pas forcément favorable à l'intérêt de l'enfant. Une fois que la décision de justice est rendue, le juge peut inciter les parents à suivre une médiation familiale. En cas de situation très conflictuelle en effet, il peut craindre que sa décision reste lettre morte, que l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne soit pas effectif et que les parents recourent à lui tous les six mois. La médiation familiale amènera les parents se rapprocher et à se concerter. Pour ce qui est de l'analyse quantitative de la résidence alternée, nous ne disposons effectivement d'aucune statistique, mais on sait qu'elle demeure relativement marginale. J'ai ainsi observé, de manière empirique, qu'elle concerne de 10 à 15 % des cas parmi le millier de dossiers que je traite chaque année. Il n'y a pas eu de ruée de la part des parents. Cependant, je le redis, le champ d'observation du juge est très partiel. Comme l'a souligné Mme Patricia Adam, il arrive souvent, particulièrement dans les familles naturelles, que le juge ne soit pas saisi, ou qu'il soit saisi après des années parce qu'une évolution particulière ou un incident ponctuel a eu lieu. Enfin, le fait que les parents se mettent d'accord pour organiser les conditions, bonnes ou mauvaises, de leur séparation est la conséquence de la dévolution de l'autorité parentale conjointe. On ne peut à la fois dire que l'autorité parentale s'exerce conjointement et imposer l'intervention du juge quand les parents sont d'accord sur les modalités de la séparation. M. le Président : Le dispositif de sanction vous paraît-il efficace et suffisant ? Mme Brigitte Azogui-Chokron : Il est vrai que la sanction pénale est d'un maniement très délicat. Je connais des enfants qui refusent de voir leur mère depuis des années parce qu'elle a porté plainte pour abandon de famille contre leur père et que celui-ci a été placé en garde à vue. Parce qu'elle peut faire des dégâts, la sanction pénale n'est peut-être pas idéale, mais elle demeure la meilleure façon d'imposer solennellement le respect de la loi. Si la loi n'est pas soutenue par une sanction pénale en cas de violation, elle perd de sa portée. Il faut néanmoins manier la sanction pénale avec précaution. On constate par ailleurs que la médiation pénale, systématiquement ordonnée par les parquets en cas de non paiement des pensions alimentaires, donne des résultats : les pères de mauvaise foi sont amenés à régler ce qu'ils doivent et le débiteur défaillant de bonne foi peut faire valoir ses arguments. M. le Président : Que pensez-vous de l'incarcération pour non présentation d'enfant ? Mme Brigitte Azogui-Chokron : Les cas sont rarissimes. Lorsqu'une mère ne présente pas ses enfants, c'est qu'elle éprouve des craintes après que les enfants sont revenus chez elle déstabilisés. Pour ne pas être passible d'une sanction pénale, elle saisit alors le juge et demande la suppression du droit de visite et d'hébergement donné au père. Avant de supprimer ce droit, le juge demandera une enquête médico-psychologique et, éventuellement, il entendra l'enfant, dont les auditions sont toujours très intéressantes. J'ai ainsi été amenée à suspendre un droit de visite et d'hébergement après qu'une petite fille se fut exprimée devant moi d'une manière à la fois ferme et pondérée. Il est ressorti de son audition que le père tenait des propos disqualifiants à l'égard de la mère, et menaçait d'emmener l'enfant à l'étranger où il avait des attaches, ce qui rendait les craintes de soustraction fondées. Il est toujours très intéressant pour un juge d'entendre les enfants, mais encore faut-il qu'il en ait le temps. Notre charge de travail est très importante, et nous souhaitons entendre les enfants seuls, ce qui signifie une audition supplémentaire. Ce n'est pas toujours facile à organiser mais, lorsque nous pouvons le faire, cela nous aide. Mme Isabelle Juès : Des progrès ont été réalisés depuis 2001 avec la création du Conseil consultatif de la médiation familiale et celle d'un diplôme spécialisé. La Caisse nationale d'allocations familiales, très engagée dans l'information sur la médiation familiale, a élaboré une plaquette qui sera publiée en 2006. Elle réfléchit aussi à une prestation spécifique d'aide aux services de médiation familiale, qui permettrait d'adapter les tarifs aux revenus des clients. J'appelle néanmoins l'attention sur la précarité de ces services. Les entretiens d'information ne sont pas gratuits, car la loi ne le prévoit pas ; lorsqu'ils le sont, ce sont les médiateurs qui les financent... Les injonctions d'aller s'informer sur la médiation familiale seraient plus efficaces si elles étaient faites dans des conditions financières satisfaisantes pour tous. D'autre part, la médiation concerne essentiellement des conflits qui ne sont pas portés au stade judiciaire. Le tribunal de Paris envoie beaucoup de familles en médiation, mais ce n'est pas le cas de tous les tribunaux. Par ailleurs, la raison d'être de la médiation est de travailler en amont pour éviter un recours au juge ou pour parvenir à l'homologation des accords. L'aide juridictionnelle ne peut donc pas servir à financer la médiation familiale. Mme Chantal Lebatard : L'UNAF souhaite depuis longtemps que la place du juge aux affaires familiales soit renforcée et que soit créé, comme le demande la Défenseure des enfants, un pôle « enfance-famille » dans les juridictions, ce qui favoriserait la cohérence des approches pour un même dossier. Mais valoriser la place du juge aux affaires familiales, c'est aussi lui permettre de se consacrer pleinement à ses tâches, sans surcharge de travail. Nous insistons donc à nouveau sur les moyens qu'il convient d'accorder à la justice. Le juge doit avoir le temps de s'appuyer sur les expertises qu'il a demandées et disposer de moyens. D'autre part, il est essentiel que les enfants soient entendus, y compris en cas d'homologation des accords entre les parents. Cela dit, il ne faut pas en venir à faire de l'enfant le juge de la décision ; il n'a pas à choisir entre ses parents. M. Fagniez a évoqué les problèmes que pose la mobilité internationale des parents. À ce sujet, on s'est efforcé de mettre en place un dispositif de médiation internationale et le ministère des affaires étrangères a créé un pôle de gestion des sorties du territoire sans consentement de l'autre parent. L'emprisonnement, décision gravissime, ne peut être ordonné qu'en dernière extrémité. Il faut donc envisager une gradation des sanctions et le délit d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale est une piste à explorer. La sanction a un rôle symbolique ; elle signifie que celui des parents qui empêche l'autre de remplir sa fonction se met hors-la-loi. S'agissant de la création d'un fonds pour le non paiement des pensions alimentaires, j'ai entendu l'argument de la responsabilité individuelle. Sans doute, mais il faut trouver un mécanisme permettant d'éviter d'en passer par une plainte. La médiation a lieu en amont des décisions de justice, mais elle doit également les accompagner, pour permettre aux parents de les comprendre et de les accepter, dans l'esprit voulu par le juge. Se pose donc une nouvelle fois la question des moyens, car il faudra bien trouver comment financer les services de médiation familiale. Mme Hana Rottman : J'ai été très intéressée par la proposition de Mme Martinez. Pour définir le lieu de résidence de l'enfant, il conviendrait de déterminer quelle est sa figure d'attachement principale. Quant à l'ouvrage du docteur Fitzburgh Dodson, Tout se joue avant six ans, il a suscité la réprobation générale des pédopsychiatres, qui considèrent que l'évolution des enfants se fait continûment et que le temps de l'adolescence est aussi celui de l'examen de ce qui s'est passé pendant l'enfance. Autrement dit, et heureusement, tout n'est pas joué à six ans. Entendre l'enfant et le laisser s'exprimer, ce n'est pas le laisser décider, c'est le rendre sujet actif de son devenir, ce qui est préventif et, parfois, thérapeutique. S'agissant des parents dont le droit de visite et d'hébergement est suspendu pour suspicion d'abus sexuel, on admettra que la question est très grave. L'accusation est peut-être fausse, peut-être ne l'est-elle pas. Dans de tels cas, on ne peut donc se satisfaire de « points rencontre » considérés comme de simples sas, d'où l'enfant repartirait seul avec le parent considéré. La rencontre doit être accompagnée, dans le lieu même, afin que la relation soit évaluée par des personnes compétentes. De plus, un travail doit être conduit pour restaurer l'image du parent accusé. Il va sans dire qu'un accompagnement de cette sorte aura des résultats autrement plus fructueux que de laisser partir l'enfant seul avec un tel contentieux. M. le Président : Je remercie tous les participants à cette table ronde. Audition ouverte à la presse de Mme Christine Miallot, M. le Président : L'allongement de la durée de la vie et la plus grande fréquence des séparations parentales ont profondément modifié les relations entre les enfants et les grands-parents. Parallèlement, de nouvelles solidarités intergénérationnelles se sont fait jour. Cela peut créer des contextes difficiles, où les grands-parents se trouvent privés de relations avec leurs petits-enfants. C'est pourquoi nous avons souhaité entendre Mme Christine Miallot, présidente de l'association « SOS Grands-parents en danger 83 ». Mme Christine Miallot : Notre association est jeune, puisqu'elle n'a que huit mois d'existence. Elle traite néanmoins déjà plus de 700 dossiers. Quatorze délégations reçoivent journellement entre 20 et 30 nouveaux cas de grands-parents et arrière grands-parents privés de toutes relations avec leurs petits-enfants. « SOS Grands-parents en danger 83 » poursuit deux objectifs : l'écoute, le conseil et l'accompagnement des grands-parents en détresse ; la modification de l'article 371-4 du code civil, qui est incomplet, ambigu et source de litiges supplémentaires. À titre d'information, notre demande de modification a reçu le soutien de plus de 2 050 signataires en 45 jours. Nous sommes présents devant vous un mercredi. Si nous n'étions pas privés de nos petits-enfants, nous serions avec eux pour une journée de tendresse. L'article 371-4 du code civil pose le principe de la reconnaissance d'un droit. Mais, si ce texte a le mérite d'exister, il n'est pas appliqué. Nous constatons un manque de volonté politique dans les directives transmises aux parquets, aux gendarmeries, aux commissariats relatives au dépôt de plainte pour non présentation d'enfants - valables aussi bien pour les grands-parents que pour les parents par suite de divorce -. Pourquoi, après plusieurs années de procédure - entre deux et quatre ans -, les jugements ne sont-ils pas appliqués, sans aucune sanction pour les parents récalcitrants ? À quoi sert un procès si la justice n'est pas capable de faire respecter ses décisions ? Trop de décisions considèrent que les éléments mêmes du conflit qui oppose grands-parents et parents constituent un « motif grave » susceptible de faire obstacle au droit de l'enfant d'entretenir des relations avec ses grands-parents. Cette jurisprudence remet en cause le droit des grands-parents et vide de sa substance l'article 371-4 du code civil. On ne comprend pas très bien comment un enfant mineur peut exercer son droit d'entretenir des relations avec ses ascendants lorsqu'il n'a pas son libre arbitre et qu'il est, en outre, victime du syndrome d'aliénation parentale. Les juges ordonnent des expertises, des médiations, qui sont longues et onéreuses. Elles mettent souvent en avant les manipulations dont les enfants sont victimes de la part des parents. Mais cela ne sert à rien puisqu'ils n'en tiennent pas compte dans leur jugement. Vous trouverez, dans le dossier que nous vous remettrons, sept cas qui illustrent cette situation. La procédure actuelle est beaucoup trop longue. Ne serait-il pas judicieux d'instituer une procédure légère, rapide, sous forme de référé plutôt que la lourde assignation au fond devant le juge aux affaires familiales ? Nous souhaitons donc la modification de l'article 371-4 du code civil qui prévoit que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, sauf motifs graves. Ces motifs doivent être strictement appréciés au regard du danger que l'enfant serait susceptible d'encourir tant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, son éducation que dans le respect de son développement dû à sa personne. Cette appréciation doit porter sur la relation entretenue avec les ascendants, et non sur le conflit qui oppose grands-parents et parents, dans lequel l'enfant n'a absolument rien à voir. À défaut, le juge aux affaires familiales doit fixer des modalités de relations entre l'enfant et ses ascendants, après avoir au besoin ordonné des mesures d'investigation nécessaires, notamment par le recours à un pédopsychiatre ou à une expertise psychologique des petits-enfants, des parents et des grands-parents. M. Lionnel Luca, député des Alpes-Maritimes, a appelé l'attention du garde des Sceaux sur les difficultés d'application de l'article 371-4. La réponse de ce dernier fut pour le moins décevante. Il n'a pas pris conscience de l'importance du problème, qui se développe et touche toutes les couches de la société. Il s'est contenté de nous rappeler la rédaction actuelle du code civil et de nous conseiller d'engager une procédure sur le fondement de l'article 227-5 du code pénal qui prévoit un délit pour refus de représentation de l'enfant. Il est indispensable de réduire le fossé entre les droits affichés et la réalité. Les juges aux affaires familiales ne devraient pas se désengager du rôle dont ils sont investis de par la loi, en bottant en touche vers la médiation. Cette médiation fait naître en nous de vaines espérances et nous fait perdre une année pour rien. Le médiateur est un mandataire de justice et ne rédige pas de rapport au juge des affaires familiales. Actuellement, la médiation n'est qu'un fourre-tout dont le but premier est de désengorger les tribunaux, tout en permettant à certains médiateurs de s'enrichir sans obligation de résultats - une médiation coûte 140 euros par séance, et il en faut huit - ! Les juges doivent rester maîtres des décisions qu'ils prennent. Nous avons besoin de réponses claires et précises face à ce que nous sommes bien obligés de qualifier de laxisme. Nous n'acceptons plus l'incapacité du système judiciaire à faire respecter ses décisions, comme nous n'acceptons plus d'assister, impuissants, à la décomposition de nos familles. Nous n'acceptons plus de voir aller à vau l'eau ce que nous avons édifié et protégé tout au long de notre vie. Nous n'acceptons pas davantage cette absence totale de repères chez les jeunes, qui n'ont plus de rappel à la loi et à l'ordre. Nous pensons que les grands-parents sont bien placés pour cela, et capables de leur transmettre certains principes de stabilité sociale et émotionnelle qui les aideront à trouver leur place dans la société. La présence des grands-parents permet d'ancrer l'enfant dans ses racines. Ils sont porteurs du passé, de l'histoire de la famille et possèdent parfois la maison familiale chargée de souvenirs et de photos. Nous ne pouvons accepter, comme ce fut le cas lors d'un récent forum sur le bien-être de l'enfant, qui s'est tenu la semaine dernière à Alès, d'être traités de « jafferie » par le président du tribunal de grande instance de Tarascon ! Nous sommes 14 millions de grands-parents, 2 millions d'arrière-grands-parents. Après la séparation de ses parents, un enfant sur deux ne revoit plus l'un d'eux et toute la famille de celui-ci. M. Marcel Rufo, pédopsychiatre, pense qu'on ne quitte jamais complètement son enfance. Dans le journal télévisé de vingt heures, le 14 novembre 2005, le président Jacques Chirac a dit : « On ne viole pas la loi sans être appréhendé, poursuivi et sanctionné (...) Il faut ressouder les liens de la famille ». Or, ces citations de bon sens ne s'appliquent pas aux jugements rendus sur les cas que nous soumettons au juge. Il est indispensable et juste de porter rapidement remède à ce constat. Quel retentissement aura, sur leur vie d'adulte, l'amputation en forme d'amnésie que subissent nos petits enfants ? La décision du juge fige souvent la situation conflictuelle entre les parties et les paralyse. Nous avons le sentiment que les juges aux affaires familiales reconnaissent l'existence d'un problème mais qu'ils refusent de le résoudre. Il apparaît à beaucoup que la décision judiciaire n'est pas en mesure de résoudre pleinement le conflit familial dans lequel règnent l'affectif et l'émotionnel. Comme le fait remarquer un juge, la décision judiciaire, très souvent non appliquée, dans le cadre d'un conflit familial, ne fait ni vaincus ni vainqueurs, mais ne fait que trop souvent beaucoup de victimes parmi les enfants. Il est temps de trouver une solution. À notre avis, un seul juge aux affaires familiales ne suffit pas pour garantir un jugement objectif. Il serait peut-être nécessaire de mettre en place une instance collégiale composée de pédopsychiatres compétents, de grands-parents, de parents qui pourraient aider à une décision équitable. D'après M. Fenech, qui est un ancien magistrat et qui siège à la commission des Lois de votre Assemblée, tous les praticiens du droit savent qu'un juge peut commettre un excès de pouvoir avec les apparences de la légalité sans jamais engager sa responsabilité personnelle. La France a besoin aujourd'hui d'une véritable révolution judiciaire. Trop souvent, aux dires de nos adhérents, ces affaires familiales sont confiées à des juges inexpérimentés. Les juges devraient être sensibilisés aux conséquences dramatiques de certaines de leurs décisions, aussi bien pour les petits-enfants que pour les grands-parents. Il serait souhaitable que les travailleurs sociaux chargés des enquêtes reçoivent une formation psychologique, de façon que leurs rapports ne débouchent pas, comme c'est le cas trop souvent, sur un constat d'hyperémotivité des grands-parents, considérée comme préjudiciable pour les petits-enfants. En 2004, 120 000 personnes ont pu renouer avec leur famille grâce au regroupement familial. Mais quel est le nombre de petits-enfants qui, chaque année, peuvent renouer avec leurs grands-parents ? On ne le sait pas. Les enfants peuvent être entendus par le juge à condition qu'ils aient atteint leur maturité. Mais à quel âge ? Selon quels critères ? Je connais le cas d'un enfant de onze ans qui a été entendu par le juge sans l'assistance d'un pédopsychiatre et sans rapport psychologique. L'enfant, qui était manipulé, a raconté ce qu'on lui avait dit de raconter, et les grands-parents ont été déboutés de leur droit de visite. Lorsqu'il n'y a pas de motif grave avéré - ce qui est le cas de 98 % des dossiers - qui mettrait en danger la sécurité, la santé, la moralité et l'éducation de l'enfant, pourquoi couper les liens familiaux pendant deux, trois, quatre ou cinq ans ? Ne serait-il pas possible d'organiser des rencontres dans un endroit neutre de façon à garder le contact ? Car les grands-parents quittent des petits-enfants de cinq ans, et le fossé se creuse. Ce n'est pas acceptable. Le syndrome d'aliénation parentale constitue un réel problème, dont la France n'a pas encore pris conscience, et qui est bien mieux reconnu au Canada, dont je reviens. Il met en scène trois personnes : l'aliénant, le parent hébergeant ; l'aliéné, le parent non résident ; et les enfants aliénés, endoctrinés, pris comme otages. Nous avons eu une réunion avec Mme Mireille Lasbats, psychologue clinicienne, expert auprès de la cour d'appel de Douai. Les manifestations du syndrome d'aliénation parentale sont : le dénigrement par le parent aliénant ; la rationalisation de la dépression ; l'absence d'ambivalence de conviction, ce qui équivaut au lavage de cerveau fait par les sectes ; le phénomène d'indépendance, qui aboutit à ce que l'enfant croit être le seul à pouvoir décider de ne pas voir ses ascendants ; le soutien au parent aliénant ; l'absence de culpabilité de l'enfant ; l'extension de l'animosité envers la famille du parent aliéné. Les scénarios sont surdramatisés. En quelques mots, c'est le syndrome de Stockholm ! L'idée d'instituer des points de rencontre était très bonne. Malheureusement, les locaux utilisés sont inadaptés. Les rencontres se déroulent le mercredi et le samedi. Quatre ou cinq familles se retrouvent dans une pièce de vingt mètres carrés. Comment renouer des liens dans une telle promiscuité ? Grands-parents et petits-enfants sont confinés dans la pièce et n'ont pas le droit de sortir. Les petits-enfants ont le sentiment d'être emprisonnés et ne veulent plus y revenir. Nous avons constaté que l'Assemblée nationale luttait activement contre le sida. Un jour viendra peut-être où nous pourrons, nous aussi, voir flotter nos trois couleurs de soutien et de ralliement à notre cause : le ruban rouge pour l'amour que nous avons à donner et que nous ne pouvons pas transmettre à nos petits-enfants ; les rubans rose et bleu pour les petits-enfants. Voilà, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, ce que souhaitaient vous dire par ma bouche nos adhérents. Merci de nous avoir écoutés. Merci de réfléchir rapidement à des solutions adaptées, de façon que nos petits-enfants puissent avoir librement le choix de voir leurs ascendants et se développer normalement. (Les adhérents présents de « SOS Grands-parents en danger 83 » applaudissent.) M. le Président. J'autorise les applaudissements de manière très exceptionnelle ! (Sourires) Merci, madame, de votre intervention. J'invite nos collègues à vous poser des questions. Mme Nadine Morano : J'ai rédigé une proposition de loi pour lutter contre le syndrome d'aliénation parentale. On peut faire dire à certains enfants n'importe quoi, mais certains ne parlent pas, pour ne pas être en conflit avec leurs parents. Ceux qui ne voient pas leurs grands-parents perdent une partie de leurs racines. C'est pour eux une source de déséquilibre. Dans les cas que vous avez eu à connaître, pourquoi y a-t-il eu rupture avec les grands-parents ? Pour des raisons financières, éducatives ? Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité d'adopter une procédure de référé. D'ailleurs, si on pouvait aller plus vite dans d'autres domaines, cela arrangerait bien des choses dans notre pays. Mme Christine Miallot : Déjà, cela désengorgerait les tribunaux... Mme la Rapporteure : Vous dites qu'un certain nombre des décisions des juges aux affaires familiales ne sont pas appliquées et que les moyens qui existent sont difficiles et longs à mettre en œuvre. Avez-vous réfléchi, dans le cadre de votre association, aux modifications concrètes qu'il faudrait adopter ? La semaine dernière, nous avons discuté des conséquences de la séparation sur l'exercice de l'autorité parentale. Nous avons envisagé la création d'un délit de non respect des obligations liées au jugement de divorce. Il s'agirait de trouver une autre sanction que celle de l'incarcération en cas de non présentation d'enfant. En tant que grands-parents, vous êtes également concernés. Avez-vous réfléchi à une sanction intelligente, efficace et rapide, de manière à faire appliquer les décisions de justice ? M. le Président : Vous avez parlé à la fois de la loi et notamment de l'article 371-4 du code civil, et du rôle du juge dans l'application de la loi. D'après vous, les problèmes que vous rencontrez proviennent-ils de la loi elle-même et la façon dont elle est rédigée ou de la manière dont elle est appliquée ? Mme Christine Miallot : Mme Morano, nous avons vu sur internet les questions que vous avez posées aux différents ministères sur les points de rencontre et sur le nombre de dépôts de plainte. Vous m'avez demandé quelle était l'origine des litiges. Sur les 700 dossiers que nous gérons, le principal point d'achoppement est d'ordre financier. Cela va du voyage ou de la chirurgie esthétique qu'on n'a pas voulu payer, au fait que les grands-parents qui ne sont plus en activité ne peuvent plus aider financièrement les parents. Ensuite, il y a la jalousie. Les belles-filles sont souvent jalouses de ce qu'ont pu construire les grands-parents. Il suffit d'une parole de travers, et la sanction tombe. Les jeunes hommes et les jeunes femmes concernés ne sont pas sûrs d'eux. Ils ont peur que les grands-parents leur volent l'amour de leurs enfants. Il ne faut pas nier que certains grands-parents sont un peu possessifs, mais ce n'est pas la majorité des cas. Le fait que les jugements ne soient pas appliqués décrédibilise la justice. Mais comment peut-on imaginer appliquer la loi sans prévoir en même temps de sanctions et de contraintes ? Si les gens, sur la route, lèvent le pied, c'est parce qu'ils ont peur des radars et d'éventuelles sanctions financières. Je signale que, sur internet, on peut visiter le site de l'association « 371-4 » qui milite pour une modification de la loi et encourage les justiciables que sont nos enfants à se rebeller et à faire de la résistance passive ! Je ne pense pas qu'il soit bon d'en arriver à de pareilles extrémités. La procédure pour obtenir un droit de visite et d'hébergement peut durer cinq ans. Entre temps, l'enfant a grandi et ce droit n'est plus applicable de la même façon. Voilà pourquoi je pense que le droit de visite devrait être évolutif, en raison justement de la lenteur de la justice. Faut-il modifier la loi ? J'ai l'impression que le législateur nous a complètement oubliés. Il faudrait préciser à partir de quand l'enfant est capable d'exercer son libre arbitre. Il faudrait également définir le motif grave. Est-ce simplement le conflit entre les parents et les grands-parents ? Dans ce cas, où place-t-on les violences physiques, les attouchements et les abus sexuels ? Les juges ont beaucoup de dossiers à traiter. Ils ont facilement recours aux médiations ou aux rapports psychologiques. Cela fait perdre du temps. Il faut en effet quatre mois pour obtenir un rendez-vous avec l'expert nommé par le tribunal et trois mois pour qu'il établisse son rapport ; il en est de même de la médiation. Cela fait également perdre de l'argent. Une expertise psychologique coûte 1 500 euros ! Et tout cela pour que le juge, finalement, n'en tienne pas compte. Qu'on arrête de nous « balader » ainsi, de médiation en point de rencontre et en expertise psychologique ! Nous sommes à la veille d'un raz-de-marée. Je reçois aujourd'hui trente appels et quinze à vingt lettres par jour. Nos délégations vont passer de neuf à quinze au début de l'année prochaine. En ce moment nous travaillons pratiquement jour et nuit. Le problème est grave. Il faut modifier profondément la loi. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés par le garde des Sceaux qui estime que la loi existe et qu'elle fonctionne de manière satisfaisante. Or elle ne fonctionne pas du tout ! M. Patrick Delnatte : L'existence de familles recomposées ne vient-elle pas rendre encore plus difficile le maintien des relations entre les enfants et les grands-parents ? Mme Christine Miallot : Il y a d'abord la famille recomposée au niveau des enfants : dans certains dossiers, on compte quatre ou cinq enfants de pères différents, et toutes les grands-mères ne voient pas les petits-enfants. Il y a ensuite la famille recomposée au niveau des grands-parents : il arrive que les enfants, souvent les filles, n'acceptent pas que leur mère divorcée se remarie. Elles acceptent que leur mère voie ses petits-enfants, mais elles ne veulent pas recevoir le nouveau mari de celle-ci. Restent les familles d'accueil qui élèvent pendant des années des enfants et qui se les voient enlever. Nous recevons des familles d'accueil - parents et grands-parents - qui sont elles aussi dans le désarroi. Cela ne peut que nous inquiéter pour la société de demain. Certains grands-parents se voient interdire l'accès à l'école. Les petits-enfants se cachent derrière la maîtresse qui a reçu des instructions, mais envoient des baisers aux grands-parents ! C'est atroce, je me demande ce que nous avons fait pour être traités de la sorte ! M. Pierre-Louis Fagniez : Ce n'est pas par la loi qu'on va pouvoir régler ces problèmes. Les situations que nous évoquons sont liées à l'évolution des familles. Aujourd'hui, certains enfants ont trois ou quatre grands-mères, un grand-père, etc. La solution viendra de la société elle-même, et passe par l'éducation de l'enfant, notamment à l'école. Mme Annie Le Guyader : Il arrive très souvent que les parents soient incapables de préciser l'objet du désaccord qui les oppose aux grands-parents. On le voit au moment du rendu des études psychologiques. Ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils leur reprochent. Je pense que l'institution d'un délit de non exécution des décisions de justice serait une bonne disposition dans un premier temps. Cela nous aiderait énormément. Peut-être qu'il faut d'abord compter sur l'école, mais, avant que les choses évoluent sur ce plan, nous serons loin... M. le Président : Je remercie Mme Miallot ainsi que toutes les personnes qui l'ont accompagnée. Table ronde, ouverte à la presse, sur la place du « beau-parent » réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : La plus grande fréquence des séparations de couples ayant des enfants entraîne la multiplication des familles recomposées. En 1999, 800 000 enfants de moins de dix-huit ans vivaient avec un de leur parent et un beau-parent, et le nombre atteignait 1,1 million pour l'ensemble des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Voilà qui pose la question de la place du beau-parent, et l'attention de notre Mission a été appelée sur l'opportunité de doter celui-ci d'un statut juridique pour résoudre les problèmes rencontrés par les familles recomposées dans leur vie quotidienne. L'intérêt de l'enfant justifie-t-il de donner un statut à l'adulte qui participe à l'éducation de l'enfant de son conjoint ou de son concubin et, si oui, quel pourrait être ce statut ? Pour traiter de cette question, j'ai le plaisir d'accueillir : - M. Didier Le Gall, sociologue, professeur à l'université de Caen, qui a consacré une partie importante de ses travaux aux recompositions familiales ; - Mme Adeline Gouttenoire, professeur de droit à l'université de Grenoble II, spécialiste du droit des personnes et de la famille ; - M. Mathieu Peyceré, membre de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens dont il anime la cellule juridique, et qui vient de publier, en collaboration avec Mme Martine Gross, Fonder une famille homoparentale ; - Mme Florence Millet, maître de conférences en droit à l'université de Cergy-Pontoise où elle enseigne le droit de la famille ; - M. Stéphane Ditchev, secrétaire général de la Fédération des mouvements de la condition paternelle qui regroupe cinquante associations, et qui nous donnera donc le point de vue des pères ; - Mme Edwige Antier, pédiatre et auteur de nombreux ouvrages sur la famille. M. Didier Le Gall : Mes travaux sur les familles recomposées m'ont, dès 1987, amené à poser la question du rôle du beau-parent après un divorce ou une séparation. Mes observations sur cette question seront d'ordre anthropologique. Les familles dans lesquelles les parents qui élèvent les enfants ne sont pas leurs géniteurs sont de plus en plus nombreuses. Il peut s'agir de familles recomposées, de familles qui comptent des enfants adoptés, de familles dans lesquelles les parents ont recouru à l'assistance médicale à la procréation avec donneur, de familles homoparentales ou de familles d'accueil. La question est donc inéluctable : qu'allons-nous faire de ces parents « en plus » ? L'interrogation est redoutable car la filiation en Occident, et en France singulièrement, repose sur la notion d'exclusivité, qui fait que l'on ne peut jamais envisager d'autres parents concomitamment ou successivement. Quels que soient les cas envisagés, le droit s'attache à réaffirmer l'exclusivité de la filiation. S'agissant de l'insémination artificielle avec donneur, le géniteur est renvoyé à n'être qu'une substance. Dans le cas d'une adoption plénière, le droit fait disparaître les origines, si bien que ses parents biologiques ne sont plus rien pour l'enfant, qui change complètement de filiation. Dans le cas d'un divorce, un, voire deux rôles sociaux supplémentaires, ceux du beau-père et de la belle-mère - termes d'ailleurs impropres - peuvent apparaître, mais il ne leur est reconnu aucun droit ni statut. Pourtant, la question de la pluriparentalité se pose avec une acuité croissante. Que faire, alors, des parents « en plus » ? Peut-être faudrait-il penser les choses autrement et modifier la vision classique de ce qu'est un parent. Des travaux anthropologiques et ethnologiques montrent que l'on peut fragmenter la parentalité en cinq éléments : concevoir et mettre au monde, nourrir, éduquer, donner l'identité à la naissance, garantir l'accès à un statut d'adulte. Le fait que la parentalité peut être constituée de plusieurs éléments donne une piste pour toutes les catégories de familles précédemment évoquées. D'évidence, la société sera toujours davantage composée de familles où s'exercent ces parentés sociales. Il appartient donc aux politiques de faire bouger les choses afin que notre droit ne reste pas arrimé à la norme de l'exclusivité. En permettant l'adoption simple pour des enfants qui ont deux filiations, une telle évolution a déjà été autorisée, et il n'y a pas de raison que, dans d'autres cas, on ne puisse adjoindre de nouveaux parents. Pour autant, on doit distinguer les situations. Ainsi, pour l'insémination avec donneur, il est évident que le donneur anonyme de sperme ne revendique pas une paternité : il a contribué à la conception d'un enfant, mais il sait que c'est l'éducation de l'enfant qui fait la paternité et il ne revendique rien. En revanche, il arrive souvent qu'une femme ayant des enfants en bas âge constitue un nouveau couple. Un lien électif se tisse alors avec le beau-parent, les enfants reconnaissant cet acteur comme père nourricier ayant un rôle affectif et de socialisation qui est un rôle de suppléance, car il ne concurrence pas le père biologique. Dans ce cas, on peut reconnaître au nouveau conjoint un statut spécifique qui facilitera la vie quotidienne des familles. Mme Adeline Gouttenoire : La question du beau-parent vise l'hypothèse où il existe d'une part une relation de sang entre un adulte et un enfant, d'autre part une relation de couple entre cet adulte et une autre personne. Quelle relation de droit faudrait-il envisager pour cette personne qui prend l'enfant en charge et participe à sa vie ? Il faut en premier lieu distinguer deux situations : celle du beau-parent d'addition, troisième adulte qui s'occupe de l'enfant après que ses parents se sont séparés, et celle du beau-parent de substitution, en cas de décès puis de constitution d'un nouveau couple, ou lorsqu'il n'y a jamais eu deux parents, comme dans les couples homosexuels par exemple, notamment lorsque le beau-parent a été associé au projet parental dès son origine. Les difficultés auxquelles se heurtent les familles concernées sont de divers ordres : la prise en charge quotidienne de l'enfant et le pouvoir d'en contrôler l'éducation ; à plus long terme, la question patrimoniale, lorsque le troisième adulte souhaite transmettre ses biens à ses beaux enfants ; la prise en charge de l'enfant par le beau-parent dans l'hypothèse du décès du parent par le sang ; le devenir du lien entre le beau-parent et l'enfant qu'il a élevé en cas de séparation du couple. Avant d'envisager un statut créé de toutes pièces, il convient de considérer les moyens juridiques disponibles. Il existe en premier lieu la délégation de l'autorité parentale, qui, depuis la loi du 4 mars 2002, est envisagée comme le partage au bénéfice d'un tiers, et qui a été utilisée plusieurs fois au bénéfice d'un beau-parent vivant avec l'enfant depuis plusieurs années. Le partage de l'exercice de l'autorité parentale prévu à l'article 377-1 du code civil est toutefois sujet à interprétation, certaines juridictions considérant qu'il ne peut intervenir qu'en cas de crise. Il serait peut-être judicieux d'interpréter les textes de manière à mettre en œuvre la délégation de l'autorité parentale pour permettre une prise en charge quotidienne de l'enfant. En tout état de cause, cette délégation devrait continuer d'être soumise à l'accord des deux parents pour éviter tout conflit avec l'autre parent de sang, et le contrôle du juge devrait demeurer, pour vérifier que la délégation se fait bien dans l'intérêt de l'enfant. En cas de décès du parent légal avec lequel l'enfant vit, l'article 373-3 du code civil permet déjà au juge de confier l'enfant à une autre personne que le parent survivant, notamment si ce dernier s'est désintéressé de lui. Cette demande peut être faite soit après le décès du parent qui exerce l'autorité parentale, soit de son vivant, par exemple s'il se sait malade. Il serait possible de privilégier le beau-parent et de lui permettre de solliciter lui-même une telle décision de la part du juge, ce qui n'est pas possible actuellement. En outre, la loi ne donne aucun pouvoir réel au tiers auquel l'enfant est confié, et, lorsque ce tiers est le beau-parent, on pourrait autoriser le juge à lui conférer l'exercice de l'autorité parentale. S'agissant de la tutelle, et dans l'hypothèse où l'enfant n'a pas d'autre parent, l'article 397 du code civil permet déjà de désigner le beau-parent comme tuteur de l'enfant. Mais, en cas de décès brutal, il serait peut-être judicieux d'envisager le beau-parent comme tuteur privilégié et de permettre au juge de le désigner comme dévolutaire de la tutelle légale de préférence aux grands-parents. En cas de séparation du couple, l'article 371-4 du code civil qui donne le droit à un tiers d'obtenir un droit de visite peut être mis en œuvre au profit du beau-parent. L'application de ce droit a été élargie par la loi du 4 mars 2002, si bien qu'il suffit désormais que la relation soit conforme à l'intérêt de l'enfant, alors que, précédemment, le texte la subordonnait à l'existence de circonstances exceptionnelles. Là encore subsiste un problème d'ordre procédural, car le beau-parent ne peut solliciter lui-même le droit de visite. Il conviendrait peut-être d'élargir le champ de l'article à cette fin et, pourquoi pas, de prévoir aussi un partage de l'hébergement plus ou moins égalitaire. Une autre possibilité juridique existe : l'adoption. Le problème tient dans le fait que, sauf en cas d'adoption de l'enfant du conjoint marié, le parent de sang perd l'exercice de l'autorité parentale au profit de l'adoptant. Il conviendrait donc d'étendre le régime de l'adoption de l'enfant du conjoint à tous les beaux-parents, même non mariés. Faut-il, par ailleurs, étendre ce dispositif à l'adoption plénière ? Le juge a un entier pouvoir d'appréciation de l'opportunité de l'adoption en regard de l'intention de l'enfant, et il reste maître de ne prononcer qu'une adoption simple alors que l'adoption plénière est sollicitée. Une adoption simple est révocable, au contraire de l'adoption plénière. Or il faut prendre en compte la combinaison de la relation du couple et de la relation avec l'enfant, et se demander quel sera le sort de la relation entre le beau-parent et l'enfant si le couple se dissout. Il serait donc plus opportun de conserver la possibilité d'une révocation de l'adoption pour ne pas instaurer des liens indestructibles qui pourraient gêner l'enfant par la suite. Il conviendrait également d'instaurer un critère de durée de la vie commune - de huit à dix ans par exemple - avant de permettre l'adoption par le beau-parent, et envisager de soumettre celle-ci au consentement de l'enfant. M. Mathieu Peyceré : Ma fonction de responsable juridique de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) m'a amené à entendre des centaines de demandes d'aide juridique de parents homosexuels, mais la question concerne d'innombrables familles. Je dirai quelles sont les configurations familiales concernées, et montrerai pourquoi et par quels moyens un statut de parent social doit absolument voir le jour dans le droit de la famille, dans l'intérêt direct et indirect de l'enfant. En réalité, la seule forme de famille à n'être pas concernée par le statut de parent social est la famille dite « classique », autrement dit les parents légaux vivant sous le même toit avec leurs enfants. Or, cette configuration familiale ne représente plus qu'une moitié des familles actuelles. Pour toutes les autres se pose la question d'un statut légal de parent social. Pour plus de clarté, je désignerai par le terme de « parent social » toute personne qui se conduit comme un parent sans en avoir le statut. Un parent social peut être un beau-parent dans une famille recomposée ; il peut être un « second parent » s'il est le compagnon ou la compagne du parent légal d'un enfant qui n'a qu'une seule filiation ; il peut être également un « coparent » dans la coparentalité homoparentale. Toutes les familles dans lesquelles les parents élèvent leurs enfants en coparentalité, que celle-ci provienne d'un divorce ou d'une séparation de concubins ou qu'il s'agisse d'une coparentalité homoparentale, avec deux parents légaux et, selon les cas, zéro, un ou deux coparents, sont donc potentiellement concernées. On parlera de « beau-parent » dans les deux premiers cas, et de « coparent » dans le cas de la coparentalité homosexuelle, dans laquelle il n'y a pas eu rupture d'une conjugalité antérieure mais projet parental de deux couples. La question concerne aussi les familles monoparentales aux yeux de la loi mais biparentales dans les faits : les parents ayant adopté individuellement, les mères lesbiennes d'enfants issus d'une insémination artificielle avec donneur, les pères d'enfants issus de maternité pour autrui, dont la compagne et a fortiori le compagnon ne peuvent adopter les enfants. Dans ces cas, on désignera par « second parent » le compagnon ou la compagne du parent légal. Quel est l'intérêt de l'enfant au regard du statut de parent social ? Pour l'APGL, l'intérêt de l'enfant est triple : il doit pouvoir accéder, dans la mesure du possible, à une information sur ses origines ; il doit bénéficier d'une filiation sûre, qui ne peut pas changer au gré de la vie des adultes ; les liens qui ont été tissés avec les personnes qui l'élèvent doivent être protégés, notamment en cas de décès ou de séparation. Nous souhaitons une filiation juridique basée sur la responsabilité et un engagement irrévocable, et non plus sur la seule vraisemblance d'un acte procréatif entre parents. Nous distinguons ainsi les trois aspects : le biologique Il nous semble que l'intérêt direct et immédiat de l'enfant passe par la possibilité, pour ceux qui l'élèvent, d'exercer légalement les fonctions parentales qu'ils exercent déjà dans les faits : c'est le partage de l'autorité parentale. L'intérêt de l'enfant passe aussi par la possibilité, pour celui-ci, de conserver les liens qu'il a tissés avec ceux qui l'élèvent : c'est la possibilité de l'adoption par le parent social. Il passe enfin par la possibilité, pour l'enfant, de bénéficier sans restriction de l'héritage qu'un beau-parent voudrait lui transmettre. Le partage de l'autorité parentale est directement et indirectement dans l'intérêt de l'enfant. Il permet au parent social de prendre à l'égard de l'enfant des décisions parfois urgentes sans demander systématiquement l'autorisation du seul parent légal. Aujourd'hui, le parent social ne peut pas, par exemple, assister au conseil de classe, représenter le parent légal dans les conseils d'école, les associations de parents d'élèves. Il ne peut pas faire de démarches en son nom, comme faire refaire la carte d'identité ou un passeport ; il ne peut pas emmener librement l'enfant à l'étranger. La société lui dit chaque jour qu'il n'est pas parent et dit chaque jour à l'enfant que ce parent social n'est pas son parent. Quand il s'agit de faire des économies, les caisses d'allocations familiales reconnaissent le parent social comme un parent à part entière, mais il n'en va pas de même pour les autres actes de la vie courante de la famille. Ces situations ne sont pas saines : la loi nie la réalité, au détriment de l'enfant. Le partage de l'autorité parentale contribue à solidifier les liens familiaux. Un récent jugement en la matière, rendu à Lisieux en août dernier, y voyait « un signe fort, marque pour [l'enfant] de l'attachement que [sa mère sociale] lui porte ». Le partage de l'autorité parentale avec les parents sociaux doit en effet être conçu comme un ciment dans toutes les familles précédemment citées : il leur permet de ne plus être marginalisées et de disposer d'une structure souple et adaptée à leur réalité. Les tribunaux analysent souvent cette demande de reconnaissance du parent social comme une demande égoïste d'adulte, destinée à s'assurer une place auprès de l'enfant, alors qu'elle vise au contraire à assurer les bienfaits nécessaires de l'enfant. Elle clarifie en effet le rôle du parent social, qui n'hésite plus à prendre sa place auprès de l'enfant. Elle précise à l'enfant que le parent social est un vrai parent. Elle est source de stabilité. Elle dispense l'un des parents de devoir quémander pour obtenir la signature du « vrai » parent pour des actes usuels. Le couple parental s'en trouve renforcé, ce dont l'enfant bénéficie de manière évidente. On considère volontiers que le partage de l'autorité parentale est un avantage pour le parent social. Or c'est aussi un ensemble de devoirs qui confère à celui qui reçoit ce partage une vraie responsabilité que nos politiques rappellent régulièrement, mais qui n'est accordée aujourd'hui qu'au parent légal. Vous nous demandez s'il faut partager l'autorité parentale sans passer par un juge. C'est une idée séduisante, mais on comprend que certains s'inquiètent d'éventuels abus. Je suis d'accord avec eux sur ce point. Pourquoi ne pas limiter ce partage aux actes dit usuels ? C'est une fausse bonne idée, pour plusieurs raisons. Comme Mme Gouttenoire l'a rappelé, cette délégation partielle existe déjà, à différents titres, notamment pour aller chercher l'enfant à l'école ou l'envoyer à l'étranger... M. Pierre-Christophe Baguet : Cela n'a aucune valeur ! Mme la Rapporteure : C'est une autorisation parentale ! M. Mathieu Peyceré : C'est une forme de délégation partielle de l'autorité parentale. J'espère en tout cas que les quelques exemples que j'ai précédemment évoqués vous convaincront qu'il ne faut pas faire un statut au rabais pour le parent social. Aujourd'hui, tout le monde appelle au renforcement de l'autorité parentale. Le temps n'est donc pas venu de la parcelliser. Légiférer sur de subtiles subdivisions de cette notion conduirait à l'affaiblir. Où se situerait la frontière entre actes usuels et actes non usuels ? Pour nous, l'autorité parentale est un tout qui comporte aussi bien les actes de la vie courante que les autres. Encore une fois, ayons le courage de donner un vrai statut au parent social. Comment améliorer la situation actuelle ? Je suis d'accord avec Mme Gouttenoire sur plusieurs de ses propositions. Il faut faire cesser un mythe qui a la vie dure en France. Jusqu'à la loi du 4 mars 2002, l'autorité parentale ne pouvait être déléguée que dans des cas dramatiques, lorsque les parents ne pouvaient vraiment plus l'assumer. Une porte a été timidement entrouverte lorsqu'on a permis le partage de l'autorité parentale « lorsque les circonstances l'exigent ». Mais cela permet surtout au juge de le refuser en mettant en avant sa conception des circonstances exceptionnelles. Nous souhaitons donc que l'on ouvre le partage de l'autorité parentale à tous les couples qui en font la demande dans les conditions qu'évoquait Mme Gouttenoire. Il faut modifier l'article 377 du code civil en rendant cette demande quasi automatique, sauf lorsque le juge n'est pas assuré qu'elle sert l'intérêt de l'enfant, et supprimer la mention des circonstances exceptionnelles. Le partage de l'autorité parentale doit pouvoir s'exercer de manière pragmatique, et les parents sont suffisamment responsables pour pouvoir en juger. Il faut créer un véritable statut du parent social, lequel doit bénéficier des congés accordés aujourd'hui aux pères. On pourrait remplacer le congé de paternité par un congé coparental. Aujourd'hui, il y a une discrimination sexuelle indigne des valeurs de la France et des préceptes européens. Il faut ouvrir l'adoption plénière ou simple aux personnes non mariées. Je considère qu'il faut pouvoir y recourir très tôt dans la vie de l'enfant, sans attendre qu'il ait sept, huit ou dix ans. L'enfant qui n'a qu'une parentalité reconnue doit avoir une structure familiale claire. L'adoption plénière est un engagement irrévocable. On peut concevoir qu'on s'engage irrévocablement à être parent. Et là, ce n'est plus une question de couple, d'amour vis-à-vis de l'autre. Si on se sépare, on continue d'être parent. Il faut également autoriser le parent social à transmettre ses biens, et modifier l'article 402 du code civil pour que les grands-parents ne soient plus automatiquement les tuteurs. Enfin, il faudrait que le mariage soit autorisé aux homosexuels, ce qui résoudrait déjà plusieurs de ces questions. En conclusion, alors que la société française apparaît aux yeux de certains déstructurée, que les enfants manquent de repères, rapprocher le droit de la famille de la réalité serait un moyen peu coûteux d'insuffler du positif à des centaines de milliers de familles et de structurer l'avenir de millions d'enfants. Pour nous, cela relève de l'urgence. Mme Florence Millet : La question du statut du beau-parent consiste à se demander s'il est opportun de déduire des conséquences juridiques d'une situation de fait : celle où un adulte, parce qu'il est devenu l'époux ou bien le concubin d'un parent, est amené à tenir un rôle parental vis-à-vis d'un enfant. Pour traiter le sujet de façon exhaustive, il faudrait distinguer selon que l'enfant a ou non un lien de filiation dans les deux branches, parce que le cas où l'enfant n'aurait qu'un seul parent soulève des difficultés spécifiques. Mais puisque la question se pose le plus fréquemment à propos des familles recomposées, je me limiterai à examiner le cas de l'enfant pourvu de deux liens de filiations, l'un et l'autre incontestables. D'emblée, il faut dire que l'intérêt de l'enfant ne peut pas être la justification d'une reconnaissance d'un statut du beau-parent. Il ne peut, au mieux, que constituer une limite ou une condition posée à la reconnaissance de ce statut. L'intérêt de l'enfant s'apprécie en effet in concreto et il est impossible d'affirmer qu'il commande une solution plutôt qu'une autre. Si le statut du beau-parent devait être consacré par la loi, il faudrait de toute façon apprécier au cas par cas la compatibilité de l'attribution de ce statut avec l'intérêt particulier de l'enfant. Le recours au juge est donc inéluctable. La reconnaissance d'un statut juridique du beau-parent aboutirait donc à cette conséquence de faire émerger un contentieux, au cœur duquel se retrouverait l'enfant, ce qui ne manquera pas, on le sait, d'avoir des conséquences désastreuses. Elles le seraient d'autant plus que la démonstration de l'intérêt de l'enfant obligerait les uns et les autres à fournir des arguments destinés à emporter la conviction du juge à leur avantage. On connaît les effets que la collecte et la production de telles pièces lors d'un procès peuvent avoir sur les relations familiales, aussi bien que sur l'entourage familial. La reconnaissance d'un statut juridique du beau-parent supposerait de faire du couple nouvellement formé le fondement à partir duquel seraient déduites des conséquences juridiques concernant des enfants qui n'en sont pas issus. L'hypothèse considérée est donc celle où un couple avec un ou plusieurs enfants s'est séparé et où l'un des deux parents au moins forme un nouveau couple avec un tiers par rapport à la cellule familiale d'origine. Dans un souci de cohérence, le statut de ce tiers doit être envisagé en tenant compte des questions qui se posent en amont, c'est-à-dire à l'occasion du divorce ou de la séparation des parents, et des réponses qu'y apporte le droit positif, pour ce qui concerne l'autorité parentale. L'objectif du législateur, dans les dernières réformes du droit du divorce et de l'autorité parentale, a été d'éviter de faire de l'enfant un enjeu du divorce et de le maintenir au cœur du conflit qui se noue entre les membres du couple. En particulier, la loi a permis de traiter l'autorité parentale indépendamment du couple formé par les parents : qu'il y ait ou non mariage, et surtout que le couple reste uni ou se sépare, constituent désormais des circonstances indifférentes quant aux relations de chacun des parents avec l'enfant. Dans cette perspective, le législateur a cherché à dissocier la qualité de conjoint - ou de concubin - de celle de parent, et à protéger les liens existant entre chaque parent et l'enfant contre une conséquence d'une rupture du couple qu'ils formaient autrefois. C'est ainsi qu'en dépit de la séparation, le principe est maintenu d'un exercice en commun de l'autorité parentale. Cet exercice conjoint est donc la voie privilégiée par le droit français, non seulement parce qu'elle permet de préserver le rôle de chaque parent, mais aussi et surtout parce qu'elle a paru la plus conforme à l'intérêt de l'enfant. Or, après avoir détaché du couple formé par les parents l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants qu'ils ont conçus, il est désormais question de réintroduire une corrélation entre le niveau du couple et celui de la famille, mais à propos cette fois d'enfants qui, précisément, ne sont pas issus du couple considéré. Un tel paradoxe montre la nécessité qu'il y a de bien situer la question du statut du beau-parent dans son contexte : par hypothèse, l'enfant est doté d'un père et d'une mère, et il a vocation à continuer d'être élevé par ses deux parents. C'est en tout cas ce que favorise le droit positif. Il serait contradictoire d'adopter des mesures qui pourraient avoir pour effet de fragiliser la place du parent avec lequel le beau-parent entre en « concurrence ». Il est d'autant plus important de déjouer ce risque d'incohérence que l'angle choisi pour présenter la question est souvent trompeur : la revendication d'un statut du beau-parent est en effet justifiée par la place qu'il tient, en fait, dans l'éducation de l'enfant et par les liens d'affection qui se nouent entre eux. Mais il ne faut pas oublier que cette affection, pour les cas où elle existe en effet, procède des liens du couple recomposé. Pour cette raison, elle est non seulement ambiguë, mais encore précaire, car largement placée sous la dépendance de la destinée de ce couple. Par ailleurs, il faut se garder de tout angélisme : en amont de la recomposition familiale, il y a un divorce ou une rupture qui, en dépit des efforts de pacification, conserve le plus souvent un caractère dramatique pour les enfants et pour les membres du couple. Et la place prise par le beau-parent dans la cellule familiale recomposée n'est pas nécessairement bien ressentie par les uns et par les autres. C'est en gardant ces considérations à l'esprit que les voies suggérées pour doter le beau-parent d'un statut au sein de la famille doivent être examinées. Ces deux voies sont celles de la filiation et de l'autorité parentale. Certains arguments sont communs aux deux, ce qui est logique puisque l'autorité parentale est un effet attaché à la filiation. S'agissant de l'établissement d'un lien de filiation, il faut rappeler que, par hypothèse, il n'existe pas de liens du sang, non plus que de possession d'état. Au mieux, la filiation ne pourrait se prévaloir que d'une « vérité affective », c'est-à-dire un tractatus, mais qui serait partagée entre deux « pères » ou deux « mères » et qui serait donc équivoque. La filiation ne pourrait, de toute façon, être établie que par voie d'adoption, adoption simple ou adoption de l'enfant du conjoint. Mais, en l'état du droit positif, l'enfant doté de deux parents qui entendent continuer d'exercer l'autorité parentale n'est pas juridiquement adoptable. Il faudrait donc réformer les conditions de l'adoption simple pour la rendre possible et, surtout, faire évoluer les fonctions de l'institution, qui est encore conçue aujourd'hui pour donner une famille à un enfant qui en est dépourvu, et cela dans l'intérêt primordial de l'enfant. Une telle réforme suppose qu'en soit établie l'opportunité. Or elle est extrêmement douteuse, pour toute une série de raisons. D'abord, il serait périlleux d'asseoir trop systématiquement la filiation sur le couple formé par l'un des parents de l'enfant et un « tiers », parce que cette filiation, en principe irrévocable, subsisterait au-delà de la rupture éventuelle du couple. Elle continuerait au reste de produire tous les effets, en matière d'autorité parentale, de vocation successorale et d'obligation alimentaire. Surtout, on se retrouverait dans l'incapacité de limiter le nombre des adoptions portant sur un même enfant. En effet, puisque c'est nécessairement sur le couple que la filiation serait fondée, elle devrait pouvoir être instituée au profit de l'un comme de l'autre nouveau concubin ou époux de chaque parent. Les dispositions interdisant qu'un enfant soit adopté par plusieurs personnes, sauf par deux époux, devraient logiquement être abrogées. Si bien que l'enfant pourrait être doté de quatre parents, ce qui déjà mérite réflexion. Mais, au surplus, dans le cas d'une nouvelle rupture et de la formation d'un autre couple, on serait dans l'incapacité de refuser l'institution du lien envers, par exemple, le troisième compagnon de la mère. Si bien que c'est à une multiplication incontrôlable des liens de filiation que l'on aboutirait. Outre que la filiation n'aurait plus guère de sens, il deviendrait extrêmement difficile de faire produire leurs effets à ces différents liens, de manière concomitante. L'exercice de l'autorité parentale, en particulier, devrait être réparti entre autant de titulaires qu'il y aurait de parents et deviendrait donc impraticable. On en arrive à l'autre voie envisagée, qui consiste à n'attribuer au beau-parent que l'autorité parentale, sans le support de la filiation, ce qui peut paraître a priori légitime, dès lors que le beau-parent participe en fait à l'éducation de l'enfant. Mais la même difficulté d'une répartition de l'exercice de l'autorité parentale entre une pluralité de titulaires se poserait, qu'elle découle ou non d'un lien de filiation. En outre, il serait illusoire de compter sans les conflits qui naîtraient immanquablement entre les différents adultes, une fois mis en position de revendiquer des droits sur l'enfant. Le contentieux, que le législateur a cherché à maîtriser sur le plan des conséquences du divorce, resurgirait donc à propos du beau-parent. Il se développerait non seulement au point de départ, à propos de l'attribution de l'autorité parentale, mais aussi par la suite, et de façon récurrente, à propos de la répartition, entre leurs différents titulaires, des attributs de l'autorité parentale. Enfin, il est tout sauf évident qu'il y ait avantage à dissocier la filiation des effets pour lesquels elle est conçue et, en particulier, du plus important d'entre eux, c'est-à-dire l'autorité parentale. On risque, en privant ainsi la filiation de son objet, de la priver de toute utilité et d'en faire une coquille vide. Finalement, l'admission d'effets juridiques au profit du beau-parent n'est envisageable que dans les cas où il n'y aurait pas de concurrence dans l'exercice de l'autorité parentale : c'est-à-dire lorsque le conjoint ou compagnon du beau-parent en est le titulaire exclusif. Mais cette hypothèse reçoit déjà des solutions satisfaisantes en droit positif. Pour le reste, l'intérêt de l'enfant semble en l'état bien mieux sauvegardé qu'il ne le serait par une reconnaissance d'un statut juridique du beau-parent. D'ailleurs, l'absence de statut ne fait en aucun cas obstacle au développement des liens d'affection sur lesquels on voudrait le fonder. Et ces liens sont déjà pris en compte par la loi, qui permet au juge et dans l'intérêt de l'enfant, de fixer les modalités des relations avec un tiers, parent ou non. Aussi, que ce soit après la rupture du couple recomposé ou en cas de décès de l'un de ses parents, l'enfant peut, si son intérêt le commande, faire l'objet d'un droit de visite ou d'hébergement auprès de celui qui a, en fait, contribué à son éducation. Aller au-delà se justifierait par l'intérêt qu'y trouverait le couple recomposé bien plus que par l'intérêt de l'enfant, dont on doit éviter, autant que possible, qu'il soit un enjeu, aussi bien que le centre de conflits récurrents. Autant ne pas donner à des personnes qui seraient normalement en mesure de s'entendre l'occasion de conflits, et ce dans l'intérêt même de l'enfant. M. Stéphane Ditchev : Notre association existe depuis un peu plus de trente ans et a acquis, de ce fait, une grande expérience. Nous y recevons des parents, essentiellement des pères mais aussi des mères, qui sont confrontés à la séparation ou au divorce. Certains, plus ou moins rapidement ensuite, vivent avec quelqu'un dans une autre relation de couple. Les trois lois sur l'autorité parentale, qui ont constitué une véritable évolution, sont allées dans le sens de l'évolution de la société. Nous sommes passés, il y a une cinquantaine d'années, de la grande famille agraire du XIXème siècle à la famille nucléaire. Le réseau familial s'est réduit considérablement. Mais lorsque l'un des parents, voire les deux, revivent en couple, une sorte de grande famille se trouve donc élargie autour de l'enfant, incluant en premier lieu son père et sa mère. Le discours est différent selon que l'on parle au nom des parents ou au nom des enfants. Depuis quelques années, nous sommes gênés par le terme de « famille recomposée ». Pour les enfants, il n'existe pas de famille recomposée. Il y a « leur famille » d'origine, composée de leurs relations avec leurs parents. Ce qui n'empêche pas d'autres relations sociales avec de nombreuses autres personnes, indépendamment du fait qu'il existe ou non une législation appropriée, notamment au beau-parent. Ceux de nos adhérents qui sont concernés savent d'ailleurs faire la part des choses entre un statut légal et un statut social. Dans les faits, les beaux-parents ont la place qu'ils se construisent eux-mêmes. Pour avoir beaucoup discuté avec les membres de nos associations qui sont, pour certains, beaux-parents depuis dix ou quinze ans, nous avons constaté qu'ils ont une place particulière car ils sont présents dans la vie des enfants, mais ils doivent dans le même temps respecter la place du parent absent. On le sait, les divorces se font souvent dans un climat de forte tension, dont l'enfant est l'enjeu. Trop souvent, les pères subissent des éloignements et des déménagements qui s'apparentent à des kidnappings ; de tels faits nous sont relatés de manière réitérée. J'ai entendu le mot « concurrence » évoqué par deux fois ce jour. Nous la ressentons fortement et elle est très difficile à vivre tant pour les parents que pour les enfants. Imagine-t-on dans quelle situation psychologique se trouve un père qui, venant chercher son enfant pour exercer son droit de visite et d'hébergement, voit le nouveau compagnon de son ancienne épouse ouvrir la porte et donner des raisons, parfois bien peu probantes, pour ne pas le lui confier à lui, le père véritable ? Ce sont des moments très difficiles à vivre. J'observe que la question du statut du beau-parent est posée au moment où un enfant de parents séparés sur deux ne voit plus son père, ou si peu. Comment ne pas craindre que la concurrence s'intensifie entre le père biologique et les personnes qui seraient dotées de ce nouveau statut ? Les beaux-parents construisent une relation avec l'enfant dont ils partagent la vie. Cependant les parents biologiques ont eux-mêmes construit leur parentalité depuis la naissance de l'enfant, car elle n'est pas innée. C'est pourquoi nous avions demandé, il y a vingt ans déjà, l'instauration d'un congé de paternité, qui tendait à favoriser le phénomène d'attachement entre le père et le nourrisson. Il est difficile d'envisager une trop large pluriparentalité. À dire vrai, il me semble percevoir une confusion. L'enfant vit dans un tissu social divers, et la parentalité est représentée par une sorte de grande famille qui l'entoure, composée de beaucoup de personnes : ses enseignants par exemple, et tous ceux qui, autour de lui, n'ont pas de statut particulier. Ils construisent des liens avec lui. Pourquoi envisager une relation construite par un statut juridique ? Il serait préférable de consolider les relations parentales ; dans ce cadre seulement, le beau-parent a toute sa place qui, selon nous, n'a pas besoin d'être confortée par une loi. Mme Edwige Antier : J'exerce la pédiatrie depuis trente-cinq ans. J'ai donc vu les bébés naître, leurs parents se séparer, l'enfant vivre en résidence plus ou moins alternée, la recomposition familiale se faire chez l'un ou l'autre des parents, et j'en suis ainsi à la deuxième génération pour des milliers d'enfants. De plus, ma formation en psychopathologie m'a conduite à entendre beaucoup d'enfants seuls dans mon cabinet. Je viens donc parler aujourd'hui de ce que les enfants me confient. Faut-il renforcer la participation du parent social à l'exercice de l'autorité parentale ? La formulation de cette question suppose déjà l'emploi du terme de « parent social ». Or, pour l'enfant, il y a deux parents : son père et sa mère de naissance. Il n'a, les statistiques le montrent, connu son beau-parent qu'à l'âge de quatre ans au plus tôt et généralement vers huit ans, et je n'ai jamais entendu aucun enfant me parler de son « parent social »... Il dit « mon beau-père, ma belle-mère », ou l'appelle par son prénom. M. Stéphane Ditchev a fait allusion à la distanciation des liens avec le père après un divorce. Je compléterai son propos en soulignant qu'il est très rare que les liens persistent entre un enfant et le compagnon de la mère après une nouvelle séparation, sauf si d'autres enfants sont nés. Il se peut que des liens affectifs forts se nouent entre un enfant et un beau-parent, mais c'est très rare. Le plus souvent, l'enfant ne reconnaît pas d'autorité à cette personne qu'il considère comme une pièce rapportée. Le danger qu'il y aurait à donner un statut au beau-parent serait de le conforter dans l'idée qu'il est là pour prendre de l'autorité sur un enfant qu'il n'a pas connu petit et qui est le fruit d'une autre histoire, souvent dénigrée. L'enfant d'une première union porte une forte charge affective. De plus, il se produit souvent que le beau-père entre dans la vie de l'enfant après que celui-ci est resté seul avec sa mère pendant plusieurs années. Cette arrivée peut induire un changement radical de comportement chez l'enfant, particulièrement si l'adulte entend instaurer « son » ordre. Cela ne fonctionne pas, car le beau-parent doit d'abord apprendre à respecter l'enfant qui n'est pas le sien ; son autorité découlera naturellement de ce respect, mais elle ne se décrète pas. S'agissant de l'éventualité d'autoriser le beau-parent à accomplir les actes usuels de la vie de l'enfant sans l'intervention du juge, je n'ai jamais été empêchée de pratiquer un acte médical urgent auprès d'un enfant accompagné dans mon cabinet par son beau-père. En pratique, une autorisation de l'un des parents est toujours simple à donner. Aussi pourrait-on imaginer la signature d'un formulaire ou d'une sorte de contrat autorisant le beau-parent à accomplir les actes usuels concernant l'enfant, mais à la condition qu'il y ait sur ce point accord des deux parents. Au moment où les pères viennent d'obtenir, à juste titre, le partage des informations concernant l'école, donner au beau-père l'autorité sur les questions scolaires relatives à son enfant serait un déni du père, alors que le beau-parent prend naturellement sa place quand il s'intéresse, avec respect, au travail scolaire de l'enfant. Il faut prendre garde de ne pas priver le père de naissance de son identité. Dans les maternités, les futurs pères disent leur inquiétude, avant même la naissance du bébé, à l'idée d'en être peut-être éloignés un jour s'ils se séparent de la mère. La création d'un statut de beau-parent serait une source d'angoisse pour les pères, car elle renforce le sentiment de la précarité de leur propre statut. Donner un mandat conventionnel au beau-père sans l'autorisation du père de naissance serait très dangereux, car ce serait dénier le rôle de ce dernier, alors qu'un travail formidable a été fait pour l'impliquer davantage et lui rendre sa place après une séparation, par l'exercice de l'autorité parentale conjointe et la garde alternée, dispositifs qui commencent à porter leurs fruits. Sur un autre plan, je rappelle que le droit des grands-parents a été inscrit récemment dans la loi. Est ainsi signifiée l'importance pour un enfant de connaître sa filiation et de cultiver ses acquits transgénérationnels. Les grands-parents sont de plus en plus nombreux à revendiquer leur place et les juges s'emploient à convaincre les familles en rupture à entreprendre une médiation. Ce serait abolir ces efforts que de désigner le beau-parent comme tuteur à l'heure où tant de personnes âgées meurent isolées et où tant d'enfants manquent de racines. Mieux vaudrait informer plus largement les parents de la possibilité qu'ils ont de désigner un tuteur à leurs enfants de leur vivant que de substituer le beau-parent aux grands-parents. Convient-il d'améliorer les conditions de l'adoption de l'enfant du compagnon ? L'octroi de l'autorité parentale à des parents non biologiques bouscule la notion même de parent. Que l'on crée un statut de parrainage, complétant le PACS, pour les homosexuels élevant un enfant, répond mieux aux besoins de l'enfant - si c'est bien de cela qu'il s'agit -. La parenté est fondée sur trois ordres de filiation : la filiation biologique, qui suppose la rencontre de deux êtres de sexe différent, et que Françoise Dolto recommandait d'expliquer aux enfants comme étant « l'union sexuelle » ; la filiation affective et sociale, rôle qu'un concubin, éventuellement homosexuel, peut très bien remplir et qu'il est urgent de lui reconnaître ; enfin la filiation légale. Appeler « parent » celui qui ne peut donner les trois filiations bouleverse la construction psychique de l'enfant. C'est pourquoi il vaudrait mieux instituer le statut de « parrain » au cas où le concubin homosexuel souhaite voir reconnu son rôle auprès de l'enfant. Quant à l'adoption plénière par le concubin, pourquoi ne pas garder son sens au mariage, qui permet cette adoption ? Les enfants aiment que leurs parents soient mariés. Cette officialisation du lien qui les unit leur est toujours symboliquement précieuse, même s'ils savent que des parents mariés peuvent divorcer. Pourquoi encourager par la loi la précarisation de la famille, alors même que les fondations de la famille, si souvent rappelée à ses responsabilités aujourd'hui, doivent être clairement réaffirmées ? En conclusion, je propose que l'autorité parentale de chaque parent du couple de naissance, formant la famille biologique ou vraisemblablement biologique de l'enfant, soit affirmée ; que l'importance du respect de l'enfant par le nouveau conjoint soit dite lors d'un remariage, car c'est du respect porté à l'enfant que découle l'autorité ; que les parents sachent qu'ils peuvent déléguer leur autorité parentale, mais qu'il s'agit d'un choix clairement exprimé ou de la décision du juge au cas où l'un des parents en est déchu ; que soit créé un statut d'homo-parrainage en complément du PACS. Mme Nadine Morano : Notre table ronde d'aujourd'hui montre la nécessité de réfléchir sur les expériences de chacun, sans a priori. Je voudrais attirer l'attention sur les problèmes successoraux : si tous les membres de la famille sont d'accord, ne pourrait-on pas faciliter la transmission des biens du beau-parent aux enfants ? M. Patrick Delnatte : La situation des familles monoparentales dans lesquelles il n'y a pas de père déclaré est très difficile. À dire vrai, c'est, de toutes, la plus difficile. Or, j'ai le sentiment qu'à ce sujet, on se contente de bricoler. Ne faudrait-il pas prévoir des dispositions spécifiques pour ces situations ? M. le Président : La Mission a en effet constaté, lors de son déplacement à Londres, que le plan d'action britannique est particulièrement ciblé sur les familles monoparentales. Mme la Rapporteure : Mme Edwige Antier a proposé que l'« homo-parrainage » vienne compléter le PACS et j'ai été convaincue par ce qu'a dit Mme Florence Millet du risque de « concurrence » entre parent et beau-parent. Pourrait-on envisager un parrainage pour tous les cas où il n'existe qu'un seul lien de filiation ? M. Didier Le Gall : Que de plus en plus de parents ne soient pas les géniteurs des enfants qu'ils élèvent pose, de fait, le problème de la concurrence. Mais pourquoi cela ? Parce que les pays occidentaux n'ont pas d'expérience de la gestion de la coparentalité, sinon, précisément, celle du parrainage, filiation spirituelle qui n'est pas entérinée par le droit et qui n'ouvre aucune concurrence. La France découvre donc la coparentalité sans savoir comment la gérer, et les choses sont encore compliquées par le fait que les liens du sang sont survalorisés dans notre pays. On le voyait avec la noblesse, et l'imaginaire social le reflète également : si, dans Blanche-Neige, on parle d'une « marâtre », c'est bien parce qu'une belle-mère est d'emblée considérée comme incapable de tendresse. En France, dès qu'un autre acteur que les parents biologiques joue un rôle dans la parentalité, ce rôle est pensé en termes de concurrence. Pourtant, s'il y a des cas dramatiques, il existe aussi des cas où tout se passe très bien et pour lesquels un support social permettant de faciliter les actes de la vie quotidienne serait utile à tout le monde. On a évoqué les familles monoparentales. J'ai du mal à comprendre. En effet, le terme est impropre : ce n'est pas la famille qui est monoparentale, c'est le foyer. Les enfants ont presque toujours leurs deux parents. Certes, il peut arriver qu'ils n'aient qu'un seul parent, mais la situation est un peu différente. Dans les familles recomposées, le lien qui va se tisser avec l'enfant est fondamentalement électif. Or il faut un peu de temps pour que l'élection puisse se produire. N'imposons donc pas, d'emblée, dès la formation d'un couple, le moindre statut. Il conviendrait d'attendre deux ou trois ans. Attendre cinq ou six ans me semblerait beaucoup. En tout état de cause, autant attendre que l'enfant soit en âge de donner son avis. Cependant, pour que l'élection puisse se produire, un cadre me paraît utile. Dans un premier temps, l'élection se fait entre les deux adultes qui vivent ensemble et placent l'enfant dans un contexte où lui-même doit savoir tisser un lien quasi familial. Mais ce lien est à construire et il se construit au fil du temps. Mme Adeline Gouttenoire : Sur la concurrence, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il n'est déjà pas facile de définir l'acte usuel, et le problème deviendra encore plus compliqué si l'on rajoute aux deux parents un troisième, voire un quatrième acteur. Je ne suis pas sûre que la question du partage ou de la délégation de l'autorité parentale se pose souvent dans la réalité. Elle ne se pose en fait que lorsque le deuxième parent est absent. Si les deux parents, même séparés, prennent les décisions en commun et exercent pleinement leur autorité parentale, quel que soit d'ailleurs le mode d'hébergement choisi, le besoin de déléguer l'autorité parentale ne se fera pas sentir. Ce besoin peut néanmoins apparaître lorsqu'il y a d'autres enfants, nés d'un second lit. Dans ce cas, en effet, le beau-parent a des pouvoirs différents selon l'origine des enfants. Il serait peut être opportun de l'éviter. Un texte a d'ailleurs imposé en ce sens de fixer au même endroit la résidence de la fratrie, ce que la jurisprudence a étendu aux demi-frères et demi-sœurs. Il faut en effet réfléchir aux liens entre les enfants dans un foyer recomposé. La question se pose très différemment dans une famille monoparentale, où les besoins ne sont pas les mêmes. Le beau-parent peut alors prendre la place d'un parent de substitution. À mon sens, il faut réfléchir plus avant à lui conférer des droits. Il me semble que c'est l'adoption qui répond le mieux à ce genre de situation. C'est en effet une solution préférable à une reconnaissance de complaisance qui peut être contestée. Il y a bien une différence entre le beau-parent qui devient parent de substitution sans concurrencer un parent non gardien, et le beau-parent qui vient s'ajouter à une double parenté, ce qui pose un problème de concurrence. Mme la Rapporteure : Considérez-vous qu'en la matière on doive traiter différemment les couples de même sexe et les couples de sexe différent ? Mme Adeline Gouttenoire : J'aurais tendance à dire non. Ce qui compte, c'est le lien affectif entre l'enfant et le beau-parent, la vie commune plus que la différence de sexe dans le couple. Et je pense moi aussi qu'il faut laisser passer du temps pour vérifier que la relation entre l'enfant et l'adulte existe de manière autonome, indépendamment de la relation de couple. S'agissant des successions, je voudrais faire remarquer qu'aujourd'hui un beau-parent peut transmettre ses biens à ses beaux-enfants. Mais, s'il a lui-même des enfants, il ne peut transmettre à ses beaux-enfants que la quotité disponible. Sur le plan fiscal, néanmoins, un problème se pose, les beaux-enfants étant considérés comme des étrangers. Ne pourrait-on pas envisager que, en cas de donation ou de succession, la vie commune soit prise en compte pour réduire le taux fiscal ? Cela ne devrait pas être très difficile à régler. M. Mathieu Peyceré : Je voudrais confirmer un des propos de Mme Antier, qui a fait remarquer que les enfants adorent que leurs parents soient mariés. Nous voyons, de notre côté, le bonheur que procurent les parents à leurs enfants lorsqu'ils se « pacsent ». J'en tire la conclusion que les enfants ont besoin de situations claires. Je pense qu'il ne faut pas diaboliser la concurrence, mais qu'il faut l'organiser. Les parents s'arc-boutent d'autant moins sur un pouvoir que ce pouvoir leur est donné. Si un parent social souhaite exercer cette fonction parentale et qu'il en a les attributs reconnus par la loi, il ne passera pas son temps à démontrer qu'il a des pouvoirs. Je ne suis évidemment pas d'accord avec cette idée de parrainage. Le terme n'est pas adapté à la société actuelle, en raison de sa connotation religieuse. En outre, un parrain n'élève pas un enfant. En privilégiant une telle solution, on passerait à côté de l'essentiel qui est de donner un vrai statut au parent social, quand il le désire et quand il y a accord des parents. À quel âge faudrait-il adopter ? Dans de nombreuses situations, le couple préexiste à l'arrivée de l'enfant. Or l'enfant qui n'a qu'une filiation reconnue par la loi doit être protégé. Je suggérerai de fixer une durée de couple pour pouvoir adopter. C'est un adulte qui adopte un enfant. Si le couple a préexisté et a participé au désir et à l'arrivée de l'enfant, pourquoi ne pas protéger cet enfant dès son premier jour ? Mme Florence Millet : On a tendance à vouloir recourir un peu trop facilement à l'adoption. Il me semble important de rappeler pourquoi elle est faite. L'adoption existait en droit romain et, si elle a été oubliée dans l'intervalle, c'est parce qu'alors elle servait l'intérêt des adoptants. En la redécouvrant au XXe siècle, on a complètement modifié sa fonction, qui est maintenant de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu. On peut la faire évoluer, mais il faut être conscient des conséquences d'une telle évolution. L'adoption simple institue tout de même un lien de filiation, qui ne saurait être temporaire ou révocable. Elle ne peut être révoquée qu'en raison de circonstances graves, qui sont interprétées très rigoureusement par le juge. Il me paraîtrait contraire à l'intérêt de l'enfant de pouvoir facilement révoquer un lien de filiation et de permettre que des liens de filiation sur un même enfant puissent se succéder dans le temps. J'avais exclu, dans mon introduction, l'hypothèse des familles monoparentales, c'est-à-dire celle où un enfant n'a qu'un lien de filiation. Le droit français, aujourd'hui, apporte des solutions à cette situation. On peut recourir à l'adoption de l'enfant du conjoint, l'une des conditions étant précisément que l'enfant n'ait qu'un lien de filiation établi dans une seule branche. Il s'agit d'une adoption plénière. On peut également recourir aussi à une adoption simple, avec partage de l'autorité parentale, si le couple est marié. Ainsi, pour un couple marié, il n'y a aucun obstacle à l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et l'époux. L'obstacle existe pour le concubin. On pourrait toujours consentir à l'adoption, mais un problème de répartition de l'autorité parentale se poserait. En réalité, ce n'est pas l'état de concubinage qui est en cause, mais l'homoparentalité. Si l'on ouvrait la possibilité d'adoption aux concubins, on ne pourrait pas distinguer selon que le couple est hétérosexuel ou homosexuel. Or le mariage est le seul moyen de mettre le droit français à l'abri du grief de discrimination. La question qui se pose est bien celle de l'homoparentalité, question qu'on ne peut pas aborder par voie de conséquence, à l'occasion d'un travail sur le statut du beau-parent. Il faut réfléchir et débattre de cette question en tant que telle. M. le Président : Plutôt que d'ouvrir l'adoption aux concubins, certains considèrent qu'il serait plus simple d'ouvrir le mariage. M. Stéphane Ditchev : Nous nous sommes élevés contre l'expression de famille monoparentale, qui pose problème. Cette expression, créée en 1982 par un sociologue, était censée illustrer le phénomène de multiplication des divorces depuis une dizaine d'années. Elle était pourtant davantage justifiée cinquante ans auparavant, lorsque l'un des parents devenait veuf et élevait seul ses enfants. Le terme désigne principalement des mères seules. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'enfant qu'elles élèvent n'ait qu'un lien de filiation. Une telle expression masque l'existence du père. Par ailleurs, Mme Millet remarquait qu'une adoption était possible. Mais on a fréquemment recours, et depuis longtemps, à la reconnaissance, ce qui est encore plus simple. Il suffit qu'un autre lien de filiation ne soit pas établi par ailleurs. Mme Florence Millet : Reste qu'il s'agit d'une reconnaissance mensongère. M. Stéphane Ditchev : Mais ceci est extrêmement courant : des personnes, dont l'une a déjà un enfant, vivent ensemble depuis des années et, si elles se marient, il y a légitimation par mariage. Certes, cela ne correspond pas à la vérité biologique, mais 90 % des enfants au moins sont reconnus par leurs deux parents. La société ne devrait-elle pas faire des efforts pour les autres ? Dans notre association, nous recevons de nombreux pères, peu de mères, mais aussi de nombreux enfants. Ce sont pour la plupart des adolescents, parfois de jeunes adultes, à la recherche de leur père, qui ne les a pas reconnus, ou alors qui les a reconnus mais qui a disparu dans la séparation... Nous nous sommes également rapprochés des associations de personnes nées sous X qui recherchent leur mère et leur père. Nous recevons par ailleurs de nombreux pères homosexuels qui se sentent doublement discriminés lors d'une séparation. Mais nous nous apercevons que ce n'est pas le fait d'être homosexuel qui est source de discrimination lors d'une procédure de divorce, c'est le fait d'être père. Il serait temps que la société reconnaisse que les familles monoparentales ne sont pas si nombreuses que cela, et que, lorsqu'elles existent, c'est plutôt le vrai père, à savoir le père biologique, qu'il faudrait rechercher et que les institutions de la société devraient reconnaître en tant que père à part entière. M. Le Gall disait qu'on n'avait pas l'expérience de la coparentalité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la coparentalité ? Au début de notre association, nous parlions de parentalité, alors que le mot n'existait pas encore dans le dictionnaire. Puis, on a parlé de coparentalité, parce qu'on a voulu mettre en évidence qu'on n'est jamais un parent tout seul, qu'on est toujours un coparent. Il y a en effet toujours deux parents. En outre, les expériences de coparentalité existent. Depuis trente ans, nous avons eu à gérer les difficultés de relation parentale en cas de divorce et de séparation, notamment avec présence des beaux-parents. Nous n'avons pas mené d'études scientifiques ou sociologiques, mais nous avons beaucoup de choses à dire sur le sujet, vu notre expérience de plus de trente ans. Nous regroupons une cinquantaine d'associations en France, et nous sommes en relation avec d'autres associations à l'étranger, où les questions se posent quasiment de la même façon. Les beaux-parents viennent souvent nous voir pour leurs propres enfants et pour ceux qui ne sont pas les leurs. Si on a favorisé la mise en place des services de médiation familiale un peu partout en France, c'est bien parce que ce n'est pas le statut qui pose problème, mais la relation. Travailler sur la relation est bien plus important que donner un statut. Je crains que nos débats n'aboutissent à nier l'aspect biologique de la filiation. Or cet aspect est bien présent, sinon nous n'existerions pas. Ne le masquons pas. Mme Edwige Antier : Je vais prendre un cas que je rencontre fréquemment. Une maman arrive à mon cabinet médical, pose son bébé de quinze jours sur le lit d'examen et me dit : « Docteur, je vous préviens, il n'a pas de père ! ». Je lui réponds que ce n'est pas possible et je discute avec elle de ce qui s'est passé. Il est important de mettre tout de suite le père en scène, même s'il est absent ou défaillant. Il faut en parler et l'inscrire dans l'histoire du bébé. Cela peut même faciliter sa réapparition, dans les mois ou les années qui suivent. À partir du moment où l'on a prononcé les mots de « famille monoparentale », celle-ci est devenue une norme. Elle est maintenant mise en avant pour obtenir certains avantages sociaux, au moment des inscriptions en crèche, par exemple. Attention : les mots peuvent devenir des modèles. Je comprends qu'une juriste n'accorde pas grande importance à la biologie, s'agissant de la distinction entre filiation biologique et non biologique. Mais ce n'est pas le cas des jeunes enfants. Le petit garçon ou la petite fille de dix-huit mois qui va dans le lit de ses parents le dimanche matin pour faire un câlin apprend à trouver son identité, de fille comme maman, ou de garçon comme papa. Cette construction psychique de l'enfant sera difficile si la société commence à dire qu'il peut exister des parents de même sexe. On va me rétorquer que de nombreuses études prouvent que les enfants élevés par des adultes du même sexe vont très bien. Mais dans ces études, on mélange, d'une part, les enfants qui sont nés auparavant d'une union hétérosexuelle, qui vont régulièrement chez l'autre parent et qui savent très bien qui ils sont et, d'autre part, les enfants qui sont nés par insémination par exemple en Belgique. Il faudra à mon avis beaucoup plus de recul avant de décider que ces couples d'hommes ou de femmes pourraient devenir des « parents ». Sinon, on prend un risque. Je voudrais vous recommander le livre très clair de Mme Martine Gross, où l'on retrouve tout le vocabulaire utilisé ici. « Coparentalité » signifie qu'on fait un bébé avec un homme ou une femme en sachant d'emblée qu'ils ne vivront pas ensemble. C'est à mon avis un détournement de la famille et des lois sur la procréation. Mme Martine Gross appelle une « mère de substitution » une « mère pour autrui », mais c'est tout de même une « mère porteuse », et c'est interdit par la loi. Ce livre contient toutes les recettes pour faire des bébés. Quand il deviendra possible, par le clonage, de transmettre en plus son capital génétique, ce sera l'aboutissement ! On est en train de s'interroger sur ce que sont des parents. Mais on le fait de telle façon qu'on risque de faire éclater la notion de famille qui reste la base de la société. Que penseront les enfants et la société si on décide qu'un beau-parent peut avoir les mêmes droits d'autorité qu'un père ? Il faudrait vraiment que ce soit lié à certaines conditions bien particulières - que le père ait disparu ou qu'il ait donné cette autorité - et très restreintes. S'agissant de la reconnaissance, j'ai entendu parler de « tricherie ». Mais, pour l'enfant qui vit avec son père et sa mère ou avec la personne qui l'a reconnu, la vraisemblance est là. Tout est affaire de psychisme, et ce n'est pas la technique de sa conception qui intéresse l'enfant. Ce qu'il veut, c'est que son père et sa mère puissent procréer, vraisemblablement. Enfin, on a paru s'émouvoir que le terme de « parrain » ait une connotation religieuse. Mais il n'est pas interdit d'innover, et il me paraît d'ailleurs que nombreux sont ici les partisans du baptême civil. M. le Président : Je vous remercie. Audition ouverte à la presse de M. Olivier Abel, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : J'ai le plaisir d'accueillir M. Olivier Abel, professeur de philosophie éthique. Notre mission d'information, créée à la demande du Président de l'Assemblée nationale pour réfléchir à l'évolution de la famille, a pris le parti d'examiner l'organisation de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, pour vérifier si les droits de l'enfant sont suffisamment garantis par notre législation. Nous avons, dans ce cadre, souhaité entendre les principales confessions religieuses de notre pays, afin de recueillir leur position sur l'évolution des règles applicables au couple, à la filiation et à l'autorité parentale. M. Olivier Abel : Je pense utile de rappeler en préalable qu'il n'y a pas de magistère protestant. Ma voix n'est qu'une voix parmi d'autres et ne représente pas à elle seule le point de vue protestant. D'autre part, en régime protestant, une parole éthique ne cherche pas obligatoirement à s'imposer sous forme de loi. C'est ce qu'exprimait le doyen Jean Carbonnier en demandant au législateur de ne légiférer « qu'en tremblant ». Il faut, bien sûr, protéger les plus faibles, ce qui est la fonction de la loi, mais s'il s'agit de contrer l'imaginaire social, la convoitise ou la peur, la loi demeurera impuissante. Des questions que vous m'avez posées, la première est de savoir si les trois formes d'organisation du couple que sont le mariage, le PACS et le concubinage créent une gradation de droits et de devoirs satisfaisante. J'ai beaucoup apprécié que la question elle-même soit posée. En effet, on a trop tendance à ne pas s'attarder sur le couple au motif qu'il s'agirait d'une affaire privée relevant du consentement de deux adultes, et on s'interroge plus volontiers sur la filiation, on y réduit la famille. C'est une grave erreur. Le mariage - et donc le couple - est une affaire publique qui relie les personnes en fonction de leurs appartenances ethniques, religieuses ou autres, et dont Jean-Jacques Rousseau a dit toute l'importance dans la constitution du lien social. C'est un acte fondamental, un pacte qui tisse la société politique au lieu d'être seulement l'espace du clan. Autrement dit, c'est une très bonne idée que celle de la gradation des droits et des devoirs entre conjoints, et il ne faudrait pas inventer une sorte de mariage pour chaque clan socioculturel de France ; une institution commune est nécessaire. Le mariage a sur le concubinage et le PACS cet avantage fondamental pour le couple qu'il pense le divorce. Toutefois, on a facilité le divorce sans réfléchir suffisamment sur le droit de partir, au risque de créer une dissymétrie terrible entre le divorçant et le divorcé. Mais, bien sûr, on ne peut obliger à aimer... Tout au plus peut-on protéger des conséquences de la séparation. Alors que toute l'histoire de notre droit montre qu'il a tendu à l'émancipation, la question qui se pose maintenant est celle des attachements, et de savoir comment les protéger, les tranquilliser, les réconforter. Car si, dans les sociétés traditionnelles, le problème était de s'extraire de la servitude, le problème actuel est celui de l'exclusion. Vous me demandez aussi quelles mesures je préconise pour lutter contre les mariages forcés. À mon avis, aucune, car elles sont en nombre suffisant. De plus, il y a des mariages arrangés heureux et, de surcroît, il existe, en France, des moyens pour rompre un mariage si on le veut. Il faut, bien sûr, encourager le mariage d'amour, mais il ne se décrète ni ne se légifère. Vous demandez encore si l'intérêt de l'enfant justifie de modifier les conditions requises pour adopter. La filiation est toujours un ensemble composé à la fois de chair - qui est davantage que le biologique - et de parole, narration d'une histoire qui est plus que le seul contrat juridique. Il faut dédramatiser l'adoption, car toute filiation en comporte une part. Les généalogies bibliques et romaines ne sont-elles pas des généalogies narratives ? Il est effrayant que l'adoption soit si mal vue et considérée comme quelque chose de toujours malheureux. Il faudrait la faciliter, mais comment faire beaucoup plus ? On peut alléger certaines entraves, mais c'est l'imaginaire social qui devrait d'abord changer, ce qui n'a rien à voir avec la loi. Je déplore que l'on considère l'adoption comme un moindre mal, une thérapeutique qu'il faut toujours encadrer, et jamais comme un acte positif. S'agissant du droit de la filiation, qui fait l'objet de vos questions suivantes, la réflexion doit partir du fait que les couples sont à présent solubles, à tout le moins précaires, alors que la filiation est indissoluble, puisque si le couple est choisi, la filiation ne l'est pas. Toute société a besoin de durée. Or, la durée de la famille, qui était jadis répartie entre le couple durable et les enfants, pèse désormais entièrement sur eux. Jadis, les enfants partaient avant le conjoint ; on s'est habitué à la situation inverse. Mais à vouloir tout centrer sur l'intérêt de l'enfant, on lui donne trop d'importance, ce qui est nocif pour lui. Les questions relatives à la procréation médicalement assistée (PMA) et à la gestation pour autrui suscitent de grands débats au sein du Comité consultatif national d'éthique. Il me semble que quelques arbres cachent la forêt. Je considère par exemple qu'il ne faut pas trop élargir l'accès à la PMA car j'éprouve une grande méfiance à l'égard de l'enfant-projet. La technique est là, on a donc les moyens de faire et les moyens de se donner des projets. Mais la société se « désinstitutionalise » chaque jour davantage et, en corollaire, tout est de plus en plus représenté par des projets. C'est une idéologie de guerre, dangereuse en soi et catastrophique pour des enfants que l'on ne peut réduire à des projets. Il y a là une modification anthropologique vertigineuse dont on ne mesure pas toutes les implications. Voilà pourquoi je ne suis pas favorable, sur le fond, à un trop grand élargissement de l'accès à la PMA. De plus, il faut se méfier des intérêts économiques qui peuvent se greffer sur le désir d'enfant, intérêts tels que la gestation pour autrui pourrait devenir une nouvelle forme d'esclavage, parmi les plus atroces, et contre laquelle la loi doit être inflexible. Outre cette violence directe possible, une pression économique « douce » parce qu'indolore peut aussi apparaître : puisqu'on a les équipements, il faut les rentabiliser. C'est l'effet « autoroute », qui fait que la demande se crée ; de cela aussi il convient de se méfier. Pour ce qui est spécifiquement de l'homoparentalité, il me semble que la question est déjà réglée dans les faits : les lesbiennes l'ont déjà, les gays ne l'auront pas. Dire cela, c'est mettre en lumière le vrai problème, qui est la réduction de la filiation au lien entre la mère et son enfant. Peut-être n'est-ce que transitoire, mais j'ai le sentiment qu'en accordant le droit d'adopter aux femmes seules, on a lâché trop vite, sans débat, quelque chose de très grave, dont on a ainsi accepté la généralisation. À titre personnel, je préfèrerais que des enfants soient élevés par des parents gays plutôt que par une femme seule. Le droit de l'enfant à connaître ses origines personnelles est-il suffisamment garanti par notre législation ? Le Conseil consultatif national d'éthique, s'étant longuement penché sur cette question, est d'avis que l'on peut procéder à des améliorations marginales, mais ne voit pas qu'il y ait là des injustices de fond nécessitant une réforme. Ce qui est grave dans la recherche des origines personnelles, c'est leur « biologisation », qui n'est qu'un palliatif à l'« affaissement de l'identité narrative » souligné par Paul Ricoeur. Faut-il faire évoluer notre législation pour améliorer l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ? On constate de plus en plus fréquemment sinon un déni de paternité, du moins une paternité en déshérence. On s'interroge pour savoir où sont passés les hommes, jugés puérils, fragiles et, pour tout dire, inadaptés, au point qu'il conviendrait de réécrire Michelet à l'envers - Michelet qui soulignait le retard des femmes par rapport aux hommes -. Mais les femmes ne savent plus comment vouloir un homme. Comment avoir un père pour son enfant si l'on n'a pas voulu d'époux ? On en revient à la nécessité de considérer la famille comme un tout, sans en séparer les éléments. Or, la figure de l'époux est une figure effondrée et, s'il n'y a pas de conjoint, il ne peut y avoir de père pour l'enfant. Renforcer la parentalité suppose donc que l'on renforce la conjugalité - ce qui n'est pas si facile à traduire dans les textes -. Il ne sera pas plus facile de légiférer à propos du statut du beau-parent, car il y a de grandes différences selon l'âge de l'enfant, d'autant plus prêt à une recomposition familiale qu'il est très jeune. Dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que si les recompositions conjugales sont en principe choisies par le couple, elles ne se traduisent pas par un lien électif pour l'enfant du conjoint. C'est pourquoi il ne saurait être question de demander son consentement à l'enfant ; la recomposition est de fait, « c'est comme ça ». Cela n'empêche pas l'enfant de nouer un lien avec le « beau-parent », qui est beaucoup plus soumis à une histoire que ne l'est le lien avec le parent. M. René Galy-Dejean : Même si vous avez parlé en votre nom propre, quelques lignes majoritaires ne se dégagent-elles pas au sein du protestantisme français à propos des questions que vous avez abordées ? N'y a-t-il réellement que des positionnements individuels ? M. Olivier Abel : La liberté de pensée est réelle mais elle est réglée, car il s'agit d'interpréter des textes communs. Lorsque j'ai dit préférer que des enfants soient élevés par des parents gays plutôt que par des femmes seules, mes propos ne représentaient pas le mouvement protestant et beaucoup ne seraient certainement pas d'accord. En revanche, je puis dire avec certitude que les protestants accordent beaucoup d'importance au mariage civil et que penser le mariage, c'est aussi pour eux bien penser le divorce. On pense toujours le consensus, et jamais la dispute. Pourtant, mariage et divorce sont et doivent être liés. Pour ce qui est de l'adoption, j'ai insisté sur le fait que toute filiation est un mélange de chair et de parole ; c'est là une conception toute protestante. Je ne dis pas que tout est culturel, mais que le naturel n'est pas seulement charnel. La méfiance que j'ai exprimée à propos d'une filiation réduite au seul lien mère-enfant et l'importance accordée au couple sont aussi des conceptions protestantes. La figure de l'époux est une figure biblique, à laquelle la Réforme a accordé une importance particulière ; c'est celle de l'alliance plus que celle de la généalogie. M. René Galy-Dejean : J'ai été très attentif à vos propos sur ce point. Est-il juste d'en déduire que vous interprétez le couple comme l'union d'un homme et d'une femme ? M. Olivier Abel : Oui, mais ce n'est pas quelque chose de donné par une loi naturelle, c'est une interprétation permanente. M. Pierre-Louis Fagniez : Vous considérez qu'il faut protéger le mariage civil. Quelles modifications législatives seraient alors souhaitables pour le renforcer ? Vous avez dit regretter l'élargissement de la PMA ; en quoi vous a-t-il choqué ? Enfin, souhaitez-vous que le législateur revienne sur l'adoption par les femmes seules ? Mme Annick Lepetit : Vous avez exprimé votre méfiance à l'égard de l'importance accordée à la relation mère-enfant et dit préférer que les enfants soient élevés par des parents gays plutôt que par une mère seule. Faut-il entendre par là que l'enfant doit avoir un référent masculin ? Vous avez évacué la question du mariage forcé en disant qu'il fallait encourager le mariage d'amour, que l'on ne peut légiférer sur une telle question et que les outils juridiques existants suffisent pour rompre ces mariages. Les élus que nous sommes savent pourtant que des mariages forcés ont lieu sur le territoire français, et que les choses ne sont pas aussi faciles que cela. Enfin, il a été très intéressant de vous entendre dire qu'il faut expliquer aux enfants qu'ils ne peuvent choisir le conjoint de leur parent. Mme Martine Aurillac : L'éclairage que vous avez donné aux questions qui nous préoccupent est inhabituel et d'un grand intérêt. Je me retrouve parfaitement dans les propos que vous avez tenus sur l'importance du mariage civil et de la filiation narrative ainsi que dans la méfiance que vous avez exprimée à l'égard de l'« enfant projet ». Comme l'a indiqué notre collègue Fagniez, nous souhaitons améliorer par la loi ce qui peut l'être, qu'il s'agisse du mariage forcé, réalité sur laquelle on peut agir en renforçant les dispositions relatives au vice de consentement, ou de l'adoption. Même si la solution passe par une évolution des mentalités, ne pourrait-on pas procéder par une modification du droit sur des points précis ? M. Patrick Delnatte : Quelle est la position des protestants sur le mariage des couples de même sexe ? Mme la Rapporteure : Vous avez parlé de conforter le couple, question qui n'a été que peu abordée devant nous jusqu'à présent, car le couple est considéré comme une affaire privée. Toutefois, notre Mission se préoccupe de la fragilisation des unions et de ses conséquences sur la filiation. Quelles mesures permettraient, selon vous, de promouvoir le mariage ? Pensez-vous par ailleurs souhaitable de renforcer les dispositions du PACS relatives à la solidarité entre les partenaires, ou y êtes-vous opposé parce que vous considérez que ce serait aligner le PACS sur le mariage ? S'agissant du statut du beau-parent, vous semblez ne vous référer qu'à la situation dans laquelle l'enfant a deux parents biologiques. Mais lorsqu'il n'en a qu'un, le beau-parent devient une figure d'attachement possible ; ne peut-on, dans ce cas, faire quelque chose ? M. le Président : Quel sens donnez-vous au concept d'altérité, qui fonde souvent la position sur l'ouverture ou le refus de l'ouverture du mariage à des personnes de même sexe ? M. Olivier Abel : Manifestement, une intense réflexion a déjà eu lieu sur ces questions au sein de votre Mission, et vous avez une expérience de cas concrets que je n'ai aucunement. Je considère le mariage occidental comme l'un des plus forts moyens de pénétration du monde, davantage encore que l'armée et le commerce. Le mythe occidental de l'amour a une très grande force, mais il a aussi une très grande violence. Il existe, bien sûr, des mariages forcés, accomplis dans la violence, parfois avec séquestration et, dans ce cas, le droit doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Mais il ne faut pas confondre ces mariages-là avec les mariages arrangés, envers lesquels je suis moins sévère, même si je suis, vous l'avez entendu, un enthousiaste du mariage d'amour. Pour ce qui est du mariage homosexuel, les protestants, quelques minorités exceptées, sont très réservés. Le débat a été évacué par peur d'un éclatement de l'Église ; c'était à juste titre, car la question est très brutale. Le PACS n'est pas la bonne solution, car les homosexuels qui réclament le mariage demandent un vrai engagement et une véritable institution. Répondre à ces demandes par un contrat que l'on peut rompre très facilement n'est pas la bonne réponse. Le mariage offre un cadre juridique aux enfants issus du couple. Cela étant, il existe aussi des couples heureux sans enfant et l'on ne peut asservir le couple à la filiation. Il y a donc autonomie de la conjugalité et de la filiation. Mais, s'agissant de la parentalité, il est très important qu'il y ait un homme et une femme. Il se trouve aussi que, lorsque l'on est deux, l'enfant est moins un projet que pour une personne seule, pour laquelle il s'agit davantage d'un prolongement de soi. Lorsque j'ai dit préférer qu'un enfant soit élevé par des parents gays plutôt que par une mère seule, c'était une sorte de provocation, mais il faut reconstruire une hiérarchie, réintégrer du narratif dans l'identité des enfants et, pour cela, il faut au moins deux points de vue, sinon davantage - par exemple celui des grands-parents -. Cela dit, je n'ai pas la moindre idée de la manière selon laquelle il faudrait procéder pour renforcer le couple. S'agissant enfin de la PMA, je dis simplement que je n'aimerais pas qu'elle se généralise. Mais je ne suis pas très inquiet, car je suis certain que, dans un siècle ou deux, les enfants continueront de naître d'un homme et d'une femme. Il n'y a donc pas lieu de paniquer... M. le Président : Je vous remercie vivement et je pense traduire le sentiment général de la Mission en vous disant que votre contribution à nos travaux a été particulièrement intéressante. Audition ouverte à la presse de M. Joseph Sitruk, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : J'ai l'honneur d'accueillir M. Joseph Sitruk, Grand Rabbin de France et président de la Conférence rabbinique européenne. Notre Mission d'information, créée à la demande du Président de l'Assemblée nationale pour réfléchir à l'évolution de la famille, a pris le parti d'examiner l'organisation de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, pour vérifier si les droits de l'enfant sont suffisamment garantis par notre législation. Nous avons, dans ce cadre, souhaité recueillir la position des principales confessions religieuses de notre pays sur l'évolution des règles applicables au couple, à la filiation et à l'autorité parentale. M. Joseph Sitruk : Je vous remercie de prendre, au nom de la France, le temps de réfléchir sur la famille, car sans elle nous n'existerions pas. Pour moi, la famille est la cellule de base de la société, et toutes les autres structures sociales, aussi nobles soient-elles, lui sont subalternes. Cette cellule est féconde et donc obligatoirement hétérosexuelle, cela va de soi. Elle a aussi pour rôle la transmission des valeurs. Quelles sont ses fonctions ? C'est d'abord un lieu de protection, mais elle a aussi vocation à construire l'individu. Elle doit donc réunir les conditions de l'épanouissement et du bonheur. C'est, me direz-vous, la description utopiste de la famille idéale. Mais ne faut-il pas, d'abord, regarder le ciel ? Tout législateur doit, avant de légiférer, s'interroger sur le type de société qu'il souhaite construire. Je saisis l'occasion qui m'est donnée pour souligner qu'il y a un siècle, la loi de séparation des Églises et de l'État a fort heureusement permis à chacun d'être croyant ou non-croyant. La loi de 1905 fut, à ce titre, une grande avancée pour les juifs de France ; il ne faudrait pas remettre en cause cet acquis. Cette parenthèse étant fermée, j'en reviens à la famille pour souligner à nouveau qu'elle doit être le lieu de transmission de valeurs, car si cette transmission ne se fait plus, la société se désagrégera. Les dérives actuelles ne sont d'ailleurs que la conséquence de notre imprévoyance. Il ne faudrait pas concevoir la société comme une malade en réanimation qui a besoin de soins d'urgence, car l'urgence ne permet pas de résoudre durablement les problèmes. Recul et réflexion sont toujours nécessaires. C'est donc à juste titre que votre Mission inscrit ses travaux dans le cadre des droits de l'enfant. La naissance d'un enfant est un grand bonheur, mais elle crée des devoirs à chaque membre de la famille, et les enfants eux-mêmes doivent comprendre qu'ils sont soumis à des contraintes ; d'ailleurs, les pédopsychiatres soulignent fréquemment que les enfants sont sécurisés par l'exercice de l'autorité parentale. Pour autant, la famille ne doit pas être le lieu où l'on juge un enfant, mais celui où on l'aime pour ce qu'il est. Il revient aux parents de donner à l'enfant confiance en lui-même, car ses capacités futures en dépendent. Une famille réussie suppose du temps, de l'attention et une écoute réciproque. Ainsi, c'est grâce au soutien constant de mon épouse et de mes enfants que je continue de me remettre progressivement du très grave accident qui aurait dû me coûter la vie si le Créateur n'en avait décidé autrement. La famille, c'est le lieu de l'amour désintéressé, mais c'est aussi celui de l'éducation. Or, la société est malade de l'abdication des familles. Voilà pourquoi ma mission quotidienne est de veiller à l'harmonie des couples. À cet égard, il me semble que la France manque de conseillers conjugaux, car souvent le regard d'un tiers suffit à dénouer des crises. Si j'ai un titre de fierté, c'est celui d'avoir réconcilié d'innombrables couples qui s'apprêtaient à encombrer les tribunaux. Le nombre de divorces ne cessant d'augmenter dans la communauté juive comme ailleurs, mon épouse et moi-même avons multiplié les formations au conseil conjugal, et nous remettons des diplômes qui sanctionnent cet enseignement, lequel comprend un volet religieux. Je suis convaincu que, si le nombre de divorces diminuait, beaucoup des questions que vous nous avez posées tomberaient d'elles-mêmes. L'éducation, pour moi, c'est la réponse que m'a faite mon père le jour où je lui ai annoncé mon intention de devenir rabbin alors qu'il me voyait ingénieur : « Fais bien ce que tu fais », m'avait-il dit. J'en viens aux questions que vous m'avez posées. La première tend à déterminer si les trois formes d'organisation du couple que sont le mariage, le PACS et le concubinage créent une gradation de droits et de devoirs satisfaisante. Pour moi, la famille que j'appelle « légitime », c'est-à-dire issue du mariage, est la seule manière de concevoir utilement l'avenir. Le mariage est la base de la responsabilité. Dans le village de Haute-Provence où je passe mes vacances en été, les adultes ne sont, pour la plupart, pas mariés. Lorsque je les interroge sur les raisons de ce choix, ils me répondent : « On ne sait jamais, on ne veut pas s'engager ». Quelle angoisse intime ce refus de l'engagement traduit-il ? Pour moi, le concubinage ne peut être envisagé que dans une dimension de responsabilité. Autrement dit, les enfants qui naissent de cette union n'ont pas à être pénalisés, ils doivent avoir les mêmes droits et les mêmes chances de réussite que les autres enfants. Le législateur a donc bien fait de leur donner un statut. Le contrat fait défaut entre les parents, mais ce n'est pas tant la structure qui compte que l'esprit. Quant au PACS, je sais qu'il a été créé notamment pour répondre aux besoins des couples homosexuels, mais je suis farouchement opposé à l'homosexualité. Je n'ai aucun mépris pour quiconque, et j'ai souvent aidé des gens qui avaient cette conception de la vie, leur montrant en quoi c'est une erreur réductrice que d'avoir auprès de soi un être identique à soi. Le fait que la réussite d'un couple constitué d'un homme et d'une femme soit hasardeuse n'est pas une raison pour renoncer. Vous m'interrogez par ailleurs sur les mesures propres à lutter contre les mariages forcés. Ils sont scandaleux et inacceptables, mais je n'ai guère d'idée à vous donner à ce sujet, si ce n'est qu'il conviendrait au moins de donner la possibilité aux victimes d'avoir un interlocuteur qui les écouterait et leur viendrait en aide ; peut-être faudrait-il augmenter le nombre de centres d'accueil. L'intérêt de l'enfant justifie-t-il de modifier les conditions requises pour adopter ? Je n'ignore pas qu'il existe deux types d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière, la seconde concernant les enfants abandonnés. Les procédures s'apparentant au parcours du combattant, il serait souhaitable d'assouplir les conditions d'adoption des enfants abandonnés. En revanche, il n'est pas souhaitable de modifier le droit de la filiation, car les dérives sont déjà tellement nombreuses qu'il ne convient pas de les multiplier. Faut-il faciliter à la procréation médicalement assistée ? Oui, car la souffrance des couples sans enfant est terrible. Même si l'on peut leur expliquer que la finalité de l'homme et de la femme n'est pas seulement d'être père et mère, mais d'abord d'être homme et femme, ils perçoivent leur situation comme un échec. J'ai vu aussi à d'innombrables reprises le bonheur qu'avait procuré à des couples la possibilité d'avoir un enfant grâce à la procréation médicalement assistée. S'agissant de la gestation pour autrui, je serai un peu plus réticent. Je crois que nous n'avons pas assez de recul. Il ne s'agit pas uniquement de procréer, l'homme et la femme n'étant pas des machines à faire des enfants. Il faut se demander, avant de faire un enfant, si on a réuni toutes les conditions nécessaires pour l'accueillir. On ne peut pas répondre à la question de la gestation pour autrui sans faire entrer en ligne de compte d'autres considérations. En ce qui concerne le droit de l'enfant à connaître ses origines personnelles, je dirai qu'il est légitime de permettre à un enfant, une fois arrivé à l'âge adulte, de rechercher ses parents biologiques. Je souhaiterais que le législateur entende la souffrance des enfants à la recherche de leur identité. Faut-il faire évoluer notre législation pour améliorer l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ? Il me semble qu'il faut tout faire pour favoriser le dialogue entre les parents et éviter les rapports de force. L'essentiel est de préserver l'intérêt de l'enfant. Lorsque je tente de dissuader les couples de divorcer, je mets toujours en avant le fait qu'un enfant est rarement heureux du divorce de ses parents. Sur le plan théologique, le divorce n'est pas inconcevable aux yeux du judaïsme, mais il reste qu'il constitue un échec. Il faut tout faire pour le limiter. Quand on ne peut l'empêcher, il convient de faire en sorte que l'enfant ne soit pas la première victime de cette séparation. L'intérêt de l'enfant justifie-t-il de donner un statut à l'adulte qui participe à l'éducation de l'enfant de son conjoint ou de son concubin ? D'après ce que je crois, la loi ignore les liens qui peuvent se tisser entre un enfant et la tierce personne qui l'élève au quotidien. C'est une erreur. Il n'y a pas que les liens du sang, il y a les liens du cœur. Il me semble qu'il faut en tenir compte. Une reconnaissance de cette tierce personne me paraît souhaitable. Dans notre tradition religieuse, lorsqu'une personne est malade, une prière est dite, qui mentionne le nom de la personne concernée et celui de ses parents : Untel, fils d'Untel. Dernièrement, une jeune femme atteinte d'une grave maladie m'a demandé d'élever une prière pour elle. Je lui ai demandé le nom de ses parents. Elle a refusé qu'ils soient mentionnés dans la prière, parce qu'ils l'avaient abandonnée. Elle a demandé à être désignée comme la fille de la personne qui l'avait élevée. J'ai trouvé ce cri du cœur très significatif. J'ai mesuré à cette occasion quelle pouvait être la force des liens entre une personne et celle qui l'a élevée. M. Pierre-Louis Fagniez : En vous écoutant, monsieur le Grand Rabbin, j'ai eu le sentiment que votre discours illustrait le fait que le judaïsme est une religion de la vie. C'est ce qui peut expliquer que vous êtes contre le mariage homosexuel, que vous n'êtes pas hostile, au contraire, à la procréation médicalement assistée, et que vous avez même une certaine indulgence pour les mères porteuses, puisque vous n'avez pas dit que la gestation pour autrui devait être bannie. Finalement, c'est la loi de la vie qui veut que la famille occupe une place centrale. Vous nous avez dit que la famille est aujourd'hui malade de son manque d'autorité, comme l'est la civilisation. Je voudrais que vous me confirmiez que la vie est bien le fil directeur de la religion juive. M. Joseph Sitruk : Je vous félicite, monsieur le député. Ma réponse est oui. Mme la Rapporteure : Comment voyez-vous, monsieur le Grand Rabbin, le rôle des grands-parents ? Pensez-vous qu'il vaut mieux conforter le rôle des parents en cas de conflit ou que les grands-parents doivent voir leur rôle réaffirmé ? M. Joseph Sitruk : Cette question est importante. Je pense que le rôle des grands-parents peut être néfaste à un seul niveau, celui des couples. Lorsqu'un couple est en formation, il est bon que les grands-parents se retirent sur la pointe des pieds. Par contre, le rôle qu'ils jouent dans l'éducation de leurs petits-enfants me paraît fondamental pour l'équilibre de ceux-ci. C'est d'ailleurs un thème majeur de la tradition juive, qui parle toujours de trois générations : ton grand-père, ton père et toi. La chaîne est vraiment une chaîne quand elle relie ces trois maillons. La place des grands-parents peut-elle être contradictoire avec celle des parents ? Il faudrait peut-être en discuter plus longuement. Mais en tout cas, minimiser leur rôle me paraît être une erreur. M. le Président : Monsieur le Grand Rabbin, nous arrivons au terme de cette audition. Vous nous avez promis, s'il nous restait du temps, ce qui est le cas, une belle histoire. M. Joseph Sitruk : Cette histoire est un texte talmudique écrit il y a dix-huit siècles. Avant de mourir, un homme laissa en héritage à ses deux fils son unique champ, en leur demandant de partager également la récolte. C'est ce qu'ils firent très soigneusement. Chaque année, au moment où les gerbes de blé venaient à maturation, ils faisaient deux tas rigoureusement égaux pour chacun d'eux. Une année, après avoir procédé au partage habituel, l'un des deux frères eut du mal à s'endormir : il n'est pas juste que nous partagions la récolte, car mon frère a de nombreux enfants alors que je n'en ai pas, il a plus de bouches à nourrir que moi. En pleine nuit, il se lève, enlève des gerbes appartenant à son tas et les pose sur celui de son frère. La même nuit, son frère a aussi une insomnie : il n'est pas juste que nous partagions la récolte, car moi, j'ai des enfants qui subviendront à mes besoins durant ma vieillesse, tandis que mon frère, qui n'en a pas, sera seul, il a besoin de thésauriser. Il se lève donc, un peu plus tard que son frère, enlève des gerbes appartenant à son tas et les pose sur celui de son frère. Le lendemain matin, ils constatent que les deux tas n'ont pas changé. Ils ne comprennent pas, mais ne disent rien. La nuit suivante, les deux frères ont la même insomnie. Le premier se lève et procède au même transfert de son tas à celui de son frère. Le second fait de même un peu plus tard. Le lendemain, les deux tas sont identiques. Même incompréhension et même silence. La troisième nuit, ils se sont levés à la même heure, se sont croisés entre les deux tas avec chacun une gerbe à la main, et tous deux ont compris. Ils ont posé leurs gerbes par terre, sont tombés dans les bras l'un de l'autre, et ont pleuré. Là où leurs larmes sont tombées, Dieu a décidé de créer la ville de Jérusalem, qui est en effet, étymologiquement, la ville de la fraternité. Cette belle histoire a évidemment beaucoup d'incidences politiques. Elle nous rappelle que Jérusalem est appelée, comme le disent si bien les prophètes, à devenir un jour, non pas une ville internationale comme voudrait le faire l'ONU, mais une ville dont le monde entier peut s'inspirer pour aller à la recherche de la fraternité. C'est une noble et difficile entreprise. Quand je me rends dans cette ville, je suis toujours très ému d'entendre les églises faire tinter leurs cloches, le muezzin appeler à la prière au crépuscule et les juifs murmurer leur prière le long du Mur. Cette gerbe de prières communes me fait toujours penser à cette belle histoire. Peut-être qu'une famille, c'est aussi cela. Il faut apprendre aux enfants à vivre ensemble alors qu'ils sont tous très différents. M. le Président : Merci, monsieur le Grand Rabbin, pour cette histoire que nous nous permettrons de transmettre à nos collègues de la commission des Affaires étrangères, tant il est vrai qu'elle a une portée très actuelle. Je vous remercie d'avoir apporté votre éclairage sur les questions qui occupent notre réflexion. Audition ouverte à la presse de M. Dalil Boubakeur, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Mes chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir à présent M. Dalil Boubakeur, président du Conseil français du culte musulman et Recteur de la mosquée de Paris. J'évoquais avec lui, avant le début de cette audition, le fait que nous fêtions cette année le centenaire de la loi de séparation des Églises et de l'État. C'est être fidèle à l'esprit même de cette loi que d'écouter les représentants des Églises. Notre Mission d'information, constituée à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, travaille depuis maintenant un an sur les questions ayant trait à la famille et aux droits des enfants. Nous avons abordé différents sujets, qu'il s'agisse du couple, de la filiation ou de l'autorité parentale. Sur tous ces thèmes, nous avons voulu recueillir la position des principales confessions religieuses, ainsi que leurs suggestions éventuelles. À ce titre, votre parole, tant écoutée dans notre pays, monsieur le Président, est une parole que nous tenions beaucoup à entendre. M. Dalil Boubakeur : C'est pour moi un honneur d'être accueilli dans cette enceinte et d'être invité à tenter de présenter le point de vue qui est celui de la tradition à laquelle j'appartiens, celle de l'islam de France, sur les questions concernant la famille. Tout d'abord, de quel islam parle-t-on ? Il existe un islam libéral et moderniste, celui dans lequel se reconnaît l'islam de France. Cet islam fait siens tous les acquis de notre pays en matière de droits de l'homme, de droits de la femme, de droits de l'enfant, dans la continuité des droits de l'homme issus de 1789. Cet islam là n'est pas seulement présent en France, et il tend à gagner les administrations et les gouvernements des pays musulmans. En France, bien entendu, le droit français est notre droit, la loi du pays est notre loi. C'est l'objectif affirmé de l'intégration des musulmans de France, qui sont d'abord des Français avant d'appartenir à la tradition religieuse qui est la leur. Mais il existe également en France une vision plus radicale de l'islam, qui se réfère à la charia stricte. Je rappelle que le droit musulman est complexe. Il a pour fondement le Coran, la tradition - c'est-à-dire les faits et gestes, ainsi que les dires du Prophète - et enfin les écoles juridiques. C'est dire que la vie musulmane, dans cette vision, est enserrée dans un maillage de lois et de droits, que certains veulent privilégier. Nous ne souhaitons pas voir se développer en France cet islam, qui a un objectif communautariste. Certains pays voisins de la France acceptent cette vision communautariste de l'islam que nous récusons absolument. Pour ce qui est de la famille, ces tendances communautaristes se traduisent par la polygamie, les mariages forcés, le maintien de la tradition de répudiation, la femme au foyer, la femme voilée. À cet égard, j'insiste sur le fait que le voile est indiscutablement le reflet de cette vision plus radicale de l'islam en matière sociale, civile, familiale, sociétale. Une dernière forme contestable de cette tendance est constituée par les traditions préislamiques que l'islam a acceptées et qui lui sont abusivement rattachées. C'est le cas de l'infibulation, de l'excision, d'autres mutilations encore. C'est également le cas de la lapidation, de la coutume de couper les mains d'un voleur. Toutes ces traditions contraires aux droits de l'homme doivent évidemment être récusées. Notre droit est fondé sur la laïcité, qui est l'aboutissement d'une vision moderne de l'organisation sociale des hommes. Cette vision est fondée sur la raison. Or, les religions, et notamment l'islam, sont en phase de rationalisation. Malheureusement, tous les aspects de l'islam ne sont pas du ressort de la rationalité, mais restent dans le domaine de la révélation, des traditions, et relèvent d'une vision sémitique primitive de la religion. La laïcité nous impose de considérer le droit français comme insupérable : rien ne lui est supérieur. La nation et elle seule fixe les droits et les devoirs. Au-delà du droit français, il y a les conventions internationales, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par la France en 1990. Si la religion a fondé les droits de l'homme, au sens du membre masculin de la famille, les droits des femmes n'apparaissent qu'en filigrane. L'islam a supprimé les sacrifices et les mises en terre des filles, et bien d'autres traditions préislamiques et polythéistes. La femme a acquis un certain nombre de droits, et son rôle dans la famille a été spécifié. Quant à l'enfant, il a surtout, dans le Coran, le devoir de respecter ses parents. Les parents ont envers lui le devoir d'assurer son éducation, de le veiller, et surtout de veiller à sa formation religieuse. Mis à part ces préceptes, la tradition musulmane se contente d'insister sur la cellule familiale. La famille représente une espèce de petite société familiale, où chaque participant - le père, la mère, les enfants, les collatéraux, les grands-parents - ont des devoirs bien précis. Quels sont les problèmes que nous rencontrons en France, dans les lieux de culte, et notamment à la mosquée de Paris ? Ce sont d'abord des problèmes liés au mariage. Le mariage civil, et nous suivons en cela le droit français, doit absolument précéder le mariage religieux, lorsque l'un des deux conjoints est de citoyenneté française. Lorsque l'homme est musulman, il peut épouser une femme de confession chrétienne ou juive, sans même l'obliger à se convertir, à condition, dit le Coran, que la femme soit croyante. L'inverse pose des problèmes. Lorsqu'une femme musulmane désire épouser un homme d'une autre religion, en particulier juive ou chrétienne, la tradition musulmane souhaite que ce conjoint se convertisse à l'islam, d'où les nombreux cas de conversion que nous enregistrons en France. Qu'en est-il des parents ? Le principe de l'islam est celui de la patrilinéarité. La religion de l'enfant, son nom, son éducation et les frais qui lui sont liés, sont du ressort du père. Les enfants ont les mêmes droits en ce qui concerne l'éducation, les aspects matériels et l'héritage. Il y a certaines différences entre garçons et filles au niveau de la succession, mais elles restent très secondaires. Les traditions peuvent inspirer certains contrats privés, mais ceux-ci ne sont pas reconnus par la loi. L'autorité parentale est assurée par le père, détenteur de la puissance matérielle. Mais, en France, les allocations familiales sont perçues par les mères. Cela cause des troubles de l'autorité dans certaines familles musulmanes. Ces troubles peuvent devenir de véritables causes d'échec, quand la famille perçoit les règles du droit français comme une atteinte à la morale familiale de l'islam. Les enfants sont les premières victimes de ces échecs. Ils sont souvent livrés à eux-mêmes, et c'est alors la porte ouverte à la rue, à la délinquance, à l'exclusion, à l'échec scolaire. L'islam proscrit la filiation adoptive. Vous ne pouvez pas recueillir un enfant et lui donner votre nom comme s'il était le vôtre. La kefala est un problème très important, qui agite les chancelleries. Le sens général du mot kefala est « cautionnement ». C'est ainsi qu'il y a des kefalas pour les biens, des kefalas pour les personnes, ou encore des kefalas juridiques - c'est le cas lorsque quelqu'un se fait représenter devant un tribunal -. La kefala d'adoption consiste à recueillir un enfant orphelin et à le reconnaître comme mekfoul, c'est-à-dire enfant recueilli, lequel n'est pas pour autant adopté au sens du droit français. Pour lui donner le nom de l'adoptant, il faudrait un acte juridique supplémentaire, comme cela se fait en Algérie, moyennant quoi les consulats de France accepteraient de donner un visa au nom de la famille adoptante, permettant à l'enfant de bénéficier de tous les avantages du droit français en matière d'adoption. Je mentionne le cas particulier des mères non mariées. Il naît dans les pays musulmans, comme partout dans le monde, des enfants adultérins dont la mère n'est pas mariée. Ils portent alors le nom de la mère. C'est pour cette raison que vous pouvez rencontrer des personnes portant comme patronyme le nom d'une femme et même son prénom, par exemple Ben Halima, Ben Tounès, etc. Les questions de bioéthique ont donné lieu à de multiples commentaires, qu'il s'agisse de la procréation médicalement assistée (PMA), de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) ou de la contraception. Dans tous ces domaines, le principe qui nous guide est celui de la patrilinéarité et du respect du patrimoine génétique. La contraception est permise par l'islam, pour de multiples raisons. L'IVG au contraire est une atteinte à la vie. Or, celle-ci appartient à Dieu, elle est sacrée. L'interruption d'une vie est contraire à un principe que la tradition musulmane considère comme sacré. Il en est de même de l'euthanasie. Mais toute assistance à la procréation est vue d'un œil favorable dans la tradition musulmane, à l'exception de l'insémination artificielle avec tiers donneur inconnu, qui rompt la patrilinéarité puisque le donneur inconnu n'apparaît pas comme le père légitime et licite. La famille est constituée sur le fondement du devoir parental. L'équilibre entre les époux au niveau matériel est assuré au moment du mariage par la dotation de la femme (Mahr). La répudiation unilatérale, que l'on reproche souvent à l'islam, doit être formellement condamnée. Elle est d'ailleurs contestée par les pays musulmans eux-mêmes. On a vu en France des abus, par exemple lorsque la femme apprend par téléphone que son mari la répudie. Nous luttons contre cette tradition dont il est complètement erroné de la considérer comme musulmane. D'ailleurs, en cas de divorce légal, le mari est tenu de verser une dotation à la femme divorcée et pour ses enfants. J'ajoute que le droit musulman ne reconnaît le divorce qu'après une période de réflexion de trois mois. Cette période permet le retour de la femme dans son foyer. Qu'en est-il des mariages forcés ? Selon la loi musulmane, une jeune fille doit donner son accord. Mais dans le droit de certaines écoles, en particulier l'école malékite, qui est majoritaire en France, c'est le père qui marie sa fille. Cela pose des problèmes. Non seulement c'est contraire au droit français, mais cela peut même conduire à certaines pratiques détestables consistant à emmener des jeunes filles dans leur pays d'origine pour les marier sans recueillir un autre accord que celui de leur père. Ces mariages forcés, contraires à l'esprit de l'islam, et relevant de traditions infondées, sont combattus dans les pays musulmans. L'âge de la jeune fille à marier doit être légalement examiné de manière moderne et ne plus être considéré sur le seul critère de la puberté. J'ajoute que la femme mariée peut, selon l'islam, exiger la monogamie. Mais la polygamie est présente dans certains pays musulmans, en particulier dans les régions rurales. Cet archaïsme est rejeté par beaucoup de femmes. Le Coran lui-même stipule que la monogamie est préférable parce que l'équité entre les épouses ne peut pas être atteinte dans le cas de la polygamie (Coran IV, 3 Chapitre An Nisa, Les femmes). Les enfants ont droit à l'éducation, notamment religieuse. Jusqu'à leur puberté accomplie, ils sont sous l'autorité du père. En cas de divorce, l'enfant garde ses droits vis-à-vis de son père, qui doit subvenir à ses besoins. Il garde son droit à héritage. La seule exception concerne l'enfant adopté, qui ne peut recevoir en héritage plus du tiers des biens de son père adoptif. Pour l'avenir, nous souhaitons que le droit de la famille soit renforcé, et en particulier que soit stabilisé le lien de filiation avec les deux parents. L'accouchement sous X devrait être aménagé pour que l'enfant puisse un jour retrouver ses parents biologiques. Le principal problème qui concerne les enfants musulmans de France a trait aux conditions matérielles de l'éducation. Le rôle de la famille est fondamental dans l'éclosion d'une morale sociale. L'échec familial est aujourd'hui patent, et précède malheureusement l'échec scolaire, lequel précède l'échec de l'entrée dans la société. Les risques d'exclusion de la citoyenneté sont nombreux, et conduisent à tous les phénomènes que nous connaissons, qu'il s'agisse de la délinquance ou de la toxicomanie. On constate dans les prisons françaises la présence en nombre trop élevé de jeunes en situation d'échec moral et social. L'État se doit dans ce contexte de former et d'informer les jeunes par une pédagogie active des valeurs républicaines et laïques : amour du travail, de la Patrie, goût de l'instruction, etc. La loi n'est pas le seul remède. Il faut engager des moyens et des investissements importants dans les cités, dont certaines sont dans un état de déshérence qu'on ne peut plus accepter. Lorsque l'on se rend dans certains lieux de relégation, on est frappé par le décalage social, mais aussi intellectuel et psychologique. Des jeunes s'enferment dans un autre monde, un autre système de valeurs, une économie parallèle. C'est ainsi que se développent des logiques pernicieuses, asociales, antisociales, qui font naître une haine envers la société française, comme on l'a vu lors des manifestations récentes. Il est urgent de trouver des solutions, et non pas en termes d'identité. Je me méfie d'ailleurs de la notion d'« identité musulmane ». Cette identité est un refuge, un pis-aller, qui ne subsiste que lorsque tout le reste paraît épuisé. Ces jeunes, j'en suis certain, aspirent à être français à part entière. Mais, dans la pratique, ils se voient appartenir à une autre France. La « douce France » chantée par Charles Trenet leur paraît inaccessible. L'égalité des chances nécessite un effort d'ordre législatif, économique et politique. Mme Hélène Mignon : Monsieur le Recteur, vous avez fait allusion à la difficulté née, à l'intérieur des couples musulmans, de ce que la femme prend une certaine autorité du fait qu'elle perçoit les allocations familiales et les gère. Mais nous avons également remarqué que le père se sent très souvent privé de son autorité paternelle au bénéfice d'assistantes sociales : « Je voulais corriger mon fils. Je l'ai fait une fois. La deuxième fois, l'assistante sociale est intervenue. À partir de là, mon autorité paternelle ayant été contestée, je le laisse faire ce qu'il veut ». Je trouve que cette réaction pose un problème grave. M. Dalil Boubakeur : Parfois, ce n'est pas l'assistante sociale qui intervient, mais les gendarmes. On a connu un cas récent dans le midi de la France, où un imam prétendait empêcher sa fille de sortir. Elle a dû aller se plaindre, au risque de mettre son père en prison. Il y a un décalage entre une certaine manière de concevoir l'éducation et la loi française, une loi de progrès, qui protège de plus en plus l'enfant. Certains pères musulmans s'estiment investis d'un pouvoir de droit divin, d'une autorité absolue, voire d'un droit de vie et de mort sur leurs enfants, puisqu'on a même vu des familles condamner des filles à mort. Il importe que les familles, souvent d'origine rurale, vivant en France depuis peu de temps, soient informées des dispositions du droit français. Il ne s'agit pas seulement de leur enseigner la loi, mais de s'engager dans une démarche de prévention. Les jeunes musulmans sont appelés à vivre selon la loi française, la culture française, les traditions françaises. En France, on respecte les enfants, comme on respecte les femmes. C'est toute une mentalité qu'il faut changer. Il faut vivre avec son temps, avec sa géographie et avec l'histoire du pays dans lequel on prétend s'insérer. C'est la condition sine qua non de la réussite (ou de l'échec) du processus d'intégration sociale et religieuse des musulmans de France. M. Pierre-Christophe Baguet : Vous avez dit que vous étiez défavorable à l'insémination artificielle au nom de la rupture de la patrilinéarité, c'est-à-dire de l'impossibilité de connaître le père. Mais êtes-vous favorable à la fécondation in vitro au sein du couple ? M. Dalil Boubakeur : Oui. Toute aide à la procréation, tant qu'elle ne fait pas intervenir un tiers donneur, est permise. M. Pierre-Christophe Baguet : D'autre part, vous avez dit que l'enfant adopté ne pouvait hériter plus du tiers des biens du père. Dans quel cadre cette disposition s'inscrit-elle ? M. Dalil Boubakeur : Elle s'inscrit dans le droit musulman le plus strict, qui remonte au Prophète lui-même, lequel a adopté un fils, Zayd, auquel il a laissé le nom de son père d'origine. La règle qui a prévalu est que l'enfant adopté ne peut prétendre à plus du tiers des biens de son père adoptif. C'est là le droit musulman. En France, c'est bien sûr le droit français qui s'applique. Des conventions de droit privé peuvent exister. Si le testament est accepté par les héritiers, il n'y a pas de problème. En cas contraire, les tribunaux français tranchent selon les dispositions strictes du droit français. Parfois, des juges demandent des éclaircissements sur certaines traditions privées. M. Pierre-Louis Fagniez : Monsieur le Recteur, j'ai été très sensible à votre discours, qui oppose bien deux grandes formes d'islam. Quand on vous écoute, on voit bien que l'islam est une religion qui donne la primauté à l'homme. Vous-même, qui prônez l'abandon des traditions erronées, vous nous indiquez qu'en cas de divorce, au terme de la période de réflexion de trois mois, « la femme peut revenir au foyer », comme s'il était naturel qu'elle l'ait quitté. Mme Hélène Mignon : Cela m'a frappée moi aussi. M. Pierre-Louis Fagniez : Lors de la période de violences que nous avons récemment connue, c'était sans doute la première fois en France que seuls les garçons étaient dans la rue. En mai 68, au contraire, les garçons et les filles manifestaient ensemble. Cette primauté de l'homme ne sera pas aisément dépassée. N'y voyez-vous pas un obstacle à l'adaptation des musulmans au droit français ? Mme Annick Lepetit : Vous avez dit qu'un enfant né d'une femme non mariée prend le nom de sa mère. Le fait qu'un enfant naisse dans ces conditions est-il pleinement accepté par l'islam ? Cela semble être contradictoire avec le principe de la primauté du père. M. Pierre-Christophe Baguet : Quelle est votre position sur le PACS et le concubinage ? Mme la Rapporteure : Dans l'église chrétienne, la possibilité de célébrer un mariage religieux avant le mariage civil n'est pas ouverte. J'ai cru comprendre en vous écoutant que c'était possible dans l'islam, même dans l'islam de France. Je souhaiterais que vous précisiez ce point. D'autre part, quelle est la position de l'islam sur la pratique des mères porteuses ? Elle ne rompt certes pas la patrilinéarité, mais n'y a-t-il pas une certaine marchandisation, une disponibilité du corps humain qui peuvent choquer l'islam de France ? Enfin, que pense l'islam des couples de même sexe ? M. le Président : C'est effectivement sur cette dernière question que je voulais vous interpeller, d'autant plus que vous avez plaidé une modernité que nous vous reconnaissons bien volontiers. Quelle est la parole que vous adressez aux femmes ou aux hommes qui vous disent leur homosexualité, voire leur désir d'enfant ? M. Dalil Boubakeur : Il ne faut pas confondre ce qui relève, d'une part, des traditions et des relations sociales, et d'autre part, de la religion. Le fait que les allocations sociales soient versées à la mère a heurté les pères, qui ont le sentiment d'être inutiles, surtout quand, originaires de régions rurales où domine l'analphabétisme, ils étaient dans l'impossibilité d'apporter quoi que ce soit à leurs enfants. Ils ont même parfois essuyé le mépris de leurs propres enfants, ce qui a favorisé un certain islamisme de récupération. L'enfant, apprenant des bribes de Coran par des prosélytes de banlieue, peut s'estimer investi d'une autorité religieuse et contester celle de son père. On a vu des familles soumises à la loi du fils parce que celui-ci porte une barbe et se prétend un grand religieux. Pour revenir à la question des allocations familiales versées à la mère, peut-être conviendrait-il de moduler cette pratique. Il ne faut pas réduire à néant l'importance économique du père et par là son autorité. Pour ce qui est de la primauté de l'homme, oui, les trois religions monothéistes, juive, chrétienne et musulmane, sont issues de la tradition sémitique. Elles ont toutes les trois, à des degrés divers, atténué cette vision masculine du religieux. Le christianisme a beaucoup évolué sur ce point depuis saint Paul, notamment dans les quatre derniers siècles. Les musulmans de France vont connaître dans les années qui viennent la même évolution qui sera beaucoup plus rapide. Ils ne vont pas attendre des siècles pour s'adapter à la modernité et s'y intégrer. La loi, c'est la loi. Car c'est une loi de raison et non de passion, ni de tradition. Les sociétés musulmanes ont apporté des solutions pour les enfants naturels ou adultérins. Ces solutions se réfèrent parfois à l'islam, mais pas toujours. La tradition consistant à donner à l'enfant le nom de sa mère est admise, ce qui montre que le droit musulman est un droit vivant. L'ijtihad, c'est-à-dire l'effort spéculatif des docteurs de l'islam, permet de modifier l'application d'un texte fondateur. Prenez l'exemple du voile dit islamique : cette prescription religieuse est appliquée de manière très différente selon les périodes et les pays musulmans. Pour les uns, il est noir. Pour les autres, il est blanc. Parfois, il est facultatif. Il peut même être interdit, comme en Tunisie. La loi musulmane n'est pas une loi figée. L'homosexualité existe dans la civilisation musulmane, comme le montrent les poèmes licencieux, voire grivois de la littérature traditionnelle. Cela dit, elle n'est pas bien vue. Quand des personnes viennent me voir, je leur dis que je les comprends. Le médecin que je suis ne jette aucun anathème. Dans l'islam, on s'en remet à Dieu. Les homosexuels ne sont pas des réprouvés. C'est une question de tropisme biologique. Il n'y a pas lieu d'y voir une responsabilité, encore moins une culpabilité et surtout pas une condamnation. C'est ainsi parce que la sexualité n'est pas une norme figée. Le PACS est un accord exclusivement civil, alors que nous pensons que la famille doit être fondée sur le couple uni par un lien religieux, c'est-à-dire un engagement spiritualisé. On peut certes concevoir un lien fondé sur la raison « maturée », mais alors reste à voir si cette forme rationnelle de vie commune est universalisable. Le mariage religieux peut effectivement être célébré sans mariage civil. La fatiha, c'est-à-dire la récitation collective de versets coraniques, rend le mariage licite d'un point de vue communautaire. Mais il va de soi que le mariage musulman ne saurait être célébré en France qu'après le mariage civil. Nous ne ménageons pas nos efforts pour que la formation des personnels religieux intègre le respect de la loi française, notamment dans le cas où des mariages religieux sont prononcés par des imams parfois ignorants de la loi et qui risquent de se retrouver devant les tribunaux. L'islam assimile le cas des mères porteuses à celui d'une naissance adultérine, car la mère dite porteuse peut par la suite revendiquer un droit qu'elle n'a pas. M. le Président : Monsieur le Recteur, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et d'avoir traité de manière très directe et très moderne des questions qui sont l'objet de notre réflexion. Audition ouverte à la presse de Son Excellence Monseigneur André Vingt-Trois, Archevêque de Paris Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Monsieur l'Archevêque, je vous remercie d'être présent parmi nous ce matin. Il n'est nul besoin de vous présenter, chacun sait que vous êtes archevêque de Paris et que, jusqu'en septembre dernier, vous avez présidé au sein de la Conférence des évêques de France la commission épiscopale de la famille. Comme vous le savez, notre Mission d'information a été créée à la demande du président de l'Assemblée nationale pour réfléchir sur l'évolution de la famille. Nous avons pris le parti d'examiner l'organisation de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, afin de vérifier si les droits de l'enfant sont suffisamment garantis par notre législation. Nous avons souhaité recueillir la position des principales confessions religieuses sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux règles applicables au couple, à la filiation et à l'autorité parentale. Votre audition viendra ainsi clore une série de tables rondes dont les thèmes vous ont été communiqués. Son Excellence Monseigneur André Vingt-Trois : Je vous remercie de m'avoir invité et de consacrer votre temps à écouter les positions que l'Église catholique peut exprimer sur les sujets qui occupent votre Mission d'information. Je n'envisage pas, cependant, d'exposer ce matin les positions spécifiques de l'Église catholique. Je pense plus utile de vous faire part d'une conviction très profonde, qui est certes celle de l'Église mais qui est très largement partagée au-delà d'elle, à savoir que la famille est l'un des éléments constitutifs les plus importants de la construction et du développement du tissu social. Les études historiques ou ethnologiques font apparaître que les sociétés humaines, quelles que soient leurs formes et quelles qu'aient été leurs structurations, ont toujours porté la plus grande attention à la façon dont l'éducation des enfants était assumée, en y voyant un enjeu considérable pour leur avenir. Jamais aucune société n'a abandonné la conception et l'éducation des enfants aux seuls choix privés. Même s'il n'a pas pris la forme moderne que nous connaissons dans nos législations civiles, il y a toujours eu un encadrement de la transmission entre générations, qui est la base même de la continuité et de la stabilité d'une société. Cette transmission entre générations est assurée au premier chef par la famille. Ce sont les modalités juridiques de la vie familiale qui structurent la transmission de la vie et conditionnent l'avenir de la société. Dans notre société contemporaine, beaucoup sont tentés d'avoir une vision pessimiste de la situation de la famille. Cette vision est probablement vraie si l'on considère la mission de la famille par rapport à la société et la responsabilité de la société par rapport au cadre de la famille. Elle est beaucoup moins vraie quand on examine la pratique des familles : plus peut-être qu'à d'autres époques, celles-ci sont désireuses d'assumer leurs responsabilités à l'égard des enfants. Les nombreux contacts que nous avons avec les couples qui fondent une famille nous montrent que le désir d'assumer une responsabilité éducative et parentale est souvent l'une des motivations du mariage. Ce lien direct entre le mariage, la famille et l'éducation est un élément constitutif du tissu social. L'expérience de la vie sociale est très naturellement marquée par la compétition et par les rapports de force. Cela n'est d'ailleurs pas une mauvaise chose en soi. La question est de savoir comment les individus peuvent assumer cette compétition et ces rapports de force. Comment peuvent-ils surmonter à la fois le jugement des autres, l'agressivité des autres et leurs propres faiblesses ? Cette capacité de s'identifier comme une personne autonome par rapport au jeu de la vie sociale s'enracine dans l'expérience d'une sécurité affective. Pour devenir capable d'être un homme ou une femme libre dans le monde, il faut avoir dans sa vie l'expérience d'une relation d'amour qui ne soit pas conditionnée par ses performances. Cette relation est précisément la relation familiale. C'est dans la famille que l'on fait l'expérience d'être aimé pour soi-même, quels que soient par ailleurs ses faiblesses, ses lacunes ou ses crimes. De ce point de vue, peut-être notre société vit-elle un déplacement qui n'est pas très encourageant. Il semble que certains individus soient tentés de demander à la société la sécurité affective dont ils ont besoin, et que la société soit tentée d'accéder à cette demande, ce qui ne correspond pas à son fonctionnement normal. Inversement, les facilités que l'on donne pour affaiblir l'expérience de stabilité que représente la vie familiale déstabilisent les capacités d'affronter une situation conflictuelle dans la vie ordinaire. Il existe un lien très direct entre la déstabilisation de la vie familiale et l'incapacité à mener une vie sociale équilibrée. Le deuxième point que je souhaitais évoquer devant vous est la question de la constitution du droit. Le droit peut-il se contenter de régler les contrats privés ? La législation sur la famille est-elle simplement un arbitrage offert pour éviter que les crises relationnelles de la famille ne deviennent excessivement violentes ou nocives pour les individus ? Je reconnais très volontiers que c'est une mission légitime du législateur que d'assurer les conditions de nature à éviter que les crises familiales ne se transforment en désastres. Mais je redouterais que la législation se contente d'être l'aménagement des états de fait. Dans une société démocratique comme la nôtre, le législateur n'a pas simplement une fonction d'enregistrement et de légalisation d'une multitude de cas particuliers, nécessairement impossibles à élever au cas général qui normalement relève seul de la loi. La loi vise à une certaine universalité et doit normalement viser à concerner le plus grand nombre des citoyens d'un pays. L'idée que la légalisation de situations particulières pourrait être un moyen de leur donner une reconnaissance me semble un abus législatif, en ce sens que le droit ne serait alors que l'habillage d'une promotion éthique. Il me semble qu'il conviendrait d'agir de manière très prudente dans ce domaine. On voit bien qu'un certain nombre de demandes ont pour but la reconnaissance officielle d'un statut particulier. Je souhaitais attirer votre attention, en troisième lieu, sur la question du mariage. Il serait fastidieux de procéder à un parcours cavalier de l'histoire de l'institution matrimoniale à travers les âges. Mais on peut au moins, à titre conservatoire, reconnaître que le statut légal du mariage dans notre société est l'aboutissement d'une évolution qui s'étend sur plusieurs siècles, pour ne pas dire plusieurs millénaires. Faut-il considérer que cette évolution est sans signification ? Autrement dit, le mariage monogame stable et hétérosexuel doit-il être considéré comme une formule parmi d'autres, dont la prédominance au XXIème siècle serait purement contingente, une formule sur laquelle on pourrait revenir en estimant que, après tout, le statut du mariage dans la société romaine du Ier siècle n'était pas si mauvais ? Le mariage était alors une réalité institutionnelle relativement forte, visant à assurer la stabilité de la cellule familiale dans l'intérêt de la société patricienne, laquelle permettait par ailleurs que l'on ait ses plaisirs. Il serait assez surprenant que, après avoir considéré que l'histoire était un facteur de progrès, on considère aujourd'hui qu'elle est un facteur de régression. Si vraiment il y a progression dans l'histoire de l'humanité, il faudrait tenter de ne pas en perdre le bénéfice. Il me semble que l'intérêt bien compris de la société n'est pas de rassembler sous le même nom de « mariage » des situations complètement hétéroclites. Dans une langue aussi belle que le français, il devrait être possible d'appeler les choses par leur nom. On devrait tout de même être capable de définir le mariage. Si l'on n'était pas capable de le faire, le mot de « mariage » en viendrait à recouvrir des situations tellement différentes que l'on ne saurait plus ce qu'il représente. L'éventail des libres choix des personnes créerait ainsi un kaléidoscope de situations particulières dans lequel on renoncerait par avance à identifier des modèles qui diffèrent par leur valeur. Il serait ainsi indifférent d'être marié, concubin ou uni par un autre type quelconque de relation. Il serait indifférent de constituer un couple hétérosexuel ou homosexuel. Je pense que nous ne gagnons rien à cette confusion des réalités sous un même titre. Au contraire, nous avons intérêt à désigner des réalités par des termes propres. Qu'est-ce que le code civil veut dire quand il parle de mariage ? Peut-on mettre sous ce titre toute forme d'union plus ou moins stable, plus ou moins durable, et de composition a priori indéfinie ? Notre société a-t-elle un intérêt quelconque dans ce débat ? Ou bien est-on simplement devant des préoccupations morales sans intérêt pour la vie collective ? Je crois profondément que notre société a intérêt que la stabilité du mariage soit favorisée. Différents aménagements législatifs de ces dernières décennies induisent l'idée que le mariage n'est qu'un contrat purement privé entre les individus, fondé sur leur seule affectivité et sur un désir d'union dont ils définiraient eux-mêmes les conditions et à laquelle ils mettraient un terme quand ils le souhaitent. Si l'on persévère dans cette vision d'une gestion législative de contrats privés, on vide toute possibilité d'expression de l'intérêt de la société dans le mariage. La société se prive de son droit légitime à dire en quoi le mariage importe à sa stabilité et à son renouvellement. Le dernier point sur lequel je voudrais intervenir concerne la parentalité et les questions qui tournent autour de la conception des enfants. Je crois, en me référant à une vision chrétienne de l'homme qui peut être partagée par des non-chrétiens, que la personne humaine est constituée d'un ensemble très complexe de dimensions indissociables. On ne peut pas jouer avec les différents éléments de la personne comme s'ils étaient indépendants les uns des autres, comme si l'on pouvait les disposer autrement à sa guise. Dans une certaine approche de la conception des enfants, on accepte que l'engendrement biologique soit dissocié de l'engagement personnel. Cela ne correspond pas à la réalité. Il suffit de connaître des enfants qui n'ont pas été élevés par leurs géniteurs pour savoir que jamais cette question n'est tout à fait réglée tant qu'ils n'ont pas retrouvé ceux qui les ont mis au monde. Cela n'est pas dû à une fascination pour des racines cachées. Cela est dû au fait que l'être humain est un tout indissociable unissant le corps, l'esprit, le cœur, la volonté et l'intelligence. On ne peut pas impunément traiter de manière séparée les différents éléments de la constitution humaine. Cela ne veut pas dire que l'on n'est pas obligé, dans certaines situations, de faire face à une dissociation. Quand un enfant a perdu ses parents, il doit bien être élevé par des personnes qui ne sont pas ses parents. Mais ce n'est pas parce qu'il importe de gérer des situations particulières pour le bien des individus que ces situations particulières doivent être érigées en norme générale. Mme Martine Aurillac : Monseigneur, nous avons tous été très impressionnés par la manière dont vous abordez les problèmes relatifs au couple, à la famille et à l'intérêt de l'enfant. Vous avez souligné qu'il importait de ne pas perdre de vue l'intérêt collectif, qui est en effet particulièrement important aux yeux des législateurs que nous sommes. La stabilité de la vie familiale nous préoccupe également au plus haut point. J'ai cru comprendre que vous seriez assez désireux que figure dans le code civil une définition du mariage. En ce qui concerne l'adoption, dont vous n'avez pas parlé, voyez-vous des modifications à apporter dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt collectif ? Enfin, il m'a semblé que vous étiez tout à fait partisan du droit de l'enfant à connaître ses origines. Cela peut poser beaucoup de problèmes, notamment pour les parents qui ont élevé l'enfant. Comment voyez-vous les choses ? M. René Galy-Dejean : Parmi les problèmes auxquels nous sommes confrontés, je voudrais aborder ceux du mariage homosexuel et de l'homoparentalité. Nous avons entendu les positions des différentes Églises sur l'homosexualité : celle exprimée par le Grand Rabbin Sitruk y est très fermement opposée ; celle exprimée par le Recteur Boubakeur est également défavorable, même s'il est obligé de constater que l'homosexualité a existé dans l'histoire de l'islam. S'agissant de l'Église catholique, on observe que l'homosexualité peut recouvrir des drames. On a parfois eu le sentiment que l'Église catholique reconnaissait ces drames et manifestait une position de charité chrétienne. Mais la question posée au législateur est celle de savoir s'il convient de reconnaître ou non le couple homosexuel en instaurant le mariage des personnes de même sexe ou en rendant possible l'homoparentalité. L'Église catholique a-t-elle une position sur cette question ? M. Patrick Delnatte : Monseigneur, nous avons eu il y a quelques années un débat important sur le PACS. Celui-ci était à l'époque considéré comme un contrat signé entre deux personnes, qui n'avait rien à voir avec le droit de la famille. Il se trouve que le Conseil constitutionnel a fait du PACS une forme de conjugalité, ce qui lui donne un statut un peu différent de celui que le législateur lui avait donné, et que certains demandent, d'autre part, que le PACS évolue vers une plus grande solidarité, qu'il s'agisse de la solidarité entre les partenaires concernés ou de la solidarité intergénérationnelle. Face à une évolution qui correspond à des demandes émanant de la société et qui est « reconnue » par le Conseil constitutionnel, considérez-vous qu'il faille modifier le PACS et l'étendre à des droits nouveaux ? M. le Président : Je précise que, outre le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation s'est également prononcée dans le même sens. M. Pierre-Christophe Baguet : Je voudrais aborder la question du statut du beau-parent, dont nous constatons tous dans nos circonscriptions qu'elle pose un problème réel. Après la séparation d'un couple, l'un des deux conjoints retrouve une stabilité dans le cadre d'une union avec un nouveau compagnon, qui participe à la vie éducative et économique de la famille. Quelle est la position de l'Église catholique ? Pensez-vous qu'il faille accorder un statut au beau-parent ? Quelle place peut-on lui accorder par rapport au parent biologique dans le cas où celui-ci est toujours vivant ? Mme Annick Lepetit : Monsieur l'Archevêque, vous avez évoqué la recherche par les enfants de leur géniteur. Quelle est votre position sur ce point dans le cas d'un enfant adopté ? D'autre part, vous avez semblé parler d'une dissociation entre le statut juridique et l'engagement personnel. Pourriez-vous préciser ce point ? Mme la Rapporteure : Après un an de travaux, la Mission d'information est convaincue de la nécessité de renforcer la stabilité des couples et de promouvoir notamment la stabilité du mariage. La seule proposition que l'on nous ait faite pour aller dans ce sens est d'inscrire dans le code civil une définition du mariage. En réalité, l'expérience montre que les gens qui se marient savent très bien ce qu'est le mariage, et que, en tout état de cause, la vision qu'ils s'en font ne sera pas modifiée par le fait qu'une définition figure dans le code civil. Avez-vous d'autres propositions pour favoriser la promotion du mariage ? Certains ont évoqué la médiation familiale au moment des crises conjugales. D'autres ont insisté sur la prévention du divorce. D'autres encore ont suggéré une préparation au mariage civil. S'agissant de la recherche des origines, seriez-vous favorable à l'idée de revenir sur l'accouchement sous X en instituant un accouchement « dans la discrétion », qui protégerait le secret de la mère jusqu'à la majorité de l'enfant, date à laquelle celui-ci aurait le droit de connaître l'identité de sa mère. Nous avons bien entendu votre plaidoyer pour que l'enfant ait un père et une mère. Pensez-vous qu'il faudrait réexaminer la question de l'adoption par une personne seule ? S'agissant des mères porteuses, êtes-vous en phase avec la conception qui prévaut en France, laquelle affirme qu'il y a indisponibilité du corps humain et qu'il faut s'opposer, au nom de la non marchandisation du corps humain, à ce que l'embryon soit porté par une autre femme, même s'il est issu des deux futurs parents ? Enfin, face à la montée des familles monoparentales, soit que l'un des deux parents soit décédé, soit qu'il n'ait jamais été présent, soit qu'il ait abandonné sa famille, pensez-vous que l'on pourrait aller vers une délégation de l'autorité parentale plus importante accordée aux tiers ? En particulier, on sait que les grands-parents deviennent automatiquement tuteurs en cas de décès du parent biologique. Pensez-vous que l'on pourrait imaginer de donner au beau-parent la possibilité de demander la tutelle de l'enfant ? M. le Président : Je me permettrai, monsieur l'Archevêque, d'ajouter deux interrogations ponctuelles. J'ai été très frappé par le souci que vous avez eu d'insister sur le fait que les personnes devaient pouvoir avoir connaissance de leurs origines. Or, il m'a semblé que l'Église catholique était plutôt favorable à l'accouchement sous X, qui prive l'enfant de la possibilité d'avoir accès à l'identité de sa mère. D'autre part, sans revenir sur les positions de l'Église catholique sur la revendication de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe, je souhaiterais savoir s'il vous arrive d'être sollicité par ce qu'on appelle parfois les familles homoparentales de fait, qui correspondent aux cas de personnes de même sexe élevant des enfants nés d'une précédente union ? Dans ce cas, quelle est la parole que vous leur apportez ? Comment les accueillez-vous ? Son Excellence Monseigneur André Vingt-Trois : Faut-il inscrire dans le code civil la définition du mariage ? Si l'on m'avait posé la question il y a quinze ans, j'aurais certainement répondu par la négative, en estimant que si le code civil n'a pas défini le mariage, c'est parce que c'est une évidence et qu'il n'y a pas lieu de définir les évidences. Mais il me semble que l'évidence de ce qu'est le mariage est discutée. Si l'évidence est discutée, et puisque le mariage est un acte civil, il faut bien le définir. Je me mets parfois, par la pensée, à la place d'un élu municipal qui préside à quinze mariages dans la même journée. Que peut-il dire, en essayant d'être authentique et de ne pas blesser les personnes qui se marient ? Je ne veux pas parler de ses opinions sur le mariage, mais de la vision dont il est porteur en tant qu'officier d'état civil. Il faut que les choses soient claires. Même si le code civil du XIXème siècle peut appeler des corrections, je suis sûr qu'il n'est pas de l'intérêt ni de votre Mission d'information, ni du Parlement, ni du pays, d'imaginer des mariages entre personnes de même sexe. S'agissant de la connaissance des origines, il me semble que le problème se pose plus dans le cas de la procréation médicalement assistée, où la connaissance des origines est juridiquement interdite, que dans celui de l'accouchement sous X. Comment peut-on développer une certaine conception de l'être humain si ce qui fait l'originalité de la conception humaine, à savoir le lien d'unité biologique entre la mère et l'enfant, devient une question problématique ? La gestation est une communication indissociablement biologique, psychologique et affective ; elle est donc constitutive de l'identité de l'enfant. Si on le remet en cause, on se trouve confronté à des problèmes inextricables, surtout quand on sait l'importance de l'identité des parents et des grands-parents pour l'élaboration de la personnalité. La question de la connaissance des origines, c'est d'abord la question des conditions dans lesquelles s'envisage la procréation. Statistiquement, l'accouchement sous X n'est tout de même pas un phénomène massif. En ce qui concerne l'adoption, et à moins que les informations dont je dispose soient erronées, il me semble que le problème qui se pose n'est pas de trouver des couples pouvant adopter les enfants. La question qui doit être posée est celle de savoir ce qui est préférable pour l'enfant : vaut-il mieux pour lui qu'il soit adopté par un couple ou qu'il le soit par un adulte seul ? Si l'on se pose la question de l'adoption par des adultes seuls, c'est parce que des adultes seuls formulent des demandes. Mais ce qui est en cause, en l'occurrence, c'est leur désir d'enfant, et non le bien de l'enfant. Quand on voit la longueur des files d'attente de couples qui attendent de pouvoir adopter un enfant, on peut légitimement penser qu'il convient de se préoccuper avant tout de donner un foyer aux enfants adoptables. Le jour où tous les couples désireux d'adopter auront pu le faire, on pourra se préoccuper de savoir si l'on peut donner un parent isolé aux enfants qui resteraient orphelins. Mais, pour l'instant, je ne crois pas que ce soit le problème urgent. Le problème urgent est de faire en sorte que les couples en mal d'adoption qui réunissent les conditions d'équilibre familial puissent adopter. Je reviens sur la question du mariage homosexuel et de l'homoparentalité. Les personnes homosexuelles doivent recevoir la considération à laquelle tout un chacun a droit. Autre chose serait d'affirmer que la constitution d'une famille par le mariage est un droit universel. Toutes les situations sociologiques ne sont pas, de droit, ouvertes à tous les êtres humains. On peut et on doit définir qui est habile à contracter mariage ou pas. Une chose est de dire que les homosexuels méritent d'être respectés dans leur personnalité, dans leur sexualité et dans leur choix, pour autant que leur homosexualité soit un choix. Autre chose est d'affirmer que ce choix ou cette constitution psychosexuelle leur ouvrent nécessairement le droit au mariage. Je ne vois pas en quoi le droit au mariage serait une suite nécessaire de la considération qu'on leur doit. Ce que je dis ici du mariage vaut a fortiori pour l'homoparentalité, dont on ne voit pas très bien, tout de même, quelle figure elle donne de la relation d'engendrement. Car, à nouveau, se pose la question de savoir à quel point on peut dissocier les rôles parentaux et les rôles biologiques assumés dans la conception. En résumé, l'Église s'efforce autant qu'elle le peut d'adopter une attitude respectueuse des personnes. Elle s'efforce également, autant qu'elle le peut, de défendre des institutions définies par des missions qui font qu'elles ne sont pas nécessairement ouvertes à toute personne. S'agissant du PACS, je me souviens de ce que disait M. Bloche au moment du débat autour de la loi qui l'a institué. Le PACS apparaissait très clairement comme un « premier pas ». On savait très bien quelle dynamique était enclenchée. Il n'y avait pas de manœuvre visant à faire passer quelque chose sans le dire. Personne n'était dupe, même si certains nous assuraient que le PACS n'avait rien à voir avec la constitution d'une famille, même si Mme Guigou, alors garde des Sceaux, nous disait qu'une famille, c'était l'union d'un homme et d'une femme élevant des enfants. Le PACS est un contrat. Or, on ne peut pas ouvrir à des personnes la possibilité d'entrer dans un contrat dont la caractéristique principale serait d'être un contrat qui n'engage à rien. Au fur et à mesure que ce contrat entre dans la pratique, la question de savoir à quoi il engage se pose nécessairement. Doit-on considérer, comme cela était prévu par la loi initiale, qu'il n'engage à rien d'autre qu'à ce à quoi les individus choisissent de s'engager ? Ou doit-on considérer qu'il est du devoir du législateur de fixer un minimum d'engagements, quels que soient les choix particuliers ? Mais dans ce deuxième cas, si le législateur doit définir quels sont les engagements des personnes unies par un PACS, il doit a fortiori définir les engagements des personnes unies par un mariage. Ou alors, qu'on dise clairement que le PACS est un mariage. S'agissant du statut de beau-parent, je formulerai des remarques qui ne constituent pas des réponses, mais une contribution à votre réflexion. Nous savons tous que, aux yeux des enfants, après le décès ou le départ du foyer de l'un de leurs parents, il ne suffit pas que quelqu'un ait repris le titre tombé en désuétude et le rond de serviette rangé dans le placard pour qu'il acquière par ce seul fait le titre de parent. Pour les enfants, cohabiter avec cette personne étrangère ne va pas de soi, et lui reconnaître une autorité va encore moins de soi. Je ne suis pas sûr que le seul fait que le législateur donne au beau-parent le droit de faire ceci ou cela conduirait les enfants à reconnaître son autorité et à l'intégrer psychologiquement. La première question qu'il faut se poser est de savoir de qui on cherche le bien. Cherche-t-on le bien des enfants ? Je serais tenté de dire que le bien des enfants voudrait qu'il n'y ait pas de beau-parent. Mais quand il y a un beau-parent, la manière dont les choses se déroulent ne dépend pas de la loi, mais de la capacité des conjoints qui se sont unis à constituer effectivement un foyer. S'il s'agit de problèmes très pratiques, les solutions sont assez simples. On peut dire que le nouveau conjoint a le droit d'aller chercher l'enfant à l'école ou de regarder les bulletins scolaires. Mais s'il s'agit de faire en sorte qu'il ait une autorité sur l'enfant, cette autorité n'existera que si elle est reconnue par les enfants. Ce n'est pas la loi qui la fera reconnaître par les enfants. J'ajoute que les choses se passent différemment selon le niveau culturel des parents. Pour ce qui est des mères porteuses, il y a certes indisponibilité du corps humain, il y a certes un principe de non marchandisation, mais la question essentielle est de savoir qui est la mère de qui. Une femme peut-elle porter un enfant pendant neuf mois sans que cela ne constitue aucune relation, aucun lien entre elle et l'enfant ? « J'ai accouché, j'ai fini mon travail et je rentre chez moi ». Que peut-on faire pour promouvoir le mariage ? Je sais que, dans certaines communes de France, les maires se sont souciés de cette question. Il est même arrivé qu'ils se réunissent pour réfléchir aux moyens de donner à cet acte civil plus de solennité et plus de contenu. Il est possible de rencontrer les futurs mariés et de parler avec eux du sens de l'acte qu'ils s'apprêtent à accomplir. S'agissant des grands-parents, je suis très partagé. Mais c'est la vie qui nous partage. Pour un certain nombre de jeunes ménages, qui ne sont pas encore très rôdés dans leur rôle de parents, les grands-parents peuvent parfois jouer un rôle de suppléants. Ils ont une place éducative originale. Mais qu'ils soient une référence plausible pour les enfants ne justifie pas qu'on leur donne un titre législatif. D'un autre côté, dans certaines situations, ils deviennent vraiment pesants quand ils deviennent des parents de substitution. Faut-il accepter qu'il y ait deux autorités dans une même famille ? Je ne suis pas sûr que, pour résoudre quelques crises aiguës qui peuvent se produire ici ou là, la production d'une loi supplémentaire apporte une réponse vraiment équilibrée. Je pense qu'il faut essayer d'aider les gens à faire leur vie, et qu'il n'y a pas besoin d'une loi pour cela. Des lois, il y en a beaucoup, et il n'est pas sûr qu'elles soient toujours très productives. M. le Président : Monsieur l'Archevêque, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir apporté un éclairage sur les questions générales, mais aussi sur les questions très précises, auxquelles réfléchit notre Mission. Table ronde, ouverte à la presse, sur l'évolution du droit de la famille, réunissant Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : J'ai le plaisir d'accueillir pour cette dernière table ronde consacrée à l'évolution du droit de la famille, et qui vient clore une série d'auditions dont les thèmes vous ont été communiqués, les représentants des principales loges maçonniques : - M. Jean-Pierre Pilorge, vous êtes Grand Secrétaire de la Grande Loge nationale française ; - Mme Marie-Françoise Blanchet, vous êtes Grande Maîtresse de la Grande Loge féminine de France ; - M. Jean Eisenbeis, vous présidez le Conseil National de la Fédération Française du Droit Humain ; - M. Claude Vaillant, vous êtes Grand Orateur du Grand Orient de France ; - M. Guy Dupuy, vous êtes avocat, membre du conseil fédéral de la Grande Loge de France, que vous représentez aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, notre Mission d'information a été créée à la demande du Président de l'Assemblée nationale pour réfléchir à l'évolution de la famille. Nous avons pris le parti d'examiner l'organisation de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, afin de vérifier si les droits de l'enfant sont suffisamment garantis par notre législation. Après avoir entendu ce matin les principales confessions religieuses, nous avons souhaité recueillir la position des loges maçonniques. Je vais donc vous inviter à répondre à cette question : quelles modifications convient-il d'apporter aux règles applicables au couple - marié, pacsé ou vivant en concubinage -, à la filiation et à l'autorité parentale ? M. Claude Vaillant : Il est vrai que l'on reproche souvent au droit de la famille d'être en grand décalage par rapport aux évolutions de la société. Il me semble pourtant que le Parlement a fait un travail considérable ces dernières années. On peut ainsi citer la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la pacification du divorce, la réforme du nom de famille et celle de la filiation. Tout cela a manifestement été fait pour faire davantage « coller » le droit à la société. D'autres avancées ont été loin d'être négligeables. Je pense en particulier au PACS, qui procède d'un esprit d'égalité, tout comme la mise sur un même pied des filiations naturelle, adultérine et légitime. La réforme du divorce a aussi été l'occasion de mieux définir l'autorité parentale et de réaffirmer l'idée de coparentalité, qui a considérablement fait évoluer la jurisprudence vers la reconnaissance de la garde alternée. Récemment, vous avez encore poursuivi ce travail en permettant, toujours en vertu du principe d'égalité qui vous est cher, d'accoler le nom de la mère au nom de famille. Vous nous avez tout d'abord demandé si les trois formes d'organisation du couple - mariage, PACS, concubinage - créaient une gradation de droits et de devoirs satisfaisante. L'affirmation de Napoléon, selon laquelle « les concubins se passent de la loi, la loi se passera d'eux », ne semble aujourd'hui plus d'actualité, compte tenu de la tendance à l'uniformisation des règles entre les couples mariés, pacsés ou concubins. En effet, même si le mariage reste la situation la plus protectrice du couple, la loi a accordé aux pacsés et aux concubins un certain nombre de droits, notamment en matière de fiscalité, de successions, d'assurance-vie et de maintien dans le logement du couple. Aussi, s'il existe effectivement une gradation entre ces trois statuts, les droits qui leur sont liés demeurent-ils dans tous les cas protecteurs. Vous avez ensuite souhaité savoir quelles mesures nous préconisions pour lutter contre les mariages blancs. M. le Président : Je précise que nous n'entendions pas traiter des mariages blancs, qui relèvent de la politique de contrôle des flux migratoires, mais les cas où il y a contrainte au mariage et où les droits des femmes sont bafoués d'une manière inacceptable. M. Claude Vaillant : C'était un lapsus. Il s'agit souvent de mineures de nationalité étrangère que l'on force, vraisemblablement au nom de coutumes et de traditions, à épouser des personnes bien plus âgées qu'elles. Il me semble donc que des mesures de police doivent être prises afin que des contrôles permettent de s'assurer de la réalité du consentement de ces personnes. Il convient également que l'officier d'état civil, en cas de doute sur l'intention réelle des deux époux ou lorsqu'il constate que les témoins ne connaissent pas les mariés ou qu'il y a un écart d'âge très important, puisse user de ses prérogatives et considérer qu'il a vocation à vérifier la réalité du consentement. Vous le voyez, je n'ai pas vraiment de mesure réellement novatrice à proposer, en dehors d'un renforcement du contrôle de la publication des bans. Vous nous avez aussi demandé si l'intérêt de l'enfant justifiait de modifier les conditions requises pour adopter. Quand on constate que les couples, devant les grandes difficultés à adopter des enfants français, se tournent vers des filières étrangères sur lesquelles ne règne pas toujours la transparence, on peut se demander si les conditions posées par le code civil ne sont pas trop rigoureuses. Bien évidemment, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit avant tout être pris en compte. Dès lors qu'une famille est capable de le recevoir dignement, que toutes les conditions de son accueil sont réunies et vérifiées de la même façon pour tous les couples, le Grand Orient de France, toujours en s'attachant d'abord à l'intérêt de l'enfant mais aussi en considérant qu'il existe une demande importante, pense aujourd'hui que l'adoption doit pouvoir bénéficier aux couples homosexuels. Vous avez souhaité savoir si nous considérions qu'il fallait modifier le droit de la filiation pour tenir compte des progrès scientifiques. Eh bien, je dirai simplement qu'un colloque que nous avons organisé nous amène à répondre oui, tout étant conscients que vous devez être en alerte permanente car ces progrès sont galopants. S'agissant d'un éventuel élargissement de l'accès à la procréation médicalement assistée, il paraît évident que les règles doivent être modifiées et élargies pour permettre l'accès à cette possibilité aux couples qui vivent le drame de ne pouvoir avoir d'enfant. Le Grand Orient souhaite donc qu'on trouve un cadre juridique mieux adapté, même s'il convient bien sûr de ne pas suivre l'exemple de l'Italie, où un médecin a permis la grossesse d'une femme de soixante-cinq ans. Une limite législative paraît devoir être posée pour éviter de tels dérapages. Se pose alors la question de savoir si cette technique peut être ouverte aux couples homosexuels, dans la mesure où de nombreuses femmes y ont recours dans des pays frontaliers. Dès lors qu'il y a une demande, toujours dans l'intérêt de l'enfant, dès lors qu'on est assuré qu'il sera « reçu » dans une famille qui dispose de tous les moyens pour l'accueillir, je suis favorable à la procréation médicalement assistée pour des couples lesbiens. Je suis bien conscient que cela pourrait représenter une « fracture », mais l'essentiel me semble être de privilégier le cadre dans lequel évoluera l'enfant, et de surmonter les réticences liées au poids de la morale judéo-chrétienne et des positions de l'Église. S'agissant des enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui, c'est la loi de l'État dans lequel naît l'enfant qui détermine la licéité de cette technique. Pour beaucoup de pays, c'est le droit du sol qui conditionne le statut de l'enfant. Au Danemark, en Angleterre, en Belgique, quand un enfant naît dans ces conditions il peut être adopté, mais qu'adviendra-t-il lorsqu'un juge français aura à se prononcer sur l'exequatur de cette adoption ? Bien évidemment, c'est l'autorisation de cette pratique sur le territoire français qui permettra de répondre définitivement à cette question. Quand vous nous demandez si le droit de l'enfant à connaître ses origines personnelles est suffisamment garanti par notre législation, vous posez en fait le douloureux problème des accouchements sous X, qui, institués pour protéger des femmes en difficulté, s'opposent au droit de chacun à connaître ses origines. Pour le Grand Orient, la crainte est que la volonté de donner un droit supplémentaire à l'enfant ne prive la mère de celui d'accoucher sous X. Or cela pourrait entraîner une augmentation du nombre des abandons purs et simples, au risque que les enfants se retrouvent dans une situation pire encore. On peut toutefois admettre qu'un besoin de connaître sa filiation réponde à des motivations psychologiques ou médicales. À la question de savoir s'il faut faire évoluer notre législation pour améliorer l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés, je répondrai non, car on a assez légiféré en la matière. Qu'on utilise donc les textes équilibrés qui existent déjà ! Les parents doivent se montrer responsables, et, quand tel n'est pas le cas, le recours au juge et à la médiation familiale doit d'abord rechercher l'intérêt de l'enfant. Cet intérêt justifie-t-il de donner un statut à l'adulte qui participe à l'éducation de l'enfant de son conjoint ou de son concubin ? Je répondrai oui, car il faut éviter une injustice qui peut être terrible : il n'y a aucune raison pour que celui qui a élevé l'enfant en soit coupé au motif qu'il n'est pas le parent biologique. Même en dehors de la séparation, il doit être en mesure de prendre des décisions intéressant l'enfant, notamment quant à son éducation, ce qui n'est aujourd'hui rendu possible qu'au titulaire de l'autorité parentale. Il conviendrait, pour combler ce vide juridique, de créer un nouveau statut, qui pourrait prendre la forme du tutorat, car il me semble que le juge de la famille a vocation à régler de tels cas. Mme Marie-Françoise Blanchet : Je souhaite, en préambule, rappeler nos particularités, qui peuvent éclairer l'Assemblée sur les options que nous proposons, car notre intervention n'est pas celle d'une association de juristes, mais celle d'une obédience maçonnique féminine. La Grande Loge féminine de France est une association composée de 11 600 membres, exclusivement féminins, recrutés dans un éventail large de la population : jeunes filles, femmes, mères et grands-mères, homos et hétéros, de toutes professions et formations. Franco-françaises et filles de l'immigration s'y côtoient et côtoient des femmes d'Afrique, d'Europe, d'Asie, des Amériques, et du Maghreb, entre autres. Notre éventail est panaché et bigarré, reflet de notre diversité, qui est celle de notre société. Comme maçonnes - nous tenons à une reconnaissance de la féminisation des titres - nous avons fait le choix d'un engagement double, à la fois symbolique et républicain, que nous affirmons fortement en prêtant serment le jour de notre initiation et que nous réitérons à chaque tenue de nos assemblées. Le principe constitutionnel et républicain de fraternité - de sororité, revendiqueraient certaines d'entre nous... - est pour nous fondamental, voire constitutif de notre Ordre : nous l'éprouvons activement, mais nous mesurons aussi les efforts nécessaires pour que ces liens ne restent pas théoriques et pour que la communauté se construise en fraternité. Au-delà de l'importance numérique, qui fait de nous la première obédience maçonnique féminine du monde et une des premières associations de femmes en France, nous pouvons témoigner d'une expérience de femmes qui ont librement choisi de renaître symboliquement et qui, de ce fait, appartiennent à une communauté non biologique de Frères et de Sœurs, où l'alliance symbolique peut être plus forte qu'un lien biologique ou civil distendu. Nous nous situons dans un espace laïque, non religieux, non dogmatique qui permet à ce sentiment d'appartenance de transcender les liens communautaires, ethniques, religieux ou politiques. Nous mesurons la nécessité d'une affirmation forte et exigeante de ces principes, pour que des êtres humains vivent ensemble, en dépassant les replis, pour que se fonde l'espace de notre république laïque. Rien n'est acquis tout se construit : notre conviction maçonnique est redoublée par notre connaissance de la lutte des femmes pour qu'au moins les droits et le principe d'égalité ne soient pas remis en cause en France et en Europe. L'égalité entre les femmes et les hommes, déjà inscrite dans le préambule de la Constitution de la IVème République et réaffirmée dans celui de la Constitution de la Vème République, fait du non-respect de cette disposition un trouble à l'ordre public qui doit être dénoncé et sanctionné. Même si nous sommes une obédience relativement jeune, née en octobre 1945, nous nous inscrivons dans une tradition qui, sans démagogie, cherche à se conjuguer avec le siècle. La révision régulière de nos rituels en témoigne : en ce moment, nous réécrivons le rituel de « présentation » pour y intégrer, à côté du mariage, le PACS voté par la République. Pour nous l'ordre est symbolique. Ceci explique notre attachement profond à toutes les cérémonies qui doivent marquer les engagements pris par un membre envers la communauté, et par la communauté envers un de ses membres. C'est celui d'un espoir que les changements législatifs sauront anticiper les conséquences pour les femmes, qu'elles soient filles, sœurs, femmes ou mères, et corriger les inégalités croissantes, en défaveur des femmes, face aux responsabilités et devoirs parentaux. Les événements récents ont renforcé notre conviction qu'il importe de revitaliser nos valeurs républicaines et d'empêcher que les débats soient pollués par des lois confessionnelles ou des appartenances communautaires. Et nous craignons que les femmes soient, une nouvelle fois, enjointes de supporter tout le poids des « solutions » qui vont être proposées, et de payer au prix fort la pacification attendue, sans aucun soutien en retour. En effet, des femmes isolées portent trop souvent le poids de la pacification première qu'est l'éducation des enfants, quitte à le payer de leur vie dans les cas de violences familiales, lesquelles sont désormais aussi exercées par les grands frères sur leurs sœurs. Foin d'hypocrisie ! L'autorité parentale et les règles applicables au couple deviennent majoritairement, dans les faits, une autorité maternelle et des règles applicables d'une femme seule à une femme isolée. La figure brechtienne de « Mère Courage » risque fort d'être convoquée, comme dans toutes les périodes de crise, sans que les moyens légaux et surtout sociaux accompagnent efficacement ces femmes, et d'abord les plus démunies, qui subissent déjà une double peine. Notre aliénation risque d'augmenter à la mesure de ce qu'on exigera des femmes pour compenser les déficits dus à la mutation sociale accélérée que nous observons. Les raisons de cet exercice solitaire et fragilisé du devoir parental chez les femmes sont multiples. J'évoquerai la banalisation des divorces, qui entraîne de facto une monoparentalité presque toujours féminine ; l'adoption par des femmes seules, homosexuelles ou hétérosexuelles ; la fuite, plus fréquente qu'on ne le croit, d'un père génétique incapable d'assumer une paternité même lorsqu'elle a été désirée intellectuellement ; le choix fait par certaines femmes de la maternité solitaire ; l'enfantement ou l'adoption tardifs qui confrontent les femmes à la fois à la monoparentalité et au vieillissement ; la précarité de l'emploi des femmes, qui les expose à l'affaiblissement de leurs ressources, fragilise des familles entières, extrêmement appauvries, et réduit la disponibilité nécessaire pour assumer le devoir d'éducation des enfants. Les droits des enfants créent aussi des devoirs filiaux, qui se font jour à la maturité. Or ce sont aussi les femmes qui les assument majoritairement. Leur présence s'impose auprès des générations qui les précèdent, sans que ces charges nouvelles aient donné lieu à des congés spécifiques ou à des autorisations d'absence au travail pour celles qui travaillent encore. L'allongement de la durée de vie dramatisera encore ces problèmes que nous devons anticiper pour éviter l'abandon des générations les plus anciennes, et des femmes en particulier. Quand le code civil a été rédigé, on mourait jeune. Aujourd'hui, la séparation et la « virtualisation » que nous avons décrites proviennent de la brièveté des unions et de la multiplicité des adultes qui entrent ou sortent, vivants, de la vie des enfants. Nos Sœurs juristes soulignent qu'un appareil juridique abondant a déjà été élaboré et insistent sur les difficultés nées de l'absence d'application des lois. Des ajustements limités devraient permettre l'intégration d'une nouvelle acception de la famille qui entoure l'enfant, de moins en moins biologique et de plus en plus symbolique. Sans prétendre à une analyse juridique, nous voulons alerter le législateur sur les atteintes à l'égalité des droits des femmes qui apparaissent : l'égalité des femmes et des hommes face aux droits et devoirs de la famille, l'égalité des garçons et des filles ne sont plus assurées, sur le sol français, dans des structures familiales traditionnelles non occidentales qui font prévaloir un droit coutumier ou religieux sur le droit français. Or, aucune tradition n'autorise l'atteinte à la liberté et à l'égalité, ni à l'intégrité physique et morale des personnes. C'est donc dans la vigilance accrue des services sociaux de la République, plus que dans des modifications législatives, que réside sans doute la solution. Des informations et des formations aux droits et aux devoirs en France sont nécessaires pour les nouveaux arrivants, femmes et hommes. Le législateur a toujours souhaité corriger la misère morale et financière, source des pires inégalités et des fragilités constatées. Il sait que la protection des enfants est de plus en plus liée à la protection et à l'accompagnement de leur mère, et seulement de leur mère. C'est dire l'importance d'une nouvelle définition du tutorat, qui permettrait l'accompagnement des enfants lorsque les mères exercent seules l'autorité parentale et lorsque l'autorité paternelle est devenue virtuelle. Cette « virtualisation » croissante laisse en effet les enfants à la charge des mères ou à la merci de structures floues La République française avait institué des rituels laïques pour fédérer les citoyens aux différentes étapes de leur vie. Ces rituels manquent surtout aux plus démunis car des inégalités surgissent, toujours au profit des plus riches. Le rétablissement de cérémonies d'accueil dans l'espace scolaire, notamment au collège, et de cérémonies de remise de prix, ainsi que la création de cérémonies laïques d'accueil des femmes et des hommes dans la vie adulte auraient une forte importance symbolique, hors de toute référence religieuse. Nous mettons à la disposition de la République notre connaissance, notre expérience et notre pratique de rituels laïques. Et, pour que les femmes issues de sociétés patriarcales, encore écrasées par le poids de la coutume et la pesanteur sociale de leurs religions, puissent se sentir investies d'un pouvoir et d'une mission particulières, il faut instituer des cérémonies spécifiques qui leur permettront de constituer un lien propre aux femmes et leur ouvrira un espace à elles, étape qui les amènera à rejoindre l'espace collectif. M. Jean-Pierre Pilorge : La famille est constituée, selon le code civil, dans le cadre du mariage par un homme ayant dix-huit ans révolus et, à ce jour, par une femme ayant au moins quinze ans révolus. S'ajoutent, pour le couple, le PACS et le concubinage. Dans sa forme traditionnelle, la famille est le fondement de la vie sociale, elle est insérée dans la vie politique et exerce un rôle important d'éducation privée. Elle exerce ainsi un droit fondamental, et constitue un droit fondamental. Aussi le pouvoir civil doit-il respecter et protéger la famille, car elle est le modèle de base de la communauté du genre humain, de la solidarité internationale, communauté au sein de l'univers. Le mariage est une réalité humaine, une institution naturelle qui précède des systèmes sociaux, juridiques et religieux. Il n'est pas une création de l'État ou des religions, et ni l'État, ni les confessions religieuses n'ont autorité pour en changer la nature. Le mariage entre un homme et une femme constitue un bien unique pour toute la société ; par son rôle irremplaçable, il construit les sociétés et les civilisations. La valeur sociale du mariage vient de ce qu'il est la pierre d'assise assurant la stabilité de la famille, cellule de base de la société. Par l'union conjugale, le couple hétérosexuel qui fonde la famille fournit un milieu stable et propice à la prise en charge des enfants et à l'éducation des générations futures. La famille est la base du lien social qui s'établit entre les générations qui se succèdent et qui font ainsi l'apprentissage de l'amour et de l'altérité. Le mariage est l'institution sur laquelle est fondée la société occidentale. Créé à l'image de Dieu, selon la Bible, l'humain est un être relationnel. La relation la plus fondamentale trouve son origine dans la différence des sexes, comme l'exprime en termes symboliques le récit de la Création : sans Ève, Adam n'a pas de raison d'exister, et réciproquement. Le corps humain est le langage de l'âme, et notre corps est sexué. C'est en termes d'alliance et de complémentarité qu'il faut réfléchir sur la différence entre l'homme et la femme, alliance et complémentarité qui s'exercent dans le couple, par la spiritualité. Certaines pratiques sexuelles sont souvent présentées comme de nouveaux modes de vie qu'il convient de légitimer au plus vite. Ces comportements ont toujours existé, mais une confusion grandissante laisse à croire que l'égalité entre les personnes implique nécessairement l'égalité des situations affectives et appelle de fait une validation sociale et un traitement juridique et politique. Nous sommes un homme ou une femme ; nous ne pouvons exister qu'à travers une identité sexuelle et c'est à partir de celle-ci que la société s'organise et développe sa culture et le sens de son histoire. L'enfant ne peut se construire qu'à travers la différence sexuelle incarnée par son père et sa mère. La question, le concernant, est donc de savoir dans quelle structure relationnelle on va l'engager plutôt que de savoir s'il sera entouré affectivement. Il ne peut y avoir d'actions en faveur de la famille que s'il existe d'abord une réelle volonté politique de promouvoir un modèle. À cet égard, la famille définie par les Nations unies en décembre 2004, dans le cadre du dixième anniversaire de l'année internationale de la famille, comme étant « la cellule de base de la société » renvoie à une conception sociale précise. Une politique de la famille distincte de l'aide sociale devrait en faire la promotion, sans étatisation et en mettant la famille en valeur comme modèle. Nous notons que le Premier ministre vient de donner la priorité à la responsabilisation des parents et à la valorisation de l'autorité parentale. C'est là un retour à des valeurs essentielles qui contribueront à l'unité des générations au sein de la République. Notre obédience n'abordant que les questions spirituelles au travers de l'anthropologie et de la métaphysique, les détails de l'organisation sociale ne sont pas de notre compétence. Nous considérons qu'elle doit créer un socle traditionnel mais non conservateur. Aussi, s'agissant de l'autorité parentale, nous pensons que le travail accompli a été bien fait et qu'il reste à l'appliquer. Nous considérons également qu'il conviendrait d'instituer le tutorat et de renforcer la symbolique dont la République a besoin pour mieux faire comprendre ses valeurs ; nous serons donc très favorable à l'institution de cérémonies conçues comme le support symbolique du tutorat. Je m'en tiendrai là pour ne pas outrepasser le mandat qui m'a été confié par mon obédience. M. Jean Eisenbeis : La Constitution de notre Ordre Maçonnique Mixte et International, le Droit Humain, affirme l'égalité de l'homme et de la femme et veut qu'ils parviennent sur toute la terre à bénéficier, d'une façon égale, de la justice sociale, dans une humanité organisée en sociétés libres et fraternelles, sans distinction d'ordre racial, ethnique, philosophique ou religieux. Elle ne professe aucun dogme. C'est pourquoi, dans nos ateliers, des discussions ou débats ayant trait aux questions sociales ne peuvent en aucun cas avoir d'autre but que d'éclairer les membres et leur permettre de remplir, en meilleure connaissance de cause, leurs devoirs de francs-maçons. Nous sommes 15 000 en France, et présents dans 55 pays. Le Droit Humain place la mixité, la famille et les droits de l'homme au centre de ses préoccupations depuis sa création en 1893. Nos fondateurs, Maria Deraismes et Georges Martin, annonçaient leur confiance absolue dans l'union des hommes et des femmes pour travailler ensemble à établir le bonheur pour tous sur la terre. Aujourd'hui, l'évolution du droit de la famille devrait être repensée à partir de la clarification du mot « famille ». La famille n'est pas un groupe social comme les autres. Il semble qu'elle n'existe, dans toutes les sociétés, que rapportée à un système symbolique, celui de la parenté. Or, n'y a-t-il pas actuellement déconnexion entre le biologique et la filiation ? Au-delà des différences entre les cultures, la parenté est l'institution qui articule la différence des sexes et celle des générations, et les familles, si diverses soient-elles, s'inscrivent dans cette dimension symbolique. La famille est la cellule de base institutionnelle de notre société. Les législateurs ont depuis longtemps pris en considération les problèmes de parentalité, d'éducation, de filiation, d'héritage et de préservation des biens, de respect de l'identité des enfants. Mais l'enfant, fruit de la mixité du couple dans la famille traditionnelle, grandit aujourd'hui dans des situations inédites. Des structures doivent donc être créées, dans son intérêt, pour garantir son éducation, sa santé et son épanouissement. C'est à partir de l'intérêt de l'enfant qu'il faut raisonner et s'interroger sur le milieu le plus propice à sa protection. C'est sa fragilité qui exige que soit envisagée la construction d'institutions nécessaires à cette protection. Il semble bien que la situation des enfants se soit considérablement modifiée car la notion de famille s'est élargie au point de sortir du cadre de la parenté. Ni les règles morales ni les formes juridiques anciennes ne nous paraissent plus répondre à ces préoccupations. De la morale établie ne faudrait-il pas passer à une éthique en marche ? Être parent, c'est s'engager à l'être. C'est l'engagement qui fonde la parentalité, et il ne faut pas craindre de se livrer à une lecture éthique des situations nouvelles que sont la multiplication des familles monoparentales avec des situations de détresse économique, l'existence de familles homoparentales qui vivent en quasi-clandestinité, les familles recomposées qui offrent parfois des situations compliquées pour les enfants, l'importance des familles d'accueil, relais éducatif de plus en plus nécessaires. La diversité de ces situations complique la réflexion et rend difficile l'énonciation d'une règle applicable à tous. Le Droit Humain, s'appuyant sur la tolérance, a le souci de ne pas sanctionner par un jugement moral les attitudes que les individus adoptent et les solutions qu'ils donnent à leurs problèmes personnels et familiaux. Mais, au-delà des préjugés et des dogmes, l'on constate que l'appareil juridique ne paraît pas toujours adapté à la réalité. L'évolution des mœurs rend nécessaire un ajustement pour pallier le manque de garantie et parfois même d'humanité qui apparaît lorsqu'on envisage la famille au-delà de son aspect traditionnel. Un progrès des droits de l'enfant, entièrement dépendant d'une famille dont il n'a pas choisi le modèle, suppose de prendre en compte l'évolution intervenue. Doit-on demeurer frileux face à une réalité incontestable ? Doit-on se voiler la face et ignorer la situation de l'enfant dès que l'on sort du cadre classique de la famille ? Par exemple, les liens d'un enfant avec le parent « social », c'est à dire la personne qui se conduit avec lui comme un parent sans en avoir le statut légal, sont-ils vraiment protégés ? Au début du XXème siècle, l'un de nos fondateurs abordait déjà ce problème en disant : « L'enfant a le droit d'avoir sa vie assurée par ceux qui sont la cause première de sa naissance - son père et sa mère - et à leur défaut par la société au sein de laquelle vivent ou ont vécu ses parents ». Soucieux de ne pas considérer la famille comme une entité coupée du reste de la société, ni l'enfant comme un simple objet, nous souscrivons aux propositions adoptées à l'unanimité par votre Mission le 28 juin dernier. Nous déplorons que tous les États n'aient pas ratifié, comme la France, la Convention internationale des droits de l'enfant, car se construire envers et contre tous est toujours moins profitable que d'être au centre d'une union internationale. Nous soutenons une mise à jour indispensable à une meilleure adéquation de nos textes à la réalité de notre pays. La mixité était, par nécessité biologique, la base de la famille traditionnelle. Aujourd'hui, avec l'existence de familles homoparentales et monoparentales, il faut un autre cadre pour assurer la permanence de la mixité. Si la famille « nouvelle » ne le fait plus, il revient à d'autres institutions ou associations de la garantir. Ainsi, l'école peut et doit porter cette valeur en lieu et place des familles qui ne peuvent, de fait, assurer ce réfèrent. La mise en commun des genres « homme » et « femme » représente pour nous une richesse nécessaire. L'école, les associations, les structures sociales sont à même de développer la mixité. C'est le droit des enfants, et ce n'est pas en sanctionnant ou en refusant les familles homoparentales que nous résoudrons le problème. Les tentatives passéistes de pénalisation des nouvelles formes parentales seraient inefficaces et injustes pour les enfants, exclus des décisions prises par les adultes. Dès l'instant où, par la naissance, la lumière de la vie et de la conscience est donnée à un enfant, c'est à nous, adultes, de le guider vers la responsabilité et l'autonomie. Le passage symbolique à la majorité légale ne peut nous suffire car l'accession ex abrupto à un droit nouveau ne peut transformer un enfant en citoyen responsable. Dans les cas de tension ou de conflit familiaux, nous ne pouvons que nous réjouir si les parents, l'éducateur, l'enseignant, le juge ou l'assistante sociale tiennent davantage compte des aspirations de l'enfant. Une meilleure formation des personnels à la compréhension des situations paraît donc nécessaire et un cadre juridique trop rigide ne peut s'adapter à leur diversité. Conformément à notre souci éthique, nous approuvons l'évolution retenue par votre Mission. Une plus grande concertation devient la règle, et l'enfant, membre à part entière du nouveau contrat familial, a son mot à dire dans les choix de parentalité. Il ne peut être considéré comme un objet, simple propriété des adultes. Je rappelle en conclusion que le Droit Humain aspire à réaliser une « transformation profonde des mentalités et des structures de la société pour établir un nouvel humanisme social et moral, plus juste et plus équitable, imprégné de l'idéal de fraternité ». M. Guy Dupuy : Mesdames, messieurs, mes Frères, mes Sœurs - car dans notre conception de la famille, dès lors que nous avons évité la polémique, peu importe que nous prenions des positions différentes en fonction de nos sensibilités -, je rappelle tout d'abord que notre démarche est personnelle et que, pour nous, une obédience en tant que telle ne saurait donc se prononcer sur les questions que votre Mission nous a posées. Je suppose d'ailleurs que c'est pour recueillir une sensibilité, et non la parole officielle des Francs Maçons, que nous sommes interrogés. C'est donc au travers d'une réflexion personnelle que j'exprimerai la sensibilité de la Grande Loge de France dont je suis imprégné. La famille fait partie de la personne, et j'y suis attaché. Mon père a d'ailleurs été Grand Maître de la Grande Loge de France sur une période de vingt années. Et puisque je parle de famille, je commencerai par le message que mon frère, maire de Suresnes et qui était député il n'y a pas si longtemps, m'a demandé de faire passer : il paraît anormal que les assistantes sociales en milieu scolaire continuent à relever de l'État, alors que ce secteur devrait être décentralisé à la collectivité qui a la responsabilité de l'établissement scolaire d'exercice, commune pour les écoles, département pour les collèges et région pour les lycées. C'est ainsi que le milieu scolaire pourrait être surveillé de près, et l'actualité récente nous montre l'utilité d'une telle mesure. Pour nous, il est important de bien identifier les problèmes de l'enfant, c'est-à-dire de prendre en compte ses besoins matériels et ses dispositions mentales, psychologiques, morales, sociales et spirituelles. Pour les francs-maçons, ces différents niveaux d'épanouissement d'une personnalité adulte sont essentiels et correspondent à notre recherche, mais les enfants doivent en outre, en raison de leur fragilité, bénéficier d'une protection spéciale à tous les niveaux de développement de la conscience. Les mutations intervenues depuis quarante ans sont innombrables : pilule, planning familial, avortement, adultère désormais couramment admis, divorce par consentement mutuel. Aujourd'hui, le législateur s'essouffle car il ne fait que suivre les mœurs, il ne les précède jamais. Il s'agit donc d'adapter le droit à ces évolutions, tout en préservant l'essentiel concernant les droits universels des enfants à bénéficier tant bien que mal d'un cadre familial. S'agissant des trois formes d'organisation du couple, la gradation actuelle paraît largement suffisante. C'est la cellule familiale qui doit être favorisée. Qu'on permette des aménagements pour le PACS et le concubinage peut être utile, de même que le fait que les homosexuels se sentent reconnus, mais il faut s'arrêter là, car il faut maintenir au mariage son caractère privilégié, la stabilité du couple étant conforme à l'intérêt de l'enfant En ce qui concerne la lutte contre les mariages forcés, l'article 180 du code civil pose le principe que le mariage sans consentement libre ne peut être attaqué que par les époux eux-mêmes. Il faut maintenir ce principe, tout en allant peut-être plus loin que les mesures utiles préconisées par la Commission nationale consultative des droits de l'homme auxquelles j'adhère. Ces mariages touchent des jeunes mineures ou majeures, issues de l'immigration, qui hésitent à porter plainte contre leurs familles. Il est donc heureux que la décision ait été prise que les femmes deviennent majeures à dix-huit ans... M. le Président : Elles étaient déjà majeures à dix-huit ans, la nouveauté c'est qu'elles ne pourront plus être mariées avant cet âge. Mme la Rapporteure : Les femmes ne deviennent jamais majeures, c'est bien connu... M. Guy Dupuy : Vous plaisantez, mais pour ma part j'ai le sentiment d'être toujours un enfant, ne serait-ce qu'aujourd'hui, quand je me livre devant vous à un exercice qui m'était jusqu'ici inconnu... Pour en revenir au mariage forcé, je suis favorable à ce qu'on introduise une sanction pénale, car la loi pénale n'est pas seulement faite pour punir mais aussi pour fixer des repères forts et pour s'appliquer aux fautes les plus graves. Notre société manque de repères clairs et sains dans les bouleversements qu'elle connaît actuellement. Ne pas dire qu'il s'agit d'une faute d'une exceptionnelle gravité serait faire preuve d'un excès de tolérance à l'égard d'une forme de communautarisme qui enfreint les principes élémentaires des droits de l'homme et va à l'encontre de tous les efforts d'intégration. Le principe de tolérance pourrait s'appliquer ensuite, le procureur appréciant l'opportunité des poursuites et le juge restant maître de la peine prononcée. S'agissant du statut du parent social, il faut reconnaître que ce dernier participe à l'éducation d'enfants, mais tout en distinguant ce qui relève de l'autorité parentale maintenue au père et à la mère, de ce qui relève de la garde, c'est-à-dire de la façon d'assurer le quotidien. Le statut pourrait être, au choix du parent gardien, soit une garde conjointe, soit une délégation de principe, le gardien légal décidant seul en cas de divergence. En cas de déchéance de l'autorité parentale de l'autre parent et en cas de parent unique, le même principe pourrait s'appliquer cette fois, non plus seulement à la garde, mais à l'autorité parentale qui pourrait s'exercer conjointement ou être déléguée. Pour les règles applicables à la filiation, j'adhère à la position du Grand Orateur du Grand Orient de France quant à la nécessité que la loi tienne compte des progrès scientifiques. Pour la procréation médicalement assistée, la loi paraît cependant suffisante. Elle permet l'insémination par tiers donneur seulement à titre exceptionnel, pour remédier à l'infertilité ou pour éviter une maladie. Cette technique n'est en outre destinée qu'à un homme et une femme formant un couple. Je ne pense pas qu'il faille toucher à cette législation, non par homophobie mais pour en conserver le caractère restrictif, afin d'éviter les dérives vers des inséminations de convenance sans souci des traumatismes futurs de l'enfant à naître La gestation pour autrui ne paraît pas poser les mêmes problèmes : si la gestation par la mère apparaît impossible ou dangereuse, je ne vois pas d'opposition fondamentale au recours à une mère porteuse. Il me paraîtrait en outre contraire à l'autonomie de la volonté, l'équité et aux principes de traitement identique de tous les enfants voulus et conçus par des Français d'interdire aux enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui de bénéficier de tous les droits attachés à la nationalité de leurs parents. Il faut donc examiner de plus près la possibilité que la mère porteuse ne soit pas considérée comme la mère légale, alors qu'elle ne l'a jamais désiré. Il me semble enfin que la législation est suffisamment avancée sur le terrain des conditions de retrait de l'autorité parentale, comme sur les mesures d'assistance éducative. Je ferai toutefois une réserve à-propos de l'article 378-1 du code civil, qui prévoit le retrait de l'autorité pour des parents condamnés comme auteurs ou complices d'un délit commis sur leur enfant ou par leur enfant. Actuellement de telles condamnations ne sont inscrites que sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire et peuvent donc être ignorées des services chargés de la protection de l'enfance. Une inscription sur le bulletin n° 2 permettrait au moins à l'administration de surveiller et d'informer les parents. M. Pierre-Christophe Baguet : S'agissant aussi bien de l'adoption par le couple homosexuel que du recours plus étendu à la PMA ou de la possibilité de faire appel à une mère porteuse, M. Claude Vaillant a fait référence à plusieurs reprises à l'intérêt de l'enfant. Pourrait-il mieux définir cette notion ? M. Jean-Pierre Pilorge nous a dit pour sa part que l'homosexualité n'était pas nouvelle, mais il a appelé à une clarification. Peut-il en dire plus à ce propos ? M. Guy Dupuy a considéré que les trois formes d'organisation du couple étaient suffisantes et que, pour préserver le mariage, il ne fallait pas toucher aux autres formes. Quelle est, dans ces conditions, sa position quant au mariage homosexuel ? Enfin, Mme Marie-Françoise Blanchet peut-elle préciser l'idée qui semble intéressante d'une cérémonie laïque pour officialiser l'intégration des femmes issues de sociétés patriarcales ? Mme Annick Lepetit : Serait-il possible de développer l'idée de tutorat évoquée par plusieurs d'entre vous ? Par ailleurs, puisque vous considérez que la législation actuelle est déjà bien fournie et que c'est plutôt l'application qui pose problème, pourriez-vous nous dire dans quels domaines nous devrions veiller à une meilleure application ? Mme la Rapporteure : La gestation pour autrui n'était à l'origine que le prêt d'un ventre pour un embryon issu de deux parents biologiques. On est passé à la procréation pour autrui avec le don d'ovules et on en arrive même, aux États-Unis, à combiner don de sperme, don d'ovule et prêt d'utérus, les parents n'étant plus qu'intentionnels. J'aimerais savoir quelle est la position de la Grande Loge féminine quant à cette évolution. M. Pierre-Christophe Baguet : J'observe à ce propos qu'aucun d'entre vous n'a fait référence à d'éventuels dérapages commerciaux liés à la PMA. M. le Président : Vos obédiences ayant une mission internationale, j'aimerais savoir si vous considérez que les évolutions du droit de la famille dans un certain nombre de pays comme l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Angleterre et le Canada peuvent être une source d'inspiration pour notre pays. Mme la Rapporteure : J'ajouterai, pour montrer à quel point cette question est délicate et fait l'objet de débats entre nous, que l'évolution de nos voisins peut être vue aussi comme une contrainte davantage que comme un modèle. La question est de savoir si, dans le cadre de la mondialisation, la France ne doit pas faire des choix juridiques qui lui soient propres, inspirés de sa tradition, de sa culture et de son histoire. En clair, faut-il imposer une harmonisation juridique, ou chaque pays doit-il être libre de se construire une éthique et un droit spécifiques ? M. Claude Vaillant: Pour moi, l'intérêt de l'enfant est d'être guidé par l'amour. De l'avoir voulu découle la responsabilité de l'élever et de l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit indépendant. Des débats approfondis ont eu lieu à ce sujet au sein du Grand Orient de France, et l'opinion que j'ai exprimée reflète celle des loges. Pour ce qui est de l'ouverture de l'adoption, on est passé du stade de la défiance à celui de la confiance. S'il existe un désir d'enfant, l'adoption doit être ouverte aux couples homosexuels comme aux couples hétérosexuels, à condition qu'elle se réalise dans des conditions identiques quelle que soit la composition du couple. S'agissant du tutorat, chacun conviendra que le vide juridique actuel a des conséquences dramatiques pour celui qui a élevé l'enfant de son conjoint décédé et qui revendique le maintien du lien. M. Pierre-Christophe Baguet : Iriez-vous, pour maintenir ce lien, jusqu'à retirer l'autorité parentale au père biologique ? M. Claude Vaillant : Non, mais un statut est nécessaire. Par ailleurs, je ne crois pas que l'on doive rejeter sur les juges la faute de la mauvaise application de la loi. La loi est ce qu'elle est et, en tant qu'avocat, je me dois de souligner que les textes ne sont pas toujours clairement rédigés. De plus, tout juge est par définition conservateur ; c'est en l'invitant à davantage d'audace dans l'interprétation de la loi que se crée la jurisprudence. Il appartient donc aux praticiens du droit de se montrer courageux et d'inciter les magistrats à une interprétation un peu plus audacieuse des textes. Ce qui me choque, en revanche, c'est que la Cour de cassation puisse revenir sur des principes votés par le législateur ; mais c'est une autre histoire. S'agissant des risques de dérapage commercial, il est clair, comme nos textes le précisent, que toute évolution doit se faire hors de toute marchandisation du corps humain. Le Grand Orient de France compte 47 000 membres, et l'obédience est présente dans de nombreux pays. Nous recherchons, bien sûr, le contact avec les autres, qu'ils soient maçons ou qu'ils ne le soient pas, car nos travaux ne sont pas seulement symboliques ; nous souhaitons qu'ils contribuent à améliorer la vie de la cité. Aussi, bien sûr, de par la vocation universaliste du Grand Orient, ce qui se fait à l'étranger nous intéresse. En tant que Franco-Danois, je suis particulièrement intéressé par les échanges avec le Danemark, premier pays qui a, d'ailleurs sous l'influence de l'Église, adopté le principe du partenariat enregistré pour les personnes de même sexe. Mme la Rapporteure nous a interrogés sur le point de savoir si l'on peut maintenir une culture nationale dans un environnement mondialisé. Je le pense, je l'espère en tout cas, car c'est bien ma conception de la construction européenne. Pour moi, les États nations doivent préserver la spécificité de leurs textes touchant au droit de la personne, à l'inverse de ce qui doit prévaloir en matière de droit commercial par exemple, où l'harmonisation est indispensable. Mme Marie-Françoise Blanchet : J'ai insisté sur l'utilité qu'auraient des cérémonies laïques J'habite Champigny-sur-Marne, commune dans laquelle vivent de nombreuses familles issues de l'immigration. On voit bien, lorsqu'on apporte une aide scolaire, combien il est compliqué de faire comprendre à certaines mères qu'elles ont des obligations à l'égard de l'école et à l'égard de leurs enfants qui doivent eux-mêmes apprendre des codes sociaux différents. Il est très difficile de leur faire prendre conscience qu'elles ont un rôle à jouer et que l'autorité parentale ne découle pas seulement du père. S'agissant du tutorat, je constate que, sans nous être concertés, nous sommes parvenus à la même conclusion, à savoir qu'une référence masculine est nécessaire, notamment à l'adolescence. Pour autant, ce n'est pas seulement dans les familles homoparentales que le problème se pose. Il existe aussi lorsque l'image du père est dégradée, qu'il est violent, déstructuré par l'alcool ou la drogue. Dans tous ces cas, le tutorat pourrait constituer un apport viril, cet apport dont l'enfant a besoin si son père est incapable de le lui donner. Le tutorat dans les familles recomposées permettrait au parent social de prendre une vraie place. Il pourrait ainsi assister aux réunions de parents d'élèves, accompagner l'enfant de son conjoint qui doit subir un traitement médical et, en cas de maladie prolongée du parent biologique, s'occuper de l'enfant en étant considéré comme un parent, ce qu'il est bien souvent, puisqu'il se substitue fréquemment à un parent défaillant. Quelque chose est donc à inventer, sans stigmatiser les mères seules qui portent déjà un très lourd fardeau. Si je n'ai pas abordé la question des mères porteuses, c'est délibérément car la Grande Loge féminine de France n'a pas étudié cette question à fond. Nous nous sommes toutefois demandé pourquoi ne pas autoriser la gestation pour autrui. C'est une question éthique à laquelle, je l'ai dit, il nous faut encore réfléchir. Ce que nous redoutons, c'est la commercialisation du corps de la femme. J'ajoute que, dans une grossesse, le corps n'est pas seul en jeu et que toute une symbolique se met en place, dont on peut légitimement se demander si elle peut prendre fin abruptement au moment de la naissance. Tout cela est très délicat. J'ai d'ailleurs entendu évoquer le cas d'adoptions à Tahiti, où il existe une tradition de don d'enfant. Dans un autre domaine, on observe dans la société tibétaine une polyandrie due au manque de femmes. La conséquence en est qu'en se mariant une femme épouse aussi les frères de son mari ; on ne sait pas, de ce fait, quel est le père des enfants qui naissent, et ils appartiennent au clan. De telles pratiques risquent de se reproduire en Inde et en Chine, étant donné les destructions massives de fœtus féminins qui ont eu lieu dans ces pays. On peut craindre aussi que le manque de femmes conduise à des rapts et à des viols, et s'interroger sur le devenir des enfants nés dans ces conditions. Bien entendu, de telles pratiques n'ont pas cours en France, mais ces exemples montrent que les choix politiques ou la coutume - puisque d'innombrables bébés filles ont été tuées à la naissance pour éviter que la famille ne soit ruinée à l'âge du mariage par la dot à verser - ont des conséquences considérables une génération plus tard. M. Jean-Pierre Pilorge : L'homosexualité est un fait qui a toujours existé et qui a même été valorisé par la Grèce antique. À présent, les tabous sont levés et c'est bien ainsi. Ma prise de position aujourd'hui ne concerne pas les homosexuels, mais l'adoption par un couple homosexuel. C'est brouiller les cartes de prétendre que l'affectif suffit, car un enfant doit pouvoir faire une différenciation sexuelle entre son père et sa mère. Il doit évoluer dans une structure institutionnelle, la famille, cellule de base de la société, dont nous souhaitons que l'État la mette en valeur et la privilégie, afin que le plus grand nombre d'enfants y soient élevés par un père et une mère. Il convient donc de définir une politique valorisant la famille par un statut rénové et non de se limiter à une aide sociale. Le tutorat doit être développé dans le cadre de la monoparentalité, car les mères dans cette situation ont plusieurs vies à mener en une seule journée et doivent être fortement soutenues. Elles ont bien souvent besoin d'une assistance morale et juridique et, plus largement, d'une aide qui leur permettrait de donner aux enfants dont elles ont la charge une meilleure éducation et la stabilité. Les événements qui ont récemment eu lieu dans les banlieues ont montré que ce qui fait défaut, à la base, c'est l'autorité parentale. Il faut donc la renforcer en éduquant les parents et, dans les cas les plus graves, par le tutorat. Notre obédience a 157 reconnaissances internationales croisées. Cela nous permet de constater que l'Amérique du Nord est à l'avant-garde des schémas nouveaux d'organisation de la famille. En Amérique latine, où les problèmes économiques et sociaux sont cruciaux, le luxe de la réflexion sur cette question n'est pas permis. Dans les sociétés traditionnelles du Bénin et du Burkina, la question ne se pose même pas, car le sens de la famille y est décuplé par rapport à ce qu'il est en France. Les Béninois et les Burkinabés ont d'ailleurs été effarés par les conséquences de la canicule en France, observant que, alors que celle-ci est permanente chez eux, les anciens n'en meurent pas car ils sont pris en charge par les familles. La question ne se pose pas davantage en Asie, où prévaut le schéma traditionnel de la famille, noyau central de la vie sociale. En Australie et en Nouvelle-Zélande, l'évolution est comparable à celle du monde occidental anglo-saxon, et semblable en Océanie à ce que l'on constate en Asie et en Afrique. Les schémas sont donc très différents selon les régions du monde. Les évolutions constatées ailleurs contraignent-elles la France, ou le pays peut-il construire une éthique à la française ? Il le peut, bien sûr, notamment dans le cadre de la francophonie. M. le Président : On ne peut toutefois confondre la situation de la France et celles des pays francophones, sous prétexte qu'elles ont l'usage du français en commun. M. Jean Eisenbeis : Je ne suis pas avocat et j'ai passé quarante-deux ans au service de l'éducation nationale. Je viens donc d'un milieu qui est confronté directement aux enfants, et, parmi nos propositions, un certain nombre viennent des enseignants et des éducateurs. Nous essayons ainsi sans cesse d'enrichir l'idée de justice sociale, qui figure dans notre constitution et qui doit être, pour nous, à la base de l'évolution de notre société. En fait, nous n'essayons pas d'apporter des réponses, nous nous posons beaucoup de questions. Ainsi, nous pensons qu'il convient de s'interroger sur les relations entre les désirs de l'adulte et l'intérêt de l'enfant. S'intéresser à l'adoption par des familles homoparentales devrait amener à clarifier les choses, à analyser pourquoi cette question est de plus en plus présente, à nous demander, si nous ne pouvons pas répondre à ce désir de l'adulte, ce que nous pouvons mettre en place pour préserver l'intérêt de l'enfant. C'est pour cela que, dans chacune de nos propositions, on voit apparaître un appel à une solution opérationnelle pour apporter des réponses sur le terrain. S'agissant de l'homosexualité, on a l'impression qu'il n'y a pas égalité entre les couples d'hommes et les couples de femmes. Notamment, l'adoption est mieux admise quand elle demandée par des femmes. Il faut s'interroger sur la justification d'une telle différenciation. Il faut aussi se demander, quand les hommes ont été mariés, ont eu des enfants et ont ensuite formé un couple homosexuel, quelles relations ils entretiennent avec leurs enfants et si ces derniers peuvent vivre avec ce nouveau couple. S'agissant de l'adoption, que faut-il penser de cette jeune femme qui rencontre d'énormes difficultés pour adopter en métropole, qui se rend à Tahiti et qui revient trois semaines plus tard avec un enfant ? Comment vérifier s'il n'y a pas là contournement de la loi française ? Je suis assez tenté de lier les sujets de l'avortement, des mères porteuses et de l'adoption. Nous avons l'impression que les lois suivent une évolution qu'il est devenu impossible d'arrêter. Cette évolution pose effectivement la question de l'influence que pourrait avoir ce qui se passe à l'étranger sur notre propre législation. Pourquoi l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre évoluent-elles ? L'influence de nos origines culturelles est-elle si forte que nous ne suivons pas ce mouvement ? Le plus simple serait de faire comme les autres, mais nous sommes ce que nous sommes et nous devons protéger cette identité par un certain nombre de textes. Enfin, je confirme qu'un certain nombre de bonnes lois ne sont pas appliquées faute des circulaires nécessaires et que, du coup, on n'en voit pas les retombées sur le terrain. M. Guy Dupuy : Je crois qu'on ne distingue pas assez ce qui relève des droits fondamentaux de l'homme en général et des enfants en particulier et ce qui relève des mœurs d'un instant auxquelles le droit commun tente de s'adapter. On ne peut pas concevoir l'application de règles universelles en suivant simplement l'évolution des mœurs particulières. Ne mondialisons pas à tout bout de champ, sauf à courir le risque que certaines sociétés ne se révoltent contre un occidentalisme excessif. À l'inverse, nous devons conserver un certain nombre de nos spécificités, car nous avons une culture particulière qui procède de notre expérience. On sait bien, par exemple, que la laïcité appliquée en France n'a rien à voir avec celle des États-Unis. Quand on se préoccupe des intérêts des enfants, la gradation des formes d'union paraît suffisante et il n'est donc peut-être pas utile de parler pour le moment de mariage homosexuel. Je le dis, car je pense que le droit commun n'est pas fait pour aller plus loin que les mœurs, sauf à prendre le risque de mettre l'enfant en porte-à-faux, par exemple à l'école, et de provoquer sa souffrance. En revanche, je pense qu'en raison des évolutions actuelles, il est possible d'accéder à l'idée d'adoption par des homosexuels. Comme dans une famille monoparentale, il n'y aurait pas un père et une mère, mais si l'amour est là, si les fonctions parentales sont assumées, le reste est affaire de mœurs et les homosexuels peuvent, de la même manière que les hétérosexuels, apporter des soins à un enfant. Autre chose est la fonction maternelle et paternelle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que la jurisprudence ne suit pas suffisamment les prescriptions du législateur. Je me distinguerai donc de mon Frère pour considérer que c'est souvent la jurisprudence qui fait évoluer les choses, précisément parce qu'elle est plus proche des mœurs de l'instant. Les institutions maçonniques n'ont pas à prendre de position collective sur tous les sujets. Nous ne défendons ni un collectivisme ni un corporatisme, nous essayons de former des hommes dans un système proche du système familial, en adressant à chacun un message de responsabilité personnel. La maçonnerie ne s'adresse pas qu'aux francs-maçons mais à des hommes qui doivent rayonner à l'extérieur et dire librement ce qu'ils pensent, sans recevoir de mot d'ordre collectif. Telle n'est pas sa mission spécifique. Mme Marie-Françoise Blanchet : Puis-je ajouter un dernier mot ? M. Guy Dupuy : J'ai parlé des hommes, mais il fallait bien sûr entendre « les hommes et les femmes » comme lorsque l'on évoque les droits fondamentaux de l'homme en général, sans s'attacher à une spécificité sexuelle. Mme Marie-Françoise Blanchet : C'est nouveau ! M. Pierre-Christophe Baguet : Vous n'avez en effet guère parlé des femmes, Monsieur... Mme Marie-Françoise Blanchet : Je ne voudrais pas qu'à partir de ce qui a été dit ici, on emprisonne les femmes dans un rôle social. L'éducation des enfants est l'affaire du couple et on voit bien, dans les générations les plus récentes, que les pères participent activement à l'éducation des enfants, dès leur plus jeune âge. Je le répète, il n'y a pas de rôle social génétiquement affecté. Enfin, le tutorat ne doit en aucun cas devenir une obligation pour toutes les familles monoparentales : il faut simplement qu'il puisse être proposé dans une situation de crise. Il ne faut pas en ignorer le côté dangereux : il peut-être une brèche dans laquelle s'engouffreraient les religieux et les sectes. M. le Président : Cela méritait d'être dit. Je vous remercie tous pour l'ensemble des informations que vous nous avez données, et qui éclaireront notre rapport. Audition de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : Nous accueillons pour la deuxième fois M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice. Monsieur le garde des Sceaux, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, notre Mission a organisé cet automne une série d'auditions et de tables rondes sur le droit de la famille. Nous avons appris beaucoup de choses qui nous permettront de faire jouer à cette Mission le rôle que lui avait donné le Président de l'Assemblée nationale il y a un an. Nous avons décidé d'aborder la question la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, en nous demandant si celui-ci devait conduire à modifier le droit de la famille. Nous avons déjà arrêté notre position sur deux sujets, d'une part en faisant, en juin, 52 propositions en vue d'améliorer le dispositif de protection de l'enfance, d'autre part, en ce qui concerne la lutte contre les mariages forcés, sous la forme d'amendements qui ont été acceptés par le Gouvernement ce matin même. Nous arrivons au terme de notre travail et nous voudrions évoquer aujourd'hui avec vous de façon très directe les pistes d'évolution possibles de notre droit de la famille. M. Pascal Clément : Je me réjouis que vous ayez choisi comme fil directeur l'intérêt de l'enfant qui doit en effet guider toute réflexion sur la famille. J'ai préparé une intervention assez didactique, afin que chacun sache ce que pense la Chancellerie, mais aussi ce que je pense moi-même, car il n'y a rien dans ce que je vais vous dire qui puisse heurter mes convictions personnelles, sur un sujet qui renvoie bien sûr aux évolutions de la société, mais aussi au plus intime de nous-même. Je vais donc être relativement long, pour essayer d'être clair, avant que nous poursuivions la discussion. Depuis le milieu des années 1990, le droit de la famille est l'objet de sollicitations très fortes et de revendications destinées à lui faire connaître des évolutions majeures. Vous avez bien voulu me faire parvenir un ensemble de questions pour lesquelles je vous laisserai un document écrit en réponse. Je souhaite néanmoins, de façon synthétique et en suivant autant que possible le plan de votre questionnaire, vous présenter ma perception du droit de la famille. En ce qui concerne le couple, le droit de la « conjugalité » a connu, par la loi du 15 novembre 1999 et dans des conditions controversées, une évolution importante avec la reconnaissance dans le code civil du concubinage, et la création d'un statut contractuel ouvert indifféremment aux couples de même sexe ou de sexe opposé, le pacte civil de solidarité. Au 1er juillet 2005, un peu moins de 170 000 PACS avaient été signés. Six ans après l'adoption de cette loi, il était nécessaire de dresser un bilan de son application, d'identifier les difficultés rencontrées, et d'engager une réflexion sur les améliorations qu'il est possible d'apporter au PACS. C'était l'objet du groupe de travail qui s'est réuni à la Chancellerie, regroupant associations, universitaires et professionnels du droit. Le groupe a remis un excellent rapport qui préconise de conserver l'économie générale du contrat de PACS telle qu'elle a été fixée par le législateur de 1999. En particulier, le PACS doit demeurer un contrat de couple et n'a pas vocation à constituer la fondation d'une famille. Il doit également demeurer ouvert tant aux homosexuels qu'aux hétérosexuels. Je souscris pleinement à ces orientations. Par ailleurs, ce rapport préconise un certain nombre de modifications, essentiellement destinées à renforcer la sécurité juridique du PACS, ainsi qu'à simplifier et assouplir les relations pécuniaires entre partenaires tout en prenant en compte la nécessaire protection des tiers. L'approfondissement et la clarification des dispositions juridiques applicables au PACS sont effectivement devenus nécessaires. Pour prolonger ces conclusions, j'ai préparé un projet de loi qui, avec l'accord du Premier ministre, sera présenté en conseil des ministres au début de l'année prochaine. Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, car les derniers arbitrages interviendront, le Premier ministre me l'a fait savoir, en janvier prochain. Mais cette évolution ne doit pas faire perdre de vue la place prépondérante du mariage dans le droit de la famille. En 2004, 275 000 mariages ont été célébrés en France. C'est dire que le mariage demeure une institution attractive. Je m'en réjouis profondément et œuvre avec l'ensemble du Gouvernement pour que cette institution ne soit pas détournée de sa finalité lorsque l'intention matrimoniale est remplacée par la volonté migratoire. Tel est l'objet du texte que l'Assemblée a examiné ce matin. Je suis attaché à conserver la spécificité du mariage, qui seul constitue la fondation d'une famille. Lui seul doit donc produire des effets familiaux. Promouvoir le mariage, c'est donc d'abord en préserver la spécificité à l'égard des autres formes de vie commune que sont le PACS et le concubinage. Vous comprendrez dès lors que je ne sois pas favorable à l'adoption d'un enfant par deux personnes qui ne sont pas mariées. Il faut s'en tenir à la vocation fondamentale de l'adoption, qui est de donner un enfant sans famille à une famille qui ne peut elle-même en avoir. Or les concubins forment un couple, ils ne forment pas une famille. Ils peuvent mettre fin à leur vie commune à tout moment, sans que jamais ne s'exerce un quelconque contrôle de l'autorité judiciaire. Ce risque important d'instabilité familiale peut s'avérer particulièrement préjudiciable pour un enfant adopté, qui, du fait de son histoire personnelle, exprime souvent un plus grand besoin de sécurité affective. En outre, le concubinage n'implique pas nécessairement l'altérité sexuelle. Or, il ne me paraît pas conforme à l'intérêt de l'enfant de permettre son inscription dans une filiation qui ne serait pas structurée sur l'altérité sexuelle des parents, et ce au risque de rendre sa généalogie incohérente et de l'exposer à des difficultés d'identification. Même si les avis sont partagés sur ce sujet et qu'il s'est trouvé des études - dont tout le monde ignore la fiabilité - pour dire que les enfants élevés dans des couples homosexuels n'étaient pas plus malheureux que les autres, j'entends également les avis qui soulignent le risque très important pour l'enfant. Je suis pour ma part opposé à une telle révolution du droit de la famille. De façon générale, je tiens à vous dire que je ne suis pas favorable à la remise en cause des équilibres actuels du code civil dès lors qu'ils permettent de protéger l'intérêt de l'enfant sous le contrôle du juge. Ainsi, il n'y a pas davantage lieu de modifier les dispositions du code civil permettant à une personne seule d'adopter un enfant, dès lors que celle-ci est susceptible de servir l'intérêt de l'enfant. Il faut savoir que l'adoption par une personne seule recouvre des réalités très différentes. Elle ne concerne pas seulement les personnes célibataires, qui d'ailleurs ne constituent que 10 % des demandes d'agrément. Elle vise principalement un époux qui souhaite adopter l'enfant de son conjoint. J'en viens à l'enfant. La question de l'enfant dans notre droit de la famille est d'abord celle des techniques nouvelles qui se développent pour pallier l'infertilité d'un couple. Ces techniques sont au nombre de deux : la procréation médicalement assistée, qui est permise et encadrée en France, et la gestation pour autrui, qui est prohibée et doit le rester. L'assistance médicale à la procréation est avant tout le moyen de remédier aux dysfonctionnements médicalement constatés affectant le processus naturel de la procréation. La loi bioéthique du 29 juillet 1994, confirmée sur ce point par la loi du 6 août 2004, en a circonscrit la mise en oeuvre à deux types d'hypothèses : d'une part, l'infertilité médicalement constatée ; d'autre part, le risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Il m'apparaît que toute mesure qui remettrait en cause ce champ d'application circonscrit doit être envisagée avec la plus extrême prudence. L'assistance médicale à la procréation n'a en effet vocation, à mon sens, ni à permettre une procréation par nature impossible, ni à garantir à tout un chacun un nouveau droit qui serait un droit à l'enfant. C'est pourquoi je suis résolument opposé à ouvrir l'assistance médicale à la procréation à une femme seule. Les lois bioéthiques ont réservé le bénéfice de l'assistance médicale à la procréation à des couples formés d'un homme et d'une femme, en âge de procréer, mariés ou vivant ensemble depuis au moins deux ans. Après s'être entourée de l'avis de différentes instances éthiques, la représentation nationale s'est prononcée sur ces conditions d'accès il y a à peine plus d'un an : je ne vois aujourd'hui aucun motif qui pourrait conduire le législateur à remettre en cause ces équilibres. Ces conditions ont en effet tenu compte de principes qui m'apparaissent fondamentaux en matière de droit de la filiation comme de politique familiale. Parmi ceux-ci figure l'exigence de donner une famille comportant un père et une mère à l'enfant né de la procréation médicalement assistée. Sans doute les familles monoparentales constituent-elles aujourd'hui une réalité sociologique importante, que le droit de la famille se doit de prendre en compte. Mais cela ne saurait constituer une raison pour qu'il encourage la création de telles familles. L'ouverture de l'assistance médicale à la procréation à une femme seule conduirait à la consécration d'un « droit à l'enfant ». C'est pourquoi j'y suis défavorable. Je suis également opposé au transfert post mortem de l'embryon vers la mère. Je sais que le Comité consultatif national d'éthique a, pour des raisons humanitaires, émis à plusieurs reprises un avis favorable à cette pratique. J'estime que ces raisons humanitaires, si respectables soient-elles, ne tiennent pas face aux incidences préjudiciables et aux bouleversements du droit de la famille qu'entraînerait sa reconnaissance par le droit. Je voudrais d'abord rappeler que cette question a fait l'objet d'un débat extrêmement approfondi à l'occasion de la récente révision des lois bioéthiques. Sous la précédente législature, l'Assemblée nationale avait prévu de rendre licite tout en l'encadrant le transfert d'embryons post mortem. Ce projet a été abandonné en particulier en raison de l'incidence qui en résulterait sur le droit des successions. Il faut avouer que c'est une question que nous ne savons pas résoudre. Mais avant tout, ce sont des motifs de politique familiale qui motivent les très vives réserves que m'inspirerait la perspective d'une telle réforme, si elle devait être à nouveau d'actualité. Vous m'interrogez également sur le maintien du principe de gratuité du don d'ovocyte. J'observe que la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique permet le remboursement de certains frais. En revanche, que le don en tant que tel fasse l'objet, sinon d'un défraiement, car certains frais peuvent effectivement être engagés, mais d'une rémunération, voilà qui serait de nature à remettre fondamentalement en cause le principe de non patrimonialité des éléments et produits du corps humain, édicté à l'article 16-1 du code civil qui est une garantie essentielle du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. S'agissant de la gestation pour autrui, je tiens à rappeler que l'article 16-7 du code civil énonce un principe d'ordre public selon lequel « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Dans le cadre de la révision des lois bioéthiques, le législateur n'a pas estimé devoir revenir sur un tel principe. Cette prise de position du législateur de 2004 ne me semble pas devoir être remise en question et ce, pour des raisons de principe. Les contrats de mères porteuses remettent en cause d'une part le principe selon lequel la mère est celle qui accouche de l'enfant, d'autre part le principe d'indisponibilité du corps humain. Vous m'avez demandé si l'une des formes de gestation pour autrui, celle où la mère porteuse met à la disposition d'un couple sa seule fonction de gestatrice - et non pas ses ovocytes - pourrait être autorisée moyennant un strict encadrement, eu égard à la nécessité de prendre en compte une stérilité absolue, par exemple celle qui résulte d'un défaut d'utérus. Je ne suis pas favorable à l'instauration législative d'une telle exception. Comme je l'ai dit précédemment, la procréation médicalement assistée, si elle doit remédier à certains cas d'infertilité, ne doit pas permettre la procréation à tout prix. L'adoption offre une possibilité d'accès à la maternité pleine et entière pour les femmes qui ont le malheur de souffrir d'une stérilité absolue. J'observe à cet égard que c'est parce que nos sociétés, pour des raisons qu'il ne m'appartient pas ici de rechercher, idéalisent la filiation biologique qu'elles hésitent à reconnaître à la filiation adoptive le crédit que celle-ci mérite. De même que je l'ai fait en ce qui concerne la question relative à la rémunération des dons d'ovocytes, j'ajouterai que toute exception à un principe fondamental - ici celui qui fait du corps humain une réalité hors commerce - comporte le risque de porter atteinte à la crédibilité même du principe. Le recours aux mères porteuses étant, que ce soit sur notre territoire ou au moyen de tourisme procréatif, une fraude à la loi française, je ne crois pas qu'il faille chercher à la régulariser. L'accouchement sous X répond à une réalité sociale douloureuse sensible. Il pose néanmoins des questions de principe, en particulier celle des droits du père qui souhaite assumer sa paternité alors que la mère de naissance, en accouchant sous X, l'empêche de le faire. Nous avons tous à l'esprit certaines affaires où père biologique et parents adoptifs se déchirent autour de l'enfant. C'est pour éviter de tels drames que l'article 62-1 du code civil a été introduit en 2002. Il permet au père, confronté à l'impossibilité de faire porter la reconnaissance sur l'acte de naissance de l'enfant en raison du secret opposé par la mère, de saisir le procureur de la République afin que celui-ci recherche l'acte de naissance de l'enfant. Il ne me paraît pas opportun d'inverser la logique actuelle en obligeant le tuteur, avant tout placement d'un pupille, à vérifier que son père ne le recherche pas. D'une part, une telle vérification serait matériellement très difficile, voire impossible à réaliser. D'autre part, elle pourrait aboutir à retarder, voire empêcher le placement de l'enfant, alors que son intérêt commande de le confier à une famille dans les meilleurs délais. Par ailleurs, je dois vous informer que ces affaires, environ deux par an, donnent lieu systématiquement à un suivi individualisé par les services de la Chancellerie. Au cours des deux dernières années, les efforts fournis ont permis de localiser l'enfant et d'établir le lien de filiation avec le père. S'agissant du droit de l'enfant né sous X à connaître ses origines, la loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines personnelles marque un pas important dans la définition des équilibres entre l'intérêt de l'enfant à accéder à ses origines et la préservation de la vie privée de la mère qui a accouché sous X. Ainsi, la mère de naissance est mieux prise en charge et mieux informée lors de l'accouchement. Par ailleurs, l'identité de la mère de naissance est communiquée à l'enfant qui en a fait la demande si la mère accepte de lever le secret. La loi a également créé le Conseil national de l'accès aux origines personnelles, chargé de la mission délicate de médiation entre la recherche des origines et le droit des mères de naissance à voir protéger, si elles le souhaitent, le secret de leur identité. Après trois ans de fonctionnement, l'intervention du CNAOP apparaît comme un gage essentiel pour la préservation des intérêts en cause. Par conséquent, je suis opposé à tout retour en arrière qui aurait pour effet de dissuader la mère de naissance de laisser des renseignements permettant son identification. Vous avez évoqué, dans vos questions, la possibilité de permettre à la mère, à tout moment, y compris dès l'accouchement, de conférer à sa demande de secret un caractère absolu même au-delà de sa mort, alors qu'en l'état du droit cet effet posthume ne peut résulter que de sa demande lorsqu'elle est contactée par le CNAOP dans le cadre d'une recherche des origines. Je comprends bien les raisons qui peuvent motiver une telle proposition. Toutefois, j'observe que l'évolution, tant législative que sur le terrain, va dans le sens du recul du secret. Ainsi, le nombre d'accouchements avec demande de secret d'identité diminue régulièrement - environ 600 par an - et, parmi ceux-ci, près de la moitié des femmes consentent à laisser leur identité, sous pli fermé ou non. Par ailleurs, le système adopté par le législateur en 2002 répond à une logique qu'il ne faut pas perdre de vue : la décision de conférer à la demande de secret un caractère absolu et posthume ne doit être formée qu'en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de l'existence d'une demande d'accès aux origines. Il me semblerait donc contraire à cette logique et à l'évolution des accouchements sous X de renforcer le droit de la mère de naissance au secret. Vous m'avez également demandé s'il était envisageable d'introduire une forme d'accès aux origines en matière de don de gamètes, en particulier en instaurant un anonymat provisoire ou optionnel. Je suis opposé à l'un et à l'autre. Une telle réforme modifierait radicalement les conditions et la philosophie qui président au don. En premier lieu, la perspective d'une levée de l'anonymat du donneur à la majorité de l'enfant serait propre à inquiéter et donc à décourager nombre de donneurs. Ceux-ci pourraient redouter l'irruption dans leur existence du tiers et de l'étranger absolu qu'est pour eux l'enfant issu du don, voire craindre des conséquences en matière de responsabilité. Surtout, cette faculté offerte à l'enfant à sa majorité ne serait sans doute pas sans incidences psychologiques sur ses relations avec ses parents, et ce, dès avant l'âge de sa majorité. La position de ceux-ci pourrait en être fragilisée. Une telle réforme conduirait donc à mon sens à affaiblir bien inutilement la filiation comportant le recours à un tiers donneur. En inscrivant aux articles 16-8 et 311-19 du code civil le principe de l'anonymat des dons de gamètes, qui constitue une disposition d'ordre public, le législateur a fait un choix de société. Le don de gamètes doit demeurer un dispositif palliatif de l'infertilité. Il ne faut pas y introduire, même partiellement, une logique de filiation ou à tout le moins d'accès aux origines. S'agissant enfin de l'exercice de l'autorité parentale, vous avez souhaité que j'aborde quatre questions. La première est celle de la résidence en alternance. La loi du 4 mars 2002 a introduit dans le code civil la possibilité d'organiser la résidence de l'enfant dont les parents vivent séparément, de façon alternée chez ses deux parents. Cette disposition continue de soulever une inutile polémique qui conduit certains à vouloir l'interdire, en particulier pour les jeunes enfants, et d'autres à en faire le principe. Il est incontestable que toutes les précautions doivent être prises pour adapter les mesures d'exercice de l'autorité parentale à l'âge et aux besoins de l'enfant. L'unique critère qui doit guider aussi bien les parents dans le cadre de leurs conventions que le juge dans sa décision demeure l'intérêt de l'enfant, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Or, cet intérêt ne peut s'apprécier qu'au cas par cas, afin de déterminer dans chaque contexte particulier les solutions les plus appropriées pour l'enfant. Le juge procède dans ce cadre à l'étude de tout un ensemble de circonstances concrètes, parmi lesquelles peuvent être cités l'éloignement des domiciles, l'aptitude de chacun des parents à s'organiser autour de ce mode de résidence, les pratiques antérieures, l'âge de l'enfant, etc. Dans ces conditions, il semble totalement arbitraire de fixer un seuil d'âge en deçà duquel la résidence alternée serait systématiquement refusée. Il convient en outre de préciser que, face à des situations complexes ou conflictuelles, les juges n'hésitent pas à avoir recours à des spécialistes de l'enfance leur permettant de statuer en toute connaissance de cause. Enfin, les problèmes peuvent être relativisés. Je vous renvoie à cet égard à l'étude réalisée par le ministère de la justice à la fin de l'année 2003, dont je ne citerai qu'un élément : sur 100 résidences en alternance fixées, près de 95 l'ont été sur la base d'un accord des parents. Au vu de ces éléments, il n'apparaît donc pas opportun de modifier l'état du droit. La deuxième question a trait à la médiation familiale. Je suis, vous le savez, favorable à son développement, car elle permet l'émergence de solutions négociées par le couple, et donc du dialogue. Particulièrement en matière d'autorité parentale, la médiation responsabilise les parents, les conduit à faire la part des choses et à rechercher l'intérêt supérieur de leurs enfants, dans un contexte de respect mutuel. La loi de 2002 sur l'autorité parentale donne au juge la faculté de prescrire aux parties de rencontrer un médiateur en vue de les informer sur le déroulement et l'intérêt d'un tel processus. Ce mécanisme, par sa souplesse, me paraît tout à fait pertinent : le juge va évaluer, dans chaque cas d'espèce, si les personnes concernées sont en mesure de tirer partie de l'entretien d'information. Le dispositif se développe d'ailleurs de façon très satisfaisante. Certaines juridictions ont mis en place des permanences d'information pendant les audiences des juges aux affaires familiales. Il ne me semble pas nécessaire d'aller plus loin et d'imposer aux familles d'assister à une réunion d'information avant de saisir le juge. Le plus souvent, cela ralentirait le processus sans réelle utilité. Enfin, de façon plus pragmatique, il m'apparaît que les structures de médiation ne seraient pas en mesure d'absorber environ 300 000 entretiens par an. J'ajoute que, lorsque la médiation familiale est inscrite dans le processus judiciaire et mise en œuvre avec l'accord de chacun des parents, leur participation financière m'apparaît souhaitable, étant précisé qu'ils peuvent d'ores et déjà bénéficier de l'aide juridictionnelle. Pour sa part, la Chancellerie travaille avec la Caisse nationale d'allocations familiales qui, en instaurant à compter de 2006 une prestation de service, va encore faciliter l'accès à la médiation. Enfin, vous le savez, la Chancellerie finance les associations œuvrant dans ce domaine, et y consacre des sommes toujours plus importantes. Troisième question : les pensions alimentaires. Faut-il un barème de fixation ? Faut-il un fonds de recouvrement ? En l'état, les critères pour fixer le montant d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont d'une part les ressources respectives des parents, d'autre part les besoins de l'enfant. L'absence d'indicateurs ou de modes de calcul auxquels le juge serait susceptible de se référer peut être source de solutions divergentes et, partant, d'incompréhension de la décision par le justiciable. Pour autant, il ne paraît pas opportun de mettre en œuvre un barème automatique et obligatoire. En revanche, la définition d'outils d'aide à la décision, tels que des données indicatives sur le coût de l'enfant en fonction de son âge et de la situation familiale ou l'élaboration de grilles indicatives pour l'information des juges, paraît intéressante. Des expériences ont déjà été conduites dans ce sens. Je suis en revanche totalement opposé à l'instauration d'un fonds de recouvrement. L'obligation alimentaire est avant tout l'expression de la solidarité intrafamiliale, les modes de recouvrement auprès du débiteur direct de la pension doivent être privilégiés. Tant sur le plan civil que sur le plan pénal, le créancier d'aliments dispose de nombreux moyens de contraindre le débiteur défaillant à s'acquitter de ses obligations. La solidarité nationale ne doit jouer qu'à titre extrêmement subsidiaire, dans le seul but d'éviter la précarisation des familles. Un des phénomènes les plus marquants de l'évolution de la famille est l'émergence des familles dites « recomposées », et votre dernière question portait sur la place du beau-parent. En cette matière, les propositions de réforme sous-estiment les instruments qui sont d'ores et déjà offerts pas le code civil. En effet, en l'état, aucun obstacle de droit ne s'oppose à ce que le père ou la mère de l'enfant donne mandat à un tiers pour accomplir tel ou tel acte relativement à l'éducation, à la santé et à la vie quotidienne de l'enfant. À titre d'exemple, il suffit que l'un des parents donne autorisation à telle ou telle personne pour que celle-ci puisse aller chercher l'enfant à l'école ou l'inscrire dans un club de sport. L'intervention du juge n'est donc pas requise, sauf en cas de désaccord entre les parents. Par ailleurs, j'observe que la loi du 4 mars 2002 a introduit un dispositif novateur dont il faut pouvoir mesurer l'efficacité : la délégation avec partage de l'autorité parentale. Ce dispositif a été créé pour répondre aux circonstances évoquées où le simple mandat n'est pas suffisant, et notamment pour que le beau-parent soit investi de réels attributs de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant si cela s'avère nécessaire à son intérêt. Cette disposition ne porte pas atteinte à la coparentalité, à laquelle je suis attaché. Son instauration étant subordonnée à l'accord des deux parents lorsque ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale, elle est en outre placée sous le contrôle du juge. J'ajoute que la création d'un statut spécifique du beau-parent pourrait aboutir à l'éviction du parent séparé qui ne vit pas au quotidien avec l'enfant. Lorsque les deux parents d'un enfant sont décédés, la tutelle doit être ouverte pour protéger et représenter l'enfant. Donc l'enfant ne peut être confié directement à un tiers, en l'espèce au beau-parent. Mais, contrairement à ce que l'on pense, l'obligation de désigner comme tuteur l'ascendant le plus proche n'est pas absolue. D'une part, cette désignation n'intervient qu'à défaut, pour le dernier vivant des parents, d'avoir désigné un tuteur par testament. D'autre part, si le conseil de famille en est d'accord, toute autre personne peut être désignée à la place de l'ascendant. Enfin, même en cas de désaccord, la désignation de l'ascendant peut être écartée en cas d'inaptitude, étant précisé que la jurisprudence entend cette notion de façon très large. Notre droit actuel permet donc une certaine liberté qui est sous estimée. Toutefois, en cette matière, le besoin d'une souplesse supplémentaire est légitime, compte tenu du fait que les parents donnent naissance à leurs enfants de plus en plus tardivement, et que l'ascendant le plus proche de l'enfant peut, en raison de l'allongement de la durée de la vie, avoir de grandes difficultés à s'occuper d'un jeune enfant ou d'un adolescent. C'est pour cette raison que le projet de loi de réforme de la protection des personnes vulnérables, qui modifie quelques dispositions relatives à la tutelle des mineurs, prévoit la suppression de l'attribution par priorité de la tutelle à l'ascendant. Enfin, vous m'avez demandé s'il fallait permettre au beau-parent d'adopter de façon plénière l'enfant de son concubin ou de son partenaire. Cette question recouvre en réalité deux problématiques différentes selon qu'il s'agit de concubins de même sexe ou de sexe opposé. S'agissant des couples de sexe opposé, je tiens à rappeler ici mon hostilité à voir le concubinage consacré comme le lieu de fondation d'une famille. Ces couples peuvent, s'ils souhaitent conférer à leur union la sécurité juridique et la reconnaissance appropriée de la collectivité, s'engager dans les liens du mariage. Ils se verront ainsi reconnaître l'ensemble des droits familiaux prévus par notre droit, et notamment le droit à l'adoption de l'enfant du conjoint. S'agissant des couples de même sexe, et pour les raisons que j'ai déjà développées précédemment, à savoir les impératifs de structuration de la personnalité de l'enfant, je ne suis pas favorable à l'adoption au sein des couples homosexuels. S'agissant de l'adoption simple de l'enfant du concubin, elle est possible, mais elle a pour effet de transférer totalement l'autorité parentale au parent adoptant. C'est d'ailleurs la raison qui conduit le plus souvent les juridictions à refuser de telles adoptions. En effet, en cas de séparation, le parent biologique se trouverait totalement dépourvu de tout droit à l'égard de l'enfant. La question est en réalité celle du partage de l'autorité parentale entre le parent biologique et le parent adoptant. Compte tenu de l'instabilité juridique intrinsèque de la situation de fait qu'est le concubinage, il faut avant tout favoriser l'adoption conjointe par les couples mariés, seule de nature à garantir le respect de l'intérêt de l'enfant en cas de séparation, en raison de l'existence d'un contrôle systématique par l'autorité judiciaire. Et c'est bien le problème : dans le cas du concubinage l'autorité judiciaire n'intervient pas et le respect de l'intérêt de l'enfant n'est pas garanti. La mesure consistant à autoriser un exercice conjoint de l'autorité parentale entre le parent biologique et l'adoptant lorsqu'ils ne sont pas mariés ne répond pas à cet objectif. Je vous précise que la question du partage de l'autorité parentale sera examinée demain - il s'agit de l'audience et non du délibéré, qui sera rendu d'ici un mois environ - par la Cour de cassation, qui juge un pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers qui a prononcé une délégation partielle d'autorité parentale par la concubine de la mère biologique de l'enfant, avec partage des droits entre ces deux femmes. Je souhaite avoir l'éclairage établi de la jurisprudence pour analyser sereinement les effets de la loi du 4 mars 2002. Telles sont, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, les observations que je pouvais formuler en réponse à vos interrogations. M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé que nous avons écouté avec grande attention. Vous avez répondu de façon très directe aux questions que nous vous avions posées et nous connaissons donc maintenant votre position, qui est sans doute celle du Gouvernement. M. Pierre-Louis Fagniez : J'ai écouté aussi avec attention cette intervention dominée par le principe du droit de l'enfant... M. Pascal Clément : Plutôt par celui de l'intérêt de l'enfant ! M. Pierre-Louis Fagniez : Il est une question précise à laquelle nous n'avons pas eu de réponse au cours de nos auditions, mais qui nous est souvent posée : c'est celle de la gestation pour autrui. Je l'ai bien compris, vous avez rappelé qu'elle était interdite au nom du principe d'indisponibilité du corps humain auquel tout le monde adhère. Mais il n'en demeure pas moins que nous nous demandons que faire de ces enfants lorsqu'ils sont nés à l'étranger. Le tribunal de Créteil a ainsi eu à se prononcer sur le cas d'un couple qui s'est rendu en Californie et qui est revenu, à Maisons-Alfort, avec des jumelles qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas reconnues comme leurs filles. Alors qu'elles n'ont jamais connu autre chose que la France, qu'elles vont à l'école dans le Val-de-Marne, elles vont devoir attendre leurs vingt et un ans pour faire la démarche de devenir françaises. Aussi, en tant que législateur, j'aimerais savoir s'il existe des perspectives d'amélioration des conditions de vie de ces enfants. M. Pascal Clément : Vous avez répondu vous-même : à partir du moment où elles arrivent en France, pays dans lequel la gestation pour autrui n'est pas reconnue, la fraude commise par leurs parents au regard du droit français interdit, pour des raisons d'ordre public, la transcription de leur naissance sur les registres d'état civil français. Elles ont en revanche un état civil dans le pays où elles sont nées. Mme Claude Greff : Rien ne va donc changer... M. Pascal Clément : Les inscrire reviendrait à accepter la gestation pour autrui, ce ne serait pas cohérent. M. Jean-Marc Nesme : Je rappelle en outre que, aux termes de la Convention internationale des droits de l'enfant, ou plutôt d'un de ses textes additionnels ratifié et signé par la France, la gestation pour autrui est assimilée à un trafic d'enfants. Mme Martine Aurillac : Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le garde des Sceaux, et je me suis reconnue dans beaucoup des solutions que vous avez proposées. Pensez-vous qu'il faudrait promouvoir le mariage ? Seriez-vous favorable à ce que l'on en donne une définition plus précise ? M. le Président : J'ajouterai : pensez-vous qu'il faudrait définir la famille ? M. Pascal Clément : Le mariage demeure un vrai succès : 275 000 mariages ont été célébrés en 2004. Il ne s'agit pas d'un contrat mais d'une institution. Notre droit reconnaît aujourd'hui trois formes d'organisation de la vie de couple : le mariage, le PACS et le concubinage, et cette diversification est peut-être à l'origine d'une certaine ambiguïté. Mais la différence est simple et fondamentale : le mariage est la seule institution qui fonde la famille. Il importe de maintenir cette distinction et de préserver les effets familiaux du mariage, notamment la présomption de paternité et la protection du conjoint survivant. Je l'ai dit, les droits des concubins et des partenaires n'ont pas vocation à rejoindre, en matière familiale, ceux des époux. Promouvoir le mariage, c'est donc d'abord en préserver la spécificité à l'égard des autres formes de vie commune que sont le PACS, contrat organisant la vie commune de deux personnes, et le concubinage, union de fait, certes reconnue par le droit, mais sans aucune garantie juridique de stabilité. C'est également lutter fermement contre les détournements dont il est parfois l'objet, nous l'avons encore vu à l'occasion de la séance publique de ce matin. J'ajoute que l'enfant, en cas de séparation des époux, est suivi par un juge alors que tel n'est pas le cas s'il n'est pas issu d'une famille, c'est-à-dire de l'institution du mariage. Dans l'intérêt de l'enfant, je souhaite donc que ce soit une famille et donc un couple marié qui l'accueille. M. Patrick Delnatte : Vous nous avez expliqué l'importance de la famille vis-à-vis de l'enfant et montré que les concubins avaient intérêt à se marier. Mais il existe bien en France un grand nombre de concubins avec enfants. En cas de litige, ils arrangent leurs affaires entre eux, sans aucun contrôle du juge et cela ne va pas forcément dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Il paraîtrait donc intéressant, au moins lorsqu'il y a des enfants, qu'il puisse y avoir le regard d'un juge, même lorsqu'il n'y a pas de conflit. M. Pascal Clément : Mais cela reviendrait à reconnaître une famille qui n'a pas d'existence juridique. Il s'agit simplement d'enfants élevés par des parents qui, parce qu'ils ne sont pas mariés, ne leur offrent pas la protection juridique qui est celle du mariage. Il n'y a donc pas de raison que le juge aux affaires familiales intervienne systématiquement. En revanche, s'il y a danger pour l'enfant, le juge pour enfants intervient. Mme la Rapporteure : J'ai bien compris que vous ne souhaitez pas définir le mariage comme l'union de deux personnes de sexe différent. C'est une demande émise par un certain nombre d'associations. Je me ferai par ailleurs le porte-parole du président du groupe UMP qui aimerait savoir si la Chancellerie envisage de lutter contre les PACS de complaisance qui procureraient certains avantages, notamment dans l'éducation nationale. S'agissant du divorce, vous nous avez dit que le créancier d'aliments dispose de nombreux moyens de contraindre le débiteur défaillant à s'acquitter de ses obligations. Sans doute, mais sous quel délai, à quel prix, avec quelles difficultés, en particulier lorsque le débiteur défaillant n'est pas salarié ? Enfin, s'agissant de l'affaire du partage de l'autorité parentale soumise à la Cour de cassation, ne pensez-vous pas qu'il appartient au législateur et non pas à la Cour d'apporter une réponse ? M. Pascal Clément : J'ai répondu sans répondre, vous l'aurez bien compris, s'agissant de la définition du mariage. Sur le PACS, il paraît nécessaire de dresser un bilan. Il y a eu en France, depuis 1999, 169 531 déclarations, 1 343 refus d'inscription, 540 modifications et 21 531 dissolutions. La proportion de dissolution est donc faible. Le « faux » PACS est, semble-t-il, une rumeur, que nous nous employons à vérifier et je vous dirai donc ultérieurement ce qu'il en est. Mais la Chancellerie n'y croit pas beaucoup, car un certain nombre d'avantages liés au PACS tiennent à la durée : par exemple, il faut deux ans de vie commune pour bénéficier des avantages fiscaux, ce qui pousse à une certaine stabilité. Mme la Rapporteure : L'amendement Sarkozy n'a-t-il pas supprimé les deux ans de vie commune sur la déclaration fiscale ? M. Pascal Clément : Non ! J'ajoute que l'Assemblée tomberait sous le coup de l'article 40 de la Constitution si elle proposait d'octroyer des avantages financiers aux couples pacsés. Mme la Rapporteure : Êtes-vous pour ou contre l'enregistrement du PACS en mairie ? M. Pascal Clément : Je n'y ai pas réfléchi. M. Pierre-Louis Fagniez : Nous apprécierions une réponse spontanée... M. Pascal Clément : Elle l'est : je n'ai pas réfléchi aux conséquences d'un tel enregistrement. Le tribunal d'instance me paraît quand même mieux, car il s'agit d'état civil et je ne vois pas vraiment l'avantage, autre que symbolique, d'aller en mairie. Depuis plus de six mois la Chancellerie réfléchit aux PACS. En l'état actuel des choses, il apparaît qu'il faut conserver l'économie générale du contrat, qui doit demeurer un contrat de couple sans vocation à constituer la fondation d'une famille. Il est appelé à rester ouvert tant aux homosexuels qu'aux hétérosexuels. Il faudrait par ailleurs simplifier et assouplir les relations pécuniaires entre partenaires, tout en prenant en compte la nécessaire protection des tiers. S'agissant du divorce, il me semble que la loi permet de récupérer relativement facilement des pensions alimentaires en cas de carence du débiteur d'aliments. Sur le plan civil, depuis 1973, les pensions alimentaires bénéficient d'un régime dérogatoire destiné à assurer leur recouvrement. Ainsi, l'huissier de justice a été nanti de pouvoirs renforcés en matière de recouvrement des créances alimentaires. Par ailleurs, il suffit que le créancier d'aliments justifie du caractère infructueux d'une tentative d'exécution de son titre pour avoir la possibilité d'obtenir, par l'intermédiaire du procureur de la République, le recouvrement de sa créance par le Trésor public. Celui-ci pourra alors utiliser les procédures particulièrement contraignantes habituellement applicables à la perception des contributions directes. Le créancier d'aliments qui remplit les conditions pour demander le recouvrement public a également la possibilité de solliciter une avance sur pension - ce qui rejoint un peu ce que vous proposez - auprès des caisses d'allocations familiales, habilitées à prélever des sommes à cet effet sur leur fonds d'action sanitaire et sociale. La caisse se trouve alors subrogée de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances. Enfin, le législateur a créé une prestation spécifique, l'allocation de soutien familial, au profit du parent privé de créance alimentaire. Dès lors que le débiteur se soustrait totalement ou partiellement au versement d'une pension alimentaire fixée judiciairement, le créancier peut demander aux organismes débiteurs des prestations familiales de lui verser une allocation de soutien familial, l'organisme se trouvant subrogé dans les droits des créanciers pour le recouvrement des sommes impayées. On maintient donc le principe de la solidarité intrafamiliale, mais tout en laissant en arrière plan la solidarité nationale. M. le Président : Le PACS est un sujet que j'aborde peu au sein de cette Mission, d'abord parce que je ne veux pas apparaître monomaniaque, ensuite parce que de très nombreuses autres questions sont à traiter. Je rappelle néanmoins, s'agissant de l'imposition commune, que le délai de carence de deux ans fixé par la loi de 1999 est tombé. Le garde des Sceaux a néanmoins raison de dire que, si le PACS est dissout l'année de la déclaration ou la suivante, les co-contractants se retrouvent dans le contexte d'une imposition séparée. Lorsque nous avons dressé, deux ans après l'adoption de la loi, avec Jean-Pierre Michel, le bilan du PACS, nous avions déjà traqué cette rumeur des PACS de complaisance, notamment en vue de faciliter les mutations dans l'administration. Une enquête auprès de la Chancellerie et de l'éducation nationale nous avait montré qu'il s'agissait d'un phénomène suffisamment marginal pour rester du domaine de la rumeur. Par ailleurs, l'enregistrement en mairie ne me paraît pas une obligation, et n'est pas une revendication des personnes les plus concernées. En revanche, sans doute serait-il nécessaire que l'existence du PACS soit mentionnée en marge de l'acte de naissance. En effet, certaines professions juridiques, en particulier les notaires, inondent les tribunaux d'instance de demandes de certificats de non-PACS. Enfin, dans une lettre que je vous ai adressée le 5 octobre 2005 et dont vous avez aimablement accusé réception le 7 novembre, je vous rappelais que j'avais fait voter, dans la loi du 6 août 2004, qui adaptait la CNIL aux réalités de l'internet, un amendement, accepté par le Gouvernement, qui nous permettrait aujourd'hui de disposer enfin de statistiques plus précises sur qui sont les pacsés, quel est leur âge, quelle est la durée moyenne des PACS, dans quelles conditions ils prennent fin, combien il y a de PACS entre couples de même sexe et entre couples de sexe différent. Il semble qu'il soit difficile de mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires pour élaborer, au sein de votre ministère, ces statistiques. Pourtant, alors que le Gouvernement annonce une réforme du PACS pour le début de l'année prochaine, il serait fort utile à l'Assemblée de pouvoir disposer de ces données que la loi permet désormais de collecter. M. Pascal Clément : Nous aurons courant janvier ces statistiques qui permettront de tirer un certain nombre de leçons. Alors qu'un tiers des mariages aboutissent à des divorces, un huitième seulement des PACS sont dissous. Sans doute s'agit-il d'une institution récente... M. Sébastien Huyghe : En effet, il n'y a pas encore de « PACS d'or »... M. Pierre-Christophe Baguet : Le nombre des dissolutions augmente-t-il par rapport aux premières années d'application de la loi de 1999 ? Mme la Rapporteure : Cela pourrait aussi tenir à une augmentation des mariages entre gens pacsés. M. Pascal Clément : On ne le sait pas encore, on vous le dira en janvier. Mais pour cette année, il y a eu 1 662 dissolutions au premier trimestre et 1 846 au deuxième : je ne crois pas qu'on puisse parler de tendance... M. le Président : Nous disposons en effet déjà de quelques chiffres qui nous ont aimablement été transmis par la Chancellerie. Ils montrent que nous sommes passés de 6 151 PACS en 1999, à 22 176 en 2000, 19 632 en 2001, 25 311 en 2002, 31 585 en 2003, 40 093 en 2004 et 24 483 au premier semestre de cette année. Mme la Rapporteure : La mode prend... M. Pascal Clément : Il s'agit d'un contrat relativement récent. Sur l'enregistrement, je pense que vous tomberez d'accord avec le projet de loi, qui retient plutôt la solution du tribunal d'instance et qui prévoit la mention en marge de l'acte de naissance, tout en respectant l'anonymat et le secret sur le sexe du partenaire, afin de protéger la vie privée. Pour le reste, la question est de savoir à quel niveau on met le curseur pour fixer les avantages octroyés aux pacsés, mais cela relève moins de la Chancellerie que du ministère du budget. M. le Président : Monsieur le garde des Sceaux, je vous remercie. Audition de M. Hubert Brin, Présidence de M. Patrick Bloche, Président M. le Président : J'ai le plaisir d'accueillir M. Hubert Brin, président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) et Mme Chantal Lebatard, administratrice. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau, après vous avoir entendus au début de nos travaux. Comme vous le savez, notre Mission a organisé une série d'auditions et de tables rondes sur le droit de la famille. Nous avons en effet souhaité examiner l'organisation juridique de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, afin de vérifier si les droits de l'enfant sont suffisamment garantis par notre législation, et plus particulièrement par les règles applicables au couple, à la filiation et à l'autorité parentale. Nous arrivons au terme de ces auditions, au cours desquelles nous avons entendu des points de vue très différents. Nous souhaitons donc connaître la position de l'UNAF sur les pistes d'évolution possibles de notre droit de la famille. À cette fin, les principales questions qui nous sont posées vous ont été communiquées. M. Hubert Brin : Je vous remercie de nous recevoir une seconde fois. Mon intervention sera brève, car Mme Chantal Lebatard traitera mieux que moi des questions de droit. Je dirai seulement que l'UNAF est dubitative. Nous nous interrogeons sur la nécessité de modifier encore des textes du droit de la famille pour la plupart récents. Quel sens et quel rôle donne-t-on au droit en cherchant ainsi à corriger des lois qui n'ont pas produit tous leurs effets et qui n'ont pu être évaluées faute de recul ? Je suis tenté de dire que ce n'est pas l'amour qui crée des droits et des devoirs à l'égard d'un enfant, mais l'inscription de l'enfant dans une chaîne générationnelle par la filiation. Que l'on ne se méprenne pas : je ne dis pas, bien sûr, que l'amour n'a pas d'importance. Au contraire, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir un père et une mère qui l'aiment dans la durée. Ces remarques liminaires étant faites, Mme Chantal Lebatard vous donnera les réponses plus précises que vous attendez de nous. Mme Chantal Lebatard : Vous nous avez demandé notre opinion sur les propositions contenues dans le rapport sur le PACS remis en novembre 2004 à M. Dominique Perben, et s'il fallait, selon nous, promouvoir le mariage. Je rappelle que le rapport remis à la chancellerie répondait à la volonté du Gouvernement d'améliorer le PACS, dès lors qu'il a été décidé de ne pas accéder à la demande d'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Les propositions avancées tendent à rapprocher le PACS du mariage, sans rendre la dissolution du pacte plus difficile et sans qu'il entraîne des conséquences quant à l'établissement des filiations. Or, tel qu'il a été défini en 1999, le PACS s'applique à deux personnes physiques majeures, quel que soit leur sexe. À l'époque déjà, afin de bien distinguer le PACS du mariage, l'UNAF avait souhaité qu'un texte spécifique s'applique aux unions homosexuelles. En rapprochant maintenant le PACS du mariage, on brouille les cartes et l'on crée une sorte de sous-mariage, ce qui ne clarifie pas le débat, n'assure pas la protection des intéressés et suscite des ambiguïtés. La position de l'UNAF n'a pas varié, et nous continuons de demander une union juridique spécifique pour les personnes de même sexe, solution que vient d'ailleurs d'adopter la Grande-Bretagne. S'agissant de la promotion du mariage, la première chose à faire est de ne pas créer de confusion en lui opposant une structure concurrente. Nous regrettons d'autre part que le site mariage.gouv.fr, qui répond à une demande de l'UNAF, laquelle a participé à son élaboration, n'ait pas été lancé avec davantage de solennité. La création du site a été longtemps différée et il a été ouvert, sinon clandestinement, du moins sans publicité, alors même que son installation répond à une demande instante de nombreux maires. L'idée est que chacun puisse savoir dans quel type d'union il veut s'inscrire, qu'il sache les droits et les devoirs qui y sont liés, les attentes de la société au regard des engagements pris, le dispositif de protection et de recours. En résumé, mieux vaut améliorer l'information sur le mariage que procéder à des modifications législatives qui ajouteraient à la confusion. Vous nous demandez ensuite si l'on peut permettre à des concubins d'adopter conjointement. L'UNAF s'y oppose car le concubinage est une union de fait et non une union légale. L'autorité parentale conjointe s'inscrit tout naturellement dans le mariage ; s'en tenir à ces dispositions est ce qu'il y a de plus simple et de plus clair. D'autre part, ouvrir l'adoption conjointe au concubin serait, de facto, l'ouvrir aux concubins du même sexe, ce que l'UNAF n'est pas prête à accepter. Je rappelle d'ailleurs que, lors des débats sur le PACS, le rapporteur de la proposition de loi, le garde des Sceaux de l'époque et les associations qui avaient porté cette revendication s'étaient formellement engagés à renoncer à l'ouverture de l'adoption aux couples homosexuels. Il convient donc d'en rester là. Pour ce qui est de l'adoption par une personne seule, il est certain que, si la proposition en était faite aujourd'hui, elle ferait largement débat en notre sein. Mais la disposition existe, et l'UNAF comprend des associations de familles monoparentales. Si l'on ne peut revenir sur la disposition, il convient néanmoins de dresser le bilan de son application pour vérifier si elle répond à l'objectif de l'adoption qui est, je le rappelle, de procurer une famille à un enfant qui en est dépourvu, et non de répondre à un désir d'enfant. Tel est bien le cadre dans lequel l'adoption a été ouverte aux personnes seules. L'UNAF s'oppose à l'assistance médicale à la procréation pour une femme seule, même si la pratique du « tourisme procréatif » est avérée et que des moyens de contourner la loi existent. Nous serions seulement favorables à une modification législative autorisant le transfert d'embryon vers la mère après le décès du père, car la situation actuelle est d'une grande cruauté. Tout conscients que nous soyons des risques psychologiques et des difficultés juridiques qui peuvent se poser, nous considérons que, s'il est un point sur lequel la loi peut évoluer, c'est celui-là. Parce qu'elle considère que l'assistance médicale à la procréation n'a pas pour obligation de répondre à tous les désirs d'enfant, l'UNAF s'oppose à la gestation pour compte d'autrui. Il est vrai que l'infertilité peut faire souffrir les couples, mais il arrive aussi qu'on leur fasse parfois miroiter la réussite, qui n'est qu'hypothétique, de techniques éprouvantes et d'un parcours de soins crucifiant ; il conviendrait de revoir cet « acharnement procréatif » dramatiquement décevant. On ne peut faire sienne la conception selon laquelle la médecine serait tenue de répondre à tous les désirs d'enfant, particulièrement lorsqu'il s'agit de gestation pour autrui, pratique qui méconnaît les liens qui se créent entre une mère et son enfant au cours de la grossesse, et qui instrumentalise le corps de la femme, ce qui n'est pas acceptable. Se pose, certes, le problème de l'établissement de la filiation maternelle des enfants déjà nés dans ces conditions. Le recours à une filiation adoptive serait un détournement de l'esprit et de la lettre de l'adoption. On ne peut accepter l'instrumentalisation qui consiste à faire naître sciemment un enfant pour ensuite l'adopter. C'est pourquoi il faut laisser au juge le soin d'apprécier les situations et de dénoncer au cas par cas de tels détournements de l'adoption. La filiation n'est pas le simple enregistrement par le droit d'un désir d'enfant à tout prix. Vous nous interrogez sur la question de l'accès de l'enfant à ses origines personnelles. L'UNAF avait soutenu la loi du 22 janvier 2002 qui instaurait le Conseil national d'accès aux origines personnelles, texte qui permettait un équilibre entre le souhait de l'enfant de connaître l'histoire dont il est issu et le droit de la mère à accoucher en préservant le secret de son identité. Cet équilibre délicat doit être maintenu et le dispositif se met en œuvre, mais il doit assumer un héritage pratique : des dossiers lacunaires. Nous n'en sommes qu'au début de l'application de ce texte, il faut être vigilant sur les difficultés éventuelles qui pourraient surgir, mais il nous paraît difficile d'aller beaucoup plus loin. Reste le problème du père. Comment, en effet, concilier le droit de la mère d'accoucher sous X et le fait que le père ait pu procéder à une reconnaissance anténatale ? Faut-il légiférer, au risque de devoir lancer des enquêtes qui retarderaient l'adoption des enfants ? Ce qui est inscrit dans la loi est raisonnable, mais l'on pourrait améliorer le texte en disposant que, au moment de la reconnaissance anténatale, le père doit être informé de la possibilité qui s'offre à lui, en cas de besoin, de saisir le procureur de la République pour faire procéder, selon les termes de la loi, à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. Peut-être faudrait-il aussi revoir la disposition qui autorise la levée du secret après la mort de la mère, si celle-ci n'y a pas fait expressément opposition de son vivant. La question est très difficile : des personnes nées sous X attendraient le décès de leur mère de naissance pour accéder à leur dossier, pour passer outre le refus qu'elle leur oppose de son vivant. De fait, on a créé un déséquilibre qui ne s'explique guère en autorisant la levée du secret dans ce cas, tout en interdisant l'accès aux origines génétiques pour établir une filiation si une opposition a été formulée du vivant du présumé géniteur. La situation n'est pas le même en cas d'insémination artificielle avec donneur. Dans les cas d'accouchement sous X, même si elle a été douloureuse, il y a eu une histoire de couple. Lors du don de gamète et singulièrement de sperme, il n'y a eu, en fait, que mise à disposition d'un couple d'un « matériel génétique » dont la finalité est une procréation à l'intérieur de ce couple. L'histoire n'est pas la même, la demande non plus. D'ailleurs, les centres d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains indiquent recevoir très peu de demandes de levée de l'anonymat après des dons de sperme. La situation est différente en cas de don d'ovocyte, car, l'impact physique et psychologique n'étant pas le même, il est arrivé que des donneuses demandent ce qu'il est advenu de leur don. Une émission télévisée récente, réalisée aux États-Unis, montrait les difficultés de relation entre la mère de naissance et la donneuse en cas de don non anonyme, en particulier lorsque les dons ont été faits par des proches de la mère. Cela nous conduit à préconiser, pour préserver la maternité qui se construit, le maintien de l'anonymat pour l'ensemble des dons de gamètes. Toutefois, il sera difficile de tenir cette position devant la fragmentation croissante de la filiation, qui rend très compliquée la construction de l'identité. Le Comité consultatif national d'éthique a d'ailleurs le plus grand mal à formuler un avis à ce sujet. La question est d'une acuité plus grande encore lorsqu'il s'agit de l'accueil d'un embryon, car les conséquences psychologiques de la révélation de cette histoire particulière à un enfant peuvent être graves. L'enfant concerné a en effet été l'objet d'un don mais aussi d'un abandon ; il est fondé à s'interroger pour savoir pourquoi c'est lui qui a été choisi pour être donné, et à se poser des questions sur ses frères et sœurs. Mais nous manquons de recul sur cette question. S'agissant de l'exercice de l'autorité parentale, j'ai déjà eu l'occasion d'exposer que, pour l'UNAF, un enfant a droit à deux parents et doit pouvoir conserver des liens durables avec les deux, même s'ils se séparent. Ce qui prime, c'est que l'enfant se sente en permanence en confiance avec son père et avec sa mère, et aussi qu'il sache quelle est sa situation exacte et ce qui va se passer. L'important est de prendre en considération l'intérêt de l'enfant, ses besoins et d'entendre ses désirs. Une fois posé le principe fondateur qu'un enfant a droit à ses deux parents et qu'en conséquence, si les parents se séparent, la résidence alternée est de plein droit, il n'y a pas à légiférer. Ce qui est nécessaire, c'est d'aider les parents, et les services de médiation ont un rôle de premier plan à jouer. Les parents doivent aussi apprendre à tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant et comprendre que les choses ne sont pas inscrites dans le marbre mais qu'elles sont modulables. Cela ne signifie aucunement qu'il faille instaurer une sorte de « service à la carte » pour les enfants, car il faut distinguer prise en compte de l'intérêt de l'enfant et obligation de suivre ses désirs : séparés ou non, les parents restent les parents, et ce sont eux qui prennent les décisions. Il revient au juge d'homologuer les conventions élaborées par consensus entre les parents, et l'on constate que les couples qui choisissent d'organiser la résidence alternée le font le plus naturellement possible, l'enfant devant, pour sa part, s'accommoder de la séparation de ses parents. Reste en suspens la question de la gratuité de la médiation. Pour la rendre accessible au plus grand nombre de couples possible, il serait bon d'instituer un mécanisme d'aide. Ainsi, les parents ne pourraient utiliser le prétexte du coût pour ne pas recourir à la médiation. Voilà pourquoi il conviendrait de décider que la première séance de médiation est gratuite, le dispositif étant financé par les caisses d'allocations familiales, avec l'objectif de parvenir au meilleur accord possible. Ensuite, la contribution des parents serait adaptée aux ressources de l'un et de l'autre. Pour ce qui est d'instituer un barème des pensions alimentaires, on peut concevoir un barème indicatif, puisque les juges semblent le souhaiter, mais son application ne devrait pas être automatique. D'autres éléments doivent être pris en considération, en particulier la manière dont le temps de garde de l'enfant est partagé entre les parents. L'UNAF s'est déjà prononcée, par ma voix, en faveur de la création d'un fonds d'avance de paiement des pensions alimentaires. Suppléer ainsi aux carences de versements de pensions alimentaires éviterait que, lorsqu'un parent est défaillant, l'autre soit contraint de se tourner vers la justice, ce qui empoisonne l'ensemble des relations familiales, celles entre les anciens conjoints bien sûr, mais bien souvent aussi celles entre les enfants et l'un ou l'autre des parents. J'en viens à la place du beau-parent. Nous avions été très fermes à ce sujet dans un premier temps, considérant qu'il ne convenait pas d'instituer quelque statut que ce soit aussi longtemps que le père de naissance n'avait pas été réinstallé dans la plénitude de ses droits, ce que la loi sur l'autorité parentale du 4 mars 2002 a permis. Le texte prévoyant des modalités de délégation de l'autorité parentale, il ne faut pas aller plus loin, au risque, sinon, d'introduire la confusion dans l'esprit de l'enfant, qui doit garder des liens avec ses deux parents de naissance. Il existe, c'est vrai, des cas d'abandon total, mais les moyens existent de les pallier. N'inscrivons pas dans la loi une disposition qui risquerait de faire prendre au beau-parent la place d'un parent. Il ne faut pas introduire de confusion et le législateur ne doit surtout pas intervenir en ce sens. J'en viens pour finir à la question des grands-parents, sujet sur lequel l'UNAF s'interroge, car la question est nouvelle. La loi doit-elle intervenir pour codifier les relations entre enfants et grands-parents ? On risque de créer des difficultés en allant dans cette voie, et la législation contient, nous semble-t-il, des dispositions en nombre suffisant pour en rester là. Plutôt que de judiciariser les rapports familiaux, mieux vaut renforcer la médiation en cas de conflit. Les enfants ont le droit de rencontrer leurs grands-parents, mais est-ce une obligation absolue ? Surtout, cela ne créerait-il pas un droit pour les grands-parents d'intervenir dans la vie familiale de leurs enfants ? Je rappelle que le texte portait sur les droits de l'enfant et non sur les droits des grands-parents. M. Hubert Brin : Vous nous avez aussi demandé s'il nous semblait nécessaire de modifier la définition des associations familiales. Je rappelle les critères qui, pour nous, les définissent : ce sont les associations qui regroupent les familles fondées sur le mariage, ou sur la filiation, ou sur l'exercice de l'autorité parentale. C'est donc une acception large de la notion de famille et, sauf à dire qu'un individu seul constitue une famille, je ne vois pas ce que l'on pourrait ajouter à une définition déjà souple. M. le Président : Je vous remercie tous les deux pour ces exposés dont on sent qu'ils traduisent un très fort investissement personnel et je tiens à vous rassurer : les positions que vous avez exprimées présentent une grande cohérence avec celles du garde des Sceaux, que nous venons d'entendre... J'ai entendu M. Brin exposer que, pour l'UNAF, la famille est fondée soit sur le mariage, soit sur la filiation, soit sur l'exercice de l'autorité parentale. Ai-je bien compris que vous ne restreignez pas la famille à la famille mariée ? M. Hubert Brin : Cette définition de la famille remonte à 1989 ; ce n'est donc pas une position récente de notre institution. M. Jean-Marc Nesme : Je profite de la présence de M. Hubert Brin pour rappeler avoir déposé, il y a deux ans, une proposition de loi qui donnait la possibilité à l'UNAF d'avoir accès au secteur public de l'audiovisuel, comme l'ont les syndicats et les partis politiques. M. Raffarin et le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel étaient parfaitement d'accord avec cette idée, mais la proposition n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée. Je souhaite que la Mission la reprenne dans ses conclusions. M. le Président : J'ai constaté que la famille fait l'objet d'innombrables débats et enquêtes à la télévision. La proposition de notre collègue Jean-Marc Nesme signifie-t-elle donc que l'UNAF ne siège pas au conseil d'administration de France Télévisions ? M. Hubert Brin : En effet. Le service public de l'audiovisuel est le seul service public dont les usagers ne sont pas représentés au conseil d'administration. Mme la Rapporteure : L'UNAF est-elle opposée à certaines des propositions du groupe de travail de la Chancellerie sur le PACS ? Mme Chantal Lebatard : Ce n'est pas que des dispositions particulières nous gênent, c'est que la démarche ne nous convient pas, car le texte organise un statut de couple en créant une ambiguïté qui ne nous donne pas satisfaction et qui n'a pas beaucoup de sens. M. le Président : Pour que les choses soient claires, je rappelle que la création du PACS a découlé de la volonté expresse du législateur de créer un cadre juridique commun aux couples de même sexe et aux couples de sexe différent, car procéder différemment aurait été discriminatoire. M. Patrick Delnatte : Le statut qui a été adopté en Angleterre pour les homosexuels est une copie conforme du mariage. Mme Patricia Adam : Interrogés sur l'adoption par les concubins, vous avez expliqué que l'UNAF n'est pas favorable au concubinage, car ce n'est pas un statut qui organise la famille. J'observe que l'on peut adopter si l'on est seul et qu'après avoir adopté, on peut vivre en concubinage et même se marier, mais qu'il ne peut, en l'état, y avoir de filiation entre l'enfant adopté et le compagnon. Dans le même temps, M. Hubert Brin a exposé que, pour l'UNAF, la famille est fondée soit sur le mariage, soit sur la filiation, soit sur l'exercice de l'autorité parentale. Autrement dit, si l'autorité parentale partagée est exercée par des concubins, ils constituent une famille. Pourquoi, alors, s'opposer à ce qu'ils adoptent ? Mme Chantal Lebatard : Pour l'UNAF, l'autorité parentale partagée s'inscrit dès le départ et tout naturellement dans le mariage. En dehors du mariage, l'union de fait n'implique aucun cadre juridique dans lequel l'autorité partagée peut s'inscrire. Je le redis, l'adoption n'est pas faite pour combler un désir d'enfant ; si un couple veut adopter, il peut se marier. L'adoption a été conçue pour permettre à un enfant de trouver une famille pour remplacer celle qui lui fait défaut. Il y a, dans les demandes d'adoption par le concubin, l'idée sous-jacente que l'on a droit à un enfant parce que l'on est concubin. Dans ce cas, il est légal de recourir à la procréation médicalement assistée, mais il faut réserver l'adoption aux couples mariés. Cette position de l'UNAF est ancienne, et elle s'exprime encore plus fortement actuellement, car nous ne voulons pas que l'adoption par les concubins serve à installer l'homoparentalité. Je suppose que c'est ce que vous vouliez nous faire dire. Mme Patricia Adam : En effet, je tenais à ce que les choses soient clairement dites. M. Hubert Brin : Cette position est celle de l'UNAF de longue date. Si la question avait été posée à nouveau à notre conseil d'administration, une évolution aurait été possible, mais la confusion entre concubinage hétérosexuel et concubinage homosexuel crée un blocage. Mme Patricia Adam : Si l'on interdisait l'adoption par les concubins homosexuels, vous ne seriez pas opposé à l'adoption par les concubins hétérosexuels ? M. Hubert Brin : La question serait reposée dans l'institution. M. le Président : Je rappelle qu'une personne seule peut adopter mais qu'elle n'a pas accès à la PMA, que les couples hétérosexuels mariés peuvent adopter et que les concubins hétérosexuels peuvent accéder à la PMA. Il y a là des incohérences sur lesquelles on ne peut pas ne pas s'interroger dans un pays où 50 % des enfants naissent hors mariage. Dans un autre domaine, je crois savoir que SOS Papa a adhéré à l'UNAF. L'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) est-elle toujours à la porte ? Mme Chantal Lebatard : L'APGL n'a pas reformulé de demande d'adhésion. M. Hubert Brin : La réponse qui a été faite à l'APGL est qu'une association de parents au sens biologique ou juridique pourrait être agréée quand bien même les parents seraient homosexuels, car le critère d'agrément n'est pas la sexualité mais la charge d'enfants. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est la reconnaissance de l'ami comme coparent, et de la PMA et de l'adoption par les futurs parents. Mme la Rapporteure : Notre Mission est elle-même très partagée quant à l'adoption par les concubins, y compris par les concubins hétérosexuels, certains d'entre nous considérant que l'engagement dans la durée que traduit le mariage est une garantie supplémentaire pour l'enfant. Mme Patricia Adam : Tous les mariages ne s'inscrivent malheureusement pas dans la durée... M. Hubert Brin : L'UNAF pourrait faire la distinction entre l'engagement public, que traduisent le mariage et le PACS, et l'union libre, qui relève du domaine privé. Il est en effet légitime de s'interroger sur le point de savoir si l'engagement public n'apporte pas une garantie supplémentaire à l'adoption. M. le Président : Le garde des Sceaux vient de nous expliquer que le PACS est l'institution la plus solide : il s'en dissout très peu... Mme la Rapporteure : Voilà ce qui s'appelle une interprétation libre des propos du ministre de la justice ! M. le Président : Madame Lebatard, Monsieur Brin, je vous remercie. Audition de M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, Présidence de M. Patrick Bloche, président M. le Président : Nous accueillons M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous le savez, notre Mission a organisé cet automne une série d'auditions et de tables rondes sur le droit de la famille. Nous avons en effet souhaité examiner l'organisation juridique de la famille sous l'angle de l'intérêt de l'enfant, afin de vérifier si les droits de l'enfant sont suffisamment garantis par notre législation, et plus particulièrement par les règles applicables au couple, à la filiation et à l'autorité parentale. Nous arrivons avec vous au terme de ces auditions, au cours desquelles nous avons entendu des points de vue très différents. Nous souhaiterions donc examiner avec vous les pistes d'évolution possibles de notre droit de la famille. À cette fin, les principales questions qui nous sont posées vous ont été communiquées. Je vais donc vous laisser la parole, et après votre intervention nous poursuivrons cette audition en vous posant des questions. M. Philippe Bas : Je vous remercie de me recevoir à nouveau. J'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt, voici quelques mois, des premières conclusions de vos travaux. Le Président de la République et le Premier ministre m'ont demandé de préparer, d'ici au printemps, une réforme de la protection de l'enfance, et vos conclusions inspireront naturellement l'essentiel des propositions que nous serons amenés à faire, au terme d'un débat public décentralisé que j'ai demandé aux présidents de conseils généraux d'engager avec les tribunaux de grande instance, les procureurs, les inspections académiques, les services sociaux et hospitaliers, afin de vérifier que les différents points de vue sont bien en train de se rapprocher. Vous avez certes pu le percevoir au cours de vos auditions, et je le perçois moi-même par des contacts que j'ai, mais il est indispensable qu'il y ait des lieux où matérialiser ce rapprochement. Au-delà de la loi elle-même, en effet, c'est l'évolution des pratiques professionnelles, des doctrines - parfois trop rigides - qui permettra d'améliorer le dispositif. C'est aujourd'hui sur la deuxième étape de vos travaux que je suis amené à m'exprimer. J'ai pris connaissance de votre questionnaire, et peut-être n'aurai-je pas le temps d'y répondre en totalité ce matin. Pour ne pas être trop long, j'exposerai surtout les principes qui guident mon approche des différents points sur lesquels vous m'avez interrogé, de sorte que vous ayez tout loisir, ensuite, de me faire préciser ceux que j'aurais omis ou sur lesquels je n'aurais pas été assez explicite. Le premier de ces principes est la nécessité de veiller à ce que les enfants se sentent pleinement pris en considération et ne souffrent pas de la variété des situations résultant de l'évolution des structures familiales. J'avais lu avec beaucoup d'intérêt, il y a quelques années, le rapport d'Irène Théry qui présentait un panorama objectif de ces situations, et dont il ressortait que 83 % des enfants vivaient avec leur père et leur mère sous le même toit. Qu'on le veuille ou non, c'est cette situation qui, en occident du moins, est la norme de référence, et qui doit servir de point de départ à toute réflexion sur la famille - pardonnez moi si j'enfonce là des portes ouvertes -. Pour autant, il y a aussi, à la suite de décès, de divorces ou de séparations, des familles monoparentales, recomposées, homoparentales : toutes ces situations existent et méritent que l'on en tienne compte, en respectant cependant une exigence fondamentale, qui est l'intérêt de l'enfant. Ce sont en effet des situations dans lesquelles il y a des épreuves et des souffrances pour l'enfant, et ce n'est pas parce que, grâce à la maturité des parents ou des beaux-parents, elles se surmontent de mieux en mieux, qu'elles ne sont pas réelles. Il n'est pas inutile de le rappeler. Nos pratiques et nos règles doivent donc viser à ce que ces enfants se sentent pris en considération et ne souffrent pas du jugement des autres. J'assistais récemment au colloque « Adoption et école » organisé par des associations de parents adoptifs, dont certains soulignaient que l'école avait beaucoup de mal à intégrer, dans ses programmes mêmes, la particularité des enfants adoptés : l'apprentissage des repères temporels, par exemple, tend à considérer comme allant de soi les diverses étapes de la vie de l'enfant dans sa famille à partir de sa naissance, ce qui peut heurter un enfant dont l'histoire personnelle n'est pas celle-là. Il nous faut veiller à ce que nos pratiques - aussi bien à l'école que dans les loisirs, les établissements de soins, etc. - et nos règles - en matière d'héritage ou de revenu familial, par exemple - ne pénalisent pas les enfants dont la situation est en soi handicapante, même si ce handicap peut être surmonté. Le deuxième principe, qui vous paraîtra peut-être excessif, est un principe que j'appellerais de prudence, de circonspection. Je crois qu'il faut éviter tout emballement et que l'on ne peut pas, dans un domaine tel que la loi civile, chercher à coller à tout prix à la variété des situations. La loi doit demeurer une référence pour tous, et ne peut s'adapter à chaque cas particulier. Il y a certes la liberté des uns et des autres, il y a certes les réalités de la vie sociale, mais elles ne suffisent pas à poser l'exigence de l'intervention du législateur. C'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer, et le législateur ne doit pas prendre le risque de multiplier les situations expérimentales, qu'elles soient imposées par les réalités de la vie ou qu'elles découlent de l'exercice de la liberté des adultes. Le fait que ces situations puissent se rencontrer et que les enfants puissent y trouver un cadre favorable à leur épanouissement ne suffit pas pour considérer qu'elles doivent donner lieu à l'intervention du législateur. C'est pourquoi je reste, comme je vous l'ai dit, prudent et circonspect - ce qui ne veut pas dire fermé ni bloqué -. Le troisième principe, que j'aurais d'ailleurs dû placer en premier, est celui de l'intérêt de l'enfant. Il y a des droits de l'enfant, il y a des devoirs des parents, mais il n'y a pas de « droit à l'enfant » qui serait imprescriptible et sacré. Il convient d'être intransigeant sur ce point. Il ne suffit pas qu'il ne soit pas démontré que telle ou telle situation ne porte pas préjudice à l'enfant pour que le législateur décide de la normer, de la consacrer, il faut encore démontrer qu'elle n'est pas susceptible de porter préjudice à l'enfant. Il y a là, comme dans le droit de l'environnement, une sorte de principe de précaution. C'est la simple existence du risque qui doit nous retenir, non la probabilité de sa réalisation. Si l'on applique ces principes à l'adoption, celle-ci se définit comme le fait de donner une famille à un enfant malheureux, et non comme le fait de donner un enfant à un couple ou à un adulte qui le désire et qui n'en a pas. Tant mieux, bien sûr, si cela permet aussi de satisfaire ce désir, mais cette satisfaction ne vient qu'en second. Quant à l'assistance médicale à la procréation, le législateur, qui a travaillé sur le sujet plus que sur aucun autre, sans doute, au cours des douze dernières années, lui a imposé deux conditions essentielles. En premier lieu, il l'a définie comme un geste médical, destiné à pallier la stérilité d'un couple dans la stricte mesure des moyens nécessaires : c'est la règle que le Parlement a adoptée en 1994 et confirmée en 2004. En second lieu, le couple en question doit être un couple stable - condition qui n'est peut-être pas toujours suffisamment vérifiée dans les faits - et composé d'un homme et d'une femme. Il ne s'agit pas de reconnaître la vocation des individus à mettre au monde et à élever des enfants, mais d'autoriser la médecine à venir en aide à un couple stable. Il ne saurait donc y avoir d'assistance médicale à la procréation de convenance. Vous aurez d'ailleurs observé que le terme n'est pas « procréation médicalement assistée », mais « assistance médicale à la procréation ». L'intervention du législateur consiste à définir cette assistance, à dire ce que le médecin a le droit de faire ou non. L'indisponibilité du corps humain découle des mêmes principes. Le commerce de la gestation et celui des gamètes, qu'il s'agisse d'ovocytes ou de spermatozoïdes, sont proscrits par notre législation. À plus forte raison celui de l'enfant lui-même, qui n'est pas une marchandise. Il serait inacceptable de s'engager dans un engrenage qui, de remise en cause en remise en cause, fût-elle marginale, aboutirait à bouleverser les principes fondamentaux sur lesquels reposent les droits de la personne humaine. L'exigence d'enfant comme accomplissement du couple conduit à des dangers. Parmi les cas de maltraitance, il y a beaucoup de parents par ailleurs instruits, certains ont même « bac plus 5 », comme dans un cas récent de maltraitance sur un bébé, dont les parents ont expliqué - car ils étaient tout à fait capables de s'expliquer - que cet enfant les avait « beaucoup déçus » ! Souvent l'enfant est désiré, l'enfant est rêvé, mais l'enfant est méconnu en tant que personne, et nous ne devons pas encourager cette conception de l'enfant comme accomplissement, comme simple témoignage de l'amour de deux adultes l'un pour l'autre, excluant d'une certaine façon l'enfant lui-même de cette relation. Il y a une sorte d'intolérance à la frustration : on revendique le droit de ne pas avoir d'enfant, le droit d'avoir un enfant dès qu'on en a envie, le droit d'avoir l'enfant qu'on veut. Le fait que la transmission parentale ne soit plus aussi naturelle qu'hier aboutit à une méconnaissance de l'enfant comme personne, qui est nuisible à son épanouissement. Aussi le seul conseil que je me permettrai de donner au législateur est d'être très vigilant face aux demandes de certains, qui ne sont pas tournées vers l'enfant lui-même, mais vers l'adulte. Vous déduirez de ce tableau très général mes réponses implicites sur certains points que je n'ai pas directement abordés, et que vos questions permettront peut-être d'éclairer. M. le Président : Je vous remercie d'avoir fait cette présentation générale des principes auxquels vous êtes attachés, et je donne maintenant la parole à ceux des membres de la Mission qui souhaitent revenir sur certains sujets. Mme Hélène Mignon : Vous avez écarté tout commerce d'ovocytes et, implicitement, la gestation pour autrui. Mais êtes-vous favorable à ce que le don d'ovocytes donne lieu à défraiement ? Par ailleurs, quelle est votre position, s'agissant notamment d'enfants adoptés, sur l'accès aux origines personnelles ? M. Philippe Bas : Vous avez légiféré voici quelques années sur l'accès aux origines, et créé un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. L'accouchement sous X, que vous avez maintenu, a été institué dans notre pays dans un but de prévenir l'infanticide et de permettre à des jeunes femmes d'éviter de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, par exemple quand elles ont dépassé le délai légal. Se pose alors la question du secret que la mère est en droit d'exiger. Dans le cadre légal actuel, la volonté de la mère doit être respectée, mais cette volonté peut changer par la suite, d'où l'utilité du Conseil national, qui permet à une personne ayant été abandonnée à sa naissance de mobiliser le concours d'un service public pour tenter d'approcher l'auteur de ses jours et de recueillir éventuellement quelques renseignements. C'est un système dont le fonctionnement n'est pas facile, et nous assistons à une surenchère de la part de certaines organisations, qui trouvent que le secret est respecté de façon trop stricte. À l'heure actuelle, nous n'avons pas le recul suffisant pour dire s'il faut faire évoluer le dispositif. M. Patrick Delnatte : Le juge a depuis quelque temps la faculté de faire preuve d'une plus grande souplesse en matière de garde alternée, mais tous les magistrats n'ont pas la même approche. Faut-il, selon vous, mieux encadrer la garde alternée ? Si oui, faut-il modifier la loi ou suffit-il de réorienter la pratique des juges ? M. Philippe Bas : Je n'ai pas d'opinion personnelle sur les vertus de la garde alternée. Je lis et j'entends cependant ce que l'on dit à ce sujet, et dont il ressort qu'elle n'est pas la panacée. Elle a fait l'objet d'un certain engouement, dont il me semble que l'on est en train de revenir un peu. La question ne se pose pas de la même façon selon que l'enfant a trois mois ou quatorze ans, selon que les parents habitent la même rue ou aux deux bouts de la France, selon qu'ils ont reconstitué un couple chacun de leur côté ou non. La séparation des parents est toujours une souffrance, que nous sommes soucieux d'apaiser autant que possible. Tout esprit de système serait très dangereux, et ma conviction est donc que la réponse à apporter est plus judiciaire que législative, car le juge est plus à même de tenir compte des situations particulières. Mais il y a, je le crois, beaucoup de cas où l'on est allé trop vite et trop loin dans la mise en pratique d'une solution que le législateur a conçue comme une commodité supplémentaire n'ayant pas forcément vocation à devenir une norme - ce qu'elle ne doit pas être, à mon sens, car cela pourrait créer une source supplémentaire d'instabilité -. Mme Martine Aurillac : Vous avez évoqué les différences de situations individuelles ou conjugales. Le PACS, quelle que soit l'opinion qu'en en a, est une situation désormais assez répandue : il en a été signé, à ce jour, quelque 170 000. Nous réfléchissons actuellement aux améliorations à lui apporter, notamment pour améliorer la protection des partenaires et les conditions de dissolution du pacte. Qu'en pensez-vous ? M. Philippe Bas : L'une des grandes forces du mariage, c'est, paradoxalement, le divorce. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas la répudiation. Il y a en effet des obligations des deux parents Mme Nadine Morano : Nous sommes, comme vous, attentifs à l'intérêt de l'enfant. S'agissant des naissances sous X, nous savons que les enfants ne connaissant pas leurs origines personnelles subissent de graves troubles psychologiques... M. Philippe Bas : Je dirais plutôt qu'ils peuvent en subir... Mme Nadine Morano : Mais il y a aussi la question des maladies héréditaires ou génétiques dont ils peuvent être atteints sans le savoir. Étant donné qu'une femme qui accomplit la démarche d'accoucher sous X le fait dans le souci de protéger son enfant, ne pourrait-on imaginer, comme le proposent certaines associations, qu'en plus de l'enveloppe fermée contenant, le cas échéant, les informations sur l'identité de la mère, il y ait une seconde enveloppe, qui renfermerait des données biologiques ou médicales susceptibles d'être utiles à son enfant, notamment à des fins de prévention ou quand il sera lui-même en âge d'avoir des enfants. J'ai une deuxième question, qui porte sur les divorces difficiles ou conflictuels. Au cours de notre voyage au Canada, nous avons appris que la médiation familiale y est obligatoire dès le début de la procédure, et que les premières séances sont même gratuites. Nous voudrions renforcer le rôle de la médiation familiale, notamment pour que chacun des deux parents évite les mots ou les attitudes qui auraient pour effet de détruire l'image de l'autre aux yeux des enfants, au risque de déstabiliser ceux-ci et de les faire sombrer, plus tard, dans la délinquance. Pour ma part, je souhaiterais que le juge puisse, dès le début, prescrire une médiation familiale, mais cela suppose évidemment que celle-ci dispose de plus de moyens. Qu'en pensez-vous ? M. Philippe Bas : L'idée de disposer de données médicales et biologiques sur la mère est une bonne idée, car les progrès de la médecine prédictive sont tels que l'utilité de ces données, que l'on mesure encore mal aujourd'hui, pourrait bien apparaître demain comme très grande - aussi bien pour la mère que pour l'enfant, d'ailleurs -. Dans le domaine du cancer, par exemple, il semble de plus en plus probable que les facteurs soient en partie liés à l'environnement et en partie liés à des prédispositions génétiques, dont la connaissance permettrait d'adopter des comportements de prévention. Peut-être faudrait-il, d'ailleurs, disposer aussi de données sur la mère de la mère... Mme Christine Boutin : On n'a pas toujours toutes les maladies de ses parents, Dieu merci ! M. Philippe Bas : Certes, mais pourquoi se priver d'informations qui peuvent être utiles ? C'est une piste à explorer, en tout cas. Quant à la médiation familiale, je suis tout à fait favorable à ce qu'on la développe, car le juge ne peut jouer ce rôle de rapprochement des points de vue. Pour cela, cependant, il faut de l'argent, et je n'en ai pas beaucoup ! Mais il est certain que cela adoucirait beaucoup de situations... M. Pierre-Louis Fagniez : J'ai bien noté que vous vous appuyez sur trois principes : un principe de réalité - la plupart des enfants vivent dans des familles « comme il faut », avec un papa et une maman -, un principe de prudence - et c'est bien, mais je vous rassure : nous n'avons pas fait, à ce stade, de propositions qui seraient imprudentes ! - et un principe de précaution appliqué à l'enfant. En résumé : l'enfant d'abord, et pas de droit à l'enfant ! Or l'enfant vit au sein d'une famille, et il est encore majoritairement issu d'un mariage. D'où ma question : nous conseilleriez-vous de donner une définition du mariage civil ? M. Philippe Bas : Celle qu'en donne le code civil est claire, et les tribunaux l'appliquent. Je ne vois pas la nécessité de la préciser davantage. Mme Hélène Mignon : Très bien ! Mme Patricia Adam : Votre réponse sur les moyens accordés à la médiation familiale a le mérite de la franchise et de la clarté. M. Philippe Bas : Elle ne signifie pas que l'on ne va pas les augmenter ! Mme Patricia Adam : En le faisant, vous feriez par ailleurs des économies certaines en simplifiant le travail des juges aux affaires familiales et des juges pour enfants. Mais pensez-vous qu'il serait bon de réunir ces deux fonctions, comme le fait, avec un certain succès, le Canada ? S'agissant de la connaissance du « matériel génétique », ce que propose Nadine Morano ne toucherait, par définition, que les enfants nés en France, et non pas ceux venus en France par l'adoption internationale. De plus, tout le monde ne connaît pas sa propre histoire génétique, ni son propre matériel génétique. Mme Nadine Morano : Même sans avoir de données très précises, on peut savoir, par exemple, si l'on a des ascendants ou des collatéraux diabétiques. Mme Christine Boutin : Mais imaginons le cas d'un enfant qui serait adultérin sans le savoir : il risque de se mettre en tête qu'il a telle ou telle maladie héréditaire, alors que ce n'est pas vrai. Mme Patricia Adam : J'ai une autre question, qui porte sur la parole de l'enfant, sur sa représentation juridique dans les affaires qui le concernent, et sur l'aide juridictionnelle qui lui est éventuellement apportée à cet effet. Enfin, je voudrais savoir si vous comptez développer l'information sur les droits et devoirs des familles et des enfants, comme l'a fait - on y revient toujours - le Québec. M. Gérard Cherpion : Je voudrais évoquer, pour ma part, le problème des enfants de couples séparés de nationalités différentes. La convention de La Haye est certes censée s'appliquer, mais certains pays, pourtant signataires, l'appliquent mal, et en particulier sa disposition qui stipule que le parent qui a emmené - qui a enlevé - l'enfant vers son propre pays - l'Allemagne par exemple - doit le restituer préalablement à l'audience du tribunal appelé à statuer. Mais une fois la décision rendue - par un juge qui est forcément de l'un des deux pays -, comment s'assurer de sa bonne application ? Mais peut-être le garde des Sceaux serait-il plus à même de répondre à cette question. Mme la Rapporteure : Je voudrais revenir, pour ma part, sur plusieurs points précis de notre questionnaire. Seriez-vous favorable à la création d'un fonds chargé d'avancer le paiement des pensions alimentaires en cas de carence du débiteur et sous condition de ressources ? Si oui, comment ce fonds pourrait-il être financé ? Je vous précise tout de suite que nous connaissons parfaitement les mécanismes existants, sur lesquels le garde des Sceaux a cru devoir nous faire un cours hier... Par ailleurs, l'attention de la Mission a été attirée sur le cas d'enfants placés victimes d'accidents. L'établissement où ils sont placés n'étant pas titulaire de l'autorité parentale, c'est aux parents qu'il revient d'engager les actions en responsabilité, ce qui est assez absurde dans la mesure où, justement, ils n'ont pas la garde des enfants. Ne faudrait-il pas autoriser le juge pour enfants à déléguer à l'établissement gardien l'exercice de l'autorité parentale pour les besoins de la vie courante de l'enfant ? En troisième lieu, estimez-vous pertinent d'autoriser le beau-parent à accomplir les actes usuels de la vie de l'enfant sans intervention du juge ? Si oui, cette autorisation pourrait-elle reposer sur un fondement conventionnel supposant l'accord des personnes qui partagent l'exercice de l'autorité parentale ou qui en sont titulaires ? Nous pensons, par exemple, à une délégation de l'autorité parentale par acte notarié directement exécutoire ou par déclaration sous seing privé homologué par le juge. En cas de décès des parents, il peut être dans l'intérêt de l'enfant de désigner comme tuteur un tiers, par exemple le beau-parent qui élève l'enfant, plutôt qu'un ascendant. Peut-on autoriser ce tiers à demander lui-même au juge de lui confier l'enfant après le décès du parent ? Et seriez-vous favorable à ce que soit supprimée l'attribution automatique de la tutelle aux ascendants, lorsque le dernier mourant des père et mère n'a pas choisi de tuteur - ce qui est souvent le cas en cas de mort accidentelle ou imprévue - ? Enfin, serait-il pertinent de prévoir que le juge peut faire obstacle au droit de l'enfant d'entretenir des relations avec ses ascendants « dans l'intérêt de l'enfant », et non plus seulement pour « motifs graves » ? L'intérêt de l'enfant peut en effet être apprécié plus largement par le juge que des « motifs graves », généralement invoqués par les parents eux-mêmes. M. le Président : J'ai une observation à formuler et une question à poser. Vous avez dit que le mariage est la formule la plus favorable à l'intérêt de l'enfant, car il produit des effets familiaux, à la différence du PACS et du concubinage. J'observe cependant que le Conseil constitutionnel a considéré le PACS comme devant servir de cadre à une vie commune, et que par ailleurs la jurisprudence des tribunaux ne fait pas de l'absence de vie commune, en tant que telle, un élément de dissolution du mariage. Les couples mariés ont accès à l'adoption et à la procréation médicalement assistée (PMA). Une personne seule peut adopter, mais pas accéder à la PMA. Des concubins peuvent, inversement, accéder à la PMA, mais pas adopter. Nos concitoyens ont parfois du mal à percevoir la cohérence de tout cela. Notamment les couples concubins - je laisse de côté la question de l'homoparentalité - ou les personnes seules se demandent pourquoi ils ne peuvent accéder, les uns à l'adoption, les autres à la PMA, comme c'est le cas dans les autres pays. Peut-être une clarification serait-elle nécessaire ? M. Philippe Bas : Certaines questions s'adressent en effet plus au garde des Sceaux qu'à moi, mais la responsabilité du ministre chargé de la famille s'étend aux conditions juridiques de son développement. Faut-il, comme dans certains pays, un juge unique qui serait à la fois juge pour enfants et juge des affaires familiales ? Je ne le crois pas. Les deux fonctions sont bien distinctes. Et la protection des enfants, notamment contre la maltraitance, n'est pas la même chose que le règlement des conditions d'un divorce. S'agissant de la représentation juridique des enfants, je vais peut-être répondre un peu à côté, mais je dois dire que je suis assez critique sur la façon dont on recueille leur témoignage. Quand l'enfant dit-il vrai ? Quand il porte une accusation, ou quand il se rétracte ? Je fais ici très directement référence à l'affaire d'Outreau, et je ne suis pas certain que nous ayons le recul nécessaire pour hurler avec la meute contre la décision des premiers juges et pour encenser les seconds. Je crois qu'il faut développer les expériences menées par les unités médico-judiciaires, où les conditions les plus favorables sont réunies pour recueillir la parole des enfants. Je crains qu'en leur faisant réitérer sans cesse leur témoignage, et ce jusqu'à la barre du tribunal, on ne fasse peser sur eux une pression très forte, même s'il y a, heureusement, des procès qui se passent mieux que d'autres, avec un très grand tact et un très grand respect de l'enfant. La question posée est très large, je le sais, mais, à la racine, le problème de l'expression de l'enfant devant la justice n'est pas encore correctement résolu. Nous faisons des campagnes d'information sur les droits des enfants, mais je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de renforcer encore cette information. Je relie cette question à ce que je disais tout à l'heure sur l'affaiblissement de la fonction parentale, qui n'est plus transmise comme autrefois de génération en génération. Je ne suis guère à même de répondre sur le respect de la convention de La Haye. Comment améliorer les choses quand des couples binationaux se déchirent et qu'un enfant est enlevé en cours de procédure ? Chaque fois que le problème s'est posé entre la France et l'Allemagne, l'affaire est remontée jusqu'aux ministres de la justice des deux pays, parfois jusqu'au Chancelier et au Président de la République. La solution est d'autant plus difficile que les lois ne sont pas les mêmes dans chaque État, et que les tribunaux des deux pays peuvent être saisis. Il y a une convention, certes, mais toute la difficulté est de la faire appliquer correctement. Je suis très réservé quant à l'idée de créer un fonds de paiement des pensions alimentaires, car il faut éviter tout ce qui pourrait inciter le débiteur à ne pas s'acquitter de ses obligations. Nous disposons d'une petite allocation dite « de soutien familial », qui peut servir, mais à laquelle nous ne faisons pas trop de publicité... Elle permet quand même d'améliorer la situation quand la pension n'est pas versée. Mme la Rapporteure : 80 euros par mois ! M. Philippe Bas : Il y a évidemment des inconvénients à la situation actuelle, mais il ne faut pas inciter les gens à se défausser de leurs responsabilités. Mme la Rapporteure : Ne pourrait-on subroger l'État dans le recouvrement des créances, notamment dans le cas de conjoints divorcés ou séparés qui profitent du fait que, n'étant pas salariés, la saisie-arrêt n'est pas possible ? Nous sommes un certain nombre à avoir été avisés de ces situations. En outre, toutes les procédures actuelles supposent que le créancier fasse l'avance des frais d'huissier, connaisse les numéros de compte bancaire, les communique au procureur, etc. M. Philippe Bas : Si je comprends bien, il s'agirait de faire exercer les droits du créancier d'aliments par une institution qui le dispenserait de ces formalités ? Mme la Rapporteure : Cela permettrait de déjudiciariser la procédure, qui, actuellement, est réservée dans les faits, en raison du coût des démarches à accomplir, aux pensions d'un montant relativement élevé, et donc aux classes favorisées. M. Philippe Bas : S'agissant des accidents survenant aux enfants placés, il me semble que les cas dont vous faites état soient dus à un dysfonctionnement, à des difficultés survenant dans l'intervalle de temps où l'enfant est placé sans que ses parents soient dessaisis de l'autorité parentale. Mme la Rapporteure : Le problème est dû au fait que deux juges interviennent : le juge pour enfants, qui prend la décision de placement, et le juge des affaires familiales ou le juge des tutelles, qui prend la décision relative à l'autorité parentale. Il peut donc y avoir discordance entre les deux jugements. Et comme, dans la plupart des cas de placement, il n'y a pas de délégation de l'autorité parentale, un problème de responsabilité civile se pose lorsque l'enfant, tout simplement, se casse la jambe ou doit être opéré de l'appendicite. M. Philippe Bas : S'agissant de l'habilitation du beau-parent à accomplir les actes de la vie courante, des arrangements sont déjà possibles dans la pratique, sans qu'il faille changer la législation. Si l'on devait le faire, il faudrait être très vigilant sur les droits du parent séparé qui n'a pas la garde de l'enfant. Je suis un peu surpris par la question sur le tuteur désigné en cas de décès des deux parents. Il me semble que le conseil de famille est libre aujourd'hui de désigner le beau-parent ou toute autre personne. Mme la Rapporteure : Non. S'il y a des ascendants, ils sont automatiquement désignés, sauf s'ils sont incapables, mais le fait qu'ils soient trop vieux n'est pas une raison suffisante. M. Philippe Bas : Ils ont en effet une vocation naturelle à être tuteurs. Mais si le conseil de famille estime qu'ils n'en ont pas la capacité ? Mme la Rapporteure : C'est encore un problème de double régime : celui de la tutelle et celui de la garde. La garde peut être attribuée à quiconque, mais pas la tutelle, ce qui peut aboutir à des problèmes compliqués entre le tuteur et le gardien, en cas de remariage par exemple. C'est le seul point dont le garde des Sceaux ait dit que nous avions raison de nous inquiéter, compte tenu, a-t-il souligné, de l'avancement de l'âge de la procréation et de l'allongement de l'espérance de vie. Seriez-vous d'accord pour que la tutelle ne soit plus confiée automatiquement aux ascendants, sous réserve de la décision du conseil de famille ou du juge ? M. Philippe Bas : Dans ce cas, cela ne créerait pas de droits à la personne non apparentée revendiquant la tutelle de l'enfant. Et si elle ne se voyait pas confier la tutelle, elle n'aurait aucun droit à faire valoir en justice. Mme Patricia Adam : Elle pourrait la réclamer, mais elle ne serait pas sûre de l'obtenir. M. Philippe Bas : Alors, vous régleriez un certain nombre de problèmes, mais vous en soulèveriez de nouveaux. Mme la Rapporteure : Pas tant que cela, car quand un juge confiera la tutelle à un tiers, peut-être créera-t-il une frustration chez les grands-parents, mais les décisions que le tiers gardien aura à prendre dans la vie quotidienne s'en trouveront simplifiées. M. Philippe Bas : Je réponds enfin à la question du Président Bloche sur la cohérence intellectuelle qu'il y a à distinguer le régime de l'assistance médicale à la procréation de celui de l'adoption. Ce sont deux situations différentes. Dans un cas, il s'agit d'un enfant qui demande une famille. Dans l'autre, il s'agit d'un couple qui veut avoir un enfant, qui ne le peut pas, et qui revendique l'aide du législateur pour obtenir cet enfant qu'il ne peut avoir. C'est à la lumière de cette différence fondamentale qu'il faut examiner les régimes juridiques respectifs. L'enfant que l'on adopte est un enfant qui a souffert, qui a une fragilité particulière au départ, et pour qui il faut reconstituer un foyer dans lequel il pourra s'épanouir. Cela justifie que l'on prenne certaines précautions. Dans le cas de l'assistance médicale à la procréation, possibilité qui n'est ouverte qu'en cas de stérilité d'un couple stable, les règles sont différentes. Je ne crois pas qu'il y ait d'incohérence. Ce sont tout simplement deux réalités qui n'ont rien à voir. M. le Président : Mais un couple de concubins hétérosexuels qui, moyennant deux ans de vie commune, a accès à la PMA, peut s'étonner qu'on lui dise de se marier s'il veut adopter. Nous nous interrogeons sur ce point, et nous ne sommes pas les seuls. En effet, en quoi deux ans de vie commune sont-ils une garantie de stabilité et comment vérifier la réalité de la communauté de vie de concubins ? M. Philippe Bas : La réalité est que la majorité des enfants naissent de parents non mariés, et le législateur, dans sa sagesse, n'a pas voulu poser de conditions supplémentaires à l'assistance médicale à la procréation. Mais pour l'adoption, il en va autrement : il faut des garanties supplémentaires. Peut-être parce que la loi est plus ancienne, mais aussi parce qu'il y a une vulnérabilité particulière, celle de l'enfant abandonné, que l'on a voulu compenser en s'entourant de garanties maximales. En revanche, le régime de l'assistance médicale à la procréation est différent : nous avons voulu le rapprocher le plus possible de celui d'une naissance classique. M. le Président : Toutefois, une personne seule peut adopter. Vous me répondrez, je le sais, que c'est dû à des raisons historiques, à la tradition des assistantes maternelles. Mais n'y revenons pas. Monsieur le Ministre, nous vous remercions d'avoir répondu en détail à nos questions. AUDITIONS DU PRÉSIDENT ET DE LA RAPPORTEURE Auditions du Président · M. Jean-Claude FRANÇOIS, président de Justice Papa - Parité parentale, et Mme Pascaline Saint-Arroman Petroff, membre de la direction générale · M. François BEAUJEU, porte-parole de L'enfant et son père Auditions de la Rapporteure · Mme Isabelle de RAMBUTEAU, Présidente du Mouvement Mondial des Mères - France · Mme Nicole PRUD'HOMME, Présidente de la Caisse nationale des allocations familiales · M. Didier SICARD, président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé · M. Bernard BEIGNIER, doyen de la faculté de droit de l'université de Toulouse Contribution écrite adressée à la Mission - La détection de l'enfance en danger et son signalement : La formation à la détection dans les IUFM apparaît dans l'emploi du temps. Je l'ai déjà encadrée, mais peu de temps y est consacré. Il faudrait qu'elle soit faite automatiquement par des praticiens, professeurs d'école ou directeurs, et non par les théoriciens que sont les professeurs d'IUFM. Elle devrait pouvoir se faire en présence de toutes les parties concernées : CMS (centre médico-social), médecine scolaire, assistantes sociales, DISA, IEN et enseignants. En effet, il faut que les PE2 connaissent les différents partenaires qui seront les leurs, qu'ils puissent poser toutes les questions. Ce serait aussi l'occasion de mettre ces différents services en présence, car jamais ils n'en ont l'occasion, et c'est certainement une des causes pour lesquelles le système marche fort moyennement. Chacun pourrait alors mesurer sa place dans le circuit de signalement et sa responsabilité, car on se heurte trop souvent à une succession de refus de prise de responsabilité dans le système actuel. Je participe à la formation continue chaque année en tant que directrice d'école d'application et je n'ai jamais vu se mettre en place une formation continue spécifique sur ce point. Pourtant cela le mériterait, car aujourd'hui ce n'est qu'un point qui est abordé dans certains stages qui en ont l'occasion, ce qui est insuffisant. Le partage d'informations entre les professionnels de la protection de l'enfance et l'éducation nationale me semble impératif. Les enseignants doivent être avertis, alertés si nécessaire, et doivent être entendus. En effet, c'est souvent à eux que les enfants se confient, car ils perçoivent le quotidien des enfants. Les procédures de signalement existent mais sont très compliquées. J'ai moi-même procédé à plusieurs signalements, et ce, « malgré » les autres services, c'est à dire que CMS, médecine scolaire et assistantes sociales réagissent de telle sorte qu'ils vous dissuadent de procéder à ce signalement : rien n'est jamais tangible, rien n'est jamais grave, tout est tolérable, tout s'explique par un « manque de temps » de leurs services, qui souvent ne « peuvent » rien de plus. L'argument « les parents refusent » est constamment mis en avant. J'ai toujours signalé, malgré la tiédeur des autres services. J'ai rarement eu des informations sur les suites données, sauf quand les signalements ont conduit à ce que je sois entendue par la police ou la justice. Les directeurs ne doivent pas, à mon sens, avoir la responsabilité de signalement aux allocations familiales pour les absences abusives, pourvu que les inspecteurs d'académie assument correctement leur responsabilité de signalement. Les directeurs d'école ont déjà beaucoup de charges, sans personnel pour les y aider. Introduire des assistantes sociales dans les écoles serait une bonne chose, mais à condition que leur rôle ne se limite pas à donner des « aides sociales » aux familles, mais aussi à être responsables face aux conséquences possibles pour des enfants en danger dans leur famille, à pouvoir « former » les parents aux gestes minimums de nourriture, d'hygiène et de sécurité. - La santé des enfants scolarisés : Un certificat de santé obligatoire à 3 ans serait utile pour la détection des enfants victimes de négligences. Suspendre le versement des allocations familiales serait certainement efficace pour certaines familles. À ce propos, je travaille dans un quartier de ZEP et je peux témoigner qu'une infime partie des allocations, primes attribuées aux familles pour leurs enfants, revient effectivement à ces mêmes enfants. Il serait certainement plus efficace que ces sommes soit remises en bons d'achat ciblés. Votre questionnaire indique : « la médecine scolaire manquant cruellement de personnels », c'est un sentiment, que, sur le terrain, je n'ai absolument pas. Il est vrai, par contre, que si l'on pouvait étendre la compétence de la PMI à l'ensemble des enfants, ce serait à mon avis positif en terme de suivi. Mes remarques quant aux thèmes véhiculés sur les points ci-dessus : Mon vécu de directrice d'école en ZEP me pousse à des constats : Comment des enfants peuvent-ils être dans une famille sans aucun suivi mis en place alors que des services savent que cette même famille a eu des problèmes avec des aînés, qui parfois leur ont même été retirés ? Que de gain de temps si l'école connaissait d'emblée le passé de certaines familles et que de souffrances d'enfants épargnées ! Pourquoi les services représentés par les assistantes sociales sont-ils si peu efficaces ? Les enseignants font souvent le travail de ces assistantes qui se réfugient sans cesse derrière l'argument : « la famille ne m'a pas laissée entrer, ou la famille refuse de me voir ». Quel suivi est donné aux éducateurs qui interviennent dans les familles, aux aides-familiales qui bien souvent font le travail à la place de mais n'apprennent pas aux mamans ce qu'elles doivent faire et comment le faire, d'où des familles qui profitent d'un système, sans jamais évoluer : l'aide familiale fait le ménage, amène les enfants à l'école, les parents se lèvent tard et vont se promener en ville ensuite. Il faudrait mettre en place tôt une prise en charge des familles dans l'unique but de leur « apprendre à ». Je scolarise également dans mon école des enfants de la MADEF (placement des enfants hors famille). Force est de constater les immenses négligences de ce service, les carences de formation pour faire face à des enfants la plupart du temps en détresse psychologique et affective. Toutes ces remarques pour dire que le statut d'enfant en danger en France est lourd à porter et qu'un enfant peut être victime de négligences diverses, sans que personne ne bouge ou du moins, sans que personne ne mesure l'urgence d'une décision à prendre. Si l'on essaye de faire évoluer le système, de mettre d'abord l'enfant au centre des préoccupations de tous, on se heurte à beaucoup d'inertie, de manque de motivation et de fatalisme, d'habitudes de fonctionnaires Ce sont souvent les enseignants qui prennent les responsabilités, toutes les responsabilités, simplement parce qu'un enfant en détresse ne peut apporter aucune attention au travail scolaire, et s'enfonce donc, de plus, dans des échecs et des retards, ce qui la plupart du temps conduit ces élèves à de la rébellion contre le système : l'indiscipline apparaît, la violence verbale, puis physique, puis les dérapages hors des murs scolaires, les mauvaises relations et les délits. Contribution écrite adressée à la Mission Faut-il faire évoluer notre législation pour améliorer l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés ? Une loi a récemment été promulguée, le 5 mars 2002, sur ce thème. Si la question nous est posée aujourd'hui c'est probablement parce que cette loi est contestée. À ma connaissance cette contestation porte sur le fait que la résidence alternée serait nocive pour les enfants, notamment lorsqu'ils sont d'âge préscolaire. J'ai rencontré dans ma pratique, comme beaucoup de mes semblables je pense, des difficultés avec la résidence alternée. Mais je rencontre tout autant de situations où ce dispositif marche parfaitement sans que les enfants ne présentent aucun trouble. Quand des difficultés se présentent elles sont souvent dues à une réticence de l'un des deux parents qui souhaiterait bénéficier d'une garde principale à son profit. Dans ces cas il est fréquent que l'enfant soit lui-même embarrassé par la situation et préfère qu'elle soit tranchée par un recours à l'hébergement principal du parent demandeur. Je dois tout de même souligner le fait que je n'ai jamais vu un enfant réclamer cela lorsque les deux parents étaient favorables à la résidence alternée ! Si nous nous en tenons simplement à ce que disent les parents, ou à ce que dit un enfant plus ou moins influencé par l'un d'entre eux, nous ne parviendrons jamais à un résultat objectif. Pour y parvenir il faudrait disposer d'une ou de plusieurs études menées de façon rigoureuse sur le plan scientifique. J'insiste sur ce point car les parents recrutés sur la base du volontariat présentent un biais de sélection tout comme ceux qui consultent des cliniciens. J'ai commencé un tel travail et j'ai eu des propositions de parents favorables à la résidence alternée pour que je teste leur enfant. Malgré la facilité de telles propositions je les ai toujours refusées. Je pense que seul un recrutement fait sur la base du hasard serait en mesure de répondre à ces critères. Nous le faisons actuellement sur Grenoble, mais c'est extrêmement long et difficile à mettre en place. Pour l'instant nous ne pouvons donc nous fier qu'aux études parues à l'étranger. Une seule tend à démontrer la nocivité de la résidence alternée. Il s'agit de l'étude de Solomon et George (1999) qui porte sur les mécanismes d'attachement. Elle porte sur des enfants de 12 à 20 mois et montre que des enfants qui passent la nuit chez leur père ont un pattern d'attachement plus souvent désorganisé que celui des deux groupes témoins. Outre que les différences ne sont pas aussi significatives qu'il a été rapporté en France, des auteurs particulièrement qualifiés dans le domaine de l'attachement, comme M. Lamb, estiment que l'étude de Solomon et George n'est pas convaincante et ils soulignent que le bébé ne doit pas être séparé trop longtemps de chacun de ses parents et puisse dormir chez l'un comme chez l'autre. Ces auteurs pensent que l'enfant a besoin d'un contact qui implique le coucher et le lever avec son père pour avoir un certain nombre d'expériences avec lui. Les visites brèves (2 h) sont d'après Kelly et Lamb à prohiber car elles ne produisent pas le même type d'expérience. Ils insistent enfin pour que la séparation avec l'un des parents n'excède pas 2 ou 3 jours chez les plus petits et pas plus de 7 jours durant la période préscolaire. Ce dernier point montre que l'alternance classique une semaine - une semaine n'est pas adaptée au rythme d'un enfant très jeune. Je pourrai encore citer d'autres études allant dans le même sens, mais je crains de prendre trop de temps et de lasser l'auditoire avec des données extrêmement techniques. Je voudrais seulement souligner un dernier point qui est souvent négligé. On parle de la nocivité de la résidence alternée, mais rarement de ce qu'elle apporte. Le travail d'une collègue belge (Mme Van Pevenage, Revue trimestrielle de droit familial) a montré que les enfants en résidence alternée étaient les seuls qui ne développaient pas de relation d'emprise à la mère alors que celle-ci apparaît dans 80 % des cas dans le groupe en résidence principale maternelle sans recomposition familiale. Ensuite je pense qu'on ne parle pas assez de ces cas particulièrement douloureux où l'enfant pour échapper à la douleur du conflit de loyauté décide de rejeter totalement l'un de ses parents. Cela fait quinze ans que je présente dans mes conférences des cas de ce genre. Ils sont beaucoup plus nombreux et terrifiants pour l'avenir psychologique de l'enfant qu'on ne le pense. Ils ne sont possibles que parce qu'un parent possédant l'hébergement principal fait entrer l'enfant dans un système de pensée qui inclut le rejet de l'autre lignée comme seule solution acceptable. Et cela se produit très tôt. C'est une autre raison de penser que la possibilité donnée aux juges aux affaires familiales d'ordonner une résidence alternée, ne serait-ce que pour un temps, doit être préservée. Néanmoins il convient de s'entourer d'un certain nombre de règles et de précautions pour éviter d'aboutir à un remède qui serait pire que le mal : Règle n°1 : ne pas imposer un hébergement alterné à un enfant qui n'en veut pas et le dit de façon claire et argumentée. Règle n°2 : dans le cas d'enfants de moins de trois ans s'assurer que les parents échangent l'enfant de manière correcte, en se parlant, et que le rythme de l'enfant est respecté (alternance courte). Règle n°3 : ne pas faire de l'hébergement alterné un remède pour les parents en conflit. C'est le contraire qui se passe. Il vaut mieux dans ce cas utiliser les « espaces-rencontres » qui devraient bénéficier d'une reconnaissance de la loi (un manque rarement relevé). Prétendre que l'hébergement alterné est producteur de pathologie est démenti par les neuf dixièmes des études parues sur la question. S'il existe une pathologie c'est en général qu'un autre facteur est en jeu. Cela dit le fait qu'elle ne soit pas en elle-même productrice de pathologie n'indique pas que l'alternance soit sans effets négatifs dans certains cas. Un hébergement alterné peut être la meilleure des solutions, mais il peut être aussi un leurre ou pire encore un instrument de manipulation quand une pathologie du lien ne fait que s'exacerber à travers l'alternance. Il ne doit pas exister de réponse automatique, mais tout doit être fait pour qu'un enfant ne soit pas amputé d'une de ses lignées. Le principe du maintien de la possibilité de l'alternance à l'intérieur de la loi est un moyen d'y parvenir. Le but de l'alternance n'est pas de maintenir une sorte d'égalité des parents devant l'enfant : il est de permettre à ce dernier d'avoir la possibilité de maintenir un lien avec ses deux parents. La mise en cause de l'alternance est l'arbre qui cache la forêt de tous ces enfants décervelés par un parent qui cherche à les amputer d'une part de leur filiation. Dans ces cas la pathologie qui menace est beaucoup plus évidente
l'enfant et son droit 12, rue Alphand 75013 Paris http://www.enfant-du-divorce.magic.fr Louis-Albert STEYAERT Président A: M. Patrick BLOCHE Président de la Mission d'Information sur la Famille et le Droit des Enfants de l'Assemblée Nationale (version numérique) - 2 documents joints en annexe - "l'essentiel" sur deux pages en fin de document Paris le 14/12/2005 Monsieur le Président, Nous vous remercions de nous avoir sollicités pour exposer notre appréciation sur la manière dont le droit de l'autorité parentale respecte le droit de l'enfant afin de participer à l'information de la Commission que vous présidez. A défaut de n'avoir pu être auditionnés par la Commission, nous espérons que nos appréciations pourront être annexées aux consultations dont vous avez largement sollicité de vastes secteurs de la société. REFERENCES PRELIMINAIRES: Nous y avons adjoint, en annexe, nos propositions remises en octobre 2000 à la Conseillère du Ministre de la Famille, Mme Marie-Christine GEORGE, lors de la préparation de la loi réformant l'autorité parentale votée en mars 2002, réitérées lors notre audition à la Délégation aux Droits des Femmes en mai 2001. Elles restent tout à fait d'actualité; nous y demandions des dispositions qui ont été prises: sécurisation juridique de la garde alternée, notion de respect de la relation entre l'enfant et l'autre parent, et diverses mesures que nous préconisions précisément comme l'inscription des enfants sur la carte Vitale des deux parents, le quart de part pour l'imposition des parents en garde alternée, le double vote aux élections de parents d'élèves; pour autant de nombreuses autres mesures restent à mettre en œuvre (Annexe 1: pages 8 à 11); Vous trouverez également une note remise en avril 2005 à M. Stéphane NOEL, Conseiller à la Famille du Garde des Sceaux, M. PERBEN, concernant les comportements de manipulation de l'enfant par l'un des parents (Annexe 2: pages 12 et 13). L'ENFANT DE PARENTS SEPARES RESTE INUTILEMENT VICTIME D'UN CONFLIT DE LOYAUTE : Pour l'enfant, comme pour le reste de la société, la famille a changé plus vite que les mentalités dans les trente dernières années: au modèle du foyer unique centré sur un couple parental pérenne a succédé pour près d'un enfant sur deux une désunion du couple parental avant la majorité des enfants; en ont découlé la présence d'un seul parent au quotidien, l'apparition de plus en plus fréquente d'un autre adulte au foyer (beau-père ou belle-mère), de demi-frères ou de demi-soeurs et bien souvent la cohabitation avec des enfants d'une autre union sans lien de parenté. Dans le même temps, comme pour conjurer le sort, la fiction sociale imposée à tous du foyer unique déserté par un des parents ou chassé pour une faute nécessairement inexpiable a imposé à l'enfant un conflit de loyauté dont on fait trop peu de cas jusque-là. Faute de reconnaître la légitimité de deux foyers parentaux (les fameuses "deux maisons" de Françoise Dolto), et parce qu'alors étaient désignés un des deux parents comme parent principal et l'autre comme un parent secondaire sans autorité effective, l'enfant a été et reste instrumentalisé pour 'se passer' de force de l'un de ses parents et de sa parentèle; et de s'embarquer, seul, dans les aléas de la recomposition ou de la solitude du parent principal. Faut-il encore rappeler combien les enfants 'de divorcés' souffrent de cette situation? Et bien oui! Et ce n'est pas porter atteinte à l'émancipation de la femme ni à la liberté des individus de changer de partenaire sexuel ou de vouloir changer de condition matérielle que de tenter d'examiner, sans a priori, cette réalité et ses conséquences pour y porter des remèdes. A l'extrême, ce conflit de loyauté est parfois manipulé par un des parents et conduire à une forme particulièrement redoutable de maltraitance, l'aliénation parentale. Longtemps considérée comme une pure invention de parents accusés d'être eux-mêmes maltraitants, cette maltraitance doit être mieux reconnue et prévenue. Elle constitue une urgence dont la négligence a des conséquences dramatiques. Aux travaux de Darnal, Major, Gardner, se sont ajoutés très récemment ceux de Van Giseghem et la reconnaissance officielle de ce syndrome dans l'expertise judiciaire par le Dr Delfieu. Nous avons remis au Ministère de la Justice une note que vous trouverez en annexe de notre contribution sur la prévention de comportements beaucoup plus fréquents, et même usuels, se rapprochant de l'aliénation par certains côtés et qu'il convient de condamner fermement. Leur banalisation, qui mine le quotidien, explique peut-être la peur de se reconnaître dans le concept d'aliénation, bien qu'ils n'aient rien de commun en terme de gravité pour l'enfant. (pages 13 et 14) L'ENFANT DE PARENTS SEPARES MIS EN PRECARITE - la paupérisation des foyers monoparentaux malgré un soutien social limitant les effets de la misère, très variable d'une commune ou d'une région à l'autre, - la paupérisation encore moins reconnue des parents exclus, beaucoup moins soutenus que les foyers avec enfants, la faillite personnelle après la perte de leur emploi de nombreux pères assujettis à des pensions alimentaires calculées au plus haut de leurs revenus et quasiment impossibles à réviser, ont des conséquences dramatiques sur les conditions matérielles des enfants et leur avenir (difficultés scolaires, déclassement social...) - de plus, la rupture avec l'une des parentèles remet en cause la transmission aux enfants des valeurs véhiculées par chaque parent et la diversité culturelle dans l'intégration républicaine défendue par la majorité de votre Commission. L'ENFANT DE PARENTS SEPARES, REVELATEUR, ACTEUR ET VICTIME D'INSTABILITE SOCIALE? Paradoxalement, le confinement des femmes dans leur rôle de 'femmes au foyer' subventionnées ou pensionnées, leur assujettissement au fardeau de la 'double journée', voire et la déresponsabilisation des hommes en tant que pères, reproduisent insidieusement des schémas sociaux en totale contradiction avec les aspirations réelles à rompre avec des formes d'exploitation 'sexistes' ou plus généralement les aspirations à un partage des charges et avantages entre hommes et femmes. Ce 'modèle' pose déjà de sérieux problèmes dans les identifications au parent de même sexe et la place assignée au sexe opposé. L'affaiblissement de l'autorité parentale -tout parent d'adolescents sait qu'il n'est pas trop d'être deux pour faire face à leur bouffées d'indépendance ou de révolte- a pu enfin être reconnu à l'occasion de la 'crise des banlieues'; les conséquences de ce manque d'autorité: absentéisme scolaire, vandalisme, délinquances plus graves, devraient être sérieusement examinées et prévenues. La crise des 'banlieues' a révélé les dégâts occasionnés par le chômage et la déstructuration familiale. Révolte contre l'absence d'avenir professionnel certes, mais aussi l'absence de projection dans l'avenir en tant que parent. Au total, l'éviction de l'univers de l'enfant d'un des parents (en général le père), en cas de divorce ou de séparation, nuit à l'enfant et cause des dommages immenses à la société. En 2001 notre association avait évalué le traitement des séparations parentales à un coût annuel équivalent à 6 milliards d'Euros. Nous regrettons qu'aucune étude des organismes officiels (CNRS, INED, INSEE) n'ait été lancée pour informer la représentation nationale. LE CONTACT DE L'ENFANT DE PARENTS SEPARES AVEC SES DEUX PARENTS A-T-IL ETE AMELIORE DEPUIS LA LOI DE 2002? La réforme législative de 2002 avait pour but d'améliorer cette situation en sécurisant le statut juridique de la garde alternée. Mais il est à craindre que cette innovation n'ait été sabotée par les résistances idéologiques donnant l'exemple déplorable du contournement de la loi et de son esprit par de nombreux juges, certains pédopsychiatres influents, experts, enquêteurs sociaux... Là aussi peut-on regretter l'absence d'une mission parlementaire pour évaluer l'impact de la loi de 2002. Comment peut-on se plaindre de l'absence d'autorité parentale quand la majorité des juges font tout dans les divorces pour encourager la perpétuation de familles mono-parentales en difficulté prévisible avec leurs enfants et singulièrement écarter les pères de leur éducation, alors même que l'intérêt supérieur de l'enfant est de lui épargner les effets délétères des conflits entre parents et renforcer leur engagement à éduquer leurs enfants? Les juges auraient un moyen extrêmement simple de pacifier les séparations parentales: celui de confier la résidence majoritaire au parent le plus ouvert à l'autre dans ses relations à l'enfant et de sanctionner les comportements plus ou moins insidieux de sabotage de la relation de l'enfant à l'autre parent. Au reste, les tenants de la 'discrimination positive' ne devraient-ils pas s'engager à favoriser les demandes des pères les plus responsables et les plus demandeurs? L'ENFANT DE PARENTS SEPARE A DROIT A SES 'DEUX MAISONS': Nous l'avons vu, il n'est pas sérieux de débattre de l'autorité parentale et de responsabilisation des parents dans un contexte de résidence de l'enfant chez un seul des parents. La seule solution pratique a été trouvée, et est d'ailleurs mise en place dans un nombre croissant d'Etats : l'alternance de résidence de l'enfant, selon des rythmes adaptés aux âges et aux situations particulières. On peut déjà remarquer que, garde alternée ou non, les enfants « alternent » déjà entre crèches, nounous, grands-parents et bénéficient de cette richesse de stimulation ; pour aller en ce sens on encourage les parents à faire intégrer leurs enfants à l'école maternelle de plus en plus tôt. Passons à la trappe les appréciations formulées dans les années 70 de Mme Dolto sur les tentatives de garde alternée dans un contexte où les familles ne se séparaient qu'exceptionnellement. Autant appeler à la barre Daniel Cohn-Bendit et Jacques Sauvageot! De nombreux travaux ont validé la garde alternée dans l'intérêt de l'enfant, hélas en majorité étrangers faute d'un financement correct et l'utilisation de vraies compétences dans le domaine, étroitement verrouillé en France, des recherches sur la famille. L'enfant jeune souffre-t-il de cette alternance ? Aucune statistique n'existe. La technique du 'case-report' ne devrait jamais faire tirer de conclusion sans de réelles études. D'énormes bourdes scientifiques ont été ainsi commises, au niveau médical notamment, faute d'un minimum de rigueur et de l'emballement irresponsable de quelques-uns. Dans quelles revues scientifiques d'audience internationale ceux qui dénoncent la garde alternée chez les tout-petits ont-ils exposé leurs théories ? Les mêmes ont fini par perdre toute mesure et endosser les habits de militants, ce qui n'a rien de déshonorant, mais jette un sérieux doute sur l'impartialité de leurs 'travaux'. Pour ce qu'on en sait, il s'agit de mères en grande difficulté dont les autres causes que l'alternance ne sont tout simplement pas discutées; on peut avoir quelques interrogations sur les soins qui leur sont prodigués dans ce contexte. De même, l'argument de l'allaitement pour rejeter la garde alternée, si elle soulève en effet quelque émotion, doit être rapporté à la durée moyenne de celui-ci, très inférieure à 3 mois ; de là à autoriser l'alternance à partir de 3 mois... Au niveau des expertises individuelles, comment désormais faire confiance aveuglément à quelques pédopsychiatres et travailleurs sociaux dont les préjugés et les comportements négligents -revendiqués par certain au motif d'une rémunération insuffisante! - ont créé le désastre d'Outreau? Vous trouverez des propositions concrètes à ce sujet dans la suite de notre contribution. Au sujet de la garde alternée d'enfants plus grands, force est de constater qu'elle manque de visibilité, même si on sait qu'elle est pratiquée au sein de la magistrature et des administrations centrales... Les raisons en sont simples, mais largement méconnues car hautement "politiquement incorrectes": - la garde alternée est pour l'instant pratiquée dans des catégories socio-professionnelles plutôt supérieures et ces dernières ne voient pas leur passage à la télévision comme une promotion, bien au contraire, malgré de fréquentes sollicitations des journalistes, - elle est franchement mal vue par les parents ayant la garde 'principale' de leurs enfants, et ce d'autant plus qu'elle est plus exclusive; il n'y a donc aucune raison d'encourir l'hostilité des voisines, parents d'élèves etc. - elle reste chère faute de dispositifs de financements convenables et équitables entre parents pour favoriser ce mode de garde, - elle reste fragile tant que les enfants ne sont pas adolescents, le père étant à la merci d'un retournement de la mère contre ce mode de garde; ce à quoi les juges font droit quasi-automatiquement, - il n'est donc pas exagéré de dire que la garde alternée se poursuit souvent sous contrôle de la mère (avec parfois des arrangements financiers qui lui sont favorables) ou grâce à la générosité ou la bienveillance de mères 'conciliatrices', pas toujours bien vues des autres, nous l'avons vu, - un certain nombre de gardes alternées en quelque sorte 'clandestines' et sous contrôle plus étroit encore de la mère, concerne des situations où les jugements classiques d'exclusion d'un des parents donnent lieu dans la pratique à "un meilleur accord": l'hébergement glisse progressivement vers une alternance, surtout vers l'adolescence, et ces situations ne reviennent devant les juges que si le père prétend à diminuer de ce fait le montant de la pension... - la moindre difficulté avec les enfants, et on peut dire que la vie de famille en général n'en manque pas, fait trop souvent porter le soupçon sur ce mode de garde par les tiers intervenants: autres parents, psys, travailleurs sociaux etc. : ignorance et préjugés restent tenaces, - le monde de l'entreprise et plus généralement du travail ne font pas suffisamment place à l'aménagement des horaires pour les pères qui doivent bien souvent mettre un temps leur plan de carrière en sourdine, ce dont les femmes font l'expérience depuis longtemps, - enfin de nombreux pères, il faut le reconnaître, n'y sont ni prêts ni encouragés à la proposer: on voit jusqu'à leurs propres avocats y être hostiles! On peut s'étonner de voir au sujet de la garde alternée des prises de position d'autant plus tranchées qu'elles sont plus hostiles, de la part de personnes vivant dans des couples unis ou encore unis, alors que la liberté de pouvoir divorcer ne soulève plus guère d'indignation. De façon moins factuelle que les remarques précédentes, on peut néanmoins risquer l'hypothèse qu'elles traduisent un certain rapport de force entre hommes et femmes au sein des couples au sujet de l'enfant... ce que personne n'a vraiment envie d'examiner. Le paradoxe majeur concernant les débats autour de la garde alternée est que les voix les plus entendues sont précisément celles de parents qui ne la pratiquent pas: ceux qui la revendiquent comme un souverain bien sans vraiment en connaître les difficultés et ceux (celles) qui la redoutent et la dénoncent pour mieux défendre une certaine toute-puissance sur leurs enfants; le discours change à l'adolescence, mais il est souvent trop tard... L'ENFANT DE PARENTS SEPARES DOIT ETRE DEFENDU, D'ABORD, PAR DES LOIS JUSTES ET BIEN APPLIQUEES: A- concernant les modifications envisagées sur l'âge minimum de l'alternance: Nous avons vu que l'exposé de quelques cas particuliers, exacerbés par le conflit des parents et un discours "d'expert" emporté par l'émotion n'est pas un argument suffisamment solide pour faire modifier la loi. Il est au contraire urgent de dissuader la prétention de certains parents au monopole sur leurs enfants. C'est une maltraitance que de priver un enfant petit de l'attachement « multiple », en particulier à ses 2 parents. B - Pour un aménagement éventuel de la loi et des usages, nous proposons quelques idées : 1) Généraliser la responsabilisation et l'égalité parentale : L'intérêt de l'enfant est d'être élevé par ses deux parents et d'avoir égal accès à ses deux parentèles. Il convient donc d'inscrire dans le code civil que la résidence alternée de l'enfant de parents séparés ne peut être refusée si un parent la demande et que toute opposition à cette alternance, opposition qui ne serait pas justifiée par des arguments solides, constitue présomption de mauvaise foi de ce parent récalcitrant et présomption d'inaptitude à assurer l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge devra se limiter, le cas échéant, à aménager les conditions pratiques de l'alternance. La seule exception permettant au juge de refuser une alternance demandée doit être justifiée par l'incompétence démontrée de l'un des parents et la démonstration que son refus va dans le sens de l'intérêt de l'enfant qu'il convient alors de motiver. Nous proposons donc que soit adjoint dans la proposition de loi 2071 au chapitre 6 un article disant que dès l'âge de la maternelle la résidence alternée est de droit. Faute d'une telle mesure, se continuera la tradition judiciaire de fabrication massive de semi-orphelins. Tout projet ou proposition de loi qui vise à écarter et déresponsabiliser un parent compétent au profit de «techniciens», plus ou moins délégués par l'Etat est pervers. 2) Légaliser dans le code civil des accords prénuptiaux ou «préparentaux» prévoyant l'éventualité de séparation du couple: Les contrats de mariage (et PACS ...) doivent pouvoir comporter des clauses organisant la vie des enfants après séparation des parents. Actuellement, les parents responsables sont traités comme des mineurs et la loi, et/ou le juge, désavouent leur prévoyance et les poussent au conflit ou encore les forcent à l'inobservation d'un jugement déséquilibré. C - Propositions concernant les procédures pour fixer les modalités de l'autorité parentale: 1) On a vu les désordres causés par les expertises pédopsychiatriques dans le domaine pénal. Ce sont les mêmes experts, requis par les JAF, qui interviennent dans le domaine civil et orientent la décision des magistrats. Au surplus les JAF font souvent appel à des enquêteurs sociaux non seulement pour évaluer les conditions économiques mais aussi pour examiner psychologiquement parents et enfants. Le tout sans aucun encadrement du NCPC : enquêteur irresponsable, non agréé ni assermenté, recours à des associations retouchant les rapports d'enquête, absence de contradiction, de transparence, et d'équité. Ces pratiques déplorables sont contraires à l'article 6 de la CEDH, il convient d'introduire les règles de déontologie qui existent dans le NCPC en matière de mesures d'instruction. 2) En matière de justice familiale, le huis-clos strict, la procédure du juge unique sont très décriés par les parents qui se plaignent du manque d'équité, de transparence, de l'absence de contradiction et finalement de l'idéologie du JAF. Pour rétablir l'image de la justice, nous proposons la présence d'observateurs désignés par les parties pour assister aux audiences. Nous terminerons, en hommage à nos propres parents, sur un appel à considérer en priorité la sécurité du statut juridique des parents et leur droit de vivre avec leurs enfants dans l'intérêt supérieur de ceux-ci. Nous rappellerons cette prise de conscience du Garde des Sceaux, M. Pascal Clément, le 01/12/05: "Qu'y a t-il de pire que de ne pas voir grandir son enfant lorsqu'on est privé de (cette) liberté par la force d'une justice injuste ?" Et n'est-il pas de plus grande angoisse pour les enfants que de risquer de perdre leurs parents? Veuillez agréer, Monsieur le Président de la Commission d'Information sur la Famille et le Droit des Enfants, nos respectueuses salutations. Pour l'enfant et son droit, Louis-Albert STEYAERT Président PROPOSITIONS DE L'ENFANT ET SON DROIT REMISES LE 18/10/2000 A MME MARIE-CHRISTINE GEORGE, CONSEILLERE DE MME SEGOLENE ROYAL, MINISTRE DELEGUEE A LA FAMILLE En vous remerciant de nous accorder cet entretien sur la promotion de la parentalité dans le contexte des séparations parentales, nous souhaitons insister, Madame, sur la nécessité d'accorder une représentation des associations de parents séparés dans les commissions concernant les familles. Nous vous présenterons brièvement les enjeux immédiats (1), les concepts fondamentaux pour se donner les moyens d'y faire face (2), les premières conséquences pratiques au plan fiscal et réglementaire (3), un encadré sur la stabilisation matérielle des situations existantes, un autre sur la proposition d'un suivi de ces mesures, et enfin quelques exemples d'alternances possibles. Nous joignons quelques exemples de notre réflexion sur les enjeux à plus ou moins long terme des séparations parentales. 1) les enjeux - promouvoir un modèle de bientraitance de l'enfant qui reconnaît explicitement: son droit d'être élevé par ses deux parents son besoin d'avoir deux parents qui se respectent dans leur dimension de parent, quels qu'aillent pu être la nature et le niveau de conflit entre les deux adultes - désamorcer les conflits: promouvoir les discours sociologiques, psychologiques, judiciaires et médiatiques de l'alternance de l'hébergement, promotion de la médiation et créer des incitations financières à son exercice réel 2) les moyens: simplification, intérêt de l'enfant, respect des délais - simplifier le 'régime commun' des séparations dans les mesures provisoires: - définir d'un côté ce qui revient aux difficultés de la séparation entre adultes dans les aspects financiers et patrimoniaux notamment - cadrer l'obligation d'accord entre parents concernant les enfants en posant comme une urgence des dispositions provisoires préservant leur contact avec les deux parents et poser l'obligation d'imaginer leur vie future suivant les principes suivants(cf. infra) - donner un contenu explicite dans la loi, les règlements, les directives éventuelles de l'intérêt supérieur de l'enfant, dont: - le maintien de contacts prolongés, réguliers, voire égaux en temps entre l'enfant et ses deux parents, - reconnaître comme une maltraitance la volonté et la complicité active ou passive d'entraver les contacts entre l'enfant et un de ses parents dans le cadre des accords ou du droit de visite, et sauf cas exceptionnels mettant l'enfant en danger, reconnaître de même le danger de cette maltraitance, considérer comme circonstances aggravantes l'utilisation de faux en écriture, de faux témoignages, la complicité ou la manipulation à cette fin de personnes ayant autorité ou de personnel de la fonction publique. De même, le dénigrement répété de l'autre parent devant l'enfant et la pression psychologique "d'aliénation parentale" doivent être reconnus comme une atteinte à la personne de l'enfant. le principe du parent le plus tolérant (principe 'californien'): en cas d'impossibilité pour l'un des parents de conclure ou de respecter un accord d'hébergement au bout de quelques semaines ou quelques mois, l'hébergement principal, la résidence principale et les avantages qui en découlent seront attribués au parent qui présente le plus de garanties de favoriser le contact avec l'autre parent. Nous insistons sur le caractère indispensable et nécessairement conjoint de ces deux notions, la qualification de maltraitance dans la volonté de détourner l'enfant d'un de ses parents et le principe du parent le plus tolérant dans le maintien du contact enfant-parent dans la cohérence de la promotion de la parentalité. 3) conséquences pratiques et application aux domaines législatifs et réglementaires résidence de l'enfant: la mesure la plus urgente est de créer la notion de double résidence, l'une chez le père, l'autre chez la mère, attachée à l'autorité parentale et quelles que soient les modalités d'hébergement. fiscalité: domaine-clef qui entraîne en cascade de nombreuses conséquences dans tous les aspects financiers. - Quart de part fiscale pour chacun des foyers fiscaux des parents pour les premier et deuxième enfant, conséquences en proportion pour les suivants, quelles que soient les modalités d'hébergement. - Intégration des pensions alimentaires éventuelles en déduction des revenus avant abattements - Intégration des frais de transports éventuels dans les déplacements des enfants ou des parents dans les déductions forfaitaires ou les frais réels, avec plafonnements éventuels, en partageant ces frais entre parents assurance-maladie et assurances complémentaires: ouverture automatique des droits des deux parents aux enfants, - bénéfice automatique du tiers payant, à charge pour les régimes d'assurance-maladie de pouvoir recouper les prestations sur un seul numéro d'identification par enfant si besoin, - inscription automatique des deux parents comme bénéficiaires du remboursement du ticket modérateur ou des prestations particulières sur présentation du relevé de règlement de l'assurance maladie, - partage parental si nécessaire de la contribution à l'assurance complémentaire ou alignement sur l'assurance complémentaire la plus favorable toutes ces mesures sont justifiables, sans préjudice des régimes concernés prestations sociales: - partage à égalité des prestations sociales liées à l'enfant entre parents, quelles que soient les modalités d'hébergement. a priori surprenante, cette mesure favorisera le parent éventuellement hébergeant principal à solliciter l'entretien de l'enfant par l'autre parent - avantages liés aux familles nombreuses attribuées aux deux parents détenteurs de l'autorité parentale éducation: - application de la circulaire d'octobre 1999 sur l'inscription des adresses des deux domiciles, qui sera obligatoire concernant les deux résidences, et information en double des deux parents par courrier. - droit de vote pour chaque parent et double vote pour les familles non séparées banques, épargne: - exclusion du versement des pensions alimentaires éventuelles de l'amputation des revenus au titre de l'endettement - mesures spécifiques à étudier concernant l'ouverture de PEL et autres contrats financiers à longue échéance au titre des enfants - paiement des pensions alimentaires par virements exonérés des frais de virement interbancaires, ou intégrations de ceux-ci dans les déductions précitées. les autres domaines: - relevant de l'aide publique décentralisée, relevant des conventions collectives, des comités d'entreprise et d'autres formes d'entraide associative ou privée comportant un versement régulier ou en capital (hors donations ou droit à héritage par exemple de grands-parents à enfants soumises aux règles fiscales en vigueur et dont le versement est effectif à la majorité) doivent être soumises au principe d'intégration à la contribution aux enfants et permettre le contrôle ou à l'information des deux parents. - l'enfant majeur, obtenant l'attribution d'une pension d'un ou des deux parents, doit pouvoir présenter l'état de son capital constitué et des éventuels revenus qu'il en tire pour justifier le versement des contributions à son éducation jusqu'à 25 ans au moins, sauf à y renoncer. Il ne s'agit pas de dresser pour l'heure une liste exhaustive des conséquences de l'application des principes de co-parentalité. L'application de ces principes au maintien ou à la restauration de la responsabilité, à la dignité et au bien-être de chacun, doit prendre en compte de façon IMPERATIVE le maintien des moyens d'existence de tous les parents, en priorité les parents exclus et 'monoparentaux' sur la base des besoins de l'enfant jusqu'à son indépendance. Ce doit être une priorité majeure de l'administration, des intervenants sociaux, privés (banquiers, assureurs...), légaux (magistrats, experts, notaires, administrateurs, curateurs, tuteurs...) pour lesquels une formation spécifique, avec rappel à leur responsabilité, doit être définie, organisée et supportée branche par branche. Parce qu'un enfant a droit à ses deux parents, être assuré de son droit à être un parent responsable à part entière à son tour et qu'il s'agit d'un enjeu individuel, social et citoyen majeur: Création d'un Observatoire de la Parentalité Les moyens de suivi de ces mesures doivent relever d'une mission spécifique, autonome, centrée sur la co-parentalité et le développement harmonieux et respectueux de l'enfant dans un cadre citoyen, suivant les principes exposés plus haut, définie de façon réglementaire ou législative, incluant les représentations de parents séparés, constituée pour commencer sur la base de la commission existante, renouvelable suivant les dispositions arrêtées (QS), disposant d'un budget propre, qui rendra compte chaque année de sa mission au gouvernement et aux assemblées, devra publier un rapport annuel public, comprenant une véritable saisie des données judiciaires, fiscales, et un pouvoir d'investigation direct ou par saisine des organismes qu'il jugera utile (IGAS, Intérieur, INSEE... voire organismes indépendants) concernant les décisions judiciaires en matière familiale, (à commencer par l'obtention de statistiques détaillées), en matière de justice des mineurs, l'impact économique et social, les résultats par régions et par départements, les échanges dans le cadre européen et international. Voici quelques exemples d'alternances possibles: Une semaine sur deux, une quinzaine sur deux, avec plus ou moins chevauchement d'un enfant à l'autre, Une année sur deux dans les cas d'éloignement important pour préserver la scolarité (déplacement que vivent nombre d'enfants de certains fonctionnaires, de militaires, de coopérants...) Une alternance à jours fixes dans la semaine, souhaitée davantage par les parents géographiquement proches et soumis à des obligations professionnelles particulières, Par défaut, on peut envisager schématiquement:
L'ENFANT ET SON DROIT (avril 2005) COMPORTEMENTS ALIENANTS DANS LES SEPARATIONS PARENTALES La fragilité du lien entre l'enfant et le parent qui n'a pas la garde n'est plus à démontrer. Or des comportements nés du sentiment de toute-puissance du parent 'gardien' s'exercent au détriment de l'enfant et sont parfois si envahissants que les psychiatres discutent actuellement d'une véritable maladie psychique, le Syndrome d'Aliénation Parentale (SAP). Sans rentrer dans les considérations scientifiques ou techniques, nous constatons qu'un certain nombre de ces comportements destinés à blesser ou à anéantir l'autre parent constituent une véritable maltraitance de l'enfant. Ajoutés à d'autres comportements plus ou moins banalisés, ils constituent de par leur caractère répété - ou isolés mais associés entre eux- des comportements aliénants devant être clairement recherchés et sanctionnés par le juge en énonçant clairement la possibilité d'un 'changement de garde'. 1- faire raconter tous les événements à l'enfant lors de la visite chez l'autre parent 2- demander des informations sur la vie personnelle de l'autre parent 3- écouter les conversations de l'autre parent avec l'enfant 4- dénigrer systématiquement les vêtements achetés par l'autre parent et ou sa parentèle 5- faire ou laisser assister l'enfant à des entretiens, y compris téléphoniques, avec des parents ou des tiers où l'autre parent est critiqué, où on laisse entendre que l'enfant n'est pas bien élevé ou que l'enfant est en danger chez l'autre parent 6- planifier les activités de l'enfant quand il est chez l'autre parent 7- appeler systématiquement l'enfant et à plusieurs reprises dans la journée quand il est chez l'autre parent ou le faire appeler lui-même 8- dénigrer de façon répétée le compagnon ou la compagne de l'autre parent 9- désigner le père (ou la mère) de l'enfant à des tiers devant l'enfant comme M. Untel ou Mme Untel 10- refuser à l'autre parent des informations sur les activités de l'enfant 11- refuser à l'autre parent des informations sur la scolarité de l'enfant 12- entretenir des codes propres au parent et à l'enfant quand celui-ci communique depuis le domicile de l'autre parent 13- prendre prétexte que l'enfant a d'autres activités (bain, travail, jeu) quand l'autre parent appelle ou dire à l'enfant "je te laisserais bien jouer, mais ton père (ta mère) veut absolument te parler" 14- faire appeler l'autre parent M. Untel ou Mme Untel par l'enfant 15- tenter de faire changer à l'enfant son nom ou son prénom 16- prétendre que l'enfant est en danger chez l'autre parent 17- renvoyer les cadeaux adressés à l'enfant par l'autre parent 18- faire des simulacres de rendez-vous ratés (par exemple dire à l'enfant que l'autre parent va venir le chercher à une heure, un jour ou un endroit que l'on sait pertinemment erroné. Qu'il s'agisse de prévention des conduites à risque des adolescents, des non-paiements de pension alimentaire ou des scores de réussite scolaire, la garantie d'un contact éducatif prolongé et soutenu de l'enfant avec ses deux parents est un critère qui devrait en faire une priorité des institutions. La justice ne devrait pas tolérer des comportements parentaux visant à déstabiliser la relation de l'enfant avec l'autre parent ni laisser se développer, a minima, des incivilités plus ou moins graves dans ce domaine. Enfin, l'expertise demandée par le juge, plutôt que de traiter les parents en malades mentaux potentiels ou se lancer dans des interprétations plus ou moins psychanalytiques devrait s'attacher à rechercher concrètement ce type de comportement à haut risque de rupture du lien parent-enfant. ---------------------
l'enfant et son droit 12, rue Alphand 75013 Paris http://www.enfant-du-divorce.magic.fr A l'attention de M. Patrick BLOCHE, Président de la Commission d'Information sur la famille et le Droit des Enfants de l'Assemblée nationale. RESUME DES PROPOSITIONS CONCERNANT LE DROIT DE L'ENFANT DE PARENTS SEPARES L'enfant de parents séparés reste encore victime d'un conflit de loyauté, faute de la volonté de mettre en place une véritable alternance auprès de ses deux parents. Malgré la sécurisation juridique de la garde alternée, l'application de la loi de mars 2002 et les pratiques judiciaires et sociales ne garantissent pas suffisamment le droit de l'enfant à être élevé par ses deux parents ni des procédures équitables dans la justice familiale. La pacification du conflit éventuel entre parents devrait être une priorité de la justice familiale dans l'intérêt de l'enfant. A- concernant les modifications envisagées sur l'âge minimum de l'alternance: L'exposé de quelques cas particuliers, exacerbés par le conflit des parents et un discours "d'expert" emporté par l'émotion n'est pas un argument suffisamment solide pour faire modifier la loi. Il est au contraire urgent de dissuader la prétention de certains parents au monopole sur leurs enfants. C'est une maltraitance que de priver un enfant petit de l'attachement « multiple », en particulier à ses 2 parents. B - Pour un aménagement éventuel de la loi et des usages: 1) Généraliser la responsabilisation et l'égalité parentale : L'intérêt de l'enfant est d'être élevé par ses deux parents et d'avoir égal accès à ses deux parentèles. Il convient donc d'inscrire dans le code civil que la résidence alternée de l'enfant de parents séparés ne peut être refusée si un parent la demande et que toute opposition à cette alternance, opposition qui ne serait pas justifiée par des arguments solides, constitue présomption de mauvaise foi de ce parent récalcitrant et présomption d'inaptitude à assurer l'intérêt supérieur de l'enfant. Le juge devra se limiter, le cas échéant, à aménager les conditions pratiques de l'alternance. La seule exception permettant au juge de refuser une alternance demandée doit être justifiée par l'incompétence démontrée de l'un des parents et la démonstration que son refus va dans le sens de l'intérêt de l'enfant qu'il convient alors de motiver. Nous proposons donc que soit adjoint dans la proposition de loi 2071 au chapitre 6 un article disant que dès l'âge de la maternelle la résidence alternée est de droit. Faute d'une telle mesure, il continuera la tradition judiciaire de fabrication massive de semi-orphelins. Tout projet ou proposition de loi qui vise à écarter et déresponsabiliser un parent compétent au profit de «techniciens», plus ou moins délégués par l'état est pervers. 2) Légaliser dans le code civil des accords prénuptiaux ou «préparentaux» prévoyant l'éventualité de séparation du couple: Les contrats de mariage (et PACS ...) doivent pouvoir comporter des clauses organisant la vie des enfants après séparation des parents. Actuellement, les parents responsables sont traités comme des mineurs et la loi, et/ou le juge, désavouent leur prévoyance et les poussent au conflit ou encore les forcent à l'inobservation d'un jugement déséquilibré. C - concernant les procédures pour fixer les modalités de l'autorité parentale: 1) On a vu les désordres causés par les expertises pédopsychiatriques dans le domaine pénal. Ce sont les mêmes experts, requis par les JAF, qui interviennent dans le domaine civil et orientent la décision des magistrats. Au surplus les JAF font souvent appel à des enquêteurs sociaux non seulement pour évaluer les conditions économiques mais aussi pour examiner psychologiquement parents et enfants. Le tout sans aucun encadrement du NCPC : enquêteur irresponsable, non agréé ni assermenté, recours à des associations retouchant les rapports d'enquête, absence de contradiction, de transparence, et d'équité. Ces pratiques déplorables sont contraires à l'article 6 de la CEDH, il convient d'introduire les règles de déontologie qui existent dans le NCPC en matière de mesures d'instruction. 2) En matière de justice familiale, le huis-clos strict, la procédure du juge unique sont très décriés par les parents qui se plaignent du manque d'équité, de transparence, de l'absence de contradiction et finalement de l'idéologie du JAF. Pour rétablir l'image de la justice, nous proposons la présence d'observateurs désignés par les parties pour assister aux audiences. ------------ "Qu'y a t-il de pire que de ne pas voir grandir son enfant lorsqu'on est privé de (cette) liberté par la force d'une justice injuste ?" (Pascal Clément, Garde des Sceaux, le 01/12/05) Et n'est-il pas de plus grande angoisse pour les enfants que de risquer de perdre leurs parents? ------------  Objet : Mission d'information sur la famille et les droits des enfants Cambrai, le 12 décembre 2005 A l'attention de Monsieur le Député P.BLOCHE Monsieur le Député, Je vous suis extrêmement reconnaissante de l'attention que vous portez aux travaux de notre association Procréation Médicalement Anonyme (PMA), et vous transmets, comme vous me le suggérez dans votre courrier du 15 novembre dernier, des informations complémentaires sur notre position concernant l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Je me permets de vous joindre également un article sur le don d'embryon, que j'ai rédigé avec Mme Delaisi de Parseval. Cet article a été publié en septembre 2004 dans Libération. Je reste à votre entière disposition et espère que notre association sera représentée sur les questions précises de votre mission concernant le don d'embryon et l'anonymat. Dans cette attente, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes respectueuses salutations. Dr Pauline TIBERGHIEN Présidente de PMA  Nombreux sont ceux qui, avant nous, ont pu mettre en garde contre les effets pervers de l'anonymat et du secret ...et cette prise de conscience dépasse largement nos frontières ! En France, au cours des 30 dernières années, 40 000 enfants sont nés d'un don de sperme anonyme. Depuis juin 2004, 6 enfants sont nés d'un don anonyme d'embryon et une dizaine de grossesses sont en cours. Procréation Médicalement Anonyme a pour objectif de mettre en garde contre ces techniques d'Assistances Médicales à la Procréation (AMP) avec tiers donneur anonyme ou double donneurs, afin de ne pas reproduire médicalement une situation qui revient à amputer un individu de sa propre histoire, et ce, en toute légalité. Les enfants issus de ces AMP doivent être replacés au centre des débats afin que l'héritage que nous leur laisserons soit complet : social, affectif, familial et ... biologique. Connaître son histoire...un droit élémentaire On peut disserter à l'infini sur l'importance ou le poids respectif du biologique et de l'affectif dans la filiation, on peut même privilégier l'un ou l'autre, au pire les opposer...Mais, en écoutant ceux pour qui la loi a érigé la règle du secret des origines, force est d'admettre que la filiation biologique participe à l'histoire de chacun.... La filiation est multiple : affective, sociale, charnelle et... biologique. C'est un tout. La filiation génétique est une réalité, on ne peut la nier. Bien sûr, considérée de façon brute ou isolée, la génétique ne définit en rien un individu ! La biologie est une pièce du puzzle complexe de l'identité d'un individu, mais son absence est cruellement ressentie...surtout quand elle provient d'un interdit, d'un secret... Les dons ne sont pas anonymes, ils sont secrets...au détriment du droit le plus élémentaire de chaque être : celui de savoir d'où il vient. Qui peut prétendre qu'il est préférable pour un enfant, qu'il ne sache jamais d'où il vient ? Quelle société peut volontairement refuser à celui qui le désire, de connaître son histoire ?....Et, si pour certains la filiation biologique n'est « pas si importante »....alors pourquoi la rendre secrète, pourquoi la cacher ? Une réflexion basée sur une expérience qui dépasse nos frontières En 1994, le principe de l'anonymat jusqu'alors purement interne aux CECOS, a été légalisé et inscrit de fait dans la loi dite de bioéthique. L'anonymat des dons de gamètes a été légalisé sans concertation avec ceux qui auraient pu témoigner de ce que « vivre sans racine » représente au quotidien : ---Les associations françaises de personnes nées sous X : nous avons « grâce » à eux, 60 ans de recul...En effet, il existe un dénominateur commun indéniable entre les personnes nées sous X et celles issues de dons anonymes, qui est l'impossibilité totale et complète d'accéder à ses origines biologiques. C'est pourquoi PMA et 5 associations françaises de nés sous X sont, depuis mai 2005, rassemblées et solidaires dans une « fédération de présidents » et réclament l'accès pour chacun à ses origines personnelles, et ce, quel que soit son mode de conception. ---Les personnes nées de dons anonymes : contrairement à la France, l'expérience étrangère est extrêmement documentée, et nous avons des échanges réguliers avec des associations similaires à PMA : - En Angleterre, M. le Pr Walter Merricks (membre de la HFEA) a fondé avec sa femme Olivia, l'association Donor Conception Network (1). Ils sont parents de deux grandes filles issues de dons de sperme anonyme. Ils prônent la transparence et militent depuis 1993 pour la levée de l'anonymat. L'association Dcnetwork, forte de 900 adhérents, fut à l'origine d'une réelle prise de conscience de la société britannique qui a abouti au changement de la législation le 01 avril 2005. - Dans le même temps, a été fondé le DonorLink Britannique (2), un registre d'informations génétiques basé sur le volontariat. Il est accessible à toutes personnes de plus de 18 ans et permet un échange d'informations entre donneurs de gamètes et personnes conçues par dons de gamètes. - A Toronto, Diane ALLEN (3) milite également depuis de nombreuses années pour la levée de l'anonymat des dons de gamètes, au même titre que Barry STEVENS (4), réalisateur canadien issu d'un don de sperme anonyme, qui a découvert en 2000, l'existence d'environ deux cent demi-frères et sœurs. - Aux Etats-Unis, Bill CORDRAY modère un célèbre forum de discussion entre personnes issues de dons anonymes (5) et depuis 2000, une nouvelle association et un registre génétique similaire à celui qui existe en Angleterre ont été fondés (6). - Petra THORN en Allemagne (7) a créé un groupe de travail dont le but est de sensibiliser les parents ayant recours aux dons à l'importance des origines biologiques, et d'inciter ces parents à dévoiler aux enfants la vérité de leur conception. - Le Professeur Ken DANIELS (8) poursuit le même objectif en Nouvelle-Zélande, et depuis 1993, une association de parents ayant recours aux dons a été fondée en Australie (9). Le don d'embryon : une bombe à retardement Il est souvent comparé à une adoption...il n'en est rien.... Dans une adoption, il faut secourir un enfant abandonné et lui trouver une famille. Le don d'embryon, c'est l'inverse...L'enfant a des parents biologiques qui vivent à priori toujours ensemble. Il a été désiré, conçu....il a des frères et sœurs biologiques issus de la même fécondation in vitro, conçus le même jour mais nés il a y plus de 5 ans. Mais lui, on l'a donné,...abandonné ? On fait de lui un X des temps modernes en effaçant à jamais son origine biologique. Sa raison d'être ne trouve d'explication que dans la souffrance d'un couple infertile... Le renoncement à la fertilité naturelle est un processus complexe et extrêmement douloureux. Avant la légalisation du don/accueil d'embryon, les couples infertiles n'avaient pas d'autre issue que de parvenir, au terme d'un travail personnel long et difficile, à dissocier ce qui leur paraissait jusqu'alors ne faire qu'un : porter un enfant et être parent. Le don d'embryon leur offre à présent la possibilité de donner la vie sans la transmettre. Avec l'accueil d'embryon, est créée l'illusion.....l'illusion de la fertilité par la toute puissante maternité : Cela voudrait il dire que porter un enfant est primordial pour le lien parent-enfant ? ou encore qu'une grossesse peut éviter voir résoudre les difficultés d'une adoption ? Une maman adoptive aimerait-elle son enfant davantage si elle l'avait porté ??... Le CCNE, dans son avis de 1998 s'est inquiété pour « ces enfants issus de dons anonymes (qui) ne pourront pas avoir connaissance de leurs ascendants génétiques, ce qui risque de les exposer dans leur quête d'identité, à la souffrance, voire à des troubles psychiques. » et a ajouté que « le don d'embryons cumule et aggrave les difficultés inhérentes au don de sperme et au don d'ovocytes »... Le secret ne répare rien Les couples infertiles sont dans une détresse terrible et cette souffrance, si légitime soit-elle, finit par aveugler. Cela fait 3, 5 ou 10 ans qu'ils désirent être parents et leur parcours médical n'est qu'un chemin semé d'échecs et de désillusions. Le recours à un tiers donneur est pour eux la solution ultime proposée par le corps médical....Ils oublient qu'avoir un enfant n'est pas synonyme d'être parent. Ils se persuadent qu'une grossesse va effacer les problèmes. ...La loi Française les incite à vivre dans l'illusion de la vérité et le déni de leur infertilité Ils ne peuvent renoncer à l'enfant « naturel » qu'au terme d'un travail long et difficile. Ce travail, le corps médical a tendance à leur laisser croire qu'ils vont pouvoir y échapper grâce aux dons anonymes : avec un tiers donneur, rien ne sera visible, ils pourront faire comme si...Mais en vérité, l'anonymat ne répare rien : il ajoute au contraire, à la rupture de la filiation, le poids d'un secret. Références : (3)http://www.InfertilityNetwork.org (4)http://www.cbc.ca/programs/sites/features/offspring/off_bio.html (5) http://members.optushome.com.au/dcsg/index.html (6) http://www.donorsiblingregistry.com (7)http://www.spendersamenkinder.de (9)http://members.optushome.com.au/dcsg/index.html 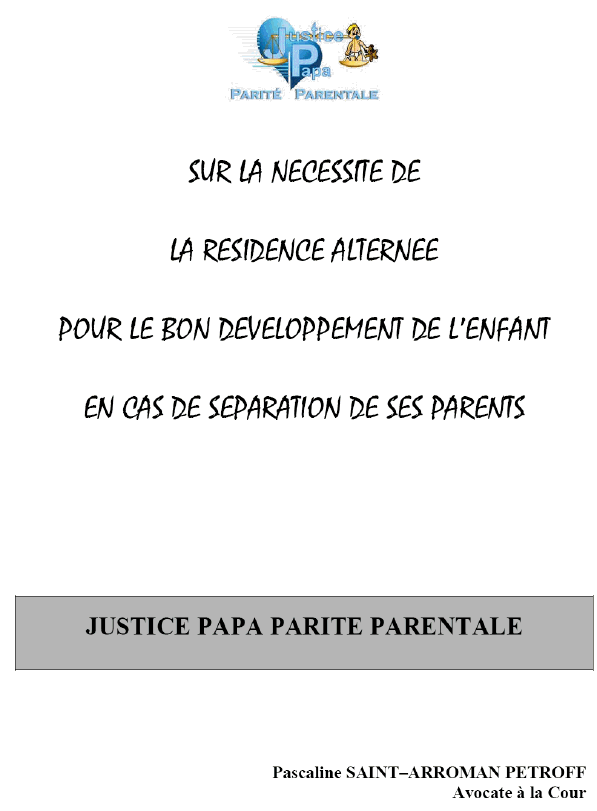 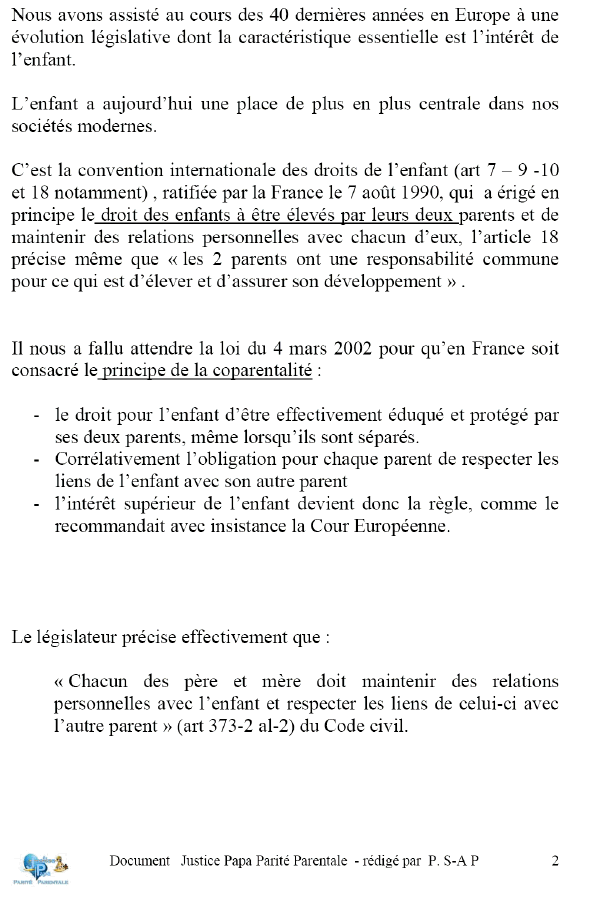 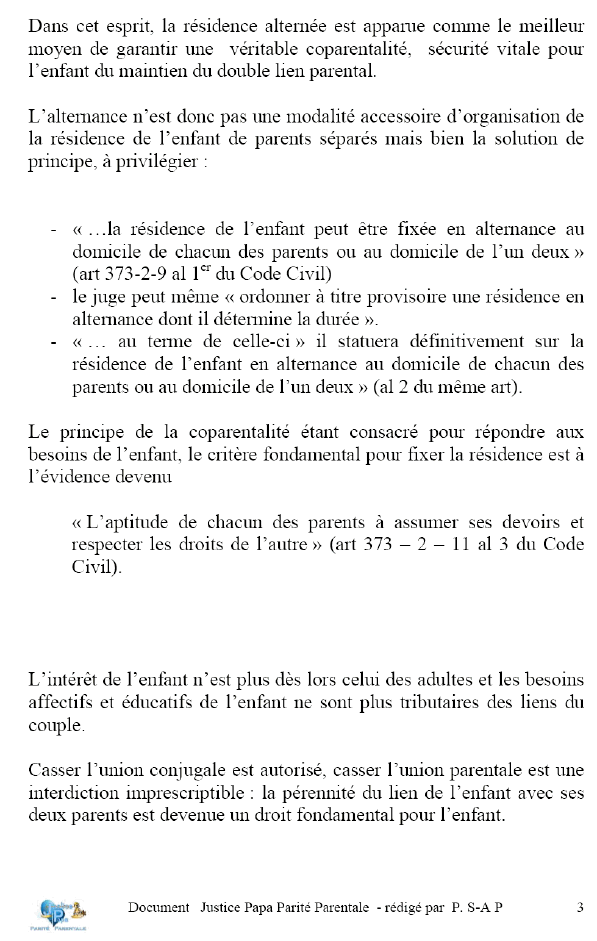 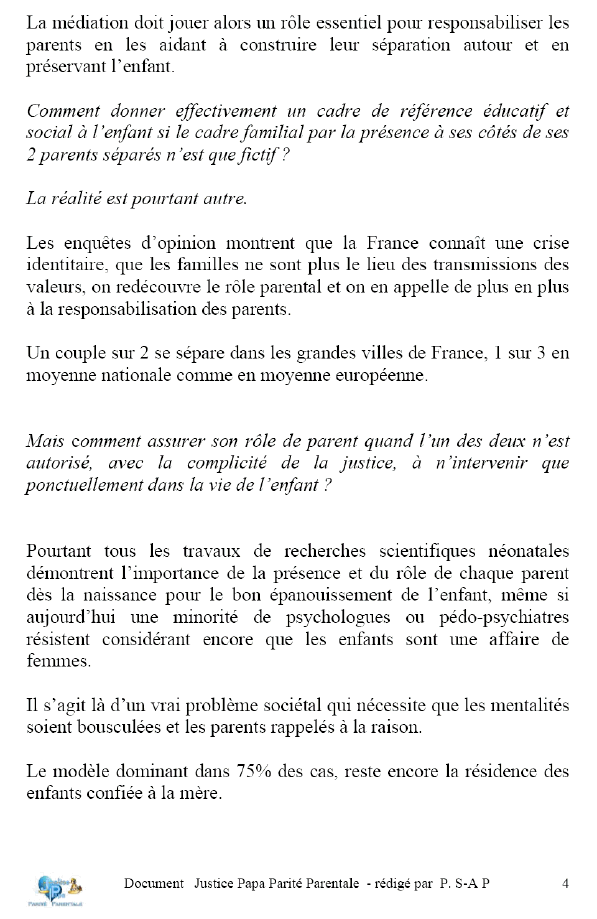 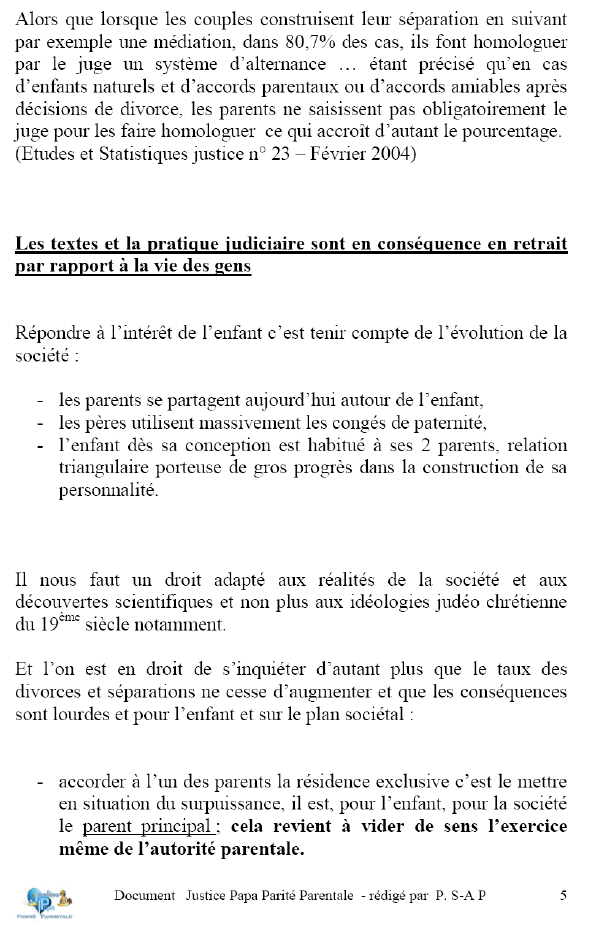 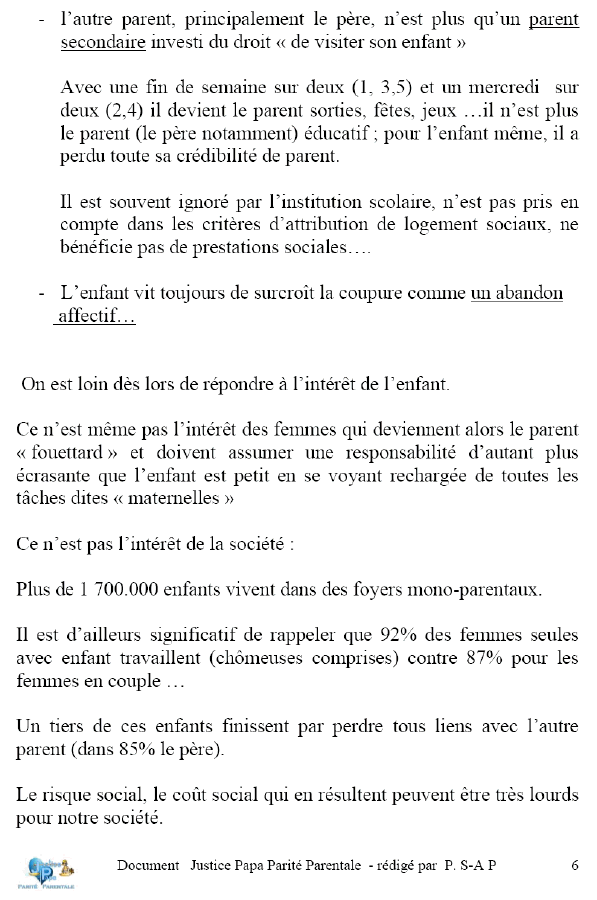 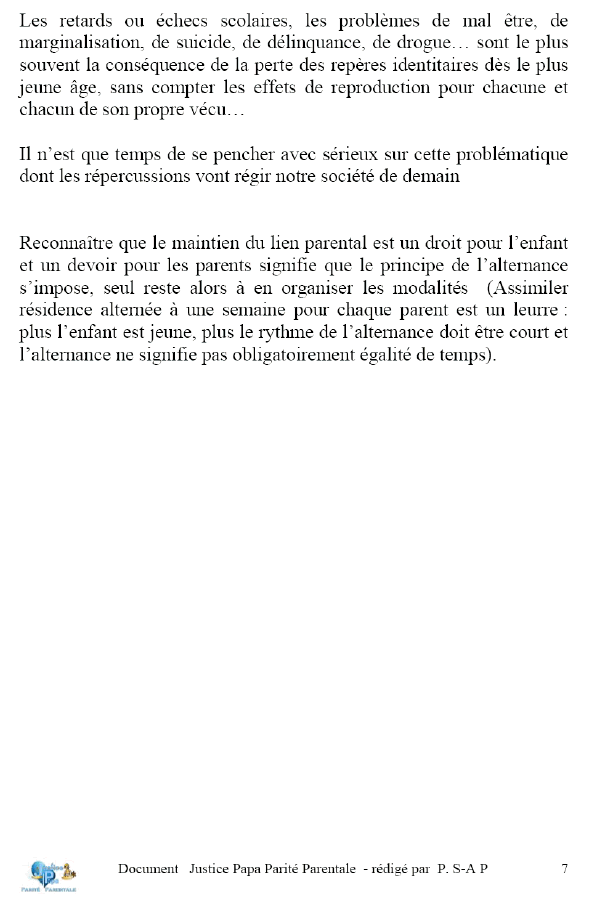 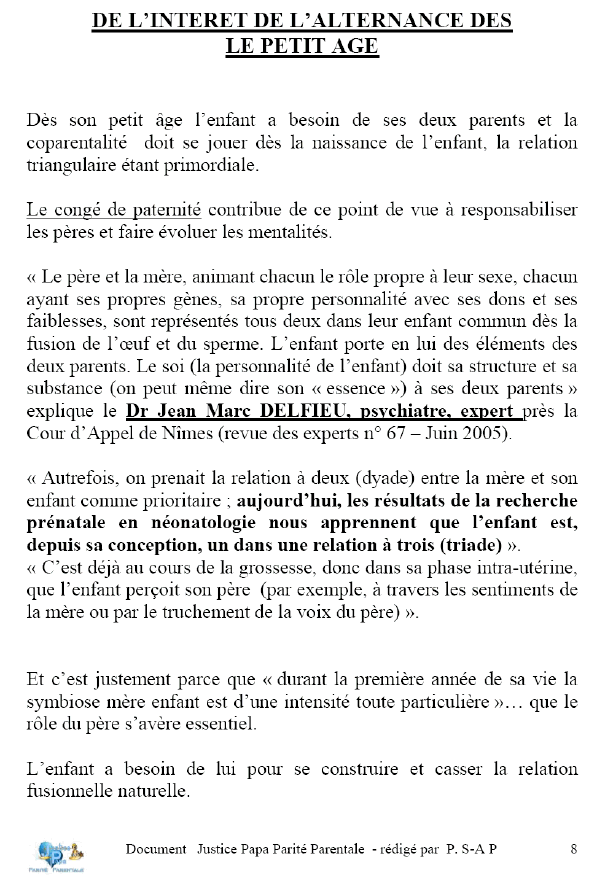 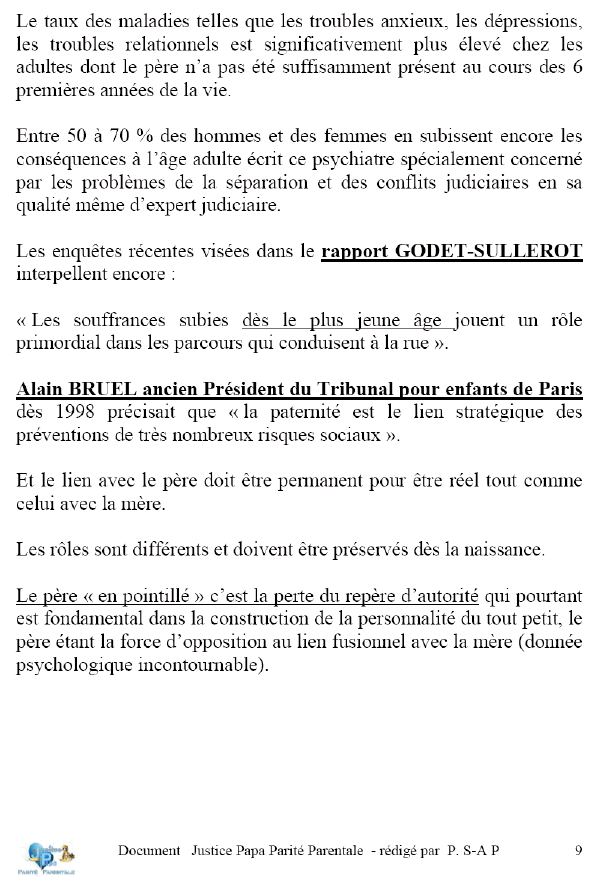 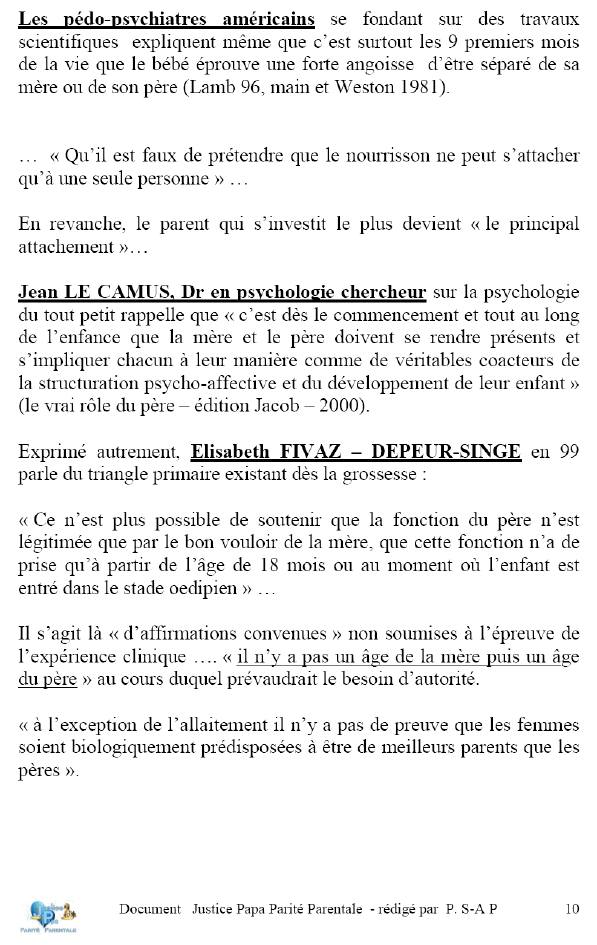 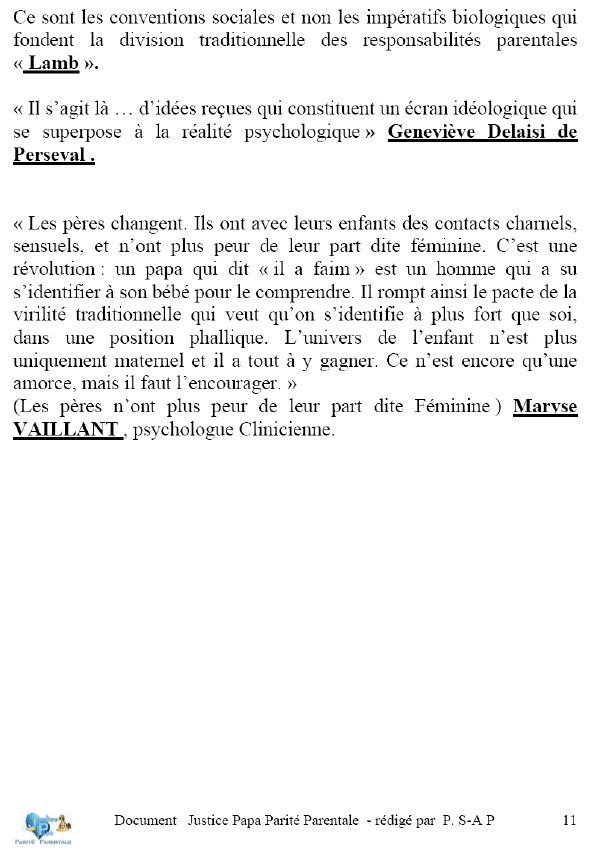 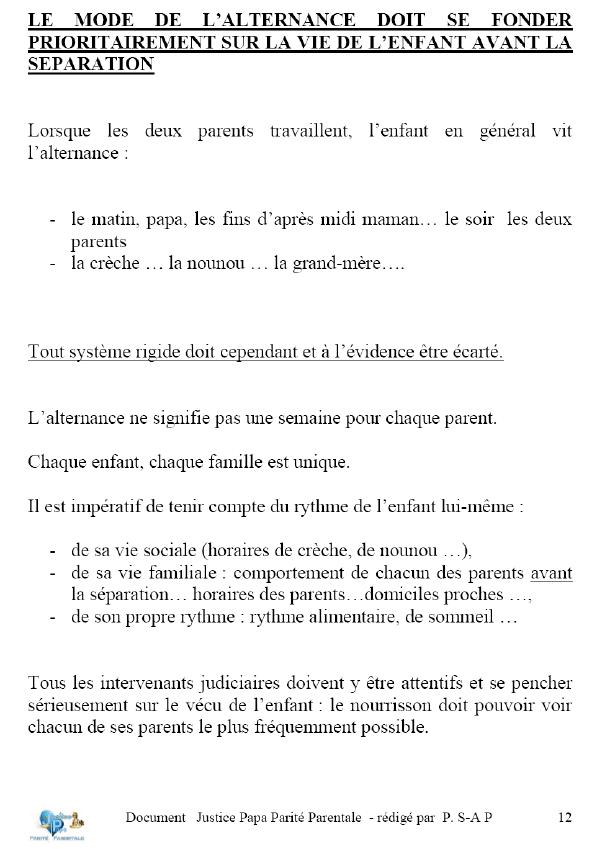 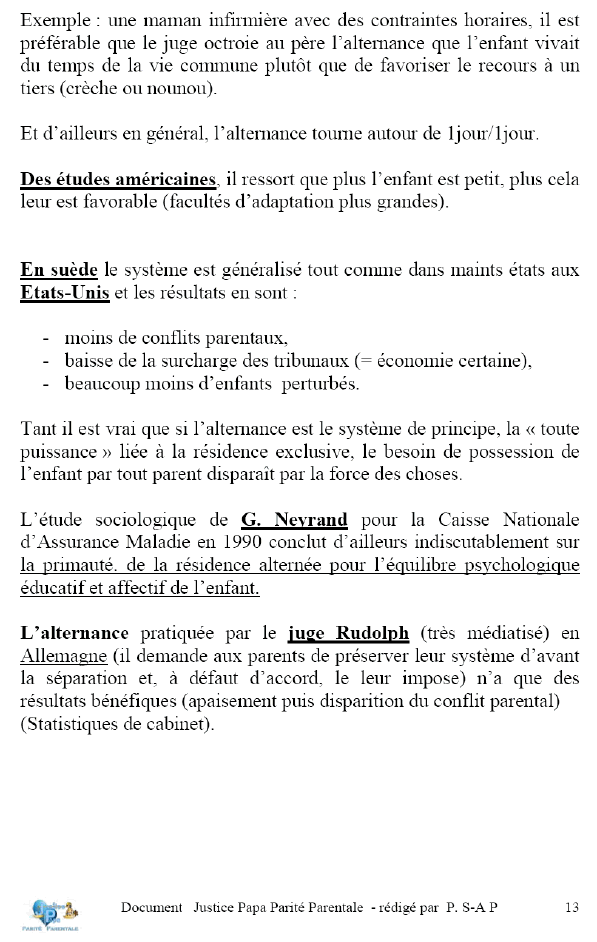 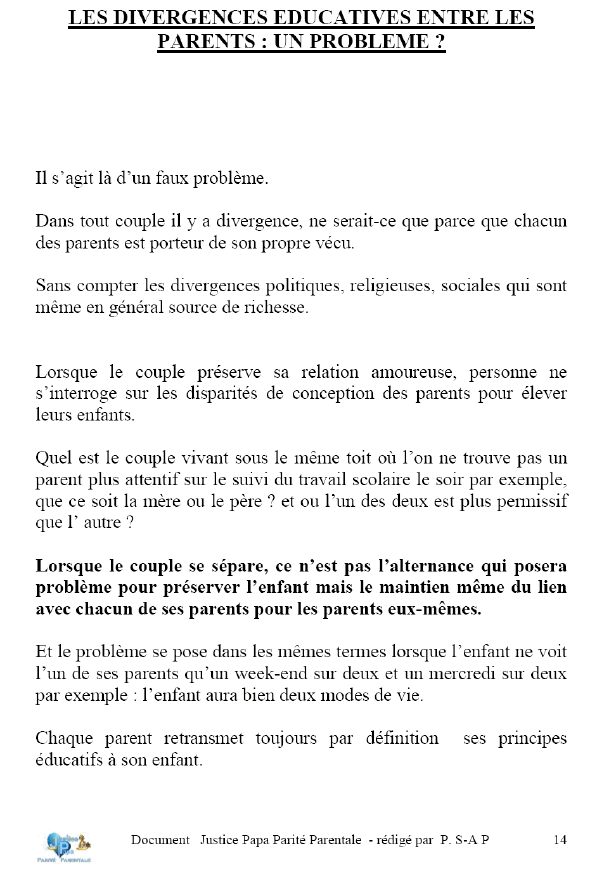 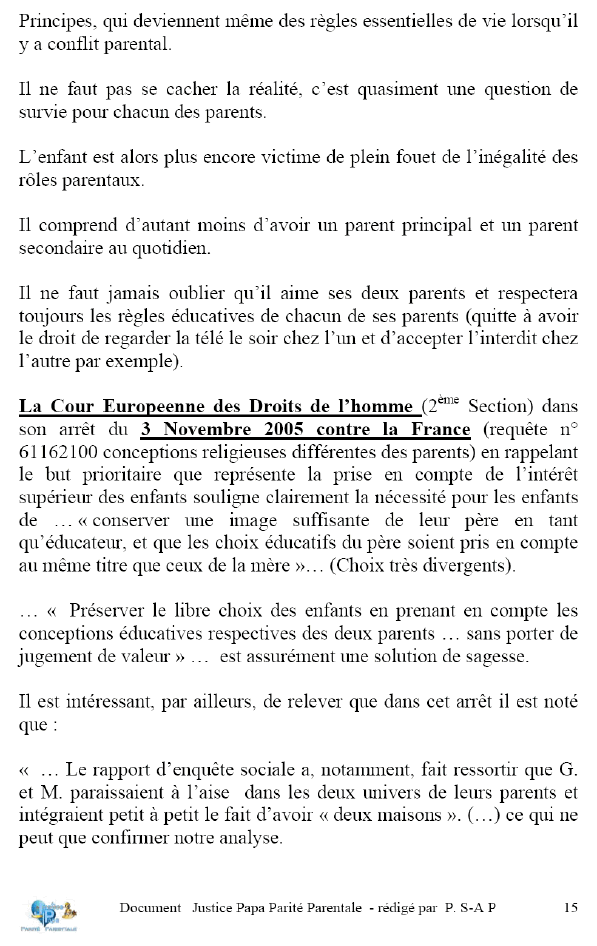 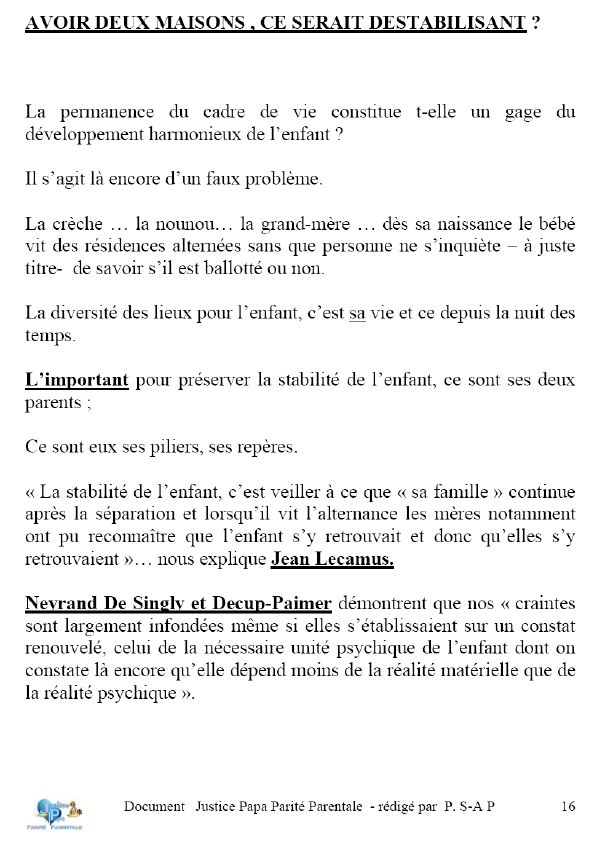 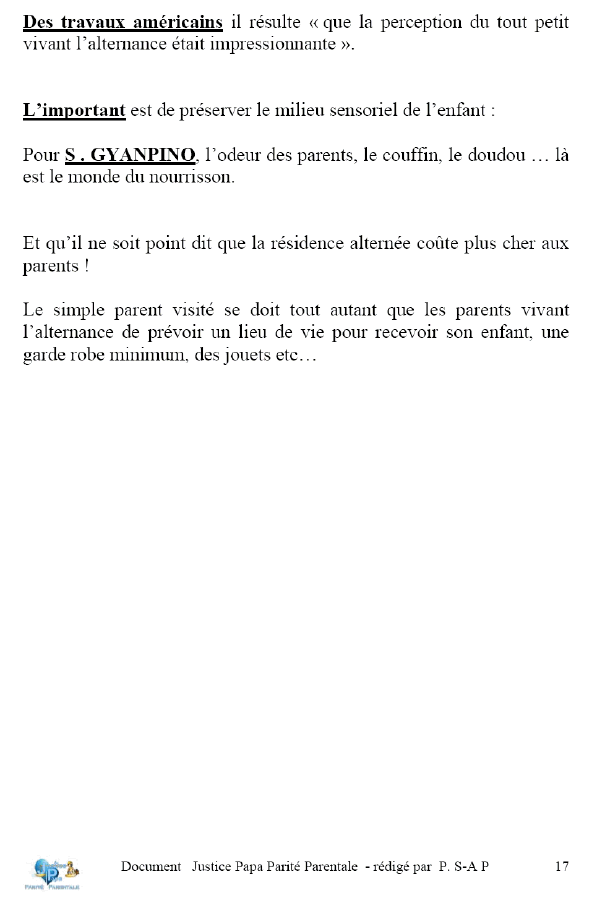 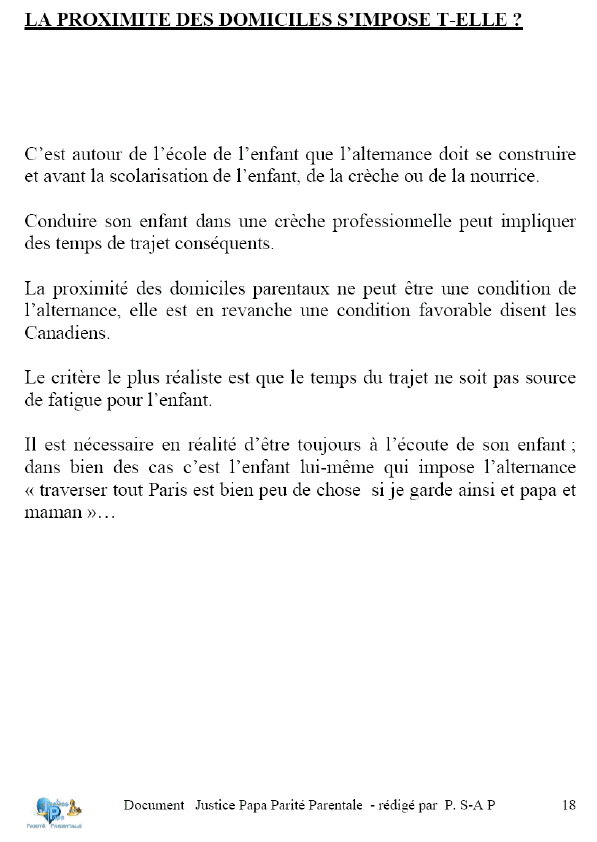 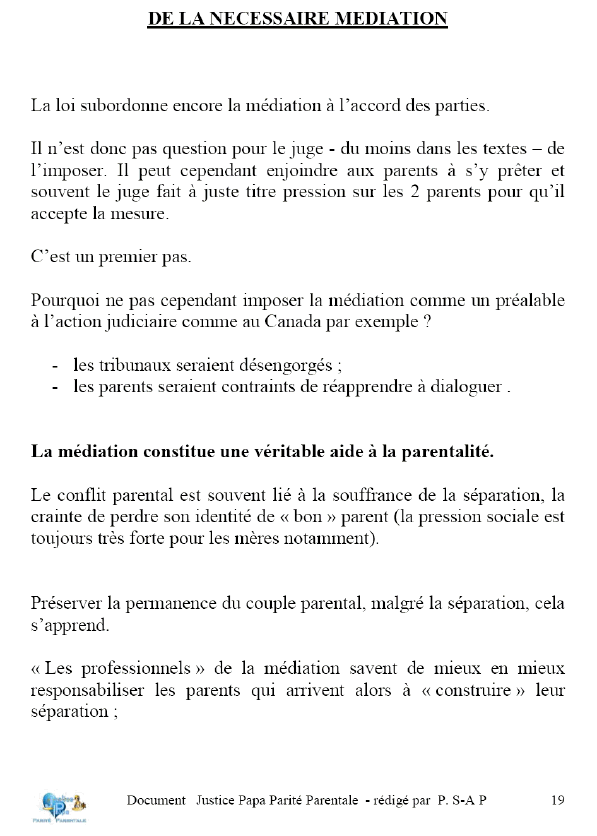 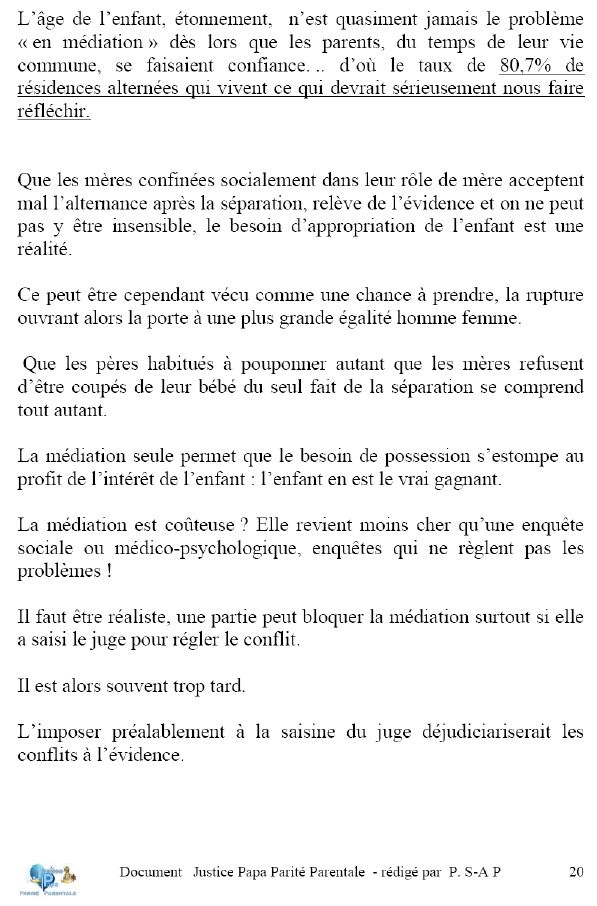 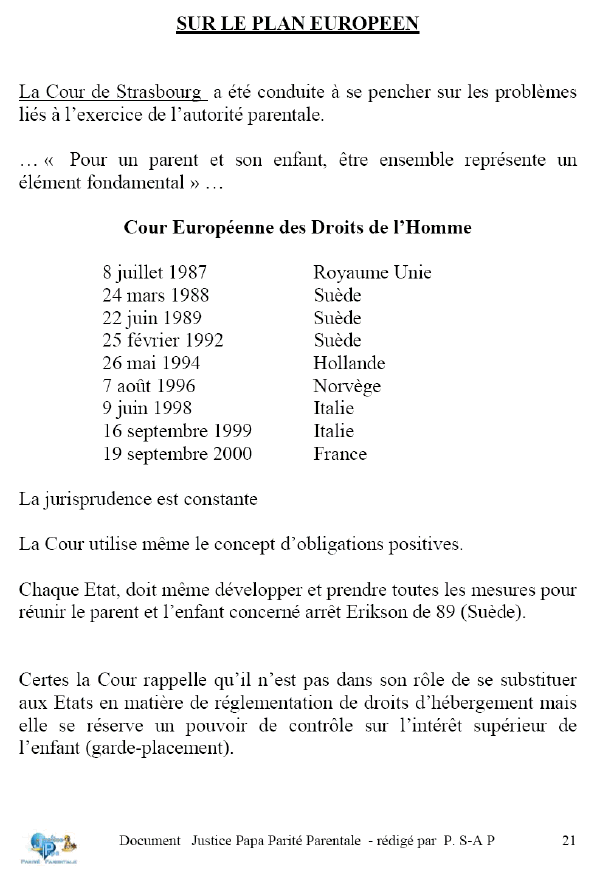 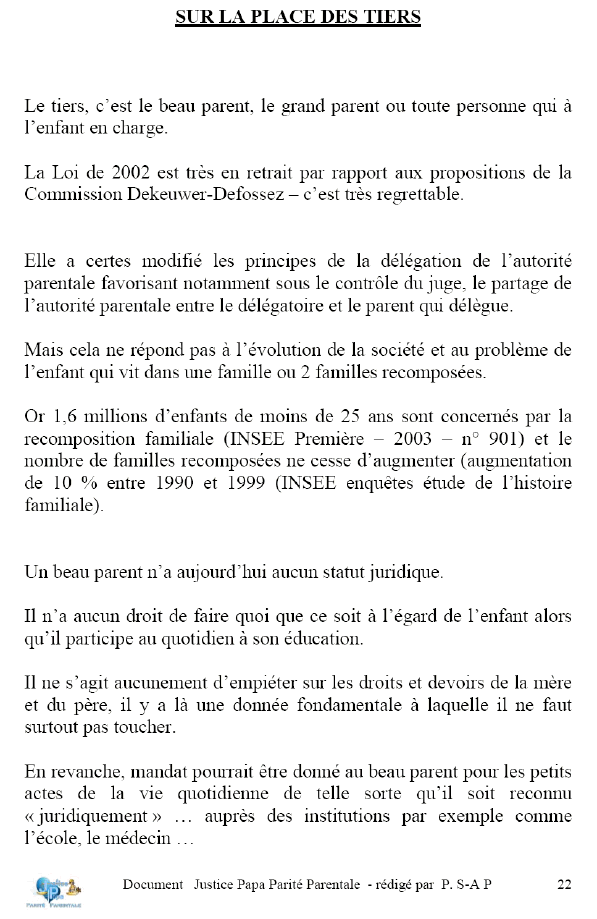 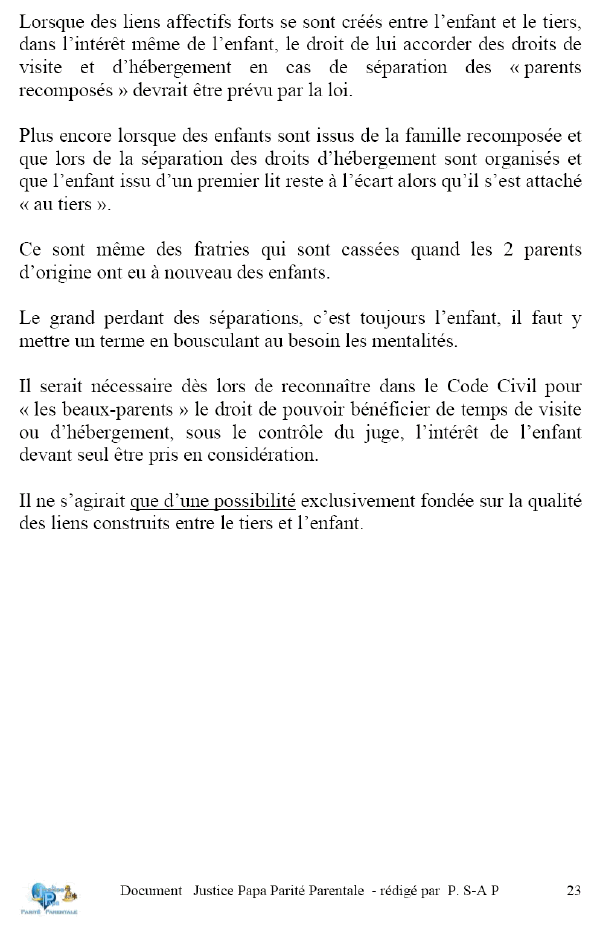 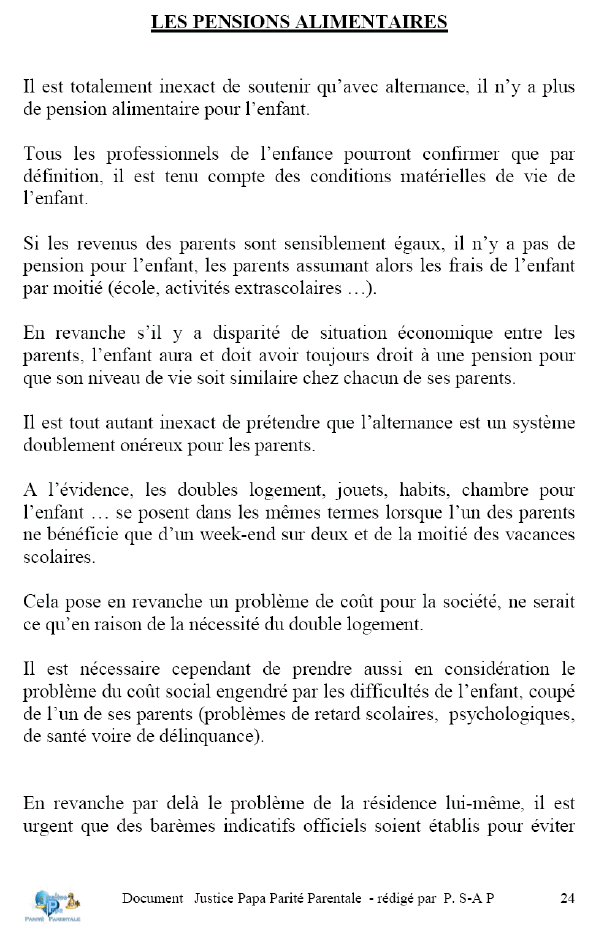 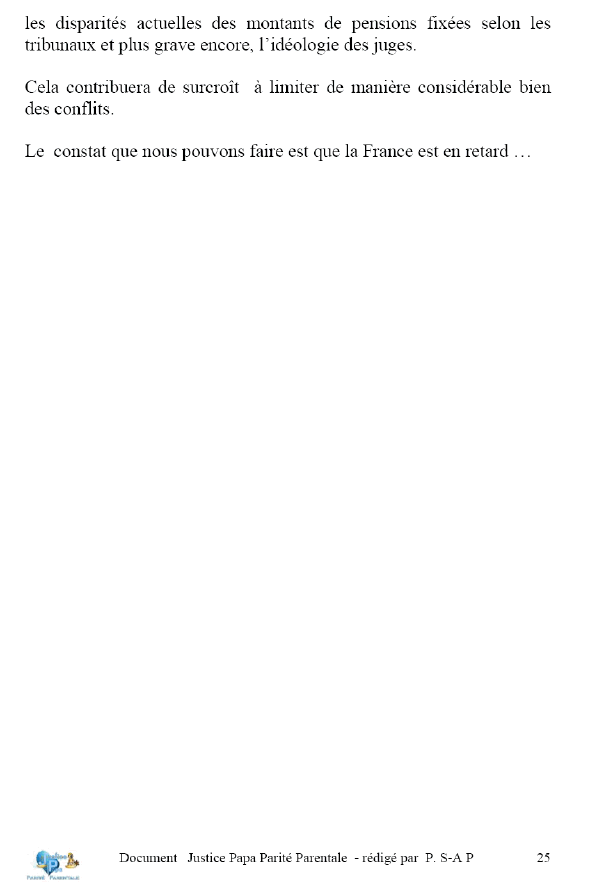 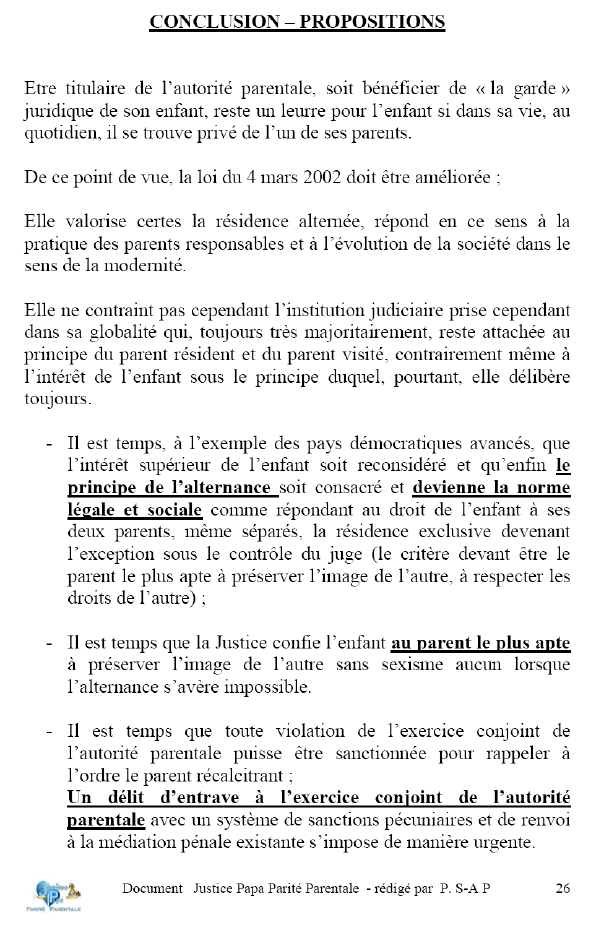 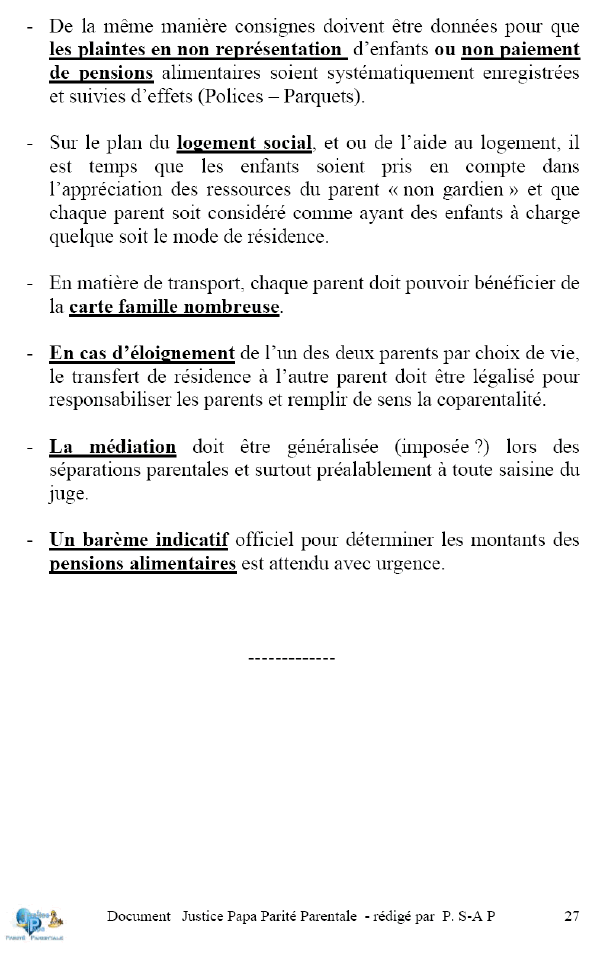 Rapport n° 2832 de Mme Valérie Pécresse fait au nom de la mission d'information sur la famille et les droits des enfants tome II - Auditions (1) Ce témoin n'a pas retourné le compte-rendu de son audition pour observations. ( __ Ce témoin n'a pas retourné le compte-rendu de son audition pour observations. (1) Cass. 1ère civ. 2 décembre 1997, n° 96-12.324. (2) Décision du 20 novembre 2003 n° 2003-484 DC JO 27 novembre. (3) article 180, alinéa 1, du code civil. ( 1) article 146 du code civil. ( 2) article 180, alinéa 1, du code civil. ( 3) article 63 C du code civil. ( 4) article 170 C du code civil. |