


Document mis en distribution le 14 octobre 2003 N° 1110 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2003. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2004 (n° 1093), TOME I RAPPORT GÉNÉRAL PAR M. GILLES CARREZ Rapporteur général, Député. -- Economie et finances. SOMMAIRE ____ Accès à la 1ère partie du tome I (chapitre I) Accès à la 3ème partie du tome I (chapitre III et annexe) CHAPITRE II : UNE POLITIQUE FISCALE RESPONSABLE : DÉTERMINATION DANS L'EFFORT DE BAISSE DES IMPÔTS, TRANSPARENCE ET RÉALISME DANS L'ÉVALUATION DES RESSOURCES 89 I.- UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT DE TRANSPARENCE ET DE RÉALISME DANS L'ÉVALUATION DES RESSOURCES 91 A.- CLARIFIER LE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE DE L'ETAT 91 B.- L'INCIDENCE DU RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE ÉVALUÉE AVEC PRUDENCE ET RÉALISME AFIN D'ÉVITER LES « MAUVAISES SURPRISES » 96 II.- DES RESSOURCES FISCALES PEU DYNAMIQUES 99 A.- LA PÉRENNITÉ DE L'EFFORT D'ALLÉGEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU 101 1.- Le poids de la conjoncture économique 102 2.- La pérennité de l'effort d'allégement 103 B.- LES AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES 109 C.- LA SENSIBILITÉ DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AUX RETOURNEMENTS CONJONCTURELS 110 D.- LES AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES 116 E.- UN PRODUIT DE LA TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS TOUJOURS DYNAMIQUE 118 F.- LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 120 G.- LES ENREGISTREMENTS, TIMBRES, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES 122 III.- DES RECETTES NON FISCALES QUI RETROUVENT LE NIVEAU ATTEINT EN 2002 APRÈS UN FORT TASSEMENT EN 2003 123 A.- UNE RELATIVE STABILITÉ DU PRODUIT DU SECTEUR PUBLIC HORS DIVIDENDES EXCEPTIONNELS 126 1.- Un dynamisme exceptionnel des dividendes et impôts acquittés par la Caisse des dépôts et consignations 126 2.- Des dividendes versés par les entreprises non financières encore affectés par le ralentissement économique 129 B.- UN PRODUIT DES JEUX TOUJOURS DYNAMIQUE 132 C.- AUTRES ÉVOLUTIONS DE RECETTES NON FISCALES NETTES 136 1.- La modulation de certains prélèvements 136 2.- Les recettes diverses, accidentelles et d'ordre 139 3.- De nouvelles recettes 142 IV.- DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES EN TRANSITION 144 1.- La stabilité trompeuse du prélèvement au profit des Communautés européennes 145 2.- Le prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales, témoin d'une première étape de la simplification des concours de l'État 147
CHAPITRE II : DÉTERMINATION DANS L'EFFORT DE BAISSE DES IMPÔTS, TRANSPARENCE ET RÉALISME DANS L'ÉVALUATION DES RESSOURCES RECETTES BUDGÉTAIRES : LES CHIFFRES-CLEFS (en milliards d'euros)
Rappel des principales hypothèses associées : - croissance prévue du PIB en 2004 : · en valeur : + 3,4% - hausse des prix à la consommation en 2004 (en moyenne) : + 1,8% (hors tabac : + 1,5%)
I.- UN EFFORT SANS PRÉCÉDENT DE TRANSPARENCE ET DE RÉALISME DANS L'ÉVALUATION DES RESSOURCES Après avoir diminué de 1,90% entre 2002 et 2003 pour s'établir, selon l'estimation révisée associée au présent projet de loi de finances, à 218.196 millions d'euros, les ressources nettes du budget général, hors recettes d'ordre, devraient atteindre 227.828 millions d'euros en 2004, soit une progression de 4,41%. Cependant, le tiers de cette augmentation s'explique par d'importants changements du périmètre des recettes de l'Etat. A.- CLARIFIER LE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE DE L'ETAT Le tableau ci-après détaille l'incidence de ces mesures de périmètre. LES CHANGEMENTS DE PÉRIMÈTRE DES RESSOURCES NETTES DE L'ETAT DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004 (en millions d'euros, et en italique, ressources de nature exceptionnelle et non pérenne)
(suite)
Au total, les mesures de périmètre, dont les contreparties en dépenses sont étudiées dans le deuxième chapitre du présent rapport, majorent les ressources nettes du budget général de 3.191 millions d'euros, avec + 10.130 milliards d'euros au titre des recettes fiscales nettes, + 1.184 millions d'euros au titre des ressources non fiscales et - 8.123 millions d'euros s'agissant des prélèvements sur recettes. Ces évolutions sont les fruits d'un quadruple effort de transparence. · En premier lieu, concomitamment à l'intégration de ses dépenses, le projet de loi de finances procède à l'affectation des recettes du FOREC au budget général. Comme le décrit en détail le commentaire de l'article 24 (voir tome II du présent rapport), le choix a été retenu de budgétiser les ressources de l'organisme « en l'état », c'est-à-dire sans procéder, comme il était de coutume, à des manipulations discrètes de ressources afin d'équilibrer les dépenses relatives aux baisses de charges sociales en masquant l'évolution réelle des dépenses de l'Etat. C'est ainsi que l'ensemble des taxes affectées au FOREC à ce jour est, sans modification d'assiette ou de taux, transféré au budget général. Sont ainsi inscrits en recettes fiscales nettes du budget général de l'Etat : - l'intégralité du produit des taxes que l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) avait affecté au FOREC, c'est-à-dire celui de la contribution sociale sur le bénéfice des sociétés, de la TGAP et de la taxe sur les véhicules de société, aux lignes 40 (estimation de 740 millions d'euros pour 2004), 67 (510 millions d'euros) et 44 (780 millions d'euros) ; - l'intégralité du produit du droit de circulation des vins, cidres, poirés et hydromels (ligne 85, 124 millions d'euros), du droit de consommation sur les produits intermédiaires (droits sur les alcools visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts) (ligne 86, 150 millions d'euros) et du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées (ligne 88, 370 millions d'euros) affectés dans leur intégralité au FOREC par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) ; - l'intégralité des produits de la taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire (ligne 60, 505 millions d'euros) et de la taxe sur les primes d'assurances automobiles (ligne 35, 965 millions d'euros), créées et affectées au FOREC par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée. En outre, le FOREC a disposé d'une fraction du produit du droit de consommation sur les alcools visés à l'article 403 du code général des impôts (47% en application de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 précitée, puis son intégralité à l'exception du prélèvement effectué au profit du BAPSA et du produit perçu en Corse, en application de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée). Le projet de loi de finances procède à l'affectation au budget général de l'ensemble du produit du droit de consommation sur les alcools à l'exception du produit perçu en Corse (ligne 87, 1.910 millions d'euros). Remarquons que la perte de recettes résiduelles pour le BAPSA (19,2 millions d'euros de produit anticipé en 2004) est compensée pour le budget annexe par un relèvement des droits de tabac qui lui sont affectés. Enfin, l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 précitée a prévu que le FOREC bénéficierait d'une fraction de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, le reliquat étant affecté au budget général. Dès lors, la budgétisation du FOREC a pour conséquence d'affecter l'intégralité du produit de cette taxe au budget général de l'Etat (ligne 34, 2.375 millions d'euros). En outre, s'agissant du produit des droits de consommation sur les tabacs, « variable d'ajustement » traditionnelle pour assurer l'équilibre du fonds, il est proposé de transférer au budget général le montant, en valeur, que le FOREC devrait percevoir en 2003 (soit une évaluation de 7.342 millions d'euros), afin d'affecter l'intégralité du produit supplémentaire de ces droits en 2004 (estimé à 400 millions d'euros) à la Caisse nationale d'assurance maladie. Le budget général ne bénéficiera cependant que d'une partie de cette ressource, en raison de son affectation, strictement compensée par une majoration de recette, au BAPSA (la ligne 87 « droits de consommation sur les tabacs » n'est ainsi dotée que de 2.587 millions d'euros). Le tableau ci-après synthétise l'ensemble de ces évolutions. ÉVOLUTION DES RESSOURCES DU FOREC ENTRE 2001 ET 2004 (PRÉVISIONS) (en millions d'euros)
(a) Dont 4.815 millions d'euros affectés au BAPSA mais de manière neutre pour le budget général (voir plus bas). Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Les recettes issues de la budgétisation du FOREC sont, dans l'ensemble, relativement stables entre 2003 et 2004, à l'exception des droits sur les alcools dont le produit devrait se redresser (+ 1%) après deux années de baisse liée à de moindres recouvrements de taxe sur les alcools forts, et de la taxe sur les conventions d'assurance qui bénéficie d'une augmentation spontanée de 5% liée à une hausse des tarifs d'assurance destinée à permettre la reconstitution de réserves mises à mal suite à des catastrophes naturelles et au coût croissant de la réassurance sur le marché secondaire. Votre Rapporteur souhaite insister, à ce stade, sur les deux types de conséquences induites par cette affectation « en photographie 2003 » des recettes anciennement dévolues au FOREC dont le produit apparaît ainsi modérément dynamique. Tout d'abord les dépenses relatives aux baisses de charges et aux 35 heures ne seront plus équilibrées par des manipulations de ressources affectées, comme ce fut le cas auparavant avec le FOREC. Dès 2004, cette décision courageuse induit une charge nette pour le budget général de 1,25 milliard d'euros (différence entre les dépenses du FOREC inscrites dans le budget général s'élevant à 17,1 milliards d'euros et le produit attendu des recettes affectées estimé à 15,85 milliards d'euros), partiellement compensée, il est vrai, par le versement en recettes non fiscales de 328 millions d'euros provenant du fonds de roulement du FOREC, dont il faut rappeler qu'il constitue une ressource exceptionnelle non renouvelable. Mais, surtout, à l'avenir, la dynamique propre des baisses de charges sociales, relancée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, pèsera de tout son poids sur le budget général, les recettes ne progressant qu'au rythme de l'évolution de leur assiette (soit entre 2 et 3% par an en moyenne). Dès 2005, l'impact de cet effort d'allégement de charges supplémentaire est évalué à 3,2 milliards d'euros. Ce choix courageux donne toute sa portée, et son ambition, à la volonté du Gouvernement du maintien en volume des dépenses de l'Etat. · En second lieu, le projet de loi de finances propose de clarifier le mode de financement des retraites agricoles en remplaçant les trois ressources dont bénéficiait le BAPSA jusqu'alors (TVA perçue par le BAPSA, évaluée pour 2004 à 5.991 millions d'euros de recouvrements bruts et 1.345 millions d'euros de remboursements et dégrèvements, soit 4.646 millions d'euros de produit net ; fraction de droits sur les consommations d'alcool évaluée pour 2004 à 19 millions d'euros, et subvention budgétaire au profit du budget annexe de 150 millions d'euros en 2003, soit, au total, 4.815 millions d'euros) par une recette unique aisément identifiable, d'un montant strictement équivalent, issue du produit affecté d'une fraction des droits de consommation sur les tabacs (évaluée pour 2004 à 4.815 millions d'euros). Votre Rapporteur général remarque cependant que l'évaluation du produit des droits sur les tabacs en 2004 est rendue difficile par la forte hausse de leur taux, les données manquant pour anticiper avec précision l'élasticité de la consommation de ce type de produit à des augmentations de prix d'une telle ampleur. Il constate par ailleurs que ces difficultés de prévision concernent aussi bien le BAPSA que le budget de l'Etat, qui bénéficie du reliquat des droits tabacs, évalué à 2.587 millions d'euros. · En troisième lieu, les flux financiers avec les collectivités locales sont considérablement simplifiés par le basculement en prélèvement sur recettes à leur profit de 8.123 millions d'euros de concours de l'Etat, dont le détail est décrit plus bas. Dans le même esprit, 5.027 millions d'euros de produit de la TIPP sont transférés aux département. · En dernier lieu, plusieurs mesures de périmètre sont motivées par le souci de transparence qui inspire la nouvelle majorité, et par la nécessité de procéder dès à présent à l'application de la loi organique relative aux lois de finances : - la budgétisation du Fonds national de l'eau (compte d'affectation spéciale n° 902-00), rendue nécessaire par l'absence de relation directe par nature entre l'une de ses ressources (une fraction du produit du prélèvement sur les paris mutuels) et ses dépenses, entraîne l'affectation au budget général du prélèvement sur les agences de l'eau (ligne 342 des recettes non fiscales, 83 millions d'euros) dont bénéficiait la section B du compte d'affectation spéciale, le Fonds national de solidarité pour l'eau, du produit de la taxe sur les consommations d'eau potable (ligne 341, 77 millions d'euros) dont bénéficiait la section A, le Fonds national de développement des adductions d'eau (il convient de rappeler que l'autre ressource du fonds, une fraction du prélèvement sur les paris mutuels, avait été intégrée au budget général en 2003, majorant les recettes de la ligne 314 de 65 millions d'euros). De même, la budgétisation du Fonds national de développement de la vie associative (compte d'affectation spéciale n° 902-20) entraîne la budgétisation de sa ressource PMU (majorant de 8 millions d'euros la ligne 314 précitée) ; il convient d'ailleurs de remarquer que ces budgétisations sont neutres sur le niveau des ressources de l'Etat, puisqu'elles ont pour contrepartie une diminution des recettes des comptes d'affectation spéciale ; - divers fonds de concours sont budgétisés à hauteur de 3,6 millions d'euros en recettes (comme en dépenses) sur la ligne 318 « produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat » ; - la réforme du service public de l'équarrissage entraîne la suppression de la taxe sur les achats de viande (ligne 84 des recettes fiscales, - 550 millions d'euros), compensée par une majoration de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (ligne 340 des recettes non fiscales, + 374 millions d'euros) ; - enfin, divers mouvements de périmètre plus traditionnels (transferts de personnels, prélèvement sur des réserves constituées par des organismes bénéficiant du produit de taxes parafiscales éteintes au 1er janvier 2004, assujettissement à la taxe sur les salaires des assistants d'éducation) ont un impact positif sur le niveau des ressources nettes du budget général. B.- L'INCIDENCE DU RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE ÉVALUÉE AVEC PRUDENCE ET RÉALISME AFIN D'ÉVITER LES « MAUVAISES SURPRISES » En excluant l'effet de ces changements de périmètre, les ressources nettes du budget général de l'Etat s'établissent à 224.637 millions d'euros, soit une augmentation de 2,95% dont il faut cependant modérer la portée. En effet, cette croissance, par ailleurs inférieure à la croissance anticipée du PIB en valeur (+ 3,4%), s'appuie sur un niveau de recettes en 2003 très affecté par la conjoncture économique. Les prévisions associées au projet de loi de finances prennent en effet acte d'une moins-value de ressources nettes liée au creusement de l'activité en 2003 (croissance du PIB estimée désormais à 0,5% contre 2,5% à l'automne 2002) de 9,98 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale Il convient à cet égard de remarquer que le projet de loi de finances pour 2004 s'appuie sur des hypothèses délibérément prudentes, voire pessimistes, sur l'évolution des ressources. Ainsi, à périmètre constant, les recettes fiscales nettes ne devraient augmenter que de 1,99%, soit une progression spontanée hors mesure nouvelle de 1,8% à rapprocher d'une croissance estimée en valeur à 3,4%. Votre Rapporteur général constate ainsi que l'hypothèse d'élasticité retenue dans la construction de l'équilibre du budget pour 2004, de 0,6 (contre une tendance de long terme égale à 1), est la plus faible jamais choisie depuis que cet indicateur est utilisé. Prudence dans la prévision de croissance de l'économie, et prudence dans l'estimation de l'élasticité des recettes à la croissance se conjuguent pour donner au projet présenté sa posture délibérément réaliste et transparente. En revanche, il est vrai, les recettes non fiscales retrouveraient un réel dynamisme (+ 11,78%, + 7,79% cependant à périmètre constant). Mais cette croissance est très largement illusoire dans la mesure où elle s'appuie elle aussi sur un niveau anticipé en 2003 très déprimé. Au total, hors changement de périmètre, ces recettes en 2004, qui s'élèveraient à 32.006 millions d'euros hors recettes d'ordre, resteraient inférieures de 2,30% au niveau de 32.759 millions d'euros constaté en 2002. Le tableau ci-après offre une synthèse de l'ensemble de ces évolutions.
Compte tenu des changements importants ayant affecté le périmètre des prélèvements sur recettes, il peut être opportun de rappeler l'évolution de long terme des ressources brutes du budget général. Elles s'élèveraient à 356.004 millions d'euros, mais 343.345 millions d'euros à périmètre constant, soit une progression de 1,90 % par rapport à l'évaluation révisée pour 2003. Cependant, le caractère peu significatif de cet agrégat implique de l'interpréter avec prudence.
II.- DES RESSOURCES FISCALES PEU DYNAMIQUES La conjoncture économique pèse indéniablement sur le niveau des recettes fiscales nettes de l'Etat. Comme le montre le tableau ci-après, l'atonie de la croissance a induit une importante correction à la baisse des prévisions pour 2003 (- 3%), la moins-value conjoncturelle de 7.473 millions d'euros par rapport aux montants anticipés en loi de finances initiale portant principalement sur l'impôt sur les sociétés net EVOLUTION DES RECETTES FISCALES NETTES ENTRE 2003 ET 2004 (en millions d'euros et en pourcentage)
Pour 2004, la progression spontanée des recettes fiscales est limitée à 4.874 millions d'euros (+ 1,98%) soit une élasticité à la croissance du PIB de 0,6, la progression économique étant particulièrement freinée pour les impôts assis sur les revenus ou l'activité en 2003, année particulièrement touchée par le marasme économique (croissance de 0,5%). Ainsi, le produit de l'impôt sur le revenu ne devrait augmenter spontanément que de 1,76% et celui de l'impôt sur les sociétés diminuer, hors mesure nouvelle, de 2,04%. En revanche, les autres impôts sont en ligne avec la prévision de reprise de l'activité en cours d'année 2004, évoluant au même rythme que le PIB anticipé (3,4% en valeur), le taux de croissance spontané de la TVA étant de 3,22% et celui des autres recettes fiscales nettes de 2,96%. Votre Rapporteur général remarque cependant que, même dans le cas d'impôts assis sur la conjoncture en 2004, les prévisions ont été établies avec un grand réalisme, dont témoigne une évolution spontanée globale inférieure à la croissance du PIB. Les aménagements de droits en 2004 ont une incidence nette de + 77 millions d'euros sur les recettes fiscales nettes. Cependant, il convient d'isoler l'effet sur 2004 de mesures prises antérieurement à mai 2002, qui majorent le niveau des recettes de 2.106 milliards d'euros. Les allègements décidés par la présente majorité représentent ainsi un peu plus de deux milliards d'euros dont 1.297 millions d'euros liés aux dispositions nouvelles du projet de loi de finances pour 2004. IMPACT EN 2004 DES MESURES NOUVELLES (en millions d'euros)
(a) Majoration des dégrèvements minorant les recettes fiscales nettes. (b) Soumise à l'approbation du Conseil des Communautés européennes, donc n'intervenant pas dans le calcul des allègements nets. (c) Reconduction qui fera l'objet d'une disposition dans la loi de finances rectificative pour 2003. A.- LA PÉRENNITÉ DE L'EFFORT D'ALLÉGEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Comme le montre le tableau ci-après, comme pour les trois années précédentes, le produit de l'impôt sur le revenu serait en 2004 inférieur aux niveaux atteints en 1999 et 2000. Cependant, l'augmentation constatée en 2003 est trompeuse, dans la mesure où elle intègre des reports, évalués à 450 millions d'euros, de recouvrements liés au décalage d'un mois des émissions en 2002 en raison de la baisse de 5% décidée en juillet. Le graphique ci-après corrige ce phénomène calendaire exceptionnel afin de mieux cerner l'évolution réelle de l'impôt. Au terme de ce retraitement, le produit de l'impôt sur le revenu devrait progresser de 3,6% en 2003 et diminuer de 0,8% entre 2003 et 2004 pour passer de 52.605 millions d'euros (dont 425 millions d'euros de contributions représentatives du droit de bail) à 52.192 millions d'euros (dont 430 millions d'euros de CRDB).
en millions d'euros  La part de l'impôt sur le revenu est passée de 20,7% des ressources fiscales nettes en 1997 à un sommet de 22,2% en 2000. On remarque qu'en 2004, le poids de l'impôt sur le revenu serait le plus faible constaté depuis 1995. Cette constatation est confirmée par l'analyse d'un indicateur plus pertinent, la part de l'impôt sur le revenu dans le PIB. Là encore, l'inflexion constatée depuis 2002 est manifeste. L'impôt sur le revenu représenterait ainsi 3,24% du PIB en 2004, soit une diminution cumulée de 0,75 point de PIB depuis le sommet de 2000.
1.- Le poids de la conjoncture économique Après avoir atteint 7,3% en 2001, la progression tendancielle de l'impôt, hors mesures nouvelles, s'est considérablement ralentie au rythme de l'affaiblissement du dynamisme des salaires et des pensions et du tassement de la progression des effectifs salariés. Encore robuste en 2002 (+ 4,6%) grâce à la bonne tenue des revenus en 2001, la croissance spontanée de l'impôt devrait s'infléchir à 4,1% en 2003 (en retraitant le phénomène calendaire évoqué plus haut), ce qui est cependant une estimation, motivée par l'observation des émissions en juin 2003, plus optimiste que celle établie dans la loi de finances initiale pour 2003. En 2004, les recouvrements ne devraient progresser spontanément que de 1,7% (1,95 % après indexation du barème sur les prix). Ce net infléchissement s'appuie sur des hypothèses prudentes de progression des bases taxables, avec une progression du revenu disponible brut des ménages ramenée de 3,9% en 2002 à 2,7% en 2003 et une augmentation des effectifs salariés limitée à 0,3% contre 1% l'année dernière.
2.- La pérennité de l'effort d'allégement Le présent projet de loi de finances propose d'amplifier le mouvement de baisse de l'impôt sur le revenu entamé par la nouvelle majorité par un allégement supplémentaire de 1.779 milliards d'euros (après 3.700 millions d'euros en 2002 et 2003) consacré à hauteur de 1.760 millions d'euros à la baisse de 3% des taux du barème avec le maintien des plafonds de la décote et du quotient familial, à hauteur de 97 millions d'euros à l'amélioration de la prime pour l'emploi et pour 90 millions d'euros à l'extension de la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance en faveur des personnes âgées. Parallèlement, la réforme du mode de taxation des plus-values immobilières à l'impôt sur le revenu devrait augmenter de 240 millions d'euros le produit de l'impôt en 2004.
B.- LES AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES La forte révision à la hausse du produit de cette ligne en 2002 est due à l'importance des dégrèvements d'impôt sur les sociétés sur rôle constatés en 2003 sur des titres antérieurs (induisant une diminution des émissions de rôle d'impôt sur les sociétés), ayant par conséquent pour contrepartie une dépense en atténuation de recettes à hauteur de 700 millions d'euros. Hors cet évènement exceptionnel, la diminution tendancielle pour 2004 de 2,3% est proche de la tendance constatée en 2002 et 2003 (-3,5%), due essentiellement au tassement des recouvrements à la suite d'un contrôle fiscal en matière d'impôt sur les sociétés au rythme de la réduction du produit de ce dernier.
C.- LA SENSIBILITÉ DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS AUX RETOURNEMENTS CONJONCTURELS Après 8 années de forte croissance entre 1993 et 2001, dont le taux de progression ne s'est jamais révélé inférieur à 10%, l'impôt sur les sociétés a, comme il est traditionnel en raison de ses mécanismes par soldes et acomptes, fortement surréagi à l'affaiblissement de la conjoncture en diminuant, hors mesure nouvelle, de 5% en 2002 et de 8,45% en 2003. Les tableaux et graphiques ci-après montrent bien la très forte volatilité du produit de l'impôt.
(en millions d'euros) 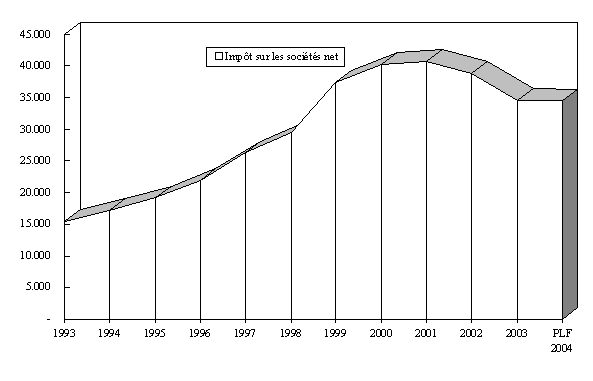 Hors contribution sur les revenus locatifs, le produit de l'impôt sur les sociétés net devrait s'établir en 2003 à 34.555 millions d'euros, soit un écart de 3.190 millions d'euros (-8,45%) par rapport à la loi de finances initiale et une diminution de 10,87% par rapport à 2002 (-9,20% à législation inchangée). Cette moins-value résulte de l'amplification de la réduction du bénéfice fiscal en 2002 par une forte diminution des acomptes à compter du moins de juin et l'existence de soldes relativement faibles en 2003, les acomptes versés en 2002 étant restés élevés. En outre, les remboursements et dégrèvements, très dynamiques depuis 2001 (+ 14,7% entre 2000 et 2001, + 13% entre 2001 et 2002), restent élevés en 2003 (9,1 milliards d'euros), malgré l'interruption du processus exceptionnel de transferts d'acomptes liés à la mise en place de la direction des grandes entreprises (ces transferts d'acomptes, qui se traduisaient certes par une majoration des dégrèvements par abondement de l'article 19 du chapitre 15-01 du budget des Charges communes, avaient pour exacte contrepartie l'inscription d'une recette brute d'impôt sur les sociétés). L'encadré ci-après reproduit la teneur de la réponse du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie aux questions posées par votre Rapporteur général relatives aux premiers bilans de la mise en place de la DGE. Depuis le 1er janvier 2002, la direction des grandes entreprises est devenue l'interlocuteur fiscal unique des grandes entreprises pour ce qui concerne à la fois l'assiette, le contrôle et le recouvrement des principaux impôts et taxes dont elles sont redevables. Sont concernées les entreprises dont le chiffre d'affaires ou le total de l'actif brut est au moins égal à 600 millions d'euros, les entreprises qui sont liées à plus de 50% avec une de ces entreprises, celles qui bénéficient du régime du bénéfice consolidé et les entreprises qui appartiennent à un groupe lorsque celui-ci comprend au moins une entreprise mentionnée ci-dessus. En matière de recouvrements d'IS spontané, la DGE a recouvré, à fin 2002, 44% de l'IS brut. Cette part s'élève à 48% pour l'IS net, la DGE représentant 29% du montant total des remboursements, restitutions et transferts. En terme de transferts d'acomptes, l'année 2002 a été marquée par un fort dynamisme, lié essentiellement à la création de la DGE, se traduisant par des mouvements comptables, budgétairement comptabilisés au §19 « transferts d'acomptes », qui accompagnent le passage des entreprises du périmètre DGCP vers celui de la DGE. Le niveau des transferts d'acomptes prévus en 2003 s'élève à 817 millions d'euros. Pour mémoire, le montant des transferts, en 2002, s'est élevé à 2.241 millions d'euros. Néanmoins, le niveau de réalisations à fin août 2003, malgré un élargissement au 1er janvier 2003 du périmètre des entreprises relevant de la DGE, (653 millions d'euros, contre 1.969 millions d'euros à fin août 2002) conforte l'hypothèse du caractère largement atypique de l'année 2002. Pour l'exercice 2004, il a été retenu une hypothèse de maintien du niveau des transferts au niveau de 2003. Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il convient en outre de remarquer que l'année 2003 est marquée par un versement exceptionnel de 900 millions d'euros par un gros contributeur dont le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, interrogé à ce sujet par votre Rapporteur général, a détaillé l'origine : « L'application d'une nouvelle méthode comptable, obligatoire dès 2002 pour toutes les entreprises, oblige de comptabiliser au passif la totalité des obligations incombant à l'entreprise à la clôture de l'exercice et ce quelle que soit l'échéance des décaissements. Ce changement de méthode comptable affecte principalement les provisions de certains gros contributeurs. Dans le cas présent, le montant -important- des provisions de la société en question devait être considérablement augmenté ; cependant, faisant le choix d'actualiser ces sommes (option ouverte par l'avis sur les passifs), elle est au contraire conduite à diminuer ses provisions donc à reprendre des provisions qui avaient été passées en franchise d'impôt, d'où un impact fiscal non négligeable ». S'agissant de l'évaluation pour 2004, elle s'appuie, comme le montre le tableau ci-après, sur l'hypothèse prudente d'un modeste redressement des bénéfices fiscaux en 2003.
Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette croissance modérée devrait entraîner une légère augmentation des acomptes versés en 2004, mais, en raison du phénomène exceptionnel évoqué plus haut pour 2003, la tendance spontanée de l'impôt sur les sociétés est négative de 2,04%. Parallèlement, les mesures ayant un impact nouveau en 2004 sont globalement équilibrées, les réductions induites par les mesures pour les jeunes entreprises innovantes (-5 millions d'euros), par l'extension du régime d'allégement d'impôt sur les sociétés aux entreprises implantées dans les 41 nouvelles zones franches urbaines (-18 millions d'euros) et par la prolongation de l'exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées dans les zones de redynamisation urbaine (-17 millions d'euros) en application de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ainsi que par le relèvement de l'abattement de 15.000 à 50.000 euros sur l'impôt sur les sociétés à taux réduit dû par les fondations reconnues d'utilité publique (-10 millions d'euros) en application de la loi relative au mécénat, étant compensées par l'expiration du relèvement du taux d'amortissement dégressif de 30% décidé en loi de finances rectificative pour 2001 et par l'incidence sur les recouvrements d'impôt sur les sociétés de la réforme de la part salariale de la taxe professionnelle.
D.- LES AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES Cette catégorie en quelque sorte « fourre-tout » des recettes fiscales devrait subir en 2003 une moins-value de 1.024 millions d'euros par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale, en raison principalement de la morosité en 2002 des marchés boursiers qui implique une correction à la baisse de 25 millions d'euros du produit des retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bonds anonymes (ligne 5), et de 140 millions d'euros du produit de l'impôt de solidarité sur la fortune (ligne 8). Ce dernier a ainsi diminué depuis 2001 de 13%, après une forte croissance, notamment en 2000 (+ 24,9%), liée à l'augmentation du nombre de contribuables amplifiée par l'absence d'indexation du barème. Pour 2004, le produit des autres impôts directs et taxes assimilées devrait être stable (+ 0,48%), l'effet de l'évolution spontanée (+ 2,3%), substantiel pour les impôts assis sur des éléments de patrimoine en raison du redressement des cours boursiers, étant compensé par des mesures nouvelles dont : - la prise en compte à concurrence de moitié de leur valeur des parts et actions de société (pacte d'actionnaire) dans la base d'imposition de l'ISF (-75 millions d'euros), l'exonération des titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d'une société par apport de biens, en numéraire ou en nature, nécessaire à l'exercice de l'activité (-10 millions d'euros) et l'extension de la définition des biens professionnels entrant dans l'assiette, en application de la loi pour l'initiative économique, réduisent le produit anticipé de l'ISF de 131 millions d'euros (-5,6%) ; - l'extinction progressive de la contribution des institutions financières (1) dont le taux a été ramené, par la loi de finances initiale pour 2003, de 1% à 0,8% en 2003 puis 0,4% en 2004 avec sa suppression en 2005, réduit de 185 millions d'euros les recettes de la ligne 17 afférente. Votre Rapporteur général relève en outre le dynamisme spécifique de la cotisation minimale de taxe professionnelle (ligne 12), qui augmenterait de 8,17% entre 2003 et 2004. Cette cotisation assise sur la valeur ajoutée est un supplément d'imposition versée par les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est supérieur à 7,6 millions d'euros, lorsque la cotisation de taxe professionnelle calculée dans les conditions de droit commun est inférieure à un pourcentage de la valeur ajoutée, fixé à 1,5 % depuis 2001. Son dynamisme spontané en 2003 et 2004 s'explique par l'arrivée à son terme en 2003 de la réforme de la taxe professionnelle, la suppression définitive de la part salaires ayant conduit à une diminution conséquente des impositions à la charge des entreprises. Comme ce sont essentiellement les très grandes entreprises qui, en 2003, bénéficient de la suppression définitive de la part salaires, la baisse de cotisation de taxe professionnelle fait basculer un grand nombre d'entre elles dans le champ d'application de la cotisation minimale, ou fait que le montant de leur cotisation « minimale » augmente par rapport à 2002. E.- UN PRODUIT DE LA TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS TOUJOURS DYNAMIQUE
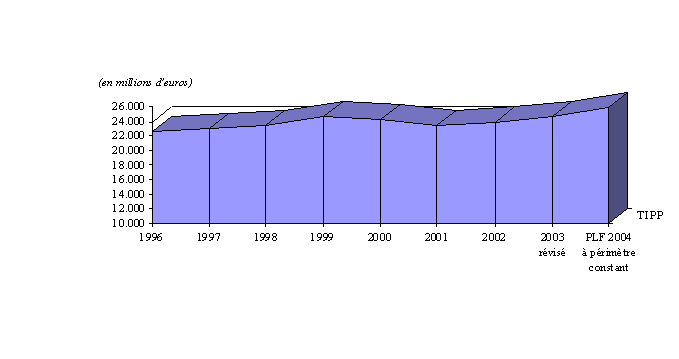 Le produit attendu de la TIPP en 2003 s'établirait à 24.665 millions d'euros, soit 1.150 millions d'euros de moins que prévu dans la loi de finances initiale En 2004, hors changement de périmètre lié au transfert au département de 5.027 millions d'euros de TIPP, et à législation constante, le produit de la taxe ne progresserait spontanément que de 1,62% en raison d'une croissance modérée de la consommation de produits pétroliers dont le tableau ci-après présente le détail.
Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. En outre, l'augmentation de 2,5 centimes par litre de la TIPP applicable au gazole relève de 845 millions d'euros le produit anticipé pour 2004 qui atteint, en tenant compte de la prorogation du régime fiscal spécifique des biocarburants qui devrait être soumise à l'approbation du Parlement lors du dépôt du projet de loi de finances rectificative pour 2003 en novembre, 25.930 millions d'euros à périmètre constant (+ 5,13%).
F.- LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
(en millions d'euros) 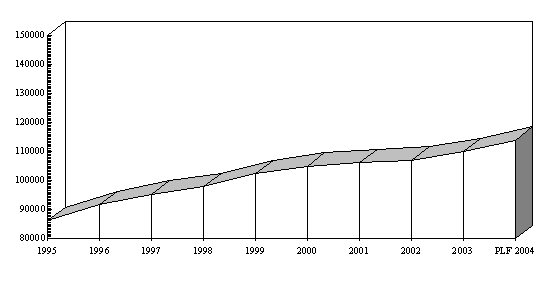 La TVA nette devrait rester modérément dynamique en 2003, progressant de 2,14% (dont 1,9% de hausse spontanée) par rapport à 2002, quoique dans des proportions moindres qu'anticipée en loi de finances initiale. En effet, malgré un tassement de 600 millions d'euros des remboursements et dégrèvements dans les estimations révisées, en raison d'une diminution accusée des exportations et des importations, le produit anticipé de TVA nette pour cette année est inférieur de 1.924 millions d'euros aux prévisions initiales (-1,72%), correction entièrement attribuable à l'ajustement de l'hypothèse de progression des emplois taxables de 3,5% (pour une consommation des ménages de 3,9%) prévus à l'automne 2002 à 2,5% aujourd'hui attendus. Pour 2004, en revanche, la croissance spontanée des recettes de TVA nette serait de 3,22% par rapport au montant révisé pour 2003, soit un rythme supérieur à celui de la progression de la base taxable (+ 2,75%) dont le tableau ci-après détaille la composition. Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en forme.
Cette élasticité supérieure à l'unité s'explique par l'anticipation d'un phénomène traditionnel en période de reprise progressive de l'activité : les recouvrements de TVA brute devraient suivre la remontée de la consommation des ménages (évaluée à 3,6% pour 2004) tandis que les remboursements resteraient relativement stables, sous l'effet, d'une part, de la compensation du rebond modéré de l'investissement par une propension moins importante des entreprises à soumettre rapidement leurs demandes de restitutions compte tenu d'une situation de trésorerie en amélioration, et compte tenu, d'autre part, de probables déports de remboursements de 2004 vers 2003 en raison de l'acuité actuelle du ralentissement économique. L'estimation pour 2004, à 113.823 millions d'euros hors changement de périmètre (affectation à l'Etat de la TVA nette BAPSA pour 4.646 millions d'euros), prend en compte l'impact de mesures nouvelles antérieures au présent projet de loi de finances (principalement 78 millions d'euros au titre de l'annualisation du paiement de la TVA pour certains redevables décidée en loi de finances initiale pour 2003 et 130 millions d'euros liés à l'aménagement de la déduction de la TVA sur les frais de représentation en conséquence de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mai 2002), l'incidence du relèvement de la TIPP applicable au gazole sur les recouvrements de TVA (+ 55 millions d'euros) et, enfin, anticipe le consentement de nos partenaires européens à la prorogation de l'application du taux réduit aux travaux d'entretien (reconduction d'une mesure de 3.600 millions d'euros, dont l'impact est donc neutre en progression 2003-2004). Votre Rapporteur général rappelle en outre que le coût de l'application d'un taux réduit aux services de restauration (hors boissons alcoolisées), subordonnée à l'accord du Conseil des Communautés européennes sur proposition de la Commission, serait de 3.300 millions d'euros en 2004 sur une année pleine. L'appréciation de l'impact d'une application en cours d'année est rendue complexe par la saisonnalité des activités de restauration, ainsi que par les effets induits en termes de hausse de la consommation de l'adoption d'une telle mesure.
G.- LES ENREGISTREMENTS, TIMBRES, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES Cette catégorie de recettes devrait connaître une progression extrêmement vive de 11.194 millions d'euros entre 2003 et 2004, principalement attribuable au changements de périmètre induits par la budgétisation du FOREC, pour 11.027 millions d'euros (15.842 millions d'euros de recettes budgétisées, moins 4.815 millions d'euros de produit des droits sur les tabacs réaffectés au BAPSA en compensation de la récupération par le budget général de la TVA BAPSA (2)). III.- DES RECETTES NON FISCALES QUI RETROUVENT LE NIVEAU ATTEINT EN 2002 APRÈS UN FORT TASSEMENT EN 2003 En apparence, les recettes non fiscales nettes en 2004, qui atteindraient 33.190 millions d'euros hors recettes d'ordre, devraient progresser fortement de 11,78% par rapport au montant révisé pour 2003. En apparence seulement, car deux facteurs doivent conduire à nuancer l'ampleur de cette augmentation. D'une part, le niveau des recettes non fiscales en 2003 apparaît exceptionnellement faible. Les estimations révisées jointes au présent projet de loi de finances, conduisent à constater, par rapport aux prévisions initiales, une moins-value de 1.953 millions d'euros (-6,18%), ce qui accentue la diminution de ces recettes entre 2002 et 2003 (-9,98%). Le tableau ci-après détaille l'origine de cette moins-value, en distinguant les évolutions par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale selon qu'elles relèvent de facteur tendanciel ou de facteurs exceptionnels tenant notamment à la modulation de certains prélèvements ou à l'apparition de recettes exceptionnelles non anticipées. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES PRÉVISIONS DE RECETTES NON FISCALES ENTRE LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2003 ET L'ESTIMATION RÉVISÉE POUR 2003 (différence en millions d'euros entre les deux estimations)
D'autre part, les recettes non fiscales en 2004 font l'objet de changements de périmètre d'un montant de 1.184 millions d'euros, ce qui ramène leur progression par rapport à 2003, à périmètre constant, à 7,79%. Ces modifications de périmètres, évoquées plus haut, concernent principalement la budgétisation du FOREC qui conduit à inscrire en produit des recettes diverses (ligne 899) le versement de son fonds de roulement de 328 millions d'euros après sa liquidation. De même, la clôture du Fonds national de l'eau et du Fonds national du développement de la vie associative et l'affectation corrélative de leurs ressources au budget général conduisent à affecter au budget général 77 millions d'euros au titre de la redevance sur les consommations d'eau (nouvelle ligne 341), 83 millions d'euros au titre du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de bassins (nouvelle ligne 342), 8 millions d'euros au titre de l'intégration dans les prélèvements sur les paris mutuels au profit de l'Etat (ligne 315) de la fraction de ces prélèvements dévolue jusqu'alors au FNDVA, et enfin 1 million d'euros de versement de recettes diverses du FNE (ligne 899). La budgétisation de la part de la cotisation nationale de péréquation de la taxe professionnelle (CNP) affectée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) conduit parallèlement à majorer de 278 millions d'euros les reversements au budget général de diverses ressources affectées (ligne 326). Enfin, l'augmentation du taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) qui majore son produit de 374 millions d'euros (ligne 340) vient compenser la suppression de la taxe sur les achats de viande et le transfert de 176 millions d'euros de dépenses au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Au total, la prise en compte de ces deux éléments permet de remarquer que les recettes non fiscales, à périmètre constant et hors recettes d'ordre, sont inférieures de 753 millions d'euros (- 2,30%) au montant constaté en 2002. Le tableau ci-après résume les principaux facteurs de variations des recettes non fiscales nettes entre 2003 et 2004. PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES RECETTES NON FISCALES (différence en millions d'euros )
A.- UNE RELATIVE STABILITÉ DU PRODUIT DU SECTEUR PUBLIC HORS DIVIDENDES EXCEPTIONNELS En prenant en compte l'évolution des rémunérations des dotations en capital (ligne 407), et du produit des participations de l'Etat (lignes 110, 111 et 116), l'ensemble des recettes retirées du secteur public s'élèverait en 2004 à 2.629 millions d'euros, soit un doublement par rapport au montant révisé pour 2003 (1.278 millions d'euros), lui-même inférieur d'un tiers aux prévisions initiales. Cependant, cette augmentation, loin de refléter la rentabilité intrinsèque du secteur public pour l'Etat actionnaire, est liée principalement à trois phénomènes de nature exceptionnelle. En premier lieu, la vente de l'ensemble des participations de l'Etat dans le Crédit Lyonnais fin 2002 entraîne la fin des versements de dividendes à ce titre, soit une moins-value de 30 millions d'euros en 2003. En second lieu, l'année 2003 a été marquée par l'ajustement des recettes versées par la Caisse des dépôts et consignations, au regard du ralentissement des marchés financiers en 2002, avec une diminution de 89 millions d'euros du dividende versé par rapport aux prévisions initiales et des versements représentatifs de l'impôt sur les sociétés inférieurs de 277 millions d'euros aux prévisions. En dernier lieu, l'année 2004 sera marquée par le versement par la même CDC d'un quasi-dividende exceptionnel de 1.332 millions d'euros lié à la cession en cours d'année de certains de ses actifs. 1.- Un dynamisme exceptionnel des dividendes et impôts acquittés par la Caisse des dépôts et consignations Comme le montre le tableau ci-après, les produits des participations de l'Etat dans les entreprises financières (ligne 110) ont subi l'incidence de la forte réduction du périmètre du secteur public financier, dont la vente de la participation résiduelle de l'Etat dans le Crédits Lyonnais en 2002 a constitué la plus récente étape. Désormais, l'évolution de cette ligne de recettes, compte-tenu de la stabilité à long terme des dividendes versés par la Caisse centrale de réassurance et la Caisse nationale de prévoyance, dépend essentiellement du niveau des dividendes de la Banque de France et de la Caisse des dépôts et consignations. S'agissant de la première, après le versement de dividendes importants de 450 millions en 2001 et 2002, liés à des résultats nets remarquables (830 et 840 millions d'euros), aucun versement n'est prévu pour 2003 ou 2004. PRODUIT DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES FINANCIÈRES
L'essentiel est donc l'évolution du dividende versé par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que celle de la contribution volontaire représentative de l'impôt sur les sociétés (CRIS) qu'elle verse depuis 1961 et dont le produit est affecté à la ligne 111. Cette contribution, légalisée par l'article 41 de la loi de finances pour 1990, est « calculée de façon à ce que son montant soit équivalent à celui qui résulterait de l'application de l'impôt sur les sociétés au taux normal ». Elle est payée par la CDC selon un régime d'acomptes similaire à celui existant en droit commun.
En 2003, le dividende de la CDC et la CRIS se sont inscrits en recul de 366 millions d'euros par rapport aux prévisions initiales. Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « l'ajustement à la baisse du quasi-dividende 2003 versé par la CDC est dû à des résultats moins bons qu'attendu, en particulier en raison de la dégradation non prévue, au moment où ont été élaborées les évaluations de recettes du projet de loi de finances pour 2003 (été 2002), des marchés financiers de la fin de l'année 2002 ». De même, selon les informations fournies à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la révision à la baisse de la contribution représentative de l'impôt sur les sociétés tient à la régularisation d'un trop-versé en 2002 (sur les trois premiers acomptes) qui a conduit la CDC à ne verser ni le dernier acompte en 2002, ni les deux premiers acomptes pour 2003. Le troisième acompte pour 2003 s'est, en outre, trouvé réduit en partie pour régulariser ce trop-perçu et a ainsi été limité à 14 millions euros versés au cours du mois de septembre. Selon le ministère, « il est prévu que le dernier acompte pour 2003 (qui sera versé en décembre), retrouve un niveau conforme à son niveau tendanciel (36 millions d'euros) ». Votre Rapporteur général constate que cette modulation des acomptes, déjà effectuée par la CDC en 2001 de manière à régulariser un trop-perçu au titre de ses acomptes en 2000, répond à la logique de l'impôt sur les sociétés. A l'instar des sociétés soumises à cet impôt, la CDC peut ainsi, à son initiative, moduler les acomptes qu'elle verse voire s'abstenir de tout versement, si elle considère que ses prévisions de résultats pour l'année en cours ne correspondent pas à la base d'imposition retenue, à savoir les résultats connus de l'exercice précédent (possibilité d'autolimitation des acomptes). Il faut cependant remarquer qu'en revanche, à la différence de ce qui se passe en droit commun, l'Etat n'effectue aucun remboursement à la CDC en cas de trop-perçu, la Caisse ajustant en conséquence ses acomptes suivants. Pour 2004, à l'inverse, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prévoit « une recette au titre de la CRIS de 168 millions d'euros, correspondant à un retour à la normale du calendrier et du niveau des acomptes versés par la CDC ». Mais, surtout, le dividende versé par la CDC en 2004 devrait être exceptionnellement élevé. En effet, le projet de loi de finances s'appuie sur l'hypothèse du versement en 2004 au budget de l'Etat d'un dividende exceptionnel de la part de la CDC suite à la cession au cours de l'année 2004 de ses participations dans EULIA (environ 50% du capital) et dans CDC IXIS (environ 44%). Cette opération devrait dégager des plus-values reversées intégralement, l'année même de leur constatation, au budget de l'Etat, et s'ajoutant au dividende « normal ». Il convient de remarquer que le versement effectif du dividende exceptionnel en 2004 sera conditionné, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'accord préalable de la Commission de surveillance de la CDC. Votre Rapporteur général rappelle qu'en effet, en application de l'article 41 de la loi de finances initiale pour 1990 du 30 décembre 1989 « la Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement ». 2.- Des dividendes versés par les entreprises non financières encore affectés par le ralentissement économique _ Si le produit de la ligne 116 devrait progresser de 17,57% en 2004, il n'atteindra, à 1.093 millions d'euros, qu'un niveau proche de l'estimation initiale de la loi de finances initiale pour 2003 (1.081 millions d'euros).
Comme le montre le tableau ci-dessus, la moins-value anticipée en 2003 par rapport aux prévisions initiales tient principalement à l'ajustement à la baisse des dividendes de GDF et des sociétés autoroutières. S'agissant du premier, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que « les prévisions de dividende pour 2003 au titre de l'exercice 2002 étaient fondées sur le budget 2002 de Gaz de France, qui prévoyait un résultat net part du groupe de 986 millions d'euros soit un dividende de 345 millions d'euros revenant à l'Etat pour un taux de distribution de 35% en application du contrat de groupe 2001-2003. Le profit exceptionnel, lié à l'opération de rachat du réseau de transport de gaz, correspondait à un simple bénéfice comptable permettant d'améliorer la structure financière de l'entreprise, alors que l'impact en trésorerie de l'opération était négatif pour Gaz de France (un versement de 108,7 millions d'euros étant effectué au profit de l'Etat et correspondant au solde entre le prix de cession du réseau et l'indemnité de résiliation anticipée de la concession due par l'Etat). En conséquence ce profit exceptionnel n'a pas été soumis au taux normal de distribution prévu par le contrat de groupe, mais à un taux réduit de 5,88%. Il conduit, pour une prévision de bénéfice exceptionnel d'environ 2.830 millions d'euros, à un dividende complémentaire de 166 millions d'euros. La prévision de dividende de Gaz de France inscrite en loi de finances initiale pour 2003 a donc été de 345 + 166 = 511 millions d'euros. Les moindres résultats de Gaz de France par rapport à ses prévisions budgétaires s'expliquent par le redoux climatique de la fin de l'année 2002, la hausse des amortissements à la suite de la réévaluation de la valeur des actifs de transport, et des difficultés rencontrées par certaines filiales étrangères. Ils ont conduit à une révision à la baisse du résultat net part du groupe à 838 millions d'euros, soit un dividende de 293 millions d'euros. Par ailleurs, l'ajustement du chiffrage du bénéfice exceptionnel à 2.774 millions d'euros à conduit à un dividende complémentaire de 163 millions d'euros (au lieu de 166 millions d'euros prévus en LFI). Au total le dividende prélevé sur Gaz de France s'est donc établi à 293 + 163 = 456 millions d'euros ». De même, « la révision à la baisse de la prévision de dividendes versés par les sociétés autoroutières tient essentiellement aux provisions passées dans les comptes 2002 de la SANEF. Le résultat négatif de la SANEF ne lui a pas permis de verser à l'Etat le dividende prévu en loi de finances initiale pour 2003 ». Les prévisions pour 2004 s'appuient en revanche sur la réapparition d'un dividende versé par France Télécom. En effet, l'opération publique d'échange entre le groupe et Orange, pour avoir certes dilué la part de l'Etat, devrait consolider le résultat net part du groupe dont le redressement est net au regard des résultats du premier semestre 2003. De même, le dividende versé par EDF se redresserait en 2004. Le budget 2003 d'EDF prévoit en effet un résultat consolidé de 878 millions d'euros dont 864 millions d'euros part du groupe. L'application du contrat de groupe conduit donc à une prévision de dividende de 324 millions d'euros au titre de l'exercice 2003. Interrogé par votre Rapporteur général sur l'existence d'un écart entre cette prévision et le montant inscrit en ressource anticipée sur la ligne 116, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué que « bien que le budget 2003 d'EDF prévoyait une hausse des tarifs aux non éligibles de + 4,8 % au 1er avril 2003, alors que cette hausse n'a été que de + 3% au 1er juillet 2003, les résultats semestriels présentés par EDF avec un résultat net part du groupe de 728 millions d'euros restent en ligne avec les prévisions budgétaires. L'effet de la hausse tarifaire qui améliorera le chiffre d'affaires au second semestre 2003 sera cependant compensée par les surcoûts d'exploitation liés à la canicule estimés à 300 millions d'euros ». Le dividende de GDF, quant à lui, reste celui découlant des prévisions du budget 2003 qui prévoit un résultat net part du groupe de 754 millions d'euros et donc une prévision de dividende en application du contrat de groupe (35% du résultat net) de 264 millions d'euros. Cette prévision apparaît même prudente au regard des résultats dégagés les années précédentes (résultat net part du groupe de 891 millions d'euros en 2001 et de 838 millions d'euros hors exceptionnel en 2002) et des comptes semestriels au 30 juin 2003 qui présentent un résultat net part du groupe de 816 millions d'euros du fait d'une bonne performance des filiales et d'un hiver relativement froid. _ Les rémunérations des dotations en capital accordées par l'Etat retracées sur la ligne 407 sont désormais marginales, l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) disposant que le dividende constitue désormais le mode exclusif de rémunération de l'Etat actionnaire par les établissements publics à caractère industriel et commercial. Les recettes de la ligne ne concernent plus désormais que les intérêts versés par les ports autonomes au titre de la rémunération de la dotation en capital accordée en 1988. Il convient de rappeler que les produits de la ligne 407 avaient été substantiellement réduits par les nouvelles modalités de la rémunération de l'Etat actionnaire par EDF et GDF définies en 2001. Les modalités réglementaires de rémunération d'EDF et GDF reposaient avant 2001 sur le décret n°56-493 du 14 mai 1956 modifié, qui prévoyait que les dotations en capital d'EDF et GDF donnaient lieu à l'attribution, au profit de l'Etat, d'un intérêt ainsi que d'une rémunération complémentaire fixée sur la base du résultat. Un arrêté des ministres de l'industrie, de l'économie et du budget fixait ces différents montants. Les contrats passés par l'Etat avec EDF et GDF et valables jusqu'en 2000 compris, qui ont donc servi de base pour les versements effectués en 2001 au profit de l'Etat, définissaient le taux de l'intérêt et le taux de distribution du résultat. Les nouveaux contrats de groupe signés en 2001, pour la période 2001-2003, prévoient désormais une simplification du mode de rémunération de l'Etat, déterminant, comme seul mode de rémunération, le dividende dû à l'Etat comme représentant 35% du résultat net du groupe pour GDF et 37,5% du résultat net du groupe pour EDF.
B.- UN PRODUIT DES JEUX TOUJOURS DYNAMIQUE Le produit des jeux recueilli par le budget général est réparti entre trois lignes de recettes différentes (ligne 114 pour les versements effectués par la Française des jeux, ligne 314 pour le produit des jeux dans les casinos et ligne 315 pour le Pari mutuel). Traditionnellement dynamique (croissance moyenne supérieure à 10% entre 1999 et 2002), il devrait cependant ralentir en 2003 (+ 3,93% selon l'estimation révisée, qui évalue l'ensemble des produits des jeux à 2.695 millions d'euros, mais seulement + 1,42% en tenant compte de l'affectation en loi de finances initiale pour 2003 au budget de l'Etat de la part du prélèvement sur le PMU auparavant affecté au compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau » (section B « Fonds national de développement des adductions d'eau ») à hauteur de 65 millions d'euros). En 2004, l'hypothèse de progression retenue, compte-tenu de l'affectation au budget général de la part du prélèvement PMU affectée au Fonds national de développement de la vie associative (FNDVA) dont le projet de loi de finances propose la clôture, est de 4,87%. Les jeux rapporteraient ainsi à l'Etat 2.831 millions d'euros en 2004.
(en millions d'euros) 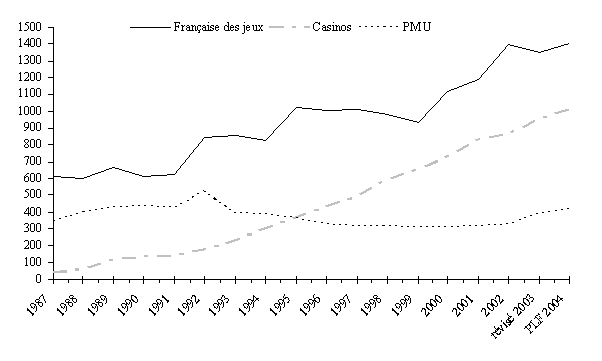 _ Le produit des jeux exploités par la Française des jeux (ligne 114) est révisé à la hausse de 77 millions d'euros pour 2003 par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale, en raison d'une reprise du dynamisme des jeux au second semestre 2002 et au premier semestre 2003, limitant la dégradation par rapport à 2002 à 3,5%. Pour 2004, il est fait l'hypothèse d'une progression de 4% de ces recettes, due pour l'essentiel à un effet volume. La ligne 114 ne retrace toutefois pas l'ensemble des prélèvements opérés par l'Etat sur la Française des jeux, détaillés dans le tableau ci-après.
· Le produit des prélèvements sur le PMU au profit du budget général est pour sa part peu dynamique en 2003. L'évaluation des prélèvements 2003 sur le pari mutuel faite dans la loi de finances initiale 2003 n'ayant pas été révisée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004, au regard des résultats en exécution enregistrés au cours des premiers mois de l'année, il n'augmenterait que de 2,4% à périmètre constant. Il convient en effet de rappeler que conformément à l'article 45 de la loi de finances initiale pour 2003, cette prévision de recettes intègre la part du prélèvement sur le pari mutuel attribuée jusqu'en 2002 au « Fonds national pour le développement des adductions d'eau » (section du compte spécial du Trésor n° 902-00 « Fonds national de l'eau ») et affectée, en 2003, au budget de l'Etat, soit une recette supplémentaire pour la ligne 315 par rapport à 2002 de l'ordre de 65 millions d'euros. Pour 2004, l'évaluation de cette recette inscrite en projet de loi de finances intègre également la part du prélèvement sur le pari mutuel qui était attribuée avant 2003 au « Fonds national pour le développement des adductions d'eau » ainsi que celle attribué au compte spécial du trésor n°902-20 (« Fonds national pour le développement de la vie associative », conséquence de la budgétisation de ces deux comptes spéciaux. Hors cet effet de périmètre, il est fait l'hypothèse d'une croissance de cette recette de 4,3%, en conséquence d'une prévision d'augmentation du chiffre d'affaires du PMU estimée à 7% en 2004. L'ensemble des prélèvements de l'Etat sur le PMU est détaillé dans le tableau suivant :
_ L'évaluation des prélèvements 2003 sur le produit des jeux dans les casinos faite en loi de finances initiale n'a pas été révisée dans le cadre du présent projet de loi de finances 2004, les résultats en exécution enregistrés au cours des premiers mois de l'année confirmant cette évaluation. Leur dynamisme en est confirmé, puisque cette recette progresse de 9,9% en 2003, après 4,3% en 2002 et 14,4% en 2001. Il est fait l'hypothèse d'un ralentissement de cette recette dont la croissance est ramenée dans le projet de loi de finances pour 2004 à 5,9%. D'une part, la croissance du secteur s'infléchit depuis le second semestre 2002 après plusieurs années de vive progression. D'autre part, la réforme de l'assiette des prélèvements opérés sur le produit brut des jeux des machines à sous mise en œuvre au cours du deuxième trimestre 2002 arrive à maturité.
C.- AUTRES ÉVOLUTIONS DE RECETTES NON FISCALES NETTES 1.- La modulation de certains prélèvements · Les prélèvements sur les fonds gérés par la Caisse des dépôts et consignations (lignes 812, 813 et 814, dont les règles relatives à la fixation de ces prélèvements sont récapitulées dans l'encadré ci-après) sont réduits, dans l'estimation révisée pour 2003, de 2.350 millions d'euros dans l'évaluation initiale à 1.550 millions d'euros. La situation dégradée des marchés financiers lors de l'établissement des prévisions à l'été 2002 conduisait à ne pas anticiper de prélèvements en 2003 sur les résultats des Fonds d'épargne directement adossés aux livrets réglementés (Fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne (FRGCE), Fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne (FRGCNE) et Fonds de réserve du livret d'épargne populaire (FRGLEP)). Dès lors, le prélèvement proposé devait s'imputer intégralement sur le stock des « intérêts compensateurs » du Fonds de réserve du financement du logement (FRFL), soit 2.350 millions d'euros inscrits en ligne 814 des recettes non fiscales. Des résultats définitifs du FRGCE meilleurs que prévu en 2002 ont permis de procéder au prélèvement de 205 millions d'euros sur ses réserves en mai 2003 (recettes de la ligne 813). Par ailleurs, le prélèvement sur les « intérêts compensateurs » du FRFL devrait se limiter à 1.345 millions d'euros en 2003 dont 845 millions d'euros déjà perçus en mai 2003. Pour 2004, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie estime qu' « il est possible d'inscrire un montant de prélèvement sur les résultats des fonds d'épargne, 1.614 millions d'euros, comparable à celui prévu en 2003 (1.550 millions d'euros). Cette somme se décomposant de la manière suivante : 264 millions d'euros de prélèvement sur le FRGCE (recette inscrite en ligne 813 des recettes non fiscales), évaluation établie à partir des hypothèses du projet de loi de finances pour 2004, un scénario prudent d'évolution des marchés financiers et en tenant compte de la baisse du taux du livret A au 1er août ; et 1.350 millions d'euros de prélèvement sur le stock résiduel d'intérêts compensateurs du FRFL (recette inscrite en ligne 814 des recettes non fiscales ». Interrogé par votre Rapporteur général sur l'incidence de la modification des taux réglementés en 2003 (abaissement du taux de livret A de 3% à 2,25% au 1er août 2003 et maintien du taux du livret d'épargne populaire à 4,25% jusqu'au 1er août 2004, puis, à terme, évolution du taux du livret A égale à la moyenne entre l'inflation et les taux d'intérêt à court terme, augmentée de 0,25 point afin de garantir une rémunération de l'épargne supérieure à l'inflation), le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a apporté les éléments d'information suivants : « Il est prévu que la baisse du taux du livret A mise en œuvre le 1er août 2003 sécurise le résultat du FRGCE et du FRGCNE (lignes 813 et 815) cette année, en rétablissant un différentiel de taux favorable entre le coût de la ressource (taux du livret + taux de commissionnement des réseaux de collecte) et les taux d'intérêt des obligations à long terme. Les calculs réalisés au moment de l'évaluation des recettes pour 2004, laissaient supposer une amélioration des résultats 2003 de 380 millions d'euros à répartir pour 60%, soit 230 millions d'euros, sur le FRGCE (ligne 813) et 40%, soit 150 millions d'euros, sur le FRGCNE (ligne 815). La baisse des taux réglementés du 1er août 2003 n'a pas d'impact sur le résultat prévisionnel du FRLEP pour 2003 (prélevable en 2004 - ligne 814), le taux du LEP n'étant pas affecté par cette baisse. Elle n'en a pas non plus sur le prélèvement du FRFL, uniquement constitué de fonds propres (ligne 814). »
Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. · En outre, le niveau bas des taux d'intérêt constaté depuis la fin 2002 permet d'envisager en 2004 : - une majoration de 200 millions d'euros (portant le reversement en ligne 807 à 400 millions d'euros) du prélèvement sur l'excédent de trésorerie du compte de la procédure de garantie de taux d'intérêt géré par NATEXIS-Banques populaires, compte dont le solde s'élevait au 6 octobre 2003 à 815 millions d'euros ; - une majoration de 710 millions d'euros du prélèvement sur l'excédent de trésorerie du compte de l'Etat à la COFACE dont le solde au 26 septembre 2003 était de 2.046 millions d'euros, portant la recette de la ligne 812 « reversements de la COFACE » à 1.400 millions d'euros. Votre Rapporteur général relève, outre le niveau élevé des excédents du compte de l'Etat auprès des deux organismes, que les deux prélèvements en 2004 (400 et 1.400 millions d'euros) restent dans l'ensemble inférieurs aux prélèvements pratiqués en 2002 (respectivement 335 et 1.829 millions d'euros). · En revanche, plusieurs prélèvements sont interrompus, dont la contribution des associés collecteurs de l'UESL (ligne 324) dont les recouvrements en 2002 (427 millions d'euros) et en 2003 (250 millions d'euros), définis, respectivement, au II de l'article 26 de la loi de finances initiale pour 2002 et à l'article 38 de la loi de finances initiale pour 2003, étaient motivés par les délais nécessaires à la montée en puissance de la politique de renouvellement urbain que prennent en charge les contributions du « 1% logement » collectées par les organismes adhérents à l'UESL. 2.- Les recettes diverses, accidentelles et d'ordre · Les recettes accidentelles à divers titres (ligne 805) retrouveraient en 2004 leur niveau tendanciel à 500 millions d'euros. Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : « La révision à la hausse de l'évaluation 2003 (+103,4 millions d'euros) s'explique par une hausse des recouvrements : - sur des créances garanties par l'Etat (+42 millions d'euros). Cette recette nouvelle est issue, pour l'essentiel, de procédures d'aides au développement, et s'ajoute à la recette de 270 millions d'euros inscrite en loi de finances initiale, liée au refinancement de la République Démocratique du Congo et découlant des dispositions de l'article 126 de la loi de finances initiale pour 2003. Il est également prévu une recette de l'ordre de 60 millions d'euros en 2004 à ce titre, à laquelle s'ajoutent 10 millions d'euros de recettes liées au recouvrement de diverses créances ; - sur frais de poursuite (+16 millions d'euros), les recettes enregistrées à ce titre atteignant déjà 74 millions d'euros à la fin septembre 2003, niveau correspondant à celui prévu en année pleine en loi de finances initiale 2003. Il est fait l'hypothèse du maintien de cette recette à son niveau 2003 en 2004 ; - une révision à la hausse de (+34 millions d'euros) de l'évaluation des recettes perçues au titre de la validation de services extérieurs (part patronale de cotisations retraite : reversement de l'Ircantec et de divers régimes d'assurance vieillesse), l'évaluation des recettes de ce type inscrites en loi de finances initiale étant clairement sous-évaluée par rapport aux résultats obtenus en exécution en 2001 et en 2002. Il est fait l'hypothèse du maintien de cette recette à son niveau 2003 en 2004 ; A l'inverse, les dernières informations disponibles semblent indiquer que le versement que doit effectuer le Crédit Mutuel au budget de l'Etat (3), conformément d'une décision de la Commission européenne, sera inférieur à ce qui a été inscrit en loi de finances initiale d'environ -19 millions d'euros. Ce versement n'a pas d'équivalent en 2004. Enfin, les autres recettes de cette ligne apparaissent, au vu des résultats enregistrés au cours du premier semestre, devoir être supérieures à ce qui était prévu en loi de finances initiale d'environ +30 millions d'euros. Il est fait l'hypothèse d'une progression de ces recettes de +4% environ en 2004 ».
_ Les recettes diverses (ligne 899), révisées à la baisse pour 2003 de 1.178 millions d'euros en raison principalement du report du versement de 1.219,6 millions d'euros de l'UNEDIC au budget de l'Etat, défini par l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, prévu initialement en 2002 et reporté, une première fois en 2003, par l'article 40 de la loi de finances initiale pour 2003, devraient s'établir en 2004 à 1.200 millions d'euros. Elles seraient pour moitié en conséquence des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances : - 328 millions d'euros correspondraient à l'affectation au budget de l'Etat des réserves du FOREC après sa liquidation, selon l'article 18 du projet de loi ; - 300 millions d'euros seraient prélevés, en raison du niveau élevé des réserves, sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires dommages (FGAO), en application de l'article 16 du projet de loi ; - et enfin 30 millions d'euros seraient prélevés sur les réserves des comités professionnels de développement économique, en application de l'article 17 du présent projet de loi de finances, au regard de l'abondance des réserves de trésorerie accumulées par les organismes grâce au bénéfice de taxes parafiscales manifestement mal calibrées. Le tableau ci-après permet de retracer les évolutions des recettes diverses depuis 1997. DÉCOMPOSITION DES RECETTES NON FISCALES DIVERSES (LIGNE 899) (en millions d'euros)
(a) Excédent du compte du produit de la redevance sur les débits de tabac. (b) Versements retracés en ligne 814 des recettes non fiscales à partir de 2001. Source : Ministère des finances, de l'économie et de l'industrie. · En dernier lieu, les recettes en atténuation de la charge de la dette inscrites sur la ligne 806 s'établiraient à 2.404 millions d'euros, soit une diminution de 3% par rapport au montant révisé pour 2003.
Il faut souligner que l'évaluation initiale n'est qu'approximative, le rendement de cette catégorie de recettes étant très volatil. En effet, il dépend des modalités de gestion de ses liquidités par le Trésor (dépôt sur le compte tenu par la Banque de France, prise en pension de titres, dépôt sur le marché interbancaire de la zone euro ou auprès d'Etats membres de la zone euro) et du niveau des recettes de coupons courus encaissées lors de l'émission des titres d'emprunt de l'Etat. Le placement des fonds du Trésor permet, au prix d'une immobilisation temporaire des liquidités, d'obtenir sur celles-ci une rémunération supérieure à celle procurée par le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Les recettes de coupons courus représentent les intérêts versés par les acquéreurs de titres d'Etat, courant de la date de souscription à la prochaine échéance du titre. L'évaluation ex ante des recettes de coupons courus dépend de nombreux paramètres (niveau des taux d'intérêt, choix des lignes qui constituent les émissions, choix des dates d'adjudication et des dates d'échéance, etc.). 3.- De nouvelles recettes Votre Rapporteur général tient à souligner le progrès considérable que constitue l'apparition d'une nouvelle ligne de recette, 211, qui bénéficiera du produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat (évalué à 500 millions d'euros pour 2004), et de l'annonce corrélative par le Premier ministre, le 23 septembre 2003, de la création d'une agence interministérielle dédiée à la modernisation de la politique immobilière de l'Etat, qui pilotera la réalisation du programme lancé par le Gouvernement tendant à mettre en vente sur la durée de la législature un million de mètres carrés d'immeubles de bureaux banalisés. Votre Rapporteur général rappelle qu'aujourd'hui, les bureaux domaniaux sont gratuits pour les administrations qui les occupent. Cette gratuité apparente engendre des effets pervers : elle n'incite pas les administrations à utiliser au mieux les surfaces occupées, par la réduction des surfaces mobilisées ou par le regroupement sur un même site des services d'une même administration. Deux exemples concernant le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont illustratifs : les ratios d'occupation (surface utile totale par agent) sont en moyenne le double du secteur privé (30 mètres carrés contre 15), et dans plus de 33 villes françaises, le nombre d'implantations du ministère est supérieur à 20. En outre, la gestion du parc immobilier de l'Etat mobilise plus de deux milliards d'euros de crédits budgétaires au titre de ses dépenses immobilières (hors investissements). L'entretien du patrimoine repose en effet aujourd'hui trop largement sur une approche curative et ponctuelle, ce qui conduit à un sous-entretien et à des surcoûts entre 40 et 100 % par rapport à des actions préventives. De façon plus générale, les fonctions d'exploitation, de maintenance ou d'entretien pourraient être optimisées, découvrant des gisements d'économie considérables. L'objectif de rationalisation de la gestion du parc immobilier est donc un objectif fondamental dans la maîtrise des dépenses. Dans cet état d'esprit, votre Rapporteur général a demandé des précisions sur les hypothèses qui sous-tendent la prévision de recettes pour 2004. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a, en réponse, apporté les éléments d'information suivant : « La cession de biens est l'une des modalités d'une politique globale de modernisation de la politique immobilière et de valorisation du patrimoine de l'Etat qui comportera dès 2004 des progrès importants, dans deux directions : - l'amélioration du système d'information patrimonial, dans le cadre des travaux de mise en œuvre de la LOLF : l'inventaire que constitue le TGPE sera enrichi au cours de l'année 2004 notamment d'informations relatives à la valeur des biens afin de pouvoir établir d'ici le 1er janvier 2006 un bilan patrimonial de l'Etat ; - l'assouplissement du cadre juridique applicable au domaine : les dispositions législatives nécessaires à une gestion plus fluide du parc domanial public seront finalisées d'ici la fin de l'année 2003 pour être, le cas échéant, incorporées dans les ordonnances prises dans le cadre de la loi Plagnol d'habilitation en matière de simplification administrative. Au total, la politique ainsi mise en œuvre permettra de mettre en vente un million de mètres carrés de bureaux banalisés sur la durée de la législature, sur un parc domanial de 12 millions de mètres carrés d'immeubles de bureaux détenus par l'Etat et recensés au TGPE. Une première tranche sera placée sur le marché au second semestre 2004, pour un montant prévisionnel de 500 millions d'euros, et selon des modalités qui seront arrêtées avant la fin de l'année sur le fondement d'un rapport qui a été demandé à M. Olivier Debains. » IV.- DES PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES EN TRANSITION Le projet de loi de finances pour 2004 propose un important aménagement du périmètre des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, induisant une hausse « optique » de leur montant de 16,7% par rapport à l'évaluation révisée pour 2003, et portant leur part dans les ressources nettes du budget général à 21,1%. A périmètre constant, ces prélèvements apparaissent à l'inverse d'une grande stabilité, ne progressant que de 1,3% par rapport à 2003, la stagnation du prélèvement au profit de l'Union européenne étant compensée par une augmentation modérée des prélèvements au profit des collectivités locales. Il semble à cet égard qu'un palier nouveau soit atteint à 19% des recettes nettes du budget général avant prélèvement en 2003 comme en 2004 à périmètre constant. Les deux principaux moteurs de la hausse tendancielle à partir de 1999, année durant laquelle cette part s'établissait, depuis 1996, à environ 16% sont désormais éteints, puisque leur application pleinement effective. Il s'agit : - d'une part, de la réforme du financement du budget communautaire (décision sur les ressources propres 2000/597/CE du Conseil du 29 septembre 2000, ayant pour effet d'accroître la contribution française de 3% par rapport à l'ancien système de financement), - et d'autre part, la suppression progressive de la part salariale de la taxe professionnelle (dont la compensation en prélèvement sur recettes a augmenté au rythme de 15% par an).
1.- La stabilité trompeuse du prélèvement au profit des Communautés européennes
Le projet de loi de finances pour 2004 évalue à 16.400 millions d'euros le prélèvement sur recettes au profit des Communautés européennes, soit 1,02% du revenu national brut et un montant identique à l'évaluation révisée pour 2003. Cependant, cette stabilité est trompeuse à deux égards. D'une part, le montant anticipé pour 2003 a été corrigé de 3,8% à la hausse par rapport aux estimations de la loi de finances initiale, en raison, principalement, d'une anticipation de solde excédentaire en 2002 plus faible (6,4 milliards d'euros dans le présent projet de loi contre 8 milliards d'euros un an plus tôt, ce qui traduit une meilleure exécution du budget communautaire dont il y a tout lieu de se féliciter), mais aussi de l'atonie de la croissance en Europe qui réduit le montant des ressources propres de l'Union (assises, comme la TVA et les droits de douane, sur la consommation) et se traduit donc par un accroissement de l'appel à la ressource PNB, au détriment des pays les plus importants comme la France. D'autre part, 2004 est marqué par l'élargissement, puisqu'au 1er mai dix nouveaux Etats membres rejoindront l'Union européenne. Il est vrai qu'en 2004, une indéniable discipline budgétaire (les crédits pour les 15 actuels Etats membres devraient stagner (+ 0,7%) s'agissant des engagements et même diminuer (- 2,0%) s'agissant des paiements) permet de modérer le coût de l'élargissement, les crédits de paiement du projet de budget communautaire, qui déterminent le niveau des contributions nationales, ne progressant à 25 que de 2,6%. Cependant, votre Rapporteur général rappelle que l'élargissement exercera à terme un impact important sur les dépenses européennes et, partant, sur le prélèvement sur recette que la France consent au profit de l'Union. En effet, dès 2004, les crédits d'engagement augmentent de 12,6%, soit du montant des programmes engagés dans les nouveaux Etats membres (2.088 millions d'euros au titre de l'extension des aides agricoles, 6.709 pour les fonds structurels, 1.633 millions d'euros liés aux politiques internes et 1.410 millions d'euros de diverses compensations budgétaires spécifiques). A terme, conformément aux conclusions du Conseil européen de Copenhague en décembre 2002, 45 milliards d'euros (en prix 2004) seront consacrés aux nouveaux adhérents sur la période 2004-2006, soit la moitié du budget communautaire actuel. Ces chiffres montrent bien l'ampleur des pressions auxquelles seront soumises les finances publiques européennes, et la force des tensions susceptibles d'apparaître à l'occasion de l'adoption du nouveau cadre financier des Communautés à l'horizon 2007. Des éléments plus détaillés sur cette estimation, ainsi qu'une analyse du projet de budget communautaire figure dans le commentaire de l'article 41 du présent projet (4). 2.- Le prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales, témoin d'une première étape de la simplification des concours de l'Etat
a) Une profonde modification du périmètre des prélèvements sur recettes Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales sont affectés par des substantielles modifications de périmètre dont l'incidence totale est évaluée à 8.123 millions d'euros. Leur objet est de simplifier l'analyse des flux entre l'Etat et les collectivités locales, par le regroupement de diverses dotations qui échappent, par leur indexation automatique, aux logiques d'évaluation qu'introduit la nouvelle loi organique relative aux lois de finances, et qui doivent être préservées, par nature et en raison de l'objectif constitutionnel de préservation de la péréquation entre les collectivités, des aléas de la régulation budgétaire. · Le principal changement de périmètre résulte de l'intégration de diverses dotations dans la dotation globale de fonctionnement (ligne 1), dont l'effet est de majorer son montant, hors mesures nouvelles, de 17.510 millions d'euros, dont principalement : - 9.014 millions d'euros liés à l'intégration de l'allocation de compensation de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle ; - 318 millions d'euros à l'intégration de la compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) subies par certaines communes en raison de l'application du mécanisme de l'enveloppe normée, versée jusqu'alors par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Il convient de remarquer que ces mouvements sont neutres sur le montant global des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales, dans la mesure où ils traduisent des transferts internes, avec pour contrepartie respectivement une minoration d'un même montant de ligne 10 « Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle » (- 9.014 millions d'euros) et de la ligne 4 « Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle » (- 318 millions d'euros). En outre, diverses dotations auparavant financées par des dépenses du budget général sont intégrées dans la DGF : - la dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales, pour 1.894 millions d'euros, jusqu'alors financée par le chapitre 41-55 du budget de l'Intérieur ; - 95% du montant de la dotation générale de décentralisation (DGD), pour 5.856 millions d'euros, jusqu'alors inscrites en crédits du chapitre 41-56 du même budget. Enfin, l'intégration des dotations de péréquation du fonds national de péréquation dans la DGF (+ 432 millions d'euros pour la ligne 1, hors majoration et hors prélèvement destiné à compenser les exonérations de TP dans les zones de revitalisations rurale) est compensée par la budgétisation des fonds (avec notamment la suppression corrélative de 108 millions d'euros de crédits sur le chapitre 41-23 « Aides de l'Etat en faveur des collectivités locales » du budget des Charges communes, et la budgétisation du FNPTP dont le solde finançait la FNP (avec notamment l'inscription dans les recettes non fiscales de l'Etat, pour 278 millions d'euros, de la part de la CNP affectée au FNPTP). · D'autres lignes de prélèvements sur recettes font l'objet de mesures de périmètre. Comme il a été dit, la ligne 10, compensation de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle, est minorée de 9.014 millions d'euros intégrés à la DGF, ne conservant que la part de la compensation revenant aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) pour 157 millions d'euros. En outre, la budgétisation du FNPTP évoquée plus haut réduit de 434 millions d'euros le montant du prélèvement de la ligne 4 prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, au transfert de la DCTP dans la DGF s'ajoutant la budgétisation de la dotation de développement rurale (DDR) financée par l'ouverture de 116 millions d'euros d'autorisations de programme et de crédits de paiement sur le chapitre 67--2 « dotation globale d'équipement et de dotation de développement rural » du budget de l'Intérieur. Enfin, la compensation des exonérations liées aux extensions d'activité dans les zones de revitalisation rurale, prise en charge jusqu'alors par le FNPTP (11 millions d'euros), l'aide financière de l'Etat aux communes fusionnées et la compensation de diverses pertes de recettes (auparavant financés par le chapitre 41-51 « subventions de caractère obligatoire en faveur des collectivités locales » du budget des Charges communes pour 103 millions d'euros) induit un relèvement de 114 millions d'euros de la ligne 7 prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. b) Une évolution modérée à périmètre constant entre 2003 et 2004 Hors mesures de périmètre, le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales progresse de 1,77% pour atteindre 37.038 millions d'euros. Cependant, le ralentissement constaté par rapport aux taux de croissance en 2002 (+9,8%) et en 2001 (+ 9,9%) n'est qu'apparent. En effet, la mise en œuvre progressive de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle était la source principale du dynamisme constaté du prélèvement, avec des taux de croissance atteignant notamment 15% par an entre 1999 et 2002 en ce qui concerne le prélèvement consacré à la compensation pour les collectivités de cette réforme. Hors ce phénomène exceptionnel, le taux moyen de progression s'établit depuis quatre ans à 1,45% par an. La croissance du prélèvement sur recettes en 2004 est principalement due : _ à la progression de la DGF calculée, conformément aux dispositions de l'article L. 1613-1 du code général des impôts, par l'application d'un taux de 1,75% égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabacs pour 2004 et à la moitié du taux d'évolution en volume du PIB pour 2003 au montant de la DGF révisé en 2003 ; _ à un abondement de 51 millions d'euros des dotations de péréquation communale pour préserver la stabilité des dotations de péréquation. Votre Rapporteur général rappelle qu'en outre, au regard de l'effort consenti par l'Etat pour l'équipement de nouveaux appareils de contrôle automatique de la vitesse (radars), l'article 9 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a disposé que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçu par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction sera versé, de 2004 à 2006, au profit du budget général de l'Etat ». On peut rappeler que l'article L. 2334-24 du code des collectivités territoriales dispose que le produit des amendes de police relatives à la circulation routière fait l'objet d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat (ligne 002). Seul le produit des amendes forfaitaires de la circulation payées spontanément (ligne budgétaire 312) est reversé aux collectivités locales. La différence de traitement entre les amendes forfaitaires, donnant lieu à répartition au profit des collectivités locales, et les amendes forfaitaires majorées (dont le produit est un des éléments des recettes inscrites en ligne 313 des recettes non fiscales), qui ne font pas l'objet d'un reversement aux collectivités locales, s'appuie sur les dispositions du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale. Celui-ci précise que l'amende forfaitaire majorée est recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par l'officier du ministère public (contrairement aux amendes forfaitaires qui ne font pas l'objet d'un titre exécutoire). Dès lors, en application de l'article 9 précité, l'essentiel de la progression de la ligne 312 en 2004 (80 millions d'euros sur une hausse de 100 millions d'euros, soit + 24%) sera conservée par le budget général de l'Etat, la progression de la contrepartie en prélèvement au profit des collectivités locales du produit des amendes forfaitaires de la circulation (cf. ligne 0002 des prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales) étant limitée à 50 millions d'euros. ___________________ N°1110 - Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2004 (tome I) (M. Gilles Carrez 1 () Créée en 1982 à titre temporaire puis pérennisée en 1985, la CIF prend la forme d'un prélèvement sur certains frais généraux (charges de personnel ; travaux, fournitures et services extérieurs ; frais de transport et déplacement ; frais divers de gestion, dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement) des organismes de crédit (banques et établissements de crédit) et des entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance. Le montant de la contribution est égal à 1 % de cette assiette après abattement de 3.000 euros jusqu'en 2002. Elle n'est pas déductible du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. La loi sur l'épargne (votée en 1999) a institué un crédit d'impôt imputable sur la CIF. Celui-ci s'applique aux institutions financières qui cotisent à l'un des quatre fonds créés pour garantir respectivement, les déposants, les assurés, les investisseurs et les cautions. Il est égal à 25% des charges effectivement constatées au profit du fonds de garantie dont les institutions financières sont adhérentes. Si le montant du crédit d'impôt excède la contribution due, l'excédent n'est pas restituable mais peut être imputé sur la contribution due au cours des trois années suivantes. 2 () Voir A ci-dessus. 3 (1) Il s'agit du règlement d'un contentieux de plus de 10 ans né des plaintes de l'association française des banques, du Crédit agricole, et du groupe des banques populaires pour distorsion de concurrence liée au monopole du livret bleu géré par la crédit Mutuel. La Commission européenne a décidé en début d'année pour règlement de ce litige, et après mise en conformité des relations financières entre l'Etat et le Crédit Mutuel, que celui-ci rembourse à l'Etat la partie jugée indue de la commission qui lui a été versée de 1991 à 1998 pour la collecte du livret bleu. 4 () Voir le tome II du présent rapport. © Assemblée nationale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||